INTRODUCTION
0. PROBLEMATIQUE
Depuis les années 80, la République
Démocratique du Congo a vécu de multiples turbulences qui ont
fortement affecté la vie économique et sociale du pays.
L'endettement, les pillages, les guerres civiles, les troubles
sociales qu'a connu les pays, n'ont épargné ni les
activités de l'Etat, ni celles des privées, toutes ont
été secouées. Les tissus économiques se
dégradés, ont favorisé la détérioration du
niveau de vie de la population, L'instabilité du cadre
macroéconomique, et ont réduit les capacités productives
et le financement des privés comme de l'Etat. Les politiques
monétaires et budgétaires restrictives, adoptées par
l'état pour assainir le cadre macroéconomique ne sont pas
resté sans conséquences. Les secteurs à caractères
social, dont l'éducation fait parti, ont été fortement
touchés. Les dépenses publiques d'éducation sont
restées inférieurs à 2% en moyenne affectant ainsi la
qualité de l'enseignement et le niveau de vie de personne enseignant.
Cependant, il parait, de plus en plus, évident que le
niveau atteint par les individus qui composent une économie constitue un
déterminant majeur de son succès sur l'échiquier
économique mondial et, partant, du niveau de vie de ses citoyens. Les
nations développées cherchent désormais à s'imposer
comme des « réservoirs » de main d'oeuvre hautement
qualifiée, exploitant ainsi leurs avantages concurrences face à
la main d'oeuvre abondante, bon marché et généralement peu
instruite des pays en voie de développement.
Nous savons maintenant que l'accumulation de capital humain
contribue au même titre que l'accumulation de capital physique à
la croissance économique à long terme. Dans un tel contexte, il
n'est pas surprenant que l'éducation et la formation occupent une place
prépondérante dans l'élaboration des politiques
économiques et à la fois micro-économiques et
macro-économiques1
Mais l'éducation est un thème vaste et complexe
qui, touchant tous les domaines de la vie et ayant pour champ d'application
l'homme, nécessite de plus en plus que l'on lui accorde une attention
particulière.
En effet, l'action de l'éducation ne s'exerce que sur
l'homme qui constitue son unique champ d'application, et consiste en la
transformation de cette personne humaine en lui dotant de connaissances utiles
et appropriées qui forgent ses capacités, ses aptitudes, ses
compétences et le rend plus productif.
C'est ainsi que nous tenterons de répondre dans notre
travail aux questions ci-après : Question1/ Les dépenses
publiques en éducation influencent-elles la croissance économique
en RDC ? Question2/ Quelle est la nature de la corrélation qui
existe entre les dépenses publiques en éducation et la croissance
économique en RDC ?
1. HYPOTHESES
Dans ce travail, nous nous situons dans l'hypothèse
selon laquelle, l'impact des dépenses publiques en éducation dans
le cadre de la croissance économique, auxquelles la RDC veut atteindre
dans les prochains jours ; nous voulons voir si et seulement si les
dépenses publiques en éducation n'auront pas des effets positifs
ou négatifs ou soit la combinaison de ces deux questions. C'est ainsi
que nous répondons à nos hypothèses de la manière
suivante :
H1. Les dépenses publiques en
éducation n'influencent pas la croissance économique en RDC
à cause de leur faible part dans le budget de l'Etat ;
H2. La nature de la corrélation qui existe
entre les dépenses publiques en éducation et la croissance
économique en RDC serait positive car les deux variables évoluent
dans le même sens.
2. Etat de la Question
La problématique sur la contribution de
l'éducation dans l'activité économique fait l'objet des
nombreuses études. Cette question de recherche a pris de l'ampleur au
20ème siècle, lorsqu'au début des années
60, les économistes anglo-saxons en général et
américains en particulier ont introduit la dimension qualitative du
facteur travail grâce à l'éducation et à la
formation. C'est à partir des travaux de ces économistes que l'on
a déterminé le rôle de l'éducation dans le
développement socio-économique en général et
à la croissance économique en particulier.
De nombreux auteurs ont analysé, tant sur le plan
théorique qu'empirique, les liens qui existent entre les dépenses
publiques, l'éducation et la croissance économique.
THEODORE SCHULTZ a analysé l'évolution aux USA
durant la période 1900-1957 du stock de l'éducation de la
population d'une part et de stock du capital physique d'autre part, par
l'approche de relation entre les dépenses en éducation et la
formation du capital physique. Il parvint à la conclusion qu'au cours de
cette période les USA ont plus investi dans la formation du capital
humain que dans la formation du capital physique c'est-à-dire les
investissements matériels.
EDWARD DENISON, cherchant à déterminer les
sources de la croissance économique aux USA, à mené une
étude couvrant la période 1929-1957 en utilisant l'approche
résiduelle qui consiste à expliquer le taux de croissance de PNB
non expliqué par les variations des facteurs travail et capital. Il est
arrivé à la conclusion selon laquelle l'éducation a
contribué à la croissance du revenu national quatre fois plus que
le facteur capital physique.
FREDERIC HARISON ET CHARLES MAYEURS ont appliqué dans
leur étude l'approche de corrélation internationale entre le taux
de scolarisation de la population et le PNB sur un échantillon de 75
pays et ont conclus qu'il existe une corrélation très positive
entre la scolarisation de la population et le PNB.
FOUEKA TAGNERS en 2009, a étudié la croissance
des dépenses publiques et son incidence sur le développement au
Cameroun. Les résultats empiriques indiquent à partir d'un
modèle de déséquilibre où les aspects d'offre et de
demande de dépenses publiques sont pris en compte simultanément,
que le niveau de vie appréhendée à partir du revenu
réel, est le principal facteur qui explique la demande. Du coté
de l'offre ce sont les facteurs tels que le montant des taxes et des
impôts qui ont une influence significative mais une observation faite
dans le secteur de l'éducation permet de constater que ces
dépenses sont inégalement réparties selon la zone
géographique.
RIADH BEN JILILI (2000) a analysé en 2007 les
dépenses publiques, corruption et la croissance économique dans
les pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) par
une analyse de la causalité au sens de granger. Il ressort de
résultats de cette analyse que les dépenses publiques et
croissance économique s'influencent mutuellement.
WAUTABOUNA OUATTARA a analysé les dépenses
publiques et la croissance économique dans une étude
économétrique en Cote d'ivoire. Cette étude a
apporté la confirmation de la contribution productive des
dépenses d'investissement public en infrastructures et en capital humain
à la croissance du PIB.
THOMAS JOUBERT a étudié les dépenses
publiques d'éducation, les dépenses militaires et la croissance
en Turquie. Se basant sur une analyse empirique, il en est
résulté une causalité positive des dépenses
d'éducation vers le PIB et une causalité négative des
dépenses militaires.
BILETIKA A. a étudié l'efficacité des
dépenses publiques en capital humain sur la croissance économique
en RDC. Il résulte de cette étude que les dépenses
publiques d'investissement en capital humain ont un effet positif mais non
significatif sur la croissance économique en RDC.
NYAMUHIRYE NZIGIRE R. a étudié les
dépenses publiques et la croissance en RDC de 1976 à 2008 par
l'estimation de l'approche autorégressive (VAR). Il résulte de
cette étude que les dépenses publiques sont négativement
liées à la croissance économique. La présente
étude considère les dépenses publiques en éducation
et analyse son impact sur la croissance économique en RDC.
3. OBJECTIF DE LA
RECHERCHE
Dans ce travail, l'objectif est de 3 ordres à
savoir : l'objectif général, l'objectif social et enfin
l'objectif économique.
0.1. Objectif
Général : Il est question de faire une Analyse
empirique, tout en essayant de voir l'impact Dépenses publiques en
éducation sur la Croissance économique de la RDC.
Par rapport à l'impact nous vaudrions juste mesurer la
corrélation positive ou négative des dépenses publiques
allouées dans le secteur éducatif enfin d'évaluer leur
répercutions sur la croissance économique.
Dans le cas où ces dépenses publiques nous
conduisent à un résultat positif par rapport au taux de
croissance cela implique que le développement peut être
envisageable.
Dans le cas contraire, il y a nécessité
d'évaluer l'allocation de ces dépenses publiques enfin qu'il ait
équilibre avec le taux de croissance économique.
0.2. Objectif
social : A ce stade, il est d'abord question
d'améliorer la qualité de la formation, d'assainir
l'environnement social éducatif, et enfin de se procurer des
infrastructures éducatives de base étant donné qu'une
partie des dépenses publiques est allouée à ce secteur.
0.3. Objectif
Economique : l'objectif économique de ce
présent travail est de faire des analyses du cadre
macro-économique pour voir la part des dépenses publiques
allouées dans le secteur éducatif enfin d'envisager une
croissance auto-entretenue et une croissance économique.
4. INTERET ET CHOIX DE LA
RECHERCHE
0.4.
Intérêt de la Recherche
L'intérêt porté à ce sujet
s'explique par l'importance de l'éducation dans le développement
des peuples d'autant plus qu'il est admis sur base des faits que la croissance
économique que certains pays connaissent, repose sur l'économie
du savoir. Et cette éducation nécessitant des coûts
énormes que certaines couches de la population de la RDC ne peuvent
supporter, d'où, l'intervention indispensable de l'Etat
particulièrement dans ce secteur par les dépenses publiques enfin
d'envisager son développement de et de stimuler la croissance
économique et de permettre l'accès de tous à
l'éducation.
0.5. Choix de la Recherche
Le choix de ce sujet s'avère d'une grande importance,
du fait que le système éducatif congolais ne prend pas de l'essor
étant donné qu'il y a une faible part des dépenses
publiques allouées à ce secteur alors que, l'éducation
sous d'autre cieux est l'un des facteurs déterminant le
développement des pays. Outre cela, la RDC connait encore de graves
problèmes dans son système éducatif entre autre : les
salaires des personnels enseignants, des infrastructures scolaires et la
qualité de la formation et bien tant d'autres que le Gouvernement doit
résoudre dans les jours avenirs.
5. METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
Au sens général du terme, la méthode est
l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrent et les vérifient1(*).
L'élaboration de notre travail va nécessiter
l'utilisation des méthodes ci-après :
Ø La
Méthode Déductive : qui consiste à
partir des faits généraux et des théories
déjà élaborées, se rapportant à notre sujet
pour aboutir aux faits particuliers de la RDC.
Ø La
Méthode Analytique : qui nous a permis
d'analyser l'importance des dépenses publiques en éducation sur
la croissance économique de la RDC.
Quant aux techniques, nous allons utiliser les techniques
ci-après :
Ø La technique
Documentaire : qui a permis de recourir aux ouvrages,
articles, documents officiels et autres écrits qui sont en rapport avec
notre sujet.
Ø La technique
Quantitative : qui nous a permis de démontrer par des
Analyses économétriques la corrélation qui existe entre
les dépenses publiques en éducation et la croissance
économique en RDC.
Elles ont porté sur l'estimation d'un modèle
avec capital humain dans lequel nous considérons les variables taux de
scolarisation primaire, secondaire et dépenses publiques en
éducation pour établir la relation avec la croissance
économique.
Nous utilisons à cet effet, le modèle vectoriel
autorégressif (VAR) et le logiciel E-Views pour l'estimation.
6. DELIMITATION
SPATIO-TEMPORELLE
La délimitation spatiale consiste à baser nos
recherches sur les frontières de la RDC, quant à la
délimitation temporelle, nos recherches seront basées sur la
période allant de 1980 à 2012.
7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Ce travail comprend trois chapitres, hormis l'introduction et
la conclusion générale. Le premier est consacré aux
généralités conceptuelles sur les dépenses
publiques, l'éducation et la croissance économique. Le
deuxième est consacré à la présentation du
système éducatif de la RDC et analyse l'évolution de
l'économie de la RDC. Enfin et le dernier chapitre analyse empiriquement
l'influence des dépenses publiques en éducation sur la croissance
économique en RD Congo.
Cette ossature du travail prend en considération les
différents mots clés de notre étude à savoir :
les dépenses publiques, l'éducation, la croissance
économique et le modèle VAR.
CHAPITRE PREMIER
GENERALITE CONCEPTUELLE SUR
LES DEPENSES PUBLIQUES, L'EDUCATION, ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE
Ce chapitre se veut introductif. Son objectif est de clarifier
les différents concepts utilisés dans cette étude de
manière à permettre aux lecteurs d'avoir le même
entendement que nous.
Ainsi, ce chapitre est subdivisé en trois
sections : la première présente : Les
Généralités Conceptuelles sur les
Dépenses Publiques, la deuxième traite : Les
Généralités Conceptuelles sur l'Education, et enfin
la dernière traite : sur La Croissance Economique.
Section 1 : Les
Généralités Conceptuelles sur les Dépenses
Publiques
La dépense publique est, avec la fiscalité, l'un
des principaux instruments de l'action financière de l'Etat. Elle est
aussi sujet de controverses multiples. Le libéralisme tend à
considérer que tout accroissement de la consommation publique se fait au
détriment de la consommation privée ; le réflexe
libéral est fondé sur une présomption de
méfiance : tout ce qui est collectif est un poids mort ; la
dépense publique est pour ainsi dire par nature, improductive, à
l'exception limitée des dépenses dites Régaliennes.
La consommation de l'Etat équivaut à une
destruction réelle ou potentielle de richesses. A cette conception
s'oppose la conception inverse : l'idée que la dépense
publique est, par nature, plus conforme à l'intérêt
général que ne l'est l'emploi des mêmes ressources
lorsqu'il est librement décidé par les personnes privées
où l'entreprise ; la dépense publique dans cette optique
à une double fonction, sociale et économique : elle permet
d'assurer une certaine forme de solidarité sociale et elle joue le
rôle de stabilisateur économique. Dans l'optique
Keynésienne comme l'écrivain M. BOUVIER, M.C. ESCLASSAN & J.P
LASSALE, à propos de cette transformation : « les
finances publiques contemporaines nées des crises, des guerres et de
l'Evolution de la demande sociale elles - même, sont
caractérisées par un changement de dimension qui a
transformé leurs rapports avec l'économie
générale »2(*)
L'Etat, ou plutôt l'ensemble des collectivités
publiques, dû à une progression constante de la consommation et de
la redistribution collective, s'est traduit à l'époque
contemporaine par deux phénomènes nécessairement
liés : la croissance continue des dépenses publiques et les
prélèvements obligatoires ?
Mais avant de s'interroger sur l'ampleur du
phénomène et sa signification, encore faut - il
préalablement définir les dépenses publiques et s'entendre
sur un critère qui permette d'en mesurer l'amplitude et l'incidence.
Les dépenses publiques ont pour but d'assurer la marche
des services publiques et l'existence même de l'Etat. A cet égal,
il faut noter que la détérioration de la gestion
budgétaire en RDC, observée au cours des années 80 et qui
s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 2003, a fait ressortir
l'importance capitale des dépenses publiques et la
nécessité pour les pouvoirs publics d'avoir une attention
soutenue dans ce domaine.
Certes, la croissance rapide de ces dépenses au cours
des années 80 était due principalement aux dépenses
excessives effectuées à des fins politiques et politiciennes, et
pour des investissements sans rentabilité économique.
Mais, dans tous les cas, il faut reconnaitre la place de plus
en plus importante faite aux dépenses publiques dans les
différents projets de développement de notre pays.
La notion de dépenses publiques a évolué
avec la conception des finances publiques. Si le principe fondamental de
l'équilibre budgétaire tend à être aujourd'hui
abandonné au profit soit du déficit soit de l'excédant
budgétaire, c'est en grande partie à cause de la conception
nouvelle qu'on se fait des dépenses publiques.
Le dictionnaire économique les définit comme
étant les dépenses de l'Etat inscrit dans le budget de
l'état (dépenses budgétaires). Au sens large, le
traité de Maastricht et le pacte de croissance et de stabilité
les définissent aussi comme étant l'ensemble des dépenses
des administrations publiques (Etat, collectivités locales, Organismes
de Sécurité Sociale).3(*)
Les dépenses publiques peuvent s'entendre comme celles
qui relèvent d'une personne au droit public. Elles comprennent tous les
paiements non remboursables des administrations publiques.4(*)
Du point de vue socio-économique, il s'agit des
interventions des pouvoirs publiques dans le système économique
et financier dans le cadre de sa fonction de commandement. Ces interventions se
manifestent selon de modalités diverses. Certaines sont
monétaires et d'autres sont budgétaires, ces derniers prennent la
forme de dépenses et de recettes publiques.5(*)
Pour les financières libérales, les
dépenses publiques sont des simples consommations. Elles
possèdent un caractère destructeur dans la mesure où
l'état apparaît comme un trou ou un gouffre sans fond.
Pour les financiers classiques, les dépenses publiques
sont les dépenses des collectivités publiques. Par
collectivités publiques, on désigne l'Etat et les
collectivités locales dotées de la personnalité morale.
Autrement dit, ce qui donne à une dépense le
caractère public, c'est la qualité juridique de l'auteur de la
dépense, le fait qu'il s'agit d'un organe ou d'une institution publique.
Le terme collectivité publique est synonyme en somme du terme
« Personne morale publique ».
1.1. Eléments
Constitutifs des Dépenses Publiques.6(*)
Les dépenses de l'Etat sont constituées de
traitement des allocations, des subsides et subventions, des achats des biens
et services ainsi que des intérêts sur la dette.
1.1.1.Traitements
Il s'agit des salaires de toutes les personnes occupées
par l'Etat ; fonctionnaires, militaires, enseignements, ministres...
1.1.2. Allocations
Contreparties des cotisations, elles consistent principalement
les allocations sociales telles que : pension, invalidité...
1.1.3. Subsides et
Subventions
Ce sont des faveurs que l'Etat accorde à certains
secteurs ou à certaines activités qui doivent être
aidés dans l'intérêt général.
Ces faveurs peuvent être définitives, donc sans
remboursement, on les appelle subventions ou subsides. D'autres peuvent
constitués des prêts remboursables, dans ce cas, il faut faire
figurer les remboursements de ces prêts du coté des recettes de
l'Etat.
1.1.4. Achat des Biens et
Services
Il s'agit de nombreux biens de consommation que l'Etat
achète pour assurer son fonctionnement. Il s'agit également des
biens de production (investissements) tels que routes, écoles, ponts,
1.1.5. Intérêt
de la Dette
Les pouvoirs publics empruntent ; aussi ils doivent non
seulement rembourser des emprunts à l'échéance mais aussi
ils doivent en outre payer chaque année les intérêts de la
dette.
1.2. STRUCTURE DES DEPENSES
PUBLIQUES.7(*)
La classification des dépenses publiques revêt
une grande importance. En effet, l'intervention de l'Etat est plus ou moins
efficace selon la nature des dépenses.
Plusieurs types de classification ont été
proposés : les classifications économiques l'emportent sur
les classifications juridiques ou formelles. Elles varient cependant d'un pays
à un autre.
Les charges de l'Etat ne sont pas de même nature :
c'est pourquoi elles font l'objet des classifications selon le critère
choisi.
1.2.1. Classifications
Administratives
La classification administrative appelée aussi
classification organique ventile d'abord la masse budgétaire entre les
différents ministères qui composent le Gouvernement.
Ensuite, à l'intérieur de chaque
ministère, elles sont basées sur l'organisation administrative
des personnes morales intéressées de l'état. On parle de
classifications organiques. Celles-ci peuvent exister sur une base juridique
distinguant des catégories spécifiques.
1.2.2. Classification
Economiques
On clase ici les dépenses suivant leur fonction
économique et le type d'intervention économique qu'elles
permettent à l'Etat de réaliser. Quatre grands types de
dépenses s'opposent 2 à 2 :
A. Dépenses de Fonctionnement ou Courantes -
Dépenses d'Investissement ou en Capital
B. Les dépenses de fonctionnement ou courantes
ont pour objet d'assurer la vie normale de services. Ces dépenses n'ont
pas pour but de déclencher les dépenses publiques, ni d'augmenter
le capital social ou privé. Il s'agit tout au plus de maintenir le
niveau attendu. Cette première catégorie de dépenses
correspond à la vie des services publics, à l'activité des
administrations.
C. Les dépenses d'investissement ou en capital
visent à transformer le capital public ou privé, pour accroitre
l'efficacité de la production privée ou publique des biens et
services. L'investissement de l'Etat se définit comme comprenant :
la participation de l'Etat aux investissements publics effectués par les
entreprises de l'Etat (contributions budgétaires au programme
d'investissement ou participation au capital d'organismes tels que les Banques
de développement : cas de l'ex Société
Financière de Développement - SOFIDE) ; les investissements
directs d'infrastructures et services publics ; les dépenses
d'exploitation et d'entretien des administrations publiques et autres
organismes extérieurs contractées par les entreprises de
l'Etat.
Ces dépenses correspondent à l'achat des biens
qui vont demeurer pendant plus d'un an dans le patrimoine de l'Etat. Les
principaux éléments sont les infrastructures publiques (routes,
bâtiments, écoles, dispensaires, etc....) les dépenses
élargissent les bases productives du pays et agissent sur la croissance
économique.
Dans les théories modernes, cette distinction pose un
sérieux problème parce que les investissements peuvent même
concerner le capital humain surtout (l'éducation et la santé)
pourtant les dépenses y afférentes sont enregistrées en
consommation.
D. Dépenses de Transfert - Dépenses
Effectives
Il s'agit d'une distinction à l'implication
économique. L'Etat peut dépenser directement pour acquérir
les biens et services nécessaires à ses missions. On dit que
l'Etat fait des dépenses effectives : dépenses avec
contrepartie. Dans d'autres cas, l'Etat fait des dépenses sans
contrepartie ; il prélève sur un secteur ou l'ensemble de la
collectivité pour réserver sur l'autre ; il s'agit dans ce
cas, de dépenses de transfert.
Sur le plan économique, la différence est grande
car, dans les dépenses effectives, l'Etat prélève une
partie de la substance économique, ce qui peut avoir pour
conséquence d'entrainer la rareté des biens et services.
Dans le cas des dépenses de transfert, l'Etat ne
prélève rien, il se contente d'agir sur le pouvoir d'achat (en le
modifiant) et laisse aux autres agents économiques les moyens
d'intervenir sur les biens des consommations.
1.2.3. Classification
Fonctionnelle
Elle répartit les dépenses entre les domaines
d'attribution ou les tâches de l'Etat. Elle va au-delà de la
classification organique dans la mesure où elle facilité le
calcul de coût d'exécution de différentes activités
et permet d'apprécier leur importance dans le budget de l'Etat.
Dans cette perspective : il devient facile de fixer des
priorités dans la planification des dépenses.
Dans cette classification, les différentes rubriques
sont :
Ø Services généraux (administration
générale, défense nationale, justice) ;
Ø Services de collectivités (routes et voies
navigables, adduction d'eaux, hygiène, publique,...)
Ø Services sociaux (enseignement,
santé,...) ;
Ø Services économiques (agriculture, commerce,
transport,...).
La classification fonctionnelle procède en quelque
sorte en une analyse économique des dépenses publiques en termes
de biens collectifs.
1.3. LES PRINCIPAUX
DETERMINANTS DES DEPENSES PUBLIQUES.8(*)
Les principaux éléments qui influencent les
dépenses publiques sont :
1. Le produit national : une
variation du produit national implique une variation du niveau de revenue de la
population, qui entraîne à son tour une modification de besoins
sociaux et culturels, dont une fraction est traditionnellement
rencontrée par les pouvoirs publics. Une variation du produit national
entraîne donc une variation de l'offre des biens et services collectifs
(administration, enseignement...) et du volume des investissements en termes
absolus, mais aussi en part relative du produit national (Loi de Wagner)
émise à la fin du XIX ème siècle). Celui-ci a
montré que les dépenses de l'Etat augmentaient plus rapidement
que la production en raison des éléments suivants :
l'amélioration du niveau de vie entraine un accroissement des
dépenses consacrées à l'éducation. Le
développement économique s'accompagne d'investissements
très importants (infrastructure, recherche) que le secteur privé
ne peut financer. Enfin la réglementation (dépenses
d'administration générale) s'accroit avec l'industrialisation et
l'urbanisation.
2. Défaillance des marchés
privés : d'après la théorie de
« Market faillures » certaines carences ou insuffisances
sur le marchés privés entraînent l'intervention de
l'état et implique des dépenses publiques : fourniture des
biens collectifs, investissements publics, subsides aux entreprises.
3. Productives relatives de secteurs public et
privé : pour un volume de production
donné, puisque la productivité des facteurs de production
augmente plus lentement dans le secteur public que dans le reste de
l'économie (en raison d'éléments technologiques et
institutionnelles), une part croissante des ressources doit être
dirigée vers le secteur public. Cela implique une augmentation des
dépenses publiques lorsque les productivités augmentent.
4. Charge fiscale : une
variation importante de la charge fiscale ne peut être
tolérée par la population qu'en dehors d'événements
exceptionnels (guerres, crises majeure). A un endettement public
inchangé, cela implique une croissance faible et régulière
des dépenses publiques dans le temps.
5. Taux d'intérêt de la dette
publique : une variation du taux moyen
d'intérêt de la dette publique implique une variation de
dépenses publiques, en fonction du montant de la charge en
intérêt de cette dette dans les dépenses.
1.4. LES GENERALITES
CONCEPTUELLES SUR L'EDUCTION
L'éducation joue un rôle essentiel dans le
développement économique, et un des facteurs explicatifs
importants des écarts des niveaux de vie entre pays est la plus ou moins
grande priorité historique des progrès éducatifs.
Si l'on considère des pays contenant de taille et de
poids comparables comme les Etats-Unis, la première puissance
économique mondiale est liée à la mise en place d'un
système éducatif primaire généralisé
dès le 19è siècle, puis secondaire et tertiaire
dans la première partie du 20è siècle.
La démocratisation précoce de l'enseignement aux
Etats-Unis est une des raisons de leur développement rapide, comme cela
a été aussi le cas pour les pays Européens et leurs
rejetons outre-mer : pays scandinaves, pays germaniques, pays anglo-saxons
ou latins.9(*)
1.4.1. Définition et
Formes de l'Education
L'éducation est l'ensemble des moyens mis en oeuvre
pour assurer la formation et le développement d'un être
humain.10(*)
Selon PIERRE ENCKEL, l'éducation est la formation de
quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité, ensemble des connaissances
intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine par quelqu'un,
par un groupe.11(*)
L'acquisition des connaissances intellectuelles pour
développer ou mettre en valeur les ressources humaines et pour former le
capital humain se fait de plusieurs façons. En d'autres termes, il y a
plusieurs formes de l'éducation notamment 4 à savoir :12(*)
Ø L'éducation formelle ;
Ø L'éducation non formelle ;
Ø L'éducation informelle ;
Ø L'éducation indirecte.
1.4.2. L'Education
Formelle
C'est une éducation qui se transmet dans des
établissements des enseignements maternels, primaires, secondaires,
supérieurs et universitaires. On l'appelle aussi éducation
scolaire.
1.4.3. L'Education non
Formelle
Il s'agit de toute activité éducative qui est
organisée en dehors du système de l'éducation formelle et
qui poursuit des objectifs spécifiques d'instruction notamment
l'éducation des adultes, le séminaire du stage professionnel et
la formation au sein de l'entreprise appelée couramment formation sur
l'état.
1.4.4. L'Education
Informelle
C'est une instruction qui résulte de l'une ou l'autre
situation c'est-à-dire soit c'est la source de l'instruction qui
manifeste la volonté délibérée d'acquérir
l'instruction mais pas les deux à la fois.
Si la volonté délibérée est
manifestée aussi bien par la source que par le
bénéficiaire, cela devient soit l'éducation formelle, soit
l'éducation non formelle. L'éducation informelle est un important
moyen d'auto-perfectionnement pour ceux qui n'ont pas la possibilité
d'aller à l'école et que l'on appelle autodidactes.
1.4.5. L'Education
Indirecte
C'est une instruction qui se donne sous la volonté
délibérée ni de la source de l'instruction, ni de
bénéficiaire. L'éducation dans le cas de
l'éducation indirecte se fait par l'association des Trois
événements à savoir :
Ø L'observation ;
Ø L'imitation ;
Ø L'émulation sélective d'une
société par d'autres membres de la même
société. C'est notamment le cas pour apprendre une langue
étrangère en milieu ambiant.
NB. : L'éducation formelle, non formelle,
informelle forment ensemble l'éducation permanente en d'autres formes,
aussi longtemps qu'on est en vie, on apprend toujours. En termes de coût,
c'est l'éducation formelle et non formelle que l'on doit
considérer.
1.1.1. 1. Finalités
de l'Education13(*)
Tout système d'éducation formelle et non
formelle poursuit Trois principes des finalités à
savoir :
ü Finalité culturelle ;
ü Finalité sociale ;
ü Finalité économique.
1.4.6.2.
Finalité Culturelle
Elle consiste à transmettre la culture de la
société aux nouvelles générations. Cette
finalité de transmettre la culture a 3 fonctions :
1. Confirmer la culture du passé en affirmant son
prestige ;
2. Permettre la culture de se perpétuer ;
3. Endoctriner la population de telle sorte que cet
endoctrinement se conforme à l'image des groupes qui dominent la
société.
1.4.6.3.
Finalité Société
L'éducation joue un rôle de socialisation et
d'intégration du corps social du point de vue de la connaissance de la
valeur morale et des catégories de pensée. La finalité
sociale a été assignée à l'éducation depuis
la fin de la seconde guerre mondiale et particulièrement en 1948 avec la
déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration
a fait de l'éducation un droit parmi les droits fondamentaux de
l'homme : d'après l'article 26 de cette déclaration, toute
personne a droit à l'éducation, l'enseignement
élémentaire est gratuit et obligatoire et d'accès aux
autres niveaux d'enseignement doit être ouvert en fonction de leur
mérite.
1.4.6.4.
Finalité Economique
Elle consiste à préparer les individus au
métier et à la vie professionnelle. Elle consiste
également à adapter la formation aux besoins de
l'économie.
Bref, il s'agit de donner au facteur travail la
possibilité d'être plus productif.
C'est vers les années 60 avec la naissance par les
travaux des économistes anglo-saxons, de la théorie du capital
humain, terme utilisé en économie depuis les travaux de
Théodore SCHURTZ (1961) et Gay BECKER (1964), qu'on parle de
l'éducation comme un bien de production et des dépenses y
afférentes comme des dépenses d'investissement.
Il y a deux raisons qui militent en faveur de reconnaissance
de la finalité économique de l'éducation :
1. L'importance de ressources financières qui sont
mobilisées au profit du secteur de l'éducation ;
2. Les exigences de l'économie à l'égard
du facteur humain.
NB. : Il n'existe pas un système d'enseignement qui
ne poursuit pas une finalité.
Tous les systèmes éducatifs poursuivent au moins
deux finalités et l'importance accordée à chaque
finalité dépend de la politique nationale ou régionale en
matière d'éducation.
1.4.6.5. Nature des
Biens et des Dépenses de l'Education14(*)
L'éducation est une activité qui produit des
connaissances en utilisant des ressources humaines, matérielles et
financières que l'on peut consacrer à d'autres activités.
Les connaissances qui sont produites sont des biens immatériels ayant
une double nature :
Ø Biens de consommation ;
Ø Biens d'investissement.
Les ressources financières qui sont mobilisées
pour produire les connaissances sont des dépenses monétaires. Ces
dépenses ont également une double nature économique
à savoir :
Ø Dépenses de consommation ;
Ø Dépenses d'investissement.
Ainsi en tant que système d'enseignement maternel,
primaire, secondaire, supérieur et universitaire, ou en tant que stocks
de connaissances, l'éducation est considérée de deux
manières :
1. L'éducation est considérée comme un
bien de consommation lorsque la finalité n'est pas professionnelle
(finalité culturelle et finalité sociale) et les dépenses
y afférentes sont considérées comme des dépenses de
consommations. Ainsi on considère comme bien de consommation les
formations et les degrés d'enseignement suivants :
Ø Enseignement maternel ;
Ø Enseignement Primaire ;
Ø Tout enseignement (formation qui vise la culture
générale).
2. L'éducation est considérée comme un
bien de production lorsque la finalité est professionnelle et les
dépenses y afférentes sont considérées comme
dépenses d'investissement. Comme notamment le cas de l'enseignement
professionnel, technique, supérieur et universitaire y compris la
formation sur l'état. Il y a deux remarques à faire concernant la
nature des biens et des dépenses de l'éducation :
- En dissociant l'éducation de bien de consommation et
de bien de production, il y a un danger parce que la formation
générale qui est considérée comme un bien de
consommation est la condition préliminaire de toutes formations
professionnelle et technique qui sont considérées comme bien de
production. En d'autres termes, plus la formation est bonne, plus nombreuses
sont les activités professionnelles auxquelles cette formation
prépare.
- La distinction de l'éducation entre dépense de
consommation et dépense d'investissement n'est valable qu'au niveau de
l'individu qui bénéficie de l'éducation mais pas au niveau
des parents et de la société, pour ceux-ci toute dépense
effectuée pour l'éducation de leurs enfants constitue un
investissement.
1.5. LES EFFETS
MACROECONOMIQUES DE L'EDUCATION
1.5.1. Education et
Croissance
Les travaux de Denison constituent le point de départ
de la réflexion s'attachant à mesurer la contribution de
l'éducation à la croissance économique des USA, Denison a
réalisé en 1962 la première tentative de mesure de cette
contribution pour les USA sur la période 1910 - 1960. Il était
question de montrer que la croissance des facteurs de production traditionnels
(capital et travail) n'explique pas en totalité le taux de croissance de
l'économie.
Globalement, nous pouvons affirmer que l'éducation est
un ensemble des facteurs favorables aux processus de croissance.
En premier lieu, l'éducation améliore la
productivité des individus et permet donc à l'économie de
disposer d'une main - d'oeuvre qualifiée adaptée à la
technique croissance qui accompagne toujours le développement
économique. Etant donné que la croissance implique un
renouvellement des techniques de production, celles-ci ne peuvent être
mises en application que lorsqu'il existe des hommes suffisamment
qualifiés, adaptables, mobiles et capables d'assimiler ces
évolutions. Ils pourront l'être s'ils ont un niveau
d'éducation élevé.
L'éducation engendre aussi un `'état d'esprit''
favorable.
Elle modifie les valeurs individuelles et peut créer
des attitudes de désir de réussite, de compétition, de
recherche du progrès, évidemment favorable au
développement économique.15(*)
Enfin, l'éducation joue aussi un rôle fondamental
du côté de la demande sans laquelle toute croissance est
illusoire. Un haut niveau d'éducation débouche en effet sur des
revenus très élevés qui permettront d'alimenter la demande
des biens et services (ainsi qu'une capacité d'épargne
nécessaire pour financer l'investissement).16(*)
1.5.2. Education et les
Grands Equilibres
Les grands équilibres sont définis à
quatre niveaux :
1. L'emploi : l'éducation est un
élément favorable à la diminution du chômage par le
fait qu'elle favorise les innovations technologiques, la croissance
économique, l'adaptabilité de la main- d'oeuvre aux
inévitables évolutions liées au développement
économique, et cette adaptabilité sera, meilleure si la politique
éducative a le souci de pendre en compte les besoins de main- d'oeuvre
de l'économie pour ajuster le système éducatif de
façon cohérente.
2. Les prix : l'impact de l'éducation sur
les prix est double. Il génère, à certains égards,
des pressions inflationnistes. Cela s'explique par les dépenses
publiques croissantes (dont les effets positifs ne se font pas sentir
qu'après un délai assez long) qu'engendre le développement
du système éducatif et qui pèsent sur les finances
publiques.
Cela s'explique aussi par les risques de contagion que peut
créer l'augmentation des salaires de la main - d'oeuvre qualifiée
sur les salaires des autres catégories des travailleurs. A l'inverse, le
développement de l'éducation exerce des effets
anti-inflationnistes bénéfiques en créant des gains de
productivité dont on sait qu'ils sont la meilleure arme contre les
dérapages de paix.
3. Les finances publiques : l'éducation
pèse nécessairement sur les finances publiques d'autant plus que
les pouvoirs publics, face à une demande croissante des familles, mais
aussi face aux besoins croissants de main - d'oeuvre qualifiée, doivent
engager des sommes de plus en plus importantes dans ce domaine.
Mais cette `'dérive'' des dépenses publiques est
compensée à terme par une augmentation quasi - automatique des
recettes fiscales par le fait que les rentrées liées à la
fiscalité directe sont abondantes dans la mesure où
l'augmentation du niveau de l'éducation engendre une augmentation du
revenu et dans la mesure où le système fiscal l'imposition
progresse.
4. La balance des paiements : ce dernier grand
équilibre concerne les relations économiques
internationales ; les relations sont des types commercial et financier.
L'impact de l'éducation sur les relations commerciales
est une évidence largement développée par la
théorie du commerce international. Etant donné que la structure
du commerce internationale est déterminée par celle de la main -
d'oeuvre liée à celle du système éducatif et
à la politique éducative même dans chaque pays.
On peut donc dire que l'éducation joue, une fois de
plus, un rôle déterminant dans le commerce international.
Pour ce qui concerne les mouvements internationaux des
capitaux, la relation avec l'éducation est par contre moins
évidente. On n'admettra sans difficulté qu'un niveau
d'éducation élevé constitue un élément
favorable pour la gestion efficace d'un portefeuille, d'une trésorerie
et pour une plus grande rationalité dans les décisions
d'investissements. De là à conclure que le solde de la balance
des capitaux s'en trouvera automatiquement améliorée, il y a un
pas qu'on ne saura franchir tant que ce solde résulte des facteurs
multiples et aléatoires.17(*)
1.5.3. Education et
Répartition des Revenus
Le problème ici est de savoir si l'éducation
permet d'améliorer l'équité comme elle permet
d'améliorer l'efficacité du système économique.
Comme l'appréciation de l'équité se fait
principalement par l'intermédiaire de la répartition de revenus,
l'éducation aura donc des effets bénéfiques du point de
vue de l'équité, si son développement tend à
resserrer la distribution des revenus.
De nombreux travaux menés sur ce sujet, pour les pays
en développement, font apparaître que, quelques soient les
instruments de mesure des inégalités retenus, il existe une
relation significative entre les revenus et le développement
économique (qui est étroitement lié au niveau
d'éducation). Dès 1955, Kuznets faisait apparaître que les
inégalités retenus, commencent d'abord par augmenter pour
diminuer ensuite au fur et à mesure que le niveau de
développement s'élève. Des travaux menés par la
Banque Mondiale dans les années 80 montrent que cette loi de Simon
Kuznets n'est sans doute pas claire de nos jours, mais que l'on peut
globalement considérer que le niveau de développement (et donc de
l'éducation) est un facteur de réduction des
inégalités.
Cette influence tient principalement au fait que
l'éducation étant un déterminant significatif des revenus
individuels, son développement doit émaner plus d'individus
à des niveaux de revenus supérieurs et donc réduire la
dispersion des dits revenus.18(*)
1.6. GENERALITES CONCEPTUELLES
SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE
La croissance économique est un phénomène
qui est recherché par et pour tous les pays. C'est un impératif
que toutes les économies se donnent de réaliser, car la
croissance économique appréhende le changement économique.
De ce fait, il constitue un des facteurs clés de changement social. La
croissance économique est donc un préalable au
développement économique.19(*)
La croissance économique est aussi l'un des
phénomènes les plus passionnants de la science économique,
car elle permet d'expliquer non seulement le processus d'enrichissement des
nations, mais aussi d'expliquer le creusement des disparités de niveau
de vie entre pays. (Pays du Nord et pays du Sud)20(*)
La croissance économique constitue aujourd'hui la
principale référence pour la gestion à court terme et
à long terme des économies. Elle constitue le principal objectif
de la politique économique en ce que, à travers elle, on
peut atteindre les autres objectifs : accroissement du revenu et du bien
être collectif, accroissement de la capacité de créer des
emplois, élargissement de l'assiette fiscale, et l'affirmation de la
puissance du pays vis-à-vis de l'étranger.21(*)
La croissance économique permet l'entrée des
devises et, de ce fait, elle permet de recourir aux produits et aux
opportunités des marchés extérieurs, elle assure aussi la
compétitivité et la puissance recherchée par chaque
pays.
Elle permet, en outre, la réduction de divers
déséquilibres aussi bien dans la mobilisation des ressources et
la résorption des inégalités que dans la gestion des
équilibres macroéconomiques fondamentaux, tels que celui de la
balance des paiements et celui de la lutte contre l'inflation. C'est ainsi que
le taux de croissance est aujourd'hui l'expression la plus courante du
progrès d'un pays. On trouve un témoignage éloquent dans
la fréquence de référence à la croissance dans les
discours politiques et dans les commentaires et options diffusées
quotidiennement par les médias.22(*)
Selon Simon Kuznets (Prix Nobel de sciences économiques
en 1971), la croissance économique d'un pays peut être
définie comme une hausse de long terme de sa capacité d'offrir
à sa population une gamme sans cesse élargie des biens
économiques.23(*)
1.6.1. Le Modèle
d'Inspiration Keynésienne.24(*)
Le Modèle de Harrod est à bien des égards
très proche de Domar et bien des présentations sont similaires.
On parle ainsi souvent de modèle de Harrods - Damar.
Les Postkeynésiens Harrod et Damar sont les premiers
à avoir proposé un modèle qui cherche les
possibilités d'une croissance équilibrée et leurs travaux
ont consisté à prolonger dans le long terme l'analyse de Keynes
sur l'instabilité des économies de marché.
Harrods, par ces analyses, a montré que la croissance
économique de plein emploi est par nature instable. Ceci parce que
l'égalité nécessaire entre le taux de croissance effectif,
le taux de croissance garantie et le taux de croissance naturelle ne peut
être satisfait.
Domat, quant à lui, à montré la
nécessité de l'investissement dans croissance d'une
économie et, en introduisant les anticipations dans la
détermination de l'investissement, il a conclu que la relation
déterminant le taux de croissance est instable car la croissance de
l'offre n'est pas égale à celle de la demande.
Les analystes particulièrement de Robert SOLOW et
Trésor SWAN ont remis en cause le principe de l'instabilité de la
croissance de plein emploi énoncé par Harrods et se sont
proposé de mettre en évidence les déterminants de la
croissance économique et de caractériser son comportement dans le
moyen/ long terme. De tous les modèles suggérés aux
alentours des années 1950 - 1960 pour rendre compte le
phénomène de croissance qui explique pourquoi certains pays sont
plus riche que d'autres, c'est celui de SOLOW qui a reçu les plus
grandes lettres de noblesse.
Il constitue le point de départ de presque toutes les
analyses de la croissance en ce que la plus part de modèle se
comprennent bien par lui, même ceux qui semblent s'en écarter
considérablement.
1.6.2. Le Modèle de
SOLOW
Le Modèle de croissance de SOLOW montre comment
l'épargne, la croissance démographique et le progrès
technique affectent le niveau de la production et de sa croissance dans le
temps.25(*)
Ce modèle met en exergue les interactions entre la
croissance du stock du capital et celle de la force du travail, d'une part, et
le progrès technologique, d'autre part, et montre comment ces Trois
facteurs affectent le niveau de la population.
1.1.1.1. Modèle de
SOLOW sans Progrès Technique26(*)
Cette première version du modèle de SOLOW ne
prend pas en considération le progrès technique, seuls les
facteurs travail et capital expliquent le niveau de la production et
constituent les sources de la croissance économique.
Il stipule que le produit réalisé par un
travailleur est réparti entre sa consommation et son épargne,
celle-ci étant censée financée l'investissement.
Ainsi on écrit :
C = (1-s)y et I-Sy
Le paramètre s est compris entre 0 et 1
représente la propension marginale à épargner.
L'investissement par tête I est une fraction S du
produit individuel, la consommation part tête c est une fraction (1-s) du
revenu individuel.
Les variations du stock du capital de l'économie K sont
provoquées d'une part par l'acquisition des nouvelles machines
(l'investissement) et d'autre part par le vieillissement du capital
installé (l'amortissement ou l'obscelenscence).
La variation du capital dans le temps est donnée
par :
dk/ dt = Sf (K, L) - SK.
S: est une constant qui représente le taux
d'amortissement du stock de capital existant.
Etant donné que K=K/L, le taux de variation de K est
gk = gk - n et l'équation d'ajustement du capital
par tête est :
dk (dt = SF (K) - (n+S) k
L'économie atteint ainsi est un état
stationnaire, c'est-à-dire un équilibre de long terme lorsque
dk/dt = 0, soit lorsque :
SF (K*) = (n+S) K*.
A cet état, l'investissement réalisé par
les individus est qualifié d'investissement de point mort car il
compense exactement les effets négatifs de la croissance
démographique et de l'amortissement sur l'intensité
capitalistique de l'économie. Ainsi, on n'observera pas une
décroissance du produit par tête quand bien même il y a
croissance de l'effectif de la population.
Figure I.1. Détermination de Régime Stationnaire
(n+ ä)
Sf(k)
Sf(k*)= (n+ä) k
k1 k*
k2
1.1.1.2. Modèle de
SOLOW avec Progrès Technique27(*)
Dans la deuxième version du modèle, le
progrès technique est intégré en introduisant une
variation A dénommée efficience du travail dans la fonction de
production macroéconomique, variable qui vient améliorer la
productivité du facteur travail. La fonction de production
s'écrit :
y = F (K, AL)
La fonction de production étant par hypothèse
homogène de degré un, on définit la production par
unité d'efficience s'écrit :
y = f(K)
où y = y/AL et K = K/AL représente
respectivement le produit et le capital par unité d'efficience. Puisque
l'efficience augmente dans le temps au taux gA, l'équation
reflétant le comportement de K dans le temps devient :
dk/dt = Sf(K)-(gA+n+ä)K.
L'état stationnaire au régime permanent est
atteint lorsque l'intensité capitalistique devient constante,
c'est-à-dire quand on vérifie que :
Sf(K*) = (gA+n+ä)K*.
La consommation par tête sera maximisée si le
produit marginal du capital est égal à l'investissement de point
mort, soit : (gA+n+ä)K.
A l'état stationnaire le taux de croissance du capital
par unité d'efficience, gy.
Le produit par travailleur/ L =Af(K) croit au taux
gA et la production totale y croit au taux :
gy=gA=n.
Tout compte fait, le modèle de SOLOW montre que seul le
progrès technique peut expliquer des niveaux de vie en hausse
persistance, c'est-à-dire le caractère auto-entretenu d'une
croissance enrichissante. Aussi il montre d'où viennent les
écarts de niveau de vie entre pays.
1.1.1.3.
Dépassement du Modèle de SOLOW : la Croissance
Endogène.28(*)
Le modèle de SOLOW nous a permis d'expliquer
d'où viennent les écarts de niveau de vie ou de
développement entre les pays en mettant en évidence le rôle
joué par le progrès technique dans le processus de croissance
économique. Cependant, on lui reproche de ne pas avoir expliqué
de manière claire, les déterminants de progrès technique
celui-ci étant considéré comme une manne qui tombe du ciel
(variable exogène).
Pour faire face à cette faiblesse, il a été
proposé à partir des années 1980, des modèles de
croissance qui faisaient du progrès technique une variable
endogène, c'est-à-dire une variable expliquée. Ce sont ces
modèles qui ont donné le jour à ce que l'on convient
d'appeler les théories de la croissance endogène. Ces
théories se fondent sur l'idée selon laquelle l'activité
économique utilise des ressources précieuses dans la recherche de
l'innovation, avec les brevets, et que l'on peut donc rendre compte du facteur
A qui, dans les théories traditionnelles, représentait le niveau
de la technologie.
Un premier groupe des travaux, à la suite de Paul
Römer (1986), cherche le moteur de la croissance dans l'accumulation du
capital et dans le phénomène d'apprentissage par la pratique
(Learning by doing). Par la circulation de l'information et par l'accumulation
du savoir-faire entraîné par l'accumulation de capital physique et
expérience au travail, les entreprises améliorent leurs
productivités ainsi que leur contribution au PIB. Dans ces conditions,
la croissance économique résulterait des externalités
positives que produisent les investissements et la pratique professionnelle.
Une deuxième vague de chercheur a été
ouverte par Lucas (1988), et fait de l'accumulation du capital humain une
déterminante importance du progrès économique des nations.
L'accumulation du capital humain se définit comme le stock des
connaissances économiquement valorisables et incorporées aux
individus : qualifications, compétences, état de
santé, hygiène,... Lucas distingue le capital humain qui
correspond à une accumulation volontaire des connaissances (Scolling) de
l'apprentissage par la pratique qui est une accumulation involontaire des
connaissances.
Il montre à cet effet que la productivité
privée du capital humain a un effet externe positif car, en
améliorant son niveau d'éducation et de formation, chaque
individu augmente le stock de capital humain du pays et par là
même aussi il contribue à améliorer la productivité
de l'économie.
Enfin, Barro (1990) fera des dépenses publiques un
déterminant du progrès économique et proposera le concept
de taille optimale de l'Etat pour montrer que ce dernier doit intervenir dans
l'économie pour améliorer la productivité du secteur
privé, tout en réduisant au strict maximum, les distorsions
fiscales qui découleraient de son intervention financière. Barrot
a souligné l'importance des infrastructures publiques dans la
circulation des informations des personnes et des besoins.
CHAPITRE DEUXIEME
PRESENTATION DU SYSTEME
EDUCATIF CONGOLAIS ET EVOLUTION DE L'ECONOMIE CONGOLAISE DE 1980 A 2012.
Ce chapitre présente l'évolution du
système éducatif en République démocratique du
Congo et analyse l'évolution de l'économie congolaise la pour
période 1980 à 2012 tout en mettant un accent particulier sur les
finances publiques et les dépenses publiques d'éducation. Cette
dernière comprend également trois sections, la première
présente l'évolution de l'économie de la RD Congo pour la
période sous étude, la deuxième présente
l'évolution des finances publiques de la RDC pour la période sous
étude, enfin la troisième section analyse les dépenses
publiques d'éducation en RDC.
2.1. HISTORIQUE DU SYSTEME
EDUCATIF CONGOLAIS.
Le pouvoir colonial s'est employé contentieusement
à s'assurer d'une part la dollicité et la soumission du peuple
colonisé et d'autre part, des auxiliaires autochtones agents de
collaboration pour l'exploitation de la colonie, le Congo belge. Ainsi, une
place de choix était accordée à l'enseignement de la
religion et à l'éducation morale à l'école. Aux
cotes, une instruction était donnée, mais dosée pour
écarter les velléités d'émancipation et pour
préparer davantage aux conditions et aux obligations de servir.
En référence à cette vision et à
cette politique, la pyramide d'enseignement primaire pour le Congolais
était fort développée à la base et se
rétrécissait considérablement dès la
troisième année. La veille de l'accession à
l'indépendance, la structure scolaire au primaire comprenait deux
années du premier degré pour l'éducation de base et de
masse, trois années du deuxième degré ordinaire
orienté vers les métiers et les travaux agricoles pour les moins
doués, quatre années du deuxième degré
sélectionné pour un enseignement préparatoire à
l'enseignement secondaire, les classes des sixièmes et de
septième années étaient fréquentées par les
élèves les mieux doués désireux d'entrer au
secondaire.
L'enseignement secondaire pour Congolais était, d'une
part, d'un cycle de quatre ans organisant l'école moyenne,
l'école professionnelle, l'école ménagère, les
écoles d'infirmiers, d'accoucheuses, des moniteurs agricoles.
Il était d'autre part, des six ans organisant les
sections : latine, moderne scientifique, normale administrative et
commerciale, de géométrie, d'éducation physique.
Le réseau du régime de gestion était
l'officiel laïc, l'officiel congréganiste, le libre
subsidié, le libre non subsidié.
· L'officiel laïc concernait les écoles
appartenant et gérées par l'Etat.
· L'officiel congrégationniste pour les
écoles de l'Etat qui en a confié la gestion aux
missionnaires ;
· Le libre subsidié pour les écoles
missionnaires bénéficiaires des subventions de l'Etat et
contrôlées par lui ;
· Le libre non subsidié faisait
référence aux écoles missionnaires non
bénéficiaires des subventions de l'Etat.
A l'accession du Congo à l'indépendance, il a
fallu entre autre impérativement former rapidement des cadres moyens et
supérieurs pour le nouvel Etat, une élite nombreuse pour la
relève de l'africanisation, augmenter les effectifs du secondaire pour
accroitre ceux des finalistes devant accéder à l'enseignement
supérieur.
Deux années du cycle d'orientation ont
été créées, mais le cycle n'a guère
orienté les élèves, faute d'instruments appropriés,
du personnel spécialisé, et d'application des principes de
l'orientation. Il sera supprimé par décision du 8 juin 1981 prise
par le comité central du parti-Etat.
La langue française a été imposée
comme seule langue d'enseignement. Les conséquences en sont
catastrophiques jusqu'à ce jour. Plus particulièrement au niveau
des apprentissages et des acquisitions des compétences de base au niveau
de l'enseignement fondamental : faire acquérir aux
élèves la capacité de lire, d'écrire, de calculer,
de s'exprimer convenablement à l'oral et à l'écrit.
Cependant, sur terrain, les langues vernaculaires et du milieu
étaient les langues d'enseignement suivant les régions et y ont
considérablement favorisé l'acquisition des apprentissages. En
1967 l'examen d'Etat a été institué pour l'ensemble du
territoire national pour sanctionner les études secondaires par un
diplôme de cycle long.
La constitution de 1967 a reconnu un enseignement national
à réseaux multiples : national, catholique, protestant,
kimbanguiste, islamique.
En 1974, les réseaux ont été abolis pour
faire place à l'enseignement national tenu par l'Etat. Il s'en est
suivi l'étatisation des réseaux confessionnels et privés
puis la rétrocession de leur gestion.
En 1977, la convention de gestion des écoles nationales
a été signée entre l'Etat et les représentants des
confessions religieuses.
Le budget d'Etat alloué à l'éducation
était de 30% en 1978, les taux bruts de scolarisation de l'année
1978-1979 étaient de 94% au primaire, de 2% au secondaire.
L'autorité politique a néanmoins déploré et
dénoncé l'inadéquation entre le système
d'enseignement, l'austénite culturelle congolaise et les
impératifs de développement national.
Plusieurs autres déficiences n'ont pas permis des
rentabiliser le système éducatif. La commission nationale de la
réforme de l'enseignement primaire et secondaire, CNR, a alors
fonctionné de 1982 à 1989 en insistant sur la finalisation
à l'école et l'emploi.
Il importe de retenir des travaux de la CNR : les
ordonnancés n 91-231 et 232 du 15 aout 1991 relatives au statut des
enseignements, les questionnaires simplifiés et informatisés
nouveau type sur les statistiques de l'éducation pour la collecte de
données fiables, la loi-cadre de l'enseignement national encore en
vigueur, bien qu'elle n'ait jamais été assortie des mesures
d'application, le programme national de l'enseignement primaire revisité
récemment en 2010.
Les états généraux de l'éducation
ont adopté, en 1996, le projet d'un « nouveau système
éducatif ». Les perturbations liées à la guerre
n'ont pas permis au « nouveau système
éducatif » de voir le jour. Les conflits et les guerres ont
détérioré davantage l'Etat du système et
accentué le besoin de la reconstruction.
2.1.1. ADMINISTRATION DU
SYSTEME EDUCATIF.
En République Démocratique Du Congo,
l'enseignement national est composé de deux catégories
d'écoles : les écoles publiques et les écoles
privées agréés.
Dans les écoles publiques on retrouve les écoles
non conventionnées gérées directement par l'Etat, et les
écoles conventionnées dont la gestion est assurée par les
confessions religieuses signataires de la convention de gestion scolaire avec
le gouvernement. Ainsi, dans ce dernier groupe on a :
(1) Les Ecoles Conventionnées Catholiques ;
(2) Les Ecoles Conventionnées Protestantes ;
(3) Les Ecoles Conventionnées Kimbanguistes ;
(4) Les Ecoles Conventionnées Islamiques ; et
(5) Les Ecoles Conventionnées de l'Armée du
Salut.
Au niveau national, provincial, et local, chacune de ces
églises dispose de services de gestion scolaire appelés bureaux
de coordination.
Les écoles publiques sont financièrement prises
en charge par l'Etat, surtout en ce qui concerne les salaires des personnels
enseignants ; compte tenu des difficultés que connait le pays
depuis des années, les parents interviennent financièrement et de
façon significative dans le fonctionnement des écoles.
Les écoles privées agrées sont celles
créées par des particuliers (personnes physiques ou
matériels), et qui sont soumises à la réglementation
officielle en matière d'agrément, de programmes d'études,
de contrôle et d'évaluation pédagogiques.
Elles ne bénéficient d'aucun subside de la part
de l'Etat. Toutes leurs charges financières reviennent aux parents. Un
grand nombre d'écoles privées(ASSONEPA). D'autres sont
plutôt affiliées au collectif des écoles privées
agrées du Congo (CEPACO).
Le secteur de l'enseignement privé connait un
développement rapide en termes de nombre des écoles. En 2001-2002
on a dénombré, au niveau de l'enseignement privé, 2.195
écoles primaires et 1.205 écoles secondaires, alors qu'en
1986-1987 ces nombres étaient respectivement de 378 et 109.
Les parents sont le quatrième acteur majeur de
l'administration su système scolaire congolais. Ils sont
représentés, de la base au sommet, par des comités de
parents dans les écoles, les communes et les provinces.
Il existe plusieurs organisations de parents
d'élèves dont la plus ancienne et la plus importante est
l'association nationale des parents d'élèves du Congo (ANAPECO).
Ces associations ont pour rôle d'inciter les parents à scolariser
leurs enfants et coopérer à la gestion des écoles.
Les écoles sont gérées par un chef
d'établissement (directeur au niveau des écoles primaires,
préfet au niveau secondaire), assisté par un conseil de gestion.
Le chef d'établissement assure la gestion
pédagogique administrative, et financière de l'école, y
compris la gestion du personnel ainsi que le versement des salaires de ces
derniers. Sur proposition de chef de division provincial ou coordonnateur
provincial, le gouvernement nomme ou relève de leurs fonctions, les
chefs d'établissements respectivement des écoles non
conventionnées et conventionnées.
Le conseil de gestion est l'organe délibérant de
l'établissement scolaire. Ses membres sont le chef
d'établissement, le conseiller pédagogique, le directeur de
discipline, le représentant des parents.
Pour gérer le personnel, enseignant de l'enseignement
primaire, secondaire et professionnel, le gouvernement a crée depuis
1985 le service de contrôle et de la paie des enseignants (SECOPE),
placé sous le contrôle du secrétaire général
qui a ce secteur dans ces attributions. (Ministère de l'EPSP, 2005).
2.1.2. STRUCTURE DU SYSTEME
EDUCATIF
La durée de l'enseignement obligatoire est de 6 ans
pour les enfants entre 6 et 12 ans. Bien qu'une scolarité
pré-primaire de 3 ans soit prévue, elle n'est offerte en pratique
que dans quelques zones urbaines.
La scolarité primaire de 6 ans est divisé en
trois cycle de deux ans chacun. Le certificat de fin d'études primaires
est accordé sur base d'une évaluation des résultats en
classe et des notes de l''élève à un test national
(TENAFEP), pondérés respectivement par 60% et 40%.
L'enseignement secondaire consiste en un cycle de long et un
cycle court. Le cycle long comprend trois filières :
général, normale et technique. Ce cycle consiste en une
première étape de deux ans, commune aux trois filières, et
une seconde étape de quatre ans qui introduit la différenciation
entre les trois filières. Au sein de chaque filière, diverses
options sont offertes, jusqu'à trente options dans la filière
technique.
Les élèves qui réussissent au concours
national, appelé Examen d'Etat, obtiennent le diplôme d'Etat
sanctionnant la fin de leurs études secondaires.
Le cycle court concerne l'enseignement professionnel et
consiste en une formation de 4 ans, commençant immédiatement
après l'enseignement primaire, ou une formation de 3 ans après le
tronc commun du secondaire. Il existe également des écoles des
arts et métiers qui offrent une formation à l'artisanat en trois
ou quatre ans. Les élèves de ce cycle obtiennent en cas de
satisfaction aux concours de fin de cycle, un certificat.
L'enseignement supérieur comporte un premier cycle de
trois ans et un second de deux à trois ans selon les
filières.
Trois types d'enseignement supérieur sont
organisés en RDC : l'enseignement supérieur universitaire,
l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement
supérieur technique. Un diplôme est décerné aux
étudiants ayant réussi aux examens de fin de cycle,
respectivement le diplôme de graduat pour ceux du premier cycle, de
licence pour ceux de deuxième cycle.
Pour les études de médecine, le deuxième
cycle, qui dure trois ans, est sanctionné par un diplôme de
doctorat en médecine. Le troisième cycle propose le diplôme
d'études supérieurs (DES) et le doctorat (Ministère de
l'EPSP, 2005).
2.1.3. Evolution de l'Economie
Congolaise
L'analyse de l'économie congolaise pour la
période 1980 à 2012 peut être abordée en trois
phases. La première couvrant la sous période 1980 - 1989, est
caractérisée par une reprise temporaire de l'activité
économique et la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel
(PAS) de première génération, la deuxième allant de
1990 à 2001 est margé par un effondrement total de l'appareil
économique, et la dernière phase allant de 2002 à 2012 est
marqée par une relative stabilité du cadre
macroéconomique.
2.1.4. Situation de l'Economie
Congolaise de 1980 - 1989
Après une période de croissance avec des taux
relativement élèvés, L'activité économique
s'est graduellement détériorée à partir de 1975. Le
PIB commerciale a enregistré jusqu'en 1979 un taux de régression
moyen en termes réels de 0,2%.
Après quatre années d'évolution en dents
de scie, la reprise amorcée en 1979 s'est nettement confirmée en
1980, le taux de croissance ayant atteint 2,3% en termes réels contre
0,2% en 1979. En effet, le PIB commercialisé qui avait
régressé de 6,3% en 1979, s'est d'abord relevé de 0,1% en
1979 et ensuite de 2,5% et de 2,4% en 1989 et 1981. Il s'est accrue en valeurs
nominales, dans des proportions plus importantes en raison de la nouvelle
politique de libéralisation des prix ainsi que des modifications
intervenues dans la parité de la monnaie, la fiscalité et le
niveau de rémunérations, le taux d'investissement est
passé de 14,3% en 1984 à 2,5% en moyenne en 1989 ;
l'investissement est passé de 9,9% en 14,2% en 1987.
En somme, cette sous période est
caractérisée par des taux de croissance positifs, excepté
l'année 1982.
L'appréciation de l'activité économique
observée dans cette sous période a été
renforcée par les programmes d'ajustement structurel de 1983 et de 1987
- 1988.
Les politiques monétaires et budgétaires
restrictives imposées par ces programmes ont permis à
l'assainissement du cadre macroéconomique, mais ceci n'a pas
été fait sur des bases solides, les dirigeants ayant
été défaillants dans la gouvernance et la gestion de la
République.
Tableau 2.1. Taux de
Croissance en Volume de Différents secteurs et de leurs
composantes : 1980 - 1989
Années
Secteurs d'activités
|
1980
|
1981
|
1982
|
1993
|
1984
|
1985
|
1986
|
1987
|
1988
|
1989
|
|
A. Secteur des biens
|
4.2
|
4.4
|
-3
|
2.9
|
3.6
|
1.6
|
3.2
|
0.3
|
2.7
|
-0.7
|
|
1. Agriculture Commercialisée
|
2.9
|
2.6
|
0.8
|
0.7
|
2.9
|
3.4
|
4
|
-2.8
|
2.4
|
6
|
|
2. Extraction Minière et
Métallurgie
|
6.8
|
7.2
|
-3.1
|
3.9
|
6.9
|
2.2
|
2.5
|
-2
|
2.4
|
6
|
|
3. Industrie Manufacturières
|
-1.2
|
0.7
|
10.8
|
-0.5
|
3.8
|
-2.6
|
2.1
|
6
|
3.7
|
0
|
|
4. Bâtiments et Travaux Publics
|
0
|
0.4
|
3
|
13.1
|
-28.8
|
-3.5
|
9.3
|
16.7
|
2
|
-13.2
|
|
5. Electricité et Eau
|
5.5
|
-2.6
|
6.2
|
3
|
5.8
|
5.5
|
6
|
9.3
|
5.2
|
5
|
|
A. Secteur des Services
|
0.1
|
1.5
|
-3.7
|
-0.1
|
3.5
|
3.5
|
0.9
|
4.5
|
2.2
|
4.8
|
|
1. Transport et Communication
|
6.4
|
6.3
|
13.3
|
6.3
|
1.3
|
3.8
|
1.1
|
-3.4
|
7.7
|
-3.8
|
|
2. Commerce
|
8.2
|
-4.5
|
-4.1
|
5.1
|
8.8
|
5
|
-0.2
|
-1.6
|
1.4
|
6.4
|
|
3. Services
|
-2.1
|
-1.1
|
-1.2
|
-3.4
|
2.2
|
1
|
1.7
|
9.4
|
1.7
|
2.8
|
|
4. Droits et Taxes à l'Importation
|
23.2
|
2.7
|
-27.4
|
38.1
|
-44.2
|
12.5
|
6.9
|
-3.5
|
5.5
|
4.2
|
|
5. Produits Intérieur Buts
Commercialisées
|
2.3
|
2.9
|
-3.9
|
0.8
|
3.1
|
2.6
|
2.1
|
2.3
|
2.4
|
2.1
|
|
6. Agriculture non Commercialisées
|
2.7
|
2.7
|
3
|
3
|
3
|
3.03
|
3.8
|
3
|
3
|
3
|
|
7. Construction non Commercialisée
|
3.3
|
0.8
|
3.2
|
13.2
|
-21.9
|
2.63
|
9.2
|
20.5
|
2
|
13.2
|
|
PIB
|
2,4
|
2,9
|
-3
|
1,3
|
2,7
|
2
|
2,4
|
2,6
|
2
|
2
|
Source : BCC, rapports
annuels 84 - 85, P. 38 ; 89 - 90, P. 6.
L'analyse de ce tableau nous relève une relative
stabilité de la production dans le secteur des biens et dans celui des
services. Seule l'année 1982 est caractérisée par des taux
de croissance négatifs marquant la baisse de la production.
L'année 1983 est caractérisée par un léger
redressement qui se poursuit jusqu'en 1989.
2.1.5. Situation de l'Economie
Congolaise de 1990 - 2001
Cette sous période, consécutive à la
suspension du PAS fut marquée par plusieurs événements
notamment, les troubles sociales de 1990, les pillages de 1991 et 1993, les
conflits armés de 1996 et 1998. Ceux-ci ayant fortement affecté
l'activité économique, on observe tout au long de cette sous
période une instabilité macroéconomique, une baisse
sensible de la production et la détérioration des conditions de
vie de la population. En effet, dès le début de cette sous
période, l'activité économique s'est
développé dans un contexte peu propice à la croissance.
Le recul du PIB intervenu en 1990 soit - 6,6% s'est
aggravé en 1991 avec un taux de - 8,4% et a atteint - 13,5% en 1993,
année à laquelle les différentes branches
d'activités qui concourent à la formation du PIB ont connu des
baisses plus accentuées entraînant ainsi une
décélération du taux de croissance de 0,7% et 1,1%
respectivement, grâce à l'application du programme de
désinflation rapide (PDR) basé d'une part sur l'assainissement
des finances publiques et d'autre part, sur le contrôle des
émissions monétaires.
Mais cette situation ne s'est pas maintenue dans les
années suivantes, suite au relâchement de politiques restrictives
menées antérieurement et à la situation de guerre
d'octobre 1996. Le taux de croissance de PIB de cette sous période s'est
élevé en moyenne de -5,3%.
La décennie 1990 a été aussi
marquée par une hyperinflation. En 1991, l'économie congolaise a
enregistré pour la première fois un taux d'inflation à
trois chiffres, atteignant ainsi son niveau le plus élevé en
1994, soit 9.796,9%.
En ce qui concerne les secteurs d'activités, la
production a nettement baisé dans presque tous les secteurs. Seul le
secteur de l'eau et de l'électricité a pu maintenir un taux de
croissance positif, soit 1,54% en moyenne. Les grandes entreprises
minières ayant connu des difficultés d'exploitation, Les volumes
de production de différents produits miniers ont fortement
reculé ; la production agricole a également baissé
suite à la persistance des contraintes structurelles notamment la
vétusté des équipements et l'état défectueux
des routes de dessertes agricoles.
Tableau 2.2. Taux de Croissance
en Volume de différents secteurs et leurs composantes (variations par
rapport à l'année précédente).
Années
Secteur d'activités
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
|
A. Secteur des Biens
|
-7.2
|
-6.3
|
-8.2
|
-2.7
|
-0.8
|
0.7
|
-0.5
|
-7.3
|
-0.7
|
-1.9
|
-8.2
|
-3.3
|
|
1. Agriculture, Sylviculture, Elevage, Chasse et
pêche
|
2.6
|
2.8
|
3.1
|
1.9
|
-0.8
|
-2.3
|
-2.8
|
-2.8
|
-1.3
|
-5.1
|
-11.7
|
-3.9
|
|
2. Extraction Minière et
Métallurgie
|
-15.6
|
-22.8
|
-36.3
|
-20.3
|
1.9
|
6.3
|
3.2
|
-14.2
|
10
|
-18.7
|
29.1
|
0.8
|
|
3. Industries Manufacturières
|
-14.6
|
-21.5
|
-27.5
|
-12.2
|
-7.4
|
9.7
|
3.3
|
-21.8
|
-7.3
|
-13.8
|
-10.9
|
-16.2
|
|
5. Bâtiment et Travaux publics
|
-39.7
|
-16.5
|
-35
|
-11.3
|
12.8
|
26.2
|
24.7
|
-30.6
|
-5
|
-32.4
|
3.5
|
6.7
|
|
6. Electivité et eau
|
3.2
|
6.2
|
7.8
|
-17.1
|
-3.3
|
6.7
|
18.9
|
-10.6
|
-4.5
|
-5.3
|
-66
|
8.6
|
|
B. Secteurs des Services
|
-5.7
|
-11.2
|
-13.6
|
-29.3
|
-10.1
|
-13
|
-29.8
|
-0.8
|
-5.3
|
-9.1
|
-6.9
|
-3.5
|
|
1. Transport et Communications
|
-27.6
|
-15.9
|
13.7
|
-25.7
|
-2.8
|
-0.6
|
-3.5
|
-4.2
|
-6.4
|
-20.4
|
28.5
|
14.1
|
|
2. Commerce
|
-2.5
|
-12
|
-9.7
|
-28.4
|
-2.2
|
-0.6
|
-0.2
|
-2
|
-12.5
|
-11.6
|
-2.3
|
-0.7
|
|
1. Services Marchands et Non Marchands
|
1.7
|
1.9
|
-5.9
|
-18.8
|
-29.7
|
-23.3
|
-0.8
|
11.7
|
-0.4
|
-27.7
|
-63.4
|
-40.3
|
|
2. Droits et taxes à
l'Importation
|
-31.6
|
-30.1
|
-48.9
|
-29
|
-2
|
47.9
|
-4.2
|
-1.5
|
26.9
|
-52.6
|
25.1
|
44.4
|
Source : BCC, rapport annuels,
95, P. 4 ; 2001, P.5
Il ressort de l'analyse de ce tableau une baisse importante de
l'activité économique dans le secteur des biens comme dans celui
des services. Une légère amélioration est constatée
en 1995 surtout dans le secteur des biens où l'on remarque des taux de
croissance positif dans activités d'extractions minières et
métallurgie ; d'industries manufacturés ; de
bâtiments et travaux publics ; d'électricité et
eau.
Mais ces taux restent négatifs dans le secteur des
services, à l'exception de celui des droits et taxes à
l'importation qui est de 47,9% contre -2,0 en 1994. Le PIB est passé de
-3,9% en 1994 à 0,7% en 1995. Cette situation ne se poursuit pas
malheureusement dans les années suivantes, l'activité bascule
à nouveau et enregistre enfin de la période un taux de croissance
négatif, soit -2,1%.
Le recul de l'activité économique qui a
caractérisé cette sous période est dû entre
autre :
Ø A l'instabilité de l'environnement
macroéconomique, caractérisé par l'hyperinflation qui a eu
comme corolaire notamment le recul de l'investissement ;
Ø Au tarissement des apports extérieurs et une
politique de charge rigide qui ont contribué à affaiblir les
capacités du pays à assurer un approvisionnement régulier
en intrants ;
Ø A la situation de guerre qu'à connu le pays
depuis 1996 et qui a favorisé l'instauration d'un climat
d'insécurité, peu propice au développement des
affaires ;
Ø Aux pillages de 1991 et 1993 qui ont provoqué
la faillite de bon nombre des entreprises et ont suscité la
méfiance dans le chef des entrepreneurs.
Ø Le changement de régime politique,
consécutif à la reprise du pouvoir par l'AFDL le 17 Mai 1997, n'a
pas permis à l'activité économique de s'améliorer,
le nouveau gouvernement n'a pas pu maitriser le cadre macroéconomique et
l'économie congolaise est restée exposée aux
déséquilibres qui ne cessaient de s'aggraver. De plus le
déclenchement de la guerre d'agression en 1998 n'a fait qu'accentuer la
fragilité de l'économie congolaise. Le tableau ci-après
résume la situation économique de 1997 à 2001.
Tableau 2.3. Evolution secteur
Réel Congolais
|
1997 1998 1999
2000 2001
|
|
Taux de croissance du PIB (en %) - 5,41
- 1,74 - 4,27 - 6,89 - 2,11
PIB/ habitant (en USD Courants) 122,84
84,17 97,96 82,59 127,32
Taux Démographique (en %)
3,29 3,40 3,19 3,37 2,69
Solde Budgétaire (en % du PIB)
- 6,0 - 2,8 - 4,4 - 6,0 - 1,7
Taux de Croissance de M2 (en %)
51,91 157,83 363,32 501,70 227,46
Taux d'inflation (en %)
13,76 134,85 483,71 511,21 135,09
Taux de change (CDF/ 1USD) 1,31
2,40 4,50 50,00 311,56
Ratio d'investissements (% de PIB) 8,10
6,50 9,60 11,20 8,10
Ratio pop. Salaire & active (en %)
24,78 29,22 28,55 28,12 35,11
Taux de chômage (en %)
70,2 65,8 66,5 66,9 49,0
|
Source : BAD et Banque Centrale du
Congo, 2001, P. 5, 66
Ce tableau révèle la situation critique dans
laquelle se trouvent tous les grandeurs macroéconomiques. On observe une
baisse continuelle de la production d'une année à l'autre ;
un amenuisement du revenu par tête et une montée de l'inflation.
La part des investissements est restée faible et le niveau de
chômage à un niveau assez élevé.
2.2. SITUATION DE
L'ECONOMIE CONGOLAISE DE 2002 A 2012
Au cours de cette sous période, l'économie
congolaise rompt avec des taux de croissance négatifs et avec la
série des taux d'inflation de trois chiffres qui ont
caractérisé la décennie précédente. En
effet, dans le domaine des prix intérieurs d'après avoir atteint
511% en 2000, le taux d'inflation est ramené à 15% en 2002, pour
se situer 21,3% en 2005 ; à 9,8% en 2010 ; à 15,4% en
2011 ; et à 6,4% en 2012. Le taux de croissance du PIB a
été de 3,5% en 2002, a atteint 7,8% en 2005 ; à 7,2%
en 2010 ; à 6,9% en 2011 ; et à 7,2% en 2012. Cette
amélioration est le résultat de l'exécution de deux
programmes successifs de stabilisation, le programme intermédiaire
renforcé (PIR) et le programme économique du gouvernement (PEG).
En somme, au cours de cette sous période, la situation de
l'économie congolaise s'est amélioré bien que dans un sens
proportionnel.
Tableau 2.4. Taux de Croissance
de PIB et taux d'inflation : 2002 - 2012
|
2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inflation 15,0 4,4 9,2 21,3
18,2 9,9 27,6 53,4 9,8 15,4 6,4
PIB 3,5 5,8 6,6 7,8
5,6 6,3 2,2 2,8 7,2 6,9 7,2
|
Source : BCC, Rapport annuels,
60
70
50
0
10
40
30
20
2002
2003
2004
2005
2007
2006
2008
2009
2010
2011
2012
Graphique 2.1. Taux de
Croissance de PIB et Taux d'inflation : 2002 - 2012
INFLATION PIB
Source : Africain Economie Outlook.org
Après plusieurs années de récession,
l'activité économique a enregistré une croissance de 3,5%
en 2002 contre un objectif de 3,0% prévu au programme triennal 2002 -
2005 (PEG). La libéralisation de plusieurs secteurs de l'économie
et la région de confiance de certains investissements ont permis
l'entrée d'importants capitaux sous formes d'investissements directs
étranger (IDE) favorisant ainsi la création de nouveaux emplois.
En effet, le taux de chômage est passé de 49,1% en 2001 à
43,2% en 2007 et à 54% en 2010, le ratio d'investissement sur le PIB
étant de 8,1% en 2001, s'est situé à 20,2% en 2007 ;
le PIB par habitant a également connu une amélioration passant de
79,3$USD en 2002 à 96,6$USD en 2009 à 100,5 en 2010 à
319$USD en 2013.
La reprise de la croissance a été rendu possible
grâce au dynamisme de différentes branches de la vie
économique notamment, l'extraction minière et industries
métallurgiques, transports et communications, bâtiments et travaux
publics, agriculture, sylviculture, chasse, pêche, élevage ainsi
que l'amélioration des droits et taxes à l'importation.
Tableau 2.5. Taux de croissance
en volume des différents secteurs et leurs composantes (variations en
pourcentage par rapport à l'année précédente).
|
Années
Secteurs d'Activités
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
I. Secteurs des biens
|
3.1
|
4.6
|
6.6
|
7.2
|
3.7
|
3.5
|
4.7
|
3.5
|
8.2
|
6.9
|
|
1. Agriculture, Sylviculture, élevage,
pêche, chasse
|
0.5
|
1.2
|
0.6
|
2.9
|
3.2
|
3.3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
2. Activité extractives et métallurgies
|
9.9
|
13.2
|
16.4
|
13.6
|
0.9
|
2.5
|
11.4
|
2.5
|
24.6
|
15.7
|
|
3. Activités de fabrications
d'électricité, de gaz et d'eau
|
6.8
|
-3.3
|
24
|
6.6
|
0.9
|
5.1
|
2.7
|
1.4
|
1.6
|
1.8
|
|
4. Production et distribution d'Electricité, gaz et
d'eau
|
2 ,8
|
8.3
|
-7.4
|
1.7
|
4.3
|
1.8
|
-4.9
|
-1.6
|
0.8
|
-2.7
|
|
5. Construction
|
11.5
|
23.8
|
22.5
|
24.1
|
13.2
|
5.4
|
3.8
|
9.1
|
9.4
|
10.3
|
|
I. Secteurs des services
|
4.9
|
8
|
7.5
|
8.7
|
9.1
|
11.1
|
9 ,9
|
2.4
|
4.1
|
5 ,5
|
|
1. Commerce de gros et détail
|
1.7
|
3.5
|
5.7
|
9.9
|
8.9
|
13.1
|
12.3
|
4.3
|
4.4
|
5.3
|
|
2. Transports, entreposage, et communications
|
21
|
27.8
|
11.3
|
10.1
|
12.5
|
10.9
|
8.4
|
2.9
|
5
|
5.7
|
|
3. Services marchands
|
6.1
|
6.2
|
8.1
|
8.5
|
7.5
|
6.9
|
4.8
|
3.5
|
3.1
|
6.9
|
|
4. Administrations publiques et défense,
sécurité sociale obligatoire
|
3.5
|
14.4
|
11.6
|
-3.5
|
5.8
|
6.2
|
4.2
|
-23
|
0.1
|
0.3
|
|
Droit et taxes à l'importation
|
16.3
|
4.7
|
11.5
|
13.7
|
14
|
19
|
15.4
|
8.5
|
13.8
|
19.2
|
|
Produit Intérieur Brut
|
3.5
|
5.8
|
6.6
|
7.8
|
5.6
|
6.3
|
6.2
|
2.8
|
7.2
|
6.9
|
Source. BCC, Rapport annuel 2010, P.33
Malgré l'amélioration de l'activité
économique qui caractérise cette sous période, nous
constatons un net ralentissement en 2009, le taux de croissance est
passé de 6,2% en 2008 à 2,8% en 2009. Ce ralentissement est
dû essentiellement aux effets de la crise économique et
financière mondiale. La demande mondiale ayant baissé et les
cours de principaux produits d'exploitations basculés, les
répercussions n'en ont pas été moindre sur les secteurs
des mines et des hydrocarbures. La RDC a été fortement
touchée par cette crise à cause entre autre de la diversification
limitée de son économie et sa dépendance vis-à-vis
de ses exportations. Les activités économiques sont
restées vulnérables aux chocs extérieurs, on notre la
hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques, la
baisse des investissements directs étrangers.
Cependant, l'exercice 2010 a malgré des effets de la crise
financière internationale, réalisé des performances qui
ont débouché sur un taux de croissance de 7,2% soutenant ainsi la
croissance amorcée depuis 2002.
2.3. Evolution des Finances
Publiques
2.3.1. Situation des
Finances Publiques de 1980 - 1989
De 1980 à 1989, la gestion des finances publiques a
été, en somme, relativement bonne. Elle a coïncide en 1980
avec l'exécution du programme de stabilisation conclu avec le fond
monétaire international. Ce programme visait entre autre
l'assainissement de la gestion financière de l'Etat par une mobilisation
plus accrue de recettes et une stricte limitation de dépenses autre que
celles nécessaires pour les rémunérations et les services
de la dette.
Dès le début de cette sous période,
particulièrement en 1980 et 1989, l'intervention des administrations
publiques dans la vie économique a été
caractérisée par un accroissement des ressources nationales
soumises à l'affection publique, alors que la charge fiscale n'a pas
connu des changements très indicatifs. En effet, le rapport entre les
dépenses publiques et le PIB commercialisé, qui permet
d'appréhender la part de l'activité soumise à
l'affectation publique s'est constamment relevée. On observe
également un net recul des déficits publics en % du PIB, soit
-14,3% en 1980, -19,5% en 1983 et 1984, et l'apparition des excédents
budgétaires en 1985, 1986 et 1989.
Tableau 2.6. Importance
Relative des Finances publiques dans l'Economie : 1980 - 1989
|
Années
|
Recettes
|
Dépenses
|
Solde
|
|
1980
|
24
|
38,3
|
-14,3
|
|
1981
|
22,3
|
38,5
|
-16,7
|
|
1982
|
23,8
|
48
|
-24,2
|
|
1983
|
22,3
|
34,8
|
-12,5
|
|
1984
|
29,9
|
47,1
|
-17,2
|
|
1985
|
33
|
25,2
|
7,8
|
|
1986
|
32
|
30,2
|
1,8
|
|
1987
|
32,8
|
38,7
|
-5,9
|
|
1988
|
39,7
|
62,3
|
-22,6
|
|
1989
|
37
|
30
|
7
|
Source. BCC, rapports annuels, 84, -85, P.140 ;
89 -90, P. 102
82
83
60
80
40
81
20
-20
-40
0
80
84
85
86
87
88
89
Graphique 2.2. Importation
relative des finances publiques dans l'économie : 1980 - 1989
RECETTES DEPENSES
SOLDE
L'assainissement des finances publiques et les
excédents budgétaires réalisés au cours de cette
période sont les effets de la discipline imposée par le programme
d'ajustement structurel de première génération, avec
notamment la promotion des politiques budgétaires et monétaires
restrictives.
De plus, il convient de signaler que pour financer son
développement, la RD Congo a eu recours aux capitaux étrangers et
l'assistance technique extérieure grâce auxquels, elle a pu se
doter d'importantes infrastructures telles que le barrage d'Inga, des ponts, la
RTNC, d'un nombre importants de diplômés dans divers domaines du
savoir, etc. Malheureusement, au terme de la décennie 80, force
était de constater que le pays , ne pouvait plus faire face
à ses engagements vis à vis de l'étranger, étant
entré dans un cycle d'endettement sans précédent d'autant
plus qu'il a accumulé et rééchelonné plusieurs
arriérés et est même de fois arrivé à
s'endetter de nouveau pour relancer la production et dégager des surplus
financières. Ainsi le paiement du service de la dette a
constitué, chaque année un poids important dans le budget de
l'état réduisant de ce fait sa capacité à soutenir
le développement socio-économique.
2.3.2. Situation des
Finances Publiques de 1990 - 2001
Au cours de cette sous période, l'économie
congolaise a connu une récession sans précédent et la
gestion des finances publiques n'est pas restée indifférente
à cette situation, les exercices budgétaires de cette sous
période sont caractérisés par un sérieux
dépassement des dépenses sur les recettes, le solde
budgétaire ayant atteint jusqu'à -15,9% du PIB en 1991.
L'aggravation du déficit s'explique par une exécution laxiste des
dépenses et par une mobilisation insuffisante des recettes. Le solde
positif apparait seulement en 1995.
Tableau 2.7. Importance
Relative des Finances Publiques dans l'Economie 1990 à 2001
|
Années
Indicateurs
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
|
Recettes publiques en % du PIB
|
9.96
|
4.94
|
3.13
|
4.1
|
3.01
|
5.35
|
5.42
|
5.17
|
6.05
|
5.01
|
3.73
|
4.73
|
|
Dépenses publiques en % du PIB
|
17.21
|
15.67
|
15.67
|
17.5
|
5.41
|
5.33
|
5.74
|
5.98
|
8.89
|
11
|
7.77
|
4, 79
|
|
Solde en % du PIB
|
-7.25
|
-12.5
|
-12.5
|
-13.4
|
-2.4
|
0.02
|
-0.32
|
-0.81
|
-2.84
|
-5.6
|
-4
|
-0.1
|
|
Stock de la Dette en % du PIB
|
119.6
|
130.1
|
146.3
|
112
|
240.2
|
271.4
|
237.7
|
217
|
226.6
|
279
|
298
|
269
|
Source : Banque Mondiale et BCC, 95, P.
64 ; 2001, P. 66, 98
Les intérêts de la dette ont continuée de
courir, le stock de la dette suspendue, la gestion des finances publiques s'est
d'avantage détériorée. En 1991, les ressources ont
progressé moins vite que les dépenses, soit respectivement 4,7%
contre 24,4%. Celle-ci a continué de ressentir de l'absence d'un cadre
institutionnel stable, de la profonde détérioration de
l'infrastructure de base et de l'outil de production. Il s'en est suivi de
graves difficultés sociales. En 1994, le dysfonctionnement de l'appareil
administratif de l'état et l'instabilité gouvernementale ont
profondément marqué la gestion de finances publiques. Cette
situation s'explique par la contreperformance dans la mobilisation des recettes
avec comme corolaire notamment la compression des dépenses publiques qui
ont été de 5,4% du PIB.
Malgré un léger excédent accusé en
1995, la gestion des finances publiques s'est fortement
détériorée les années qui ont suivi, influence par
la situation de guerre qui a conduit en Mai 1997 à d'importants
changements politiques dans la direction du pays. Elle a enregistré des
résultats très mitigés, en dépit d'efforts
réels consentis pour leur ajustement, le solde global des
opérations du cadre budgétaire s'est encore
détérioré. Le déficit s'est établi à
1,9% en 1997 contre 1,2% en 1996. Le recours aux avances du système
bancaire a été le principal mode de financement du déficit
public.
Tableau 2.8. Situation des
Finances Publiques : 1990 - 2001
Années Recettes
Dépenses Solde
1990 10,1 16,9 -6,8
1991 4,7 24,4 -19,7
1992 2,7 15,3 -12,6
1993 3,5 18 -14,5
1994 2,6 5,4 -2,8
1995 4,5 4,4 0,1
1996 3,8 5,7 -2,9
1997 4,1 6 -1,9
1998 5,3 9,1 -3,8
1999 3,5 10,6 -7,1
2000 3,5 8,5 -5
2001 4,7 4,8 -0,1
Source : BCC, Rapports Annuels, 95, P. 64 ;
2001, P. 66
RECETTES DEPENSES
SOLDE
Graphique 2.3. Situation des
Finances Publiques : 1990 - 2001
90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 00 01
L'abondance des moyens de paiement sur le marché au cours
de cette sous période est dû au fait que les dépenses
courantes, entre autre les dépenses de consommation, ont
été plus exécutées que les dépenses en
capital. Les énormes déficits qu'à connu le pays, durant
cette sous période et, leur monétisation ont contribué
à la dégradation non seulement du tissu économique mais
aussi de celle encore plus prononcée des conditions de vie de la
population. Le financement monétaire des déficits publics par les
avances du système bancaire en RD Congo a été à la
baisse de l'hyperinflation qui a atteint le sommet record de 9.796,9% en
1994.
Dans le but de lutte contre l'hyperinflation, le programme de
désinflation rapide (PDR) a conduit à une politique
budgétaire restrictive et le principe d'unicité de centre
d'ordonnancement des dépenses, confié traditionnellement au
Ministère des finances étant réaffirmé, les
restrictions des dépenses ont permis aux finances publiques d'atteindre
un niveau assez soutenable entre 1995 et 1996.
Mais les séries de guerre qu'à connu le pays
entre 1996 et 2000, ont renversé les tendances à causes des
dépenses de souveraineté ramenant ainsi le solde
budgétaire à -5,1% du PIB en 1999.
2.3.3. Situation des
Finances Publiques de 2002 - 2012
La gestion des finances publiques a été, en
somme, satisfaisante au cours de cette sous période. La reprise des
activités économiques et le retour des taux de croissance
positifs ont permis d'élever le niveau des recettes publiques. Le
recours aux avances de la banque centrale pour le financement des
déficits a été sensiblement réduit, le stock de la
dette également a considérablement été
réduit passant de 205,2% du PIB en 2003 à 30,7% en 2010.
Tableau 2.9. Importance
Relative des Finances Publiques dans l'Economie : 2002 - 2012
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
Recettes publiques en % du PIB
|
7,69
|
9,63
|
11,77
|
14,58
|
14,18
|
14,76
|
18,48
|
18,63
|
19,34
|
|
Dépenses publiques en % du PIB
|
6,77
|
10,12
|
12,89
|
15,46
|
15,04
|
15,02
|
18,95
|
17,98
|
17,8
|
|
Solde en % du PIB
|
0,92
|
-0,49
|
-1,12
|
-0,86
|
-2,6
|
-0,26
|
-0,47
|
0,65
|
1,54
|
|
Crédit à l'Etat en % du PIB
|
-0,52
|
-0,49
|
-0,88
|
3,27
|
2,48
|
3,42
|
3,81
|
1,91
|
0,35
|
|
Stock de la dette en % du PIB
|
191,6
|
205,2
|
181,2
|
155,2
|
135,2
|
132,7
|
118,2
|
192,2
|
30,7
|
Source : BCC, Rapports Annuels,
2004 - 2005, P. 119 ; 2009, P. 93
L'exécution du programme intermédiaire
renforcé et d'autres programmes politiques ont permis au
gouvernement congolais de restructurer les niveaux des soldes
budgétaires qui sont restés inférieures à -2%
et qui ont des fois même été positifs, soit 0,9%, 0,7% et
1,5% respectivement en 2002, 2009 et 2010.
Ce sont, notamment, ces critères de performances qui
ont conduit à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative en
faveur des pays pauvres très endetté (I-PPTE) en 2010. En effet,
après plusieurs années de suspension de la coopération
avec la communauté financière internationale, la RD Congo a
réussi à restructurer sa dette extérieure. Ce qui a permis
le retour de l'aide publique au développement (APD), le
redémarrage du paiement de la dette extérieure et l'admission
à l'I - PPTE.
La rigueur qui a caractérisé la gestion des
finances publiques en 2009 a permis au pays d'atteindre au mois de juillet de
l'année 2010, le point d'achèvement de l'I - PPTE. La dette de la
RD Congo a été allégée de 12,3 milliards USD, les
conseils d'administration de la FMI et de la Banque Mondiale estimant que la
RDC avait appliqué des mesures politiques requises pour atteindre le
point d'achèvement, un stade auquel l'allègement de la dette
devient irrévocable.
2.4. EVOLUTION DES
DEPENSES PUBLIQUES D'EDUCATION EN RD CONGO
L'aspect original du financement de l'éducation en
République Démocratique du Congo réside dans le niveau
élevé des financements privés à tous les niveaux de
l'enseignement, y compris dans le primaire. Cette situation représente
un changement marqué par rapport à celle qu'il y a plusieurs
décennies, lorsque l'éducation était hautement prioritaire
dans les dépenses de l'Etat.
Néanmoins, bien que le montant total des financements
privés ait dépassé celui des financements publics,
(analyse des dépenses de l'Etat demeure importante, d'autant plus que
l'accroissement de ces dernières peuvent améliorer la
qualité de l'éducation qui est l'un des objectifs primordiaux
inscrit parmi les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD).
2.4.1. Situation des
Dépenses Publiques d'Education de 1980 - 1989.
Tableau 2.10. Evolution des
dépenses courantes et en capital de l'éducation en % des
dépenses publiques totales : 1980 - 1989
|
Années
|
Dépense publiques
d'éducation (Milliers de CDF)
|
Dépense publiques
Courantes d'éducation (Milliers de CDF)
|
Dépense publiques
d'éducation en capital (Milliers de CDF)
|
|
1980
|
933 722,000 000 0
|
912 908,000 000 0
|
20 814,000 000 0
|
|
1981
|
1 631 090,000 000 0
|
1 604 098,000 000 0
|
26 992,000 000 0
|
|
1982
|
1 818 150,000 000 0
|
1 741 525,000 000 0
|
76 625,000 000 0
|
|
1983
|
1 713 523,500 000 0
|
1 672 811,000 000 0
|
40 712,000 000 0
|
|
1984
|
309 905,000 000 0
|
236 251,000 000 0
|
73 653,000 000 0
|
|
1985
|
208 041,000 000 0
|
168 018,000 000 0
|
40 023,000 000 0
|
|
1986
|
506 133,000 000 0
|
455 400,000 000 0
|
50 733,000 000 0
|
|
1987
|
525 749,000 000 0
|
195 689,000 000 0
|
330 060,000 000 0
|
|
1988
|
14.434 017,000 000 0
|
13 785 597,000 000 0
|
648 420,000 000 0
|
|
1989
|
4 845 525,000 000 0
|
227 555 9
|
2 566 966,000 000 0
|
Source : Nos calculs sur base des données
de la BCC, Rapports Annuels, 1985 P. 152, 156 ; 1989, P. 113, 116
Graphique 2.4. Evolution des
dépenses courantes et en capital de L'éducation en % des
dépenses publiques totales : 1980 - 1989.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
16 000 000,000 000 0
14 000 000,000 000 0
12 000 000,000 000 0
10 000 000,000 000 0
8 000 000,000 000 0
6 000 000,000 000 0
4 000 000,000 000 0
2 000 000,000 000 0
Dépenses publiques d'éducation (Milliers
de CDF) ;
Dépenses publiques courantes d'éducation
(Milliers de CDF) ;
Dépenses publiques d'éducation en
capital (Milliers de CDF).
La lecture de cette figure nous révèle qu'au
cours de la période allant de 1980 à 1989, les dépenses
publiques de l'éducation n'ont pas occupé une place de choix dans
le budget de l'Etat. Les dépenses courantes ont largement
dépassé les dépenses en capital. Ces derniers ont
été exécutés en moyenne de 0,14% du PIB et n'ont
pas réussi à atteindre 1% des dépenses publiques. La
promotion des politiques budgétaires et monétaires restrictives
par les organismes financiers internationaux dans le cadre de la mise en oeuvre
du programme d'ajustement structurel, a permis certes d'assainir les finances
publiques, mais au prix d'une compression des dépenses publiques en
capital de manière général et celles de l'éducation
en particulier qui ont connu une baisse sensible jusqu'à se situer
à 0,09% des dépenses publiques en 1986.
Tableau 2.11 : Evolution
des dépenses courantes en capital de l'éducation en % des
dépenses publiques totales : 1990 - 2001.
|
Années
|
Dépense publiques
d'éducation (Milliers de CDF)
|
Dépense publiques
Courantes d'éducation (Milliers de CDF)
|
Dépense publiques
d'éducation en capital (Milliers de CDF)
|
|
1980
|
9 861 138,000 000 0
|
6 161 507,000 000 0
|
3 699 631,000 000 0
|
|
1981
|
159 011,000 000 0
|
118 015,000 000 0
|
40 996,000 000 0
|
|
1982
|
11 327 905,000 000 0
|
10 911 46,000 000 0
|
416 359,000 000 0
|
|
1983
|
24 663 197,000 000 0
|
24 659 397,000 000 0
|
3 800,000 000 0
|
|
1984
|
1 703,000 000 0
|
1 703,000 000 0
|
0,000 000 0
|
|
1985
|
25 161,000 000 0
|
25 161,000 000 0
|
0,000 000 0
|
|
1986
|
1 553,640 000 0
|
1 355,240 000 0
|
198,400 000 0
|
|
1987
|
1 440,890 000 0
|
770,990 000 0
|
669,900 000 0
|
|
1988
|
1 398,000 000 0
|
1 398,000 000 0
|
0,000 000 0
|
|
1989
|
19 296,000 000 0
|
19 296,000 000 0
|
0,000 000 0
|
|
1999
|
21 856,000 000 0
|
21 856,000 000 0
|
0,000 000 0
|
|
2001
|
191 654,000 000 0
|
191 654,000 000 0
|
0,000 000 0
|
Source : Nos calculs sur base des données de
la BCC, Rapports Annuels, 1995, P. 73, 76 ; 2001, P. 75, 78
Graphiques 2.5. Evolution des
dépenses courantes et en capital de l'éducation en % des
dépenses publiques totales : 1990 - 2001
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
35 000 000,000 000 0
30 000 000,000 000 0
25 000 000,000 000 0
20 000 000,000 000 0
15 000 000,000 000 0
10 000 000,000 000 0
5 000 000,000 000 0
0,000 000 0
Dépenses publiques d'éducation
(Milliers de CDF) ;
Dépenses publiques courantes
d'éducation (Milliers de CDF) ;
Dépenses publiques d'éducation
en capital (Milliers de CDF).
2.4.2. Situation des
Dépenses Publiques d'Education de 2002 - 2012
La part des dépenses publiques en éducation dans
le budget de l'Etat, au cours de cette sous période est restée
insignifiante malgré la reprise des activités économiques
et la réapparition des taux de croissance positifs depuis 2002. Elle a
représenté en moyenne 1,4% des dépenses courantes de
l'éducation qui ont représenté en moyenne 0,75% ;
celle en capital ont représenté en moyenne 0,77% des
dépenses totales et ont atteint un sommet record en 2009, soit 2,2% des
dépenses publiques.
Toutefois, ce niveau n'est pas toujours significatif pour
stimuler une forte accumulation du capital humain et déclencher une
croissance économique autoentretenue, stade et durable.
Tableau 2.12. Evolution des
dépenses courantes et en capital de l'éducation en % des
dépenses publiques totales : 2002 - 2012
|
Années
|
Dépense publiques
d'éducation en capital (Milliers de CDF)
|
Dépense publiques
Courantes d'éducation (Milliers de CDF)
|
Dépense publiques
d'éducation (Milliers de CDF)
|
|
2002
|
12 101,000 000 0
|
342 053,000 000 0
|
354 154
|
|
2003
|
6 000,000 000 0
|
831 381,000 000 0
|
837 381
|
|
2004
|
670,000 000 0
|
1 303 397,000 000 0
|
1 303,397
|
|
2005
|
2 015 010,000 000 0
|
1 606 151,000 000 0
|
3 631 161
|
|
2006
|
1 928 610,000 000 0
|
1 816 742,000 000 0
|
3 745 352
|
|
2007
|
2 996 925,000 000 0
|
17 254 437,000 000 0
|
20 337 362
|
|
2008
|
3 481 041,000 000 0
|
19 856 309,000 000 0
|
23 337 350
|
|
2009
|
26 760,504
|
1 042 228,000 000 0
|
27 802 732
|
Source : Nos calculs sur base des
données de la BCC, Rapports Annuels, 2004 - 2005, P. 132, 135 ;
2009, P. 107
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Graphique 2.6. Evolution des
dépenses courantes et en capital de l'éducation en % des
dépenses publiques totales : 2002 - 2012
30 000 000,000 0
25 000 000,000 0
20 000 000,000 0
15 000 000,000 0
10 000 000,000 0
5 000 000,000 0
Dépenses publiques d'éducation en
capital (Milliers de CDF) ;
Dépenses publiques courantes
d'éducation (Milliers de CDF) ;
Dépenses publiques d'éducation
(Milliers de CDF).
Il convient de signaler que les dépenses publiques de
l'éducation présentée ci-haut concernant tous les niveaux
de l'enseignement en RD Congo et sont relatives aux prévisions
budgétaires. En ce qui concerne l'exécution du budget, la
situation est encore plus lamentable, on a exécuté très
souvent moins que ce que l'on a prévu. Les dépenses en capital,
par exemple, a représenté d'après le budget
exécuté en moyenne 0,19% pour la sous période 2002 -
2010.
CHAPITRE TROISIEME
ANALYSE EMPIRIQUE DES DEPENSES PUBLIQUES EN EDUCATION SUR LA
CROISSANCE ECONOMIQUE DE LA RDC
Ce troisième chapitre est résolument
économétrique. Cette étape du travail se distingue des
précédentes par l'étude de cas exposé, qui utilise
systématiquement des données réelles portant sur les
quatre variables en études, notamment la Croissance du PIB en % annuel,
le taux de Scolarisation primaire, taux de Scolarisation Secondaire et les
dépenses Publiques d'investissement en éducation en % des
dépenses publiques totales.
Cette étape se distingue également des
précédentes par la place qu'elle accorde à expliquer
comment les quatre variables se sont comportées durant la période
d'étude en utilisant un modèle très sophistiqué dit
(Vecteur auto régressif).
Car la validité d'une étude
économétrique dépend de la pertinence de la
spécification du modèle estimé ; il est vain de
vérifier une relation économétrique si on l'applique
à des modèles incohérents.
3.1. Spécification
du modèle
Le fondement théorique du modèle utilisé
est la fonction de production obtenue par Mankiw et al.(1992) par
l'amélioration du modèle de Solow en y incluant l'accumulation du
capital humain compte tenu des hypothèses des théories de la
croissance :
 (1) (1)
Où y est la production ; k le stock de capital
physique, L la force de travail, H le stock de capital humain et A
l'état de la technologie disponible.  et et  sont des paramètres positifs tels que sont des paramètres positifs tels que  + +  = 1. = 1.
De cette équation découlent les nombreux
modèles. Ce modèle empirique sera testé dans le cadre de
notre travail, s'écrit de la façon suivante :
  + +  + + 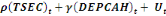 (2) (2)
Avec :
· TPIB : Croissance du PIB en %
· TPRIM : Taux de Scolarité au
primaire,
· TSEC : Taux de Scolarité au
Secondaire ;
· DEPCAH : Dépenses Publiques
d'investissement en éducation en % des dépenses publiques
totales.
 · le terme d'erreur · le terme d'erreur
Sous la forme estimable, le modèle se présente
comme suit ; avec entre parenthèses les signes attendus :
 (3) (3)
3.2. Notions de base sur la modélisation VAR29(*)
Dans l'utilisation des techniques quantitatives pour la
prévision, les modèles uni-équationnels ont
été peu à peu laissés de coté au profit des
modèles simultanés multi-équationnels. Ainsi dans les
modèles d'équations à système simultanés,
certaines variables sont considérées comme endogènes et
d'autres comme exogènes. Pour estimer ces modèles
simultanés, l'on doit s'assurer au préalable de l'identification
de chaque équation du modèle. A cet effet des restrictions
étaient imposées sur :
· Des paramètres avec notamment le principe de
normalisation ;
· Les variables dont quelques unes devraient être
absentes dans certaines équations
Or, le principe de simultanéité peut être
discutable. En effet, s'il y a véritablement simultanéité
dans les relations d'un modèle, logiquement il n'y aurait pas eu lieu
de faire la distinction entre variables endogènes et variables
exogènes ; toutes les variables devraient être
considérées comme endogènes.
Sur base de toutes ces considérations, une nouvelle
classe d'économètres s'est mise à la recherche d'autres
formes fonctionnelles plus adéquates. C'est dans ce contexte que survint
la modélisation vectrice autorégressive (VAR), qui tente de
relier les variables en se basant sur l'évolution des
données-elles-mêmes.
La conception de base de la modélisation VAR est de
relier les variables dans une vectrice auto régressive d'un ordre
donné mettant les variables dans un cadre relationnel. D'autre part,
à cause de la particularité de ses différentes parties
aléatoires, la modélisation VAR est utilisée dans le cadre
de l'analyse des impacts et de la causalité.
De ce fait, le modèle VAR repose sur l'idée
selon laquelle toutes les variables présentées dans le
modèle sont endogènes et les erreurs de chaque équation
sont corrélées.
3.3. Forme fonctionnelle du
modèle VAR utilisé
Le modèle VAR utilisé dans ce travail s'appuie
sur un modèle à quatre variables, mettant en relation la
Croissance du PIB, le taux de Scolarisation primaire, taux de Scolarisation
Secondaire et les dépenses Publiques d'investissement en
éducation dans les dépenses publiques totales.
Construisons le modèle suivant à q
décalages :
 (4) (4)
 (5) (5)
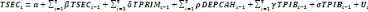 (6) (6)
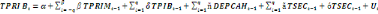 (7) (7)
La première équation postule que la croissance
économique est fonction de ses valeurs décalées de taux de
scolarité primaire, secondaire et des dépenses publiques en
éducation et des valeurs courantes de taux de scolarité primaire,
secondaire et des dépenses publiques en éducation.
La deuxième équation postule quant à elle
que les dépenses publiques en éducation est fonction des valeurs
décalées de la croissance économique, de ses propres
valeurs décalées, de taux de scolarité primaire,
secondaire et enfin des valeurs courantes de la croissance économique,
de taux de scolarité primaire, secondaire.
La troisième équation postule quant à
elle que Le taux de scolarité secondaire est fonction des valeurs
décalées de la croissance économique, de ses propres
valeurs décalées, de taux de scolarité primaire,
dépenses publiques en éducation et enfin des valeurs courantes de
la croissance économique, de taux de scolarité primaire,
dépenses publiques en éducation.
La quatrième et la dernière équation
postule quant à elle que Le taux de scolarité primaire est
fonction des valeurs décalées de la croissance
économique, de ses propres valeurs décalées, de taux de
scolarité secondaire, dépenses publiques en éducation et
enfin des valeurs courantes de la croissance économique, de taux de
scolarité secondaire, dépenses publiques en éducation.
Donc, les quatre équations constituent la forme
fonctionnelle de notre modèle VAR. Il sied de rappeler que le
décalage optimal sera déterminé en passant par les
critères d'Akaike et Schwartz.
3.4. Estimation du modèle et interprétation des
résultats
Une fois représentée par la forme fonctionnelle
adéquate ; la relation théorique c'est-à-dire le
modèle, peut être confrontée aux données
observées, il s'agit de vérifier leur caractère explicatif
de la réalité et de mesurer concrètement la valeur de
leurs paramètres. Il est alors possible de calculer le taux de
réaction des variables.
Les données observées peuvent être des
séries temporelles, des données en coupe instantanée ou
des données de panel. Mais en ce qui nous concerne, nos données
sont belles et bien des séries temporelles ou séries
chronologiques.
3.4.1. Présentation et traitement des
données.
Un processus peut être défini comme étant
une collection des variables aléatoires ordonnées dans le temps.
Ainsi des séries temporelles telles que la Croissance du PIB en %
annuel, le taux de Scolarisation primaire, taux de Scolarisation Secondaire et
les dépenses Publiques d'investissement en éducation en % des
dépenses publiques totales de la RDC couvrant la période 1980
à 2012 peuvent être considérées comme les
réalisations d'un processus aléatoire.
Le processus aléatoire qui intéresse tout
particulièrement les analystes des séries chronologiques est
« le processus stationnaire «, c'est-à-dire le processus
dans lesquels les données fluctuent autour de la moyenne constante
indépendamment du temps ;
Si une série chronologique ou
temporelle est stationnaire au sens défini ci-haut alors sa moyenne, sa
variance et son auto-covariance sur différents décalages restent
constantes quelque soit le moment où ces valeurs sont calculées.
La série chronologique qui ne vérifie pas ces conditions est dite
non stationnaire. Etant donné que c'est le processus stationnaire qui
retient l'attention des analystes, nous allons dans ce point procéder
par la stationnarisation de nos séries temporelles notamment la
Croissance du PIB en % annuel, le taux de Scolarisation primaire, taux de
Scolarisation Secondaire et les dépenses Publiques d'investissement en
éducation en % des dépenses publiques totales.
De tout ce qui précède, nous disons que la
résolution de nos séries temporelles par le modèle
« VAR » se fera à travers les étapes
suivantes :
· Vérification de la
stationnarité ;
· Détermination du nombre de retard
(décalage) optimal du modèle VAR ;
· Estimation des paramètres du
modèle ;
· Teste de la causalité de Granger ;
· Analyse de dynamique du VAR ;
· Prévision du modèle.
3.4.1.1. Stationnarité Des Variables
Cette étude se fera variable par variable. Pour ce faire,
nous allons recourir à l'analyse de leur graphique et au test de racine
unitaire ou de Dickey Fuller.
a) Le taux de croissance du PIB (TPIB)
Nous avons choisi d'utiliser le taux de croissance du PIB en %
comme indicateur de la croissance tels que récoltés dans les
différents rapports annuels de la Banque Centrale du Congo et de la
Banque Mondiale.
Graphique n°1 non stationnarité de la croissance
économique du PIB

A partir de ce graphique nous analysons l'évolution du
taux de croissance et nous remarquons que celui-ci à une tendance mais
qui se traduit à la hausse, alors cela nous amène à
présumer que le taux de croissance n'est pas stationnaire. Alors nous
allons stationnariser la variable taux de croissance en recourant aux
différenciations de test de Dickey Fuller Augmenter.
Ici nous observons que la variable taux
de croissance est stationnaire à la première différence
car la statistique en valeur absolue d'ADF est supérieure à celle
de Mackinnon au seuil de 5% (5.96 ? 3,56) mais cette stationnarité est
du type Tendance stochastique (DS) car la probabilité associée
à la tendance n'est pas significative.
Graphique n°2 stationnarité de la croissance
économique du PIB
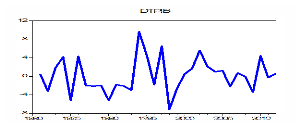
Ce graphique nous montre que la variable taux de croissance
est maintenant stationnaire.
b) Taux de Scolarisation primaire (TPRIM)
Pour cet indicateur les données ont été
puisées dans les différents rapports de la Banque Mondiale et
Banque Centrale.
Graphique n°3
stationnarité du Taux de Scolarisation primaire

Ici nous observons que la variable taux de scolarisation
primaire est stationnaire à niveau car la statistique en valeur absolue
d'ADF est supérieure à celle de Mackinnon au seuil de 5% (7.37 ?
3,55) mais cette stationnarité est du type Tendance stochastique (DS)
car la probabilité associée à la tendance n'est pas
significative.
c) Taux de Scolarisation Secondaire (TSEC)
Pour cet indicateur les données ont été
puisées dans les différents rapports de la banque mondiale et
banque centrale.
Graphique n°4
stationnarité du Taux de Scolarisation Secondaire

Ici nous observons que la variable taux de scolarisation
secondaire est stationnaire à niveau car la statistique en valeur
absolue d'ADF est supérieure à celle de Mackinnon au seuil de 5%
(4.86 ? 4.27) mais cette stationnarité est du type Tendance stochastique
(DS) car la probabilité associée à la tendance n'est pas
significative.
d) dépenses Publiques d'investissement en
éducation en % des dépenses publiques totales. (DEPCAH)
Pour cet indicateur les données ont été
puisées dans les différents rapports de la Banque Mondiale et
Banque Centrale.
Graphique 5
stationnarité dépenses Publiques d'investissement en
éducation
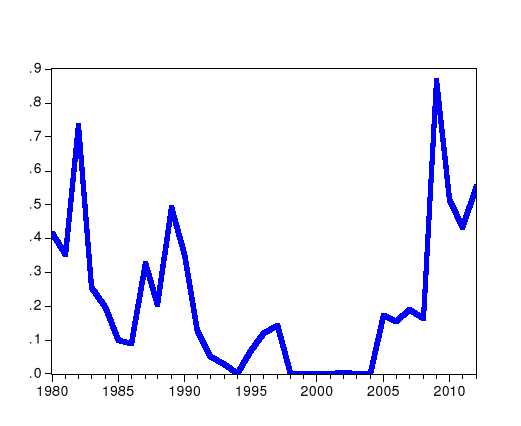
Ici nous observons que la variable
dépenses Publiques d'investissement en éducation est stationnaire
à la première différence car la statistique en valeur
absolue d'ADF est supérieure à celle de Mackinnon au seuil de 5%
(7.95 ? 3,56) mais cette stationnarité est du type Tendance stochastique
(DS) car la probabilité associée à la tendance n'est pas
significative. Voici le graphique de la stationnarité ci
après :

Tous Ces graphiques nous montrent que les variables sont
maintenant stationnaires.
3.3.1.2. Décalage optimale du modèle VAR
|
Endogenous variables: DTPIB TPRIM TSEC
DDEPCAH
|
|
|
|
|
Exogenous variables: C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lag
|
LogL
|
LR
|
FPE
|
AIC
|
SC
|
HQ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
-386.6279
|
NA*
|
5888175.*
|
26.93986*
|
27.12845*
|
26.99892*
|
|
1
|
-378.5986
|
13.28981
|
10344542
|
27.48956
|
28.43252
|
27.78489
|
|
2
|
-368.4773
|
13.96046
|
16653576
|
27.89499
|
29.59232
|
28.42657
|
|
3
|
-357.7653
|
11.82020
|
28984764
|
28.25967
|
30.71138
|
29.02752
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* indicates lag order selected by the
criterion
|
|
|
|
|
LR: sequential modified LR test statistic (each
test at 5% level)
|
|
|
|
FPE: Final prediction error
|
|
|
|
|
|
AIC: Akaike information criterion
|
|
|
|
|
|
SC: Schwarz information criterion
|
|
|
|
|
|
HQ: Hannan-Quinn information criterion
|
|
|
|
Pour trouver le décalage optimale nous allons faire
recours aux critères (AKAIKE ET SCHWARZ) ces deux critères nous
permettra de minimiser le nombre de paramètres dans le modèle et
c'est celui qui sera choisi, le décalage minimise les deux
critères à un Lag de 0 mais vu que le modèle exige un auto
régressif des équations nous considérons directement le
Lag 1 qui constitue notre première décalage.
3.3.1.3. Estimation du modèle retenu de l'estimation
du modèle vectoriel autorégressif VAR (-1) avec la constante.
|
Vector Autoregression Estimates
|
|
|
|
Date: 09/15/13 Time: 16:55
|
|
|
|
Sample (adjusted): 1982 2012
|
|
|
|
Included observations: 31 after
adjustments
|
|
|
Standard errors in ( ) & t-statistics in [
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DTPIB
|
TPRIM
|
TSEC
|
DDEPCAH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DTPIB(-1)
|
-0.120691
|
0.554986
|
12.41863
|
0.006116
|
|
(0.19604)
|
(0.52364)
|
(14.6639)
|
(0.00990)
|
|
[-0.61566]
|
[ 1.05986]
|
[ 0.84688]
|
[ 0.61778]
|
|
|
|
|
|
|
TPRIM(-1)
|
0.056248
|
-0.262688
|
-6.080605
|
-0.001360
|
|
(0.06891)
|
(0.18407)
|
(5.15479)
|
(0.00348)
|
|
[ 0.81623]
|
[-1.42708]
|
[-1.17960]
|
[-0.39073]
|
|
|
|
|
|
|
TSEC(-1)
|
0.001398
|
-0.002767
|
0.205017
|
0.000163
|
|
(0.00251)
|
(0.00671)
|
(0.18783)
|
(0.00013)
|
|
[ 0.55661]
|
[-0.41245]
|
[ 1.09148]
|
[ 1.28486]
|
|
|
|
|
|
|
DDEPCAH(-1)
|
0.370240
|
13.60800
|
-59.77445
|
-0.375207
|
|
(3.53693)
|
(9.44768)
|
(264.572)
|
(0.17861)
|
|
[ 0.10468]
|
[ 1.44035]
|
[-0.22593]
|
[-2.10075]
|
|
|
|
|
|
|
C
|
0.348764
|
0.766530
|
-124.4712
|
0.034114
|
|
(0.82381)
|
(2.20051)
|
(61.6229)
|
(0.04160)
|
|
[ 0.42336]
|
[ 0.34834]
|
[-2.01989]
|
[ 0.82004]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R-squared
|
0.042198
|
0.155672
|
0.127589
|
0.208570
|
|
Adj. R-squared
|
-0.105156
|
0.025776
|
-0.006628
|
0.086812
|
|
Sum sq. resids
|
408.0979
|
2911.805
|
2283486.
|
1.040652
|
|
S.E. equation
|
3.961827
|
10.58265
|
296.3552
|
0.200063
|
|
F-statistic
|
0.286370
|
1.198433
|
0.950619
|
1.712983
|
|
Log likelihood
|
-83.93865
|
-114.3965
|
-217.6991
|
8.622072
|
|
Akaike AIC
|
5.737978
|
7.702999
|
14.36768
|
-0.233682
|
|
Schwarz SC
|
5.969266
|
7.934287
|
14.59897
|
-0.002394
|
|
Mean dependent
|
0.151613
|
1.070323
|
-162.3877
|
0.006474
|
|
S.D. dependent
|
3.768631
|
10.72173
|
295.3779
|
0.209356
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Determinant resid covariance (dof adj.)
|
5357403.
|
|
|
|
Determinant resid covariance
|
2650946.
|
|
|
|
Log likelihood
|
-405.2000
|
|
|
|
Akaike information criterion
|
27.43226
|
|
|
|
Schwarz criterion
|
28.35741
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C'est le modèle par principe de parcimonie qui comporte
moins des paramètres possibles.
3.3.1.4. Test de Causalité d'Engel et Granger
L'un des inconvénients des modèles
économétriques est de déceler les corrélations
superflues, qui sont simplement fausses ou sans significations. C'est ainsi que
la corrélation ne signifie pas nécessairement causalité
(entre deux ou plusieurs séries économiques).
En effet, au sens de Granger, on dit : « qu'une variable
y cause la variable x au sens de Granger si et seulement si la connaissance du
passé de y améliore la prévision de x à tout
horizon ».
|
Pairwise Granger Causality Tests
|
|
Date: 09/15/13 Time: 17:15
|
|
Sample: 1980 2012
|
|
|
Lags: 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Null Hypothesis:
|
Obs
|
F-Statistic
|
Prob.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TPRIM does not Granger Cause DTPIB
|
31
|
0.56379
|
0.4590
|
|
DTPIB does not Granger Cause TPRIM
|
0.66886
|
0.4204
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TSEC does not Granger Cause DTPIB
|
31
|
0.20486
|
0.6543
|
|
DTPIB does not Granger Cause TSEC
|
0.60978
|
0.4414
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DDEPCAH does not Granger Cause DTPIB
|
31
|
0.01261
|
0.9114
|
|
DTPIB does not Granger Cause DDEPCAH
|
0.48039
|
0.4940
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TSEC does not Granger Cause TPRIM
|
32
|
0.01846
|
0.8929
|
|
TPRIM does not Granger Cause TSEC
|
1.37537
|
0.2504
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DDEPCAH does not Granger Cause TPRIM
|
31
|
1.64637
|
0.2100
|
|
TPRIM does not Granger Cause DDEPCAH
|
0.29076
|
0.5940
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DDEPCAH does not Granger Cause TSEC
|
31
|
0.08605
|
0.7714
|
|
TSEC does not Granger Cause DDEPCAH
|
2.11680
|
0.1568
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La relation entre les variables peut être définie
en terme de relation unidirectionnelle, lorsque la causalité entre deux
variables se définit dans un seul sens. Et une relation bidirectionnelle
en ce sens que la causalité entre deux variables s'identifie dans les
deux sens (relation symétrique). Ainsi les hypothèses sont
posées comme suit :
H0 : Il n'y a pas causalité au sens de
Granger
H1 : Il y a causalité au sens de
granger
Le tableau ci-haut montre qu'a court terme la relation entre
le taux de croissance économique du PIB et le taux de scolarité
primaire, secondaire, dépenses publiques d'investissement en
éducation n'est pas justifiée. Car on remarque que la
probabilité de la statistique de Fisher est supérieure à
5%. D'où, nous sommes tentés d'accepter H0 soutenant
l'absence de la causalité au sens de granger.
3.3.1.5. Analyse de la réponse Impulsionnelle
Nous allons analyser les chocs au moyen de la fonction de
réponse impulsionnelle, cette fonction montre comment l'effet des chocs
se répercute à un horizon prévisionnel de h période
sur les variables du modèle (TPIB, TPRIM, TSEC et DEPCAH). Les
graphiques suivant nous en donnent le résultat :

L'analyse des chocs montre que lorsque les résidus de
la croissance économique baissent, et ça se trouve dans la zone
négative, TPRIM, TSEC et DEPCAH atteint la zone négative
c'est-à-dire sa dégradation. Mais au fur et à mesure qu'on
observe cette baisse de la croissance économique, TPRIM, TSEC et DEPCAH
tentent de reprendre l'équilibre mais dans le long et moyen terme
c'est-à-dire dans trois, quatre et Huit ans. Quand aux innovations dans
le secteur éducatif que L'Etat y consacre plus des moyens la situation
ne perdurera pas dans le long terme, Les graphiques ci - après nous en
donnent la certitude :

3.3.1.6. Décomposition du modèle VAR
La décomposition de la variance totale de l'erreur de
prévision est important dans ce sens que si celle-ci augmente, nous
montrerons sa contribution à sa variable endogène, mais ici si
l'innovation est de 1% sur la valeur de la prévision quel serait
l'impact de l'autre variable en observant son évolution dans le
temps.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Period
|
S.E.
|
DTPIB
|
TPRIM
|
TSEC
|
DDEPCAH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3.961827
|
100.0000
|
0.000000
|
0.000000
|
0.000000
|
|
2
|
4.025881
|
97.59505
|
1.393617
|
0.978383
|
0.032952
|
|
3
|
4.044287
|
96.93092
|
2.007292
|
0.969991
|
0.091795
|
|
4
|
4.047766
|
96.77392
|
2.055151
|
0.999286
|
0.171644
|
|
5
|
4.048653
|
96.73222
|
2.065114
|
1.003258
|
0.199412
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Period
|
S.E.
|
DTPIB
|
TPRIM
|
TSEC
|
DDEPCAH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
10.58265
|
2.702396
|
97.29760
|
0.000000
|
0.000000
|
|
2
|
11.28885
|
3.540740
|
90.39773
|
0.400032
|
5.661494
|
|
3
|
11.46493
|
3.442620
|
88.08318
|
0.938537
|
7.535665
|
|
4
|
11.50464
|
3.418897
|
87.56574
|
1.009963
|
8.005399
|
|
5
|
11.51381
|
3.414277
|
87.43659
|
1.030688
|
8.118441
|
|
|
|
|
|
|
|
Period
|
S.E.
|
DTPIB
|
TPRIM
|
TSEC
|
DDEPCAH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
296.3552
|
1.084048
|
7.377078
|
91.53887
|
0.000000
|
|
2
|
316.0974
|
3.151459
|
12.90153
|
83.80768
|
0.139326
|
|
3
|
317.0170
|
3.153048
|
12.86676
|
83.66254
|
0.317646
|
|
4
|
317.1996
|
3.157134
|
12.90827
|
83.56736
|
0.367236
|
|
5
|
317.2472
|
3.156228
|
12.90795
|
83.54812
|
0.387708
|
|
|
|
|
|
|
|
Period
|
S.E.
|
DTPIB
|
TPRIM
|
TSEC
|
DDEPCAH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0.200063
|
2.582242
|
0.006773
|
0.066903
|
97.34408
|
|
2
|
0.223082
|
5.125804
|
1.572412
|
3.989009
|
89.31278
|
|
3
|
0.224552
|
5.289043
|
1.579545
|
3.965277
|
89.16614
|
|
4
|
0.224787
|
5.320491
|
1.598595
|
3.978923
|
89.10199
|
|
5
|
0.224807
|
5.324176
|
1.600551
|
3.978812
|
89.09646
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cette situation traduit que la relation entre croissance
économique et les autres variables se situe dans le long terme.
3.3.1.7. Prévision
Dans ce cadre nous nous contentons de prévoir
l'indicateur du modèle dégagé par le tableau de
stationnarité de TPIB, TPRIM, TSEC et DEPCAH soit un modèle ARIMA
(1, 1, 1). Ainsi, pour faire une prévision fiable de ces quatre
variables, il faudrait une analyse Uni variée. Sur ce, nous avons
estimé d'abord notre variable TPIB comme l'indique le graphique
ci-après :
|
2013
|
1.615154981194868
|
|
2014
|
1.615088395864208
|
|
2015
|
1.615035857572295
|
|
2016
|
1.614994402914193
|
|
2017
|
1.614961693653656
|
Ce tableau nous indique une prévision assez
rapprochée des valeurs de TPIB pour les 5 ans.

CONCLUSION
L'étude de la
relation « Dépenses Publiques En Education Sur La Croissance
Economique » en République Démocratique du Congo, tel est le
thème qui a servi de fil conducteur à l'élaboration du
présent travail.
En effet, plusieurs pays sont confrontés à la
difficulté de pouvoir définir une bonne politique
socio-économique à cause de la mauvaise appréhension des
problèmes qui les préoccupent. C'est ainsi que nous avons voulu
étudier cette relation afin d'examiner la nature et la structure de
ladite interdépendance en RDC.
Notre jugement de départ s'est
basé sur les hypothèses selon lesquelles :
v Les dépenses publiques d'éducation
n'influencent pas la croissance économique en RDC à cause de leur
faible part dans le budget de l'Etat ;
v La nature de corrélation qui existe entre les
dépenses publiques d'éducation et la croissance serait positive
car les variables évoluent dans le même sens.
Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes
servis des techniques et méthodes appropriées afin de bien saisir
le problème. A cet effet, une étude économétrique a
été envisagée en vue de déterminer la robustesse de
la relation qui existe entre Dépenses Publiques en Education Sur La
Croissance Economique en RDC.
Eu égard à nos résultats de recherche,
nous pouvons affirmer et infirmer certaines hypothèses et cela de
la manière suivante :
· Pendant la période sous étude, c'est au
contraire le taux de scolarité primaire, secondaire et dépenses
publiques d'investissement en éducation qui ont causé la
croissance économique ;
· Leur relation est réellement de long
terme ;
· L'impact de taux de scolarité primaire,
secondaire et dépenses publiques d'investissement en éducation
sur la croissance est négatif en RDC suite à l'absence des effets
significatifs de productivité factorielle relative au capital humain et
physique de l'effet significativement négatif du revenu par
habitant ;
· Le lien entre les quatre variables est fragile car, en
absence de croissance économique, les ressources servant à
investir dans le secteur éducatif font défaut, et le niveau
faible de la santé, et de nutrition limite les possibilités de
croissance économique rapide.
Cette étude met en exergue la contribution très
significative de l'investissement humain et physique à la croissance
économique en RDC.
Etant donné que la croissance économique
constitue une condition nécessaire et suffisante pour accéder
à une bonne éducation, la RDC a tout intérêt de
renforcer le secteur éducatif en mettant en oeuvre la série des
mesures notamment l'équité dans la répartition de la
croissance, les dépenses éducatives prioritaires,
opportunités de gains, accès aux moyens de production, bonne
gestion des affaires publiques et les actions collectives ; car les
bénéfices apportés par le capital humain à la
croissance économique ne diminuent pas rapidement, à mesure que
le niveau de l'Education du pays s'élève
sensiblement faible.
A l'issu de cette étude, il est important de rappeler
que la plupart des données ne sont que des approximations
grossières. C'est l'une des raisons pour laquelle les signes attendus
des paramètres ne sont pas apparus comme le dit la théorie
économique.
De tout ce qui précède, l'actualisation des
enquêtes sur la scolarité et dépenses en éducation
de la RDC s'avère indispensable. Une telle enquête est
justifiée par la nécessité de procéder à la
sélection et à l'analyse des indicateurs dans le secteur
éducatif, condition impérieuse pour mieux appréhender la
structure et les relations entre ces différentes variables.
BIBLIOGRAPHIES.
I. OUVRAGES.
0. BAKANDEJA Wa MPUNGU, Droits des finances publiques,
éd, Noraf, Kinshasa, 1997 ;
1. BOFAYA KOMBA, Finances publiques approfondies,
éd, callimage, Kinshasa, 2010 ;
2. BERTONI (P), Finances publiques, l'essentiel du cours,
Paris, Vuibert, 3è éd, 2001 ;
3. BOUVIER (M), ESCLASSAN (M.C.) et LASSALE (J.P.),
Finances publiques, Paris, L.G.D.J., 6è éd, 2002 ;
4. NSHUE MBO. M, Macroéconomie, théories et
exercices résolus, Edupc, 2007 ;
5. PIERRE GRAVOT, Economie de l'éducation,
éd, Economica, Paris, 1993.
II. NOTES DES
COURS.
1. BONGOY Mkapesa Y, Théories de l'économie et
des finances publiques, notes, inédits, UNIKIN, L2 Economie, 2007,
p.283 ;
2. BELKHEIRI O, Support du cours de macroéconomie II,
inédits, 2007 ;
3. KAWATA J, Support du cours de macroéconomie I,
UPN/FASEG, G3 2011 ;
4. KANKWANDA G, Théories de croissance
économique, notes inédits, UNIKIN/FASEG, L1 ECOMATH, 2007-2008,
p.16 ;
5. MATINGU V, Economie de l'éducation, notes
inédits, UNIKIN/FASEG, L1 ECO PUB, 2010-2011, p.10 ;
6. MUBAKE MUMEME M. Fluctuation et croissance
économique, notes inédits, G3 UNIKIN/FASEG, G3, 2010-2011,
p.86 ;
7. MUKOKO SAMBA D. Cours de modèles
macroéconomiques, UNIKIN/FASEG, L2 ECOMATH, 2012 ;
8. SUMATA J.C, Théories de croissance
économiques, notes inédits, L1 ECO.PUB, UPN/FASEG, L1 ECO PUB,
2012-2013, p.16
III. MEMOIRES.
1. BILETIKA A, Efficacité des dépenses publiques
en capital humain sur la croissance économique e RDC, Mémoire de
licence, UPC, Kinshasa, 2011 ;
2. BIRINDWA J, De l'atteinte du point d'achèvement
à la gestion de la dette publique Congolaise et son impact sur les
finances publiques, Mémoire de licence, UPN, Kinshasa, 2013 ;
3. BAHATI MULUNGULA A, L'union douanière du COMESA et
ses enjeux sur l'économie de la RDC, une évaluation par le MEGC,
Mémoire de licence, UNIKIN, Kinshasa, 2011 ;
4. ELONGA MBOYO J.P, Evaluation de l'impact de la politique
monétaire sur la croissance économique en RDC, Mémoire de
licence, UPC, Kinshasa, 2011 ;
5. NYAMUHIRYE NZIGIRE R, Dépenses publiques et
croissance économique en RDC par l'estimation de l'approche
autorégressive, Mémoire de licence, UNIKIN, Kinshasa,
2012 ;
6. ZAGABE BISIMWA C, Efficacité de l'aide publique au
développement socio-économique de la RDC, Mémoire de
licence, UPN, Kinshasa, 2013.
IV. RAPPORTS ET
AUTRES PUBLICATIONS.
1. Banque Centrale Du Congo (1980-2012), Rapports
annuels ;
2. Banque Centrale Du Congo, loi n 005/2002 du 07 mai 2002
relative à la Constitution, à l'organisation et au fonctionnement
de la BCC ;
3. FMI, l'ajustement budgétaire comme instrument de
stabilité et de croissance, Washington, 2006, par James Daniel et
al.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE........................................................................................................................................................
i
DEDICACE...........................................................................................................................................................
ii
AVANT
PROPOS.................................................................................................................................................iii
AVERTISSEMENTS.............................................................................................................................................
iv
REMERCIEMENTS...............................................................................................................................................
v
INTRODUCTION
1
0. PROBLEMATIQUE
1
1. HYPOTHESES
2
1.1. Etat de la Question
2
2. OBJECTIF DE LA RECHERCHE
5
2.1. Objectif
Général
5
2.2. Objectif social
5
2.3. Objectif Economique
5
3. INTERET ET CHOIX DE LA RECHERCHE
6
3.1. Intérêt de la
Recherche
6
3.2. Choix de la Recherche
6
4. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
6
? La Méthode
Déductive
7
? La Méthode Analytique
7
? La technique Documentaire
7
? La technique Quantitative
7
5. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
7
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE PREMIER
9
GENERALITE CONCEPTUELLE SUR LES DEPENSES PUBLIQUES,
L'EDUCATION, ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE
9
Section 1 : Les
Généralités Conceptuelles sur les Dépenses
Publiques
9
1.1. Eléments Constitutifs des
Dépenses Publiques.
11
1.1.1. Traitements
12
1.1.2. Allocations
12
1.1.3. Subsides et
Subventions
12
1.1.4. Achat des Biens et
Services
12
1.1.5. Intérêt de
la Dette
12
1.2. STRUCTURE DES DEPENSES PUBLIQUES.
13
1.2.1. Classifications Administratives
13
1.2.2. Classification Economiques
13
1.2.3. Classification Fonctionnelle
15
1.3. LES PRINCIPAUX DETERMINANTS DES
DEPENSES PUBLIQUES.
15
1.4. LES GENERALITES CONCEPTUELLES SUR
L'EDUCTION
17
1.4.1. Définition et Formes de
l'Education
17
1.4.2. L'Education Formelle
18
1.4.3. L'Education non Formelle
18
1.4.4. L'Education Informelle
18
1.4.5. L'Education Indirecte
18
1.4.6. 1. Finalités de
l'Education
19
1.4.6.2. Finalité Culturelle
19
1.4.6.3. Finalité Société
19
1.4.6.4. Finalité Economique
20
1.4.6.5. Nature des Biens et des Dépenses de
l'Education
20
1.5. LES EFFETS MACROECONOMIQUES DE
L'EDUCATION
22
1.5.1. Education et Croissance
22
1.5.2. Education et les Grands
Equilibres
23
1.5.3. Education et Répartition des
Revenus
24
1.6. GENERALITES CONCEPTUELLES SUR LA
CROISSANCE ECONOMIQUE
25
1.6.1. Le Modèle d'Inspiration
Keynésienne.
26
1.6.2. Le Modèle de SOLOW
27
1.6.2.1. Modèle de SOLOW sans
Progrès Technique
28
1.6.2.2. Modèle de SOLOW avec
Progrès Technique
29
1.6.2.3. Dépassement du Modèle
de SOLOW : la Croissance Endogène
30
CHAPITRE DEUXIEME
32
PRESENTATION DU SYSTEME EDUCATIF CONGOLAIS ET
EVOLUTION DE L'ECONOMIE CONGOLAISE DE 1980 A 2012.
32
2.1. HISTORIQUE DU SYSTEME EDUCATIF
CONGOLAIS.
32
2.1.1. ADMINISTRATION DU SYSTEME
EDUCATIF.
35
2.1.2. STRUCTURE DU SYSTEME EDUCATIF
37
2.1.3. Evolution de l'Economie
Congolaise
38
2.1.4. Situation de l'Economie Congolaise de
1980 - 1989
38
Tableau 2.1. Taux de Croissance en Volume de
Différents secteurs et de leurs composantes : 1980 - 1989
40
2.1.5. Situation de l'Economie Congolaise de
1990 - 2001
40
Tableau 2.2. Taux de Croissance en Volume de
différents secteurs et leurs composantes (variations par rapport
à l'année précédente).
42
Tableau 2.3. Evolution secteur Réel
Congolais
43
2.2. SITUATION DE L'ECONOMIE CONGOLAISE DE
2002 A 2012
44
Tableau 2.4. Taux de Croissance de PIB et taux
d'inflation : 2002 - 2012
44
Graphique 2.1. Taux de Croissance de PIB et Taux
d'inflation : 2002 - 2012
44
Tableau 2.5. Taux de croissance en volume des
différents secteurs et leurs composantes (variations en pourcentage par
rapport à l'année précédente).
46
2.3. Evolution des Finances Publiques
47
2.3.1. Situation des Finances Publiques de
1980 - 1989
47
Tableau 2.6. Importance Relative des Finances
publiques dans l'Economie : 1980 - 1989
47
Graphique 2.2. Importation relative des finances
publiques dans l'économie : 1980 - 1989
48
2.3.2. Situation des Finances Publiques de
1990 - 2001
49
Tableau 2.7. Importance Relative des Finances
Publiques dans l'Economie 1990 à 2001
49
Tableau 2.8. Situation des Finances
Publiques : 1990 - 2001
50
Graphique 2.3. Situation des Finances
Publiques : 1990 - 2001
50
2.3.3. Situation des Finances Publiques de
2002 - 2012
51
Tableau 2.9. Importance Relative des Finances
Publiques dans l'Economie : 2002 - 2012
51
2.4. EVOLUTION DES DEPENSES PUBLIQUES
D'EDUCATION EN RD CONGO
52
2.4.1. Situation des Dépenses
Publiques d'Education de 1980 - 1989.
53
Tableau 2.10. Evolution des dépenses
courantes et en capital de l'éducation en % des dépenses
publiques totales : 1980 - 1989
53
Graphique 2.4. Evolution des dépenses
courantes et en capital de L'éducation en % des dépenses
publiques totales : 1980 - 1989.
53
Tableau 2.11 : Evolution des dépenses
courantes en capital de l'éducation en % des dépenses publiques
totales : 1990 - 2001.
54
Graphiques 2.5. Evolution des dépenses
courantes et en capital de l'éducation en % des dépenses
publiques totales : 1990 - 2001
54
2.4.2. Situation des Dépenses
Publiques d'Education de 2002 - 2012
55
Tableau 2.12. Evolution des dépenses
courantes et en capital de l'éducation en % des dépenses
publiques totales : 2002 - 2012
55
Graphique 2.6. Evolution des dépenses
courantes et en capital de l'éducation en % des dépenses
publiques totales : 2002 - 2012
55
CHAPITRE TROISIEME
57
ANALYSE EMPIRIQUE DES DEPENSES PUBLIQUES EN
EDUCATION SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE DE LA RDC
57
3.1. Spécification du
modèle
57
3.2. Notions de base sur la
modélisation VAR
58
3.3. Forme fonctionnelle du modèle
VAR utilisé
59
3.4. Estimation du modèle et
interprétation des résultats
60
3.3.1. Présentation et traitement des
données.
61
Graphique 1 non stationnarité de la
croissance économique du PIB
62
Graphique 2 stationnarité du Taux de
Scolarisation primaire
63
Graphique 3 stationnarité du Taux de
Scolarisation Secondaire
64
Graphique 4 stationnarité dépenses
Publiques d'investissement en éducation
64
3.3.1.2. Décalage optimale du modèle
VAR
65
3.3.1.3. Estimation du modèle retenu
de l'estimation du modèle vectoriel autorégressif VAR (-1) avec
la constante.
66
3.3.1.4. Test de Causalité d'engel
et granger
67
3.3.1.5. Analyse de la réponse
Impulsionnelle
68
3.3.1.6. Décomposition du
modèle VAR
71
3.3.1.7. Prévision
71
CONCLUSION
73
BIBLIOGRAPHIES.
75
I. OUVRAGES.
75
II. NOTES DES COURS.
75
III. MEMOIRES.
75
IV. RAPPORTS ET AUTRES PUBLICATIONS.
76
TABLE DES MATIERES
77
* 1 B.M. MWAMBA, Méthode
de recherche en sciences sociales, notes inédits, UPN/FASEG, G2
économie 2009-2010, p.21
* 2 M. Bouvier et alii ;
finances publiques, 6è Ed. Paris, 2001, p. 35
* 3 J.Y.CAPUL et O. GARNIER.
Le dictionnaire économique et des sciences sociales, éd.
Hatier, Paris, 2008, p. 27
* 4 B.W. MPUNGU, Droit des
finances publiques, éd. Noraf, Kinshasa, 1997, p. 36
* 5 Ibidem.
* 6 K.B. BOFAYA, Finances
publiques approfondies, éd. Galimage, Kinshasa, 2001, p. 53
* 7 B.W. MPUNGU, Op.cit,
p.45
* 8 M.M. MUBAKE, Fluctuations et
croissance économique, Notes Inédits, UNIKIN/FASEG, G3,
2010-2011, p. 85-86
* 9 URL : http://www.
Google. Com, l'éducation dans le monde, consulté le 3 Mars.
* 10P. VERLUISE, Dictionnaire
le robert, éd. Argos, paris, 1989
* 11 P. ENCKEL, Grand Larousse,
Tome 2, Volume 5, éd. Dalloz, Paris, 2013
* 12 M. MATINGU, Economie de
l'éducation, notes inédits, UNIKIN/FASEG, L1 éco pub,
2010-2011, p.10
* 13 M. MATINGU,
op.cit., p.11
* 14 M. MATINGU,
op.cit., p.14
* 15 P. GRAVOT, Economie de
l'éducation, éd. Economica, paris, 1993, p.178
* 16 P. GRAVOT, Idem, p.
178
* 17 P. GRAVOT, op.cit.,
p.183
* 18 P. GRAVOT, op.cit.,
p.184
* 19 G.KANKWANDA,
Théories de croissance. Notes In edits, UNIKIN/FASEG, L1 ECOMATH,
2007-2008, p. 16
* 20 M.M. SHUE,
Macroéconomie, théories et exercices résolus,
Edupc, 2007, p.76
* 21 M.M. SHUE, op cit, p.76
* 22 M.M. SHUE, Idem, p. 77
* 23 G. KANKWANDA, Idem,
p. 16
* 24 G. KANKWANDA,
op.cit, p. 100
* 25 G.N. MANKIW,
macroéconomie, de Boeck, paris, 2003, p. 213
* 26 G. KANKWANDA,
op.cip, p.11
* 27 M.M. NSHUE, op.cit,
p. 87
* 28 M.M. NSHUE, op.cit,
p. 91-93
* 29 M. E. G.
KINTAMBU (2004), Principes d'économétrie,
3ème Edition, Presses de l'Université Kongo,
Mbanza-Ngungu, P.222
| 


