|

Année académique
2015-2016
Université Mohammed V de Rabat
Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales -Soussi
Projet de fin d'étude présenté pour
l'obtention du diplôme de 3éme cycle en :
SCIENCES ECONOMIQUES
ET GESTION
Option :
« Management de projets et entrepreneuriat
»
|
|
Sous le thème :
« Les projets agricoles :
Contribution au développement socio-économique en
milieu
rural »
Cas des zones rurales de la région : BENI MELALL
- KHENIFRA
|
Présenté et soutenu publiquement par
:
M. Jihad OUDDIDA
Encadré par :
Pr. lalla latifa ALAOUI (FSJES-Rabat)
Pr. Khalid LIMAMY (FSE-Rabat)
Membre de Jury :
Présidente du jury : Mme. ALAOUI Lalla
Latifa : Professeur à la FSJES-Souissi, Rabat. Suffragant : M.
CHEGRI Bader Eddine: Professeur à la FSJES-Souissi, Rabat.
2
REMERCIEMENTS
Mes chaleureux remerciements à
l'issue de ce travail, vont à l'endroit de :
Madame lala Latifa ALAOUI, Professeur
à la FSJES - SOUISSI de Rabat (Maroc). Monsieur Khalid
LIMAMAY, Professeur à la Faculté des sciences de
l'éducation - Rabat
(Maroc).
Monsieur Abdelghani AMEUR, Directeur
régional par intérim, chef de la
division de
partenariat avec l'agence pour le développement
agricole et appui au développement a la direction régionale de
l'agriculture - Beni Mellal (Maroc) .
Monsieur Abdelaziz BOUHOU, chef de
service développement et recherche a la direction régionale de
l'agriculture de BENI MELALL
Qui ont déployé beaucoup d'efforts pour la
réussite de ce travail, pour l'aide et les conseils concernant les
missions évoquées dans ce rapport et qu'ils nous ont
apportés lors des différents suivis.
Ma FAMILLE, pour son soutien moral.
TOUS LES NOMBREUX AMIS marocains et
non marocains, avec qui j'ai eu le plaisir de sympathiser pendant mes
années d'étude au Maroc.
L'ENSEMBLE DES REPRESENTANTS des
institutions et organismes de
développement au Maroc et à l'extérieur
du Maroc pour leur largesse (pour les documents utiles fournis) et pour leur
disponibilité (pour les précieux moments consacrés aux
entretiens à mon égard. Je fais particulièrement, à
l'Agence de développement social à BENI MELLAL (ADS), le centre
régional de l'investissement à BENI MELLAL. L'ODECO-Maroc, la
GTZ-Maroc, l'USAID-Maroc, la Banque mondiale au Maroc, L'ONG CEFA.
Ma sincère gratitude va enfin à l'endroit de
toutes les personnes et de toutes les institutions qui, de près ou de
loin, ont marqué de leurs traces le présent travail que je
dédie également à LA TOLERANCE, LA PAIX ET L'AMOUR
DANS LE MONDE.
3
DEDICACE
A MA MERE LALLA SOUAD
LEFECHTALI
A MON PERE SALAH OUDDIDA
A
MA SOEUR YOUSSRA OUDDIDA
A MA CHERE
Dr. BOTAINA MJIDILA
A MES CHERS ASSIL JABY
& SAEB JABY
A TOUS MES NOMNBREUX AMIS
JE DEDIE CE TRAVAIL.
4
Résumé :
Ce projet de fin d'étude présente des constats
issus d'une analyse menée sur les projets agricoles dans le milieu rural
dans la région de BENI MELLAL - KHENIFRA. Il a été
réalisé sous la direction de l'équipe d'encadrement au
sein de la Direction régionale de l'agriculture de BENI MELLAL.
L'approche prise porte sur la nécessité de
projeter la lumière sur les actions qui participent au
développement socio-économique des zones rurales.
Les objectifs principaux de l'étude étaient les
suivants : dresser le profil du porteur des PA, identifier les impacts locaux
des projets, mettre en considération les atouts et les contraintes du
milieu rural par rapport à la mise en place des PA ainsi que ses
perspectives d'avenir dans ce milieu et dégager des pistes de
développement de la création des PA en milieu rural.
5
ADA
|
Liste des acronymes
Agence pour le développement agricole
|
|
ADS
|
Agence de le développement social
|
|
AGCD
|
Administration générale de la coopération au
développement
|
|
BAD
|
Banque africaine pour le développement
|
|
BM
|
Banque mondiale
|
|
CEFA
|
Comité Européen pour la Formation et
l'Agriculture;
|
|
CP
|
Cycle de projet
|
|
DRABK
|
Direction régionale de l'agriculture BENT MELLAL -
KHENIFRA
|
|
FDA
|
fond de développement agricole
|
|
FDR
|
fond de développement rural
|
|
MCP
|
management du cycle de projet
|
|
ODECO
|
Office de Développement de la Coopération
|
|
ONG
|
Organisations non gouvernoumentales
|
|
OPA
|
Organisation professionnelle agricole
|
|
PA
|
Projet agricole
|
|
PCM
|
Project Cycle Management
|
|
SAU
|
Supérficie agricole utile
|
|
UE
|
Union europeene
|
|
1
|
Liste des tableaux
Liste des organismes enquêtés
|
|
2
|
Répartition des zones rurales d'étude
|
|
3
|
Dépense de consommation finale des ménages dans la
région béni Mellal - Khenifra
|
|
4
|
Répartition de la SAU selon le statut juridique
|
|
5
|
tableau des domaines d'intervention de l'ADS
|
|
6
|
Les motivation de création des PA
|
|
1
|
Liste des graphiques Les raison de choix du lieu
|
|
2
|
L'ambiance au sein des PA
|
|
3
|
L'esprit de collaboration au sein des PA
|
|
4
|
L'impact de l'activité sur le revenu
|
|
5
|
L'avenir des projets agricoles
|
|
6
|
Les difficultés attendues par les PA
|
|
7
|
Les éléments d'influence sur le fonctionnement des
PA
|
|
8
|
Localisation de la clientèle
|
1
Liste des figures
Cycle de projets
|
2
3
|
Région BENI MELLAL - KHENIFRA Organigramme de L'ODECO
|
6
Sommaire :
Résumé : 4
INTRODUCTION GENERALE 8
PROBLEMATIQUE : 10
Partie I : cadre théorique et approche
méthodologique
Chapitre I : Terminologie et concepts 14
1. Définition et concept de développement
: 14
2. Le développement rural et agricole :
15
3. Le développement socio - économique :
16
Conclusion : 17
Chapitre II : les projets agricoles et son cycle de
management 18
1. Définition du projet : 18
2. Les projets agricoles au Maroc 19
3. Le management et le cycle des projets de
développement agricole 22
Conclusion : 26
Chapitre III. Approche méthodologique de
l'étude 26
1. L'objectif du choix d'étude : 26
2. Choix de la zone d'étude : 27
3. Méthodologie d'approche : 28
Conclusion : 29
Partie II : cadre descriptif et présentation des
résultats
Chapitre I. Aperçu sur territoire de Beni Mellal -
Khenifra 31
1. Le découpage administratif 32
2. Niveau de vie des ménages dans la
région : 33
3. Analyse du potentiel agricole et agroalimentaire /
matrice SWOT 34
Conclusion : 39
Chapitre II. Les acteurs des projets de
développement agricole . 40
1. Les organisations non-gouvernementales (ONG)
40
2. Les agences gouvernementales 41
3. Les bailleurs de fonds 51
Conclusion 52
Chapitre III. Présentation des résultats de
l'étude terrain . 53
1. Présentation du cadre général
des enquêtes 53
2. Discussion des résultats et constats :
55
Conclusion : 63
7
CONCLUSION GENERALE 64
Bibliographie : 65
Webographie : 65
Annexes : 65
8
INTRODUCTION GENERALE
La recherche de l'amélioration des conditions de vie
des populations a toujours été la préoccupation majeure de
tous les gouvernants. L'amélioration des conditions de vie
représente la manière dont un être humain parvient à
satisfaire ses besoins économiques et sociaux à savoir la
nourriture, la santé, le logement, l'habillement, les conditions de
travail et l'éducation de ses enfants. Face à la misère,
la création d'un minimum de bien-être favorise la
sécurité physique et matérielle des populations. Afin d'y
parvenir, les Etats mettent en oeuvre diverses stratégies de
développement.
Dans la mesure où les individus constituent la richesse
principale d'une nation, Les stratégies de développement doivent
viser à assurer l'égalité des chances,
l'équité, de meilleures possibilités et de bonnes
conditions de vie à chacun des individus formant la nation.
C'est pourquoi, le développement socio -
économique au milieu rural notamment doit rester constamment au coeur de
tout programme politique de gouvernement. Les nations dites sous -
développées mènent constamment des politiques sectorielles
et multisectorielles en faveur de la lutte contre la pauvreté. Le
développement socio - économique doit favoriser
l'éradication des disparités intra - régionales et la
valorisation des potentialités de chaque localité.
Au Maroc les projets coopératifs occupent une place non
négligeable dans le tissu économique national, il joue un
rôle prédominant dans le développement rural et durable,
dans la mesure où il représente une part importante dans les
programmes de développement économique et social du pays. Ce
champ a ouvert des horizons porteurs pour créer des projets de
développement économiques et social qui concourent pour combattre
la pauvreté, l'exclusion, et l'intégration des petits producteurs
dans le marché. Ces horizons qui ce renforcées par l'Initiative
Nationale du Développement Humain(INDH). « Ce qui s'est traduit par
l'évolution significative tant de l'effectif que de la qualité
des coopératives. Cet effectif est passé de 5.749 à 9.046
coopératives entre les années 2007 et 2011, soit un accroissement
de 57,35% durant cette période ».1
L'agriculture constitue un secteur clé de la
stabilité et du développement économique et social du
Maroc. A cet égard, une politique publique complète a
été définie par le gouvernement, en associant toutes les
parties concernées en vue de renforcer le rôle de ce secteur,
dépasser ses handicaps et valoriser pleinement les opportunités
offertes aux opérateurs économiques. Cette politique est
illustrée par la stratégie intitulée `Plan Maroc Vert'
avec son deuxième pilier qui
1 Statistiques de l'office du développement de
la coopération
9
repose sur le thème de l'agriculture solidaire et la
large batterie de programmes, plans, réformes et mesures structurelles
d'accompagnement mises en place.
Parmi les défis à relever dans ce cadre, figure
la réalisation d'importants investissements publics et privés,
évalués à près de 147 Md MAD. Aussi,
s'avère-t-il important de dresser le présent guide de
l'investisseur dans le secteur agricole au Maroc.
Le Maroc dispose d'une richesse et diversité offrant un
potentiel important pour la valorisation des produits agricoles. Au regard des
visites réalisées il y a une dissymétrie entre les efforts
consentis sur les aspects techniques et organisationnels et les questions
commerciales. Ceci s'explique notamment par le contexte de mise en oeuvre des
projets qui pour la plupart s'inscrivait dans le cadre de l'amélioration
des conditions de vie des populations rurales et de l'amélioration de la
productivité.
Les projets visités nous font considérer aussi
les bénéfices potentiels de la production des produits d'origine
agricole ou agroalimentaire en termes de valeur économique et sociale.
En premier lieu, les agriculteurs ont souligné l'amélioration de
l'alimentation et les conditions de vie de leurs familles due au changement
technique qui a conduit à une qualité de leurs productions
nettement meilleure, car une partie non-négligeable de leur production
est destinée à l'autoconsommation. D'autres externalités,
issues des nouveaux projets de changement technique, ont été
repérées, telles que celles qui sont à caractère
environnemental (par exemple, l'élimination des margines grâce au
nouveau système d'extraction d'huile), ou bien celles à
caractère socio-économique et culturel (comme c'est le cas du
développement du capital social entraîné par la
constitution de groupements de femmes rurales).
Il apparait un problème de capacité
financière le plus souvent lié à la taille des projets de
développement rural qui ne permettent pas de dégager les moyens
suffisants pour assumer les investissements techniques et commerciaux
nécessaires à la valorisation des Produits.
Il existe ainsi beaucoup de conceptions sur les produits
agricoles, en fonction du degré de spécificité
territoriale, de la taille du marché, etc...
10
PROBLEMATIQUE :
Après la années 60, les états du monde
étaient en recherche d'un nouveau dynamisme mondial susceptible
d'éviter dans l'avenir de nouvelles crises graves Où il y aura
plus d'harmonie, plus de développement et de coopération. Pour
cela, plusieurs actions figuraient dans leurs plans d'action parmi lesquelles
il faudrait reconstruire et équilibrer les économies
internationales et les méthodes d'approche.2
De nombreuses organisations et institutions internationales
(CEFA, progettomondo mlal
...) et nationales (ADS, ADA, ODECO ) avec chacune un objectif
précis.
La banque mondiale et le FMI ont initialement porté
leurs efforts sur la reconstruction dans le monde. Elle replace aujourd'hui
toutes leurs activités dans le cadre global de la lutte contre la
pauvreté en finançant des programmes et des projets oeuvrant pour
pallier les conséquences des catastrophes naturelles, régler les
urgences humanitaires, gérer les conflits dans les pays en
développement et appuyer les économies en transition.
A cela, il faudrait ajouter les actions considérables
des ONG et certains organismes gouvernementaux bailleurs de fond (BM, USAID,
.....Etc.) au niveau national et international. Ces actions qui se traduisent
par des interventions humanitaires financées par les pays riches en
faveurs des pays sous-développés dans le but de lutter contre la
famine, l'analphabétisme, et d'aider les couches les plus
vulnérables (femmes et enfants) pendant les moments de crises graves
comme les sécheresses et les catastrophes naturelles. « Il est
recensé actuellement plus de 50.000 ONG de ce type contre 10.000 au
début des années 80 et 700 en 1939 ».3
Malgré ces plusieurs décennies d'investissement
et d'aide au développement en faveurs des pays en voie de
développement, les résultats se sont avérés de peu
à très peu convaincants. En effet, les actions de
développement menées sous formes de projets identifiés,
sont souvent confrontées à des grandes difficultés tout au
long de leur cycle. L'une des difficultés de pérennisation de ces
actions est l'inefficacité des méthodologies et des approches
utilisées. En effet, elles connaissent dans la plupart des cas, des
déficits dans la mise en place et dans leurs contributions a
l'amélioration des conditions sociales et économiques.
Notre travail s'inscrit alors dans une démarche
déjà établie au développement territorial au Maroc
en faveur des zones rurales enclavées. Essentiellement, cette
démarche a pour but de favoriser le développement
d'activités socioéconomiques enracinées dans le territoire
rural à travers des projets purement agricoles ou agroalimentaires et
parfois un enjolivement artisanal. Tant la culture
2 Guide de développement économique et
social au milieu rural - Nathalie Normandeau
3 TROGER, 2003 TROGER V. (2003), - Les ONG à
l'épreuve de la critique
11
propre des communautés que leurs ressources naturelles
permettront cet enracinement. À notre époque de mondialisation
des marchés et de normalisation des technologies ainsi que des modes de
vie, une telle orientation a de quoi surprendre. De fait, la force des
principes économiques dominants est de posséder cette
prégnance qui rend suspect tout ce qui semble s'en éloigner.
L'état, les organismes, les institutions, les
chercheurs, les spécialistes et les experts de développement
économique se sont activés et s'activent toujours afin de
définir des méthodes d'approche et développer des
solutions et méthodologies de travail plus flexibles et plus
adaptées à la cause des différentes parties prenantes et
qui répondent en même temps à notre problématique
qui s'articule autour de la question suivante :
« Quel serait l'impact des projets agricoles dans
le développement de la zone rural ? Peut -on
toucher la contribution
socioéconomique des projets agricoles dans le développement
des
zones rurales au niveau de la région? »
Dans le souci d'apporter des réponses à la fois
réalistes et constructives à notre problématique, il nous
a semblé nécessaire de repartir la question centrale en
sous-questions harmonieuses auxquelles nous nous efforcerons d'apporter des
réponses conçues à la lumière de notre étude
bibliographique, de nos enquêtes et de nos différentes
recherches.
Les sous-questions sont les suivantes
:
- Quel sont les principales orientations
stratégiques de l'Etat en matière de développement rural
et territorial ?
- Quelles sont les caractéristiques des projets
agricoles ?
- Quel sont les créateurs et les dirigent des
projets agricoles ?
- Quelle contribution des projets agricole au
développement socioéconomique des zones rurales ?
- Existe-t-il une continuité de
l'activité économique des projets agricoles installés en
milieu rural ?
- Le milieu rural : quels atouts pour implanter des
activités économique ?
Les réponses à ces différentes questions
nous serviront de recherche tout au long de notre travail. Le
méthodologie que nous avons opté et qui sera abordé dans
le 3éme chapitre du cadre théorique s'articule autour des
démarches suivantes :
12
Une recherche bibliographique approfondie orientée vers
la problématique de développement social et économique
tiré par les projets agricoles, nous permettra de comprendre les
concepts essentiels liés au projet et son impact sur le
développement et la promotion socioéconomique.
Des enquêtes et des entretiens sur le terrain
auprès de 27 projets agricoles et certains nombre d'organismes nous
permettra de connaître concrètement les principales
préoccupations et priorités des institutions et organismes : DRA
- ONG - ADS..... etc. en matière de contribution au
développement.
13
Partie I :
cadre théorique et approche méthodologique
14
Chapitre I : Terminologie et concepts
1. Définition et concept de développement
:
A. La définition du concept de
Développement
La définition du mot »Développement»
est très diversifiée et se heurte parfois à des versions
quelque peu divergentes. Mais d'une façon générale, on
peut définir le développement comme étant un processus
politique, social et économique cohérent et harmonieux engendrant
un état de vie, d'être et de pensée favorable à
l'amélioration durable; et tout ceci se caractérisant et
s'appréciant par rapport à des références
communément admises.
OAKLEY ET GARFORTH (1986) cité par HOMMANI (1997),
estiment que le développement évoque une certaine forme d'action,
ou d'intervention propre à influencer le processus général
de transformation sociale. Il s'agit d'un concept dynamique qui suppose que
l'on modifie les données d'une situation antérieure ou que l'on
s'en éloigne. Ils ajoutent que le processus de développement peut
prendre des formes variées et tendre vers toutes sortes d'objectifs.
C'est dans le même sens et dans le contexte de
conception de projet de développement rural que BOUKHARI (1997) estime
que : « le développement est un changement de l'environnement
(aménagement et équipement) et de CAP (connaissances, attitudes
et pratiques) » 4.
A partir de ces différentes approches, on
perçoit qu'il n'existe pas une définition universelle
communément admise qui puisse réellement cerner tous les aspects
de ce concept qui se veut d'avantage dynamique et relatif à un
contexte.
En effet, on voit de plus en plus des attributs qui se
greffent au développement afin de l'adapter aux différentes
réalités du monde contemporain. Nous faisons allusion à
des concepts comme le développement durable, le développement
genre, le développement participatif, le développement
rural...
B. Origine du concept :
Le concept de développement a vu le jour au cours de
ces quarante dernières années et a fait l'objet d'innombrables
réflexions, études, précisions et critiques lui faisant
connaître de nombreux apports théoriques.
4 Guide à l'usage des partenaires - Rabat, Edition
2004.
15
Cependant, d'une façon générale, le
concept est resté marqué par son origine. En effet il a
été établi au début pour être appliqué
à une partie de l'humanité, celle qui était
destinée à grandir, celle qui était enfant ou adolescent
pendant la Guerre et qu'il fallait aider (par exemple aider un enfant) pour
atteindre la maturité. L'aide au développement des "pauvres" a
été le revers de la médaille des vrais investissements
chez les "riches".
Ce sujet est affirmé par les experts de
développement « Ceux qui ont proposé l'utilisation de cette
notion se sont considérés eux-mêmes comme
"développés", c'est-à-dire, comme appartenant à des
sociétés ayant atteint l'âge mûr. Ils devaient alors
étendre les bénéfices de la maturité à toute
la planète ».5
2. Le développement rural et agricole
: ? Le développement rural :
Le développement rural est la transformation positive
et durable du milieu rural en faveur du facteur humain et des
différentes activités, en particulier l'activité agricole,
par la mise en place ou le renforcement des infrastructures de bases
nécessaires.
Selon MORIZE (1992): « Le développement rural
consiste à améliorer tout l'environnement de l'agriculteur,
considéré cette fois comme le principal
bénéficiaire. Il porte à la fois sur les routes, les
villages, la santé, l'éducation et sur tous les services
économiques et sociaux susceptibles d'améliorer non seulement la
fonction productive, mais aussi le bienêtre social ». 6
Ces différentes définitions mettent en
évidence la forte corrélation qui existe entre le
développement rural qui est un aménagement de l'espace rural et
le développement agricole qui est une augmentation des rendements des
activités agricoles. On perçoit en effet que le
développement rural est infrastructurel et cela constitue une base
incontestablement importante pour asseoir un développement agricole
solide.
? Le développement agricole :
MORIZE (1992) a annoncé que le développement
agricole consiste essentiellement à augmenter le volume des
récoltes, globalement ou pour certains produits seulement. Cette
augmentation se fait en augmentant les rendement par une meilleures utilisation
des terres ou des autres facteurs limitant.
5 Arocena José, Le développement par
l'initiative locale. Collection logiques sociales / Edition Le Harmattan
6 Morize, Manuel pratique de vulgarisation agricole, 2
volumes ; Maisonneuse et Larose, Paris, 1992)
16
De nos jours, le développement agricole inclue
davantage la notion de durabilité pour protéger l'environnement,
et de qualité pour améliorer le régime alimentaire des
populations ou pour répondre aux exigences du marché.
La vulgarisation agricole est un moteur clé du
développement agricole puisque ce dernier passe inconditionnellement par
l'introduction de nouvelles productions (animales et végétales),
par l'amélioration des techniques de production et par l'information et
la formation des agriculteurs.
3. Le développement socio - économique
:
Le développement économique et social
fait référence à l'ensemble des mutations
positives (techniques, démographiques, sociales, éducatives,
sanitaires...) que peut connaître une zone géographique (monde,
continent, pays, région...).
Il ne doit pas être confondu avec la croissance
économique. Celle-ci est habituellement nécessaire ou
consécutive au développement mais elle n'en est qu'un aspect. Il
existe même des zones en croissance par simple inertie de tendance ou
sous l'effet de dopants artificiels de types dits keynésiens, sans pour
autant connaître les transformations de structure et la «
destruction créatrice » propres au développement, qui
assurent sa pérennité. Cela peut conduire à un
épuisement des ressorts de la croissance. On peut alors retrouver le
phénomène de cycle de vie (de l'émergence à
l'expansion puis au plafonnement et enfin au déclin)
étudié en marketing.
Le développement économique nécessitant
notamment de la création de richesses, on associe développement
économique et « progrès », puisqu'il entraîne,
généralement, une progression du niveau de vie des habitants. On
parle alors d'amélioration du bien-être social (au sens
économique). La volonté de concilier simple développement
économique et progrès ou amélioration du bien-être a
mené à forger, à côté des indicateurs de
développement traditionnels (PNB, PIB), d'autres indicateurs, tels que
l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la
santé, l'éducation, le respect des droits de l'homme (dont font
partie, depuis1966, les droits économiques et sociaux ....etc. Les
paramètres économiques et sociaux pour la mesure du
développement sont indiqués dans l'article « Pays en
développement ». La différence entre croissance
économique et développement social est mal perçue dans le
grand public1. Le bien-être social doit être
distingué de la production économique2. Le
bien-être est pluridimensionnel. D'autres composants existent à
côté du bienêtre matériel
17
Conclusion :
Après cette ces définitions relatives au
développement, il est évident que le mot quel que soit le
qualitatif attribué, se rapporte toujours au changement, à
l'amélioration d'une situation à une autre jugée
préférable.
Il est un processus qui a besoin d'une méthode pour que
l'esprit du concept « sorte de lui-même » pour se
concrétiser en réalité sur le terrain. Pour cela il
faudrait oeuvrer davantage pour l'élaboration de programmes de
développement pertinents. Ce travail doit se faire avec des
stratégies bien élaborées et des objectifs
réalistes sous des conditions politiques privilégiant la
démocratie, la transparence, la bonne gouvernance et la prise en
considération de certains nouveaux concepts comme la mondialisation.
Les coopérations partenariales au développement
doivent se revêtir de nouveaux principes favorisant des interventions
répondant aux préoccupations réelles des populations qui
sont les seules à pouvoir exprimer correctement leurs besoins.
A ce propos, GANDHI affirmait que : « ce que vous faites
pour moi mais sans moi, vous le faites contre moi ».
18
Chapitre II : les projets agricoles et son cycle de
management
1. Définition du projet :
Le concept «projet» possède beaucoup de sens. On
l'utilise dans différents domaine tels que
l'architecture, l'agriculture, la gestion, l'économie .
etc.
En étymologie le mot projet provient du mot latin
projectum , « jeter quelque chose vers l'avant»
dont le préfixe pro-signifie« qui
précède dans le temps »7.
Quand le mot a été initialement adopté,
il se rapportait au plan de quelque chose, non à l'exécution
proprement dite de ce plan. Quelque chose accompli selon un projet était
appelé «objet». Cette utilisation du mot «projet»
changea dans les années 1950, quand plusieurs techniques de gestion d'un
projet ont été élaborées : avec cette
avancée, le mot à légèrement dévié de
ce sens pour couvrir à la fois les projets et les objets.
Pour Robert HOUDAYER (2006) un projet est « ensemble
cohérent d'activités »
Selon lui sous l'angle financier, un projet d'investissement
représente l'acquisition des immobilisations, permettant de
réaliser ou de développer une activité ou un objectif
donné.
Dans son aspect commun il correspond à une
dépense immédiate dont on attend des avantages futurs.
Wikipédia, l'encyclopédie libre définie le projet comme :
«une aventure temporaire entreprise dans le but de créer quelque
chose d'unique» .
Il est temporaire car il se termine à une date
déterminée et unique car le résultat final est proprement
entrepris. Dans le contexte professionnel, il s'agit de réalisation d'un
produit ou un service.
Pour M. BRIDER et S.MICHAILOF, le projet est «un ensemble
complet d'activité et d'opération qui consomment des ressources
limités et dont on attend des revenues et d'autres avantages
monétaires ou non monétaires». Cette définition a le
mérite d'insister sur le caractère global en relativement
autonome que doit présenter tout projet.
Le projet est une opération ou un ensemble
d'opération précises à réaliser au cours d'une
période de temps donnée pour mettre à la disposition de
son promoteur (entreprises ou organismes professionnelles ) de nouveaux moyens
de production (usine centrale) ou de nouveau équipements
7 RWIGAMBA.B. Cours d'initiation à la recherche
scientifique,.ulk,2001
19
collectifs (écoles,hopitaaux,...). Cette
définition met l'accès sur l'idée de la nouveauté
ou de la création et la durée nécessaire à sa
réalisation.
Elle intéresse principalement l'auteur (initiateur ou
promoteur) du projet (et tous ce qu'il réunit autour de lui pour
réaliser son projet). C'est aussi l'ensemble des actions à
accomplir ou accomplis qui tendent vers une même finalité : le
changement d'une situation existante. En mettant en exergue le changement,
cette définition s'inscrit nettement dans l'optique des
bénéficiaire ou usagers du bien produit par le projet.
C'est aussi un processus unique qui consiste en un ensemble
d'activités coordonnées et maitrisées, comportant des
dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif
conforme à des exigences spécifiques incluant des contraintes de
délais, de couts et de ressources.8 Cette définition
résumé un projet et elle insiste sur les trois principaux
caractères d'un projet qui sont couts, délais et objectif. Ces
trois caractères d'un projet sont interdépendants. Chaque
changement d'un caractère déséquilibre le projet.
Si l'on souhaite atteindre plus vite l'objectif, il faut
engager des moyens supplémentaires, ce qui agit directement sur les
couts.
2. Les projets agricoles au Maroc
Le Plan Maroc Vert a fait de l'investissement ambitieux
.mobilisant 10 milliards de Dirhams annuellement au
profit du secteur agricole à l'horizon 2020. En effet, et en vue
d'assurer une modernisation accélérée et un
développement équitable et durable du secteur, deux approches
d'intervention différenciées sont retenues pour la mise en oeuvre
des projets agricoles du Plan Maroc Vert, à
savoir :
? Les projets Pilier I qui reposent sur
l'investissement privé et ciblant les zones à fort potentiel
agricole, visent le développement d'une agriculture moderne à
haute productivité ou à forte valeur ajoutée. Ces projets
prévoient un investissement de 70 Milliards de dirhams au profit de
près de 560 0008 agriculteurs cibles.
8 Données de l'agence pour le
développement agricole - 2014
20
? Les projets Pilier II qui reposent sur une
intervention directe de l'Etat, visent la relance de l'agriculture
traditionnelle ou solidaire dans les régions défavorisées.
20 Milliards de dirhams d'investissements sont prévus à l'horizon
2020 au profit de 840 000 agriculteurs bénéficiaires.
Afin d'assurer la visibilité pour l'ensemble des
opérateurs, des objectifs chiffrés à l'horizon 2020 ont
été définis dans le temps et dans l'espace à
travers des objectifs macroéconomiques, des objectifs par région
déclinés dans le cadre des 12 Plans Agricoles Régionaux et
des objectifs par filière concrétisés à travers la
signature de 18 contrats-programmes avec les interprofessions.
Ces objectifs filières sont accompagnés par des
actions transverses ciblées relatives à la mobilisation du
foncier dans le cadre du Partenariat Public Privé, le Programme
d'économie d'eau d'irrigation sur 500.000 ha et aussi,
l'amélioration des filières de production animale et
végétale .
Ainsi, le secteur agricole offre d'importantes
opportunités d'investissement aux opérateurs économiques
à tous les niveaux de la chaîne de valeur à savoir, la
production, la valorisation, la commercialisation et l'export en passant par la
logistique et le traitement et la valorisation des sous-produits de
l'agro-industrie.
A. Accompagnement des investissements en projets
agricoles
En vue d'accompagner les promoteurs à réaliser
leurs projets, l'Etat marocain a veillé à l'amélioration
de l'environnement des investissements dans le secteur agricole à
travers la mise en place d'un ensemble de mesures à savoir :
- Les subventions financières accordées dans le
cadre du Fonds de Développement Agricole. - La mise en place d'un
système d'assurance agricole par la compagne : MAMDA - MCMA -
L'accès au financement bancaire notamment la banque du crédit
agricole, banque populaire.. - La mise en place des agropoles
régionaux
- La facilitation de l'accès des produits agricoles au
marché international.
· Incitations financières accordées par le
Fonds de Développement Agricole (FDA) :
Le Fonds de Développement Agricole a pour objectif de
promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole et de
l'orienter, à travers des subventions ciblées, vers des
activités permettant une meilleure exploitation du potentiel agricole
national. Les principales rubriques concernées par les subventions de
l'Etat dans le cadre du FDA sont comme suit :
21
En matière d'irrigation et
d'aménagement foncier :
- Projets d'irrigation localisée : de
80% à 100%
- Projets d'irrigation de complément :
de 50% à 70%
- Travaux d'améliorations foncières :
30% pour l'épierrage de profondeur et 50% pour la collecte des
eaux pluviales
En matière d'acquisition du matériel
agricole et de protection des cultures :
- Matériel agricole : de 30% à
70% selon le type de matériels (tracteurs, matériel de travail et
d'entretien du sol, matériel de récolte...)
- Filet de protection des cultures : 35%
pour les cultures maraichères sous serre contre les insectes et 40% pour
les plantations fruitières contre la grêle .
En matière de production
végétale :
- Création de vergers d'olivier et d'agrumes :
de 3.500 dh/ha à 6.000 dh/ha / 12.000 dh/ha
- Création de vergers arboricoles d'amandier, de
figuier, de caroubier, de pistachier, de noyer, de grenadier, de cerisier, de
néflier, de pêcher, de nectarinier, de cognassier, de pommier et
de prunier : 60% du coût d'acquisition des plants avec un
plafond de 3.500 dh/ha à 17.000dh/ha
- Acquisition et installation des serres
destinées à la production agricole: 10% pour les
armatures et la
couverture de serre en plastique et fil de fer
En matière de production animale
:
- Construction des bâtiments d'élevage
: 25% pour les étables, les bergeries et les chèvreries
et 30% pour les centres de collecte de ylait.
- Acquisition du matériel d'élevage :
30% du coût du matériel
- Amélioration génétique des
espèces animales : 700 à 850 dh/tête pour les
ovins et 4000 à 5 000 dh/tête pour les bovins
En matière de mise en place des unités de
valorisation des produits agricoles9 : 10% avec un plafond
variant de 1
million DH à 4,75 millions de DHS
9 Données et chiffres de l'agence pour le
développement agricole, Année 2014
22
3. Le management et le cycle des projets de développement
agricole
La MCP se définit communément comme un
système de directions qui assure la réalisation et le
fonctionnement des différentes phases du cycle des projets tout en
tenant compte de leur interdépendance afin de structurer et de faciliter
l'accomplissement des objectifs fixés et cela de façon efficace
et efficiente.
Selon L'UE (2001), le management du cycle de projet (MCP) est
un ensemble d'outils de conception et de gestion de projets basés sur la
méthode d'analyse du cadre logique. Cette méthode est largement
utilisée par de nombreux acteurs. Tels que les gouvernements et les
bailleurs de fond, ONG ..... Etc.
Dans le même sens que « la gestion du cycle de
projets est un ensemble de concepts, de techniques, d'instruments et de
pratiques qui permet aux gestionnaires du cycle de projets de les faire
évoluer au travers des diverses phases de la vie ou du cycle propres
à chaque projet, et ce, sur base de décisions faites en
connaissance de cause ».10
Le concept de gestion du cycle de projet est plus élargi
que celui de la gestion de projet. En réalité, la gestion du
cycle de projet est la gestion de chacune des phases du cycle de projets par la
détermination des termes de référence adéquats pour
chaque phase, et par la vérification de la qualité de la gestion
de chaque phase.
Le gestionnaire du cycle de projet doit s'assurer que les
procédures applicables à chacune des phases et sur lesquelles les
acteurs se sont mis d'accord, sont bel et bien suivis. Il ou elle commence
chaque phase par des termes de référence et vérifie que
ceux-ci ont été suivis sur la base des documents fournis lors de
chaque phase 11
Les projets et le management de cycle de projet se
déroulent dans un environnement plus vaste que celui du projet
lui-même. L'équipe de management de projet se doit de comprendre
ce contexte élargi pour bien choisir les phases du cycle de vie, les
processus, les outils et les techniques qui correspondent le mieux au projet.
Ce chapitre décrit quelques aspects majeurs du contexte du management de
projet. Les sujets présentés sont :
10 Project cycle management - PCM group (2002)
11 (PCM GROUP, 2003).
A. Le cycle de projets :
C'est la planification et la mise en oeuvre des projets
suivent une séquence bien établie, qui débute par une
stratégie convenue, qui mène à l'idée d'une action
donnée, qui est ensuite formulée, mise en oeuvre, et
évaluée en vue d'améliorer la stratégie et les
interventions futures.
post-évaluation
|
Identifictaio
n
|
|

23
L'éxécusion
Recherche
du
financemen
t
|
Evaluation
|
Décision
|
|
|
Figure 1 : le cycle de projets
B. La définition des étapes du projet
agricole :
La planification et la mise en oeuvre des projets suivent une
séquence bien établie, qui débute par une stratégie
convenue, qui mène à l'idée d'une action donnée,
qui est ensuite formulée, mise en oeuvre, et évaluée en
vue d'améliorer la stratégie et les interventions futures.
a. Phase d'identification
différentes configurations possibles d'un point de vue
sommaire. Prendre soin de s'assurer aussi que l'objet du projet reste pertinent
et qu'il entre dans la stratégie de l'entreprise. Cette phase, est
parfois qualifiée d'Avant-Projet, doit se conclure par la mise au point
de documents formalisant le projet et indiquant les conditions
organisationnelles de déroulement du projet.
24
Elle va consister à :
- Analyser les problèmes associés
à la situation
· Identifier les problèmes clés,
· Apprécier les contraintes à respecter et
opportunités à envisager
· Établir les liens de « causes à effets
» entre problèmes.
· Concevoir « l'arbre à problèmes
»
- Analyser les objectifs
· Définir les objectifs à atteindre et tenant
compte des contraintes déjà évaluées
· Établir les liens de « moyens à fins
» entre objectifs.
· Concevoir « l'arbre à objectifs »
Parmi les objectifs de l'identification en
relève :
· Voir si l'idée de projet est techniquement,
financièrement et économiquement viable
· S'assurer que l'on peut raisonnablement continuer
à y consacrer d'autres ressources
· Donner un ordre de grandeur des besoins financiers
nécessaires.
Les aspects à apprécier au niveau de
cette phase :
· La faisabilité technique : s'assurer que le projet
est techniquement réalisable : voir aussi les différentes
solutions qui peuvent s'offrir
· La faisabilité économique : s'assurer que
le projet est économiquement viable (bilan-devises, emplois,
équilibre régional...)
· Identification des problèmes : il s'agit de
relever les problèmes qui peuvent survenir même s'il ne s'agit pas
de les solutionner durant cette phase (organisation, gestion, aspects
financiers, institutionnels (politique des prix, fiscalité etc.),
commercialisation.
b. Phase de préparation :
La préparation du projet d'investissement agricole doit
aboutir à chaque fois que cela est possible à la
détermination de plusieurs variantes (c'est-à-dire plusieurs
possibilités), devra suivre le processus suivant :
· Etude du marché
· Etudes techniques
· Estimation coûts d'investissement et
d'exploitation
25
- Etude de marché :
L'étude du marché aura pour but de répondre
aux questions suivantes :
? Quelles quantités peut-on envisager de produire et
à quel prix ? Cette production pourrait-
elle être vendue ? (il en découle l'estimation des
recettes). Les notions de prix et de quantités sont en
général liées,
? Quelles sont les conditions générales de
commercialisation du produit ?
? Quelle sera l'évolution dans le temps des
différents facteurs dont nous venons de parler (niveau de consommation
et prix) ?
- Etude technique :
La validation d'une étude technique de réalisation
du projet est requise : durée des travaux, localisation possible,
processus utilisé, besoins en matières premières, eau,
énergie, main-d'oeuvre, équipements à envisager.
- Cout d'investissement et d'exploitation
:
A l'étude technique doit être associée une
analyse des dépenses et des recettes et ce, pour chacune des solutions
envisagées : coût de l'équipement, coût de la
main-d'oeuvre, de la matière première, de l'énergie,
recettes d'exploitation ainsi que l'évolution possible de ces
paramètres.
C. Les objectifs du management du cycle de projet :
L'objectif du MCP est et demeurera, l'amélioration de
la gestion des actions de coopération en tenant mieux compte des
questions essentielles et des conditions cadres dans la conception et la mise
en oeuvre des projets et programmes.
Le MCP fournit en outre une structure visant à garantir
la consultation des principales parties prenantes et la mise à
disposition des informations pertinentes, afin que des décisions
éclairées puissent intervenir aux étapes clés de la
vie d'un projet. Il permet d'améliorer la qualité de la
conception et de la gestion des projets et, par-là, l'efficacité
de l'aide. Son atout fondamental réside dans le fait que les documents
du projet sont structurés suivant un format normalisé abordant
tous les points pertinents, y compris les hypothèses sur lesquelles
repose le projet. Elle oblige de même les professionnels de la conception
de projet à se concentrer sur les besoins réels des
bénéficiaires en exigeant une évaluation
détaillée de la situation existante. »12
12 L'OCDE Edition - 2001,
26
Conclusion :
Suite à cette analyse succincte du MCP, on constate que
les acteurs de développement de ont vite compris la
nécessité de gérer les projets agricole de façon
continue et cyclique. Les impressions sont multiples et diverses à cet
effet, mais toutes manifestent des sentiments de confiance en cette
approche.
Par exemple, l'AGCD en parlant de la GCP, estime que la
planification doit se faire progressivement, d'où la
nécessité d'avoir une vision intégrale de l'ensemble des
phases du cycle de projet. Plus la qualité de la première phase
de l'intervention n'est bonne et/ou précise, plus la qualité des
phases suivantes sera meilleure. Ce raisonnement est vrai pour tout le cycle
d'intervention.13
Et enfin, la gestion du cycle du projet met l'accent sur les
instruments systémiques, et reconnaît la nécessité
de piloter les projets au moyen d'un suivi continu de l'impact, au lieu d'une
planification à long terme, tout en conservant les idées
maîtresses de la participation, de la transparence et de la
normalisation.
Chapitre III. Approche méthodologique de
l'étude
1. L'objectif du choix d'étude :
L'intérêt que ce sujet suscite en nous est important
et se situe à un double niveau : personnel, professionnel.
D'abord au plan personnel, nous sommes émerveillés
par le nombre sans cesse croissant des projets de développement agricole
dans notre pays et par le bon ancrage de la culture entrepreneuriale et de
coopération. Notre curiosité intellectuelle nous a poussés
à nous interroger sur l'impact de ces organisations professionnelles
agricoles sur le développement économique et social du pays.
Aussi, étant dans un pays sous développé, et vu la
rareté des ressources, l'Etat à lui seul ne peut subvenir
à l'épanouissement de ses citoyens. Pour cela, il se fait aider
naturellement
par d'autres acteurs au développement dont les
coopératives les GIE Etc. Ce soutien loin
13 AGCD Administration générale de la
coopération au développement - 1990
27
d'être une panacée ou un satisfecit, nous interpelle
à réfléchir réellement sur le rôle et la
place des projets agricole dans les politiques du pays.
Ensuite, au plan professionnel, en tant que futur manager de
projets nous avons jugé utile d'entamer un début de
réflexion autour de la politique de développement et la gestion
des cycles dans les projets agricoles . Tout développement suppose un
choix judicieux d'outils de planification. Notre ambition est de rendre plus
performante et visible l'action des projets sur le terrain par un management.
Cela passe par l'élaboration de meilleurs outils de gestion. Nous
demeurons convaincus que grâce au dynamisme des projets agricoles, les
conditions de vies des populations rurales peuvent s'améliorer
énormément. Le choix de ce sujet participe à savoir la
contribution des projets agricoles à l'amélioration des
conditions de vie des paysans.
Notre présente étude poursuit un objectif
général et des objectifs spécifiques. -
L'objectif général :
L'objectif général de cette étude est de
cerner les perspectives du gouvernement dans le modèle de
développement social et économique tiré par les projets
agricoles.
- Les objectifs spécifiques :
Faire une analyse critique de la contribution des PA au
développement socio - économique dans la région de BENI
MELALL,
Proposer des solutions permettant une amélioration de la
contribution des associations sur les conditions de vie des populations au
milieu rural
2. Choix de la zone d'étude :
En réalité, le choix de la région
s'imposait, puisque les enquêtes concernaient les agriculteurs qui ont le
potentiel apicole et agricole dans la région de BENI MELLAL -
KHENIFRA.
A. Choix des organisations et projets enquêtés
:
a. Les organisations interviewés :
Le choix des organismes interviewés était fait de
telle sorte qu'il y ait une représentation de tous les types d'acteurs
et intervenants de financement ou de développement au niveau
régional. Ainsi devraient être représentés :
28
Nom de l'organisation
|
statut
|
|
Progetto mondo.MLAL
|
ONG
|
|
Le Comité Européen pour la Formation et
l'Agriculture
|
ONG
|
|
La délégation régionale de l'office du
développement de la
coopération
|
acteur public
|
|
La coordination régionale de l'agence de
développement social
|
agence public
|
|
La division de partenariat avec l'agence pour le
développement agricole
|
Service public
|
Tableau 1. Liste des organismes interviewés b. Les
projets agricoles enquêtés :
Les projets agricoles ont été choisi sur une
base d'un échantillonnage représentatif de 27 projets
répartis sur tout le territoire de la région BENI
MELLAL KHENIFRA, un découpage provincial de la région est pris en
considération toujours dans le souci de garder l'aspect
représentatif de notre étude.
Les enquêtes sont effectuées avec les dirigeants
des projets agricoles dans notre zone d'étude. 2
principaux domaines d'activités des projets à
savoir :
- L'agriculture
- L'agroalimentaire
3. Méthodologie d'approche :
L'objectif poursuivi à travers cette étude est de
vérifier à quel point les projets agricoles contribuent au
développement social et économique au milieu rural dont
l'objectif stratégique est de lutter contre la pauvreté rurale et
la dégradation de l'environnement, l'état des
infrastructures de base Etc. Dans la région BENI MELLAL -
KHENIFRA, par la
réalisation d'une enquête empirique et des
entretiens avec les parties prenantes intervenantes au développement
local et rural à fort potentiel. Et ce à travers :
? La définition des concepts de base lies au
développement agricole, rural social et économique
? Le concept du projet agricole et le management de son cycle
? L'analyse du potentiel agricole et agroalimentaire dans la
région de BENT MELLAL - KHENIFRA
? Etude documentaire sur le niveau de vie des ménages
avec une analyse comparative entre le milieu rural et urbain
29
? Description du rôle et mode de contribution des acteurs
de développement dans la question de développement au milieu
rural.
La zone de notre d'étude concerne 5 zones
rurales relevant des 4 provinces de la
région BENI MELLAL KHENIFRA, à savoir :
|
PROVINCE DE BENI MELLAL
|
|
ZONES RURALES (montagne)
|
ELKSIBA
|
NOUAR
|
FOUM ELANSAR
|
OUM EL BAKHT
|
|
PROVINCE D'AZILAL
|
|
ZONES RURALES (montagne)
|
BIN EL OUIDAN
|
AFOURAR
|
TIMOULILT
|
BOUGMAZ
|
|
PROVINCE DE FKIH BEN SALAH
|
|
ZONES RURALES (plaine)
|
OULED ABDELLAH
|
OULED
IYAD
|
BOUKAROUN
|
OULED MBAREK
|
|
PROVINCE DE KHENIFRA
|
|
zones rurales (montagne)
|
OUAOUMANA
|
TIGHSSALIN
|
AIT ISHAQ
|
****
|
Tableau 2. Répartition des zones rurales
d'étude
Conclusion :
La réalisation concrète des projets agricoles
suppose la mobilisation de nombreux agents économiques qui ne partagent
souvent pas les mêmes intérêts et ne peuvent donc pas
nécessairement poursuivre des objectifs convergents à tous les
instants, malgré les dispositions initialement prévues à
cet effet. Les problèmes à résoudre par chacun d'eux ne
présentent pas toujours la même acuité et peuvent surgir
à des rythmes différents.
Si les projets ont été réalisés de
façon à favoriser la convergence d'intérêts entre
les multiples catégories sociale, il n'en reste pas moins vrai que
parvenir à une réelle
Complémentarité de leurs efforts, doit rester une
préoccupation majeure tout au long de leur réalisation.
La coordination des activités des opérations sont
des tâches d'autant moins faciles àassumer que le
développement agricole reste soumis à d'importants aléas
d'ordre climatique, sanitaire, économique, financier, social et
politique qui peuvent entraîner des changements et des perturbations au
niveau de l'exécution et de la gestion des projets .
Le fonctionnement des projets dépend très fortement
de la qualité des rapports et partenariats existant entre les divers
organismes et services publics. Ces rapports doivent Êtres les plus
opérationnels possibles.
30
Partie II :
cadre descriptif et présentation des
résultats de l'étude
Chapitre I. Aperçu sur territoire de Beni Mellal
- Khenifra
La région BENI MELLAL - KHENIFRA est une zone
très riche en matière des ressources naturelles en eau (barrage
Bin Elwidane, barrage Ahmed el Hansaly), en superficie agricole (SAU
irriguées, forêts,....), en terme de localisation (situer au coeur
du Maroc), en terme ressources humaines, en terme de climat
(précipitations et températures). Elle dispose d'un potentiel
agricole important qu'il faut l'exploiter efficacement pour être
compétitif avec d'autres régions. Cette
compétitivité aura un effet bénéfique pour le
développement durable de secteur agricole dans le pays entier.
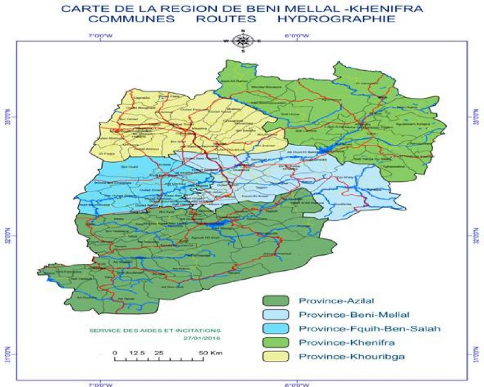
31
Figure 2 : Région BENI MELALL -
KHENIFRA
32
1. Le découpage administratif
Conscients du rôle important que joue l'organisation
administrative dans le développement économique et social du
pays, les pouvoirs publics marocains, et ce depuis l'indépendance, ne
cessent de multiplier les efforts en vue de doter le pays d'une organisation
administrative moderne, capable de répondre aux besoins et aux
aspirations des citoyens dans divers domaines: productifs, sociaux et
infrastructurels.
Ces efforts ont été couronnés, en 1976,
par la promulgation d'une charte communale relative à l'organisation des
collectivités locales et de leurs finances; et en 1996 par la
promulgation de la région en collectivité locale jouissant de la
personnalité morale et de l'autonomie financière. C'est ainsi que
le Royaume est à présent découpé en seize
régions, contenant chacune un nombre entier de provinces et/ou de
préfectures.
La région de BENI MELLAL - KHENIFRA comprend
actuellement Cinque provinces : Béni Mellal, Fkih Ben Saleh , Khouribga,
Khenifra et Azilal.
L'encadrement territorial de la région est
assuré par une armature administrative se composant de neuf communes
urbaines et soixante-treize communes rurales regroupées au sein de neuf
cercles.
|
PROVINCE
|
COMMUNES
|
|
URBAINE
|
RURALES
|
TOTAL
|
|
BENI MELLAL
|
4
|
18
|
22
|
|
FKIH BEN SALAH
|
3
|
13
|
16
|
|
AZILAL
|
2
|
42
|
46
|
|
KHOURIBGA
|
3
|
25
|
28
|
|
KHENIFRA
|
4
|
16
|
20
|
Tableau 2: Répartition des cercles et communes par
province14
14 Le Décret n°2.15.10 du 20
Février 2015,
33
2. Niveau de vie des ménages dans la
région :
A. Le niveau de vie et de consommation
Concernant la structure des dépenses de consommation
selon les grands groupes de biens et services, on constate qu'à l'instar
de l'ensemble du pays, ce sont les dépenses de première
nécessité, à savoir les dépenses d'alimentation et
d'habillement qui s'accaparent presque la moitié des dépenses
(49.9%). Le reste est réparti entre l'énergie et les
équipements ménagers (24.2%), puis les autres biens et services :
25.9% (soins médicaux, transport et enseignement ...).
|
Dépenses de consommation finale des ménages dans
la région
|
|
BENI MELLAL
- KHENIFRA
|
DCFM (en millions de DH)
|
DCFM par tête
|
|
2012
|
2013
|
2012
|
2013
|
|
31810
|
32885
|
11862
|
12204
|
Tableau 3. Dépense de consommation finale des
ménages dans la région béni Mellal -
Khenifra15
B. Le prix à la consommation
Comparés à son niveau de l'année 2010,
l'indice des prix à la consommation relatif à la ville de
Béni Mellal a augmenté de 1.8 point en 2011. Cette augmentation
est similaire à celle observée au niveau national. En revanche,
si on compare les valeurs de cet indice en 2009 l'IPC au niveau de Béni
Mellal a diminué de1.1 point par rapport à sa valeur en 2008.
Cette situation est tout à fait inverse au niveau national où on
trouve que cet indice a augmenté de1.1 point par rapport à
2008.
L'indice des prix à la consommation est calculé
mensuellement au niveau national et à l'échelle des villes, par
variété, produit, section, classe, groupe de produits et division
en plus de l'indice général. Cet indice est calculé sur la
base de la nouvelle nomenclature des prix des Nations Unies
15 Rapport des comptes régionaux de l'HCP 2010
- tableaux des résultats par le nouveau découpage
34
3. Analyse du potentiel agricole et agroalimentaire /
matrice SWOT
Le secteur de l'agriculture, forêts, parmi les piliers
de l'économie marocaine, a constamment constitué une
priorité dans la stratégie de développement
économique et social du pays.
Plusieurs raisons concourent pour conférer à ce
secteur son importance stratégique. Tout d'abord, on relève qu'au
niveau national presque 74% de la population rurale était occupée
par ce secteur en 2008 participant ainsi à l'approvisionnement du
marché local en produits alimentaires de base : céréales,
sucre, viande, lait, ...etc.
Au niveau de l'économie de la région Tadla
Azilal, le secteur agricole occupe également une place importante, aussi
bien par les emplois offerts (81.3% de la population active occupée
rurale en 2008)16 que par les effets induits sur la création
d'emplois et d'unités agro-industrielles. Dans ce chapitre, nous
procéderons à la présentation du secteur sous ses
différents aspects : intervenants, structures foncières,
productions végétales et animales et forêts.
A. La production végétale
V' Filière Agrumes :
- Niveau de rendement réalisé faible (23 T/Ha) par
rapport aux potentialités de la région (60
T/Ha) ;
- 15% des plantations dépassent 35 ans d'âge et
nécessitant un renouvellement ;
- Circuit de commercialisation non organisé ;
- Prédominance de la vente sur pieds (70%) : impact
négatif sur le revenu de l'agriculteur ;
- Sous valorisation de la production régionale ;
- Faible production conditionnée dans la station de la
région : 13 780 T (5% de la production
régionale) ;
-Absence de Label de qualité propre à la
région surtout pour la Navel et la Maroc ;
- Faible implication de l'organisation professionnelle.
V' Filière Betterave à Sucre
:
-Ecart important entre le rendement moyen global (53 T/ha) et le
potentiel réalisé de la région (100 T/Ha) ;
16 Statistiques du haut-commissariat au plan 2010
35
- Faible développement de la culture mono germe ;
- Dominance de l'irrigation gravitaire ; - Mécanisation
limitée de la culture ;
- Faible taux d'encadrement de la culture : 800 Ha/agent contre
100 Ha/agent au niveau des exploitations Pilotes ;
- Faible implication des organisations professionnelles dans
l'encadrement. V' Filière Céréales Communes
:
- Faible productivité principalement en Bour ;
- Non-respect de l'assolement (rotation céréales
sur céréales) ;
- Train technique non maîtrisé ;
- Faible recours des agriculteurs aux analyses du sol ;
- Difficultés d'approvisionnement en facteurs de
production et d'écoulement des
productions en zone de montagne.
V' Filière Olivier :
- Niveau de rendement faible (2 à 3 T/Ha), comparé
au potentiel de la région (7 T/Ha) ;
- Dispersion et irrégularité des plantations : 50%
de la superficie plantée en irrégulier ;
- Nombre important de vergers de très petites tailles en
plantation régulière ;
- Forte dominance de l'irrigation gravitaire et faible
investissement dans la reconversion du
système d'irrigation gravitaire en localisé ;
- Faible diversification variétale ;
- Circuit de commercialisation non organisé : impact
négatif sur le revenu de l'agriculteur
qui perd 1,5 à 2 Dh/Kg au profit de
l'intermédiation ;
- Multiplicité des intermédiaires qui profitent des
marges importantes par rapport aux
producteurs;
- Structure insuffisante des points de collecte des olives ;
- Dominance des unités traditionnelles de trituration
(86%) ;
- Absence d'un cadre interprofessionnel.
V' Filière Caroubier :
- 75% du potentiel de production non exploité ;
- Absence d'unités modernes de production de caroubier
;
- Faible maîtrise de l'opération de greffage ;
- Méconnaissance du sexe de l'arbre avant l'entrée
en production ;
36
- Circuit de commercialisation non organisé ;
- Complexité de la réglementation de la
commercialisation et du transport de la production ; - Sous valorisation de la
production régionale ; - Faible organisation professionnelle.
B. La production animale
? Filière Lait :
- Faible productivité des vaches laitières : 52%
des producteurs réalisent des productivités inférieures
à 2750 ;
- l/vache/an et 20% n'atteignent pas les 1500 litres/vache/an
- Ecart important entre productivité moyenne des vaches de
races pures (4500 l/V/an) et le potentiel de la Région (7000 L/V/an):
manque à gagner de 2500 l/vache/an ;
- Faible taux de couverture des vaches en insémination
artificielle : 40% ;
- Faible Taux d'encadrement de la filière : 1450
vaches/agent contre 100 vaches/agent chez les exploitations pilotes ;
- Coût élevé de l'alimentation des troupeaux,
conjugué à la non maîtrise du rationnement des vaches
laitières ;
- Les quantités du lait collectées par les
coopératives ne dépassent pas les 57% de la production
laitière ;
- Statut sanitaire du cheptel laitier non indemne en absence d'un
dépistage sanitaire obligatoire vis-à-vis de la Tuberculose et la
Brucellose Bovine ;
- Le prix du lait à la production est faible et
n'encourage pas les éleveurs à investir dans le secteur ;
- Filière menacée à cause de l'absence d'un
dialogue constructif en interprofession entre les industriels et les
producteurs.
? Filière Viandes Rouges :
- Absence d'une stratégie d'approvisionnement des
éleveurs engraisseurs en aliments de bétail Approvisionnement
collectif en aliment à des prix préférentiels, ...
- Méconnaissance de l'intérêt de l'aspect
sanitaire par les éleveurs engraisseurs ;
- Faible implication des Organisations Professionnelles ;
37
- Défaillance des circuits de commercialisation du
bétail, caractérisés actuellement par la
multiplicité ; des Intermédiaires et la spéculation; ce
qui entrave le développement du secteur d'embouche ;
? Filière Viandes Blanches :
- Non généralisation de la mise à niveau des
unités d'élevage avicoles conformément aux recommandations
de la loi 49/99 ;
- Non Maîtrise de la gestion technique et sanitaire des
élevages avicoles par les éleveurs ; - Non organisation du
circuit de commercialisation de volaille qui connaît des fluctuations -
Absence d'une infrastructure d'abattage répondant aux normes techniques
et hygiéniques
? Filière Miel :
- Conditions climatiques parfois défavorables ;
- Dominance d'élevage traditionnel à colonies
d'abeille locale peu productives ; - Absence de programme spécifique au
développement de l'apiculture ;
- Organisation professionnelle très limitée et
défaillante.
C. Principaux intervenants dans le domaine agricole
Le secteur agricole de la région Tadla Azilal est
caractérisé par l'intervention de trois acteurs principaux. Il
s'agit de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tadla (ORMVAT)
d'une part et des directions provinciales de l'agriculture (DPA) d'une autre
ainsi que une direction régional de l'agriculture (DRA).
D. Structures foncières
La Superficie agricole utile s'élève à
259.600 ha représentant 80% de l'ensemble des terres. La
répartition de la SAU selon le statut juridique révèle une
prédominance des terres Melk (91%), les terres collectives n'en
représentent que 4%.17
|
STATUT
|
PART
|
|
Terres Melk
|
91%
|
|
Terres Collectives
|
4%
|
|
Domaine privé de l'état
|
5%
|
Tableau 4: Répartition de la SAU selon le statut
juridique
17 Données de l'office régional de mise
en valeur agricole de TADLA
· Importance de la SAU qui occupe plus de 31% de la
superficie totale de la Région
· Importance des infrastructures hydrauliques : Barrages
Bin El Ouidaneet El Hansali
· Existence d'une importante infrastructure d'irrigation en
grande hydraulique
· Existence des ressources en eau souterraines qui assurent
l'irrigation des zones de pompage et de sources irrigant les secteurs de PMH
dans le Dir et la montagne
· Existence d'importantes potentialités en
matière de production et de valorisation des produits, puisqu'un manque
à gagner reste à rattraper, notamment pour les principales
filières (betterave, céréales, agrumes, olivier, amandier,
lait, viandes et apiculture )
· Acquisition d'une grande expérience en
matière de conduite des cultures (exploitations pilotes réalisant
le potentiel de production de la région)
· Développement d'un tissu organisationnel important
(projets , coopératives,...)
· Existence d'une infrastructure agro-
industrielle privée, notamment en matière de
traitement des productions de la betterave et du lait
· Possibilité de développement de produits de
terroirs, surtout en zones de montagne
· Dominance de la petite exploitation non viable
· Faible valorisation de l'eau d'irrigation par la
majorité des cultures pratiquées
· Dominance de l'irrigation gravitaire occasionnant
d'énormes pertes en eau d'irrigation
· Faible implication des organisations professionnelles au
niveau de l'encadrement des producteurs
· Conduite technique sommaire des cultures, surtout en
zones de PMH et bour
· Absence d'organisation des circuits de
commercialisation des fruits et légumes
· Insuffisance des aspects liés au conditionnement
et à la valorisation des productions.
38
Les terres irriguées s'élèvent dans la
région à 126000ha, soit 49% de la SAU. Eu égard aux
importantes ressources en eau dont dispose la région, les superficies
irriguées restent encore faibles et peuvent être
étendues.
E. Analyse du potentiel agricole - la matrice SWOT
|
S (Forces) w (Faiblesses)
|
O (Opportunités) T (Menaces)
· Milieu physique (climat, sols) favorable pour une
production agricole diversifiée
· Grandes potentialités en terres agricoles pouvant
constituer le support de grands projets porteurs (Terrains SODEA et SOGETA,
Terres Collectives et Domaniales)
· Proximité des grands centres de
consommation du pays, notamment Casablanca, Marrakech et
Fès, lesquels comptent plus de 7 Millions de consommateurs
· Développement des infrastructures de base, avec la
naissance de grands projets en matière de transport (autoroute Berrechid
- Béni Mellal, Aéroport Béni Mellal,...).
|
· Succession des années de sécheresse qui
entrave l'expression du potentiel agricole de la Région
· Baisse chronique des dotations d'eau d'irrigation
allouées au périmètre irrigué, ce qui pose la
problématique de durabilité du système de production en
irrigué
· Non adéquation entre rareté de l'eau
d'irrigation et tarification de l'eau qui reste parmi les plus faibles au
niveau national
· Baisse du niveau de la nappe phréatique suite
à sa surexploitation
· Concurrence imposée par d'autres secteurs (AEP,
Industrie) vis-à-vis de la ressource eau
· Pollution des ressources en eau souterraines par les
effluents et rejets (Unités industrielles, Engrais, ...)
· Faiblesse des marges bénéficiaires et de la
valorisation de l'eau d'irrigation par les cultures; ce qui condamne le
développement agricole à terme
· Extension urbaine au détriment des terres
agricoles.
|
|
39
Conclusion :
Le territoire de BENI MELLAL - KHENIFRA représente la
zone géographique qui réunit des ressources naturelles
idéales (environnement et milieu naturel biologique, y compris les
ressources génétiques) et les ressources humaines ou culturelles
portées par différentes générations d'habitants et
de producteurs. le terroir est la zone géographique
délimité ainsi la communauté humaine a
développé, au cours de son histoire, une méthode de
production et un savoir-faire collectifs basé sur un système
d'interactions entre un milieu riche et diversifié et un ensemble de
facteurs humain impliqués pour exprimer une originalité,
conférer une typicité et constituer la réputation des
produit agricoles locaux .
40
Chapitre II. Les acteurs des projets de
développement agricole .
Cette partie du travail consiste essentiellement à
présenter les institutions qui interviennent dans l'élaboration
ou concrétisation des projets agricoles dans la région (leurs
priorités, leurs domaines d'intervention, leurs critères
d'éligibilité...). Il s'agit de leurs méthodes de travail
ainsi leurs objectifs.
1. Les organisations non-gouvernementales (ONG)
Les organisations de la société civile qui ont
été qui ont contribué à notre étude sont
:
? CEFA : Le Comité Européen pour la Formation et
l'Agriculture; ? ProgettoMondo. Mlal
A. Le Comité Européen pour la Formation et
l'Agriculture
La CEFA est la 1éme plus grande ONG italienne
après ProgettoMondo Mlal. Cette ONG créée en 1972
à Milano (Italie), est présente dans une cinquantaine de
pays dans le monde et oeuvre essentiellement dans les domaines suivants :
? Développement rural, des populations
défavorisées ;
? Soutien aux initiatives locales ;
? Renforcement des capacités ;
? Appui à la gouvernance et financement des projets
agricoles.
? Intervention dans le domaine d'éducation
Cette ONG oeuvre de concert avec les populations locales et
les partenaires. Son apport est essentiellement technique et structurel mais
aussi des actions de proximité. En effet, elle aide les populations
à identifier et à planifier des projets de qualité puis,
à trouver les financements nécessaires. Toutes ces actions lui
ont valu le prix Nobel de la paix en 1972.
B. L'organisation ProgettoMondo Mlal
L'organisation ProgettoMondo Mlal est une institution
privée de volontariat national et international. Elle a
été constituée en 1966, et a son
siège à Vérone (Italie). Elle a pour objectif de
promouvoir et soutenir l'engagement de volontaires en Amérique
Latine et en Afrique, et de stimuler et renforcer le
volontariat.
41
La progetto mondo.mlal travaille essentiellement dans 21 pays
dont le Maroc dans la région de BENI MELLAL - KHENIFRA.
Elle intervienne dans les domaines :
· L'autosuffisance alimentaire
· La lutte contre l'exode rural
· Les petites productions agricoles
· La promotion de le femme rurale
· La formation professionnelle agricole
· Financement des projets solidaire
· Les droits de l'homme
2. Les agences gouvernementales
Les agences gouvernementales de développement sont des
administrations qui sont installées dans les pays les moins
avancés dans le cadre de la coopération. Elles gèrent
l'aide publique au développement de leurs gouvernements respectifs. Leur
mission principale est la concrétisation des politiques et projets de
développements élaborés par leurs gouvernements.
Le Maroc bénéficie d'une représentation
importante de ces agences gouvernementales de développement parmi
lesquelles, 2 constitué qui sont impliqués dans la
concrétisation des projets de notre étude. Ce sont :
- Agence de développement social
- Agence pour le développement agricole
- Office de développement de la coopération
A. L'agence de développement social a.
Présentation de l'ADS
L'ADS est un établissement public marocain doté
de l'autonomie financière. Elle a pour mission d'appuyer
financièrement et d'accompagner des projets de développement
local dans les milieux ruraux et périurbains. Sa mission principale est
de contribuer à la réduction de la pauvreté, de la
marginalisation et à la promotion d'un développement durable par
:
· L'amélioration des conditions de vie des groupes
défavorisés par le soutien de petits projets
· La création d'emplois durables et
générateurs de revenus pour les populations vulnérables
· 42
Le renforcement des structures relais (organisations travaillant
dans le même sens que l'ADS)
L'ADS, dans ses différentes démarches essaye de
concilier trois concepts importants qui sont :
· La participation de l'ensemble des acteurs en particulier
des populations concernées ;
· L'approche genre ;
· La dimension environnementale.
b. Structure de l'ADS :
Quatre organes principaux concourent à la gestion
centrale et régionale de l'agence. Ce sont :
· Le conseil d'administration : détermine la
politique générale de l'ADS (programme annuel, budget, domaines
prioritaires...) ;
· La direction : prend les décisions
nécessaires à la gestion de l'ADS ;
· Les coordinations régionales : assurent la
promotion des activités de l'ADS dans leur ressort territorial.
c. Secteur d'intervention de l'ADS :
SECTEUR D'INTERVENTION DE L'ADS
|
INFRASTRUCTURES SOCIALES DE
BASE
|
Eau potable et assainissement Education - Soins de santé
primaire Projets socio-éducatifs Préservation de l'environnement
Electrification rurale
|
ACTIVITES GENERATRICES DE
REVENUS
|
Irrigation, agriculture Promotion et soutien Eco - Tourisme
Formation professionnelle
|
FORMATION ET APPUI
INSTITUTIONNEL
|
Renforcement des capacités institutionnelles Formation -
Assistance technique ,Information
|
|
Tableau 5: tableau des domaines d'intervenetion de
l'ADS
43
d. Les critères généraux
d'Eligibilité de l'ADS :
Tous les projets présentés à l'ADS doivent
:
· Avoir un caractère communautaire et participatif
;
· Profiter aux couches les plus de favorisées de la
population surtout au milieu rural ;
· Promouvoir l'égalité entre les hommes et
les femmes ;
· Etre viables sur le plan technique et
socio-économique ;
· Présenter des garanties de durabilité ;
· Utiliser en priorité les ressources et
matérielles locales.
L'ADS réalise depuis sa création des efforts
considérables en faveur de l'amélioration des conditions de vie
des populations défavorisées. Elle connaît plus que
n'importe quelle agence, les spécificités socioéconomiques
du milieu Marocain. Elle est la seule agence qui a des représentations
sur tout le territoire grâce à ses coordinations régionales
qui complètent les actions menées par Rabat (Ce sont Oujda, Beni
Mellal, Fès, Agadir et Laâyoune). C'est pour cette raison qu'elle
est la partenaire privilégiée de la plupart des institutions de
développement au Maroc.
B. L'agence pour le développement agricole
a. Présentation de l'ADA
C'est un établissement public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après
désigné par l'Agence. L'Agence est placée sous la tutelle
de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes
compétents de l'Agence, les dispositions de la présente loi, en
particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de
manière générale, de veiller à l'application de la
législation et de la réglementation concernant les
établissements publics. L'Agence est également soumise au
contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics
et autres organismes conformément à la législation en
vigueur.
L'Agence a pour mission de participer à la mise en
oeuvre de la stratégie adoptée par le gouvernement en
matière de développement agricole. L'Agence est notamment
chargée de proposer aux autorités gouvernementales les plans
d'action relatifs au soutien des filières agricoles à haute
valeur ajoutée dans une perspective d'amélioration de la
productivité.
44
b. Structure de l'ADA
Le conseil d'administration est composé de :
· Représentants de l'Etat ;
· Deux représentants des professionnels élus
parmi les présidents des chambres d'agriculture
· Deux personnalités nommées par
l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture compte tenu
de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la formation
agricoles.
Il peut inviter à assister, à titre
consultatif, à ses réunions toute personne du secteur public ou
privé, dont la participation est jugée utile. (Voir
l'organigramme dans les annexes)
c. Secteur d'intervention de l'ADA
· la recherche et la mobilisation du foncier pour
l'extension des périmètres agricoles et le développement
des cultures à haute valeur ajoutée ;
· l'incitation à la valorisation des produits
agricoles à travers la mise en place de nouveaux systèmes,
d'équipements des exploitations, de conditionnement et de
commercialisation ;
· la promotion des investissements agricoles et la mise
en oeuvre des partenariats avec les investisseurs.
d. Les critères généraux
d'Eligibilité de l'ADA
· Avoir un caractère de développement
agricole ;
· Soit une action au profit des porteurs de projets
désirant investir en agriculture ;
· Promouvoir les territoires a vocation agricole ;
· Etre viables sur le plan agro économique ;
· Présenter un caractère de solidarité
et coopération ;
· Valoriser en priorité les ressources de
terroir.
45
C. Office de développement de la
coopération
a. Présentation de l'office de développement de la
coopération
Le Bureau du Développement de la Coopération
(BDCO) a été créé le 18 Septembre 1962 sous forme
de structure administrative dépendante de la présidence du
Conseil de Gouvernement. Avec l'importance accordée par les pouvoirs
publics au secteur coopératif, la nécessité de sa
restructuration s'est imposée ; d'où sa conversion en
établissement public bénéficiant de la personnalité
morale et l'autonomie et financière dénommé Office de
Développement de la Coopération (ODCO) conformément au
Dahir du 3 Août 1975 doté d'attributions précises
Orientées principalement vers l'accompagnement des
coopératives dans les domaines de la formation, l'information et l'appui
juridique.18
b. structure de l'ODECO
L'organisation interne de l'office a été
particulièrement influencée et façonnée par ses
attributions, et se reflètent clairement dans son organigramme qui
comprend des services centraux au niveau du siège et quatorze 15
délégations régionales.

Figure 3 : Organigramme de L'ODECO
18 La loi 24-83 relative a la création de
l'office de développement de la coopération
46
i. les attributions de la division formation et
information :
Le législateur a donné plus d'importance
à la formation des ressources humaines dans les coopératives la
division de formation et information et dans le cadre des fonctions qui lui
sont attribuées se charge de :
1. Assister les coopératives et leurs unions dans le
domaine de la formation et l'information,
2. Financer les compagnes de vulgarisations sur les principes
coopératifs,
3. Collecter et diffuser les documents et informations relatifs
au mouvement coopératif,
Parmi les attributions de la division de formation et information
qui est compensée de deux services (Formation et Information) :
· Coordination et suivi de l'exécution des
opérations relatives à la formation et information,
· Coordination avec les administrations techniques, les
partenaires, coopératives et leurs unions en vue d'établir un
programme et des modules des sessions de formation et de sensibilisation,
· Coordination avec les intervenants dans l'organisation
des journées d'études, des forums, tables rondes..... concernant
des sujets relatifs au secteur et mouvement coopératif marocain.
· Création des relations bilatérales et
multi latérales relatives au mouvement coopératif avec les
organisations et les représentations estrangères au Maroc.
· Coordinations avec les organisations gouvernementales
et non gouvernementales en matière d'encadrement et formation des
ressources humaines dans les coopératives.
ii. Les attributions de la division des
études et assistance eux coopératives :
La division des études et assistance aux
coopératives déploie au sien de L'Office de développement
de la coopération (ODCO) plusieurs missions afférentes aux
attributions de celui-ci conformément au Dahir portant loi No
1.73.654 en date du 23 Avril 1975.Parmi ses fonctions on peut citer :
· Etude des dossiers d'agrément des
coopératives et leurs unions et le suivi des différentes
étapes relatives à la procédure d'agrément,
· Assister les coopératives et leurs unions
à l'élaboration de leurs statuts et règlement
intérieurs et particulièrement dans le domaine juridique,
· Production et diffusion des statistiques relatives aux
coopératives et leurs unions,
·
47
Etudier et proposer toutes réformes législatives ou
réglementaires et toutes mesures de caractère particulier
intéressant la création et le développement des
coopératives,
· Régler les différents à l'amiable au
sien des coopératives,
· S'assurer que les coopératives et leurs unions
sont gérées conformément à la loi No
24/83 formant le statut général des coopératives et les
missions de l'ODCO et des textes prix pour son application,
· Gestion et actualisation du fichier central des
coopératives,
· Elaborer de guides (comptabilité, documents
administratifs, création des coopératives
etc )
· Assister aux assemblées générales
constitutives, ordinaires, annuelles et extraordinaires des
coopératives,
· Réalisation de diagnostics et audits dans le cadre
de l'assistance à la promotion et à la mise à niveau des
coopératives.
iii. Les attributions de la division finance et
ressources humaines :
Il se décompose de deux services le premier
destiné au support administratif chargé de la gestion des
ressources humaines et la gestion des emplois et compétences , le
deuxième est service financier a pour objectif d'élaborer les
budgets de l'office et préparer les comptes de gestion de l'office .
Le service administratif :
· Gérer les dossiers administratifs du personnel de
l'Office (recrutements, avancements et promotions, dossiers de
crédit...etc.)
· Gérer la paie du personnel de l'Office
· Préparer les plans de formation continue du
personnel et veiller au suivi de leur exécution
· Elaborer le référentiel des emplois et
compétences.
Le service financier et recouvrement :
· Tenir la comptabilité générale de
l'Office et préparer les états de synthèse ;
· Gérer le parc automobile de l'Office ;
· Assurer l'inventaire annuel du matériel et du
mobilier de bureau dont dispose l'Office ;
· Veiller au contrôle continu des régies des
recettes et des dépenses existantes au niveau du siège de
l'Office et de ses délégations régionales.
48
c. Les secteurs d'intervention de l'ODECO :
Dans le but d'améliorer la situation des
coopératives et leurs performances, dans la perspective de leur mise
à niveau, l'ODCo, suivant les prérogatives qui lui sont
dévolues, procède à :
? Organisation de cessions de formation aux profits des
coopératives et projets agricoles ? Assistance aux réunions des
coopératives et projets agricoles
? La réalisation du diagnostic des projets agricoles
réalisés en partenariat avec l'ODECO ? Aide à la
commercialisation des produits agricoles
D. La Direction régionale de l'agriculture BENI MELLAL -
KHENIFRA : a. Présentation de la DRABk
Le directeur régional est chargé de décliner
les orientations nationales du secteur agricole au niveau régional a
travers l'élaboration des plans agricoles
régionaux. il s'assure de la
bonne mise en oeuvre de ces plans régionaux et coordonne l'action de
l'ensemble des acteurs du secteur au niveau de la région. Il est
également responsable de la bonne gouvernance de la direction
régionale.
i. La structure divisionelle :
Division finance et support :
Superviser et piloter la gestion des services support au niveau
régional Gérer les équipes sous sa
responsabilité
Division de l'irrigation et de l'aménagement de
l'espace agricole :
- Planifier et suivre les ressources hydro agricoles
- Planifier et suivre les projets d'aménagements
(hydro-agricoles, fonciers et de parcours)
Division de développement des filières
agricoles :
- Encadrer le développement des filières agricoles
au niveau régional - Assurer le suivi du développement des
filières au niveau régional
Division du partenariat et appui au développement
:
- Piloter le système d'aides et d'incitations
- Superviser le traitement des requêtes
- Encadrer les organisations professionnelles et la Chambre
d'Agriculture Régionale
- Animer la vulgarisation
- Animer et suivre l'enseignement technique et la formation
professionnelle au niveau
régional
49
- Orienter et suivre la recherche et développement au
niveau régional.
ii. Le service attaché :
Service contrôle de gestion :
- Collecter et consolider les données de contrôle
de gestion
- Analyser les données collectées et
consolidées de contrôle de gestion
Service statistiques :
- Réaliser les enquêtes statistiques et
recensements
- Consolider les statistiques et gérer la base de
données
Service communication et promotion :
- Assurer la communication
- Mener des actions de promotion
Service coordination avec l'ADA :
- Assurer la coordination avec l'ADA
- Participer aux projets réalisés par agence de
développement agricole
b. Les activités de la direction régionale
d'agriculture BK
La mise en oeuvre du Plan Agricole Régional comprenant
70 projets, dont 38 projets pilier I et 32 projets pilier II, avec un montant
d'investissement de 12 milliards de dhs, se poursuit par le lancement de 42
projets avec 17 projets pilier I et 25 projets pilier II, soit 56 % du
programme, pour un investissement de 4.9 milliards de dhs soit 40% du montant
total d'investissement.
Les projets ainsi lancées concernent les principales
filières au niveau de la région notamment l'olivier, les agrumes,
le grenadier, l'amandier, le pommier, le noyer, la vigne, la betterave à
sucre, l'apiculture, le lait et les viandes rouges et répondent
parfaitement aux besoins de la région en matière de valorisation
et de commercialisation des produits agricoles.
Dans ce sens, 18 unités de valorisation sont
créés ou en cours de construction, notamment 7 unités de
trituration des olives, 2 unités de valorisation de pommier, 1
unité apicole, 1 unité de valorisation de grenade, 3
unités de valorisation des amandes, 1 unité de valorisation des
vignes, 1 unité de valorisation des noix, 1 unité de valorisation
du lait et une unité de valorisation des viandes rouges et qui vont
permettre à la région de tirer profit de la valeur ajoutée
des produits agricoles.
50
C. Les secteurs d'activités de la DRABK
i. En matière d'économie d'eau
d'irrigation
La région de Tadla Azilal connait la
réalisation de la première tranche de PNEEI qui constitue la
principale action transverse du Par de Tadla Azilal à travers la
reconversion de terre collective de l'irrigation gravitaire en irrigation
localisée sur une superficie de 10235 ha pour un montant
d'investissement de 977 millions de dirhams.
En parallèle, la superficie équipée en
système d'irrigation à économie d'eau par les agriculteurs
à titre individuel a atteint les 21000 ha. Ces efforts
déployés en matière de modernisation des techniques
d'irrigation permettront d'une part une importance économie en eau
d'irrigation et d'autre part l'intensification de nouvelles cultures à
haute valeur ajoutée et par conséquent l'amélioration des
revenus des agriculteurs.
ii. En matière de développement
agricole régional
Dans ce contexte, et depuis la création des guichets
uniques en 2008, le nombre de dossiers de demande d'aides traités au
niveau de la région de Tadla Azilal s'élève à 7170
dossiers pour un montant global de 919 Millions de Dhs.
Au niveau régional, 72% des aides de l'état ont
été accordées au niveau de la zone d'action de l'ORMVE de
Tadla, suivi de la zone DPA de Beni Mellal avec 25% et de la zone DPA d'Azilal
avec 3%.
En ce qui concerne la répartition de l'aide
financière par type d'investissement, les projets d'irrigation
localisée et aménagement hydro agricoles se situent en premier
rang avec un taux de 40% et un montant de 332.78 Millions de Dhs pour une
superficie équipée de 17 262 ha. L'équipement en
matériel agricole intervient en deuxième position pour un taux de
30% et un montant de 250.42 Millions de Dhs. Pour ce qui est de
l'intensification de la production animale, les bâtiments et le
matériel de l'élevage, ont été
subventionnées par un montant de 134.49 Millions de Dhs, soit 17% de
l'aide totale accordée depuis 2008, en plus d'une aide de 43.41 Millions
de Dhs (5%), octroyées aux éleveurs pour la production et
l'acquisition des reproducteurs bovins de race pure.
51
Les autres projets d'investissements restant ont
bénéficié d'une aide de 157.91 Millions de Dhs, soit 19%
du montant total distribué. Ces projets concernent en grande partie
l'installation des
vergers de l'olivier et la plantation des agrumes qui ont
reçu un montant de subvention de 64.13 Millions de Dhs, soit un taux de
8% pour une superficie plantée de 6704 ha, l'acquisition du petit
matériel agricole qui a reçu un montant de subvention de 93.78
Millions de Dhs soit un taux de 11%.19
3. Les bailleurs de fonds
A. La banque mondiale
Les bailleurs de fond sont des groupes financiers qui ont pour
objectif principal le financement d'activités propices au
développement.
Le groupe de la banque mondiale crée en 1945 est la
plus grande source d'aide au développement. Elle est présente
dans plus de 100 pays en développement où elle apporte des
financements mais aussi des idées en vue d'aider ces pays à
améliorer leur niveau de vie, favoriser leur croissance
économique et éradiquer la pauvreté (BM, 2004).
La BM appartient à 184 Etats qui sont les actionnaires
et dont les opinions sont représentées par un conseil des
gouverneurs et un conseil des administrateurs basés à
Washington.
Le groupe se compose de cinq institutions qui sont : BIRD
(Banque internationale pour la
reconstitution et le développement), IDA (Association
internationale de développement), SFI
(Société
financière internationale), MIGA (Agence multilatérale de garanti
des investissements),
Le Maroc a adhéré à la BM depuis 1958 et
l'ouverture du bureau de la BM à Rabat eu lieu en 1998. Cette
coopération s'est concrétisée par la réalisation de
divers projets en faveur du Maroc. Ces nombreuses réalisations visent
particulièrement les points suivants :
? La promotion du développement humain et des politiques
de l'inclusion dans « l'autre
Maroc »
? La valorisation des conditions de développement
économique et du développement du secteur
privé
? La réduction de la vulnérabilité des
pauvres
? L'amélioration de la gouvernance publique
19 Chiffres de la direction régionale de
l'agriculture de BENI MELALL - KHENIFRA
52
B. La banque africaine de développement
La Banque africaine de développement est une institution
financière multinationale de
développement, établie dans le but de contribuer au
développement et au progrès social des États africains.
La BAD, dont le siège est à Abidjan (Côte
d'Ivoire), a été fondée en 1964. Le groupe comprend deux
entités : la Banque africaine de développement, le Fonds africain
de développement, créé en 1972 .
La mission de la Banque est de combattre la pauvreté et
d'améliorer les conditions de vie sur le continent, via la promotion des
investissements à capitaux publics et privés dans des projets et
des programmes aptes à contribuer au développement
économique et social dans la région. La BAD est un bailleur de
fond pour bon nombre de pays africains et d'entreprises privés
investissant au Maroc.
Conclusion
Après cette description des acteurs des projets de
développent agricole, il est important de procéder à
étudier et analyser leur contribution sur la réalisation des
projets agricole qui sont considérés comme une activités
économique durable et un levier de développement rural viable
quel que soit l'apport en matière de financement d'accompagnement ou
d'évaluation .... Etc
53
Chapitre III. Présentation des résultats de
l'étude terrain.
1. Présentation du cadre général
des enquêtes
Ce chapitre présent des constats issus d'une analyse
menée sur les projets dans le milieu rural dans la région de BENT
MELLAL - KHENIFRA. Elle a été réalisée sous la
direction de l'équipe d'encadrement au sein de mon lieu de stage
(Direction régionale de l'agriculture de BENT MELLAL)
L'approche prise porte sur la nécessité projeter la
lumière sur les actions participant au développement
socio-économique des zones rurales. A partir de notre lecture
théorique, il est apparu qu'un des vecteurs semblant pouvoir
répondre à cette attente est celui des projets de
développement agricole une vision souvent citée par les
responsables des politiques publique.
En 2009-2010 environ 94% des projets agricoles dans la
région sont composées de moins de dix travailleurs
indépendants. En termes de densité, cela représente 7
projets agricoles : coopératives -
associations professionnelles - groupement d'intérêt
économique - fédération agricole Etc.
pour 100 ruraux,
contre 5.3 PA pour 100 habitants du milieu urbain en 2002.
Malgré leur faible présence, ces projets sont
faiblement reconnus comme moteurs de développement économique,
facteurs de cohésion sociale et pourvoyeurs d'emploi par la population.
Dans, ce sens, il est apparu intéressant de penser à un
étudier une telle problématique de situation actuelle.
Les objectifs principaux de l'étude étaient les
suivants : dresser le profil du porteur des PA , identifier les impacts locaux
du projet , mettre en considération les atouts et les contraintes d
milieu rural par rapport la mise en place des PA ainsi que ses perspectives
d'avenir dans ce milieu et dégager des pistes de développement de
la création des PA en milieu rural.
54
La collecte des informations s'est réalisée sur
base de contacts de terrain auprès de 27 PA,
localisés au sein des zones rurales relevant le territoire de 5
provinces de la région (BENI MELLAL - AZILAL - FKIH BEN SALAH - KHENIFRA
- KHOURIBGA).
Ces zones ont été sélectionnées
afin d'intégrer des spécificités territoriales des zones
rurales. En suite l'échantillon de communes intègre
différentes dynamiques démographique et résidentielle,
différents niveaux de richesse (interprété selon le revenu
net moyen imposable par habitant), de densités en PA (nombre De
PA/km2 et nombre de hab/ km2) .
L'échantillon pris a permis d'atteindre un taux de
représentativité assez bon des PA dans les communes
sélectionnées.
Nous avons décidé de mettre l'accent sur 2
secteurs d'activité reposant sur la vocation agricole globale d'une ou
de plusieurs caractéristiques locales. A savoir : le secteur
agroalimentaire (5 répondants), agriculture (22
répondants),
L'analyse des résultats a été
opérée sur base d'une approche globale portant sur l'ensemble de
l'échantillon mais aussi selon une approche par secteur (selon les
secteurs d'activité ciblés) et le milieu d'origine du dirigeant
du PA (issu de la ville ou de la campagne).
55
2. Discussion des résultats et constats :
« Quelles ont été les motivations
qui vous ont poussé à créer votre PA ? »
La question suivante a été posée aux
dirigeants de projets : « Quelles ont été les
motivations
qui vous ont poussé à créer
votre PA ? ». Les réponses étaient
spontanées et trois motivations pouvaient être
énoncées. Des Réponses recueillis, il ressort que c'est
essentiellement la dynamique psychologique qui intervient dans la
création des PA. Les Créateurs recherchent l'amélioration
du revenu autonomie et indépendance. Ils veulent prendre des initiatives
et contribuer au développement de leur territoire dans ce sens. Ils sont
animés par la volonté et le plaisir trouvé de proposer des
produits et/ou services nouveaux.
Ils recherchent aussi une certaine qualité de vie,
trouvée pour certain par la possibilité de travailler à
domicile et pour d'autre par celle de travailler à son rythme ou en
famille. Au cours des entretiens tenus avec les Créateurs des PA, il est
apparu qu'ils étaient pleins d'énergie et de motivation et qu'ils
avaient un réel besoin de réalisation et de développement
personnel.
|
Les motivations de création
|
Réponses en %
|
|
Vivre sa passion
|
18.50%
|
|
Besoin d'autonomie
|
74.10%
|
|
Améliorer le revenu
|
88.90%
|
|
Autre
|
66.70%
|
Tableau 6: Les motivations de création des PA
Quel est le profil des créateurs des projets
agricoles :
|
V' C'est un homme [70.4%]
V' C'est une femme [29.60%]
V' Il est originaire du milieu rural [85.2%]
V' Il habite près de son entreprise [92.6%]
V' Il a souvent terminé ses études secondaires
[40.7%], 37% ont fait des études
universitaires
V' Il est âgé entre 30 et 35 ans [48.10%]
|
56
La création des PA semble être grâce
à la naissance du terroir. Près de 86% des créateurs
rencontrés sont originaires du milieu rural. Bien souvent, la
création a lieu après le trentième anniversaire du
créateur (48%). Au-delà de 40 ans, entreprendre
une telle activité devient plus difficile (14.80 %). La
représentativité féminine est moins dominante au sein de
notre échantillon sondé (29%).
Les quelques femmes rencontrées, principalement actives
dans l'activité de l'élevage et la transformation du lait :
fromagerie - huile d'olive - les pates traditionnelles. De ce fait elles
contribuent également à côté des hommes à
développer une valeur économie de leurs territoires ruraux.
Est-ce que la proximité des ressources et la
disponibilité du foncier prime sur le choix de l'installation des PA
?
Comme annoncé précédemment, une grande
majorité des dirigeants de projets rencontrés est originaire de
la campagne. Les résultats recueillis fait donc apparaître une
forte filiation au milieu rural (85.20%). Toutefois, dans le
même échantillon presque (15%) sont issus de la
ville, alors le choix de vivre et de travailler à la campagne s'est fait
en même temps.
Ces constats laissent supposer que nos zones rurales disposent
d'une typicité attractive auprès des porteurs de projets
agricoles et présentent de réelles opportunités
favorables.
Pour environ (82%) des dirigeants des PA, La
proximité des ressources en milieu, y compris la disponibilité du
foncier : terrain, (66.7%) et le lieu de naissance en milieu
rural (63%) ont été déterminants dans leur choix
d'implanter leur projet en milieu rural.
Il ressort que la spécificité du milieu rural
(proximité des ressources, la disponibilité du foncier)
prévalent sur les possibilités de promotion territorial et du
dynamisme du milieu rural au niveau de la région BENI MELLAL -
KHENIFRA.
La recherche de rentabilité (existence d'un
marché potentiel) avec un ensemble de réponse de (3.70%),
Constatant que la recherche de profits n'est pas donc
l'élément majeur ou il est plus faiblement marqué dans les
motivation des créateurs de projet, plus tôt que la recherche d'un
mieux-être.
Ajoutant que au cours des discussions tenues avec les chefs de
projets, il est d'ailleurs parfois exprimé une volonté
affirmée à garder un caractère classique à leur
activité.
57
« Quelles sont les raisons de votre choix du lieu
? »
Autre Les liens familiaux Natif du milieu rural Aide et
incitations de l'Etat Proximité des ressources
0%
29.60%
63%
7.40%
81.50%
Dynamisme de la zone Foncier disponible Existence d'un
marché potentiel
33.30%
66.70%
3.70%
Travail à domicile
22.50%
|
Atmosphere de vie agréable
|
|
18.50%
|
|
|
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Graphique 1: Les raison de choix du lieu
Alors constatant que plus que des éléments
socio-économiques, existe des éléments
(territoriaux ou spatiaux) qui peuvent en effet être
considérés comme susceptibles d'avoir un impact positif sur la
décision d'implanter des PA en milieu rural. En choisissant ce milieu
pour installer les PA, les Créateurs évitent en effet des
surcoûts fonciers (énoncé comme facteur de localisation par
(66.7% des répondants).
A contraire, d'autres facteurs plus au moins sans incidence
sur la localisation des projets agricoles tel que des facteurs publiques et
gouvernementaux, tels que les aides et incitation publiques aux PA
(7.40% des répondants).
Les projets agricoles et leurs caractères
:
Les différentes politiques et stratégies de
développement de secteur agricole au niveau du Maroc s »occupent
une place importante en termes de croissance socioéconomique de nos
régions.
On peut citer le plan Maroc vert aussi la stratégie
nationale de développement rural et les plan communaux de
développement ainsi l'initiative nationale pour le développement
humain, sans oublier les nombreuses aides financières : le fond de
développement agricole (FDA) et le fond de développement rurale
(FDR).
58
Outre les effets sur la croissance sociale et
économique que nous cherchions à démontrer a traves ce
travail , les enquêtes faites a permis de constater que les PA
participent activement au développement rural .
Ils dynamisent le milieu rural par la création
d'emplois, ils permettent aussi l'exploitation des ressources locales,
l'utilisation du savoir-faire local et participent à la promotion
sociale des territoires par l'enrichissement du relationnelle entre les
habitants des douars et zones rurales en globale. Ainsi, les PA jouent deux
rôles : économique et de développement rural en global.
Les enquêtés nous disent aussi que La
flexibilité du personnel et l'esprit de collaboration est
également une caractéristique attendue au sein des PA :
(78%) sont assez d'accord que le climat de travail est
qualifié de « bon ». La cohésion entre les membres du
personnel et l'esprit d'équipe sont bien jugés.
L'ambiance au sein des PA rurales est bonne
?

25.90%
0%
11.10%
63%
Sans avis
Pas d'accord Assez d'accord
Tout à fait d'accord
Graphique 2: L'ambiance au sein des PA
L'esprit de collaboration et de solidarité au
sein de votre PA est bon ?
Sans avis
Pas d'accord Assez d'accord
Tout à fait d'accord

18.50%
78%
3.70%
Graphique 3: L'esprit de collaboration au sein des PA
Existe-t-il une continuité de l'activité
économique des projets agricoles installés en milieu rural ?
:
Les résultats traités dans leur globalité
indiquent que (40.70%) des enquêtés voient
respectivement leur revenus augmenter et (48%) ont
répondu que leur revenu est stable.
4% des enquêtés ne touchent aucun
impact sur leur revenu et les (7.40%) restants ont
malheureusement marqués une diminution de leur revenus à cause
d'une compagne agricole mauvaise.
Alors on peut constater que le PA en milieu rurale est en
général, en bonne santé et il répond plus au moins
au développement économique local.
Quelle est l'impact de votre activité sur
l'amélioration du revenu des membres de PA ?

40.70%
4%
7.40%
48%
Aucun impacte Diminue Stable Augmente
59
Graphique 4: l'impact de l'activité sur le
revenu
Les enquêtés ont ensuite été
interrogés sur leur prévision globale envers leur avenir. On
constate alors qu'il n'y a pas de doute entre la prospérité
actuelle du PA et la confiance qu'à son dirigeant en son avenir.
(81.50%) voient leur avenir clairement.
Comment voyez-vous l'avenir de votre PA ?
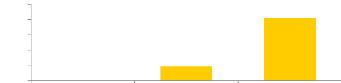
100%
81.50%
80%
60%
40%
18.50%
0%
20%
0%
sans avis Incertain Claire
Graphique 5: l'avenir des projets agricoles
Afin d'identifier les difficultés attendues par les
créateurs des PA en milieu rural dans son avenir proche, une liste de
proposition lui a été suggéré. Plusieurs
réponses étaient possibles. Définies comme obstacle, les
charges et dépenses arrivent en tête des problèmes.
Le souci de commercialisation de leur produit et les mesures
d'aide de l'Etat font également parties des préoccupations de
plus de (59%) des problèmes attendus. (40.70%)
des enquêtés expliquent aussi qu'il est de plus en plus
difficile de gérer les problèmes internes et
organisationnelles,
Quelles sont les difficultés attendues
?

70.40%
29.60% 29.60%
59.30%
51.90%
18.50%
29.60%
40.70%
11.20%
60
Graphique 6: les difficultés attendues par les
PA
61
Le milieu rural : quels atouts pour implanter des
activités économique ?
Nous avons mis aux créateurs des PA toute une
série d'éléments et nous leur avons demandé s'ils
les considéraient comme des atouts ou des contraintes du milieu rural ou
sans effet sur le fonctionnement de leur projets agricoles : organisation de
leurs activités.
Les réponses obtenus, il ressort que les
enquêtés considèrent pas souvent les conditions du milieu
rural comme étant des obstacles à leur fonctionnement.
(52%) expriment que Le cadre de vie
agréable est l'une des caractéristiques principales dont
bénéficie du milieu rural. L'air pur, le calme et le retour
à l'authenticité sont cités et sont selon les dirigeants
des projets.
Or. (70%) des réponses montrent que le
milieu rural souffre d'un quasi absence des infrastructures de base et
l'accès aux services publics: Etat des routes - scolarisation -
hôpitaux ce qui provoque une contrainte pour le bon fonctionnement de
l'activité économique des PA dans le milieu rural, ces
contraintes influence fortement et particulièrement sur la demande et la
recherche des débouchés pour commercialiser le produit
(63% ont répondu contraintes ) ainsi et d'une
façon générale sur le faible revenu marqué de la
population local au niveau des zones rural en question d'étude
(82%) .
En grosso modo Les résultats expliquent encore que dans
cette atmosphère rurale agréable porte dans sa globalité
un potentiel de ressources naturelles et une Maine d'oeuvre mois chère
qui facilité l'implantation de nouveau PA. Mais aussi existe des
contraintes liées à l'aménagement en infrastructure de
base de ces territoires ruraux.
Considérez-vous l'élément suivant
comme un atout, une contrainte ou sans effet pour le
fonctionnement de votre
PA ?
|
Santé / scolarisation Eau / électricité
Etat des routes Cadre de vie La demande Revenu de la population locale
|
|
|
|
|
|
|
|
30%
|
|
70%
|
0.00%
|
|
|
|
|
|
|
56%
|
41% 3.70%
|
|
|
|
|
|
|
11%
|
|
|
74%
|
14.80%
|
|
|
|
|
|
|
52%
|
22%
|
25.90%
|
|
|
|
|
|
|
26%
|
|
63%
|
11.10%
|
|
|
|
|
|
|
%
|
|
82%
|
14.80%
|
|
|
|
|
|
|
Attout
|
|
Densité de population locale (hab./km2)
Ressources matérielles
|
7%
|
26%
|
|
66.70%
|
|
Contrainte
sans effet
|
|
|
|
|
|
|
|
63%
|
|
33% 3.70%
|
|
Qualification de la main d'oeuvre locale
|
|
|
|
|
|
|
|
37%
|
|
52%
|
11.10%
|
|
Densité (Projet/km2)
|
11%
|
|
|
|
|
|
|
11%
|
|
77.80%
|
|
|
Mentalité des ruraux
|
15%
|
|
|
|
|
|
|
|
74.10%
|
11.10%
|
|
Distance aux villes
|
|
|
|
|
|
|
|
37%
|
|
40.70%
|
22.20%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0%
|
20%
|
40%
|
60%
|
80% 100%
|
120%
|
Graphique 7: les éléments d'influence sur le
fonctionnement des PA
Où est principalement localisée votre
clientèle ?
|
etranger
|
|
14.80%
|
|
niveau national
|
|
40.70%
|
|
niveau régional
|
55.60%
|
|
niveau provincial
|
|
22.20%
|
|
niveau local
|
|
18.50%
|
62
Graphique 8: Localisation de la clientèle
63
Nous avons aussi interrogé les enquêtes sur la
question de localisation de la clientèle (55.60%) ont
une clientèle principalement au niveau régional (région de
BENI MELLAL - AZILAL - TADLA - KHOURIBGA - FKIH BEN SALAH - KHENIFRA)
(40.70%) ayant des clients dispersés à
l'échelle nationale, (14.80%) internationale .Pour
(18.50%) ont la clientèle est locale.
Mais la distance entre les villes n'est pas pour autant
considérer comme un désavantage de leur localisation.
(40.20%) ont répondu sur la contraintes de L'isolement,
souvent évoqué comme contrainte rurale.
Conclusion :
En guise de conclusion, les expériences mondiales
montrent que pour réussir une meilleure promotion des activités
économiques en milieu rural : projets agricoles en milieu rurale, il
convient de disposer d'une vision stratégique appropriée à
ce domaine.
En effet il faut disposer d'abord d'une politique et une
volonté nationale spécifiquement à la promotion des PA
ruraux. Cette politique doit être guidée plus par l'objectif
stratégique de développement généralisé du
monde rural que par la levée des contraintes liées à la
régulation des mouvements de main-d'oeuvre en milieu rural. De
même, le développement des projets agricoles en milieu rural ne
doit pas être limité aux seuls villages ruraux, mais doit
s'étendre aux petites et moyennes communes périurbaines. Elle
doit aussi être insérée dans les programmes de
développement élaborés par les agences de
développement du nord et sud ainsi par les collectivités
territoriales.
64
CONCLUSION GENERALE
Alors notre objectif à travers ce projet de fin
d'étude qui consiste à identifier la situation actuelle des
projets agricole (PA) en milieu rural en prenant en compte les opinions de
différents acteurs de ce milieu. L'approche développée
prend appui sur la nécessité de mettre en oeuvre des actions
participant à la contribution au développement
socio-économique rural et limitant ainsi le phénomène des
milieux enclavés rencontré en zones rurales.
Les résultats obtenus vise d'une part à
démontrer l'importance de ces PA vis-à-vis du dynamisme des
espaces ruraux, d'autre part, à dégager les possibilités
pouvant pousser à la création des PA en zones rurales, et enfin,
comprendre le fonctionnement de ces projets agricole et le profil de leur
créateurs.
Dans cette perspective, rappelons que notre objectif par cette
étude c'est d'évaluer la contribution socio-économique des
PA en milieu rural. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons
développé une un questionnaire à partir d'un
pré-aperçu avec les ingénieurs de la direction
régionale de l'agriculture, ce qui permettait de comprendre
l'évaluation de la contribution socio-économique des projets
visités. Puis, cet outil de mesure nous a permis de guider notre
enquête.
Nous avons constaté que cette contribution ne pourra
être qu'avec une approche coopérative qui se focalise sur la
création de la valeur par , le rôle d'implanter ( les projets
agricole ) et l'implication de la population locale dans ces projets comme une
masse de main d'oeuvre sans oublier le rôle cruciale des parties
prenantes qui interviennent en milieu agricole et rural à travers des
stratégies et politique propres afin d'améliorer et
développer les zones rurales marginaliser .
Bibliographie :
- L'évolution de la pensée en science de
développement . bulletin de l'OCDE Numéro
1.1977 - OSVALDO SUNKEL .
- Le Décret n°2.15.10 du 20 Février 2015,
- Les données de la direction régionale de
l'agriculture de BENI MELALL
- Mémoire de fin d'étude en 3éme cycle en
agronomie , option la vulgarisation agricole ,
YODA BALAIS.
- Rallet, A. et A. Torre (1995), Économie industrielle et
économie spatiale, Economica.
- Saives, A.L. (2002), Territoires et compétitivité
de l'entrepris, l'Harmattan, Paris.
- Saleilles, S. (2006), « Le faible encastrement territorial
: handicap ou opportunité pour la
création d'entreprise en milieu rural »,
Cinquièmes journées de la proximité, Bordeaux, 28-
30 juin.
Webographie :
- Haut-Commissariat au plan l.es statistiques sur la consommation
des ménages de 2013 - L'office de développement de la
coopération : l'organigramme
- Le site du ministère de l'agriculture carte de la
région de Beni Mellal
65
Annexe 1 : Organigramme de l'agence nationale pour le
développement agricoles
66

67
Annexe 2 : Organigramme Fiche de collecte
d'informations auprès des ONG et des agences
Fiche de collecte d'informations auprès des ONG et
des agences
I - Identification de l'institution
1 - Nom :
2 - Statut :
3 - Domaine d'intervention :
4 - Type d'apport :
5 - Axes prioritaires d'intervention :
II - Comment travaillez-vous?
1 - présentez - vous de votre structure ? :
2 - Quelles sont les approches les plus utilisées
(approche participative, approche genre...) ?
3 - Avez-vous des types de canevas que vous utilisez?
(Formulaire, format standard de document...) :
4 - Quels sont vos critères d'éligibilités
?:
5 - quels sont les types de thèmes de formation
réalisez ( si vous réalisez des formation ) ? :
68
III - Analyse de la méthode de travail
?
1 - Quelles sont les actions facilitatrices que vous donnez
?
(Les actions d'appui et
d'accompagnement) :
2 - Quelles sont vos recommandations ? :
AVEZ -VOUS D'AUTRES COMMENTAIRES ?:
69
Annexe 3 : Questionnaire auprès des dirigeants
des projets agricoles
| 


