|
|
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET
PROFESSIONNEL (ENSETP)
BP 5004 Dakar-Fann-Sénégal
Tél : (+221) 33 821 76 69- (+221) 33 822 33
84
DEPARTEMENT : SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES
(S.T.I)
SPECIALITE : STRUCTURE METALLIQUE
Mémoire pour l'obtention du Certificat
d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire
Technique et Professionnel
(CAESTP)
Thème:
|
|
Etude d'un bâtiment en charpente
métallique à usage
d'habitation (R+1)
|
|
|
Présenté par: Sous la direction de
:
|
|
Youssou SAWARE M. Benjamin GOMIS
M. Sylvain AGBANGLANON
Devant le jury composé de:
|
|
M. Youssoupha BA Président
M. Mandir DIAKHATE Examinateur
M. Boubacar DIALLO Examinateur
Année Académique 2015-2016
(c) Tous droits réservés, Youssou
SAWARE, 2016
|
|

LOUANGE A ALLAH
REMERCIEMENTS
Louange à ALLAH de nous avoir gardé en bonne
santé afin de mener à bien ce projet de fin d'étude.
Avant tout je remercie mes parents qui m'ont guidé toute
ma vie. Sans leurs soutiens moraux et leurs prières, je serais incapable
d'accomplir cette mission.
Je rends cordialement hommage à tous les membres de ma
famille plus particulièrement mes frères et soeurs.
Je remercie également du fond de mon coeur mes encadreurs
Monsieur GOMIS et Monsieur AGBANGLANON pour tous les conseils, supports et
l'aide qu'ils m'ont apporté afin que je puisse mener à bien ce
travail.
Je remercie également Adji NIOME, Ameth DIALLO et Amadou
DIOP NDIAYE pour leurs aides et leurs soutiens.
Je remercie tout le personnel de l'Agence Nationale de l'Aviation
Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM)
pour l'ensemble des données mises à ma disposition.
Je remercie aussi tous les enseignants du département des
Sciences et Techniques Industrielles (STI) de l'ENSETP.
Enfin je remercie tous mes amis et collègues qui m'ont
soutenu pour la réalisation de ce travail.
DEDICACE
Ce travail est spécialement dédié à
:
Mes très chers parents qui m'ont guidé tout au long
de mon cursus. Que dieu les protège.
A mes soeurs Mami, Absa, Khady et Fagueye.
A mes frères Mamadou, Libass, Gora, et Seydina.
A mes cousins et cousines.
A mes amis en particulier: Amadou Diop NDIAYE, Ameth DIALLO, Pape
Souka DIOUF, Issa DIOP, Sophie DIOP Abdoulaye NDIAYE, Cheikh SAWARE, Thierno
Abou SAWARE Alassane GNING.
A toute la promotion 2012/2016 de l'ENSETP.
ETUDE D'UN BATIMENT EN CHARPENTE METALLIQUE A
USAGE
D'HABITATION(R+1)
Youssou SAWARE
RESUME
Notre projet de fin d'études porte sur l'étude
d'un bâtiment en charpente métallique à usage
d'habitation à un niveau.
Le projet est élaboré en plusieurs étapes
D'abord nous avons fait une descente des charges pour pouvoir
vérifier la stabilité et la résistance aux états
limites ultimes et de mises en service des éléments.
Ensuite nous avons procédé au dimensionnement des
éléments porteurs puis la vérification.
Enfin nous avons fait l'étude des assemblages puis le
contrôle des soudures et la protection de la structure.
l'ensemble des calculs ont été effectués sur
la base des normes européennes en l'occurrence les Eurocodes.
Ce projet m'a permis davantage de me familiariser avec les
Eurocodes et d'acquérir plus de connaissance sur l'étude des
structures simples.
Mots clés:
Bâtiment
Dimensionnement
Charpente Métallique Contrôle
Study of metallic framework building with use habitation
(R+1)
Youssou SAWARE
ABSTRACT
Our project graduation focuses on the study of metallic framework
building with use habitation at a level.
The project is designed in several steps.
First we did a load descending to check for stability and
strength to the ultimate limit state and elements of activations. Then we
proceeded to the design of carrying elements and verification. At last we made
the study of the assemblies and the inspection of the welds and protection of
the structure. All calculations were performed on the basis of European
standards in this case the Eurocodes.
This project allowed me to familiarize myself more with the
Eurocodes and gain more knowledge on the study of single structures.
Key words: Building Design
Framework Metallic
Inspection
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE i
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE 1
A-PARTIE TECHNIQUE
CHAPITRE I : GENERALITES 5
I-1 Présentation du projet 5
I-1-1 Données géométriques du projet 5
I-1-2 Localisation et données concernant le site 5
I-2 Conception architecturale du projet 6
I-3 Les caractéristiques du matériau
utilisé 6
CHAPITRE II : HYPOTHESES DES CHARGES ET ACTIONS 8
Introduction 8
II-1Charges permanentes 8
II-2 Surcharges d'exploitations 10
II-3 Charge climatique due aux vents 10
II-3-1 L'influence du vent 10
II-3-2 La pression du vent 11
II-4 Effet de la variation de la température 17
Conclusion 17
CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS
PORTEURS 19
III-1 Règlements utilisés 19
III-2 Les solives 20
III-2-1 Calcul des actions 21
III-2-2 Pré-dimensionnement 21
III-2-3 Calcul des sollicitations internes 23
III-2-4 Vérification selon EC3 [8] 23
III-3 Les poutres 24
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE ii
III-3-1 Calcul des actions 25
III-3-2 Pré-dimensionnement 25
III-3-3 Calcul des sollicitations internes 26
III-3-4 Vérification selon EC3 27
III-4 Les poteaux 28
III-4-1 Calcul des actions 28
III-4-2 Pré dimensionnement 29
III-5 Les lisses pour bardages 31
III-5-1 Calcul des actions 31
III-5-2 Pré- dimensionnement 31
III-6 Les escaliers 33
CHAPITRE IV : ETUDES DES ASSEMBLAGES 37
Introduction 37
IV-1 Les types d'assemblages utilisés 37
IV-1-1 Le soudage 37
IV-1-2 Le boulonnage 37
IV-2 Assemblage poteaux-poutres 38
IV-2-1 Calcul des soudures (gorge) 38
IV-2-2 Le nombre de boulons 40
IV-3 Assemblage poutres solives 41
IV-3-1 Vérification au cisaillement 42
IV-3-2: Vérification à la pression
diamétrale 42
IV-4 Assemblage pieds de poteau 42
IV-4-1 Dimensionnement de la platine 43
IV-4-2 Dimensionnement des tiges d'ancrage 44
Conclusion 45
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE iii
CHAPITRE V : CONTROLE DES SOUDURES ET
PROTECTION DE LA STRUCTURE 47
V-1 Contrôle des soudures 47
Introduction 47
V-1-1 Avant soudage 47
V-1-2 Pendant soudage 47
V-1-3 Après soudage 48
Conclusion 48
V-2: Protection de la structure 49
B-PARTIE PEDAGOGIQUE
EXPLOITATION PEDAGOGIQUE 50
CONCLUSION GENERALE 98
REFERENCES BIBLIOGRAHIQUES 99
ANNEXE A : 101
ANNEXE B : 103
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE iv
Liste des Tableaux
Tableau II- 1:Caractéristiques du bac d'acier Cofraplus
60 8
Tableau II- 2:Charge permanente pour la poutre de plancher
9
Tableau II- 3:Charge permanente pour la poutre sous toiture
9
Tableau II- 4:Charge permanente pour le palier de l'escalier
9
Tableau II- 5:Charge permanente pour la volée de
l'escalier 10
Tableau II- 6:Charge permanente pour la volée de
l'escalier 10
Tableau III- 1:Caractéristiques du profilé IPE
160 22
Tableau III- 2:Caractéristiques du profilé IPE
300 25
Tableau III- 3:Caractéristiques du profilé HEA
120 29
Tableau III- 4:Caractéristiques du profilé UPN
100 32
Tableau IV- 1:Valeurs nominales de la limite
d'élasticité et de la
résistance ultime à la traction des boulons
ordinaires 38
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE v
Liste des Figures
Figure I- 1:Vue en 3d du projet 6
Figure II- 1:Dimensions de la dalle collaborante 8
Figure II- 2:Directions du vent 12
Figure II- 3:Légende applicable aux parois verticales
13
Figure II- 4:Légende pour les toitures plates 14
Figure II- 5: Légende applicable aux parois verticales
15
Figure II- 6: Légende pour les toitures plates 16
Figure III- 1:Représentation des efforts
appliqués sur une solive 21
Figure III- 2:Représentation des efforts
appliqués sur une poutre 24
Figure III- 3:Disposition des marches 34
Figure IV- 1:Assemblage poteau-poutre 38
Figure IV- 2:Assemblage poutre-solive 41
Figure IV- 3:Assemblage pied de poteau 43
Figure IV- 4:Dimensions et dispositions des tiges d'ancrage
44
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
LISTE DES SYMBOLES ET UNITES DE MESURES
|
Symboles
|
Grandeurs à mesurer
|
Unités
|
|
A
|
Section brute d'une pièce
|
cm2
|
|
Anet
|
Section nette d'une pièce
|
cm2
|
|
Av
|
Aire de cisaillement
|
cm2
|
|
Cr
|
Coefficient de rugosité
|
Sans unité
|
|
E
|
Module d'élasticité longitudinale de l'acier
|
daN/mm2
|
|
G
|
Module d'élasticité transversale de l'acier
|
daN/mm2
|
|
F
|
Force en générale
|
daN
|
|
G
|
Charge permanente
|
daN/m2
|
|
Q
|
Charge d'exploitation
|
daN/m2
|
|
j
|
Moment d'inertie
|
mm4
|
|
K
|
Coefficient d'encastrement ou de rigidité Poteaux/
Poutre
|
Sans unité
|
|
K0
|
Coefficient de flambement
|
Sans unité
|
|
Kt
|
Facteur de terrain
|
Sans unité
|
|
l
|
Longueur ou portée d'une poutre
|
mm
|
|
Msd
|
Moment sollicitant, en général
|
daN.m
|
|
M
|
Moment fléchissant
|
daN.m
|
|
Mrd
|
Moment résistant
|
daN.m
|
|
Mpl
|
Moment plastique
|
daN.m
|
|
Npl, rd
|
Valeur de calcul de la résistance
plastique de la section transversale brute
|
daN
|
|
Nsd
|
Effort normal sollicitant
|
daN
|
|
Npl
|
Effort normal plastique
|
daN
|
|
S
|
Surface
|
mm2
|
Youssou SAWARE vi
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
Vsd
|
Valeur de calcul de l'effort tranchant sollicitant
|
daN
|
|
Vpl, rd
|
Valeur de calcul de la résistance plastique au
cisaillement
|
daN
|
|
Vm
|
Vitesse moyenne du vent
|
m/s
|
|
Wpl
|
Module de résistance plastique
|
cm3
|
|
Wel
|
Module de résistance élastique
|
cm3
|
|
d
|
Diamètre d'une section circulaire
|
mm
|
|
f
|
Flèche
|
mm
|
|
fy
|
Limite d'élasticité
|
N/mm2
|
|
fu
|
Résistance à la traction
|
N/mm2
|
|
H
|
Hauteur d'une pièce
|
mm
|
|
b0
|
Longueur d'une pièce
|
mm
|
|
lf
|
Longueur de flambement
|
mm
|
|
i
|
Rayon de giration
|
mm
|
|
t
|
Épaisseur d'une pièce
|
mm
|
|
tf
|
Épaisseur de la semelle (poutre, solive, poteau)
|
mm
|
|
tw
|
Épaisseur de l'âme (poutre, solive, poteau)
|
mm
|
|
z
|
Hauteur au-dessus du sol
|
mm
|
|
zéq
|
Hauteur équivalente
|
mm
|
|
zmin
|
Hauteur minimale
|
mm
|
|
x
|
Coefficient de réduction pour le mode de flambement ou
déversement approprie
|
Sans unité
|
|
ãM
|
Coefficient de sécurité
|
Sans unité
|
|
?
|
Elancement
|
Sans unité
|
|
qp
|
Pression dynamique de pointe
|
daN/m2
|
|
Aréf
|
Aire de référence
|
m2
|
|
Iv
|
Intensité de turbulence
|
Sans unité
|
|
Fw
|
Force résultante par le vent
|
daN
|
|
p
|
Masse volumique
|
Kg/m3
|
|
Cpe
|
Coefficient de pression extérieure
|
Sans unité
|
|
Cpi
|
Coefficient de pression intérieure
|
Sans unité
|
Youssou SAWARE vii
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
cscd
|
Coefficient structural
|
Sans unité
|
|
ßw
|
Facteur de corrélation
|
Sans unité
|
|
a
|
Gorge de la soudure
|
mm
|
|
ãMw
|
Coefficient partiel de sécurité
|
Sans unité
|
|
ãMb
|
Coefficient partiel de sécurité Des boulons
|
Sans unité
|
|
As
|
Aire de la section résistance en Traction des boulons
|
Sans unité
|
|
cf
|
coefficient de force applicable à la construction
|
Sans unité
|
Youssou SAWARE viii
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 1
INTRODUCTION GENERALE
De nos jours, l'acier a tendance à prendre les devants
dans le monde de la construction des grands chantiers (Buildings, Tour,
Gratte-ciel etc.) grâce à ses propriétés qui lui
confère beaucoup d'avantages à savoir la rigidité la
souplesse la malléabilité....Mais le plus souvent l'acier n'a pas
été recommandé[1]pour la
construction, parce que les concepteurs :
-N'ont pas considéré l'acier comme solution
possible en raison de leur à priori sur la complexité ou la non
familiarité avec les coûts de construction,
-Ont préparé une solution en acier, mais l'ont
rejetée aux premières étapes de dimensionnement en raison
d'une mauvaise approche de conception la rendant non économique.
En effet, l'utilisation de l'acier dans les maisons individuelles
est très rare au Sénégal.
« Cependant, compte tenu des différents avantages
qu'a l'acier, n'est-il pas temps de faire face à la construction des
bâtiments en charpente métallique dans notre pays?»
Nous allons à partir de ce mémoire qui consiste
à étudier un bâtiment en charpente métallique
à usage d'habitation(R+1) faire l'étude de ce projet en
appliquant les différentes connaissances acquises au cours de notre
cursus mais aussi de présenter un travail satisfaisant en vue d'obtenir
notre diplôme de CAESTP (certificat d'aptitude à l'enseignement
secondaire technique et professionnel) et enfin compléter les
informations acquises dans les cours de la charpente métallique.
Chaque étude de projet à un but. L'objectif de
notre recherche est d'inciter les personnes à la construction des
bâtiments en charpente métallique avec ces avantages comme
[1] :
-La rapidité d'exécution
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 2
-La souplesse du bâtiment
-La facilite d'extension des constructions
-L'aptitude à la rénovation au recyclage et
à la réutilisation des éléments.
-Réduction des coûts de gestion du chantier et de
stockage -Etc.
Par conséquent, ce présent mémoire est
subdivisé en deux grandes parties : Une partie technique composée
de cinq chapitres dont: Le premier est consacré aux
généralités;
Le deuxième présente les hypothèses des
charges et actions;
Le troisième consiste à dimensionner les
éléments porteurs; Le quatrième consiste à
étudier les assemblages;
Le cinquième traite le contrôle des soudures et la
protection de la structure;
et une partie exploitation pedagogique où on y traitera
deux leçons à savoir le soudage à l'arc électrique
avec électrode enrobée et le contrôle des soudures par
radiographie.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE
PARTIE
TECHNIQUE
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE
CHAPITRE I
GEnERAlITES
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 5
CHAPITRE I : GENERALITES I-1 Présentation du
projet
Le projet étudié concerne la conception d'un
bâtiment en charpente métallique à usage d'habitation. Le
bâtiment sera constitué d'un rez-de-chaussée
surmonté d'un étage.
Le projet sera dimensionné selon l'Eurocode 3 et la nuance
d'acier utilisée sera de type S 235.
Le bardage de façade est formé par des lisses de
type UPN, elles-mêmes fixées aux poteaux de type HEA.
Le plancher utilisé est de type collaborant
constitué par des bacs en aciers sur lesquels repose la dalle. Pour
assurer la stabilité du plancher on va utiliser des solives de type
IPE.
I-1-1 Données géométriques du
projet
Suivant la vue en plan, nous avons:
Ø Longueur totale 15 m
Ø Largeur totale 10 m
Ø Hauteur du rez-de-chaussée ..3 m
Ø Hauteur étage .3 m
Ø Hauteur totale .6 m
I-1-2 Localisation et données concernant le site
L'étude du projet sera faite à Dakar plus
précisément à Mermoz Sacre coeur dont:
· La vitesse du vent est de 7.5m/s
· L'altitude est de 40m
N.B : Le bâtiment sera dimensionné
selon les conditions climatiques de la région de Dakar.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
I-2 Conception architecturale du projet
Notre bâtiment est de forme rectangulaire. Il est
composé d'un RDC et un étage destiné à
l'habitation.

Figure I- 1:Vue en 3d du projet
I-3 Les caractéristiques du matériau
utilisé
L'acier utilisé pour l'étude est le S235 de classe
1 avec les
caractéristiques suivantes :
V' Résistance à la traction : R= 360 MPa
V' Limite élastique : Re=235 MPa
V' Le module de YOUNG: E=210000MPa
V' Le module de COULOMB : G= 83000 MPa
V' Le coefficient de POISSON: ?= 0,3
V' Masse volumique : 7850Kg/m3
Youssou SAWARE 6
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
CHAPITRE II
HYPOTHESES DES
CHARGES ET
ACTIONS
Youssou SAWARE
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
CHAPITRE II : HYPOTHESES DES CHARGES ET ACTIONS
Introduction
Dans ce chapitre, nous allons essayer de définir
clairement les différentes charges et actions agissantes sur notre
structure en nous
basant sur l'Eurocode [2] fixant la
valeur des charges pour chaque cas.
II-1Charges permanentes
Noté G, elles désignent le poids propre de tous les
éléments permanents constituants la structure, les
précontraintes, les tassements...
Caractéristiques du plancher collaborant COFRAPLUS
60 utilisé Cofraplus 60 est un profil nervuré
cranté latéralement destiné à la construction de
dalles en béton. Il évite le décoffrage, allège le
plancher et économise une nappe d'armature.

Figure II- 1:Dimensions de la dalle collaborante (c) Arcelor
Mittal, 2008[3]
|
Hauteur des nervures (mm)
|
Nombre de nervures par bac
|
Espacement
des
nervures
(mm)
|
Largeur
outil du
bac mm
|
Epaisseur de tôle (mm)
|
Poids (daN/m2)
|
|
55
|
5
|
207
|
1035
|
1
|
11 ,37
|
Tableau II- 1:Caractéristiques du bac d'acier Cofraplus
60
Ø Détermination des différentes
charges permanentes *Pour la poutre de plancher
Youssou SAWARE 8
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 9
|
Type
|
Charges permanentes (daN/m2)
|
|
Cofraplus 60épaisseur (1mm)
|
11,37
|
|
Poids de la dalle épaisseur (12 cm)
|
0,12x2500=300
|
|
Revêtement de carrelages (2 cm)
|
0,02x20x100=40
|
|
Mortier de pose (2 cm)
|
0,02x20x100=40
|
|
Cloison de répartition épaisseur (10 cm)
|
90
|
|
Faux plafond
|
10
|
|
Isolation thermique (4 cm)
|
0,04x400=16
|
|
TOTAUX
|
507,37
|
Tableau II- 2:Charge permanente pour la poutre de plancher
*Pour la poutre sous toiture
|
Type
|
Charges permanentes (daN/m2)
|
|
Cofraplus 60 épaisseur (1 mm)
|
11,37
|
|
Poids de la dalle épaisseur (12 cm)
|
0,12x2500=300
|
|
Isolation thermique (4cm)
|
0,04x400=16
|
|
Etanchéité (5 cm)
|
0,05x600=12
|
|
Protection étanchéité par gravier
roulée (5cm)
|
0,05x1700=85
|
|
Faux plafond
|
10
|
|
Béton de pente (10cm)
|
0,1x2200=220
|
|
TOTAUX
|
654,37
|
Tableau II- 3:Charge permanente pour la poutre sous toiture
*Pour l'escalier
|
Type
|
Charges permanentes daN/m2
|
|
Cofraplus 60 ép. (1mm)
|
11,37
|
|
Poids de la dalle ép. (6 cm)
|
0.06x2500=150
|
|
Mortier de pose (2cm)
|
0.02x20x100=40
|
|
Revêtement en carrelage (2cm)
|
0,02x20x100=40
|
|
TOTAUX
|
241,37
|
Tableau II- 4:Charge permanente pour le palier de l'escalier
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 10
*Pour la volée
|
Type
|
Charges permanentes (daN/m2)
|
|
Tôle striée ép. (5mm)
|
11,37
|
|
Mortier de pose (2cm)
|
0.02x20x100=40
|
|
Revêtement en carrelage (2cm)
|
0,02x20x100=40
|
|
TOTAUX
|
91,37
|
Tableau II- 5:Charge permanente pour la volée de
l'escalier
II-2 Surcharges d'exploitations
Généralement notées Q, elles
désignent l'ensemble des charges qui résultent de l'usage des
locaux. Ces charges correspondent au mobilier, au matériel aux
matières en dépôt aux personnes pour un mode normal
d'occupation. Les valeurs des charges d'exploitations comprennent
également les équipements légers tels que canalisations de
distribution des fluides ménagers, appareils sanitaires appareils de
chauffages individuels.
Voici les valeurs des charges d'exploitations à prendre
à compte pour notre structure.
|
Natures
|
Valeurs (daN/m2)
|
|
Logement y compris combles aménageables
|
150
|
|
Balcons
|
350
|
|
Escaliers
|
250
|
|
Planchers terrasse sous toiture (inaccessible)
|
100
|
|
Planchers courants (accessible)
|
250
|
Tableau II- 6:Charge permanente pour la volée de
l'escalier
II-3 Charge climatique due aux vents
II-3-1 L'influence du vent
L'effet du vent a une grande influence sur la stabilité
d'un ouvrage. Pour cela, une étude rigoureuse doit être
élaborée afin de déterminer ces différentes actions
dans toutes les directions.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Les actions du vent appliquées aux parois dépendent
de :
*Sa direction,
*Son intensité,
*La région,
*La forme géométrique et les ouvertures de la
structure,
II-3-2 La pression du vent
Pour calculer la pression due au vent, nous allons prendre en
compte certains paramètres comme:
-La catégorie du terrain: selon l'Eurocode notre terrain
est classé en
catégorie II. EN 1991-1-4 § 4.3.2 Tableau 4.1
[4]
y' La vitesse moyenne du vent 7,5 m/s (selon
l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de Météorologie du
Sénégal (ANACIM) voir détail dans l'annexe
y' hauteur au-dessus du sol Z
y' La hauteur minimale Z min égale 2m EN
1991-1-4 Tableau 4.1 y' La hauteur maximale Z max selon
l'EUROCODE égale 200m y' Masse volumique de l'air
ñair =1,25 kg/m3
y' Intensité de turbulence
Iv(z)
y' Le coefficient de turbulence KI : la
valeur recommandée est 1,0
y' Le coefficient orographique co(z) égal
1,0 (s it e pl at)
y' La longueur de rugosité z0 égale 0,05 EN
1991-1-4 § 4.3.2 Tableau
4.1

) = [1 + 7 D X ) 2
> Calcul de ression dy e p o du
vent

L
pour z min = z = z max EN 1991-1-4
§4.4 éq 4.7 [4]
Youssou SAWARE 11
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

(2.1)
) =
(
1 +
2
5 =
1
Youssou SAWARE 12
Ø Les directions du vent
Nous avons deux directions du vent:
-V1 perpendiculaire à la façade AB
-V2 perpendiculaire à la façade BC

Figure II- 2:Directions du vent
Ø Détermination des coefficients de
pressions extérieures(Cpe) selon le vent V1 pour les parois verticales
et pour la toiture:
*Pour les parois verticales
e= min [b, 2h] b : cote perpendiculaire au vent
h : hauteur totale du bâtiment
b= 10m e = 10m
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Figure II- 3:Légende applicable
aux parois verticales
[4]
d= 15m
h= 6m
e < d on a la configuration suivante:
D'où on a
A : Cpe= -1,2
B : Cpe= -0,8
C : Cpe= -0,5 EN 1991-1-4 tableau 7.1
D : Cpe= 0,8
E : Cpe= 0,5
*Pour la toiture
Les toitures-terrasses sont définies comme ayant une pente
(á) telle
que -5° < á < 5°
Il convient de diviser la toiture en zone telles que
représentées à la figure ci-dessous.
e= mini [b ; 2h]= 10 m
Youssou SAWARE 13

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Figure : II- 4:Légende pour les toitures
plates
D'où on a les coefficients extérieurs suivants
selon EN 1991-1-4 tableau 7.2
F : Cpe= -1,8
G : Cpe= - 1,2
H : Cpe= - 0,7
I : Cpe= 0,2
Ø Coefficients de pression intérieure (Cpi)
selon le vent V1
Selon l'Eurocode, dans le cas d'une construction fermée
Cpi= -0.3 ou +0,2
Ø Détermination des coefficients de
pressions extérieures(Cpe) selon le vent V2 pour les parois verticales
et pour la toiture
*Pour les parois verticales
e= mini [b ; 2h] b : cote perpendiculaire au
vent
b=15m h : hauteur du bâtiment
d=10m e =12m
h=6m
Youssou SAWARE 14
e>d on a la configuration suivante
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Figure II- 5: Légende applicable
aux parois
verticales
D'où on a
A : Cpe= -1,2
B : Cpe= -0,8
C : Cpe= -0,5 EN 1991-1-4 tableau 7.1 [4]
D : Cpe= 0,8
E : Cpe= 0,5
*Pour la toiture
Les toitures-terrasses sont définies comme ayant une pente
(á) telle
que -5° < á < 5°
Il convient de diviser la toiture en zone telles que
représentées à la figure ci-dessous.
e= mini [b ; 2h]= 12 m
Youssou SAWARE 15

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Figure II- 6: Légende pour les toitures plates
[4]
D'où on a les coefficients extérieurs suivants
selon EN 1991-1-4 tableau 7.2
F : Cpe= -1,8
G : Cpe= - 1,2
H : Cpe= - 0,7
I : Cpe= 0,2
Ø Coefficients de pression intérieure (Cpi)
selon le vent V2
Selon l'Eurocode, dans le cas d'une construction fermée
Cpi= -0.3 ou +0,2
Ø Calcul de la force exercée par le vent
(Fw)
-Pour le vent V1
La force exercée par le vent sur notre construction est
obtenue par:
|
Fw=CSCd. Cf. qp(Ze).Aref (2.2) EN 1991-1-4 § 5.3
[4]
|
|
CSCd=1
|
EN 1991-1-4 § 6.2
|
|
Aref = 1m2
|
EN 1991-1-4 § 6.2
|
|
Cf= Cf0 Ør. Øë
|
EN 1991-1-4 Eq 7.9
|
|
Ør= 1
|
EN 1991-1-4 Figure7.24
|
|
Youssou SAWARE
|
16
|
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 17
Øë = 0.72 EN 1991-1-4 Figure7.36
d/b=0,6 Cf0 =2,35 EN 1991-1-4 Figure 7.23
D'où
Cf=2,35x1x0, 72= 1,692
Donc Fw= 1x1, 692x86, 55 x1=146,442
daN
-Pour le vent V2
La force exercée par le vent sur notre construction est
obtenue par:
Fw=CSCd. Cf. qp(Ze).Aref EN 1991-1-4 § 5.3
[4]
CSCd=1 EN 1991-1-4 § 6.2
Aref = 1m2 EN 1991-1-4 § 6.2
Cf= Cf0. Ør. Øë EN 1991-1-4 Eq 7.9
Ør= 1 EN 1991-1-4 Figure7.24
Øë = 0.48 EN 1991-1-4 Figure7.36
d/b=1,5 Cf0 = 1,825 EN 1991-1-4 Figure7.23
D'où Cf =
1,825x1x0, 48 =0,876
Donc Fw= 1x0, 876x86, 55x1= 75,817
daN
II-4 Effet de la variation de la température
Dans une construction il faut toujours prendre en compte les
effets de la variation de la température si la longueur de la structure
est supérieure à 50m pour anticiper au phénomène de
la dilatation thermique.
Dans notre construction la longueur totale est de 15m largement
inférieure à 50m [5] raison pour
laquelle on n'a pas pris en compte l'effet de la température.
Conclusion
A présent nous venons de déterminer dans ce
chapitre les différentes charges qui sont appliquées dans notre
structure pour pouvoir attaquer le chapitre suivant qu'est le dimensionnement
des éléments porteurs de notre bâtiment.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
CHAPITRE III
DIMENSIONNEMENT DES
ELEMENTS PORTEURS
Youssou SAWARE
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 19
CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS
PORTEURS
Une structure doit être conçue et
réalisée de sorte que, pendant sa durée de vie
escomptée qu'elle :
-Résiste à toutes les actions susceptibles
d'intervenir pendant son exécution et son utilisation;
-Reste adaptée à l'usage pour lequel elle a
été conçue; -Etc. ;
Pour cela il faut faire un bon dimensionnement de tous les
éléments porteurs de l'ouvrage.
III-1 Règlements utilisés
Pour pouvoir faire le pré dimensionnement des
éléments porteurs de notre structure nous devons suivre certaines
règles établies par l'Eurocode à savoir: La classification
des sections, les coefficients partiels de sécurité et la valeur
limite des déformations (flèches).
Ø La classification des sections
L'Eurocode 3[6] a instauré une
classification des sections transversales, en fonction de divers
critères comme:
-Elancements des parois,
-Résistances de calcul,
-Capacité de rotation plastique,
-Risque de voilement local,
-Etc.,
Quatre classes de sections ont été définies
allant de 1(la plus performante) à 4 (la plus fragile), soit:
-Classe 1 : Sections transversales
pouvant atteindre leur résistance plastique, sans risque de voilement
local et possédant une capacité de rotation importante pour
former une rotule plastique.
-Classe 2 : Sections transversales
pouvant atteindre leur résistance plastique, sans risque de voilement
local, mais avec une capacité de rotation limitée.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 20
-Classe 3 : Sections transversales
pouvant atteindre leur résistance élastique en fibre
extrême, mais non leur résistance plastique du fait du risque de
voilement local.
-Classe 4 : Sections transversales ne
pouvant atteindre leur résistance élastique du fait du risque de
voilement local.
Ø Les coefficients partiels de
sécurité
Les résistances de calculs sont affectées des
coefficients partiels de sécurité ãM dont les valeurs sont
les suivantes:
-Sections brutes de classe 1,2 ou 3 : 7M0= 1
(ou 1,1 s'il s'agit des aciers non agrées)
-Sections brutes de classe 4 : 7M1=
1,1
-Sections nettes au droit des trous : 7M2=
1,25
Ø La valeur limite des déformations
(flèches)
Les valeurs limites des déformations des structures
métalliques ne sont pas imposées règlementairement et
brutalement, car elles dépendent de divers critères.
Mais l'Eurocode recommande des valeurs limites à respecter
qui sont: -Toitures en général : f < L/200
-Planchers en général : f < L/250
-Planchers supportant des poteaux: f < L/400
-Planchers et toitures supportant des cloisons en plâtre ou
en autre matériaux fragiles ou rigides : f < L/250
III-2 Les solives
Les solives sont des poutrelles en IPE. Espacées d' 1,25
m, elles permettent de supporter le plancher de bac en acier.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 21
Figure III- 1:Représentation des efforts
appliqués sur une solive
III-2-1 Calcul des actions
ü La charge totale non pondérée
appliquée sur la solive en (daN/m) P= (507, 37 + 250) x1, 25=
946,71 daN/m = 9,5 N/mm
P= 9,5 N/mm
III-2-2 Pré-dimensionnement

ü Condition de che
On a f max ble
Or f max = (3.1) f admissible = r
les
planchers
D'où on I =
Or E= 210000N/mm2
P= 9,5 N/mm L= 5000mm

D'où I = mm4
I = 368,14 cm4
D'après notre résultat on choisit un IPE 160 avec
les caractéristiques dans le tableau
III-1[7] ci-dessus
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
DESIGNATION
|
Poids
|
Section
|
Dimensions
|
Caractéristiques
|
|
P
Kg/ m
|
A
cm2
|
h
mm
|
b
mm
|
tf
mm
|
Iy
cm4
|
Wpl-y
cm3
|
iy
cm
|
|
IPE160
|
15,8
|
20,1
|
160
|
82
|
7,4
|
869,3
|
123,9
|
6,58
|
Tableau III- 1:Caractéristiques du profilé IPE
160

V' Vérification de la flèche
f dm
mm
8,47 < 20 d'où la flèche
vérifiée. V' La classe de la
section:
On utilise un acier S235 d'où ?=1 V'
Semelle comprimée
tf =7,4 mm
b = 82 mm c = 82/2= 41 mm
Or c = b/2
c/tf= 41/7,4=5,54mm c =41mm
Youssou SAWARE 22
c/tf= 5,54 < 10? la semelle est de classe 1
V' Ame fléchie d = 127,2 mm
tw = 5 mm d/tw= 127,2/5 = 25,44 mm
d/tw= 25,44 < 72? l'âme est de classe 1
Ame classe 1 La section est de classe 1
Semelle classe 1
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
III-2-3 Calcul des sollicitations internes
ü La charge totale pondérée
appliquée sur la solive en (daN/m) NB : On prendre en compte le poids
propre du profilé
P= 1,35 x [(507, 37 x 1,25) + 15,8] + 1, 5 x 250 x 1, 25=
1347,33 daN/m
P= 13426 daN/m
ü 
Le mo citant (Msd)
Msd=
Msd = 04,70 daN.m
Msd = 2804,70 daN.m
ü Effort chant (Vsd)

Vsd =
Vsd = 5,65 daN Vsd = 3365,65 daN
Youssou SAWARE 23
III-2-4 Vérification selon EC3 [8]
ü Pour le moment sollicitant maximum

Pour que l ofilé puisse résister il faut que
Msd soit inférieur à Mply.
Mpl (3.4)
9 cm3
= 1,0
fy= 235

Mply =
6500N.mm = 2911,65
daN.m
Mply = 2911,65 daN.m Msd < Mply c'est
vérifié
Msd= 2804,7 daN.m
Université Cheikh Anta DIOP
2015/2016
ü Pour l'effort tranchant maximum
Pour que puisse résister il faut que Vsd
soit inférieur à Vpl, rd.
Vpl, rd= 'V (3.5)
O Avz= 9,7 cm2 = 970 mm2

35 N/mm2
= 1
Vpl, rd= 'V 6,99N = daN 13160,69 daN

Youssou SAWARE 24
Vpl, rd = 13160,69 daN Vsd < Vpl, rd c'est
vérifié
Vsd = 3365,65 daN
Le profilé IPE 160 retenu résiste.
III-3 Les poutres
Ø Les poutres de planchers
Les poutres sont des poutrelles en IPE de longueur 5m.Elles sont
Espacées de 5m entre elles et permettent de supporter les planchers et
les solives.

Figure III- 2:Représentation des efforts
appliqués sur une poutre
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
III-3-1 Calcul des actions
ü La charge totale non pondérée
appliquée sur une poutre en (daN/m)
P= [[(507, 37 + 250) x 5] + (15,8 x 3)]= 3834,9 daN/m =
38,34N/mm
P= 38,34 N/mm

III-3-2 Pré-dimensionnement
ü Condition de che :
On a f max ble
D'où on I =
Or f max = f admissible =
Or E= 210000N/mm2 P= 38,76 N/mm L= 5000mm

Youssou SAWARE 25
D'où I = 9mm4
I = 1485,77 cm4
D'après notre résultat on choisit un IPE
300 avec les caractéristiques suivantes :
|
DESIGNATION
|
Poids
|
Section
|
Dimensions
|
Caractéristiques
|
|
P
Kg/m
|
A
cm2
|
h
mm
|
b
mm
|
tf
mm
|
Iy
cm4
|
Wpl-y
cm3
|
iy
cm
|
|
IPE300
|
42,2
|
53,8
|
300
|
150
|
10,7
|
8356,1
|
628,4
|
12,46
|
Tableau III- 2:Caractéristiques du profilé IPE
300
ü 
Vérification de la flèche
f dm

Anta DIOP 2015/2016
Uni e
mm
Youssou SAWARE 26
3,55 < 20 d'où la flèche
vérifiée. V' La classe de la
section
On utilise un acier S235 d'où ?=1 V'
Semelle comprimée
tf =10,7 mm c/tf= 75/10,7=7 mm c = 75 mm
b = 150 mm c = 150/2= 75 mm
Or c = b/2
c/tf= 7 < 10? la semelle est de classe 1
V' Ame fléchie
d = 248,6 mm
tw = 7,1 mm d/tw= 248,6/7,1 = 35,01 mm
d/tw= 35,01 > 72? l'âme est de classe 1
Ame classe 1 La section est de classe 1
Semelle classe 1
III-3-3 Calcul des sollicitations internes
V' La charge totale pondérée
appliquée sur une poutre en (daN/m) :
NB : On prendre en compte le poids propre du
profilé
P= 1,35 x [(507, 37 x 5) + (15,8 x3) + 42,2] + 1, 5 x 250 x 5 =
5420,70 daN/m
P= 5420,70 daN/m
V' Le moment sollicitant (Msd)
Univer kh Anta DIOP 2015/2016

Msd=
Msd = 93,12 daN.m
Msd = 293,12 daN.m
ü Effort chant (Vsd)

Vsd =
Vsd = ,75daN Vsd = 13551,75 daN
Youssou SAWARE 27
III-3-4 Vérification selon EC3
ü Pour le moment sollicitant maximum

Pour qe le filé puisse résister il faut que
Msd soit inférieur à Mply.
Mpl
4cm3
= 1,0
fy= 235 N/mm2

Mply = 235x 6284001 =147674000 N.mm =
14767,4daN.m
Mply = 14767,4 daN.m Msd < Mply c'est
vérifié
Msd= 11293,12 daN.m
ü Pour l'effort tranchant maximum

Pour que é puisse résister il faut que
Vsd soit inférieur à Vpl, rd.
Vpl, rd=
v

Or Avz= 25,7 cm2 = 2570
mm2 f 35 N/mm2
= 1,0
Univers IOP 2015/2016


Youssou SAWARE 28
Vpl, rd= ~ 0,69N =34869,06 daN
Vpl, rd = 34869,06 daN Vsd < Vpl, rd c'est
vérifié
Vsd = 13551,75 daN
Le profilé IPE 300 retenu
résiste.
Ø Pour la poutre sous toiture
Ø La charge totale non pondérée
appliquée sur une poutre en (daN/m)
P= [[(654, 37 + 100) x 5] + (15,8 x 3)]= 3839,05 daN/m =
3839N/mm P= 3819,25 N/mm
La charge de la poutre sous toiture est presque
égale à la charge des poutres planchers (3834,9 N/m) donc on
retient la même poutre utilisée qui est l'IPE 300.
III-4 Les poteaux
Les poteaux sont des poutrelles en HEA de longueur 3m.Ils
permettent de transmettre les efforts extérieurs provenant des
différentes charges aux fondations.
Les charges reprises par le poteau sont:
-Poids propre poutre 42,2 daN/m
-Poids propre solive .15,8 daN/m
-Charge permanente du plancher courant .654,37
daN/m2
-Surcharge pour plancher courant 250 daN/m2
III-4-1 Calcul des actions
ü La charge totale pondérée en
(daN)
Nsd = 1,35 [(654,37x5x5) + (42,2x5 x2) + (15,8x5x4)] +
1,5x250x5x5= 32460,33 daN
Nsd= 324,60 KN
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 29
III-4-2 Pré dimensionnement
Nous partons sur la base que l'élancement maxi X est <
150. Comme le poteau est encastré en tête et en pied, la longueur
de flambement est égale à : Lf =0,5 x Lo = 0,5 x3 =1,5 m = 150
cm
Le rayon de giration mini : i = Lf/150 = 150/150=1 cm
D'où le choix du HEA 120 avec les caractéristiques
suivantes:
DESIGNATION
|
Poids
|
Section
|
Dimensions
|
Caractéristiques
|
|
A
cm2
|
h
mm
|
b
mm
|
tf
mm
|
Iy
cm4
|
iz
cm
|
iy
cm
|
HEA 120
|
19,9
|
25,3
|
114
|
120
|
8
|
606,2
|
3,02
|
4,89
|
|
Tableau III- 3:Caractéristiques du profilé HEA 120
V' La classe de la section
On utilise un acier S235 d'où ?=1
V' Semelle comprimée
tf =8 mm c/tf= 60/8= 7,5mm
b = 120 mm c = 120/2= 60 mm c =60mm
Or c = b/2
c/tf= 7,5 < 10? la semelle est de classe 1
V' Ame fléchie
d = 74 mm
tw = 5 mm d/tw= 74/5 = 14,8 mm
d/tw= 14,8 < 72? l'âme est de classe 1
Ame classe 1 La section est de classe
1
Semelle classe 1
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

III-4-3 Vérification selon EC3
ü Longueur de flambement :
Comme le poteau est encastré en pied et en tête on
a :
Longueur de flambement Lf =0,5x Lo
Or Lo= 3m=300 cm
Suivant y-y : Lfy=0,5 x 300 = 150 cm
Suivant z-z : Lfz = 0,5 x 300 = 150 cm
ü Elancement Suivt y-y :
ëy= =
=30,67
,
Suivt z-z :
ëz= =
=49,66
,
Youssou SAWARE 30
ëz = élancement maxi d'où on choisit
l'axe z-z comme axe de référence pour les calculs.
ü 
éduit
Or » 93,9 x ?
l aciers S235
» 52
» 2 > 0,2 donc il y'a risque de flambement il
déterminer x
h/b =114/120 = 0,95 < 1,2 x =0,724

tf < 100 axe z-z
Nc, Rd =

O 5,3 cm2 = 2530 m
3 et 5 N/mm2
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
V' Condition d he :
On a f max ble
Or f max = f admissible =


Youssou SAWARE 31
0,724 x 2530 x235
Nc, Rd = = 391322 N = 391,322 kN
1,1
Nc,Rd= 391,322 kN Nsd <Nc,Rd Nsd= 325,27
KN
Le profilé HEA 120 retenu
résiste.
NB: Pour le RDC on prendra un HEA 200 pour les
poteaux
centraux
Pour les poteaux de rive
-1er niveau HEA 120
-RDC HEA 140
III-5 Les lisses pour bardages
Les lisses sont des poutrelles en UPN de longueur 5 m
espacées de 1,5 m. Elles permettent de supporter le bardage
III-5-1 Calcul des actions
Les charges appliquées sur les lisses sont:
-Poids du bardage..... 10 daN/m2
-Force due au vent .86,55 daN/m2
Ø Calcul en flexion horizontale
Elle est occasionnée par la charge due au vent.
V' La charge totale non pondérée:
We = 86,55 x 1,5 =129,75 daN/m
III-5-2 Pré- dimensionnement

Universit Ant DIOP
D'où on I >
Or E= 210000N/mm2 P= 1,297 N/mm = L= 5000mm

Youssou SAWARE 32
D'où I > 67mm4
=201,047 cm4
I = 201,041cm4
D'après notre résultat on choisit un UPN 100 avec
les caractéristiques suivantes :
DESIGNATION
|
Poids
|
Section
|
Dimensions
|
Caractéristiques
|
|
A
cm2
|
h
mm
|
b
mm
|
tf
mm
|
Iy
cm4
|
Wpl-y
cm3
|
iy
cm
|
UPN 100
|
10,6
|
13,5
|
100
|
50
|
8,5
|
206
|
49,0
|
3,91
|
|
Tableau III- 4:Caractéristiques du profilé UPN
100

Vérification de la flèche
J dm
mm
24,399 < 25 d'où la flèche
vérifiée. Ø Calcul en flexion
verticale
Elle est occasionnée par le poids propre du
profilé et le poids du bardage.
ü La charge totale non pondérée
P= 10,6 + (10x1, 5)= 25,6 daN/m
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 33
On voit que cette charge est inférieure à la charge
due au vent donc le profilé choisi résistera.
Le profilé UPN 100 retenu
résiste.
III-6 Les escaliers
Suite de marches qui sert à monter ou descendre. Ils sont
en charpente métallique avec:
La hauteur de contre marche = 17cm.
Pour calculer le giron (g) on utilise la règle de Blondel
: 2h + g = 60 à 65 cm
60- (2x17) = g = 6S-(2x17)
Soit 26cm = g = 31cm
On prend g =30 cm = 0,3m
ü Calcul du nombre de marche
Hauteur d'étage (H) = 3m
Hauteur de contre marche (h) = 16,5 cm
Le nombre de marche n = 300/16,5 = 18,18
D'où on a 9 marches pour la première volée
et 9 pour la deuxième volée :
· La longueur de la ligne de foulée sera: L = g
(n-1) = 30(9-1) =240 cm
·

L'inclina volée
Tan á = 0,55 ' = 29°
Ø Dimensionnement des éléments
porteurs o Cornière de marche

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 34
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Figure III- 3:Disposition des marches V' La
charge totale non pondérée
P= (91,37 + 250) x0, 3 =102,411 daN/m = 1,024 N/mm

V' Condition d he
On a f max ble
Or f max = f admissible =
D'où on I ?

Or E= 210000N/mm2 P= 1,024N/mm L= 1000mm
D'où I ? mm4 =
1,587 cm4
I = 1,587cm4 d'où on choisit une
cornière de 35x35x4 avec I =2,95 cm4

V' Vérification
f dm
0,021< 4 donc la cornière de 35x35x4 retenue
résiste.
o Les limons
Les limons sont des poutrelles en UPN sur lesquels on fixe
les
cornières de marches.
V' La charge totale non
pondérée
P = (241,37+250) x1, 6=786,192 daN/m =7,861 N/mm
he
On a f max ble

V' Condition d
Or f max = f admissible =
D'où on I ?
Or E= 210000N/mm2 P= 7,861N/mm
L= 2300 mm

D'où I ? 08mm4

Youssou SAWARE 35
= 148,25cm4
I = 148,25 cm4 d'où on choisit un UPN
120 avec I =364 cm4 V'
Vérification:
f dm
m
3,74 < 9,2 donc le profilé UPN 120
retenu résistera.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
CHAPITRE Ii
ETUDES DES
ASSEMBLAGES
Youssou SAWARE
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 37
CHAPITRE IV : ETUDES DES ASSEMBLAGES
Introduction
L'assemblage sert à réunir ensemble deux ou
plusieurs pièces en assurant la bonne transmission des efforts. Il en
existe plusieurs types mais nous allons dans notre cas utiliser les assemblages
boulonnés et les assemblages soudés.
IV-1 Les types d'assemblages utilisés
La caractéristique essentielle des ossatures
métalliques est d'être composée d'éléments
élaborés en des lieux et des instants différents qui sont
ensuite assemblés sur le site de construction. Cet assemblage est fait
généralement par le soudage et/ou par le boulonnage.
IV-1-1 Le soudage
Le soudage est l'opération qui consiste à assembler
des pièces par fusion. Cette fusion peut être d'origine
électrique (arc, résistance...), chimique (combustion de gaz),
mécanique (friction, choc...).En tant que procédé
d'assemblage, le soudage présente de nombreux avantages mais
nécessite d'observer certaines précautions.
IV-1-2 Le boulonnage
Le boulonnage est le mode d'assemblage obtenu par vis
écrou. Il est le moyen d'assemblage le plus utilisé du fait de sa
facilité de mise en oeuvre et des possibilités de réglages
qu'il ménage sur sites. Pour notre cas, nous allons utiliser les boulons
ordinaires avec les caractéristiques dans le tableau ci-dessous:
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 38
|
Classe
|
4.6
|
4.8
|
5.6
|
5.8
|
6.6
|
6.8
|
8.8
|
10.9
|
|
f yb (MPa)
|
240
|
320
|
300
|
400
|
360
|
480
|
640
|
900
|
|
f ub (MPa)
|
400
|
400
|
500
|
500
|
600
|
600
|
800
|
1000
|
Tableau IV- 1:Valeurs nominales de la limite
d'élasticité et de la
résistance ultime à la
traction des boulons ordinaires
Ø Coefficients partiels de
sécurité des boulons V' Résistance des boulons
à la traction : 7 MB = 1,5
V' Résistance des boulons au cisaillement : 7
MB= 1,25
IV-2 Assemblage poteaux-poutres
Les sollicitations sont transmises de la poutre au poteau
à l'aide de la platine fixée sur l'aile de la poutre et
attachée au poteau par des boulons.

Figure IV- 1:Assemblage poteau-poutre
IV-2-1 Calcul des soudures (gorge)
La charge appliquée sur la poutre est de : Nsd=271 KN
avec: Msd= 112,93 KN.m
Vsd= 135,51 KN
Ø L'épaisseur du cordon sur la
semelle
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016


bonne (a = 6 mm)
Ø L'épaisseur du cordon sur l'âme
Vérifions avec une gorge a = 6 mm que:
MPa
La platine est assemblée avec la poutre par des cordons de
soudures d'épaisseur 6 mm que nous avons choisi et qu'on va
vérifier par la su

L gueur totale des cordons:
£ (b x 2) + (b - tw) x 2 + (h - 2tf) x 2]=
[8]
£ (150 x 2) + (150-7,1) x 4 + (300-21,4) x 2]= 1428,8 mm
£ 428,8 mm
b + (h-2tf) x 2 = 728,6mm
150 + (300-21,4) x 2 = 707,2 mm
= 7072 mm
0 ~ Pa
hoisie est
Youssou SAWARE 39
h A OP 2015/2016

3(2 hoisie est

bonne (a = 6 mm).
e nombre de bou
amètre des
0.9 x fub x (5.3)
ise un boulon de classe 8.8 :fub = 800 MPa
r les boulons résistants à
Le nombre s pour l'assemb
112930000 800 x
405384,16 < 720 x
,55 mm2
mm2 pour
n boulon 8 = 0,56 mm2
mm2
D'où on prend un boulon Ø 16 ( = 157
mm2)
Youssou SAWARE 40
Ø Vérification des boulons au
cisaillement
Pour que les boulons tiennent, ils doivent vérifier la
relation suivante :
F V, sd < FV, rd [8] (5.4)

FV, sd = Effort de cisaillement de calcul par boulon ;
FV, rd = ul au cisaillement par boulon ;
3 KN
FV, sd=
FV, rd= 0.5 x fub x 40 N
FV, rd= 50,24KN
FV, sd < FV, rd les boulons
résistent.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 41
Ø Vérification à la pression
diamétrale FV, sd = FB

FB = R l à la pression diamétrale par boulon ;
FV, sd N
FB = 2,5 x á x fub
Avec á = mini (
-Disposition constructive :
P1 > 2,2 do = 22 x 18 = 396 on prendra P1 = 40 mm

e1 > 1,2 d a e1 = 22 mm
á = mini ( á = 0,4
FB = 2,5 x 0,4 x 800 x 18 2,8 KN
FV, sd < FB donc les boulons
résistent.
IV-3 Assemblage poutres solives
Les solives sont assemblées aux poutres par des
tôles pliées en L de
100 x 100 x10 à l'aide de boulons M 14 de classe 8.8.
Nsd = 67,3 KN
Vsd = 33,65 KN

Figure IV- 2:Assemblage poutre-solive
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 42
IV-3-1 Vérification au cisaillement
FV, sd = FV, rd (5.5)

FV, sd = Effort de cisaillement de calcul par boulon ;
FV, rd =Rés e calcul boulon ;
FV, rd = 0.5 x 800 x N
F V, sd < FV, rd les boulons
résistent.
IV-3-2: Vérification à la pression
diamétrale

FV, sd = FB
la pression diamétrale par boulon ;
FB = 2,5 x á x fub
Avec á = mini (
-Disposition constructive :
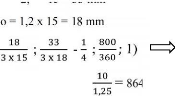
P1 > 2,2 do = 22 x 15 = 33 mm e1 > 1,2 d
á = mini ( á = 0,36
FB = 2,5 x 0,36 x 800 x 15 x 400N
FV, sd < FB donc les boulons résistent. IV-4
Assemblage pieds de poteau
Les pieds de poteau sont assemblés à l'aide des
platines et des tiges d'ancrage. Ces dernières qui sont au nombre de
huit, sont noyées dans le béton dosé à 350
Kg/m3.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 43
Figure IV- 3:Assemblage pied de poteau
IV-4-1 Dimensionnement de la platine
La platine est la plaque de tôle soudée à la
base du poteau dont le rôle est de repartir au maximum la pression sur le
béton, engendrée par la compression du poteau.
Ø Les dimensions de la platine
Comme le poteau est un HEA 200 on a :
a = h + (2 x u)
b = b + (2 x u) Avec
a = largeur da la platine
b = longueur de la platine
u = largeur entre le poteau et l'extrémité de la
platine = 50 mm
a = 190 + (2 x 50) = 290 mm
b = 200 + (2 x 50) = 300 mm On prend:
a = 400 mm

b = 400
Ø seur de la platine
[8]
t u (5.6)
= Résistance limite élastique de l'acier
utilisé (S235)

iv 2015/2016
= mm2
t > 80 19 mm
Youssou SAWARE 44
On prend t = 20 mm
IV-4-2 Dimensionnement des tiges d'ancrage
Les tiges d'ancrage sont des tiges filetées à
l'extrémité noyées dans la fondation pour permettre de
fixer le poteau et de prévenir tout décollement de la platine.

Figure IV- 4:Dimensions et dispositions des tiges d'ancrage
L'effort admissible par scellement (Na) doit
supérieur ou égal à
l'effort de traction N (donné par la force due au vent +
Nsd) de chaque tige.

*Nsd =649,2

*La force du ve
Na = 0,1 6,4r +3,5 l2) >

Avec
gc : Le sage en cimen u béton = 350m3 ;
r = 3 l2= 2 l1= 20
Vérifions avec un diamètre de
25 mm

Université kh 2015/2016
-Na = 0,1 + 6,4 x 3x 25 +3,5 x 2
x 5 daN
- ,15 KN = 8115daN
-Na > Le diamètre choisi est bon (
= ).
Conclusion
L'une des phases les plus importantes d'une construction est
l'assemblage. Il permet la construction d'une structure spatiale en assurant sa
fiabilité et sa stabilité.
Apres l'étude des assemblages nous allons passer au
contrôle des soudures et à la protection de la structure.
Youssou SAWARE 45
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE
CHAPITRE Y
CONTROLE DES
SOUDURES ET
PROTECTION DE LA
STRUCTURE
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 47
CHAPITRE V : CONTROLE DES SOUDURES ET
PROTECTION DE LA STRUCTURE
V-1 Contrôle des soudures
Introduction
Le contrôle des soudures [9]
vise à renforcer d'avantage la sécurité de
notre structure. Il se fait en trois étape : Avant,
pendant et après soudage.
V-1-1 Avant soudage
il permet d'assurer:
Que les qualifications effectuées en amont justifient de
la capacité des opérateurs (reconnaissance d'une
compétence);
Que les modes opératoires retenus attestent de la
soudabilité métallurgique, c'est à dire de la
possibilité de réaliser une
soudure sans défaut;
Que les opérations de réception des
matériaux (de base et d'apport) attestent de leur conformité aux
paramètres des modes opératoires retenus;
Etc. ;
On doit également s'assurer dès ce stade de la
faisabilité des étapes ultérieures telles que :
La soudabilité opératoire qui correspond à
la possibilité pratique de réaliser une soudure;
La possibilité de réaliser les CND (contrôle
non destructif) de façon efficace après fabrication;
V-1-2 Pendant soudage
Le contrôle pendant soudage vise à
assurer:
La préparation des pièces;
La correcte mise en oeuvre du procédé;
Éventuellement la mise en oeuvre de contrôles de
compacité (par
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 48
exemple le ressuage entre passes);
V-1-3 Après soudage
Le contrôle après fabrication est fait par divers
procédés à savoir le contrôle par ressuage, par
radiographie, par ultrason, par gammagraphie etc. Ils visent à
détecter les défauts de soudure aussi petit soient-ils.
Ils permettent d'apprécier sans destruction de
l'état de santé des pièces et ainsi de formuler un avis
sur leur aptitude à remplir la fonction à laquelle elles sont
destinées. Cependant certains CND nécessitent une bonne
connaissance de tous les phénomènes mis en jeux, en particulier
de la nocivité des défauts et de leur évolution dans le
temps. Sous cet angle, l'absence de contrôle peut conduire à des
conséquences catastrophiques.
Conclusion
Le contrôle des soudures est une étape importante
parce qu'il permet de garantir la durée de vie des structures. Cependant
ça ne suffit pas après cette phase, il faut procéder
à la protection de l'ouvrage.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 49
V-2: Protection de la structure
Pour garantir d'avantage la sécurité d'un
bâtiment en ossature
métallique, il faut le protéger contre la
corrosion et l'incendie.
Ø Protection contre la corrosion
Ils y'a différents procèdes qui sont
utilisés pour protéger une structure
Parmi lesquels on peut citer les revêtements de peinture
qui sont
couramment utilisés et qui tiennent une place
importante. Cependant
certaines précautions sont à prendre pour les
choisir et les appliquer.
Il y'a aussi les revêtements métalliques qui sont
utilisés
lorsque la corrosion risque d'être importante.
Ø Protection contre l'incendie
L'incendie peut causer des dégâts catastrophiques
comme par exemple
la ruine ou la déformation d'une structure grâce
aux températures
élevées qu'elle peut provoquer.
Pour remédier aux problèmes, on peut utiliser
différents procédés
parmi lesquels la peinture intumescente, enduits de
plâtres ou de
ciments mélangés à des particules
minérales.
On peut faire aussi des projections de plâtres, de
pierres liquides, de
fibres céramiques et minérales etc.
Et enfin la structure peut être équipée
d'un dispositif d'alerte
anti incendie.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

Ecole Normale Supérieure
d'Enseignement
Technique et Professionnel

BP 5004 Dakar - fann - Sénégal
Tel.: 221
338217669 - 338223384
Télécopie: 221 338217051
Youssou SAWARE
EXPLOITATION
PEDAGOGIQUE
LECON N°1 : LE SOUDAGE A L'ARC
ELECTRIQUE AVEC
ELECTRODE ENROBEE
(111)
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 51
Ø Justification de la leçon par rapport
au mémoire: Dans notre mémoire, les assemblages
sont faits par soudage et par boulonnage. Pour le soudage nous avons choisi le
procédé à l'arc avec électrode enrobée parce
qu'il permet une grande liberté d'exécution, une grande
autonomie, et l'équipement requis est le moins coûteux. Ainsi,
selon la technique utilisée, il devient possible de réaliser des
soudures dans n'importe quelle position de soudage et les dépôts
obtenus possèdent des qualités non négligeables,
puisqu'ils sont souvent plus purs que le métal de base et que leurs
propriétés mécaniques se révèlent
meilleures.
Ø Justification de la leçon par rapport
au programme: Le soudage à l'arc avec électrode
enrobée est l'un des procèdes les plus utilisés en
construction métallique grâce à sa polyvalence. Mais sa
pratique demande une connaissance avérée en la matière.
Donc il est primordial pour le technicien supérieur de le maitriser afin
de pouvoir corriger les erreurs éventuelles de manipulation de l'ouvrier
pratiquant pouvant aboutir à de mauvais résultats.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
FICHE PEDAGOGIQUE
|
Fiche N° : 01
|
LES
PROCEDES DE
SOUDAGE
|
CEDT LE G15
|
|
Date: Le -06- 01- 16
|
Classe: 2e BTS/SM
|
|
Durée : 7h
|
Effectif: 10 élèves
|
THEME : Le soudage à l'arc
électrique avec électrode enrobée OBJECTIF
SPECIFIQUE : A la fin de la séance, l'élève sera
capable de réaliser des cordons de soudure (200 mm) à plat sur
une pièce en respectant les paramètres suivants : Longueur d'arc,
vitesse d'avance, largeur du cordon, angle d'électrode. Les cordons
doivent être réguliers et homogènes.
OBJECTIF D'APPRENTISSAGE: A la fin de la
séance, l'élève sera capable de réaliser des
cordons de soudure à plat sur des pièces en respectant les
paramètres suivants : Longueur d'arc, vitesse d'avance, largeur du
cordon, angle d'électrode. Les cordons doivent être
réguliers et homogènes.
MO1 : Choisir le poste adéquat selon le
type de travail. Le poste choisi doit être compatible avec le type
d'électrode, l'intensité de soudage et la caractéristique
requise par le soudage à l'arc avec électrode enrobée.
MO2 : Choisir la bonne électrode selon le
métal de base, la dimension de l'assemblage, de la source du courant
disponible. Le choix doit être justifié selon la classification
établie par les normes.
MO3 : Calculer l'intensité pour un
diamètre d'électrode donnée. L'intensité
réglée doit être juste et permet le soudage des
pièces sans problème.
MO4 : Régler l'intensité sur un
poste de soudage. L'intensité réglée doit être
cohérente avec la valeur calculée.
Youssou SAWARE 52
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 53
MO5 : Souder des pièces à plat
tout en respectant la longueur d'arc, la
largeur du cordon, la vitesse d'avance, l'angle
d'électrode. Les
cordons de soudure doivent être réguliers et
homogènes.
DOMAINE TAXONOMIQUE : Psychomoteur
NIVEAU DE TAXONOMIE : Reproduction
PRE REQUIS:
Notions sur le courant continu
Notions sur le courant alternatif
SUPPORTS MOBILISES : Tableau- marqueur-
effaceur-documents
supports- électrodes -portes électrodes
-câbles de soudage-marteaux
piqueurs- prises de masses- brosses métalliques -
pièces-équipements
de sécurité.
SOURCES DOCUMENTAIRES:
C.Paquet, L.Lévesque, et M.Bramat,
Procédés de soudage à l'arc, 1er
édition, Canada: Reynald Goulet, 2008.
Liens
http://www.airliquide.com/saf/
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
ETAPES
|
OBJECTIFS D'ETAPE
|
CONTENUS CLES
|
ACTIVITES
|
UTILISATION DES SUPPORTS DIDACTIQUES
|
METHODE D'EVALUATI ON
|
REPARTITIO N
DU CREDIT HORAIRE
|
|
PROFESSEUR
|
ELEVES
|
|
Préalables
|
|
Préparation du poste de travail
|
Efface le tableau Aménage le bureau
Répartit le tableau Installe les postes de soudage
|
|
|
|
|
|
Salutation des élèves
|
Le prof salue les élèves
En taquinant les élèves, le prof se prive de saluer
les retardataires
dans le souci de ne pas être contaminé par leurs
virus de retard.
|
Les élèves répondent à la
salutation
Certains se mettent à rire
|
|
|
20 min
|
|
Identifications des absents
|
Le prof fait un appel et note les noms des absents
|
Les élèves répondent à l'appel
|
Liste officielle de la classe Feuille de présence
|
|
Youssou SAWARE 54
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
Vérification
|
Le prof demande
|
Les élèves
|
Feuille blanche
|
Évaluation
|
|
|
|
des prés
|
(qu'est-ce que le
|
notent les
|
Marqueur
|
diagnostique (A
|
|
|
|
requis
|
courant continu)
|
questions
|
Tableau
|
partir des
|
|
|
|
|
Le prof demande
|
essaient de
|
Effaceur
|
questions
|
|
|
|
|
(qu'est-ce que le
|
les traiter
|
|
posées
|
|
|
|
|
courant alternatif)
|
sur les 5
|
|
consistant à
|
|
|
|
|
Le prof donne la
|
min.
|
|
définir le
|
|
|
|
|
consigne
|
Apres ils
|
|
courant continu
|
|
|
|
|
suivante : Prenez chacun une feuille blanche et essayez de
répondre à ses deux questions vous avez 5 minutes.
Le prof se déplace entre les rangées pour voir si
les élèves font le travail ou pas
Apres les 5 minutes, le prof demande aux élèves
d'échanger leur copies ensuite il amène un élève au
tableau et ensemble ils corrigent les questions
|
échangent leurs copies et suivent la correction du prof au
tableau.
Ceux qui ont trouvé lèvent leurs bras de même
que ceux qui ont faussé
Ils suivent attentivem ent le rappel du prof et posent des
questions s'il y'en a
|
|
et alternatif)
|
|
Youssou SAWARE 55
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
Demande ceux qui ont trouvé et ceux qui n'ont pas
trouvé
Le prof fait un bref rappel
|
|
|
|
|
|
|
Annonce de
|
Le prof tout en
|
Les élèves
|
|
|
|
|
|
l'objectif du
|
faisant le tour de
|
essaient de
|
|
|
|
|
|
cours
|
la classe pour voir
|
donner des
|
|
|
|
|
|
|
si les élèves sont
|
réponses
|
|
|
|
|
|
|
pas en train de
|
Apres les
|
|
|
|
|
|
|
faire autre chose, demande vous êtes en bureau
|
explicatio ns du prof, ils se
|
|
|
|
|
|
|
d'étude dans une
|
rendent
|
|
|
|
|
|
|
entreprise et on
|
compte de
|
|
|
|
|
|
|
vous demande de
|
l'importan
|
|
|
|
|
|
|
faire le cahier de
|
ce du
|
|
|
|
|
|
|
charge (le type de
|
cours à
|
|
|
|
|
|
|
courant, la
|
leur
|
|
|
|
|
|
|
machine à utiliser
|
niveau et
|
|
|
|
|
|
|
les électrodes
|
vont
|
|
|
|
|
|
|
etc.) pour un
|
probablem
|
|
|
|
|
|
|
chantier de
|
ent lui
|
|
|
|
|
|
|
charpente. Que
|
prêter une
|
|
|
|
|
|
|
faites-vous?
|
attention
|
|
|
|
|
|
|
Face aux réponses
|
particulièr
|
|
|
|
|
|
|
tâtonnantes des élèves, le prof en profite
pour leur dire : Etant
|
e
|
|
|
|
Youssou SAWARE 56
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
technicien et vous ne parvenez pas à faire ce choix, votre
directeur va tout simplement vous remercier et chercher un autre donc ce cours
est important pour vous
|
|
|
|
|
|
Apprentiss age
du Jour
|
MO1 : Choisir le poste adéquat selon le
type de travail. Le poste choisi doit être compatible avec le type
d'électrode, l'intensité de soudage et la caractéristique
requise par le soudage à l'arc avec électrode enrobée.
|
Choix d'un poste de soudage
|
Le prof distribue les documents élèves.
Demande aux élèves les différents postes
qu'ils connaissent en SMAW
Synthétise les réponses.
Explique au tableau les critères de choix d'un poste de
soudage qui consistent à étudier les avantages et les
inconvénients de chaque poste selon un travail donné
|
Les élèves prennent leurs copies.
RA : Les postes à c.c et les postes à c.a
essaient de répondre à la question du prof.
Suivent les explicatio ns du prof.
Prennent note.
Posent des questions s'il y'en a
|
Tableau (pour dessiner les schémas guidant les
explications)
Marqueurs Effaceur
Documents élèves (pour prendre note)
Feuille blanche
|
Evaluation formative (Sur la base d'un exercice consistant
à faire le choix d'un poste de soudage)
|
30 min
|
Youssou SAWARE 57
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
Demande aux élèves de prendre note tout en se
déplaçant entre les rangées pour s'assurer que les
élèves prennent ce qu'ils doivent prendre
|
Traitent l'exercice
|
|
|
|
|
|
|
Donne un travail aux élèves sous forme d'exercice
et leur demande de choisir le poste adéquat pour faire ce travail.
|
|
|
|
|
|
MO 2: Choisir la
|
Choix d'une
|
Le prof demande
|
RA :
|
Documents élèves
|
Evaluation
|
|
|
bonne électrode
|
électrode pour
|
qu'est-ce qu'une
|
L'électrod
|
Electrodes (pour
|
formative (A
|
|
|
selon le métal de
|
un travail
|
électrode
|
e est une
|
faire la
|
partir d'un
|
|
|
base, la
|
donné.
|
Synthétise les
|
tige
|
codification)
|
exercice on
|
|
|
dimension de
|
|
réponses pour en
|
métallique
|
Tableau
|
demande aux
|
|
|
l'assemblage, de
|
|
sortir une et la
|
ronde
|
Marqueurs
|
élèves de
|
|
|
la source du
|
|
dicte aux élèves
|
(âme)
|
Effaceur
|
codifier une
|
|
|
courant
|
|
tout en se
|
recouverte
|
|
électrode)
|
|
|
disponible. Le choix doit être justifié selon la
classification établie par les normes.
|
|
déplaçant dans la classe pour voir si les
élèves prennent exactement ce qu'il dicte Explique le codage
utilisé par
|
d'un produit chimique (enrobage)
Les élèves essaient de donner des
réponses
|
|
|
20 min
|
Youssou SAWARE 58
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
les normes pour distinguer les électrodes.
Donne une électrode à chaque élève et
lui demande de la codifier
|
Suivent les explicatio ns du prof
Prennent note
Essaient de faire l'exercice donné
|
|
|
|
|
MO3 : Calculer
|
Calcul de
|
En SMAW on
|
Les élèves
|
Tableau
|
Evaluation
|
|
|
l'intensité pour un
|
l'intensité de
|
utilise du courant
|
prennent
|
Marqueurs
|
formative (A
|
|
|
diamètre
|
soudage
|
pour souder et la
|
note
|
Effaceur
|
partir d'un
|
20 min
|
|
d'électrode
|
|
formule pour
|
Ecrivent la
|
Documents élèves
|
exercice, le prof
|
|
|
donnée.
|
|
calculer ce
|
formule
|
|
demande aux
|
|
|
L'intensité réglée
|
|
courant est la
|
Essaient
|
|
élèves de
|
|
|
doit être juste et
|
|
suivante.
|
de faire
|
|
calculer
|
|
|
permet le soudage
|
|
Donne la formule
|
l'exercice
|
|
l'intensité de
|
|
|
des pièces sans problème.
|
|
au tableau Donne un diamètre quelconque et demande aux
élèves de calculer l'intensité
|
d'applicati on
|
|
soudage)
|
|
|
|
|
Regarde la copie de chaque élève pour voir s'il a
trouvé ou pas dans le but d'interroger après
|
|
|
|
|
Youssou SAWARE 59
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
quelqu'un qui a faussé
|
|
|
|
|
|
MO 4: Régler
|
Réglage de
|
Le prof va en
|
Les élèves
|
Poste de soudage
|
Evaluation
|
|
|
l'intensité sur un
|
l'intensité de
|
atelier en
|
suivent les
|
(pour faire la
|
formative (Sur
|
|
|
poste de soudage.
|
soudage
|
compagnie des
|
explicatio
|
pratique)
|
un poste de
|
|
|
L'intensité réglée
|
|
élèves
|
ns et la
|
|
soudage, le prof
|
30 min
|
|
doit être
|
|
Nous voici devant
|
pratique
|
|
demande aux
|
|
|
cohérente avec la
|
|
un poste de
|
du prof
|
|
élèves de faire
|
|
|
valeur calculée.
|
|
soudage et on veut régler une intensité donc en
premier lieu nous devons mettre la machine en marche ensuite régler
l'intensité voulue avec ce bouton
|
Chaque élève essaie de régler son poste
selon son intensité
|
|
le réglage de l'intensité)
|
|
|
|
|
Vous voyez j'ai
réglé le poste à
une
intensité de
|
|
|
|
|
|
|
|
100 A.
|
|
|
|
|
|
|
|
Demande à chaque élève de régler son
poste selon l'intensité qu'ils avaient calculé tout en lui
assistant lors de la manoeuvre
|
|
|
|
|
Youssou SAWARE 60
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
MO 5 : Souder
|
Soudage d'une
|
Le prof va en
|
Les élèves
|
Poste de soudage
|
Evaluation
|
|
|
des pièces à plat
|
pièce
|
atelier en
|
suivent la
|
Electrodes (pour
|
formative (Le
|
|
|
tout en respectant
|
|
compagnie des
|
pratique et
|
souder)
|
prof donne des
|
|
|
la longueur d'arc, la largeur du
|
|
élèves fait deux cordons et ré
|
les
explicatio
|
Marteaux
piqueurs (pour
|
pièces et demande aux
|
|
|
cordon, la vitesse
|
|
explique
|
ns du prof
|
enlever les
|
élèves de les
|
|
|
d'avance, l'angle
|
|
d'avantage aux
|
Chaque
|
laitiers)
|
souder)
|
|
|
d'électrode. Les cordons de
|
|
élèves certains paramètres
|
élève essaie de
|
Brosses
métalliques (pour
|
|
2h
|
|
soudure doivent
|
|
Donne chaque
|
faire des
|
nettoyer les
|
|
|
|
être réguliers et
|
|
élève des pièces
|
cordons
|
pièces)
|
|
|
|
homogènes.
|
|
et lui demande de
|
avec
|
Equipements de
|
|
|
|
|
|
faire des cordons à tour de rôle sur un même
poste afin d'avoir un oeil sur chaque passant pour veiller à la bonne
pratique
|
l'assistancsécurité e du prof
Après ils enlèvent les laitiers avec le marteau
piqueur et nettoient les pièces avec une brosse métallique
|
en vue de
protéger tout le corps
|
|
|
Youssou SAWARE 61
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
Synthèse évaluative
|
|
Vérifier que les objectifs sont atteints
|
|
Soudage d'une pièce à plat
|
|
Donc pour souder une pièce il faut d'abord choisir un
poste, choisir l'électrode, ensuite calculer l'intensité de
soudage puis faire le réglage sur la poste et enfin procéder
à l'opération de soudage en respectant les paramètres
cités dans le cours
Demande aux élèves s'ils n'ont pas de questions
Donne des pièces à chaque élève et leur demande de
:
Choisir le poste, Choisir le diamètre,
Calculer l'intensité,
Régler l'intensité, Souder les pièces
|
|
Les élèves suivent attentivem ent le
résumé du prof
Demande nt des questions s'il y'en a
Font le travail demandé par le prof
c.-à-d. Choisir un poste, choisir le diamètre,
calculer l'intensité, régler, l'intensité et faire des
cordons de longueur 200 mm.
|
|
Poste de soudage Electrodes (pour souder)
Marteaux piqueurs (pour enlever les laitiers)
Brosses métalliques (pour nettoyer les pièces)
Equipements de sécurité en vue de protéger
tout le corps
|
|
Evaluation formative (Sur la base d'un exercice sous forme de TP
sur l'ensemble du cours du choix du poste jusqu'au soudage)
|
|
3h
|
Youssou SAWARE 62
I-
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
LE SOUDAGE A L'ARC ELECTRIQUE AVEC ELECTRODE ENROBEE
(111)
Youssou SAWARE 63
Principe
Le soudage à l'arc avec électrode enrobée
est un procédé de soudage autogène qui consiste à
unir, avec une électrode de métal d'apport enrobée, deux
pièces de métal de même nature en fusionnant leurs
bords.
Cette fusion est obtenue grâce à la chaleur
dégagée par un arc établi entre l'électrode
enrobée et la pièce de métal et dont la température
est de 3500°C à l'anode, 2500 °C à la cathode et 5000
°C dans l'arc. La fusion de l'électrode enrobée et du
métal de base forme le bain de fusion qui, en se solidifiant, forme le
cordon de soudure. De plus, la fusion de l'enrobage dégage un gaz qui
protège le bain de fusion de l'air ambiant et forme un laitier
(dépôt vitreux) qui couvre le bain de fusion.

Figure 1 : Principe du procédé soudage à
l'arc électrique avec
électrode enrobée.
II- Choix du post de soudage
Plusieurs facteurs influent sur le choix d'un poste de
soudage à courant alternatif (c.a) ou à courant continu (c.c) ;
on doit considérer les avantages et les inconvénients de
chacun.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 64
A- Les avantages et les inconvénients d'un poste
c.c 1-Les avantages
Ø La possibilité de choisir la polarité
inverse (CCPI).
· CCPI produit une pénétration plus
profonde que CCPD.
· CCPI s'utilise pour le soudage en position autres
qu'à plat et à la verticale en descendant.
· Les électrodes pour souder le nickel
l'aluminium, et le cuivre s'utilisent généralement en
CCPI.
Ø La possibilité de choisir la polarité
directe (CCPD).
· CCPD est recommandé pour les électrodes
de série EXX2X possédant un haut taux de
dépôt.
· CCPD permet également le soudage en
position autre qu'à plat.
2-Les inconvénients
Le principal inconvénient d'un poste c.c à
courant constant demeure son prix plus élevé comparé
à un poste c.a de même qualité et d'une capacité
équivalente.
B- Les avantages et les inconvénients d'un poste
c.a
1-Les avantages
Ø Les soudures effectuées avec ce type de
poste offre une pénétration moyenne.
Ø On peut utiliser des électrodes de grand
diamètre à une intensité élevée, permettant
un taux de dépôt considérable et une bonne vitesse
d'exécution.
2-Les inconvénients
L'inconvénient majeur d'un poste c.a réside
dans le fait que certaines électrodes ne fonctionnent qu'en courant
continu.
En définitif, le choix d'un poste de soudage
dépend du type de soudures à effectuer, du prix d'achat et des
préférences personnelles. On peut également se procurer un
poste combiné c.a / c.c qui bien que plus couteux, offre la
possibilité d'adapter le courant aux exigences de la tâche
à réaliser.
III-Les accessoires de soudage à l'arc
Université Cheikh Anta DIOP
2015/2016
Youssou SAWARE 65
Les câbles de soudage servent à amener le courant
électrique du poste de soudage aux pièces à souder.
Leurs choix s'effectuent en fonction du travail à
effectuer et de la puissance de la soudeuse.
Le porte-électrode est relié au bout du
câble conducteur du courant de soudage. Il permet le passage du courant
vers l'électrode en plus de la retenir pendant le soudage;
La pince de masse est reliée à l'un des
câbles de soudage. Elle sert à établir la liaison entre la
soudeuse et la pièce à souder, ce qui ferme le circuit
électrique lorsque l'électrode entre en contact avec la
pièce à souder.
Pour enlever le laitier du cordon de soudure, on utilise le
marteau à piquer. On termine le nettoyage à l'aide de la brosse
métallique. I1 est. important de porter un casque de soudage muni d'un
verre de teinte adéquate pour se protéger contre le rayonnement
de l'arc et des particules en fusion.
On doit porter aussi des vêtements en cuir pour se
protéger contre les projections d'étincelles, la chaleur et le
rayonnement de l'arc.
IV- Les électrodes
L'électrode est constituée d'une tige
métallique ronde (âme) recouverte d'un produit chimique
(enrobage).

Figure 2 : Electrode enrobée
A- Classification
Comme il existe une variété innombrable de marques
et de types d'électrodes sur le marché, le choix d'une
électrode appropriée peut
Université Cheikh Anta DIOP
2015/2016
s'avérer difficile. C'est pourquoi certains organismes ont
mis au point différents systèmes de classification pour faciliter
cette tâche. Voici une classification selon l'Association Canadienne de
Normalisation et la Société Américaine de Soudage.

Figure 3 : Classification des électrodes
enrobées
B- Dimensions
La taille des électrodes varie selon l'épaisseur
du métal à souder, la position de soudage et la
préparation des bords. L'intensité du courant de soudage
dépend de l'électrode choisie. Plus l'enrobage de
l'électrode est épais, plus l'intensité de courant devra
être élevée. Le diamètre de l'électrode
désigne le diamètre de l'âme, exprimé en pouces ou
en millimètres. En principe, le diamètre de l'électrode ne
doit pas être supérieur à l'épaisseur du
métal à souder. Mais il peut arriver que l'on utilise des
électrodes de plus grand diamètre, lorsque la rapidité
d'exécution permet de croire que l'on évitera les
problèmes liés aux déformations, à
l'échauffement et à la présence de caniveaux.
Youssou SAWARE 66
Université Cheikh Anta DIOP
2015/2016
Ø#177; 0,03 (mm)
|
1,25
|
1,6
|
2 - 2,5
|
3,15 - 4-
5- 6,3 -
8-10
|
L #177; 2 (mm)
|
150-200
|
200-250
|
350
|
350-400
|
|
Tableau 1 : Longueurs des électrodes selon les
diamètres
C- Rôle de l'enrobage
L'enrobage a principalement quatre rôles que sont:
· Rôle électrique
Isoler électriquement les côtés de
l'âme métallique qui compose l'électrode, évitant
ainsi l'amorçage d'un arc sur les côtés.
· Rôle physique
Protéger le bain de fusion de l'oxygène et de
l'azote contenu dans l'air ambiant afin d'éviter que les
propriétés mécaniques du métal déposé
ne soient dégradées.
· Rôle métallurgique
Désoxyder le bain de fusion afin d'empêcher la
formation de soufflures dans celui-ci.
Amener des éléments d'alliage au bain de fusion
lorsque cela est nécessaire.
· Rôle mécanique
Soutenir et donner une forme au bain de fusion.
D- Les différents types d'enrobages
Différents types d'enrobages sont actuellement
disponibles ; ils sont désignés par leur lettre initiale:
- R : Rutile
- B : Basique
- C : Cellulosique
- O : Oxydant
- A : Acide
- V ou S : autres types ou spéciaux
Youssou SAWARE 67
Université Cheikh Anta DIOP
2015/2016
Enrobage
|
Constituants
|
Caractéristiques
|
Domaines
|
Rutile
|
Principalement composé de : - bioxyde de titane TIO2 -
cellulose
- ferro-alliages FeMn
- spath fluor
- silicate de fer
|
Caractéristiques: - facile à utiliser - tension
d'amorçage faible Uoe45 volts-pôle - fusion douce -bonne
caractéristiques mécaniques
- soudage en toutes positions - enrobage
généralement semi-épais ou épais
|
d~utilisation Serrrerie, charpente
légère, menuiserie métallique, entretien, chantier.
|
Basique
|
- carbonate de chaux,
de calcium ou de potassium
- ferro-alliages Mn, Ti, Cr, Si
- spath fluor
- silicates
-poudre de fer pour les électrodes
|
- excellentes caractéristiques
mécaniques
-très bonne protection du bain de fusion
- soudage en toutes positions sauf vertical descendant PG
- tension d'amorçage forte U >60 volts-pôle -
taux d'hydrogène très faible
|
Soudage des aciers au carbone et faiblement alliés,
assemblages de haute qualité soumis à des sollicitations
mécaniques importantes, structures spatiales, chaudières,
construction navale, mécano-soudure.
|
Cellulosique
|
- cellulose
- bioxyde de titane TiO2
- silicate
- ferro-alliages
- aluminium
|
nnes
étuvage
indispensable
- pariculièrement réervé au soudage en
vertical descendant PG
obage mince et très volatile qui laisse peu de laitier
- tension d'amorçage
Uoe50
volts-pôle
caractéristiques mécaniques
- demande une intensité légèrement plus
forte qu'en rutile
|
L'enrobage cellulosique est spécialement
élaboré
pour le soudage en position et plus particulièrement en
PG de tôlerie, tuyauterie, chantier et serrurerie. Quand
l'esthétique et la finesse du cordon sont nécessaires:
ferronnerie, serrurerie, menuiserie métallique.
|
Oxydant
|
- oxyde de fer
- oxyde de Mn, Ti
|
-uniquement réservé au travail à plat
-bonne apparence du cordon
|
Réservé aux travaux
de
tôlerie, serrurerie, il est de moins en moins
utilisé.
|
|
Youssou SAWARE 68
Université Cheikh Anta DIOP
2015/2016
|
- oxyde de fer
- oxyde de Mn
|
-très bon rendement 160 à200 %
|
Soudage à plat BW, PA et
|
|
- Mn, Si
|
- soudage en « PA > ou « PB >
|
en angle FW, PB, de
|
Acide
|
- Ferro-alliages
|
- cordon de bel aspect -tension d'amorçage Uoe60
volts-pôle + ou -
- étuvage nécessaire
|
tôlerie
type de construction navale et grosse chaudronnerie.
|
|
|
|
Uniquement sur aciers non alliés ou faiblement
alliés.
|
|
Tableau 2 : Caractéristiques des enrobages
V- Les sources de courant de soudage
Les sources de courant de soudage ou machines à
souder peuvent être à courant alternatif (c.a), à courant
continu (c.c) ou de type mixte (c.a/c.c).Elles sont conçues pour fournir
une intensité constante (courant constant), mesuré en
ampères ou une tension constante (potentiel constant), mesurée en
volts.
· Sources à courant alternatif
-Transformateur
-Alternateur -Onduleur
· Sources à courant continu
-Transformateur-redresseur -Générateur (groupe
électrogène) -Alternateur-redresseur
-Onduleur
· Sources à courant alternatif et continu ou
de type mixte -Transformateur-redresseur
-Alternateur-redresseur
-Onduleur
A- L'intensité de soudage
L'intensité dépend du diamètre de
l'électrode sa formule est:
I = 50 x (Ø -1)
Youssou SAWARE 69
Université Cheikh Anta DIOP
2015/2016
Voici des valeurs approximatives de l'intensité I pour le
soudage à plat des aciers non alliés.
e
|
Ø 1.6
|
Ø 2
|
Ø 2.5
|
Ø 3.15
|
Ø 4
|
Ø 5
|
Ø 6.3
|
1
|
25
|
|
|
|
|
|
|
2
|
35
|
45
|
55
|
|
|
|
|
3
|
|
60
|
70
|
90
|
|
|
|
5
|
|
|
90
|
110
|
130
|
160
|
|
6
|
|
|
|
120
|
140
|
160
|
|
8
|
|
|
|
125
|
150
|
170
|
|
12
|
|
|
|
130
|
170
|
200
|
250
|
15
|
|
|
|
|
180
|
210
|
270
|
25
|
|
|
|
|
200
|
230
|
320
|
50
|
|
|
|
|
|
250
|
350
|
80
|
|
|
|
|
|
250
|
350
|
100
|
|
|
|
|
|
250
|
350
|
|
Tableau 3 : L'intensité de soudage à plat des
aciers non alliées B- La tension de soudage
La tension dépend de l'intensité; elle est
donnée par la formule:
U = 0,04 I +20
VI- Le soufflage de l'arc
Le soufflage magnétique de l'arc est une déviation
de l'arc électrique
sous l'effet de forces magnétiques engendrées par
le courant de
soudage principalement en courant continu. Ce
phénomène complexe
et imprévisible est rencontré sur des
matériaux magnétisables lors de
soudage en fond de chanfrein, en angle et sur les
extrémités de pièces
de longues dimensions.
Pour corriger ce phénomène, on peut effectuer un
:
-Soudage opposé à la prise de masse;
-Changement de position de l'électrode;
-Déplacement de la position de la prise de masse;
-Positionnement des pièces à souder dans une autre
direction;
-Etc.
Youssou SAWARE 70
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 71
VII-Règles de sécurité
Le soudage à l'arc surtout avec électrode
enrobée expose le corps humain à un certain nombre de risques.
Pour pallier à ce phénomène, le soudeur
doit respecter certaines règles de sécurité que sont:
· Protéger les yeux et le visage contre les
rayons nocifs en portant un masque approprié.
· Porter des vêtements et des chaussures
adaptés aux travaux à exécuter.
· Eviter de travailler dans un environnement humide ou sur
un plancher mouillé pour éliminer les risques
d'électrocution. Le soudeur peut s'isoler en travaillant sur une
plateforme de bois.
· Protéger ses mains et ses bras en portant des
gants en crispins.
· Ne jamais utiliser d'équipement électrique
modifié ou non approuvé. Il peut être très dangereux
surtout si les enroulements primaire et secondaire produisent un
court-circuit.
· Disposer d'un système d'aspiration ou d'un
équipement de protection approprié pour protéger les voies
respiratoires contre les fumées produites durant le soudage.
· Etc.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
EPREUVES DES EVALUATIONS FORMATIVES DE LA
LECON N° 1
MO1 :
On vous demande de souder deux pièces d'épaisseur 6
mm. Condition de réalisation:
-Les passes en fond de chanfrein sont faites avec CCPI. -La
pénétration doit être forte.
Choisissez le poste adéquat pour effectuer ce travail.
MO2 :
Faites la codification de l'électrode suivantes : E6013
MO3 :
Calculez l'intensité nécessaire pour souder avec
une électrode de diamètre 3.2 mm.
Youssou SAWARE 72
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
LECON N°2 : LE CONTROLE DES SOUDURES
PAR
RADIOGRAPHIE
Youssou SAWARE 73
Ø Justification de la leçon par rapport
au mémoire:
Dans notre mémoire, nous voyons bien que notre structure
est assemblée avec : Le boulonnage et le soudage. Ce dernier
étant très compliqué à faire et présentant
souvent des défauts.
Comme nous étudions un bâtiment à usage
d'habitation, pour garantir d'avantage la sécurité des personnes
nous allons faire le contrôle des soudures par radiographie parce qu'il
est l'un des contrôles les plus performants pour détecter des
défauts de sous surface.
Ø Justification de la leçon par rapport
au programme: Le titulaire du brevet de technicien
supérieur en conception et réalisation en chaudronnerie est un
spécialiste des produits, il intervient à tous les niveaux depuis
la préparation jusqu'à la livraison (conception, organisation de
la fabrication, réalisation, assemblages et contrôle).Donc le
cours du contrôle des soudures par radiographie occupe une place
importante dans le programme car il permet aux techniciens d'interpréter
les résultats des contrôles faits par les ouvriers mais aussi de
faire lui-même le contrôle en cas de nécessité.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
FICHE PEDAGOGIQUE
|
Fiche N° : 05
|
Contrôle et
essais des
soudures
|
CEDT LE G15
|
|
Date: Le -04- 05- 16
|
Classe: 2e BTS/SM
|
|
Durée: 8h
|
Effectif: 08 élèves
|
THEME : Le contrôle des soudures par
radiographie.
OBJECTIF SPECIFIQUE : A la fin de la
leçon, l'élève sera capable de contrôler une soudure
avec les rayons X ou gamma (ã) : La conclusion devra être conforme
à la qualité de la pièce.
OBJECTIF D'APPRENTISSAGE: A la fin de la
leçon, l'élève sera capable de contrôler une soudure
avec les rayons X ou gamma (ã) : La conclusion devra être conforme
à la qualité de la pièce.
MO1 : Décrire la procédure de mise
en oeuvre des rayons X ou gamma (ã) par ses propres mots à partir
d'un schéma, tout en respectant la cohérence avec celle
décrite dans le cours.
MO2 : Déterminer le temps de pose pour
n'importe quelle soudure à radiographier: La valeur trouvée doit
être à la seconde-prés.
MO3 : Radiographier une soudure avec n'importe
quelle pièce en relevant le nombre exact de défauts.
MO4 : Interpréter les résultats
d'une pièce radiographiée
en donnant le type et la nature des défauts.
DOMAINE TAXONOMIQUE : Psychomoteur
NIVEAU DE TAXONOMIE : Perfectionnement
PRE REQUIS:
Notion sur les défauts de soudures ;
Notion sur les rayons ionisants;
SUPPORTS MOBILISES : Tableau- marqueur-
effaceur-documents
supports- pièce soudée- appareil de contrôle.
Combinaison de sécurité
SOURCES DOCUMENTAIRES:
Youssou SAWARE 74
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
§ Norme française," Contrôle non destructif des
assemblages soudés - Contrôle par radiographie des assemblages
soudés," Norme française, A89-510, 1997.
§ Norme française," Assemblages en acier
soudés à l'arc - Guide des niveaux d'acceptation des
défauts," A89-231, 1992.
§ C. Philip, Contrôles non destructifs des assemblages
soudés, 2007
Liens
§ http://www.rxi-inspection.ca/
§
http://www.ebanque-pdf.com/fr_fiche-de-controle-non-destructif.html
Youssou SAWARE 75
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
ETAPES
|
OBJECTIFS D'ETAPE
|
CONTENUS CLES
|
ACTIVITES
|
UTILISATION
DES
SUPPORTS
DIDACTIQUES
|
METHODE
D'EVALUATION
|
REPARTITION
DU CREDIT
HORAIRE
|
|
PROFESSEUR
|
ELEVES
|
|
|
Préparation du poste de travail.
|
Efface le tableau Aménage le bureau
|
|
|
|
|
|
|
|
Repartit le tableau
|
|
|
|
|
|
|
|
Installe le matériel de contrôle dans la salle de
contrôle
|
|
|
|
|
|
Préalables
|
|
Salutation des
|
Le prof salue
|
Les
|
|
|
|
|
|
élèves.
|
les élèves
Tapote certains en leur demandant s'ils ont pris un bon petit
déjeuner pour pouvoir se tenir tout au long du
cours.
|
élèves répondent à la salutation
Certains se mettent à rire
|
|
|
30 min
|
Youssou SAWARE 76
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
Identifications des absents
|
Le prof fait un appel et note les noms des absents.
|
Les
élèves répondent à l'appel.
|
Liste officielle de la classe
Feuille de présence.
|
|
|
|
|
Vérification
|
Le prof
|
RA :
|
Feuille blanche
|
Évaluation
|
|
|
|
des prés
|
demande
|
Cratères
|
Marqueurs
|
diagnostique
|
|
|
|
requis
|
(Quels sont
|
défaut
|
Tableau
|
(Sur la base
|
|
|
|
|
les types de
|
d'alignem
|
Effaceur
|
d'une série de
|
|
|
|
|
défauts de
|
ent nid de
|
|
questions, le
|
|
|
|
|
soudages que
|
porosité
|
|
prof demande
|
|
|
|
|
vous
|
inclusion
|
|
aux élèves de
|
|
|
|
|
connaissez?) Le prof demande (Qu'est-ce que un rayonnement
ionisant?)
Le prof demande
Le prof demande à chaque élève d'essayer sur
feuille blanche
Le prof se déplace entre les rangées
|
de laitier etc. Sur une
feuille blanche chaque élève essaie de donner les
réponses
Après échange des copies, ils suivent la correction
au tableau
|
|
répondre).
|
|
Youssou SAWARE 77
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
pour voir si
|
et après
|
|
|
|
|
|
|
les élèves
|
ils
|
|
|
|
|
|
|
travaillent ou
|
prennent
|
|
|
|
|
|
|
pas.
|
le corrigé
|
|
|
|
|
|
|
Après avoir
|
Pour
|
|
|
|
|
|
|
fini, le prof leur demande
|
terminer, chaque
|
|
|
|
|
|
|
d'échanger
|
élève dit
|
|
|
|
|
|
|
leurs copies, et ensemble
|
le nombre de
|
|
|
|
|
|
|
ils corrigent
|
questions
|
|
|
|
|
|
|
les questions
|
faussées
|
|
|
|
|
|
|
sur le tableau
|
Suivent
|
|
|
|
|
|
|
Demande à
|
attentive
|
|
|
|
|
|
|
chaque élève
|
ment le
|
|
|
|
|
|
|
les questions faussées.
|
prof.
|
|
|
|
|
|
|
Fait un bref rappel
|
|
|
|
|
|
|
Annonce de
|
Le prof crée
|
Les
|
|
|
|
|
|
l'objectif du
|
une situation
|
élèves
|
|
|
|
|
|
cours
|
pour
|
tentent de
|
|
|
|
|
|
|
l'annonce de
|
donner
|
|
|
|
|
|
|
l'objectif Par
|
des
|
|
|
|
|
|
|
exemple:
|
réponses
|
|
|
|
|
|
|
Imaginez que
|
Les
|
|
|
|
|
|
|
vous êtes
|
élèves
|
|
|
|
|
|
|
responsable
|
prennent
|
|
|
|
|
|
|
d'un chantier
|
connaissa
|
|
|
|
|
|
|
et on vous
|
nce de
|
|
|
|
|
|
|
demande de
|
l'importa
|
|
|
|
|
|
|
vérifier ou
|
nce du
|
|
|
|
Youssou SAWARE 78
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
d'interpréter le contrôle fait par un ouvrier. Que
faites-vous? Le prof récapitule les réponses, les oriente dans le
cadre du cours et de là il dit les dégâts que peuvent faire
un mauvais contrôle ou une mauvaise interprétation afin de leur
montrer l'importance du cours et leur dit que l'objectif du cours du c'est de
vous permettre d'éviter ces dégâts.
|
cours et vont probable ment l'accorder une importanc e
capitale.
|
|
|
|
|
MO1 : Décrire la
|
Procédure de
|
Distribue les
|
RA : A
|
Documents
|
Évaluation
|
|
|
procédure de mise en
|
mise en oeuvre
|
documents
|
partir
|
élèves (pour
|
formative (A
|
|
|
oeuvre des rayons X
|
|
élèves
|
d'un
|
prendre note et
|
partir d'un
|
|
Youssou SAWARE 79
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
Apprentissage du Jour
|
|
ou gamma (ã) par ses propres mots à partir d'un
schéma, tout en respectant la
cohérence avec celle décrite dans le cours.
|
|
des rayons X ou gamma(ã)
|
A partir d'un schéma dessiné au tableau, le prof
demande aux élèves d'essayer de donner la procédure de
mise en oeuvre des rayons
Synthétise l'ensemble des réponses pour en faire
une et la dicte aux élèves tout en se déplaçant
entre les rangées pour voir si les élèves prennent note ou
pas mais de s'assurer qu'ils prennent ce qu'ils doivent prendre
|
émetteur de rayon X ou gamma, La pièce est soumise
à l'action d'une source de rayonnem ent.
Le rayonnem ent sortant de la pièce sous forme d'image est
capté par le récepteur de film après expositio n pendant
un temps donné.
Enfin le film est interprété
|
|
suivre le
déroulement du cours)
Tableau
(support pour dessiner)
Marqueurs (pour dessiner)
Effaceur
(éventuellement pour effacer)
|
|
exercice de description d'une procédure de mise en oeuvre
des rayons X ou gamma sur la base d'une figure)
|
|
45 min
|
Youssou SAWARE 80
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
Sur une figure légèrement différente le prof
demande aux élèves de faire pareil.
|
pour connaitre la nature et le type de défaut. Les
élèves essaient de donner des réponses
|
|
|
|
|
|
|
|
Prennent notes
|
|
|
|
|
|
|
|
Essaient de faire l'exercice d'applicat ion
|
|
|
|
|
MO 2: Déterminer le
|
détermination
|
Définit la
|
Les
|
Tableau (pour
|
Evaluation
|
|
|
temps de pose pour
|
du temps de
|
notion du
|
élèves
|
écrire)
|
formative (A
|
|
|
n'importe quelle
|
pose.
|
temps de
|
suivent
|
Marqueurs
|
partir d'un
|
|
|
soudure à
|
|
pose
|
les
|
Effaceur
|
exercice, le prof
|
|
|
radiographier: La
|
|
Ecrit sa
|
explicatio
|
Documents
|
demande aux
|
|
|
valeur trouvée doit
|
|
formule au
|
ns et
|
élèves.
|
élèves de
|
|
|
être à la seconde-
|
|
tableau
|
prennent
|
|
déterminer le
|
|
|
prés.
|
|
(rayon gamma)
|
note. Essaient
|
|
temps de pose individuellemen
|
|
|
|
|
Explique la détermination du temps de pose sur
|
de faire l'exercice
|
|
t)
|
35 min
|
Youssou SAWARE 81
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
abaque
|
|
|
|
|
|
|
|
(rayon X)
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecrit un exercice d'application au tableau où il demande
aux élèves d'essayer de déterminer le temps de pose
|
|
|
|
|
|
|
|
Circule dans la classe tout en se penchant sur la feuille de
chaque élève pour voir où il en est
|
|
|
|
|
|
MO 3: Radiographier
|
Radiographie
|
Le prof
|
Les
|
Appareils de
|
Evaluation
|
|
|
une soudure avec
|
d'une pièce
|
explique la
|
élèves
|
contrôle (Pour
|
formative (Sur
|
|
|
n'importe quelle
|
soudée.
|
procédure
|
suivent
|
pouvoir de faire
|
une pièce
|
2h
|
|
pièce en relevant le
|
|
pour faire la
|
les
|
le contrôle)
|
soudée, le prof
|
|
|
nombre exact de
|
|
radiographie
|
explicatio
|
Pièces
|
demande aux
|
|
|
défauts.
|
|
des soudures.
|
ns et la
|
(éléments à
|
élèves de faire
|
|
|
|
|
Va en salle
|
pratique
|
contrôler)
|
la pratique du
|
|
|
|
|
de
|
du prof
|
Combinaison de
|
contrôle par
|
|
|
|
|
radiographie avec les élèves
|
Faites la radiograp hie de leur pièce
|
sécurité (pour protéger le corps contre les
rayons X)
|
radiographie)
|
|
Youssou SAWARE 82

|
Feuilles blanche (support pour faire l'interprétation)
Support de cours
|
Evaluation formative (Sur la base des résultats de leur
pièces radiographiées, le prof demande aux élèves
d'interpréter les résultats)
|
40 min
|
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|
MO 4 : Interpréter les résultats
d'une pièce radiographiée en donnant le type et la nature des
défauts.
|
|
Interprétation des défauts.
|
|
Fait une démonstratio n
Donne une pièce à
chaque élève.
Demande aux élèves à tour de rôle
d'effectuer le contrôle par radiographie de la pièce tout en leur
assistant à chaque étape à fin de rectifier certaines
erreurs
|
|
Le prof et les élèves décrivent la
procédure d'interprétati on des défauts.
Donne la liste des défauts et leurs manifestation s
après
|
|
à tour de rôle.
Réajusten t leur manière de faire selon les
explicatio ns du prof.
|
|
Les
élèves suivent les explicatio ns du prof et la
façon dont il analyse ses résultats
|
Youssou SAWARE 83
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
passage des
|
essaient
|
|
|
|
|
|
|
rayons X ou
|
d'interpré
|
|
|
|
|
|
|
gamma.
|
ter leurs
|
|
|
|
|
|
|
interprète les
|
résultats à
|
|
|
|
|
|
|
résultats de
|
partir des
|
|
|
|
|
|
|
sa
|
supports
|
|
|
|
|
|
|
radiographie
|
de cours
|
|
|
|
|
|
|
demande à
|
mis à
|
|
|
|
|
|
|
chaque élève
|
leurs
|
|
|
|
|
|
|
d'interpréter
|
dispositio
|
|
|
|
|
|
|
les résultats de sa radiographie sur feuille blanche
|
ns
|
|
|
|
|
|
|
Fait le tour des tables pour observer les élèves
|
|
|
|
|
|
Synthèse
|
Vérifier que les
|
Récapitulatif
|
Le prof
|
Font la
|
Pièces
|
Evaluation
|
|
|
évaluative
|
objectifs sont atteints.
|
du cours.
|
récapitule le cours
Demande aux
|
synthèse avec l'aide du
|
Appareils de contrôle.
Combinaison de
|
formative (A partir d'une pièce, le prof
|
|
|
|
|
élèves de faire la synthèse
Demande aux élèves s'ils n'ont pas de questions
|
prof
posent des questions s'il y'a n'en
|
sécurité
|
demande la pratique du contrôle par radiographie).
|
3h 30 min
|
Youssou SAWARE 84
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
|
|
|
Donne une
|
Calculent
|
|
|
|
|
|
|
pièce à
|
le temps
|
|
|
|
|
|
|
chaque élève
|
de pose
|
|
|
|
|
|
|
et leur
|
Détermin
|
|
|
|
|
|
|
demande de :
|
ent le
|
|
|
|
|
|
|
Calculer le
|
temps de
|
|
|
|
|
|
|
temps de
|
pose par
|
|
|
|
|
|
|
pose;
|
abaque
|
|
|
|
|
|
|
Déterminer le
|
Radiogra
|
|
|
|
|
|
|
temps de
|
phient les
|
|
|
|
|
|
|
pose par
|
pièces et
|
|
|
|
|
|
|
abaque;
|
les
|
|
|
|
|
|
|
Radiographie
|
interprète
|
|
|
|
|
|
|
r la pièce en utilisant selon leur choix les rayons X ou
gamma;
|
nt.
|
|
|
|
|
|
|
D'interpréter les résultats.
|
|
|
|
|
Youssou SAWARE 85
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
LE CONTROLE DES SOUDURES PAR
RADIOGRAPHIE
Youssou SAWARE 86
I-Principe
La radiographie peut être décrite comme étant
un examen qui utilise un faisceau de radiations
électromagnétiques pénétrantes dirigé vers
la pièce à inspecter. Suivant la nature et la
géométrie de la pièce, une portion du faisceau est
absorbée et/ou déviée. En créant une image à
partir de l'intensité de la radiation derrière la pièce,
des variations d'intensité sont donc observées. Ces variations
correspondent à l'ombrage produit par les différentes structures
(internes et externes) de la pièce inspectée.

Figure 1 : Schéma de principe du contrôle par
radiographie A- La procédure de mise en oeuvre
A partir d'un émetteur de rayon X ou gamma, La
pièce est soumise à l'action d'une source de rayonnement.
Le rayonnement sortant de la pièce sous forme d'image
est capté par le récepteur de film après exposition
pendant un temps donné.
Enfin le film est interprété pour connaitre la
nature et le type de défaut. II-Les sources de
rayonnements
En radiographie, on utilise deux sources de rayonnements
électromagnétiques (même nature que la lumière ou
les ondes radio) :
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 87
Le rayonnement X et le rayonnement
gamma(y).Ces rayonnements sont dits ionisants du fait de leur
capacité à agir sur la matière et d'y créer des
charges électriques.
A- Le contrôle par rayonnement X
Les rayons X, mis en évidence par Röntgen en
1895, sont créés en envoyant des électrons
accélérés sur une cible en tungstène. Les rayons X
ont des longueurs d'onde comprise entre 10-7 m et 10-12
m, ce qui correspond à une gamme d'énergie allant de 10 V
à 1000 KV. Toutefois, seuls les rayons X de longueur d'onde
inférieure à 2,5 10-10 m (c'est-à-dire
d'énergie supérieure à environ 5 KV) ont un pouvoir
pénétrant suffisant pour être utilisés
industriellement
Avec les accélérateurs linéaires, on
sait aujourd'hui produire des rayonnements X de quelques MV, capables de
radiographier des épaisseurs souvent supérieures à 200
mm.
Il va sans dire que ce type d'équipement est
très coûteux. Contrairement aux rayons ã, les rayons X sont
produits, à la demande par un générateur. Un très
haut potentiel électrique (plusieurs centaines de kV) est établi
entre deux électrodes (la cathode négative source
d'électrons et l'anode positive source des rayons X). Les
électrons sont accélérés par la tension entre les
électrodes. La production du faisceau électronique
génère de la chaleur (99%) et des rayons X (1%) de façon
à éviter la formation d'arcs électriques entre les deux
électrodes.
B- Le contrôle par rayonnement Gamma
(y)
Les rayonnements ã (gamma) sont créés
par désintégration spontanée d'un élément
radioactif tel l'iridium 192 (période de 74 jours) ou le cobalt 60
(période de 5, 3 ans). Les énergies produites (entre 0,3 et 0,6
MV pour l'iridium, entre 1,1 et 1,3 MV pour le cobalt) permettent de
radiographier des pièces plus épaisses qu'avec les rayons X
produits par des moyens classiques : pour fixer les idées, les
épaisseurs d'acier acceptables vont jusqu'à 20 mm avec les rayons
X classiques, et jusqu'à 150 mm avec les rayons gamma.
Dans la plupart des applications industrielles, la formation
de
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 88
l'image radiographique s'effectue grâce à un
film qui, après développement, est observé par
transparence. La procédure est un peu complexe, prend du temps (quelques
heures, si on veut une image de qualité) et coûteuse si on a
beaucoup de contrôles.
Comme pour toutes les techniques de CND, le CND par
radiographie exige un savoir-faire important, tant au niveau des conditions
opératoires qu'à celui de l'interprétation des
résultats.
III-Le temps de pose
A- Définition
C'est le temps de l'exposition externe durant lequel la
source radioactive est sortie de son conteneur pour la prise d'un
cliché.
B- Le temps de pose aux rayons X
Le temps de pose est déterminé par un abaque
d'exposition spécifique à chaque poste à rayon X.
C-

Le temps de pose aux rayn Gm ()
Le temps de pose est déterminé p uivante :
T= .
Avec
T : Temps de pose en heure;
Q : Le facteur d'exposition en heure /curie;
d : La distance source / film en mètre;
K : Le coefficient de rapidité du film;
N : Le coefficient de densité optique;
IV-Les indicateurs de qualité d'image
Les indicateurs de qualité d'image sont des dispositifs
permettant de
définir la qualité de l'image d'un film
radiographique.
Les IQI les plus courants sont:
-Les indicateurs à fils;
-Les indicateurs à gradins percés;
A- Les indicateurs à fils
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 89
Les indicateurs à fils sont constitués d'une
pochette en plastique translucide dans laquelle est placée 7 fils de
diamètre calibres et décroissants. Le matériau des fils
doit avoir un coefficient d'absorption le plus proche du matériau
à contrôler.
Ils existent quatre matériaux pour les fils : Le fer,
l'aluminium, le cuivre et le titane.

Figure 2 : Indicateur à fils
B- Les indicateurs à gradins percés
Les indicateurs à gradins percés sont des
pièces étalons comportant des inclusions et des
aspérités jouant le rôle des défauts. Ils sont
repérés par un numéro en plomb (H1,
H5, H9 et H13) correspondant à l'épaisseur du
gradin et au diamètre du trou le plus gros.
Le matériau des fils doit avoir un coefficient
d'absorption le plus proche du matériau à contrôler.
Ils existent quatre matériaux pour les fils : Le fer,
l'aluminium, le cuivre et le titane.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 90
Figure 3 : Indicateur à gradin percé V-
Interprétations de quelques défauts:

Un désalignement des pièces à
souder (Offset) et un remplissage


Concavité excessive (insuffisamment rempli)
La quantité de metal d'apport sur la dernière passe
est insuffisante. La soudure sur le cap est creuse, l'épaisseur totale
du cordon est donc plus mince a cet endroit.
L'image radiographique qui revéle une densité plus
sombre qui s'étend sur toute la largeur de la zone de soudage. Le reste
de la partie soudee est plus « blanc >
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 91
Concavité excessive (insuffisamment rempli)
Pénétration excessive (glaçon)
|
1,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénétration excessive
(glaçon)
Quantité de metal d'apport a la racine du cordon de
soudure excédentaire
L'image radiographique révèle une densité
plus clair dans le centre de la largeur de la zone de soudage. Cela peut
s'étendre tout le long du joint de soudure ou. comme dans ce
cas, à des zones isolées.
|
|
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 92
Caniveau externe
|
|
|
Caniveau externe
Sur la surface externe le long du joint de soudure et su le bord
de l'arête, amincissement du métal de base provoquant un «
undercut ».
L'image radiographique révèle une zone
irrégulière de densité plus sombre. Lors d'un caniveau tel
que celui-ci, la densité de ce défaut sera toujours plus sombre
que la densité des pièces â souder.
Met
|

Caniveau interne e la racine
Sur la surface interne le long du joint de soudure ,
amincissement du métal de base provoquant un
«underdut »_
|
Limage radiographique rèvéle une zone
irrégulière de densité plus sombre non loin
du centre du joint de soudure et tout le long de l'arête de la
passe â la racint
|
Caniveau interne à la racine
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
VI- Les critères d'acceptations des
défauts
Le critère d'acceptation d'un défaut ou d'une
série de défauts est un phénomène important dans le
contrôle par radiographie. Il permet d'accepter ou de rejeter un
défaut selon sa taille et sa position. Deux classes de
sévérités sont définies. La classe à prendre
en considération doit être aux spécifications techniques.
Voici selon les tableaux ci-dessous les critères établies par le
code E.D.F (Electricité De France).
|
Nature du défaut
|
Décision
|
|
Fissure critique, collage, manque de pénétration,
caniveau
|
Classe 1
|
Classe 2
|
|
A réparer
|
A réparer
|
|
Inclusion
|
Tolérés si sa plus grande dimension
inférieure : (b) (c) (d)
(e)
|
|
<1.5mm pour e < 5mm (b) <3mm pour tôle 5 <e<
9mm
(c)
<e/3 mm pour e = 9 à 60mm
(d)
<20mm pour e > 60mm (e)
|
5mm pour e < 10mm e/2 mm pour e =10 à 60mm
30mm pour e > 60mm
|
Tableau 1 : Les critères établis par le code E.D.F
en fonction
des défauts
|
Epaisseur de la paroi e en mm
|
Plus grande dimension de la soufflure en mm
|
|
Classe 1
|
Classe 2
|
|
e < 5
|
1
|
1.5
|
|
5 = e = 10
|
1.5
|
2
|
|
10 < e = 20
|
2
|
2.5
|
|
20 < e = 40
|
2.5
|
3
|
|
e > 40
|
3
|
4
|
Tableau 2 : Les critères établis par le code E.D.F
en fonction de
l'épaisseur
Youssou SAWARE 93
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 94
VII-Avantages et Inconvénients
A- Avantages
y' Détection des défauts dans le volume de la
pièce;
y' Applicable à tous les matériaux;
y' Traçabilité et archivage des
résultats;
y' Facilité d'identification des défauts internes
des soudures bout
à bout interpénétrées;
y' Performant pour défauts volumiques et manques de
pénétrations;
y' Etc.
B- Inconvénients
y' Peu adapté aux contrôles des soudures en
angle;
y' Pas adapté aux soudures non
interpénétrées;
y' Règles de sécurité rigoureuse et
contraignante;
y' Difficulté de localisation du défaut dans
l'épaisseur;
y' Les défauts plats (collages ou fissures) ne sont
décelés que
s'ils sont orientés suivant le rayonnement (ou
légèrement
inclinés sur celui-ci);
y' Orientation du rayonnement à choisir en fonction de
l'orientation supposée du défaut
recherché;
y' Méthode coûteuse en investissement et
développement des
films;
y' Pénétration des rayons limitée par
l'épaisseur et la puissance de
la source;
y' Etc.
VIII-Protections contre les rayons
Toutes expositions à des rayonnements ionisants, aussi
faible soient-
elles, peuvent entraîner des risques pour la santé
du travailleur. Des
mesures sont donc à prévoir pour supprimer ou
limiter autant que
possible les expositions.
La radioactivité est un phénomène naturel
lié à l'instabilité de certains
atomes qui composent la matière. Ces atomes instables
(les
radioéléments) émettent des rayonnements
qui, en interagissant avec
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 95
la matière peuvent l'ioniser, c'est-à-dire enlever
un ou plusieurs électrons à ses atomes. Ces rayonnements sont
dits ionisants. Généralement, un radioélément
émet plusieurs types de rayonnements ionisants à la fois (alpha,
bêta, gamma, X et neutronique). L'émission diminue avec le temps
(de quelques jours à plusieurs millions d'années, selon le
radioélément considéré), on parle de
décroissance radioactive.
La radioactivité peut provenir de substances radioactives
naturelles (uranium, radium, radon) ou artificielles (californium,
américium, plutonium).
Différents dispositifs et installations
(accélérateurs de particules, générateurs
électriques...) peuvent également émettre des rayonnements
ionisants.
En outre, il est important de connaître les signes
d'alerte, la conduite à tenir et les différentes mesures à
prendre en cas de situation anormale lors de l'utilisation d'un
générateur ou d'une source scellée ou en cas de
dissémination de substances radioactives lors de l'utilisation d'une
source non scellée.
La protection contre le rayonnement X est donc
impérative, tant par la prévention collective
(vérification périodique des appareils, formation à leur
utilisation, délimitation et signalisation des zones d'émission,
écrans de protection...) que par la prévention individuelle
(dosimétrie, surveillance médicale renforcée, port
d'équipements de protection...).
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
EPREUVES DES EVALUATIONS FORMATIVES DE LA
LECON N° 2
MO1 :
A partir du schéma ci-dessous, décrire avec vos
propres mots la procédure de mise en oeuvre des rayons X ou gamma.

MO2 :
Une source d'iridium 192 a une activité de 925 MBq (25
curies) au 1er mars 2004. Le cliché est pris le 10 juin 2004 avec un
film ayant un facteur k = 4 pour une densité recherchée de 2,5.
La soudure à radiographier est un tube de 508 x 5 en acier. La source
radioactive est disposée dans l'axe du tube.
· L'activité résiduelle au 10 juin 2004 : 925
x 0,392 = 362,6 MBq = 362,6 106 Bq
· Epaisseur de l'acier: 5 mm donc Q = 950 (densité
voulue 2,5)
· Distance source film en mètres : d =0,26 m
· Coefficient de rapidité du film = K = 4
Calculez le temps pose?
Youssou SAWARE 96
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 97
Définitions de certains mots
difficiles
Radiation: C'est le processus d'émission
ou de transmission d'énergie impliquant une onde, une particule.
Rayonnement ionisant: C'est un rayonnement
capable de déposer assez d'énergie sur la matière qu'il
traverse pour créer une ionisation. Ionisation : C'est
le fait d'arracher un ou plusieurs d'électrons à la structure
électronique d'un atome le transformant ainsi en un ion.
Désintégration: c'est la transformation d'un
noyau d'un atome Iridium: C'est un élément
chimique de symbole Jr et de numéro atomique 77.Il est utilisé
dans les alliages à haute résistance et pouvant supporter de
hautes températures.
Dosimétrie : C'est la
détermination quantitative de la dose absorbée par un organisme
ou un objet, c'est-à-dire l'énergie reçue par unité
de masse, suite à l'exposition à des rayonnements ionisants.
Radioactivité : C'est un phénomène
physique au cours duquel des noyaux atomiques se transforment
spontanément par désintégration simple ou en chaine en
dégageant de l'énergie sous forme de rayonnement ionisant en des
noyaux atomiques plus stables ayant perdu une partie de leur masse.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 98
CONCLUSION GENERALE
Notre projet consistait à étudier un bâtiment
en charpente métallique à usage d'habitation muni d'un
rez-de-chaussée et un niveau.
La structure est entièrement dimensionnée selon
l'Eurocode, de l'hypothèse des charges et actions puis la descente des
charges pour terminer avec le dimensionnement afin de choisir les
profilés adéquats tout en veillant sur sa
légèreté et sa stabilité.
De cette étude, je me suis d'avantage familiarisé
avec les règles de dimensionnement, l'élaboration des fiches
pédagogiques mais aussi j'ai eu à perfectionner les connaissances
acquises lors de ma formation.
Notre étude, n'étant pas axée sur le
coût mais les travaux de certains comme le Docteur J.W.Rackham
[1] sur sa publication sur « les
Stratégies pour la construction rentable de bâtiment en acier en
Europe version 6, d'octobre 2010 » nous montre les nombreux avantages que
présentent les bâtiments à ossature métallique par
rapport aux ceux en béton armé.
Cependant, malgré ces nombreux avantages, on ne saurait
dire avec exactitude que les bâtiments à ossature
métallique sont moins chers que les bâtiments en béton
armé. Donc selon nous, une étude comparative doit être
effectuée pour y avoir une idée beaucoup plus claire.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE 99
REFERENCES BIBLIOGRAHIQUES
[1] :J.W.Rackham, Stratégies pour la
construction rentable de bâtiments en acier en Europe, 2010.
[2] : C. E. de Normalisation, « Eurocode
1. Actions sur les structures. Actions générales. Poids
volumiques- poids propres-charges d'exploitation des bâtiments », EN
1991-1-1, 2002.
[3] : Arcelor Mittal, Caractéristiques
géométriques des planchers collaborants Cofraplus 60
[Figure].Tiré de
https://www.google.fr/#q=arval+plancher+collaborant+2008+cofraplu
s+60, 2008.
[4]: C. E. de Normalisation, « Eurocode 1:
Actions sur les structures- Partie 1-4: Actions générales-Actions
du vent », EN 1991-1-4, 2005.
[5] : M. H. Midoun, et W. Mostefaoui, " Etude
d'un bâtiment métallique (R+14) + sous-sol -Oran," Mémoire
de maitrise. , Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen UADT,
Algérie, 2014. [En ligne].Disponible : DSpace,
http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/3899.[Consulté
le 5 janvier 2016].
[6]: J. Morel, Guide de calcul des structures
métalliques CM 66 additif 80-Eurocode 3, Paris : Eyrolles, 2001.
[7]C. Hazard, F. Lelong, et B. Quinzain,
Mémotech structures métalliques, Paris : Casteilla, 1997.
[8] : J.MOREL, Calcul des structures métalliques selon
l'Eurocode 3, Paris : Eyrolles, 2005.
[9] :D.Semin, "Technique et application,"
Assemblages soudés et contrôles non destructifs(C.N.D), n°.2,
pp.82, 2004.
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
Youssou SAWARE
ANNEXES
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
ANNEXE A :
Tableau des vitesses du vent selon L'Agence Nationale de
l'Aviation
Civile et de la Météorologie du
Sénégal
(ANACIM)

Youssou SAWARE 101
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 102
Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016
ANNEXE B :
PLAN 3D

PLAN 3D
Eeh : 1/100
Youssou SAWARE 103



