
ROYAUME DU MAROC
ÉÜíÈÑÛãáÇ
ÉÜßáããáÇ
áÇÓÈ
äíÓÏäåãáá
ÉíæÈÇÛáÇ
ÉíäØæáÇ
ÉÓÑÏãáÇ
ECOLE NATIONALE FORESTIERE
D'INGENIEURS DE SALE
Caractérisation chimique des huiles
essentielles de différentes provenances de Thymus satureioides
C. & B. dans le Sud-Ouest Marocain et évaluation de leur
potentiel bio-insecticide contre Varroa destructor Anderson &
Trueman (Arachnida: Acari: Varroidae) dans le
Gharb.
MEMOIRE DE 3ème
CYCLE
Présenté par : Mr. KONKO
Yawo
POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'INGENIEUR DES EAUX ET
FORETS
OPTION : Ecologie et Gestion des Ressources
Naturelles
Soutenu publiquement le Jeudi 10 Juillet 2014 à
09h00 devant le jury:
MM.
Pr. SESBOU A. (E.N.F.I-Salé)
Président
Pr. RAMZI H. (E.N.F.I-Salé) rapporteur
|
M. ISMAILI M.R.
Dr. ABERCHANE M.
Pr. ZINE EL ABIDINE A.
|
(C.R.F-Rabat)
(C.R.F-Rabat)
(E.N.F.I-Salé)
( .)
|
Co-rapporteur Examinateur Examinateur
|
ENFI, BP: 511, Bd. Moulay Youssef, Tabriquet,
Salé, Maroc - Tél: 0537861149, Fax: 0537862607

Dédicaces
Je dédie ce travail,
A mon père, lui qui a sacrifié tant de choses
pour que je puisse étudier et pour le soutien et l'encouragement qu'il
m'a apporté.
A ma belle-mère qui n'a jamais cessé de me
soutenir et de m'encourager;
A mes frères et soeurs qui, malgré la distance
qui nous sépare, ont toujours occupé mon coeur et ma
pensée;
A monsieur Sabir Mohamed qui m'a toujours conseillé
comme son fils.
A ma bien-aimée et à toute sa famille qui m'ont
soutenu et encouragé durant la réalisation de ce travail.
Au couple Landry pour leur soutient et leur conseils.
A l'Agence Marocaine de Coopération Internationale
(AMCI) pour la bourse d'études qu'elle m'a accordé.
A tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont
accordé leur aide et soutien, je leur exprime, mon affection, ma
gratitude et mes meilleurs voeux de bonheur et de santé.
iii
Remerciements
Aux termes de ce travail, il m'est très agréable
d'exprimer ma profonde gratitude, ma reconnaissance et mes vifs remerciements
à tous les intervenants dans la réalisation de ce travail.
J'adresse mes respectueux remerciements au Pr. RAMZI
Hassan enseignant chercheur à l'ENFI. Son précieux
encadrement, ses conseils, ses directives, sa disponibilité, ses
initiatives et ses remarques constructives m'ont été d'un grand
intérêt. Qu'il soit assuré de ma profonde gratitude et ma
reconnaissance pour m'avoir fait profiter de son expérience et de son
talent pédagogique.
Mes remerciements sont également adressés
à M. ISMAILI My Rchid, Ingénieur-chercheur au
Centre de la Recherche Forestière de Rabat, qui a bien voulu co-encadrer
ce travail malgré ces multiples occupations. Ces connaissances, son
soutien et ses remarques pertinentes ont été un plus. Je le
remercie également pour son accueil au laboratoire de chimie relevant du
CRF.
Je tiens à remercier le Pr. SESBOU Abdssadek,
Enseignant chercheur et Directeur de l'ENFI, pour l'honneur qu'il m'a
accordé en acceptant de présider ce jury et pour ses suggestions
constructives. Qu'il trouve ici l'expression de mes meilleurs remerciements.
J'adresse mes remerciements également au Pr.
ZINE EL ABIDINE Abdenbi, Enseignant chercheur à l'ENFI qui m'a
fait l'honneur de bien vouloir accepter d'évaluer ce travail et de
l'enrichir par ses critiques et suggestions constructives. Qu'il trouve ici
l'expression de mes vifs remerciements.
je tiens également à remercier le Dr.
ABERCHANE Mohammed du Centre de la Recherche Forestière de
Rabat, qui a accepté de faire partie des membres du jury et qui a bien
voulu nous faire profiter de son expérience et d'évaluer mon
travail. Qu'il trouve ici mes vifs remerciements.
Je remercie vivement M. ZANTAR Saïd,
Coordinateur de l'Unité de Recherche sur les Techniques
Nucléaires, l'Environnement et la Qualité (INRA) du Centre
Régional de la Recherche Agronomique de Tanger pour l'aide
précieuse qu'il m'a apporté pour les analyses chimiques des
huiles essentielles au sein de leur laboratoire. Qu'il trouve ici l'expression
de ma reconnaissance.
Ma reconnaissance s'adresse aussi à tous mes
professeurs de l'E.N.F.I. qui n'ont ménagé aucun effort pour me
transmettre une partie de leur savoir.
iv
Je remercie vivement M. Bouâddi El houcine,
Président de l'association régionale des éleveurs
de reines d'abeilles du Gharb, pour l'aide précieuse qu'il m'a
apporté pour les enquêtes et le choix du rucher
expérimentale. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.
Je remercie vivement M. Tahiri ben Aissa,
Apiculteur à Nkhakhssa, pour l'aide précieuse qu'il m'a
apporté pour la réalisation des tests aux Huiles essentielles au
sein de son rucher. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.
Mes remerciements sont également adressés
à M. El Haj El Maadoudi, Chef du Service de
Recherche-Développement (INRA) du Centre Régional de la Recherche
Agronomique de Rabat .Ses connaissances et ses remarques pertinentes ont
été un plus. Qu'il trouve dans ces mots ma grande
considération et mon profond respect.
Je tiens à remercier M. EL HARCHAOUI El Hassan
et M. LAMZOUDI Omar, du Centre de la Recherche Forestière
à Rabat qui m'ont accompagné et apporté une aide
précieuse durant mes investigations sur le terrain à Taroudant et
régions.
Je tiens à remercier aussi tous les apiculteurs du
Gharb et de Taroudant pour leur aide
précieuse durant mes investigations sur le terrain.
Je remercie M. SANGARE I., Pour son soutient
infaillible durant la réalisation de ce travail.
Mes vifs remerciements à tous mes collègues
marocain de l'ENFI, notamment Mouna, Hajar, Monsif, Hanane, Ahlam,
Nadia, Olarbi, Omar, Ali bouch, Kadaoui... et tous les autres
élèves-ingénieurs de la 46ème,
45ème , la 44ème et la
43ème promotion.
Mes vifs remerciements à tous les étudiants
« Pays-amis » de l'ENFI, notamment Bagaram M.(Togo), Noumonvi
Dodji (Togo),Orlando (Kenya), Affo Biao ( Togo), Ola Gloria (Bénin),
Len'nah (Togo), S.J. Vanessa(Haïti)... et tous les autres
élèves-ingénieurs de la 46ème,
45ème , la 44ème et la
43ème promotion.
Mots clé : Varroa
destructor, Thymus satureioides, Huiles essentielles, abeille,
bioinsecticide.
v
Résumé
Le Maroc héberge une flore riche constituée de
près de 4200 espèces et une végétation
variée, à endémisme très marqué. Les
espèces à intérêt aromatique et/ou
médicinales (PAM) sont estimées à près de 600
espèces dont un grand nombre sont de même endémiques parmi
lesquels figure thymus satureioides.
Les déclarations empiriques relatant que les colonies
d'abeilles séjournant dans la région de Taroudant (Maroc) sur les
formations de thymus satureioides acquièrent une certaine
immunité contre le Varroa, ont été
confirmées par une enquête réalisée auprès
des apiculteurs et coopératives de la dite région. Partant de
cela, notre travail s'est consacré, d'abord à la
caractérisation chimique des huiles essentielles (HE) de cette
espèce de thym récolté dans de différentes stations
altitudinales dans la dite région. Par la suite, on a
procédé à l'évaluation de l'effet bioacaricide
d'huiles essentielles à différentes compositions chimiques contre
Varroa destructor dans la région du Gharb : région
à grande activité apicole et connaissant des infestations du
parasite. Les essais de traitements ont été conduits en utilisant
des lanières de papier absorbant imbibé d'HE (5 ml) et
disposées entre les cadres des ruches.
La caractérisation chimique des différents
provenances de T. satureioides a permis de mettre en évidence
quatre chémotypes de thym dans la province de Taroudant: Le
chémotype à borneol (94%) de la provenance de Timoulay à
850 m d'altitude, le chémotype à borneol (26,75%) et carvacrol
(21,38%) de la provenance d'Amskrod-Est à 1050 m d'altitude, le
chémotype à borneol (23,39%) et thymol (16,17%) de la provenance
d'Aoulouz à 1020 m d'altitude et le chémotype à borneol
(de 27,49% à 31.07%) et á-terpineol (de 12,57 à 14,97%)
pour les provenances d' Ankrim (320 m), d'Amskrod (1050 m) et d'Oulad Berhil
(1240 m).
Les traitements aux huiles essentielles ont montré un
effet acaricide plus efficace par rapport à un acaricide
homologué (Bayvarol) avec des efficacités variant selon la
composition chimique de l'HE : Bayvarol (83,3%), chémotype borneol
(71,4%), chémotype borneol & thymol (90,9%), chemotype borneol &
carvacrol (92,6%). L'approfondissement des études sur thymus
satureioides permettrait la mise en place d'un bioacaricide
écologique, économique et efficace pour la lutte contre le
varroa.
Keywords: Varroa destructor, Thymus
satureioides, essential oils, bee, bioinsecticide.
vi
Abstract
Morocco is home to a rich flora consisting of nearly 4200
species and of diverse vegetation, with very marked endemism. Species of
aromatic and/or medicinal interestare estimated at about 600, many of which are
endemic including Thymus satureioides.
Statements relating to bee colonies visiting the region of
Taroudant (Morocco) on Thymus satureioides plant formations and
acquiring some immunity against Varroa were confirmed by a survey conducted
among beekeepers and cooperatives in the said region. From this, our work is
devoted to the first chemical characterization of essential oils (EO) of this
species of thyme collected from different altitudinal provenances in the said
region. Subsequently, we evaluated the bioacaricidic effect of essential oils
at various chemical compositions against Varroa destructor in the
Gharb region : a highly beekeeping region familiar with the parasite
infestations. The treatment trials were conducted using strips of absorbent
paper soaked in EO (5 ml) and placed between the hive frames.
The chemical characterization of different origins of T.
satureioides helped highlight four chemotypes of thyme in the province of
Taroudant as follows: borneol chemotype (94%) of Timoulay origin at 850 m above
sea level, borneol (26.75%) and carvacrol (21.38%) of East Amskrod at 1050 m ,
borneol (23.39%) and thymol (16.17%) chemotypes of Aoulouz 1020 m, and borneol
(27.49% to 31.07%) and á-terpineol (12.57 to 14.97%) chemotypes ofAnkrim
(320 m), Amskrod (1050 m) and Oulad Berhil (1240 m) origins.
The essential oils applications showed a more effective
acaricidic effects compared to an approved acaricide (Bayvarol), with varying
efficiencies depending on the chemical composition of EO: Bayvarol (83.3%),
borneol chemotype (71.4%), borneol & thymolchemotype (90.9%), borneol &
carvacrol chemotype (92.6%). Further studies will enable the establishment of
an ecologically, economically efficient bioacaricide to combat varroa.

Õwáã
æ ÉíÑØÚáÇ
ÚÇæäáÇÇ.ÙæÍáã
äØæÊ äã äæßÊí
íÊÇÈä ÚæäÊÈ
ÒíãÊí æ. Úæä 0044
íáÇæÍ äã
Éäæßã ÉíäÛ
ÇÑæá ÈÑÛãá
Ç ãÖí ÈÑÛãáÇ
æå íáÕáÇÇ
åäØæã ÑíÈß
ÏÏÚ ÇåäíÈ äã
Úæä 044 È ÑÏÞÊ
ÉíÈØáÇ s myhT
ÊáÇíßÔÊ ØÓæ
ÉäãÇßáÇ
áÍäáÇ
ÊÇÑãÚÊÓã äÇ
ÉíÈíÑÌÊ áÇ
ÊÇÍíÑÕÊ
ãÚÒÊ.
ÊäÇÏæÑÇÊ
ÉÞØäã í æ
äíáÇÍäáÇ Úã
ÈÇæÌËÓÇ ÑÈÚ
ËÇÍíÑÕËáÇ
åÐå ÏíßÇÊ ãÊ
ÏÞá. ÇæÑÇáÇ
ÏÖ ÉÚÇäã
ÈÓÊßÊ sed oaurutas
ÑËÚÒáÇ äã
ÚæäáÇ ÇÐåá
ÉíÓÇÓáÇÇ
ÊæíÒáá
íÆÇíãíßáÇ
ÕæáÇ ìáÚ
áÇæÇ. áãÚáÇ
ÇÐå ÒßÊÑí.
ÇÐå äã
ÇÞáÇØäÇ.ÊÇíäæÇÚÊá
ÉíÆÇíãíß
ÊÇÈíßÑÊ ÊÇÐ
ÉíÓÇÓáÇÇ
ÊæíÒáÇ
ãííÞÊÈ ÇäãÞ
ãË. ÉÞØäãáÇ
ÓäÈ ÉáÊÎã
ÊÇÚÇÊÑÇ ÊÇÐ
ÊÇåÌ äã
ÐæÎÇãáÇ í
ÚÓÇæ ØÇÔä
ÊÇÐ ÉÞØäã(
ÈÑÛáÇ ÉÞØäã
í tasdo sdro aeoore ÏÖ ÓæÓÊ
ÏÇÖãß
ÇåÑíËÇÊ ËíÍ
äã ÉáÊÎã
aurutasmyhT s sed oá
íÆÇíãíßáÇ
ÕæáÇ
)íáíØáÇ íÔÊ
ÑÚÊ æ áÍäáÇ
ÉíÈÑÊ
áæíäÑæÈáá
ÚæäæãíßáÇ.
ÊäÇÏæÑÇÊ
ÉÞØäã í
ÑÊÚÒáÇ äã
ÊÇíÚæäæãíß
ÚÈÑÇ äííÈÊ
äã äßã ÉáÊÎã
ÊÇåÌ äã
ÑÏÍäãáÇ
áæÑßÇÇßáÇ
æ )% 00.62(
áæíäÑæÈáá
ÚæäæãíßáÇ.ÑÊã
014 ÚÇÊÑÇ ìáÚ
ÉÚÞÇæáÇ
íáæãíÊ ÉåÌ
äã )40%(
|
æ)
|
01.14%(
áæíäÑæÈáá
ÚæäæãíßáÇ
.ÑÊã
|
1424
|
ÚÇÊÑÇ
ìáÚ
ÉÚÞÇæáÇ
|
-ÞÑÔ
ÊæÑßÓãÇ
ÉåÌæ äã
|
)01.10%(
|
|
ìáÇ
|
06.04% äã(
áæíäÑæÈáá
ÚæäæãíßáÇæ
ÑÊã 1404 ÚÇÊÑÇ
ìáÚ ÉÚÞÇæáÇ
ÒæáæÇ ÉåÌæ
äã )
|
10.16%( áæãÊáÇ
|
ÏáÇæÇ æ
ÑÊã 1424
ÊæÑßÓãÇ .ÑÊã
104 ãíÑßäÇ ÉåÌ
äã)10.46% ìáÇ % 10.26 äã(
áæäÈÑÊ
ÇááÇÇæ )11.46%
. ÑÊã 1 004
áíãæÈ
.ÊÇÑÇØáÇÇ
äíÈ ÊÚÖæ .)ãáã
2( ÉíÓÇÓáÇÇ
ÊæíÒáÇÈ
ÉÚæÞäã ÉÕÇã
ÉíÞÑæ ÉãÒÍÇ
áÇãÚÊÓÇÈ
ÌáÇÚáÇ
ÈÑÇÌÊ
ÊíÑÌÇ
ÞíæÓÊáá
ÍÑÕãáÇ
ÓæÓÊáÇ ÏÇÖã
Úã ÉäÑÇÞã
ÓæÓÊáá ÏÇÖã
áÇÚ íæíÍ
ÑíËÇÊ ÏæÌæ
ÊÏßÇ
ÈÑÇÌÊáÇ åÐå
ÉíÓÇ
ÓáÇÇ
ÉÈíßÑÊáÇ
ÈÓÍ áÊÎÊ
ÊÇÁÇß Úã lehaeorB
Úæäæãíß.) 44.4%(
áæãÊá Çæ
áæíäÑæÈáá
Úæäæãíß .) 61.0%(
áæíäÑæÈáá
Úæäæãíß lehaeorB) 01.12%(
. )%00.0(
áæÑßÇÇßáÇ æ
áæíäÑæÈáá
.ÇæÑÇáÇ
ìáÚ ÁÇÖÞáÇ
áÌÇ äã
ÇíÏÇÕÊÞÇ æ
ÇíÌæáæßíÇ
áÇÚ ÓæÓÊ
ÏÇÖã ìáÇ
áÕæÊáá
ÊÇÓÇÑÏáÇ
ÞíãÚÊÈ íÕæä
ÏÇÖã ,
ÉíÓÇÓáÇÇÇ
ÊæíÒáÇ , áÍäá
, Varroa destructor, Thymus satureioides ,
:ÉíÑæÍãáÇ
ÊÇãáßáÇ
. ÓæÓÊ
viii
Table des matières
Dédicaces ii
Remerciements iii
Résumé v
Abstract vi
ÕÎáã vii
Table des matières: viii
Liste des Tableaux xi
Liste des figures xii
Liste des Abréviations xiv
Introduction Générale 1
Partie 1 : Synthèse bibliographique 5
Chapitre 1.Généralités sur les
plantes aromatiques et médicinales 6
1.1. Historique 6
1.2. Utilisation des plantes aromatiques et médicinales
6
1.2.1. Les plantes médicinales 7
1.2.2. Les plantes aromatiques 7
1.2.3. Les plantes à parfum 7
1.3. Les huiles essentielles 8
1.3.1. Définition 8
1.3.2. Rôle des huiles essentielles dans la plante 9
1.3.3. Facteurs de variabilité des HE 10
1.3.4. Domaines d'utilisation des HE 12
Chapitre 2. Le thym doux du Maroc « Thymus
satureioides Cosson & Balansa» 13
2.1. Botanique 13
2.2. Place dans la systématique 14
2.3. Répartition biogéographique et écologie
14
2.4. Importance socio-économique de T. satureioides
15
2.5. Propriétés et vertus du thymus
satureioides 16
2.6. Composition chimique 16
Chapitre 3. Le Varroa, parasite redoutable des
abeilles 18
3.1. Le déclin des populations d'abeilles à travers
le monde 18
3.2. Historique de la varroase 20
3.3. Description biologique des phases de développement du
Varroa destructeur 22
3.4. Ontogenèse du Varroa destructor 24
3.4.1. Processus d'infestation 24
3.4.2. La fécondation 25
ix
3.4.3. Emergence de la jeune abeille 25
3.4.4. Concordance phénologique cycle Varroa/cycle abeille
(récapitulation) 26
3.5. Dynamique des populations de V. destructor au sein
de la colonie 28
3.6. Expression de la varroase 30
3.6.1. Au niveau de l'individu 30
3.6.2. Au niveau de la colonie 32
Partie 2: Matériel et méthodes
33
2.1. Présentation de la zone d'étude
34
2.1.1. Situation géographique 34
2.1.2. Relief et climat 34
2.1.3. Données sur le secteur forestier 35
2.1.4. Organisations professionnelles 37
2.2. Approche méthodologique 38
2.2.1. Enquête de confirmation auprès des
apiculteurs de la région de Taroudant et
entretien avec les apiculteurs du Gharb 38
2.2.2. Collecte de Thymus satureioides au niveau de
différentes provenances dans
la province de Taroudant 39
2.2.3. Distillation de T. satureioides
récolté dans la province de Taroudant 41
2.2.4. Détermination du rendement en HE 41
2.2.5. Caractérisation chimique des HE de T.
satureioides 41
2.2.6. Evaluation du taux d'infestation du Varroa dans
le Gharb 42
2.2.6.1. Echantillonnage des Varroas phorétiques
42
2.2.6.2. Suivi des chutes naturelles de Varroas «
méthode de pose de langes » .... .43
2.2.6.3. Comptage des Varroas piégés dans
le couvain mâle 44
2.2.7. Essais de traitements aux huiles essentielles de
Thymus satureioides 46
2.2.8. Traitement des données 47
Partie 3 : Résultats et discussions 48
3.1. Typologie de l'apiculture et modalités de
l'infestation par le Varroa 49
3.1.1. Typologie de l'apiculture et modalités de
l'infestation par le Varroa dans la
province de Taroudant 49
3.1.1.1. Pratique apicole 49
3.1.1.2. Etat sanitaire de l'abeille pendant la période
d'installation du rucher au
niveau des populations de Thymus satureioides 54
3.1.2. Typologie de l'apiculture dans la région du Gharb:
calendrier apicole et cycle
de l'abeille 58
3.1.2.1. Critères utilisés pour le choix de
l'emplacement du rucher 58
3.1.2.2. Disposition et gestion du rucher 58
3.1.2.3. Calendrier apicole 59
x
3.1.3. Synthèse 62
3.2. Caractérisation chimique des huiles essentielles de
Thymus satureioides 64
3.2.1. Rendement en huiles essentielles 64
3.2.2. Composition chimique des HE de Thymus satureioides
65
3.2.2.1. Propriétés chimiques des Provenances 65
3.2.2.2. Les chémotypes de T. satureioides 70
3.2.3. Conclusion 73
3.3. Evaluation de l'infestation au rucher 73
3.3.1. Taux d'infestation évalué par
échantillonnage des Varroas phorétiques
(effectifs de Varroas/effectifs d'abeilles) 73
3.3.2. Taux d'infestation évalué par le suivi des
chutes naturelles de Varroas
« méthode pose des langes » 74
3.4. Evaluation du taux d'infestation « du couvain
mâle » au laboratoire 74
3.5. Evaluation des potentialités acaricides des HE de
T. satureioides 75
Conclusion générale 78
Références bibliographiques 80
Annexes 93
xi
Liste des Tableaux
Tableau 1. Composition chimique des huiles
essentielles de Thymus satureioides de
différentes provenances du Maroc 17
Tableau 2.
Causes suspectées dans le déclenchement du syndrome
d'effondrement des
colonies d'Apis mellifera à travers le monde
19
Tableau 3. Principales essences
forestières dans la province du Taroudant 36
Tableau 4. Quelques productions
forestières dans la province du Taroudant 36
Tableau 5. Répartition des
coopératives agricoles dans la province du Taroudant 37
Tableau 6. Dispositif expérimental 46
Tableau 7.Calendrier apicole et transhumance
dans le Gharb 60
Tableau 8. Rendement en HE des
différentes provenances de Thymus satureioides 64
Tableau 9. Principaux composés chimiques
des HE des différentes provenances de
Thymus satureioides 66
Tableau 10. Taux d'infestation du couvain
mâle (varroas dans les alvéoles) 74
Tableau 11. Résultat des essais de
traitements contre le Varroa 77
xii
Liste des figures
Figure 1. Illustration schématique du
développement des glandes productrices d'huile
essentielle 9
Figure 2. Thymus satureioides C.&B.
13
Figure 3. Pertes mondiales estimées dues
à V. destructor 19
Figure 4. Répartition géographique
de Varroa destructor 21
Figure 5. Vue dorsale (à gauche) et
ventrale ( à droite) d'une femelle adulte V.
destructor 23
Figure 6. Composition
normale d'une famille V. destructor observée dans une
alvéole
de couvain d'ouvrières approximativement 11 jours
après l'operculation. 23
Figure 7. Processus
d'entrée de la fondatrice V. destructor dans la cellule de
couvain(Vandame, 1996). 24
Figure 8. Cycle de reproduction de Varroa
destructor 26
Figure 9. Evolution des effectifs de V.
destructor en fonction de l'état de la colonie
d'abeilles et des saisons 27
Figure 10.
Modélisation du niveau d'infestation par l'acarien V.
jacobsoni des abeilles
adultes et du couvain au cours d'une année
28
Figure 11. Modélisation de la dynamique de
population de Varroa destructor au cours
d'une année 29
Figure 12. Carte montrant la localisation de la
zone d'étude. 34
Figure 13. La carte géographique de la
province du Taroudant 35
Figure 14. Carte montrant l'emplacement des
stations de récolte des échantillons de
thymus satureioides dans le Sud-ouest Marocain.
40
Figure 15. Abeilles adultes immergées dans de
l'alcool et double tamis pour séparer les
abeilles des Varroas 43
Figure 16. Insertion d'un lange graissé
à la margarine au fond d'une ruche 44
Figure 17. Couvain mâle
désoperculé au laboratoire de l'ENFI 45
Figure 18. Huiles essentielles ( à
gauche) et Bayvarol ( à droite) testé au rucher
d'Nkharkhssa (Kénitra) 46
Figure 19.
Bandelette en papier absorbant imbibée d'huile essentielle (5
ml) et installée
entre les cadres de la ruche. 47
Figure 20. Spectre de masse du carvacrol de
thymus satureioides 68
Figure 21. Spectre de masse du thymol thymus
satureioides 68
Figure 22. Spectre de masse du borneol
thymus satureioides 69
Figure 23. Spectre de masse de l'
á-terpineol thymus satureioides 70
Figure 24. Variation de la teneur en borneol
selon les provenances 70
Figure 25. Efficacités des traitements
aux HE et du Bayvarol contre varroa destructor
après un jour 76
xiii
Liste des Annexes
Annexe 1. Fiche enquête : Etude du Varroa
des abeilles 94
Annexe 2. Fichier Excel de l'enquête 99
Annexe 3. Chromatogrammes des HE de
différentes provenances de Thymus
satureioides 100
Annexe 4. La lutte contre le Varroa
destructor 101
A. Le Piégeage 101
B. La thermothérapie 102
C. L'usage de produits anti-adhésifs 102
D. L'électricité 103
E. Sélection d'abeilles tolérantes ou
résistantes à Varroa jacobsoni 103
F. La lutte biologique 103
G. L'utilisation de la roténone 104
H. L'aromathérapie 104
I. L'utilisation de répulsifs 106
J. Lutte par traitements acaricides 106
K. Mise en oeuvre de la lutte 108
xiv
Liste des Abréviations
A. mellifera : Apis
mellifera
CRF : Centre de Recherche Forestière
DREF : Direction Régionale des eaux et
forets
DPEFLCD : Direction Provinciale des Eaux et
Forêts et à la Lutte contre la
Désertification
ENFI : Ecole Nationale Forestière
d'Ingénieurs
HCEFLCD : Haut-commissariat des Eaux et
Forêts et à la Lutte contre la
Désertification
HE : Huile Essentielle
IAV : Institue Agronomique et
Vétérinaire Hassan II
INRA : Institue National de la Recherche
Agronomique
PAM : Plantes Aromatiques et
Médicinales
V.destructor : Varroa
destructor
1
Introduction Générale
De par ses contrastes géographiques offrant une gamme
variée de bioclimats méditerranéens, le Maroc
héberge une flore riche constituée de près de 4200
espèces et une végétation variée, à
endémisme très marqué. Les espèces à
intérêt aromatique et/ou médicinales (PAM) sont
estimées à près de 600 espèces dont un grand nombre
sont de même endémiques (Benabid, 2000). En outre, vu les
conditions écologiques du pays, en comparaison avec les mêmes
espèces produites dans les pays voisins, les PAM du Maroc se distinguent
par leur haute teneur en essences et des caractéristiques chimiques
variables (Gnanmi et al.2010)
Ces plantes médicinales et aromatiques demeurent une
source considérable de substances biologiquement actives et
possèdent des potentialités biologiques très
intéressantes et exploitables dans divers domaines : médecine,
pharmacie, agriculture, apiculture, ... (Beylier-Maurel, 1976 ; Valnet et
al.1978 ; Beraoud, 1990; Gnanmi et al.2010) et le Maroc
dispose d'un savoir-faire ancestral, qui a été
préservé au cours des siècles: la médication par
les plantes ainsi que pour l'extraction des principes actifs notamment
aromatiques.
Par ailleurs, sur les 600 espèces de PAM
potentiellement exploitables au Maroc, une dizaine l'est effectivement comme le
romarin, le thym, la camomille, l'armoise, l'origan, la menthe pouliot, le
laurier sauce, le lichen, le pyrèthre et le myrthe. Ainsi, plus d'une
vingtaine d'espèces sont utilisées pour la production d'huiles
essentielles ou d'autres extraits aromatiques destinés essentiellement
à l'industrie de parfumerie et cosmétique ainsi que pour la
préparation des produits d'hygiène et la formulation des
arômes (Gnanmi et al.2010).
Les huiles essentielles sont, par définition, des
métabolites secondaires produits par les plantes comme moyen de
défense contre les ravageurs phytophages (Kaufman et al. 1999).
Ces extraits contiennent en moyenne 20 à 60 composés qui sont
pour la plupart des molécules peu complexes, soit des
monoterpènes avec leurs phénols reliés, et des
terpènes plus complexes, dont les sesquiterpènes. Les
biopesticides à base d'huiles essentielles présentent plusieurs
caractéristiques d'intérêt. Plusieurs sont aussi efficaces
que les produits de synthèse. Ils ont en général une
efficacité à large spectre, mais avec
2
une spécificité pour certaines classes ou ordres
d'insectes et une rémanence courte (Kaufman et al. 1999)
Au Maroc, le genre Thymus est
représenté par 21 espèces dont 12 sont endémiques;
On peut citer entre autre le thym de Brussonnet (Thymus satureioides)
et le thym du Maroc (Thymus maroccanus). Les formations naturelles
à base de thym sont importantes dans le Haut Atlas central et
occidental, dans les associations steppiques à arganier, les groupements
pré-forestiers à thuya, à chêne vert ou à
genévrier rouge (Benabid, 2000).
Utilisée dans l'industrie pharmaceutique et
parapharmaceutique (crèmes, savons, dentifrices..) ainsi que pour la
fabrication de parfums, l'huile essentielle de thym est produite dans le monde
entier; l'Espagne et le Maroc figurent parmi les principaux producteurs et la
teneur en huile est de l'ordre de 2 à 5 % de la masse
végétale sèche (Ghanmi et al. 2010). L'huile de
thym contient plusieurs principes actifs dont le thymol, antiseptique majeur,
est le plus important. Ce dernier est actuellement utilisé dans beaucoup
de pays pour la formulation des acaricides commerciales contre la varroase des
abeilles domestiques (APILIFE VAR, APIGUARD,...) et dont l'intérêt
réside dans le respect du miel. Cette valorisation des HE de thymus
satureioides n'est pas encore developper au Maroc.
Le Varroa destructor, parasite des abeilles, est
devenu depuis les années 80, le ravageur principal des ruchers. Le monde
scientifique s'accorde à peu près pour dire qu'il est une des
causes majeures des affaiblissements et des pertes auxquels sont
confrontés les apiculteurs, et cela en combinaison avec d'autres stress
(Anderson et Trueman, 2000).
Afin de répondre à la problématique de la
varroase, plusieurs études ont été menées de part
le monde pour extraire et tester des substances naturelles contre le parasite
des colonies d'abeilles domestiques (Anderson et Trueman, 2000). Le
développement d'infestations massives du parasite avait, en effet,
suscité une utilisation abondante d'insecticides chimiques qui a fini
par contaminer les productions de miel sans pouvoir acquérir une
efficacité et une maîtrise du problème.
Le Maroc, qui a connu l'introduction du Varroa en
1989, connait la même problématique. Les apiculteurs utilisent
différentes méthodes pour lutter contre le parasite (lutte
à base de produits chimiques, bioinsecticides, méthodes
traditionnelles,
3
....) en attendant de disposer de moyens efficaces et
respectueux de l'environnement pour contrôler voire
éradiqué le Varroa et ses pathologies
associées.
Dans ce contexte, le fait reconnu et reporté que les
colonies d'abeilles séjournant dans le sud ouest marocain sur les
formations de Thymus satureioides acquièrent une certaine
immunité contre le Varroa, nous a amené à
conduire cette étude qui se préoccupe d'abord de la
caractérisation chimique des huiles essentielles de cette espèce
de thym à partir de différentes provenances altitudinales dans
cette région du pays et ensuite de les tester dans la lutte contre le
Varroa. Le T. satureioides s'avère présenter
une composition chimique particulière et variable notamment riche en
borneol (Richard et al. 1985; Mebarki, 2010), qui mériterait
d'être tester comme bioinsecticide contre le Varroa à
l'instar du thymol.
Le présent travail est réalisé dans le
cadre d'une collaboration entre l'Ecole Nationale Forestière
d'Ingénieurs, le Centre de Recherche Forestière (Haut
Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la
Désertification) et l'Institut National de la Recherche Agronomique.
L'intérêt de ce travail est double :
? d'un point de vue appliqué, nous nous sommes
proposé d'étudier la composition chimique des huiles essentielles
de Thymus satureoiedes, espèce endémique et de grande
importance parmi les PAM du Maroc. L'étude prend en compte l'aspect
écologique (gradient altitudinale, continentalité,...) et la
variabilité chimique, il contribue donc pleinement à la
démarche de diversification de la gamme de caractérisation des
huiles essentielles.
? d'un point de vue valorisation, notre travail s'inscrit dans
une démarche exploratoire pour mettre en évidence les
potentialités acaricides des huiles essentielles de T.
satureioides et particulièrement selon leurs compositions en
principe actives. Il constitue une contribution visant à mettre en
oeuvre un moyen de lutte alternative (bioinsecticide) contre le
Varroa. Par ailleurs, la diversification de la production d'huiles
essentielles (chémotypées) ne peut être envisagée
que si la caractérisation est réalisée et celle-ci passe
par la connaissance de la composition chimique et des lieux de
récolte.
4
Les objectifs spécifiques assignés à
cette étude sont :
? Réaliser une enquête (de confirmation)
auprès des apiculteurs de la région de Taroudant, relative aux
modalités de manifestation de l'infestation par le Varroa.
? Caractériser les huiles essentielles de Thymus
satureioides de différentes provenances altitudinales dans la
province de Taroudant (sud-ouest marocain),
? Evaluer l'infestation par le varroa dans les ruchers du
Gharb (région à infestation importante par le Varroa)
? Réaliser dans la région du Gharb des tests
d'efficacité de traitements à base d'huiles essentielles
extraites et caractérisées de Thymus satureioides
5
Partie 1 : Synthèse bibliographique
6
Chapitre 1. Généralités sur les
plantes aromatiques et médicinales
1.1. Historique
L'histoire des plantes aromatiques et médicinales est
souvent liée à celle de l'humanité puisque
déjà dans l'Egypte antique (environ 4500 av. J.C)
l'homme utilisait largement les onguents parfumés, les résines
aromatiques, les épices et les végétaux odorants. La
civilisation du Nil a transmis au travers des gravures sur la pierre de ses
monuments toute une iconographie des procédés de
préparation des huiles, des baumes et des liqueurs fermentées.
Les Romains furent les maîtres incontestés dans l'art de
l'extraction et de la conservation des arômes par macération de
l'aromate dans un corps gras. Les découvertes archéologiques
attestent de ces pratiques (Figueredo, 2007).
Les anciennes civilisations se servaient des plantes
aromatiques et médicinales dans un but cosmétologique et
thérapeutique. Toutefois, ce sont les Grecs et les Arabes qui ont
développés l'utilisation des plantes en médecine. Le
développement industriel de la distillation par les Arabes fut le
premier pas de la production moderne des essences volatiles. Avicenne,
médecin et philosophe (980-1037), produit la première huile
essentielle pure, une huile essentielle de roses, extraite de Rosa
centifolia. Pour cela, il met au point un alambic. La distillation par la
vapeur d'eau autorisait l'extraction d'huiles essentielles pures de très
nombreuses plantes (Zhiri, 2006).
Avec les progrès de la chimie, l'extraction des
essences devient plus rationnelle et dès le XIXème
siècle, l'industrie proprement dite des arômes à usage
alimentaire voit le jour. Elle connaît un essor remarquable
parallèlement à celui des parfums, bénéficiant des
nombreux progrès techniques qui se développent. Actuellement, le
champ d'utilisation des plantes aromatiques et médicinales est devenu
encore plus large (Paris et Moyse, 1971).
1.2. Utilisation des plantes aromatiques et
médicinales
Ces plantes sont utilisées, soit pour l'extraction des
huiles essentielles, soit pour l'extraction de molécules
particulières recherchées par l'industrie pharmaceutique, soit
comme aromatisant dans l'industrie alimentaire. Ainsi, trois catégories
de plantes sont distinguées selon leurs utilisations : les plantes
médicinales, les plantes aromatiques et les plantes à parfum.
Les huiles essentielles sont sécrétées
par les cellules glandulaires à huiles situées dans
différentes parties de la plante. Elles sont extraites à partir
des feuilles (romarin et
7
1.2.1. Les plantes médicinales
Les plantes médicinales peuvent être
divisées en deux classes distinctes selon leur utilisation :
- Les plantes médicinales utilisées dans la
médecine allopathique classique. Ce sont des espèces
végétales qui produisent certaines molécules très
recherchées par l'industrie pharmaceutique, tel que le taxolère
extrait des feuilles de l'if commun qui est utilisé contre le
cancer de la gorge et de l'ovaire. La colchicine qui est extraite à
partir de la colchique; est utilisée pour ses propriétés
anti-inflammatoire, et la khilline extraite des fruits de l'Ammi visnaga
; est utilisée contre l'asthme bronchique, la coqueluche et pour le
traitement de l'angine de poitrine (Fechtal, 2000).
- Les plantes utilisées dans la phytothérapie.
Elles sont utilisées sous forme de recettes traditionnelles ou des
préparations pharmaceutiques (extraits aqueux ou alcoolique, infusion ou
poudre, gélules, etc.). Ce type d'utilisation a été
développé grâce à la médecine traditionnelle
et à la médecine moderne (A.M.I., 1995).
1.2.2. Les plantes aromatiques
Les plantes aromatiques sont utilisées, comme
épices (safran, cumin, poivre, etc.) et leurs huiles essentielles comme
aromatisants (agrumes, rose, etc.), dans l'industrie agro-alimentaire en
boulangerie, confiserie, fromagerie, pâtisserie, charcuterie et dans
diverses préparations alimentaires. En outre, les huiles essentielles de
certaines plantes aromatiques sont également utilisées comme
aromatisant dans la formulation de certaines préparations
pharmaceutiques (Ismaili, 2000).
1.2.3. Les plantes à parfum
Ce sont des plantes utilisées pour l'extraction des
essences volatiles. Celles-ci sont des huiles essentielles constituées
de mélanges complexes de composés organiques. Leur valeur
commerciale dépend souvent de la présence de molécules
recherchées pour une utilisation donnée (Lachance, 1977).
8
myrte), des fleurs (rose et jasmin), des fruits (agrumes), des
graines (coriandre), de l'écorce (cassis), des racines (iris) et du bois
(cèdre, thuya, santal).
Les essences aromatiques des plantes à parfum sont
destinées à l'industrie de parfums grand consommateur des huiles
essentielles, et des détergents (gels de bain, savons, shampooings,
lotions, crèmes diverses, déodorants d'ambiance, etc.). Parmi les
plantes aromatiques marocaines destinées à ce secteur, nous avons
les plantes spontanées telles que le romarin, l'armoise, la menthe
pouliot, le myrte
etc. et les plantes de culture, telles que
les citrus, la rose, le jasmin et le géranium (Fechtal, 1999).
1.3. Les huiles essentielles 1.3.1. Définition
La synthèse et l'accumulation des huiles essentielles
sont généralement associées à la présence de
structures histologiques spécialisées, souvent localisées
sur ou à proximité de la surface de la plante (Brunetton, 2008) :
cellules à huiles essentielles des Lauraceae ou des
Zingiberaceae, poils sécréteurs des Lamiaceae,
poches sécrétrices des Myrtaceae ou des
Rutaceae, canaux sécréteurs des Apiaceae ou des
Asteraceae.
Provenance des huiles essentielles en fonction des
différentes parties de plantes :
- feuilles : romarin, sauge, niaouli,
eucalyptus, ...
- tiges : citronnelle, ...
- écorces : cannelier, ...
- racines : angélique, calamus, ...
- rhizomes : gingembre, vétiver, iris,
valériane,...
- bulbes : oignons, ...
- bois : santal, bois de rose, camphrier,
cèdre,...
- péricarpes de fruits : orange, citron,
mandarine, ...
- fleurs : jasmin, rose, ylang-ylang, camomille,
...
- fruits : aneth, céleri, carvi, fenouil,
coriandre, ...
Selon la pharmacopée Européenne
7ème édition (2010), L'huile essentielle est
définie comme étant un « Produit odorant,
généralement de composition complexe, obtenu à partir
d'une matière première végétale botaniquement
définie, soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par
distillation sèche, soit par un procédé mécanique
approprié sans
9
chauffage. Une huile essentielle est le plus souvent
séparée de la phase aqueuse par un procédé physique
n'entraînant pas de changement significatif de sa composition».
Cette définition spécifique est restrictive dans
la mesure où elle exclut les huiles essentielles obtenues par extraction
à l'aide de solvant et celles obtenues par tout autre
procédé (gaz sous pression, enfleurage), bien que ceux-ci
occupent une place importante sur les marchés de la parfumerie, de la
cosmétique, de la pharmacie ainsi que dans de nombreux secteurs de
l'industrie.
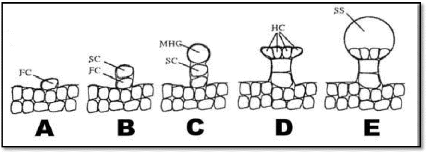
Figure 1. Illustration schématique du
développement des glandes productrices d'huile essentielle
(Gaspar et Jeeke, 2004).
- A et B : différenciation, à partir d'une cellule
épidermique des cellules constitutives du pied.
- C : division des cellules constituant le pied pour former la
cellule mère de tête.
- D et E : division de la cellule mère de tête et
formation de la glande sécrétrice.
1.3.2. Rôle des huiles essentielles dans la
plante
Différentes suppositions ont été
avancées sur le rôle des huiles essentielles pour les plantes.
Nous nous contenterons d'en énumérer quelques-unes :
- D'après Verschaffelt et Stahl (1915)
(in Figueredo, 2007), les huiles essentielles constituent un moyen de
défense contre les microorganismes pathogènes, les champignons,
les insectes et les herbivores en modulant les comportements de ceux-ci
vis-à-vis des plantes.
- Lutz (1940) estime que les constituants des
huiles essentielles sont des modérateurs des réactions
d'oxydation intramoléculaire protégeant la plante contre les
agents atmosphériques. Cette théorie suppose que certains de ces
composés se comporteraient aussi comme source d'énergie à
la suite d'une baisse de l'assimilation chlorophyllienne.
10
- Nicholas (1973) considère que les
monoterpènes et sesquiterpènes jouent des rôles aussi
variés qu'importants dans la relation des plantes avec leur
environnement. Ces travaux ont montré que, par exemple, le
1,8-cinéole et le camphre inhibent la germination des organes
infectés ou la croissance des agents pathogènes issus de ces
organes.
- Enfin, Croteau (1986) a montré que
les huiles essentielles auraient un rôle de mobilisateur d'énergie
lumineuse et de régulateur thermique au profit de la plante. Ces
essences volatiles réguleraient la transpiration diurne en absorbant les
rayons ultraviolets par leurs constituants insaturés. La présence
et la teneur en huiles essentielles dans les plantes seraient donc en rapport
avec la photochimie.
Outre ces aspects, les HE contribuent à
l'équilibre des écosystèmes, attirent les abeilles et des
insectes responsables de la pollinisation (Kurt, 1983).
1.3.3. Facteurs de variabilité des HE
Divers recherches sur les huiles essentielles ont
montré que la composition chimique de celles-ci est très
fluctuante (Ghanmi et al. 2010). En effet, elle dépend d'un
grand nombre de facteurs d'ordre naturel (génétique,
localisation, stade végétatif, sol, climat, etc. ...). Il y a
d'autres facteurs qui sont liés à la durée de distillation
et la méthode utilisée pour l'extraction des huiles essentielles.
Ces deux derniers facteurs dépendent de la nature du matériel
à distiller. Dans cette présentation on se limitera
essentiellement aux facteurs liés à la plante et son
environnement.
- Diversité selon l'organe
végétal
Chez une même espèce, il arrive que la
composition chimique de l'huile essentielle diffère d'un organe de la
plante à un autre. Guignard (1983) souligne que l'écorce de la
cannelle (Cinnamomum zeylanicum B.) fournit un extrait où
l'aldéhyde cinnamique est majoritaire. Les feuilles donnent une huile
riche en eugénol, tandis que le camphre prédomine dans l'essence
des racines.
- Influence de la période de récolte, du
climat et du sol
La teneur des différents constituants de l'huile
essentielle d'une espèce donnée peut varier au cours de son
développement et de son stage végétatif. Par exemple, chez
Coriandrum sativum L., le fruit mûr contient 50% plus de linalol
que le fruit vert (Crouteau, 1988).
11
Gauthier et al. (1988) ont constaté que la
composition chimique de trois provenances de myrte marocaines varie en fonction
du stade végétatif. L'a-pinène et le 1,8-cineol augmentent
en début du cycle de végétation. Puis, à partir de
la floraison, l'a-pinène diminue fortement et le 1,8-cineol continue
à augmenter pour subir une légère diminution en fin de
végétation.
Bruneton (1987) a constaté que la menthe poivrée
récoltée en début de floraison a une huile essentielle
riche en néomenthol et en menthone tandis qu'en fin de floraison cette
huile est riche en menthol.
D'après Fluck (1963), le climat et le sol ont une
influence plus importante pour les espèces végétales dont
l'organe sécréteur d'huile essentielle se situe au niveau des
poils glandulaires (Lamiaceae, Verbenaceae,
Geraniaceae, Rutaceae) que pour celles dont l'huile est
produite dans les formations schizogènes des feuilles, calices ou tiges
(Lauraceae, Asteraceae).
- Existence de variétés chimiques ou
chémotypes
Au sein d'une même espèce la composition chimique
de l'huile essentielle peut être différente: on parle alors de
races chimiques ou de chémotypes. Il s'agit d'un polymorphisme chimique.
Une espèce peut être homogène au niveau de son caryotype et
produire des huiles essentielles de compositions différentes. Le cas du
thym (Thymus vulgaris L.) avec ses 7 chémotypes est sans doute
le plus connu (Duval, 2012), on peut aussi citer le cas de l'Ocimum
gratissimum L., qui peut présenter 5 chémotypes:
eugénol, méthyl-eugénol, linalol, b-caryophyllène,
et géraniol (Charles et Simon, 1992).
Au Maroc, Fechtal et al. (2001) mentionnent deux
races chimiques de romarin, celle de la région rifaine est riche en
a-pinène, avec une teneur variant entre 33,1 et 50% alors que celle de
la région orientale est riche en 1,8-cineole dont la teneur varie entre
41 et 63%.
Le Lippia multiflora récoltée au Togo a
révélé les chémotypes à citral, à
thymol (acétate de thymyle), à para-cymène et à 1-8
cinéole (Inouye et Abe, 2003).
Enfin, Charchari et Boutekedjret (1994) ont
démontré que le rendement en huile essentielle et la teneur en
principaux constituants de l'Artemisia herba-alba assa
récoltée en Algérie diffèrent selon le lieu de
végétation de la plante. Ils observent deux chémotypes
suivant la région de récolte: le type à a-thuyone
caractérisant l'huile essentielle de la plante provenant de
Ghardaïa et celui à a-thuyone-camphre et
12
chrysanthénone caractérisant celle de la plante
récoltée à Biskra, à Bordj Bou Arreridj et à
Laghouat.
1.3.4. Domaines d'utilisation des HE
Les huiles essentielles, grâce à leur
concentration en principes actifs bien diversifiés, possèdent des
activités antiseptiques, bactéricides, antifongiques,
antivirales, antimitotiques, hormonales, antirhumatismales, circulatoires,
antidiabétiques, immunostimulantes, hyper ou hypotensives, tonifiantes,
antispasmodiques, antioxydantes, bio-insecticide, et bien d'autres. Elles sont
utilisés dans de nombreux domaines aussi diverses que les produits de
toilette ou la parfumerie, la cosmétique, la pharmacie, la
phytothérapie, l'aromathérapie, l'industrie bio-insecticide et
l'agro-alimentaire (Beylier-Maurel, 1976 ; Valnet et al. 1978;
Beraoud, 1990; Zhiri, 2006; Figueredo, 2007).
On les utilise aussi dans la fabrication des adhésifs
(colle, scotch ...), dans l'industrie automobile et pour aromatiser les
gâteaux, biscuits, soupe, sauce, chewing gum, chocolats, bonbon, etc.
Différents travaux ont mis en évidence l'action
bio-insecticide des huiles essentielles contre les insectes nuisibles
(Obeng-Ofori et Reichmuth 1997; Prates et al. 1998; Huang et al.
2002; Park et al. 2003). Tous ces auteurs sont arrivés
à la même conclusion sur la toxicité des composés
des huiles essentielles. Toutefois, l'effet bio-insecticide des HE sur les
insectes n'est pas systématique car des réponses
différentes ont été observées selon l'espèce
d'insecte et d'huile essentielle.
L'utilisation des huiles essentielles comme bio-insecticide
offre de nouvelles possibilités de leurs utilisations.
L'efficacité des huiles essentielles en tant que bio-insecticides reste
de nos jours la préoccupation de nombreux chercheurs à travers le
monde entier.
13
Chapitre 2. Le thym doux du Maroc « Thymus
satureioides Cosson &
Balansa»
2.1. Botanique
Le thym saturéioïde ou thym à feuilles de
sarriette ou Thymus satureioides est une plante endémique du
Maroc occidental, elle appartient à la famille des Lamiacées
(Benabid, 2000). Son nom en arabe est Zaetra et en berbère
Azoukenni.

Figure 2. Thymus satureioides
C.&B.(Gayda A., 2013)
C'est un arbuste vert touffu pouvant atteindre 60 cm de
hauteur. Ses feuilles sont opposées, linéaires, enroulées
sur les bords, grisâtres sur le dessus, tomenteuses sur le dessous; ses
fleurs sont groupées en glomérules ovoïdes et à
corolle bilabiée rosée.
14
2.2. Place dans la systématique
La systématique de thymus satureioides se
présente comme suit :
Embranchement : Spermaphytes
Sous-embranchement : Angiospermes
Classe : Dicotylédones
Sous-classe : Gamopétales
Série : Superovariées tétracycliques
Super ordre : Tubiflorales
Ordre : Lamiales
Famille : Lamiaceae
Genre : Thymus
Espèce : satureioides
La famille des Lamiaceae comprend 187 genres et 3 000
espèces. Elle est la plus homogène de la sous classe des
Gamopétales, et la plupart des Genres sont riches en huiles essentielles
(Atlan M., 1987). L'ancien nom des Lamiaceae, Labiées
dérive du nom latin "labium" qui signifie lèvre, en
raison de la forme particulière des corolles.
Le genre Thymus comporte plus de 300 espèces,
c'est un arbuste odorant qui pousse spontanément dans le vieux
continent, dans la région Macaronisienne (les Canaries, les
Açores et le Madère), dans le Nord de l'Afrique (le Maroc,
l'Algérie, la Tunisie et la Libye), dans la péninsule de
Sinaï (l'Egypte), dans la péninsule Ibérique (l'Espagne)
ainsi qu'en Sibérie et en Europe Nordique. Cependant, la plupart des
espèces se concentrent dans le pourtour du bassin
Méditerranéen (Pedersen, 2000).Au Maroc, le thym est
représenté par 21 espèces dont 12 sont endémiques
(Benabid, 2000).
2.3. Répartition biogéographique et
écologie
Le thymus satureioides est endémique du Maroc.
Géographiquement on le retrouve dans la série
Inframéditerranéen et
Mésoméditérranéen, au niveau des clairières
des forêts, des broussailles, des matorrals et au niveau des basses et
moyennes montagnes jusqu'à des altitudes de 2200m. Le thymus
satureioides se développe sur substrat calcaire siliceux et sols
rocailleux à moyennement terreux mais bien drainés dans le Haut
Atlas et Anti-Atlas. Sur le plan climatique thymus satureioides se
situe dans le bioclimat aride à subhumide, à variante chaude et
fraîche (Benabid, 2000).
15
Thymus satureioides Cosson et Balansa
succède à Thymus leptobotrys Murbeck quand 1'altitude
s'élève. On le rencontre donc dans le Haut-Atlas entre 950 et
1600 m d'altitude et s'associe à Chamaerops humilis L., Cistus
villosus L., Lavandula dentata L. et Pistacia lentiscus L. Dans
les Ida-ou-Tanane, il s'étale entre 350 et 1100 m et accompagne
fidèlement du thuya. Dans 1'Anti-Atlas entre 1300 et 2000m et forme avec
l'armoise blanche et Cistus villosus L. des groupements de
dégradation (Peltier, 1983).
De nos jours, le thym est à l'état
dégradé car il subit beaucoup de pression de la part de la
population. Il est très pâturé et brouté par le
bétail, ce qui lui confère un aspect rabougri et chétif.
Des mesures devraient être prises pour sensibiliser la population pour la
conservation de cette espèce.
2.4. Importance socio-économique de T.
satureioides
Le thym satureioide (Thymus satureioides),
appelé par la population locale « Azoukenni » est une plante
aromatique, médicinale, mellifère, condimentaire et pastorale qui
pousse en sols caillouteux, pierreux et plutôt secs. Elle est
utilisée soit à l'état de feuilles pour les recettes
culinaires, soit dans l'industrie où elle est distillée pour
extraire une huile essentielle riche en borneol utilisé dans le domaine
du cosmétique et de pharmacie (Anonyme, 2014)
Le thym satureioides forme des nappes très importantes
dans la région du Haut Atlas occidental. Dans la province de Taroudant,
la production annuelle issue de l'exploitation de la biomasse foliaire de cette
espèce, pour la production de la feuille sèche et des huiles
essentielles, s'élève à environ 600 Tonnes/an. Ces nappes
constituent aussi pour les éleveurs une précieuse ressource
fourragère, et la réputation de la qualité de viande bien
ovine que caprine est en grande partie attribuée à cette plante
(Division économique et sociale, 2010).
Il est important de citer qu'une part non négligeable
de la population s'adonne à l'apiculture, cette espèce est
considérée dans la région parmi les principales plantes
productrices de nectar. Le miel qui en résulte est très
apprécié par les consommateurs et est considéré
comme un miel de qualité importante vu son prix élevé. Ce
dernier s'est multiplié par 3 ces dernières années pour
dépasser les 800 dh/litre. Bien que soumis à d'innombrables
contraintes écologiques et anthropozoïques, les nappes de thym
continuent à jouer un rôle très important sur le plan
économique et social à travers les
Zhiri A. et al.(2010) ont aussi obtenu le borneol
comme constituant majoritaire de l'huile essentielle de T.
satureioides. Alors que, El Ouali Lalami A. et al. (2013)
relatent
16
multiples services qu'elles procurent aux usagers,
constitués dans leur grande majorité d'agriculteurs et
d'éleveurs généralement pauvres (DREFLCD-HA, 2013).
2.5. Propriétés et vertus du thymus
satureioides
Le thym est une plante qui a une longue tradition. Il est
utilisé principalement dans le domaine médical pour ses
propriétés antiseptique, antispasmodique et antitussive (Karawya
et Hifnawy, 1974; Salgueiro et al. 1997).
Les 2 grandes qualités de l'essence de thym sont: sa
forte action stimulante et son remarquable et puissant pouvoir antimicrobien
« le thym étant reconnu comme antibiotiques des pauvres ». En
effet, il a une action très intéressante sur les maladies
microbiennes. L'huile essentielle de thym est généralement
utilisée comme agent antiseptique dans beaucoup de préparations
pharmaceutiques et comme aromatisant dans plusieurs préparations
alimentaires (Papageorgio, 1980).
Son activité bactéricide à l'encontre de
nombreux germes pathogènes a été largement prouvée
(Ruberto et al. 1993; Tzakou et al. 1998; Karaman et al.
2001).
L'huile essentielle de thym est caractérisée par
un remarquable effet antioxydant (Dragland et al. 2003), liés
principalement à la présence de composés
phénoliques en grandes proportions dans cette huile essentielle.
2.6. Composition chimique
Peu d'études ont été
réalisées sur la caractérisation chimique des huiles
essentielles de Thymus satureioides. Les résultats de ces
travaux sont résumés dans le tableau 1.
Les travaux d'El Ouali Lalami et al. (2013), de Zhiri
et al (2010) et de Jaafari et al. (2007) ont fourni des
informations sur les pourcentages des différents constituants contenus
dans les huiles essentielles de Thymus satureioides.
Jaafari et al. (2007) ont identifiés trois
chémotypes de T. satureoides sur la base de la composition
chimique des huiles essentielles : Un chémotype à borneol dans la
région du Sud-ouest (Tiznit), un chémotype à borneol et
thymol dans la région de Beni Mellal (Bin El Widane) et un
chémotype à borneol et carvacrol dans la région de
Marrakech (Asni-Moulay Brahim).
t : la composé a été signalé
à l'état de trace ; (1) : Jaafari et al. 2007 ; (2) :
Zhiri A. et al (2010) ; (3) : El Ouali Lalami A. et al.
(2013)
17
le p-cymène (27,59%) comme composé majoritaire
pour le T. satureioides récolté dans le Moyen Atlas
(région d'Ifrane). Il s'agirait certainement d'une autre espèce
de thym puisque comme cité par Benabid (2000) «Thymus
satureoides se localise essentiellement dans le Haut Atlas et
l'Anti-Atlas» et n'existe pas dans la Région d'Ifrane (Moyen
Atlas).
Tableau 1. Composition chimique des huiles
essentielles de Thymus satureioides de différentes provenances
du Maroc
|
Constituants
|
Marrakech
(Asni Moulay
Brahim)
|
Beni Mellal
(Bin el Widane)
|
Sud-ouest
(Tiznit)
|
Maroc
(Laboratoire
Pranarôm)
|
Moyen Atlas (région
d'Ifrane)
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
|
Camphen
|
0,58
|
0,33
|
2,44
|
-
|
1,48
|
|
Geraniol formate
|
0,32
|
0,18
|
0,11
|
-
|
-
|
|
p-Cymene
|
2,17
|
0,12
|
1
|
3,65
|
27,59
|
|
ã-Terpinene
|
0,37
|
0,32
|
0,56
|
4,1
|
10.74
|
|
Linalol
|
t
|
3,83
|
10,54
|
5,39
|
8.79
|
|
Terpendiol
|
4,21
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6-3-Carene
|
t
|
0,2
|
0,41
|
-
|
-
|
|
Camphor
|
0,48
|
t
|
-
|
-
|
0.19
|
|
Borneol
|
30,03
|
51,98
|
59,37
|
27,31
|
2.59
|
|
á-Terpineol
|
1,78
|
2,03
|
t
|
6,69
|
0.18
|
|
Carvacrol methyl ether
|
0,71
|
5,74
|
t
|
-
|
1.86
|
|
Bornyl acetate
|
1,73
|
1,51
|
1,53
|
|
0.13
|
|
Thymol
|
0,94
|
26,81
|
0,78
|
13,54
|
14.09
|
|
Carvacrol
|
35,9
|
2,83
|
1,24
|
2,21
|
5.49
|
|
trans-Caryophyllene
|
3,28
|
4,18
|
1,58
|
10,93
|
4.08
|
|
á-Caryophyllene
|
0,16
|
0,19
|
0,19
|
-
|
-
|
|
á-copaène
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
â-Cadrene
|
0,31
|
t
|
0,23
|
-
|
-
|
|
á-Cadinene
|
0,48
|
t
|
0,28
|
-
|
-
|
|
6-cadinene
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Caryophyllene oxide
|
0,51
|
0,5
|
0,58
|
-
|
0.80
|
|
Germacrene D
|
0,33
|
0,15
|
0,29
|
-
|
-
|
18
Chapitre 3. Le Varroa, parasite redoutable des
abeilles
3.1. Le déclin des populations d'abeilles
à travers le monde
La santé des abeilles est exposée à tout
moment à des épizooties qui compromettent la pratique apicole.
Les maladies se propagent très rapidement à l'intérieur
des ruches en raison des contacts physiques entre ouvrières et de la
trophallaxie (échange de nourriture entre abeilles). De même, les
abeilles pouvant voler sur de grandes distances, piller les colonies voisines
ou y dériver, le risque qu'un grand nombre de colonies et de ruchers
soit touché par une épizootie est important. Si l'on ajoute
à cela le déplacement des ruches par l'apiculteur entre
différentes régions au rythme des saisons (transhumance), la
contamination devient plus que probable.
Depuis 2006, à travers le monde, on assiste un
phénomène de surmortalité des abeilles; le Syndrome
d'effondrement des colonies ou Colony Collapsus Disorder (CCD): les ruches se
vident de leurs ouvrières du jour au lendemain en l'absence de cadavres
dans ou à proximité de la ruche. Ce phénomène
semble affecter certaines régions du globe plus que d'autres et les
causes ne semblent pas les mêmes pour chacun des continents (Pelletier,
2010). L'Amérique semble la plus affectée avec des pertes
hivernales du cheptel de plus de 30% en 2009/2010 aux USA. Pour la même
période, en Europe, la France, l'Espagne, l'Italie ont enregistré
des pertes comprises entre 20 et 35%. Notons que les chiffres
enregistrés étaient beaucoup plus importants pour la
période 2003/2006 aussi bien aux USA qu'en Europe (30 à 90%)
(Rey, 2012). Concernant l'Afrique et le Proche-Orient, aucune
surmortalité n'est rapportée et les auteurs attribuent cela au
fait qu'Apis mellifera étant une espèce originaire du
continent africain, elle y est mieux adaptée et résiste mieux
à ses divers antagonistes et aussi, l'usage des pesticides y demeure
encore restreint (Morin, 2010; Neumann et Carreck, 2010). Le Maghreb reste
néanmoins touché par le syndrome sachant que des pertes de plus
de 30% ont été observées durant la saison apicole 2010
(Baaklini, 2010).
Les causes suspectées pour le déclenchement de
ce syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles (SECA) sont
présentées par continent dans le tableau suivant (Pelletier,
2010):
19
Tableau 2. Causes suspectées dans le
déclenchement du syndrome d'effondrement des colonies d'Apis
mellifera à travers le monde
|
Continent
Causes
|
Amérique
|
Europe
|
Afrique
et
Proche-
Orient
|
Asie
|
Australie
|
|
USA
|
Canada
|
|
SECA
|
X
|
|
X
|
|
?
|
|
|
Colonies faibles
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
Conditions climatiques
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
Famine
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
Nosémose
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
Parasite/virus divers
|
X
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Perte d'habitats
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
Pesticides agriculture
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
Problèmes de reine
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
Varroase
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
(Pelletier, 2010)
Dans ce phénomène de surmortalité, la
varroase semble être une cause prépondérante parmi les
maladies, virus et autres agents pathogènes affectant l'abeille A.
mellifera (Pelletier, 2010).
La varroase est une maladie causée par un acarien parasite
externe hématophage des abeilles ; le Varroa destructor qui
sévit actuellement un peu partout dans le monde (Figure 3).
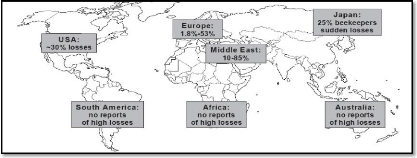
Figure 3. Pertes mondiales estimées dues à
V. destructor (Neumann et Careck, 2010)
20
3.2. Historique de la varroase
Le Varroa a été récolté
pour la première fois par l'entomologiste Edward Jacobson sur des
abeilles de l'espèce Apis cerana de l'île de Java. Le Dr.
Oudemans, acarologue hollandais en a fait la première description en
1904 et lui a donné le nom de Varroa jacobsoni en hommage
à son découvreur (Oudemans, 1904). Varroa jacobsoni est
donc le parasite de l'abeille Apis cerana dont l'aire de
répartition, principalement asiatique, était
séparée de celle d'Apis mellifera par les zones
désertiques d'Iran et d'Afghanistan à l'ouest et les
régions sibériennes froides au nord. La relation
hôte-parasite existante entre l'abeille Apis cerana et l'acarien
est actuellement dans un état d'équilibre, si bien que Varroa
jacobsoni ne constitue pas aujourd'hui une menace pour Apis cerana
(Donzé, 1995).
Le parasite a été observé en 1951
à Singapour (Gunther, 1951), en 1953 en URSS (Breguetova, 1953). Le
passage de Varroa de son hôte originel Apis cerana
à son nouvel hôte Apis mellifera a sans doute eu
lieu au cours des années 1940 ou 1950 (Grobov, 1976). L'importation de
colonies d'abeilles de l'espèce Apis mellifera en Asie
où elles n'étaient pas présentes, dans les années
1930, a donné l'occasion de passer sur cet hôte fraîchement
arrivé (Donzé, 1995). La première observation de
Varroa dans le couvain d'Apis mellifera aurait eu lieu en
Corée dans les années 1950 (Topolska, 2001). Cette même
observation a été réalisée en 1958 au Japon et en
Chine (Ian Tsin-He, 1965; Topolska, 2001), en 1963 à Hong Kong et aux
Phillippines (Delfinado, 1963).En 1970, le parasite a été
découvert dans des ruchers bulgares. Il s'agit probablement de la
première description du parasite sur le continent européen
(Grobov, 1976). En France, la première observation de colonies
d'abeilles infestées par Varroa a été faite en 1982 (Colin
et al. 1983). En Tunisie, la varroase a été
découverte en 1976. L'Algérie est déclarée
infestée en 1981. En Espagne la maladie a été
dépistée pour la première fois en 1985. La varroase a
été déclarée en Portugal en 1988. Récemment,
en 2010, le Varroa a fait son apparition au Madagascar.
Au Maroc, deux enquêtes pour le dépistage de la
varroase ont été effectuées en 1981 et 1988 et ont
concerné l'ensemble du territoire national et notamment les zones
frontalières. Ces enquêtes n'ont pas révélé
la présence de Varroa et ce n'est qu'au mois d'Août 1989
que la varroase a été déclarée pour la
première fois dans la région du Loukkos
(précisément le 18 Août 1989) après confirmation par
les laboratoires
21
d'Analyses Vétérinaires de Tanger et de
Casablanca ainsi que par le département de parasitologie de I.A.V.
HASSAN II (Rabat). La maladie s'est en suite propagée rapidement dans
d'autres régions et ce, en dépit des mesures d'urgences qui ont
été prises. Actuellement aucune région ne peut en
être déclarée indemne.
Vu qu'au moment de la déclaration, 1'infestation dans
ces zones était faible, la possibilité de l'introduction de la
varroase au Maroc par la voie naturelle (vol naturel d'essaims) est à
écarter, d'autant plus que le stade le plus avancé de la varroase
a été dépisté dans la province de Kénitra et
de Larache (zones éloignées des frontières) (El Bouhamid,
1994).
A travers le monde, ce n'est qu'en 1966 que l'on
déclare officiellement le danger et les dommages potentiels, pour
l'apiculture, provoqués par l'extension du parasite. La
répartition du Varroa dans les ruches est dès lors
devenue, au gré des échanges internationaux d'abeilles (colonies,
reines), peu à peu mondiale.
En 2000, Anderson et Truemann, dissocie l'acarien initialement
Varroa jacobsoni en 2 espèces distinctes. Le nom de
l'espèce qui regroupe les acariens infestant l'abeille domestique
Apis mellifera est désormais Varroa destructor. De nos
jours, de part le monde, peu de territoires sont épargnés par
l'infestation des colonies d'Apis mellifera par le Varroa
(Figure 4). Notons que l'Australie est encore l'un des territoires
déclarés indemnes de l'infestation grâce à la mise
en oeuvre de protocoles de quarantaine en cas d'introduction de colonies
d'abeilles (Anonyme, 2013).
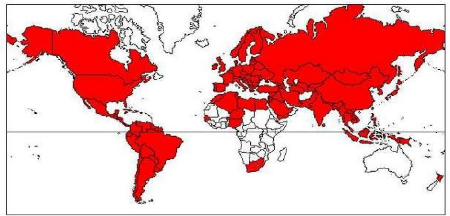
Figure 4. Répartition géographique de
Varroa destructor (Ellis et Zettel Nalen, 2010).
(Les zones colorées en rouge indiquent la
présence de Varroa destructor sur le territoire)
22
3.3. Description biologique des phases de
développement du Varroa destructeur
Le parasite responsable des signes cliniques de la varroase
chez A. mellifera est le Varroa destructor Anderson &
Trueman. Il appartient à l'embranchement des Arthropoda,
à l'ordre des Mesostigmata, à la famille des
Varroidae et au genre Varroa (Wendling, 2012).
Le cycle de développement du parasite se subdivise en
deux phases: la phase immature qui comprend trois stades (oeuf, protonymphe et
deutonymphe) et la phase mature où le dimorphisme sexuel est facilement
observable.
Les oeufs pondus par la femelle de Varroa sont
blancs. Ils présentent une consistance élastique et une forme
ovoïde et mesurent environ 300 jim de long et 230 jim de large (Wendling,
2012). Le stade protonymphal est le premier stade mobile. Il montre quatre
paires de pattes et le corps est clair et non sclérotisé. Le
mâle a une forme ovoïde dont les dimensions sont de 500 à 590
jim et la femelle a une forme sphérique et mesure entre 530 et 750 jim
(Wendling, 2012). Au début du stade deutonymphal, la forme du corps de
la femelle évolue vers une forme ovoïde, puis progressivement
transversalement elliptique. La taille d'une deutonymphe femelle de Varroa
destructor varie entre 750 et 1000 jim de long et 800 et 1600 jim de large
et celle du mâle est de 750 à 770 jim de long et 750 à 800
jim de large (Wendling, 2012). Le mâle deutonymphe est le plus souvent
plus petit que la femelle. Son corps à une forme de poire.
Concernant la phase mature, le poids d'une femelle adulte
V. destructor est de 325 jig (+/- 26 jig) en phase de phorésie
et ce poids augmente en phase de reproduction (environ 480 jig deux jours
après l'operculation de la cellule de couvain) (Garrido et al,
2000). Le corps de la femelle adulte V. destructor est
ellipsoïdal, déprimé dorso-ventralement (Figure 5). Il a une
longueur de 1167,3 jim et est large de 1708,9 jim (Anderson et Trueman, 2000).
Les femelles adultes V. destructor ont une espérance de vie de
2,5 à 3,5 mois pendant l'été (Calatayud et Verdu, 1994; De
Ruijter, 1987). Le corps du mâle V. destructor est
jaune-verdâtre, presque sphérique. Il mesure environ 750 à
980 jim de long et 700 à 880 jim de large (Ellis et Zettel Nalen, 2010).
Les membres sont longs et fins. Son corps est peu sclérotisé
excepté au niveau des membres. Les mâles adultes V.
destructor sont incapables d'accéder à une source de
23
nourriture par leurs propres moyens. Ils sont par ailleurs
très sensibles à la déshydratation. De ce fait, ils
meurent peu de temps après l'émergence de la jeune abeille adulte
parasitée (Moritz et Jordan, 1992).

Figure 5. Vue dorsale (à gauche) et ventrale (
à droite) d'une femelle adulte V. destructor (Wild,
2011)
La figure ci-dessous montre la composition normale d'une famille
V. destructor observée dans une alvéole de couvain
d'ouvrières approximativement 11 jours après l'operculation.

Figure 6. Composition normale d'une famille V.
destructor observée dans une alvéole de couvain
d'ouvrières approximativement 11 jours après l'operculation. En
haut de gauche à droite: une protonymphe femelle, une deutonymphe mobile
femelle, une deutonymphe immobile femelle. En bas de gauche à droite:
une jeune femelle venant de muer, la fondatrice V. destructor, un
mâle adulte (Rosenkranz et al. 2010).
24
3.4. Ontogenèse du Varroa destructor
3.4.1. Processus d'infestation
La future fondatrice de V. destructor fixée
sur l'abeille adulte est transportée à proximité (quelques
millimètres) d'une alvéole susceptible d'être
infestée. Elle est la forme de résistance, la seule
présente sur les abeilles pendant la période d'hivernage. En
sortie d'hivernage, la femelle fondatrice infeste le couvain pour s'y
reproduire. Une fois à proximité, les femelles V.
destructor envahissent les alvéoles de couvain ouvertes,
attirées par des substances volatiles provenant des larves d'abeilles
(Pernal et al. 2005; Noireterre, 2011). Parfois, l'acarien quitte son
hôte pour se placer sur le bord de l'alvéole, et se dirige
rapidement vers le fond en se mouvant entre la larve et la paroi de
l'alvéole (Beetsma et al. 1999; Boot et al. 1992;
Ibrahim et al. 2007). Une fois à l'intérieur de
l'alvéole, l'acarien ne le quitte plus (Ibrahim et al, 2007) et
se cache sous la larve d'A. mellifera dans la nourriture
destinée à l'alimentation du stade operculé (Figure 7).
L'entrée des fondatrices dans les alvéoles s'effectue d'une
façon aléatoire (Martin, 1995a; Salvy et al. 1999a).
Notons que Varroa destructor pour se reproduire préfère
les cellules de couvain de faux-bourdons à celles d'ouvrières
(Calderone et Kuenen, 2001; Fuchs, 1990).

Figure 7. Processus d'entrée de la fondatrice
V. destructor dans la cellule de couvain (Vandame, 1996).
25
3.4.2. La fécondation
Après l'operculation de l'alvéole le premier
oeuf de V. destructor est pondu après 60 à 70 heures
aussi bien dans le couvain d'ouvrières que celui des faux-bourdons
(Donzé et Guérin, 1994; Martin, 1995b). Seul le premier oeuf
donnera un mâle V. destructor. L'acarien est qualifié
d'arrhénotoque, car les oeufs non fécondés engendrent des
mâles haploïdes (n=7), les oeufs fécondés produisent
des femelles diploïdes (2n=14) (Akimov et al. 1986b). La
fécondation de la femelle V. destructor s'effectue une seule
fois au cours de sa vie néanmoins plusieurs accouplements sont
nécessaires pour obtenir une fécondation efficace (Donzé
et al. 1996). Le nombre d'oeufs pondus par le Varroa est de 5
à 6 (1 mâle et 4 femelles), tandis que dans le couvain de
faux-bourdons, ce nombre est de 6 à 7oeufs (1 mâle et 5 femelles)
(Martin, 1995b). Les descendants mâles et femelles atteindront la
maturité sexuelle immédiatement après leur dernière
mue. Le temps nécessaire pour qu'un V. destructor passe du
stade oeuf au stade adulte est d'environ 134 heures (5,6 jours) chez les
femelles et de 144 heures (6 jours) chez les mâles (Donzé et
Guérin, 1994; Martin, 1994). Compte tenu de l'intervalle de ponte entre
les deux premiers oeufs, le mâle atteint ainsi l'âge adulte une
vingtaine d'heures avant la première femelle. Le mâle doit donc
attendre que la première femelle achève sa mue imaginale pour
s'accoupler avec elle (Donzé et al, 1996 ; Lobb et Martin,
1997).
3.4.3. Emergence de la jeune abeille
Après la mue imaginale de l'abeille, les femelles adultes
V. destructor sont généralement observées entre
les tergites gastriques de l'abeille en attendant que cette dernière
émerge de l'alvéole. À l'émergence de la jeune
abeille, les femelles adultes de Varroa, parfois aussi les femelles
immatures et le(s) mâle(s) adulte(s) quittent l'alvéole, seuls ou
portés par l'abeille. Cependant, les femelles de Varroa encore
immatures au moment de l'émergence, ainsi que les mâles sont
voués à mourir rapidement (Donzé, 1995; Martin, 1994).La
figure 8 illustre le cycle de reproduction de Varroa destructor
26

Figure 8. Cycle de reproduction de Varroa
destructor (Vidal-Naquet, 2008)
3.4.4. Concordance phénologique cycle Varroa/cycle
abeille (récapitulation)
Varroa destructor est un parasite obligatoire du
genre Apis. Il est présent à tous les stades de
développement de son hôte, ce qui implique une étroite
relation entre leurs cycles de développement respectifs (Figure 9). En
résumé, le cycle de développement de ce parasite se
déroule donc essentiellement dans le couvain et dure huit jours. La
femelle Varroa fondatrice entre donc dans les cellules d'ouvrières ou de
faux-bourdons au stade larvaire juste avant l'operculation et s'immerge dans la
gelée larvaire, pour se cacher des abeilles ouvrières
nettoyeuses, nourricières et cirières. 60 à 70 heures
après l'operculation, le premier oeuf (généralement un
mâle haploïde) est pondu. Dans les cellules de couvain
d'ouvrière la femelle fondatrice pond 3 à 4 oeufs en plus du
premier
27
oeuf mâle pondu. Au niveau des cellules de couvain de
faux-bourdon, elle pond 5 ou 6 oeufs en plus du premier oeuf mâle pondu.
Le couvain de faux-bourdon étant operculé plus longtemps (14,5
jours) que celui des ouvrières (12 jours), le varroa s'est ainsi adapter
en optimisant sa fertilité dans les cellules mâle. Le couvain
mâle est beaucoup plus attractif pour le Varroa que le couvain
d'ouvrières. Le développement de l'oeuf à l'adulte se fait
dans la cellule operculée au stade nymphal de l'abeille et dure environ
134 heures pour le mâle et 154 pour la femelle. Les larves se nourrissent
de la nourriture apportée à la larve d'abeille, tandis que les
femelles adultes se nourriront de l'hémolymphe de la larve d'abeille.
Le premier mâle Varroa va s'accoupler avec ses
soeurs dans la cellule sous l'opercule. Les femelles vont remplir leur
spermathèque puis elles ne s'accoupleront plus. Lorsque l'abeille
émerge de sa cellule, les jeunes Varroa et la femelle
fondatrice quittent la cellule sur l'abeille. Le mâle survit un court
moment dans la cellule ouverte et meurt ne pouvant pas se nourrir de
l'hémolymphe de l'abeille. Les femelles de Varroa, étant
très mobiles, vont pouvoir être disséminées dans la
ruche et les ruches avoisinantes en s'accrochant aux abeilles et aux faux
bourdons (Vidal-Naquet, 2008; Noireterre, 2011).
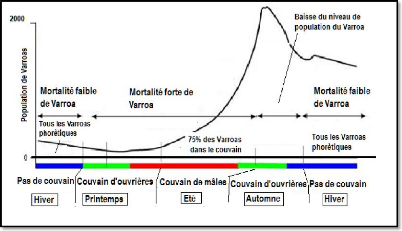
Figure 9. Evolution des effectifs de V.
destructor en fonction de l'état de la colonie
d'abeilles et des
saisons (Traduit) (Randy Oliver, 2006)
28
3.5. Dynamique des populations de V. destructor au sein
de la colonie
La dynamique de population de Varroa au sein de la colonie est
directement liée à celle de la colonie d'abeilles. Le nombre
d'acariens augmente habituellement lentement au début de la saison. Des
signes cliniques peuvent être observés à tout moment
pendant la pleine saison, bien que les taux maximum soient
généralement atteints en fin de saison. La population parasitaire
totale augmente au cours de l'année dès qu'il y a présence
de couvain dans la ruche, et donc possibilité pour les fondatrices
V. jacobsoni de se reproduire (Figure 10). Une étude
menée en climat britannique montre que pendant la période de
présence de couvain, 60 à 70 % de la population totale d'acariens
est présente dans le couvain operculé (Martin, 1998).
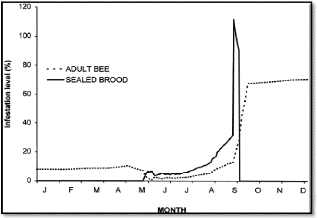
Figure 10. Modélisation du niveau d'infestation
par l'acarien V. jacobsoni des abeilles adultes et du couvain au cours
d'une année (Martin, 1998a).
(Infestation level = niveau d'infestation, adultbee =
abeille adulte, sealedbrood = couvain operculé, month =
mois)
Noireterre (2011) propose un modèle
mathématique, validé par de nombreuses études sur le
terrain, qui permet d'évaluer la croissance de la population du parasite
au cours de l'année. Elle est pratiquement exponentielle et on
considère qu'elle augmente d'un facteur 0,021 par jour lorsque la
colonie élève du couvain. Le modèle donnant la population
de varroas à un jour donné selon Noireterre (2011) est le
suivant:
|
Nombre de varroas à l'arrêt de
l'élevage = (Nombre de varroa initial) ×
1,021X
X= Nbre de jours de l'année avec le
couvain
|
29
Ainsi à la sortie d'hivernage, une colonie
parasitée par 50 Varroas, connaitra 1100 Varroas en juin et
2000 Varroas avant la fin du mois d'août, moment où la
population d'abeilles décline. Il en résulte une pression
parasitaire maximale sur la colonie, le couvain est alors fortement
parasité. On parle de période critique (Figure 11). Les abeilles
d'hiver seront nettement affaiblies et la colonie s'effondrera brutalement
à la fin de l'hiver car elle ne sera pas capable d'élever la
nouvelle génération (Noireterre, 2011).
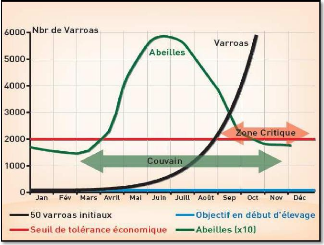
Figure 11. Modélisation de la dynamique de
population de Varroa destructor au
cours d'une année
(Noireterre, 2011)
En été, par des phénomènes de
pillage des ruches malades, de dérive des ouvrières, de passage
de faux-bourdons et de visite de ruches abandonnées, les Varroas
qui ré-infestent les ruches, ont été estimés
par certaines études à prés de 70 par semaine (contre 5 au
printemps) (Fernandez et Coineau, 2002). Avec cette modélisation, il est
estimé qu'en l'absence de traitement, 10 Varroas aboutiraient
à une population de 1000 individus en deux ans (Martin, 1998).
De ce fait, on comprend l'importance de la mise en oeuvre d'un
dépistage et traitement réguliers contre Varroa pour
contrôler sa reproduction et gérer les ré-infestations.
Par ailleurs plusieurs auteurs s'accordent à
considérer qu'à partir du moment où le taux d'infestation
atteint 2000 parasites, le risque d'effondrement de la colonie est important.
Ce taux est nommé seuil de tolérance ou seuil de dommage
économique. Une
30
colonie qui possède 500 varroas à la sortie
d'hivernage atteint ce seuil dès le mois de mai et la population atteint
rapidement 6000 Varroas pendant l'été.
Concernant la lutte contre Varroa, les
recommandations sont donc d'obtenir un seuil maximal de 50 varroas par colonie
avant hivernage. Pour que la colonie redémarre correctement au printemps
suivant, les abeilles d'hiver doivent être correctement
développées et aptes à élever du couvain. Il est
donc important que le traitement acaricide, permettant de réduire
l'infestation au seuil de 50 varroas, soit réalisé en août
avant l'élevage du couvain d'abeilles d'hiver. Ainsi, la charge
parasitaire sera faible, et les abeilles d'hiver ne présenteront pas de
modifications morphologiques qui auraient été imputables au
parasitisme des larves au cours de leur développement (Noireterre,
2011).
3.6. Expression de la varroase
3.6.1. Au niveau de l'individu
La varroase s'exprime de plusieurs façons au niveau de
l'individu abeille. Parmi tant d'autre on peut citer :
? Spoliation d'hémolymphe lors de la nutrition
Les femelles adultes de Varroa destructor percent la
cuticule de leur hôte, afin de pouvoir accéder à leur
source de nourriture : l'hémolymphe. Le prélèvement
quotidien d'hémolymphe est estimé à 0,67 ìl
(Bowen-Walker et Gunn, 2001). La nutrition de l'acarien entraîne une
baisse de la quantité globale de protéines de
l'hémolymphe. Chez les nymphes d'ouvrières, elle
s'élève à 27 % lors d'une infestation unique et à
50 % lors d'une infestation double (Amdam et al. 2004).
? Baisse du poids des abeilles infestés
L'infestation entraîne une perte de poids chez les
abeilles adultes. Une étude montre que pour une infestation de 1
à 3 femelles fondatrices la perte de poids moyen est estimée
à 10,33 % chez les jeunes faux-bourdons et 11,09 % chez les
ouvrières à l'émergence. Pour une infestation de 3
à 5 acariens elle est estimée en moyenne à 18,26 % chez
les faux-bourdons et 17,53 % chez les ouvrières (Kotwal et Abrol, 2009).
Les imagos faux-bourdons arrivent à émerger d'alvéoles
renfermant 15 à 20 femelles fondatrices et leurs descendances, mais leur
poids reste très faible et ne pèsent que la moitié du
poids de mâles non parasités (Duay et al. 2003).
31
? Déformations morphologiques externes
Environ 8,5 % des ouvrières parasitées à
divers degrés émergent avec des déformations
morphologiques externes comme des ailes atrophiées, un raccourcissement
du corps (seules 1,8 % des ouvrières non parasitées
présentes des déformations morphologiques externes) (Bowen-Walker
et Gunn, 2001)
? Réduction de l'espérance de vie
L'espérance de vie des abeilles diminue lorsque le taux
d'infestation augmente (Ellis et Delaplane, 2009). En république
Allemande, une étude a montré que la durée de vie moyenne
des ouvrières est respectivement 15,6; 9,1; 8,3 semaines pour des
colonies faiblement, moyennement et fortement infestées pour la
période d'étude de mai à septembre (Ritter et al,
1984).
? Altération des fonctions cérébrales de
l'abeille
Le parasitisme diminue la capacité d'apprentissage chez
les butineuses parasitées. Cela influe sur le comportement de vol,
l'orientation, ainsi que le succès de retour à la ruche des
butineuses (Kralj et al. 2006). L'observation de ruches fortement
infestées montre une perte très rapide des butineuses
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la reine accompagnée de
quelques ouvrières (Sakofski, 1990).
? Diminution du potentiel reproducteur des faux-bourdons
La baisse de la capacité de vol et de la production de
spermatozoïdes au cours du parasitisme chez l'abeille male entraine la
baisse du potentiel reproducteur des faux-bourdons. En effet, les faux-bourdons
infestés durant leur développement par une ou deux femelles
adultes produisent respectivement 24 % et 45 % moins de spermatozoïdes de
faible qualité que les témoins (Duay et al. 2002; Del
Cacho et al. 1996).
? Varroa destructor, un vecteur de virus
Les colonies d'abeilles sévèrement
infestées par V. destructor ont un taux de mortalité
très élevé souvent attribuée à l'action
concomitante de virus. Les virus CBPV (Chronic Bee Paralysis Virus - Virus de
la paralysie chronique), BQCV (Black Queen Cell Virus - Virus de la cellule
royale noire), SBV (Sacbrood Bee Virus - Maladie du couvain sacciforme), DWV
(Deformed Wing Virus - Virus des ailes déformées) et autres
sont
32
retrouvés chez l'abeille de façon concomitante
à l'infestation parasitaire (Chen et Siede, 2007 ; Martin et al.
1998; Tentcheva et al. 2004).
? Varroa destructor, un vecteur de champignons
Plusieurs champignons ou spores de champignons sont
retrouvés à la surface de Varroa destructor. Parmi eux,
Aspergillus flavus et Ascosphaera apis sont connus comme
pathogènes pour l'abeille. Les spores d'Ascophaera apis sont
responsables de la maladie du couvain plâtré ou
ascosphérose (Ball, 1997).
? Varroa destructor, un vecteur de bactéries
L'acarien Varroa destructor est en mesure de
transporter des spores de Paenibacillus larvae (agent de la loque
américaine) à la surface de son corps (Alippi et al,
1995). Le parasite participerait ainsi à la propagation de la loque
américaine.
3.6.2. Au niveau de la colonie
Quand l'infestation de la colonie d'abeilles par V.
destructor est faible, on n'observe aucun symptôme clinique et le
parasitisme passe souvent de façon inaperçue. Au cours d'une
infestation modérée, la croissance de la population d'abeilles
pourrait être affectée aussi bien que le niveau de production en
miel. Une étude réalisée au Canada montre qu'un taux
d'infestation de 2 acariens pour 100 abeilles suffirait pour réduire de
façon significative la production en miel de la colonie (Currie et
Gatien, 2006). L'expression clinique se traduit par la présence
d'abeilles traînantes au sol, certaines ont les ailes
écartées, déformées ou asymétriques, le
corps peut être noir dépourvu de poils. Le couvain est en
mosaïque et paraît irrégulier, les
réserves en miel et en pollen deviennent disproportionnelle par rapport
à la force de la colonie. Les colonies deviennent alors plus sensibles
aux surinfections (teignes, loques,...).Les colonies symptomatiques
évoluent vers la mort, le plus souvent durant la période
hivernale (Rosenkranz et al, 2010).
NB : Les informations relatives à la
lutte contre le varroa sont en annexe
33
Partie 2: Matériel et méthodes
34
2.1. Présentation de la zone
d'étude
2.1.1. Situation géographique
La zone d'étude concernée est le Sud ouest
marocain .Elle est située en grande partie dans la province de Taroudant
.La province de Taroudant a été créée en
décembre 1981, elle est située au centre de la région
Souss-Massa-Draa et s'étend sur une superficie de 16.500 km2.
La province de Taroudant est bordée par les provinces d'Essaouira, de
Chichaoua et d'Al Haouz au nord, la province de Ouarzazate à l'est, les
provinces de Tata et de Tiznit au sud, la province de Chtouka-Aït Baha et
les préfectures d'Inezgane-Aït Melloul et d'Agadir Ida-Outanane
à l'ouest. La province de taroudant est découpée en 81
communes rurales et 8 communes urbaines. L'ensemble est réparti en 5
cercles.

Figure 12. Carte montrant la localisation de la zone
d'étude dans le Sud Ouest du Maroc.
2.1.2. Relief et climat
Taroudant est une province essentiellement montagneuse, avec
60% de relief de la province. Comme on peut le voir sur la Figure 13, le
territoire s'articule autour de la vallée du Souss. Il est limité
au nord par les contreforts occidentaux du Haut Atlas et au sud et au centre
par les montagnes de l'Anti-Atlas. L'oued Souss né à l'est de la
province, là où le terrain s'élève et la
vallée se case dans les montagnes. Il poursuit sa
35
course vers l'ouest, et finalement abandonne la province pour
se jeter quelques km plus loin dans l'Océan Atlantique, dans la province
d'Agadir.
La province est caractérisée par un climat sec
et ensoleillé, avec des hivers tempérés et des
étés très chauds, Le climat est plus froid dans les
montagnes et en hiver la neige peut tomber. Les différences thermiques
entre le jour et la nuit sont importantes. La radiation solaire, même en
hiver, est intense. Les données climatologiques sont comme suit :
V' Pluviométrie annuelle moyenne : 275 mm
V' Température maximale : 30°
V' Température minimale : 12°
La sécheresse a fait ses dégâts dans les
dernières années, surtout dans la région de l'Anti-Atlas,
ce qui a contribué à son appauvrissement et à son
abandon.
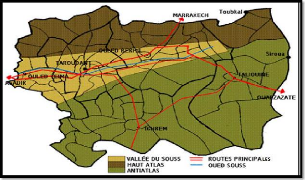
Figure 13. La carte géographique de la province du
Taroudant (Ministère de l'Intérieur, S.E.P.C.P.,
2012)
2.1.3. Données sur le secteur forestier
La superficie forestière de la province est de 543 707
Ha. Les principales essences forestières de la zone d'étude sont
: L'arganier, avec 66% de la superficie totale, suivie du chêne vert, du
thuya et du genévrier. Elles sont accompagnées d'autres
espèces
telles que le lentisque, l'oléastre, le doum, le
caroubier, le jujubier. Le réseau des
pistes forestières
relevant de la DPEFLCD de Taroudant est d'une longueur totale de l'ordre de 700
Km. Il ya deux postes vigies dans les communes rurales de Ménizla et
de
36
Talmakant. Les superficies occupées par les
espèces forestières, leurs repartitions ainsi que les productions
diverses dans le secteur forestier sont représentées dans le
tableau 3 et 4 suivants.
Tableau 3. Principales essences forestières dans
la province du Taroudant
|
Principales essences forestières
|
Superficie (ha)
|
Pourcentage (%)
|
Superficie province (%)
|
|
Arganier
|
358 100
|
66
|
21,7
|
|
Chêne vert
|
79 050
|
14,6
|
4,8
|
|
Thuya
|
61 160
|
11
|
3,7
|
|
Genévrier
|
26 200
|
5
|
1,6
|
|
Autres
|
18 501
|
3,4
|
1,2
|
|
Total
|
543 011
|
100
|
33
|
(Ministère de l'Intérieur, S.E.P.C.P., 2012)
Tableau 4. Quelques productions forestières dans
la province du Taroudant
|
PRODUCTION
|
|
Fourrage (UF/an)
|
Bois de feux (STERE/an)
|
Huile d'argan (T/an)
|
Miel (T/an)
|
Thym (T/an)
|
Armoise (T/an)
|
|
162.900.000
|
238.400
|
1.500
|
270
|
600
|
50
|
(Ministère de l'Intérieur, S.E.P.C.P., 2010)
37
2.1.4. Organisations professionnelles
Le Tableau 5 suivant établit les différentes
organisations professionnelles du secteur agricole dans la province du
Taroudant.
Tableau 5. Répartition des coopératives
agricoles dans la province du Taroudant
|
Désignation
|
Nombre
|
Capital
(1000 Dh)
|
Active
|
Inactive
|
Membres
|
|
Collecte et commercialisation du lait
|
49
|
14 202,58
|
48
|
1
|
7.000
|
|
Reforme agraire
|
15
|
6135
|
15
|
0
|
859
|
|
Emballage des primeurs
|
2
|
2 984
|
1
|
1
|
15
|
|
Emballage des agrumes
|
5
|
105 109,8
|
4
|
1
|
269
|
|
Matériel agricole
|
14
|
666,5
|
10
|
4
|
324
|
|
Femme rurale
|
18
|
196
|
17
|
1
|
598
|
|
Apicole
|
11
|
301
|
10
|
1
|
159
|
|
Production
|
5
|
27 270
|
5
|
0
|
240
|
|
Amélioration génétique
|
1
|
2931
|
1
|
0
|
130
|
|
Polyvalente
|
5
|
435,1
|
1
|
0
|
160
|
|
Oléiculture
|
3
|
214
|
3
|
0
|
58
|
|
Aviculture
|
1
|
109
|
0
|
1
|
12
|
|
Safran
|
12
|
543 ,800
|
12
|
-
|
516
|
|
Autres
|
40
|
301
|
38
|
2
|
1.342
|
|
Total
|
181
|
161 398,78
|
169
|
12
|
11682
|
(Ministère de l'intérieur, S.E.P.C.P., 2012)
38
2.2. Approche méthodologique
2.2.1. Enquête de confirmation auprès des
apiculteurs de la région de Taroudant et entretien avec les apiculteurs
du Gharb
Une recherche bibliographique a été
réalisée afin de recueillir les informations utiles à
notre étude. Cette recherche bibliographique a concerné les
thèses et mémoires de fin d'études, les articles
scientifiques, les études et les documents techniques en rapport avec
notre problématique. Cela nous a permis de recadrer et de bien orienter
notre enquête.
D'après des déclarations empiriques, il
s'avère que les colonies d'abeilles séjournant dans le Sud-ouest
marocain sur les formations de Thymus satureioides acquièrent
une certaine immunité contre le Varroa. C'est dans cette
optique qu'une enquête a été conduite, dans la province de
Taroudant et la région du Gharb, auprès d'une dizaine
d'apiculteurs et de coopératives apicoles. Il convient de souligner que
compte tenu de la nature de l'information à collecter et de l'objectif
de l'enquête, il n'a pas été prévu de
procéder selon une approche statistique (choix raisonné).
L'objectif est plutôt la qualification et le diagnostic de la
problématique de l'apiculture et du Varroa dans la zone
d'étude.
L'entretien semi-directif ou semi-ouvert représente le
principal outil pour les éléments de réponse à
notre problématique, à savoir : la conduite du rucher et les
modalités d'infestation par le Varroa dans les peuplements de
thym. L'entretien est structuré en fonction de thèmes
précis qu'on a souhaité approfondir. On a utilisé une
grille d'entretien (Voir annexe) où sont répertoriées et
classées des questions précises et spécifiques.
Elaboration du guide d'entretien
Il oriente la recherche de l'information, il permet de
recueillir la parole, les témoignages, les réactions des acteurs
face à leurs réalités et faits sociaux. Ainsi un guide
d'entretien a été élaboré.Ce guide a
été adapté au contexte et au type d'informations qu'on a
souhaité recueillir par notre entretien avec les apiculteurs.
Le guide d'entretien a été basé sur six
grands thèmes qu'on a abordé lors des entrevues : -
Critères utilisés pour le choix de l'emplacement du rucher
- Disposition et gestion du rucher - Nourrissage
39
- Calendrier apicole et transhumance
- Etat sanitaire des abeilles pendant la période
d'installation du rucher au niveau des populations de Thym
satureioides
- La fin de récolte et hivernage
Au début les questions sont d'ordre
général. Ensuite, les questions deviennent pointues. C'est le
"modèle de l'entonnoir".
Méthode d'analyse de l'entretient
L'analyse des entretiens a été
réalisée par deux méthodes d'analyse qui sont :
- L'analyse du contenu, qui est une technique importante et
convenable sur laquelle nous nous sommes basé pour le traitement des
entretiens. Cette méthode d'analyse permet le filtrage et la
sélection des informations qui sont recueillies lors des entretiens.
Elle consiste au repérage des mots clés et des phrases noyaux
portant l'information recherchée. Ce qui nous permet de dégager
ce qui est essentiel et ayant une relation avec notre problématique.
Ensuite, ces informations ont été regroupées par
thème, et au niveau de chaque thème, les phrases noyaux ont
été classées en sous-catégories.
- L'analyse descriptive est une analyse permettant de
présenter et de caractériser un phénomène ou une
situation de manière claire et simplifiée.
2.2.2. Collecte de Thymus satureioides au niveau de
différentes provenances dans la province de Taroudant
La récolte du thym a eu lieu le 1er et le 2
août 2013 au niveau de six stations dans la zone d'étude selon des
transects linéaires et dans l'ordre géographique:
Argana-Aoulouz-Ankrim-Timoulay-Amskrod. La localisation des stations dans la
zone d'étude ainsi que l'emplacement des stations de récolte du
thym et leurs caractéristiques sont représentés dans la
figure 14 et le tableau 8 suivant :
40
Tableau 8.Caractéristiques des stations de
collecte des échantillons de Thymus satureioides
|
Station
|
Type de peuplement
|
Exposition
|
Altitude (m)
|
Pente (%)
|
Coord. GPS
|
|
Argana
|
Thuya
|
Nord
|
1240
|
20
|
N30 42.792
|
|
(Ouled
|
|
|
|
|
W9 06.194
|
|
Berhil)
|
|
|
|
|
|
|
Aoulouz
|
Arganier
|
Nord
|
1020
|
23
|
N30 47.812
|
|
|
|
|
|
W8 23.132
|
|
Arganier + thuya
|
Nord-Est
|
320
|
23
|
N30 32.812
|
|
Ankrim
|
+ Oleastre
|
|
|
|
W9 34.284
|
|
Thuya + Oleastre +
|
|
|
|
|
|
Timoulay
|
+Lentisque+Pin
|
Est
|
860
|
30
|
N30 37.443
|
|
d'alep+Jujibier
|
|
|
|
W9 30.336
|
|
+Chêne vert
|
|
|
|
|
|
Amskrod
|
Thuya
|
Est
|
1050
|
30
|
N30 38.138
|
|
|
|
|
|
W9 22.921
|
|
Amskrod
|
Thuya
|
Ouest
|
1050
|
25
|
N30 38.153
|
|
|
|
|
|
W9 22.947
|
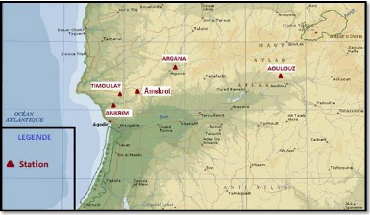
Figure 14. Carte montrant l'emplacement des stations de
récolte des échantillons de thymus satureioides dans le
Sud-ouest Marocain.
Seule la partie aérienne du thym a été
récoltée à l'aide d'un sécateur et mise en carton
au terrain. Environs 4 kg de thym a été récolté par
station et les caractéristiques des stations étaient inscrites
sur les cartons. Les cartons ont été ensuite acheminés au
laboratoire du Centre de Recherche Forestière à Rabat pour
l'extraction des huiles essentielles.
41
2.2.3. Distillation de T. satureioides
récolté dans la province de Taroudant
La distillation des différentes provenances de
Thymus satureioides a été effectuée au
laboratoire de chimie du CRF à Rabat par hydrodistillation sous montage
de Clévenger. C'est la méthode la plus simple et de ce fait la
plus anciennement utilisée. Le procédé consiste à
immerger la matière première végétale dans un
ballon rempli d'eau placé sur une source de chaleur. Le tout est ensuite
porté à ébullition. La chaleur permet l'éclatement
des cellules végétales et la libération des
molécules odorantes qui y sont contenues. Ces molécules
aromatiques forment avec la vapeur d'eau, un mélange
azéotropique. Les vapeurs sont condensées dans un
réfrigérant et les huiles essentielles se séparent de
l'eau par différence de densité. L'eau aromatique est
recyclée dans l'hydro-distillateur afin de maintenir sont rapport avec
la plante à son niveau initial (El haid, 2011). Pour
l'hydro-distillation du thym, environ 150g de thym broyés ont
été mélangé avec 750 ml d'eau dans un ballon d'un
litre surmonté d'une colonne d'environ 60 cm de longueur et qui est
reliée à un réfrigérant. L'ensemble est
chauffé à ébullition pendant 3 heures de temps. Trois
répétitions par station ont été effectuées.
Les huiles essentielles obtenues ont été mises dans des flacons
et conservés au réfrigérateur.
2.2.4. Détermination du rendement en HE
Le rendement en HE des différentes provenances est
calculé par la formule suivante:
|
Rdt = (V/ms x 100)
|
avec :
|
|
- Rdt = rendement en HE (ml/100g); - V = volume d'HE recueilli; -
ms = masse végétale sèche.
|
|
Comme la densité des huiles essentielles est proche de 1,
le rendement est exprimé en %.
2.2.5. Caractérisation chimique des HE de T.
satureioides
La caractérisation des huiles essentielles de
Thymus satureioides a été réalisée par la
chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse (CPG-SM) à l'Unité de Recherche sur
les Techniques Nucléaires, l'Environnement et la Qualité du
Centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger. Elle est
réalisée sur un chromatographe en phase gazeuse de type
Hewlett-Packard (série HP 6890) couplé à un
spectromètre de masse (série HP 5973). La fragmentation est
effectuée par impact électronique sous un champ de 70 eV. La
colonne utilisée est une colonne capillaire HP-
42
5MS (30 m x 0,25 mm), l'épaisseur du film est de 0,25
um. La température de la colonne est programmée de 50 à
200°C à raison de 4°C/min. Le gaz vecteur est l'hélium
dont le débit est fixé à 1,5 ml/min. Le mode d'injection
est split (rapport de fuite: 1/70, débit 112 ml/min). L'appareil est
relié à un système informatique gérant une
bibliothèque de spectres de masse NIST 98. L'identification des
constituants a été réalisée en se basant sur les
spectres de masses, les données de la littérature et les Indices
de Kovat's.
2.2.6. Evaluation du taux d'infestation du Varroa dans le
Gharb
Afin d'avoir une idée sur le taux d'infestation du
Varroa dans les ruches du Gharb où a eu lieu le test bio-insecticide des
HE de thym, on a évalué le taux d'infestation aussi bien dans le
couvain mâle que sur les abeilles adultes (Varroas
phorétiques) avant et après les traitements aux HE par
différentes méthodes. Cette évaluation du taux
d'infestation a été réalisée sur deux ruchers, l'un
à Sidi Yahya et l'autre à Kénitra. Une partie de
l'expérimentation a eu lieu sur le terrain et une autre partie au
laboratoire de l'ENFI.
2.2.6.1. Echantillonnage des Varroas
phorétiques
Cette méthode est celle de Cantin (2014) avec quelque
modification. Les échantillons ont été
prélevés au niveau d'un rucher à Nkharkhssa
(Kénitra) et au niveau d'un autre rucher à Sidi Yahya.
Principe d'échantillonnage
Les Varroas qui sont portés sur le corps des
abeilles ouvrières ou faux bourdons sont appelés « varroas
phorétiques ». Le comptage de ces Varroas, sur un
échantillon donné d'abeilles adultes permet de déterminer
un taux d'infestation de l'échantillon prélevé. Ces
Varroas sont détachés de leurs hôtes par des
« lavages », puis sont comptés. Ce nombre peut être
rapporté au nombre d'abeilles collectées, pour exprimer le taux
d'infestation des abeilles échantillonnées. Sur des cadres de
couvain ouverts de différentes ruches, on a prélevé des
abeilles et on les a mis dans un pot. On a ajouté ensuite de l'alcool
(Figure 15) et on a agité vigoureusement pendant 30 secondes. Le contenu
du pot est versé sur un double tamis (le 1er tamis laissant
passer les varroas mais pas les abeilles, 2ème tamis ne
laissant pas passer les varroas). Apres rinçage, on a
procédé au décompte des abeilles sur le 1er
tamis et des varroas sur le second tamis. Le
43
rapport entre le nombre de varroas et le nombre d'abeilles
permet de calculer un taux d'infestation moyen.

Figure 15. Abeilles adultes immergées dans de
l'alcool et double tamis pour séparer les abeilles des
Varroas
Lecture des résultats :
Selon Gatien et al. (2003), les seuils de dommage se
présentent comme suit :
- Au printemps, un taux d'infestation de 1% cause un impact
négatif sur la production de miel.
- Un taux de 2 à 5% abaisse significativement la
production de miel
- Un taux de 20% annule toutes possibilités de
récolte.
- Quel que soit la période, un taux > 5%
nécessite le recourt à un traitement efficace
2.2.6.2. Suivi des chutes naturelles de Varroas «
méthode de pose de langes »
Elle a été réalisée au niveau du
rucher d'Nkharkhssa (Kénitra).Cette méthode est celle figurant au
niveau de la Direction de la santé animale et de l'inspection des
viandes Quebec(2011)
Principe:
C'est une méthode simple qui s'effectue normalement
sans ouvrir la ruche, si celle-ci dispose d'une fente à la base. Elle
permet de compter le nombre de varroas qui tombent naturellement (notamment par
le nettoyage pratiqué par les abeilles) au fond de la
44
ruche. Il s'agit donc d'une estimation indirecte de
l'infestation. Mise en oeuvre au rucher:
La mesure du taux d'infestation a été
effectuée sur 15 ruches. Un carton graissé à la margarine
permettant de fixer les varroas tombés est glissé au fond de
chaque ruche (Figure 16). Le comptage des Varroas à l'aide
d'une loupe sur les cartons a eu lieu le 1er, 2ème et
6ème jour. A chaque comptage on renouvelle les cartons. Le
nombre de varroas compter est exprimé en «Varroas par
jour».

Figure 16. Insertion d'un lange graissé à
la margarine au fond d'une ruche
Lecture des résultats :
En printemps, si on a plus d'un varroa par jour, on fait
recourt à un traitement (Direction de la santé animale et de
l'inspection des viandes Quebec, 2011). En Europe centrale, le seuil de dommage
est fixé de 20 à 30 varroa/jour.
2.2.6.3. Comptage des Varroas piégés dans
le couvain mâle
Cette méthode est celle de Jean Maurice CANTIN (2014) avec
quelque modification. Les échantillons ont été
prélevés au niveau du rucher d'Nkharkhssa (Kénitra) et
celui de Sidi Yahya. Comptage des Varroas piégés dans le
couvain mâle à été effectué au laboratoire de
l'ENFI.
45
Principe
Les abeilles ont tendance à bâtir naturellement
du couvain mâle d'avril à juillet. L'entrée de nourriture
au printemps relance, en effet, l'activité des bâtisseuses.
Normalement, un simple cadre vide (sans fil et sans cire) est utilisé et
sur lequel des bâtisseuses construiront naturellement du couvain
mâle sachant que l'on peut retirer ce couvain mâle
préexistant pour stimuler ce comportement. Pour nos investigations, on a
tout simplement prélevé du couvain mâle au niveau des
ruches.
Mise en oeuvre
On a donc retiré le couvain mâle bâti et
complètement operculé et l'échantillon a été
ramené au laboratoire à l'Ecole Nationale Forestière
d'Ingénieurs. On a ensuite désoperculé les alvéoles
et on a récupéré les larves avec les varroas. Le comptage
permet de calculer le taux d'infestation.

Figure 17. Couvain mâle désoperculé
au laboratoire de l'ENFI
Lecture des résultats :
Selon Cantin (2014) :
- Si le taux est inférieur ou égale à 5 % de
varroas pas de danger immédiat ;
- Entre 5 et 10 % la colonie est sérieusement atteinte,
faire un traitement qui peut être différé ; - Entre 10 et
20 % la colonie est très sérieusement atteinte, faire un
traitement immédiat ;
- Plus de 20 % effondrement probable de la colonie dans les
quelques jours à quelques semaines suivantes.
46
2.2.7. Essais de traitements aux huiles essentielles de
Thymus satureioides
Les essais de traitement aux huiles essentielles de thymus
satureioides ont eu lieu dans le rucher du Gharb à El
Khéssasna. Le dispositif expérimental est composé de 15
ruches, disposé en bloc aléatoire et simple (Tableau 6).
Au total, 5 traitements ont été
réalisés (Figure 18):
? 1 traitement à l'huile essentielle de T.
satureioides de la provenance de Timoulay,
? 1 traitement à l'huile essentielle de T.
satureioides de la provenance d'Amskrod-Est,
? 1 traitement à l'huile essentielle de T.
satureioides de la provenance d'Aoulouz, ? 1 traitement par le Bayvarol
(produit de référence, homologué et commercialisé)
? 1 Témoin (pas de traitement)
Pour chaque traitement, on a prévu trois
répétitions
Tableau 6. Dispositif expérimental
|
Ruches
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
HE
|
Produit
|
HE
|
HE
|
Témoins
|
|
Traitements
|
(Timoulay)
|
Bayvarol
|
(Amskrod Est)
|
(Aoulouz)
|
|

Figure 18. Huiles essentielles ( à gauche) et
Bayvarol ( à droite) testé au rucher d'Nkharkhssa
(Kénitra)
Des bandelettes confectionnées en papier absorbant ont
été imbibées de 5 ml d'huiles essentielles et ont
été insérés dans les ruches (Figure 19). Les
bandelettes de Bayvarol ont été introduite dans les ruches telle
que indiqué dans la notice d'utilisation. Les ruches témoins
n'ont subit aucun traitement.
47

Figure 19. Bandelette en papier absorbant
imbibée d'huile essentielle (5 ml) et installée entre les cadres
de la ruche.
Au fond de la ruche on distingue le lange de carton
graissé à la margarine pour piéger les Varroas en
chute.
Des langes graissés à la margarine ont
été insérées au fond des ruches afin de fixer les
varroas qui chutent. Le comptage des Varroas sur les langes a
été effectué le 1er ,2ème et
6ème jours. A chaque comptage, l'emplacement des bandelettes a
été revérifié et les langes ont été
renouvelés. Les taux d'efficacité ont été
calculés en prenant compte des varroas décrochés
naturellement en l'absence de traitement et le chiffre moyen pris en
considération est celui de 0,4 varroas/jour/ruche
déterminé pour l'évaluation de l'infestation au rucher (15
ruches). L'efficacité des traitements est calculée comme suit:
(cf. réf: Recommendations from the CA3686 Working
group).
|
Efficacité (%) = 100 x
|
Nbre moy. de varroas/jour décrochés
après traitement
|
|
Nbre moy.de varroas/jour décrochés
avant et après traitement
|
Le lange est disposé directement au-dessus du fond de
la ruche, donc en contact direct avec les abeilles. Selon le protocole
cité par «Santé de l'abeille : Protocole de traitement
anti-varroa à l'Amitraz (Taktic) ,(Var Apiloisir,2014),
48 heures représente le temps maximum entre le traitement et le comptage
(activité de nettoyage, fourmis, parasites...).
2.2.8. Traitement des données
Les données recueillis ont été
analysé par le logiciel SPSS 22.0 et le tableur Excel sous Microsoft
office 2013.
48
Partie 3 : Résultats et discussions
49
3.1. Typologie de l'apiculture et modalités de
l'infestation par le Varroa
L'enquête a pu fournir une quantité non
négligeable d'informations concernant toute la pratique apicole dans la
région. Nous présentons ci-après, par rubrique, les
résultats obtenus auprès des coopératives apicoles. Le
fichier Excel de l'enquête est en annexe.
3.1.1. Typologie de l'apiculture et modalités de
l'infestation par le Varroa dans la province de Taroudant
3.1.1.1. Pratique apicole
Identification et caractéristiques des ruchers
> 60% des enquêtés adhèrent à des
coopératives et 40% sont des particuliers.
> Appartenance géographique des enquêtés:
14% à ouled Berhil, 14% à Tamloukt,
14% à Ait Iazza, 14% à Ighrem, 14% à Lasta
et 30 % à Ouled Aissa.
> Tous les ruchers des enquêtés étaient en
transhumance.
> Les ruches utilisées sont du type moderne «
Langstroth ».
> Les dates d'installation des élevages sont
très variables. Elles couvrent la
période 1998-2011.
> Les races d'abeilles utilisées pour les
élevages sont:
? Race jaune (Apis mellifica sahariensis) (57%)
? Race hybride (Apis mellifica sahariensis x Apis
mellifica intermissa) (43%).
> Le nombre de ruche/élevage reste variable et est
compris entre 60 et 500.
> L'effectif moyen d'abeilles par ruche varie entre 20 000
et 40 000 (une dominance de 24 000 (43%).
> La production moyen annuel / ruche reste variable de
5kg/an à 20 kg/an. Critères utilisés pour le choix de
l'emplacement des ruchers
Les principaux critères utilisés pour le choix
de l'emplacement des ruchers se présentent comme suit : Exposition
(17%), floraison (17%), proximité des cultures (14%), ensoleillement
(12%), proximité de point d'eau (12%), proximité d'un verger
(7%), abris des vents (5 %)
Disposition et gestion des ruchers
> 42% des enquêtés ont déposés
leurs ruches au sol et en zigzag, > 29% ont déposé leurs
ruches au sol et en rangée,
> 29% ont leurs ruches surélevé et en zigzag.
50
> 57 % des enquêtés ont opté pour une
ouverture de la ruche vers l'Est (au levé du soleil) pour avoir un
ensoleillement doux,
> 43% des enquêtés ont opté pour une
ouverture au Sud pour éviter le Chergui (vent d'Est chaud).
> L'écartement entre les ruches varie de 0,5
à 2 m avec une fréquence élevée à 1,5 m
(29%) et à 2 m (29%).
> Les distances séparant les ruchers sont comprises
entre 500 m et 2000m avec un fort pourcentage à 2 000m (71%).
Nourrissage des abeilles
Pour l'ensemble des enquêtés, le nourrissage des
abeilles s'effectue à base du sucre à foyer.
57% ont opté pour un nourrissage individuel contre 43 %
pour un nourrissage collectif. La période de nourrissage est comprise
entre Octobre et Février selon les proportions suivantes : Octobre
(13%), Novembre (20%), Décembre (40 %), Janvier (20%) et Février
(7%). Bref, le nourrissage des abeilles s'effectue exclusivement durant la
période d'hivernage.
Méthode et efficacité des traitements contre la
varroase
> Les produits et méthodes de traitement
utilisées par les apiculteurs sont :
- Apiguard (50%) (par simple dépôt au fond de la
ruche, bandelettes, ou
encore application sur les cadres),
- Klartan (20%) (par pulvérisation),
- Bayvarol (10%) (bandelettes),
- Ectaz (10%) (par fumigation),
- le Thym broyé (10%) (application sur les cadres).
> Les périodes de traitement sont comprises entre
Octobre et Janvier.
- Octobre (17%)
- Novembre (8%),
- Décembre (50%)
- Janvier (25%).
> L'efficacité des traitements pour tous les produits
est forte.
> La mortalité des abeilles par toxicité est
toujours constatée:
- Risque de mortalité des abeilles faible (63%)
51
- Risque de mortalité des abeilles moyen (37%).
? Selon les apiculteurs plus la méthode d'application
inscrite dans la notice est respectée plus le traitement est efficace
mais aucun produit n'élimine le Varroa à 100%.
Transhumance
? Les transhumances dans la région sont
fréquentes. Les différentes localités et la
fréquence des transhumances se présentent comme suit: Ighram
(15%), Oussa (7%), Aït Baamrane (7%), Tamaloukt (7%), Oulad Aissa (7%),
Aït Daoud(4%), Aoulouz (4%), Asni (4%), Benil Mellal (4%), Essaouira(4%),
Haut Atlas ounaine (4%), Ifni(4%) , Imintanoute (4%), Imozzar Ida (4%),
Indouzane (4%), Lasta (4%), Massa(4%), Oulad Berhil (4%), Ouzioua (4%),
Région Goulmim (4%).
? Les espèces mellifères recherchées par les
apiculteurs sont :
- Euphorbia resinifera (Euphorbe) (33%),
- Thymus satureoides(26%),
- Citrus sinensis (Oranger) (22%),
- Divers (mélange d'espèces mellifère)
(11%),
- Prunus dulcis (Amandier) (4%),
- Carlina gummifera (chardon) (4%).
? Les périodes de transhumance coïncident avec les
périodes de floraison des espèces mellifère afin de
produire leur miel respectif:
- La transhumance sur le thym s'effectue en été
et dure en moyenne 50 jours.
- Sur les Euphorbes, elle s'effectue de juin à
septembre et dure près de 45 jours
- Sur les orangers, elle reste très variable (janvier
à juin) et dure en moyenne 95 jours.
- La transhumance sur le chardon s'effectue d'avril à
juin et dure près de 45 jours.
- Dans les espèces mellifères
hétérogènes sauvages (diverses), elle s'effectue de
janvier à juin et dure approximativement 30 jours.
52
? La récolte du miel s'effectue pendant le séjour
des ruches au niveau des espèces
mellifères. En hiver, c'est le retour à domicile
des ruches pour l'hivernage et les
traitements. Les traitements ne s'effectuent pas en
période de transhumance pour
éviter la contamination du miel par les produits
chimiques.
- La production moyenne du miel sur les fleurs sauvages est de
1kg/ruche,
- Sur les euphorbes, 5,5 kg/ruche,
- Sur le chardon, 8 kg/ruche,
- Sur le thym, 1 kg/ruche,
- Sur les orangers, 10,5 kg/ruche.
? Agressivité des abeilles: (Selon les apiculteurs,
l'agressivité serait liée à
l'élevage du couvain)
- Sur oranger et amandier (100% des enquêtés
affirment que l'agressivité
des abeilles est élevée) car la période de
transhumance au niveau de ces
espèces mellifères coïncide avec
l'élevage du couvain.
- Sur le thym (86%, agressivité moyenne et 14%,
agressivité faible).
- Sur les Euphorbes, (70%, agressivité, 15%,
agressivité faible, et 15%,
agessivité élevée.
- Sur les fleurs sauvages, agressivité reste variable
(fort, moyen, faible
avec une proportion de 33% chacune).
- Sur chardon, (100%, agressivité faible).
? Le risque d'infestation existe quelque soit l'espèce
mellifère :
- Sur le thym, 86% des apiculteurs ont affirmé que le
risque d'infestation
est moyen contre 14% qui affirment qu'il est
élevé,
- Sur les fleurs sauvages, 67 % affirment qu'il est moyen,
- Sur les orangers 50% affirment qu'il est constant et 50%
affirment qu'il
est élevé
- Sur les amandiers et les chardons, le risque est
élevé à 100%,
- Sur les Euphorbes, 87% affirment que le risque est constant.
? La varroase se manifeste par l'apparition d' ailes
mutilées chez les abeilles et
tous les apiculteurs questionnés affirment qu'ils
effectuent un dépistage par
observation directe (à l'oeil nu).
53
Cycle d'activité des abeilles
? Repos :
Selon les apiculteurs, la période de repos des abeilles
est variable et est comprise entre septembre et février avec les
proportions suivantes : Septembre (7% des apiculteurs), Octobre (26%), Novembre
(26%), Décembre (26%), Janvier (12%), Février (4%).
? Elevage du couvain :
La période de l'élevage du couvain est variable
et peut avoir lieu à tout moment de l'année. Elle dépend
des conditions de vie (nourriture, température idéal,
élevage de la reine..). Selon les résultats de notre
enquête l'établissement du couvain s'effectue
généralement de janvier à Mai [janvier (16% de
apiculteurs), Février (16%), Mars
(16%), Avril (13%), Mai (10%)].
? Essaimage
Selon les apiculteurs la période d'essaimage est
comprise entre Février et Mai : Février (20% des apiculteurs),
Mars (35%), Avril ( 35%), Mai( 10%).
? Constitution de réserves
La période dominante de la constitution des
réserves est comprise entre Avril et septembre (14% des apiculteurs pour
chaque mois). Pour les autres mois les proportions se présentent comme
suit : Février (2%), Mars (10%), Novembre (2%), Décembre (2%).
? Apparition des faux-bourdons
L'apparition des faux-bourdons peut s'effectuer de Janvier
à juillet, la période la plus propice est comprise entre
Février et Mai [Février (15% des apiculteurs), Mars (27%),
Avril (23%), Mai (15%)]. Les proportions pour les autres mois
sont : Janvier (8%), Juin (8%), Juillet (4%).
54
3.1.1.2. Etat sanitaire de l'abeille pendant la
période d'installation du rucher au niveau des populations de Thymus
satureioides
? Méthode de diagnostic du Varroa
utilisée par les apiculteurs
La méthode utilisée à l'unanimité
est l'observation directe à l'oeil nu de l'état ou du
comportement de l'abeille (ailes mutilées, comportement
désorienté des abeilles, observation du Varroa
phorétique sur les abeilles)
? Ruches non traitées arrivant saines sur les
populations de thym
- 42% des apiculteurs affirment que le risque d'infestation est
faible,
- 29% affirment que le risque est moyen.
- 29% affirment que le risque est fort.
Dans ce cas, 86% des apiculteurs affirment qu'un traitement
n'est pas nécessaire (car la baisse de la population de Varroa se fera
naturellement et pour éviter aussi la contamination du miel par les
produits) et contre 14% qui affirment qu'un traitement est
nécessaire.
- En début de séjour, 86% des apiculteurs
affirment que l'agressivité des abeilles est forte (période
d'adaptation au milieu) contre 14 % qui affirment qu'elle est moyenne.
- En plein séjour, 86% des apiculteurs affirment que
l'agressivité des abeilles est faible (absence de couvain, absence de
nourriture, faiblesse de la colonie) contre 14% qui affirment qu'elle est
moyenne.
- A la fin du séjour, les apiculteurs affirment
à l'unanimité que l'agressivité des abeilles est faible
(absence de couvain, absence de nourriture, faiblesse de la colonie).
- Au retour du rucher à l'emplacement principal, tous
les apiculteurs affirment que la force des colonies est faible à cause
de l'épuisement des abeilles. 86% témoignent que les ruches sont
intactes contre 14 % qui disent qu'elles sont infestées. En effet la
transhumance dans les populations de thym s'effectue en été dans
les conditions climatiques extrêmes (chaleur). 14% des apiculteurs
affirment que la chaleur serait responsable de l'effondrement des populations
d'abeilles et des varroas contre 86% qui affirment que la baisse de la colonie
des varroas serait due aux vertus médicinales du thym. Le pourcentage de
ruche
55
infesté/ruchers est de 0% pour 86% des apiculteurs
contre 100% pour 14% des apiculteurs. Selon ces derniers une baisse de la
colonie des varroas est observée mais le varroa existe toujours dans les
ruches. 71% des enquêtés disent que l'état du couvain est
régulier contre 29% qui disent qu'il est en mosaïque. L'état
régulier du couvain témoigne une bonne santé des
ruches.
? Ruches traitées arrivant saines sur les
populations de thym
? Tous les apiculteurs affirment que le risque d'infestation
est faible et qu'un traitement n'est pas nécessaire.
? En Début de séjour, 86% des apiculteurs
déclarent que l'agressivité des abeilles est fort (période
d'adaptation au milieu) contre 14 % qui disent qu'elle est moyenne.
? En plein séjour et à la fin du séjour,
100% des apiculteurs affirment que l'agressivité des abeilles est faible
(absence de couvain, absence de nourriture, faiblesse de la colonie).
? Au retour du rucher à l'emplacement principal, 86%
des apiculteurs affirment que la force des colonies est faible à cause
de l'épuisement des abeilles contre 14% qui témoignent qu'elle
est moyenne.
? 86% des enquêtés déclarent que les
ruches sont intactes contre 14 % qui disent qu'elles sont infestés. Tous
les apiculteurs affirment que le degré d'infestation par le varroa est
faible. En effet la transhumance dans les populations de thym s'effectue en
été (période de chaleur extrême).14% des apiculteurs
affirment que la chaleur serait responsable de l'effondrement des populations
d'abeilles et des varroas contre 86% qui affirment que la baisse de la colonie
des varroas serait du aux vertus médicinales du thym. Tous les
enquêtés disent que l'état du couvain est régulier.
L'état régulier du couvain témoigne une bonne santé
des ruches. Le pourcentage de ruches infestés/ruchers est de 0% pour 86%
des apiculteurs contre 100% pour 14% des apiculteurs. Selon ces derniers une
baisse de la colonie des varroas est observée mais le Varroa
existe toujours dans les ruches et aucune ruche n'est indemne.
56
? Ruches arrivant infestées par le varroa sur les
populations de thym
- 57% des apiculteurs témoignent que le risque de
contamination des autres ruches est fort contre 43% qui disent que le risque
est moyen à cause de la période estival et de la présence
du thym.
- Dans ces conditions, 86% des enquêtés disent
qu'un traitement n'est pas nécessaire pour éviter la
contamination du miel contre 14 % qui disent qu'un traitement est
indispensable.
- En cas de non traitement ou en cas de traitement 14 % des
apiculteurs disent que 100% des ruches restent infestées mais on
constate une baisse de la population de Varroa en cas de traitement.
Le reste des apiculteurs (86%) sont sans avis à ce sujet.
Evolution de l'état du Rucher pour les ruches arrivant
infestées sur les populations de thym ? Evolution de
l'état du rucher en cas d'infestation forte ou moyenne.
Tous les apiculteurs affirment qu'il y a une diminution du niveau
d'infestation par le Varroa durant le séjour des ruches dans le
thym.
- En début du séjour, 86% des apiculteurs
déclarent que la vigueur des abeilles est faible à cause de la
forte ou moyenne infestation par le Varroa contre 14% qui disent
qu'elle est moyenne.
- En plein séjour, 86% des enquêtés disent
que la vigueur des abeilles est moyenne à cause de la baisse de
l'infestation par le Varroa contre 14% qui disent qu'elle est
forte.
- A la fin du séjour, les apiculteurs disent à
l'unanimité que la vigueur des abeilles est forte à cause d'une
baisse considérable de la population de Varroa.
57
? Evolution de l'état du rucher en cas d'infestation
Faible.
86% des apiculteurs affirment qu'il ya une diminution de
l'infestation car il ya une baisse de la population de Varroa durant
le séjour des ruches dans le thym contre 14% qui disent qu'il y a
plutôt une stabilité de l'infestation. Selon ces derniers, le
Varroa restera et existera toujours dans les ruches.
? En début du séjour, 86% des apiculteurs
déclarent que la vigueur des abeilles est faible à cause de
l'infestation par le varroa contre 14% qui disent qu'elle est moyenne.
? En plein séjour, 86% des enquêtés disent
que la vigueur des abeilles est moyenne à cause de la baisse minime de
l'infestation par le varroa contre 14% qui disent qu'elle est faible.
? A la fin du séjour, 86% des apiculteurs disent que la
vigueur des abeilles est forte à cause d'une baisse considérable
de la population de varroa contre 14% qui disent qu'elle est faible.
Fin de récolte et hivernage
A la fin de la récolte, 57 % des apiculteurs affirment
qu'un traitement n'est pas indispensable (obligatoire) contre 43% qui disent
qu'un traitement est indispensable afin de pouvoir limiter encore plus la
population de Varroa et améliorer l'état sanitaire des
ruches pour les futures transhumances.
Les apiculteurs déclarent à l'unanimité
que d'autres maladies n'ont pas été constatées mais dans
des cas exceptionnels de manifestation de la fausse teigne, de la loque
américaine (transhumance en milieu humide), ou l'apparition de couvain
calcifié causée par les chocs thermiques.
58
3.1.2. Typologie de l'apiculture dans la région du
Gharb: calendrier apicole et cycle de l'abeille
3.1.2.1. Critères utilisés pour le choix de
l'emplacement du rucher Le rucher est installé :
- A proximité des plantes fleuries et d'un point d'eau,
- Loin des agglomérations, de la route et des points d'eau
des autres apiculteurs, - Dans un endroit ensoleillé, l'ouverture de
ruche est orientée vers l'Est (lever du
soleil)
- La distance idéale entre le rucher et les autres
ruchers à proximité est de 1 Km, mais parfois seulement 600
mètres vue le nombre élevé des apiculteurs dans la
région du Gharb.
3.1.2.2. Disposition et gestion du rucher
Les ruches sont surélevées par rapport au sol
pour favoriser l'aération et protéger la ruche de l'attaque des
insectes (fourmis par exemple).Elles sont disposées en rangées,
la distance entre ruches est de 1 m et entre lignes est de 2m pour
facilité l'orientation des abeilles et permettre leur retour à la
ruche d'origine. L'ouverture des ruches est exposée vers l'Est, face au
lever du soleil.Cela permet un réchauffement matinal de la ruche pour
exciter les abeilles à travailler tôt le matin et de même
pour faciliter l'orientation de l'abeille par rapport au rucher.
59
3.1.2.3. Calendrier apicole
? Le nourrissage
Le nourrissage est réaliser collectivement avec du
sirop de glucose et du sucre au foyer (pour certaines ruches) depuis le
début de novembre jusqu'au mois de février.
Pendant le mois de février le pourcentage d'eau est
diminué dans la nourriture pour stimuler la reproduction des abeilles.
Le renouvellement de la reine est réalisé chaque deux ans. Les
reines non agressives sont sélectionnées pour la reproduction.
? Le traitement sanitaire
Deux traitements sont réalisés en dehors de la
période de miellée, le premier pendant la mi-août et le
second vers la fin de l'hiver (la veille de la compagne de reproduction). Le
produit utilisé est le BAYVAROL sur des bandelettes qui sont
disposées en position perpendiculaire entre les cadres. En seconde
année, le produit utilisé est changé par un autre, c'est
le KLARTAN, pour éviter à ce que le Varroa
développe une résistance aux produits utilisés.
Les deux produits, le BAYVAROL et le KLARTAN, n'ont pas
d'effets toxiques pour la race d'abeille utilisée et ont un effet
toxique moyennement fort pour le Varroa.
Deux centilitres de KLARTAN sont dilués dans 1000 cl
d'eau. ? Calendrier apicole et transhumance
60
Tableau 7.Calendrier apicole et transhumance dans le
Gharb
|
Localité
|
Maamora
|
Sidi Slimane
|
Had Kourt (Gharb)
|
Affaiblissement de la colonie par le facteur de la chaleur et la
réduction du nombre d'abeilles dans la colonie. La durée de vie
d'une ouvrière est réduite à 45 jours, alors qu'en hiver
sa durée de vie est estimée à 90 jours
|
Haut Atlas Occidental, ou le Rif en fonction des conditions
climatiques de chaque année
|
Doukkala
|
|
Période
|
Fin janvier-fin avril
|
Fin Mars- fin Avril
|
Fin Avril-fin juin
|
Fin juin-fin juillet
|
Mi Aout-fin octobre
|
|
Espèce mellifère dominante
|
E. camaldulensis
|
Agrumes
|
Toues fleurs (Ammi visnaga, jujubier, etc)
|
Thym du Sud/ origan du Nord (Rif)
|
E.
gomphocephala
|
|
Durée de transhumance
|
90 jours
|
21 jours
|
90 jours
|
30 jours
|
75 jours
|
|
Période de récolte
|
Fin avril
|
Fin avril
|
Fin juin
|
Fin juillet
|
Fin octobre
|
|
Production par ruche
|
10 kg
|
20 à 25 kg
|
5 à 7 kg
|
3 à 4 kg
|
10 kg, une partie non négligeable de miel est
laissée aux abeilles pour l'entrée en hivernage
|
|
Agressivité des abeilles
|
Non agressives
|
Non
agressives
|
Non agressives
|
Non agressives
|
Non agressives
|
|
Etat de santé
|
Bonne santé
|
Bonne santé
|
Bonne santé
|
Origan : bonne santé
Thym : faible
|
Regain de santé, et augmentation du nombre d'abeilles dans
les colonies suite à la reprise des pontes par les reines
|
|
Risque
d'infestation
|
En cas de traitement, pas de risque
Au cas contraire, il ya risque élevé
|
En cas de traitement, pas de risque
Au cas
contraire, il ya risque élevé
|
Risque plus faible à cause de la chaleur
|
Risque plus faible
|
Un traitement est réalisée avant la miellée,
le risque est par conséquent plus faible
|
|
Symptômes et apparition du varroa
|
Abeilles sans ailes, varroa sur les abeilles, couvain
perturbé
|
Abeilles sans ailes, varroa sur les abeilles, couvain
perturbé
|
|
Nbre de ruches infestées/au nbre total
|
En cas de traitement, 0% Au cas contraire, 100%
|
En cas de traitement, 0% Au cas contraire, 100%
|
Moins de 10 % des abeilles sont infestées par le varroa
|
Moins de 10 % des abeilles sont infestées par le varroa
|
En cas de traitement, 0% Au cas contraire, 100%
|
61
L'Eucalyptus gomphocephala est un passage clef pour
les apiculteurs et pour les reines des abeilles. Vers la fin du mois de
juillet, les colonies sont épuisées et le couvain est
réduit à son minimum suite à l'arrêt des pontes des
reines par manque de nectar. L'E. gomphocephala par sa floraison
abondante, tardive (de Mi Aout-fin octobre) et son nectar riche permet aux
apiculteurs de prolonger la période de production du miel, mais surtout
de renforcer leur colonies, avant d'entrer en hivernage, par la constitution
des réserves en miel, le regain de santé et le renforcement du
nombre d'abeilles dans les couvains suite à la reprise des pontes par
les reines. Une colonie qui entre forte en hivernage résiste mieux au
Varroa qu'une colonie faible. Malheureusement, la majorité des
reboisements d'E. gomphocephala ont été exploités
dans la région de la Maamora et du Gharb et remplacées par
d'autre espèces qui ne présentent pas un tel intérêt
pour les apiculteurs. Alors, que cette espèce est actuellement
très recherchée pour sa qualité de bois qui est
utilisé en menuiserie navale. Les apiculteurs du Gharb, conscients de
l'intérêt du gomphocephala pour leurs ruchers, sont
obligés de se déplacer jusqu'à la région de
Doukkala à la recherche des rares plantations pour cet espèce.
? Cycle de l'abeille
- Le repos: fin de novembre à la
mi-janvier
C'est la période propice d'infestation des abeilles par
le Varroa. Pendant cette période, les colonies sont
généralement faibles
- L'établissement du couvain:
Mi-janvier à la mi-février
La métamorphose d'une ouvrière dure 21 jours,
pendant l'hiver sa durée de vie est estimée à 90 jours et
pendant l'été, elle est réduite à 45 jours.
Le traitement est réalisé avec des bandelettes
pendant 4 semaines pour couvrir la période d'élevage du
couvain.
- L'essaimage : Mi-février
à fin avril
En phase de transhumance sur les agrumes, les apiculteurs sont
obligés de suivre quotidiennement le couvain pour éviter
l'essaimage
- Constitution de réserve:
mi- août à fin octobre
- Apparition des faux-bourdons : Fin-
janvier à fin avril
62
3.1.3. Synthèse
L'enquête a eu lieu auprès des apiculteurs et des
coopératives. Elle a porté sur la conduite du rucher et les
modalités d'infestation par le Varroa dans des peuplements de
thym.
Au terme de l'enquête, concernant la conduite du rucher,
les informations suivantes ont été recueillies :
L'exposition, la floraison, la proximité des cultures,
l'ensoleillement et les points d'eau sont autant de critères principaux
pour le choix de l'emplacement des ruchers. Des apiculteurs posent leurs ruches
au sol ce qui les rend propices aux attaques de prédateurs et en zigzag
(en désordre) ce qui rend le contrôle difficile et mal
organisé. L'ouverture des ruchers est à l'Est au levé du
soleil pour avoir un ensoleillement matinal doux, ou au Sud pour éviter
le Chergui. Les distances séparant les ruchers sont comprises
entre 500 m et 2000 m, donc les problèmes de contaminations
inter-ruchers sont probables. Les ruches utilisées sont de type moderne
Langstroth. Elles se prêtent facilement aux opérations
régulières de contrôle. Le nombre de ruche/élevage
reste variable et est comprise entre 60 et 500. Les races d'abeilles
utilisées pour l'élevage sont Apis mellifera intermissa
dans la région du Gharb, la race jaune (Apis mellifera
sahariensis) et la race croisée (Apis mellifera sahariensis x
Apis mellifera intermissa) dans la province de Taroudant. Ces
dernières sont connues par leur résistance aux maladies (Kefuss
et al. 2004).
Le nourrissage des abeilles s'effectue individuellement ou en
collectif à base du sucre à foyer, la période de
nourrissage est comprise entre Octobre et Février à Taroudant et
à partir de Novembre à Février au Gharb.
La production moyenne annuelle de miel / ruche reste variable
(5kg/an à 25 kg/an) et dépend de l'espèce
mellifères (production plus importante sur agrumes).
A propos du cycle d'activité de l'abeille :
? L'établissement du couvain s'effectue en
général de Janvier à Mai, et c'est la période
propice pour l'installation du Varroa dans le couvain,
? L'essaimage s'effectue de Février à Mai, c'est
l'occasion de dépister l'infestation et de procéder au besoin
à un traitement.
Pour ce qui est de l'effet du séjour des ruchers sur le
thym dans la province de Taroudant, il ressort clairement des réponses
des enquêtés que ce dernier assure une
63
? La période dominante pour la constitution des
réserves est comprise entre Avril et Octobre, c'est
généralement une phase durant laquelle un traitement est à
proscrire.
? L'apparition des faux-bourdons s'effectue de Janvier
à juillet; un dépistage au niveau du couvain mâle
operculé est opportun au début de cette phase pour effectuer un
éventuel traitement.
? La période de repos des abeilles est variable et est
comprise entre septembre et février. Durant cette phase un
dépistage du Varroa phorétique est
préconisé pour juger du niveau de population du parasite.
A Taroudant, un seul traitement est effectué entre
octobre et janvier. Cependant, dans le Gharb deux traitements sont
effectués, l'un à la mi-août, avant la reconstitution des
colonies et l'autre en hivers. Ces traitements sont donc bien calés sur
les niveaux de populations importants du Varroa, alors
phorétique. La panoplie de produits de traitements reste cependant
limitée (L'Apiguard, le Klartan, le Bayvarol et le Thym broyé
(méthode artisanale) sont les produits les plus utilisés par les
apiculteurs). L'efficacité des traitements effectués est
forte.Néanmoins il a été constaté qu'il y a souvent
la mortalité d'abeilles par toxicité, ce qui suppose des
problèmes de surdosage. Ces traitements n'arrivent pas à
éradiquer le parasite, ce qui sous-entend que des opérations de
dépistage régulières sont nécessaires pour
raisonner la lutte.
L'infestation par le Varroa s'effectue le plus
souvent lors des transhumances. La méthode utilisée à
l'unanimité par les apiculteurs pour diagnostiquer la varroase est
l'observation directe à l'oeil nu de l'état ou du comportement
des l'abeille (ailles mutilées, comportement désorienté
des abeilles, observation du Varroa phorétique sur les abeilles). Cette
façon de procéder est peu rigoureuse sachant que l'essentiel de
l'infestation se fait en cachette au sein du couvain (Fries et al.
1994). Lorsque les abeilles se retrouvent mutilées cela veut dire
que l'infestation est déjà arrivée à son maximum.
Des dépistages réguliers au niveau des ruches (chutes naturelles
des varroas phorétiques, diagnostic au niveau du couvain mâle)
sont primordiaux pour estimer l'infestation réelle par le Varroa
selon les différentes phases de la vie de l'abeille et agir en
conséquence pour assurer la continuité de la colonie.
64
immunité à l'abeille vis-à-vis du
Varroa. Une colonie y arrivant saine, elle le reste par la suite, y
arrivant atteinte, le niveau d'infestation baisse, plus encore, ce
séjour lui assure une vigueur et une immunité par la suite. 57 %
des apiculteurs affirment qu'un traitement n'est pas indispensable
(obligatoire) devant l'amélioration de l'état sanitaire des
ruches pour les futures transhumances. Toutefois, certains apiculteurs mettent
en exergue l'effet néfaste par épuisement des hautes
températures de la région pendant le séjour aussi bien
pour les colonies d'abeilles que pour les populations de Varroa.
3.2. Caractérisation chimique des huiles
essentielles de Thymus satureioides
3.2.1. Rendement en huiles essentielles
Les rendements en huiles essentielles des différentes
provenances de thym, récoltées dans la province de Taroudant,
sont illustrés dans le tableau 7.
Tableau 8. Rendement en HE des différentes
provenances de Thymus satureioides
|
Rendement Moyen en HE (%)
|
Ecart-type
|
|
Ouled Berhil (1240 m)
|
2,32a
|
0,275
|
|
Amskrod Est (1050 m)
|
2,16 a
|
0,382
|
|
Amskrod Ouest (1050 m)
|
1,73a
|
0,225
|
|
Aoulouz (1020 m)
|
2,02a
|
0,239
|
|
Timoulay (850 m)
|
1,35 b
|
0,287
|
|
Ankrim (320 m)
|
2,15a
|
0,265
|
a=Il n'ya pas de différence
significative au seuil á = 5% ; b=la différence
est significative au seuil á = 5%
Le thym de la province de Taroudant donne un rendement en
huiles essentielles variant entre 1,35% et 2,32% en fonction de la
provenance. Les analyses statistiques ont montré qu'il n'ya pas
de différence significative dans la teneur en huiles essentielles entre
les différentes provenances excepté celle de Timoulay où
le rendement est plus bas. D'après ces résultats. La production
en huiles essentielles de Thymus satureioides n'est pas
influencée par l'effet de l'altitude et de la continentalité.
Les rendements obtenus, dans le cadre de notre travail pour
Thymus satureioides, sont largement supérieurs par rapport aux
rendements observés dans le cadre d'autres travaux
réalisés sur les thyms au Maroc. El Ouali Lalami A. et
al. (2013) rapportent des rendements de 0,5% et 1,1% (par rapport à
la matière sèche) respectivement pour Thymus vulgaris et
Thymus satureioides. Selon Amarti et al. (2010) et El Ajjouri
et al.
65
(2010), Thymus ciliatus donne un rendement en huiles
essentielles estimé à 1,2%, Thymus algeriensis donne un
rendement en HE d'environ 0,3% et Thymus bleicherianus donne un
rendement moyen en HE de l'ordre de 1,75 %.
3.2.2. Composition chimique des HE de Thymus
satureioides
3.2.2.1. Propriétés chimiques des
Provenances
Les analyses chromatographiques des huiles essentielles de
Thymus satureioides ont permis de mettre en évidence une grande
variabilité dans la teneur des constituants chimiques en fonction des
provenances. Toutefois, le borneol reste le composé majoritaire et
caractéristique de ce thym. Le tableau 9 donne la composition chimique
détaillée des huiles essentielles étudiées.
66
Tableau 9. Principaux composés chimiques des HE
des différentes provenances de Thymus satureioides
|
N°
|
RT
|
DB5
|
IK
|
Composés
|
Pourcentage
|
|
Ankrim (320m)
|
Timoulay (850m)
|
Aoulouz (1020m)
|
Amskrod Est(1050m)
|
Amskrod Ouest(1050m)
|
Ouled
Berhil(1240m)
|
|
1
|
5,1
|
301
|
926
|
Tricyclene
|
0,57
|
0,05
|
0,99
|
0,65
|
0,64
|
1,05
|
|
2
|
5,26
|
307
|
931
|
alpha-thujene
|
5,86
|
0,11
|
5,86
|
4,81
|
6,1
|
7,28
|
|
3
|
5,51
|
340
|
939
|
Camphene
|
11,9
|
1,14
|
10,6
|
9,66
|
12,39
|
13,18
|
|
4
|
5,93
|
379
|
976
|
Sabinene
|
0,98
|
0,04
|
1,11
|
0,85
|
1,01
|
1,45
|
|
5
|
6,06
|
386
|
980
|
beta pinene
|
-
|
-
|
0,37
|
0,18
|
0,12
|
0,29
|
|
6
|
6,32
|
435
|
1005
|
alpha phellandrene
|
0,04
|
-
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
|
7
|
6,42
|
444
|
1011
|
delta 3 carene
|
-
|
-
|
0,02
|
0,01
|
-
|
0,01
|
|
8
|
6,5
|
457
|
1018
|
alpha-terpinene
|
0,27
|
-
|
0,33
|
0,28
|
0,24
|
0,36
|
|
9
|
6,63
|
471
|
1026
|
para-cymene
|
4,1
|
-
|
7,21
|
3,68
|
4,64
|
8,76
|
|
10
|
7,15
|
545
|
1062
|
gamma-terpinene
|
0,86
|
-
|
0,53
|
0,97
|
1,03
|
1,83
|
|
11
|
7,61
|
608
|
1088
|
Terpinolene
|
0,25
|
-
|
0,15
|
0,16
|
0,22
|
0,26
|
|
12
|
7,73
|
632
|
1098
|
Linalool
|
0,62
|
0,03
|
1,58
|
1,26
|
1,09
|
1,49
|
|
13
|
8,54
|
734
|
1143
|
Camphre
|
0,2
|
0,13
|
0,49
|
0,15
|
0,24
|
0,24
|
|
14
|
8,85
|
789
|
1165
|
Borneol
|
31,07
|
94,19
|
23,39
|
26,75
|
31,36
|
27,49
|
|
15
|
8,98
|
820
|
1177
|
Terpin-4-ol
|
1,97
|
-
|
1,62
|
1,49
|
2,05
|
2,17
|
|
16
|
9,17
|
852
|
1189
|
alpha-terpineol
|
14,27
|
1,08
|
4,31
|
12,93
|
14,97
|
12,57
|
|
17
|
9,87
|
968
|
1235
|
Thymol methyl ether
|
0,6
|
0,04
|
12,69
|
1,45
|
0,35
|
0,15
|
|
18
|
10,1
|
1011
|
1252
|
carvenone
|
-
|
-
|
0,03
|
0,02
|
0,01
|
0,03
|
|
19
|
10,5
|
1113
|
1290
|
Thymol
|
6,07
|
0,49
|
16,17
|
1,3
|
4,17
|
5,85
|
|
20
|
10,7
|
1137
|
1298
|
Carvacrol
|
8,22
|
0,9
|
1,59
|
21,38
|
6,44
|
4,75
|
|
21
|
11,8
|
1334
|
1376
|
alpha-copaene
|
0,14
|
0,06
|
0,4
|
0,14
|
0,17
|
0,22
|
|
22
|
12,4
|
1562
|
1467
|
9-epi-caryophyllene
|
4,16
|
0,24
|
3,92
|
5
|
4,71
|
4,96
|
|
23
|
13,5
|
1676
|
1513
|
gamma-cadinene
|
0,37
|
0,04
|
0,5
|
0,45
|
0,57
|
0,36
|
|
24
|
13,6
|
1700
|
1524
|
delta-cadinene
|
0,36
|
0,05
|
0,97
|
0,4
|
0,51
|
0,52
|
|
25
|
14,5
|
1837
|
1581
|
Caryophyllene oxyde
|
0,66
|
0,28
|
0,56
|
1,06
|
0,8
|
0,69
|
|
Total (%)
|
93,54
|
98,87
|
95,41
|
95,06
|
93,86
|
96
|
RT= Retention Time ; (-) = Absent ; DB5=Retention time on DB-5
column; IK=Indice de kovat's
- Provenance Ouled Berhil (1240m)
Les analyses chromatographiques des HE de la provenance
d'Ouled Berhil (1240 m) ont permis d'identifier 25 composés qui
représentent 96% de la composition chimique totale. L'HE de cette
provenance est composé principalement du borneol (27,49%), du camphene
(13,18%) et de l'á-terpineol (12,57%) accompagnés d'autres
constituants à
67
des teneurs relativement faibles : para-cymene (8,76%),
á-thujene (7,28%), thymol (5,85%), 9-epi-caryophyllene (4,96%),
carvacrol (4,75%) et terpin-4-ol (2,17%). Nous notons aussi la présence
d'autres composés à plus faible pourcentage comme le sabinene
(1,45%), la tricyclene (1,05%) et le delta-cadinene (0,52%), etc. Ces
composés de faible pourcentage totalisent environ 9% de la composition
chimique totale.
- Provenance Amskrod ouest (1050m)
Les analyses chromatographiques des HE de la provenance
d'Amskrod Ouest (1050 m) ont permis d'identifier 24 composés chimiques
qui représentent 93,86% de la composition chimique totale.
L'HE de cette provenance est composé principalement par
du borneol (31,36%), de l' á-terpineol (14,97 %) et du camphene (12,39
%), suivies d'autres constituants avec des teneurs relativement faibles :
carvacrol (6,44%), á-thujene (6,1%), 9-epi-caryophyllene (4,71%),
para-cymene (4,64%), thymol (4,17%), terpin-4-ol (2,05%). On note aussi la
présence d'autres composés à plus faible pourcentage comme
le linalool (1,09%), le camphre (0,24%), l'alpha-copaene (0,17%), etc. Ces
composés de faible pourcentage totalisent environ 7,3% de la composition
chimique totale.
- Provenance Amskrod Est (1050m)
Les analyses chimiques ont permis d'identifier 25
composés qui représentent 95,06% de la composition chimique
totale. L'HE de la provenance d'Amskrod Est est composée principalement
du borneol (26,75%), suivi du carvacrol (21,38%) et de l' á-terpineol
(12,93%); On note la présence d'autres constituants avec des teneurs
moyennement faibles: camphene (9,66%), 9-epi-caryophyllene (5%), para-cymene
(3,68%) et d'autres constituants à plus faible pourcentage comme le
terpin-4-ol (1,49%), le thymol (1,3%), le linalool (1,26%), etc. Ces
composés de faible pourcentage totalisent environ 15,85% de la
composition chimique totale.
Cette provenance se différencie par rapport aux autres
provenances par une teneur élevée en carvacrol, dont le spectre
de masse est représenté par la figure 20.
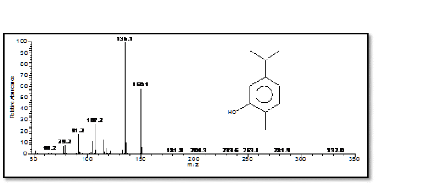
68
Figure 20. Spectre de masse du carvacrol de thymus
satureioides
- Provenance Aoulouz (1020m)
L'HE de la provenance d'Aoulouz (1020 m) est composé
principalement du borneol (29,39%), du thymol (16,17%), du thymol-methyl-ether
(12,69%) et du camphene (10,6%), et d'autres constituants avec des teneurs
relativement faibles : para-cymene (7,21%), á-thujene (5,86%),
á-terpineol (4,31%), 9-epi-caryophyllene (3,92%). On note aussi la
présence d'autres composés à plus faible pourcentage comme
le terpin-4-ol (1,62%), le carvacrol (1,59 %), le linalool (1,58%), etc. Ces
derniers totalisent environ 11,26% de la composition chimique totale.
L'huile essentielle de cette provenance de thymus
satureioides est caractérisée par son importance en thymol,
celui-ci atteint un pourcentage de 16% alors qu'il ne dépasse pas 6,07%
dans les autres provenances. Le spectre de masse caractéristique du
thymol est illustré par la figure 21.
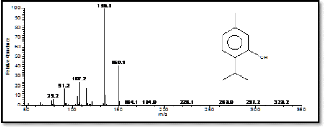
Figure 21. Spectre de masse du thymol thymus
satureioides
69
- Provenance Timoulay (850m)
Les analyses chromatographiques des HE de la provenance de
Timoulay (850 m) ont permis d'identifier 16 composés qui
représentent 98,87% de la composition chimique totale.
L'HE de la provenance Timoulay est caractérisée
par une teneur très élevée en borneol (94,19%). Les autres
constituants tel que le camphene, le thymol, le delta-cadinene, le linalool ou
le carvacrol restent minoritaire et ont des pourcentages inférieurs
à 2%. Les composés minoritaires composent 4,68% de la composition
chimique totale.
Quoi que cette provenance ait donné un faible
rendement, de l'ordre de 1,35%, en huiles essentielles par rapport aux autres
provenances étudiées, elle reste très particulière
par sa richesse en borneol. Ce Thymus satureioides contient le borneol
presque à l'état pur. Le spectre de masse caractéristique
du borneol est illustré par la figure 22.
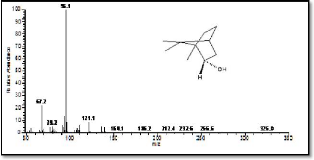
Figure 22. Spectre de masse du borneol thymus
satureioides
- Provenance Ankrim (320m)
L'HE de la provenance d'Ankrim (320 m) est composée
principalement par le borneol (31,07%), l' á-terpineol (14,27 %) et le
camphene (11,90%). D'autres composés sont contenus dans l'HE, avec des
teneurs moyennement faibles, comme le carvacrol (8,22 %), le thymol (6,07%), l'
á-thujene (5,86), le 9-epi-caryophyllene (4,16%) et la para-cymene
(4,10%). Les autres constituants tel que le linalool, le terpinolene,
l'alpha-terpinene, le sabinene, le tricyclene et autres ,restent minoritaire et
ont des pourcentages inférieurs à 1%. Ces composés
minoritaires composent 7,89% de la composition
Figure 24. Variation de la teneur en borneol selon les
provenances
70
chimique totale. Le spectre de masse caractéristique de
l'á-terpineol est illustré par la figure 23.
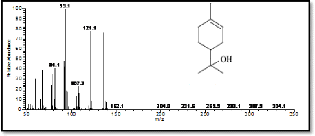
Figure 23. Spectre de masse de l' á-terpineol
thymus satureioides
3.2.2.2. Les chémotypes de T. satureioides
Le constituant majoritaire pour toutes les provenances est le
borneol. Quoique le prélèvement des échantillons ait
été réalisé au même moment et pour des
provenances proches géographiquement, on voit clairement dans la figure
24 et le tableau 11 comment la teneur des composés chimiques de l'HE de
Thymus satureioides varie d'une provenance à une autre.
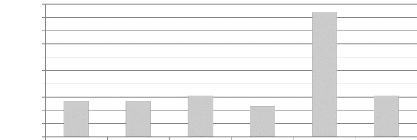
Teneur en borneol
100%
30%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
20%
10%
0%
|
Ouled Berhil (1200m)
|
Amskrot Est (1050m)
|
Amskrot
Ouest
(1050m)
|
Aoulouz
(1020m)
|
Timoulay
(850m)
|
Ankrim (320m)
|
71
D'après ces analyses, on a pu identifier quatre
chémotypes de thym dans la province de Taroudant :
- Le chémotype à
borneol
Dans la station de Timoulay, à 850 m d'altitude, en
exposition Est et dans un mélange de peuplements de thuya,
oléastre, chêne vert, pin d'halep, jujubier, et des lentisques, le
borneol a atteint un pourcentage de 94% dans l'huile essentielle de thym. El
Ouali Lalami et al. (2013), Jaafari et al. (2007), Amarti et
al.(2010); El Ajjouri et al.( 2010) et beaucoup d'autres
auteurs, qui ont travaillé sur la composition chimique de beaucoup de
variétés de thym, n'ont pas mentionné de tels pourcentages
élevés en borneol. Le maximum observé est un pourcentage
de 59,37 % pour le thym satureioide récolté dans la région
de Tiznit, qui est une zone proche géographiquement de notre zone
d'étude (Jaafari et al. 2007). Cette forte teneur en borneol,
qui est presque à l'état pure, est une des particularités
du chémotype de Thymus satureioides de la station de
Timoulay.
- Le chémotype à borneol et
carvacrol
Le Thym satureioides récolté dans la
station d'Amskrod Est, à 1050 m d'altitude et sous peuplement de thuya
est caractérisé par sa teneur élevée en carvacrol
(21,38%) par rapport aux autres provenances étudiées. Pour une
même altitude (1050m), une même pente, un même type de
peuplement (sous thuya), le thym satureioide récolté en
exposition Ouest présente une variabilité dans la teneur des
constituants en HE. En effet, la station d'Amskrod-Est reçoit le
rayonnement du soleil levant tandis que la station d'Amskrod-Ouest
reçoit le rayonnement du soleil couchant. Ceci serait à l'origine
de la variabilité observée. Thymus satureioides d'Amskot
Est est un chémotype à Borneol et carvacrol.
Généralement, le carvacrol est présent
dans l'huile essentielle de plusieurs espèces de PAM, soit comme
composé majoritaire, tel est le cas de Thymus capitatus dont
l'huile essentielle renferme environ 77% de carvacrol (Amarti et al.
2008), soit associé à d'autres composés, tel est le
cas de l'Origanum elongatum (Zine El Abidine et al. 2001).
Mais, c'es rarement qu'on retrouve le carvacrol et le borneol comme
constituants majoritaires, c'est une spécificité des huiles
essentielles de Thymus satureioides. Jaafari et al. (2007)
ont aussi soulignés un chémotype à borneol et carvacrol
dans la région de Marrakech. Dans leur travail, ils ont mentionné
des teneurs en carvacrol de l'ordre de
72
16,20%, 1,24% et 2,83% respectivement pour les provenances
récoltés à Asni Moulay Brahim (Marrakech), Tiznit et Bin
El Widane (Beni Mellal).
- Le chémotype à borneol et
thymol
Le Thym satureioides, récolté dans la
station d'Aoulouz en exposition Nord, à 1050 m d'altitude et sous
peuplement d'arganier se distingue par rapport aux autres provenances par sa
teneur élevée en thymol (16,17%) et en borneol (23,39%), c'est un
chémotype à borneol et thymol. La même chose a
été avancé par Jaafari et al.(2007) sur le thym
satureioide récolté dans la région de Bin El Widane (Beni
Mellal), cette provenance de thym satureioide a été
identifié comme un chémotype à borneol (51,98%) et thymol
(26.81%).
- Le chémotype à borneol et
á-terpineol
Le chémotype de Thymus satureoides à
borneol et á-terpineol est représenté par trois
provenances dans notre étude :
- Ankrim à 320 m d'altitude, en
exposition Nord-Est et sous peuplement d'arganier, de thuya et
d'oléastre.
- Oulad Berhil à 1240 m d'altitude, en
exposition Nord et sous peuplement de thuya.
- Amskrod à 1050 m d'altitude, en
exposition Ouest et sous peuplement de thuya.
Ce chémotype est caractérisé par des
teneurs variant entre 27,49% et 31.07% pour le borneol et des teneurs variant
entre 12,57 et 14,97% pour l' á-terpineol.
73
3.2.3. Conclusion
Thymus satureioides est un produit typique du Maroc
et la seule espèce riche en borneol parmi toutes les autres
espèces de thym étudiées. Le thym est l'exemple même
d'espèce végétale permettant d'illustrer la notion de
chémotype. Il existe plusieurs races chimiques dont la composition de
l'huile essentielle varie suivant le biotope dans lequel elles évoluent.
Dans notre étude nous avons pu identifier quatre chémotypes de
Thymus satureioides :
- le chémotype à borneol,
- le chémotype à borneol et carvacrol,
- le chémotype à borneol et thymol,
- le chémotype à borneol et á-terpineol.
Les facteurs environnementaux influencent certainement la
composition chimique et par conséquent la qualité des huiles
essentielles de Thymus satureioides. Ces différences de
compositions en huiles essentielles sont intéressantes, dans la mesure
où elles offrent d'énormes opportunités en principes
actifs qui peuvent être testés comme bio-insecticide pour lutter
contre le Varroa destructor, objet du deuxième volet de notre
travail.
3.3. Evaluation de l'infestation au rucher
3.3.1. Taux d'infestation évalué par
échantillonnage des Varroas phorétiques (effectifs de
Varroas/effectifs d'abeilles)
Les taux moyens d'infestation par les varroas
phorétiques échantillonnés sur les abeilles au rucher de
Sidi Yahya et au rucher d'Nkharkhssa (Kénitra) sont respectivement de
3,6% (#177;5,04) et de 6,55% (#177;1,95). La variabilité (Ecart-type)
entre les taux
d'infestation est assez importante soulignant qu'ils sont
variables entre les ruches d'un même rucher. Toutefois, selon Gatien et
al. (2003), un taux de 2 à 5% abaisse significativement la
production de miel, un taux >5% nécessite le recourt à un
traitement efficace, c'est dans ce sens qu'on recommande vivement un traitement
efficace au niveau des deux ruchers afin d'améliorer l'état
sanitaire des abeilles et d'optimiser la production du miel.
74
3.3.2. Taux d'infestation évalué par le suivi
des chutes naturelles de Varroas
« méthode pose des langes
»
Le taux d'infestation par le suivi des chutes naturelles de
Varroas par la méthode biologique «pose des langes»
à Nkharkhssa est de l'ordre de 0,4 varroas/ruche/jour.
Cette valeur reste relativement faible par rapport à la valeur
obtenue au niveau des échantillons des varroas phorétiques. Ceci
pourrait être du au fait que certains varroas ont subi le nettoyage
continu des ruches par les ouvrières ou tout simplement que l'essentiel
de la population de Varroa est inféodé au couvain (dans
les alvéoles). L'infestation dans le couvain et celle
évaluée sur les abeilles (Varroas phorétiques) ont
d'ailleurs été faiblement corrélées (Broodsgaard et
Broodsgaard , 1998)
En principe dans notre cas, un traitement n'est pas
recommandé sur la base du diagnostic « pose des langes » mais
étant donné que le taux d'infestation obtenu au niveau du
même rucher par la méthode d'échantillonnage des varroas
phorétiques est assez important (6,65%), un traitement peut être
envisageable afin d'optimiser la production du miel et maintenir les abeilles
en bonne santé. La méthode d'échantillonnage des varroas
phorétiques est destructive mais elle reste beaucoup plus précise
que la méthode du suivi des chutes naturelles de Varroas.
3.4. Evaluation du taux d'infestation « du
couvain mâle » au laboratoire Tableau 10. Taux d'infestation du
couvain mâle (varroas dans les alvéoles)
|
Rucher
|
Taux moyen d'infestation (%)
|
Ecart-type
|
|
Sidi Yahya
|
16 a
|
6,5
|
|
Nkharkhssa
|
13 a
|
6,9
|
a = Il n'ya pas de différence
significative au seuil á = 5%
Le taux d'infestation du couvain mâle (effectifs de
varroas/effectifs de larves d'abeilles) est de 16% pour le rucher de Sidi Yahya
et de 13% pour le rucher d'Nkharkhssa (Tableau 10). Selon Cantin (2014) pour un
taux d'infestation du couvain mâle compris entre 10 et 20% la colonie est
très sérieusement atteinte d'où l'importance d'effectuer
un traitement immédiat. Respectivement au niveau du rucher de Sidi Yahya
et au niveau du rucher d'Nkharkhssa, le taux d'infestation au niveau du couvain
mâle est 5 fois et 2 fois plus important que celui
révélé par la méthode d'échantillonnage des
varroas phorétiques. Ces résultats concordent avec ceux de
Fries, et al. (1994) qui relatent que
75
l'infestation au niveau du couvain mâle est 6 à
12 fois plus importante que sur les abeilles.
La variabilité (Ecart-type) entre les pourcentages des
ruches infestés est très grande au niveau des deux ruchers. Ceci
signifie que le taux d'infestation n'est pas homogène d'une ruche
à une autre au sein d'un rucher.
3.5. Evaluation des potentialités acaricides des
HE de T. satureioides
Le tableau 11 restitue les comptages des varroas
décrochés et fixés sur les langes disposés au fond
des ruches selon la nature du produit de traitement utilisé (HE des
différentes provenances de T. satureioides et
Bayvarol) et pour les témoins (aucun traitement). Les langes sont
renouvelés chaque jour (pour les 2 premiers jours) et un recomptage a
été effectué au bout de 6 jours. Les bandelettes sont
positionnées au plus près des rives du centre de la grappe
(couvain), elles agissent par contact mais aussi par évaporation, ce qui
rend ce traitement particulièrement efficace.
Rappelons les caractéristiques des HE utilisées
selon leur provenance :
? HE Timoulay (850m) : Par rapport aux autres, cette
provenance est caractérisée par une teneur très
élevée en borneol (94,19%).
? HE Aoulouz (1020m) : Cette provenance est
caractérisée essentiellement par le
borneol (29,39%) avec le thymol (16,17%) comme composés
majoritaires. ? HE Amskrod-Est (1050) : C'est une provenance qui se
démarque par sa forte
teneur en borneol (26,75%) et carvacrol (21,38%).
Pour l'ensemble des traitements, le maximum de chute des
varroas est enregistré après le premier jour. Ces
résultats sont en accord avec ceux de Chiesa (1991) qui a trouvé
que la plus grande chute des acariens s'observe immédiatement
après chaque application. L'analyse de l'efficacité la plus
efficiente sera donc celle qui concernera le premier jour après le
traitement.
Les HE de toutes les provenances de T. satureioides
semblent aboutir à une efficacité réelle et
convenable par rapport au produit de référence (le Bayvarol),
homologué, commercialisé et connu pour son efficacité
(figure 25). A titre de comparaison, Akyol et Yeninar (2008) ont obtenu une
efficacité de l'ordre de 90% en utilisant une spécialité
à base de Thymol (Thymovar).
76
Après traitement aux HE au rucher Nkharkhssa,
l'évaluation de l'infestation sur la base de l'échantillonnage
des varroas phorétiques a abouti à un taux d'infestation (nbre de
varroas/nbre d'abeilles) de 1% contre 6,55% évalué avant les
traitements, soit une réduction du taux d'infestation de 85%.
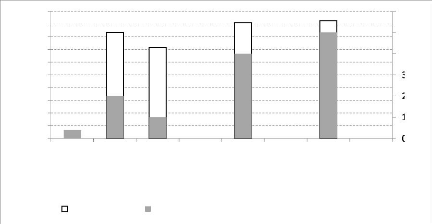
100
40
90
80
70
60
50
30
20
10
0
Témoins Bayvarol HE
Timoulay (850m)
%
0,4
Efficacité (%) Nbre moy. de varroas/jour
décrochés après traitement
83,3%
2
71,4%
1
HE
Aoulouz (1020m)
90,9% 92,6%
4
HE
Amskrot
Est
(1050m)
5
4
v
6
5
Nbre varroas moy./Jour décrochés
Figure 25. Efficacités des traitements aux HE et
du Bayvarol contre varroa destructor après un jour.
Tous les Varroas recueillis sur les langes
après les traitements étaient morts. L'absence ou le faible
effectif de varroas décrochés au niveau des témoins montre
que le test
réalisé reste fiable pour évaluer l'effet
acaricide des huiles essentielles utilisées. Par ailleurs, l'action
insecticide de ces huiles essentielles n'a pas nécessité beaucoup
de temps pour se manifester puisqu'on assiste à des efficacités
importantes dès le premier jour. De plus aucune mort d'abeilles par
toxicité n'a été enregistrée.
Conclusion
A terme, l'HE d'Amskrod-Est (à borneol et carvacrol) et
celle d'Aoulouz (à borneol et thymol) semblent procurer des
efficacités plus intéressantes (respectivement 92,6% et 90,9%).
Cela traduit que l'efficacité de l'HE contre le Varroa est
vraisemblablement tributaire de sa composition en principes actifs. On constate
que plus les composés majoritaires des HE sont nombreux avec des teneurs
proches, plus l'efficacité est bonne. La présence
simultanée de plusieurs molécules dans l'HE fournirait peut
être un effet
77
plus important (cumulé). Des investigations devraient
être poursuivi dans ce sens afin d'explorer la possibilité de
trouver les meilleures combinaisons de molécules pour un traitement
meilleur. Toujours est-il, cette variabilité de combinaisons de
principes actifs est toujours souhaitable étant donné que
l'acarien développe rapidement des résistances et l'alternance de
produits de traitements peut être assurée et empêcher
l'acarien de s'adapter.
Tableau 11. Résultat des essais de traitements
contre le Varroa
|
1er jour
|
|
Produits
|
Nbre moyen de varroas/jour
décrochés avant
traitement
|
Nbre moyen de varroas/jour
décrochés morts
après traitement
|
Taux efficacité (%)
|
|
Témoins
|
0,4
|
0
|
-
|
|
Bayvarol
|
2
|
83,3
|
|
HE Timoulay (850m)
|
1
|
71,4
|
|
HE Aoulouz (1020m)
|
4
|
90,9
|
|
HE Amskrod Est(1050m)
|
5
|
92,6
|
|
2ème jour
|
|
Produits
|
Nbre moyen de varroas/jour
décrochés avant
traitement
|
Nbre moyen de varroas/jour
décrochés morts
après traitement
|
Taux efficacité (%)
|
|
Témoins
|
0,4
|
0
|
-
|
|
Bayvarol
|
0
|
0,0
|
|
HE Timoulay (850m)
|
0
|
0,0
|
|
HE Aoulouz (1020m)
|
1
|
71,4
|
|
HE Amskrod Est (1050m)
|
1
|
71,4
|
|
6ème jour
|
|
Produits
|
Nbre moyen de varroas/jour
décrochés avant
traitement
|
Nbre moyen de varroas/jour
décrochés morts
après traitement
|
Taux efficacité (%)
|
|
Témoins
|
0,4
|
1
|
-
|
|
Bayvarol
|
1
|
71,4
|
|
HE Timoulay (850m)
|
3
|
88,2
|
|
HE Aoulouz (1020m)
|
0
|
0,0
|
|
HE Amskrod Est (1050m)
|
0
|
0,0
|
|
Total
|
|
Produits
|
Nbre moyen de varroas décrochés avant traitement
|
Nbre moyen de varroas décrochés
morts
après traitement
|
Taux efficacité (%)
|
|
Témoins
|
0,4
|
1
|
|
|
Bayvarol
|
3
|
88,2
|
|
HE Timoulay (850m)
|
4
|
90,9
|
|
HE Aoulouz (1020m)
|
5
|
92,6
|
|
HE Amskrod Est (1050m)
|
6
|
93,8
|
78
Conclusion générale
Le Maroc héberge une flore riche constituée de
près de 4200 espèces et une végétation
variée, à endémisme très marqué. Les
espèces à intérêt aromatique et/ou
médicinales (PAM) sont estimées à près de 600
espèces dont un grand nombre sont de même endémiques parmi
lesquels figure thymus satureioides
Ces plantes médicinales et aromatiques demeurent une
source considérable de substances biologiquement actives et
possèdent des potentialités biologiques très
intéressantes et exploitables dans divers domaines : médecine,
pharmacie, agriculture, apiculture,
Le constat que les colonies d'abeilles séjournant dans
le sud ouest marocain sur les formations de Thymus satureioides
acquièrent une certaine immunité contre le Varroa,
a été confirmé par une enquête auprès des
apiculteurs et coopératives apicoles de la région de
Taroudant. En réaction à ce constat, le présent
travail a constitué une contribution exploratoire visant à mettre
en oeuvre un moyen de lutte alternative (bioinsecticide) contre le
Varroa.
La suite du travail s'est penché sur la
caractérisation chimique des huiles essentielles de thym
récolté à partir de différentes provenances selon
le gradient altitudinal et la continentalité dans le Sud Ouest marocain.
Les résultats ont permis d'identifier 04 chémotypes à
borneol de T. satureioides dans la zone d'étude, à
savoir:
? T. satureioides Timoulay (850m): chémotype
à borneol (94,19%).
? T. satureioides Aoulouz (1020m): chémotype
à borneol (29,39%) et thymol (16,17%):
? T. satureioides Amskrod-Est (1050m) :
chémotype à borneol (26,75%) et carvacrol (21,38%).
? T. satureioides Amskrod-Ouest (1050m), Oulad Berhil
(1240m) et Ankrim(320m): chémotype à borneol (27,49%-31,07%) et
a-terpineol (12,57%14,97%).
Bien que les stations de récoltes soient proches
géographiquement, les investigations sur la composition chimique des HE
de T. satureioides ont montré une grande diversité en
principes actifs. Cette diversité a constitué un avantage pour
procéder à l'utilisation des
79
HE à différentes formulations pour les essais de
traitements contre le Varroa des abeilles.
A cet effet, des essais de traitements ont été
conduits en utilisant des lanières de papier absorbant imbibé
d'HE (5 ml) et disposées entre les cadres. Ils ont montré un
effet acaricide certain par rapport à un acaricide homologué
(Bayvarol) avec des efficacités variant selon la composition chimique de
l'HE : Bayvarol (83,3%), chémotype borneol (71,4%), chémotype
borneol & thymol (90,9%), chemotype borneol & carvacrol (92,6%).
Ces essais seront reconduits dans un futur proche à des
niveaux de populations de Varroa plus importants, à d'autres
stades de la vie de l'abeille (sortie de l'hivernage par exemple;
période de faiblesse des colonies) et avec des doses d'application
variables. L'utilisation des HE d'une autre espèce endémique du
Maroc riche en thymol, molécule réputée pour ses
différentes vertus, serait opportune. L'Origanum elongatum
(Thym de Targuist) peut très bien se prêter à ses
investigations.
Enfin, à la lumière des résultats obtenus
pour ce présent travail, on recommande :
? De reconduire les essais de traitements au niveau d'autres
ruchers beaucoup plus infesté et testé les HE d'autres
provenances de Thymus satureioides en hiver.
? D'approfondir les études afin de trouver une bonne
combinaison entre les principales molécules des différents HE de
Thymus satureioides, les tester et envisager à mettre en place
un bioacaricide écologique, économique et efficace pour la lutte
contre le varroa.
? D'envisager de conduire les mêmes investigations avec
les HE d'autres plantes. ? Des cultures de Thymus satureioides pour
développer la filière des bioincesticides.
? De mettre en place une stratégie pour sauvegarder
l'espèce Thymus satureioides dans le Sud ouest marocain.
Atlan M., 1987. Les labiées :
études botaniques, économiques, chimiques et pharmacologiques.
Doctorat en Pharmacie. Université de Bordeaux II.
80
Références bibliographiques
Abdeslam J., Hassan A., El Mostapha R., Lahcen A.,
Mounir T., Chouaib B., Abdelali B.,Aziz A., Abdelmajid Z.(2007).
Chemical composition and antitumor activity of different wild
varieties of Moroccan thyme. Brazilian Journal of Pharmacognosy
17(4),pp : 477-491,
Abdesselam Z., Mayaud L., Bouhdid S., Baudoux D.,
Abrini J., Aubert G.,2010.Evaluation de l'activité
bactéricide et bactériostatique des huiles essentielles vis
à vis des souches d'origine clinique résistantes aux
antibiotiques. Congres francophone de phytothérapie au Liban. 18p.
Akimov I.A., Zaloznaya L.M., Piletskaya IV. 1986b.
Arrhénotokie et différentiation du sexe dans la ponte de
l'acarien Varroa jacobsoni. Vestn. Zool., 4,
pp: 64-68.
Akyol E et Halil Yeninar H., 2008.
Controlling Varroa destructor (Acari: Varroidae) in
honeybee Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) colonie by using
Thymovar and BeeVital. Ital.J.anIm.ScI. vol. 7, pp: 237-242
Al Ghamdi A., 2002. The comprehensive study
of the mite Varroa destructor on honeybees Apis mellifera indigenous and
imported. Final Report. King Abdulaziz City for Sciences and Technology. 77
p.
Alippi A.M., Albo G.N., Marcangeli J., Leniz D.,
Noriega A., 1995. The mite Varroa jacobsoni does not transmit
American foulbrood from infected to healthy colonies. Exp. Appl.
Acarol., 19, pp: 607-613.
Amdam G.V., Hartfelder K., Norberg K, Hagen A., Omholt
S.W., 2004. Altered physiology in worker honey bees (Hymenoptera:
Apidae) infested with the mite Varroa destructor (Acari: Varroidae): a
factor in colony loss during overwintering? J. Econ. Entomol., 97, pp
: 741-747.
A.M.I., 1995 : Etude de la Filière des
Epices, Plantes Aromatiques et Médicinales et les Huiles Essentielles,
MAMVA DAI USAID, p.75.
Amrine J., Bob N., Harry M., Terry S., and Robert S.,
1996. Mite control in honeybees with essential oils.West Virginia
University.
Anderson D.L., Trueman J.W.H., 2000.
Varroa jacobsoni (Acari: Varroidae) is more than one species.
Exp. Appl. Acarol., 24,pp:165-189.
Anonyme, 2001. Hort. Research Client Report
No. 2001/249 A Review of Treatment Options For Control of Varroa Mite in New
Zealand. 26 p.
81
Ball B.V., 1997. Secondary infections and
diseases associated with Varroa jacobsoni. Opt.
Méditerr., 21, pp: 49-58.
Beetsma J., Boot W.J., Calis J., 1999.
Invasion behaviour of Varroa jacobsoni Oud.: from bees into
brood cells. Apidologie, 30, pp : 125-140.
Benabid A., 2000. Flore et
écosystèmes du Maroc, Evaluation et préservation de la
biodiversité, Ibis Press, Paris, 359p
Beraoud L., 1990. Effet de certaines
épices et plantes aromatiques et de leurs extraits sur la croissance et
l'aflatoxinogénèse d'Aspergillus parasiticus NRRL 2999,
Thèse de doctorat de troisième cycle, Faculté des sciences
Rabat, Maroc.
Beylier-Maurel M.F., 1976,-Activite
bacteriostatique des matieres premieres de parfumerie, Rivista Italiana
E.P.P.O.S, 58, pp : 283-286.
Boot W.J., Calis Jnm., Beetsma J., 1992.
Differential periods of Varroa mite invasion into worker and drone
cells of honey bees. Exp. Appl. Acarol., 16, pp: 295-301
Bowen-Walker P.L., Gunn A., 2001. The effect
of the ectoparasitic mite, Varroa destructor on adult worker honeybee
(Apis mellifera) emergence weights, water, protein, carbohydrate, and
lipids levels. Entomol. Exp. Appl., 101, pp: 207-217.
Breguetova N.G., 1953. The mite fauna of the
Far East. Parasitologuitcheskii Zbornik ZIN AN SSR, 15, pp: 302-338
Broodsgaard C. J. et Broodsgaard H.F., 1998.
Monitoring method as a basis for Need-based Control of Varroas mites
infesting Honey Bees colonies. ATLA, 26, pp :413-419.
Bruneton J., 1987. Éléments de
phytochimie et de Pharmacognosie, Tec. et Doc. Lavoisier, Paris p 230.
Bruneton, J., 2008. Pharmacognosie -
Phytochimie, plantes médicinales, 2eme éd., Paris, Tec & Doc
- Éditions médicales internationales, p 1188.
Burlew R., 2009. Essential Oils and Organic
Acids for the Control of Varroa destructor in Honey Bees (Apis mellifera)
Cakmak O., Erenler R., Tutar A. et Celik N., 2006.
Synthesis of new anthracene
derivatives.J. Org.
Chem. 71,pp : 1795-1801
Calatayud et Verdu, 1994. Survival of the
mite Varroa jacobsoni Oud. (Mesostigmata: Varroidae) in broodless colonies of
the honey bee Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae). Experimental &
Applied Acarology , Volume 18, Issue 10, pp: 603-612.
Delfinado M.D., 1963. Mites of the honey bee in
South-east Asia. J. Apic. Res., 2, pp:113 -114.
82
Calderone N.W., Kuenen L.P.S., 2001. Effects of
western honey bee (Hymenoptera: Apidae) colony, cell type, and larval sex on
host acquisition by female Varroa destructor (Acari: Varroidae).
J. Econ. Entomol., 94, pp :1022-1030.
Charchari S. et Boutekedjret C., 1994.
Composition chimique de l'huile essentielle d'Artemisia herba alba
assa provenant de différentes régions d'Algérie,
Rivista Italiana EPPOS, 13, pp : 631-633.
Charles D. et Simon J., 1992. A new geraniol
chemotype of Ocimum gratissimum, J. Essent. Oil Res., 4, pp:
231-234.
Chen Y.P., Siede R., 2007. Honey bee viruses.
Adv. Virus Res., 70, pp : 33-80.
Chiasson H. et Beloin N., 2007.
Les huiles essentielles, des biopesticides « nouveau genre
». Bulletin de la Société d'entomologie du
Québec. Antennae, vol. 14, n°1.
Colin M.E., Faucon J.P., Heinrich A., Ferry R.,
Giauffret A., 1983. Etude du premier foyer français de
varroatose de l'abeille. Bulletin de l'Académie
Vétérinaire de France, 56, pp : 89-93.
Croteau F., 1986. Biochemistry of
monoterpenes and sesquiterpenes of the essential herbs : spices and medicinal
plants, Recent advances in botany, horticulture and pharmacology. Vol., 1,
Craken, Simon, Oryx Press, Phoenix.
Crouteau R., 1988. Catabolism of monoterpenes
in essentials oil plants, Flavour and Fragrance, A world perspective, X eme
congres ,Amsterdam pp: 65-83.
Currie R.W., Gatien P., 2006. Timing
acaricide treatments to prevent Varroa destructor (Acari: Varroidae)
from causing economic damage to honey bee colonies. Can. Entomol.
Vol., 138, pp: 238-252
De Guzman L., Kulincevic J., Rinderer T., 1997.
Selection of honey bees tolerant or resistant to Varroa jacobsoni
Oud. Cahiers Options Méditerranéennes; n°21,
pp : 59-75.
De Ruijter A.1987. Reproduction of Varroa
jacobsoni during successive cycles of the honeybee. Apidologie
18, pp :321-326
Del Cacho E., Marti J., Josa A., Quilez J.,
Sanchez-Acedo C., 1996. Effect of Varroa jacobsoni
parasitization in the glycoprotein expression on Apis mellifera
spermatozoa. Apidologie, 27, pp: 87-92.
Delaplane K., Berry J., Skinner J.,
2005.Integrated pest management against Varroa destructor
reduces colony mite levels and delays treatment threshold Journal of
apicultural research vol 44, pp:157-162
83
Division Economique et Sociale, 2010:
Données Monographiques sur la Province de Taroudant,
Secrétariat Général, du Ministère de
L'intérieur, Maroc, 47p.
Donzé G., 1995. Adaptations
comportementales de l'acarien ectoparasite Varroa jacobsoni durant sa
phase de reproduction dans les alvéoles operculées de l'abeille
mellifère Apis mellifera. Thèse de doctorat ès
sciences, Université de Neuchâtel, 152p.
Donzé G., Guérin P.M., 1994.
Behavioral attributes and parental care of Varroa mites
parasitizing honeybee brood. Behav. Ecol. Sociobiol., 34,pp:
305-319.
Donzé G., Herrmann M., Bachofen B.,
Guérin P.M. 1996. Effect of mating frequency and brood cell
infestation rate on the reproductive success of the honeybee parasite
Varroa jacobsoni. Ecol. Entomol., 21, pp:17-26.
Dragland S., Senoo H., Wake K., Blomhoff R., 2003.
Several culinary and medicinal herbs are important sources of dietary
antioxidants. The journal of Nutrition, 133. pp : 1286-1289.
DREFLCD-HA, 2013 : Etude d'aménagement
des facieès de thym au niveau de la forêt de Goundafa-Province
d'El Haouz, Rapport 3 : Approche méthodologique, 87p.
Duay P., De Jong D., Engels W., 2002.
Decreased flight performance and sperm production in drones of the
honey bee (Apis mellifera) slightly infested by Varroa destructor
mites during pupal development. Genetics and Molecular Research,
3,pp: 227-232
Duay P., De Jong D., Engels W., 2003. Weight
loss in drone pupae (Apis mellifera) multiply infested by Varroa
destructor mites. Apidologie, 34,pp : 61-65.
Duval L., 2012. Les huiles essentielles à
l'officine, Thèse pour le diplôme d'état de docteur en
pharmacie,154p
Ebert Timothy A., Peter Kevan G., Sherrene Kevan D.,
and Roger Downer A.,2007. Oral toxicity of essential oils and organic
acids fed to honey bees (Apis mellifera). Journal of Apicultural
Research 46, no. 4: pp: 220-224.
Egin, N.L. 1988. ["Brushes" for mites.]
Pchelovodstvo, n3: 15p.
El Bouhamid Abdelaziz, 1994.Des contraintes
majeures au développement de l'apiculture au Maroc. Thèse de
doctorat vétérinaire, institue agronomique et
vétérinaire Hassan II,120p.
El-Halim Abd M., Ismail., HelmyA. Ghoniemy and Ayman
A. Owayss.,2006.Combatting honeybee varroa mites by plant
oils aloneor in an ipm program.The 2nd conference of Farm Integrated Pest
Management, 16-18 Jan., Fac.Agric.,Fayoum Univ., pp:172-185
84
El Oualilalami Abdelhakim.,El-akhal Fouad., Ouedrhiri
Wissal. Ouazzani Chahdi Fouad.,Guemmouh Rajae., Greche
Hassane.,2013.Composition chimique et activité
antibactérienne des huiles essentielles de deux plantes aromatiques du
centre nord marocain : Thymus vulagris et Thymus
satureioides. Les technologies de laboratoire, Volume 8, N°31
.7p.
Ellis A.M., Delaplane K.S., 2009. Individual
forager profits in Apis mellifera unaffected by a range of colony
Varroa destructor densities. Insect. Soc.,
56, pp:419-424.
Ellis J.D., Zettel Nalen C.M., 2010.
Varroa Mite, Varroa destructor Anderson and Trueman
(Arachnida: Acari: Varroidae). In: University of Florida, document
EENY-473p.
Elzen P., Baxter J., Spivak M. et Wilson W., 2000.
Control of Varroa Jacobsoni Qud. Resistant fluvanilate and amitraz
using coumophos. Apidoloie, 31: pp:437-441.
Faucon J.P., Drajnudel P., Chauzat M.P. et Aubert M.,
2007. Contrôle de l'efficacité du médicament
APIVAR ND contre Varroa destructor, parasite de l'abeille
domestique. Revue Méd. Vét., 158, 6,pp : 283-290
Fechtal M., 1999 : La Filière des
Plantes Aromatiques et Médicinales au Maroc, Station de la Recherche
Forestière, Rabat, Maroc.
Fechtal M., 2000 : Production et
Marché des Huiles Essentielles au Maroc, 2ème Colloque
Andalou-Marocain sur la Chimie des Produits Naturels, Université Hassan
II, Mohammedia, Maroc.
Fechtal M., Ismaili R., Zine El Abidine A., 2001 :
Effet de la transplantation sur la qualite et le rendement en huiles
essentielles du romarin (Rosmarinus officinalis L.), An.Rech For au Maroc,
Tome 34, pp : 94-102, Rabat.
Fernandez N., Coineau Y. (2002). Varroa,
tueurs d'abeilles. Bien le connaître, pour mieux le combattre.Edition
Atlantica, Biarritz, France, 237p.
Figueredo G., 2007. Étude chimique et
statistique de la composition d'huiles essentielles d'origans (Lamiaceae)
cultivés issus de graines d'origine méditerranéenne,
Thèse doctorat, Ecole doctorale des sciences fondamentales,
université blaise pascal, 416p.
Fluck H., 1963. Chemical plant taxonomy, London
T. Swain Academic. pp. 167- 186.
Fuchs S., 1990. Preference for drone brood
cells by Varroa jacobsoni Oud in colonies of Apis mellifera
carnica. Apidologie, 21, pp:193-199
Garrido C., Rosenkranz P., Stürmer M.,
Rübsam R., Büning J., 2000. Toluidine blue staining as a
rapid measure for initiation of oocyte growth and fertility in Varroa
jacobsoni Oud.. Apidologie, 31, pp:559-566.
Ibrahim A., Reuter G.S., Spivak M., 2007. Field
trial of honey bee colonies bred for mechanisms of resistance against
Varroa destructor. Apidologie, 38, pp: 67-76.
85
Gaspar F. and JEEKE G., (2004). Essential oil
from Origanum vulgare L. ssp. virens (HOFFM. and LINK) IETSWAART :
Content, Composition and Distribution Within the Bracts., J. Essent. Oil
Res., 16, pp: 82-84.
Gatien, P., and Currie R. W., 2003. Timing of
acaracide treatments for control of low level populations of Varroa
destructor (Acari:Varroidae) and implications for colony performance of
honey bees. Canadian Entomologist 135 (5), pp :749-763.
Gauthier R., Gourai M. et Bellakhdar J., 1988.
A Propos de l'Huile Essentielle de Myrtus communis L. var. Italica
Récolté au Maroc, Al Biruniya., Tome 4, N°2, pp :
97-132.
Gayda A., 2013. Etude des principales huiles
essentielles utilisées en rhumatologie, thèse d'état de
docteur en pharmacie, faculté des sciences pharmaceutiques,
université Toulouse III paul sabatier, France, 119 p.
Ghanmi M., Satrani B., Aberchane M., Ismaili M.R.,
Aafi A., El Abid A., 2010. Plantes Aromatiques et Medicinales du Maroc
: Les milles et une vertu, Centre de Recherche Forestiere.
Ghomari F. N., Kouache B., Arous A., Cherchali S.,
2013. Effet de traitement par fumigation du thym (Thymus vulgaris) sur
le Varroa destructor agent de la varroase des abeilles. Revue « Nature
& Technologie ». B- Sciences Agronomiques et Biologiques, n°
10/Janvier 2014.pp :34 - 38
Grobov O.F., 1976. La varroase de l'abeille
mellifère. Apiacta, 11, pp:145-148 Guignard J., 1983.
Abrégé de botanique, Masson 5ème édition,
Paris, 259p.
Gunther Cem, 1951. A mite from a beehive on
Singapore Island (Acarina : Laelapidae). Proc. Linnean Soc.,
76, 155p.
Hanley Alexandre et Duval Jean., 1993. La
varroase des abeilles.Agro-bio .pp :370 - 08
Huang Y., Ho S., Lee H. & Yap Y., 2002.
Insecticidal properties of eugenol, isoeugenol and methyleugenol and
their effects on nutrition of Sithophilus zeamais Motsch. (Coleoptera:
Curculionidae) and Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrioniadae).
Journal of Stored Products Research, 38 (5),pp:403-412.
Ian Tsin-H., 1965. Les particularités
biologiques de l'acarien Varroa jacobsoni (Oudemans). Kounchong
Zhishi, 9, pp:40-41.
Lachance M., 1977: Extraction des huiles
essentielles, Manuel de Construction et d'Opération d'Usines,
Bibliothèque Nationale du Québec, p.62.
86
Imdorf A., Charrière J., Kilchenmann V., Bogdanov
V., Fluri P.,2003.Alternative strategy in central Europe for the
control of Varroa destructor in honey bee colonies. Apiacta,
38, pp: 258-285.
Imdorf A., Charrière J., Maquelin C., Kilchenmann
V., BachofenB.,1996a. Alternative Varroa control. Am. Bee J.,
136, pp:189-193.
Inouye S., Abe S., Repot S., 2003.Comparative
study of antimicrobial and cytotoxic effects of selected essential oils by
gaseous and solution contacts International Journal of Aromatherapy, vol.
13, pp:33-41
Ismaili M.R. 2000. Essai de Domestication de
Rosmarinus officinalis, Myrtus communis et Origanum
elongatum pour la Production des Huiles essentielles au Maroc,
Mémoire de 3ème cycle, Ecole Nationale
Forestière des Ingénieurs, Salé, Maroc, p 84.
Kanga I., James R., Boucias D.,
(2002).Hirsutellathompsonii and Metarhizium anisopliae as potential
microbial control agents of Varroa destructor, a honey bee parasite.
J.Invertebr. Pathol., 81, pp: 175-184.
Karaman S., Digrak M., Ravid U., Ilcim A., 2001.
Antibacterial and antifungal activity of the essential oils of Thymus
revolutus Celak from Turkey. J. of Ethnopharmacology, 76,pp: 183
-186.
Karawya M., Hifnawy M., 1974. Flavors and
Nonalcoholic Beverages, Analytical study of the volatile oil of Thymus vulgaris
1. growing in Egypt. J of the AOAC, 47.pp: 997-1001.
Kaufman PB., Cseke LJ., Warber S., Duke JA., Brielmann
HL., 1999. Natural Products from Plants.CRC Press, Boca Raton,
FL.10p
Kefuss J., Vanpoucke J., de Lahitte J.D., Ritter W.,
2004. Varroa tolerance in France of Intermissa bees from Tunisia and
their naturally mated de-scendants: 1993- 2004, Am. Bee J. 144, pp:
563-568.
Kotwal S., Abrol D.P., 2009. Impact of
Varroa destructor infestation on the body weight of developing
honeybee brood and emerging adults. Pak. Entomol., 31, pp:67-70
Kralj J., Brockmann A., Fuchs S., Tautz J., 2006.
The parasitic mite Varroa destructor affect non-associative
learning in honey bee foragers, Apis mellifera L.. J. Comp.
Physiol. A., 193, pp: 363-370.
Kurt Torssell B., 1983. Natural Products
Chemistry: Mechanistic and Biosynthetic Approach to Secondary Metabolism
, paperback, 401 p.
Nicholas H. J., 1973. Phytochemistry Organic
Metabolites, Vol. 2, Yonkers, New York.121p
87
Langhammer L., 1986. Bildatlas zur
mikroskopishen analytik pflanzlicher arzneidrogen, Ed. Walter de Gruyter,
Berlin, 26p.
Lobb N., Martin S., 1997. Mortality of
Varroa jacobsoni Oudemans during or soon after the emergence of worker
and drone honeybees Apis mellifera L.. Apidologie, 28, pp
:367-374.
Lutz H., 1940. La Société
zoologique de France, Bulletin de la Société de Chimie
Biologique, 22, p. 497.
Martin S.J., 1994. Ontogenesis of the mite
Varroa jacobsoni Oud. in worker brood of the honeybee Apis
mellifera L. under natural conditions. Exp. Appl. Acarol., 18,
pp: 87-100.
Martin S.J., 1995a. Reproduction of
Varroa jacobsoni in cells of Apis mellifera containing one or
more mother mites and the distribution of these cells. J. Apicul. Res.,
34, pp: 187-196.
Martin S.J., 1995b. Ontogenesis of the mite
Varroa jacobsoni Oud. in drone brood of the honeybee Apis
mellifera L. under naturel conditions. Exp. Appl. Acarol., 19,
pp: 199-210.
Martin S.J.,1998 a. A population model for
the ectoparasitic mite Varroa jacobsoni in honey bee (Apis
mellifera) colonies. Ecol. Model., 109, pp :
267-281.
Mebarki N., 2010. Extraction des huiles
essentiel les de Thymus fontanesii et application à la forme
médicamenteuse antimicrobienne. Thèse de Magister,
Université de Boumerdess;185p.
Miguel N., Heinsohn P. ,Roberto C., Andrea M, et Juan
B., 2004. Effet des huiles essentielles de lavande et de laurier sur
Varroa destructor, Agric.Chillán.11p
Morales R., 1997. Synopsis of the genus
Thymus L. in the mediterranean area. Logascalia, 19, pp :
249-262.
Moritz R.F.A., Jordan M., 1992. Selection of
resistance against Varroa jacobsoni across caste and sex in the
honeybee (Apis mellifera L., Hymenoptera: Apidae). Exp. Appl.
Acarol.,16, pp: 345-353.
Muhammad A., Bilal S. and Muhammad H., 2013.Efficacy
of Plant Extracts Against Honey Bee Mite, Varroa destructor
(Acari: Varroidae) in World Journal of Zoology 8 (2), pp:
212-216,.ISSN 1817-3098.5p
Neumann P. et Carreck, N. L., 2010. Honey Bee
Colony Losses. Journal of Apicultural Research, vol. 49, no 1, pp:
1-6.
88
Nicolas Vidal-naquet., 2008. Dictionnaire des
Médicaments vétérinaires.
Noireterre P., 2011. Biologie et
Pathogénie de Varroa destructor. Bulletin des GTV.n°62 pp:
101-106.
Obeng-Ofori D. & Reichmuth C.,1997.
Bioactivity of eugenol, a major component of essential oil of Ocimum
suave (Wild.) against four species of stored-product Coleoptera.
International Journal of Pest Management; 43 (1) , pp: 89-94.
Oudemans A.C., 1904. On a new genus and
species of parasitic Acari. Notes from Leyden Museum, 24, pp: 216-222.
Papageorgio V., 1980. GLC-MS Computer
Analysis of the Essential oil of Thymus cap itatus. Planta Medica Supplement,
pp : 29 - 33.
Paris R.R. et Moyse H., 1971 : Matière
Médicale, Editions Masson, Paris, pp : 277279.
Park I., Lee S., Choi D. & Ahn Y., 2003.
Insecticidal properties of constituents identified in the essential
oil from leaves of Chamaecyparis obtuse against Callosobruchus chinensis (L.)
and Sitophilus oryzae (L.). Journal of Stored Products Research, 39
(4), pp:375 - 384.
Pedersen J., 2000. Distribution and taxonomie
implications of some phenolics in the' family Lamiaceae determined by ESR
speetroscopy. Biochem. Syst. Ecol., 28 ,pp : 229 - 253.
Péguin P., 1991. L'apiculture bio face au
varroa. Nature et progrès, n123,pp :27-28.
Pelletier N.,2012. Le déclin des
populations d'abeilles au québec : causes probables, impacts et
recommandations. Centre universitaire de formation en environnement
Université de Sherbrooke.77p
Peltier J. P., 1983. Ecologie de quelques
espèces climaciques dans le sous Maroc occidental. Documents de
cartographie écologique, Vol. XXVI Grenoble, pp :6182
Pernal S.F., Baird D.S., Birmingham A.L., Higo H.A.,
Slessor K.N., Winston M.L., 2005.Semiochemicals influencing the
host-finding behaviour of Varroa destructor. Exp. Appl.
Acarol., 37,pp: 1-26
Petrov S.G. et Khazbievich L.M.. 1980. [A
biological trap as a method for controlling Varroa infestations of
honeybees.] DokladyTSKhA, n °266,pp :139-141.
Pharmacopée Européenne., 2010. 7e
édition.Strasbourg: Conseil de l'Europe.
Prates H., Santos J., Waquil J., Fabris J., Oliverta
A. & Foster J., 1998. Insecticidal Activity of Monoterpen against
Rhyzopertha dominica (F) and Tribolium
castaneum (Herbst). Journal of stored products Research,
34 (4),pp: 243-249.
89
Rademacher E.1983.[Versuchez Bckämpfunder
verroatoscmiy Naturs loffem].Apidologie, 14(4),pp:265-266.
Rey R., 2012.La disparition des abeilles (Colony
Collapsus Disorder) Etat des lieux, analyse des causes et conséquences.
Thèse Diplôme d'Etat Pharmacie. Univ. Victor Segalen-Bordeaux. 115
p.
Richard H., Benjilali B., Banquour N., Baritaux 0.
1985. Etude de diverses huiles essentielles de thym de Maroc.
Lebensm. Wiss. U. Technol., 18, pp:105 - 110
Ritter W., Leclercq E., Koch W., 1984.
Observations des populations d'abeilles et de Varroa dans les colonies
à différents niveaux d'infestation. Apidologie, 15,
389400.
Rosenkranz P., Aumeier P., Ziegelmann B., 2010.
Biology and control of Varroa destructor. J. Invertebr.
Pathol., 103, pp:96-119.
Rosenkranz P., Aumeier P., Ziegelmann B., 2010.
Biology and control of Varroa destructor. J. Invertebr.
Pathol., 103, pp:96-119.
Ruberto G., Biondi D., Ciana P., Geraci, 1993.
Antimicrobial activity and chemical composition of essential oils from
Sicilian aromatic plants. Flavour and Fragrance J, 8, pp : 331
-337.
S.E.P.C.P., 2010. Données
monographiques sur la province de Taroudant, ministère de
l'intérieur de la province de Taroudant, secrétariat
général division économique et sociale.45p
S.E.P.C.P., 2012. Données
monographiques sur la province de Taroudant, ministère de
l'intérieur de la province de Taroudant, secrétariat
général division économique et sociale.50p
Sakofski F. (1990). Quantitative
investigations on transfer of Varroa jacobsoni Oud.. In:
RITTER W. (Ed). Proceedings of the international symposium on recent research
on bee pathology, Gent, pp: 70-72.
Salgueiro L., Vila R., Tomi F., Figueiredo A., Barroso
J., Caîiigueral S., Casanova J., Proença Da Cunha A., Adzet T.,
1997. Variability of essential oils of Thymus caespititius
from Portugal. J of Phytochemistry, 45, pp: 307-311.
Salvy M., Capowiez Y., Clément J.L., Le Conte
Y. 1999a. Does the spatial distribution of the parasitic mite
Varroa jacobsoni in worker brood of honey bee rely on an aggregative
process ? Natur wissens chaften (86) pp: 540-543.
Sammataro, D. 1994. Controlling tracheal
mites (Acari:Tarsonemidae) in honey bees (Hymenoptera:Apidae) with vegetable
oil. Journal of Economic Entomology, 87(8), pp: 910-916.
Zhiri A., 2006 : Les huiles essentielles, un
pouvoir antimicrobien avéré, Natura News, Fondation pour le libre
choix, octobre 2006, 16p.
90
Shah, F.A. et Shah T.A.
1988.Tropilaelapsclareae, a serious pest of honey bees; flour dusting
controls for Varroa disease. American Bee Journal, 128(1).pp27-38.
Tentcheva D., Gauthier L., Zappulla N., Dainat B.,
Cousserans F., Colin M.E. et al. 2004. Prevalence and
seasonal variations of six bee viruses in Apis mellifera L. and
Varroa destructor mite populations in France. Appl. Environ.
Microbiol., 70, pp:7185-7191.
The Food and Environment Research Agency .2010.
Managing Varroa, York, UK, 44 p.
Topolska G., 2001. Varroa destructor
(Anderson and Trueman, 2000); the change in classification within the
genus Varroa (Oudemans,1904). Wiad. Parazytol,
47,pp:151-155.
Tzakou O., Verykokidou E., Roussis V., and Chinou I.
(1998): Chemical Composition and Antibacterial Properties of
Thymus longicaulis subsp. chaubardii Oils: Three Chemotypes
in the Same Population. J. Essent. Oil Res., 10, pp:97-99
USDA. 1993. Dark-colored hives help protect
bees. Quarterly Report of Selected Research Projects,11p.
Valnet J., Duraffourd C.H., Duraffourd P. & Van
Hoof L., 1978. L'aromatogramme: nouveaux resultats et essais
d'interpretation sur 268 cas cliniques, Plant, Med, Phytotherapie, 12,
pp :43-52.
Vandame R. (1996). Importance de
l'hybridation de l'hôte dans la tolérance à un parasite.
Cas de l'acarien parasite Varroa jacobsoni chez les races d'abeilles
Apis mellifera européenne et africanisée, en climat
tropical humide du Mexique. Thèse de doctorat, Université Claude
Bernard, Lyon 1, 126 p.
Verschaffelt et Stahl, 1915.K. gl. Ak.
Amsterdam, Gertz, Jahr, Wis. Bot., 56, 536p.
Valnet J., Duraffourd C.H., Duraffourd P. & Van
Hoof L., 1978. L'aromatogramme: nouveaux resultats et essais
d'interpretation sur 268 cas cliniques, Plant, Med, Phytotherapie, 12,
pp : 43-52.
Wallner Klaus.2003. Control of the mite
Varroa destructor in honey bee colonies. Pesticide Outlook.
pp :80-84.
Wendling Paul Sébastien Lucien, 2012.
Varroa destructor (Anderson et Trueman, 2000),un acarien ectoparasite
de l'abeille domestique apis mellifera linnaeus, 1758. Revue bibliographique et
contribution à l'étude de sa reproduction.Thèse de
doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire
d'Alfort, 196p.
91
Zine El Abidine A., Fechtal M. et Ismaili M. R., 2001:
Multiplication par bouturage et effet de la fertilisation sur le
rendement et la composition chimique des huiles essentielles d'origan
(Origanum elongatum), An. Rech For au Maroc, Tome 34, pp
40-77, Rabat
Wild A. Varroa ! Myrmecos. Disponible
sur
http://myrmecos.net/2011/04/13/varroa/
(consultée le 16 Juin 2014).
92
Webographie
Anonyme 2014.Composition chimique des huiles
essentielles de thymus satureioides.
Disponible sur
http://www.hunzaroma.com/huile-essentielle-de-thym-a-
borneol.htm.(consulté
le 26 Juin 2014 à 18 heures (GMT+1))
Anonyme 2013.Australian Government.
Australian Quarantine and Inspection Service. AQIS and
Australia's honeybee industries [en-ligne], Mise à jour le 23
septembre
2009, [
http://www.daff.gov.au/aqis/quarantine/pests-
diseases/honeybees],(Consultée
le 12 novembre 2013).
Arista Bee Research. Disponible sur
http://aristabeeresearch.org/fr/resistance-a-varroa/
Consulté le 29 Juin 2014 à 18 heurs GMT
Baaklini, S. 2010. Disparition des abeilles :
des proportions effrayantes au Liban et
dans le monde. In L'Orient le jour
.[Enligne].
http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/678298/Disparitio
n_des_abeilles+%3A_des_proportions__effrayantes_au_Liban_et_dans_le_mond e.html
(Page consultée le 1 Juillet 2014 à 20 heure GMT).
Cantin J.M.2014.« Le comptage des
varroas » la méthode par lavage à l'alcool. Disponible sur:
http://www.apiculture.com/rfa/artic.s
(consulté le 1 Janvier 2014)
Document CA3686 European Working group.2014
Technical guidelines for the evaluation of treatments for control of
Varroa mites in honey bee
colonies.Disponiblesurwww.agroscope.admin.ch/imkerei/00316/00329/.../index.ht
ml? (Consulté le 3 Juillet 2014 à 20 heure GMT)
MorinM.,2010.Au chevet des abeilles. In
Cyberpresse.ca.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201002/28/01-4256169-auchevet-des-abeilles.php
(Page consultée le 1 Juillet 2014 à 19 heures GMT).
Nicolas V., 2009. Les médicaments
vétérinaires pour les abeilles : Situation en Europe. Apivet.
Disponible sur
http://www.apivet.eu/abeilles_dailleurs/
(consultée le 26 Juin 2014).
Randy O., 2006. Beekeeping Through the Eyes
of a Biologist. Disponible sur
Www.ScientificBeekeeping.com.(Consulté
le 1er Juillet 2014 à 18 heure GMT)
Randy O.,2006. Beekeeping Through the Eyes of
a Biologist. Disponible sur
Www.ScientificBeekeeping.com.
Consulté le 1er Juillet 2014 à 18 heure GMT
Var A.,2014. Rucher école de la
Dracénie.Disponible sur :
http://www.varapiloisir.com/spip.php?article87
. (Date de mise en ligne : samedi 24 septembre2005, consultéle 3 Juillet
2014)
93
ANNEXES
94
Annexe 1. Fiche enquête : Etude du Varroa des
abeilles
Date : Observateur : N.B. Une
fiche/rucher
|
Identification et caractéristiques du
rucher
|
|
Nom du propriétaire :
.
|
Localisation
· Province :
|
· Rucher Sédentaire
|
|
· Lieu dit :
|
· En transhumance
|
Raison sociale :
|
|
|
Coopérative Particulier
|
· Coord. GPS :
..............................
|
· Type de rucher : moderne
|
|
· Altitude :
|
traditionnel
|
|
· Pente :
|
· Date de l'installation de
|
|
.
|
l'élevage :
|
|
· Exposition :
|
· Race : ..............................
|
|
.
|
· Nbre de ruches :
|
|
|
· Effectif moy./ruche :
|
|
|
· Production annuelle moy. /ruche
|
|
|
(Kg ou Litre):
|
|
|
......................
|
|
· Quels sont les critères utilisés
pour le choix de l'emplacement du rucher
- Floraison :
- Exposition : - Proximité de cultures : .
- Ensoleillement : - Proximité d'un verger:
- Abri des vents : -
Autres :
- Milieu: Aride : Semi aride : Humide subhumide :
- A proximité d'un point d'eau : Oui : Non :
- La distance entre le rucher et les autres ruchers à
proximité :
· Disposition et gestion du rucher
- La pose des ruches : Surélevées : Au sol :
En rangée : Non arrangées :
- 2m : 4m : Autre :
Ecartement :
- Orientation du rucher (ouverture des ruches) :
Est :
Sud : Ouest : Au hasard :
|
Nord :
|
|
95
? Nourrissage
- Collectif :El - Individuel :El
- Aliment utilisé: Sucre à foyer : El Candi: El
|
|
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Avr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
|
Aou
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Nourrissages
|
Nature et période
|
|
Traitement
|
Période de traitement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Transhumance
|
Localité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres observations :
|
|
96
|
|
|
Cycle d'activité l'abeille
|
de
|
Repos
|
Du
|
au
|
|
Du
|
au .
|
|
Du
|
au
|
|
Du
|
.au
|
|
Du
|
au
|
|
- Déchets de la sucrerie :El Autre : ?
Calendrier apicole
Autres observations
? Etat sanitaire des abeilles pendant la
période d'installation du
rucher au niveau des populations de Thym satureioides
Méthode de diagnostic du Varroa
utilisée par l'apiculteur :
|
|
.1 ruches non traitées arrivant saines sur
les populations de thym - Le risque d'infestation par
Varroa : Fort : El Moyen : El Faible : El
- Un traitement contre le varroa est-il, dans ce cas
? :
Indispensable : El Nécessaire : El Pas nécessaire
: El
- Degré d'agressivité des abeilles
observé :
En début de séjour :
|
Fort : El
|
moyen : El
|
faible :
|
El
|
|
|
|
En plein séjour :
|
Fort : El
|
moyen : El
|
faible :
|
El
|
|
|
|
A la fin de séjour :
|
Fort : El
|
moyen : El
|
faible :
|
El
|
|
|
|
|
A La fin de la miellée et le retour du rucher sur
l'emplacement principal - Etat des ruches (force des colonies) :
Fort : El Moyen :El Faible :El
97
Intactes : Infestées :
- Degré d'infestation/Varroa :
Fort : Moyen : Faible : Nul :
- Etat du couvain :
Régulier : En mosaïque : Des larves mortes :
- Le pourcentage d'infestation (ruches infestées/rucher)
: %
5.2 Ruches traitées arrivant saines sur les
populations de thym - Le risque d'infestation par le
Varroa : Fort : Moyen : Faible :
- Un deuxième traitement contre le varroa
est-il, dans ce cas:
Indispensable : Nécessaire : Pas
nécessaire
:
- Degré d'agressivité des abeilles
observé:
En début de séjour : Fort : moyen :
faibles
En plein séjour : Fort : moyen : faibles
A la fin de séjour : Fort : moyen : faibles
A la fin de la miellée et le retour du rucher
sur l'emplacement principal
- Etat des ruches (force des colonnies)
Fort : Moyen : Faible :
Intactes : Infestées :
- Degré d'infestation/Varroa : Fort : Moyen :
Faible :
- Etat du couvain : Régulier En mosaïque : Des
larves mortes :
- Le pourcentage d'infestation (ruches infestées/rucher)
.%
Ruches arrivant infestées sur les populations de
thym par le varroa
- Le risque de contamination des autres ruches
:
Fort : Moyen : Faible :
- Un traitement est-il, dans ce cas :
Indispensable : Nécessaire : Pas
nécessaire :
- - En cas de non traitement, quel est le
nombre moyen des ruches infestées par rapport au nombre total :
98
- - En cas de traitement, quel est le nombre
moyen des ruches infestées /au nombre total :
- Pour les ruches infestées, quelle est
l'évolution de l'état du rucher (vigueur -agressivité) :
- Evolution de l'état du rucher en cas d'infestation
forte :
|
Stabilité / Aggravation / Diminution
|
|
En début de séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
En plein séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
A la fin de séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
|
- Evolution de l'état du rucher en cas d'infestation
Moyenne :
|
Stabilité / Aggravation / Diminution
|
|
En début de séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
En plein séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
A la fin de séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
|
- Evolution de l'état du rucher en cas d'infestation
faible :
|
Stabilité / Aggravation / Diminution
|
|
En début de séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
En plein séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
A la fin de séjour :
|
Fort :
|
moyen :
|
faible :
|
|
Observations.
6. La fin de récolte et
hivernage
- Des traitements sont ils indispensables : oui : non :
- D'autres maladies ont-elles été
constatées : oui : non :
- Si oui les quelles :
? 1 .
? 2 .
Observations
99
Annexe 2 . Fichier Excel de l'enquête
|
Nom
|
Périodes
|
Lieu
|
Esp.
méllifère
|
Durée (j)
|
Production/ruche (Kg)
|
Agressivité
des abeilles
|
Risque
infestation
|
Symptômes varroa
|
Nbre ruches
infestées (%)
|
|
mar-avr
|
Tamaloute
|
Oranger
|
120
|
10
|
faible
|
Elevé
|
Obs. directe
|
100
|
|
Lfrakiss
|
avr-juin
|
Ighrem
|
Thym
|
40
|
3
|
normale
|
Nul
|
Obs. directe
|
0
|
|
juin-aout
|
Ighrem
|
Euphorbe
|
40
|
3
|
normale
|
Elevé
|
Obs. directe
|
100
|
|
jan-juin
|
Guelmime
|
Oranger
|
90
|
7
|
Forte
|
Moyen
|
Obs. directe
|
100
|
|
Ekafech
|
juin-juillet
|
Ouled Aissa
|
Euphorbe
|
50
|
5
|
normale
|
Moyen
|
Obs. directe
|
60
|
|
juillet-sept
|
Asni
|
Thym
|
60
|
3
|
normale
|
Nul
|
Obs. directe
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
jan-mars
|
Ouled Berhil
|
Oranger
|
60
|
0
|
Forte
|
Moyen
|
mutilées
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
mai-juin
|
Ouzioua
|
Euphorbe
|
45
|
10
|
normale
|
Elevé
|
mutilées
|
80
|
|
Jarra
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
juin-juillet
|
Ighrem
|
Thym
|
30
|
2,5
|
normale
|
Nul
|
mutilées
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
juillet-sept
|
Massa
|
Euphorbe
|
60
|
2
|
Forte
|
Elevé
|
mutilées
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
jan-mars
|
Aoulouz
|
Divers
|
60
|
0
|
Forte
|
Elevé
|
mutilées
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
mars-mai
|
Ait Iaazza
|
Oranger
|
60
|
10
|
Forte
|
Moyen
|
mutilées
|
80
|
|
Toubali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
mai-juillet
|
Ait Baamrane
|
Euphorbe
|
45
|
2
|
normale
|
Moyen
|
mutilées
|
60
|
|
|
Imonaneuzzer
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
juillet-sept
|
Idaoutanane
|
Thym
|
60
|
3
|
normale
|
Faible
|
mutilées
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
fev-mars
|
Imintanoute
|
Amandier
|
60
|
0
|
Forte
|
Elevé
|
mutilées
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
mars-mai
|
Ouled Aissa
|
Oranger
|
60
|
7
|
Forte
|
Moyen
|
mutilées
|
100
|
|
Abakas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
mai-juin
|
Beni Mellal
|
Euphorbe
|
40
|
3
|
Forte
|
Moyen
|
mutilées
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ailes
|
|
|
juillet-sept
|
Ait Daoud
|
Thym
|
60
|
2
|
faible
|
Moyen
|
mutilées
|
100
|
|
Aglif
|
fev-avr
|
Ait Baamrane
|
Divers
|
90
|
0
|
normale
|
Elevé
|
Obs. directe
|
faible
|
|
avr-juin
|
Essaouira
|
Chardon
|
45
|
8
|
normale
|
Elevé
|
Obs. directe
|
moyen
|
|
juin-juillet
|
H. Atlas
|
Thym
|
30
|
5
|
normale
|
Elevé
|
Obs. directe
|
faible
|
|
juillet-aout
|
Ait Oussa
|
Euphorbe
|
45
|
7
|
normale
|
Elevé
|
Obs. directe
|
fort
|
|
mai-juin
|
Tamaloute
|
Divers
|
30
|
3
|
normale
|
Moyen
|
Obs. directe
|
100
|
|
juin-juillet
|
Ighrem
|
Thym
|
40
|
2
|
normale
|
Moyen
|
Obs. directe
|
100
|
|
Affaghrou
|
juillet-aout
|
Indouzane
|
Euphorbe
|
40
|
3
|
normale
|
Moyen
|
Obs. directe
|
100
|
|
aout-sept
|
Ifni
|
Euphorbe
|
20
|
1
|
normale
|
Elevé
|
Obs. directe
|
100
|
|
oct-mai
|
Lasta
|
Oranger
|
180
|
30
|
forte
|
Elevé
|
Obs. directe
|
100
|
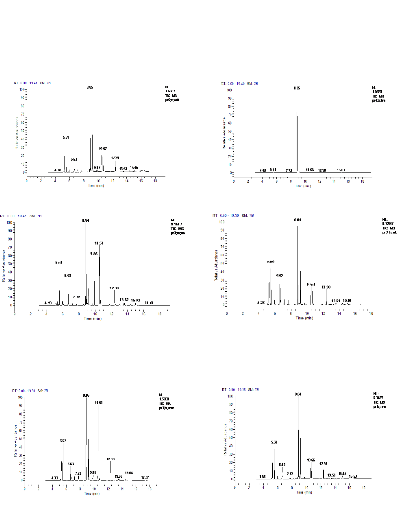
100
Annexe3. Chromatogrammes des HE de différentes
provenances de Thymus satureioides
Chromatogramme de l'HE d'Ankrim (320 m) Chromatogramme de l'HE de
Timoulay (850 m)
Chromatogramme de l'HE d'Aoulouz (1020 m) Chromatogramme de l'HE
d'Ouled Berhil (1240)
Chromatogramme de l'HE d'Amskrod Est (1050 m) Chromatogramme de
l'HE d'Amskrod Ouest (1050 m)
101
Annexe 4. La lutte contre le Varroa destructor
Les méthodes de lutte contre le parasite sont
relativement limitées, notamment à cause de sa capacité
d'adaptation (résistance) aux différents pesticides. Donc dans
l'impossibilité de l'éradiquer totalement, l'objectif du
contrôle demeure alors de permettre aux colonies d'abeilles de cohabiter
avec une infestation de varroas minimale et supportable (une colonie
commencerait à ressentir un dommage pour une infestation comprise entre
3500 et 4000 varroas) (Delaplane et al. 2005).
Par ailleurs, dans la quête de moyens de contrôle,
plusieurs méthodes ont été développées avec
le temps. On en citera entre autres :
A. Le Piégeage
Les méthodes de piégeage suivantes visent
à concentrer les acariens sur un seul cadre de la ruche pour ensuite
éliminer ce cadre. Elles ne permettent que de limiter le taux
d'infestation. De plus, elles peuvent provoquer un affaiblissement de la
colonie (Hanley A. et Duval J.., 1993)
? L'utilisation de cellules à faux-bourdons:
Comme les varroas préfèrent pondre dans les cellules de
faux-bourdons, il est possible de les piéger en fournissant un cadre
avec de telles cellules. Lorsque ces dernières seront operculées,
le cadre sera retiré et la cire fondue ou brûlée.
? L'utilisation d'attractif: Pour attirer les acariens
sur un cadre de la ruche en particulier, on peut utiliser un attractif. Un
produit commercial fabriqué en Belgique, le Varroutest de la compagnie
Sanders Probel Biotechnology, consiste en de l'extrait de larves de
faux-bourdons et permet d'attirer les acariens une fois appliqué sur un
cadre. Le Varroutest attirerait plus de 75% des acariens selon de nombreux
tests faits en Belgique, en Italie, en Grèce et dans les pays de
l'Est.
? L'utilisation d'une nouvelle reine: En retirant et en
faisant fondre le premier cadre à la reprise de la ponte, on peut
enlever une grande partie des varroas présents. Des chercheurs russes
(Petrov et Khazbievich, 1980) ont observé que le couvain du premier
rayon où une nouvelle reine a pondu est infesté de varroa
à 46% tandis que les autres ne le sont qu'à 4%. En retirant ce
rayon, ils ont pu réduire grandement la population de parasites, la
colonie s'est par la suite bien développée et a pu hiverner de
façon satisfaisante.
102
? L'introduction de jeunes larves: On introduit des
jeunes larves d'abeilles dans les colonies au moment où elle n'en a pas.
Les parasites se précipitent sur ces larves pour y pondre. On retire le
cadre aussitôt que les cellules sont operculées. La méthode
a plusieurs avantages, notamment elle respecte le cycle reproducteur de
l'abeille et permet à la colonie de développer une
résistance graduelle au Varroa.
? Reine engagée: Cette méthode consiste
à enfermer la reine sur un cadre trois fois de suite à
intervalles de 10 jours. Au bout des 30 jours, le cadre est sorti et
brûlé. La reine peut être sacrifiée ou non. Environ
60% des varroas seraient éliminés de cette façon.
B. La thermothérapie
Plusieurs expériences ont été
menées sur l'utilisation de la chaleur contre le varroa et l'acarien de
l'abeille qui vit dans la trachée, certaines avec un certain
succès, d'autres pas. Les acariens sont très sensibles à
la chaleur. En ex-URSS, une technique de lutte contre le varroa consiste
à passer les colonies dans une chambre chauffée à 46-48C
pendant 15 minutes. La méthode est coûteuse et brutale pour les
abeilles. Des expériences réalisées en Louisianne par John
Harbo du Département américain de l'agriculture (USDA., 1993) ont
démontré qu'une température de 39°C pendant 48 heures
décimait les acariens de l'abeille.
C. L'usage de produits anti-adhésifs
Comme l'acarien dépend de l'abeille pour se
déplacer dans la ruche et d'une ruche à l'autre, les apiculteurs
et chercheurs ont pensé à utiliser des produits qui
empêchent l'acarien d'adhérer au corps de l'abeille, et donc de se
propager. On peut citer :
Farine: Des apiculteurs de l'Inde (Shah et Shah, 1988)
saupoudrent les abeilles de 10 à 15 grammes de farine de blé
dès l'apparition du varroa et répètent ce traitement trois
fois à une semaine d'intervalle. La farine empêche simplement les
acariens de s'accrocher à l'abeille et donc de voyager d'un rayon
à l'autre. Cette méthode ne pose de problème ni aux
abeilles, ni au miel.
Corps gras: Selon le même principe, Sammataro
(1994) conseille de placer une galette faite d'un mélange de 150g de
farine végétale et 300g de sucre en poudre sur les barres du haut
de la ruche où se trouve un couvain. Les abeilles pensent qu'il s'agit
de déchets
103
et petit à petit vont l'évacuer de la ruche.
Pendant ce temps, la farine empêche les acariens de s'accrocher aux
abeilles.
D. L'électricité
Dans la province du Ryazan en ex-URSS, un chercheur a mis au
point une méthode de lutte efficace à 100% contre les varroas
accrochés aux abeilles et qui utilise l'électricité (Egin,
1988).Il s'agit d'une plaque percée de trous tout juste assez grands
pour laisser passer les abeilles et qui est placée à
l'entrée de la ruche. Le bord de chaque trou est frangé de
façon à créer une espèce de brosse. La plaque est
trempée dans un électrolyte. Lorsqu'un courant de 12 volts passe
par la plaque, les varroas qui sont attachés aux abeilles sont
paralysés et tombent tandis que les abeilles ne sont pas
affectées.
E. Sélection d'abeilles tolérantes ou
résistantes à Varroa jacobsoni
En 1984, plusieurs années après la
découverte de Varroa jacobsoni en Yougoslavie et trois ans
avant que cet acarien soit identifié aux Etats-Unis, un projet de
recherche conjoint avait été établi. Le but de ce projet
était d'essayer de sélectionner des souches d'abeilles
mellifères tolérantes ou résistantes à ce parasite.
Quatre générations provenant de deux lignées d'abeilles
mellifères (Apis mellifera carnica) furent propagées
sélectivement à partir de ces reines. Les deux lignées
étaient sélectionnées pour une infestation
élevée et faible du couvain par les acariens. Des
différences
significatives dans toutes les générations de
sélection montraient que cette
caractéristique était
héritable, car une proportion significative de cette variation
génétique était additive. L'amélioration par
sélection, à condition d'être organisée sur une base
génétique plus large, peut offrir les solutions à long
terme espérées concernant le problème de la Varroase. (De
Guzman et al. 1997; Al Ghamdi, 2002)
F. La lutte biologique
Peu de recherches sur le contrôle biologique du
Varroa ont été réalisées. L'utilisation de
toxines de Bacillus thuringiensis et de virus a été
envisagée mais aucune application pratique n'est prévue à
court terme. Des isolats de champignons (Verticillium lecanii, Hirsutella
spp., Paecilomyces spp., Beauveria bassiana, Metarhizium spp., Tolypocladium
spp.) testés expérimentalement ont permis d'infecter et de
tuer V. destructor (Kanga et al. 2002 ).
104
G. L'utilisation de la roténone
La roténone est un insecticide végétal
toléré par les cahiers de charge d'agriculture biologique pour la
protection des productions végétales. Son utilisation contre le
Varroa a été développée en France par des
apiculteurs biologiques. Pour être efficace, la roténone doit
être appliquée pendant un cycle de vie complet du Varroa,
soit 30 jours. Il faut l'utiliser avec une grande prudence car elle peut tuer
les reines.
H. L'aromathérapie
Beaucoup d'acides organiques sont répandus dans la
nature et certains d'entre eux (notamment l'acide formique) se produisent
naturellement dans le miel et ne laissent pas de résidus toxiques
(Imdorf et al. 2003).
Certaines des essences de plantes sont efficaces sur les
Varroas qui infestent le couvain et d'autres ne le sont pas. L'acide
oxalique, par exemple, n'est pas efficace contre les acariens qui infestent le
couvain, et n'est donc utilisé que chez les colonies sans couvain, comme
ceux qui se produisent en novembre. L'acide formique, est efficace aussi bien
contre les Varroas qui infestent le couvain que ceux
phorétiques. Les acides organiques sont utilisés pour
réduire les populations d'acariens à un niveau qui permet
à la colonie de se développer, mais des traitements annuels (et
parfois biannuels) sont nécessaires pour limiter l'infestation (Burlew,
2009). Aucun acide organique ne s'est révélé être
à 100% efficace pour tuer les acariens.
Les biopesticides à base d'huiles essentielles (HE)
forment une classe de pesticides intéressante puisqu'étant
constituées de plusieurs composés à mécanismes
d'action multiples, elles ont des modes d'application variés
(fumigation, répulsion, contact). Comme tous les extraits de plantes,
elles mettent en action simultanément plusieurs mécanismes
physiologiques (par opposition à des pesticides n'ayant qu'une seule
cible moléculaire), et de ce fait, l'apparition de populations
résistantes d'insectes se retrouve retardée (Chiasson et Beloin,
2007).
Les huiles essentielles sont souvent utilisées pour la
lutte contre le Varroa. Péguin (1991) a proposé un
traitement à base d'huiles essentielles en mélangeant l'huile de
thym de sariette, de lavande et de génévrier additionnée
de sauge, de menthe et de girofle. Miguel Neira et al. (2004) au chili
ont étudié l'effet des huiles essentielles de lavande et de
laurier sur Varroa destructor. Les deux HE ont été
diluée à 30% avec de
Outre la fumigation, d'autres méthodes d'application
ont été essayées, y compris l'utilisation de la
fumée (Ghomari et al. 2013). En Turquie, les feuilles de
différentes
105
l'acétone avant les traitements. Au terme de leur
expérience, 100% des Varroas ont chuté des abeilles mais
avec une mortalité du parasite de 41,67% pour le traitement à
l'HE de lavande et 35% de mortalité pour le traitement à l'HE de
laurier.
Muhammad Asif et al. (2013) au Pakistan ont
effectués contre le Varroa des tests d'efficacité de
traitement à base d'HE de Neem, à base d'un mélange (HE de
Neem, HE d'ail et de l'HE de tabac) et à base d'HE de tabac. La plus
importante chute d'acariens a été observée après 15
jours pour le traitement par le mélange (huile de Neem , huile d'ail et
huile tabac). Il y a eu, en effet, en moyenne 91,46 varroas
décrochés au niveau du traitement par le mélange d'HE
contre 61,34 pour le traitement à base d'HE de Neem et 71,33 pour le
traitement par l'HE du Tabac.
Onze huiles volatiles ont été testées
contre Varroa destructor in vitro en Egypte (Abd E., et al.
2006). Il s'agit des HE de menthe, de Thymus vulgaris,
d'Eucalyptus, de marjolaine, de cumin, de l'ail, du basilic, de l'orange, du
Géranium, de menthol et de l'Eugénol. Les résultats ont
montré que tous les traitements ont été efficaces contre
le Varroa (réduction de 66% de varroa en moyenne) et une
différence significative a été observée dans les
colonies traitées par rapport à ceux non traités.
Néanmoins quelques mortalités d'abeilles ont été
observées.
Les acides organiques et des huiles essentielles fonctionnent
de façons différentes pour contrôler le Varroa.
L'effet acaricide essentiel des acides organiques est d'abaisser le pH dans la
ruche, un phénomène toléré par les abeilles, mais
au détriment des acariens (Wallner, 2003). Les huiles essentielles ont
quant à elles, deux modes d'action dans la lutte contre le
Varroa. Elles peuvent tuer les acariens par contact (Armine et al.
1996). Comme les abeilles se déplacent dans la ruche, elles
s'imprègnent d'huile essentielle et la dispersent. Par ailleurs, si
l'huile est mélangée au sirop liquide de nourrissage, les
abeilles nourricières s'en alimentent (effet par ingestion) et la
nourrissent aux larves.
L'un des problèmes rencontrés avec les huiles
essentielles et les acides organiques est leur extrême volatilité.
Ebert et al. (2007) ont cherché à réduire les
problèmes liés à la volatilité en incorporant un
certain nombre de composés végétaux directement dans le
sirop de nourrissage destiné aux abeilles
106
plantes sont séchées et brûlées ;
la fumée est dirigée dans les ruches. Les fumées de tabac,
de cèdre, thym, pin, et le pyrèthre (chrysanthème) se sont
tous été révélés efficaces contre le
Varroa (Cakmak et al. 2006), mais jusqu'à
présent, aucun avantage particulier n'a été trouvé
dans l'utilisation de la fumée, par opposition à une autre
méthode d'application.
I. L'utilisation de répulsifs
Des apiculteurs biologiques allemands considèrent que
la présence à proximité des ruches de certaines plantes
à forte odeur explique que leurs ruches soient exemptes de
Varroa. Les plantes en question seraient l'ail des ours et la
fougère-mâle (Dryopteris filix-mas). Cette
dernière étant reconnue pour ses propriétés
acarifuges. Des fumigations de mélisse et de menthe ont aussi produit de
bons résultats en Allemagne (Rademacher, 1983).
J. Lutte par traitements acaricides
Le Hort. Research Client Report No. 2001/249 présente
une revue complète des produits acaricides utilisés contre le
Varroa ainsi que leur principe actif et leur dose et mode
d'application
107
Tableau a. Liste de produits ayant montré une
efficacité significative dans le contrôle de la
varroase
|
Nom commerciale des Produits
|
Principe actif
|
Classe chimique
|
|
Apiguard
|
Thymol
|
Huile Essentielle
|
|
Apilife VAR
|
Thymol,eucalyptol, menthol, camphor
|
Huile Essentielle
|
|
Apistan
|
Fluvalinate
|
Pyrethroid Synthétique
|
|
Apitol
|
Cymiazol
|
Dérivé Iminophenyl thiazolidine
|
|
Apivar
|
Amitraz
|
Amadine
|
|
Bayvarol
|
Flumethrin
|
Pyrethroid Synthetique
|
|
Check-Mite+,Perizin
|
Coumaphos
|
Organophosphate
|
|
Folbex
|
Bromopropylate
|
hydrocarbure Chlorinaté
|
|
Generic
|
Acide Formique
|
Acide organique
|
|
Generic
|
Acide Lactique
|
Acide organique
|
|
Generic
|
Acide Oxalique
|
Acide organique
|
(Anonyme, 2001)
Faucon et al. (2007) relatent d'autres
spécialités d'acaricides utilisés (Tableau 2)
Tableau b. Nature de traitements mis en oeuvre pour le contrôle
la mise en évidence du Varroa
|
Matière active
|
Specialité commerciale
|
Dosage
|
|
Acide oxalique
|
Acide oxalique dihydrate
(Merch)
|
35 g/l de sirop de
saccharose
50/50
|
|
Coumarphos
|
Asuntol ND (Bayer)
|
15 g d'Asuntol ND pour 11 litres d'eau
|
|
Fluvalinate
|
Apistan ND (Swarm)
|
Lanière contenant 0,5 de fluvalinate
|
(Faucon et al. 2007)
108
En France, afin de minimiser la charge parasitaire, cinq
médicaments disposant d'une Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM) pour la varroose de l'abeille sont actuellement disponibles: l'Apistan,
l'Apivar, l'Apiguard,le Thymovar et l'Apilife Var. Au Maroc les produits
disponibles et proposés actuellement par les services
vétérinaires pour la lutte contre le Varroa sont:
l'Apiguard, l'Apistan, l'Apitol, le Fumidil B., l'Apilife Var, le Bayvarol et
le Perizin.
Par ailleurs, d'autres molécules sont autorisées
en Europe mais qui ont montrées avec le temps des problèmes de
résistance et d'inefficacité vis du Varroa infestant le
couvain (Elzen et al. 2000): le coumafos (Autriche, Belgique, Chypre,
Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Portugal, Roumanie, Slovénie,
Bulgarie), l'acrinathine (République Tchèque, Lituanie), la
fluméthrine (pyréthrinoïde) (Estonie, Allemagne,
Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Royaume-Uni, Bulgarie).
Il faut signaler qu'une des molécules les plus
utilisées en France, considérée comme la plus efficace:
l'amitraze, n'est pas autorisée dans d'autres pays européens
(Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Islande,
Norvège, Suède, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande,
Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Bulgarie, Royaume-Uni) (Nicolas
Vidal-Naquet, 2008).
K. Mise en oeuvre de la lutte
Les conditions climatiques, les périodes de
miellées, le développement de la population de V.
destructor doivent être pris en compte lorsque l'on met en place une
stratégie de lutte. Après une forte miellée, le couvain
est réduit par manque de place, donc le pourcentage d'alvéoles du
couvain infestées augmente (Imdorf et al. 2003).
Les traitements habituels pour réduire la population de
V. destructor se font en fin d'été (août et
septembre) dès la dernière récolte de miel, le but
étant de réduire au maximum l'infestation du couvain, afin
d'obtenir un développement normal des abeilles destinées à
passer l'hiver (Colin, 1989). L'objectif est d'obtenir une population de moins
de 50 V. destructor à l'intérieur des ruches pour passer
l'hiver .On peut vérifier que cet objectif est bien atteint si moins de
1 chute naturelle d'acarien est observée quotidiennement à
l'issue de la période d'efficacité du traitement de fin
d'été (Imdorf et al. 1996; 1999; The Food and
Environment Research Agency, UK, 2010).
109
Si cet objectif n'est pas atteint, deux solutions:
- un traitement complémentaire peut être
envisagé.
- la mise en place de moyens de lutte biotechnologique en
début de saison apicole; le plus facile à mettre en place
étant le retrait de cadres de couvain de faux-bourdons operculés
(avril-mai).Un traitement de `secours' pourra être aussi
réalisé pendant la période apicole (mars à
août) si le niveau d'infestation par V. destructor
dépasse les seuils critiques (Charrière et al. 1998).



