I- ACTIVITÉS BANCAIRES ET
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : ENJEUX ET PARADOXES. UNE
ÉTUDE APPLIQUÉE À LA BICEC
II- Contexte et constat de la recherche
La fin des années 80 dans la plupart des pays de la
zone CEMAC est marquée par une grave crise du secteur bancaire dont la
manifestation la plus apparente a été la liquidation de plusieurs
établissements de crédits. Plusieurs raisons ont permis
d'expliquer cette crise. D'abord, une conjoncture économique
dégradante du fait de la chute des cours des produits de base
exportés par les pays de la sous-région et sur laquelle reposait
leur économie. Ensuite, le fait que l'État ait joué un
rôle d'actionnaire majoritaire dans ces banques a abouti à la
transposition des problèmes des gouvernements à ceux des banques
devenues fragiles. Enfin, on a également évoqué
l'inefficacité du système de surveillance et la mauvaise gestion
de ces banques.
Pour y remédier les autorités monétaires
de la sous-région ont entreprises des réformes portant sur le
renforcement du cadre réglementaire et prudentiel. On a surtout
assisté à la libéralisation de l'activité bancaire
ainsi qu'à de nombreuses restructurations du système bancaire.
C'est ainsi que la Commission Bancaire d'Afrique Centrale (COBAC) voit le jour
en 1993 en tant qu'organe supranational de supervision des
établissements de crédits. Elle apprécie la santé
financière de ces derniers afin de prendre les mesures correctives en
cas de nécessité. C'est ainsi que dès l'année
suivante, et avec la dévaluation du franc CFA, les banques commerciales
de la zone CEMAC se retrouvent dans une situation de surliquidité
donnant ainsi une présomption d'une bonne santé
financière. Depuis lors, les choses ne semblent pas avoir changé,
du moins jusqu'à la récente crise financière mondiale.
En effet, à travers la crise financière de
2008, on a observécomment un phénomène national né
aux États-Unis, pouvait rapidement s'internationaliser pour devenir un
phénomène mondial. On a surtout observé comment un
phénomène né sur le marché boursier pouvait gagner
tout le secteur financier et s'étendre sur l'ensemble de
l'économie.Cette crise a montré les lacunes des grands acteurs du
marché financier. Elle a surtout montré que tous les
problèmes économiques et financiers des établissements de
crédits ne pouvaient pas être résolus seulement de
manière « macro » (le rôle que joue la COBAC
Afrique Centrale), mais qu'il incombe à chaque établissement
financier, de mettre sur pied, des dispositifs prudentiels pour se
prévaloir de tels risques. Il importe donc pour nos
établissements de crédits en général, et nos
banques en particulier, de mettre sur pied des techniques de gestion qui
assurent au mieux la couverture, non pas seulement du risque de faillite mais
également du risque de perte de fiabilité auprès de
l'ensemble de ses parties prenantes.
En d'autres termes, comme toute entreprise consciente qui
exerce dans une société, les établissements financiers
doivent désormais prendre conscience que la performance
économique ne conduit pasobligatoirement au bien-être de la
société et au progrès social.Face à la destruction
del'environnement, la discrimination vis-à-vis de certains groupes
sociaux, l'insécurité dans letravail, il devient
nécessaire d'établir de nouvelles règles
économiques, sociales etécologiques, contribuant à une
meilleure entente entre tous les acteurs de la société. Et comme
le soulignent si bien Allemand I. et Brullebaut B. (2007), il nes'agit pas
seulement de l'élaboration de lois, mais d'une part de la multiplication
d'actions volontaires,permettant aux générations présentes
de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause lacapacité des
générations futures à satisfaire les leurs et d'autre
part, de concilier la protection del'environnement naturel, le
développement social ainsi que le développement
économique. En bref les établissements financiers doivent
désormais être « socialement responsables ».
Ce qui signifie aux termes de la Commission Européenne (2001), non
seulement de s'arrimer pleinement aux obligationsjuridiques applicables, mais
aussi aller au delà et investir davantage dans le capital
humain,l'environnement et les relations avec les parties prenantes.
Ainsi, la problématique de la Responsabilité
Sociétale de l'Entreprise (RSE) autrefois propre à la firme,
semble gagner une nouvelle sphère, mieux un nouveau champ d'application,
celui des établissements financiers en général, et de la
banque en particulier. La responsabilité sociale ou sociétale de
l'entreprise est un principe largement répandu dans le corps social
notamment celui du développement durable (Domergue F., 2014).
D'après cet auteur, le concept de RSE est basé sur la
dépendance mutuelle entre l'entreprise et la société. Il y
a une interaction entre l'entreprise et les parties prenantes, l'entreprise et
le gouvernement, l'entreprise et l'environnement, l'entreprise et
l'éthique, et l'entreprise et l'avantage compétitif durable
(Bowen H., 1953 ; StanwickP A. et StanwickS. D., 1998 : Maignan I. et
Ralston D., 2002). La RSE agit sur quatre responsabilités :
économique, juridique, éthique et philanthropique (Carrol A. B.,
1999) et exprime l'opportunité pour les décideurs d'entreprises
de réduire les coûts à long terme et de valoriser
l'excellence de l'entreprise citoyenne (NormannR. et Ramirez R., 1993).
La responsabilité sociale de l'entreprise est un enjeu
très actuel, mais il ne s'agit paspour autant d'un concept nouveau.
Depuis les activités philanthropiques des sociétés
industrielles visant à améliorer les conditions de vie et de
travail jusqu'à la mise en valeur des dimensions économique,
sociale et environnementale d'aujourd'hui la perspective de la
responsabilité sociale de l'entreprise a évolué de
façon considérable (Mekdessi S., 2007). D'ailleurs, comme le
souligne Pasquero J. l'évolution des exigences de la
responsabilité sociale de l'entreprise repose sur les acquis du
passé.
Comme toute autre entreprise, la banque dans la
réalisation de ses opérations de collecte et d'octroi de
crédit, interagit avec une multitude de parties prenantes à qui
elle doit rendre des comptes. Les activités de la banque étant
essentiellement financières, la problématique du
« socialement responsable »se pose avec acuité. En
effet, bien qu'elles soient rentables, l'on aimerait savoir pourquoi les
banques devraient « gaspiller » de l'argent aussi bien en
interne qu'en externe pour la mise en oeuvre des activités à
priori non génératrices de ressources additionnelles. Car
reprenant Friedman M. (1970), «The Social Responsibility of Business
is to Increase Profits». Pourtant la banque peut jouer un rôle
remarquable dans la circulation du message de la RSE auprès de ses
tiers.
En effet, comme l'a montré l'Agence Française
de Développement (AFD), les banques constituent un vecteur de
développement de la RSE dans les entreprisesclientes, notamment les
PME.La promotion de la RSE auprès des banques vise doncà
renforcer la politique RSE de la banque, mais aussià permettre une
sensibilisation de ses clientes PME àl'adoption de meilleures pratiques
(AFD, 2014). Vu sous cet angle, la banque constitue un double enjeu pour la
mise en oeuvre des politiques RSE.L'exigence d'un comportement socialement
responsable est de plus en plus pressantepour toutes les organisations.Dans
plusieurs pays développés, le secteur bancaire est relativement
concentré. Enconséquence, les institutions financières
sont grandes, plus ou moins rentables et très visibles. Ces
facteursexpliquent les attentes élevées tant du public que des
gouvernements face à ces institutionspour qu'elles redistribuent
à l'ensemble de la société une partie de leur richesse et
qu'ellessoient à l'avant-garde du développement durable.
A l'échelle internationale, plusieurs programmes ont
été établis en vue d'appuyer lesinstitutions du secteur
bancaire dans la mise en oeuvre de leurs pratiques en matière
deresponsabilité sociale. C'est le cas du Programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE), reconnaissantl'importance du système
financier dans la promotion du développement durable, et qui a
émis en1992 la Déclaration des institutions financières
sur l'environnement et le développementdurable. On peut également
citer le cas de Global Reporting Initiative (GRI), qui est sans doute
l'initiative la plus connue née en 1997 et affiliée aux Nations
unies à titre de Centre de Collaboration du PNUE. Elle a pour mission le
développement et la promotion de méthodesd'information comptable
(reporting) sur le développement durable.
Seulement, ces initiatives sont propres à des
contextes particuliers, notamment aux pays en voie de développement.
Mais, dans notre contexte comme ailleurs, les institutions financières
banquières sont de taille moins grandes mais demeures néanmoins
rentables. Elles ont donc une image et une réputation certaine à
protéger.La prise en compte des principes de Responsabilité
Sociétale de l'Entreprise par les établissements financiers,
devient donc une nécessité grandissante.Pourtant, dans le cas des
Banques au Cameron et de la BICEC en particulier, l'implication dans les
activités RSE n'est pas une priorité. Ce constat nous pousse donc
à porter une attention particulière au thème
suivant : activités bancaires et responsabilité
sociétale : enjeux et paradoxes. Une étude appliquée
à la BICEC.
III- Problématique de la recherche
Concilier la recherche du profit à la mise en oeuvre
d'activités extra-financières est déjà l'objet de
nombreux débats et controverses tant dans le milieu académique
que dans le cadre professionnel. Mais ces travaux se sont pour la plupart
limités au monde de la firme. Ce n'est que depuis la dernière
décennie qu'ils prennent de l'ampleur dans le monde de la finance en
général, et dans celui de la banque en particulier.
En effet, les banques ont été pendant longtemps
tenues à l'écart de la problématique de
développement responsable. Pour Eurogroup Consulting (2012), cela
était dû d'une part au faible impact environnemental et
écologique (faible utilisation des ressources naturelles, absence
d'usines de transformation, ...) ; d'autre part compte tenu du niveau de
régulation et d'encadrement de l'activité bancaire. Ces
dernières années, les évolutions ont été
nombreuses et la notion de développement responsable s'est
progressivement étendue au secteur bancaire. Au départ, il
s'agissait beaucoup d'une question d'image et d'affichage. Aujourd'hui, l'enjeu
est devenu plus prégnant : le développement responsable est
désormais un sujet qui touche à la stratégie, au business
model et à l'humain qui compose la banque (Chen M.C., 2005).
Les actions RSE s'inscrivent dans le cadre des relations de la
banque avec sonenvironnement, puisant dans les fondements à la fois de
la théorie de la contingence, de lathéorie institutionnelle et de
la théorie de la responsabilité sociale des organisations.
Lathéorie de la contingence met en lumière la faculté
d'adaptation de l'organisation considéréecomme un système
ouvert à l'influence de facteurs de contingence, tels que les
technologies,les types d'activités, de structures, de stratégies
ou de taille (Lawrence et Lorsch, 1967). Les facteurs de contingence ainsi
soulignés remettent au devant de la scène, les problèmes
de gouvernance d'entreprise.
Quant à elle, la littérature sur la
responsabilitésociale des entreprises traite abondamment des motifs pour
lesquels les entreprises adhèrentou devraient adhérer à ce
principe, surtout lorsque ce n'est pas une obligation légale.
Laconception de la responsabilité sociale d'une entreprise ne fait pas
l'unanimité. Pour Barnard A. (1958), laresponsabilité ne doit pas
être imposée ou être arbitrairement
déléguée aux organisations. Arguant dans le même
sens et de manière plus radicale, Friedman M. (1970), "L'entreprise a
une et une seule responsabilité sociale : utiliser sesressources et
exercer ses activités destinées à accroître ses
bénéfices, dès lors qu'elle respecteles règles du
jeu, à savoir prendre part à une concurrence ouverte et libre,
sans tromperies ni fraude". Selon la littérature sur la
responsabilité sociale des entreprises, celle-ci peut
êtreconsidérée en tant qu'une réponse
organisationnelle au questionnement social (d'ordreinstitutionnel) auquel font
face les entreprises.
Ces fondements théoriques et conceptuels
soulèvent certaines interrogations du point de vue dumanagement
stratégique. Les entreprises adoptent ou devraient adopter
généralement despratiques dites responsables pour être
perçues comme éthiques, pour gérer leurs relations avecla
société ou pour tenir compte des enjeux sociaux dans le cadre de
la gestion stratégique.Elles le font d'abord pour elles-mêmes,
pour conserver leur légitimité et pour assurer
leurpérennité et leur position socioéconomique. Mekdessi
S. (2007) rappelle que la première étape pour qu'une banque
conservesa légitimité auprès de la société
comme du gouvernement est de se conformer aux exigenceslégales et
réglementaires. Si les banques adoptent des pratiques en matière
de responsabilitésociale des entreprises et d'inclusion sociale, la
question est de savoir si elles y sontcontraintes ou si elles le font de
façon volontaire.
Pour les banques qui le font volontairement, ca peut
être dansle but de se démarquer, d'en retirer un avantage
concurrentiel et d'en retirer ainsi une valeurajoutée.Pour celles qui le
font uniquement pour se conformer à des exigences, il faudrait que des
lois soient mises en place pour qu'une banque soit forcée à
prendre en considération les conséquences sociales de
sesactivités non seulement par rapport à ses actionnaires, mais
aussi par rapport à ses autrespartenaires, au sens où l'entend
Freeman (1984), incluant la société dans laquelle elle
évolue.Dés lors, il serait nécessaire que soient mises en
place, des règles de jeu capables de les influencer pour amener les
entreprises, et notamment les banques, à se questionner et à
êtreplus responsables socialement.
En effet, l'institution bancaire est une entreprise de secteur
tertiaire, c'est-à-dire une firme fournissant des services. De par son
statut « d'entreprise », il est par conséquent possible de
parler de responsabilité sociétale d'une banque (Cayrol A.,
2006). Toutefois, vu la nature de ses opérations, cette dernière,
contrairement à d'autres entreprises, se joue plus au niveau indirect.
C'est qu'on apprend des définitions du Council on
EnvironmentalQuality1(*):
- Direct effects, which are caused by the action and occur
at the same time and place;
- Indirect effects, which are caused by the action and are
later in time or farther removed in distance, but are still reasonably
foreseeable.
Par exemple, il est important que la banque, en tant
qu'entreprise de services, contrôle sa consommation de papier, son
utilisation d'énergie, sa gestion des déchets, son recyclage de
manière à réduire ses impacts environnementaux comme il
est important qu'elle veille aux conditions sociales locales (tant en interne
qu'en externe). Mais de tels engagements semblent à priori
contradictoires aux objectifs de rentabilité financière des
banques. Dans cette perspective, l'interrogation majeure de ce travail de
recherche est la suivante : Quels enjeux la mise en oeuvre des
activités RSE présentent-t-elle pour une
banque comme la BICEC? En d'autres termes,
que gagnerait la BICEC à être socialement
responsable ?
Cette question centrale suscite les sous-questionnements
suivants :
· Quelles sont les activités exercées par
la BICEC ?
· La BICEC intègre-t-elle les attentes des parties
prenantes dans sa politique de gestion?
· La BICEC est-t-elle impliquée dans la protection
de l'environnement ?
· Les activités RSE d'une banque comme la BICEC
peuvent-t-elles avoir un impact sur sa performance (sociale et
commerciale) ?
IV- Objectifs de la recherche
Ce travail effectue un rapprochement entre les
activités bancaires et les activités de responsabilité
sociétale. Il vise principalement à découvrir les
enjeux de la mise en oeuvre d'activités extra-financières pour la
BICEC. Pour ce faire, il nous faudra spécifiquement :
· Présenter les activités principales
exercées par la BICEC ;
· Caractériser la politique de la BICEC envers ses
parties prenantes ;
· Découvrir le degré d'implication de la
BICEC dans la lutte contre la pollution ;
· Découvrir la nature de l'effet des
activités extra-financièresde la BICECsurson image, sa
réputation et sa différentiation.
V- Intérêt de la recherche
Les débats actuels sur la protection de la couche
d'ozone, le réchauffement climatique, le développement durable
est soutenable, la scolarisation de la jeune fille et l'égalité
des genres (...), font l'objet de nombreuses recherches dans tous les domaines
de la science. Les sciences de gestion n'en font pas abstraction. Le
thème que nous abordons dans ce travail de recherche a la
particularité d'envisager rapprocher deux concepts
généralement contradictoires : la performance
financière et la performance sociale. Son importance est d'autant plus
grande qu'il envisage s'appliquer au domaine bancaire.
De manière analytique, l'importance de ce travail de
recherche se relève à trois grands niveaux :
Pour la banque, ce travail met en relief le caractère
« rentable » ou « performant » des
activités extra financières. Il va permettre à la BICEC et
aux autres banques de se rendre compte du rôle que jouent les pratiques
de RSE au sein des entreprises en général et des
établissements financiers en particulier.
Pours les parties prenantes, il remet au devant de la
scène, le rôle que joue cette catégorie de personnes
(physiques ou morales) pour l'image et la réputation de l'entreprise. Il
s'agit aussi bien des parties prenantes internes (salariés et
actionnaires) que des parties prenantes externes (gouvernement, ONG, syndicats,
société civile, concurrents, ...).
Pour la recherche en master banque, ce travail va
significativement contribuer à enrichir la littérature sur les
thématiques de performance sociale, de responsabilité
sociétale, de théorie des parties prenantes, de performance
commerciale et de performance managériale. Il a surtout la
particularité d'aborder ces différents concepts non plus dans le
domaine de la firme, mais surtout dans le domaine des établissements
financiers, notamment de la banque.
VI- Hypothèses de la recherche
Les recherches sur la thématique de la
responsabilité sociétale des entreprises sont de plus en plus
nombreuses à travers le monde. Certains travaux établissent
d'ailleurs un lien positif entre RSE et performance de l'entreprise.Orlitzky M.
et al. (2003), après avoir fait une synthèse de plusieurs
études menées avant eux sur les interactions entre la RSE et la
performance, ont révélé que dans la plupart des cas (pris
dans différents contextes), on a décelé des liens positifs
et aussi quelques liens négatifs et que par conséquent, on peut
mesurer cette performance.
Il est à remarquer que la littérature empirique
ne fait pas état d'un consensus sur la nature du sens du lien de
causalité.L'examen des résultats des études existantes
traduit pour une part l'influence de la RSE sur sa performance
financière, et pour une autre part, le sentiment d'un lien fragile voire
inexistant et quelque peu contrasté (Allouche J. et Laroche P., 2005).
Mais ces résultats ont été constatés dans le champ
plus général de l'entreprise industrielle et commerciale. Le
présent travail s'interroge sur ce que serait cette relation dans le
secteur financier, notamment le secteur de la banque.
Pour appréhender cet aspect de la relation, nous
émettons comme hypothèse principale ou
hypothèse générale (HG), l'idée suivante :
HG :Les activités
extra-financières de la BICEC ont une influence sur sa
performance
Mais, compte tenu du caractère polysémique et
pluriel du concept de performance en sciences de gestion, nous allons
uniquement nous focaliser sur la performance relationnelle (image et
réputation) et la performance commerciale (notoriété,
concurrence).
D'après Cheynel H. (2010), l'entreprise est
dorénavant exposée à un véritable « risque de
réputation ». Lesrésultats financiers sont
oblitérés s'ils sont obtenus dans des conditions qui
contreviennentaux règles déontologiques et environnementales
considérées comme socialement exigibles.Et la crise, largement
d'origine bancaire, rend encore plus aigue pour les
établissementsfinanciers la question de leur image.On comprend
aisément pourquoi Les banques accordent un grand soin à la
publication des rapports annuels sur leDéveloppement durable, qui sont
de plus en plus fournis. Des labels récompensent lesrapports
jugés les meilleurs.
Le secteur bancaire se caractérise par la nature
même des relations qu'il entretien avec ses clients (Fahd R., 2009). Ces
relations reposent essentiellement sur la confiance permettant d'instaurer ou
restaurer une bonne réputation des banques auprès du grand
public.Domergue F. (2014) souligne d'ailleurs que la crise de 2008 a
révélé une défaillance des banques en ce domaine,
et qu'à la crise de crédit s'est ajoutée celle de la
confiance. Par conséquent, l'image des banques s'est fortement
détériorée, notamment auprès des clients actuels et
potentiels. Ce secteur a vite compris ce malaise en réagissant par une
stratégie de transparence et de communication, notamment par le biais de
la RSE (Bratu D. et Jacquin M. P., 2007).
Les constats opérés ci-dessus ont
été d'une forte empreinte dans les contextes américains et
européens, brefs dans les contextes d'économies
développées ou émergentes. Pour effectuer un
parallèle avec une banque d'une économie en voie de
développement, nous émettons les deux premières
hypothèses spécifiques suivantes :
· HS1 : Les activités extra
financières de la banque ont un impact sur son image et sur son risque
de réputation ;
· HS2 : La communication RSE par la BICEC a une
influence sur son image et sa réputation.
Domergue F. op cit.souligne qu'un niveau plus
récent et plus puissant explique la grande importance que les
entreprises françaises, à la suite de leurs homologues
anglo-saxones accordent désormais à la RSE. Celle-ci est en effet
sortie d'une sphère essentiellement éthique. La RSE
véhicule des valeurs dont la portée est désormais
économique, car se soucier du développement durable c'est
s'éclairer auprès des parties prenantes sur les risques et les
opportunités de long terme, en matière autant économique
qu'environnementale. Pour « tacler » l'opportunité
économique qu'offrirait la RSE, nous émettons la troisième
hypothèse spécifique suivante :
· HS3 : La prise en compte des attentes des
parties prenantes par la banque procure un avantage concurrentiel
durable
VII- Méthodologie de la recherche
Ce travail de recherche vise principalement à
découvrir les enjeux de la mise oeuvre des activités extra
financières pour la banque. Pour ce faire, nous devons opter pour une
approche méthodologique qui nous permette de concilier activités
RSE et avantage concurrentiel en milieu bancaire. La responsabilité
sociétale de l'entreprise, bien qu'étant un concept suscitant un
intérêt sans cesse grandissant, n'est plus un
phénomène nouveau dans le monde de la recherche. Il n'est donc
plus question de "comprendre", mais de "découvrir". Dans cette
perspective, la rétention de la démarche quantitative est
justifiée pour ce travail de recherche.
Cependant, en ce qui concerne le secteur de la finance, c'est
un concept qui reste encore très peu étudier surtout
corrélativement aux activités bancaires. Il demeure donc possible
d'emprunter des bribes d'outils à la démarche qualitative lors de
la collecte des données.Car tout au long de ce travail, il sera facile
pour nous d'observer et de questionner de manière ouverte certains
responsables hiérarchiques.
Ainsi, nous allons procéder en deux grandes
étapes. Premièrement, nous allons parcourir l'essentiel de la
littérature sur le concept de la RSE et les notions associées
telles que le Développement Durable, la théorie des Parties
Prenantes, les placements responsables entre autres. Nous allons
également porter une attention particulière à la
littérature existante sur les phénomènes de diffusion de
l'information sociétale et de performance sociale. Une fois enrichis sur
les concepts clés de la recherche, nous escomptons effectuer plusieurs
descentes auprès des personnes ressources.
Pour ce qui est de la deuxième étape, dans le
cadre de ce travail sur la RSE en milieu bancaire, les personnes ressources
concernent aussi bien les instances dirigeantes de la banque cadre d'accueil
que les parties prenantes (internes et externes). Nous allons donc
procéder en deux phases. Premièrement, nous allons rencontrer les
instances dirigeantes de la BICEC pour recueillir les informations sur les
motivations à mettre sur pied ou non, les activités socialement
responsables. Deuxièmement, nous allons nous rapprocher des parties
prenantes aussi bien en interne (salariés et actionnaires) qu'en externe
(clients, fournisseurs, état, ONG, syndicats, ...) pour nous
enquérir de leurs attentes en matière de pratiques de RSE par
leurs banques actuelles et potentielles.Autrement dit, l'approche de recherche
de ce travail est une approche hybride ou mixte et la technique
d'échantillonnage sera différente d'une catégorie de
répondants à l'autre.
Par exemple, pour les instances dirigeantes et les parties
prenantes internes, nous allons effectuer un échantillonnage
probabiliste, car nous pouvons connaitre avec exactitude la population cible
totale. Tandis que pour l'échantillon des stakeholders externes, il nous
est presque impossible de connaitre avec exactitude la taille de la population
cible. Dans cette perspective, nous allons opter pour la technique
d'échantillonnage non probabiliste. Les types d'échantillonnage
(par grappes, stratifié, boule de neige, ...) seront
précisés plus loin dans le chapitre réservé
à la méthodologie de la recherche.
S'agissant des outils de collecte des données, nous
allons procéder par observation puis, par entretien auprès des
instances dirigeantes de la BICEC à l'aide d'un guide d'entretien. Pour
les parties prenantes, trois questionnaires distincts seront
administrés :un aux parties prenantes externes, un autre aux
salariés et un dernier aux actionnaires. Les données issues de
ces outils de collecte vont faire l'objet d'une analyse distincte selon l'outil
utilisé (analyse du contenu pour les guides d'entretiens et analyse des
données dans le logiciel SPSS pour les questionnaires).
En effet, outre le tri plat, nous allons effectuer plusieurs
tests de sélection et d'extraction des variables pertinentes, notamment
des analyses de fiabilité, des tests de multi colinéarité,
des analyses factorielles et des analyses en composantes principales. Pour les
tests d'hypothèses proprement dits, nous allons réaliser des
régressions linéaires simples et multiples selon les cas. Il
n'est également pas exclu que nous performions des tests sur
échantillons appariés.
L'ensemble du travail contenu dans ce mémoire portera
sur deux parties libellées comme l'indique l'ébauche de plan.
CHAPITRE 1
PRÉSENTATION DU CADRE DE LA RECHERCHE : LA
BICEC
L'objet de ce chapitre est de faire une présentation
d'ensemble de la BICEC. Pour cela, il convient dans une première partie
de faire l'historique et la genèse de cette institution ; puis,
dans une deuxième partie de la situer dans son environnement
SECTION 1 : HISTORIQUE ET
GÉNÉRALITÉS SUR LA BICEC
La Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et
le Crédit est issue de nombreuses restructurations qui ont
affecté le secteur bancaire camerounais. Elle fait aujourd'hui partie
des meilleures enseignes bancaires, mais comme tous les établissements
du même secteur, elle doit subir la conjoncture et s'adapter. Dans la
présente section, nous allons effectuer une brève historique de
cet établissement financier avant de déboucher sur ses aspects
les plus génériques.
I- Historique de la BICEC
La BICEC n'est pas née « BICEC »,
elle est le fruit de la restructuration d'un établissement financier qui
a connu les effets néfastes de la crise économique. Nous allons
dans un premier temps rappeler les origines de l'actuelle BICEC avac de nous
attarder sur son évolution.
I-1- Genèse de la BICEC
L'histoire de la BICEC remonte à l'époque de la
réunification. En effet, elle est issue de la fusion- absorption de la
BNCI (Banque Nationale pour le Commerce et l'industrie) du Cameroun Oriental
par la BARCLAYS BANK appartenant au Cameroun Occidental. Cette absorption donne
naissance le 27 octobre 1962, à la Banque Internationale du Cameroun
pour le Commerce et l'Industrie (B.I.C.I.C.).
A sa création, la B.I.C.I.C, au capital de deux cent
millions de francs CFA (200 000 000 F CFA), dont 25% sont
détenus par l'État camerounais emploie près de 140 agents
sur 4 agences.
Les années 80 marquées par la récession
économique, la B.I.C.I.C., subira une importante restructuration.
En effet, la B.I.C.I.C. avait un portefeuille qui
représentait deux situations : une partie saine qui a été
reprise par le groupe des Banques Populaires (ensemble de grandes
coopératives constituées en établissements bancaires dont
le siège est à Paris), et une partie douteuse qui sera
confiée à la SRC (Société de Recouvrement des
Créances) pour recouvrement. Malheureusement, la restructuration ne sera
pas suffisante pour sa pérennisation. Après 35 ans d'existence,
elle fermera ses portes, suite au départ d'un de ses partenaires
stratégiques : la B.N.P. (Banque Nationale de Paris), et au regard
d'énormes difficultés auxquelles elle ne pouvait plus faire
face.
Le conseil d'administration tenu le 14 mars 1997 prononce sa
liquidation et donne naissance le 17 mars 1997, à la Banque
Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit
(B.I.C.E.C) dont le Groupe des Banques Populaires détient plus de 51% du
capital. Ledit groupe a pour mission de rentabiliser l'établissement
financier tout en le préparant à la privatisation dans un
délai de trois (03) ans.
I-2- Évolution de la BICEC
L'évolution de la B.I.C.I.C. a été
marquée par plusieurs mutations en ce qui concerne sa
dénomination, son niveau d'activité, son effectif et surtout son
capital social. La B.I.C.I.C. s'est affirmée comme leader des banques du
pays, non seulement du point de vue de son vaste réseau de distribution,
mais aussi de l'importance de sa clientèle qui ne cesse de
s'accroître.
En 1970, le nombre d'agences est passé de 4 à
15, pour un effectif de 315 agents. En 1974, les intérêts
camerounais sont portés à 35%, à la faveur d'une
augmentation de capital. En 1978, L'Etat camerounais prend le contrôle
majoritaire du capital avec 51% des actions. Le capital se présente donc
ainsi :
Tableau 1.1 : Répartition du capital de la
BICIC en 1978
|
Actionnaires
|
Pourcentages
|
Montants
|
|
État camerounais
|
51 %
|
1 530 000 000 F CFA
|
|
SFIO
|
24 %
|
720 000 000 F CFA
|
|
Barclays Bank
|
13 %
|
390 000 000F CFA
|
|
BNP
|
12 %
|
360 000 000 F CFA
|
|
Total
|
100 %
|
3 000 000 000 F CFA
|
La lecture du tableau ci-dessus montre qu'en 1978,
l'État camerounais est majoritaire à la BICIC. Il y
détient plus de la moitié du capital. Pourtant, les choses vont
bien vite évoluer.
En 1981, le capital social est porté à quatre
milliards de francs CFA (4 000000000 F CFA), le nombre d'agences passe de 15
à 35 et l'effectif de 315 à 1239 agents. Cependant, avec la crise
économique des années 80 qui frappe l'économie
camerounaise de plein fouet, la croissance fulgurante de la B.I.C.I.C. marquera
un temps d'arrêt.
Ceci sera concrétisé par l'adoption d'un plan de
restructuration en janvier 1991, avec pour objectif de rendre la banque plus
rentable et de la préparer à la privatisation. Une aste
compression du personnel va entraîner la réduction de l'effectif
total à 947 agents et à la fermeture de dix (10) agences.
En 1994, la B.N.P, SFIO. et la BARCLAYS BANK se retirent du
capital. La liquidation de la B.I.C.I.C. intervient le 13 mars 1997. La
structure de l'actionnariat est alors revue comme le présente le tableau
ci-dessous :
Tableau 1.2 : Répartition du capital de la
BICIIC avant restructuration
|
Actionnaires
|
Pourcentage
|
Nombre d'actions
|
Montants
|
|
État camerounais
|
79,98 %
|
239 940
|
2 399 400 000 F CFA
|
|
CFC
|
11,66 %
|
34 980
|
349 800 000 F CFA
|
|
CSPH
|
8,33 %
|
24 990
|
249 900 000 F CFA
|
|
Administrateurs
|
0,03 %
|
90
|
900 000 F CFA
|
|
Total
|
100 %
|
300 000
|
3 000 000 000 F CFA
|
À la lecture de ce tableau, on constate que la crise
économique a « chassé » l'essentiel des
investisseurs étrangers. Mais on va assister à un retour de ces
derniers pour une restructuration avérée de
l'établissement financier dont les objectifs de privatisation
étaient déclarés.
Le 17 mars 1997, une nouvelle entité plus
crédible, dénommée BICEC, voit le jour, avec pour vocation
de reprendre les actifs sains et la totalité des dépôts de
la défunte B.I.C.I.C, contrôlée généralement
par le groupe des Banques Populaires de France à hauteur de 51% du
capital et détenant 26 agences.
Jusqu'en 2006, la B.I.C.E.C., une société
anonyme de type mixte, dispose de 27 agences reparties dans le territoire
national, avec un effectif de près de 557 employés pour un
capital de trois milliards de francs CFA (3 000 000 000 F CFA) réparti
ccomme suit :
Tableau 1.3 : Répartition du capital de la
BICEC 9 ans après restructuration
|
Actionnaires
|
Pourcentage
|
Nombre d'actions
|
Montants
|
|
Banque Populaire
|
51 %
|
156 000
|
1 560 000 000F CFA
|
|
Privés camerounais
|
19,50 %
|
58 500
|
585 000 000 F CFA
|
|
Personnel BICEC
|
5 %
|
15 000
|
150 000 000 F CFA
|
|
Banque Mondiale
|
7,50 %
|
22 500
|
225 000 000 F CFA
|
|
PROPARCO
|
7,50 %
|
22 500
|
225 000 000 F CFA
|
|
Autres
|
8,50 %
|
25 500
|
255 000 000 F CFA
|
|
Total
|
100 %
|
300 000
|
3 000 000 000 F FCA
|
Plus récemment, la situation de l'actionnariat a
légèrement été revue, à la hausse pour la
Banque Populaire et à la baisse pour l'État camerounais. Le
tableau ci-dessous donne un aperçu de la structure actuelle du capital
de la BICEC :
Tableau 1.4 : Répartition récente
du capital de la BICEC
|
Actionnaires
|
Pourcentage
|
|
Banque Populaire
|
61,22 %
|
|
État camerounais
|
17,50 %
|
|
Personnel BICEC
|
5,00 %
|
|
PROPARCO
|
7,25 %
|
|
Istituto Centrale delle Banche Populari
|
1,50 %
|
|
Privés Camerounais
|
7,50 %
|
|
Autres
|
0,03 %
|
|
Total
|
100 %
|
En effet, la lecture du tableau ci-dessus montre que la
structure du capital de la BICEC a connu une légère
restructuration dans un passé récent.
La présente section a effectué la genèse
de la BICEC de sa création à nos jours. Dans la prochaine
section, nous allons porter une attention particulière à
l'organisation de cet établissement financier, ainsi qu'à ses
activités et aux résultats qui en découlent.
SECTION 2 : STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET
ACTIVITÉS DE LA BICEC
Dans cette section, nous allons tour à tour
présenter la structure organisationnelle et les activités de la
BICEC.
II-1 Structure organisationnelle de la
BICEC
Comme toute entreprise bancaire, la B.I.C.E.C. a mis sur pied
une organisation afin de mieux sécuriser, gérer et garantir les
fonds placés par les clients. Cette organisation est faite autour de
trois pôles : les pôles décisionnels, les pôles
opérationnels et les réseaux. Ces différents pôles
sont pilotés par des hommes et des femmes qui ne cessent d'adopter des
stratégies pour :
- Offrir des produits et services répondant aux
attentes d'une clientèle de plus en plus avisée et
exigeante ;
- Réserver un accueil chaleureux à sa
clientèle ;
- Être toujours à l'écoute de sa
clientèle ;
- Manifester sa présence sur l'étendue du
territoire Camerounais par la multiplication du nombre d'agences.
On comprend donc que le service prôné par la
BICEC est celui de la proximité avec la clientèle. Cette
proximité est assurée à travers les différents
pôles que nous présentons ci-dessous.
II-1-1- Les pôles
décisionnels
Ils sont essentiellement constitués du Conseil
d'Administration, de la Direction Générale et du Comité de
Direction.
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'entreprise. Il a
à sa tête un Camerounais. Les pouvoirs du Conseil d'Administration
sont liés aux fonctions administratives. Le CA statue également
sur toutes les autres questions qui dépassent les pouvoirs de la
Direction générale.
La Direction Générale est chargée de
mettre en application toutes les résolutions prises par le conseil
d'administration. A sa tête se trouve un expatrié, son adjoint
étant un Camerounais.
La Comité de Direction est l'ensemble constitué
du PCA jusqu'aux Directeurs Régionaux en passant par la Direction
Générale, le Sécretariat Général, la
Direction du marché des Grandes Entreprises, la Direction de la Gestion
des Engagements, la Direction de la Gestion du Parc Immobilier, la Direction de
l'Organisation et de la Qualité Bancaire, la Direction des Affaires
Juridiques et du Contentieux, etc ...
II-1-2- Les pôles
opérationnels
Il ressort de l'organigramme présenté en annexe,
la répartition des responsabilités et des différentes
tâches qui incombent à chaque responsable. Ceci permet
d'éviter les différentes interférences et la violation du
principe d'unité de commandement. Ainsi, les pôles
opérationnels sont construits autour de trois grandes
subdivisions : le Secrétariat Général, les Directions
Centrales et les Départements.
a. Le Secrétariat
Général
Le Secrétariat Général dirige et
coordonne les activités des entités ci-après :
- Le Département des Ressources Humaines
(DRH) : Ce département s'occupe du recrutement, de la
formation et du suivi du personnel. Il est composé de
trois services à savoir :
o le service gestion des carrières qui
s'occupe aussi de la formation du personnel ;
o le service du personnel qui s'occupe de la paie du
personnel et de tous les rapports des employés avec la
CNPS ;
o l'agence du personnel qui est le service qui
s'occupe des engagements du personnel.
- Le Département des Affaires Juridiques et du
contentieux (DAJC) : Il s'occupe des affaires juridiques et
toutes les relations entretenues avec le fisc. Elle aussi
gère le patrimoine juridique et fiscal de la banque ainsi que
le contentieux avec les clients.
- La Direction de la comptabilité et de la
trésorerie (DCT) : elle s'occupe de la comptabilité
de la banque. Elle a en son sein, le contrôle comptable bancaire, la
comptabilité bancaire et la trésorerie.
b. Les Directions Centrales
Elle est composée des directions
ci-après :
· La Direction du
Développement.
Elle assure la gestion administrative de tout le
réseau. Elle comprend les régions qui, elles mêmes ont en
leur sein les agences. La BICEC, avec un réseau de 26 agences, est
actuellement installée dans 5 régions à savoir : le Nord ;
le Littoral ; l'Ouest ; le Centre/Sud/ Est ET le Sud-Ouest.
La direction du développement s'occupe de
l'exploitation courante de la banque. Elle met un accent sur l'aspect
commercial qui, consiste à prospecter la clientèle et à la
fidéliser au travers de divers services (gestion de compte,
crédit, vente des produits, etc...).
· La Direction Centrale des
Engagements.
Elle est composée d'une direction, d'une division, de 2
services.
o La Division du Contentieux et Recouvrement
Bancaire.
Elle s'occupe de tous les dossiers litigieux pour lesquels le
client s'est avéré défaillant. Elle s'occupe
également du recouvrement des créances litigieuses.
o Le Service de la Surveillance des Engagements.
Son travail consiste à prévenir les risques, en
s'assurant que le processus de décision défini par la banque est
bien respecté. Il détecte les anomalies liées au
fonctionnement des comptes et au remboursement des prêts accordés.
Il suit la régularisation des anomalies et des dysfonctionnements
constatés.
o Le Service Gestion des Prêts.
Dès la réception du dossier de prêt pour
mise en place, il procède à un contrôle systématique
de la délégation de pouvoir, de la validité des garanties
et la mise en place du crédit.
o La Direction des Études et
Décisions.
Elle est chargée de l'étude complète des
dossiers de crédit soumis à son appréciation. Cette
tâche est réservée à l'analyste de crédit qui
vérifie toutes les informations fournies par le commercial. Par
ailleurs, il complète au besoin le dossier, émet son avis et le
transmet à la hiérarchie pour prise de décision.
· La Direction de l'Informatique.
Cette direction s'occupe de la gestion et de la maintenance du
matériel informatique de la banque, de la gestion de la messagerie
interne, et du logiciel utilisé pour la gestion de la banque.
· La Direction de la Production.
Cette direction s'occupe du traitement des chèques, des
virements locaux et des transferts à l'étranger.
· La Direction de la Stratégie,
Organisation et Logistique.
Il s'agit de la direction où nous avons effectué
notre stage. Nous y mettrons un accent particulier. Nous présentons
ci-dessous son organigramme.
Comme nous l'avons souligné plus haut, outre le
secrétariat général et les directions centrales, les
pôles opérationnels sont également construits autour des
départements.
c. Lé départements des pôles
opérationnels
Il s'agit essentiellement du département du
contrôle de gestion, de la logistique et de l'inspection
générale.
· Département du contrôle de
gestion
Il s'occupe de l'élaboration du budget. Toutes les
entités font part de leurs besoins, et il revient au contrôle de
gestion d'élaborer le budget global de la banque afin de le
présenter à la Direction Générale. Une fois le
budget adopté par le C.A, il contrôle les réalisations et
les prévisions. Ensuite, il analyse et interprète les
écarts éventuels constatés, puis soumet son rapport
à la Direction Générale.
Le responsable de ce département a pour rôle de
:
- mesurer la performance et participer à
l'élaboration de la gestion prévisionnelle de la banque ;
- mener des études de rentabilité relatives aux
opérations, aux produits, aux clients et aux différentes
unités de la banque ;
- contrôler la fiabilité de l'information
comptable ;
- animer, diriger et gérer le département ;
- assurer l'animation des collaborateurs de son
département.
Le Responsable du service analytique est chargé :
- d'assurer la confection mensuelle du compte de
résultat et la préparation du compte de résultat
prévisionnel ;
- d'analyser les écarts du compte de
résultat.
Ce département a une équipe constituée de
chargés d'études qui ont pour rôle de : -
- participer à des projets conduits par le
Département ;
- mener des études qui permettront d'aboutir à
une optimisation, une fiabilité et une mise à niveau des process
contribuant à l'amélioration de la qualité des prestations
du département.
· La Logistique.
Elle s'occupe de la gestion administrative des biens meubles
et immeubles de la B.I.C.E.C. Elle regroupe quatre services :
- le service du courrier ;
- le service de maintenance ;
- le service des achats ;
- le service de l'économat et des archives.
· L'inspection
générale.
Cette Direction s'occupe du contrôle et de la
régularité des opérations, ainsi que de la
sécurité des valeurs et personnes. Elle a également un
rôle d'assistance technique. C'est le gendarme de la banque.
II-1-3- Les réseaux
Il s'agit essentiellement des directions régionales. Il
est composé :
- De la Direction Générale du Littoral ;
- De la Direction Générale du
Centre/Sud/Est ;
- De la Direction Générale de l'Ouest ;
- De la Direction Générale du Nord ;
- De la Direction Générale du Sud-Ouest.
Nous venons, dans la présente sous-section, de
présenter la structure organisationnelle de la BICEC. Dans la p^rochaine
section, nous allons présenter ses activités.
II-2- Ressources et Activités et environnement
de la BICEC
Nous présentons d'abord les ressources et les
activités de la structure avant de nous attarder sur sa situation dans
son environnement.
II-2-1- Ressources et activités de la
BICEC
Pour assurer son fonctionnement de manière efficiente
et efficace, la BICEC dispose d'un ensemble de ressources qu' »il
convient de présenter.
a. Les ressources de la BICEC
Il s'agit des moyens de fonctionnement mis à la
disposition de l'entreprise pour la bonne marche de ses activités. Elles
sont d'ordre financier, technique et humain :
· Les moyens financiers
Ils sont constitués des fonds propres de la banque, des
dépôts à vue et à terme de la clientèle. Ces
moyens permettent à la banque de jouer pleinement son rôle
d'intermédiaire financier et d'effectuer diverses autres prestations
auprès du public.
· Les moyens techniques
La B.I.C.E.C. dispose du réseau de distribution le plus
étendu à l'heure actuelle au Cameroun, avec 5 régions et
36 agences dont la dernière en date est celle d'Ebolowa. Ces agences
sont réparties comme suit :
Tableau 1.5 : Réseau de Distribution de la
BICEC
|
Régions
|
Villes
|
Nombre d'agences
|
Lieu d'implantation
|
|
Littoral
|
Douala
|
|
Bonanjo, Bassa, Bali, Edea, Kribi
|
|
Ouest
|
Bafoussam
|
|
Dschang, Bafoussam, Bamenda, Nkongsamba, Bafang
|
|
Sud-Ouest
|
Limbe
|
|
Limbe, Tiko, Buea, Kumba, Mamfe
|
|
Centre/Sud/Est
|
Yaoundé
|
|
Yaoundé (Centre, Le Parc, Vallée), Sangmelima,
Mbalmayo, Bertoua, Ebolowa
|
|
Nord
|
Garoua
|
|
Garoua, Kousseri, Maroua, Ngaoundéré
|
La B.I.C.E.C. est la première banque camerounaise
à mettre sur pied la billetterie automatique depuis 1990. Sur le plan
informatique, la B.I.C.E.C. dispose pour l'exécution de ses
opérations bancaires, d'un parc informatique important fonctionnant en
réseau de telle sorte que chaque employé dispose d'un poste de
travail. Ce réseau permet de se connecter à toutes les agences du
site par l'intermédiaire du réseau VSAT et des serveurs.
· Moyens humains.
Grâce aux multiples formations et recrutements
effectués par la Direction des ressources humaines, actuellement, la
B.I.C.E.C. emploie 600 personnes, toutes catégories confondues.
b. Les Activités de la BICEC
L'ordonnance 73-27 du 30 août 1973 du Ministère
des Finances relatif aux banques et sociétés financières
à caractère bancaire, industriel, commercial, définit la
banque comme « une entreprise ayant pour profession habituelle de
recevoir du public, sous forme de dépôts, des fonds
qu'elle emploie pour son propre compte en opérations d'escompte, de
crédit ou en autre opération financière
». Répondant à cette définition, la B.I.C.E.C.
offre à ses clients une gamme variée de services :
· L'Épargne.
Les agents économiques en excédent de
trésorerie ((ou à capacité de financement) ont la
possibilité d'ouvrir des comptes d'épargne
rémunérés au taux annuel de 4.25%, des comptes courants,
des comptes de dépôt : dépôt à terme pour les
personnes morales et bons de caisse pour les particuliers.
· Le Crédit.
Moyennant des garanties, la B.I.C.E.C. octroie des
crédits à sa clientèle :
- Crédit à court terme d'une durée
inférieure ou égale à 2 ans : le crédit à la
consommation, le crédit documentaire, l'escompte des effets de commerce
;
- Crédit à moyen terme, d'une durée
inférieure ou égale à dix ans : le revolving, le
crédit d'investissement accordé aux entreprises pour
l'acquisition des immobilisations, du crédit achat automobile ;
- Crédit à long terme, d'une durée
supérieure à dix ans : ce type de crédit est
réservé à l'habitat et à l'immobilier.
· Autres activités.
La B.I.C.E.C. effectue aussi des opérations de change,
de virement, de transfert de fonds, de location de coffre-fort, de traitement
de travellers chèques, des opérations monétiques
(utilisation des cartes dans les transactions : carte VISA, carte plus,
carte express).
Sur le plan informatique, la BICEC possède un
système appelé "EAGLE", ce qui veut dire en français
« l'aigle » de par sa capacité à couvrir le maximum
d'opérations en temps réel et dans toutes les agences. Par
ailleurs, la BICEC possède à travers le monde, un vaste
réseau de correspondants tels que CITIBANK (New-York) ; NATEXIS
(France)
Toutefois, la BICEC mobilise ses ressources pour exercer dans
un environnement qu'il convient de présenter.
II-2-2- Environnement de la BICEC
L'analyse de l'environnement externe de la banque pourrait
être faite au travers de son marché, sa concurrence et
l'architecture juridique sur lequel elle exerce.
a. Le marché de la banque
Il s'articule autour de trois principales clientèles.
Nous y distinguons le marché des entreprises, celui des professionnels
ou PME/PMI et enfin celui des particuliers.
Le marché des entreprises comprend les entreprises
publiques, les entreprises privées. Ce sont des personnes morales. La
condition d'ouverture de compte entreprise ou compte courant est d'être
immatriculée au registre du commerce et de déposer un minimum
d'un million de francs CFA pour faire fonctionner le compte.
Le marché des professionnels concerne les PME et les
PMI. Il regroupe des entreprises individuelles et les conditions d'ouverture de
compte sont les mêmes que celle des entreprises.
Le marché des particuliers est, de loin, le
marché le plus vaste de la banque. La BICEC dispose d'environ 150.000
clients particuliers. Dans ce marché, nous distinguons :
- les administrations publiques ;
- les administrations privées ;
- les entreprises d'assurances publiques ;
- les entreprises d'assurances privées ;
- les particuliers.
En ce qui concerne les particuliers, le montant minimum
nécessaire pour l'ouverture d'un compte est de 200.000 FCFA. Hormis ces
marchés traditionnels régulièrement rencontrés dans
toutes les banques, nous notons cependant un marché de l'agriculture. Ce
dernier prend progressivement de l'ampleur à la BICEC et son essor
devient de nos jours incontestablement remarquable.
b. Le marché concurrentiel de la
BICEC
La concurrence se fait de plus en plus âpre sur le
marché bancaire camerounais. Le fait que la B.E.A.C ait assoupli les
conditions d'octroi d'agrément, que la concurrence internationale soit
de plus en plus menaçante, et surtout l'avènement du
marché boursier, font que de nouvelles banques frappent aux portes du
marché bancaire camerounais.
Le marché bancaire camerounais est composé de
dix banques actuellement :
ü Afriland First Bank ;
ü Atlantic Bank of Cameroon ;
ü Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne
et le Crédit (BICEC) ;
ü BGFI Bank Cameroon ;
ü Citibank ;
ü Commercial Bank of Cameroon (CBC);
ü Ecobank Cameroon;
ü National Financial Credit Bank (NFCB);
ü Société Camerounaise de Banque du
Cameroun ;
ü Société Générale des
Banques au Cameroun ;
ü Standard Chartered Bank ;
ü Union Bank of Cameroon ;
ü United Bank of Africa.
c. Le cadre réglementaire
L'architecture du système bancaire camerounais repose
sur trois textes organiques.
Le premier est relatif à la convention de
coopération monétaire entre la république du Tchad, du
Cameroun, de la Centrafrique, du Congo et celle du Gabon signée à
Brazzaville le 22 novembre 1972. Cette convention est complétée
le 18 novembre 1990 par un texte créant la Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale, en abrégé "C.O.B.A.C". Elle est
chargée de veiller au respect, par les établissements de
crédits, des dispositions législatives et réglementaires
éditées par les autorités monétaires nationales,
par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (B.E.A.C) ou par
elles-mêmes et qui leur sont applicables. Elle sanctionne
également les manquements constatés.
Le second est celui de l'ordonnance n°85/002 du 31
août 1985 relative à l'activité des établissements
de crédits. Ce sont des organismes qui effectuent à titre
habituel les opérations de banque.
Le troisième texte est régi par l'article 2 de
la convention portant création de la C.O.B.A.C du 22 novembre 1990
stipule que les établissements de crédit comprennent les banques,
les établissements financiers, les caisses d'épargne postale, les
sociétés financières d'investissements et de
participations. L'article 4 de la même convention stipule que les
opérations de banques comprennent la réception des fonds du
public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à
disposition de la clientèle des moyens de paiement et leur gestion.
Aussi, les États se sont dessaisis de leur pouvoir individuel au profit
d'une gestion commune de leurs intérêts en ce qui concerne les
problèmes de la monnaie.
Au terme de cette section sur la structure organisationnelle
et les activités de la BICEC, il apparait que la structure offre une
gamme variée de produits et services financiers à un vaste
réseau de clients qui vont de l'administration publique aux
particuliers. Aussi, la BICEC opère dans in environnement concurrentiel
certain.
Parvenu à la fin de ce chapitre, il y était
question de présenter la structure d'accueil dans son ensemble. Pour ce
faire, nous avons, dans une première section, effectué la
genèse et l'évolution de la BICEC. Puis, dans une deuxième
section, nous avons présenté les ressources de la BICEC, ses
activités et son environnement fortement concurrentiel. Il ressort que
pour se démarquer de la concurrence, la BICEC doit sans cesse proposer
à sa clientèle, des offres aussi attrayantes les unes que les
autres. Pour y parvenir, des investissements extra financiers ont
été réalisé, notamment à travers des
activités de responsabilité sociétale.
CHAPITRE 2
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET
ACTIVITÉ BANCAIRE AU COEUR DE LA RECHERCHE
Le présent chapitre, purement théorique, a pour
but essentiel d'effectuer une revue de la littérature sur le concept
clé de la recherche qu'est la responsabilité sociétale.
Dans une première analyse, nous allons présenter ce concept de
manière globale, ses origines, ses domaines d'applications, ses
contours, et les concepts qui lui sont rattachés. Puis, dans une seconde
analyse, nous allons présenter les enjeux de la responsabilité
sociétale pour les entreprises en générale et pour la
banque en particulier.
SECTION 1 : APPROCHE NOTIONNELLE DE LA RSE
Dans cette section, nous allons premièrement retracer
l'historique de la RSE, définir le concept, et présenter la
théorie des parties prenantes. Par la suite, nous allons
deuxièmement présenter les domaines d'application et les
instruments de mesure de ce concept..
I-1- La responsabilité sociétale :
historique, definition et principes
Nous retraçons d'abord l'histoire de
la RSE, puis nous définissons ce concept aux contours multiples que nous
abordons par la suite selon l'approche des parties prenantes.
I-1-1- Aperçu historique de la
Responsabilité Sociale de l'Entreprise
On associe souvent la RSE au
développement durable ou encore à la mondialisation, alors que
cette notion a vu le jour bien avant ces phénomènes. En
réalité, la RSE est apparue dès les années 1950'
aux États-Unis, mais sa diffusion vers d'autres contextes s'est faite de
manière décalée dans le temps. Nous allons dans ce qui
suit nous intéresser à l'historique de ce concept et aux diverses
acceptions auxquelles il a donné lieu.
Le thème de la Responsabilité Sociale des
Entreprises n'est pas véritablement nouveau. À partir des
années 1920, plusieurs dirigeants s'expriment publiquement sur leur
responsabilité à l'égard de la société. Si
aucune doctrine clairement formulée de la responsabilité sociale
n'avait émergé à la fin de la décennie, les
discours de l'époque sont très marqués par les concepts de
« public service » et de « trusteeship »
qui stipulent l'idée d'un contrat implicite, caractérisant la
relation entre l'entreprise et la société (Heald, 1961, 1971).
Ces débats, bien que controversés, ont
été mis en application par Henri Ford, surtout sur le plan
interner avec l'instauration du salaire journalier minimum (principe du
five dollars per day). Des discours et pratiques relatifs à la
responsabilité sociale se développent ainsi de manière
précoce dans le milieu des affaires. Au début des années
1930, notamment en 1932 le débat entre Berle et Dodd sur la question de
la gouvernance d'entreprise (stakeholders versus shareholders) conduit
aux premières réflexions sur la RSE. Mais ce n'est que dans les
années 1950 que des efforts significatifs en matière de RSE
voient le jour.
Dans son expression et dans son sens actuel, la RSE est
essentiellement liée au contexte nord américain de l'après
Deuxième Guerre mondiale (Charles et Hill, 2004). C'est l'ouvrage de
Bowen en 1953 qui marque l'avènement du concept et le début de la
recherche autour de lui (Carroll, 1999 ; Acquier et Gond, 2005 ; Locket et
coll., 2006 ; Windsor, 2006). En effet, Bowen y pose les fondements de la
responsabilité sociale de l'entreprise, même s'il y relève
plus tard (en 1978), un caractère idéaliste et normatif faisant
prévaloir deux principes. Le premier renvoie au fait que les hommes
d'affaires ne doivent prendre que des décisions qui vont dans le sens
des orientations et des valeurs souhaitées par la société.
Le deuxième stipule que la prise en compte de préoccupations
sociales par la firme doit se faire d'une manière volontaire. C'est donc
H. BOWEN qui a fait passer ce concept dans l'ère moderne du
management.
Si Bowen est reconnu dans la littérature comme
étant le père de la RSE, Caroll (1999) signale que les
idées qu'il a exprimées dans son ouvrage ne sont pas nées
ex nihilo et qu'on en trouve la trace dans certains essais de la
littérature managériale, notamment dans les années 1930'
et 1940'. Notons tout de même qu'il est possible que la RSE, telle que
formulée à l'époque par Bowen, repose sur les valeurs
culturelles et managériales qui prévalaient à son
époque. Le contexte ayant évolué, l'acception de la RSE a
progressivement changé.
La RSE est devenue un thème de recherche à
l'origine de l'émergence d'un nouvel espace académique, à
savoir le courant « Business and Society »
s'intéressant aux relations entre l'entreprise et son environnement
sociétal (Acquier et Gond, 2005). Son influence s'est
progressivement renforcée à travers le monde pendant les
années 1960. Depuis lors, la responsabilité sociale de
l'entreprise fait l'objet de nombreux débats entre chercheurs,
praticiens, État, organisations non gouvernementales et autres acteurs
de la société moderne.
Après avoir occupé les chercheurs
américains et suscité quelques controverses émanant
d'académiciens libéraux, la recherche sur la RSE diminuera
d'intensité à partir du milieu des années 1980 et muera
vers d'autres concepts comme la citoyenneté de l'entreprise ou
l'approche par les parties prenantes (Caroll, 1999).
Toutefois, cette pensée de Carroll, bien que séduisante, ne
s'applique qu'au contexte américain. Elle va alors se heurter au nouvel
ordre économique mondial établi, qui prône le
libéralisme économique.
L'émergence de la grande entreprise au delà des
frontières nord-américaines est à l'origine du regain
d'intérêt que connait la RSE en ce début de siècle,
en redevenant un phénomène de plus en plus présent sur la
scène politique et économique.
En Europe, on a commencé à s'intéresser
à la RSE dès le milieu des années 1990 suite aux actions
des organismes de la société civile à l'encontre des
entreprises ayant causé un tort environnemental (Shell, Total ...),
social (Danone, Renault...) ou sociétaire (Parmalat, Vivendi...). D'un
autre côté, le regain d'intérêt pour la question
s'est accentué à partir du début des années 2000
aux États-Unis avec les faillites touchant de grands groupes
américains (Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Xerox...). C'est sans
doute la raison pour laquelle Doh et Guay (2006) attribuent le
regain d'intérêt pour la RSE à deux éléments
: la montée de la société civile d'un côté,
et les scandales financiers des grandes entreprises de l'autre.
I-1-2- Construction d'une définition du concept
de responsabilité sociétale de l'entreprise
Rappelons tout d'abord que l'appellation RSE telle que
dérivée de la littérature anglo-saxonne, ne se limite pas
qu'à la simple responsabilité sociale, c'est-à-dire,
qu'à la société. Elle va au delà de celle-ci pour
intégrer l'environnement, les ONG et tous les autres partenaires directs
et indirects de l'entreprise. C'est pourquoi on lui préfère de
plus en plus l'appellation de responsabilité sociétale de
l'entreprise.
Les définitions attribuées à la RSE sont
variables selon les approches (volontariat ou légale) et les auteurs.
Selon l'approche, la Commission Européenne (2001) a adopté une
définition qui ménage les deux aspects fondamentaux de la RSE
(contrainte et volontarisme) : « Être socialement
responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations
juridiques applicables mais aller au-delà et investir davantage dans le
capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes,
cela suppose l'intégration volontaire par les entreprises de
préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes
». En effet, dans son livre vert publié en 2001, la
Commission Européenne, qui est devenue une référence dans
les organismes internationaux et qui est évoquée dans la
majorité des travaux sur la RSE, la définit
comme : « l'intégration volontaire des
préoccupations sociales et écologiques des entreprises à
leurs activités commerciales et leurs relations avec toutes leurs
parties prenantes internes et externes (actionnaires, personnels, clients,
fournisseurs et partenaires, collectivités humaines,...), et ce, afin de
satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables et investir dans
le capital humain et l'environnement ».
Selon des auteurs comme Friedman M. (1962), cité par
D'Arcimoles Ch-H. et Trébucq St. (2003), la responsabilité
sociale de l'entreprise est d'accroitre ses profits. Cette proposition de
Friedman repose sur les postulats de la « main invisible de Adam
Smith », car pour lui, seules les forces du marché
génèrent la richesse collective, ce qui n'est pas totalement
acceptable dans le contexte actuel. Par exemple, dans des cas de fraudes comme
Enron et bien d'autres, cette responsabilité envers les actionnaires n'a
pas été respectée. Autrement dit, la RSE ne se limiterait
pas à cela.
En effet, nombreux sont les auteurs qui s'opposent à
cette vision étroite de la responsabilité sociétale de
l'entreprise. Au contraire de la vision de Friedman, selon la théorie
des stakeholders, il existe un contrat implicite entre l'entreprise et la
société. Si ce contrat est rompu, l'entreprise perd sa
légitimité et ne peut bientôt plus fonctionner. Ainsi,
selon Freeman R. (1984), l'entreprise est responsable devant toutes ses
parties prenantes.
Certaines définitions sont fondées sur des
études de cas particuliers d'entreprises pratiquant la RSE. C'est le cas
de la définition de Mc Williams A. et Siegel D. (2001) selon laquelle la
RSE est l'ensemble des actions visant le bien social au-delà des
intérêts de la firme et de ce qui est demandé par la loi.
Mc Guire J. (1963) et Davis K. (1973) soutenus plus tard par Jones M. T.
(1980), perçoivent la RSE comme la prise en compte par l'entreprise, de
problèmes qui vont au delà de ses obligations économiques,
techniques et légales et la reconnaissance par celle-ci, de ses
responsabilités envers la société. Ces définitions
semblent ne pas tenir compte des entreprises qui ne se conforment qu'au stricte
minimum requis par la loi, parce que ne faisant face à aucune
compétition sur le marché.
Carroll A. B. (1979) ne se contente pas seulement de limiter
les champs d'action possibles de l'entreprise responsable car pour elle, «
la CSR2(*) intègre
l'ensemble des attentes économiques, légales, éthiques et
philanthropiques que peut avoir la société à
l'égard d'une entreprise à un moment donné ».
Suivant le même ordre d'idées que Carroll, Wood D.J.
(1991) souligne que: « La signification de la responsabilité
sociétale ne peut être appréhendée qu'à
travers l'interaction de trois principes : la légitimité, la
responsabilité publique et la discrétion
managériale, ces principes résultant de la distinction
de trois niveaux d'analyse, institutionnel, organisationnel et individuel
». Les définitions proposées par Carroll et Wood vont plus
loin que les approches précédentes en spécifiant les
catégories d'analyse de la CSR et en systématisant les acquis des
recherches antérieures.
Ainsi, nous pouvons résumer les définitions
ci-dessus dans un tableau tiré des « fondements
théoriques de la responsabilité sociale des
entreprises », de Jean-Pascal Gond.
. Tableau 2.1 : Définitions et
théorisations du concept de RSE
|
Types d'approches
|
Sources
|
Définitions
|
|
Agir au delà d'une responsabilité
économique, contractuelle ou légale.
|
Jones (1980)
|
La responsabilité sociétale est
« [l'idée] selon laquelle les entreprises, au delà des
prescriptions légales ou contractuelles, ont une obligation envers les
acteurs sociétaux »
|
|
Maximiser le profit pour les actionnaires
|
Friedman (1962)
|
« Rien n'est plus dangereux pour les fondements de
notre société que l'idée d'une responsabilité
sociale des entreprises autre que de générer un profit maximum
pour leurs actionnaires »
|
|
Répondre aux attentes de la société de
manière volontaire
|
Carroll (1979)
|
La responsabilité sociétale est « ce
que la société attend des organisations en matière
économique, légale, éthique et volontaire, à un
moment donné »
|
|
Respecter des principes se déclinant au niveau
institutionnel, organisationnel et managérial
|
Wood (1991)
|
« La signification de la responsabilité
sociétale ne peut être appréhendée qu'à
travers l'interaction de trois principes : la légitimité, la
responsabilité publique et la discrétion managériale, ces
principes résultant de trois niveaux d'analyse, institutionnel,
organisationnel et individuel »
|
|
La performance sociétale comme intégration des
approches de la RSE
|
Wartick & Cochran (1985)
|
La PSE est « l'interaction sous-jacente entre les
principes de responsabilité sociale, le processus de sensibilité
sociale et les politiques mises en oeuvre pour faire face aux problèmes
sociaux »
|
|
La performance sociétale comme capacité à
satisfaire les stakeholders
|
Clarkson (1995)
|
La PSE peut se définir comme la capacité
à gérer et à satisfaire les différentes parties
prenantes de l'entreprise (définition construite)
|
Source : Gond, J.-P. et Mullenbach A.
(2004)
De toutes les définitions et approches
développées ci-dessus, nous pouvons définir la
responsabilité sociale de l'entreprise comme la prise en compte par
l'entreprise des variables extra économiques dans la réalisation
de ses objectifs à long et moyen terme. C'est un processus
d'amélioration, dans le cadre duquel, les organisations, les
entreprises, les pouvoirs publics et les collectivités locales
intègrent de manière volontaire, systématique et
cohérente des préoccupations d'ordre social, environnemental et
économique dans leur gestion au quotidien. En d'autres termes, une
entreprise socialement responsable est celle dont l'atteinte des objectifs
économiques est conjointe à l'intérêt collectif de
toutes les parties prenantes et dans le respect des contraintes légales
naturelles.
Après avoir défini la RSE, il importe de
présenter ses principes théoriques.
I-1-3- Principes théoriques de la RSE
La notion de la responsabilité
sociale de l'entreprise est fondée sur l'idée que les entreprises
doivent assumer des responsabilités qui vont au-delà de leur
sphère d'activités directe. Du point de vue de l'entreprise, la
RSE se traduit par « l'intégration volontaire de
préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes »3(*). La théorie de la RSE se veut une
réponse aux thèses défendues par plusieurs auteurs sur le
pouvoir disproportionné dont disposent les entreprises et leurs managers
dans nos sociétés modernes (Bearle et Means, 1932) cités
par Bowen (1953) et Mills (1956). En effet, la RSE renvoie à une vision
de l'entreprise dont la finalité n'est pas d'enrichir les shareholders
(actionnaires), mais de concilier les intérêts opposés de
tous les stakeholders (parties prenantes). Une entreprise socialement
responsable adopte ainsi nécessairement une approche à long terme
de ses objectifs, de sa stratégie et de ses bénéfices.
Le principe théorique de la RSE postule par ailleurs
qu'un comportement socialement responsable n'est pas incompatible avec une
meilleure performance financière. Cette attitude permet de créer
un environnement institutionnel favorable à l'exercice des
activités économiques de l'entreprise et contribue à
l'acceptation volontaire des principes de RS. Notons aussi, qu'un comportement
responsable de l'entreprise se traduit par une plus grande stabilité
économique, sociale, et politique, et d'une diminution des critiques
faites par la société civile aux entreprises privées.
Plusieurs tendances lourdes confirment la portée de la
notion de RSE pour les entreprises. Le développement des filières
de commerce équitable atteste par exemple de la sensibilité des
citoyens-consommateurs à des facteurs non économiques mais
plutôt d'ordre sociétal (Jacquot et Attarça 2006). Dans une
certaine mesure, le succès grandissant des filières de produits
biologiques relève de la même logique : besoins de
sécurité er de transparence entre autres. Le développement
des agences de notation sociale souligne également la prise en compte du
comportement sociétale de l'entreprise dans les choix des
actionnaires
La performance de l'entreprise n'est pas seulement
jugée selon des critères financiers ou économiques, mais
aussi selon des critères relatifs à son comportement
sociétal. Les relations avec l'ensemble de ses parties prenantes
deviennent alors une donnée objective dans l'appréciation de la
performance. Différentes initiatives publiques donnent à la RSE
un caractère stratégique pour les entreprises. A l'échelle
internationale, le programme Global Compact, lancé par les
Nations Unies en 2000 a pour objectif de promouvoir au sein des entreprises des
pratiques respectueuses de l'environnement et des droits de l'homme. En 2001,
la Commission européenne a publié un Livre vert visant
à promouvoir la RSE.
Ces initiatives visent à faire prendre conscience aux
dirigeants d'entreprises, de la présence d'acteurs autres que les
actionnaires (shareholders), pouvant affecter et être affectés par
les activités de l'entreprise. Il s'agit des stakeholders ou parties
prenantes.
I-1-4- Comprendre la RSE par la théorie des
parties prenantes
C'est dans le sillage des approches managériales de la
Corporate Social Responsiveness (CSR) que le terme de stakeholders va se
développer, à partir de la fin des années 1970 et du
début des années 1980. Ces approches ont ceci d'original qu'elles
rapprochent et font cohabiter des groupes aux intérêts
contradictoires. A ce titre, on peut définir un stakeholders comme
« n'importe quel groupe dont le comportement collectif peut affecter de
manière directe le futur de l'organisation, mais qui n'est pas sous son
contrôle direct » (Emshoff et Freeman, 1978)4(*).
Le concept cosmopolite de stakeholders constitue une
deuxième occasion de synthèse théorique majeure. Ce
concept est doublement intéressant. Premièrement, il
bénéficie d'une large diffusion au sein des milieux
académiques. De plus, le concept de stakeholders apparaît
aujourd'hui comme le concept fédérateur pour mener à bien
une unification voire une refondation théorique du champ Business
and Society (Freeman, 1994). Deuxièmement, le concept de
stakeholders se distingue par son appropriation massive et inédite dans
le champ des pratiques managériales (A. Acquier et F. Aggeri, 2008).
Ainsi, le management des parties prenantes occupe une place centrale dans la
conceptualisation et la mise en oeuvre de la RSE au sein des entreprises. Les
stakeholders constituent alors un outil stratégique de management, car
la prise en compte de leurs intérêts n'a d'importance que
lorsqu'elle est associée aux objectifs de l'entreprise.
La question des parties prenantes pose la question de leur
recensement. F. Lépineux (2003) propose ainsi de
distinguer entre les parties prenantes sur la base d'une classification en
catégories d'acteurs :
· les parties prenantes internes (actionnaires,
salariés, syndicats) ;
· les partenaires opérationnels (clients,
fournisseurs avec, parmi ceux-ci, les sous-traitants, les banques dans la
position de prêteur mais aussi en attente d'une stabilité et d'une
solvabilité, les compagnies d'assurance dans les termes d'une
confrontation au risque dont la substance se renouvelle profondément
aujourd'hui) ;
· la communauté sociale (pouvoirs publics,
organisations spécialisées de type syndicat professionnel,
organisations non gouvernementales, société civile).
Le tableau ci-dessous recense et reprend de manière
synthétique, l'énumération faite ci-dessus.
Tableau 2.2 : Tableau synthétique des
parties prenantes et leurs attentes ou intérêts
principaux
|
Parties Prenantes
|
Exemples de leurs objectifs,
intérêts
|
|
Équipe de direction /
Décideurs
|
Gouvernance,
Culture
d'entreprise,
ventes à l'
exportation,
risque juridique,
risque de
réputation,
stratégie (court
et moyen terme),
responsabilité
civile,
risque
de perte de compétence,
performance,
rémunération,
lien de
subordination
|
|
Propriétaires /
actionnaires
|
Profit, valeur de l'
action en bourse,
information,
stratégie (long et
moyen terme)
|
|
Clients
|
Qualité
et absence de défaut des produits/Coût et délai de
livraison des produits/qualité de service, relation de
confiance et
partenariat
|
|
État,
Mission
économique
|
Souveraineté,
sécurité
collective (
défense),
indépendance
énergétique,
sécurité
des
approvisionnements
(
énergie,
matières
premières),
exportations, respect
des principes du
droit (
sécurité
juridique), respect des règles (
comptabilité
publique,
loi),
monnaie,
impôts
|
|
Citoyens
des communautés locales
|
Information sur les
impacts
environnementaux et
sociaux (
emplois), taxes et
contributions financières,
risque juridique
|
|
Employés
|
Rémunération,
sécurité de
l'
emploi,
intérêt du
travail,
conditions de
travail,
hygiène
et sécurité au travail (
CHSCT)
|
|
Syndicats
|
Négociation d'accords,
rémunération,
conditions de
travail,
hygiène
et sécurité au travail (
CHSCT)
|
|
Fournisseurs
/ sous-traitants
|
Prix et volume d'achat,
continuité, retombées technologiques,
partenariat
|
|
Banques
|
Fiabilité des
systèmes de
paiement
|
|
Investisseurs
|
Informations sur la
solvabilité, la
liquidité,
|
|
Compagnie
d'assurance
|
Informations sur la
gestion des
risques et la
solvabilité, sur la
sécurité
informatique (
profil de
protection)
|
Source: 1. Post, Preston, Sachs (2002),
2. Freeman R. E. (1984),
« Strategic Management : A Stakeholder Approach »,
éd. Pitman.
Cependant l'équivocité de la notion de RSE
aboutit parfois à des situations paradoxales d'entreprises
autoproclamées responsables, se félicitant de respecter les
droits de l'homme, tout en interdisant les syndicats et toute forme
d'expression collective. Il est en effet difficile, vu l'étendue de la
notion de se prétendre socialement responsable ou labellisé RSE
par quelque organisme que ce soit et prétendre satisfaire
simultanément les attentes de chaque partie prenante.
De ce qui précède, on est enclin de penser que
les débats et divergences d'approche, de compréhension, de
contextualisation et de théorisation ne manquent pas. Il existe en
sciences de gestion, une multitude de théories permettant
d'appréhender les démarches et politiques RSE.
Dans cette sous-section, il était question de retracer
la généalogie de la RSE depuis sa première formulation
académique jusqu'à nos jours, afin d'en ressortir une
définition consensuelle. Il en ressort que c'est l'américain
Howard Richard BOWEN en est le père fondateur et que la RSE devrait
revêtir plus un aspect volontaire que réglementaire. Ainsi, la
prochaine sous-section va nous édifier d'avantage sur les domaines
d'application et les outils qui permettent d'apprécier la RSE.
I-2- Domaines d'application et instruments de mesure
de la RSE
Si le problème de la mesurabilité des
activités extra économiques des entreprises s'est
généralement posé, celui de leur champ d'application se
pose moins.
I-2-1- Champ d'application des activités extra
économiques de l'entreprise
Les domaines d'application de la RSE sont multiples, mais par
rapport à l'entreprise qui là réalise, on peut regrouper
les activités de RSE en interne et en externe. Nous allons d'abord
présenter les types ou niveau de RSE avant d'aborder les domaines de la
RSE proprement dits.
a. Les niveaux de responsabilité sociale de
l'entreprise
D'une manière générale, il est
accepté que la notion de RSE intègre globalement les deux
critères normatifs suivants :
· Les firmes doivent honorer des obligations à
l'égard d'une pluralité de groupes sociaux ;
· Les firmes doivent savoir réagir aux demandes
sociales qui émanent de leur environnement.
Dans les deux cas, il s'agit de qualifier des actions de
l'entreprise qui traduisent une forme d'engagement de celle-ci envers ses
parties prenantes, et cela au-delà de ses obligations purement
légales ou économiques.
La responsabilité sociale des entreprises a
été abordée sous plusieurs dimensions et par plusieurs
auteurs. Il convient tout de même de noter que ces dimensions de RSE
présentent des similitudes et des complémentarités fortes
d'un auteur à l'autre.
Dans une étude sur la pratique de la RSE,
Johnson et Scholes (2000) identifient quatre types de
positions responsables :
- Les entreprises qui considèrent que leur seule
responsabilité est de garantir l'intérêt à court
terme des actionnaires. Pour cette catégorie d'organisations, seul
l'État est garant de l'encadrement juridique de la politique sociale de
l'entreprise ;
- Les entreprises dont les dirigeants pensent qu'une position
intelligente avec les autres parties prenantes sert à long terme les
intérêts des actionnaires ;
- Les entreprises qui intègrent dans les buts et les
stratégies, de façon explicite, les intérêts et les
attentes des parties prenantes. Elles dépassent souvent les obligations
légales. Pour les dirigeants de ces entreprises, la performance va
au-delà des considérations financières ;
- Enfin, les entreprises qui ont pour ambition de transformer
la société. Les considérations financières y sont
reléguées au second plan et sont plutôt perçues
comme une contrainte et non comme un objectif.
Cette approche bien qu'intéressante, ne nous permet
pas de ranger une entreprise dans l'un ou l'autre niveau de RSE de façon
explicite. A. B. Carroll rend cette classification plausible en
définissant
A. B. CARROLL (1979) souligne que les activités de RSE
englobent quatre grandes catégories d'obligations :
économiques (être profitable, fabriquer des produits respectant
des normes de qualité et de sécurité), légales
(respecter les lois et les réglementations), éthiques (agir
conformément à des principes moraux partagés au sein de la
société), philanthropiques (agir avec bienfaisance et
charité). La définition d'A. B. Carroll, considérée
comme fondatrice des approches théoriques de la RSE, a été
affinée par WOOD (1991) qui précise trois niveaux de
responsabilité pour l'entreprise.
En effet selon Wood (1991), la
responsabilité sociétale de l'entreprise présente trois
niveaux. D'une part, la responsabilité de l'entreprise en tant
qu'institution sociale : l'entreprise dispose d'une
légitimité accordée par la société, elle
doit utiliser son pouvoir économique qui découle de cette
légitimité, dans un sens favorable aux attentes de la
société, au risque de perdre ce pouvoir. D'autre part, la
responsabilité en termes de conséquences (outcomes) de ses
activités : ce sont les conséquences au niveau de ses
parties prenantes primaires (acteurs concernés directement et
profondément par les décisions de l'entreprise) ou de ses parties
prenants secondaires (acteurs concernés indirectement par les
décisions de l'entreprise). Enfin, la responsabilité
individuelle et morale des dirigeants et des managers : ceux-ci
doivent utiliser leur pouvoir discrétionnaire au service de la
responsabilité sociétale de l'entreprise (dans le choix des
stratégies de l'entreprise et dans les moyens de mettre en oeuvre ces
stratégies).
L'approche de Wood est complémentaire à celle de
Carroll. Chacune des formes de RSE proposées par Carroll
(économique, légale, éthique et discrétionnaire)
peut être déclinée selon les trois niveaux définis
par Wood.
Capron et Quairel-Lanoizelée (2000) proposent de
distinguer deux catégories de comportements ou de logiques
stratégiques en matière de RSE5(*). D'une part, les stratégies
substantielles : l'entreprise modifie réellement ses
objectifs, adapte ses méthodes de travail et son organisation de
manière à répondre aux valeurs de la société
et à la demande sociale. L'intégration entre les
préoccupations sociales de l'entreprise et ses choix stratégiques
économiques est forte6(*). Elle peut découler d'une attitude proactive
d'anticipation des demandes sociales ou d'une attitude réactive
d'adaptation face à une pression sociale. D'autre part, les
stratégies symboliques : l'entreprise s'approprie
opportunément la notion de RSE mais sans les fondements de cette
approche. Ce type de stratégie est centré sur l'image et sur la
réputation. Cela passe par la politique de communication
institutionnelle de l'entreprise, sa politique de communication commerciale ou
encore les stratégies de discours de leurs dirigeants envers les parties
prenantes. Leur objet est alors moins de prendre en compte certains enjeux
sociétaux que de servir de support à une politique de
communication externe ou de motivation du personnel.
Les niveaux de RSE tels que décrits par Capron et
Quairel-Lanoizelée peuvent être qualifiés de
génériques parce qu'elles englobent toutes les dimensions
proposées par les auteurs précédents. Toutes les approches
de la RSE proposées ci-dessus ont ceci de commun qu'elles
débouchent toutes sur les deux grandes orientations de la RSE à
savoir les dimensions obligatoires et volontaires de la RSE.
b. Mise en oeuvre de la RSE
La Responsabilité Sociale de l'Entreprise peut
être mise en oeuvre de plusieurs façons et ce dans plusieurs
domaines. En ce qui concerne les pratiques de RSE proprement dites, la
littérature distingue l'approche sociétale française de
l'approche d'inspiration anglo-saxonne. Dans l'une ou l'autre approche de la
RSE, les domaines d'application de la RSE ont deux grandes orientations ou
dimensions à savoir : la responsabilité sociale interne et
la responsabilité sociétale externe.
Bien qu'ils ne constituent pas les destinataires de
référence, les parties prenantes internes sont les acteurs
dominants du discours managérial (devant les actionnaires et les
clients). Depuis une quinzaine d'année, le personnel est davantage
présenté comme un partenaire, c'est d'ailleurs la raison pour
laquelle on lui attribue une place notoire dans les études portant sur
la performance partenariale des entreprises de l'ère contemporaine.
L'intégration des membres de l'entreprise a fortement
progressé à la fin des années 1990 (M. Attarça
& T. Jacquot, 2006). En effet, ces évolutions confirment
l'importance accordée à l'Homme au sein de l'organisation. Par
exemple dans les grandes entreprises et dans certaines PME, on emploi
désormais des termes plus valorisant, comme les notions
d'Equipe et de Collaborateurs, pour substituer les notions de
Personnel, employés ou de Salariés.
Ainsi, le « collaborateur » ne
représente plus un simple potentiel à gérer, mais est
plutôt perçu comme un acteur interne à former, bâtir,
édifier et animer. En bref, la responsabilité sociale en interne
a trait à plusieurs composantes de la GRH, notamment les conditions de
travail, la politique de rémunération, le dialogue social dans
l'entreprise, le climat social dans l'entreprise, la gestion des emplois et des
compétences, le temps de travail, l'intégration des
catégories fragiles, le principe de non discrimination selon
l'âge, le sexe, voire l'appartenance tribale.
En externe, la responsabilité sociale a trait aux
dimensions sociétales et environnementales. Les parties prenantes
externes prennent également une importance grandissante dans le discours
managérial. La progression significative des références
aux partenaires économiques puis à la population et à la
préoccupation environnementale illustre la volonté par les
dirigeants d'entreprise, d'affirmer une légitimité sociale. Elle
manifeste également la volonté de démontrer
l'étendue du champ de la réflexion stratégique (la RSE
s'inscrit dans une perspective de développement durable). Enfin, cette
présence met en évidence la volonté de valoriser les
acteurs dans le but de rechercher leur confiance, leur adhésion et
d'orienter leurs comportements à l'égard de l'entreprise.
Ainsi la mise en de la RSE en externe, peut
caractériser une dépendance ou bien une volonté d'associer
certains acteurs à la réflexion stratégique. Deux grandes
composantes auxquelles on peut associer les décisions
stratégiques de l'entreprise vis-à-vis des parties prenantes
externes sont la société civile et l'environnement. La
responsabilité environnementale s'inscrivant dans la volonté de
préserver l'environnement naturel (le souci du maintien des
écosystèmes) voire de participer activement à
l'écologie (lutte contre la pollution par exemple).
En bref, les domaines de la RSE en externe concernent
essentiellement la consultation et la prise en compte des attentes des parties
prenantes externes (État, société civile, banques et
autres compagnies), la prise en compte de l'impact écologique des
produits et services fabriqués et commercialisés, la limitation
de la consommation d'énergie et des matières premières, la
lutte contre la pollution, le recyclage des fournitures et des produits
usés, la réduction des rejets et émissions dans l'eau, la
contribution à la protection de la biodiversité et des
écosystèmes, application du principe de précaution en
matière de recherche scientifique et technologique.
Les domaines d'application de la RSE en interne et en
externe, et selon le modèle (anglo-saxon et français) sont
résumés en annexe. Il convient toutefois de noter que la maitrise
des différents domaines vers lesquels les dirigeants d'entreprise
peuvent orienter leurs démarches RSE n'est pas un acquis, encore faut-il
qu'ils sachent comment instrumenter la RSE et avec quelle efficacité.
I-2-2- Instruments de mesures de la RSE
A la question « comment instrumenter la
RSE ? », on trouvera difficilement une réponse
immédiate qui soit acceptée de tous. Car les contextes de mise en
oeuvre de RSE sont différents malgré la conjoncture actuelle de
mondialisation (déphasage persistant entre les conceptions
européenne et anglo-saxonne de la RSE). Les instruments dont dispose
l'entreprise dans sa politique de responsabilité sociale, ont
été regroupés en cinq catégories par Capron M. et
Quairel L. (2004) et dans un rapport de la CNUCED7(*). Par instruments de la RSE il faut entendre l'ensemble
des dispositifs que mettent en oeuvre les différents acteurs (internes
ou externes à l'entreprise) pour peser sur les décisions. Ces
dispositifs sont présentés sommairement dans le tableau
suivant :
Tableau 2.3 : Les Instruments de la
Responsabilité Sociétale de l'Entreprise
|
Dispositif
|
Utilité
|
Exemple
|
|
Mise en oeuvre
|
Assister le manager à la mise en oeuvre des
stratégies RSE au sein de l'entreprise. Autoévaluation et
évaluation croisée avec d'autres PP.
|
- Système de management de qualité (ISO 9001 et
9004),
- Système de management environnemental (ISO 14004),
- Système de management de la sécurité
(OHSAS 180001),
- Guide méthodologique (AA 1000-SD 21000).
|
|
Prévention
|
Construire la crédibilité des
représentations de l'entreprise et donner confiance aux parties
prenantes.
|
- Codes de conduite
- Certification sociale (SA 8000)
- Labellisation
|
|
Communication
|
Communiquer sur l'impact social de son activité et sur
la performance environnementale.
|
- Reporting social
- Rapport de DD
- Rapport Annuel
- Bilan Sociétal / Bilan Social
|
|
Contrôle
|
Contrôler l'application des critères sociaux
internationalement reconnus.
|
- Normes de performance (SA 8000)
- Normes de certification (AA 1000)
- Normes de gouvernance (OCDE)
- Tableaux de bord
|
|
Évaluation
|
Aider au diagnostic des performances sociétales.
|
- Bilan sociétal
- Notation sociétale
- Indice social danois
- SME key
|
Source : CAPRON M. et QUAIREL L.(2004) et le
CNUCED
Le tableau ci-dessus comprend au total cinq (05)
catégories de dispositifs auxquels les entreprises peuvent recourir dans
leurs démarches responsables. De manière sommaire, ces
dispositifs sont universellement applicables, mais pris dans les
détails, chaque société s'inscrit dans un exemple bien
précis. Ce tableau aurait donc été construit sur la base
de l'exemplarité8(*),
ce qui ferait de toutes ses rubriques (dispositif, utilité et exemples),
et particulièrement celles sur l'utilité et les
exemples des rubriques non exhaustives et sujettes à des
critiques. Par exemple, les instruments d'évaluation, telles que
définies, restent un mythe dans le contexte subsaharien en
général, et camerounais en particulier.
Ce qui nous amène à nous interroger sur
l'évaluation de la RSE au Cameroun en général et dans les
établissements financiers en particulier.
SECTION 2 : ANALYSE THÉORIQUE DES ENJEUX
DE LA RSE POUR LE SECTEUR BANCAIRE
Reprenant le point de vue partagé par T. Levitt (1958)
et M. Friedman (1962), on est enclin de se demander pourquoi une entreprise
dont l'objectif principal est de maximiser ses profits, engagerait des
dépenses supplémentaires pour mettre en oeuvre une politique RSE.
En effet, la mise en oeuvre d'une politique de responsabilité au sein de
l'entreprise comporte des enjeux déterminants pour celle-ci, surtout
dans le contexte actuel de mondialisation. Ces enjeux constituent une source
majeure de motivation des dirigeants à s'engager dans des
activités socialement responsables. Nous allons donc, dans une
première sous-section, présenter les enjeux de la RSE pour
l'ensemble des entreprises ; puis, dans une seconde sous-section, analyser
les enjeux de la RSE pour la firme bancaire.
II-1- Enjeux de la RSE pour les
entreprises
Les enjeux de la RSE pour l`entreprise sont multiples et
relatives au milieu dans lequel elle opère, à son domaine
d'activité et aux attentes de ses différentes parties prenantes
entre autres. Dans leurs pratiques de RSE, les dirigeants d'entreprises sont
généralement en phase avec le respect et la protection de
l'environnement, le développement durable et la bonne santé de
l'entreprise.
Selon J. IGALENS (2005) « l'enjeu premier est de
pouvoir bien aligner l'ensemble des dimensions et donc ne pas les traiter de
façon séparée. Il faut aussi se situer dans un contexte
sectoriel. Car il ne faut pas que la RSE devienne un moyen de fausser la
concurrence ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une
entreprise très en avance sur ces aspects sociaux et environnementaux
soit pénalisée parce que ses concurrents n'en feraient pas
autant. Prenons l'exemple de Nike qui, après des difficultés, est
allé très loin dans la transparence. Les conditions de travail de
certains de ses sous-traitants n'étaient pas conformes aux principes de
sa Charte et cela apparaissait dans un rapport d'audit. Un consommateur a
attaqué Nike pour publicité mensongère et a obtenu le
bénéfice d'une transaction financière avantageuse. Du
coup, Nike ne veut plus aller aussi loin dans la transparence. Aujourd'hui la
responsabilité sociale est devenue un vaste sujet, très complexe,
qui sollicite beaucoup de précautions de la part des entreprises. Une
stratégie de RSE doit être mûrement réfléchie
en amont comme le préconise à juste titre le MEDEF9(*), mais aussi dotée des
capacités requises en prévision de l'entrée en vigueur de
la nouvelle norme ISO 2600010(*).
Comme nous l'avons énoncé ci-dessus, les enjeux
de mise en oeuvre de la RSE sont multiples et variés, les plus connus
sont les enjeux managériaux, économiques, sociétaux et
environnementaux. Locket et coll., (2006) distinguent aussi les enjeux
théoriques et les enjeux idéologiques. P. Crifo et J-P Ponssard
(2008) quant à eux, examinent les enjeux que prend la RSE sur quelques
leviers classiques : décisions stratégiques, décisions
opérationnelles, communication.
Nous allons tour à tour examiner les décisions
ou enjeux stratégiques, les enjeux ou décisions
opérationnelles, les enjeux managériaux et les enjeux
économiques et sociétaux et leurs implications dans les pratiques
de RSE.
II-1-1- Les enjeux stratégiques :
préserver les intérêts à moyen et long terme
Le problème qui se pose ici est celui de la
détermination de la stratégie à adopter vis-à-vis
des exigences de responsabilité sociale. Cette stratégie peut se
développer au niveau de la communication d'informations à
caractère sociétal et l'entreprise pourra alors s'appuyer sur des
outils existant à cet effet (les médias, internet, ou le
reporting social). Il est notoire que les perspectives de croissance de
marché jouent un rôle prépondérant pour justifier
les choix d'investissement (P. Crifo et J-P. Ponssard,
2008)11(*). Il
est clair que la RSE s'inscrit tout naturellement dans un tel schéma :
par exemple les questions relatives à l'énergie renouvelable,
à l'obésité et à la nutrition ouvrent de nouveaux
marchés et précipitent le déclin d'autres marchés.
Ainsi, l'innovation, perçue ici comme
la capacité à anticiper les besoins futurs du marché,
offre des opportunités de croissance en termes de revenus et d'emplois
pour les firmes et les pays. C'est le cas, certes inversé, de quelques
firmes de l'industrie automobile. En effet, le constructeur automobile Krysler
envisage fermer une de ses branches en France. Le fait d'annoncer la nouvelle
quelques mois à l'avance permet non seulement à l'entreprise de
revoir ses stratégies en terme de coût (performance
économique), mais aussi, de préparer psychologiquement ses
employés afin d'éviter les effets néfastes d'un
licenciement soudain (aspect sociétal).
Après les enjeux stratégiques qui concernent les
intérêts de long et moyen terme de l'entreprise dans ses pratiques
de RSE, viennent les enjeux opérationnels, qui sont d'un horizon plus
rapproché et par conséquent, concernent les décisions
tactiques et courantes prises par les dirigeants.
II-1-2- Les enjeux opérationnels :
Responsabilité sociale et profit à cour terme
Selon M. Kramer et M. E. Porter (2006) c'est
à ce niveau que se font les arbitrages en matière de conditions
de travail, de sécurité, de sous-traitance... Ces arbitrages sont
pris par le management intermédiaire : responsables d'unités,
responsables logistique, directeurs d'usine, .... On peut
penser que c'est à ce niveau qu'est ressentie de manière la plus
forte la contradiction entre la RSE et le profit à court terme, profit
mesuré et analysé dans toutes ses dimensions par les multiples
outils du contrôle de gestion. C'est aussi à ce niveau que les
objectifs opérationnels se retrouvent le plus directement dans les
critères d'évaluation servant de base à
l'établissement des parts variables de rémunération.
Les procédures et outils auxquels les entreprises
peuvent avoir recours pour infléchir les décisions
correspondantes sont encore peu analysés. Epstein et Cornelius (2003)
proposent de s'appuyer sur des sustainable balanced scorecards12(*) permettant d'inscrire les
nouveaux enjeux dans les outils modernes de contrôle de gestion tels que
les tableaux de bord. Une autre démarche consiste à recourir
à l'exemplarité. L'exemplarité fait appel
à la motivation intrinsèque des managers, satisfaction
personnelle associée au fait de mettre en oeuvre des actes
cohérents avec son propre système de valeur. On a, à cet
effet, pu montrer que le fait d'être identifié par la
collectivité pouvait favoriser l'engagement personnel.
En bref, la mise en oeuvre de la RSE engendre des
coûts élevés à court terme, c'est-à-dire
sur le plan opérationnel, mais constitue une source d'avantage
concurrentiel sur le plan stratégique. Toutefois, les
enjeux peuvent
être analysés par rapport aux attentes et
intérêts
des
parties
prenantes de l'entreprise.
II-1-3 Les enjeux managériaux comme arbitrage
entre critères économiques et extra
économiques
Les enjeux managériaux de la RSE expriment les valeurs
et le comportement des dirigeants concernant le style de management et l'esprit
d'entreprise. Ils traduisent la perception que les managers se font de la RSE
et sont fondés sur les motivations individuelles de ces derniers
plutôt que sur des réflexions de groupe.
La tâche du manager n'est donc pas simple, car il doit
piloter l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties
prenantes. Cela suppose aussi d'arbitrer entre des critères
économiques et d'autres critères qui ne sont pas toujours en
« coalition » et qui ne sont généralement pas
pris en compte dans les modèles traditionnels de management (croissance
et profits par exemple). Le secteur de la construction en est un exemple
récurrent. En effet, comment concilier les politiques de GRH actuelles
des grands constructeurs automobile (contraction du personnel) à celles
de protection de la couche atmosphérique (fabrication des
véhicules à faible émission de CO2).
L'enjeu de la mise en oeuvre de la RSE apparait donc assez
compliqué et complexe au niveau des dirigeants pris individuellement. En
effet, comment rechercher des profits en menant des activités extra
économiques dans un marché intérieur sans
frontières ?
Il semble que l'existence d'un lien positif entre la
performance sociétale et la performance financière n'est pas
remise en question par les praticiens, le problème étant celui de
l'échéance ou de la date à laquelle la rentabilité
commence à se matérialiser. A cet effet, F. DEJEAN & J-P.
GOND ont collecté en 2003, les avis de quelques organismes
internationaux et de quelques gérants de fons éthiques, sur le
lien entre RSE et performance économique (voir tableau ci-dessous). Il
en résulte que les actions socialement responsables constituent un enjeu
économique important pour l'entreprise.
Les effets de la RSE sur la performance ont été
analysés à plusieurs niveaux et par plusieurs organismes. Les
plus importants ont été résumés dans e tableau
ci-dessous :
Tableau 2.4 : Relation entre CSR et performance
économique
|
Organismes
|
Citations
|
|
CSR Europe
|
« Pourquoi la CSR ? Les récompenses sont
énormes. Il a été démontré que la CSR est
une stratégie qui fonctionne. » Un encadré liste ensuite
l'ensemble des bénéfices que la CSR est susceptible de procurer :
performance financière accrue, des coûts de gestion
réduits, un renforcement de la valeur de l'entreprise et de sa
réputation, etc..
|
|
Business for Social Responsibility
|
Le document disponible sur le site Internet de l'organisme et
intitulé « Introduction à la CSR » commence par
détailler l'ensemble des impacts positifs susceptibles d'être
générés par la CSR, au premier rang desquels figure
l'idée d'un renforcement de la performance financière. A l'appui
de chacun des impacts, un grand nombre d'études empiriques montrant
l'existence d'un impact positif de la CSR sont citées.
|
|
Gérants de fonds éthique A
|
« une société qui est bien avec ses
salariés, avec son actionnariat, avec ses clients, ses fournisseurs et
puis avec tous les gens qui travaillent avec elle, doit normalement assurer des
bases solides pour croître durablement et avoir des performances
financières élevées ».
|
|
Gérants de fonds éthique B
|
« Je pense qu'une société qui gère
de manière intelligente des problèmes sociaux et environnementaux
est une société dans la quelle il y a une dynamique beaucoup plus
forte, où les gens sont plus productifs, et cela a une influence
énorme sur la rentabilité des sociétés. Pour le
social c'est une évidence, une société qui est bien
gérée sur le plan social ne peut pas faire autrement que d'avoir
des bonnes performances, enfin on va dire des performances économiques
au moins supérieures à ses concurrentes mal gérées,
ça ne veut pas dire que ce sera extraordinaire mais ça sera
supérieur, ça c'est tout à fait évident. ».
|
|
Gérants de fonds éthique C
|
« c'est un jugement sur des sociétés qui
allonge leur durée de visibilité, c'est-à-dire qu'on pense
que ce sont des sociétés qui se projettent non pas sur les
résultats financiers des six mois prochains mais qui se projettent
à long terme. Et comme nous on est des investisseurs très
fondamentaux, comme ce qui nous intéresse c'est d'investir dans des
sociétés qui ont des fondamentaux très solides, on pense
que ça nous donne une vision plus complète de la
société »
|
Source : Inspiré des travaux de Frederique
Dejean et Gond Jean-Pascal (2003).
Au-delà des avantages économiques potentiels que
les dirigeants reconnaissent à la RSE on assiste à un
renforcement d'un ensemble de pressions qui contraignent ces derniers et
convergent pour leur faire adopter un comportement socialement responsable. Ces
transformations de l'univers des entreprises confèrent à la
gestion stratégique de l'entreprise, des dimensions sociétales.
C'est ce qui fera l'objet du sous-paragraphe suivant.
II-2- Enjeux de la RSE pour la Banque
Les banques sont en général de grandes
entreprises qui ont un fort impact sur le tissu économique. Leur
métier les place au coeur des conséquences sociales et
environnementales des activités des entreprises qui
bénéficient de leurs concours. Il leur confère de ce fait
une responsabilité particulière. Elles intègrent
progressivement cette préoccupation à leurs pratiques depuis
quelques années, pour répondre notamment à la demande de
la société civile et des bailleurs de fonds. Nous montrons
d'abord comment la RSE trouve son application dans le domaine bancaire avant de
prêter une attention particulière à son apport au secteur
de la finance.
II-2-1- Déclinaison des activités RSE
dans le domaine bancaire
L'engagement des banques se décline sous
différentes formes : amélioration des conditions de travail en
interne, réduction de l'empreinte écologique de l'entreprise,
mécénat, philanthropie et/ou financement d'oeuvres sociales,
partenariats avec des ONG, clients, institutions de microfinance..., offre de
produits et services responsables : prêts verts, investissement
socialement responsable (ISR), épargne solidaire..., maîtrise des
risques environnementaux et sociaux des investissements. Un tel engagement
serait bénéfique tant pour les actionnaires que pour l'ensemble
des autres parties prenantes internes et externes.
Pour Allemand I et Brullebeaut B (2007), une politique de RSE
visant à satisfaire les actionnaires, en tant que parties prenantes,
comporterait trois axes : la transparence, la responsabilité
financière et la gouvernance. Poussées par l'évolution du
cadre règlementaire, comme les accords de Bâle II, toutes les
banques aujourd'hui se sont structurées par rapport au risque, avec un
département spécialisé dans la gestion des risques, des
instances de maîtrise des risques, des comités de contrôle
interne, une direction des risques. Comme le soulignent Marsiglia et Falautano
(2005), les banquiers et les assureurs, à l'intérieur de leur
rôle fondamental de gestionnaires des risques, peuvent choisir d'utiliser
des modèles offrant une vision globale de l'articulation du
système entre les différentes parties prenantes impliquées
et ainsi prendre en compte les conséquences qui découleront de
leurs actions. Se soucier des impacts économiques, sociaux et
environnementaux de ses activités est une manière pour une
entreprise de prévenir des risques qui peuvent à tout moment
venir mettre en péril sa rentabilité ou son avenir.
Au niveau du management, le respect de la diversité
dans l'équipe de direction s'inscrit dans le cadre d'une politique de
responsabilité sociétale. La composition de la direction
générale et celle du conseil d'administration peuvent ainsi
être définies de manière à respecter la proportion
entre les hommes et les femmes, ou tout autre indicateur de
diversité.
Au niveau des salariés, l'entreprise doit reconnaitre
aux termes de Novethic, que ses collaborateurs représentent sa
première source de richesse. Ils garantissent non seulement la
production d'un bien ou d'un service, mais peuvent également,
placés dans des conditions favorables, améliorer la
qualité des produits et des services, imaginer de nouvelles
façons de travailler. "L'entreprise socialement responsable a pour
objectif de prendre en compte les souhaits et valorise les
intérêts de ses ressources humaines en tant que condition
fondamentale de son acceptabilité sa cohésion et sa
croissance "13(*). Il en est de même pour les syndicats en leur
qualité de représentants et de défenseurs des droits des
salariés. En France, le pouvoir syndical et les revendications
salariales sont importants, ils sont susceptibles d'influencer les
stratégies de responsabilité sociale des sociétés
françaises (Grand et al. 2005). La plupart des banques font état
dans leur rapport annuel de développement durable d'accords syndicaux et
soulignent leur souci d'établir un dialogue social.
Au niveau de la clientèle, la RSE évolue
progressivement d'une variante philanthropique du capitalisme à des
approches stratégiques pour gagner la confiance de leurs clients et
celle de la société en général (Marsiglia et
Falautano, 2005). Les auteurs mettent en évidence dans leurs travaux
l'enjeu représenté par la RSE dans le contexte très
compétitif des services financiers et d'assurance, la RSE pouvant
être considérée comme un élément clé
de création de valeur. La communauté financière est
historiquement reconnue pour placer les considérations morales
au-delà des obligations légales et opportunistes. La notion de
confiance est extrêmement importante, les clients attendant des banques
qu'elles soient vigilantes vis-à-vis des fonds qu'ils leur confient et
de leur utilisation, notamment en les transformant en prêts (Green,
1989). Les banques ayant la meilleure visibilité sur leurs clients
seraient celles qui développeraient et extérioriseraient le plus
une image de développement durable (Branco, 2006).
Vis-à-vis des fournisseurs, il s'agit d'établir
un nouveau type de contrat en établissant des relations à long
terme. L'idée n'est plus d'obtenir le meilleur prix, en écrasant
les marges de ses fournisseurs et en les changeant régulièrement,
mais de bénéficier de produits ou de services de qualité
constante, dans un bénéfice mutuel pour les deux parties. Le
respect des engagements est une autre composante fortement mise en avant.
Pour les autres parties prenantes, s'inscrivant dans une
démarche citoyenne, la politique RSE d'une entreprise vis-à-vis
de la communauté (communauté locale, minorités) s'analyse
par exemple à travers les politiques de mécénat ou les
politiques de réduction des impacts sociétaux et de sponsoring.
C'est le cas de la Barclays qui sponsorise officiellement le championnat de
première division anglaise.
Cet engagement des établissements financiers en
général, et des banques en particulier, est d'un apport
substantiel pour les parties prenantes certes, mais également pour les
banques.
II-2-2- Apport de la RSE à l'activité
bancaire
Il importe avant tout, de souligner que la RSE revêt un
coté non moins obligatoire à l'endroit des entreprises qui
exercent en société. Le respect des normes anti pollution, le
respect des droits de l'homme et des chartes de bonne conduite sont autant de
facteurs qui révèlent que la RSE est mise en oeuvre avant tout,
par respect de la réglementation en vigueur.
En interne, se joue la crédibilité d'un
système de valeurs mises en avant comme ciment du collectif de travail.
Ces valeurs ont longtemps été formalisées dans des «
projets d'entreprises » (. Epstein et Cornelius ; 2003). Ceux-ci ont
été complétés ou remplacés par des codes
éthiques ou des recueils de principes de développement durable,
nettement plus impératifs. Les salariés en souscrivant à
ces textes marquent un engagement quasi contractuel à l'égard des
valeurs de l'entreprise ou du groupe.
En externe, l'entreprise est dorénavant exposée
à un véritable « risque de réputation ». Les
résultats financiers sont oblitérés s'ils sont obtenus
dans des conditions qui contreviennent aux règles déontologiques
et environnementales considérées comme socialement exigibles. Et
la crise, largement d'origine bancaire, rend encore plus aigue pour les
établissements financiers la question de leur image.
Les banques accordent un grand soin à la publication
des rapports annuels sur le Développement durable, qui sont de plus en
plus fournis. En Europe, des labels récompensent les rapports
jugés les meilleurs. Les rapports des grandes banques y sont d'ailleurs
audités.
La RSE, en effet, est sortie d'une sphère d'ordre
essentiellement éthique (Cheynel H., 2010). Pour l'auteur, on s'est
avisé que l'harmonie sociale, la qualité de la relation clients
et de la relation fournisseurs, la bonne acceptation par le tissu social
environnant sont autant de valeurs à portée économique.
Tel est le cas jusqu'au respect des normes environnementales qui
témoigne d'une gestion prudente des ressources. De plus, se soucier du
développement durable, c'est s'éclairer auprès des parties
prenantes sur les risques et les opportunités de long
terme, en matière autant économique qu'environnementale.
En bref, l'apport de la RSE est considérable tant pour
les entreprises en général que pour les établissements
financiers en particulier notamment les banques. La RSE permet surtout aux
banques de légitimer leurs actions aussi bien en interne auprès
des actionnaires et salariés qu'en externe auprès des clients,
fournisseurs et autres membres de la collectivité civile.
Parvenu au terme de ce chapitre, il était question pour
nous, de présenter les enjeux de la RSE pour les entreprises en
général et le secteur bancaire en particulier. Pour ce faire,
nous avons d'abord présenté l'éclosion du concept de sa
genèse à nos jours. Puis, après avoir
présenté ses instruments de mise en oeuvre et après avoir
mobilisé les éléments de compréhension de la
théorie des parties prenantes, nous avons mis en exergue, l'apport
théorique de la RSE au domaine bancaire. Dans le prochain chapitre, nous
allons, de manière empirique, vérifier les fondements et enjeux
théoriques de la RSE dans le domaine de la banque.
CHAPITRE 3
APPORT DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE
L'ENTREPRISE AU SECTEUR BANCAIRE
Ce travail de recherche a pour objectif
principal de découvrir les enjeux de la mise en oeuvre
d'activités extra-financières pour les établissements
bancaires en général et pour la BICEC en particulier. Le
présent chapitre s'attèle à répondre à cet
objectif. Pour atteindre cet objectif, nous y allons dans un premier temps
rappeler le construit méthodologique qui nous a servi de guide lors des
phases de collecte et d'analyse des données. Par la suite, nous
présentons les principaux résultats de notre recherche en
caractérisant les activités RSE de la BICEC suivi de leur impact
sur la performance de cette institution.
SECTION 1 : DÉMARCHE D'IDENTIFICATION DES
ENJEUX DE LA RSE POUR LE SECTEUR BANCAIRE
En effet, sur le plan théorique, il a
été démontré que la RSE présente des enjeux
et offre des perspectives indéniables aux établissements
financiers. Aussi, la BICEC n'en faisant pas abstraction, nous allons analyser
ce positionnement théorique sur la base de données empiriques.
Pour ce faire, nous allons, dans la présenter section, rappeler la
démarche adoptée et l'ensemble des techniques qui nous ont permis
de constituer notre échantillon final.
I-1- Démarche adoptée et technique
d'échantillonnage
Dans la présente sous-section, nous allons rappeler les
différentes phases qui ont constituées les grandes lignes de
notre approche méthodologique. Nous allons spécifiquement
rappeler les étapes de collecte de données et les techniques
d'échantillonnage. Mais il convient au préalable de rappeler
brièvement les hypothèses de recherche et leurs bases
respectives.
I-1-1- Rappel des hypothèses et de la
démarche adoptée
Cette sous-section commence sur un rappel en un rappel des
différentes hypothèses de la recherche et débouche sur le
choix d'une démarche méthodologique précise pour la suite
de notre travail..
I-1-1-1 Rappel des hypothèses et de la
problématique
La problématique de notre travail de recherche est
celle des enjeux des activités RSE pour la BICEC. En d'autres termes,
nous nous interrogeons sur ce que la BICEC gagne ou gagnerait à mener
des activités RSE dans un environnement caractérisé par
une concurrence rude et sans cesse croissante.
En phase avec la problématique, nous émettons
l'idée centrale selon laquelle « les activités
extra-financières de la BICEC ont une influence sur sa
performance ». Il s'agit en effet notre hypothèse
générale soutenue par les hypothèses subsidiaires ou
spécifiques suivantes :
· HS1 : Les activités extra
financières de la banque ont un impact sur son image et sur son risque
de réputation ;
· HS2 : La communication RSE par la BICEC a une
influence sur son image et sa réputation ;
· La prise en compte des attentes des parties
prenantes par la banque procure un avantage concurrentiel durable.
Ainsi, tels sont les hypothèses qui nous ont
guidées tout au long de la rédaction de ce travail de recherche.
Il importe maintenant de jeter un regard sur les techniques qui nous ont permis
d'aboutir à la constitution définitive de notre
échantillon.
I-1-1-2- Rappel de la démarche
méthodologique
Un travail de recherche, quelque soit le domaine, doit pouvoir
répondre à trois questions épistémologiques
fondamentales : Quoi ? Pourquoi ? et Comment ?14(*) Dans le cadre
de notre travail, nous avons déjà apporté une
réponse à la première question, car il s'agit des
activités extra financières de la BICEC.
S'agissant du « pourquoi », le
cadre théorique (chapitre 2) et le champ d'application (chapitre 1) y
ont déjà apporté des éléments de
réponse. Quant au « comment » il s'agit de
la démarche de la recherche que nous envisageons appliquer dans ce
travail. Nous avons déjà souligné en introduction que la
démarche méthodologique pour laquelle nous optons est de type
hypothético-déductif. Elle consiste en l'émission
préalable d'hypothèses que nous cherchons à valider ou
à infirmer à travers l'analyse des données
collectées auprès des différents répondants.
En général, la recherche en sciences de gestion
est marquée principalement par deux grandes approches : une
approche positiviste qui prône les méthodes quantitatives et une
approche constructiviste qui repose sur les méthodes qualitatives. Le
choix de l'une ou l'autre méthode n'est pas le fruit du hasard, il est
fonction des objectifs poursuivis par le chercheur. Par exemple, la
méthode qualitative est adoptée lorsque le but de la recherche
est de comprendre un phénomène que l'on se propose
d'étudier. Par contre, la méthode quantitative est plus
appropriée lorsque l'objectif de la recherche est de quantifier et
généraliser les résultats obtenus.
Ainsi, les concepts de responsabilité sociétale
et de parties prenantes ne sont plus des phénomènes nouveaux dans
le monde de la recherche en sciences de gestion. Ils ont déjà
fait l'objet de beaucoup d'études dans plusieurs contextes. Ce qui
écarte d'emblée, la possibilité d'adopter une
démarche qualitative dans ce travail. De plus, les travaux sur les
enjeux de la RSE ont pour la plupart porté sur l'approche quantitative.
Nous devons donc, dans le présent travail, adopter une approche
déductive pour découvrir le rôle de la prise en compte des
attentes des parties prenantes sur la performance des établissements
bancaires.
Le choix de la méthode quantitative tient
principalement du fait qu'elle permet d'établir des relations entre les
variables et apparait comme le moyen le plus efficace pour tester certaines
hypothèses de recherche. C'est notamment le cas lorsqu'on veut analyser
le lien de causalité qui existerait entre deux ou plusieurs variables
(responsabilité sociétale et performance).
Plusieurs autres raisons sous-tendent le recours à
l'analyse quantitative comme démarche méthodologique dans un
travail de recherche. Nous les retrouvons de manière synthétique
dans le tableau ci-après :
Tableau 3.1 : Recherche quali Vs Recherche
quanti
|
Recherche quantitative
|
Recherche qualitative
|
|
Tester une théorie par déduction
|
Développement de la théorie par induction
|
|
Tester des théories composées de variables
|
Construire une vision complexe et holistique
|
|
Mesurer à l'aide de chiffres
|
Expliquer avec des mots
|
|
Analyser, à l'aide de procédures statistiques,
et déterminer si les généralisations annoncées par
la théorie sont vraies
|
· Rendre compte de la vision des informateurs ;
· Conduite dans un cadre naturel
|
Source : Adapté de Nkakleu R. (2010),
Méthodologie de la recherche15(*)
En effet, conformément au tableau ci-dessus, nous avons
opté pour la méthode quantitative parce qu'elle repose sur une
analyse hypothético-déductive. Loin de construire une vision
holistique et complexe des déterminants des pratiques comptables, cette
approche nous aidera à tester la validité des théories
existantes à travers des analyses statistiques afin de corroborer ou
d'infirmer nos hypothèses.
I-1-2- Techniques d'échantillonnage et
constitution des échantillons
Pour découvrir les enjeux de la responsabilité
sociétale pour les établissements bancaires, nous avons
jugé nécessaire d'interroger non seulement les salariés de
l'entreprise, mais également les personnes externes à celle-ci
pour deux raisons : l'analyse d'un tel lien du seul point de vue des
salariés ne serait pas objective, car ceux-ci seraient juges et parties.
Aussi, la notion de partie prenante ne se limite pas qu'aux seuls
salariés, elle s'étend également à l'ensemble des
stakeholders externes à l'entreprise.
Nous retraçons donc d'abord le chemin qui nous a
permis de constituer l'échantillon des stakeholders internes avant de
nous intéresser à la composition de l'échantillon des
stakeholders externes.
I-1-2-1- Échantillonnage des stakeholders
internes
La BICEC étant une entreprise de grande envergure,
nous escomptions réaliser un échantillon représentatif de
la population des employés de cette structure. Pour ce faire, nous ne
pouvions pas sélectionner les employés au hasard (méthode
probabiliste). Nous devrions donc nous adresser à des personnes dont les
réponses pourraient contribuer effectivement à l'enrichissement
des données en vue de la vérification des hypothèses et de
l'atteinte de notre objectif. Ainsi, outre les responsables du service RSE,
nous nous sommes adressés aux personnes ressources (chefs d'agences,
cadres et employés) des différentes agences de la ville de
Yaoundé.
Le tableau ci-dessous schématise et synthétise
les différentes phases qui nous ont permis d'aboutir à la taille
actuelle de notre échantillon des parties prenantes internes
Tableau 3.2 : Constitution de la taille de
l'échantillon des stakeholders internes
|
Agences
|
Questionnaires
|
Taux de réponses
|
|
Administrés
|
Retournés
|
Exploitables
|
|
Yaoundé Centre
|
15
|
12
|
12
|
80,00 %
|
|
Yaoundé la le Parc
|
15
|
15
|
14
|
93,33 %
|
|
Yaoundé la Vallée
|
15
|
14
|
14
|
93,33 %
|
|
Omnisport
|
15
|
15
|
15
|
100 %
|
|
Biyemassi
|
15
|
15
|
14
|
93,33 %
|
|
Total
|
75
|
71
|
69
|
92,00 %
|
La lecture du tableau ci-dessus montre que nous
administré cinq séries de quinze questionnaires par agence, pour
un total de soixante-quinze questionnaires administrés. Dans l'ensemble,
tous les questionnaires administrés n'ont pas été
récupérés. Le délai de rédaction de ce
travail étant atteint, nous ne pouvions plus patienter. Aussi, tous les
questionnaires retournés n'ont pas été exploités,
car certaines réponses aux questions clés de notre questionnaire
n'ont pas été fournies.
Mais nous ressortons satisfaits d'ans l'ensemble, car nous
constituons un échantillon de 69 prospects sur les 75 escomptés,
soit un pourcentage de 92 %, largement au dessus de la norme statistique.
L'échantillon des stakeholders internes ayant
été présenté, nous allons présenter celui
des parties prenantes externes dans le sous-paragraphe suivant.
I-1-2-2- Échantillonnage des stakeholders
externes
En général, dans un échantillonnage
probabiliste, les unités de sondage sont tirées de manière
aléatoire. Il peut s'agir d'un sondage aléatoire simple, d'un
sondage statistique ou encore, d'un sondage stratifié. Dans les deux
premiers types de sondage, la liste de toutes les unités constitutives
de la population statistique est nécessaire. Ce qui n'était
déjà pas possible pour l'ensemble des stakeholders externes,
c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour un sondage
stratifié.
En effet, nous avons opté pour un sondage
stratifié où chacune des agences prospectées
représente une strate (un groupe homogène). Par la suite, nous
avons effectué des tirages aléatoires au sein des
différents groupes homogènes pour en constituer notre
échantillon. Pour ce faire, nous avons recensé un ensemble de
stakeholders accessibles, auxquels nous avons administré un
questionnaire.
La constitution de l'échantillon des stakeholders
externe a été très difficile. Car pour une première
analyse, il nous a fallu définir les parties prenantes externes à
retenir pour cette analyse. En effet, les parties prenantes externes
constituent un ensemble très vastes de prospectés pouvant aller
des clients et fournisseurs actuels, à l'ensemble des membres de la
société civile, en passant par les ONG et l'État. Pour ce
travail de recherche, nous avons décidé de nous limiter
uniquement aux clients actuels des différentes agences de la ville de
Yaoundé. Les raisons de ce choix sont multiples.
D'abord, nous pensons que pour un premier pas véritable
dans le monde de la recherche, il serait risqué et prétentieux de
vouloir couvrir l'ensemble des stakeholders externes de la BICEC. Ensuite, le
facteur « temps » ne nous aurait pas permis de prospecter
l'ensemble des différentes catégories de stakeholders externes.
Nous nous sommes donc limités aux clients desdites agences, l'objectif
étant d'obtenir une trentaine de questionnaires par agence à
l'issue de l'enquête.
Il importe de rappeler que très peu de questionnaires
ont été remplis sur place. Les clients étant presque
toujours pressés, nous n'avons pas voulu les embarrasser et avons
préféré leur remettre les questionnaires qu'ils n'avaient
qu'à remplir à domicile et ramener à l'agence. Aussi, les
questionnaires remplis pouvaient être déposés dans
n'importe quelle agence BICEC de Yaoundé. Cette phase a duré six
semaines.
Le tableau ci-dessous résume le processus de
constitution de l'échantillon des stakeholders externes, notamment les
clients prospectés.
Tableau 3.3 : Constitution de la taille de
l'échantillon des stakeholders internes
|
Agences
|
Questionnaires
|
Taux de réponses
|
|
Administrés
|
Retournés
|
Exploitables
|
|
Yaoundé Centre
|
30
|
27
|
27
|
90 %
|
|
Yaoundé la le Parc
|
30
|
30
|
30
|
100 %
|
|
Yaoundé la Vallée
|
30
|
26
|
26
|
86,67 %
|
|
Omnisport
|
30
|
21
|
21
|
70 %
|
|
Biyemassi
|
30
|
30
|
29
|
96,67 %
|
|
Total
|
150
|
134
|
133
|
88,67 %
|
La lecture du tableau ci-dessus laisse paraitre que sur les
150 questionnaires administrés, 133 ont pu être exploités
pour les besoins de notre étude. Soit un taux de réponse de 88,67
%, ce qui est significatif du point de vue statistique. On constate
également que plus de quinze questionnaires administrés n'ont pas
été retournés aux agences. Mais dans l'ensemble, nous
ressortons satisfaits de la phase de collecte des données.
I-2- Opérationnalisation des variables et
méthode de collecte et d'analyse
Dans la présente sous-section, il s'agit
essentiellement de présenter l'outil de collecte des données,
ainsi que les méthodes de collecte et d'analyse des données.
I-2-1- La collecte des données
La collecte des données est une phase cruciale dans
tout travail de recherche. Dans le présent paragraphe, nous allons dans
un premier temps justifier le choix de l'outil de collecte des données
auquel nous avons eu recours ; puis nous allons effectuer
l'opérationnalisation de nos variables pour montrer la base sur laquelle
le questionnaire a été élaboré.
I-2-1-1- Outil de collecte des données :
le questionnaire
Le questionnaire est un outil indispensable au recueil de
différents types d'informations, notamment sur les comportements, les
attitudes et opinions, les connaissances et sur des données
sociodémographiques (âge, sexe, revenu, ...). C'est un ensemble de
questions qui peuvent être des questions ouvertes, fermées ou les
deux. En ce qui concerne notre questionnaire, nous avons utilisé en
grande partie des questions fermées (dichotomiques et multiples) dans le
but de faciliter leur codification et l'analyse ultérieure des
données.
Nos questionnaires ont été administrés
à un ensemble plus vaste de stakeholders, allant des stakeholders
internes (les salariés) aux stakeholders externes (les clients). Pour ce
faire, deux questionnaires distincts ont été attribués aux
parties prenantes internes et externes.
Le questionnaire peut être administré de
plusieurs façons. D'une part, le chercheur peut, pour une raison ou une
autre, procéder par minitel ou par voie postale et dans ce cas, on dit
que le questionnaire est auto-administré. D'autre part, le chercheur
peut opter pour une administration par téléphone ou en face
à face. Dans le cadre de notre travail, l'administration des
questionnaires s'est faite en face à face qu'il s'agisse des
stakeholders externes ou internes.
L'élaboration des questionnaires s'est faite sur la
base de variables issues de nos hypothèses. Le sous-paragraphe suivant
présente de manière synthétique,
l'opérationnalisation des concepts de responsabilité
sociétale. Opérationnalisation qui nous a d'ailleurs permis de
concevoir et de formuler les questions de nos différents
questionnaires.
I-2-1-2- Opérationnalisation des variables de
la recherche
Partant de notre hypothèse générale, nous
avons opérationnalisé les concepts clés de notre recherche
que sont la responsabilité sociétale et la performance de
l'entreprise. Le résultat de cette opérationnalisation est
contenu dans le tableau ci-dessous :
Tableau 3.4 : Opérationnalisation des concepts
de RSE et de performance
|
Concepts
|
Dimensions
|
Indicateurs
|
Auteurs
|
|
Responsabilité sociétale de
l'entreprise
|
Interne
|
Climat social en entreprise
|
Une synthèse de la littérature sur le concept de
la RSE
Acquier et Aggeri (2001), David et al. (2005), Acquier et Gond
(2005), Carroll (1999), CEE (2001), Mc Williams et Siegel (2001); Mc Guire
(1963), Davis (1973), Wood (1991), Clarkson (1995), Capron et Quairel (2004),
Freeman (1984)
|
|
Parité Homme-femmes
|
|
Équilibre régional de l'effectif
|
|
Conditions de travail et de sécurité
|
|
Hygiène et salubrité
|
|
Processus/Profil de carrière
|
|
Politiques de formation des employés
|
|
Rémunération du personnel
|
|
Affiliation du personnel à la CNPS
|
|
Externe
|
Relations avec les fournisseurs
|
|
Relations avec les clients
|
|
Respect des délais
|
|
Relations avec les autres tiers
|
|
Activités philanthropiques (dons)
|
|
Activités de sponsoring / mécénat
|
|
Reporting sociétal
|
|
Environne-mentale
|
Engagement dans le développement de la
communauté locale
|
|
Lutte contre la pollution
|
|
Activités de protection de l'environnement
|
|
Gestion des déchets et rejets
|
|
Politiques de prévention et de gestion des risques
environnementaux
|
|
Économique
|
Impact sur la capacité de production
|
Doh et Guay (2006), D'Arcimoles Ch-H. et Trébucq St.
(2003), Friedman (1962)
|
|
Productivité des employés
|
|
Horizon des retombées
|
|
Maitrise des coûts de production
|
|
Impact sur le chiffre d'affaires
|
|
Rentabilité économique (profit)
|
|
Performance
|
Performance actionnariale
|
Remboursement des dettes
|
Jensen et Meckling (1976),
|
|
Distribution des dividendes
|
Poulain-Rhem T. (2005)
|
|
Market Value added (Valeur Boursière Ajoutée) et
PER
|
Charreaux et Desbrières (1998), Martinet (2002)
|
|
Total shareholder value
|
Lordon F. (2000)
|
|
Performance partenariale
|
Valeur ajoutée économique
|
Lordon (2000),
|
|
Valeur ajoutée
|
Remaud (2001), Steurer et al (2005),
|
|
Résultat net
|
|
Chiffre d'affaires
|
Le tableau ci-dessus nous a servi de base pour la construction
de nos questionnaires respectifs. On y constate par exemple que la performance
que les fruits de la performance de toute entreprise peuvent être
partagés aussi biens entre les actionnaires qu'entre les autres
stakeholders. Et une analyse plus approfondie de ce tableau laisse paraitre que
la dimension économique de la RSE et la performance ont beaucoup
d'indicateurs en commun.
Ainsi, après avoir opérationnalisé les
variables, il ne reste plus qu'à préciser les méthodes
d'analyse des données auxquelles nous pourrons recourir pour l'analyse
et l'interprétation des données collectées via les
questionnaires.
I-2-2- L'analyse des données
Les données collectées à l'aide des
questionnaires seront premièrement codifiées pour une bonne
lisibilité et pour faciliter leur insertion dans le logiciel d'analyse
et de traitement des données que nous allons utiliser. La fiche de
codification va d'ailleurs figurer en annexes pour une illustration de cette
étape de la recherche.
Le logiciel d'analyse des données que nous avons
retenu est le logiciel SPSS versions « SPSS 10 et 20 pour
Windows ». En effet, le choix de ce logiciel tient au fait qu'il
est le logiciel le plus approprié et recommandé en sciences de
gestion. Aussi, il regorge de multiples tests qui satisfont nos ambitions, car
nous allons effectuer plusieurs tests de vérification
d'hypothèses.
En effet, outre le tri à plat qui va nous permettre
d'observer la fréquence de certains phénomènes relatifs
aux activités RSE de la banque, nous allons effectuer des analyses
factorielles des correspondances. Celles-ci nous permettront d'extraire, d'un
panier de variables relatives à la responsabilité
sociétale de la BICEC, celles qui sont les plus pertinentes pour
découvrir leur impact sur la performance de la banque.
I-2-2-1- Test d'extraction des variables
pertinentes
Il existe une multitude test d'extraction des variables. Mais
le choix d'un l'un ou l'autre outil n'est pas le fait du hasard. Dans le cadre
de notre travail, nous retenons comme critère la nature des variables et
le nombre d'items. En ce qui concerne la nature des variables il s'agit de
connaitre si les variables sont nominales ou ordinales. Dans le cadre de notre
recherche, nos variables sont pour l'essentiel des variables nominales. Dans
cette perspective, les tests d'extraction les plus appropriés sont
l'analyse factorielle des correspondances, l'analyse en composantes
principales, le test Alpha de Cronbach entre autres. Mais le choix de l'un de
ces outils dépendra du nombre d'items représentant la variable
étudiée.
En effet, étant donné la multitude d'indicateurs
de RSE contenus dans notre questionnaire, nous prévoyons qu'il sera
nécessaire d'en extraire au moins un qui soit le plus pertinent. Pour ce
faire, compte tenu de la nature de nos variables (variables nominales pour la
plupart), nous allons réaliser des analyses factorielles des
correspondances. L'indicateur le plus important sera celui le plus
éloigné de l'origine.
Après avoir identifié les indicateurs les plus
pertinents de nos variables respectives, il va falloir les rapprocher deux
à deux conformément aux hypothèses spécifiques. Ce
rapprochement va constituer le test d'hypothèse proprement dit.
I-2-2-2- Tests de vérification des
hypothèses
En ce qui concerne les tests de vérification des
hypothèses, le test le plus approprié pour les variables
nominales est le test du Khi-deux. Encore faut-il que la taille de
l'échantillon soit assez élevée et que les indicateurs
retenus pour le test soient issus de questions elles-mêmes dichotomiques
ou bimodales. Notre travail rempli les conditions d'applicabilité du
Khi-deux, surtout en ce qui concerne le caractère nominal des variables
et la taille de l'échantillon. Mais pour le nombre de modalités
des variables, nous ne saurons prévoir le nombre de modalités des
variables qui seront retenues dans la mesure où il nous faudrait d'abord
disposer des réponses des prospects.
Cependant, lorsque que la réalisation du Khi-deux n'est
plus possible, le test alternatif le plus indiqué est l'analyse de la
régression. Notamment une régression linéaire qui pourra
être simple ou multiple selon qu'on ait retenu une ou plusieurs variables
explicatives respectivement.
Ainsi, les tests de vérification des hypothèses
retenus dans le cadre de ce travail sont le Khi-deux et l'analyse de la
régression, tandis que le test d'extraction des variables pertinentes
est l'AFC. Nous pouvons donc nous livrer au traitement, à l'analyse et
à l'interprétation de nos résultats.
SECTION 2 : ANALYSE DE L'INFLUENCE DES ACTIONS
RSE SUR LE RENDEMENT DES ACTIVITÉS BANCAIRES
Cette section a pour objectif ultime de présenter les
résultats empiriques de notre recherche. Pour ce faire, nous allons dans
un premier temps caractériser les actions RSE et la performance de la
BICEC ; puis, dans un deuxième temps, nous allons rapprocher ces
deux concepts pour voir s'ils sont liés.
II-1- Caractérisation des actions RSE et de la
Performance de la BICEC
Pour apprécier les phénomènes de RSE et
de performance à la BICEC, nous allons nous servir simultanément
des questionnaires adressés aux clients et au personnel. Ceci nous
permettra de rapprocher les points de vue afin d'en ressortir des conclusions
objectives et vides de biais.
II-1-1- Évaluation de la RSE à la
BICEC
Pour mieux apprécier la responsabilité
sociétale dans un milieu, il importe de vérifier son degré
de notoriété dans ce milieu. Aussi, il a été
demandé aux différents répondants s'ils sont au courant de
l'existence d'un tel concept. Les résultats sont donnés
ci-dessous :

Le tableau ci-dessus montre qu'en interne, la RSE n'est pas
un concept nouveau pour plus de 82 % des prospects. Rappelons que les parties
prenantes internes sont pour la plupart des chefs de service. Autrement dit,
nous pensons que ce pourcentage, bien qu'élevé, n'est pas des
plus satisfaisants dans la mesure où la totalité des PP internes
doit être « éduquée » sur le concept de
responsabilité sociétale pour une meilleure pratique des
ressources humaines.
Mais, pour les répondants n'ayant pas encore entendu
parler du concept de RSE, nous leur avons fait une brève
présentation du concept pour qu'ils puissent répondre
objectivement aux questions suivantes. Notamment sur les pratiques RSE de la
BICEC.

Le tableau ci-dessus est la preuve qu'à 100 %, la
BICEC mène des activités sociétales et responsables. Ceci
peut être apprécié en interne à travers des
variables comme la politique de recrutement (équilibre des genres,
équilibre régional), la sérénité du climat
social, les bonnes conditions de travail, d'hygiène et de
sécurité, la justesse et la régularité des
rémunérations, sans oublier la prise en compte des attentes des
parties prenantes internes. En bref, la BICEC réalise des oeuvres
sociales tant en interne qu'en externe.

Le tableau ci-dessus montre que la totalité des
prospects rencontrés en interne s'accordent pour dire que la BICEC
réalise des oeuvres sociales aussi bien en interne qu'en externe. En
externe, la RSE de la BICEC peut être globalement appréciée
à travers le tableau ci-après :

En effet, jusqu'à 91 % des répondants
perçoivent clairement les actions sociétales de la BICEC. Ce qui,
comme le montre le tableau suivant, peut constituer une variable importante de
fidélisation et de pérennisation de la clientèle.
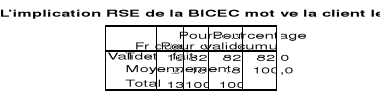
En effet, le tableau ci-dessus montre que les engagements
sociaux de la BICEC peuvent lui être profitables dans la mesure où
ils motivent plus de 80 % des clients rencontrés. C'est d'ailleurs ce
qui a été découvert en interne sur le caractère
constant et croissant des clients.
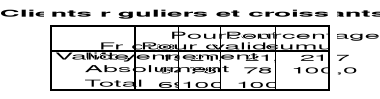
Le tableau ci-dessus montre en effet que les clients sont
fidèles et croissants. Autrement dit, les activités RSE de la
BICEC font de cet établissement bancaire, une structure digne de
confiance.
En bref, plusieurs variables attestent de l'emprunte
sociétale de la BICEC. Autrement dit, la BICEC est une entreprise
socialement responsable. Cependant, il importe de savoir si cette
responsabilité extra financière n'entame pas sa
responsabilité financière. D'où la nécessité
d'évaluer son niveau de performance.
II-1-2- Appréciation du niveau de performance
de la BICEC
En ce qui concerne la performance de la BICEC, elle ne
s'apprécier globalement qu'à travers les réponses fournies
par les employés. Autrement dit, seul le questionnaire des parties
prenantes internes a été exploité pour évaluer la
performance de l'entreprise. Mais avant toute chose, il importe de savoir si la
BICEC évalue sa performance. Le tableau ci-après nous renseigne
à cet effet :

Le tableau ci-dessus montre bel et bien que toutes les
agences de la BICEC évaluent leur performance en vue de
l'évaluation de la performance globale de l'entreprise. Aussi, cette
performance est évaluée à travers un échantillon
très grands d'indicateurs de la performance. Mais ceux qui reviennent
fréquemment sont donnés dans le tableau ci-dessous :
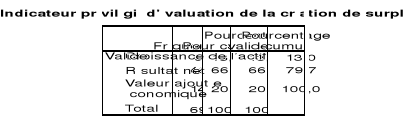
En effet, conformément aux rapports financiers des
exercices comptables, résultat net, valeur ajoutée
économique et croissance de l'actif sont les indicateurs
privilégiés d'évaluation de la performance à la
BICEC. Aussi, l'évolution de ces indicateurs peut nous permettre
d'évaluer la performance de l'entreprise.
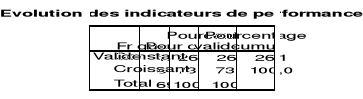
Comme le montre le tableau ci-dessous, la performance de la
BICEC est réelle dans la mesure où ses principaux indicateurs
sont dans hausse dans près de 74 % des cas rencontrés. De plus,
lorsqu'ils n'ont pas augmenté, il sont au moins resté constants
dans le temps. En aucun cas ces indicateurs privilégiés n'ont
conne de baisse ces trois dernières années. On admet donc que la
BICEC est performante.
Mais il reste à découvrir si la RSE a une part
des responsabilités dans le niveau de performance constaté
à la BICEC jusqu'ici le premier tableau ci-dessous précise la
raison globale de la performance sans cesse croissante de la BICEC.

En effet, la performance croissante de la BICEC est d'abord
et surtout le fruit de nouvelles pratiques managériales (82,60 %)
soutenue par de nouveaux indicateurs (17,40 %). Mais de manière globale,
ces pratiques managériales peuvent être relatives à la mise
en oeuvre des activités de responsabilité sociétale comme
le montre le tableau ci-dessous :

En effet, le tableau ci-dessus montre que la plupart des
employés pensent que les actions sociétales de l'entreprise ont
un impact réel sur sa performance. Autrement dit, tout porterait
à croire que des niveaux élevés de performance sont en
partie explicables par la mise en oeuvre des actions RSE au sein de la
structure.
Nous ne saurons conclure à cet effet sans effectuer les
tests de vérification d'hypothèses. C'est sur ce point que nous
nous attardons dans la sous-section suivante.
II-2- Analyse de l'incidence des activités RSE
sur la performance de la BICEC
La présente section a pour objectif de vérifier
(corroborer ou invalider) notre hypothèse générale selon
laquelle Les activités extra-financières de la BICEC ont une
influence sur sa performance. Il s'agit en d'autres termes de
découvrir la nature du lien (positif, négatif ou neutre) qui
existerait entre les actions RSE de la banque et sn niveau de performance.
Toutefois l'hypothèse générale ayant fait
l'objet de scission en sous-hypothèses, la validation ou le rejet de
celle-ci passe nécessairement par la validation ou le rejet des
hypothèses spécifiques. Nous allons donc tour à tour
vérifier nos hypothèses spécifiques pour conclure sur une
influence possible de la RSE sur la performance de la BICEC.
II-2-1- Analyse de l'incidence des activités
extra financières de la BICEC sur son risque de
réputation
Ce paragraphe a pour objectif principal de vérifier
notre première hypothèse spécifique selon laquelle :
les activités extra financières de la banque ont un impact
sur son image et sur son risque de réputation. Pour ce faire, nous
avons identifié les items suivants dans le questionnaire des parties
prenantes externes :
· « BICEC mène des activités
RSE » comme indicateur de la mise en oeuvre de la RSE par la
BICEC (variable indépendante) ;
· « RSE a une incidence sur la
réputation » comme indicateur du risque de réputation
et de l'image (variable dépendante).
Le choix du questionnaire des parties prenantes externes tient
au fait que celui des PP internes peut contenir des biais provenant
d'employés voulant à tout prix justifier le bien fondé des
activités RSE de la BICEC.
Ainsi, comme nous l'avons souligné dans la
première section de ce chapitre, a nature nominale et plurimodale de
l'une des variables du test (notamment la variable explicative) exclue
d'emblée la possibilité de recourir au test du khi-deux. Nous
avons donc effectué une analyse de régression. Notamment une
régression linéaire simple mettant en relation les
activités RSE de la BICEC à son image et sa réputation.
Les résultats de ladite régression sont
donnés dans les tableaux ci-dessous :
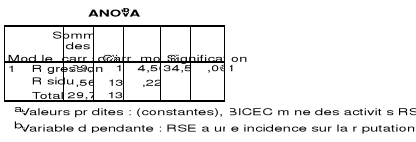
Le tableau ci-dessus montre que la valeur des résidus
(0,562) est largement inférieure à celle de la régression
(29,21). Autrement dit, l'analyse de la régression pour laquelle nous
avons opté est statistiquement significative au seuil de 5 %. Les
coefficients de régression sont donnés dans le tableau
ci-dessous
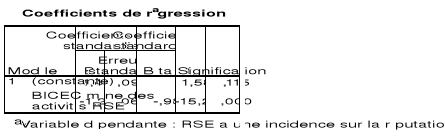
La lecture du tableau ci-dessus montre que le béta
standardisé (corrigé des erreurs) est de - 0,983 pour la relation
entre les activités de responsabilité sociétale de la
BICEC et son risque de réputation. Dans cette perspective,
l'équation de régression à laquelle nous aboutissons est
la suivante Y = - 0,983 X + 0,063. De plus, le seuil
asymptotique de signification de 0,000 est la preuve que notre test est
statistiquement significatif au seuil asymptotique de 0,05. Pourtant pour la
constante, ce seuil est de 0.115, autrement dit, la constante est
négligeable et peu significative dans notre équation de
régression. Par conséquent, il est logique de conclure que les
activités RSE de la BICEC réduisent le risque de
réputation de la BICEC. Plus la BICEC mène des activités
de responsabilité sociétale, plus son risque de réputation
diminue.
Nous retenons donc notre première hypothèse
spécifique selon laquelle : Les activités extra
financières de la banque ont un impact sur son image et sur son risque
de réputation.
Qu'en est-il de la nature du lien entre la communication RSE
de l'entreprise et son image ?
II-2-2- Analyse de l'impact de la communication RSE
sur son image et sa réputation
Ce paragraphe a pour objectif principal de vérifier
notre deuxième hypothèse spécifique selon laquelle :
la communication RSE par la BICEC a une influence sur son image et sa
réputation. Pour ce faire, nous avons identifié les items
suivants dans le questionnaire des parties prenantes externes :
· « Répondant au courant des actions RSE
menées par la BICEC » comme indicateur de la communication RSE
(variable explicative) ;
· « L'implication RSE de la BICEC motive la
clientèle à plus de confiance » comme indicateur de
l'image de la banque (variable dépendante).
Pour les mêmes raisons que celles évoquées
ci-dessus et compte tenu de la nature plurimodale de la variable à
expliquer, nous avons effectué une analyse de la régression.
Cette régression met en relation la communication RSE et la confiance de
la clientèle vis-à-vis des actions de la BICEC.
Les résultats de ladite régression sont contenus
dans le tableau ci-dessous :

Le tableau ci-dessus montre que la valeur des résidus
(3,851) est largement inférieure à celle de la régression
(15,808). Autrement dit, l'analyse de la régression pour laquelle nous
avons opté est statistiquement significative au seuil de 5 %. Les
coefficients de régression sont donnés dans le tableau
ci-dessous

La lecture du tableau ci-dessus montre que le béta
standardisé (corrigé des erreurs) est de 0,443 pour la relation
entre la commuication RSE de la BICEC et la confiance suscitée en la
clientèle. Dans cette perspective, l'équation de
régression à laquelle nous aboutissons est la suivante Y
= 0,443 X + 0,088. De plus, le seuil asymptotique de signification de
0,000 est la preuve que notre test est statistiquement significatif au seuil
asymptotique de 0,05.
Cependant, pour la constante, ce seuil est également
significatif (valeur de 0.000), autrement dit, la constante n'est pas
négligeable. Par conséquent, il est logique de conclure que la
communication des actions de responsabilité sociétale ne suffit
pas pour susciter plus de confiance des clients. Nous retenons notre
deuxième hypothèse en précisant que : la
communication RSE par la BICEC a une influence relative sur son image et
sa réputation.
Nos deux premières hypothèses ayant
été corroborées, on peut dire que l'hypothèse
générale est vérifiée à 66,67 %. Pour
être entièrement satisfaits, nous devons vérifier la
troisième et dernière hypothèse spécifique.
II-2-3- Impact de la prise en compte des attentes des
parties prenantes sur l'avantage concurrentiel de la BICEC
Ce dernier paragraphe a pour objectif principal de
vérifier notre troisième et dernière hypothèse
spécifique selon laquelle : la prise en compte des attentes des
parties prenantes par la banque procure un avantage concurrentiel durable.
Pour ce faire, nous avons identifié les items suivants dans le
questionnaire des parties prenantes externes :
· « Partage de la valeur créée
par la BICEC » comme indicateur de la prise en compte des attentes
des parties prenantes (variable explicative) :
· « RSE comme outil stratégique
concurrentiel » comme indicateur de l'avantage concurrentiel pour la
BICEC (variable expliquée).
Nous avons une fois de plus réalisé une analyse
de régression. Les résultats de cette analyse sont contenus dans
les tableaux ci-dessous :*
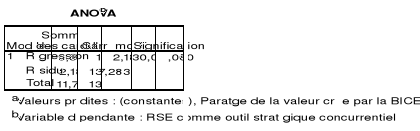
Comme les tableaux précédents, le tableau
ci-dessus montre que la valeur des résidus (2,189) est largement
inférieure à celle de la régression (9,540). Autrement
dit, l'analyse de la régression pour laquelle nous avons opté est
statistiquement significative au seuil de 5 %. Les coefficients de
régression sont donnés dans le tableau ci-dessous

La lecture du tableau ci-dessus montre que le béta
standardisé (corrigé des erreurs) est de 0,932 pour la relation
entre le partage de la valeur créée et l'avantage concurrentiel
qui en résulte. Dans cette perspective, l'équation de
régression à laquelle nous aboutissons est la suivante Y
= 0,932 X + 0,029. De plus, le seuil asymptotique de signification de
0,000 est la preuve que notre test est statistiquement significatif au seuil
asymptotique de 0,05. Pourtant pour la constante, ce seuil est de 0.065,
autrement dit, la constante est négligeable et peu significative dans
notre équation de régression. Par conséquent, il est
logique de conclure qu'en partageant la valeur créée à
l'ensemble des parties prenantes, la BICEC se procure un avantage concurrentiel
substantiel dans son secteur d'activités. Plus la BICEC mène des
activités de responsabilité sociétale, plus son avantage
concurrentiel est considérable.
Nous retenons donc notre troisième hypothèse
spécifique selon laquelle : la prise en compte des
attentes des parties prenantes par la banque procure un avantage concurrentiel
durable.
Parvenu au terme de cette section, il ressort, que la BICEC
est un établissement financier socialement responsable, mais avec
beaucoup de points à améliorer. Parallèlement à son
empreinte RSE, la BICEC fait preuve de bonne performance globale. Des
différentes analyses des hypothèses qui ont été
faites, il ressort que nos différentes hypothèses
spécifiques sont toutes vérifiées et validées,
chacune d'une ampleure différente de l'autre. Par conséquent nous
pouvons conclure sur la rétention de notre hypothèse
générale en soulignant que « les
activités extra-financières de la BICEC ont une influence
positive et significative sur sa performance ».
En sommes, il était question, pour ce
chapitre, de présenter la phase empirique de notre travail de recherche.
Nous y avons dans une première section, présenté le
construit méthodologique qui nous a permis d'atteindre notre objectif
principal, celui de découvrir la nature du lien entre les actions de
responsabilité sociétale de la banque et son incidence sur la
performance. La méthode étant
hypothético-déductive, nous avons opté pour une
démarche quantitative. L'outil de collecte des données
utilisé est le questionnaire. Les données ainsi collectées
ont été analysées dans le logiciel SPSS. Il en ressort que
nos hypothèses spécifiques sont toutes validées. Ce qui
nous a permis de corroborer notre hypothèse générale en
concluant sur une incidence positive et significative des activités
sociétales sur la performance de la banque.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
· Heald M., (1961), «Business Thought in the
Twenties: Social Responsibility», American Quarterly, vol. 13,
n° 2, p. 126-139;
· Heald M. (1970), The Social Responsibilities of
Business: Company and Community, 1900-1960, Cleveland , Case Western
Reserve University Press;
· Berle et Dodd (1932), For whom corporate managers are
trustees ?, Harvard Law Review, 45 (7), May, p. 1145-1163;
· Charles W. et Hill I. (2004), International Business,
www.academia.edu/4716993/
internationalbusiness_charles_w_i_hill;
· Locket A., et al. (2006), «Corporate social
responsibility in management research: focus, nature, salience and sources of
influence», Journal of management studies, Vol. 43, n°1, PP. 15-35
· D'Arcimoles Ch-H., Trébucq St. (2003),
«Etude de l'influence de la performance sociétale sur la
performance financière et le risque des sociétés
françaises cotées (1995-2002)», Actes du Colloque
interdisciplinaire La Responsabilité Globale de L'Entreprise : un
nouveau modèle de régulation ?, Audencia Nantes. Ecole de
Management, 16 et 17 octobre 2003, 54 p ;
· Mc Williams A. et Siegel D. (2001),
«Corporate Social Responsibility: a theory of the firm perspective»,
Academy of Management Review, 26(1), p. 117-127 ;
· McGuire J. W. (1963), Business and
Society, MacGraw-Hill, New-York ;
· Davis K., (1973), « The case for and against
business assumptions of social responsibilities », academy of
management journal, vol. 16, n° 2, 1973, P. 312-322
· Jones T. M. et Wicks A. C., (1999),
« Convergent stakeholder theory », Academy of management
review, 24 (2), P. 206-221.
· Wood D. J. (1991).
Corporate social performance revisited, Academy of Management
Review, n°16, p. 691-718.
· Wartick S. L. et Cochran P. L., (1985), « The
evolution of the corporate social performance model », academy of
management review, vol. 10, n°4.
· Clarkson M., (1995), «A stakeholder framework for
analyzing and evaluating corporate social performance, academy of management
review, vol. 20, n°1, P. 92-117.
· Gond, J.-P. et A. Mullenbach (2004),
Les fondements théoriques de la Responsabilité Sociétale
de l'entreprise, Revue des Sciences de Gestion, 205, Janvier/Fevrier.
n°93 ;
· Pasquero J. (1980), « L'entreprise face aux
pressions socio-politiques de son environnement », document de
travail n° 80-100, IAE-IEC Grenoble.
· Global reporting initiative (1992), Environmental
management accounting-purpose and progress, by Bennett M.D., Rikhardsson P.M.
& Schaltegger S.;
· Global reporting initiative (1997), Sustainable
measures : evaluation and reporting of ..., b Bennett M., Peter J. and
Klinkers L.;
· Lawrence et Lorsh (1967), Organization and
Environment : managing differenciation and integration, Boston, harvard
Business School Press ;
· Doh J.P. et Guay T.R. (2006),
«Corporate Social Responsibility, Public Policy and NGO Activism
in Europe and the United States: an institutional-stakeholder perspective»
Journal of Management Studies, Vol 43, n°1, pp.47-73;
· Berle A.A. et Means C.G. (1932),
The Modern Corporation and Private Property, MacMillan, New York ;
· Mills (1956), The Power Elite,Oxford University
Press;
· Jacquot et Attarça (2006), La
représentation de la responsabilité sociale des
entreprises : une confrontation entre les approches théoriques et
les visions managériales,
www.researchgate.net
· Ernshoff J. R. et Freeman R. E., (1978),
«Stakeholder management», working paper, Wharton applied research
center.
· Frederick W. C. (1994), « Coda »,
Business and society, vol. 33, n°2
· Acquier A. et Aggeri F. (2008), Une
généalogie de la pensée managériale sur la RSE.
Revue Française de Gestion, numéro de publication n°180, p
131 à 157 ;
· Lépineux F., (2003), «Dans quelle mesure
une entreprise peut-elle être responsable à l'égard de la
cohésion sociale ? ». thèse de doctorat nouveau
régime ès sciences de gestion, conservatoire des arts et
métiers LIPS, Tome 1.
· Stanford research institute (1963), Stakeholders
Theory, Long Range Planning Service,
· Post, Preston etSachs (2002), Redefining th
corporation : stakeholder management and organisational wealth,
Stanford University Press, p.376;
· Johnson et Scholes (2007), Exploring corporate
strategy, 8th Edition, Pearson, p.29-46
· Capron M. et Quairel-Lanoizelée F.
(2004), Mythes et réalités de l'entreprise responsables,
Edition La Découverte-Paris, résumé de l'ouvrage par
Peyron V. (2005 - 2006), 26 pages ;
· Capron M. et F. Quairel-Lanoizelée.
(2007), La responsabilité sociale d'entreprise. Repères
la découverte 477, Paris ;
· Savage et Cataldo (1993), The january Effect and other
Seasonal Anomalies : A Common Theoretical Framework, Jai Press,
Stamford, Connecticut, p 24;
· Lewitt T., (1958), «The dangers of social
responsibility», Harvard business review, Septembre-Octobre.
· Igalens J. (2003), « Etudes des
relations entre les entreprises et les organisations de la
société civile autour du concept de responsabilité sociale
» Notes du LIRHE, n° 2003-1 ;
· Crifo P. et Ponssard J-P. (2008),
« RSE et/ou performance financière : points de
repère et pistes de recherche », Finance Durable et
Investissement Responsable, Business Economics, Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), cahier n°2008-15, p 6-14 ;
· kramer M. et Porter M. (2006), « Strategy and
society: the link between competitive advantage and corporate social
responsibility», Harvard Business Review, Vol 84, n°12;
· Epstein M. et Cornelius P. (2003).
Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy , New York: Oxford
University Press, 2003;
· Kaplan R. et Norton D. (1996). The
Balanced Scorecard, Harvard Business School Press: Boston, Massachussetts ;
· Zingales, O'Rourke et Hockerts (2002), Balanced
scorecard and sustainability : state of the art, INSEAD;
· Déjean F. et Gond J. P., (2004),
« Responsabilité sociétale de l'entreprise :
enjeux stratégiques et méthodologiques de recherche »,
Finance contrôle stratégies, 57 (6) : 741-764.
· Marsiglia et Falautano (2005), Corporate sociale
responsibility and sustainability challenges for a Bancassurance Company,
The Geneva Papers, 30(3), 485-497;
· Grand B., Grill P., Rousseau P., Schneider-Maunoury G.
(2005), "La responsabilité sociale des entreprises en Europe : une
étude empirique", WP n°723 ;
· Green C.F. (1989), "Business Ethics in Banking",
Journal of Business Ethics, vol. 8, n°8, p. 631-634 ;
· Branco M.C. (2006), "Communication of Corporate Social
Responsibilty by Portugese Banks : A Legitimacy Theory Perspective", Corporate
Communications : An International Journal, vol. 11, iss. 3, p. 232-248
· Cheynel, H. (2010). Responsabilité sociale
d'entreprise (RSE) dans les entreprises bancaires, Observatoire
des Métiers, des Qualifications
et de l'Egalité Professionnelle
entre les Femmes et les
Hommes dans les Banques, 1-22 ;
· Bekolo Ebe B., (2010), Cours
d'Epistémologie de la Recherche, Unité d'enseignement,
Université de Douala, Ecole Doctorale ;
· Nkakleu R. (2010), Cours de
Méthodologie de la Recherche : Méthodes Mixtes de la
Recherche, Papier non publié, Université de Douala,
École Doctorale ;
· McGuire J. W. (1963), Business and
Society, MacGraw-Hill, New-York ;
· Jensen M.C., Meckling W.H. (1976),
« Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership
Structure », Journal of Financial Economics, vol.3,
p.305-360 ;
· Poulain-Rhem T. (2005), L'impact de
l'affectation du Free Cash Flow sur l'affectation de la valeur
actionnariale : le cas de la politique d'endettement et de dividendes des
entreprises françaises cotées. Finance Contrôle
Stratégie, Volume 8, n°4, p 205-2 ;
· Charreaux G. et Desbrieres P. (1998),
« Gouvernance des entreprises : valeur partenariale contre valeur
actionnariale », Finance Contrôle Stratégie, Vol 1, n°2,
p. 57- 88 ;
· Martinet A.C. (2002),
« L'actionnaire et les formations des stratégies »,
Revue Française de Gestion, n°139 ;
· Remaud H. (2001), Modes de Gouvernance
et « Création de Valeur » en Petite
Entreprise : une application au secteur agroalimentaire du
Languedoc-Rousillon ; U.M.R MOISA Place P. Viala - 34060
Montpelier cedex 1 - France ; 6ème conférence de
l'association internationale de management stratégique, FSA ;
* 1Terminologie du Council on
EnvironmentalQuality dans le National Environmental Policy Act of 1969 des
Etats-Unis, disponible sur internet :
http://ceq.eh.doe.gov/Nepa/regs/ceq/1508.htm#1508.8 ;
* 2 CSR : de l'anglais
Corporate Social Responsibility
* 3 Livre vert de la Commission
européenne sur la responsabilité sociale des entreprise
(2001).
* 4 Freeman (1984) accorde la
paternité de la notion de stakeholder à une note interne du
Stanford Research Institute (SRI, organisme de recherche et de conseil) de
1963.
* 5Les auteurs font
référence pour cette typologie à A. Savage et A. J.
Cataldo : « a multicase investigation of environmental
legitimation in annual reports », research paper, 1993
* 6 Capron et
Quairel-Lanoizelée (2004) illustrent ce type d'intégration par
les politiques de développement d'éco-conception (pneus par
Michelin par exemple).
* 7 Conférence des
Nations Unies pour le Commerce et le Développement
* 8 L'exemplarité
consiste à partir des cas d'entreprises précis qui ont fait
preuve de succès en matière de rentabilité dans leurs
démarches RSE et d'inciter leur généralisation pour en
ressortir des modèles et des grilles applicables à toute
entreprise.
* 9 Mouvement des Entreprises de
France
* 10 La norme ISO 26000 est une
norme ISO en cours d'élaboration. Elle portera sur la
responsabilité sociétale des organisations et devrait être
publiée en 2010.
* 11 Patricia Crifo et
Jean-Pierre Ponssard (2008), RSE et/ou performance financière :
points de repères et pistes de recherche, Laboratoire
d'économétrie, Ecole Polytechnique.
* 12 Le Balanced Scorecard
(Kaplan et Norton, 1996) répond au double objectif de gérer les
demandes des différentes parties prenantes de l'entreprise et traduire
les stratégies en actions opérationnelles. La notion de
sustainable balanced scorecard est une extension `naturelle' du Balanced
Scorecard dans la mesure où ce concept reste ouvert à
l'intégration de toutes les perspectives ou parties prenantes
pertinentes, notamment la perspective environnementale et sociale. La
référence à la RSE (ou à la citoyenneté
d'entreprise) y est d'ailleurs explicite mais il faut attendre le début
des années 2000 pour qu'une attention plus importante lui soit
réellement consacrée (Zingales, O'Rourke et Hockerts, 2002).
* 13
http://www.novethic.fr/novethic/site/article
* 14 Extrait du cours
d'épistémologie de la recherche dispensé par
Bekolo Ebe B. (2010) dans le cadre des enseignements en Master
Recherche (DEA)
* 15 Cours de
Méthodologie de la Recherche, Master II Sciences de Gestion,
Nkakleu (2010)



