REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERTSITAIRE
« E.S.U »
UNIVERSITE SAINT JOSEPH
U.S.J-GOMA
CAMPUS DE GOMA

251601920B.P 170 Goma N/K
FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PROFESSIONNELS
DE SANTE SUR LA GESTION DES DECHETS HOSPITALIERS.
« Cas observé à l'hôpital
de RUHENGERI du 1er Janvier au 30 Juin 2010 »
DEPARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE
Par :
NTIRENGANYA Jean de Dieu
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention d'un grade de Licencié en science de la santé.
Option : Santé
Publique.
Orientation: Gestion des
institutions de santé.
Directeur : C.T AMISI RAMAZANI
Timothée
Année académique 2009-2010
EPIGRAPHE
Je veux dire merci au Seigneur, de tout mon
coeur je
Veux remercier le Dieu Saint. Oui, je veux
remercier le
Seigneur Sans oublier un seul de ses
bienfaits. C'est lui
Qui pardonne toutes mes fautes,
Guérit toutes mes
Maladies, m'arrache à la tombe, me comble de
Tendresse et de bonté. Il remplit ma
vie de bonheur, Il
Me donne une nouvelle jeunesse ; Je
suis comme
L'aigle qui prend son vol. Que ta
gloire, Seigneur dure
Toujours ! Réjouis-toi, de ce
que tu as fait ! Je veux te
Chanter toute ma vie ; mon Dieu, je te
louerai tant que
J'existerai Que mon poème te plaise,
Seigneur ; Moi, je
Suis heureux de t'avoir comme Dieu !
Oui, je veux te dire
Merci, Seigneur. Alléluia, vive le
Seigneur.
Psaume 103 (102)
Jean de Dieu NTIRENGANYA
DEDICACE
A Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient
Pour ta gloire infinie et ta miséricorde
divine,
A mon regretté père MANIRAGABA Jean
Damascène
Qui n'a pas pu savourer les fruits de ses efforts,
A nos chers parents NYIRABAHURUZA Annonciatta
A la famille Emmanuel Sekomine, Joseph Munyanziza, Bertin
Gakombe, Dr Phocas Biraboneye, Ildephonse Seramuka, Joseph MUNYANZIZA, Emmanuel
Uwimana, Emmanuel Bugingo et Jean Claude Ndungutse.
Pour leur esprit de familiarité, de
serviabilité et de dévouement,
Aux Personnels de l'hôpital de Ruhengeri et ceux du
Centre de santé de Gasiza
Pour leur devise de charité toujours,
A nos grands frère, petit frère et petite
soeur Jean d'Amour Manirere, Aline INGABIRE, Simon Pierre Ndayisenga, et
Aimé Gustave Iragena,Batundi Hangi.
Et puisque la barque de la vie ne se navigue vraiment
bien qu'à deux, à ma chère épouse Donatille Uwineza
et au don précieux de l'éternel ma fille aînée Ineza
Ntirenganya Amanda
Pour tout... au delà des mots,
Jean de Dieu NTIRENGANYA
REMERCIEMENTS
C'est le fruit de la contribution de plusieurs personnes.
C'est pourquoi nous tenons à leur exprimer nos vifs remerciements.
Premièrement, nous remercions Dieu puissant pour sa
bénédiction tout au long de ce travail. Le Gouvernement
congolais, les parents, nos frères et soeurs congolais méritent
un salut pour avoir mis en place l'Université Saint Joseph à
toute la nation sans discrimination, nous héritons de vous une mission
sociale, nous vous disons merci.
Nous remercions encore tout le corps professoral de
l'Université saint Joseph pour la formation de qualité qu'il nous
a offerte.
Nos remerciements s'adresse d'une façon
particulière à Monsieur CT AMISI RAMAZANI Timothée, qui,
malgré ses multiples occupations se donner l'audace de diriger notre
travail.
A tous nos frères et soeurs ainsi que tous les
compagnons de lutte et ceux dont les noms ne sont pas cités ici.
Jean de Dieu NTIRENGANYA
RESUME
Notre travail traits «connaissances, attitudes et
pratiques des professionnels de sante sur la gestion des déchets
hospitaliers a l'hopital de Ruhengeri du 1er janvier au 30 Juin
2010
L'objectif principal est de déterminer les
connaissances, attitudes et pratique du personnel sur le système de
gestion des déchets hospitaliers de l'hôpital de Ruhengeri.
Au cour de cette travail noua avons mené notre
enquête sur 55 personne travaillant dans les différents services
de l'hôpital
Ainsi les résultats auxquels nous sommes aboutis
témoignent ce qui suit :
· 32,7% des enquêtés ont fait les
études secondaires, carrière non médicale, ils ont fait la
normale primaire et comptabilité ; 27,3% des enquêtés
ont fait les études secondaires, carrière médicale, option
des soins infirmiers, anesthésie et physiothérapie ; 21,8%
des enquêtés ont fait des études primaires non
médical
· 21 enquêtés savent que le déchet
c'est une saleté soit 38% et 20 cas soit 36% savent que c'est l'objet
intitulé et sans valeur.
· 41,1% des enquêtés utilisent la
boîte de sécurité lors de la collecte des
déchets ; 31,5% des enquêtés utilisent les poubelles
en métal inox ou en plastique sans couvercle 18,1% des
enquêtés utilisent les poubelles en métal ou en plastique
couvert.
· les poubelles sont installées dans les services
à 64,4% ceci qui explique l'absence des poubelles dans les services
responsable des maladies nosocomiales et autres dangers.
· les résultats montrent que 65,5% des
enquêtés font la collecte sélective, alors que 34,5% ne la
font pas.
· 38,2% utilisés les récipients de type
différents pour le triage des déchets tandis que 32,1% des
enquêtés le font par les Boites de sécurité de
couleurs différentes.
· 60% des enquêtés transportent les
déchets dans les brouettes tandis que 25,5% utilisent les poubelles en
couvercles.
· 56,4% des enquêtés désinfectent
quelquefois les matériels ; 16,4% des enquêtés
désinfectent toujours les matériels ; 16,4% des
enquêtés ne désinfectent jamais les matériels.
· 78% des enquêtés portent quelquefois les
matériels de protection tandis que 18 % les portent toujours.
· 41% des enquêtés affirment que le lieu de
stockage ne réunit pas les conditions et seulement 39% des
enquêtés disent que le lieu de stockage réunit les
conditions.
· il ressort que le four d'incinération est le
plus utilisé pour la gestion des déchets avec 42 cas soit 76,4%,
alors qu'il est inapproprié.
· 83% soit 49 cas ont montre que le lieu de gestion des
résidus d'incinération est inappropriée.
· la mauvaise gestion des déchets hospitaliers
constitue le problème de sante publique par les infections nosocomiales
avec 30 cas soit 54,1% contre la prolifération des vecteurs avec 20 cas
soit 36,4%.
· L'hôpital a besoin la disponibilité des
équipements pour résoudre le problème de gestion des
déchets hospitaliers à 56,4%
· 38,2% ont une besoin en formation sur la gestion des
déchets hospitaliers.
SUMMARY
Our work features «knowledge, attitudes and convenient
professionals of health on the hospitable garbage management have the hospital
of Ruhengeri of January 1st to June 30, 2010
The main objective is to determine knowledge, attitudes and
convenient of the staff on the system of management of the hospitable garbage
of the hospital of Ruhengeri.
To the court of this work tied led our investigation on 55
person working in the different services of the hospital
So results to which we is succeeded testify what follows:
· 32,7% of them investigated made the secondary studies,
nonmedical career, they made the primary normal and accounting; 27,3% of them
investigated made the secondary studies, medical career, option of cares male
nurses, anesthesia and physiotherapy; 21,8% of them investigated made some
primary studies non medical
· 21 investigated know that the loss it is a dirt is 38%
and 20 cases are 36% know that it is the titled object and without value.
· 41, 1% of them investigated use the box of security at
the time of the collection of garbage; 31,5% of them investigated use trash
cans made of metal steel or in plastic without lid 18,1% they investigated use
trash cans in metal or in plastic covered.
· trash cans are installed in services to 64,4% this that
explains the absence of trash cans in the services person responsible of
illnesses nosocomialeses and other dangers.
· Results show that 65,5% of them investigated make the
selective collection, whereas 34,5% don't make it.
· 38, 2% used the different type containers for the
sorting of garbage while 32,1% of them investigated make it by them Limp of
different color security.
· 60% of them investigated transport garbage in barrows
while 25,5% use trash cans in lids.
· 56,4% of them investigated disinfect materials
sometimes; 16,4% of them investigated disinfect materials always; 16,4% of them
investigated disinfect materials never.
· 78% of them investigated carry the protective materials
sometimes while 18% always carry them.
· 41% of them investigated affirm that the place of
storage doesn't unite conditions and only 39% of them investigated say that the
place of storage unites conditions.
· he/it comes out again that the oven of incineration is
the more used for the management of garbage with 42 cases is 76,4%, whereas it
is inappropriate.
· 83% either 49 cases have watch that the place of
management of incineration residues is inappropriate.
· the bad hospitable garbage management constitutes the
problem of public health by infections nosocomialeses with 30 cases is 54,1%
against the proliferation of vectors with 20 cases is 36,4%.
· The hospital has need the availability of facilities to
solve the problem of hospitable garbage management to 56,4%
· 38, 2% have one need in formation on the hospitable
garbage management.
SIGLES ET ABBREVIATIONS
0C : Degré Célcius
AES : Accident d'exposition au sang
ASC : Animateurs de Santé Communautaire
ASRI : Activité de Soins à Risque
CCC : Communication aux Changement de Comportement
CHR : Centre Hospitalier Régional
CLIN : Comité de lutte contre les infections
nosocomiales
DASRI : Déchets d'Activité de soins à
risque infectieux
FOSA : formation sanitaires
FOSA : Formation Sanitaire
FRW : Francs Rwandais
GDM : Gestion des Déchets Médicaux
I.N : Infection Nosocomiale
JSI : John Snow incorporated
Kg/j : Kilogramme par jour
KHI : Kigali Heath Instute
MINISANTE : Ministère de Santé
MSF : Médecin Sans Frontière
NMIS : Making Medical Injection Safer
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
POSACOM : Poste de Santé Communautaire
PVD : Pays en Voie de Développement
TAB : Tableau
T° : Température
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour L'Enfance
VHB : Virus de l'Hépatite B
VHC : Virus de l'Hépatite C
VIH : Virus de l'immuno- déficience Humaine
WWW : Wolrd Wide Web
INTRODUCTION GENERALE
0.1. ETAT DE LA QUESTION
Dans ce point, nous allons présenter quelques
théories et résultats des études antérieures sur
la gestion de déchets hospitaliers.
Willy NZAMUYE a mené une étude sur la gestion
des déchets hospitaliers auprès de 443 Formation sanitaires de la
République du Rwanda en 2008 1(*)avec objectifs de:
- Evaluer le niveau de gestion des déchets hospitaliers
dans les formations sanitaires ;
- Evaluer les activités de stockage de déchets
hospitaliers selon la source;
- Evaluer les activités de ramassage et de transport
des déchets hospitaliers jusqu'à l'endroit de destruction;
- Evaluer le niveau de connaissances des professionnels en
matière de la gestion des déchets hospitaliers ;
Il ressort de cette étude que 89,8% des formations
sanitaires n'ont pas la capacité de gestion des déchets
hospitaliers.
Dans cette même étude, il apparaît que la
majorité des professionnels et la population aux alentours des Fosa ont
les chances plus élevées de développées les
maladies nosocomiales suite à une mauvaise gestion des déchets
hospitaliers; cela est affirmé dans toutes les 30 districts du pays:
soit 100% des répondants de la province du nord, 83,4% de la ville de
kigali, 91,2% de la province de l'est et 98% de la province de l'ouest.
Au vue de ce résultat, Monsieur Willy NZAMUYE estime
que toute les professionnels et la population est courant de méfait de
la me gestion des déchets hospitaliers.
0.2 PROBLEMATIQUE
Diverses publications et enquêtes ont montrés que
les conditions actuelles d'élimination des déchets hospitaliers
ne sont pas toujours satisfaites.
Une manipulation et un transport multiplie ou ne prenant pas
en considération certains paramètres scientifiques, ou bien leur
mélange avec les déchets municipaux généraux, leurs
dépôts sur les terrains en plein air, voir leur utilisation comme
remblai ; ou encore fouille sans précaution dans des
décharges sauvages, les déchets hospitaliers posent de
très sérieux problèmes environnementaux et peuvent causer
des dangers pour la santé des habitants en
général1
Les déchets d'hôpitaux sont toxiques et
contiennent des matières infectieuses et dangereuses.
Dans nos hôpitaux nationaux, il n'est pas rare de
constater que les déchets hospitaliers sont collectés et
entassés dans un seul dépôt (souvent dans l'enceinte de
l'établissement).
Ces déchets ne sont pas souvent brûlés et
fréquemment visités par les enfants, les chiffonniers et les
animaux.
Le manque d'infrastructure, la faute de recueil des
données épidémiologiques systématiques, le faible
niveau d'éducation font que l'hygiène hospitalière reste
un problème de santé publique avec ses conséquences qui
sont : les risques infectieux, la pollution atmosphérique, la
dégradation de l'environnement par l'enfouissement et les risques
chimiques par la manipulation de ces produits dangereux2(*).
L'élimination sans précaution des déchets
d'activité des soins est une source de danger pour la santé, les
aiguilles et les seringues contaminés représentent un risque
particulier, car si elles ne sont pas éliminées correctement,
elles risquent d'être remises dans des emballages et recyclées
donnant lieu à une réutilisation dangereuse.
L'OMS estime qu'en 2004, des injections au moyen de seringues
contaminées ont été responsable de :
- 21 millions d'infections à virus de l'hépatite
B soit 32% de toutes les nouvelles infections ;
- 2 millions d'infections de l'hépatite C soit 40% de
toutes les nouvelles infections ;
- Au moins 260000 d'infections à VIH soit 5% de toutes
les nouvelles infections.
En 2002, dans les pays en voie de développement, autour
d'une campagne de vaccination de masse contre la rougeole en Afrique de
l'Ouest, 17 millions d'enfants ont été vaccinés, ce qui a
généré près de 300 T de déchets de
matériels d'injection.
En l'absence d'installations adaptées, à
l'échelle locale ou régionale un tel volume de déchets
aurait été difficile à éliminer en toute
sécurité.
Les résultats de l'OMS en 20032(*), conduite dans les 22 pays en
voie de développement a montré que la proportion des
établissements de santé qui n'éliminent pas les
déchets de soins est de 18 à 64%.
Cette étude montre qu'en plus des risques pour la
santé publique en l'absence d'une bonne gestion, le risque d'être
infecté par le HBV, le HCV et le VIH après piqûre
accidentelle avec une aiguille utilisée pour le patient infecté
est respectivement de 30%, 1,8% et 0,3%.
Au Maroc, les différents soins de santé
génèrent quelque 38.000 T/an de déchets médicaux,
les 12.000 T entre eux sont classés dangereux. Ce qui rend leur
traitement beaucoup plus complexe que les autres déchets solides3(*).
Au Rwanda, une enquête menée en juillet-
Août 2004 sur 80 formations sanitaires du pays (59% publiques, 22%
confessionnels, 19% privés) a montré que :
Dans 80% des FOSA, il y avait 1 à 4 boîtes de
sécurité ;
Au moins une piqûre avec aiguilles usagées chez
les agents de santé, a été reportée sur 6% des
FOSA ;
Dans 43% des FOSA, la présence d'aiguilles a
été observée aux alentours des bâtiments et la
gestion des déchets n'a été considérée que
sur 38%.
Ces résultats montrent clairement qu'il y a encore des
faiblesses en matière de gestion des déchets médicaux et
qu'il est urgent de mettre en oeuvre des stratégies visant
l'amélioration de cette situation dans toutes les FOSA et à tous
les niveaux4(*).
A l'hôpital de Ruhengeri les résultats obtenus
par l'étude de la GTZ en 2009 ont montre que :
- L'hôpital ne possédait pas
d'incinérateur moderne pouvant acquérir tous les déchets
solides hospitaliers des 12 formations sanitaires ;
- Les poubelles étaient insuffisantes et
n'étaient pas munies de couvercles ;
- La présence de déchets
éparpillés (seringues, aiguilles, objets tranchants...) dans la
cour et certains services de l'hôpital ;
- Mauvaise gestion des eaux usées provenant des
douches, toilettes et dans les services.
Tableau n°1 : Comparaison de production des
déchets hospitaliers par niveau de soins.
|
Niveau hospitaliers
|
quantité de déchets médicaux
produits (kg/lit/j)
|
capacité
d'accueil
nbre de lit
|
quantité maximale de production des
déchets par mois
|
|
Poste de santé ou POSACOMS
|
2.5Kg
|
0
|
0
|
|
Centre de santé
|
2.5kg
|
240
|
18.000kg
|
|
Hôpital de district
|
2.5kg
|
409
|
30.675kg
|
|
Total
|
649
|
48.675kg
|
Source:
www.moh.gov.rw; health facilities,
2009, p4
Au vu de ces données, il nous montre que la production
des déchets hospitaliers dans le district de Musanze
s'élevé à 48.675kg par mois si le taux
d'occupation des lits est de 100% pour cela il est nécessaire que tout
et chacun soit sensibilisé pour la protection de notre environnement de
vie de peur que ce dernier ne connaisse une catastrophe si ces déchets
ne sont pas gérés convenablement.
Partant de cette problématique, nous nous sommes
posé des questions suivantes :
1. Quel est le niveau de connaissance du personnel sur
l'hygiène et assainissement du milieu hospitaliers au sein de
l'hôpital de Ruhengeri?
2. Quelles sont les stratégies à mettre en place
pour une bonne gestion efficace des déchets hospitaliers à
l'hôpital de Ruhengeri?
3. Quelle est la capacité financière des
matériaux et des équipements de l'hôpital Ruhengeri
adéquat pour la collecte de déchets hospitaliers ?
4. Quelle l'attitude du personnel sur la gestion rationnelle
des déchets hospitaliers dans l'hôpital de Ruhengeri ?
0.3 HYPOTHESE DU TRAVAIL
La mise en oeuvre d'une série des questions
débouche nécessairement sur des hypothèses. Celles-ci
naissent donc à partir des questions posées au niveau de la
problématique.
« L'hypothèse est une proposition de
réponses à la question posée. »6 Elle est
généralement considérée comme « la
transposition directe d'une proposition théorique dans le monde
empirique. Une hypothèse établit une relation qui peut être
vérifiée empiriquement entre une cause et un effet,
supposé. Une hypothèse est donc un énoncé formel
des relations attendues entre au moins une variable indépendante et une
variable dépendante »7.
Bref, une hypothèse est une affirmation provisoire
concernant la relation entre deux ou plusieurs variables, concernant le
fonctionnement a priori ou a posteriori d'une institution. Cette affirmation
provisoire implique également une prise de position du chercheur face au
fait observé. Une hypothèse du travail est donc une idée
directrice, une tentative d'explication de faits formulée au
débutant, de la recherche et destinée ou maintenue d'après
le résultat de l'observation »8
6 M. GRAWITZ, lexique des sciences sociales, Paris,
DALLOZ, 2000, p. 360.
7 A.P. CONTANDRIOPOULOS, savoir préparer une
recherche. La définir, la structurer, la financer, presse de
l'université de Montréal, 1990, p. 30.
8 F. ESISO, Méthodes de recherche en science
sociales, cours inédit, UNIKIS/ CUEG, FSSAP/ G3 SPA, 1999- 2000, p.
18.
Compte tenu des préoccupations évoquées
ci- haut, nous émettons les hypothèses suivantes :
1. Le manque de connaissance des agents de l'hôpital de
Ruhengeri sur l'hygiène et assainissement du milieu hospitalier serait
l'une des facteurs lieu à la mauvaise gestion des déchets du
milieu hospitalier.
2. La disponibilité des moyens financiers, le
renouvellement du matériel et d'un équipement adéquat de
gestion des déchets réduiront les risques des maladies
nosocomiales au sein de l'hôpital Ruhengeri.
3. La mauvaise application des procédures pour une
gestion rationnelle des déchets serait à la base d'une mauvaise
gestion des déchets à l'hôpital de Ruhengeri.
0.4 OBJECTIFS DE L'ETUDE
0.4.1 Objectif global
Notre étude a comme objectif global de
déterminer les connaissances, attitudes et pratique du personnel sur le
système de gestion des déchets hospitaliers de l'hôpital de
Ruhengeri.
0.4.2. Objectifs spécifiques
1. Déterminer le niveau de connaissances du personnel
sur les normes de bonne gestion des déchets hospitaliers
2. Identifier les stratégies pour la gestion efficace
des déchets et proposer des solutions concrètes pour
améliorer l'hygiène et l'assainissement pour la prévention
des maladies nosocomiales et autres dangers.
3. Déterminer la capacité de l'hôpital de
Ruhengeri sur la gestion des déchets hospitaliers.
4. Déterminer le type de déchets produits dans
l'hôpital de Ruhengeri.
5. Déterminer la capacité des équipements
et outils disponible destinés à la gestion des déchets
hospitaliers.
0.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET
0.5.1 Intérêt personnel
Le choix de ce sujet est motivé par une présence
des déchets que l'on constate ici et là à travers
l'hôpital de Ruhengeri.
En choisissant ce sujet, c'est après un constant d'un
grand problème de la mauvaise gestion des déchets hospitaliers
dans l'hôpital de Ruhengeri et après avoir vu que ce
problème est devenu de plus en plus risquant pour les professionnels de
sante et la population. Ce travail cherche à donner des informations
plus ou moins fiables pour ceux qui auront à faire une étude dans
ce domaine, il aboutit en suite à des propositions socio sanitaires qui
peuvent permettre d'orienter harmonieusement l'état de besoin sur la
gestion des déchets hospitaliers de l'hôpital de Ruhengeri.
0.5.2 Intérêt scientifique
Les recherches et les analyses menées, suscitent un
esprit critique face à la dégradation de l'environnement dû
aux déchets hospitaliers responsable des maladies nosocomiales et autres
dangers dans nos milieux de vie.
0.5.3 Intérêt social
Vu que notre environnement se dégrade davantage et
laisse des effets négatifs sur toute la société, notre
étude se propose comme remède à la promotion soutenue de
l'environnement favorable à une vie saine laquelle est
premièrement bénéficiaire d'un écosystème
bien équilibré.
0.6 DELIMITATION DU SUJET
0.6.1 Délimitation dans le temps
Notre travail portera sur une période de six mois
allant de Janvier 2010 au Juin 2010.
0.6.2 Délimitation dans l'espace
Notre travail se limité à l'hôpital de
Ruhengeri, district de Musanze, en République du Rwanda.
0.7 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
0.7.1 Méthodes Utilisées
La recherche scientifique exige le recours aux méthodes
et techniques pour collecter, traiter et analyser les données.
Selon Madeleine GRAWITZ : « la méthode est
constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par le
quelle une discipline cherche à atteindre les objectifs qu'elle
poursuit, les démontrés et les vérifiés
»6
0.7.1.1 Méthode descriptive
Elle nous permettra de décrire l'hôpital de
Ruhengeri dans ses aspects organisationnels et fonctionnels.
0.7.1.2 Méthode statistique
La méthode statistique est une méthode qui tente
de concilier les démarches quantitatives et qualitatives.
Nous allons recourir à cette méthode pour
pouvoir quantifier et chiffrer les résultats de la collecte des
données par questionnaire. Elle nous permettra également de
présenter ces résultats sous forme des tableaux afin de les
visualiser plus rapidement et efficacement.
0.7.1.3 Méthode analytique
Elle nous a permis d'analyser les résultats des auteurs
qui avaient traité sur les déchets hospitaliers. En effet, cette
méthode est utile dans l'interprétation et analyse des
résultats obtenus au cours de la recherche.
6M. GRAWITZ, Op. Cit., P. 301.
0.7.2 Techniques Utilisées
Selon GRAWITZ, la technique est définie comme «un
moyen d'atteindre un but, mais qui se situe au niveau des faits ou des
étapes pratiques. Les techniques ne sont donc que les outils mis
à la disposition de la recherche »5(*).
Pour pouvoir collecter les données et informations,
analyser, et interpréter les résultats de notre travail de
recherche en vue de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses de
départ, nous allons recourir à quelques techniques.
0.7.2.1 Technique documentaire
Pour compléter les données recueillies sur
terrain nous avons consulté les ouvrages, revues, mémoires et
autres rapports ayant trait à notre sujet de recherche.
0.7.2.2 Technique d'interview
Selon ALBERT cité par MULUMBATI, « l'interview est
une technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale
entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté, afin de
permettre à l'enquêteur de recueillir certaines informations
concernant un objet précis»9.
Dans le cas notre recherche, cette technique va nous permettre
d'accéder à certaines informations par les enquêtés
qui sont les prestataires et les gens chargés d'hygiène
grâce à la communication verbale afin de recueillir les
informations objectives.9
0.7.2.3 Questionnaire d'enquête.
Elle consiste en une élaboration d'un questionnaire sur
base de variables dépendantes et leurs indicateurs liés aux
hypothèses et aux objectifs de notre travail.
Elle comprend des questions ouvertes, fermées, directes
qui permettent de recueillir les informations susceptibles de vérifier
les hypothèses formulées.
7.2.4. Population d'étude
La population de notre étude est constituée
de :
- Les agents de l'hôpital Ruhengeri
- Harvest (Entreprise chargé d'hygiène).
7.2.5. Taille de l'échantillon
La taille de l'échantillon a été
déterminée à l'aide d'une technique
d'échantillonnage.
L'OMS préconisant un échantillon variant de 1
à 50% de la population cible qui est composée de 55 personnes
présentant 50% de tous le personnel de l'hôpital dont :
- 40 (50%) d'agents de l'hôpital
- 15 (50%) du personnel chargé d'hygiène
à l'hôpital (Harvest).
0.8 DIFFICULTES RENCONTREES
· l'insuffisance d'une documentation appropriée
à notre recherche
0.9 SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hors mis l'introduction et la conclusion, notre travail
s'articule en quatre chapitres :
Le premier chapitre présente les considérations
théoriques ainsi que la revue sur les déchets hospitaliers.
Le deuxième chapitre présente le milieu
d'étude.
Le troisième chapitre porte sur l'enquête et ses
résultats.
Le quatrième chapitre se focalise sur le Projet/Cadre
logique
Chapitre I : LITTERATURE SUR LES DECHETS
HOSPITALIERS
1.1 DÉFINITIONS DES CONCEPTS
Déchets : On appelle
«déchet» toute substance que le propriétaire abandonne,
destiné à l'abandon ou se trouve dans l'obligation de se
débarrasser.
Un déchet est tout ce que le producteur ou le
détenteur élimine à l'intention d'éliminer ou est
tenu d'éliminer6(*).
Déchets d'activité de soins (D.A.S.) sont des
déchets issus d'activités de diagnostic de suivi et de traitement
préventifs ou curatifs dans le domaine de la médecine humaine ou
vétérinaire. Article R 44-1 du code de la santé publique
française (11). Les déchets d'activité de soins sont le
synonyme des déchets médicaux.
Cependant les déchets d'activités de soins ne
sont pas uniquement produits à l'hôpital, ils sont
également produits en ambulatoire (25). Au niveau de
l ;hôpital, ils sont appelés «hospitaliers» ou
«concentrés» et au niveau de l'ambulatoire ces déchets
sont dits «diffus» (25).
Les déchets hospitaliers représentent
«tous les déchets générés par le
fonctionnement d'un hôpital tant au niveau de ses services
d'hospitalisation et de soins qu'au niveau des services paramédicaux
administratifs et de ses dépendances» (3).
Les déchets hospitaliers peuvent être solides
et/ou liquides. Les déchets liquides concernent essentiellement les eaux
usées hospitalières, mais aussi les déchets. Chimiques
tels que les réactifs de laboratoires, les solvants, les produits de
fixation, les liquides de développement des films radiologiques
(fixateur et révélateur), le sang et dérivées
(16,24).
Infection : c'est un envahissement d'un
organisme par un agent étranger pathogène (bactérie,
virus, parasite) capable de s'y multiplier et ensemble des modifications
pathologiques qui peuvent en résulter7(*).
Infection nosocomiale : une infection
nosocomiale est une infection contractée par un malade
hospitalisé et qui n'était ni présent, ni en incubation
à l'entrée du malade.
Un délai de 48 heures est classiquement admis pour
affirmer le caractère nosocomial8(*).
Maladie : toute altération de
l'état de santé9(*).
Incinérer= Brûler : on incinère des
déchets hospitaliers contaminés pour tuer les germes qu'ils
contiennent et qui peuvent présenter des risques10(*).
Les définitions qui ont été
adoptés par cette loi 28-00 sont les suivantes :
1. Déchets : tout résidu
résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation,
production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une
manière générale, tout objet et matière
abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas
porter atteinte à la santé, à la salubrité et
à l'environnement ;
2. Déchets médicaux et
pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de
diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif
dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et
tous les déchets résultant des activités des
hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la
recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérant dans ces
domaines et de tous établissements similaires ;
3. Déchets dangereux : toutes
formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique
réactive, explosive, inflammable,
4. Déchets ménagers: tout
déchet issu des activités des ménages ;
5. Déchets assimilés aux déchets
ménagers : tout déchet provenant des
activités économiques commerciales ou artisanales et qui par leur
nature, leur composition et leurs caractéristiques sont similaires aux
déchets ménagers ;
6. gestion des déchets : toute
opération de pré collecte, de collecte, de stockage, de tri, de
transport, de mise en décharge de traitement, de valorisation, de
recyclage et d'élimination des déchets y compris le
contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de
décharge pendant la période de leur exploitation ou après
leur fermeture ;
7. Générateur des
déchets : toute opération physique ou morale dont
l'activité de production, de distribution ou d'exportation
génère des déchets ;
8. Traitement des déchets : toute
opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant
à un changement dans la nature ou la composition des déchets en
vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel
polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d'en
extraire la partie recyclable ;
9. Elimination des déchets :
toute opération d'incinération, de traitement, de mise
en décharge contrôlée ou tout procédé
similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets
conformément aux conditions assurant la prévention des risques
pour la santé de l'homme et de l'environnement.
1.2. CRITERE DE CLASSEMENT DES DECHETS DES UNITES DE
SOINS
Ils sont considérés comme déchets des
unités de soins tous les objets à jeter issus de
l'activité de traitement souillé ou pas, par des liquides
biologiques, ils sont aussi appelés les déchets médicaux
ou les déchets d'activité des soins.
Ils font l'objet d'un tri à la source, d'un emballage
résistant, d'un transport rapide par un transporteur agréé
et d'un destructeur conforme à la législation.
En général, le classement d'un type de
déchet sous la rubrique des déchets médicaux peut se faire
selon les critères différents :
- En fonction de la source des
déchets : tous les déchets issus de service
médical (chirurgie, obstétrique, laboratoire, gynécologie,
etc.) sont automatiquement considérés comme déchets
médicaux.
- En fonction de la filière
d'élimination des déchets : tous les déchets
domestiques sont tous incinérés, la définition des
déchets médicaux pourra être limitée n'incluant ni
les non tissus ni les produits périmés si les parties
anatomiques.
- En fonction du risque infectieux encouru par le
personnel : seul le matériel pointu tranchant et
contaminé présente un risque de blesser lors de son transport et
de sa manutention. Ils sont considérés comme déchets
à risques mécaniques.
- En fonction de raisons
psychologiques : des objets et des pansements souillés de
secrétions humaines, de petites pièces anatomiques (placenta, par
exemple) pourraient choquer le personnel de sa manutention. Ils sont
considérés comme déchets pathologiques11(*).
b) La classification internationale de l'OMS distingue
(19) :
1. Les déchets sans risque :
comparables aux ordures ménagères. Ils comprennent surtout des
déchets provenant du secteur hôtelier et administratif des
hôpitaux.
2. Les déchets très
infectieux : comprennent tous les déchets contenant de
fortes concentrations de microbes pathologiques, tels que les cultures
microbiennes, les cadavres d'animaux de laboratoire et d'autres déchets
pathologiques très infectieux.
3. Les déchets infectieux ni coupants ni
piquants : comprenant tous les autres déchets
pathologiques et atomiques, ainsi que les pansements, le sang et les
excréta des patients et tout déchet taché de sang ou
d'excréta humains.
4. Les déchets coupants ou
piquants : comprennent les seringues jetés, les scalpels
brisés et tout autre déchet piquant ou coupant.
5. Les déchets chimiques et
pharmaceutiques : comprennent les résidus de produits
pharmaceutiques et chimiques avec leurs emballages internes.
6. Les déchets spéciaux :
comprennent 5 sous catégories :
- Les déchets radioactifs
- Les résidus de produits cytotoxiques, avec leurs
emballages internes
- Les conteneurs usagés de gaz pressurisés
- Les déchets contenant de fortes concentrations de
métaux lourds toxiques (arsenic, mercure, plomb) tels que les piles
électriques usagés et les thermomètres brisés
- Les produits chimiques périmés.
Administration, cuisine
Services généraux
Déchets ménagers ou
assimilés
Services cliniques et
Services paramédicaux
Blocs opératoires et
Déchets médicaux et
Pharmacie
pharmaceutiques
Fig. Lieux de production des DSMP dans l'hôpital
Tableau n° 1 : Catégories des
déchets d'activités de soins
|
Catégories
|
Producteurs
|
|
Les déchets d'activités des soins des
établissements de santé
|
- Secteur hospitalier (hôpitaux, cliniques)
-Industries pharmaceutiques
-Etablissements de recherche et d'enseignement
|
|
Les déchets médicaux diffus
|
-Secteur professionnel en exercice, libéral
-Laboratoire d'analyse médicale
|
|
Les déchets des soins des ménages et des
personnes en automédication
|
-Toute personne, hors de l'intervention libéral ou d'un
établissement de santé
|
Tableau n° 2 : Classification des
déchets
|
a. Déchets solides
|
|
Sortes
|
Exemples
|
|
Déchets infectieux non tranchants
|
Gaz/bandages, déchets anatomiques, gants, pansements,
sachets de sang, matériel souillé de sang...
|
|
Déchets infectieux tranchants
|
Seringues, aiguilles, bistouris, lames, lancettes...
|
|
Déchets non infectieux
|
Papiers emballages, bouteilles, reste de nourritures, cartons,
épluchures
|
|
B. Déchets liquides
|
|
Eaux usées des installations sanitaires, eau de lavage
du sol, eau de cuisine, de cantine, des lavabos et de la buanderie.
|
1.3. PLAN NORMAL DE LA GESTION DES DECHETS
HOSPITALIERS
1.3.1. Importance de la gestion des déchets
hospitaliers
Les déchets hospitaliers non incinérés
sont nocifs. Le danger qu'ils présentent à la santé
publique est très important.
En effet, ces déchets proviennent des milieux hautement
contaminés et contiennent de nombreux micro-organismes qui peuvent
causer des infections plus ou moins graves aux personnes qui les manipulent et
polluent l'environnement.
Tous les germes qui affectent l'homme et le rend malade
peuvent se retrouver dans ces déchets. Le personnel médical qui
le manipule doit prendre certaines mesures de précaution pour limiter le
plus possible les infections.
A) Tri et collecte des déchets
médicaux
Le tri et collecte constituent une étape primordiale
dans la gestion des déchets.
La collecte a eu lieu au niveau de chaque service et de chaque
salle. Les agents responsables collectent des déchets produits à
ce niveau et les conditionnent dans des récipients qu'ils
présentent au lieu de ramassage lorsqu'il existe un service
d'hygiène hospitalière.
Les seringues, les aiguilles et les autres objets tranchants
contaminés doivent être immédiatement placés dans
une boite de sécurité.
Tous les déchets autres que les matériels
d'injection et autres objets tranchants piquants doivent être
placés dans des conteneurs appropriés colorés selon leur
catégorie comme le montre le tableau ci-dessous :
Tableau n° 3 : Tri et collecte des déchets
médicaux
|
catégories
|
Exemples
|
Couleur du conteneur
|
|
Déchets non infectieux
|
Papiers, emballages, bouteilles, reste de nourritures,
cartons, épluchures
|
NOIRE
|
|
Déchets infectieux non tranchants
|
Fluide du corps humains, déchets anatomiques, gants,
pansements, sang...
|
JAUNE
|
|
Déchets infectieux tranchants
|
Seringues/aiguilles, bistouris, lancettes, lames
|
Boite de sécurité
|
N.B : -Il est très important que
les prestataires et les travailleurs (manipulateurs des déchets)
s'entendent sur le système d'utilisation de conteneurs
colorés.
-Les déchets anatomiques et infectieux à haut
risque doivent être désinfectés à la source pour
réduire les risques pour le personnel et les patients avant d'être
emballés.
b) Stockage des déchets médicaux
Le stockage doit se faire dans de grands récipients
protégés contre les mouches et refroidis s'ils sont
entreposés pendant longtemps. Ces récipients devraient être
étanches aux liquides et mis à l'abri des animaux (rongeurs,
chiens) et des personnes non autorisées.
Les déchets qui sont séparés des autres
devraient être placés dans des sacs non réutilisables
étanches. A l'humidité, suspendus dans des supports
spéciaux ou utilisés comme enveloppes antérieures dans les
récipients en plastique ou en métal.
Des sacs robustes portant marquage coloré doivent
rester aux dommages intérieurs et extérieurs et ne devraient pas
être remplis au-delà d'un niveau permettant de fermer le sac et de
tenir étanche12(*).
c) Condition du lieu ou de regroupement des
déchets médicaux
Le stockage des déchets médicaux pendant
plusieurs jours avant leur destruction est à proscrire vu les risques
qu'ils comportent.
Cependant dans certains hôpitaux, l'incinération
ne peut être réalisée que tous les deux jours et les
déchets produits en quantité importante s'amoncellent.
Dans ce cas, il faut respecter les conditions
suivantes :
- Le stockage des déchets ne doit pas dépasser
trois jours au maximum ;
- Réserver le lieu de stockage à
proximité à cet effet ;
- Choisir le lieu de stockage à proximité de
l'incinérateur ;
- S'il s'agit d'un local fermé, celui-ci doit
être aéré et protéger d'un revêtement
facilement lavable ;
- S'il s'agit d'un conteneur situé dans une zone
à ciel ouvert, l'endroit choisi doit être ombragé, il faut
donc construire un abri et clôturer13(*).
d) Le transport des déchets médicaux
Le mouvement et transport des déchets médicaux
doivent être considérés comme s'intégrant dans un
système général de gestion.
Le transport des déchets contaminés peut exposer
l'agent aux maladies et aux blessures. Pour réduire les risques
causés par ces déchets durant le transport ou le stockage, les
dispositions suivantes doivent être respectées :
- Les déchets pouvant être détruits
localement, on les transporte dans une brouette vers le lieu de destruction. Le
manipulateur doit porter les habits de protection ;
- Pour les déchets pouvant être
transportés loin du site, si les moyens les permettent, un
véhicule doit être affecté pour cette fin. Ce
véhicule doit être nettoyé et désinfecté
à la fin de chaque journée. Pour cela, on doit prendre les
précautions suivantes :
· Empiler les récipients ou B.S et les sceller de
manière à les maintenir fermes ;
· Lorsqu'ils sont transportés dans et qu'elle
comporte des fuites, le véhicule devrait être
désinfecté avec une solution de javel (1%) avant de l'utiliser
à d'autres fins ;
· Ne pas permettre aux individus de s'asseoir sur les
récipients ou boite de sécurité.
1.3.2. Traitement et Gestion des déchets
hospitaliers
Malgré une stratégie en matière des
déchets prévoyant la diminution à la source, la diminution
des polluants dans les biens de consommation, la collecte sélective et
la valorisation, certains déchets ne peuvent être
évités ou recyclés.
L'objectif du traitement est de transformer les déchets
en produits susceptibles de retourner sans inconvénient dans le milieu
naturel ou de trouver une utilisation.
Donner une destination aux déchets constitue une voie
désormais essentielle pour leur élimination. Qu'il s'agisse des
déchets dangereux ou d'ordures ménagères, les mesures de
protection de l'environnement imposent, avant de les déverser dans les
décharges ou dans les cours d'eau, d'éliminer de tels
déchets au moyen des installations spéciales14(*).
1.3.3 Dispositifs de Gestion des déchets
médicaux
Il est, en effet, extrêmement important de trier les
déchets selon leur nature, pour faciliter leur élimination
correcte. Le type des déchets, l'environnement local, la technologie
disponible, les coûts et financements ainsi que le consensus social
(religion, coutumes, etc...) sont autant d'éléments qui
influencent sur le mode de traitement à adopter. C'est donc à
chaque établissement ou à chaque autorité sanitaire de
déterminer les paramètres locaux, et de décider quelles
sont les solutions appropriées. Il n'existe pas de méthode
idéale, qu'elle soit unique ou panachée.
Les dispositifs recommandés pour l'élimination
des déchets médicaux :
· Boîte de sécurité ;
· Ote aiguilles ;
· Fosse à aiguilles ;
· Fosse à aiguilles protégée
· Incinérateur ;
· Fosses à déchets séparées
protégées.
a. La boîte de sécurité
La boîte de sécurité, appelée aussi
conteneur pour objets tranchants/piquants est un récipient
résistant et impénétrable utilisé pour
l'élimination appropriée et sans risque des seringues et
aiguilles usagées et autres objets tranchants contaminés.
Utilisation de la boîte de
sécurité
· Une boîte de sécurité d'une
capacité de 1 litre peut contenir 20 seringues environ ;
· Une boîte de sécurité d'une
capacité de 5 litres peut contenir environ 80 seringues ;
· Une boîte de sécurité d'une
capacité de 10 litres peut contenir environ 200 seringues;
· Une boîte de sécurité doit
être remplie jusqu'au ¾ environ (jusqu'à l aligne
«maximum» `'Full'', lorsqu'elle est imprimée sur la
boîte). Ne mettez pas trop de seringues dans la boîte ;
· Une boîte de sécurité ne doit
servir qu'une seule fois et ensuite détruite immédiatement ou
bien entreposée dans des endroits sur pour être détruite
plus tard ;
· Une fois que la boîte est remplie, refermez le
couvercle et scellez la boîte pour éviter que les seringues ne se
répandent par terre ;
· Remplacez par une boîte vide.
b. L'ôte aiguilles
L'ôte aiguilles est un instrument destiné
à couper, de manière sure, l'aiguille de son embout ou de la
seringue si elle est sortie. On introduit l'aiguille et l'embout de la seringue
dans l'entonnoir de l'ôte aiguille, dont on actionne la
poignée.
L'aiguille tombe dans un petit conteneur. Quant à la
seringue, on la jette dans une boîte de sécurité.
Lorsque le conteneur d'aiguilles est plein, on le
sépare minutieusement de l'ôte aiguille pour le vider dans une
fosse à aiguilles protégée. Le conteneur doit être
désinfecté, nettoyé et réutilisé. Ce
dispositif ne doit être utilisé que lorsqu'on dispose d'une fosse
à aiguilles.
c La fosse à aiguilles
C'est une fosse dans laquelle les aiguilles sont jetées
après avoir été coupés des seringues avec ôte
aiguilles.
Cette fosse est dotée d'un orifice étroit (au
moins 10 cm de diamètre) fermé à cadenas. La fosse
à aiguille n'est utilisée lorsqu'on dispose d'ôtes
aiguilles, dans le cas contraire on utilise des boîtes de
sécurité seulement.
d. L'incinérateur
C'est un matériel conçu pour assurer la
destruction des déchets à haute température d'au moins
800°c. Les déchets combustibles sont réduits en résidus
incombustibles beaucoup moins volumineux et moins encombrants. Il existe
plusieurs types d'incinérateurs. L'incinérateur de Montfort
construit selon les normes, entretenu dans les règles peut fonctionner
conformément «aux pratiques optimales».
Il peut traiter les déchets infectieux et non
infectieux avec des retombées environnementales minimales.
L'incinérateur de Montfort détruit 6-7kg/h (ou 6
boîtes de sécurité par heures) s'il est correctement
utilisé.
N.B : L'incinérateur De Montfort
ne doit pas être utilisé pour détruire :
- les déchets contenants les thermomètres
cassés, les poches de perfusion, les sacs plastics en P.V.C, des flacons
en verres fermés, ou les ampoules ;
- les déchets humides.
e. Fosse à déchets
séparés
Les déchets médicaux sont collectés et
jetés dans une fosse (3 m au moins). La fosse n'est renfermée de
terre qu'une fois pleine.
Cette solution peut être utilisée dans les zones
rurales ou la nappe phréatique est profonde (plus de 1,50 m en dessous
de la base de la fosse) et où la quantité des déchets est
moins importante. Pour éviter la contamination de la nappe
phréatique, il est conseillé de bétonner le fond et les
parois. Cette fosse peut servir à l'élimination de déchets
anatomiques, la cendre...
1.4. DESTRUCTION DES DÉCHETS
Les dispositifs de destruction des déchets
médicaux ayant été décrits dans la partie
précédente, les principales méthodes de destruction, leurs
avantages et leurs inconvénients sont présentés dans le
tableau ci-dessous :
Tableau n° 4: Destruction des
déchets
|
Methods
|
Avantages
|
Inconvénients
|
|
Incineration
|
-Construit sur place ou importé
-Destruction complète et efficace des déchets
médicaux
-Répond aux normes hospitalières
-Retombées environnementales minimales
|
-place de coût $ 1000 à 10.000
-Nécessite de transport, formation/supervision
-Nécessité du carburant ou du bois au
préchauffage
-Nécessite le matériel réfractaire
-Nécessite le tri des déchets à
incinérer
|
|
Combinaison dans un tonneau ou foyer métallique
couvert
|
-Matériel disponible localement
-Faible coût
|
-Supervision nécessaire pour une utilisation
correcte
-Danger de laves de plastique
-Inefficace en saison pluvieuse
-Destruction incomplète des aiguilles
|
|
Fosses à déchets séparés
|
-pas besoin d'équipement supplémentaire
-pas besoin de combustible
-pas de fumée
-faible coût
|
-Fosse peut être remplie rapidement
-Sol parfois très dur
-Seringues se dégradent très lentement
-Danger de contamination des nappes phréatiques
-Danger de récupération des seringues par
déterrement
|
|
Fosses à aiguille protégée
|
-Peut être disponible localement
-pas de besoin de matériels sophistiqué
-Peut servir très longtemps
-Pas de retombées environnementales
|
-Sert uniquement à l'élimination des objets
tranchants piquants
|
1.5. LES DANGERS ET SITUATION À RISQUE
LIÉS À LA MAUVAISE GESTION DES DÉCHETS
Selon l'OMS, la santé étant définie comme
un état complet du bien être, la qualité de cet état
dépend du rapport entre l'homme et l'environnement. La santé
individuelle et tous devient un thermomètre, un indicateur de la
qualité de l'environnement.
En ce qui concerne le risque d'infection et de dommage,
résultant de la gestion des déchets médicaux, les
études montrent que l'abandon de ces déchets permettra à
l'hôpital d'attirer les animaux errants et les insectes qui sont souvent
à cheval entre les foyers de pollution, les établissements
humains, et les installations hospitalières transformant ainsi
l'hôpital en un milieu infectieux. Cela entraîne des
conséquences diverses sur la morbidité et la moralité de
la population.
a) L'agression visuelle et psychologique
C'est l'une des premières nuisances aux déchets
hospitaliers. Les professionnels de la santé qui ont banalisé les
images de leur monde médical, doivent comprendre la répulsion ou
le dégoût des personnes étrangères pour ces rebuts.
La vision des déchets est le premier signe visible partout d'une
hygiène déficiente.
b) Les risques mécaniques
Ils sont intimement liés aux objets piquants et
coupants spontanément ou à cause de bris. Leur présence au
sein de dispositif de collecte peut mettre en jeu la sécurité du
personnel de manutention et de traitement.
c) Les risques toxiques et chimiques
Ils sont souvent liés, les substances toxiques ont une
interaction plus ou moins réversible avec les constituants, vitaux des
cellules, et les substances corrosives détruisant immédiatement
les tissus, les produits chimiques doivent être
répertoriés, leur emploi précis et leur élimination
doivent être réglementés.
d) Les risques infectieux ou biologiques
Les déchets d'activités de soins à
risques infectieux présentent des risques difficiles à
évaluer précisément les raisons qui font les
déchets des vecteurs de risques infectieux reposent sur le fait
qu'à l'hôpital les germes qui circulent sont plus virulents et
souvent plus résistants aux antibiotiques, aux désinfectants et
aux agents physiques.
e) Les accidents d'exposition au sang et aux liquides
biologiques
La majorité des piqûres survient une fois le
geste effectué, lors de l'élimination du matériel
souillé. La présence d'objets piquants non protégés
traînant sur un plateau, dans les poubelles, sur un champ voire sur
un lit compte pour un tiers d'accidents d'exposition au sang (AES).
Le personnel infirmier est le plus touché par les AES,
mais tous les acteurs de la chaîne d'élimination des
déchets sont concernés.
f) Les infections nosocomiales
Le rôle du manu portage est mis en avant dans toutes les
études et l'on peut dire que 80% à 95% des infections sont
transmises par la main. Là encore, tous les acteurs de soins ou
d'environnement du malade sont impliqués et le déchet
contaminé peut être l'un des facteurs important de la chaîne
de transmission15(*).
1.6. DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS
En vue de parvenir à cette amélioration dans la
gestion des déchets bio-médicaux, aux Etats-Unis, il
s'avère important d'établir au préalable et de
façon scientifique une définition des termes
« déchets bio-médicaux », de leurs composants
ainsi que des buts visés par leur gestion. Si l'objectif premier de la
« gestion » des déchets générés
par les unités médicales est d'éviter une propagation
accidentelle de maladies, il faudrait alors reconnaître en tout premier
lieu qu'il y a seulement un petit pourcentage contaminé et susceptible
de transmettre des maladies.
a) METTRE TOUT D'ABORD L'ACCENT SUR LE TRI A LA SOURCE
Ce qui fait couramment en matière de gestion de
déchets dans beaucoup d'hôpitaux est de rassembler tous les
déchets (aussi bien ceux qui sont potentiellement infectieux que ceux
provenant des bureaux, les restes de nourritures, les débris de
construction ainsi que de dangereux déchets chimiques) de les collecter
et de les mettre au rebut.
La conséquence de cette politique est que les
déchets quittant les hôpitaux sont dans l'ensemble potentiellement
infectieux et potentiellement dangereux et chimiques.
Ainsi, plusieurs hôpitaux en Inde ont déjà
arrêté des programmes de tri, donnant ainsi sur le plan local des
exemples de ce qui est possible.
Si un tri adéquat est réalisé à
travers la formation, l'établissement de normes claires et une mise en
application stricte, alors les ressources pourraient être tournées
vers la gestion de la portion des déchets qui nécessitent un
traitement spécial. Le propos ici n'est pas de minimiser le besoin de
ressources à allouer pour contribuer au tri : la formation, l'usage
de conteneurs appropriés, les signes et les équipements de
protection pour les travailleurs, constituent les composants nécessaires
de ce processus qui permettra de s'assurer que le tri est effectif et q'il est
maintenu.
b) LA SECURITE DU PERSONNEL A TRAVERS L'EDUCATION ,LA
FORMATION ET LES EQUIPEMENTS
Les travailleurs, qui manipulent des déchets chimiques.
Il faut donc q'une éducation et une formation appropriée soient
offertes à tous les travailleurs : des docteurs aux garçons
de salle, aux manoeuvres et aux chiffonniers, pour assurer une
compréhension des risques que posent les déchets et savoir
comment se protéger et gérer ces déchets (plus
particulièrement comment procéder à un tri à la
source appropriée). Des programmes d'éducation et de formation
doivent être élaborés. Ces programmes doivent pouvoir
cibler chacune des populations identifiées de manière à
satisfaire aux besoins, de manière à construire une
compréhension et un changement de comportement.
c) ASSURER UNE COLLECTE ET UN TRANSPORT SUR
Si l'on veut tirer les avantages du tri à la source, il
faudrait des systèmes sûrs internes et externes de collecte et de
transport des déchets. Si les déchets triés sur place
doivent être mélangés par les travailleurs au moment de
leur collecte, ou si un hôpital se donne beaucoup de mal pour
séparer ces déchets et qu'au niveau de la décharge
municipale, on les mélange de nouveau, le problème demeure. Les
travailleurs quant à eux sont protégés mais le mal
causé à l'environnement et qu public est toujours le même.
Il faudrait aussi que les inquiétudes des administrateurs des
hôpitaux et des officiels municipaux quant à la
réutilisation des appareils médicaux, conteneurs et autres
équipements, soient prises en compte dans tout projet de gestion des
déchets. Il suffit pour vérifier le bien fondé de ces
inquiétudes de parcourir les rues pour constater que des gants en latex
ou de cidex usagé ( un désinfectant considéré aux
USA comme pesticide), des récipients servant à retenir de l'eau
pour faire du thé, sont revendus. Alors seulement on comprendra le
risque que présentent les décharges peu sûres. Il faut
signaler aussi la pratique qui consiste à nettoyer et revendre
seringues, aiguilles, ampoules et flacons.
d)RETRAITER LES STOCKS A TRAVERS LES FORMATION ET LES
EQUIPEMENTS
La science du retraitement de l'équipement et des
matériels pour une réutilisation dans les unités
médicales est assez bien implantée dans des pays tels que l'Inde
et mérite d'être appuyée. Les associations de
professionnels de soins de santé doivent être encouragées
à soutenir fermement une réutilisation judicieuse des
matériels. Elles doivent aussi commencer à arrêter des
normes pour le retraitement. Le maintien de cet effort à
l'intérieur des hôpitaux donnera des produits de qualité et
découragera l'achat d'objets jetables.
Les produits à usage unique sont chers, ils augmentent
la production de déchets et ne contribuent pas nécessairement
à une diminution des taux d'infection dans les hôpitaux.
e) INVESTIR POUR UN TRAITEMENT EN MATIERE DE DECHETS
MEDICAUX ET DE TECHNOLOGIES DE DECHARGES
L'incinération en masse des déchets hospitaliers
ne réduira pas les risques encourus par les travailleurs. Au contraire,
la menace pour la santé publique est plus grande avec la présence
dans l'air de mercure et d'autres métaux lourds, ou encore de dioxines
et furanes provenant de la combustion de plastiques, tels que le PVC, de plus
en plus utilisés dans l'empaquetage médical.
D'autres techniques de traitement des déchets, comme
l'autoclave, les micro-ondes et la désinfection chimique,
présentent moins de risques pour le traitement des déchets.
Le choix des technologies de traitement doit être fait
en ayant une bonne connaissance du flux de déchets à gérer
et l'objectif visé à travers le traitement. Si la technologie
doit être écologiquement sûre, alors le flux des
déchets doit être traité (désinfecté) sans
générer des sous-produits dangereux. L'incinération peut
être considérée comme une technologie qui donne dans
« l'exagération ».
Des normes nationales en matière de technologies de
traitement doivent être arrêtées et il n'y a aucune raison
pour qu'un pays ait des normes moins rigoureuses que celles en vigueurs aux USA
ou en Europe.
1.7. DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
a) Au Maroc
Dans le cadre du programme national de lutte contre les
IST/SIDA, le ministère de la santé a élaboré un
guide de gestion des déchets piquants et tranchants en milieu de soins.
Son objectif principal est de contribuer à la réduction du risque
de la transmission du VIH et des hépatites virales B et C, aux niveaux
de toutes les formations sanitaires.
1. La transmission des micro-organismes à partir des
déchets se fait soit :
· Directement par le manu portage ou par projection
à partir des produits contaminés
· Indirectement à travers un matériel
souillé entraînant des blessures et piqûres ou à
travers le milieu extérieur (eau, air sol, aliments)
· Existence d'un réservoir (patient, porteur sain,
déchets, animaux tels des chats ou rats)
b. Prévention de la transmission d'agents
infectieux par des objets piquants et tranchants
La prévention repose sur le respect des
précautions«standards »,qui sont destinées à
limiter tout contact avec le sang et les autres liquides biologiques.
Les règles de prévention passent essentiellement
par :
· le port de gants : il contribue de façon
efficace à la prévention de la transmission des germes en cas
d'un AES ,il retient 30 à 60% du volume sanguine contenu dans
l'aiguille,
· le lavage des mais :il doit se faire avant et
après tout acte exposant au sang ou à un liquide biologique,
même en cas de port de gant,
· la vaccination de personnel soignant contre
l'hépatite B,
· L'organisation de la gestion des déchets
à l'intérieur de l'hôpital,
· La sensibilisation du personnel soignant à
l'importance hygiénique d'une bonne gestion des déchets
médicaux,
· L'organisation des actions de formation et recyclage
des professionnels de santé.
Par ailleurs, la gestion correcte des déchets piquants
et tranchants permet d'éviter le risque de blessures infectantes ;
les DPT doivent être :
· Triés au niveau de leur production,
· Ramasser dans des récipients rigides, de forme
et de couleur spécifique,
· Stockés dans un endroit clos
réservé à cet effet,
· Traités correctement par un
procédé valable à savoir : incinération,
stérilisation
Ou encapsulation16(*)
a) Au Sénégal
Pour améliorer la salubrité de l'environnement
hospitalier au bénéfice des populations, une étude sur la
gestion des déchets biomédicaux a été menée
au centre hospitalier régional (CHR) de Ziguinchor du 1er au
15 mars 2000.au niveau du CHR ,l'incinérateur a cessé de
fonctionner depuis 1993.
Les problèmes de gestion des DBM ont été
observés à tous les niveaux. Pendant la phase de collecte, il n'y
a pas d'identification ni de tri. Les poubelles sont exposées un peu
partout. Les manoeuvres, à défaut de porter les poubelles sur
le dos ou la tête, utilisent une table roulante .les déchets
aboutissent dans une crevasse peu profonde à ciel ouvert où ils
sont périodiquement brûlés. La collecte, le stockage et le
transport se font sans aucun moyen de protection (gants, bottes, masques,
tabliers, etc).
Les déterminants essentiels de cette mauvaise gestion
seraient l'insuffisance de moyen financiers, et de formation des agents
chargés du nettoiement, l'inconscience du personnel, et l'utilisation de
pratiques non standardisées, par manque de programme.
Désormais, la gestion des DBM au CHR de Ziguinchor doit
être correcte.
L'enfouissement sanitaire a été choisi comme
méthode d'élimination des DBM dans
Le contexte actuel du CHR. un programme annuel a
été proposé dans ce sens.
Les stratégies d'approche sont la formation et
l'information,la motivation,l'équipement,la supervision et
l'évaluation. L'exécution de ce programme requiert un budget de
5432454 francs CFA répartis entre la formation (22%)
l'équipement, (40%), la construction de la fosse et le suivi (38%). Les
tâches sont réparties entre un médecin de santé
publique, les responsables d'unités de soins, et les agents
préposés au nettoiement.
Le suivi se fera essentiellement par trois supervisions
trimestrielles au troisième sixième et neuvième mois et
par une évaluation à la fin du programme, l'impact sera
apprécié par la disparition des dépôts sauvages
grâce à l'élimination effective de tous
Les DBM dans la fosse d'enfouissement sanitaire du CHR de
Ziguinchor.17(*)
Chapitre. II : PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE
II.1. BRÈVE PRÉSENTATION DE
L'HÔPITAL DISTRICT DE MUSANZE
1.2.1. SITUATION
GEOGRAPHIQUE.
L'Hôpital de district de Ruhengeri est situe dans la
ville de Ruhengeri/Musanze, Province du Nord, District de Musanze, Secteur
Muhoza ; sur la route principale KIGALI-RUHENGERI-GISENYI
(KIGALI-MUSANZE-RUBAVU),
Il est facilement repérable à cause de son type
pavillonnaire et Nature
Il est limite :
· A l'Est par : National Policy Academy
· A l'Ouest par: Prison Central de Ruhengeri.
· Au Nord par : Ancien Région sanitaire de
Ruhengeri
· Au Sud par : SOPYRWA.
1.2.2. APERCU HISTORIQUE
L'hôpital de référence de Ruhengeri fut
construit en 1939 pendant la période coloniale. Il démarra ses
activités comme un dispensaire public pour le peu d'habitants et
quelques résidents coloniaux ; de 1939 à
l'indépendance (1962), il connut une évolution qui l'amena au
statut d'un hôpital public géré par le Gouvernement
Rwandais jusqu'en 1964. Dans le cadre des accords signés en 1964 entre
le gouvernement Rwandais et la coopération française, la gestion
et le fonctionnement de l'établissement ont été
confiés à cette dernière. Elle prenait en charge une bonne
partie du personnel, les équipements ainsi que les extensions
indispensables au développement d'un hôpital de
référence nationale. C'est ainsi que dans les années 1980,
l'hôpital de Ruhengeri fut reconnu comme hôpital de
référence nationale, en 3ème rang après le Centre
Hospitalier de Kigali et l'hôpital Universitaire de Butare, grâce
aux travaux de réorganisation, de réaménagement et
d'extension réalisés par la coopération
française.
Durant la tragédie du génocide, L'hôpital
de ruhengeri comme les autres institutions du pays, n'a pas été
épargné : les infrastructures ont été
détruites, le matériel et équipements ont
été pillés sans oublier les pertes en ressources
humaines.
Les coopérants expatriés ont tous quittés
le pays et très peu d'entre eux sont revenus épauler leurs
collègues rwandais après 1994. En Juin 1996, le ministère
de la santé a repris la relève ; bénéficiant
de l'appui d'une ONG « MSF Hollande ». L'OPHAR et d'autres
partenaires comme Save the Children, Caritas, ect... qui fournissaient les
produits pharmaceutiques à l'hôpital de Ruhengeri.
En Janvier 1997, la coopération française a
repris ses activités surtout dans le service de Chirurgie avec
l'arrivée du chirurgien Dr Tol YIN, qui a persévéré
à appuyer l'hôpital même durant la période
d'insécurité qui prévalait dans la région de 1997
à 1998. Depuis lors, la coopération française a
réalisé certaines réhabilitations d'urgence
nécessaires à la bonne marche des activités et tous les
services du paquet complémentaire d'activités fonctionnaient
à part celui d'ophtalmologie faute des spécialistes.
Signalons aussi que Médecins Sans Frontières
Belgique a appuyé les services de maternité et de gynéco
obstétrique de 2004 jusque fin 2006.
Notons que depuis 1994, l'hôpital de Ruhengeri a perdu
théoriquement son rang d'hôpital de référence
nationale pour être classé comme hôpital de district devant
couvrir la ville de Ruhengeri, les districts de Bugarura, Kinigi et Mutobo,
mais cela ne l'a pas empêché de continuer à recevoir les
transferts des hôpitaux de Shyira, Kabaya, Gisenyi, Nemba ainsi que
ceux des centres de santé du district sanitaire de Gitare qui ne
disposait pas d'hôpital.
1.2.3. SERVICES ET ORGANES
L'Hôpital de Ruhengeri est le seul hôpital de
district que compte le District de Musanze.
La capacité d'accueil actuelle est de 409 lits
dont :
· 23 lits dans les 2 cliniques (chirurgie et
médecine interne),
· 97 en chirurgie,
· 75 en pédiatrie et nutrition,
· 79 en médecine interne,
· 91 en gynéco obstétrique,
· 20 en soins intensifs post opératoire,
· 18 au service de santé mentale et 6 aux
urgences.
Soucieux d'accomplir la mission lui assignée,
l'hôpital de Ruhengeri a renforcé au cours de l'année 2007
des actions s'articulant dans un réseau de services curatifs :
· Consultation curative de référence,
· Hospitalisations,
· Prise en charge des maladies chroniques,
· Prise en charge chirurgicale,
· Prises en charge des accouchements eutociques et
dystociques,
· Prises en charge des malnutritions
sévères,
· Prises en charge psychosociales,
· Prises en charges des PVVIHs et
· Réadaptations fonctionnelles.
Dans ce cadre, l'hôpital de Ruhengeri a concentré
ses efforts dans les activités pouvant améliorer la
qualité des services. Il s'agit notamment :
· Accorder un intérêt particulier aux soins
de qualité et y apporter un appui concret,
· Mettre à la disposition de la population des
médicaments essentiels de qualité en quantité
suffisante.
· Equiper les services en matériel et
équipement de base approprié ;
· Renforcer et privilégier les activités
ayant trait à la santé de la mère et de l'enfant ;
· Renforcer le service de prise en charge aux ARVs des
adultes et pédiatriques ;
· Réhabiliter et faire l'extension des
bâtiments afin de les rendre plus pratiques et renforcer la
capacité d'accueil des services
· Améliorer le système de rapportage et de
gestion de l'information sanitaire
· Inviter les médecins spécialistes pour
certaines opérations nécessitant une haute expertise
· Faire le plaidoyer pour payer la motivation du
personnel
· Assurer un encadrement régulier des centres de
santé de sa zone de rayonnement
· Assurer le perfectionnement du personnel à
travers les formations dans différents domaines
· Améliorer l'hygiène et le jardin de
l'hôpital
· Mettre en place des outils de gestion et
d'évaluation tant sur le niveau de service que sur le plan individuel
1.2.4 Situation démographique
Caractère démographique de la zone de
rayonnement de l'Hopital de Ruhengeri par zone de rayonnement en janvier
2009.
Tableau n° 5 : Base des données de la
population de la zone de rayonnement de l'hôpital de Ruhengeri.
|
N°
|
Zone de rayonnement
|
Population 2009
|
|
1
|
MUHOZA
|
78050
|
|
2
|
KARWASA
|
27720
|
|
3
|
GASIZA
|
22951
|
|
4
|
BISATE
|
20260
|
|
5
|
KINIGI
|
37251
|
|
6
|
SHINGIRO
|
34574
|
|
7
|
BUSOGO
|
38889
|
|
8
|
KABERE
|
16184
|
|
9
|
NYAKINAMA
|
40241
|
|
10
|
MURANDI
|
19030
|
|
11
|
RWAZA
|
21063
|
|
12
|
GASHAKI
|
18248
|
|
Total
|
374.471Habitats
|
Source ; HOPITAL Ruhengeri ;Statisticien 2010.
Dont :
· CS : 12
· PS : 3
· Nombre des animateurs de sante communautaire
actifs : 1772 dont 4 par village ( soit 443villages)
De part ces chiffres, la population du district de Musanze ne
fait que croitre car elle est victime d'un exode rural incontrôlé
des populations venant des territoires de Kigali, Kibungo, Byumba, etc.
II.5. RESSOURCES HUMAINES
Tableau n° 6 : Base des données du personnel
des fosas du district de Musanze.
|
N°
|
Zone de rayonnement
|
Population 2009
|
|
1
|
MUHOZA
|
37
|
|
2
|
KARWASA
|
18
|
|
3
|
GASIZA
|
29
|
|
4
|
BISATE
|
22
|
|
5
|
KINIGI
|
31
|
|
6
|
SHINGIRO
|
30
|
|
7
|
BUSOGO
|
35
|
|
8
|
KABERE
|
18
|
|
9
|
NYAKINAMA
|
32
|
|
10
|
MURANDI
|
26
|
|
11
|
RWAZA
|
31
|
|
12
|
GASHAKI
|
12
|
|
13
|
Hôpital Ruhengeri
|
186
|
|
Total
|
507
|
Dont :
· Ce qui donne 16,3% des personnel de soutien et 83,7%
des personnels soignant, ce qui montre le taux d'infirmier à 113,2%
soit 883Habitats/infirmier.
II.9. INFRASTRUCTURES DE BASE
· Hôpital de district avec tous les services
disponibles
· Centre de santé en bon état 12/12 soit
100%
II.10. ORGANIGRAMME DE L'HOPITAL
Conseil d'Administration
Comité de gestion
Directeur de l'hôpital
Administrateur Gestionnaire
Secrétariat et Archivage
Chef de Nursing
Médecin Chef de Staff
Pharmacien
Inf Responsables de service
Infirmiers de service
Médecins Chef de service
Médecins de service
Responsable de la pharmacie
Préposé (e) à la pharmacie
Responsable de Nutrition
Chargé de l'Admin du Personnel
Statisticien
Resp sce Social
Le Comptable
Chargé des Approvisionnements
Opérateur de saisie
Assistant Sociales
Caiisier princil
Charge de recouvrement
Caissiers
Ch. de facturation
Accueil, com et relations Publiques
Ch Hygiène
Maintenance et Equ, +Charroi
Superviseur point focal
Gestionnaire de la Chaine du froid et Vaccins
Conseil d'Administration
Comité de gestion
Directeur de l'hôpital
Administrateur Gestionnaire
Secrétariat et Archivage
Chef de Nursing
Médecin Chef de Staff
Pharmacien
Inf Responsables de service
Infirmiers de service
Médecins Chef de service
Médecins de service
Responsable de la pharmacie
Préposé (e) à la pharmacie
Responsable de Nutrition
Chargé de l'Admin du Personnel
Statisticien
Resp sce Social
Le Comptable
Chargé des Approvisionnements
Opérateur de saisie
Assistant Sociales
Caiisier princil
Charge de recouvrement
Caissiers
Ch. de facturation
Accueil, com et relations Publiques
Ch Hygiène
Maintenance et Equ, +Charroi

CHAPITRE III. PRESENTATIONS, ANALYSE DES DONNEES ET
INTERPRETATION DES RESULTATS
III.1. PRESENTATIONS ET ANALYSE DES DONNEES.
Tableau n° 5 : Répartition des
enquêtés selon la tranche d'âge
|
Tranche d'âge
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
> 30 ans
|
24
|
43.6
|
|
30-39 ans
|
12
|
21.8
|
|
40-49 ans
|
14
|
25.5
|
|
< 50 ans
|
5
|
9.1
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 1
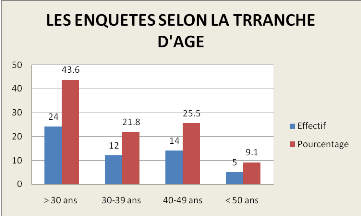
Au regard de ce tableau no 5 et graphique
no 1, les résultats montrent que 43,6% de nos
enquêtés se retrouvent dans les tranches d'âge inferieur a
30 ans.
Tableau n° 6 : Répartition des
enquêtés selon le sexe
|
N°
|
Sexe
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Masculin
|
19
|
35
|
|
2
|
Féminin
|
36
|
65
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 2
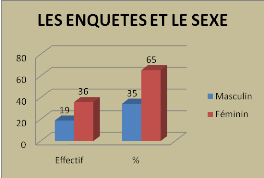
Source : notre enquête
Notre tableau no6 et graphique no2,
montre le personnel interviewé du genre féminin est de 65%, alors
que le genre masculin est de 35%.
Tableau n° 7 : Réponse en rapport
avec l'Etat Civil du répondant
|
N°
|
Etat-Civil
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Marié(e)
|
33
|
60
|
|
2
|
Célibataire
|
8
|
15
|
|
3
|
Divorce(e)
|
4
|
7
|
|
4
|
Séparé(e)
|
5
|
9
|
|
5
|
Veuf(e)
|
5
|
9
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : Notre enquête.
Graphique no 3

Source : notre enquête.
Ce tableau no7 et graphique no3 stipule
que 60% des répondants sont des mariés.
Tableau n° 8 : Répartition selon le niveau
d'étude
|
Niveau d'étude
|
Domaine
|
Effectif
|
%
|
|
Primaire
|
Médical
|
0
|
0.0
|
|
Non médical
|
12
|
21.8
|
|
Secondaire
|
Médical
|
15
|
27.3
|
|
Non médical
|
18
|
32.7
|
|
Universitaire
|
Médical
|
4
|
7.3
|
|
Non médical
|
6
|
10.9
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no4

Les résultats de notre tableau no8 et
graphique no 4 montre que :
· 32,7% des enquêtés ont fait les
études secondaires, carrière non médicale, ils ont fait la
normale primaire et comptabilité ;
· 27,3% des enquêtés ont fait les
études secondaires, carrière médicale, option des soins
infirmiers, anesthésie et physiothérapie ;
· 21,8% des enquêtés ont fait des
études primaires non médical
Tableau n° 9 : Répartition des
enquêtés selon leur affectation au service
|
Service
|
Effectif
|
%
|
|
Pédiatrie
|
3
|
5.5
|
|
Médecine interne
|
9
|
16.4
|
|
Urgence
|
3
|
5.5
|
|
Maternité
|
4
|
7.3
|
|
Laboratoire
|
4
|
7.3
|
|
Bloc opératoire
|
4
|
7.3
|
|
Dentisterie
|
3
|
5.5
|
|
Physiothérapie
|
2
|
3.6
|
|
Radiologie
|
2
|
3.6
|
|
Pharmacie
|
2
|
3.6
|
|
Consultation de référence
|
4
|
7.3
|
|
HARVEST
|
15
|
27.3
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 5

Source :notre enquête
A la lumière de ce tableau no 9 et graphique
no5, nous constatons que notre échantillon est reparti dans
12 services et le service Harvest vient au premier rang avec 27,3% contre 16,4
% pour la médecine interne.
Tableau n° 10 : Réponse en rapport
avec l'ancienneté au poste du répondant
|
N°
|
Ancienneté au Poste
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
1an - 4 ans
|
4
|
7
|
|
2
|
5 ans - 9 ans
|
27
|
49
|
|
3
|
10 ans - 14 ans
|
14
|
25
|
|
4
|
15 ans et plus
|
10
|
18
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête.
Graphique no 6
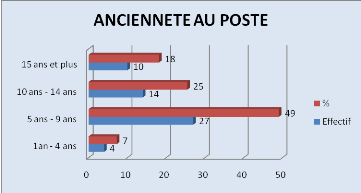
Source : notre enquête.
Le tableau no 10 et graphique no6
montre que 49% des personnes enquêtées ont une ancienneté
au poste de 5ans à 9 ans et 25% de 10 ans à 14 ans.
Tableau n° 11. REPONSE EN RAPPORT AVEC LA
SIGNIFICATION DES DECHETS
|
N°
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Saleté
|
21
|
38
|
|
2
|
Résidu qu'on ne peut plus utiliser
|
2
|
4
|
|
3
|
Objet que l'on pourrait jeter
|
12
|
22
|
|
4
|
Objet inutile et sans valeur
|
20
|
36
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête.
Graphique no7

Source : Notre enquêté.
Ce tableau no11 et graphique no7
stipule que, 21 enquêtés savent que le déchet c'est une
saleté soit 38% et 20 cas soit 36% savent que c'est l'objet
intitulé et sans valeur.
Tableau n° 12 : Réponse de la question
relative au matériel de collecte utilisé
|
No
|
Matériel
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Poubelle en inox en métal ou plastique couvert
|
102
|
50.2
|
|
2
|
Poubelle en métal inox, ou en plastique non couvert
|
78
|
38.4
|
|
3
|
Carton vide
|
23
|
11.3
|
|
4
|
Boîte de sécurité
|
45
|
22.2
|
|
Total
|
203
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique No8

Quant au tableau no9 et graphique no
8 :
· 41,1% des enquêtés utilisent la
boîte de sécurité lors de l collecte des
déchets ;
· 31,5% des enquêtés utilisent les poubelles
en métal inox ou en plastique sans couvercle ;
· 18,1% des enquêtés utilisent les poubelles
en métal ou en plastique couvert
Tableau n° 13 : Disponibilité des
poubelles dans les services
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Oui
|
85
|
64.4
|
|
2
|
Non
|
47
|
35.6
|
|
Total
|
132
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 9

Le tableau 13 et graphique 9 indique que :
- les poubelles sont installées dans les services
à 64,4% ceci qui explique l'absence des poubelles dans les services.
Tableau n° 14 : Résultats de la question
relative à la sélection des déchets avant la
destruction
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Oui
|
36
|
65.5
|
|
2
|
Non
|
19
|
34.5
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no10

Source :notre enquête
Au regard du tableau 14 et graphique no10
ci-dessus, les résultats montrent que 65,5% des enquêtés
font la collecte sélective, alors que 34,5% ne la font pas.
Tableau n° 15 : Résultats de la question
relative aux matériaux utilisé pour le triage
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Boite de securite de couleurs différentes
|
18
|
32.7
|
|
2
|
Récipients de type différents
|
21
|
38.2
|
|
4
|
Récipients de grandeurs différentes
|
16
|
29.1
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 11
 source:notre enquete
source:notre enquete
Les résultats de notre tableau no 15 et
graphique no 11 montre que :
- 38,2% utilisés les récipients de type
différents pour le triage des déchets tandis que 32,1% des
enquêtés le font par les Boites de sécurité de
couleurs différentes.
Tableau n° 16 : Moyen de transport disponible
|
No
|
Moyen utilisé
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
1
|
Poubelles en couvercles
|
14
|
25.5
|
|
2
|
Poubelles sans couvercles
|
8
|
14.5
|
|
3
|
Brouettes
|
33
|
60.0
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 12
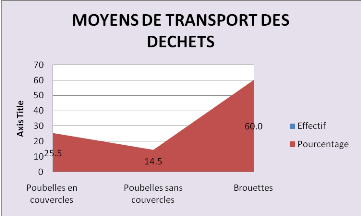
source : notre enquête
D'après le tableau et graphique ci-dessus, il ressort
que 60% des enquêtés transportent les déchets dans les
brouettes tandis que 25,5% utilisent les poubelles en couvercles
Tableau n° 17 : Résultats de la question
relative à la désinfection ou non du matériel après
son utilisation
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
1
|
Toujours désinfectés
|
9
|
16.4
|
|
2
|
Quelquefois désinfecté
|
31
|
56.4
|
|
3
|
Jamais
|
9
|
16.4
|
|
4
|
Sans réponse
|
6
|
10.9
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 13

Source : notre enquête
Au regard de ce tableau no 17 et graphique
no 13, il ressort que :
· 56,4% des enquêtés désinfectent
quelquefois les matériels ;
· 16,4% des enquêtés désinfectent
toujours les matériels ;
· 16,4% des enquêtés ne désinfectent
jamais les matériels ;
Tableau n° 18 : Réponse de la question
relative a la disposition des matériel de protection (gants, bottes,
uniformes) lors du travail
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Toujours
|
10
|
31
|
|
2
|
Quelquefois
|
43
|
59
|
|
3
|
Jamais
|
2
|
10
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 14
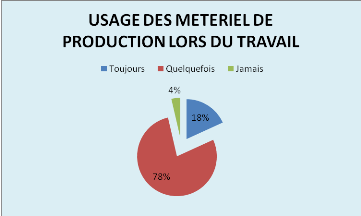
Source : notre enquête
Au regard de ce tableau no 18 et graphique
no14, nous remarquons que 78% des enquêtés portent
quelquefois les matériels de protection tandis que 18 % les portent
toujours.
Tableau n° 19 : Connaissance en rapport avec les
conditions du lieu de stockage
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
1
|
Oui
|
12
|
39
|
|
2
|
Non
|
29
|
41
|
|
3
|
Ne sait pas
|
14
|
20
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no15

Source : notre enquête.
De ce tableau no19 et graphique no 15
montre que :
· 41% des enquêtés affirment que le lieu de
stockage ne réunit pas les conditions et seulement 39% des
enquêtés disent que le lieu de stockage réunit les
conditions.
Tableau n° 20 : Résultats de la question
relative aux Moyens disponible de destruction des déchets
hospitaliers.
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
1
|
Four d'incinération
|
42
|
76.4
|
|
2
|
Fosse à déchets séparés
|
13
|
23.6
|
|
3
|
Compostage
|
0
|
0.0
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 16

Source : notre enquête
Au regard du tableau no 20 et graphique
no 16 ci-dessus, il ressort que le four d'incinération est le
plus utilisé pour la gestion des déchets avec 42 cas soit 76,4%,
tandis que la fosse et le compostage sont respectivement utilisés de
l'ordre de 21,8% et de 1,8%.
Tableau n°21 : Réponses des
enquêtés suivant le lieu de Gestion des résidus
d'incinération
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
1
|
fosse appropriée
|
6
|
10.9
|
|
2
|
fosse non appropriée
|
49
|
89.1
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 17

Source : notre enquête
Le tableau no 21 et graphique no 17
montre que le lieu de gestion des résidus d'incinération est
inappropriée avec 49 cas soit 83%.
Tableau n° 22 : Résultats de la question
relative aux déchets à incinérer
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
déchets ménagers
|
20
|
36.4
|
|
2
|
boîtes de sécurité
|
32
|
58.2
|
|
3
|
Flacon en verre
|
3
|
5.5
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 18

Source : notre enquête
D'après les résultats du tableau no
21 et graphique no 17, nous constatons que 58,2% des
enquêtés affirment que les boîtes de sécurité
sont à incinérer alors que les déchets ménagers
sont incinéré à 36,4%.
Tableau n° 22 : La mauvaise gestion des
déchets comme un problème de santé publique
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Oui
|
53
|
96.4
|
|
2
|
Non
|
2
|
3.6
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 18

Quant aux résultats du tableau no 22 et
graphique no 18 la mauvaise gestion des déchets constitue un
problème de santé publique avec 53cas soit à 96,4% des
enquêtés.
Tableau n° 23 : Résultats de la question
relative aux risques sanitaires de la mauvaise gestion des déchets
hospitaliers
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Mauvaise odeur
|
3
|
5.5
|
|
2
|
Proliférations des vecteurs
|
20
|
36.4
|
|
3
|
Infection nosocomiales
|
30
|
54.5
|
|
4
|
Piqûres
|
2
|
3.6
|
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no19

Au vu du tableau no 23 et graphique no
19, la mauvaise gestion des déchets hospitaliers constitue le
problème de sante publique par les infections nosocomiales avec 30cas
soit 54,1% contre la prolifération des vecteurs avec 20 cas soit
36,4%.
Tableau n° 24 : Participation à une
formation sur la gestion des déchets hospitaliers
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Oui
|
34
|
61.8
|
|
2
|
Non
|
21
|
38.2
|
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 20

Quant au tableau no 24 et graphique no
20 seulement 34 cas soit 61,8% des enquêtés ont pu participer
à une formation sur la gestion des déchets hospitaliers tandis
que 38,2% n'ont jamais participé à cette formation.
Tableau n° 25 : Résultat de la question
relative aux propositions émises pour palier le problème la
gestion des déchets dans l'hôpital.
|
No
|
Réponses
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
Formation
|
21
|
38.2
|
|
2
|
Equipements suffisants
|
31
|
56.4
|
|
3
|
Renforcer les services d''hygiène
|
2
|
3.6
|
|
4
|
Agents qualifies
|
1
|
1.8
|
|
|
Total
|
55
|
100
|
Source : notre enquête
Graphique no 21
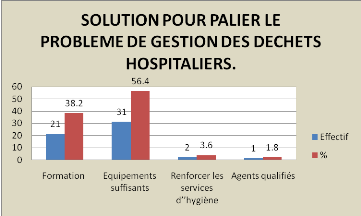
Source : notre enquête
Les résultats du tableau no 25 et graphique
no 21 nous montre que, pour résoudre le problème de
gestion des déchets hospitaliers au sein de cet hôpital :
· 56,4% des enquêtes c'est la disponibilité
des équipements suffisant.
· 38,2% des enquêtes ont une besoin en formation
sur la gestion des déchets hospitaliers.
III.II. INTERPRETATIONS DES RESULTATS
Au terme de ce chapitre, nous voulons confronter les
résultats obtenus à partir de nos enquêtes à ceux
d'autres auteurs.
3.2.1. REPARTITION DES ENQUETES SELON LA TRANCHE D'AGE
Au regard de ce tableau no 5 et graphique
no 1, les résultats montrent que 43,6% de nos
enquêtés se retrouvent dans les tranches d'âge inferieur a
30 ans.
Ce constant rejoint celui de Gentilini( 1993) dans son
étude menée sur le taux d'occupation selon les tranche
d'âge qui est chez l'adulte entre 15 et 49 ans et estime au alentours de
60%19
3.2.2. REPARTITION DES ENQUETES SELON LE SEXE
Notre tableau no6 et graphique no2,
montre le personnel interviewé du genre féminin est de 65%, alors
que le genre masculin est de 35%.
Signalons que d'après l'EDS du mai 2005 qu'actuellement
59% de la population Rwandaise sont des femmes, ce qui représente une
féminisation croissante du travail médicale 20
3.2.3. REPONSE EN RAPPORT AVEC L'ETAT CIVIL DU
REPONDANT
Le tableau no7 et graphique no3 stipule
que 60% des répondants sont des mariés.
Ce constant rejoint le résultat de Mlle Bernadette
FURAHA BALANGALIZA sur l'Etude de l'Impact socio-économique des micros
crédits octroyés aux PVVIH et OEV de la ville de Bukavu dans le
cadre du projet AMITIE CRS-USAID, qu'il y a une proportion dominante des
mariés soit 36,6% parmi les bénéficiaires
21
19 Gentilini, 1993, p431
20 EDS, 2005, P 867
21 Mlle Bernadette FURAHA BALANGALIZA, 2006, p58
3.2.4. REPARTITION SELON LE NIVEAU D'ETUDE
Les résultats de notre tableau no8 et
graphique no 4 montre que 32,7% des enquêtés ont
fait les études secondaires, carrière non médicale, ils
ont fait la normale primaire et comptabilité ; 27,3% des
enquêtés ont fait les études secondaires, carrière
médicale, option des soins infirmiers, anesthésie et
physiothérapie ; 21,8% des enquêtés ont fait des
études primaires non médical
Ces résultats corroborent avec ceux obtenus par KIZUNGU
MINTUOLI Fabien sur les facteurs contribuant à la prolifération
des déchets ménagers dans des rues et son impact sur la
santé de la population, dans le quartier Mabanga Sud en 2008, il avait
trouvé que sur 384 ménages enquêtés, les finalistes
des écoles secondaires ont été majoritaires avec un taux
de 54,7%.21
Il confirme ensuite en disant que la plupart était de
carrière médical come l'avait affirmé 125 soit 32,5%.
3.2.5. REPARTITION DES ENQUETES SELON LEUR AFFECTATION
AU SERVICE
A la lumière de ce tableau no 9 et graphique
no5, nous constatons que notre échantillon est reparti dans
12 services et le service de Harvest vient au premier rang avec 27,3% contre
16,4 % pour la médecine interne.
Ce constant rejoint celui de rapport sur l'évaluation
des activités mène par l'hôpital de Ruhengeri, que 25,2% du
personnel sont chargés de l'hygiène a partir de l'entreprise
harvest contre 31% de la médecine interne car ceci représente 30%
du taux d'occupation de l'hôpital22
21 KIZUNGU MINTUOLI, facteurs contribuant à
la prolifération des déchets ménagers dans les rues de la
ville de Goma et son impact sur la santé de la population
mémoire, 2ème licence santé publique, CIDEP
U.O/ Goma 2007-2008
22 Hôpital Ruhengeri, Evaluation des
activités 2008,p 123
3.2.6. REPONSE EN RAPPORT AVEC L'ANCIENNETE AU POSTE
DUREPONDANT
Le tableau no 10 et graphique no6 montre
que 49% des personnes enquêtées ont une ancienneté au poste
de 5ans à 9 ans et 25% de 10 ans à 14 ans.
Signalons que d'après Rwanda nurse midwife Council,
dans son rapport sur l'état des infirmiers et sage femme dans les
formations sanitaires que 61% des infirmiers ont une ancienneté de plus
de 5 ans dans le domaine médical 23
3.2.7. REPONSE EN RAPPORT AVEC LES CONNAISSANCES DES
DECHETS
HOSPITALIERS.
Ce tableau no11 et graphique no7
stipule que, 21 enquêtés savent que le déchet c'est une
saleté soit 38% et 20 cas soit 36% savent que c'est l'objet
intitulé et sans valeur.
Ce résultats coïncident ceux de Robert Nancy, dans
son étude sur la gestion des déchets d'activités de soins
que 50% des cas considère les déchets comme un résidu sans
valeur24
3.2.8. REPONSE DE LA QUESTION RELATIVE AU MATERIEL DE
COLLECTE UTILISE
Quant au tableau no9 et graphique no
8 ; 41,1% des enquêtés utilisent la boîte de
sécurité lors de la collecte des déchets ; 31,5% des
enquêtés utilisent les poubelles en métal inox ou en
plastique sans couvercle 18,1% des enquêtés utilisent les
poubelles en métal ou en plastique couvert.
D'après ESTRADA, Lors de la collecte des déchets
résultant d'activités de soins, des récipients
appropriés doivent être muni d'une ouverture adaptée,
être solide et étanche, avoir le volume adapté et
facilement lavable. Ces récipients doivent être munis d'une
couverture et d'une pédale, enfin de couleurs différentes selon
les types de déchets25.
23RNMC, Etude sur les infirmiers et sages femmes
dans les fosa, 2008, p432
24 Robert Nancy, Traité de gestion des
déchets d'activités de soins, Paris, 2000
25 ESTRADA, R.G., Gestion des résidus
hospitaliers, Espana principado d'Asturis, 1999,p 123
3.2.9. DISPONIBILITE DES POUBELLES DANS LES SERVICES
Le tableau 13 et graphique 9 indique que les poubelles
sont installées dans les services à 64,4% ceci qui explique
l'absence des poubelles dans les services responsable des maladies nosocomiales
et autres dangers.
La production de différents types des déchets
par différents services, exige la disponibilité des poubelles
correspondantes et les déchets d'activités de soins doivent
être classifiés afin de pouvoir limiter les risques infectieux et
les traumatismes qu'ils peuvent occasionner lors de leur
évacuation26.
3.2.10. RESULTATS DE LA QUESTION RELATIVE A LA SELECTION
DES DECHETS AVANT LA DESTRUCTION
Au regard du tableau 14 et graphique no10
ci-dessus, les résultats montrent que 65,5% des enquêtés
font la collecte sélective, alors que 34,5% ne la font pas.
Ce qui coïncide avec la théorie qui dit qu'il faut
disposer les deux poubelles de couleur différente ; dans l'un il
jettera les déchets non infectieux, dans l'autre les déchets
infectieux non tranchants, les infectieux tranchants se tiendront dans les
boites de sécurité.26
3.2.11. RESULTATS DE LA QUESTION RELATIVE AUX MATERIAUX
UTILISE POUR LE TRIAGE
Les résultats de notre tableau no 15 et
graphique no 11 montre que 38,2% utilisés les
récipients de type différents pour le triage des déchets
tandis que 32,1% des enquêtés le font par les Boites de
sécurité de couleurs différentes.
Ceux-ci coïncident avec la théorie disant qu'un
triage préalable des déchets doit être effectué au
niveau de chaque service producteur des déchets et pour cela chaque
service doit disposer ces poubelles différentes selon les déchets
produits27.
26RACHID BELKAHIA, Traitement des déchets de
soins de santé humaine, Bruxelles, 2000,p786
27 OMS, Promotion de l'assainissement,
Genève, 1998, p235
3.2.12. MOYEN DE TRANSPORT DISPONIBLE
D'après le tableau no 15 et graphique
no12 ci-dessus, il ressort que 60% des enquêtés
transportent les déchets dans les brouettes tandis que 25,5% utilisent
les poubelles en couvercles.
Ces résultats sont différents de la
théorie qui dit que le circuit choisi pour le transport des
déchets d'activité des soins devrait remplir les conditions
exigées ; ces déchets doivent être bien
emballés pour réduire les risques infectieux ; les
résultats aussi montrent que ces déchets hospitaliers ne sont
jamais transportés étant couverts soit à 59% et ils sont
quelquefois couverts soit à 26% de nos
enquêtés.28
3.2.13. RESULTATS DE LA QUESTION RELATIVE A LA DESINFECTION
OU NON DU MATERIEL APRES SON UTILISATION
Au regard du tableau no 17 et graphique
no 13, il ressort que 56,4% des enquêtés
désinfectent quelquefois les matériels ; 16,4% des
enquêtés désinfectent toujours les matériels ;
16,4% des enquêtés ne désinfectent jamais les
matériels.
Dès lors la désinfection appropriée du
matériel de collecte des déchets médicaux est toujours
nécessaire après sa vidange pour leur utilisation, aussi
«bien laver et désinfecter les poubelles a l'eau de javel a 0,5%
et rincer a l'eau après leur utilisation» est toujours l'une des
précautions a prendre pour une meilleure utilisation des
poubelles29
3.2.14. REPONSE DE LA QUESTION RELATIVE A LA DISPOSITION
DES MATERIEL DE PROTECTION (GANTS, BOTTES, UNIFORMES) LORS DU TRAVAIL
Au regard de ce tableau no 18 et graphique
no14, nous remarquons que 78% des enquêtés portent
quelquefois les matériels de protection tandis que 18 % les portent
toujours.
28 KARANGWA C.
Cours d'Hygiène et Assainissement, KHI, 2002
29 KAYIHURA Balthazar, Evacuation des
déchets médicaux des hôpitaux de Kinshasa, Kinshasa,
1997.
Ces résultats sont différents de la
théorie disant qu'il est recommandé à tout le personnel
manipulateur des déchets hospitaliers de porter les équipements
de protection pendant les processus de gestion des déchets hospitaliers
(collecte, transport et destruction/élimination finale).30
3.2.15. CONNAISSANCE EN RAPPORT AVEC LES CONDITIONS DU LIEU
DE STOCKAGE
Le tableau no19 et graphique no 15
montre que 41% des enquêtés affirment que le lieu de stockage
ne réunit pas les conditions et seulement 39% des enquêtés
disent que le lieu de stockage réunit les conditions.
D'après DESPORTES, les locaux utilisés pour le
stockage doit être protégés contre les risques de
dégradation, de vol, d'intempéries et d'incendies, être
correctement ventilés et éclairés. En outre, ces locaux
doivent être munis d'une arrivés d'eau avec dis connecteur et
d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux
usées, enfin ils doivent être protégés de la chaleur
et de la pénétration des animaux31
3.2.16 RESULTATS DE LA QUESTION RELATIVE AUX MOYENS
DISPONIBLE DE DESTRUCTION DES DECHETS HOSPITALIERS.
Au regard du tableau no 20 et graphique
no 16 ci-dessus, il ressort que le four d'incinération est le
plus utilisé pour la gestion des déchets avec 42 cas soit 76,4%,
tandis que la fosse et le compostage sont respectivement utilisés de
l'ordre de 21,8% et de 1,8%.
En 1997, KAMBAU a évalué les méthodes de
destruction des déchets médicaux dans les hôpitaux de
KINSHASA et a aboutit aux résultats ci-après : 72% des
hôpitaux recourraient à l'incinération artisanale souvent
aboutissant à la combustion incomplète des déchets, 44%
pratiquaient la décharge non contrôlée et 28%
procédaient à l'enfouissement32
30 DIDIER GABARDA, OLIVA, Aide au tri des
déchets d'activité de soins, Paris, 2000
31 DESPORTES V. et al, Hygiène dans les
institutions des soins de santé en situation précaire,
Bruxelles, 1996
32 KAMBAU, Les méthodes de gestion des
déchets médicaux des hôpitaux de Kinshasa, 1997
3.2.17. REPONSES DES ENQUETES SUIVANT LE LIEU DE GESTION
DES RESIDUS D'INCINERATION
Le tableau no 21 et graphique no 17
montre que le lieu de gestion des résidus d'incinération est
inappropriée avec 49 cas soit 83%
Ce qui est différent de la théorie disant qu'il
faut prévoir à 100% une fosse cimentée et bien
fermée pour y mettre la cendre33
Ce qui est différent de la théorie de MINISANTE
disant que les eaux usées produites à l'hôpital doivent
être évacuées sous conduite fermée vers les fosses
septiques et les puits perdus.
Notre résultats ne coïncide pas avec le journal
officiel n° 9 du 1er Mai 2005 portant sur les modalités de
protéger, sauvegarder et promouvoir l'environnement au Rwanda dans son
article 32, 33 et 35 respectivement dit que
«Nul ne peut déposer les déchets dans un
endroit autre qu'un lieu de d'entreposage, d'élimination ou une usine de
traitement des déchets dont les caractéristiques ont
été approuvées par les autorités
compétentes» ;
«Tous les déchets doivent être
collectés, traités, et éliminés de manière
écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer
réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les
ressources naturelles, sur la faune et la flore et sur la qualité de
l'environnement» ;
«L'élimination des déchets doit respecter
les normes en vigueur et être conçu de manière à
faciliter leur valorisation là où c'est possible34
33Association générale
des techniciens municipaux, les déchets urbains, Paris, 1985
34République du Rwanda, Journal Officiel n°
9 du 1er Mai 2005, p67
3.2.18. RESULTATS DE LA QUESTION RELATIVE AUX DECHETS A
INCINERER
D'après les résultats du tableau no
21 et graphique no 17, nous constatons que 58,2% des
enquêtés affirment que les boîtes de sécurité
sont à incinérer alors que les déchets ménagers
sont incinéré à 36,4%.
Qui est différent d'un incinérateur de
Frankfurt, rappelons que d'après notre observation, ce four
d'incinération reçoivent aussi les boite de
sécurité provenant des 12 fosa, ce qui rend le travail
difficile.
Pour les hôpitaux disposant l'incinérateur comme
ceux de Frankfurt, il est contre indique de brûler les
comprimés ; les fioles en verre ; déchets
ménagers ; tubes en PVC ; aérosols.35
Pour notre cas, les déchets ou flacons en verre doivent
être évités, car dans la plupart des cas, ils causent des
dégâts pour l'incinérateur suite aux gaz qu'ils
renferment.
3.2.19. LE RISQUE SANITAIRE LIE A LA MAUVAISE GESTION DES
DECHETS HOSPITALIERS
Au vu du tableau no 23 et graphique no
19, la mauvaise gestion des déchets hospitaliers constitue le
problème de sante publique par les infections nosocomiales avec 30cas
soit 54,1% contre la prolifération des vecteurs avec 20 cas soit
36,4%.
Ces chiffres cités ci-haut montrent que l'existence de
ces infections peut augmenter au cas où l'hôpital ne dispose pas
de système de surveillance des infections nosocomiales36
35 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Gestion des
déchets hospitaliers : circulaire n°
76/92, Tunis, 1992
36 Robert GIRARD et al, Guide technique
d'hygiène, Paris, 1993
3.2.20. PROPOSITIONS EMISES POUR PALIER LE PROBLEME LA
GESTION DES DECHETS DANS L'HOPITAL
Les résultats du tableau no 25 et graphique
no 21 nous montre que, pour résoudre le problème de
gestion des déchets hospitaliers au sein de cet hôpital 56,4%
des enquêtes c'est la disponibilité des équipements
suffisant, 38,2% des enquêtes ont une besoin en formation sur la gestion
des déchets hospitaliers.
Pour arrive à gérer les déchets
médicaux a 100%, selon l'OMS on doit avoir des incinérateurs
appropriées pour évite le stockage des déchets tel que les
seringues du Vaccin anti pneumocoques.37, 38
37 OMS, Lenoir et Magner: Manuel du technicien
sanitaire, Genève, 1991
38
www.alexa.com/siteinfo/incinerateur.com
CHAPITRE IV. PROJET/CADRE LOGIQUE
4.1 TITRE DU PROJET :
Implantation d'incinérateur au sein de l'hôpital
de Ruhengeri pour améliorer la bonne gestion des déchets
médicaux.
4.1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET
Les déchets médicaux constituent un
problème majeur dans les formations sanitaires de la République
du Rwanda, particulièrement au sein de l'hôpital de Ruhengeri qui
ne disposent pas suffisamment d' incinérateur pouvant rendre la tache
facile aux professionnels de sante dans le traitement des déchets
médicaux car dans notre enquête sur terrain nous avons observe
qu'il reçoit les déchets provenant de 12 Fosa de la zone de
rayonnement.
Ces déchets sont à la base de plusieurs
maladies nosocomiales et le post exposition par exemple le VIH/SIDA qui peut se
transmettre aux personnels soignants, aux garde-malades et aux visiteurs.
La santé constitue le moteur pour le
développement d'un Pays comme la République du Rwanda parce que
une personne dont l'état de santé est médiocre ne peut
rien produire et par conséquent elle devient totalement
dépendante et elle constitue une charge pas seulement pour sa famille
mais aussi pour la société toute entière.
Cependant, pour palier aux problèmes de santé,
il a été organisé à ALMA ATA en 1978 une
conférence qui avait comme objectif« la santé pour
tous» pour atteindre cet objectif, aucun aspect sanitaire ne doit
être omis ni oublier. Ce le cas de la gestion efficace des déchets
qui doit figurer parmi les priorités car les milieux hospitaliers sont
fréquentés quotidiennement par la population, raison pour
laquelle ces milieux doivent suffisamment être assainis afin
d'éviter les dangers qui peuvent être occasionné par la
présence de la salubrité.
Cependant, à travers ce projet nous voulons implanter
l'incinérateur dans l'hôpital de Ruhengeri afin de permettre
à cet hôpital la capacité de gérer efficacement les
déchets médicaux qu'ils produisent.
4.1.2 OBJECTIFS DU PROJET
a) Objectif général
Implantation d'incinérateur au sein de l'hôpital
de Ruhengeri en vue d'éradiquer les dangers des déchets
médicaux.
B) Objectifs spécifiques
Ø D'ici 2011, renforcer la capacité de gestion
des déchets 28,5% à 100% au sein de l'hôpital de
Ruhengeri par la mise en place d'incinérateur ;
Ø Prévenir d'ici 2011, les maladies
nosocomiales et autres dangers liés aux déchets médicaux
au sein de cet hopital ;
4.1.3 LOCALISATION ET DUREE DU PROJET
Ce projet sera exécuté dans l'hôpital de
Ruhengeri, pour une durée de 10 mois, du Février en Novembre
2011.
4.1.4 BENEFICIAIRES DU PROJET
Les bénéficiaires directs de ce projet est
l'hôpital de Ruhengeri avec 12Fosa de sa zone de rayonnements et la
population du district de Musanze (374 471 habitant dans 433 ménages)
constituent les bénéficiaires indirectes.
4.1.5 RESULTATS ATTENDUS
1. L'hôpital de Ruhengeri est dotés
d'incinérateur d'ici 201 ;
2. Les maladies nosocomiales ainsi que les autres dangers dues
aux déchets médicaux sont 54,1% à 20% d'ici fin 2011,
3. Les professionnels de santé de l'hôpital
gèrent efficacement les déchets médicaux dans leurs
milieux professionnels.
4.1.6 ACTIVITES
· Mobiliser les ressources nécessaires;
· Mener une étude sur l'incinérateur
appropriés;
· Construire l'incinérateur ;
· Former des hygiénistes sur l'utilisation
d'incinérateur ;
· Organiser une cérémonie de remise officielle
de cet incinérateur a l'utilisateur;
· Faire le suivi et l'évaluation ;
· Produire le rapport.
4.1.7 CHRONOGRAMME
|
NO
|
ACTIVITE
|
PERIODE en 2011
|
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
O
|
S
|
O
|
N
|
|
1
|
Mobiliser les ressources nécessaires;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Mener une étude sur l'incinérateur
appropriés;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Construire les incinérateurs ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Former des hygiénistes sur l'utilisation des
incinérateurs ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Organiser une cérémonie de remise officielle de cet
incinérateur à l'utilisateur;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Faire le suivi et l'évaluation ;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Produire le rapport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. CADRE LOGIQUE
|
LOGIQUE D'INTERVENTION
Prévention des maladies nosocomiales et dangers
liés aux déchets médicaux.
|
INDICATEURS OBJECTIVEMENTS VERIFIABLES
(I.O.V)
|
SOURCES DE VERIFICATION
|
CONDITIONS RECQUISES
|
|
Objectif général
Implanter l'incinérateur au sein de l'hôpital de
Ruhengeri de en vue de prévenir les dangers lieu aux déchets
hospitaliers
|
-1 incinérateur construits et utilisés,
-Nombre d'hygiénistes formés ;
-Nombre de personnes impliquées dans l'étude sur
les incinérateurs appropriés;
-Nombre de missions de suivi et évaluation
réalisées.
|
- L'incinérateur
en place
-pièces justificatives (reçus et factures, Fiches
de paie, liste de présence ) ;
- rapport avec accuse de réception des
évalué.
|
-Disponibilité de financement pour la réalisation
du projet ;
-Implication du gouvernement Rwandais dans la réalisation
du projet,
-Implication des Gestionnaires de l'hôpital de
Ruhengeri.
|
|
Objectifs spécifiques
-D'ici 2011, renforcer l'incinérateur au sein de
l'hôpital de Ruhengeri 28,5% à 100% ;
-Prévenir d'ici 2011, les maladies nosocomiales et autres
dangers liés aux déchets hospitaliers au sein de l'hôpital
de Ruhengeri.
|
|
Résultats attendus
- incinérateurs disponible d'ici 201 ;
-Les maladies nosocomiales ainsi que les autres dangers dues aux
déchets médicaux sont à 20% d'ici fin 2011,
-Les professionnels de santé de l'hopital gèrent
efficacement les déchets médicaux dans leur service.
|
|
Activités
-Mobiliser les ressources nécessaires;
-Mener une étude sur l'incinérateur
appropriés;
-Construire l'incinérateur ;
-Former des hygiénistes sur l'utilisation
d'incinérateur ;
-Organiser une cérémonie de remise officielle de
cet incinérateur aux utilisateurs;
-Faire le suivi et l'évaluation ;
-Produire le rapport.
|
Coût du projet:
- Ressources humaines: 2.459.650Frw
-Frais d'étude sur l'incinérateur
appropriés;383.640Frw
Dépense pour la construction d'incinérateur :
23.000.540Frw
- Atelier de formation : 1.238.000Frw
- cérémonie de remise officielle :
854.000Frw
- Frais pour le suivi et évaluation :
2.400.000Frw
- Production de rapport : 1.500.000FRw
Coût total : 31.835.830Frw
soit (53.148 $USD)
Source :
www.alexa.com/siteinfo/incinerateur.com
|
CONCLUSION
Au terme de ce travail intitulé «connaissances,
attitudes et pratiques des professionnels de sante sur la gestion des
déchets hospitaliers.
» avait comme objectif principal de déterminer les
connaissances, attitudes et pratique du personnel sur le système de
gestion des déchets hospitaliers de l'hôpital de Ruhengeri.
Pour y arriver, nous nous sommes fixés des
hypothèses qui devraient être vérifiés. L'analyse
des résultats montre que nos hypothèses sont confirmées
car :
· 32,7% des enquêtés ont fait les
études secondaires, carrière non médicale, ils ont fait la
normale primaire et comptabilité ; 27,3% des enquêtés
ont fait les études secondaires, carrière médicale, option
des soins infirmiers, anesthésie et physiothérapie ; 21,8%
des enquêtés ont fait des études primaires non
médical
· 21 enquêtés savent que le déchet
c'est une saleté soit 38% et 20 cas soit 36% savent que c'est l'objet
intitulé et sans valeur.
· 41,1% des enquêtés utilisent la
boîte de sécurité lors de la collecte des
déchets ; 31,5% des enquêtés utilisent les poubelles
en métal inox ou en plastique sans couvercle 18,1% des
enquêtés utilisent les poubelles en métal ou en plastique
couvert.
· les poubelles sont installées dans les services
à 64,4% ceci qui explique l'absence des poubelles dans les services
responsable des maladies nosocomiales et autres dangers.
· les résultats montrent que 65,5% des
enquêtés font la collecte sélective, alors que 34,5% ne la
font pas.
· 38,2% utilisés les récipients de type
différents pour le triage des déchets tandis que 32,1% des
enquêtés le font par les Boites de sécurité de
couleurs différentes.
· 60% des enquêtés transportent les
déchets dans les brouettes tandis que 25,5% utilisent les poubelles en
couvercles.
· 56,4% des enquêtés désinfectent
quelquefois les matériels ; 16,4% des enquêtés
désinfectent toujours les matériels ; 16,4% des
enquêtés ne désinfectent jamais les matériels.
· 78% des enquêtés portent quelquefois les
matériels de protection tandis que 18 % les portent toujours.
· 41% des enquêtés affirment que le lieu de
stockage ne réunit pas les conditions et seulement 39% des
enquêtés disent que le lieu de stockage réunit les
conditions.
· il ressort que le four d'incinération est le
plus utilisé pour la gestion des déchets avec 42 cas soit 76,4%,
alors qu'il est inapproprié.
· 83% soit 49 cas ont montre que le lieu de gestion des
résidus d'incinération est inappropriée.
· la mauvaise gestion des déchets hospitaliers
constitue le problème de sante publique par les infections nosocomiales
avec 30 cas soit 54,1% contre la prolifération des vecteurs avec 20 cas
soit 36,4%.
· L'hôpital a besoin la disponibilité des
équipements pour résoudre le problème de gestion des
déchets hospitaliers à 56,4%
· 38,2% ont une besoin en formation sur la gestion des
déchets hospitaliers.
RECOMMANDATIONS
Au vu de nos résultats et conclusions, nous en arrivons
à formuler des recommandations aux différents
partenaires :
AU MINISANTE
· Rendre disponible des règlements nationaux
concernant la gestion des déchets médicaux dans les institutions
sanitaires ;
· Rendre disponible les fonds pour la formation du
personnel en matière de gestion des déchets
hospitaliers ;
· Fournir des équipements nécessaires en
matière de gestion des déchets médicaux ;
· Initier le programme de suivi et évaluation du
système de gestion des déchets hospitaliers.
AUX AUTORITES DE L'HOPITAL
· Organiser des formations continues en matière de
gestion des déchets d'activité de soins pour le personnel
oeuvrant en milieu hospitalier ;
· Mobiliser les fonds pour la construction de
l'incinérateur de Frankfurt ;
· Augmenter le nombre de poubelles dans les
services ;
· Créer un comité de lutte contre les
infections nosocomiales au sein de l'hôpital.
AUX PRESTATAIRES DE SOINS
· Assurer le triage des déchets au point de
production ;
· Porter régulièrement l'équipement
de protection ;
· Utiliser correctement les boites de
sécurité et autres poubelles ;
· Renforcer l'éducation sanitaire aux malades et
garde malades.
AUX HARVEST
· Porter régulièrement l'équipement
de protection ;
· S'assurer de la destruction complète des
déchets médicaux ;
· Assurer la désinfection soigneuse des locaux et
matériels ;
· Renforcer l'association sur le système de
gestion des déchets hospitaliers.
BIBLIOGRAPHIE
A. OUVRAGES GENERAUX
1. Association général des techniciens
municipaux, Les déchets urbains, Paris, 1985
2. DESPORTES V. et al, Hygiène dans
les intuitions des soins de santé en situation précaire,
Bruxelles, 1996
3. DIDIER GABARDA, OLIVA, Aide au tri des
déchets d'activité de soins, Paris, 2000
4. MUSANZE DISTRICT , Monographie du
District de Musanze, 2006
5. EMILLIER KOLLER, Traitement des
pollutions industrielles, Paris, 2004
7. F. KANNE et al, Elément
d'hygiène hospitalière et recherche d'isolement hospitalier,
Paris, 1999
8. JEAN BERNARD LOROY, Les déchets
et leur traitement, 3eème édition, France, 1997
9. L.KARBOUBI et al, Gestion des
déchets piquants et tranchants en milieu d'isolement hospitalier,
paris, 1999
10. L.MANULA et al, Dictionnaire
médical, Paris, 1999
11. LARDELEL A. Les déchets
d'activité de soins en île de France, Montréal, 1995
12. LE PETIT LAROUSSE, Dictionnaire
encyclopédique, Paris, 1997
13. LE PRJET MMIS-JSI,
Sécurité des injections et GDM, Rwanda, 2006
14. LIONEL HUGARD, Hygiène et soins
infirmiers, Paris, 2003
15. M. HEURT, et al, Nouveau cahier de
l'infirmier pour l'Hygiène, 2002
16. MICHAEL J. SUESS et al, La gestion des
déchets dangereux, Principes directeurs et code de bonne pratique,
Copenhague, 1998
17. MINISTERE DE L SANTE PUBLIQUE, Gestion
des déchets solides en ville de Kigali, Kigali, 2002
18. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Gestion des déchets hospitaliers : circulaire n° 76/92,
Tunis, 1998
19. MSF, Technicien sanitaire en
situation précaire, 1994
20. OMS, Gestion des déchets
biomédicaux, Genève, 2003
21. OMS, La noix et Magner : manuel
du technicien sanitaire, Genève, 1991
22. OMS, Promotion de
l'assainissement, Genève, 1998
23. R. GIRARD et al, Guide technique
d'hygiène hospitalière, Paris, 1993
24. RICHARD BELKAHIA, Traitement des
déchets des soins de santé humaine, Bruxelles, 2000
25. ROBERT GILLET, Traité de
gestion des déchets solides et son application aux PVD, Copenhague,
1986
26. T. AJZOUL, Gestion des déchets
médicaux dans la ville de Tétouan, Rabat, 2007
27. OMS, Guide de l'assainissement individuel, OMS
Genève, 1995, P6
28. OMS, Traitement et élimination des
déchets, OMS, Genève, 1976.
29. WHO-UNICEF, Gestion des déchets, article
EKOPEDIA, 2004.
30. WORLD WATCH INSTITUTE, Etat de la planète, 1995
éd. La découverte, Paris XIIIème, 1995, P. 123.
B. Rapports et Revues
1. NDIAYE PAPA et al, Gestion
biomédicaux au CHR de Ziguinchor, Dakar
2. OMS, Rapport d'une réunion sur
la gestion des déchets des hôpitaux, Copenhague, 1999
3. KAMBAU, Les méthodes de gestion
des déchets médicaux de Kinshasa, 1997
C. Mémoires et Notes de cours
0. KARANGWA C. Cours d'hygiène et
Assainissement, KHI, 2002
1. KAYIHIURA Balthazar, Evacuation des
déchets médicaux des hôpitaux de Kinshasa, Kinshasa,
1997
2. WILLY NZAMUYE, CAP sur la Gestion des
déchets hospitaliers dans les Fosa de la République du
Rwanda, Maitrise en S.P , mémoire inédit, UNR-ESP/Rwanda,
2007-2008.
3. KABUTU BIRIAGE, Cours de recherche et
enquêtés sur terrain, inédit, G2 et G3 santé
publique, 2007-2008, 2008-2009.
D. SITE INTERNET
1.
http://www.paris.fr/portail/urbanisme/portail.lut?, Pagid=5692
2.
http://www.mulhouse.fr/fr/santé.php? Page ID=397
3.
www.afrique_gouvernance.net/ficheo/dph/fiche_dph_130.html
4.
www.alexa.com/siteinfo/incinerateur.com
ANNEXE N° 1
QUESTIONNAIRE RESERVES AUX PERSONNELS DE
L'HOPITAL
CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES
PROFESSIONNELS DE SANTE SUR LA GESTION DES DECHETS HOSPITALIERS ; Cas de
l'hôpital de Ruhengeri, District de Musanze
PRESENTATION
Finaliste à l'Université Ouverte en
département de SANTE PUBLIQUE, Option de gestion des institutions de
santé, nous sommes en train de mener une étude intitulée
connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de sante sur la
gestion des déchets hospitaliers ; cas de l'hôpital de
Ruhengeri
Votre hôpital a été sélectionné
pour être évalué. Votre participation aidera dans
l'amélioration de la gestion des déchets hospitaliers et de
l'état de santé de la population. Je vous remercie d'avance pour
votre aimable contribution en répondant aux questions.
I. IDENTIFICATION
1. Age : entre 20-29 ans
30-39 ans
Plus de 50 ans
2. sexe : M
F
2. Niveau d'étude
a) Primaire
b) Secondaire
c) Universitaire
d) Autres à préciser...........
4. service d'affectation
a) Labo
b) maternité
c) Pédiatrie
d) Soins intensifs
e) Autres à préciser.............
II. OUTILS ET EQUIPEMENTS DE GESTION DES
DECHETS
2.1. MATERIEL DE COLLECTE
3. Quels sont les matériels utilisés pour la
collecte des déchets ?
a) Poubelle en métal inox ou en plastique couvert
b) Poubelle en métal inox ou en plastique non couvert
c) Carton
d) Boite de sécurité
e) Autres à préciser...
4. les poubelles sont-elles suffisantes ?
Oui
Non
5. Les poubelles sont-elles installées dans chaque
service ?
Oui
Non
6. Les boîtes de sécurité sont remplies
jusqu'au :
a) 1/3 de la boîte de sécurité
b) ½ de la boîte de sécurité
c) ¾ de la boîte de sécurité
e) Autres à préciser.......
7. Y a t il un système de collecte sélective des
déchets suivant leur type ?
Oui non
8. a) si oui lequel ? -utilisation des poubelles de couleurs
différentes
-utilisation des récipients de
types différents
-autres à préciser
b) Si non pourquoi : -insuffisance des
matériels
-pas de connaissance dans la
collecte séparative
-négligence
-autres à
préciser
2.2. TRANSPORT DES DECHETS
1. Quels sont les moyens utilisés pour le transport des
déchets ?
a) carton
b) sceaux
c) poubelles
d) brouettes
e) véhicules
f) autres à préciser
2. Les déchets sont-ils transportés étant
couverts ?
a) toujours
b) Quelquefois
c) Jamais
3. Le matériel de transport est désinfecté
systématiquement après chaque utilisation ?
Oui Non
4. Le personnel manipulant les déchets porte le
matériel de protection (gants, uniforme, bottes et masques) ?
a) toujours
b) quelquefois
c) jamais
2.3. STOCKAGE DES DECHETS
6. Où est ce que vous stockez vos déchets avant
leur élimination ?
a) Dans les services
b) A l'extérieur
c) maison appropriée
d) Autres à préciser.....
7. Le lieu de stockage réunit-il les conditions
exigées ?
a) oui
b) Non
c) ne sait pas
8. Combien de temps de séjour des déchets au lieu
de stockage ?
a) moins de 3 jours
b) 3 jours
c) plus de 3 jours
d) ne sait pas
e) autres à préciser....
2.4. DESTRUCTION
9. Quels sont les dispositifs d'élimination des
déchets médicaux ?
a) Four d'incinération
b) Fosses à déchets séparés
c) Fosses à aiguilles
d) Ote aiguilles
e) Compostage
f) Autres à préciser.....
10. Les résidus d'incinération sont
éliminés dans :
a) La fosse
b) par le service de la ville
c) Autres à préciser........
11. Le four d'incinération et ses fosses sont-ils
clôturés ?
Oui Non
12. parmi les déchets à incinérer se
trouvent :
a) Les thermomètres cassés
b) Poches de perfusion
c) Flacons en verre ou ampoules
d) B.S
e) Autres à préciser
III. CONNAISSANCE DU PERSONNEL SUR L'HYGIENE ET
ASSAINISSEMENT DU MILIEU HOSPITALIER
17. Croyez-vous que la mauvaise gestion des déchets
hospitaliers constitue un problème de santé publique ?
Oui
Non
18. Quelles sont les conséquences de la mauvaise gestion
des déchets dans votre établissement ?
a) mauvaise odeur
b) prolifération des mouches et autres vecteurs des
maladies
c) nuisance visuelle
d) infections nosocomiales
e) piqûres
f) autres à préciser..............
19. Quelles sont les maladies fréquentes
rencontrées comme les infections nosocomiales dans votre
service ?
a) infection urinaire
b) infection broncho-pulmonaire
c) infection du site opératoire
d) autres à préciser
20. Informez-vous les malades et leurs gardes concernant les IN
causées par les déchets d'activités de soins ?
Oui Non
21. Avez-vous participé à une formation sur la
Gestion des deschets médicaux ?
22. Quelles sont les propositions pour l'amélioration de
la gestion des déchets médicaux dans votre
hôpital ?
a) Formation
b) Les équipements et matériels suffisants
c) renforcer le service d'hygiène
d) Avoir les agents qualifiés
* 1 WILLY NZAMUYE, CAP sur la
Gestion des déchets hospitaliers dans les Fosa de la
République du Rwanda, Maitrise en S.P , mémoire inédit,
UNR-ESP/Rwanda, 2007-2008.
* 1 Bernard Leroy, Traitement
des déchets, 1997, p.45
2Rapport d'une réunion sur la gestion des
déchets des hôpitaux, Copenhague, 1999
* 2 OMS, Gestion des
déchets biomédicaux, Genève, 2003
* 3 T. AIZOUL, Gestion des
déchets médicaux dans les villes de Ttouan, Rabat, 2002
* 4 LE PROJET NMIS-ISI,
Sécurité des injections et GDM, Rwanda, 2006
* 5M. GRAWITZ, Op.
Cit., P. 301.
9 MULUMBATI
* 6 Op.cit
* 7 LE PETIT LAROUSSE,
Dictionnaire encyclopédique, Paris, 1997
* 8 R. GIRARD et al, Guide
technique d'hygiène hospitalière, Paris, 1993
* 9 L. MANUILA et al,
Dictionnaire médical, paris, 1999
* 10 Op.cit
* 11 MICHAEL J. SUESS et al, La
gestion des déchets dangereux, Principes directeurs et code de bonne
pratique, Copenhague, 1998
* 12 F. KANNE et al.
Elément d'hygiène hospitalière et technique d'isolement
hospitalier, Paris, 1999
* 13 DESPORTES V. et al,
Hygiène dans les intuitions des soins de santé en situation
précaire, Bruxelles
* 14 EMILLIER KOLLER,
Traitement des pollutions industrielles, Paris, 2004
* 15 LIONEL HUGARD,
Hygiène et soins infirmiers, Paris, 2003
* 16 L KARBOUBI et al, gestion
des déchets piquants et tranchants en milieu de soins, Rabat, 2007
* 17 NDIAYE, PAPA, et al,
Gestion des déchets bio- médicaux au CHR de Ziguinchor,
Dakar, 2000



