|

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO

J'éprouve une reconnaissance toute spéciale
à l'endroit de mon directeur de recherche, le Professeur
Ibrahima LY, agrégé de droit public, chef de département
de Droit Public, de la faculté des sciences juridiques et politiques,
Directeur du CREDILA, qui tout au long de mon travail a
démontré une grande disponibilité. Son soutien
indéfectible lors de la réalisation de ce travail a
contribué à l'enrichir.
Je manifeste ma gratitude à tous mes professeurs du
programme de master II en droit de l'environnement de la faculté des
sciences juridiques et politiques de l'Université cheikh Anta Diop de
Dakar. A madame Fatou SOW (notre forte amitié) et à sa soeur
madame Amsatou Sow SIDIBE, directrice de l'IDHP, pour leur soutien.
Une mention exceptionnelle à Mme BA, la
secrétaire du CREDILA pour toute sa compréhension.
Je remercie profondément Monsieur Moustapha NDIAYE de
la CEPS/MEPN pour notre amitié forte et très distinguée
mais plus particulièrement pour sa contribution décisive à
l'élaboration de cette étude.
Je témoigne ma grande reconnaissance à mes
ami(e)s et frères pour leurs prières et conseils
distingués : ceux-ci sont entre autres, Souleymane Sanokho, Aliou Gueye,
Cheikh Elbou Diagne, Dame Gueye, Oumy SY, Moustapha Diouf, Abdou karim SARR,
etc.
Mes remerciements sont également adressés
à tous les Etudiants inscrits au master II du droit de l'environnement
pour leur bienveillance distinguée et leur esprit d'ouverture
illimité. Je voudrai nommément citer ces personnes qui m'ont
beaucoup marquées par leur indulgence distinguée : Moustapha
Niang, madame Touré, Aminata Diop, Sokhna Dié Ka,
Diédhiou, tous du Master II en droit de l'environnement.
Enfin, toute reconnaissance à toute ma famille que
j'adore bien.
II
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO

Je dédie ce travail de recherche :
+ A mes chers parents ;
+ A mes soeurs et frères ;
+ A mes très fideles amis ;
+ A mes Oncles et Tantes
+ A toute ma famille
+ Enfin, dédions ce travail à toutes les personnes
qui de prés ou de loin
ont apporté leur concours pour la réalisation de ce
mémoire de
recherche (une modeste contribution intellectuelle).
J'ose espérer que ce travail sera d'un certain apport pour
la communauté intellectuelle (chercheurs et étudiants) surtout
pour les personnes soucieuses de la gestion durable du littoral
sénégalais.
III
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
TABLES DES SIGLES ET DES ACRONYMES
APIX : Agence pour la Promotion des Grands
Travaux.
AOF : Afrique Occidentale Française.
AOP-OSP : Autorisation d'Outillage Privé
avec Obligation de Service Public
ANOCI : Agence Nationale pour l'organisation de
la conférence islamique
CCL : le Code des Collectivités locales
du Sénégal.
CDE : le Code du Domaine de L'Etat
CREDILA : Centre de Recherche, d'Etude et de
Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines.
DPM : le Domaine Public Maritime
DPN : Domaine Public Naturel
DN : le Domaine Nationale
DRIRE : Direction Régionale de
l'Industrie de la Recherche et de L'Environnement.
IRD : Institut de Recherche pour le
Développement de Dakar.
PNAT : Programme National d'Aménagement
du Territoire.
PED : les Pays en voie de
Développement.
PNAE : Plan National d'Action pour
l'Environnement.
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
ONG : les Organisations Non-Gouvernementales.
OCI : Organisation pour la Conférence
Islamique
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OIG : Organisation Internationale
Gouvernementale
UCAD: Université Cheikh Anta Diop de
Dakar.
IV
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
UICN : Union Mondiale pour la Conservation de la
nature.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l?Education, la Science et la Culture. WWF : World Wide
Foundation
V
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
LA LISTE DES GRAPHIQUES
|
DESIGNATIONS
|
PAGES
|
|
Graphique 1 : Appréciation de la
|
P. 48
|
|
qualité de gestion du DPM
|
|
Graphique 2 : Opinions sur
|
P. 50
|
|
l'efficacité des lois de protection du
Littoral
|
|
Graphique 3 : Appréciation de
|
P. 54
|
|
l'implication des populations
|
|
Graphique 4: propositions globales
|
P.57
|
|
de solutions
|
VI
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
LA LISTE DES CARTES
|
DESIGNATIONS
|
PAGES
|
|
Carte N° 1 : les différents
|
P. 19
|
|
écosystèmes du Sénégal (composantes
du DPM)
|
|
Carte N°2 : la grande Côte au
|
P. 20
|
|
Sénégal (de Dakar à Saint louis)
|
VII
Mater II, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE I : IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
SECTION I : DESCRIPTION DU DPM
Para I. aux plans physique et
socioéconomique
Para II. Aux plans juridique et
institutionnel
Section II. Identification des problèmes de
gestion de l'environnement sur le DPM
Para I. Les difficultés de la gestion du DPM et
ses impacts
Para II. Les impacts primordiaux
Conclusion partielle
PARTIE II : LES PERSPECTIVES DE SOLUTIONS ET AMELIORATION
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE DPM
Section I. les perspectives de gestion du DPM
Para I : les perspectives d'ordre
environnemental
Para II. Les perspectives de développement
socio-économique
Section II. Amélioration de la gestion de
l'environnement sur le DPM Para I. amélioration des textes et du cadre
institutionnel
Para II. Révision de la politique
environnementale
Conclusion générale
VIII
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
RESUME DU MÉMOIRE
Les sommets mondiaux sur la terre et le développement
durable, sur la biodiversité, consécutivement de Stockholm et de
Rio, ont suscité pour l'humanité une plus grande attention et une
préoccupation majeure pour de l'environnement en
générale.
En effet, des protocoles et des conventions internationales
adoptées en partie au cours de ces dernières décennies
constituèrent la ligne directrice de la politique des Etats devant
assurer une gestion et une protection des ressources de l'environnement.
Ainsi, à l'instar de plusieurs pays signataire, le
Sénégal s'inscrit dans cette logique de protection et de gestion
de son environnement. L'étude portant sur la gestion du Domaine Public
Maritime (DPM)1 fait montre des conventions sur le droit de la mer,
la convention de Ramsar, entre autres, dont le Sénégal est
signataire. A cet, il faut dire qu'un dispositif juridique et institutionnel de
protection de son domaine maritime est mis en place en vue d'un encadrement
efficace. Néanmoins, Le DPM au Sénégal en raison de ses
enjeux majeurs fait actuellement l'objet de beaucoup de débats sur la
manière dont les populations en font usage. Les enjeux en termes de
climat, de rentabilité économique et touristique attirent les
investisseurs privés nationaux tout comme étrangers. Cette
attraction des populations vers ses ressources créent une concurrence
sur elles, et par conséquent cela pose une dégradation du
potentiel existant.
En effet, cette présente étude portant sur la
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal, vient à une heure cruciale dans un contexte
d'occupations rapides et douteuses du littoral. Les débats qui animent
le sens commun font état de la mal-gouvernance des zones
côtières. Ainsi, pour mieux édifier les populations et les
chercheurs sur les atteintes à l'environnement du DPM, il convient de
spécifier la recherche d'abord. Pour ce faire, nous nous sommes
focalisés sur la grande côte du Sénégal, autrement
dit les Niayes.
Dans la partie I, les points traités
s'articulent autour de l'encadrement du DPM de façon
générale car les lois sur la protection de l'environnement ne
sont pas exclusives. Toujours
1 Le Domaine Public Maritime fait partie
intégrante du domaine public naturel de l'Etat. Son gestion est du
ressort de l'Etat sauf à quelques exceptions prés, selon le code
du domaine de l'Etat au Sénégal, loi 76-66, JORS.
IX
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
dans la partie I, la section II de
l'étude de la gestion a permis de mieux appréhender les
problèmes environnementaux et institutionnels.
L'encadrement qui convient pour assurer une bonne gestion du
DPM tant juridique qu'institutionnel est cloué à des lacunes
d'imprécision des textes et/ou de manque de moyens d'action des
intervenants. Le laisser-aller notoire, a induit des problèmes majeurs
de pollution maritime et de réduction des potentialités
pédologiques du milieu.
A cet effet, la partie II de cette
étude, a consisté à identifier en premier lieu les causes
des problèmes et en second lieu à proposer des mesures
palliatives.
Dans la section I, les différentes
causes s'articulent autour de deux points : les causes externes (globaux du
problème de gestion de l'environnement) et les causes internes (à
savoir spécifique à la grande côte au
Sénégal). L'ensemble de ces causes ont permis
l'élaboration de mesures substantielles (Section II)
d'atténuation et de réduction des effets sur la population et
l'environnement.
Il faut simplement se rappeler que l'environnement en particulier
le littoral, en raison des changements climatiques qui se profilent et des
actions anthropiques négatives, nécessite une plus grande
attention de la part des pouvoirs publics mais aussi des populations locales.
Vu que l'existence de l'humanité est conditionnée par la
diversité biologique, les citoyens et les autorités publiques
sont interpellés à plus responsables face à la menace de
dégradation du DPM en vue d'une gestion efficace de ce domaine
précité.
1
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
INTRODUCTION
Le droit de l'environnement a pour objet l'étude ou
l'élaboration de règles juridiques concernant l'utilisation, la
protection, la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes ses
formes. C'est un droit en pleine expansion, dont les champs tendent à se
densifier au fur à mesure que des avancées sociales,
scientifiques et techniques se manifestent dans la prise en compte de
l'environnement dans les activités économiques.
En effet, au cours de ces dernières décennies,
l'environnement s'est peu à peu imposé aux acteurs juridiques,
économiques, politiques et sociaux à toutes les échelles.
La prise en compte de la protection de notre environnement dont dépend
notre qualité de vie est devenue incontournable dans
l'élaboration de politiques publiques. Parallèlement la
décentralisation a conféré aux collectivités
territoriales toujours plus de pouvoirs et de compétences notamment dans
les décisions locales relatives à l'environnement.
Inscrit dans l'option stratégique du
Développement durable institué au lendemain de la
conférence de Rio2, le Sénégal manifeste ;
à cet effet, une volonté politique de prise en compte des
exigences de protection et de conservation des ressources naturelles et de
l'environnement. Cette nouvelle exigence semble aboutit à l'implication
des populations et la responsabilisation des acteurs de développement
d'une part et d'autre part dans le renforcement du dispositif juridique et
organisationnel.
Située à l'extrême ouest du
Sénégal, avec une position géographique frontalière
des eaux océaniques sur sa grande partie, la grande côte dispose
d'un domaine public maritime qui est aujourd'hui l'un des plus convoités
(700 km de large) du pays. De surcroît, elle bénéficie d'un
climat frais et doux presque 9 mois sur 12. Un tel privilège suscite des
convoitises et attire les investisseurs à se livrer parfois des
activités déloyales sur le Domaine Public Maritime
(DPM3) souvent même avec la bénédiction de nos
autorités.
2 La Conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement s'est tenue à Rio de Janeiro
au Brésil du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'Etats et
de gouvernements et 178 pays. 27 principes qui prennent en charge la question
de la préoccupation environnementale au-delà celle
socio-économique sont pris.
3 DPM voire définition dans un sens
donné dans le Code du Domaine de L'Etat par la loi 76-66 en son article
5.
2
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Pour cette raison, l'étude de la gestion de
l'environnement sur le DPM, dont la notion juridique remonte à Colbert,
est d'une importance capitale dans un contexte générale de
développement durable. Si en France, la gestion du DPM, est du ressort
de l'Etat, le Sénégal n'en est pas moins à cette
règle. Le Code du domaine de l'Etat par la loi n°76-66 en son
article 5 a définit le domaine public maritime et la
zone littorale faisant partie du domaine public naturel de l'Etat comme, «
..., les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus
fortes marées, ainsi qu'une zone de cent mètres de large à
partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ».
Ainsi, il revient à l'Etat d'assurer la gestion du DPM au
Sénégal.
A cet effet, L'étude de ce présent sujet
recèle un intérêt double pour plusieurs raisons. En premier
lieu, placé dans le contexte politico-social sénégalais
qui est d'actualité, ce sujet fait l'objet de débats
récurrents sur la façon dont est géré le DPM.
En second lieu, le littoral sénégalais
représente une zone d'intérêt stratégique à
la fois sur le plan démographique, économique et environnemental.
La pression démographique se développe
préférentiellement sur la zone côtière qui accueille
notamment dans les centres urbains et la capitale, tous situés en bord
de mer, et qui continuent de recevoir des populations en provenance de
l'intérieur. De nombreuses installations touristiques et humaines se
profilent sur les côtes avec un rythme inquiétant et sempiternel
rapide parfois aux mépris des lois et textes en vigueur au
Sénégal.
En effet, Les enjeux sur le plan socio-économique,
environnemental et touristique sont considérables et posent du coup une
gestion problématique dans la mesure où les différents
intervenants sont importants avec des intérêts qui divergent
parfois les uns des autres. Aussi, l'application des règles juridiques
demeure un problème notoire vue le niveau de pollution de nos
côtes. Aussi, des occupations résidentielles, touristiques et
industrielles demeurent très rapides posent des pollutions sur le
littoral.
Face à une telle situation, il serait pertinent de se
poser un certain nombre de questions les suivantes :
La gestion du DPM sur la Grande Côte, est elle
efficace ?
Quel est le fondement de la compétence de
l'Etat pour assurer la gestion de l'environnement ?
3
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Quelles sont les difficultés de gestion de
l'environnement sur le DPM ?
Fournir une réponse spontanée à ces
questions, serait sans conséquence et risque de manquer de justesse
d'où l'impératif d'une analyse plus approfondie de la situation
existante.
En effet, la gestion de l'environnement traduit des
interventions de nature à atténuer ou à éradiquer
toutes actions susceptibles de porter atteintes à la capacité de
régénération de l'écosystème et de la
biodiversité en place.
Une bonne gestion de l'environnement exige un important moyen
de contrôle et de prévention des préjudices sur le milieu.
Le DPM fait l'objet d'occupations anarchiques et de rejets volontaires de
polluants, d'où l'exigence pour les autorités à
remédier à ces problèmes de pollution. Cette situation
fait ressortir l'importance du travail à faire afin d'assurer une
protection juridique efficace de cet environnement extrêmement important
et fragile et de renforcer la capacité d'actions des acteurs.
Ainsi, à l'instar de tous les travaux scientifiques,
celui-ci s'inscrit dans la méthodologie suivante :
LA METHODOLOGIE
Pour ce présent travail, la méthodologie
utilisée s'article autour de deux points clés : la conception de
la recherche, l'analyse et le traitement des données. Pour se faire,
l'élaboration des questions de recherche, la revue documentaire et des
enquêtes sur le terrain demeurent un procédé
inéluctable.
LES QUESTIONS DE RECHERCHE
Dans cette présente étude, il y a une question
principale qui est scindée en deux questions spécifiques.
Question Principale :
Quels sont les facteurs explicatifs des problèmes de
gestion de l'environnement sur le DPM dans les Niayes?
Question spécifique 1 :
Quelles sont les causes principales des problèmes de
gestion du DPM ?
4
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Question spécifique 2 :
A quoi est due la mauvaise qualité de l'environnement sur
le DPM ? LES HYPOTHESES
Des hypothèses sont formulées dans le sens
d'infirmer ou de confirmer les facteurs des problèmes de gestion de
l'environnement sur le DPM.
Hypothèse principale :
Les problèmes de gestion du DPM sont liés à
la spécificité de la matière environnementale.
Hypothèse secondaire n° 1 :
Les problèmes de gestion sont causés par le manque
de moyens d'actions des institutions.
Hypothèse secondaire n° 2 :
Les insuffisances textuelles traduisent les problèmes de
gestion du DPM.
LES OBJECTIFS DE L'ETUDE
Objectif général : connaitre les
problèmes de gestion de l'environnement sur le DPM
Objectif n° 1 : identifier les facteurs des
problèmes.
Objectif n° 2 : étudier les impacts des
problèmes de gestion Objectif n° 3 : envisager des solutions
alternatives de gestion
La conception de la recherche
Notre recherche a été conçue suivant des
méthodes classiques de collectes de données (revue documentaire,
observation directe et participante), lesquelles ont fait ajouter des
enquêtes sur le terrain. Pour ce faire, des instruments de collectes
très pratiques et adaptés à ce genre de travail, ont fait
l'objet d'utilité. Il s'agit des questionnaires d'enquêtes et des
guides d'entretien auprès des acteurs susceptibles de nous fournir
d'informations utiles et nécessaires.
Pour administrer les questionnaires, 100 populations de Dakar,
plus particulièrement dans les collectivités locales (Hann,
Rufisque) qui sont plus confrontées à ces problèmes
d'environnement, sont interviewées.
5
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Les informations collectées auprès de ces
dernières sont relatives aux effets socio-économiques et aux
atteintes anthropiques sur le littoral. Concernant le traitement et la saisie
des données, le logiciel SPSS a été mis à
contribution et pour le masque de saisie, nous avons fait usage de CSPRO. La
méthode d'enquête usitée est probabiliste en raison de son
caractère simple et constitue à cet effet, une
référence statistique fiable.
La revue documentaire
De nos jours, le débat portant sur la
préoccupation de l'environnement marin et côtier explique
largement la richesse et la diversité de la documentation relative
à celle-ci. En effet, beaucoup d'univers de recherche ont
été explorés. Dans la plupart de ces univers, la
documentation (Rapports, Documents, Colloques,
Etudes) relative au droit de l'environnement
(particulièrement liée à la gestion du littoral au
Sénégal) porte généralement sur les facteurs de
pollution, les effets et les dispositions juridiques adoptées à
l'instance internationale et transposable au droit national. Les accidents
notoires au cours des années 70, ont suscité la prise de
conscience pour l'humanité à mettre en place un dispositif
institutionnel et juridique de protection des ressources naturelles et de
l'environnement. La Banque Mondiale a suivi cette logique en créant un
fonds pour l'environnement.
Ainsi d'importantes recherches et études ont permis la
publication d'ouvrages et de mesures stratégiques de prévention
et de protection des écosystèmes naturelles. Parmi ces ouvrages
on peut citer entre autres:
? Ministère de l'Environnement et de la
Protection de l `Environnement Ministère du tourisme et des transports
aériens du Sénégal (1999). «
Stratégie Nationale Initiale de Mise en oeuvre de la
convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
», Dakar, MEPE.
? Résumé du rapport du Gouvernement au
Parlement portant bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du
littoral, Septembre 2007.
? Ly Ibrahima, agrégé des
facultés de droit, (2008) : étude sur l'évolution du
droit de l'environnement depuis 1992, Université Cheikh
Anta Diop.
La liste est exhaustive (Cf. Bibliographie), pour cela nous
avons sélectionné certaines études portant sur le domaine
au regard de leur caractère spécifique. Elles portent la marque
du carde juridique et institutionnel existant au Sénégal et
inscrit dans le dispositif de protection du littoral. Seulement le bilan a
permis aux pouvoirs publics de saisir réellement du problème
de
6
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
l'environnement sur le littoral. Puisqu'il est question du
parlement, il comprend que la spécificité va tout droit dans les
mesures à prendre en faveur du littoral. Mais, on peut s'interroger
jusqu' à quand enfin le parlement va t-il voter le projet de loi sur le
littoral ?
L'analyse et le traitement des données
Le traitement des données s'est fait à partir
des logiciels informatiques qui s'adaptent parfaitement à ce genre de
recherche à savoir SPSS et Excel, très adéquats pour faire
des représentations graphiques, des tableaux afin de mieux étayer
nos analyses.
Ainsi, les résultats obtenus suite aux traitements, ont
l'objet d'analyse afin d'apprécier le niveau d'atteintes à
l'environnement. Ceux-ci permettent de proposer des recommandations
générales relatives à l'amélioration de la gestion
de l'environnement marin et côtier.
Les limites de la recherche
Cette présente étude, il faut le dire, est
emboîtée par le temps et par les moyens financiers au regard de
l'étendue du terrain et de la richesse des informations à
collecter. La visite de terrain a eu lieu alors que les préparations
d'examen et les cours théoriques s'effectuaient en même temps. Eu
égard à la sensibilité des informations, certaines cibles,
surtout les autorités politiques (structures à enquêter)
ont fait montre d'une réticence très corsée au
début.
Cependant, il faut signaler que le travail a pu être
fait à date échue, puisque cela constitue un impératif
pédagogique pour répondre aux critères exigibles
d'admission.
Toutefois, ce travail n a pu être effectué sans
l'élaboration d'un plan. Dès lors, il convient d'articuler notre
étude autour de deux axes principaux : d'abord dans la
première partie, il s'agit de procéder à
l'identification des problèmes de gestion de l'environnement
sur le domaine public maritime, puis dans la seconde partie
notre étude portera sur les perspectives et les
améliorations à apporter dans la gestion du DPM,
en tenant compte des insuffisances textuelles et de la faiblesse des
moyens d'action mis à cet effet.
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
7
PARTIE I :
IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
8
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
L'identification des problèmes qui assaillent le DPM ne
peut impérativement se faire sans une étude préalable
portant sur l'état des lieux. La section I, ainsi,
porte sur la description du DPM, particulièrement la grande
côte et la section II consiste à identifier les
réels problèmes relevés sur le littoral.
SECTION I : DESCRIPTION DU DPM
Vue l'entendue du littoral sénégalais (en
particulier les Niayes) avec une diversité d'écosystèmes
marin et côtier, il serait indispensable de faire une étude
descriptive faisant état des lieux. Cela permet par ricochet
d'identifier les problèmes essentiels et de proposer des solutions.
Para I. aux plans physique et socioéconomique
Ce paragraphe s'articule autour de deux points: la description
physique de la grande côte d'une part et d'autre part, il s'agit
d'identifier les aspects socio-économiques du DPM.
A. les aspects fonciers et écologiques
La grande côte qui fait l'objet spécifique de
cette étude, est une partie intégrante des Niayes du
Sénégal. Elle se caractérise sur le plan physique par des
sols sablonneux et des sols rocheux par endroit plus proche des vagues. De
façon générale, la morphologie de la région des
Niayes se caractérise par diverses formes de reliefs allant des sommets
dunaires, qui culminent entre 15 et 20 m, aux dépressions interdunaires
où affleure la nappe phréatique. Ainsi un vaste manteau de sables
des formations du quaternaire couvre et commande l'allure du paysage local. On
distingue globalement trois grandes unités géomorphologiques :
les dunes intérieures ou dunes rouges, les dunes semi-fixées, et
les dunes blanches vives.
9
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Les dunes rouges4 sont alignées dans la
direction NNE-SSW au nord du secteur, et d'orientation N-S entre Mboro et
Potou, dans le sens des alizés continentaux (vents dominants de saison
sèche).
Ce sont des dépressions interdunaires dont le fond est
occupé par la nappe phréatique, subaflleurante (Blouin, 1990).
Ceci a permis le maintien d'une flore relique d'origine guinéenne (12%
des espèces), caractérisée notamment par le palmier
à huile (Elaeis guineensis) que l'on trouve autour des
dépressions.
On distingue d'ouest en est :
Les dunes littorales vives, situées
entre la plage sableuse et les dunes jaunes semi fixées. Cette
première catégorie de dunes dites « dunes blanches » ou
encore « dunes maritimes » est le résultat de la recrudescence
de la déflation éolienne, facilitée par les rigueurs
climatiques. Elles datent de la période actuelle ou subactuelle et sont
orientées de manière conforme à la direction dominante des
masses d'air. Elles sont façonnées par les vents alizés
à partir du matériau sableux côtier. Elles bordent le
littoral et se forment à partir des apports de la plage, nourries par la
dérive littorale. Généralement, elles surplombent les
autres formations dunaires. Leur orientation est peu précise.
Les dunes littorales semi-fixées ou
« dunes jaunes » constituent une bande irrégulière et
discontinue. Elles s'intercalent entre les dunes vives littorales et les dunes
intérieures.
Les dunes jaunes se terminent parfois par des fronts abrupts
de 10 à 20 m.
Les dunes rouges fixées font suite au
système des dunes jaunes. D'après les estimations faites par
Staljanssens (1986), la largeur de cette bande continue est inférieure
à 3 kilomètres.
Entre les systèmes dunaires, des dépressions
hydromorphes s'égrènent le long de la grande côte. Ce sont
les Niayes sensus stricto5, cuvettes inondées par des
fluctuations de la nappe phréatique au cours de l'année. La nappe
y affleure périodiquement, provoquant la formation de marais temporaires
ou permanents qui donnent son cachet particulier à cette
région.
Par ailleurs, les Niayes occupent une superficie de 2000
km2 environ et correspondent à une bande longue de 135 km et
large au maximum de 35 km. Elles abritent environ 419 espèces
représentant près de 20% de la flore sénégalaise.
Elles sont le lieu privilégié du maraîchage,
activité économique extrêmement importante tout le long de
cette côte, en plus de la pêche.
4 Ce sont des dunes appelées
également par les géographes de dunes ogoliennes car remonte au
temps géologique dans l'ère ogoliennes. Il ya de cela environ
25millions d'années.
5 Les Niayes sensus stricto ont des
formes et des dimensions très variables, on distingue deux types : - des
Niayes de petites dimensions orientées NNW-SSE,
- des Niayes de vaste superficie.
10
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Ceci entraîne une disparition progressive de la
végétation naturelle. Ces activités sont menacées
en certains endroits par la progression des dunes jaunes
ravivées6 et par une salinisation des sols et de la nappe.
Sur le plan climatique, inscrites dans la moitié sud de la zone
sahélienne, les Niayes et la région de Dakar sont
caractérisées par l'alternance de deux saisons annuelles : une
saison humide concentrée sur trois mois (juillet, août et
septembre) et une saison sèche qui dure les autres neuf mois. La
région des Niayes bénéficie en plus d'un microclimat assez
particulier par rapport aux autres parties du pays qui s'intègrent dans
les mêmes domaines climatiques qu'elle. Elle est
caractérisée par des températures modérées
influencées par la circulation des alizés maritimes
soufflés par les courants froids des Açores. La proximité
de l'océan favorise le fort taux d'humidité relative de 15 % dans
les zones les plus éloignées de la mer. Ce taux d'humidité
peut remonter jusqu'à 90 % à partir du mois d'avril.
Carte n°2 : la Grande Côte au
Sénégal (de Dakar à Saint-Louis)
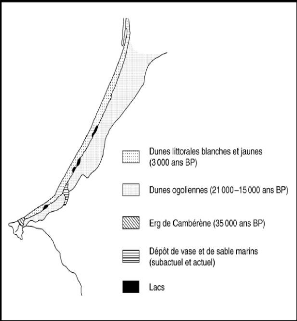
Source : enquête mémoire master II
environnement, 2010, M. SANOKHO
6 Ce sont des dunes de sables dont la coloration
demeure vive et claire en raison des phénomènes climatiques
changeant.
11
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
En effet, de nouvelles études dans l'espace
périurbain nous montrent : les Niayes à la fois une zone
d'agriculture semi-biologique et réserve d'équilibre biologique
avec plus de 140 espèces d'oiseaux et de reptiles (IRD, 1998). Ceux-ci
s'étendent derrière le cordon dunaire, le long de la côte
entre Dakar et Saint-Louis sont alimentées par une nappe
phréatique affleurant de 0,5m à 1m suivant les apports
pluviométriques et par des lentilles d'eau douce interdunaires
permettant des cultures maraîchères tout au long de
l'année. Soumises aux attaques anthropiques avec les
prélèvements effectués par un maraîchage intensif
d'une part et d'autre part, à une forte évaporation, le niveau
d'eau a considérablement diminué ces dernières
années. En plus, au niveau des Niayes, le DPM (en se
référant sur les 100 mètres de la limite des hautes
marées) concentre une importante réserve naturelle
constituée de mangroves et de marais.
Sur le plan écologique, la partie du DPM est une «
interface » soumises aux marées où sont en jeux des
phénomènes trophiques et fonctionnels très importants (un
écotone7 par rapport au paysage). En effet, a cause de la
montée des eaux maritimes de partout dans le monde, le littoral s'avance
sur les zones urbaines ou rurales en fonction des lieux. A cet effet, les
limites du DPM sont localement à mettre à jour
périodiquement à cause du recul du trait de côte, qui
pourrait être exacerbé par le changement climatique et la
montée des océans.
Une partie du DPM est juridiquement
protégée et classée suivant plusieurs
directives européennes (publié par Natura, 2000). Des
réserves naturelles nationales peuvent s'y étendre avec une
possibilité d'installer des parcs naturels marins ou encore des aires
marines protégées.
A l'instar des côtes ouest-africaines, les eaux
sénégalaises renferment une biodiversité riche qui
comprend, entre autres, des mammifères marins tels que les requins, les
lamantins, les dauphins, les otaries, les phoques, les baleines, les tortues
marines, les oiseaux côtiers (rapport national8, 2009).
Ces espèces qui étaient méconnues il y a
quelques années, font aujourd'hui l'objet d'une surexploitation qui
menace même leur survie. Par ailleurs, ces espèces subissent la
7 Zone de
séparation entre deux écosystèmes, autrement dit entre
l'écosystème marin et celui des habitations humaines ou
même écosystème constitué de terres
agricoles.
8 Ce rapport est publié en 2009 par la
direction de l'environnement et des établissements classés sous
l'institution tutelle du ministère de l'environnement et de la
protection de la nature modifiée et remplacée par le
ministère de l'environnement, de la protection de la nature, des bassins
de rétention et lacs artificiels.
12
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
dégradation de leurs habitats et du milieu marin, cela
a pour conséquence, la réduction de la biodiversité et le
raccourcissement des chaînes alimentaires qui englobe la disparition des
espèces carnivores. A cela s'ajoutent, certaines mauvaises pratiques
comme la pêche à explosif, qui atteint présentement des
proportions inquiétantes, car, aboutissant à la
désertification des fonds rocheux littoraux, dans des fonds
dépassant, en général 35 mètres.
Consciente de cela, l'Union Internationale pour la
Conservation de la nature (UICN) a inscrit ces espèces dans sa liste
rouge, qui concerne l'ensemble de la communauté internationale, et a
tiré sur la sonnette d'alarme pour leur sauvegarde et leur
préservation.
En effet, la richesse de la biodiversité marine au
Sénégal se manifeste par l'existence de plusieurs types
d'écosystèmes côtiers. Ceux-ci existent sur tout le long
des côtes sénégalaises. Ils sont constitués par les
côtes sableuses (la Grande Côte), les côtes rocheuses
(presqu'île du Cap Vert), les zones humides côtières
(Niayes). Egalement, cette richesse biologique se distingue au
niveau de la mangrove, les îles sableuses et les bolons dans les deltas
du Saloum et du Sénégal et des vasières au sud de
l'embouchure de la Casamance.
Il faut retenir que dans cette présente étude
bien que spécifique à la grande côte, prête
l'attention sur les autres écosystèmes qui existent au
Sénégal lesquels méritent bien d'être
soulignés.
Pour cela, les développements suivants vont porter sur
la description des mangroves et marais un peu partout au Sénégal.
L'intérêt consiste à intégrer dans les
recommandations générales tous les espaces du DPM au
Sénégal, car (bien que chaque DPM recèle des
particularités), les lois seront communes et uniformes dans la
protection de l'environnement sur ce domaine.
13
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Carte N° 1 : les différents
écosystèmes du Sénégal (la répartition des
parcs, réserves, aires marines protégées au
Sénégal)

Source : enquête mémoire master II
(in rapport érosion côtière 2005).
Au Sénégal, en plus des Niayes, une zone par
excellente du littoral, il existe d'autres écosystèmes dont nous
allons tenter dans les lignes suivantes de faire une présentation
très brève.
? LES MANGROVES ET MARAIS COTIERS
La mangrove se caractérise par la présence d'une
formation végétale particulière de palétuviers. Au
Sénégal, l'écosystème constitué de
mangroves, occupe une superficie d'environ 300 000 hectares, essentiellement
dans les estuaires du Saloum (environ 80 000 ha) et de la Casamance (environ
250 000 ha) (Diop, 1986 ; Seck, 1993, in rapport national 2009).
14
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
En Casamance, l'écosystème de mangrove
identifié, est l'un des plus productifs du monde. Il abrite des
espèces animales spécifiques (huîtres, balanes, arches,
crabes) mais aussi il sert de refuge à des espèces d'oiseaux
(hérons, aigrettes) et à des juvéniles de poissons ou de
crevettes. Il contribue ainsi de manière significative au bon
fonctionnement des communautés de poissons du plateau continental. Les
mangroves font l'objet d'exploitation abusive par les populations locales en
vue de satisfaire leur besoin nutritionnel et financière. Il s'agit
notamment des activités de récolte de coquillages (arches et
huîtres), en général effectuées par les femmes
(Descamps, 1994). Ces coquillages sont autoconsommés et
commercialisés sous forme séchée. Les feuilles et fruits
des palétuviers sont utilisés dans l'alimentation mais aussi dans
la pharmacopée. Quant au bois, il est aussi bien utilisé pour la
construction que comme source énergétique.
Au niveau des estuaires et du Delta du Saloum, il se forme
plusieurs réseaux de marigots « bolons » et de lacs autour
desquels se développement une diversité d'espèces. La
végétation constituée essentiellement de mangroves et de
prairies a halophytes (Marius, 1977) ou « tannes herbues », est
colonisée par des espèces comme exemple Ipomoea
pescaprae, Cyperus maritimus.
En plus d'une importance d'espèces
végétales, le Sénégal dispose d'espèces
animales dont la recherche menée par Bodian (2000), fait
révéler la présence de près de 260 espèces
sur les côtes sénégalaises. Les données de recherche
disponibles indiquent pour le Sénégal une biomasse annuelle
moyenne variant entre 1 100 tonnes et 9 700 tonnes. Cette biomasse peut
atteindre, en année favorable 15 000 tonnes.
Entre autres écosystèmes marins, on peut
évoquer la réserve naturelle du Djoudj. Elle est
située en milieu azonal à cause des conditions hydrologiques et
pédologiques de la plaine inondable. Cette réserve est inscrite
comme patrimoine mondiale de l'UNESCO, bénéficie également
de la protection juridique de la convention internationale sur les zones
humides d'importance capitale (convention de Ramsar 1971).
En effet, La grande richesse biologique des
écosystèmes côtiers et marins résulte de courants
marins ascendants appelés upwelling9 et de la
diversité des habitats. Les ressources halieutiques des zones
côtières et marines et l'avifaune des régions
deltaïques constituent les principales ressources biologiques de ces
écosystèmes qui sont affectées par la surpêche et
9 Le Sénégal dispose des côtes les
plus poissonneuses a cause des courants ascendants appelés upwelling.
15
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
l'exploitation du bois de mangrove. Ces pratiques abusives
constituent une menace pour la conservation de la biodiversité et des
écosystèmes marins et côtiers.
Les richesses écologiques et foncières qui
caractérisent le DPM font de lui, cette attraction exacerbée des
populations. Plusieurs activités humaines et industrielles y sont
localisées. Cela crée un fort changement du milieu dont l'analyse
suivante, nous éluciderons sur les aspects démographique et
socio-économique auxquels le DPM fait état.
B. les aspects économiques et
démographiques
Considérant les ressources foncières, on peut
relever des valeurs agricoles importantes sur les terres situées sur la
zone des Niayes. Une importante activité de maraichage et de plantes
fruitières se développent sur les zones du littoral en raison de
la nappe phréatique qui affleure. Aussi, la qualité de l'eau
(douce) favorable au développement de l'agriculture irriguée et
du maraichage explique l'importance de la zone foncière.
La zone côtière précisément joue un
rôle extrêmement important dans l'économie
sénégalaise. En effet, certaines activités
économiques particulières y sont développées
(tourisme, pêche, activités agricoles et commerciales,
activités minières).
D'abord, il y a le tourisme. Ce dernier constitue l'une des
principales sources de devises du pays dont il représente la
deuxième activité économique après la pêche
(273 milliards de FCFA de recettes en 200210 ). Il contribue pour
environ 4,6% à la formation du PIB, avec environ 267 500 emplois directs
et 25 000 emplois indirects. Il faut noter que celui-ci est avant tout un
tourisme balnéaire bien que se développent un tourisme d'affaires
et un tourisme de découverte basé sur les réserves et
parcs nationaux.
Ensuite, il y'a la pêche qui peut être artisanale
ou industrielle. Elle est pratiquée aussi bien dans la Zone Economique
Exclusive (ZEE) que dans les estuaires et ce secteur occupe le premier poste
des exportations du pays devant l'arachide et les phosphates. Elle est d'une
importance capitale pour l'économie nationale. Elle peut s'exercer
très bien dans le DPM et ce dernier souvent accueille des
infrastructures qui peuvent servir soit au débarquement des produits de
la pêche (les ports) ou soit à leur transformation.
Le DPM peut aussi accueillir des activités agricoles.
En effet, les « Niayes » sont le lieu privilégié du
maraîchage, activité économique extrêmement
importante tout le long de la Grande côte.
10 Source : Rapport national
sur les activités socio économiques du Sénégal en
2002.
16
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Il existe également des activités liées
à l'exploitation minière (sels, sables, coquillages, emplacements
de minéraux lourds). On remarque de facto que des activités
commerciales sont mises en branle le long de la zone côtière et
elles sont relatives à la pêche, à l'agriculture, à
l'exploitation minière et aux ventes d'algues.
Par ailleurs, le domaine du littoral constitue le foncier le
plus onéreux au Sénégal avec le mètre carré
qui peut excéder 100 000 francs dans certains endroits (la corniche
Ouest de Dakar par exemple). L'accès ou la proximité avec la mer
constitue pour les populations une place privilégiée, ce qui
explique leur goût profond à trouver demeure dans ces espaces du
littoral.
Il faut dire que cela se traduit par les enjeux énormes
sur le foncier situé sur le DPM car la demande est devenue très
forte. Comme disait l'adage « toute chose étant égale
par ailleurs »
D'ailleurs sur le plan démographique,
la zone littorale accueille une forte concentration de la population en
relation avec le développement des activités économiques.
En effet, le littoral Sénégalais constitue un espace de
concentration de la plus grande partie de la population urbaine en rapport avec
l'essor économique de cette zone. Cette zone abrite environ les 2/3 de
la population du Sénégal sur une population d'environ 11 millions
d'habitants dans les centres urbains et la capitale, tous situés en bord
de mer, et qui continuent à recevoir des populations en provenance de
l'intérieur. Ces populations appartiennent à différentes
communautés (communautés de pêcheurs, agricoles,
ouvrières et minières) en fonction de l'activité
exercée. A ceux-ci, il faut ajouter les nombreux nationaux et
étrangers qui viennent s'installer sur le DPM pour la
villégiature.
Aujourd'hui, la bande côtière maritime sur la
région de Dakar abrite des installations humaines, touristiques et
industrielles qui privent l'accès aux populations à la mer et
à la fraicheur du climat marin. Même la bande terrestre de
sécurité de la zone aéroportuaire n'échappe pas
à cette boulimie foncière des affairistes. Des maisons
construites à 50 m de la piste où atterrissent et d'où
décollent les avions, cela laisse perplexe et inquiète tout
observateur censé. De ce fait, le patrimoine national, la
sécurité et le bien être des populations sont
sacrifiés sur l'autel d'ambitions et d'appétits financiers.
Certaines personnes parlent de spéculation foncière aux
mépris des lois de protection du littoral. Récemment le rapport
de
17
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
l'ONG Aide transparency11 avait fait état de
cela, tout en procédant à un réquisitoire
sévère de la manière dont nos gouvernants gèrent le
DPM.
En effet, l'importance de la gestion de l'environnement sur le
DPM, ne tient au fait que ce dernier est une zone d'intérêt
stratégique au plan environnemental, économique et
démographique dont la préservation demeure vitale pour l'Etat
d'où la pertinence de la mise en place de textes Juridiques et
d'institutions en charge du respect de leur application effective.
Para II. Aux plans juridique et institutionnel
Au cours des années 70, de nombreux accidents dans le
monde causés par les hydrocarbures, ont suscité la prise de
conscience à prendre plus de préoccupations pour la protection de
l'environnement. Ainsi des mesures institutionnelles et juridiques seront
adoptées afin de réduire du moins ou stopper les actions
susceptibles de porter atteintes à l'environnement marin et
côtier.
Un cadre juridique international sera mis en place en fonction
des domaines pour soit prévenir, gérer, entres autres, les
catastrophes environnementales. Ce cadre est transposable au droit national.
A. l'encadrement juridique
En effet, l'appréhension des contours juridiques,
permet ou du moins favorise l'application efficace des mesures technique et
stratégique de la protection du DPM. Pour mieux comprendre le cadre
juridique et institutionnel, il convient d'étudier l'historique des
conventions internationales portant sur l'environnement ainsi que les textes de
lois mis à cet effet.
11 Les résultats du rapport de l'ONG Aide
Transparence, présentés en décembre 2008 font état
d'un bradage suivi d'une spéculation foncière du domaine public
maritime dans la bande côtière de Dakar avec une perte pour la
collectivité locale de 600 milliards de francs.
18
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
A -1. L'historique des conventions
C'est avec la révolution industrielle et l'ère
du charbon que la pollution de l'air est devenue la plus visible et notoire.
Dès la fin du XIXe siècle et pendant la majeure partie
du XXe siècle, le développement mondial a
été très fort. La révolution industrielle et la
forte croissance économique ont favorisé une industrie lourde et
fortement consommatrice en ressources naturelles. Les nombreux conflits ont
fait prendre conscience de la rareté de certaines ressources, voire
localement, de leur épuisement. Les premières catastrophes
industrielles et écologiques visibles (marées
noires12, pollution de l'air et des cours d'eau) conscientisent
l'opinion publique et certains décideurs sur l'importance de la
protection des écosystèmes et de l'environnement en
général.
Plus tard, dans les années 1970, les premier et
deuxième chocs pétroliers font prendre conscience de l'importance
stratégique de la bonne gestion des ressources et des
conséquences de la hausse de la consommation matérielle. A cet
effet, la préoccupation environnementale a permis l'adoption de
plusieurs textes de lois et de conventions tant internationales que
régionales.
Par ailleurs, ne serait-il pas important dans cette dynamique
de définir le terme « environnement » malgré la
diversité d'approches qui existe. Dans cette présente
étude, on peut citer l'approche du conseil international de la
langue française qui précise que l'environnement est comme :
« l'ensemble à un moment donné des agents physiques,
chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet
direct ou indirect, immédiats ou à terme sur les êtres
vivants et les activités humaines ». Il faut entendre à
partir de cette formulation que l'ensemble des éléments de la vie
sont liés fortement dont leur qualité et leur survie
dépendent de l'humanité. Il a le mérite de poser une
définition généraliste qui met en exergue les interactions
entre l'ensemble des agents économiques, sociaux et culturels.
Cette étroite relation qui existe entre toutes les
espèces vivantes et non vivantes, implique une attention toute
particulière à la préservation de chacune d'entre elles ;
car la disparition d'un
12 Les marées noires, qu'a connues le monde,
ont suscité plus de prise de conscience et de la nécessité
de protéger l'environnement contre les atteintes de l'homme. On peut
retenir le cas illustrant par l'accident de Torrey canyon en 1967 en Europe qui
pollua les côtes anglaises et déversa plus de 80 000 tonnes de
pétrole brute.
19
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
des éléments de l'environnement (du milieu) peut
bien provoquer des perturbations sur le système.
Toujours, est-il que les menaces sur l'environnement sont
nombreuses pour l'humanité au regard des accidents maritimes et
catastrophes naturelles ? Conscient, à cet effet, de la
nécessité de préserver l'environnement, des
réflexions importantes ont été poussées à
divers niveaux.
Ainsi à l'échelle internationale, plusieurs
textes relatifs à la protection de l'environnement marin et côtier
ont été adoptés : ils renvoient essentiellement à
un ensemble de normes édictées au plan externe et au plan
interne. C'est dans ce sens que le DPM, qui fait partie de l'environnement
marin et côtier, est soumis à un régime juridique visant
à le préserver de la destruction.
De nombreux textes sont intervenus avec pour but de
préserver la zone littorale en particulier les ressources d'une zone
d'importance d'eau douce. Il s'agit essentiellement de conventions
internationales (1) et de textes régionaux (2).
A-2. Les conventions internationales
Au cours de ces dernières décennies, l'Etat
sénégalais a ratifié plusieurs conventions internationales
qui sont relatives à l'environnement. Il faut noter que la codification
du droit de l'environnement a commencé au plan international avant son
intégration dans le dispositif juridique interne d'où
l'importance de ces instruments juridiques internationaux.
C'est ainsi que dans la gestion du littoral, certains de ces
textes s'appliquent entièrement ou partiellement. Toutefois, il convient
de signaler que dans leur grande majorité, ces normes internationales de
protection de l'environnement ne sont pas spécifiques au littoral mais
certaines de leurs parties peuvent concerner la gestion du littoral. C'est
ainsi qu'il y'a des conventions internationales ratifiées par l'Etat du
Sénégal applicables dans l'ordre juridique interne qui concernent
le littoral ou qui peuvent avoir des répercussions sur l'environnement
côtier et sur le littoral. Parmi ces conventions, on peut distinguer
certaines les plus largement appréciées par les Nations.
Il y'a la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982 à Montego Bay. Elle
définit les compétences de l'Etat notamment dans sa mer
territoriale, son plateau continental et sa zone contiguë.
20
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Cette Convention propose non seulement un ordre juridique
complet et nouveau pour les mers et les océans mais elle a
été également conçue et développée
comme un cadre juridique permanent. Elle touche à beaucoup de domaines
concernant le milieu marin. Ladite convention fait état, entre autres,
de la juridiction de l'Etat côtier sur les toutes ressources naturelles
à l'intérieur d'une Zone Economique Exclusive (ZEE), de la
responsabilité de l'Etat côtier pour la gestion de la pêche
dans la ZEE. Cette Convention dispose des boucliers juridiques de protection de
la mer par la mise en place de mesures de lutte contre les activités
susceptibles de porter atteintes à la mer et aux ressources. Le
Sénégal, un Etat côtier, l'a ratifiée depuis 1984.
En matière de gestion du littoral, celle-ci, à travers certaines
de ses dispositions, est applicable.
Toutefois, l'appréciation faite de cette convention
diffère selon les Etats, car les mers intérieures disposent des
ressources naturelles qui font souvent l'objet de concurrence pour certains
Etas frontaliers. Le manque de précision pose souvent des conflits de
compétences. Puis, La Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques de juin 1992 et le Protocole de Kyoto à
la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1997
ont été ratifiés par le Sénégal. Ces textes
sont d'une grande importance au regard de l'impact de la pollution sur
l'environnement et de l'effet des changements climatiques sur les zones
côtières et marines. Ainsi, ces changements climatiques ont des
impacts négatifs sur l'environnement marin et côtier puisque
l'élévation du niveau marin due à la fonte des glaciers
aura des répercussions directes sur les installations humaines
littorales ainsi que sur les écosystèmes insulaires et
côtiers.
Ensuite, l'Etat a de même ratifié la
Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau du 2
février 1971. Elle s'applique, entre autres, à tous les
rivages marins. Cette réglementation a un impact sur la gestion du
littoral en ce sens qu'il est un lieu d'habitat de beaucoup d'espèces
migratrices. La répartition géographique de ces dernières
au niveau du Sénégal concerne tout le littoral de Saint- Louis
à Ziguinchor, cependant, ces espèces se retrouvent surtout au
niveau du delta du fleuve Sénégal, et du delta du Saloum, plus
particulièrement au niveau des mangroves.
Il convient de noter qu'en plus des autres conventions
internationales ratifiées, le Sénégal a
intégré dans l'ordre juridique national la Convention sur
la biodiversité13. Il faut remarquer que la zone
littorale est d'une grande importance en ce qui concerne certaines
espèces marines
13 Convention sur la biodiversité de 1992.
21
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
et leurs habitats. C'est pourquoi, une gestion du littoral
doit intégrer forcement cette dimension, c'est-à-dire la faune et
la flore que l'on trouve dans cette zone. Cette énumération des
conventions internationales ratifiées ayant une incidence sur le
littoral n'est pas exhaustive. Celles qui retiennent notre attention de par
leur implication forte dans le dispositif juridique de protection des
écosystèmes marins et côtiers ont été
choisies.
Toujours est-il que, la préoccupation de la protection
des ressources naturelles constitue la toile de fond de la politique
environnementale du Sénégal. Dans ce sens, la convention des
Nations unies sur les Droits de la Mer de Montego Bay
en date du 10 décembre 1982 ratifiée par le
Sénégal, le 25 octobre 1984, se veut un acteur clé de la
protection des écosystèmes naturels.
Les normes exogènes applicables en matière de
protection juridique du littoral ne se limitent pas seulement aux textes de
portée internationale ; en effet, il y'a également les textes
à vocation régionale.
L'Afrique de l'ouest en particulière, également,
consciente des atteintes causées par les hydrocarbures et les hommes sur
l'environnement, s'inscrit dans une logique de préoccupations des
milieux naturels et du littoral en mettant en place un cadre juridique et
institutionnel de protection et de conservation de celui-ci.
A-3. Les textes régionaux
Puisque l'environnement est constitué de divers
domaines interdépendants et que les effets de sa
désagrégation ne connaissent pas de frontières, une
volonté de gérer la question environnementale aussi bien au plan
international qu'au niveau régional est réelle et apparente. Le
Continent africain n'est pas en reste. En effet, certaines institutions
envisagent l'intégration de la problématique environnementale
dans leur dispositif fonctionnel. Dans cette logique, l'Etat
sénégalais a ratifié des textes faisant
référence à l'environnement et parmi ceux-ci, certains
participent à la gestion et à la protection du littoral.
Ainsi, le Sénégal a ratifié la Convention
africaine sur la conservation de la nature adoptée en
Algérie le 15 septembre 1968 et entrée en
vigueur le 16 juin 1969 et complétée par la Convention de
Maputo de 2003. Ces conventions avaient pour but entre-autres
de protéger de manière globale la nature. C'est ainsi que
l'article II stipule « les contractants s'engagent à prendre des
mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le
22
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
développement des sols, des eaux, de la flore et des
ressources en faune, en se fondant sur des principes scientifiques et en
prenant en considération les intérêts majeurs de la
population ». Elles exigent aux contractants, de prendre
les mesures nécessaires pour conserver et améliorer le sol, pour
la prévention de la pollution et le contrôle de l'utilisation de
l'eau. Ces textes revêtent une importance en matière de protection
du littoral. Par ailleurs, Il convient de signaler que le PNUE (Programme des
Nations Unies pour l'Environnement), pour faire face aux besoins grandissants
en matière de gestion des océans, a mis en place et a
oeuvré pour le développement des Programmes des mers
Régionales lancés pour la première fois en 1974. Les
Programmes de Mers Régionales sont nés de la reconnaissance de
l'importance des ressources marines pour la croissance économique des
états et de la nécessité pour un besoin croissant d'une
meilleure gestion des ressources marines et des activités de recherches
scientifiques dans un cadre d'un plan régional convenu.
Un programme de mer régionale est initié
lorsqu'un groupe de pays ayant des préoccupations communes relatives aux
ressources côtières transfrontalières en partage
s'unissent, conviennent d'un Plan d'Action, d'une Convention ou des deux. Les
conventions peuvent disposer de protocoles portant particulièrement sur
des questions spécifiques.
Depuis 1974, des conventions et plans régionaux ont
été formulés. En Afrique, beaucoup d'états
côtiers participent aux conventions régionales sur les mers, le
Sénégal comme du reste. Ces accords régionaux ont
été très efficaces dans l'engagement des gouvernements
à la protection de l'environnement. Les Conventions régionales
sont détaillées, couvrant des questions allant de la pollution
due aux activités terrestres, des produits chimiques et du
développement côtier à la conservation de la
biodiversité marine et des écosystèmes entiers. Ainsi, la
Convention d'Abidjan pour la Coopération en
matière de Protection et de développement du Milieu Marin et
Côtier de la Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre,
adoptée le 23 mars 1982, est un accord cadre juridique
régional qui fournit des actions de coopération nationale et
régionale sur la protection et la mise en valeur des zones marines et
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
La Convention fait également provision pour la collaboration
scientifique et technologique (y compris l'échange d'informations et
d'expertises) pour l'identification et la gestion des questions
environnementales (ex. dans la lutte contre la pollution en cas d'urgence).
C'est le texte de base en matière de protection des zones
côtières et l'Etat du Sénégal l'a aussi
ratifiée.
23
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Dans cette perspective de gestion régionale des
problèmes environnementaux, il faut signaler que le
Sénégal est membre de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) et le chapitre IV du Protocole N° II du
Traité de l'UEMOA fait état d'une prise en compte par les Etats
membres de la question environnementale. C'est pourquoi, des accords sont mis
en place pour gérer l'environnement. La gestion du littoral est bien
prise en compte puisque un bon nombre de pays de l'UEMOA sont des Etats
côtiers et disposent par conséquent d'une zone littorale.
Le Sénégal, depuis son indépendance, a
participé à beaucoup de sommets et conférences
internationaux relatifs à la préservation de l'environnement.
Ceci a débouché sur la mise en place d'instruments juridiques qui
ont été ratifiés et qui sont extrêmement importants
au regard de leur place dans l'ordonnancement juridique. Ces conventions ont
donné naissance à plusieurs plans et programmes qui sont
applicables ou en cours d'exécution au Sénégal.
Certaines de ces normes, comme nous avons pu le voir,
concernent le littoral et par ricochet le DPM. Toutefois, la
réglementation mise sur pied ne se limite pas seulement aux textes
internationaux, en effet, des règles y relatives sont
édictées au plan interne.
L'étude de la réglementation mise à cet
effet, nous élucidera les contours au niveau interne des normes
spécifiques de protection de l'environnement et du DPM au
Sénégal. Des textes codifiés font référence
à la protection, à la gestion de l'environnement, à la
lutte contre les agressions de la nature, entre autres.
A- 4. Les textes nationaux
Plus personne ne peut réfuter l'importance et l'ampleur
des problèmes de l'environnement qui assaillent l'humanité
aujourd'hui. Jadis négligés, ils occupent actuellement une place
de choix sur la scène politique. Le Sénégal, à
l'instar des autres pays, n'est pas en reste dans cette logique de protection
de l'environnement et c'est dans ce sens que les pouvoirs publics ont mis sur
pied un cadre juridique visant la protection de toute la zone littorale y
inclus le DPM. Les textes édictés au plan national sont divers et
loin de faire une étude exhaustive quelques uns d'entre eux seront
étudiés du moins ceux les plus importants. De même, les
textes législatifs seront privilégiés.
24
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Avant tout, il faut remarquer que le DPM est soumis à
la législation foncière. Il s'agit de la loi sur le domaine de
l'Etat. La Loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du domaine
de l'Etat définit le domaine public maritime et, la zone
littorale faisant partie du domaine public naturel de l'Etat est ainsi
décrite (Loi 76-66, Livre II/Titre
Premier/Art. 5a) : « ..., les rivages de la mer couverts et
découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu'une zone de cent
mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus
fortes marées ».
Cette loi, en plus de définir le domaine public
maritime, fait état du régime de ces espaces qui peut
revêtir des aspects exorbitants. Le DPM est soumis au régime de la
domanialité publique qui se caractérise par son exorbitance
liée aux principes d'inaliénabilité et
d'imprescriptibilité qui s'appliquent à lui.
Le domaine public est formé des biens appartenant
à l'Etat qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée en
raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée. Il en
résulte que les biens du domaine public sont inaliénables et
imprescriptibles. A cet effet, l'Etat ne peut pas transférer un droit
à un tiers ni à titre onéreux ni à titre gratuit.
Par ailleurs, ces biens ne peuvent pas bénéficier d'une
prescription acquisitive. Toutefois, l'Etat peut bénéficier de
certains biens relevant du domaine public en les déclassant pour les
faire entrer dans son domaine privé.
Le domaine public, bien qu'insusceptible d'appropriation
privée, peut sous certaine conditions faire l'objet d'autorisations
d'occuper ou d'exploitation, ou de concessions (articles 11 à 14 du
CDE14).
Le régime de la domanialité publique doit
garantir en principe une protection au DPM en disposant des boucliers
juridiques et institutionnels efficaces.
Cependant comme l'environnement est un secteur
multidimensionnel et interdépendant, en plus du régime de la
domanialité publique, d'autres textes s'appliquent sur le DPM et ils ont
pour but de garantir une protection efficace et effective de l'environnement
sur cet espace. Après la législation foncière, il y'a
celle relative à l'environnement et elle se matérialise à
travers la Loi n° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de
l'environnement. Elle remplace et abroge la Loi 83-05 du 28 janvier
1983. Le contenu assez restrictif de cette dernière ne lui permettait
pas de prendre en compte tous les éléments fondamentaux de la
protection de l'environnement, et de constituer ainsi un texte de base servant
de loi-cadre au
14 Loi n° 76-66 du 2
juillet 1976, JORS.
25
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Sénégal. Par ailleurs, l'évolution de la
politique nationale de protection des ressources de l'environnement ainsi que
l'accroissement des normes et principes internationaux souscrits par le
Sénégal, rendaient nécessaires une refonte et une
actualisation du Code de l'environnement.
La loi de 200115 portant code de l'environnement
contient plusieurs dispositions qui peuvent être relatives à la
protection du littoral. En effet, le législateur prévoit des
mesures de prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances qui
concernent aussi le littoral. Ceci se concrétise par le classement de
certaines installations pour la protection de l'environnement, le respect des
règles environnementales par les établissements humains, la
gestion des déchets, l'obligation de procéder à
l'étude d'impact et l'établissement d'un plan d'urgence est
prévu en cas de situations de pollution grave. De même, des
règles sont établies pour la protection des milieux
récepteurs et concernant le littoral, il y'a des mesures de
prévention de la pollution des eaux, de la pollution et de la
dégradation des sols. Ainsi toutes ces normes participent à la
protection du littoral et pour garantir leur efficacité, des sanctions
pécuniaires, administratives et pénales sont prévues en
cas de violation.
On ne peut étudier ce thème sans pour autant
évoquer les lois de 1996 qui ont apporté des modifications
majeures dans la gestion de l'environnement et dans le foncier.
Au niveau du foncier et plus précisément en ce
qui concerne le DPM, les collectivités décentralisées
malgré l'approfondissement de la décentralisation en 1996 ont eu
peu de compétences en la matière. Ainsi, il convient de nuancer
l'implication des collectivités dans la gestion du DPM. Souvent, elles
peuvent donner leur avis quand les projets ou opérations initiés
sur le domaine public maritime se situent dans leur périmètre
foncier. De même, elles peuvent se voir déléguer les
compétences de gestion dans les zones du domaine public maritime
dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés
par l'Etat (articles 20 à 22 de la loi
n°96-07 portant
transfert de compétences aux collectivités locales du
Sénégal).
Le littoral est, pour les collectivités locales
côtières, d'une grande importance pour leur développement
économique et touristique mais la gestion du domaine maritime leur
échappe. En effet, elles ne sont que partiellement impliquées car
c'est l'Etat qui a la main mise en la matière.
Avec le nouveau régime des collectivités locales
est fixé par la loi 96-06 complétée par
la loi
15 Loi n°2001-01 du 15
janvier 2001, JORS, portant code de l'environnement de la République du
Sénégal.
26
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, communes et communautés rurales,
désormais, les collectivités locales détiennent des
compétences en matière d'environnement et de gestion des
ressources naturelles. Certaines de leurs attributions peuvent s'exercer dans
la zone littorale. Dès lors, les collectivités locales peuvent
être impliquées dans la gestion d'espaces relevant du DPM.
Toujours en poursuivant les dispositions juridiques relatives
à la gestion du DPM, il faut dire que l'Etat assure la partie la plus
importance. D'ailleurs certains domaines malgré les transferts de
compétences sont restés sous l'emprise du pouvoir Etatique. Pour
cela, il faut retenir les mines, l'eau et les carrières, matières
qui procurent une manne financière excrément colossale pour
l'Etat et les exploitants. Prudence a fait que l'Etat se donne la
compétence à assurer ces domaines intégralement. La
présence de ses ressources sur le DPM ne fait qu'intensifier leur main
mise de la part de l'Etat. A cet effet, le code minier entre souvent en
contradiction avec le code de l'environnement dont la préoccupation
consiste à la protection des biens de la nature. Il est prévu
même au Titre II de ce code de passer une étude d'impact
environnementale au préalable de tout projet de nature pouvant ou
à porter atteinte à l'environnement en place.
Mais les reformes institutionnelles et législatives
entamées depuis le processus de la décentralisation ont
donné beaucoup de légitimité aux collectivités
locales en matière de gestion du littoral et de l'environnement.
Désormais avec la loi 96-07, les collectivités locales
détiennent des compétences en matière d'environnement et
de gestion des ressources naturelles. Certaines de leurs attributions peuvent
s'exercer dans la zone littorale. Il peut s'agir de la création, de la
protection et de l'entretien des forets, des zones protégées et
des sites naturels. Ces dispositions ont une signification importante car on
remarque l'existence de forets et d'aires protégées le long du
littoral et leur importance est telle qu'il est primordial de les
préserver.
Il y'a aussi les attributions des dites collectivités
en matière d'élaboration et de mise en oeuvre des plans d'action
pour l'environnement. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y'a des
collectivités sur le long du littoral et qu'elles ont la
possibilité de planifier la gestion de l'environnement. A cet effet, la
zone côtière n'en est pas exclue.
Enfin, les collectivités décentralisées
sont concernées par la gestion des déchets. A ce niveau, celles
situées sur le long des côtes doivent veiller à ce qu'il
n'y ait pas de pollution ou de déversement de déchets ou
d'ordures sur le littoral.
27
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Cependant, il faut souligner que la mise en oeuvre des
compétences imprécises de la région, de la commune et de
la communauté rurale en matière de gestion foncière, de
planification, d'aménagement du territoire et d'urbanisme peut avoir des
répercussions sur la gestion de l'environnement et par conséquent
sur le littoral.
Il existe beaucoup d'autres textes législatifs
nationaux en vigueur en rapport avec la gestion de la zone
côtière. Il nous est impossible de les étudier
spécifiquement mais nous pouvons retenir que certaines de leurs
dispositions concernent le littoral et participent à sa protection
juridique. On peut citer, entre autres :
? La loi n° 65-32 du 19 mai 1965 relative à la police
des ports maritimes.
? La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l'eau ;
? La loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la
marine marchande ;
? La loi n° 85-14 du 25 février 1985 portant
délimitation de la mer territoriale, de la
zone contiguë et du plateau continental ;
? La loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la
Pêche maritime ;
Il faut le rappeler que toutes ces lois
précitées visent à protéger le littoral y comprises
les ressources naturelles existantes.
En effet, ces nombreux textes législatifs ont
été précisés par des décrets et
arrêtés d'application. A l'instar des normes externes relatives
à la protection de l'environnement, celles internes ont donné
naissance à divers plans et programmes visant à assurer une
effectivité de la protection du littoral. Cependant, il nous parait
intéressant de voir la mise en oeuvre de ce cadre juridique et de voir
s'il y'a réellement une effectivité de la protection du
littoral.
Par ailleurs, il faut noter que les dispositions juridiques
relatives à la protection du DPM et de l'environnement en
général sont nombreuses. Mais leur problème lié
à l'application faible des compétences dans la gestion de
l'environnement, nous poussent à étudier explicitement les
acteurs qui sont habilités à gérer ce domaine. Les zones
côtières et maritimes font l'objet d'occupations anarchiques,
d'agressions permanentes, de ce fait, on se demande qui gère le DPM ?
28
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
B. l'encadrement institutionnel
En raison de son écosystème fragilisé par
des actions anthropiques et l'intervention naturelle, les pouvoirs publics au
Sénégal ont mis en oeuvre, de l'indépendance
jusqu'à nos jours des actions/projets/programmes pour assurer la
protection de l'environnement.
La première étape est sans doute celle relative
à la ratification des conventions internationales signées
à Rio de Janeiro en 1992 (Convention sur la diversité biologique,
Convention-cadre sur les changements climatiques). Cette ratification peut
être considérée comme l'une des premières phases de
l'application des décisions de Rio 1992. Elle s'accompagne en même
temps de la définition des conditions de mise en oeuvre des principes
contenus dans l'agenda21. Mais en avant la participation du
Sénégal a cette conférence, une commission consultative de
la protection de la nature et de la conservation de l'environnement a
été créée et remplacé en 1971 par la
commission nationale de l'environnement. Cette dernière a
élaboré le premier programme du Sénégal dans le
domaine de l'environnement, qui sera présenté même à
Stockholm en 1972. Ainsi dés 1975, un décret portant sur
l'organisation du Ministère du Développement industriel et de
l'environnement crée la Direction de l'environnement.
Le Sénégal poursuivant son encadrement
institutionnel, va adopter dès 1993, le décret16
n°93885 du 4 août 1993, aussi il crée le Conseil
supérieur des ressources naturelles et de l'Environnement. Le rapport de
présentation du décret met largement l'accent sur les liens entre
protection de l'Environnement et effort de développement
économique et social au Sénégal. Le Conseil
supérieur est essentiellement un cadre de concertation chargé
sous la présidence du Premier Ministre, d'orienter l'action des
différents départements ministériels impliqués dans
la gestion des ressources naturelles et de l'Environnement. Il comprend trois
structures selon l'article 3 du décret n° 93-885 (JORS du 7
août 1993 ; p. 253).
? Un Conseil interministériel, organe de
décision.
? Un Comité permanent, organe de suivi.
? Un Secrétariat permanent, organe
d'exécution.
Le Conseil interministériel est présidé
par le Premier Ministre, tandis que le Comité permanent est
présidé par le Ministre chargé de l'Environnement
(articles 4 et 5 du décret). Quant au Secrétariat permanent, il
est dirigé par un coordonnateur national nommé par
arrêté du Ministre chargé de l'Environnement (article 11 du
décret).
16 Le décret n°93-885 du 4
août 1993 du JORS n° 5535 du 7 août 1993, pages 252 à
254.
29
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
En 1995, sera également créée la
Commission Nationale du Développement Durable (CNDD) par
arrêté de la primature n°5161 du 26 Mai 1995. Cette
Commission s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du
Sommet de Rio 1992. Elle est présidée par le Ministère
chargé des Affaires Etrangères. Son Secrétariat est
assuré par la Direction de l'Environnement et des Etablissements
Classés. Cette direction aussi a pour mandat d'assurer le suivi et
l'évaluation des recommandations de la Conférence de Rio 1992,
L'attribution principale de la CNDD17 consiste
à développer la réflexion sur les conditions de mise en
oeuvre du Développement Durable au Sénégal. C'est la
raison pour laquelle la CNDD regroupe en plus de l'Etat, des acteurs
variés. Ces derniers peuvent être du secteur privé,
à savoir des ONG, des Collectivités Locales, de la
Communauté Scientifique, des Organisations Féminines, des
Mouvements de Jeunesse, des Syndicats, des Parlementaires, etc. Ce sont les
rapports que la commission produit régulièrement au
Sénégal en collaboration avec ces acteurs cités
précédemment. Chacune de ses réunions qui constituent ses
instruments de travail. Les résultats de la CNDD sont malheureusement
très limités de nos jours compte tenu de la faiblesse des moyens
dont elle dispose, et de l'ineffectivité des rapports dans la pratique.
L'évolution institutionnelle est également marquée par des
reformes incessantes du secteur de l'Environnement dans les différents
départements ministériels consécutivement aux nombreux
remaniements ministériels. Ces fréquents remaniements sont
d'ailleurs quelquefois préjudiciables à une bonne
définition de la politique de l'environnement. Une bonne illustration de
ce phénomène est l'actuelle dénomination du
ministère : Ministère de la Jeunesse, de l'Environnement et de
l'Hygiène Publique (la politique de l'environnement est diluée
dans celle plus médiatisée de la Jeunesse et de l'Hygiène
Publique18).
En plus de la CNDD, d'autres structures ont été
créées pour renforcer le cadre institutionnel de gestion de
l'environnement au Sénégal. Il s'agit de la Direction des Parcs
Nationaux (DPN), la direction de l'environnement et des Etablissements
classés (DEEC) et la Direction des Eaux et Forêts, de Chasse et de
la Conservation des Sols (DEFCCS). Aujourd'hui, l'accent est mis sur la
création des Aires Marines protégées dans les cinq
régions, du pays.
Toujours, est-il vrai que malgré le dispositif
institutionnel large existant, les résultats escomptés en
matière de protection de la biodiversité, sont loin d'être
atteints, d'où une existence quelques fois d'organisations ou
associations de base plus proche des populations.
17 Commission Nationale pour le
Développement Durable crée en 1995 pour assurer la mise en oeuvre
des décisions de RIO. Elle est composée de 03 sous commissions.
Une sous-commission Orientation, Une sous-commission
Suivi-évaluation, Une sous-commission Etude de
Projets.
18 Rapport du professeur agrégé de
droit public, Ibrahima LY, sur les règles institutionnelles et
juridiques du Sénégal dans l'évolution de la politique de
protection de l'environnement.
30
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
SECTION II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT SUR LE DPM
L'identification des problèmes relatifs à la
gestion de l'environnement sur le littoral s'analyse à travers deux
paragraphes essentiels. D'une part, l'étude porte sur les
problèmes d'ordre environnemental et ceux relatifs à
l'application des textes juridiques. Aussi le degré de pollution de
l'environnement se mesure à travers l'analyse des impacts provenant des
atteintes sur l'environnement.
Para I. Les difficultés de la gestion du DPM et ses
impacts
L'état de la situation du DPM s'analyse sur une double
dimension : d'abord sur le plan environnemental ensuite sur le plan
organisationnel et fonctionnel.
A. les problèmes environnementaux
L'analyse de la situation environnementale de la grande
côte nous renvoie à spécifier les différents
problèmes surtout les plus fréquents (pollution marine,
érosion côtière, les inondations) qui menacent le littoral
malgré l'attraction humaine.
De par sa position géographique océanique, le
Sénégal est directement confronté, sur le plan
environnemental, aux changements climatiques qui affectent l'ensemble de la
planète. A cela s'ajoute, la concentration de l'activité
économique et la forte densité sur le littoral constituent des
facteurs aggravants pour l'érosion côtière, l'expansion des
zones inondables et la progression de la contamination des nappes
phréatiques par la remontée des eaux marines (biseau salé)
de la région de Dakar. En effet, cette étude portant
particulièrement sur la région des Niayes avec des conditions
naturelles favorables à la production horticole aura certainement des
contraintes relatives à la promotion de la culture
maraîchère en raison des facteurs précités.
Le littoral fortement fragilisé par une mainmise
humaine exacerbée, subit également une érosion marine
entrainant une régression constante de la ligne de rivage, de 1,30m
environ par an sur les côtes sableuses. Des indices visibles d'une
élévation continue du niveau de la mer
31
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
sont, en effet, manifestes dans la partie du littoral
fortement érodée ou l'on assiste à la destruction
d'installations humaines (le quartier de Thiawlene en Rufisque).
Les problèmes environnementaux sont
évalués aussi au niveau de l'activité de pèche
pratiquée sur le littoral. Certains pêcheurs vont jusqu'à
faire usage d'explosifs ou de filets à mailles interdites pour capter
plus de poissons. En effet, la question ambigüe de la reconstitution de
certaines espèces très prisées constitue une menace pour
le devenir économique des pêcheurs locaux, obligés soit de
s'éloigner des côtes ou de changer de métiers. Or, le
coût à terme de ces accords, au travers des impacts
environnementaux, de l'amoindrissement des stocks de poissons et de la perte de
revenus des pécheurs locaux dépasse largement l'apport financier
immédiat.
En plus de la menace sur la biodiversité des
écosystèmes marins, le littoral particulièrement, les
zones de plages font l'objet de dépotoirs. Cela pose en effet un
problème réel de conservation et de salubrité de nos
plages. Le problème de la pollution des baies devient de plus en plus
fréquent avec des conséquences néfastes sur la
santé publique et sur l'environnement. La gestion urbaine
entravée par une occupation anarchique sur des sites du DPM
génère des contraintes immenses pour les acteurs à assurer
une bonne gestion de ses espaces humanisés. Ces populations
déversent quotidiennement des eaux usées domestiques et
industrielles (contenant des hydrocarbures), ce qui accentue la pollution
marine. Cette pollution est aussi aggravée par le trafic maritime au
large des côtes de Dakar.
Concernant les déchets solides, certaines populations
de façon frauduleuse les rejettent sur le littoral car souvent elles
manquent de moyens de collectes ou de ramassages des ordures. Cette pratique
à la longue entraine une pollution du substrat (végétation
et sols).
De façon générale, il faut dire que les
pollutions écologiques (pollution de l'air, érosion et
salinisation des sols, urbanisation anarchique et incontrôlée)
s'aggravent de plus en plus sur le domaine maritime. Les sols subissent de
fortement pression liée à l'action industrielle et humaine, sont
tendances à perdre leur richesse écologique. Ainsi, autant de
problèmes dont les causes sont à rechercher pour la plupart dans
les actions anthropiques, affectent le développement économique
de la région.
Par ailleurs, l'application des lois et règles de
gestion de l'environnement fait l'objet de contraintes majeures d'où
l'intérêt de l'analyse suivante.
32
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
B. Les contraintes textuelles et institutionnelles
Elles s'analysent autour de deux contraintes essentielles dont
: textuelles et institutionnelles. Les textes adoptés pour
protéger les ressources naturelles sont pléthores, cependant
l'application pose un sérieux problème. Il s'agit, à cet
effet, d'appréhender les perspectives de solutions aux problèmes
d'application des textes d'une part et d'autre part au plan organisationnel et
structurel des instituts en charge de la gestion de l'environnement au
Sénégal.
Les difficultés textuelles se mesurent à travers
l'application qui fait ressortir des insuffisances.
B-1. Les insuffisances textuelles
Un nombre important d'instruments juridiques a
été mis en place pour permettre d'éviter toutes pollutions
et nuisances sur l'environnement côtier. Toutefois, certains de ces
textes présentent une imprécision qui peut constituer un frein
à une protection efficace. En plus, il y a une absence d'harmonisation
de toutes les dispositions relatives au littoral contenues dans l'ensemble des
textes.
Du fait de l'imprécision des textes, l'Etat et les
collectivités locales ; chacun détient des prérogatives et
des compétences pouvant s'appliquer dans le cadre de l'environnement et
des ressources naturelles. Des conflits peuvent gérer dans la gestion de
l'environnement sur le DPM, car beaucoup de conseillers manquent de
capacités d'interprétation des textes. Aussi les populations
ignorent le sens et le contenu des lois transférées.
Or, il faut comprendre que c'est sur une bonne partie du
domaine public maritime que les activités touristiques et
économiques se développent.
De prime abord, il convient de remarquer que la
définition portant sur le domaine public maritime fournit par le Code du
domaine de l'Etat (loi n°76-66 du 02 juillet 1976), complété
par le Code de la Marine Marchande (loi n°2002-22 du 16 août 2002),
stipule que le DPM se limite à 100m des rivages des hautes
marées. Ainsi, le DPM faisant partie du domaine public naturel de l'Etat
et désigne selon la Loi 76-66, Livre II/Titre Premier/Art. 5a : «
..., les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus
fortes marées, ainsi qu'une zone de cent mètres de large à
partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ». Or,
Les lignes de côte évoluent et changent en fonction des saisons.
Malgré cet effort de définition, ce texte
33
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
souffre d'ambiguïtés quant à la
détermination des limites physiques de ce domaine, aux modalités
d'occupation et d'exploitation de cette zone.
En second lieu, on peut évoquer la loi n° 96-07 du
22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités
locales. La décentralisation, à travers la
régionalisation, a débouché non seulement sur
l'implication des collectivités locales dans la gestion de
l'environnement mais également sur un transfert de compétences en
matière du foncier, d'urbanisme, de la planification et
d'aménagement du territoire. Ces dernières compétences
sont en lien avec la gestion environnementale. Ceci a des répercussions
sur la gestion du littoral car désormais l'exercice par les dites
collectivités de leurs compétences en matière de foncier,
d'urbanisme et d'aménagement peut concerner le littoral. Cependant, le
législateur n'est explicite sur ce point puisqu'il ne mentionne pas
clairement l'étendue des compétences locales concernant le
littoral, ce qui est source d'incertitude. Il faut préciser que les
compétences en matière d'environnement, d'urbanisme, de
planification et d'aménagement du territoire ne s'excluent pas mais sont
plutôt liées pour ce qui est de la zone littorale.
De plus, il s'y ajoute le fait que le domaine d'intervention
de l'Etat et des collectivités locales n'est pas clairement
défini et que chacun détient des prérogatives et des
compétences pouvant s'exercer dans la gestion de l'environnement.
Pour ce qui est de l'absence d'harmonisation des textes, on
peut évoquer le nombre élevé de textes contenant des
dispositions sur le littoral. En effet, il n'existe pas au
Sénégal un texte qui traite uniquement du littoral et qui
intègre tout ce qui le concerne. De cette situation découle des
difficultés car il y a une dispersion des règles. On peut citer
l'exemple du foncier où différents régimes s'appliquent en
plus de celui régissant le domaine public maritime.
Aussi, il faut noter que le transfert de compétences de
1996 a apporté des modifications et des changements majeurs. Dès
lors, il apparaît une nécessité de mettre à jour la
législation relative à ces secteurs transférés qui
peuvent concerner l'environnement côtier lorsque nous savons que la
plupart des lois sont antérieures au transfert de compétences (on
peut donner l'exemple de l'urbanisme, de la gestion domaniale entre autres).
Espérons que le nouveau projet de loi littorale en
cours d'élaboration pour le vote du législateur prendrai en
compte toutes ses imprécisions textuelles et tachera d'harmoniser les
dispositions juridiques qui régissent la protection du littoral.
34
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Au niveau des contraintes d'ordre textuel, les
difficultés ne sont pas uniquement spécifiques à la nature
des textes. En effet, elles résultent également de l'application
défectueuse qui en est faite. Les institutions en charge de
l'application des textes subissent des contraintes de fonctionnement et
même dans l'organisation de leur intervention.
B.2 Les difficultés organisationnelle et
fonctionnelle
Sur l'ensemble du littoral, le mode de gestion le plus
étendu est de loin la gestion par l'Etat, notamment lorsque le DPM est
naturel. Mais par voie de fait ou de droit l'Etat peut déléguer
à une collectivité locale ou un organisme la gestion de
l'environnement sur le DPM.
Ainsi, dans le cadre de la politique environnementale
initiée par les pouvoirs publics au Sénégal consistant
à la responsabilisation des acteurs à la base, il a
été procédé à la mise en place du conseil
local de pêche artisanale à khayar. Ses objectifs s'inscrivent
dans le cadre de la gestion des ressources halieutiques et de la protection des
plages contre l'insalubrité.
Dans leurs activités, ils sont aidés par le
World Wide Foundation (WWF), afin de renforcer l'hygiène et la
salubrité au sein des communautés des pêcheurs,
véhiculer la communication en direction des pécheurs. Leurs
activités s'inscrivent également dans la gestion participative
des ressources halieutiques.
A l'instar du conseil local de khayar, plusieurs
associations/organisations locales ont été créés au
Sénégal au lendemain du sommet de RIO, lesquelles ont
suscité la volonté des pouvoirs publics à prendre plus de
considération à l'environnement.
Pour la plupart des institutions mises en place, leur
architecture organisationnelle n'est pas souvent décriée sauf
à l'interne quelques guéguerres entre les membres pour de
positionnement ou prises de décisions sont notoires. Mais ces quelques
problèmes ne sont pas pour autant négligeables d'affecter le
fonctionnement de la structure. Parmi ceux-ci, on peut retenir essentiellement
le manque de moyens d'action des acteurs, le manque de coordination, entre
autres. L'impression des textes environnementaux aussi n'est pas non
négligeable.
35
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Ali Aidar, le Directeur de l'Océanium19
depuis 1984, parle d'inexistence de gardes de contrôles des côtes.
Il y a tantôt le manque de coordination des différentes
associations qui interviennent pour la protection du littoral. Chaque quartier
de Dakar qui est concerné directement par les problèmes du
littoral tente de s'organiser en partenariat avec l'Etat ou avec des
organisations non gouvernementales pour veiller au respect de la protection du
littoral. Souvent aussi les objectifs des uns et des autres ne se recoupent
pas. D'aucuns acteurs/associations de défense de l'environnement jugeant
que l'environnement est très prisé par les bailleurs pour
bénéficier des financements. Au fond, tous ne sont pas
animés par l'esprit de lutter pour la conservation de la
biodiversité mais plutôt par des intérêts
financiers.
Toujours, dans le cadre du fonctionnement, l'association comme
And Soukhaly Yarakh, crée le 4 juin 1999, s'est donnée pour
objectifs suivants : de mettre en oeuvre des stratégies susceptibles de
renforcer la réhabilitation de la Baie de Hann, de développer des
programmes d'éducation environnementale pour un changement de
comportements des habitants. Elle fonctionne avec 100 membres repartis dans un
bureau exécutif et directeur. Elle est dirigée par un
président renouvelable tous les deux ans après un vote des
membres. Pour atteindre ses objectifs, l'association a d'abord misé sur
les activités socioculturelles comme vecteur de sensibilisation :
organisations de régates et semaines culturelles avec des animations
musicales, combats de lutte. Pour bien fonctionner, elle a toujours besoin de
l'appui financier et technique de l'Etat et des ONG oeuvrant dans ce sens. Cet
appui est de loin équitable aux besoins de fonctionnement et d'actions
des associations.
De façon générale, les institutions qui
interviennent sur le littoral, publiques ou privées sont toutes
confrontées à un manque de moyens d'action et de capacités
techniques pour atteindre leurs objectifs fixés. Malgré l'appui
de l'Etat ou des partenaires (ONG, OIG), les difficultés sont encore
manifestes car la pollution et les agressions marines continuent de jour en
jour.
Ces atteintes portant sur l'environnement au niveau du littoral
génèrent des impacts nombreux dont on peut distinguer
principalement ceux sur les activités socioéconomiques et sur
l'environnement marin. Pour mieux saisir ces impacts, le paragraphe II y sera
consacré dans les lignes suivantes.
19 Un centre de plongée et association de
protection des ressources marines, dirigé par cet écologiste et
politicien de surcroit, d'origine libanaise.
36
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Para II. Les principaux impacts
Au Sénégal, les problèmes de gestion du
littoral sont devenus récurrents. Ils entrainent des impacts
socio-économiques d'une part et d'autre part environnementaux. Ces
problèmes posent, en effet, des questions urgentes et cruciales de prise
de conscience de la part des populations et de prise en charge de la part des
pouvoirs publics.
A. les impacts socio-économiques
La pollution maritime représente une grande partie des
atteintes sur l'environnement au Sénégal. Elle se
caractérise par le manque de civisme des résidents qui
considèrent la mer comme la poubelle. Les déchets plastiques sont
rejetés régulièrement dans la mer. Ceux-ci se
déposent sur les fonds marins et aux abords et étouffent un
milieu naturel fragile, Selon Datta Ba20. La zone la plus tristement
célèbre de la pollution marine reste la baie de Hann qui
autrefois fondait sa réputation sur son tourisme balnéaire. En
effet, la densité du tissu industriel localisé sur la baie de
Hann, traduit les nuages de fumées quotidiennes dont les
problèmes sanitaires sont largement observables. Ces différentes
pollutions produites sur la zone du DPM (côtière et franche
maritime), génèrent des impacts sur les activités
socio-économiques à l' avenir, car il faut se dire la pollution
à un certain degré peut être source d'interdiction
d'accès et de production industrielle.
20 Ingénieur à la Direction de
l'Environnement, in les cahiers de l'Alternance : le défi de
l'environnement, N° 12, janvier 2009.
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Photo 1 : la pollution industrielle sur la
Baie
|
A l'image de cette photo prise sur la Baie de Hann, ou l'on
observe a perte de vue les fumées d'une des nombreuses industries qui
jalonnent les alentours de la baie.
Ces activités industrielles, par nature,
génèrent de grandes quantités de déchets liquides
qui aboutissent systématiquement aux pieds des habitations
littorales.
|
37
Les impacts de toutes ces pollutions peuvent être
dramatiques pour l'écosystème marin mais surtout pour
l'économie sénégalaise. Nos côtes constituent les
zones les plus poissonneuses du fait de leur faible profondeur ce qui favorise
l'activité de pêche. Cette dernière offre des recettes
importantes à l'Etat et aux acteurs du secteur. Aussi elle contribue
pour environ 4,6% à la formation du PIB. Mais, cependant en raison des
activités d'exploitation surélevée, les bancs de poisson
commencent à subir des baisses de la quantité de leur
réserve halieutique. Par conséquent, le Sénégal
pourrait, bientôt si rien n'est fait, connaitre une raréfaction de
poissons car il y a risque d'eutrophisation21 c'est-à-dire un
développement excessif d'algues. Ce phénomène entraine la
raréfaction de poissons.
Ainsi, beaucoup de pécheurs sont convertis à
d'autres métiers nouveaux. D'ailleurs des études ont fait le
rapprochement étroit entre les vagues de migrations clandestines
enregistrés ces dernières années avec la baisse
considérable du volume des débarquements.
21 Ya lieu lors qu'on assiste la baisse de la
quantité de l'oxygène dissous quand s'augmentent les
débris organiques et nutritifs dans les eaux.
38
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Les problèmes d'érosion côtière ne
manquent pas aussi d'impacts socio économiques néfastes. Selon le
Directeur des services techniques de la ville de Rufisque, les autorités
étatiques et municipales sont bien conscientes de la situation portant
sur l'évolution du littoral. Elle se traduit par l'avancée de la
mer de 1917 à 1980 entre 0,7 et 1,30m par an. En plus, d'autres
études font montre de l'avance de la mer par année sur 1m
environ. De ce fait, des impacts socio économiques sont imminents et
peuvent se traduire également par des destructions d'installations
humaines et industrielles. A titre d'exemples, les populations du quartier de
Thiawlene sont exposées à des vagues quotidiennement violentes
aux risques de perdre leur habitation. Certaines ont même quitté
pour une autre contrée plus sûre.
Aussi, il faut comprendre que le littoral en concentrant
l'essentiel des activités économiques est susceptible de
compromettre le développement si des solutions idoines et rapides ne
sont pas prises. Le tourisme, le commerce, le trafic maritime, entre autres
activités risquent bientôt de subir les impacts liés
à la rareté des produits halieutiques sur le littoral. De ces
impacts, on peut retenir, les conflits récents entre les pêcheurs
Guet-Ndar et l'Etat de la Mauritanie ou de la Guinée qui les a
assignés en prison sous peine de payer de lourdes amendes. Les
insuffisances de poissons sur nos côtes poussent les pêcheurs
à s'aventurer dans d'autres zones risquées. Il faut dire que les
impacts seront plus visibles sur la société
sénégalaise en particulier sur les populations qui s'activent
dans ce métier sur rien n'est fait au plus vite. Les actions humaines et
naturelles susceptibles de portée un dommage à l'environnement ne
sont pas en reste.
B. les impacts environnementaux
Les difficultés notoires dans le fonctionnement des
services chargés de veiller à la protection de l'environnement
traduisent des impacts environnementaux. On peut citer l'insalubrité
marine et côtière qui touche pratiquement toutes les baies du
Sénégal.
Les écosystèmes marins et côtiers, en
effet, font l'objet de pollution qui affecte la propreté des plages
ainsi que la reproduction biologique du milieu marin.
En mer, la surpêche industrielle pratiquée par
les chalutiers Européens et Asiatiques a occasionné la diminution
de la taille des bancs de poisson dans les réserves des zones les
plus
39
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
productives. Les impacts biologiques partent de la diminution
des poissons à une disparition de certaines espèces
menacées aujourd'hui d'extinction.
Puis, les rejets de déchets chimiques et solides
produisent des odeurs nauséabondes susceptibles de porter atteinte
à la santé humaine et des espèces existantes. Souvent les
rejets d'ordures sont décomposés dans les fonds marins et
polluent tout l'environnement marin et côtier. Pourtant le Code de
l'environnement de la loi n° 2001-01 interdit, je le cite : «
tous rejets à partir de la côte d'eaux, et toutes
substances usées, de déchets industrielles
pouvant entrainer la pollution des plages et des
zones littorales. »
Par ailleurs, les nombreuses activités
socio-économiques et touristiques sur le long du littoral produisent des
effets directs sur l'équilibre écologique du milieu marin. Les
grandes industries chimiques qui rejettent leurs résidus dans la mer
sans traitement, selon Ali Aidar entraine la pollution
chimique. Cette pollution aura sans doute des impacts négatifs sur la
santé humaine pour les populations qui y nagent. Puis de cette
pollution, les poissons sont susceptibles d'être gravement atteints de
problèmes sanitaires contaminables aux consommateurs. A cela, s'ajoute,
la raréfaction des captures qui peuvent en découler de la
surpêche. Pas des moindres, les impacts environnementaux peuvent affecter
les ressources aquifères de la zone des Niayes surtout que les nappes
d'eau restent peu profondes.
Par ailleurs, à proximité de Hann-Pêcheur,
les promeneurs peuvent observer une petite colline de déchets, attendant
un improbable récupérateur. En effet, la baie de Hann est
touchée par une forme d'envahissement détritique dont les
conséquences sont essentiellement visuelles, esthétiques :
bouteilles plastiques, sacs et autres débris de la consommation
quotidienne constituent une première famille de pollution. Egalement,
les constructions sur les zones du DPM (les rivages de la mer), favorisent
l'érosion des sols et rochers marins susceptibles de limiter
l'avancée des eaux marines.
Cette érosion est aggravée par les extractions
de sables marins dont certains charretiers font l'objet d'activités
quotidiennes.
Ainsi, en vue de réduire les impacts négatifs
à tous les niveaux, des solutions idoines doivent être prises
très rapidement pour affirmer les propos de l'écologiste Ali
Aidar.
40
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Conclusion partielle
Les agressions humaines et industrielles d'une part et d'autre
part les insuffisances au niveau de l'encadrement juridique et institutionnel
précédemment étudiées, nous permettent de
déceler que l'environnement sur le DPM subit des contraintes majeures.
Le littoral au Sénégal (la grande côte
particulièrement) constitue aujourd'hui une zone d'attraction car les
enjeux sont énormes pour les populations. Cette compétition sur
les ressources du DPM provoque des problèmes dont les impacts demeurent
variables. On peut citer entre autres, les impacts socio-économiques et
ceux environnementaux. Ainsi, pour mieux pallier les problèmes, il
convient de façon indispensable d'appréhender des contraintes qui
affectent le milieu marin et côtier de la grande côte.
La deuxième partie de cette étude sera
consacrée à proposer des mesures d'amélioration du travail
des institutions en vue d'une bonne gestion de l'environnement
éventuellement.
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
41
PARTIE II :
LES PERSPECTIVES DE SOLUTIONS ET
AMELIORATION DE LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT SUR LE DPM
42
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
L'analyse portant sur la gestion de l'environnement (section
II, partie I) fait montre des problèmes à plusieurs niveaux.
Seulement sont plus essentiels, ceux relatifs à l'environnement
côtier et marin d'une part et d'autre part ceux socio-économiques,
car c'est ceux-là mêmes que les impacts sont plus ressentis.
En effet, La prise de conscience de l'importance de la
protection de l'environnement côtier et marin a permis aux pouvoirs
publics et aux associations de défense de l'environnement de mettre en
place des instruments juridiques et organisationnels pour remédier aux
difficultés. Cette présente partie (II) s'analyse en termes de
perspectives de solutions d'une part et d'autre part l'amélioration de
la gestion du DPM par la mise en place des instruments efficaces et pertinents
(Section II).
SECTION I. LES PERSPECTIVES DE GESTION DU DPM
Les problèmes notoires dans la protection de
l'environnement sur le DPM ont une origine interne et externe. Ceci nous pousse
à orienter les perspectives de la gestion de l'environnement dans la
résolution des problèmes clés.
Para I : les perspectives d'ordre environnemental
Elles sont appréhendées à travers les
changements climatiques (A) et la pollution marine (B)
A. Nécessité d'adaptation des changements
climatiques
Gérer l'environnement dans la zone côtière
est difficile en ce sens que le problème ne se limite pas seulement
à l'Etat. En effet, la pollution de l'atmosphère débouche
sur le réchauffement climatique qui a un effet dévastateur sur
l'environnement côtier. La Communauté internationale a
commencé à manifester de l'intérêt pour les
changements climatiques depuis quelques décennies et bon nombre de
conventions sont intervenues dans ce sens. La lutte est axée sur les
changements climatiques attribués directement ou pas à une
activité humaine altérant la composition de l'atmosphère.
Les Etats ont reconnu l'urgence de stabiliser les concentrations de gaz
à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique.
43
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
La pollution atmosphérique engendrée par ce type
de gaz a conduit au réchauffement du climat qui, accentue
l'érosion côtière car il y a une élévation du
niveau de la mer due à la fonte des glaciers. L'élévation
du niveau de la mer a des répercussions directes sur les installations
humaines littorales ainsi que les écosystèmes insulaires et
côtiers. Le Sénégal est confronté au problème
de l'érosion. Des études22 réalisées sur
les impacts des changements climatiques ont montré que les taux
d'élévation du niveau de la mer pourraient conduire à une
accélération de l'érosion côtière, à
des inondations des zones côtières basses (par exemple les
estuaires à mangrove) et à une salinisation23 accrue
des sols et des eaux de surface et souterraines. Ces risques se multiplient
avec la fréquence accrue des épisodes
météorologiques exceptionnels tels que les ondes de
tempêtes capables de dresser les pirogues à la côte ou de
provoquer la rupture de cordons dunaires. On sait, par ailleurs, que le
réchauffement de la température des mers influe
négativement sur la productivité des océans et la
dynamique des courants tels que le courant profond originaire de l'antarctique
et qui exporte vers le Sénégal et les autres pays de la
sous-région des sels nutritifs présents dans les upwellings. On
observe également une diminution de la puissance des alizés qui
pourrait avoir des répercussions directes sur la force des upwellings et
donc sur la productivité des pêcheries et du milieu marin en
général.
Les conséquences d'un tel processus sont nuisibles pour
l'environnement marin et côtier et de tels effets commencent à
être visibles sur le littoral, il est observé un recul du littoral
à raison de 1 à 1,30m/an en moyenne provoquant la destruction
d'habitations et d'infrastructures en particulier dans la presqu'île du
Cap-Vert, la Grande Côte en particulière. A ce niveau, les
difficultés découlant du réchauffement climatique
transcendent les Etats et étayent de fort belle manière
l'assertion selon laquelle « la pollution ne connait pas de
frontières ». Il convient ainsi pour les Etats d'initier des
mesures d'adaptation aux changements climatiques. Pour cela, des services de
contrôles permanents des plages, des digues de protection, entre autres,
doivent être installées sur les côtes afin de stopper
l'avancée des eaux de la mer. L'adaptation aux climats changeant doit
conduire aux populations à muer leur comportement vis-à-vis de
l'environnement et des ressources naturelles. Les consommations en poisson au
Sénégal s'estiment à 27 Kg par personne en moyenne par an
; cependant l'adaptation consistera à substituer ce produit à
d'autres beaucoup moins menacé de dégradation. Entre autres, les
comportements d'adaptation peuvent se traduire par la mise en place
d'éco-village
22 IRD de Dakar en 2010, décembre. Rapport
annuel sur les changements climatiques.
23 Cours de géographie morphologique de la
faculté de lettres et sciences humaines, UCAD, 2008.
44
Mater II, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
afin que chaque localité puisse protéger ou
disposer de comité permanent de gestion des ressources disponibles.
B. la lutte contre la pollution de l'environnement
marin et côtier
La protection des équilibres biologiques et
écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation
des sites et paysages du patrimoine sur le DPM constituent des visés
notoires aboutissant à l'élaboration de plusieurs textes
législatifs et réglementaires. Au Sénégal, la loi
sur le domaine de l'Etat (n°76-66) interdit toute construction et
installation nouvelle à moins de 100 mètres du rivage en dehors
des zones urbanisées. Ainsi, l'ARTICLE L 69 dispose
: « L'autorisation d'occupation du domaine public ne doit entraver ni
le libre accès aux domaines public maritime et fluvial, ni la libre
circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de
dégradation du site. Seules sont autorisées sur les domaines
public, maritime et fluvial, à titre d'occupations privatives, les
installations légères et démontables. »
Mais en réalité, diverses activités
industrielles et humaines pullulent sur les espaces situés à ce
niveau. Cela, en effet, a fait l'objet de beaucoup de débats dont
l'essentiel incrimine la responsabilité aux autorités politiques.
Ces activités causent des atteintes à l'environnement : allant de
la pollution à la dégradation de l'écosystème marin
et côtier.
En effet, la pollution désigne la dégradation
d'un biotope par l'introduction, généralement humaine, de
substances ou de radiations, entrainant une perturbation plus ou moins
importante de l'écosystème. Au Sénégal, les formes
de pollution les plus répandues sur le DPM sont d'origine humaine
directement ou indirectement. On peut citer l'exemple de la Baie de Hann, il y
a quelques années encore, le niveau de pollution inquiété
fort bien les populations locales et les autorités au point que le site
était interdit d'accès. Ainsi, la pollution portant sur
l'environnement, il faut cependant souligner qu'elle génère des
impacts négatifs comme en témoigne le réchauffement
climatique aujourd'hui entrainant des maladies inconnues jusqu'alors dans
certaines zones éco géographiques. Par-dessus, les inondations
permanentes avec tout leur cortège de problèmes sont
présentées comme l'un des phénomènes nés des
actions anthropiques sur l'environnement. Aussi, toujours est-il que les
activités humaines sur le DPM causent des érosions maritimes ou
du moins favorisent l'érosion sur les côtes susceptibles de
protéger les habitations contre l'avancée des eaux de la mer. De
telle
45
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
pratique en passant par l'extraction du sable marin, des
roches calcaires, sont fréquentes sur les littorales de Dakar à
saint louis.
A cet effet, en vue de protéger les côtes et
par-dessus les populations, la gestion de l'environnement marin et côtier
demeure plus qu'une nécessité mais une obligation. Les impacts de
l'homme sur l'environnement sont multiples et variés. Quasiment tous les
éléments constituants l'environnement sont touchés par les
activités humaines. Ainsi, il convient de mettre en place des
stratégies et des mesures appropriées en vue d'une gestion
efficace des ressources naturelles et de l'environnement. Cela demeure une
nécessité incontournable pour l'homme s'il souhaite assurer la
continuité de l'humanité. Actuellement la gestion de
l'environnement est compromise par les nombreuses agressions portant sur ce
dernier. Les catastrophes ainsi que les accidents maritimes sont sources de
problèmes qui préoccupent les autorités à la mise
en place de mesures appropriées visant à assurer la
pérennisation des ressources maritimes.
Pour ce faire, des mesures incitatives économiquement
doivent être appliquées. Il s'agit des études d'impacts
environnementales, des audits environnementaux, entre autres.
Par ailleurs, devant l'urgence pour les autorités
Etatiques à répondre à la demande d'urbanisation et la
menace de pollution que génèrent les activités humaines
sur le DPM, l'on s'interroge : Que faire ?
Para II. Les perspectives de concilier la protection de
l'environnement avec les activités socio-économiques
La protection de l'environnement demeure une
préoccupation universelle, mais le développement
économique des nations en est une autre. A cet effet, les perspectives
de développement durable s'appréhendent à travers une
double dimension : de prime abord en vue d'assurer pour les
générations présentes et futures les ressources naturelles
suffisantes, il convient d'imprégner les populations sur les
conséquences de leurs actions d'une part et d'autre part de
contrôler les activités industrielles par l'application des
principes du développement durable.
46
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
A. Nécessité d'informer et de former les
populations
Avec la mondialisation, la société de
consommation des biens a pris une ampleur rapide et par ricochet, les
déchets produits par les populations ont suivi une forte tendance
à tel point que la conservation ou la gestion des déchets pose un
problème.
La zone exclusive des mers et les rivages de celles-ci font
l'objet de rejets quotidiens de déchets de la part des populations
environnantes. Plus souvent ces déchets sont dangereux pour l'organisme
humain et pour le milieu naturel. Par une illustration de cas de rejets de
déchets portant atteinte à l'environnement, nous pouvons retenir
l'affaire Proba Koala en Cote d'Ivoire faisant plusieurs victimes de
déchets toxiques.
Au Sénégal, le littoral fait l'objet quotidien
de rejets d'ordures ménagères de la part des habitants, une chose
qui sans doute à contribuer à la dégradation de
l'environnement marin et côtier. Ainsi compte tenu de la situation
actuelle du littoral de Dakar à Saint- Louis, une mise en place de
mesures appropriées visant à sensibiliser et à former les
populations sur les méthodes pratiques de gestion du DPM demeure une
nécessité incontestable.
Il est certain que beaucoup d'entres elles ignorent les effets
de leurs actions sur l'environnement et sur elles mêmes. Cependant,
conscient des menaces sur l'environnement, le cadre unitaire en Afrique
occidentale, à travers la convention de Bamako de 1991,
relatives à l'interdiction d'importer de déchets dangereux et le
contrôle de leurs mouvements, mettent en place un cadre formelle de
gestion auquel doivent se soumettre les Etats signataires.
Les populations, à cet effet, doivent être
informées et sensibiliser sur les mesures prises par l'Etat afin de
minimiser les impacts de leurs activités sur l'environnement marin et
côtier. En effet, il est de même dans le cadre du
développement durable de faire appliquer un certain nombre de principes
lesquels verront la participation des populations à la gestion de leur
milieu environnement. Ainsi pour se faire, la nécessaire de faire
l'informer la population demeure un processus irréversible. Beaucoup
d'entre elles n'ayant pas été instruites, ignorent les mesures
techniques de gestion de l'environnement. Actuellement beaucoup de lois et
textes réglementaires existent en matière de gestion des
ressources maritimes et côtières24
24 La loi sur le domaine naturel
inscrite dans les dispositions de la loi sur le domaine de l'Etat, n°
76-66.
47
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
B. Nécessité de contrôler les
activités industrielles
L'environnement marin et côtier a subi depuis plusieurs
décennies les effets de la pollution industrielle. Aujourd'hui, le
phénomène de rejets des résidus industriels constitue des
atteintes gravissimes et dangereuses pour les ressources côtières
au point qu'il devient une préoccupation majeure pour les instituts
internationales de proposer des mesures directives aux Etats.
Déjà, à l'instance internationale, l'obligation de prendre
en compte l'environnement doit être effective. Le point 4 de la
déclaration de Rio de 1992 proclame que «pour
parvenir à un développement durable, la protection de
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée
isolément ».
A cet effet, le Sénégal, à l'instar de
plusieurs pays, intègre dans son dispositif juridique et administratif,
des mesures appropriées de contrôle et de gestion des ressources
naturelles affectées ou pouvant être affectées par la
pollution. Dans la constitution du Sénégal en son article 8, il
est convenu le droit à la liberté d'activités pour tous
les citoyens à un environnement sain.
Aussi, dans le même sillage, il est inscrit
l'application des principes du développement durable au
Sénégal. Pour cela, les études d'impacts des
activités industrielles sont d'une valeur indispensable. Dans le code de
l'environnement au Sénégal, son article 48 chapitre
V, il est noté que tout projet de développement ou
activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, de
même que les politiques, les plans, les programmes, les études
régionales et sectorielles devront faire l'objet d'une évaluation
environnementale.
Ainsi, ces mesures par nature, entrent dans la
nécessité de contrôler les activités industrielles
susceptibles de provoquer un dommage écologique. Cependant, les moyens
dont disposent les agents de contrôle sont dérisoires et parfois
insuffisants pour atteindre les objectifs de contrôle des entreprises
installées sur le littoral. C'est pour cela qu'il est recommandé
par des institutions de défense de l'environnement25 la mise
sur pieds d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). Ceci devra
permettre d'évaluer, de façon large et prospective, pour chaque
composante, les impacts environnementaux et sociaux des activités
futures, et de prévoir une grille d'évaluation des projets ainsi
que des mesures d'atténuation
25 Parmi les instituts à vocation de
protection de l'environnement et des ressources naturelles qui recommandent la
mise en place d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), on peut
retenir l'UICN.
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
ou de compensation. Le CGES aura une portée nationale,
régionale et locale, avec un accent particulier sur les
aménagements agricoles, la petite irrigation et les infrastructures
d'accompagnement.
A cet effet, l'activité de contrôle industriel
demeure un processus crucial afin de minimiser les impacts dans le cours ou
moyen terme, pouvant rendre l'environnement marin et côtier
vulnérable.
48
SECTION II. AMELIORATION DE LA GESTION
DE
L'ENVIRONNEMENT SUR LE DPM
49
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Para I. amélioration des textes et du cadre
institutionnel
Cette partie compose essentiellement les résultats des
enquêtes menées ainsi que les différentes propositions des
acteurs/institutions ou organismes qui interviennent dans la protection de
l'environnement côtier et marin au Sénégal. Ils
s'inscrivent dans une double dimension en vue d'assurer une bonne gestion du
DPM : d'abord, il consiste d'appliquer la réglementation en vigueur en
tout en procédant à une refonte des textes pour aboutir à
une loi littorale tout comme la France, puis le financement des actions demeure
essentiel.
Graphique 1 : Appréciation de la
qualité de gestion du DPM
Pensez vous que le DPM au senegal est mal
Géré?

80%
Oui Non
20%
Source : Enquête mémoire Master II
environnement, FSJP ; M. SANOKHO
Selon les enquêtes effectuées sur le terrain, 80%
des opinions pensent que le DPM au Sénégal est mal
géré contre seulement 20% qui disent le contraire. En effet, les
occupations récentes à caractère résidentiel,
touristique et économique font obstacles à l'accès pour
les publics à la mer. D'autres installations non contrôlées
sur le littoral de Dakar à Saint-Louis inquiètent les
écologistes. Ce qui leur fait penser que le DPM est mal
géré.
A cet effet, la majeure partie des opinions s'accordent
à mettre en place un dispositif réglementaire efficace qui
implique l'ensemble des acteurs en vue d'assurer une bonne
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
gestion de l'environnement sur le DPM au
Sénégal. S'y ajouter que le financement de la politique
environnementale constitue un volet irréversible pour atteindre les
objectifs de protection des écosystèmes côtiers et marins.
Ce sont les deux dimensions essentielles qui seront appréhendées
pour le cas des perspectives de bonne gestion du DPM.
PARA I. L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION ET L'IMPLICATION
DES CITOYENS
Vu aussi que les textes de lois sont faiblement
appliquées, des alors, il convient de les faire appliquer pour assurer
une protection efficace et effective de l'environnement. Vu aussi, la
spécificité de la matière environnementale et
l'évolution des conditions climatiques et juridiques, il y a lieu de
rédiger une loi littorale qui protège les ressources et
promouvoir l'environnement marin et côtier.
A. Une nécessité de révision des
textes
Elle renvoie à deux points essentiels : une refonte des
textes d'une part et d'autre à la nécessité de la mise en
place d'une "loi littorale".
A- 1. Une refonte des textes
Considérant les résultats des enquêtes sur
le graphique, il est avéré que la gestion du DPM recèle
des opinions diverses.
50
Graphique 2 : Appréciation des lois de
protection du littoral
51
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO

comment jugez vous l'efficacité des lois sur le
Littoral?
insuffisante
50%
suffisante
10%
peu
suffisante
40%
Source : Enquête mémoire Master II
environnement, FSJP ; M. SANOKHO
Selon les enquêtes, la moitié des personnes
pensent que les lois censées protéger le littoral sont
inefficaces car les atteintes sont récurrentes sur l'environnement. Par
contre le reste des opinions est partagé entre 40% qui jugent peu
suffisante l'efficacité des lois et 10% qui restent sont convaincus de
la bonne qualité des lois.
Il faut considérer que la tendance est plus forte sur
l'aspect inefficace des lois. Ces opinions se justifient par rapport à
l'application des lois. Des lors que les sanctions ne sont pas applicables on
parle de lois non contraignantes. Aussi, dans le littoral vu la taille des
textes de lois qui l'interpellent, pose un problème de coordinations des
interventions. Ainsi qu'il convient de procéder à une refonte des
textes.
La refonte des textes signifie procéder à leur
toilettage et plus précisément dans le cadre de notre analyse
à les préciser et à les mettre à jour.
L'intervention du législateur est nécessaire dans l'état
actuel des choses pour préciser les dispositions organisant le
littoral.
La refonte des textes sous-entend une harmonisation, une mise
à jour du cadre textuel. Certains textes ont besoin d'être revus
afin d'intégrer les rectifications et modifications apportées par
la loi portant transfert de compétences. Ces textes législatifs
et réglementaires du fait de leur antériorité au transfert
de compétences comportent certaines dispositions désuètes.
Généralement, les modifications sont relatives aux
autorités chargées de ces secteurs, à certaines
procédures. Cette mise à jour permettra une clarification du
champ
52
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
textuel qui aura l'avantage de supprimer les dispositions qui
n'ont plus de raisons d'être maintenues. De même, certaines mesures
légales s'avèrent indispensables pour une gestion durable des
zones côtières.
D'abord, il est nécessaire de procéder à
la redéfinition de la notion de domaine public maritime, de son
extension et des activités pouvant y être autorisées. La
définition de zones de retrait et/ou d'un zonage dans l'occupation de la
zone côtière.
Ensuite, l'Etat doit veiller à l'application des
réglementations en vigueur et de leur renforcement : il s'agit en
particulier des mesures vis à vis des prélèvements de
sables de plage, celles relatives à l'occupation du domaine public,
à l'attribution de permis de construire ou aux études d'impact
environnemental (intégrer la question des changements climatiques).
Après une refonte qui pourra se réaliser qu'après une
précision, harmonisation et mise à jour des textes, il est
important de mettre en place une loi spécifique au littoral.
A-2. Une nécessité d'une loi littorale
Un cadre juridique approprié suppose l'adoption d'une
loi littorale qui sera le texte de référence en matière
d'environnement côtier et marin. Cette loi va régir tout ce qui
touche au littoral et à la protection des écosystèmes
marins. Tout comme la France, le Sénégal doit disposer d'une loi
littorale applicable et contraignante afin de réduire les menaces qui
pèsent le milieu marin.
Celle-ci permettra de pallier le problème de la
dispersion des règles relatives au littoral. A l'instar de la France, le
législateur sénégalais devrait se pencher sur cette
question qui du reste demeure intéressante. Le semble t-il une
proposition de loi littorale en cours d'élaboration, s'il est vrai les
pouvoirs publics ainsi que les spécialistes a la matière doivent
tenir compte de la préoccupation de l'environnement dans un contexte
socio-économique en crise.
Bien que le Code de l'environnement soit le cadre
général régissant tout ce qui touche à
l'environnement, il faut chercher dans beaucoup de textes les dispositions qui
concernent le littoral. Donc, les textes sont non seulement
éparpillés mais souvent ils ne sont relatifs qu'à un
aspect spécifique de la zone littorale (pollution et nuisance, forets,
eau, urbanisme, foncier,...).
53
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Par conséquent, l'adoption d'une pareille loi permettra
de simplifier le cadre juridique en contenant toute la réglementation
relative à l'environnement côtier et en définissant
clairement le domaine d'intervention des institutions chargées de la
gouvernance des cotes. Pour parvenir à une protection efficace du
littoral, il ne faudrait pas se limiter aux recommandations d'ordre textuel. En
effet, il est primordial d'apporter des solutions au plan institutionnel. Il
faut espérer que le nouveau projet de loi du littoral soit voter par le
Senat et mis en application très vite afin d'assurer une protection
efficace et effective de nos côtes.
B. La nécessité d'une implication de tous
les citoyens
L'implication des citoyens pour une gestion durable et
participative des ressources demeure un volet incontournable de
résolutions des problèmes de pollution du littoral. Toutefois, la
mise en place d'institutions solides capables de coordonner les interventions
des différents acteurs passe avant.
B-1. L'harmonisation de l'intervention des institutions
Au Sénégal, la diversité des institutions
qui ont la charge de la gestion des côtes limite considérablement
l'efficacité de la protection puisqu'il y'a interaction, chevauchements
et lacunes dans la gouvernance côtière. Ce sont les services de
l'administration centrale et déconcentrée, les
collectivités locales et les structures à vocation
régionale qui ont compétences pour gérer ce secteur.
Un nombre important de projets et programmes de dimension
internationale et nationale est mis en place. Et, l'absence d'un cadre
institutionnel cohérent de gestion du littoral atténue leur
efficacité. Ainsi, une harmonisation de leur intervention permettra
d'éviter tous les obstacles de la gestion en l'occurrence les
problèmes de conflits de compétences, les incohérences de
leurs actions. On peut voir des esquisses de solution à ce niveau. Le
problème de conflit de compétences a poussé le
Gouvernement, vu la nécessité de coordonner les actions de ces
différentes structures, à créer, par décret, une
Haute Autorité chargée de la Coordination de la
Sécurité maritime, de la Sûreté maritime, et de la
Protection de l'Environnement marin (HASSMAR).
54
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
L'inexistence d'un cadre institutionnel cohérent de
gestion du littoral a pour conséquence de rendre inapplicables les
mesures nationales de sauvegarde mais aussi les engagements internationaux
souscrits par le Sénégal. Dans ce dernier cas de figure, on peut
citer l'exemple de la Convention d'Abidjan ratifiée par l'Etat
sénégalais. En effet, le cadre fédérateur de la
Convention d'Abidjan ne peut être opérationnel si, au plan
national, il n'existe pas un cadre de gestion intégrée du
littoral à l'image de la Mauritanie, avec notamment : un cadre
institutionnel cohérent de gestion du littoral ; un cadre de suivi du
littoral (observatoire).
Des efforts sérieux doivent être entrepris pour
arriver à une gestion institutionnelle cohérente. Il est
important qu'il y'ait un cadre global de gestion et d'aménagement des
zones côtières afin d'éviter les réponses
isolées et les conséquences qui pourraient en découler.
C'est pour cela qu'il est nécessaire que le Sénégal
s'engage dans une politique de gestion intégrée des zones
côtières.
B-2. L'harmonisation de l'intervention des citoyens
à travers des organisations locales
L'application des conventions internationales post-Rio a
légitimé l'intervention de nouveaux acteurs dans le domaine de la
gestion de l'environnement et des ressources naturelles au
Sénégal. Ainsi, à coté des pouvoirs publics,
plusieurs organisations locales ont été créées par
des citoyens pour atténuer les atteintes causées par la pollution
de leur environnement. On peut citer ; entres autres, l'Association
Sénégalaise des Amis de la Nature (ASAN), SOS Littoral.
Cependant, aucune de ses associations n'impliquent totalement les citoyens du
quartier ou de la localité qui a suscité sa création.
Au regard du graphique ci-dessous, seulement 20% des
enquêtés pensent que les citoyens sont impliqués
suffisamment dans le dispositif organisationnel de gestion du littoral et de
l'environnement. Par contre, les 4/5 soit 80% des personnes
enquêtées disent que l'implication reste insuffisante.
55
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Graphique 3: Appréciation de l'implication
des populations
pensez-vous que l'implication des citoyens dans la
gestion est insuffissante ?

20%
Oui Non
80%
Source : Enquête mémoire Master II
environnement, FSJP ; M. SANOKHO
Les associations de défense de l'environnement ne
regroupent que très peu d'individus, souvent elles composent un groupe
d'amis habitants dans la même rue. En vue d'une efficacité
d'actions des organisations locales, il est nécessaire d'avoir un cadre
de concertation commune pour tous les acteurs sous la direction des pouvoirs
publics. Ce cadre permettra aux populations s'impliquer à travers des
réunions de quartier ou conseils de quartier comme le cas de saint
louis, et de solutionner les contraintes de proximité. La
pluralité des organisations traduit un détournement d'objectif de
protection au profit de satisfaire les intérêts personnels. Il
convient donc, de coordonner les interventions pour mieux asseoir la politique
publique de protection du littoral.
Para II. Révision de la politique
environnementale
Il consiste à fournir plus de moyens financiers et
logistiques aux agents, services et organisations qui se préoccupent de
la protection et de la conservation du littoral.
56
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
A. pour une amélioration des moyens
financiers
La question financière demeure très cruciale si
elle n'est pas pour autant la plus importante. Suite à une
amélioration de la qualité du personnel en charge de la
protection des écosystèmes, le financement de leurs
activités demeure impératif.
Ensuite, pour ce qui est des moyens financiers, les conditions
financières permettant une prise en charge totale des besoins des
services ne sont pas encore réunies. Ceci constitue une limite de taille
dans l'action de ces services.
Les recommandations à ce niveau iront dans le sens
d'une augmentation des moyens financiers mais surtout de ceux des
collectivités locales et des services déconcentrés
chargés de la surveillance du littoral. En effet, la situation
financière des collectivités locales déteint sur celle des
services déconcentrés puisque la faiblesse des moyens
alloués à la collectivité en guise de compensation
financière des charges résultant du transfert de
compétences a eu des répercutions sur les moyens octroyés
aux services mis à la disposition des collectivités locales et
sur la gestion même des compétences environnementales.
En plus de leur mission de gestion, les collectivités
locales doivent assurer une mission de contrôle, de suivi et
d'évaluation des actions anthropiques sur le littoral ; pou cela une
amélioration des moyens d'interventions passe nécessaire par le
renforcement des finances.
Toutefois, on ne peut évoquer cette question
financière sans pour autant mentionner que l'Etat doit prendre
conscience des besoins financiers desdits services et avoir une attitude qui
traduit une volonté d' y pourvoir.
B. Pour une amélioration des moyens
matériels
Les services doivent disposer de moyens matériels
nécessaires pour l'exercice de leurs attributions. Beaucoup de
structures publiques ou privées souffrent de manque de moyens
logistiques pour rendre efficace leur intervention. Les simples Associations de
quartier (Siggil-Hann et ASC-Guédiawaye, Sos littoral), qui oeuvrent
pour la défense des plages contre toutes atteintes parlent de manques
criards de moyens matériels alors que l'Etat doit leur appuyer. Leur
intervention sur le terrain, a cet effet, est très limitée.
57
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Pour Remédier à cet état de fait,
c'est-à-dire au manque de moyens matériels, il consistera
à les doter suffisamment en la matière. Ce qui reviendrait
à les équiper convenablement (voitures, locaux, logistique...).
Sur ce plan, il convient de faire référence aux Nouvelles
Techniques de l'Informatique et des Communications (NTIC) aussi car parvenir
à une efficacité de l'action des services postule un recours
à l'informatique et éventuellement à certaines nouvelles
technologies surtout pour la surveillance du littoral avec une intervention
rapide et efficace en cas d'action illicite.
Mais aussi la dotation de matériels aux
collectivités locales et aux associations suppose un renforcement de
capacités des usagers. Autrement dit des formations courantes sur les
techniques d'utilisation de ces matériels et sur les
interprétations des textes de lois demeurent nécessaires afin de
rendre efficiente l'usage des matériels.
Il faut comprendre qu'au regard de la taille des
problèmes soulevés par le phénomène des changements
climatiques, la pollution marine et côtière ; les perspectives de
solutions doivent être traitées avec beaucoup de diligence et
planifier sur une échéance donnée sans quoi elles seront
dépassées par les contextes changeants. Le littoral constitue, en
effet, un écosystème dont les potentialités sont
considérables d'où l'intérêt à les
protéger. Si rien n'est fait pour conserver le littoral, à la
manière des jeunes de Fadiouth pour la sauvegarde et la
régénération des mangroves, les impacts seront
négatifs sur l'environnement et sur les activités
socio-économiques.
En effet en plus des solutions proposées à
savoir l'application et la refonte des textes de lois d'une part et d'autre
part le financement de la politique de gestion, il convient de mettre en place
un Cadre de Gestion Concertée (CGC) pour assurer la bonne tenue des
financements obtenus. Ce CGC aura également pour objectif claire de
coordonner les interventions des différents acteurs a travers des
rapports, des documents de planification des actions entres autres.
58
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Graphique 4 : propositions globales de
solutions
|
|
Quelles solutions préconisez-vous?
|
|
|
|
30
|
|
30
|
|
30
|
|
10
|
|
|
renforcement de renforcement de encadrement création de
zone
moyens d'action moyens financiers juridique efficace
spéciale de
protection
|
Source : Enquête mémoire Master II
environnement, FSJP ; M. SANOKHO
Toujours dans le cadre de pallier les problèmes de
pollution marine, de dégradation des ressources halieutiques, entre
autres, les populations enquêtées proposent globalement comme
mesures alternatives : Le renforcement des moyens financiers, Le renforcement
de capacité des intervenants, un encadrement juridique efficace et
enfin, la création de zone spéciale de protection.
Au regard du graphique ci-dessus, 30% des effectifs pensent
que la solution vient par un renforcement des moyens d'action des
différents intervenants. Tout comme les opinions sur le renforcement de
moyens financiers et d'encadrement juridique. Une seule exception de 10% des
enquêtés parlent de création de zone spéciale de
protection pour le littoral. Il faut comprendre que le véritable
problème demeure l'absence de moyens et la volonté politique des
autorités à faire appliquer les lois.
En effet, toutes ces propositions semblent bonnes et efficaces
que s'elles font l'objet d'application.
59
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Par ailleurs le Sénégal peut faire
référence aux normes adoptées par les instances
internationales pour mieux renforcer son dispositif de protection mais aussi de
bénéficier du fonds du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE).
Pour cela, la régularisation environnementale par des
mesures économiques incitatives doit être appliquée : il
s'agit de l'étude d'impact environnementale, l'évaluation du
cycle de vie d'un produit l'évaluation environnementale et de l'audit
environnemental. Ces techniques permettent de faire soit des corrections ou de
prévenir toutes atteintes d'une activité quelconque sur
l'environnement. En plus pour mieux gérer son DPM, le
Sénégal doit appliquer des mesures techniques d'assainissement,
de curage, de nettoiement des côtes mais surtout l'aménagement
à travers la Société d'Aménagement de la Petite
Côte (SAPCO) afin de se conformer aux normes de protection de
l'environnement et tendre ainsi vers une éco responsabilité.
60
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Conclusion générale
Le Sénégal dispose plus de 700 km de
côtes. Prés de 50% de sa population vivent le long du littoral.
Par le tourisme et la pèche, l'apport de la mer à
l'économie nationale est considérable et son impact à ce
niveau doit encore se développer. Pour avoir trop longtemps
laissé jouer les intérêts particuliers, en
négligeant les objectifs de protection, nous assistons aujourd'hui,
surtout à Dakar, à une dégradation progressive du milieu
marin. Extrait du document « protéger l'Environnement pour un
Sénégal encore plus beau », édité par
la direction de l'Environnement (1984), page 26.
Il faut entendre à ces propos que les
intérêts personnels mis au devant de la préoccupation du
littoral, ont encouragé la destruction progressive de cet
écosystème. En effet, l'encadrement juridique et institutionnel
semble être inefficace pour prévenir les atteintes sur
l'environnement ou du moins assurer la gestion des ressources. Aussi, avec le
phénomène actuel de changements climatiques, la nature est
devenue plus violente en déversant des vagues sur les installations
humaines et industrielles ; elle cause des impacts négatifs.
Consciente de la situation menaçante, la gestion du DPM
a trouvé un regain d'actualité à l'occasion de la forte
attirance du public pour le littoral, la mer et les loisirs nautiques. La
difficulté d'une telle gestion par les administrations locales ne
provient finalement pas tant de la complexité apparente des outils
juridiques ou des procédures applicables que de la difficulté
à allier, à l'occasion de décisions ponctuelles, des
préoccupations souvent contradictoires, entre l'intérêt
général et des intérêts particuliers, entre
investisseurs et société civile, entre protection du littoral et
développement local des activités liées à la mer et
aux rivages de celle-ci. Au, Sénégal en particulier le littoral
de Dakar, les préoccupations environnementales reléguées
au second plan depuis quelques années, ont suscité des
interrogations nombreuses. Faut-il continuer à privilégier
l'activité économique par des investissements sur le DPM aux
dépens de la protection des écosystèmes marins dont les
intérêts sont sans doute essentiels pour l'existence humaine
?
61
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
1. Balandier (G), 1953 : les
pêcheurs du Sénégal particularisme et évolution,
Saint-Louis, IFAN, 129 pages.
2. Guilcher (A) 1954 :
morphologie littorale et sous-marine, ORBIS, Puf, 216
pages.
3. Pinchemel (Ph et G) 198 : la
face de la terre, éléments de géographie, paris, A
colin.
4. M. Prieur :
droit de l'environnement, 3éme édition, Dalloz, 1996, 916
pages.
5. Danielle ben Yahmed : Atlas
de l'Afrique, les Atlas du Sénégal ; les éditions J.A,
2007.
6. Dupuy (G), 1962 :
définition du DPM en droit français et africains-
malgache, en prenant n° 693, sept - oct. PP 514 -
524.
Ouvrages Spécifiques et Rapports
7. Ministère du tourisme et des transports
aériens du Sénégal (2000). « Note explicative sur les
statistiques du tourisme au niveau de la Petite Côte (1988 à 1999)
», Dakar, Ministère du tourisme et des transports aériens du
Sénégal.
8. Rapport du Ministère du Tourisme (2002). «
Journées Nationales de Concertation sur Le Tourisme. Diagnostic du
Secteur du Tourisme Document de travail », Dakar, Ministère du
tourisme du Sénégal.
9. Ministère de l?Environnement et de la Protection de
l Environnement, Ministère du tourisme et des transports
aériens du Sénégal (1999). « Stratégie
Nationale Initiale de Mise en oeuvre de la convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques », Dakar, MEPE.
10. Résumé du rapport du Gouvernement au
Parlement portant bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du
littoral, Septembre 2007.
11. Ly Ibrahima, agrégé des facultés de
droit, (2008) : « étude sur l'évolution du droit de
l'environnement depuis 1992 », Université Cheikh Anta Diop de
Dakar.
62
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Mémoires et thèses
12. Diaw (AT) et Al, 1992 : la
gestion des ressources côtières et littorales au
Sénégal, Séminaire de Gorée ; 27-29 juillet 1992,
édition UICN, 482 pages.
L'étude portant sur la gestion de nos littorales met
en exergue les risques de destruction qui pèsent sur nos côtes par
l'exploitation abusive parfois des ressources côtières. Les
populations et l'Etat y tirent l'essentiel de leurs recettes d'où
l'intérêt à les protéger en vue d'éviter une
crise biologique dont les conséquences seront désastreuses pour
la survie et l'existence humaine.
13. Théophile Séne, F1-HG 2001-2002
: la problématique de l'occupation du DPM sur le
littoral centrale : cas de Lompoul, Fastef. Ex ENS.
Ce mémoire attestant la formation d'enseignement
à l'école normale, constitue un véritable
réquisitoire portant sur les occupations anarchiques du littoral par une
certaine classe sociale très privilégiée à la
limite hégémonique au dépendant de l'équilibre
écologique. La CR Lompoul, à l'instar des zones
côtières de Dakar à Saint-
Louis, demeure actuellement être convoité en
raison des enjeux majeurs. A cet effet, dans cette entité
géographique, il y a lieu une exigence d'une bonne gestion du littoral
afin de préserver les ressources pour la génération
future.
14. Diagne A.K. (2001). «Impacts of coastal tourism
development and sustainability: A geographical case study of Sali in the
Senegalese Petite Côte», Geographical Review of Japan (Series
B), Vol. 74, no 1.
15. Diallo Mamadou A. (1997). Contribution à
l`étude du domaine public maritime du Sénégal,
Mémoire de D.E.A d`enseignement, Université Cheikh Anta Diop,
Faculté des Sciences juridiques et Politiques.
16. Diop A. (1986). L'organisation touristique de la
Petite Côte sénégalaise et ses rapports avec les autres
formes d'occupation de l'espace, thèse de 3ème cycle en
Géographie, Université Paul Valery Montpellier III.
17. Tall Seydou N. (2008-2009). Cours de droit international
de l'environnement, professeur de droit, Université Cheikh Anta Diop,
Faculté des Sciences juridiques et Politiques.
63
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
19. Ly Ibrahima. (2008-2009). Cours de droit et administration de
l'environnement au Sénégal, professeur agrégé des
facultés de droit, chef de département du droit public,
Université Cheikh Anta Diop.
Lois et décrets
21. La loi n° 98/03 du 08 janvier portant
code forestier du Sénégal, JORS de janvier 1998.
22. la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au
domaine nationale, modifiée
23. la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant
transfert de compétences aux régions, communes et
communautés rurales, JORS du 23 mars 1996, de la République du
Sénégal.
24. Loi 96-06 du 22 janvier 1996 portant code
des collectivités locales du Sénégal.
25. la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de
l'environnement.
26. le décret 96-1134 du 27 décembre 1996 partie
réglementaire du CCL, JORS du 28 décembre 1996.
27. Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
(Journal officiel, république Française, du 4 janvier
1986)
Journaux quotidiens
28. Sud Quotidien (2003). « Tourisme sexuel
impliquant des enfants : un danger pour la jeunesse », Samedi 28 -Dimanche
29 Juin 2003.
29. Walfadjri (2001). « Litige foncier. Pourquoi
la révolte monte sur la Petite Côte », no 3897, 23
août 2001.
30. Walfadjri, (2001). « Démolition
à Warang : les prévenus écopent de six mois avec sursis
», no 4375, 14 septembre 2001.
Webographie :
www.google.com
www.gouv.sn
www.wikipedia.fr
64
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
LEXIQUE DES MOTS :
Diversité biologique
Variabilité des organismes vivants de toute origine y
compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie ; cela comprendra diversification au sein des espèces et
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Pollution
Toute contamination ou modification directe ou indirectes de
l'environnement provoquée par tout acte susceptible :
- d'affecter défavorablement une utilisation du milieu
profitable à l'homme.
- de provoquer ou de risquer de provoquer une situation
préjudiciable à la santé ..... aux eaux et aux biens
collectifs
Déchets
toute substance solide, liquide, gazeuse, ou résidu
d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de toutes
autres substances éliminées destinées à être
éliminées ou devant être éliminées en vertu
des lois et règlements en vigueur.
65
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
ANNEXES
? Annexe 1 :
GUIDE d'entretien
Thème de la recherche : la gestion de
l'environnement sur le DPM au
Sénégal
? Identification
Nom de l'Enquêteur :
Nom de l'Enquêté :
Quel est votre âge ? 1. jeune 2. Adulte 3. Vieux sexe : 1.M
2.F
? Méthode et instruments de collectes
Masque de saisie : CSPRO
Echantillon : 100 individus
Traitement et analyse des données : SPSS
Populations cibles : les personnes âgées de plus de
18 ans à 60 ans, susceptibles de fournir des informations pertinentes et
cohérentes.
Outils de collectes : enquêtes par pas de sondages.
Questions
1. Au Sénégal, le DPM fait l'objet d'occupation
anarchique, quels sont les facteurs ?
2. pouvez-vous expliquer les menaces qui pèsent sur
l'écosystème marin et côtier ?
3. par rapport aux ressources qui y existent, peut-on parler de
biodiversité ?
4. Si oui, quel type d'espèces existe dans cet
écosystème ?
66
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
5. le Sénégal est signataire de plusieurs
conventions en matière de gestion de l'environnement, par rapport aux
risques de dégradation de l'écosystème marin, peut on
parler d'efficacité dans l'application des textes ?
6. quel est l'arsenal juridique que dispose
concrètement le Sénégal pour la gestion de ce domaine ?
7. Qui gère le DPM (les autorités
compétentes)?
8. Quels sont les acteurs impliqués dans la gestion du
littoral et de l'environnement en général ?
9. sur le plan institutionnel qui gère le DPM ?
10. beaucoup de collectivités locales disposant de
zones côtières pensent être compétentes à la
gestion de l'environnement, mais les moyens disponibles sont limités
quelle suggestions a faire ?
11. actuellement les risques de dégradation du
littoral sont notoires et inquiètent les acteurs, que faire face
à la situation spontanée?
12. quelles sont les solutions alternatives pour assurer une
bonne gestion de ce domaine ?
? Annexe II :
La Loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du
domaine de l'Etat, JORS, juillet 1976 de la République du
Sénégal.
LIVRE II : DOMAINE PUBLIC
TITRE PREMIER : COMPOSITION - CONSTITUTION - CARACTERES
Article 4.- Le domaine public est naturel ou artificiel.
Article 5.- Le domaine public naturel comprend
:
a. la mer territoriale, le plateau continental tel que
défini par la loi, la mer intérieure, les
rivages de la mer couverts et découverts lors des plus
fortes marées, ainsi qu'une zone de cent mètres de large à
partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ;
67
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
b. les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords
avant de déborder, ainsi qu'une zone de vingt cinq mètres de
large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords
des îles ;
c. les cours d'eau non navigables ni flottables dans les
limites déterminées par la hauteur
des eaux coulant à
pleins bords avant de déborder ainsi qu'une zone de dix mètres de
large à partir de ces limites sur chaque rive ;
d. les lacs, étangs et mares permanentes dans les
limites atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi
qu'une zone de vingt cinq mètres de large à partir de
ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ;
e. les eaux de surface et les nappes aquifères
souterraines quelle que soit leur provenance,
leur nature ou leur profondeur
;
f. le sous-sol et l'espace aérien.
Article 6.-Le domaine public artificiel
comprend notamment :
a. les emprises des routes, des chemins de fer, des gares
routières et des voies de
communication de toute nature avec les
dépendances nécessaires à leur exploitation ;
b. les ports maritimes et fluviaux avec leurs
dépendances immédiates et nécessaires,
digues,
môles, jetées, quais, terre-pleins, bassins, écluses, les
sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de balisage, phares,
fanaux et leurs dépendances ;
c. les aérodromes et aéroports avec leurs
dépendances nécessaires à la navigation
aérienne
: stations météorologiques, centres de contrôle et de
guidage, etc. ;
d. les ouvrages réalisés en vue de
l'utilisation des forces hydrauliques ainsi que leurs
dépendances
;
e. les canaux de navigation ainsi que les chemins de halage,
les canaux d'irrigation et de
drainage, les aqueducs et oléoducs, les
forages et puits ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;
f. les conduites d'eau et d'égouts, les lignes
électriques, les lignes télégraphiques
et
téléphoniques, les ouvrages aériens des stations
radioélectriques y compris leurs supports, ancrages, lignes
d'alimentation, appareils de couplage ou d'adaptation et leurs
dépendances ;
68
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
g. les ouvrages militaires de défense terrestre,
maritime ou aérienne avec leurs dépendances et leurs zones de
protection.
h. les objets d'art et collections affectés aux
musées nationaux.
i. les halles et marchés ;
j. les servitudes d'utilité publique qui comprennent
notamment :
1° - les servitudes de passage, d'implantation, d'appui
et de circulation nécessitées par l'établissement,
l'entretien et l'exploitation des installations et ouvrages visés
ci-dessus ;
2°- les servitudes établies :
- pour la défense et la sécurité ;
- par les plans d'urbanisme ;
- dans l'intérêt ou pour la sécurité
de la navigation aérienne, maritime ou terrestre
- dans l'intérêt des transmissions
- dans l'intérêt ou pour la sécurité
de la circulation routière (servitudes de
visibilité).
- pour la protection des monuments et des sites.
k. et généralement les biens de toute nature non
susceptibles d'appropriation privée.
Article 7.- Les servitudes d'utilité
publique visées à l'article précédent ne peuvent
ouvrir au profit du propriétaire ou détenteur de l'immeuble qui
en est frappé un droit à indemnité que lorsqu'elles
entraînent, lors de leur établissement, une modification à
l'état des lieux déterminant un dommage actuel, direct,
matériel et certain.
Article 8.- L'incorporation d'un immeuble au
domaine public artificiel résulte soit d'un acte de classement, soit de
l'exécution de travaux qui confèrent à cet immeuble un
caractère de domanialité publique.
Article 9.- Le domaine public est
inaliénable et imprescriptible.
69
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
TITRE II : GESTION - DECLASSEMENT - SANCTIONS
Article 10.- L'Etat assure la gestion du
domaine public naturel. Il gère les dépendances du domaine public
artificiel qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert de gestion au profit d'une
autre personne morale publique, d'un concessionnaire de service public ou d'un
organisme visé à l'article 11 de la loi n° 64-46 du 17 juin
1964 relative au domaine national.
Article 11.- Le domaine public peut faire
l'objet de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concessions et
d'autorisations d'exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus
à l'article 18 ci-après, au paiement de redevances.
Article 12.- Les permissions de voirie sont
délivrées à titre personnel, essentiellement
précaire et révocable. Elles n'autorisent que des installations
légères démontables ou mobiles, n'emportant pas emprise
importante du domaine public ou modification de son assiette. Leur retrait ne
donne lieu au paiement d'aucune indemnité.
Article 13.- Les autorisations d'occuper le
domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre
personnel, précaire et révocable. L'acte accordant l'autorisation
précise les conditions d'utilisation de la dépendance du domaine
public qui en fait l'objet. L'autorisation peut être retirée
à tout moment sans indemnité.
Article 14.- Le permissionnaire ou le
bénéficiaire de l'autorisation d'occuper peut, à tout
moment, renoncer au permis ou à l'autorisation qui lui a
été accordée moyennant le paiement des redevances
échues et en délaissant l'immeuble dans l'état où
il se trouve si la remise en état des lieux ne lui est pas
imposée. Si la remise en état des lieux est imposée,
l'Etat peut, en cas de carence du permissionnaire ou du
bénéficiaire de l'autorisation, exécuter les travaux
nécessaires aux frais de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est
poursuivi contre le permissionnaire ou le bénéficiaire de
l'autorisation comme en matière d'enregistrement.
Article 15.- Les autorisations d'occuper
nécessitées par les exploitations de mines et de carrières
sont accordées dans les formes et conditions prévues par la
réglementation fixant le régime des substances minérales
et des hydrocarbures.
Article 16.- Les concessions et autorisations
d'exploitation sont accordées de gré à gré ou par
adjudication pour une durée déterminée ou non, aux clauses
et conditions fixées dans chaque cas. Elles sont réservées
aux installations ayant un caractère d'intérêt
général.
70
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Article l7.- La redevance pour occupation et
concession ou autorisation d'exploitation est fixée en tenant compte des
avantages de toute nature procurés au permissionnaire,
bénéficiaire de l'autorisation ou concessionnaire et des charges
qui lui sont imposées. Elle est révisable chaque année.
Article 18.- Les autorisations d'occuper et
les concessions ou autorisations d'exploitation du domaine public peuvent
être accordées à titre gratuit lorsqu'elles revêtent
un caractère prédominant d'utilité publique ou
d'intérêt économique ou social et sous réserve
qu'elles ne constituent pas pour le bénéficiaire une source
directe ou indirecte de profits.
Article 19.- Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa du présent article, les
dépendances du domaine public peuvent être
déclassées. Le déclassement a pour effet d'enlever
à un immeuble son caractère de domanialité publique et de
le faire entrer, s'il est immatriculé, dans le domaine privé, ou
dans le cas contraire, dans le domaine national. L'immeuble
déclassé et incorporé au domaine national peut faire
l'objet d'une réquisition d'immatriculation au nom de l'Etat sans
formalités préalables. Le déclassement entraîne
l'annulation de plein droit des titres d'occupation de la dépendance du
domaine public déclassée.
La dépendance du domaine public artificiel
déclassée fait l'objet, s'il y a lieu, d'une cession gratuite par
l'Etat au profit de la personne morale publique qui a supporté les
dépenses d'acquisition du sol et de construction de l'ouvrage et pourvu
à l'entretien de ce dernier.
Seules peuvent faire l'objet d'un déclassement les
dépendances du domaine public artificiel, la zone de cent mètres
de large en bordure du rivage de la mer, la zone de vingt cinq mètres de
large et bordure des rives des cours d'eau navigables ou flottables, lacs,
étangs et mares permanentes et la zone de dix mètres de large en
bordure des rives des cours d'eau non navigables ni flottables.
Article 20.- Nul ne peut, sans l'autorisation
délivrée par l'autorité compétente, occuper ou
exploiter une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des
limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous sur les
parties de ce domaine affectées au public.
Les agents de l'Etat ou les autres personnes habilitées
à cet effet constatent les infractions aux dispositions de
l'alinéa précédent en vue de poursuivre contre les
contrevenants le recouvrement des indemnités correspondant aux
redevances dont le trésor a été frustré, le tout
71
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
sans préjudice de l'application des sanctions
prévues au dernier alinéa du présent article, ou par
d'autres textes.
Les mêmes infractions , les actes de nature à
gêner ou empêcher l'application ou l'exercice des servitudes
d'utilité publique ainsi que les actes de dégradation ou de
destruction de dépendances du domaine public, sont passibles d'une
amende allant de vingt mille francs à deux millions de francs et, en cas
de récidive ou de non exécution des travaux prescrits, d'un
emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de vingt mille
francs à deux millions de francs sans préjudice de la
réparation des dommages causés.
72
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
TABLE DES MATIERES
TABLES DES SIGLES ET DES ACRONYMES III
LA LISTE DES GRAPHIQUES V
LA LISTE DES CARTES VI
SOMMAIRE VII
RESUME DU MÉMOIRE VIII
INTRODUCTION 1
LA METHODOLOGIE 3
LES QUESTIONS DE RECHERCHE 3
LES HYPOTHESES 4
LES OBJECTIFS DE L'ETUDE 4
La conception de la recherche 4
La revue documentaire 5
L'analyse et le traitement des données
6
Les limites de la recherche 6
PARTIE I : 7
IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT 7
SECTION I : DESCRIPTION DU DPM 8
Para I. aux plans physique et socioéconomique
8
A. les aspects fonciers et écologiques
8
B. les aspects économiques et
démographiques 15
Para II. Aux plans juridique et institutionnel
17
A. l'encadrement juridique 17
A -1. L'historique des conventions 18
A-2. Les conventions internationales 19
A-3. Les textes régionaux 21
A- 4. Les textes nationaux 23
B. l'encadrement institutionnel 28
SECTION II. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT SUR LE DPM 30
Para I. Les difficultés de la gestion du DPM et
ses impacts 30
A. les problèmes environnementaux
30
B. Les contraintes textuelles et institutionnelles
32
B-1. Les insuffisances textuelles 32
73
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
B.2 Les difficultés organisationnelle et
fonctionnelle 34
Para II. Les principaux impacts 36
A. les impacts socio-économiques 36
B. les impacts environnementaux 38
Conclusion partielle 40
PARTIE II : 41
LES PERSPECTIVES DE SOLUTIONS ET AMELIORATION DE LA
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR
LE DPM 41
SECTION I. LES PERSPECTIVES DE GESTION DU DPM
42
Para I : les perspectives d'ordre environnemental
42
A. Nécessité d'adaptation des changements
climatiques 42
B. la lutte contre la pollution de l'environnement marin
et côtier 44
Para II. Les perspectives de concilier la protection de
l'environnement avec les activités socio-
économiques 45
A. Nécessité d'informer et de former les
populations 46
B. Nécessité de contrôler les
activités industrielles 47
SECTION II. AMELIORATION DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
SUR LE DPM 48
Para I. amélioration des textes et du cadre
institutionnel 49
A. Une nécessité de révision des
textes 50
A- 1. Une refonte des textes 50
A-2. Une nécessité d'une loi littorale
52
B. La nécessité d'une implication de tous
les citoyens 53
B-1. L'harmonisation de l'intervention des institutions
53
B-2. L'harmonisation de l'intervention des citoyens
à travers des organisations locales 54
Para II. Révision de la politique environnementale
55
A. pour une amélioration des moyens financiers
56
B. Pour une amélioration des moyens
matériels 56
Conclusion générale 60
BIBLIOGRAPHIE 61
LEXIQUE DES MOTS : 64
ANNEXES 65
GUIDE d'entretien 65
Thème de la recherche : la gestion de
l'environnement sur le DPM au Sénégal 65
| 


