|
REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple - Un but - Une foi
Ministère de l'Enseignement Secondaire, des Centres
Universitaires Régionaux et des Universités
INSTITUT DE FORMATION EN MARKETING ET
COMMUNICATION

C.N.T.S
Mémoire de fin de formation pour l'obtention
de la
Licence Professionnelle en Marketing et
Communication
Présenté et soutenu par :
Sous la direction de :
Odette Siga DIOUF
M. Hamidou Diop
Marketing Manager de Promo
Media
|
AVC :
|
Accidents Vasculo - Cérébral
|
|
B.U :
|
Bibliothèque Universitaire
|
|
CNTS :
|
Centre National de Transfusion Sanguine
|
|
CSRH :
|
Chef service des Ressources Humaines
|
|
I.C.S :
|
Industries Chimiques du Sénégal
|
|
HPD :
|
Hôpital Principal de Dakar
|
|
OMS :
|
Organisation Mondiale de la Santé
|
|
P.I.B :
|
Produit Intérieur Brut
|
|
S.A.R :
|
Société Africaine de Raffinage
|
|
T.I.C :
|
Technologies de l'Information et de Communication
|
|
UCAD :
|
Université Cheikh Anta DIOP
|
Communication : la communication
marketing consiste pour une organisation à transmettre des messages
à son public en vue de modifier leur comportement mentaux (motivations,
connaissances, images, attitudes, ...) et par voie de conséquence leur
comportement effectif.
Comportement : action ou réaction
d'un individu résultant de son attitude par rapport à quelqu'un
ou quelque chose.
Consommateurs : c'est une personne qui
achète et consomme un produit ou plusieurs produits (ou services)
auprès d'un producteur ou d'un distributeur. D'autre part, c'est une
personne ou une entité physique, morale qui utilise un bien, un produit
ou un service à titre personnel ou qui est susceptible de l'utiliser.
Don de sang : c'est une opération
consistant à se présenter volontairement auprès de
services de santé compétents pour offrir son sang qui sera
recueilli dans un bocal ou une pochette pour servir à une transfusion ou
intervention chirurgicale s'il est jugé de bonne qualité et
à faible risque. L'entreprise : c'est un groupe
d'individu proposant un bien, un service, ou un support et qui
génère plus de richesse qu'elle n'en consomme.
Marketing : c'est l'ensemble des
méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour promouvoir
dans les publics auxquels elle s'intéresse des comportements favorables
à la réalisation de ses propres objectifs.
Marketing mix : l'ensemble des
décisions relatives aux politiques de produit, de prix, de distribution
et de communication d'un produit ou d'une marque.
Marketing social : c'est une nouvelle
façon de concevoir de très anciens projets.
Il constitue une nécessité, car les
méthodes traditionnelles de distribution de produits et services de
santé dans les pays en voie de développement, fréquemment
ne permettent pas d'accéder à un important segment de la
population qui comprend les groupes qui se trouvent au bas de l'échelle
de l'économie monétaire.
Motivations : les motivations sont des
pulsions poussant à l'achat et qui sont censés satisfaire un ou
plusieurs besoins. Ce sont des forces inconscientes poussant l'individu
à réduire un état de tension en orientant son action vers
la recherche d'une satisfaction.
Produit : c'est toute chose offerte sur
le marché pour être acquise, utilisée ou consommée
et pouvant satisfaire un besoin ou un désir.
Promotion : c'est un ensemble de
techniques destinées à cumuler la demande à court terme en
augmentant le rythme au niveau des achats d'un produit ou d'un service
effectué par les consommateurs ou les intermédiaires
commerciaux.
Service : un service est une
expérience temporaire vécu par un client lors de l'interaction de
celui-ci avec le personnel de l'entreprise ou son support matériel ou
technique. (Christophe Lovelock)
Un service se présente sous la forme d'activité
de bénéfice ou de satisfaction offert au moment de la vente et en
relation avec la vente de bien. (AMA)
Transfusion sanguine : c'est une
thérapeutique substitutive consistant à l'utilisation des
produits sanguins prélevés chez des individus appelés
donneurs et transfusés à des patients appelés
receveurs.
|
PAGES
|
|
INTRODUCTION GENERALE
|
6
|
|
|
|
PREMIERE PARTIE : Le cadre théorique
et méthodologique
|
8
|
|
CHAPITRE I : Le cadre théorique
|
8
|
|
I. Résumé général du thème
|
8
|
|
II. Objectif de l'étude
|
9
|
|
III. Justification du choix de l'étude
|
10
|
|
IV. Questions de recherches
|
11
|
|
CHAPITRE II : Le cadre
méthodologique
|
12
|
|
I. Le cadre de l'étude
|
12
|
|
II. Le champ de l'étude
|
15
|
|
III. Les collectes de données
|
20
|
|
|
|
DEUXIEME PARTIE : Présentation des
résultats
|
24
|
|
CHAPITRE I : Présentation des
résultats
|
24
|
|
CHAPITRE II : Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces
|
49
|
|
|
|
TROISIEME PARTIE : Recommandations et Plan
d'action
|
50
|
|
CONCLUSION GENERALE
|
52
|
|
QUATRIEME PARTIE : Annexes
|
53
|
INTRODUCTION GENERALE
Le marketing qui signifie « consulter le
consommateur et de manière plus général le
marché », peut se définir comme « l'ensemble
des méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour
promouvoir dans les publics auxquels elle s'intéresse des comportements
favorables à la réalisation de ses propres
objectifs ».
Autrement dit, c'est « l'ensemble des processus
depuis la conception et l'élaboration, la mise à disposition dans
un marché jusqu'à la consommation finale d'un produit, d'un bien
ou d'un service ».
Cette définition volontairement très large,
montre bien que le marketing ne s'applique pas seulement aux entreprises
commerciales mais peut aussi s'appliquer au social. C'est ainsi qu'on parle de
marketing social, qui est une nouvelle façon de concevoir de
très anciens projets humains.
Au Sénégal, chaque année des milliers de
femmes qui accouchent, des personnes anémiées mais aussi des
accidentés de la circulation, meurent parce que le sang dont ils ont
besoin n'est pas disponible dans les hôpitaux. Si chaque individu donnait
un peu de son sang, ces personnes pourraient être sauvées. Le
sang, produit essentiel, ne peut être synthétisé dans les
laboratoires. Seule une personne peut en donner à une autre.
Dans un tel contexte, il relève d'une grande
nécessité d'analyser la stratégie du don de sang au
Sénégal. C'est ainsi que nous nous proposons d'étudier
l'évolution que le marketing pourrait apporter au don de sang afin
d'instaurer chez la population des comportements permettant d'accomplir ce
geste qui sauve des vies. D'où l'objet de notre recherche portant sur
le marketing comme moyen de promotion du don de sang au
Sénégal. Pour cela, notre travail portera sur le cas du
Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS).
L'OMS et d'autres organisations qui ont
préconisé des stratégies claires pour développer
l'accès universel à la sécurité transfusionnelle,
suggèrent que celles-ci reposent sur la promotion du don de sang
régulier, volontaire et non rémunéré et sur la
coordination nationale des services de transfusion sanguine.
Partant delà, nous étudierons ce thème en
trois parties. Dans une première partie, nous allons délimiter le
cadre théorique et méthodologique de cette étude en
mettant l'emphase sur la problématique et l'objectif de l'étude,
sans pour autant oublier de parler de la question de recherche.
En seconde partie, nous allons faire une analyse et une
interprétation des résultats de nos recherches sur le terrain,
à partir desquelles ressortiront les forces et faiblesses du CNTS, ainsi
que ses opportunités et menaces. Enfin, nous proposerons des
suggestions, recommandations et un plan d'action pour la promotion du don de
sang au sein de la population.
CHAPITRE I : LE CADRE THEORIQUE
I. Le résumé général du
thème de l'étude
La transfusion sanguine peut être définie comme
une thérapeutique substitutive consistant à l'utilisation des
produits sanguins prélevés sur des personnes appelées
donneurs et transfusés à des patients appelés
receveurs.
Une des principales priorités de la politique nationale
de santé du Sénégal est la réduction de la
mortalité infantile et maternelle. Cette dernière a comme
principaux facteurs : les anémies et les hémorragies de la
délivrance, nécessitant une transfusion sanguine.
Une augmentation du nombre de donneurs de sang permettrait un
meilleur approvisionnement des structures de santé et par delà,
une réduction de la mortalité maternelle et infantile.
De même, le recrutement de donneurs de sang à
faible risque constitue une étape importante pour assurer une bonne
sécurité transfusionnelle, qui est un moyen de lutte contre la
pandémie des maladies transmissibles par transfusion et notamment le
V.I.H.
Au Sénégal, seuls trente cinq mille (35000) don
de sang sont réalisés en moyenne chaque année, alors que
selon les normes de l'OMS, le nombre de dons prélevés requis pour
chaque pays doit correspondre au moins à 2% de la population, soit deux
cents mille (200000) pour le Sénégal. L'insuffisance du nombre de
dons de sang réalisés au Sénégal est
aggravée par le fait que 15 à 20% des dons recueillis ne peuvent
être utilisés principalement à cause d'agents infectieux
dont le virus de l'hépatite B qui représente à lui seul
14% des causes de non utilisation des dons de sang prélevés.
La conséquence de ce problème est une
insuffisance permanente en produits sanguins, pour les patients qui en ont
besoin, principalement les femmes au cours de l'accouchement souffrant
d'anémie et de paludisme, mais également les services de
chirurgie.
Cette volonté des autorités publiques de
réduire la mortalité en générale, tarde à se
réaliser à cause du déficit constaté dans les
banques de sang.
Nos observations nous ont permis de voir que le don de sang
était victime de beaucoup de préjugés liés aux
représentations sociales. En effet, une grande partie de la population a
évolué en conservant une certaine méfiance par rapport au
don de sang. Cette attitude n'est pas gratuite, car elle a une base sociale et
psychologique bien ancrée dans l'inconscient des populations. La culture
ou les traditions y contribuent pour beaucoup, car dans la plupart de nos
sociétés (traditionnelles), il existe et demeure une certaine
réprobation à verser son sang. Les gens ont une certaine peur de
voir du sang, à fortiori se faire piquer pour donner du sang.
A ce stade de notre analyse nous pouvons-nous poser un certain
nombre d'interrogations pour mieux cerner notre sujet. Ramenée dans le
champ de la réflexion sur le don de sang et les aspects qui y sont
liés, la démarche marketing met à jour un certain nombre
d'interrogations cruciales, parmi lesquelles nous pouvons souligner les aspects
suivants :
- Comment adapter les méthodes et techniques du
marketing à un domaine où le produit est gratuit et fait sur une
base bénévole ?
- Quelle(s) stratégie(s) adopter dans ce contexte de
gratuité du produit et de bénévolat de l'action pour
accroître les disponibilités de sang ?
- En quoi le marketing peut-il aider à atteindre
valablement ces deux objectifs susmentionnés ?
Cette analyse permettra d'identifier des points d'intervention
efficaces pour mettre en place des stratégies de sensibilisation de la
population sur l'importance du don de sang et une bonne démarche
marketing pour la promotion du don de sang permettant le recrutement et la
fidélisation de donneurs.
II. Objectif de l'étude
1. Objectif général
Cette étude a pour objectif de voir comment le
marketing peut contribuer à augmenter et fidéliser les donneurs
bénévoles en vue de l'amélioration du don de sang au
Sénégal,.
2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques peuvent se regrouper en un
diagnostic externe et interne du CNTS.
Pour le diagnostic externe, il s'agira de :
Ø identifier les causes des attitudes des populations
face au don de sang ;
Ø montrer que le niveau de connaissances des
populations sur le don de sang est faible ;
Pour le diagnostic interne, nous nous proposons
de :
Ø montrer que le CNTS a un niveau de communication
faible dans les médias ;
Ø démontrer que les moyens de promotion interne
au CNTS ne touchent pas suffisamment les cibles ;
Ø montrer enfin aux groupes sociaux organisés
potentiels cibles, l'importance de l'information sur le don de sang.
III. Justification du choix de l'étude
Le choix du thème de notre mémoire peut se
justifier pour deux raisons fondamentales :
v Au plan personnel
Citoyenne, connaissant le sort des individus en situation
délicate, comme les personnes accidentées, les femmes en
accouchement ou encore les enfants anémiés, a toujours
été une préoccupation pour nous.
C'est ainsi que nous nous sommes proposés de nous
porter souvent bénévole pour donner volontairement de notre sang
afin de sauver quelques vies.
Cependant, la situation du CNTS a tout de suite attirée
notre attention, car l'offre de sang est nettement en dessous de la demande.
Une petite observation nous a permis de constater que le déficit est
surtout lié à un manque d'information de la population. Cette
dernière n'est pas assez consciente de la nécessité vitale
de donner son sang pour sauver des vies.
v Au plan professionnel
Consciente de nos aptitudes professionnelles, nous avons
pensé que cette problématique est un champ fécond pour le
marketing et la communication.
Le concept de marketing social s'adapte bien à notre
visée qui est de faire la promotion du don de sang au niveau de la
population.
Selon Kotler et Dubois, « le marketing social est la
conception, la mise en oeuvre et le contrôle de programme conçus
pour promouvoir une idée ou une pratique sociale auprès d'un
groupe cible ».
Il constitue donc une méthode de modification des
comportements. En tant que professionnel du marketing et de la communication,
la promotion d'une gamme de comportements sains et l'offre de produits et
services de santé nécessaires aux populations en
général et aux personnes à risque (femmes à
l'accouchement, enfants anémiés, personnes accidentées...)
nous interpelle au premier chef.
Dans de nombreux pays en voie de développement, le
marketing social comble le vide qui existe entre de soins du secteur public
accessibles aux personnes défavorisées, mais opérant bien
au dessus de leur capacité, et ceux du secteur commercial, accessibles
uniquement à l'élite de la population.
La promotion du don de sang au niveau de la population passe
donc par l'établissement d'un réseau de communication efficace et
durable, axé sur la clientèle. Cette clientèle du
réseau de communication constitue un élément clé
pour garantir le succès du marketing social et se matérialise
à travers des campagnes d'éducation génériques et
un ensemble de stratégies et de réseaux, tels que les
médias et les échanges interpersonnels, dans le but d'atteindre
le public cible
IV. Question(s) de recherche
Ø Comment le marketing mix pourrait-il améliorer
le don du sang au Sénégal ?
Ø Quelles stratégies de marketing adopter pour
permettre à la population de donner du sang afin d'être
fidélisée à ce geste qui sauve des vies ?
CHAPITRE II : LE CADRE METHODOLOGIQUE
I. Le cadre de l'étude
1. Le cadre naturel
Le Sénégal est situé au sud de la boucle
inférieure du fleuve Sénégal qui lui a donné son
nom. Il s'étend entre 12° et 16° de latitude Nord puis 12° et 17° de
longitude Ouest. Quatre pays sont limitrophes au Sénégal :
la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée et la
Guinée Bissau au sud. La Gambie constitue une enclave dans le territoire
sénégalais.
Le Sénégal avec comme capitale Dakar couvre une
superficie de 196.722km et à un relief plat. Il dispose d'une grande
façade maritime de 700km entièrement ouverte sur l'océan
atlantique. Le climat est de type tropical, sec, caractérisé par
une longue saison sèche (09 mois) et une saison des pluies (03 mois)
très courte.
La langue nationale la plus répandue est le wolof mais
le français reste la langue officielle administrative et
enseignée.
2. Le cadre démographique
La population du Sénégal est essentiellement
jeune. Plus de 55% de la population ont moins de 20 ans. Avec un taux
d'accroissement annuel de 2,4%, la population est estimée en 2005
à 10.817.844habitants. Les femmes représentent 52% de cette
population.
L'espérance de vie à la naissance estimée
à 51 ans pour les hommes et 53 ans pour les femmes.
Cependant, l'insuffisance permanente en
produits sanguins pour les patients qui en ont besoin, principalement les
femmes au cours de l'accouchement, les enfants souffrant d'anémie et de
paludisme, les accidentés de la route (AVC), est un handicap majeur
à la réduction de cette mortalité. A ce jour, aucune
politique de promotion du don de sang au niveau national n'a été
mise en place. La structure nationale qui devrait porter cette politique (le
CNTS), ne dispose pas de département de marketing et de communication.
Ceci justifie la nécessité de la mise en place d'une
stratégie nationale permettant d'identifier les points d'interventions
efficaces de sensibilisation et d'éducation de la population sur le don
de sang, puis le recrutement et la fidélisation des donneurs.
3. Le cadre économique
Les experts évaluent que l'économie a
vécu une période de turbulence depuis l'année 2003, avec
comme point culminant l'année 2006, notamment colorée par la
défaillance des marchés et de l'Etat, les déficits
budgétaires, la crise énergétique structurelle et la chute
du taux de croissance économique. A l'aube de l'année 2008, il
est sage de faire un bilan des récentes sautes d'humeur de
l'économie mais surtout d'évaluer les stratégies qui ont
été mises en place pour y remédier.
En effet, en raison principalement de la baisse de production
agricole pour la campagne 2005-2006 et de la hausse des cours du baril de
pétrole, l'année 2006 a connu le taux de croissance le plus bas
de la décennie, estimé seulement 2,1%, contre environ 5% en 2007
et un accroissement du déficit des comptes courants aux alentours de
10,9% du P.I.B en 2006 contre 8,9% en 2005.
- Le secteur primaire : est sans doute le principal
paradoxe de l'économie Sénégalaise, puisqu'il est à
la fois celui qui est le plus fragile mais aussi celui qui a le plus fort
potentiel de « renaissance ». Occupant plus de 70% de la
population active du Sénégal, le potentiel du secteur de
l'agriculture et de la pêche était menacé par une
croissance négative, de l'ordre de -2,9% en 2006, alors que les
estimations pour l'année 2007 prévoient une légère
hausse du taux de croissance du secteur primaire, évaluée
à 0,9%.
- Le secteur secondaire devrait se redresser à la
faveur notamment de la reprise de l'activité de production des I.C.S et
de la S.A.R. Ce secteur a enregistré une hausse de 6,3% après une
baisse de 1,7% en 2006.
- Le secteur tertiaire moins affecté par la hausse des
prix des produits pétroliers progresserait de 6,3% contre 3,5% en 2006.
Cette croissance est le fait, d'une grande partie du dynamisme du sou - secteur
des télécommunications qui croîtrait de 14% contre 15% en
2006, mais également de la progression des marges du commerce et des
autres services.
4. Le cadre technologique
Au Sénégal, à l'instar la plupart des
pays africains, l'environnement des télécommunications a beaucoup
évolué et grâce à l'existence d'infrastructures
relativement modernes couvrant une grande partie du territoire national,
l'environnement technologique est favorable à l'introduction des T.I.C.
5. L'environnement politico légal
L'environnement politico légal affecte de plus en plus
les décisions commerciales. Le système politique et son arsenal
législatif, réglementaire et administratif définit le
cadre dans lequel les entreprises mettent en oeuvre leurs activités.
Le CNTS n'a pas une influence sur les décisions
politiques au Sénégal. Cela a une grande influence sur la gestion
d'une entreprise ; car c'est ce qui détermine les lois qu'elle sera
contrainte de respecter. Elle englobe aussi les politiques publiques, les
programmes gouvernementaux ainsi que tous les aspects légaux et
réglementaires.
6. Le cadre socioculturel
Le Sénégal est un pays ethniquement
diversifié. Il compte un peu plus d'une dizaine d'ethnies
réparties comme suit : les wolofs (40%) de la population ; les
sérères (18 %) ; les toucouleurs (12%) ; les peuls
(11%) ; les diolas (9%) viennent ensuite les lébous ; les
mandingues ; les sarakholés et les bassaris. Notre pays compte
également de très fortes minorités françaises et
libanaise ainsi que des maures sénégalais.
Le Sénégal est un pays majoritairement musulman
avec 94% de la population qui est d'obédience islamique, 5%
de chrétiens et 1% d'animistes.
Le dialogue islamo chrétien garantie une bonne
cohabitation. Toutefois, il existe au sein de chaque communauté humaine
des systèmes et de représentations auxquels se
réfèrent les croyants et qui orientent leurs comportements.
Les attitudes et comportements vis-à-vis du don de sang
n'échappent à cette emprise d'idées
préconçues souvent fausses et de tabous. Le don de sang est un
geste noble qui n'interdit par aucune religion. Il ne connaît aucune
barrière religieuse, ethnique ou raciale. Cependant, le ramadan
constitue un moment ou le nombre de donneurs de sang baisse
considérablement et affecte la distribution des produits sanguins.
Compte tenu de la prédominance des musulmans au sein de la population
sénégalaise, on note une baisse nette du taux de donneurs au mois
du ramadan.
II. Champ de l'étude
1. Présentation générale de
l'organisation
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA
PREVENTION
Structure : Centre National de Transfusion
Sanguine (C.N.T.S)
Adresse : Avenue Cheikh Anta Diop
Téléphone : 33 869 86
60
Boîte Postale : 5002 Fann /
DAKAR
a) Historique
Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a
été créé le 28 Avril 1951 (57 ans) sous le nom
de Centre Fédéral de Transfusion Sanguine avec pour mission la
collecte, le traitement et la distribution du sang et de ses
dérivés dans l'ensemble de l'Afrique Occidentale
Française. Il est devenu un établissement national depuis
l'indépendance.
b) Missions
Le CNTS a pour mission de :
ü Collecter, traiter et distribuer le sang et ses
dérivés sur toute l'étendue du territoire
national ;
ü Superviser et centraliser l'ensemble des données
techniques et administratives des banques de sang placées sous sa
tutelle ;
ü Appuyer la politique gouvernementale en matière
de transfusion sanguine ;
ü Veiller à la mise en oeuvre du programme
d'assurance qualité et de sécurité en matière de
transfusion sanguine ;
ü Assurer la prise en charge des donneurs, de certaines
maladies du sang nécessitant une hémothérapie ;
ü Développer la formation et la recherche en
transfusion sanguine
ü Améliorer la santé des populations par
des prestations de qualité et des actions d'information,
d'éducation et de communication.
c) Organigramme du CNTS
Le CNTS comprend :
· Les organes de décision et de
concertation : ce sont le conseil d'administration qui est un organe de
définition de la politique de gestion du CNTS
· Le service administratif et financier : il est
chargé des affaires administratifs et de la gestion des finances de
l'établissement
· Le service de laboratoire : il a pour mission les
analyses médicales et qualification biologique c'est-à-dire
l'analyse des produits sanguins provenant des dons de sang et des
prélèvements sanguins des particuliers (malades externes).
· L'unité d'hématologie clinique est
spécialisée de la prise en charge médicales des maladies
du sang, principalement les drépanocytaires et les
hémophilies.
· Le service du sang a pour volet la transfusion, sa
politique consiste à produire du sang en qualité et en
quantité aux différentes structures
Ces activités tournent autour de quatre (04)
axes :
· Activités transfusionnelles ;
· Activités des laboratoires d'analyses ;
· Consultation spécialisée ;
· Enseignement et recherche
v Activités transfusionnelles :
ü Collecte de sang (fixe et équipe mobile) ;
ü Dépistage des maladies transmises par transfusion
;
ü Distribution de produits sanguins ;
ü Supervision des banques de sang.
v Activités de laboratoire
ü examen immuno-hématologie
ü examen sérologie
ü examen biochimie
ü recherche en collaboration avec la faculté de
Médecine de l'UCAD
v Activités d'hématologie
clinique
ü prise en charge des drépanocytaires
ü prise en charge des hémophiles
ü diagnostic des leucémies
ü recherches cliniques
d) Le Marketing Mix du CNTS
C'est « l'ensemble des décisions relatives
aux politiques de produit, de prix, de promotion, de distribution et de
communication d'une marque ». (Mercator ; Edition Dalloz
Août 2003)
Les différentes formes du marketing mix sont :
- Le produit :
Il est un composant très important pour le
consommateur. Le produit satisfait le besoin de l'entreprise mais aussi c'est
le consommateur qui en bénéficie le plus. Ici, le produit ne sera
pas un désir pour le consommateur mais pour l'entreprise.
Le produit est le sang à faible risque, en
disponibilité suffisante pour satisfaire la quantité
souhaitée en fonction du besoin des malades et permanente
c'est-à-dire toujours disponible en quantité dans les stocks.
- Le prix :
C'est la traduction économique de la valeur d'un
produit sur le marché. C'est aussi la seule composante du marketing mix
qui va permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. Mais par contre,
le prix est forfaitaire car tenant compte du coût de traitement de la
poche de sang, même si le don de sang est un acte gratuit et
bénévole.
- La communication :
« Elle est l'ensemble des techniques
destinées à cumuler la demande à court terme en augmentant
le rythme au niveau des achats d'un produit ou d'un service effectué par
les consommateurs ou les intermédiaires commerciaux ».
Le principal objectif de la promotion est ici de permettre une
modification rapide du comportement du donneur en agissant sur la demande. Elle
met directement en relation le consommateur et le produit. Le consommateur sera
le receveur et le produit le donneur.
- La distribution :
Elle est l'ensemble des opérations qui permettent
d'acheminer un produit du lieu de production jusqu'à la mise à la
disposition du consommateur ou de l'utilisateur. Elle constitue l'étape
indispensable pour mettre les produits à la disposition des
consommateurs.
Pour le CNTS, la distribution c'est les conditions
d'accès à leur produit. Il faut, accueillir le donneur, le
consulter, passer au don puis voir avec les techniciens de laboratoire
qui vont tester si le sang est à faible risque pour qu'il puisse
être distribué aux malades dans les différents
hôpitaux en fonction des besoins.
2. Présentation de l'environnement concurrentiel de
l'organisation
Nous ne pouvons pas proprement parler de concurrence en
matière de gestion du don de sang entre le CNTS et les autres structures
oeuvrant dans le même domaine. Il existe des banques de sang au niveau
des hôpitaux régionaux et une à l'Hôpital
Principal de Dakar (HPD). mais au sein de cette structure, les
disponibilités en sang sont uniquement réservées aux
patients de l'hôpital. C'est la seule différence avec le CNTS, qui
fait une demande pour tout citoyen malade étant dans le besoin. Entre le
CNTS et les banques de sang, les rapports s'inscrivent dans une dynamique de
complémentarité et non de concurrence.
III. La collecte des données
La collecte des données est subdivisée en deux(2)
parties :
v la collecte des données secondaires
v la collecte des données primaires
1. La collecte des données secondaires
Cette collecte tourne autour de trois (3) points qui
sont :
A. La Méthode de collecte
Les données secondaires sont toutes les informations
recueillies au niveau du CNTS : la lecture, les recherches au niveau de
l'internet, une thèse de doctorat en pharmacie sur le don de sang
à la Bibliothèque Universitaire (B.U), mais aussi les entretiens
avec les responsables du CNTS, tels que le responsable de la prise en
charge psychologique et le Chef du service des Ressources Humaines (CSRH) du
CNTS.
Toutes ces informations relatives au CNTS et à son
environnement immédiat nous ont permis de collectionner beaucoup de
données telles que les missions, les activités, le financement et
le statut du CNTS.
B. Analyse critique des données
Après avoir tenu des entretiens avec les responsables
du CNTS et fait un diagnostic global sur toute l'argumentation, nous avons pu
avoir quelques informations nécessaires sur le processus de don de
sang, mais surtout sur les moyens de promotion.
Il était un peu difficile pour nous de concevoir une
fiche de lecture, car la plupart des ouvrages étaient purement de type
commercial alors que nous avions plutôt à étudier un
aspect social. Nos recherches sur l'internet n'ont permis de trouver que des
informations brutes traitant souvent de sujets d'ordre général
qu'il a ensuite fallu trier pour cadrer avec notre question de recherche.
Enfin, la thèse que nous avons exploité pour
renforcer la documentation était plutôt axée sur des
informations médicales que celles marketing.
C. Justification du choix des méthodes
Nous avons opté pour ces méthodes de collecte
parce qu'elles cadrent beaucoup plus avec notre type de recherche et nos
objectifs de recherche. Grace à ces méthodes, nous avons pu avoir
des informations qui seront déterminantes pour la suite de notre
étude.
La justification d'un tel choix réside dans le fait
que les documents constituent des données fiables et concordantes par
rapport à l'information de la population sur le don de sang.
2. La collecte des données primaires
La collecte des données primaires s'est faite en trois (3)
phases :
A. Méthodes de collecte
Les données primaires sont des informations directes
recueillies suite à des enquêtes de terrain.
Cette enquête de terrain a été
menée au CNTS avec un (1) questionnaire. Ce dernier a été
appliqué sur deux (02) cibles différentes que sont les donneurs
de sang et la population générale, afin d'identifier les donneurs
et les non donneurs sur lesquelles les stratégies de marketing seront
plus axées. Cela nous a permis de savoir si le marketing agit et
pourrait aussi être un moyen de promotion du don de sang au
Sénégal.
B. Justification du choix des méthodes
La phase de terrain nous a permis d'être en contact avec
la population et de nous rapprocher des donneurs et non donneurs mais aussi de
les interroger sur les motivations qui poussent à donner ou non du sang.
En outre, cela nous a mis en rapport avec le personnel cadre (médecins,
assistants sociaux, gestionnaires, et techniciens de laboratoire) du CNTS avec
lequel avons eu un entretien très intéressant. Ceci nous a permis
de recueillir des informations sur les stratégies de promotion du don de
sang appliqué par le personnel cadre et l'appréciation des
donneurs et non donneurs sur ces stratégies.
Un tel travail trouve son intérêt dans le fait
qu'il fournit des informations claires et précises sur la qualité
des services offerts, mais aussi les moyens par lesquels le marketing pourrait
constituer une méthode de promotion du don de sang au
Sénégal.
C. Echantillonnage et présentation des
caractéristiques de l'échantillon
Les enquêtes, ont été faites au CNTS et au
sein de la population dakaroise et plus précisément à
l'UCAD et dans ses environs que sont les quartiers Point E et Fann
résidence. Nous avons aussi suivi l'unité mobile de collecte de
sang du CNTS lors d'une de ses déplacements au campus universitaire pour
une journée de don de sang organisée par une association
d'étudiants résidents au campus de l'Université Ckeikh
Anta DIOP de Dakar.
Pour bien mener cette étude, nous avons pensé
visiter les points fixes que sont : le CNTS et l'HPD. Mais pour ce dernier,
l'accès a été très difficile raison pour laquelle
nous n'avons pas pu recueillir assez d'informations nécessaires pour
bien étudier sa complémentarité avec le CNTS.
En dehors de ces points fixes, il existe d'autres lieux de
collectes mobiles. Et ceci dépend de la demande du secteur.
En somme, ce travail de recherche sur le terrain s'est
déroulé d'octobre au début du mois de novembre 2008. Nous
avons ainsi pu interroger cent (100) personnes d'âges, de
catégories socioprofessionnelles, de sexe et de religions
différentes. Cet échantillon aléatoire donne une certaine
représentation de la population dakaroise dans sa diversité.
Le mois de novembre a été consacré au
traitement des données recueillies sur le terrain et à
l'affinement du travail de recherche, suivant ses objectifs définis plus
haut.
3. Méthodes d'analyse et de présentation des
données collectées
Dans la mesure où nous avons recueillis des
données quantitatives, nous avons utilisé des méthodes
pouvant nous permettre de présenter les données collectées
de façon scientifique. De ce fait, pour présenter et analyser ces
données, nous avons utilisé des tableaux, des diagrammes en
bâtons, en bandes ou circulaires et des histogrammes. En ce sens, le
logiciel de traitement de données Microsoft Excel nous a
été d'un grand concours.
Pour l'analyse et la présentation des données
collectées, nous avons utilisé la méthode manuelle de
dépouillement qui a été complété par le
recours au logiciel tableur Microsoft Excel afin de faciliter la
présentation puis l'interprétation de ces données.
Chapitre I : PRESENTATION DES RESULTATS
A. ANALYSE ET INTERPRETATIONDES
RESULTATS
Dans ce chapitre, nous voulons
présenter, analyser et interpréter les différents aspects
relatifs aux données collectées durant notre enquête, en
rapport avec nos objectifs de recherche.
La présentation de données relatives à
une variable ou un groupe de variables sous forme de tableaux ou de graphiques
(diagrammes en secteurs, courbes, histogrammes, ...) est suivie de
l'analyse des informations ainsi fournies et de leur interprétation en
référence au contexte global de la recherche et des
réalités sociologiques, culturelles et économiques de la
population.
I. SOCIODEMOGRAPHIE DE LA POPULATION A
L'ETUDE
Cette partie permet d'apporter des informations relatives au
premier objectif spécifique de l'étude, à savoir
l'identification des caractéristiques sociodémographiques de la
population à l'étude (donneurs, non donneurs et personnel du
CNTS). Cette identification s'est opérée sur la base des
critères suivants : l'âge, le sexe, la situation
matrimoniale, le niveau d'instruction, la profession.
Tableau I : répartition de la
population à l'étude par tranche d'âge
|
Tranches d'âge
(par an)
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
[18 - 25[
|
45
|
45%
|
|
[26 - 35[
|
31
|
31%
|
|
[36 - 45[
|
18
|
18%
|
|
[46 - 60[
|
6
|
6%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF, 2008
Nous cherchons ici à voir dans la
population à l'étude les tranches d'âge qui donnent le plus
souvent de leur sang et celles qui ne fournissent pas très souvent du
sang. Ceci dans l'optique de dégager plus tard des stratégies de
marketing et de communication adaptées à chaque groupe
d'âge.
L'analyse de ce tableau nous montre que c'est la tranche
d'âge [18 - 25[qui constitue le plus grand client du CNTS en
matière de don de sang, suivi par la tranche d'âge de [26 - 35 ans
[.
En effet, selon le tableau, 76% des donneurs de sang du CNTS
ont entre 18 et 35 ans. La figure suivante illustre bien le constat selon
lequel les jeunes constituent les ¾ des donneurs de sang du CNTS.
Graphique I : diagramme
répartition par tranche d'âge de la population à
l'étude

Source : DIOUF, 2008
Une première tentative d'interprétation de ce
résultat nous ramène sans doute à la structure par
âge de la population sénégalaise qui reste essentiellement
jeune. 55% de la population à moins 20 ans. Ainsi, l'essentiel des
donneurs potentiels ne peut être trouvé que dans
l'écrasante majorité de jeunes de la ville de Dakar.
Une autre approche psychosociologique permet de mieux
comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes constituent les principaux
donneurs de sang.
En effet, si cet âge est pour un individu celui de la
pleine possession de ses capacités physiques, est aussi le moment
où se développent certains sentiments comme l'altruisme qui
repose sur des principes humanitaires poussant un individu en pleine possession
de ses capacités physiques à donner de son sang.
Ainsi, le jeune donneur fait prévaloir le sens du
devoir, il pense que c'est une bonne chose de rendre ce service à la
société, d'aider son prochain et de sauver une vie humaine.
DIOP (2007) parlant de l'altruisme comme
« motivation positive » qui incite un individu à
donner du sang, dira en ce sens que « ce type de motivation est
à encourager (surtout chez les jeunes) puisqu'il garantit que le donneur
ne cachera aucune information qui puisse nuire à la
sécurité transfusionnelle ».
En définitive, une campagne de promotion du don de sang
dans la cible jeune passera sans doute par l'utilisation de ce sentiment
d'altruisme comme stratégie de communication pour atteindre le
maximum.
Tableau II : sexe de la
population à l'étude
|
Sexe
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Masculin
|
66
|
66%
|
|
Féminin
|
34
|
34%
|
|
TOTAL
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
Le tableau fait ressortir le rapport
entre donneurs et donneuses. En effet, ce rapport est de 2 donneurs pour 1
donneuse. Donc il y'a 2 fois plus de donneurs de sang que de femmes.
La constitution physiologique de la femme fait qu'elle perd
régulièrement du sang (en moyenne tous les 28 jours). C'est ainsi
que les spécialistes se sont accordés sur le fait que la femme ne
doit donner du sang qu'une fois tous les 4 mois, là où les hommes
le peuvent le faire tous les 3 mois.
Aussi, nous pouvons évoquer le fait que les femmes
sont beaucoup plus indisponibles, et surtout si elles sont en état de
grossesse, peuvent rester plus de trois ans sans donner du sang. Au moment ou
les hommes effectuent plusieurs dons. Il y a certaines qui refusent aussi de
donner du sang par peur de l'aiguille ; par contre ce problème ne
se pose pas au niveau des hommes. Vu toutes les difficultés que
rencontrent les femmes, on peut conclure en disant que jamais le pourcentage du
taux des hommes ne serait moins faible que celle des femmes.
Graphique II :
diagramme répartition par sexe de la population à
l'étude
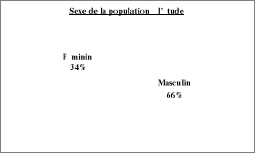
Source : DIOUF (2008)
Malgré que notre population est composée plus
de femmes que d'hommes, on constate sur notre étude que cette
élévation ne fait pas une bonne promotion du CNTS.
Les stratégies de promotion du don de sang seront donc
ciblées pour intégrer la dimension genre dans la sensibilisation
de la population sur l'importance du don de sang.
FIGURE III : relation
entre l'âge et le sexe des donneurs
La combinaison des variables âge et sexe nous renseigne
davantage sur le type d'individu donneur de sang, mais aussi sur quelles cibles
les stratégies de marketing pour la promotion du don de sang seront
beaucoup plus axées.

Source : DIOUF (2008)
L'analyse de l'histogramme nous révèle que ce
sont les hommes âgés de 18 à 35 ans qui donnent du sang au
CNTS. Nous constatons que plus l`individu prend de l'âge, moins il donne
de son sang.
L'explication que l'on peut avancer pour interpréter ce
résultat est d'ordre physiologique. En effet, plus l'individu prend de
l'âge, moins il dispose de capacités physiques pour être
apte à donner de son sang. Nous pouvons dire aussi, plus que l'individu
prend de l'âge plus il est exposé à des risques de
santé.
Tableau III : niveau d'étude de la
population à l'étude
|
Niveau d'étude
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Primaire
|
7
|
7%
|
|
Moyen
|
5
|
5%
|
|
Secondaire
|
21
|
21%
|
|
Supérieur
|
64
|
64%
|
|
Formation (coran)
|
2
|
2%
|
|
Aucun niveau
|
1
|
1%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
L'étude du niveau
d'étude de la population à l'étude peut nous fournir les
informations sur leur accès à l'information, sur l'importance du
don de sang. En effet, des études ont montré que plus l'individu
a un niveau d'étude élevé, plus il a accès à
la bonne information, et plus il est porté à donner du sang.
Nous constatons au regard de ce tableau que la majorité
des donneurs de sang ont atteint le niveau supérieur. Au-delà de
l'accès à l'information consécutive au niveau
d'étude que nous avons souligné précédemment, nous
évoquerons ici la proximité géographique du CNTS avec
l'Université Cheikh Anta Diop, mais aussi tout un foisonnement
d'écoles et d'instituts dans le périmètre des quartiers de
Fann, Point E, Mermoz.
Ceci a pour effet l'accès du niveau supérieur
à l'information sur le don de sang et la possibilité pour le CNTS
d'organiser des campagnes régulières de don de sang dans ces
différents instituts. Le diagramme suivant illustre bien l'accès
des étudiants au CNTS.
FIGURE IV : niveau d'étude de la
population enquêtée
Source : DIOUF
(2008)
Les seconds clients du CNTS restent les individus avec un
niveau d'étude équivalent au secondaire (prés d'1/4). Ceci
ne fait que confirmer l'hypothèse selon laquelle le niveau
d'étude influe beaucoup sur l'accès de l'individu aux
informations sur le don de sang. En effet, plus le niveau est faible, moins
l'individu a tendance à donner du sang.
Au delà de la corrélation (positive ou
négative) entre le niveau d'étude et la disposition à
donner du sang, des considérations socioculturelles peuvent aussi
être des sources de motivations négatives au don de sang. En
effet, les considérations de « caste » restent
encore fortement ancrées chez certains individus traditionalistes et qui
refusent de mélanger leur sang avec celui d'individus supposés
appartenir à des castes inférieures. Par exemple, certains
guéer (gens nobles) refuseraient de donner de leur
« sang noble » à des individus appartenant à
une lignée de griots ou de forgerons.
Ainsi, la valeur socioculturelle accordée au sang
influe beaucoup sur la motivation d'un individu à donner ou recevoir du
sang. Certains sous groupes religieux sont d`ailleurs contre la transfusion
sanguine même quand il s'agit de sauver une vie humaine. Il est donc
nécessaire de prendre en considération tous ces aspects
socioculturels dans les stratégies de communication pour la promotion du
don de sang surtout chez les individus à faible niveau d'instruction.
Il serait aussi intéressant de répartir les
donneurs de sang selon leurs qualifications socioprofessionnelles pour analyser
son influence dans la motivation d'un individu à donner du sang.
Tableau IV : qualification
socioprofessionnelle de la population à l'étude
|
Professions
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Elèves
|
4
|
4%
|
|
Etudiants
|
46
|
46%
|
|
Salariés
|
19
|
19%
|
|
Non salariés
|
21
|
21%
|
|
Ménagères
|
4
|
4%
|
|
Chômeurs
|
2
|
2%
|
|
Non précisé
|
4
|
4%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
L'étude de cette variable nous permet de
connaître les catégories socioprofessionnelles qui sont plus
donneurs de sang et celles pour lesquelles des campagnes de sensibilisation
sont nécessaires pour augmenter le taux de participation à des
dons de sang.
FIGURE V : répartition de
la population à l'étude selon la qualification
socioprofessionnelle

Source : DIOUF
(2008)
Cette figure vient confirmer le constat
précédent selon lequel les individus de niveau d'étude
élevés (les étudiants) sont plus favorables au don de
sang. En effet, prés de la moitié de la population à
l'étude est constituée d'étudiants. La proximité du
CNTS d'avec le campus social de l'UCAD est l'élément
déterminant de l'affluence des étudiants. Il n'est pas rare que
des entités ou autres associations d'étudiants organisent des
journées de don de sang dans le campus social au cours de leurs
manifestations. Ceci confirme tout le sens que la profession qui a le
pourcentage le plus élevé de 46% qui donnent du sang, ce sont les
étudiants. D'où la nécessité de les associer
à la politique de promotion du don de sang au sein de la population en
tant que relais.
Les salariés et non salariés constituent les
seconds clients du CNTS. Il est à noter que les non salariés
représentent les individus qui ont des revenus non réguliers
(commerçants, journaliers, ...)
Selon DIOP (2007), les motivations négatives qui
expliquent la non pratique du don de sang dans certaines catégories
socioprofessionnelles sont :
· le manque de connaissance sur le don de sang ;
· les raisons sociales portant sur la perception que l'on
du milieu médical et la méfiance par rapport à ce
milieu ;
· l'indifférence par rapport à la
portée humanitaire du don de sang se retrouve aussi chez certains
individus qui n'ont pas intériorisé la visée du don de
sang, bien qu'ayant reçu toutes les informations sur le don de sang.
Tableau V : situation matrimoniale de la
population à l'étude
|
Situation
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Célibataire
|
75
|
75%
|
|
Mariés
|
24
|
24%
|
|
Divorcés et veufs
|
1
|
1%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
L'identification du type de donneur concerne
aussi sa situation matrimoniale. Le but est de connaître qui du
marié(e), du célibataire, du divorcé(e) ou du (ou de la)
veuf (ve) donne le plus du sang.
FIGURE VI : situation matrimoniale de la
population à l'étude
 Source : DIOUF (2008) Source : DIOUF (2008)
Au regard de cette figure, nous constatons
que ¾ des donneurs de sang sont célibataires. Ce résultat se
justifie d'autant plus que la majorité de ces donneurs sont des
étudiants, étant donné que la plus part de ces derniers
sont célibataires. L'autre explication de ce résultat est
à chercher dans la structuration assez jeune de la population
sénégalaise.
Tableau VI : zone d'habitation de la population
à l'étude
|
Zone
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Centre ville
|
51
|
51%
|
|
Banlieue
|
43
|
43%
|
|
Régions
|
2
|
2%
|
|
Sans identité
|
4
|
4%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
La dernière variable de cet objectif spécifique
concernant l'identification des donneurs de sang, concerne la provenance de ces
derniers. Cette variable nous renseigne aussi sur l'accessibilité
géographique du CNTS qui a aussi des implications
socioéconomiques.
FIGURE VII : zone d'habitation de la
population à l'étude

Source : DIOUF
(2008)
Ce diagramme circulaire nous montre que la moitié des
donneurs proviennent du centre ville. Le lieu d'implantation du CNTS et la
proximité géographique du campus social et instituts font des
étudiants les premiers clients du CNTS. Ce qui explique que 51% des
donneurs proviennent des alentours immédiats du CNTS tels que l'UCAD,
Fann, Point E, Mermoz.
Cependant, il faut aussi souligner le taux non
négligeable de donneurs provenant de la banlieue de Dakar, même
si, le nombre n'est pas encore aussi significatif pour couvrir les besoins en
sang du CNTS. L'accessibilité du CNTS reste encore un obstacle au don de
sang puisque beaucoup de donneurs parcourent encore des kilomètres pour
venir donner de leur sang.
Il est donc nécessaire pour le CNTS de renforcer son
dispositif institutionnel, humain, matériel et financier pour aller
beaucoup plus vers la population.
La situation socioéconomique de la population ne permet
pas à beaucoup de se déplacer vers le CNTS pour donner du
sang.
La promotion du don de sang implique donc un mouvement vers la
cible afin de réduire les difficultés d'accessibilité au
CNTS.
Synthèse partielle
L'étude des caractéristiques
sociodémographiques de la population à l'étude a permis de
ressortir le profil du donneur de sang.
Ainsi, le client donneur de sang au CNTS est :
· de sexe masculin ;
· âgé entre 18 et 35 ans
· célibataire
· provenant des environs immédiats du CNTS ou de
la banlieue
· avec un niveau d'étude
supérieur ;
· et une situation socioprofessionnelle
d'étudiants et de salariés.
Les caractéristiques sociodémographiques des
donneurs de sang clients du CNTS identifiés, nous permettent d'adapter
ou de réadapter les stratégies de communication et de marketing
pour la promotion du don de sang selon les spécificités de chaque
cible.
Ainsi, nos suggestions pour une contribution efficace à
la promotion du don de sang prendront en compte les questions de genre,
d'accessibilité géographique, économique, socioculturelle
et psychologique du CNTS, l'influence de l'âge, de la situation
matrimoniale, du niveau d'étude et de la situation socioprofessionnelle
de la population chez qui le CNTS veut intégrer des motivations et
habitudes favorables au don de sang.
II. Notoriété du CNTS
Dans cette seconde partie de la présentation des
résultats de nos recherches, nous voulons analyser la
stratégie de communication du CNTS et son impact sur notre population
à l'étude ; notamment pour la promotion du don de sang et la
fidélisation des donneurs.
Cette analyse passera par l'étude de variables et/ou
groupes de variables sur la connaissance du CNTS, les supports, outils et
techniques de communication qu'il utilise; la qualité de ses locaux
et services et leurs impacts sur la motivation au don de sang
Tableau VII : connaissance du CNTS et source de
cette connaissance
|
Source de la
connaissance
|
Connaissance du CNTS
|
Pourcentage
|
|
OUI
|
NON
|
|
|
Par un proche
|
27
|
0
|
27%
|
|
Journées de don de sang
|
17
|
0
|
17%
|
|
Campagne de sensibilisation
|
28
|
0
|
28%
|
|
Panneaux publicitaires à la devanture du CNTS
|
5
|
0
|
5%
|
|
Sans précision
|
5
|
18
|
23%
|
|
Total
|
82
|
18
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
La majorité des
personnes enquêtées avaient déjà entendu parler de
don de sang. Seules 18% n'ont jamais entendu parler de don de sang et ignorent
ce que cela voudrait dire. Ceci témoigne du travail qui reste à
faire au niveau de cette population afin de leur permettre d'être au
même niveau d'information que les autres sur le don de sang. Parmi ceux
qui ont déjà entendu parler du don de sang, 27% ont reçu
l'information par l'intermédiaire d'un proche. Cela laisse entrevoir
l'influence de l'entourage sur la décision de donner du sang.
En effet l'un des proches qui a reçu le premier
l'information sur le don de sang ou qui en a déjà fait
l'expérience, influence généralement l'autre dans sa
décision à donner de son sang.
La première expérience de don de sang survient
aussi généralement à l'occasion d'une campagne de don de
sang en dehors des locaux du CNTS, à travers l'équipe mobile de
collecte de sang. Ainsi, 28% de la population à l'étude
déclare avoir reçu pour la première fois une information
sur le don de sang, lors de ces collectes de sang en stratégie
avancée avec l'équipe mobile. Le facteur favorisant dans cette
situation demeure la massification. L'exemple est ici le mode d'influence
usité pour convaincre la personne.
Ainsi, les modalités d'accès à
l'information sur le don de sang restent encore un enjeu majeur dans la
promotion de celui-ci. En effet, il serait très important de multiplier
ces collectes en stratégies avancées, notamment en s'appuyant sur
des relais communautaires qui, tout en faisant passer l'information sur le don
de sang dans les communautés, donnent aussi l'exemple à leurs
semblables. Le CNTS doit davantage aller vers la population et ne plus attendre
qu'elle vienne à lui. Ces déplacements sont certes couteux, mais
ne peuvent atteindre la valeur de la satisfaction morale de l'individu qui
donne de son sang et ne reçoit rien en retour.
Tableau VIII : suivi et supports des campagnes
de sensibilisation
|
Supports
|
Suivi des campagnes
|
Pourcentage
|
|
OUI
|
NON
|
|
|
Télévision
|
45
|
0
|
45%
|
|
Radio
|
3
|
0
|
3%
|
|
Journaux
|
5
|
0
|
5%
|
|
Affichage
|
11
|
0
|
11%
|
|
Flyers/Prospectus
|
4
|
0
|
4%
|
|
Panneaux Publicitaires
|
1
|
0
|
1%
|
|
Sans précision
|
4
|
27
|
31%
|
|
Total
|
73
|
27
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
En analysant ce tableau, nous pouvons dire sans risque de nous
tromper que la télévision est le média qui véhicule
mieux les informations sur le don de sang, avec un pourcentage de 45%. Les
affiches viennent en deuxième position avec 11%, enfin les journaux et
la radio avec respectivement des taux faibles de 5 et 3%.
La diffusion d'informations tendant à promouvoir des
comportements nouveaux chez la population doit nécessairement passer par
un canal qui garantisse une large couverture. C'est donc assez normal que la
télévision soit le vecteur qui diffuse mieux les informations sur
le don de sang, d'autant plus qu'elle allie image et son. L'individu a souvent
besoin de voir et d'entendre pour adhérer à un projet ; ou
changer de comportement.
Même si le CNTS produit beaucoup plus d'affiches et de
dépliants ; il faut noter que ce qui reste le plus souvent dans le
subconscient de la population demeure les images et sons qui défilent
à la télévision.
Le CNTS doit renforcer sa stratégie d'information et de
conscientisation via les journaux et la radio surtout pour toucher au maximum
la population qui n'a pas accès à la télévision.
L'utilisation des langues nationales facilite à bien
des égards l'accès de la population à l'information sur le
don de sang.
Tableau IX : rapport entre l'expérience
en Don de sang et la fréquence du Don de sang
|
Fréquence de Don de sang
|
Expérience en Don de sang
|
TOTAL
|
|
Début
|
Longtemps
|
Aucune
|
|
|
Aucun
|
0
|
0
|
21
|
21
|
|
1ére fois
|
17
|
3
|
0
|
20
|
|
2e
|
2
|
10
|
0
|
12
|
|
3e
|
0
|
10
|
0
|
10
|
|
4e
|
0
|
6
|
0
|
6
|
|
Supérieure à 4
|
0
|
31
|
0
|
31
|
|
TOTAL
|
19
|
60
|
21
|
100
|
Source : DIOUF (2008)
La relation entre l'expérience du don de sang et la
fréquence est un indicateur certains sur le niveau de
fidélisation de la clientèle,
En effet, nous avons noté que la majorité des
donneurs a une expérience de plus de quatre (04) dons. A supposer pour
les donneurs de sexe masculin un intervalle de trois (03) mois entre les dons,
nous pourrons avancer que ces donneurs ont au moins une année de
fidélité au CNTS. Pour les donneurs de sexe féminin qui
doivent observer quatre (04) mois d'intervalle entre les dons, elles
fréquenteraient la structure depuis plus de seize (16) mois.
Dans le contexte du don gratuit et bénévole de
sang, un an ou seize mois de fréquentation du CNTS suffisent largement
pour considérer un donneur comme fidèle.
Le donneur qui totalise plus de quatre dons a donc bien
intériorisé la visée de cet acte. Pour consolider son
engagement, il faudra donc diagnostiquer et maitriser avec lui les facteurs
exogènes qui peuvent concourir à son désengagement.
A cet effet, son appréciation sur la qualité des
services reste un indicateur majeur sur son degré d'engagement constant
au don de sang.
Tableau X : appréciation sur la
qualité des services offerts
Ce tableau nous permet de mesurer le degré de satisfaction
de la clientèle par rapport à la qualité des services
offerts par la structure.
|
Services offerts
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
|
Très satisfaisant
|
29
|
29%
|
|
Satisfaisant
|
33
|
33%
|
|
Assez satisfaisant
|
13
|
13%
|
|
Pas satisfaisant
|
3
|
3%
|
|
Sans réponse
|
22
|
22%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
L'appréciation des donneurs sur la
qualité des services offerts est déterminante dans leur
degré d'engagement et leur fidélisation. En effet, un client
satisfait est enclin à vouloir renouveler son acte. Le facteur
déterminant dans ce contexte demeure la relation de confiance entre le
prestataire de service et le client.
Si le client a confiance en son prestataire, il renouvelle sa
demande de service, le cas contraire mettrait un terme à
l'échange entre les deux protagonistes. Nous pouvons dire par là,
qu'il y'a une forte amélioration vu que la proximité des
différents bureaux (entretien, consultation, salle de
prélèvement et enfin la salle de collation) réduit au
maximum le temps du processus de don de sang. Le client a donc le temps de
donner du sang et de vaquer à ses occupations.
FIGURE VIII : appréciation de la
population à l'étude sur la qualité des services
offerts
Source : DIOUF
(2008)
Ainsi, il ressort une forte relation de confiance entre
les clients fidèles et la structure, d'autant plus que 62% sont
satisfaits des services qui leurs sont offerts.
Tableau XI : avis sur les locaux du
CNTS
|
Locaux
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
|
Très accueillant
|
34
|
34%
|
|
Accueillant
|
32
|
32%
|
|
Assez accueillant
|
11
|
11%
|
|
Pas accueillant
|
2
|
2%
|
|
Sans réponse
|
21
|
21%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
Ce tableau montre que les locaux du CNTS
sont accueillants d'une manière générale. La plus part des
donneurs sont très satisfaits du lieu et ceci fait la promotion du don
de sang. Nous avons remarqué pour les deux (2) derniers tableaux
(qualité du service et les locaux) pourrait etre un relais de
transmission de sensiblisation et de fidelisation des donneurs pour le CNTS.
FIGURE IX : avis de la population à
l'étude sur les locaux du CNTS
Source : DIOUF
(2008)
Dans ce tableau et l'histogramme, nous notons
que 34% des donneurs trouvent les locaux du CNTS très accueillant et 32%
accueillant. A coté de ceux là, 2% ne sont pas du tout satisfait
des locaux. Il faudra surtout analyser les explications sociologiques de cette
non satisfaction pour apporter les solutions nécessaires. Globalement,
les locaux du CNTS sont accueillants pour la plupart des donneurs qui ont eu
à accéder au centre (66%). Cependant, la structure devra
améliorer son accueil pour attitrer l'attention des autres qui n'ont
jamais eu l'occasion de connaître le CNTS. Il s'agit aussi de prendre en
considération les conditions de cet accueil et le confort
matériel qui sont les premières impressions d'un visiteur dans
une structure.
Tableau XII ; raison de l'absence
antérieure au don de sang
|
Raisons
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
|
Manque de temps
|
19
|
19%
|
|
Eloignement
|
8
|
8%
|
|
Mauvais accueil
|
0
|
|
|
Manque d'informations
|
57
|
57%
|
|
Moyen de transport
|
0
|
|
|
Sans réponse
|
16
|
16%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
Le manque de temps, le manque d'information sur le
don de sang et l'absence de sollicitation sont les principales raisons
évoquées par les non donneurs pour expliquer le manque de
pratique du don de sang. En dehors de cela, il y'a l'éloignement du
centre qui est un problème majeur pour certains. C'est pour cette raison
que le CNTS devrait intégrer une politique de déconcentration, en
créant des points de collectes dans la banlieue.
FIGURE X : raisons de l'absence antérieur
du don de sang
Source : DIOUF (2008)
Selon 57% des personnes interrogées, la raison
principale est le manque d'information, tandis que 19% avancent le manque de
temps et 8% l'éloignement du centre comme cause principale.
L'éloignement du centre transfusion par rapport aux zones d'habitation
des populations est un problème majeur.
Tableau XII : fréquence du don de
sang
|
Nombre de fois
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
|
1ère fois
|
19
|
19%
|
|
2ème fois
|
12
|
12%
|
|
3ème fois
|
10
|
10%
|
|
4ème fois
|
10
|
10%
|
|
Supérieur à 4
|
26
|
26%
|
|
Non donneurs
|
23
|
23%
|
|
Total
|
100
|
100%
|
Source : DIOUF (2008)
Les donneurs réguliers sont les piliers de la
bonne marche du centre car ils représentent 26%. Ils sont bien
informés sur la nécessité d'adopter un comportement
à faible risque de transmissions des maladies infectieuses. Ce sont donc
des agents de santé publique même s'ils sont souvent inactifs.
Certains d'entre eux se sont regroupés en associations de donneurs de
sang, mais leurs actions restent encore timides et peu
médiatisées. Ils ne sont souvent visibles qu'à l'occasion
de la journée mondiale du don de sang célébrée le
14 juin de chaque année.
Ceux qui viennent pour la première fois, doivent
être encouragés et motivés dans une perspective de
fidélisation. Il faut donc veiller à ce que toutes les conditions
soient réunies pour les motiver à renouveler cette
expérience.
FIGURE XI : fréquence du don de
sang chez la population
Source : DIOUF (2008)
Selon le tableau ci-dessus, les non donneurs
représentent un pourcentage un peu élevé de 23% de la
population interrogée sur le questionnaire. Les efforts de
sensibilisation les concernent surtout.
Synthèse partielle
L'étude de la stratégie de communication du CNTS
et son impact sur notre population à l'étude ; notamment
pour la promotion du don de sang et la fidélisation des donneurs nous a
révélé que l'entourage de la personne est
déterminante dans sa première expérience de don de
sang.
Cette première expérience survient
généralement à l'occasion d'une campagne de don de sang en
dehors des locaux du CNTS, à travers l'équipe mobile de collecte
de sang. Dés lors, le CNTS doit démultiplier ces
stratégies avancées de collecte de sang en allant davantage vers
la population. En ce sens, l'utilisation de relais communautaires au niveau des
quartiers permettrait de bien asseoir cette stratégie mobile vers la
population, en plus de la télévision qui reste le médium
qui retient le plus l'attention de la population pour la diffusion
d'informations sur le don de sang. Aussi, aller vers les populations permet de
venir à bout du manque de temps évoqué par 19% des
personnes sur les raisons de la non pratique du don de sang et des 8% de
raisons évoquées sur l'éloignement du CNTS par rapport aux
zones d'habitation ou de travail.
Même si le CNTS utilise beaucoup plus les affiches, il
est évident que renforcer la communication sur le don de sang au niveau
des télévisions notamment à travers les langues
nationales, faciliterait à bien des égards l'accès de la
population à l'information sur le don de sang. La maitrise de
l'information sur le don de sang est donc capitale d'autant plus que 57% des
raisons antérieures évoquées pour la non pratique du don
de sang concernent le manque d'informations sur le don de sang.
L'étape suivante est la fidélisation du donneur
déjà acquis à la cause. Généralement, le
donneur considéré comme fidèle capitalise une
expérience supérieure ou égale à quatre (04) dons
de sang. Etant donné qu'il faut un intervalle entre les dons, de trois
(03) mois pour les hommes et quatre (04) pour les femmes, l'on peut affirmer
que le donneur fidèle fréquente le CNTS au moins durant un (01)
an et a totalisé trois ou quatre dons de sang, selon qu'il soit de sexe
féminin ou masculin. Pour apprécier le degré de
fidélisation du client donneur de sang, il nous a fallu évaluer
son appréciation sur les locaux du CNTS et la qualité des
services offerts. Ainsi, il ressort une forte relation de confiance entre les
clients fidèles et la structure, d'autant plus que 66% d'eux trouvent
les locaux du CNTS accueillants et 62% sont satisfaits des services qui leurs
sont offerts. Cependant, la structure devra améliorer son accueil pour
attitrer l'attention des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de
connaître le CNTS. Il s'agit aussi de prendre en considération les
conditions de cet accueil et le confort matériel qui sont les
premières impressions d'un visiteur dans une structure.
En définitive, la promotion du don de sang concerne
beaucoup plus les 23% de personnes qui déclarent n'avoir jamais
reçu d'informations sur le don de sang. Cependant, il faudra concentrer
les efforts de fidélisation sur les 41% de la population qui sont entre
une (01) et trois (03) expériences de don de sang, notamment, par le
renforcement de la relation de confiance qui lie la structure et ses clients.
Aussi, les donneurs considérés comme fidèles (ayant une
expérience supérieure ou égale à quatre (04) dons
au courant d'une année) devraient servir de relais communautaires pour
le CNTS, à travers les stratégies avancées de collecte au
niveau des quartiers.
B. RESUME ET ANALYSE DES ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL
CADRE DU CNTS
Le personnel cadre est composé d'un médecin
chef, et de ses adjoints, d'assistants sociaux, de techniciens
supérieurs, d'un gestionnaire. Nous avons jugés
nécessaires de nous entretenir avec le personnel cadre pour recueillir
de plus amples informations relatives à certaines questions importantes.
Ces dernières concernent la politique de marketing interne et externe du
CNTS.
Ainsi, pour le marketing interne, nous avons soulevés
des questions relatives à la présence ou non d'un journal, de
brochures, flyers, d'un équipement audiovisuel sur le don de sang, aussi
de voir si les donneurs bénéficient d'une prise en charge
médicale et des cadeaux pour les motiver.
S'agissant du marketing externe relatif à la
présence médiatique du centre au niveau des différentes
formes de médias (radios, télévisions, journaux),
différentes questions ont été posées sur
l'existence régulière de campagnes de sensibilisation dans les
médias, des points de collecte dans les quartiers de Dakar et enfin sur
la stratégie de communication.
A cet ensemble de questionnement, des réponses ont
été apportées par le personnel cadre, réponses que
l'on peut résumer ainsi.
Premièrement, s'agissant du marketing interne, le
personnel cadre dans son ensemble nous apprend l'inexistence d'un journal de
promotion sur le don de sang. D'après leurs réponses les seuls
outils de communication dont ils disposent sont les brochures, et flyers,
l'inexistence d'un équipement audiovisuel a été aussi
soulevée. Une prise en charge médicale existe pour les donneurs
fidèles et se manifeste par des consultations régulières
et gratuites et un accompagnement psychologique pour les malades. Le centre
juge aussi nécessaire de motiver ses donneurs en les offrants des
cadeaux (tee-shirt, sacs, et porte clé, etc.).
Deuxièmement, sur les questions relatives au marketing
externe, le personnel cadre confirme qu'il existe des campagnes de
sensibilisations dans les médias. Cependant, il fait noter que celles-ci
ne sont pas régulières, elles se déroulent une à
deux fois dans l'année surtout à l'occasion de la journée
mondiale du don de sang.
Enfin, pour ce qui concerne des points de collecte fixes dans
les quartiers, le personnel confirme qu'il n'en n'existe pas. Les seules
occasions de descendre dans les quartiers se font par des équipes
mobiles qui ne passent pas plus d'une demi-journée sur le lieu. Ces
déplacements dépendent d'abord des moyens du centre et de
l'urgence des réserves.
Cet ensemble de questionnement et de réponses
mérite à notre sens une analyse en vue de mieux
appréhender les difficultés et les orientations
stratégiques. Ainsi, sur le marketing interne et externe, nous jugeons
nécessaires pour le centre de se doter d'outil de promotion du don de
sang, tel un journal périodique qui pourrait participer à faire
connaître les bienfaits et avantages de ce geste.
Les outils tels que les flyers, brochures et un
équipement audiovisuel de projection sont à promouvoir car, ils
sont utilisés par un grand nombre de structures dans leurs campagnes de
sensibilisation et de promotion.
Ces outils sont intéressants, d'abord, car ils ne
nécessitent pas de grands moyens financiers, ensuite ils permettent de
toucher un public très large.
Les réponses du personnel cadre nous ont permis de
constater que le marketing externe reste à promouvoir. Nous pensons que
dans un monde de plus en plus médiatique où la
télévision, la radio, l'internet poussent aux changements
d'attitudes et de comportement, le CNTS devrait avoir un minimum de
présence médiatique. Ainsi, des actions multiples à
travers la mise en place d'une bonne stratégie de communication pour le
don de sang s'imposent. Ces actions peuvent prendre diverses formes, des
sketches joués par des artistes de renom, des spots publicitaires, ainsi
que des appels à donner du sang dans les journaux et sur les pages des
sites internet.
Ces actions médiatiques ne doivent pas êtres
seulement sporadiques mais biens planifiées pour atteindre ce minimum de
présence médiatique.
En ce qui concerne des points de collecte fixes
sollicités par certains quartiers, nous pensons que le CNTS même
si il ne peut pas implanter partout des points de collecte fixes pour des
raisons techniques, matériels et financiers. Cependant, un effort
devrait être fait pour doter la banlieue d'un point fixe car ils sont
éloignés du CNTS.
En conclusion de cette analyse, nous disons que le CNTS est
confronté à un ensemble de problèmes. Le plus en vue est
le déficit de marketing social avec son corolaire le manque de
communication.
Source : DIOUF (2008)
Synthèse générale des
résultats de la recherche
Les stratégies de marketing/communication pour la
promotion du don de sang ou la fidélisation des donneurs doivent
nécessairement intégrer les questions de genre,
d'accessibilité géographique, économique, socioculturelle
et psychologique du CNTS, l'influence de l'âge, de la situation
matrimoniale, du niveau d'étude et de la situation socioprofessionnelle
de la population chez qui le CNTS veut intégrer des motivations et
habitudes favorables au don de sang. En cela, l'accessibilité reste un
enjeu majeur pour le CNTS. Accessibilité géographique, mais
surtout à l'information sur le don de sang. Il est donc
nécessaire pour le CNTS de renforcer son dispositif institutionnel,
humain, matériel et financier pour aller beaucoup plus vers la
population.
La maitrise de l'information sur le don de sang est donc
capitale, car dans un monde de plus en plus médiatique où la
télévision, la radio, l'internet poussent aux changements
d'attitudes et de comportement, le CNTS devrait avoir un minimum de
présence médiatique sous diverses formes comme des sketches, des
spots publicitaires, ainsi que des appels à donner du sang dans les
journaux et sur les pages des sites internet. Ces actions médiatiques ne
doivent pas êtres seulement sporadiques mais biens planifiées.
L'autre défi majeur demeure la démultiplication
des stratégies mobiles de collecte de sang en direction des populations.
En ce sens, l'utilisation des donneurs fidèles et associations de
donneurs de sang comme relais communautaires au niveau des quartiers
permettrait de bien asseoir cette stratégie qui nécessite
évidemment plus de moyens humains, matériels et financiers.
Les stratégies de fidélisation des donneurs
passent nécessairement par l'instauration ou le renforcement d'un climat
de confiance entre les donneurs et la structure. Pour cela, la première
mesure consiste à l'amélioration de la qualité de
l'accueil, du confort matériel et psychoaffectif qui sont les
premières impressions d'un visiteur dans une structure. Cette relation
de confiance passe aussi par des offres de services adaptées à la
demande de la clientèle. Les consultations régulières et
gratuites et l'accompagnement psychologique des donneurs malades sont à
encourager et à approfondir, ainsi que les cadeaux offerts (tee-shirt,
sacs, et porte clé, etc.).
Toutes ces stratégies de marketing et de communication
ne peuvent prendre forme que par la création d'un département ou
cellule de marketing et communication confié à des professionnels
au sein de la structure. Car le marketing social trouve désormais sa
pertinence dans les Etablissement de Santé Publique pour la promotion
d'une gamme de promotion de comportements répondant aux exigences de
santé publique. Le CNTS est donc interpellé sur cette question
pour atteindre ses objectifs de sécurité transfusionnelle.
Chapitre II : Identification des Forces -
Faiblesses - Opportunités - Menaces
|
FORCES
- suivi des donneurs
- analyses médicales gratuite des donneurs
fidèles
- consultations gratuites et accompagnement social
- distribution des produits sanguins
- collectes mobiles
- entretien avec l'assistant social en cas de besoin
- carte de donneur avec son groupe sanguin au deuxième don
- analyse biochimique post don
- possibilité de devenir membre de l'association des
donneurs de sang
- cadeaux offerts
- une meilleure fréquentation du CNTS
|
FAIBLESSES
- insuffisance des supports de communication
- personnel insuffisant
- manque de moyens matériels
- centralisation des activités de collecte au CNTS
|
|
OPPORTINUTES
- relais des donneurs de sang auprès de la
population
|
MENACES
- femmes enceintes
- femmes en période de règles
- les femmes allaitantes
- les personnes qui ont un comportement à risque ou des
antécédents d'Infections Sexuellement Transmissibles(IST).
- personnes malades
|
TROISIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS ET PLAN
D'ACTION
Chapitre I : Recommandations
Les suggestions de la population à l'étude nous
ont permis de dresser quelques recommandations. Ainsi, notre stratégie
de marketing pour le CNTS, s'articulera autour de l'élaboration d'un
plan de promotion du don de sang et de fidélisation des donneurs de
sang.
Sur le plan de la promotion du don de sang, le
CNTS devra :
· se doter d'un service de communication autonome ;
· faire un plaidoyer fort auprès des leaders
religieux et communautaires pour susciter un changement de comportement
favorable au don de sang ;
· utiliser l'image de personnalités (artistes,
sportifs, religieux, ...) pour la promotion du don de sang ;
· organiser régulièrement des campagnes de
sensibilisation dans les médias ;
· assurer périodiquement dans les quartiers, des
campagnes de sensibilisation de proximité à travers des
causeries, des sketches, des mobilisations sociales sur la
thématique ;
· faire des donneurs fidèles des relais
communautaires du CNTS auprès des populations;
· étudier la possibilité d'introduire dans
les curriculums scolaires des thématiques relatives au don de
sang ;
· distribuer des flyers dans les rues de Dakar ;
· améliorer l'accueil des donneurs de
sang ;
· créer des points de collecte fixes de dons de
sang dans les quartiers éloignés ;
Sur le plan de la fidélisation des donneurs,
le CNTS devra aussi
· renforcer la sécurité
transfusionnelle ;
· organiser périodiquement des espaces de
rencontres conviviales avec les donneurs fidèles et
assurer totalement avec l'Etat, la prise en
charge médicale des donneurs fidèles (de plus de trois(3)
fois).
· favoriser l'émergence de « groupes de
bénévoles du sang » dans les quartiers et
établissement scolaires ;
Chapitre II : Plan d'Action
|
ACTEURS
|
ACTIONS A MENER
|
OBJECTIFS
|
CIBLES
|
LOCALISATION
|
CHRONOGRAMME
|
MOYENS
|
SUIVI /EVALUATION
|
|
Assistant social
|
IEC/Counseling
|
Renforcer la notoriété du CNTS
Accroitre le nombre de donneurs
|
Population (spécialement les jeunes)
|
CNTS
|
Périodiquement
|
Médias, ASC, Espaces publics, CNTS.
|
Plan de suivi à élaborer
|
|
Direction
|
- Création des centres de don de sang
- Renforcement du plateau technique
|
- Recevoir plus de sang
- Améliorer la qualité transfusionnelle
|
- Jeunes de la banlieue
- Personnel du CNTS
|
- Banlieue
- CNTS
|
- A tout moment
- Janvier 2009
|
- Subvention de l'Etat
- Coopération étrangère
- Moyens financiers
|
- Lancer le projet au ministère de la santé avec
suivi
- Service administration et Financier
|
|
Division de collectes
|
- Se doter d'une structure de communication pour l'image du
CNTS
- Partenariat avec les structures de
télécommunications et les médias
|
- Améliorer la communication du CNT
- Augmenter les donneurs de sang
|
- Population de Dakar
-Nouveaux donneurs de sang
|
- Ecoles, universités, service, associations,
entreprises
- toute la population censée donner de son sang
|
- constamment
- de manière permanente
|
- Département de communication
- téléphone
- internet
- télévision, radio, presse écrite
|
- Journal mensuel d'entreprise
- faire une évaluation annuelle
|
|
Responsable du service social
|
Distribuer des flyers régulièrement
|
Sensibilisation au don de sang
|
Tous donneurs potentiels
|
Lieux publics et privés
|
constamment
|
Moyens logistiques, humains et financiers
|
Suivi permanent par le CNTS
|
|
Ministre de la santé
|
Prendre en charge médicalement les donneurs
|
Fidéliser les donneurs
|
Donneurs
|
Population de Dakar et dans les régions dès fois
|
A moyens terme
|
Procédures administratives, parlementaires
|
Suivi par l'Etat et évaluation par le CNTS
|
|
Responsable service du Sang
|
Rester en contact avec les donneurs
|
Journées d'intégrations
|
Donneurs
|
UCAD
|
De manière permanente
|
Consultation mensuelle
|
Faire des évaluations trimestrielles
|
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail de recherche qui a mobilisé
toute notre énergie durant un certains temps, nous sommes arrivé
à la conclusion suivante : la mise en oeuvre d'une bonne politique
de santé publique ne peut se faire sans l'apport stratégique du
marketing et de la communication.
Le cas du CNTS a servi de prétexte pour nous de voir
l'importance de plus en plus nécessaire d'instaurer dans les entreprises
en général et dans les Etablissements de Santé Publique en
particulier, un département chargé du marketing et de la
communication. Le Sénégal ne pourra atteindre son objectif
d'accès universel à la sécurité transfusionnelle
qu'à partir d'une politique claire et dynamique de marketing et de
communication reposant sur la promotion du don de sang régulier,
volontaire et non rémunéré et sur la coordination
nationale des services de transfusion sanguine.
La promotion du don de sang au niveau de la population passe
donc par l'établissement d'un réseau de communication efficace et
durable, axé sur la clientèle. Cette clientèle du
réseau de communication constitue un élément clé
pour garantir le succès du marketing social et se matérialise
à travers des campagnes d'éducation génériques et
un ensemble de stratégies et de réseaux, tels que les
médias et les échanges interpersonnels, dans le but d'atteindre
le public cible.
Une augmentation du nombre de donneurs de sang permettrait un
meilleur approvisionnement des structures de santé et par delà,
une réduction de la mortalité maternelle et infantile.
Le marketing social devrait donc constituer, une approche
nouvelle de plus en plus promue dans les politiques de santé publique du
Sénégal afin de permettre aux populations de mieux s'approprier
les objectifs du millénaire d'accès universel à la
santé.
Ce travail, nous l'espérons, contribuera à
l'instauration de bonnes politiques de marketing et de communication dans les
projets actuels et futures du Sénégal.
ANNEXES 1 :
|
PAGES
|
|
INTRODUCTION GENERALE
|
6
|
|
|
|
PREMIERE PARTIE : LE CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE
|
8
|
|
CHAPITRE I : LE CADRE THEORIQUE
|
8
|
|
I. Le résumé général du
thème de l'étude
|
8
|
|
II. Objectif de l'étude
|
9
|
|
1. Objectif général
|
9
|
|
2. Objectifs spécifiques
|
9
|
|
III. Justification du choix de
l'étude
|
10
|
|
IV. Question(s) de recherche
|
11
|
|
|
|
CHAPITRE II : LE CADRE METHODOLOGIQUE
|
12
|
|
I. Le cadre de l'étude
|
12
|
|
1. Le cadre naturel
|
12
|
|
2. Le cadre démographique
|
12
|
|
3. Le cadre économique
|
13
|
|
4. Le cadre technologique
|
13
|
|
5. L'environnement politico légal
|
14
|
|
6. Le cadre socioculturel
|
14
|
|
II. Champ de l'étude
|
15
|
|
1. Présentation générale de
l'organisation
|
15
|
|
a) Historique
|
15
|
|
b) Missions
|
15
|
|
c) Organigramme du CNTS
|
17
|
|
d) Le Marketing mix
|
|
|
2. Présentation de l'environnement
concurrentiel de l'organisation
|
20
|
|
III. La collecte des données
|
20
|
|
1. La collecte des données secondaires
|
20
|
|
A. La Méthode de collecte
|
21
|
|
B. Analyse critique des données
|
21
|
|
C. Justification du choix des méthodes
|
21
|
|
2. La collecte des données primaires
|
22
|
|
A. Méthodes de collecte
|
22
|
|
B. Justification du choix des méthodes
|
22
|
|
C. Echantillonnage et présentation des
caractéristiques de l'échantillon
|
22
|
|
3. Méthodes d'analyse et de présentation
des données collectées
|
23
|
|
|
|
DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS
|
24
|
|
Chapitre I : PRESENTATION DES
RESULTATS
|
24
|
|
A. ANALYSE ET INTERPRETATIONDES RESULTATS
|
24
|
|
I. SOCIODEMOGRAPHIE DE LA POPULATION A
L'ETUDE
|
24
|
|
Synthèse partielle
|
34
|
|
II. Notoriété du CNTS
|
35
|
|
Synthèse partielle
|
43
|
|
B. RESUME ET ANALYSE DES ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL
CADRE DU CNTS
|
45
|
|
Synthèse
générale des résultats de la recherche
|
47
|
|
|
|
Chapitre II : Identification des
Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces
|
49
|
|
|
|
|
|
TROISIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS ET PLAN
D'ACTION
|
50
|
|
Chapitre I :
Recommandations
|
50
|
|
Chapitre II : Plan d'Action
|
51
|
|
|
|
CONCLUSION GENERALE
|
52
|
ANNEXES 2 :
Outils de collecte de données
(guide d'entretien, questionnaire)
Odette Siga DIOUF
Etudiante en marketing/communication
Bachelor 3B/IFMC
QUESTIONNAIRE
I. Identification des donneurs
1. Sexe
Masculin Féminin
2. Tranche d'âge
18 à 25 ans ;
26 à 35 ans :
36 à 45 ans :
46 ans à 60 ans
3. Niveau d'études
Primaire
Moyen
Secondaire
Supérieure
Autres (à préciser) ........................
4. Profession
.........................................................................
5. Zone d'habitation
.........................................................................
6. Quelle est votre situation matrimoniale ?
Célibataire
Marié (e)
Autres (à préciser)
.....................................
II. Notoriété du
CNTS
7. Connaissez - vous le CNTS ?
Oui
Non
8. Si oui, par quel (s) biais ?
.........................................................................
9. Avez-vous déjà suivi des campagnes de
sensibilisation sur le don de sang ?
Oui
Non
10. Si oui, par quel(s) moyens ?
Télévision
Radio
Journaux
Affichage
Flyers/Prospectus
Panneau publicitaire
Autres (à préciser)
.....................................
11. Depuis combien de temps donnez-vous du sang ?
.........................................................................
12. Combien de fois avez-vous donné de votre
sang ?
1 fois
2 fois
3 fois
4 fois
> à 4
13. Qu'est-ce qui vous a motivé à donner de
votre sang ?
..............................................................................................................................................................................................................................
14. Pourquoi ne donniez-vous pas de votre sang avant ?
Manque de temps
Défaut d'informations
Eloignement
Moyens de transport
Mauvais accueil
Autres (à préciser)
.....................................
15. Comment trouvez-vous les locaux du CNTS ?
Pas accueillant
Assez accueillant
Accueillant
Très accueillant
16. Comment appréciez-vous la qualité des services
offerts ?
Pas satisfaisant
Assez satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant
III. Moyens et techniques de
promotion du don de sang
17. Quelle(s) suggestion(s) apporteriez-vous au CNTS pour qu'il
soit mieux connu ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. Quelle(s) suggestion(s) feriez-vous au CNTS pour
améliorer sa communication ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19. Selon vous, qu'est-ce que le CNTS doit faire pour promouvoir
le don de sang au sein de la population ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
20. Selon vous, qu'est-ce que le CNTS doit faire pour
fidéliser les donneurs de sang ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ANNEXES 3 :
|
TABLEAUX
|
TITRE
|
PAGES
|
|
Tableau I
|
Répartition de la population à l'étude par
tranche d'âge
|
24
|
|
Tableau II
|
Sexe de la population à l'étude
|
26
|
|
Tableau III
|
Niveau d'étude de la population à l'étude
|
28
|
|
Tableau IV
|
Qualification socioprofessionnelle de la population à
l'étude
|
29
|
|
Tableau V
|
Situation matrimoniale de la population à
l'étude
|
31
|
|
Tableau VI
|
Zone d'habitation de la population à l'étude
|
32
|
|
Tableau VII
|
Connaissance du CNTS et source de cette connaissance
|
35
|
|
Tableau VIII
|
Suivi et supports des campagnes de sensibilisation
|
36
|
|
Tableau IX
|
Rapport entre l'expérience en Don de sang et la
fréquence du Don de sang
|
37
|
|
Tableau X
|
Appréciation sur la qualité des services offerts
|
38
|
|
Tableau XI
|
Avis sur les locaux du CNTS
|
39
|
|
Tableau XII
|
Raison de l'absence antérieure au don de sang
|
40
|
|
Tableau XII
|
Fréquence du don de sang
|
41
|
ANNEXES 4 :
|
TABLEAUX
|
TITRES
|
PAGES
|
|
Figure 1
|
Diagramme de la répartition par tranche d'âge de la
population à l'étude
|
25
|
|
Figure 2
|
Diagramme de la répartition par sexe de la population
à l'étude
|
26
|
|
Figure 3
|
Relation entre l'âge et le sexe des donneurs
|
27
|
|
Figure 4
|
Niveau d'étude de la population à l'étude
|
28
|
|
Figure 5
|
Répartition de la population à l'étude selon
la qualification socioprofessionnelle
|
30
|
|
Figure 6
|
Situation matrimoniale de la population à
l'étude
|
31
|
|
Figure 7
|
Zone d'habitation de la population à l'étude
|
32
|
|
Figure 8
|
Appréciation sur la qualité des services offerts
|
39
|
|
Figure 9
|
Avis sur les locaux du CNTS
|
40
|
|
Figure 10
|
Raison de l'absence antérieure au don de sang
|
41
|
|
Figure 11
|
Fréquence du don de sang
|
42
|
ANNEXES 5
DEMEURE Claude, Marketing ; Paris, Editions Dalloz, 2005,
401 pages, 5ème édition
Kotler et Dubois
Thèse de Doctorat en pharmacie portant sur les
Connaissances, Attitudes et Pratiques sur le don de sang dans la ville de
Dakar, présenté et soutenu par Ndeye Fadiama Dieye DIOP, le 21
Novembre 2007 sous le N° 107, TH. M 46300 (UCAD).
Mercator (édition, Dalloz Aout 2003)
Cours de Marketing dispensé par M. DIOP
(professeur à l'IFMC)
Cours de Communication dispensé par M. KANE
(professeur à l'IFMC)
Cours de Marketing dispensé par M. SECK
(professeur à l'IFMC)
Cours de Marketing dispensé par M.
Diakhaté (professeur à l'IFMC)
Résumé de Théorie et Guide de Travaux
Pratiques « Marketing » (Pages 17 et 45).
Collection BREMOND J. (Dictionnaire économique
et social)
GEHANNE Jean Claude, (thématique de
sciences économiques, sociales, Tome II)
Internet WWW.psi.org
ANNEXES 6 : Documents divers
(documents reprographiés (photocopiés), photographies, etc.).

LES EQUIPES FIXES (CNTS)

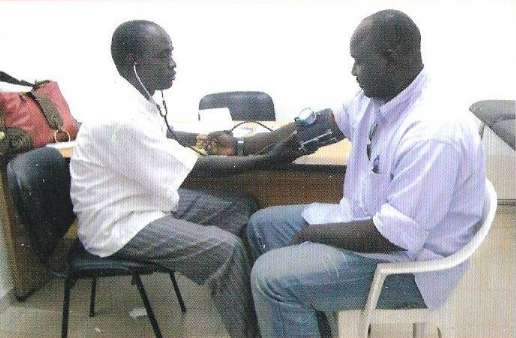
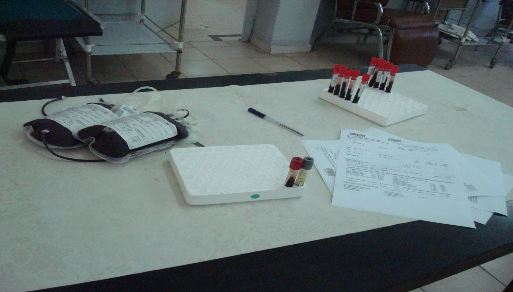
LES EQUIPES MOBILES A L'UCAD


PREPARATION POUR DES OUTILS DE DON

²


| 


