|

Département de Langue et Littérature
Françaises
Mémoire pour l'obtention du Master
spécialisé : Didactique du Français et Métiers de
l'Education et de la Formation
|
TUTORAT ET LITTERACIE UNIVERSITAIRE AU MAROC :
APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES.
CAS DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE
MEKNES
|
Préparé par : Encadré par
:
Fatima Ezahrae BIHLAL Mme. Asmaâ AFNAKAR
1
Année universitaire : 2022-2023
2
SOMMAIRE
SOMMAIRE 2
LISTES DES TABLEAUX 4
LISTES DES FIGURES 4
REMERCIEMENT 5
DEDICACE 6
INTRODUCTION GENERALE 7
PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE 11
CHAPITRE 1 : L'ECRITURE EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE. 11
1- La notion de l'écrit. 12
2-Le contexte universitaire. 14
Conclusion du chapitre 1 19
CHAPITRE 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA LITTERACIE ET LA LITTERACIE
UNIVERSITAIRE. 20
1- La littéracie. 21
2- Les principaux débats autour de la littéracie :
l'orthographe et la classification du terme 29
3- L'importance de la littéracie. 31
4- Les éléments favorisant la mise en place des
compétences littéraciques. 32
5- La littéracie universitaire : 37
Conclusion du deuxième chapitre : 42
CHAPITRE 3 : LES PRATIQUES FAVORISANT L'ACCES DES ETUDIANTS EN
LITTERACIE UNIVERSITAIRE : LE TUTORAT 43
1- Le tutorat : 44
2- le tutorat dans différents contextes
académiques : 54
3- les protagonistes de l'action tutorale : le tuteur et le
tutoré : 59
Conclusion du chapitre 3 : 69
CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE : 69
PARTIE 2 : PRATIQUE ET EMPIRIQUE 70
CHAPITRE I : METHODOLOGIE DE RECHERCHE ET PRESENTATION DE
L'INVESTIGATION 70
1- Techniques d'enquête : 70
2- Expérimentation du tutorat : 79
CHAPITRE II : RECUEIL, PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET
DISCUSSION DES RESULTATS 92
3
1- L'effet-tutoré : Recueil, présentation et
l'analyse du contenu d'exercices proposés aux tutorés, et
discussion
des résultats 92
2-L'effet-tuteur : 105
2-1 Présentation du journal de bord et son objectif :
105
2-2 Elaboration du journal de bord : 105
2-3 Recueil et analyse des données du journal de bord :
106
2-4 Discussion des données de l'expérience : (en
termes d'effet-tuteur et d'effet-tutoré) : 113
Chapitre III : Retour sur l'expérimentation et
vérification des hypothèses : 114
1- Le questionnaire d'appréciation : (retours des
tutorés) 114
1-1 Présentation du questionnaire d'appréciation
et son objectif : 114
1-2 Elaboration du questionnaire : 114
1-3 Recueil, analyse et discussion des données du
questionnaire 115
2- Difficultés rencontrées et propositions
d'amélioration du dispositif à partir du questionnaire
d'appréciation et des
journaux de bord 129
2-1 Les apports : 129
2-2 Les difficultés rencontrées : 130
2-3 les propositions d'amélioration du dispositif :
130
CONCLUSION DE LA PARTIE PRATIQUE: 132
Conclusion générale : 133
BIBLIOGRAPHIE 134
ANNEXES 136
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'APPRECIATION : 136
ANNEXE 2 : LISTE DES LACUNES 137
ANNEXE 3 : LE MODELE VIERGE DU JOURNAL DE BORD : 138
ANNEXE 4 : EXEMPLAIRE D'UN JOURNAL DE BORD DE TUTRICE REMPLI :
138
ANNEXE 5 : LE TEST DIAGNOSTIC : 140
ANNEXE 6 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AU TEST DIAGNOSTIC
: 141
ANNEXE 7 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AUX EXERCICES
D'APPLICATION DU TUTORAT 146
TABLE DES MATIERES 148
4
LISTES DES TABLEAUX
Tableau 1: comparaison des réponses S1 93
Tableau 2 : comparaison des réponses S2 99
Tableau 3: comparaison des réponses S3 101
Tableau 4: comparaison des réponses S3 suite 102
Tableau 5: comparaison des réponses S3 suite 102
Tableau 6:comparaison des réponses S4 103
Tableau 7: comparaison des réponses S4 suite 104
Tableau 8: comparaison des réponses S4 suite 104
LISTES DES FIGURES
Figure 1: utilité du tutorat 118
Figure 2: emploi du temps et répartition des
séances 119
Figure 3 : les problèmes rencontrés 123
Figure 4: accompagnement et suivi des tutrices 124
Figure 5: les points de satisfaction 127
5
REMERCIEMENT
C'est avec énorme plaisir que je réserve cette
page en signe de profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont
aidée à la réalisation de cet humble travail. Avant tout
développement de mon travail, il s'avère important d'exprimer ma
gratitude envers leur soutien qui a rendu cette expérience
enrichissante, profitable et instructive.
Tout d'abord, je tiens à exprimer mes vifs
remerciements et ma profonde gratitude pour Madame Aasmaâ Afnakar, mon
encadrante qui m'a accompagnée durant ma formation du master, et qui
sans son aide, son encadrement et sa disponibilité permanente ce travail
n'aurait jamais vu le jour. J'ai eu l'honneur madame d'être l'une de vos
étudiantes et d'avoir l'opportunité de bénéficier
de votre enseignement, de vos qualités pédagogiques,
professionnelles et humaines. J'espère que vous trouverez dans mes mots,
l'expression de ma profonde reconnaissance.
Mes remerciements sont adressés également aux
membres de jury qui ont accepté d'examiner ce modeste travail.
Je tiens à remercier aussi le corps professoral de l'Ecole
Normale Supérieur de Meknès, qui m'a dotée d'un
éventail de savoirs théoriques et pratiques durant cette
mémorable formation. Je remercie de même, l'ensemble des tutrices
et des tutorés, que pour leur participation, leur implication et leur
sérieux je dois la réalisation de ce travail.
Enfin, j'espère que ce mémoire de fin
d'étude laissera une bonne impression de l'Ecole Normale
Supérieure de Meknès.
6
DEDICACE
Quoi que je fasse ou que je dise, je ne saurai point vous
remercier comme il se doit. Votre affection me couvre et votre bienveillance me
guide.
Je tiens à dédier ce modeste travail que j'ai
réalisé avec autant d'ambition que d'ardeur à : A Dieu, le
tout puissant, le tout miséricordieux, qui m'a permis de voir ce jour
tant attendu. A la femme qui a souffert sans me laisser souffrir, et qui n'a
épargnée aucun effort pour me soutenir, mon adorable mère
Nezha Ouazzani Ibrahimi.
A l'homme précieux que Dieu m'a offert, mon cher
père Driss Bihlal, qui m'a toujours épaulée pour que je
puisse atteindre mes objectifs. Que cet humble travail traduit ma gratitude et
mon affection.
A la mémoire de mon défunt grand-père,
qui été toujours un exemple pour moi. Aucune dédicace ne
pourrait exprimer mon amour et mon respect pour toi. J'espère que ce
travail soit l'expression des voeux que vous n'avez cessé de formuler
dans vos prières. Que ton âme repose en paix.
7
INTRODUCTION GENERALE
Le concept de littéracie est souvent défini par
une entité de connaissances et de compétences qui se rapportent
à l'écrit, entre réception et production, et qui
permettent une forte acculturation au monde du savoir. L'écriture est
considérée comme étant la composante centrale de la
littéracie, elle consiste la mise en oeuvre, d'une multiplicité
de connaissances langagières visant le développement et le
progrès des aptitudes humaines.
D'ailleurs, les chercheurs ont longtemps
considéré le lire-écrire comme faisant partie des
compétences acquises après le collège, et que les
bacheliers de l'enseignement supérieur ont déjà
résolu tous les problèmes attachés à la maitrise de
l'écrit. Mais depuis les années 2000, les experts ont
annoncé une sorte de prise de conscience collective liée à
l'idée que, la compétence rédactionnelle des
étudiants en français n'est pas complétement aboutie au
moment de leur entrée à l'université, et que dès
leur arrivée, ces étudiants novices découvrent les
particularités et les spécifitées des écrits
universitaires. Conjointement, les professeurs universitaires ont tendance de
ne pas se sentir responsables de ce manque, vu qu'ils le considèrent
comme une compétence qui doit être abordée en amont.
Divers champs de recherche vont donc centrer leur attention
sur les compétences littéraciques des différents domaines
de l'activité humaine. Plus précisément, ils vont traiter
un domaine complexe, récent et pluridisciplinaire : la littéracie
universitaire, qui met en oeuvre à la fois les concepts et les
méthodologies de la didactique du français, ainsi que les
pratiques propres à l'écrit universitaire. Cet
intérêt accordé à la question des littéracies
universitaires est relatif au statut de l'écriture dans ce stade
d'enseignement, qui représente une continuité avec le cycle qui
le précède (le secondaire).
La majorité des travaux et des recherches scientifiques
qui ont été centrées sur les étudiants, insistent
sur le rôle capital que joue l'entrée à l'université
dans la réussite des étudiants, car au niveau de laquelle, ces
derniers sont appelés à réajuster leurs pratiques et leurs
manoeuvres, et les adaptées en fonction de plusieurs conditions pour
surmonter leurs difficultés. Devant cet état de
réédification, le tutorat peut trouver sa place, comme
méthode pédagogique et dispositif d'aide permettant
l'accès à la littéracie universitaire, à travers la
mise en pratique et le renforcement des pratiques scripturales.
8
L'importance accordée à la littéracie
universitaire du côté de la maitrise de l'écrit et de la
rédaction, plus le fait qu'elle est l'une des difficultés qui
priment l'enseignement supérieur au Maroc, ont influencé
fortement notre choix.
Notre problématique s'articule donc autour du
thème des compétences littéraciques à
l'université, le cas des étudiants de la première
année, département du français à ENS Meknès.
On va étudier la présence de ces compétences dans les
pratiques, et le rituel de ces étudiants, puis on va expérimenter
le tutorat comme une méthode pédagogique visant le
développement de ces capacités, et permettant l'émergence
de l'effet-tuteur.
D'ailleurs, il est important de souligner que notre
intérêt porté à la problématique de la
littéracie universitaire, a tiré sa valeur essentiellement des
témoignages des enseignants, qui soulignent à chaque fois leur
découragement face au niveau de la compétence scripturale des
étudiants, et aussi à travers l'observation des productions des
étudiants, qui a confirmé les propos avancés par leurs
enseignants.
En effet, plusieurs interrogations ont inspiré notre
réflexion, et elles peuvent se réunir sous forme de la question
suivante :
Est-ce-que le tutorat permettrait-t-il le développement
des compétences littéraciques des étudiants du
côté de l'écrit, et favoriserait-t-il l'émergence de
l'effet-tuteur à l'université marocaine ?
Les objectifs centraux de notre travail de recherche sont :
+ La focalisation sur la littéracie universitaire et
l'importance de proposer des solutions pertinentes permettant l'accès
à cette dernière.
+ La résolution des difficultés scripturales des
étudiants universitaires ainsi que la suggestion du tutorat comme
alternative proposée, pour permettre aux apprenants un
développement en termes de compétences littéraciques, et
particulièrement du côté de l'écrit.
+ La mobilisation de ce programme tutoral également pour
que les tuteurs tirent profit.
Notre recherche souhaite donc, offrir aux étudiants des
mécanismes puissants permettant leur réconciliation avec la
littéracie universitaire et surtout avec la tâche scripturale. Le
travail va se baser sur la recherche-action pour qu'il soit judicieusement
exploiter d'une part, dans le but de vérifier les connaissances du
public par rapport à la littéracie universitaire, et d'une autre
part, pour expérimenter l'efficacité du tutorat du
côté des tuteurs et des tutorés. Par
9
la suite, nous allons proposer un questionnaire
d'appréciation diffusé pour les étudiants ayant
bénéficiés du tutorat, dans le but de mesurer leur
degré de satisfaction. Un autre outil d'investigation, le journal de
bord du tuteur, va être utilisé dans la finalité de
détecter l'émergence de l'effet-tuteur chez les
étudiantes-tutrices engagées dans cette expérience. Nous
collecterons donc les données qualitatives permettant d'obtenir des
conclusions générales.
Cette recherche-action va être basée sur une
expérimentation proposée pour les étudiants de la
première année licence, département du français
à ENS Meknès qui sont des tutorés, aidés par des
tutrices-étudiantes de la deuxième année master
spécialisé en didactique du français et métiers
d'éducation et de la formation. Cette expérience commencera
d'emblée par une phase de pré-enquête ou de
découverte, durant laquelle nous proposerons une évaluation
diagnostique afin de cerner les difficultés des étudiants en
écriture. Ensuite, la modification de l'action pédagogique et la
proposition d'une forme d'aide, de remédiation, ou de
réinvestissement : le tutorat.
Et comme hypothèse de départ, nous
avançons que les étudiants de la première année du
département du français à ENS Meknès,
éprouvent de véritables difficultés en termes de
littéracie universitaire, plus précisément en
écriture, et donc ils ont besoin à l'avance des connaissances
capitales, et des pratiques appuyées pour favoriser leur accrochage aux
études supérieures qu'ils ont choisi d'entreprendre. Et le
dispositif phare capable de pallier ces besoins sera le tutorat, ayant un
rendement notable quant au développement des compétences
littéraciques des participants, et un impact positif également
sur la vie professionnelle et personnelle des tutrices.
On cite que la formulation de nos hypothèses a
trouvé son ancrage dans le rapport avec le terrain, où les
difficultés des étudiants en écriture ne sont pas
récentes. Alors les hypothèses centrales de notre recherche
résident :
+ Les étudiants de la première année
département du français, ont besoin des compétences
littéraciques pour garantir la réussite de leur parcours en
enseignement supérieur.
+ Le tutorat est un dispositif pédagogique
adéquat ayant un apport positif sur le développement de la
littéracie universitaire des étudiants.
+ Ce tutorat va être bénéfique aussi pour
les tutrices et il va contribuer au progrès de leurs compétences
personnelles et professionnelles.
10
Dans le but de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses
de recherche, et pour atteindre nos objectifs, nous articulerons dans notre
mémoire entre deux parties fondamentales : la théorie et la
pratique.
La première partie est consacrée au cadre
théorique de la recherche, qui consiste à cerner
la littérature nécessaire pour notre sujet de recherche. La
deuxième partie, pratique, consiste à mettre en oeuvre notre
méthodologie de recherche et les justifications liées à ce
choix. Egalement, il s'agit au niveau de ce volet d'expérimenter le
dispositif suggérer dans une finalité de dégager les
résultats permettant d'examiner les hypothèses avancées au
préalable. Cette partie est constituée de deux chapitres, le
premier consacré aux explications des choix méthodologiques et le
second dédié à l'expérimentation, le recueil,
l'analyse et l'interprétation des résultats, permettant de
dégager des achèvements généraux.
11
PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE
La première partie est consacrée au cadre
théorique de la recherche, dans laquelle nous allons, délimiter
la littérature nécessaire, introduire les paramètres
conceptuels et les soubassements théoriques, pour mettre en exergue les
concepts clés et les éléments de base annexés avec
notre sujet de recherche. Cette partie est intitulée : données
théoriques autour de la littéracie et du tutorat, et elle
comprend trois chapitres majeurs :
I- L'écriture en contexte
universitaire
II- La problématique de la littéracie et
la littéracie universitaire
III- Les pratiques favorisant l'accès des
étudiants en littéracie universitaire : le tutorat
CHAPITRE 1 : L'ECRITURE EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE.
En tant que matière étudiée par de
nombreux expertes et spécialistes, l'écriture a toujours
été un sujet de préoccupation pour les enseignants. Et
avec le développement de la linguistique, de la psychologie et d'autres
disciplines, la didactique de l'écrit a connu un changement
inévitable.
Au Maroc, et dans le monde entier, l'université est
conçue comme une institution d'une place valorisée, contribuant
au développement des connaissances et des savoirs, au niveau de laquelle
le statut de l'écrit et les capacités du sujet-écrivain
sont intensifiées. Ceci nous a incités à dédier ce
premier chapitre à la présentation des concepts clés que
nous avons préféré retenir dans notre cadre
général de recherche, à savoir : l'écrit, la
didactique de l'écrit, le français sur objectif universitaire, et
la compétence scripturale.
L'écriture est donc une activité
omniprésente dans les situations d'enseignement/apprentissage, où
les apprenants doivent écrire pour vérifier leur application des
règles de grammaire, de vocabulaire et de syntaxe, et pour s'engager
dans un acte de langage et de communication avec l'autre. Cette
omniprésence de l'écriture dans les activités
d'enseignement/apprentissage se manifeste clairement à travers
l'évaluation des apprenants qui se fait généralement sous
forme de travaux écrits. Elle est donc un facteur de réussite
important placé au coeur des activités d'enseignement des
sociétés lettrées.
12
1- La notion de l'écrit. 1-1 Qu'est-ce que
l'écrit :
Du latin « scriptura », l'écriture sert
à représenter les idées par des lettres ou par d'autres
signes tracés sur du papier ou sur une surface ; par ailleurs,
l'écriture est un système de signe graphiquement utilisé
dont l'intention de communiquer d'une manière textuelle.
Dans sa conception la plus large, l'écrit est souvent
défini par les didacticiens et les spécialistes en opposition
avec l'oral, ou bien en « la possibilité de représenter la
langue orale par un système visuel » (Shneuwly, 1988, p. 45). Le
même aspect est clairement présenté dans la
définition de Piolat concernant l'apprendre à écrire :
« apprendre à écrire, c'est mettre en place un autre
système de production. Différent dans ses moyens, ses contraintes
et ses fonctions du système de production orale » (Piolat, 1982,
p.159). Dans la même perspective, Vygotsky affirme que « le langage
écrit est une fonction verbale tout à fait particulière
[...] dans sa structure et son mode de fonctionnement » (Vygotsky, 1985,
p.159).
Donc on peut dire que la définition de l'écrit
par rapport à l'oral est raisonnable, du fait que les deux codes sont
différemment utilisés pour atteindre l'aboutissement de
l'écrit et accomplir l'acte de communication.
Souvent utilisée pour faire référence aux
espaces de réflexion et d'agir, l'écriture se définie
également comme étant un système de représentations
graphiques persistant dans le temps, qui génère un langage et qui
transmet du sens à travers des symboles inscrits sur un support. Dans la
même veine, nous empruntons les propos de Jean Dubois, qui profère
que :
L'écriture est une représentation de la langue
parlée au moyen de signes graphiques. C'est un code de communication au
second degré par rapport au langage, code de communication au premier
degré. La parole déroule dans le temps et disparait,
l'écriture a pour support l'espace qui la conserve. (Dubois, 2002, p.
165).
D'ailleurs, l'écrit est considéré comme
étant l'un des appuis de bases primordiales liés
aux apprentissages. Il est également un outil de
communication qui permet l'expression des sentiments, le rapport des faits et
des événements, la production d'une réflexion, d'une
pensée et d'un point de vue. Il est un élément
nécessaire pour l'apprentissage de n'importe quelle discipline qui fait
appel à plusieurs modalités et règles. Ecrire est donc une
tâche complexe et exigeante qui demande de l'apprenant-auteur, une mise
en pratique d'une orthographe, une syntaxe et une conjugaison..., et de
l'enseignant, une multiplicité de méthodes de soutien et
d'accompagnement.
Selon Yves Reuter, l'écriture :
13
Est une pratique sociale, historiquement construite, indiquant
la mise en oeuvre généralement conflictuelle de savoirs, de
représentations, de valeurs, d'investissements et d'opérations,
par laquelle un ou plusieurs
sujets visent à reproduire du sens, linguistiquement
structuré, à l'aide d'un outil, sur un support conservant
durablement ou provisoirement de l'écrit, dans un espace
socio-institutionnel donné ( 2002, p.58). Donc écrire
désigne beaucoup plus que s'approprier un code linguistique, elle
signifie aussi la nécessité d'avoir les outils et les
matériaux sociaux, linguistiques, pragmatiques et discursifs.
L'écriture a bien évidemment un processus à respecter, et
qui consiste selon l'optique du groupe DIEPE (Description Internationale des
Enseignements et des Performances en matière d'Ecrit) (1995, p.26),
à la fusion de quatre sous compétences : la planification, la
rédaction, la réécriture et la révision.
Alors, la diffusion d'un savoir ainsi que la production d'un
texte, font appel à l'écriture qui demeure une tâche
très complexe, et un acte social qui dépasse le simple
système de langue. Elle nécessite à la fois l'application
des règles linguistiques, discursives ou pragmatiques, plus le respect
des contraintes sociales et culturelles. Elle est donc la forme capitaliste des
examens à l'université qui nécessite un certain nombre
d'exigences langagières (disciplinaires, discursives,
méthodologiques, linguistiques) inscrites dans le champ des
littéracies universitaires.
1-2 la compétence scripturale :
La compétence scripturale a le mérite
d'être traitée pour nourrir davantage le champ de recherche en
didactique de l'écrit.
Suite aux nombreux travaux de recherche articulés
autour du thème de l'écriture, on peut déduire qu'il
s'agit d'un acte qui se complexifie de plus en plus, dont la mesure où
lors de cette activité, la prise en considération du contexte
social de celui qui écrit, de son statut, et de son âge
s'avère essentiel, car l'écriture n'est pas seulement une
succession de phrases et d'étapes que le scripteur doit suivre, mais
plutôt une activité qui doit être placée dans une
situation de communication bien déterminée. C'est dans cette
perspective que Reuter parle de la compétence scripturale comme
étant « l'ensemble des composantes [...] qui rendent possibles la
production et la réception de l'écrit d'une manière
adaptée et située » (Reuter, 1989, p.85).
A son tour, le groupe DIEPE (Description Internationale des
Enseignements et des Performances en matière d'Ecrit) (1995, p.5)
stipule que la compétence scripturale, se définit comme
l'agglomération et le rassemblement des savoir-faire, des acquis, des
connaissances et des attitudes qui tendent vers la production d'un texte
écrit.
14
Cette compétence scripturale, a été
à l'origine définie en didactique du français par le
sociolinguiste et le didacticien Dabène Micheal comme un « ensemble
de savoir-faire et de représentation concernant la
spécifité de l'ordre scriptural et permettant l'exercice d'une
activité langagière (extra) ordinaire » (1987, p.15). Cette
définition a été nuancée par Reuter (1996) qui
estime plutôt la conformité de trois grandes constituants : les
savoirs, les savoir-faire et les représentations. C'était donc un
survol rapide et nécessaire sur la compétence scripturale et ses
éléments constitutifs, une composante importante de la
littéracie universitaire.
1-3 L'écrit comme un objet et un outil
d'enseignement/apprentissage :
L'écrit demeure un objet d'apprentissage d'une grande
importance dans différents pays, et inclut ceux dont le français
occupe le statut de la langue maternelle, au niveau desquels, la maitrise de la
langue écrite est placée au coeur des principales
préoccupations, vu son influence sur divers apprentissages tels que
l'étude des textes littéraires, l'accès aux valeurs
nationales et aux lois etc... L'écrit domine également les
formations dans les pays où le français occupe la place d'une
langue seconde ou langue d'enseignement, il est un outil capital pour
l'apprentissage d'autres disciplines, et il réside la priorité
des écoles et des universités.
En somme, et comme le souligne Gracia-Dubanc, l'écrit
est vu comme un objet d'apprentissage favorisé et enrichi, lorsque la
langue en question est une langue maternelle. Cependant, Boudechiche et Kadi,
voient que le statut de la langue en question n'a aucun rôle pour la
faveur de l'écrit comme objet d'apprentissage, puisqu'il reste une
conduite majeure et un rituel central dans l'apprentissage d'une langue.
2-Le contexte universitaire.
2.1- l'enseignement supérieur au Maroc
:
Le système éducatif marocain est
caractérisé par la promiscuité du système public et
privé, et par la cohabitation de l'enseignement francophone et
arabophone.
En effet, depuis la création de la première
université moderne en 1957, en environ un demi-siècle, le Maroc a
réussi à créer d'autres universités et à
alphabétiser une partie importante de la population adulte, dans la
mesure où, le taux atteignait 78% en 2020 par rapport à 2004,
dont il ne dépassait pas 52%. En revanche, le système
éducatif marocain reste toujours confronter à plusieurs
défis, dont la faiblesse de l'efficience éducative principalement
due aux taux élevés d'abandon et de redoublement, et la
qualité non satisfaisante de la langue d'éducation qui influence
négativement le rendement des étudiants. Donc, l'enseignement
supérieur au Maroc positionné au sommet du système
éducatif et considéré comme l'un des piliers du
15
développement et de la formation des jeunes, doit
répondre en urgence aux enjeux sociétaux et aux fortes
inégalités.
Depuis la loi 01.00 édictée en 2000 pour
organiser le système d'enseignement supérieur marocain,
l'université a pu réaliser un développement notoire an
niveau de la formation offerte grâce aux initiatives louables qui ont
été concrétisées par un élargissement
considérable au niveau des infrastructures. Ces initiatives ont
touché l'ouverture sur l'international à travers des
partenariats, qui mettent en place des échanges internationaux des
étudiants et des chercheurs. Malgré tous les efforts
mentionnés, l'enseignement supérieur marocain est toujours
appelé pour répondre à une demande sociale pressante et
plurielle relative aux progrès économiques, sociaux et culturels,
dans la mesure où, il doit enrichir les habiletés
nécessaires pour former des jeunes capables d'assumer des
responsabilités, et de prendre en charge des missions dans
différents secteurs.
L'université est donc le lieu propice à la
formation des cadres, des intellectuels, des chercheurs et des fonctionnaires
essentiels pour le développement de toute société,
conférée à la forte demande, à la
compétitivité internationale, à la mondialisation et la
concurrence économique, elle doit mettre en place un modèle de
développement favorisant l'instauration des fondements d'une
société de savoir.
Face à cette situation exigeante qui se manifeste
surtout dans les pays en voie de développement tel que le Maroc, la
nécessité réside le fait d'offrir aux étudiants une
formation de qualité permettant l'intégration dans la vie
professionnelle active. Au bout du compte, on peut avancer que la performance
de l'enseignement supérieur au Maroc est indubitablement
multidimensionnelle, dans la mesure où, elle concerne le
déploiement des ressources humaines, la qualité de la
gouvernance, le bien fondé du financement, l'offre de formation, ainsi
que l'efficacité et la pertinence de ces modalités
pédagogiques.
2.2- Le Français Sur Objectif Universitaire
:
Le FOU, inscrit dans le domaine du français langue
étrangère, et inspiré de l'expression (English for
academic purposes) est un concept qui a gagné du terrain au niveau de la
didactique. Il est considéré comme étant une variante du
français sur objectifs spécifiques (FOS), et il vise à
préparer les apprenants pour la poursuite de leurs études
supérieures, dont la langue d'enseignement est bien évidemment le
français. Le français au niveau du FOU est conçu a
développé des programmes qui prennent en considération les
réalités du terrain, et qui appliquent des méthodes et des
activités d'appropriation linguistique pour répondre aux
besoins
16
spécifiques des étudiants. L'objectif du FOU
réside alors le fait de se concentrer sur les nouveaux besoins des
étudiants, et la nécessité de leurs doter de plusieurs
compétences, afin qu'ils puissent réaliser diverses
activités tels que : les activités communicatives,
méthodologiques, langagières et discursives.
Le FOU se centre sur l'apprenant et se préoccupe
principalement de lui offrir un éventail de compétences
transversales de réception et de production écrite et orale en
français, et de le permettre d'adapter ces compétences selon sa
spécialité. Donc le FOU est une démarche de
préparation linguistique des étudiants, principalement
appuyée sur la réception orale des cours et la production de
différents écrits universitaires.
Le FOU répond alors pertinemment à notre
objectif de recherche articulé autour de la mise en place d'un
dispositif qui vise le développement de la compétence scripturale
des étudiants, pour les initier à la littéracie
universitaire.
Le FOU à l'instar du FOS (Français sur objectif
spécifique) est donc né du souci d'adapter
l'enseignement/apprentissage du français à des publics
spécifiques qui souhaitent acquérir ou perfectionner leurs
compétences en français, pour accomplir un travail professionnel
ou une activité d'études supérieures. Il
s'intéresse à proposer des opportunités de conciliation
pour les étudiants universitaires en France, ou à ceux des
filières francophones dans d'autres pays.
Les littéracies universitaires et le français
sur objectif universitaire, sont des champs de recherche récemment
émergés dans l'horizon scientifique de la didactique des langues.
Leurs domaines sont très proches, car ils portent sur des interrogations
similaires, orientées surtout vers les écrits universitaires et
l'acculturation des étudiants. Leurs démarches sont aussi
similaires, vu que les deux adoptent une approche sociolinguistique et
pragmatique du contexte d'enseignement/apprentissage.
En définitive, le FOU considère
l'intégration et l'acculturation des étudiants comme les
clés de la réussite universitaire, il cherche alors à
accompagner ces étudiants pour qu'ils soient en mesure de s'approprier
les codes nécessaires contribuant à ces deux processus. Ce point
est donc la liaison entre les littéracies universitaires et le
Français sur Objectifs Universitaires, deux champs qui apportent un
éclairage sur cette situation complexe.
2.3- la didactique du français et les
littéracies :
La didactique par son origine grecque (didaskein : enseigner),
représente de façon générale ce qui vise à
enseigner, ce qui est propre à instruire. Comme nom, et selon le
dictionnaire de didactique du français langue étrangère et
seconde de Jean-Pierre-Cuq en 2003,
17
elle a d'abord désigné le genre
rhétorique destiné à instruire, puis l'ensemble des
théories d'enseignement et d'apprentissage. La didactique est
célèbre pour son aspect théorico-pratique, comme l'affirme
Halté :
C'est une discipline théorico-pratique dont l'objectif
essentiel est de produire des argumentations savantes,
étayées et cohérentes, susceptibles
d'orienter efficacement les pratiques enseignantes. (1993, p. 127). Il
représente également un domaine de recherche qui nous offre un
éventail de définitions, qui se rapportent aux notions qu'on
souhaite traitées dans notre travail, tel que l'écriture, la
compétence scripturale etc...
Quant à la didactique des langues, elle désigne
selon Réné Richterich, une discipline qui « a pour objet la
relation entre les actions d'enseignement et celles d'apprentissages et la
transformation des premières en secondes » (1994, p. 175). On va
s'intéresser alors à un sous-domaine de la didactique des
langues, c'est la didactique du français qui s'est
développée depuis les années 80, pour devenir d'un point
de vue des chercheurs, un outil passionnant pour examiner les activités
des apprenants, et les pratiques des enseignants. En fait, on trouve que la
didactique du français, se subdivise en deux domaines : la didactique de
l'oral qui s'intéresse au langage comme outil de communication et la
didactique de l'écrit qui le traite comme moyen d'expression
écrite. Et puisqu'on va parler des littéracies universitaires et
de la compétence scripturale, on va se positionner au détriment
de l'oral à la didactique de l'écrit, qui tire son importance
essentiellement de l'aspect « scripto-centriste » (Bouchard, 1995,
p.155) des écoles et des universités. On souligne que c'est le
caractère « scripto-centré » de la didactique de
l'écrit qui a donné naissance à une diversité de
problématiques, comme : l'entrée dans l'écrit (Coianiz,
1998, Bentolila, 2009 ; Fijalkow, 2003), le rapport à l'écrit
(Barré de Miniac, 2002 ; Chartrand & Blaser, 2008), les approches
intégrées de la lecture et de l'écriture ( Reuter, 1994
;1995), les approches intégrées de l'écrit et de l'oral
(Ammouden, 2012 ; Cappeau, 2004) et les littéracies. Alors, le lien
entre la littéracie et la didactique du français se voit
clairement dans le fait que, l'espace conceptuel de la première
amène à se questionner sur les rapports de la seconde avec les
autres disciplines, qui font appel aux activités langagières,
tels que : l'anthropologie, l'ethnologie ou les sciences de la communication et
de l'information, la littérature, les sciences du langage, les sciences
cognitives ou encore la sociologie. Cependant, la différence entre ces
deux courants, et comme l'avait mentionné Barre-De-Miniac en 1995, est
liée essentiellement au fait que l'université n'est pas le
terrain naturel pour la didactique du français, et donc lorsque nous
analysons les pratiques d'écriture des étudiants ou la
spécificité des discours universitaires, nous parlerons
plutôt des littéracies universitaires. En somme, la didactique
du
18
français reste l'ancrage théorique du champ de
la littéracie, particulièrement, la littéracie
universitaire.
2.4- L'écriture à l'université : un
enjeu complexe :
Ces dernières années et avec l'émergence
de la problématique de l'écrit universitaire dans le champ de la
didactique du français, le concept de littéracie universitaire et
celui du français sur objectif universitaire ont suscité
l'intérêt des chercheurs qui traitent les écrits
académiques, et qui s'intéressent aux difficultés des
étudiants confrontés à de nouvelles pratiques.
La problématique de l'écriture à
l'université, réside donc riche et stimulante, elle constitue un
objet d'analyse qui captive de nombreuses communautés universitaires
intéressées pour amener les étudiants à une
acquisition culturelle et à un apprentissage des normes
nécessaires pour former la communication dans l'institution
universitaire.
L'introduction du chapitre consacré aux écrits
universitaires, dans l'ouvrage « le Français sur Objectif
Universitaire » de Mangiante et Parpette en 2011, montre que les
productions écrites à l'université sont l'aboutissement du
travail académique, qui forme l'essentiel des évaluations dans ce
contexte. Ces productions doivent absolument respecter un certain nombre de
règles et de critères, chose qui rend l'écrit à ce
stade d'enseignement une tâche de plus en plus complexe. Et donc avec
cette approche, « les écrits à produire par les
étudiants sont alors perçus comme un ensemble très
diversifié qui doit répondre à « des exigences
méthodologiques » à une codification d'écriture,
à des règles de composition » (Mangiante et Parpette, 2011,
p.123). Face à cette situation, l'étudiant doit essentiellement
:
Comprendre le lien, en tant que scripteur, qui
s'établit entre le langage, la pensée, la discipline et les
différentes formes discursives. Il lui faut en effet parvenir à
maitriser ces relations entre le système
linguistique et terminologique, le savoir disciplinaire, mais
aussi la méthodologie universitaire. (Cavalla, 2007, p.37).
Alors, l'adaptation aux écrits universitaires n'est pas
une tâche simple ou automatique. Ceci est dû premièrement au
fait que la compétence écrite n'est pas accomplie lors de
l'entrée à l'université, car on parle d'une
habileté qui ne s'apprend pas une fois pour toute, mais qui continue
à évoluer tout au long de la vie de l'étudiant, et qui
nécessite une formation continue pour prendre en considération
les différents moments du parcours estudiantin. Egalement, le fait que
« les nouveaux étudiants sont confrontés à des usages
nouveaux et plus complexes de la langue écrite » (Frier, 2015,
p.34), rend l'écriture à l'université un enjeu de plus en
plus compliqué.
19
L'écriture à l'université est donc connue
par sa dynamique ainsi que sa complexité, dues aux pratiques
scripturales qui ne se réduisent pas uniquement aux aspects discursif,
linguistique, ou encore méthodologique, mais, qui demandent plusieurs
dimensions (sociale, cognitive, culturelle...), ce que Dabène en 1991,
rassemble sous le modèle de « compétence scripturale
».
En définitive, on peut avancer que l'écrit
à l'université est certainement une entrave pour les
étudiants qui fréquentent ce milieu académique. La
difficulté réside dans l'acculturation vis-à-vis des
discours universitaires, dans la prise en considération de la
diversité des pratiques, dans les choppements de s'approprier les
pratiques et les codes d'écriture à l'université, ainsi
que dans les contraintes rédactionnelles et les conditions de production
entre le scripteur primo-entrant et les évaluateurs à ce niveau
d'étude.
2.5- L'importance de l'écriture à
l'université :
Dans tous les cas, la maitrise de la production écrite
s'avère déterminante [...] avec la généralisation
des technologies de l'information et de la communication, comme l'un des
critères de recrutement académique et professionnel. Les enjeux
inhérents à l'apprentissage et à l'enseignement de la
litéracie, et notamment de l'écriture, n'ont jamais
été aussi importants et la pression sociale aussi forte.
(Alamargot, 2015, p.119)
L'écrit occupe donc une place d'une grande importance
à l'université, vu qu'il est considéré comme un
principal outil de recherche qui garantit un agir professionnel pertinent.
Conclusion du chapitre 1
Au niveau de ce premier chapitre, on a centré
l'attention sur le contexte universitaire, tout en traitant divers concepts qui
se rapporte à ce dernier, à savoir, le contexte universitaire au
Maroc, le Français Sur Objectifs universitaires, la didactique du
français, la compétence scripturale etc...
La référence à ces éléments
relatifs au domaine de l'écrit au niveau de ce chapitre, est pour
accentuer davantage son importance au niveau de l'enseignement
supérieur. Alors, on peut déduire qu'aujourd'hui, et à
première vue, l'écrit semble occuper une place très
limitée dans les nouvelles approches du monde actuel appuyées sur
le développement des technologies et des moyens de communication, et
dominées par l'oral (téléphone, télévision,
radio...). Cependant, cette révolution technologique a favorisé
l'écrit également (chat, sms, internet...). Donc malgré
tout, la communication écrite reste sans doute la plus efficace. Et
enseigner l'écriture aujourd'hui demeure un besoin indispensable
centré au coeur des recherches sur la littéracie.
20
CHAPITRE 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA LITTERACIE ET LA
LITTERACIE UNIVERSITAIRE.
L'entrée ultérieure dans l'enseignement
supérieur exige une préparation spécifique surtout en
matière de l'écrit. Cet écrit académique fait appel
à plusieurs constituantes langagières (disciplinaires,
discursives, méthodologiques, linguistiques) résumées sous
l'appellation de « littéracie ».
En fait, chaque année, un certain nombre de bacheliers
marocains quittent le lycée pour aller à l'université.
Pourtant, nombreux sont les élèves qui décrochent, car ils
se sentent incapables de s'adapter à ce nouveau monde. Ce
problème d'acculturation dans l'enseignement supérieur est
principalement dû à l'absence de la littéracie
universitaire et particulièrement à la non-maitrise de la langue
écrite, qui nécessitent un accompagnement et un suivi
approprié.
Entre les diverses nominations françaises qui
désignent la capacité à traiter l'information
écrite, tels que (lettrure, littérisme, alphabétisme,
culture écrite ou de l'écrit, maitrise de l'écrit, rapport
à l'écrit), c'est « la littéracie »,
employée à l'échelle internationale, qui domine d'une
façon triomphante les contextes francophones, dans la proportion
où, elle est connue de nos jours, comme un atout essentiel dans le
fonctionnement de la vie.
Depuis bientôt une décennie, la notion de la
littéracie a possédé l'éloge et le mérite
d'être traitée dans l'enseignement supérieur, à
travers les différents éléments de base de la langue
française, (la lecture, l'écriture et la communication orale).
Elle est donc considérée comme un concept large et
multidimensionnel, qui ne cesse d'être l'objet de nombreuses discussions
fertiles au niveau des recherches scientifiques. Son importance dans le
quotidien des hommes est expliquée davantage par la multiplicité
d'activités qui reposent sur la capacité d'écrire et de
lire.
Les compétences littéraciques sont
présentes dans toutes les sphères de l'activité humaine.
De l'enfance à l'âge adulte, tout individu devrait progresser,
développer et maintenir un niveau de littéracie afin de vivre et
communiquer en société. Et dans l'intention d'acquérir ces
compétences, il s'avère nécessaire de déterminer
«les besoins que produit une société donnée dans les
domaines de la lecture et de l'écriture, et leur maitrise »
(Rispail, 2011, p. 02).
Ce présent chapitre exposera donc les concepts phares
de notre travail de recherche, la littéracie et la littéracie
universitaire, à travers un ensemble de définitions originales
permettant d'apporter plus de précision à ces notions.
21
1- La littéracie.
1-1 L'histoire de la littéracie :
Les situations de production et de réception de
l'écrit ont été interrogées par divers champ de
recherche, vu qu'elles sont considérées comme un
élément central de l'univers supérieur qui n'a pas
été affaibli par les conditions de temporalité.
D'ailleurs, les recherches autour de cette problématique sont connues
sous l'appellation des « littéracies », orientées
essentiellement vers l'usage de l'écrit.
La notion de littéracie est née d'un
débat concernant les capacités de lire et d'écrire, et
comme la plupart des notions scientifiques, elle n'a pas été
affranchie des contradictions entre les différents groupes de
chercheurs.
Stevenson en 2010, a signalé que « la
littéracie » est un terme qui découle
étymologiquement du latin « litteratus », un adjectif qui
désigne une personne éclairée et cultivée, ou qui
fait référence au clerc, le distinguant du laïc. D'ailleurs,
ce sont les racines latines du mot qui ont accentué que l'opposition
litteratus/illeteratus, n'est pas synonyme d'une personne savante et d'une
autre populaire, mais elle renvoyait plutôt aux classes sociales
prédominantes de cette époque. Alors, il est visible que ce sont
les bases étymologiques du terme « littéracie », qui
ont donné place à l'émergence d'autres mots tels que :
(litterate : instruit, cultivé, qui sait lire et écrire), puis
illiterate, literacy et illeteracy, présentés d'une
manière attestée dans les dictionnaires anglais du
19èmesiècle.
« Le mot « littéracie » est apparu pour
la première fois en Angleterre, en 1883, au niveau du « Chambers
Dictionnary » dans un contexte de lutte contre l'analphabétisme
» (Fraenkel et Mbodj, 2010, p.9). Son apparition dans le contexte
anglophone, était au début pour faire référence, au
statut social et aux connaissances mises en oeuvre dans divers situations,
avant de devenir par la suite limitée aux pratiques du lire et
d'écrire dans un cadre éducatif. Le terme sera employé
ensuite dans la même année, au sein du « New England Journal
of Education » (Jaffré, 2004, p.24).
En 1957, l'anthropologue Richard Hoggart a effectué une
étude qui a traité le mode de vie des ouvriers britanniques dans
le Nord-Est industriel, pour montrer à tel point les capacités de
lecture de cette classe ouvrière étaient incompatibles avec les
attentes savantes de la tradition littéraire. Par la suite, en 1958,
c'est le médiéviste Herbert Grudmann qui a retracé la
construction du mot « literacy » pour souligner ses
étymologies et ses ambiguïtés.
Ensuite, dans le cadre des efforts institutionnels qui vise
l'introduction des programmes de développement et d'éducation,
L'UNESCO a diffusé le terme de littéracie dans les
années
22
1950-60. Elle a privilégié l'emploie de
l'expression « functionnal literacy » pour accentuer
l'efficacité des campagnes d'alphabétisation dans
l'intégration des adultes au sein de la société. On peut
donc déduire, que la littéracie a fait son avènement au
niveau des recherches en Angleterre et aux Etats unis durant les années
90.
Au Québec, le terme littéracie a fait sa
première apparition en 1985, au niveau de « la revue internationale
de psychologie appliquée » (Pierre, 2003, p.123). Son entrée
est une réponse aux demandes des organisations internationales comme
l'UNESCO et l'ONU qui considèrent cette compétence comme un droit
universel, et qui insistent sur son intégration dans une large
perspective socio-économique. Par la suite, elle a gagné du
terrain au niveau de grandes enquêtes, comme celle de (littératie,
économie et société, 1995), de statistique Canada et de
l'organisation de coopération et de développement
économique (l'OCDE), ou encore celle de PISA (2000-2015) (Hébert
et Lépine, 2013, p.29), chose qui a poussé les programmes
québécois à croire en l'importance « d'instruire, de
socialiser et de qualifier les élèves » (Hébert et
Lépine, 2013, p.29).
Au niveau francophone, le concept de « littéracie
» a gagné sa place au niveau des écrits scientifiques
à partir des années 90, ceci est dû au souci permanent de
toute société et qui reste bien évidemment la maitrise de
la langue écrite et sa mobilisation au sein de différents
contextes. La France n'a pas donc fait exception, et les débats autour
de « la littéracie » commencent à se multiplier.
Suite aux besoins des pays en termes de littéracie
exprimés dans divers réflexions, le courant des « literacy
studies » a trouvé largement sa place. Dans cette perspective,
plusieurs études principalement anglo-saxonnes en ethnographie et en
anthropologie ont été élaborées, surtout concernant
l'histoire de l'écriture, sa diffusion et son expansion, ses pratiques,
ses usages, ses modes de fonctionnement également, comme titre d'exemple
on site les travaux de Goody et Watt (1963), et surtout ont fait
référence à ceux de Goody (1979) qualifiés comme
étant les plus célèbres, ou encore ceux de Baso (1974), de
Swed (1981), de Heath (1983). Suivis en outre par d'autres recherches, cette
fois-ci en psychologie, comme les travaux des chercheurs Scribner et Cole
(1981), et ceux d'Olson en (1996).
Concernant, ces recherches psychologiques, on fait allusion au
« practice of literacy », une conception selon laquelle la
connaissance de la technologie de l'écrit, et les savoir-faire
liés à cette dernière, ne sont pas assimilables à
l'avance, elles sont plutôt en relation avec des contextes d'usage et
d'apprentissage bien déterminés.
La pluralité de ces recherches et leurs recommandations
empiriques multiples ont poussé l'anthropologue Brian Street (1984)
à adopter une forme plurielle de littéracie, dans la
23
mesure où il trouve que, cette littéracie
acquise au sein d'un contexte ou d'une situation, peut être
réutilisée dans une autre, et chaque structure d'usage de
l'écrit est caractérisée comme étant une
littéracie, dont le plurielle, des littéracies.
Les études en cours de la tendance des « New
Literacy Studies » de 1980, vont se baser sur de nouveaux fondements
théoriques et méthodologiques, en cohérence avec les
travaux de Street (1993,1995). L'apport de cet auteur réside avant tout
dans son travail d'orientation méthodologique, fondé sur une
approche ethnographique (contextualisation des pratiques de l'écrit,
fondement culturel de l'autorité de l'écriture, organisation des
connaissances entre l'oral et l'écrit, description
détaillée des opérations d'écriture...). On arrive
donc à comprendre les propos de Fraenkel et Mbodj : « l'effort de
Street a consisté à proposer une synthèse de ces
différents apports, dans un cadre méthodologique où
l'enquête repose sur l'observation de « literacy events », au
sein desquels le repérage de régularité permet de
dégager des « literacy practices », pratiques de
l'écrit récurrentes ». (Fraenkel et Mbodj, 2010, p.14). Par
la suite, ce courant des NLS va connaitre un éveil fertile et une
activité enrichissante avec l'apparition de plusieurs types de la
littéracie, tel que les « academic literacies » (Ac Lit) ou
les littéracies universitaires.
En gros, l'évolution du concept de littéracie,
est fondamentalement liée à quatre courants majeurs basés
sur les écrits du 20éme siècle. Le premier
courant, est celui qui définit la notion de littéracie, par un
ensemble de compétences de lecture, d'écriture et de
compréhension orale, traitées indépendamment du contexte.
Le deuxième courant, était celui des années 1960 et 1970,
qui emploie pour la première fois premier l'expression «
littéracie fonctionnelle », pour parler d'une littéracie
appliquée, pratique et située, qui vise le développement
socio-économique.
Le troisième courant, est celui qui connait la
littéracie comme un processus d'apprentissage actif. Ce courant
reproduit l'influence des théories d'apprentissage
socioconstructivistes, et interroge l'apport des pratiques de groupe. Un
dernier courant est intégré au sein des théories sociales,
où la notion de littéracie est vue en tant que texte discours.
Cette optique interpelle les discours sociopolitiques diffusés dans les
écoles, les curricula et les programmes scolaires.
La notion de « la littéracie » possède
donc une histoire prolifique, marquée par la multiplicité des
débats et des théories et des domaines qui ont marqué son
parcours, d'où le fait qu'elle soit une source de confusions
réside normal.
1-2 La littéracie : essai de définitions
:
Entant que terme calqué sur le mot anglais «
literacy » et dont son orthographe équivoque fait encore
débat dans les recherches francophones qu'on va traiter par la suite,
allant
24
de litéracie (Jaffré, 2004) à
littératie (Raynal et Rieunier, 2010), jusqu'à littéracie
(Rispail, 2011), la notion désigne d'une manière
générale, l'insertion d'un champ d'investigation qui comprend des
termes comme lecture et écriture.
Dans un sens plus large et traditionnel, la littéracie
intègre le savoir-écrire et l'usage du langage écrit dans
la société. Cependant, cette définition plutôt
simpliste ne tient pas compte des compétences en communication orale, en
écriture, et en lecture indispensables pour le développement de
chaque apprenant dans la société du XXIème
siècle. La littéracie a donc une acception plus
déterminée, qui va au-delà des capacités de lire et
d'écrire. Elle comprend le développement de la pensée,
l'ouverture sur le monde et l'utilisation des technologies de l'information et
de la communication.
Dans cette perspective, le ministère de
l'éducation et du développement de la petite enfance
Canadien a proposé en 2014, une définition plus
prétentieuse pour la littératie :
La littératie se définit comme étant la
capacité de comprendre, d'interpréter, d'évaluer et
d'utiliser à bon escient l'information retrouvée dans diverses
situations et diverses messages, à l'écrit ou à l'oral,
pour communiquer et interagir efficacement en société ».
Cette définition semble stupéfiante car, elle s'écarte des
autres explications par sa négligence des termes « lire » et
« écrire », et son privilège pour les
compétences nécessaires à l'insertion sociale. En gros, on
peut retenir que la littéracie permet à l'apprenant de «
lire » le monde et « d'écrire » sa vie.
La littéracie, « désigne à la fois
un domaine d'étude recouvrant les différentes dimensions de
l'écrit et ses rapports avec l'oral, et un état aussi bien social
qu'individuel. (Régime Pierre, 1994, p.278).
La définition de Jaffré pour la
littéracie se centre essentiellement sur l'aspect socio-pragmatique de
l'action dans le contexte social. Il mentionne que la littéracie :
[...] désigne l'ensemble des activités humaines
qui impliquent l'usage de l'écriture, en réception et en
production. Elle met un ensemble de compétences de base, linguistique et
graphique, au service de pratiques, qu'elles soient techniques, cognitives,
sociales ou culturelles. (Jaffré, 2004, p.31).
A travers cette définition, on peut constater que la
notion de littéracie est très souvent définie en fonction
de l'écrit, pour faire référence à l'ensemble de
connaissances et d'habiletés permettant son acquisition.
Sous le vocable de littéracie, Vanhulle et Schilings
estiment que cette notion est « [...] une maitrise la plus large possible
de la langue écrite, en termes de réception et/ou production de
textes complexes, [...] de genres sociaux [...] ou de genres académiques
». (Vanhulle et Schilings, 2000, p.47), qui peut être enrichie par
une diversité de supports et une multiplicité de discours.
25
De sa part, Collès souligne que :
[...] les usages de l'écrit varient d'une
société à l'autre et les niveaux de littératie
attendus varient d'autant. Selon les chercheurs, comme les usages de
l'écrit et leurs fonctionnements varient sur l'axe spatiotemporel, il y
aurait autant de types de littéracie que de cultures et de
sous-cultures. (Collès, 2001, p.68).
Ces propos accentuent de la même manière
l'idée de Jezak, Painchaud, D'anglejan et Témisjian (1995), qui
consiste au fait que la compétence langagière est dynamique dont
la mesure où, elle varie dans le temps et dans l'espace, en fonction des
individus et des contextes socioculturels.
Pour parler des réflexions contemporaines
consacrées à l'écrit, et à la littéracie, il
est important de mentionner les théories de l'anthropologue britannique
Jack Goody (1915-2015), développées dans son ouvrage « la
raison graphique » en (1979). En fait, les répercussions de Goody
ont traité la notion de littéracie comme « la relation
lecture-écriture ; - l'incarnation au travers de pratiques et
d'institutions ; - la fonctionnalité pour l'individu et la
société ; - le continuum de son apprentissage et de sa maitrise
» (Reuter, 2006, p.132). On peut retenir que, les travaux de Goody ont
défini la littéracie non seulement comme un simple
équivalent de l'écrit, mais plutôt comme un système
symbolique, institutionnel et matériel.
Dans les systèmes éducatifs et sociaux
contemporains, la littéracie et l'alphabétisation sont souvent
confondus, cependant leurs définitions montrent un certain écart,
dans la mesure où la première est définie comme
étant une « habileté ou [une] compétence dans
l'utilisation du code écrit », ou « comme étant
l'« enseignement ou [l'] apprentissage de base du code écrit
(lecture, écriture, calcul » (Legendre, 2005, p.41). Cette
définition montre clairement l'aspect restreint de
l'alphabétisation et celui large de la littéracie qui ne se
limite pas seulement à la connaissance de l'écrit, mais qui la
dépasse à tout ce qui est culturel et social.
Ensuite et selon la conception de Rispail « la
littéracie est contrairement à l'illetrisme, désigne la
possession et non-pas l'absence de compétences de lecture,
d'écriture, de calcul, et ce, sur un continuum permettant de s'adapter
à toute situation de vie » (2011). Dans la même veine, le
conseil canadien sur l'apprentissage (CCA), montre que :
La littératie va au-delà de la capacité
de lire et d'écrire. Pour réussir sur les plans économique
et social, un adulte doit avoir la capacité d'analyse l'information, de
comprendre des concepts abstraits et d'acquérir de nombreuses autres
compétences complexes. (2011, p .1).
On peut donc avancer que le point qui attire l'attention de
plusieurs chercheurs pour s'intéresser à la littéracie est
celui relatif au développement intégral de la personne, les
spécialistes voient que la littéracie pointe cet aspect
contrairement au savoir lire-écrire basique.
26
Dans le cas de la didactique des langues,
La littéracie peut avoir une réelle valeur
heuristique permettant l'établissement de relations plus étroites
entre les dimensions culturelles et cognitives dans les actes de lire et
d'écrire, en distinguant davantage la scripturalité et la
textualité, en faisant ressortir les dichotomies entre la culture de
l'écrit et la culture de l'oral, et finalement, en tissant des liens
entre les pratiques scolaires et extrascolaires familiales et sociales.
(Barré-De-Miniac, 2003 ; Cuq, 2003, p. 158),
Cette définition, met donc en exergue les origines
étymologiques du terme qui insistent sur la nécessité de
maitriser l'écrit sous ses multiples perspectives sociales. Alors, la
littéracie faisant allusion aux attitudes, aux relations sociales, aux
sentiments et aux valeurs, n'est pas liée uniquement aux individus, elle
concerne également les communautés et leur aspect
socioculturel.
La littéracie est une notion souvent connue par son
aspect changeant, fortement souligné dans la définition de
Russbach : la littéracie est «un processus en perpétuelle
transformation et en constante redéfinition que comme un ensemble de
compétences » (Russbach, 2016, p. 97). Donc, comme étant une
notion contextualisée, la littéracie permet la lecture,
l'écriture, la discussion et la pensée critique. Elle offre
l'opportunité de partager des informations, d'interagir avec autrui.
Elle dépasse donc le simple« savoir lire et écrire »,
et elle fait appel à plusieurs événements, comme la
lecture des cartes et des indications et d'autres situations qui n'ont pas
toujours une visée éducative, d'où la
référence à la « literacy events ». L'attention
accordée par la littéracie à ce genre de situations est
lié au fait que, l'individu est toujours en apprentissage et pas
uniquement dans un cadre strictement scolaire : la littéracie est «
[...] comme un ensemble évolutif de compétences, de connaissances
et de stratégies qu'une personne met en oeuvre tout au long de sa vie
dans divers contextes ...» ( Kirsch, 2005, p.11). La littéracie une
notion continuiste qui s'intéresse au développement
intégral de l'être humain, prend un chemin plurivoque qui admet en
général deux grandes définitions : une approximative, et
l'autre minimaliste.
1-3 Les caractéristiques de la littéracie
:
Le traitement des différentes définitions
proposées pour la notion de littéracie nous a permis de
dégager les principales caractéristiques qui créent la
particularité de ce concept. La littéracie est donc :
l
27
Historiquement située
l Contextualisée dans le temps et dans l'espace : elle
ne s'agit pas d'un concept théorique pur, mais d'un ensemble de contenus
intimement liés au contexte social. Par exemple, les besoins
littéraciques varient si on est jeune ou âgé, citadin ou
bien rural, américain ou africain, selon le métier exercée
et le domaine de spécialité etc...
l Complexe : d'où la nécessité de
mobiliser un éventail de compétences et de ressources, qui se
rapportent à l'individu et à son environnement.
l Liée à l'écrit : au niveau de la
littéracie, l'écrit est la forme privilégiée vu la
présence de plusieurs graphies structurées par les institutions
sociales.
l Variable, dynamique et renouvelée : dans la mesure
où, elle est une démarche d'apprentissage à vie qui
évolue en fonction d'âge, et qui se renouvèle pour
être adaptable aux besoins individuels et sociétaux.
l Interactive : une interactivité entre plusieurs
éléments, à savoir : l'individu et la
société, l'individu et son environnement, l'écrit et
l'orale... Cette interactivité rappelle éventuellement la
complexité de la notion ainsi que sa variabilité contextuelle.
l Multidimensionnelle : elle montre la fusion entre le
cognitif, l'affectif, le linguistique, le social et le culturel.
l Pluri-objectifs et interdisciplinaire : qui renvoie aux
différents contextes (personnels, professionnels, socioculturels)
liés à l'appropriation de l'écrit.
l Emancipatrice, progressiste et humaniste : qui vise le
développement exhaustif de l'individu.
l Réelle et authentique : vu qu'elle propose des
tâches extrascolaires et scolaires originales et inédites.
1-4 Les dimensions de la littéracie :
Trois dimensions de la littéracie ont
été exposées avec clarté dans l'enseignement et
l'apprentissage :
D'emblée, les dimensions culturelles : qui
font référence à un ensemble de représentations, de
capacités, et d'institutions sociales relatives à la culture de
l'écrit au sein d'une société littéracique.
28
Ensuite, les dimensions de l'agir de l'activité de
lire et d'écrire : au niveau desquelles le savoir lire et
écrire n'est pas le résultat d'une étatisation impulsive,
il dépend pourtant de plusieurs activités d'appropriation et de
diverses situations de résolutions des problèmes. Cette dimension
consiste à rendre le scripteur capable d'écrire, de
contrôler et d'aménager le processus de son l'écriture.
Enfin, les dimensions de structuration de la langue
écrite : considérablement développées par
Helmut Feilke, elles englobent la capacité de transcrire en
caractères un message, l'habileté de construire phonologiquement,
morphologiquement, syntaxiquement une représentation de la langue
écrite, et enfin la compétence de connaitre les contraintes
stylistiques, grammaticales et fonctionnels d'un texte.
1-5 Les types de littéracies :
Avant de se pencher sur la littéracie universitaire,
le sujet central de notre travail de recherche, il est appréciable de
faire le tour des horizons concernant les différents types de
littéracie pour accentuer davantage son pluralisme.
La littéracie numérique :
Se voit comme la capacité d'un individu à
participer d'une manière crédule au niveau d'une
société, qui recourt aux différentes évolutions
technologiques et numériques de communication.
La littéracie financière :
Correspond au fait de posséder les habiletés
nécessaires permettant la prise des décisions
éclairées concernant les ressources financières. Elle
englobe l'éducation économique, budgétaire et
financière, et elle touche des actions de gagner, dépenser,
gérer, économiser, investir et fructifier.
La littéracie médiatique :
Est une notion qui renvoie à la juxtaposition de deux
grands concepts : « littéracie et médias ». Selon la
commission européennes, la littéracie médiatique est la
capacité à accéder aux médias, à comprendre
ces différents aspects.
La littéracie médiatique multimodale :
(LMM)
Elle comporte les compétences liées au
décryptement, à l'analyse et à l'évaluation de
divers médias, imprimées et électroniques.
29
La littéracie en santé :
L'organisation mondiale de la santé définie ce
type de littéracie, comme étant l'ensemble des « aptitudes
cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la
capacité des individus à obtenir, comprendre et utiliser des
informations d'une façon qui favorise et maintienne une bonne
santé » (Glossaire de la promotion de la santé,
Genève, 1998).
La littéracie disciplinaire :
Les étudiants devraient développer
graduellement leur habileté à lire, et à écrire
pour qu'elles soient commodes avec leur discipline. Ils doivent donc comprendre
la façon d'adapter le lire-écrire selon le domaine ou la
spécialité.
La littéracie précoce :
Les premières compétences en littéracie
précoce se font donc avant l'école élémentaire et
correspondent au traitement de l'écriture.
2- Les principaux débats autour de la
littéracie : l'orthographe et la classification du terme
L'orthographe francisée non-stabilisée de la
notion de littéracie apporte quelques nuances. En général,
l'orthographe poursuit une habitude anglo-saxonne, puisque Barton en 1994, et
même Jaffré en 2004, ont pu relever les premières
occurrences du terme dans un dictionnaire d'éducation anglais paru en
1924. De multiples hésitations concernant l'orthographe du mot ont
été repérées surtout, au niveau de la fin du terme,
ou bien au niveau de son utilisation au singulier ou au pluriel. L'orthographe
du terme, a pris particulièrement trois formes majeures : «
littéracie », une forme qui rappelle le lien avec « la
littérature », en démontrant l'emploi du « tt »,
comme dérivant de « lettre ». Le recours à cette
orthographe se trouve surtout dans les écrits de quelques chercheurs
contemporains tels que Barré-De-Miniac (2003) et Rispail (2011).
Ensuite, « Litéracie » une forme qui
préserve l'orthographe anglaise en remplaçant dans la variante
française le « cy », par le « cie ». Et puis, «
littératie » une forme triomphante, généralement
employée dans les écrits du Canada francophone. C'est une
orthographe qui remplace le « c » final par un « t », tout
en gardant le double « tt » pour rappeler toujours le lien avec
« lettre ».
A travers les dérivations orthographiques
mentionnées on peut comprendre l'antagonisme qui entoure la traduction
du mot anglais « literacy ». Marquillo Larruy a fait
référence
30
également à ce point, dans la mesure où
il a avancé que « l'instabilité orthographique en
français de « literacy », n'est peut-être que signe
avant-coureur- néanmoins symptomatique des embarras de la migration en
francophonie de ce concept britannique » (2012, p.50-51).
Dr Latifa Kadi de l'université d'Annaba en
Algérie, a effectué une recherche sur le moteur Google concernant
l'utilisation de terme littéracie. Cette étude a donné
à lire pas moins de 124370 occurrences pour l'entrée «
littéracie » dans ses différentes variantes orthographiques
(littéracie, littératie, litéracie ou encore
litératie), 37700 pour « alphabétisme » et 11600 pour
« littérisme », et seulement 2190 pour « lettrure »
souvent utilisé dans les textes et les publications des
17ème et 18ème siècles. La recherche
était faite aussi sur le moteur de recherche Yahoo, au niveau duquel,
plus de 329400 résultats pour « littéracie ». En effet,
cette mésentente relative à l'orthographe du terme découle
de deux ordres : d'une part, étymologique, car il est question de savoir
lequel des emplois entre (-t) et (-tt-) est correct en français, et
d'autre part, dérivationnel, puisque le radical (lettr-) permettrait la
construction de plusieurs autres mots.
Autour de cette question d'orthographe, Jaffré a
écrit ironiquement :
Le choix d'une forme graphique qui obéisse aux
contraintes du français a fait l'objet de discussions diverses qui nous
semblent aller de la simple anecdote et refléter des attitudes plus
générales à l'égard de l'orthographe du
français. Certains auteurs choisissent en effet d'écrire
litéracie, ou littéracie. Que l'on se rassure, personne n'a
encore osé proposer lythérhesci ! (Jaffré, 2004, p.26).
Alors, le terme « littéracie »
représente la traduction, l'adaptation, ou encore l'équivalent
modifié du type calque du terme anglo-saxon « literacy » ou
« literacy », dont le premier s'oppose à l'oralité et
le deuxième renvoi de façon dérivationnelle à la
littérature.
Quoi qu'il en soit les orthographes proposées, nous
avons décidé d'adopter dans notre travail deux propositions,
à savoir « littéracie » et « littératie
», dans le but de garder la cohérence étymologique, et de
conserver le lien avec la forme anglaise d'origine. Admettons également
que les variantes graphiques ne changent pas grandes choses au niveau du
traitement du concept.
Il faut souligner également, que le débat
autour de « la littéracie » ne s'est limité pas
seulement aux formes graphiques du mot, il a touché aussi la
classification du terme, soit en tant que concept avec des dimensions
précises et bien déterminés, ou bien comme notion
multidimensionnelle, contextualisée et qui évolue dans le temps.
Comme il a concerné également, la dérivation du mot, dans
la mesure où, Hebert et Lépine (2013), soulignent que les
écrits interpellent le mot « littéracique » comme
adjectif qualifiant des pratiques, des
31
apprentissages et des compétences. Et d'autres comme
Goody optent pour un terme rarement utilisé : «
littéractienne » (1968, 2006, p.60), un terme rarement
utilisé afin de distinguer entre la société
littératienne et celle non-littératienne. D'ailleurs, ce sont ces
orthographes confondues qui rendent la littéracie une notion de plus en
plus délicate.
3- L'importance de la littéracie. 3-1 l'objectif
de la littéracie :
Les productions écrites forment « un espace
communicatif institutionnel (universitaire) en répandant à des
écrits injonctifs (les consignes d'examens) explicites (pas toujours
explicitées) » (Mangiante et Parpette, 2011, p.129). Devant
l'ampleur des exercices demandés au supérieur, la
littéracie cherche à doter les étudiants d'un arsenal de
compétences permettant l'accomplissement de l'ensemble des tâches
proposées.
Les pratiques littéraciques fixent comme objectif
central, la formation d'un citoyen responsable, autonome et indépendant,
habile de se développer et d'utiliser ce qui a appris dans sa vie
professionnelle et personnelle. L'espace conceptuel de la littéracie
vise également « le développement de compétences
transférables à des genres différents » (Frier, 2015,
p.38). Il insiste aussi sur la nécessité d'étudier des
champs de recherches peu documentés, comme les pratiques hors
école, les liens entre l'éducation formelle et informelle, entre
les apprentissages guidés et non-guidés etc...La notion de
littéracie, tente alors de comprendre la complexité des pratiques
d'écrit et d'appréhender la manière comment les
différents usages de l'écrit s'articulent.
3-2 les atouts majeurs de la
littéracie:
En effet, miser sur la littéracie permet :
l L'acquisition des compétences essentielles à
l'apprentissage durant la vie, par le biais d'un engagement de tous les
partenaires.
l La construction d'un registre de connaissances
littéraciques à la base d'une variété de techniques
et de ressources.
l La capacité de penser, de s'exprimer et de
réfléchir.
l Le potentiel d'être amateur d'une pensée
créative et critique, capable d'agir, de réagir, de remettre en
question, et de prendre des décisions.
l
32
La découverte novatrice permettant la participation aux
diverses activités sociales.
l Le développement des compétences orales, et
leur mobilisation de manière adéquate à travers les
différents constituants langagiers.
l Le perfectionnement de l'habileté de création
et de partage des textes.
l L'instauration d'une métacognition qui vise
l'implication des étudiants dans la gestion du progrès de leur
expression de pensée.
l La proposition des occasions d'apprentissage et des
discussions constructives qui captivent les étudiants.
3-3 la place accordée à la
littéracie:
Après beaucoup d'efforts et de tentatives, et
même avec son arrivée tardive, la littéracie a pu fortement
gagner une place notable au sein des sciences de l'homme et des
sociétés, allant de l'anthropologie, à la philosophie,
jusqu'à la psychologie. La littéracie occupe donc une place
primordiale dans la recherche en éducation et dans l'enseignement, son
statut important se montre de plus en plus à travers le nombre
avantageux des recherches qui la traitent. Certes, sa position est actuellement
remarquable, mais, elle reste tout de même un défi de taille, qui
nécessite l'intégration de tous les intervenants et la
concertation sérieuse de leurs efforts.
4- Les éléments favorisant la mise en
place des compétences littéraciques. 4-1 Concevoir un
environnement adopté à l'apprentissage de la littéracie
:
Avec le grand changement qu'a connu le monde au cours des
trois dernières décennies et avec la rapidité dont il va
continuer à se transformer davantage dans les années à
venir, le milieu d'apprentissage de la littéracie doit répondre
à plusieurs revendications liées au XXIème.
Le milieu du travail propice pour l'apprentissage de la
littéracie, se forme à la base d'un effort collaboratif entre les
enseignants, les Co créateurs majeurs et leurs étudiants. Au
niveau de ce milieu, les échanges et les interventions sont
valorisés, et les deux partenaires ont le droit de s'interroger, de
réfléchir, de chercher, de raisonner, et de partager des
idées et des points de vue par rapport à la discipline en
question. Ils construisent donc ensemble un environnement axé sur la
prise en compte des besoins, des intérêts, des
préférences et des forces.
33
D'ailleurs, cet environnement d'apprentissage doit être
comme le souligne (Cooper, 1997), un espace qui fait appel aux situations
réelles et concrètes pour doter les élèves d'une
solide maitrise des compétences littéraciques valable à
long terme.
On peut alors constater que, l'apprentissage de la
littéracie peut s'épanouir dans un milieu qui : - Exploite des
attitudes assurées, et qui met à profit des croyances
positives.
- Etablit des techniques convenables pour l'apprentissage
collaboratif, et qui conserve également l'opportunité
individuelle nécessaire pour que chaque voix soit entendue.
- Implique la Co construction d'un climat positif, favorable
pour l'expression des opinions, la prise de parole, l'innovation et la
créativité.
- Veille à ce que les valeurs et les cultures de
chaque étudiant soient représentées et prises en
compte.
- Donne accès à une gamme riche de ressources et
de moyens pédagogiques.
- Propose diverses façons de communication, de
réflexion et de documentation.
Tous ces éléments avancés dans le cadre
du milieu accommodant et bénéfique à l'apprentissage de la
littéracie, ne peuvent montrer leurs bienfaits qu'à travers un
programme adapté aux défis et aux attentes du public. Un
programme capable de fournir des expériences originales pour susciter
l'esprit critique des apprenants, et pour encourager leur participation.
4-2 L'enseignement efficace de la littéracie
:
La programmation efficace et puissante en matière de
littéracie commence avant tout, par le fait de connaitre l'importance de
cette notion dans le monde actuel. Ensuite, elle s'étale sur la
nécessité de connaitre les curriculums pédagogiques, les
méthodes et les pratiques permettant la mise en place d'un programme
complet et pertinent.
L'enseignement efficace de la littéracie nécessite
alors:
l L'établissement des liens clairs entre les
composantes essentielles de la littéracie (écriture, lecture et
oral).
l La mise en place d'une démarche formelle pour
développer la compétence écrite.
l La mobilisation des ressources nécessaires et du
matériel essentiel.
l
34
Le partage des expériences d'apprentissage
littéraciques, pour garantir l'engagement actif des étudiants.
l La sensibilisation à l'intérêt
d'être doté d'un savoir littéracique dans ce monde actuel
exigeant.
l La prise en considération des besoins, des
difficultés, et des diverses styles d'apprentissage des
étudiants.
l La création souple et flexible des groupes de
travail, permettant l'engagement réel des étudiants.
l L'étayage qui garantit la confiance et l'autonomie
des étudiants vis-à-vis des notions apprises.
l Le respect des différentes façons de penser,
d'agir et de saisir le sens, ainsi que leur incorporation au niveau de la
compréhension des concepts.
l Le développement d'une communauté
d'apprentissage centrée sur l'interaction et la communication.
l L'élargissement des partenariats communautaires
francophones qui soutiennent la réussite en matière de
littéracie.
l La prise au sérieux de l'identité de
l'apprenant et le non focalisation uniquement sur les connaissances du
maitre.
l L'évaluation juste, transparente et équitable
qui comprend une rétroaction axée sur des résultats
d'apprentissage, et sur la Co-construction.
l La participation des étudiants dans la mise en place
de l'évaluation. L'enseignement efficace en matière de
littéracie permet donc :
l La découverte des corrélations entre
l'écriture, la lecture et la communication orale.
l La participation active des étudiants et leurs
interventions concernant le développement de leur apprentissage.
l L'accès aux échanges et aux collaborations
avec autrui.
l La communication des idées et des pensées
d'une manière souveraine.
l
35
L'amplification d'un sentiment d'efficacité et de
production personnelle envers l'apprentissage.
4-3 L'évaluation de la littéracie
:
L'évaluation au service des apprentissages sert
à orienter l'enseignant et à améliorer l'assimilation des
apprenants.
De ce fait, l'évaluation des compétences
littéraciques comprend essentiellement :
- La planification d'une évaluation transparente qui
prend en considération les forces, les intérêts et les
besoins des apprenants.
- L'identification et le partage des résultats
d'apprentissage avec les étudiants. - Le recours à
l'évaluation pour guider les prochaines phases d'apprentissage.
- L'emploie des résultats de cette évaluation
nécessairement pour mesurer le progrès des étudiants et
pour modifier la démarche suivie.
- L'orientation des étudiants vers les compétences
relatives à l'auto-évaluation.
- L'incitation des apprenants pour qu'ils appliquent leurs
compétences en matière de
littéracie.
- La mise en exergue du rendement des apprenants en
matière de littéracie dans différents contextes.
- L'utilisation des épreuves probantes
collectées pour fournir un jugement professionnel sur la qualité
de l'apprentissage.
Dans cette perspective, on peut dire sous-titre d'exemple que
les éléments littéraciques instaurés durant le
cursus académique ont été réussis et aboutis, si on
vérifie dans le projet de fin d'étude d'un étudiant de la
troisième année licence département du français ,
orienté vers un sujet quelconque, des aspects tels que : une
organisation appropriée de son discours ; une présentation claire
des concepts clés de son travail sans ambiguïté;
l'argumentation et l'illustration de ses propos ; le recours à une
communication intelligible etc...
36
4-4 la complexité de la littéracie
:
Les différentes caractéristiques et dimensions
déjà citées, démontrent éventuellement la
complexité de la notion de littéracie, et insistent sur la
nécessité de cerner ce concept et de l'opérationnaliser
davantage. Il est donc important de prendre en considération sa
multi-dimensionnalité, et d'éviter le simple traitement des
objectifs quantitatifs qui le rend une notion superficielle et futile.
Le terme littéracie reste donc ambigu, entre la
désignation des compétences ou des pratiques de lecture et
d'écriture, et entre l'expression littéracies universitaires qui
fait référence aux genres de discours particulièrement
liés et produits à l'université, comme on va
détailler davantage par la suite. En somme, le fait de se placer dans le
cadre des littéracies est synonyme d'accepter l'idée que les
pratiques d'écriture et de lecture sont enracinées dans des
contextes d'interaction sociale, et sont dépendantes de
l'activité du sujet (scripteur ou lecteur). L'importance de la dimension
sociale, fait référence directe au socioconstructivisme, qui
représente le cadre théorique sous-jacent de l'enseignement et
d'apprentissage de l'écrit dans le cadre des littéracies
universitaires. D'ailleurs, la complexité de la notion de
littéracie, ainsi que la difficulté de l'appréhender, sont
dues principalement au vaste ensemble de définitions données
à cette notion, ainsi qu'à son élasticité. La
complexité peut être également renvoyée aux nombreux
domaines qui affichent des préoccupations par rapport à la
littéracie, comme l'économie, la santé, la justice et le
numérique. De plus, la présence de différents contextes
(culturel, social, institutionnel), supports et outils peut aussi être
à l'origine de cette complexité.
Cette notion de littéracie complexe mais riche, est
donc une responsabilité partagée, qui réunit tous les
partenaires du monde d'enseignement et d'apprentissage : les étudiants,
les enseignants, les parents, les directeurs d'école, les
présidents des universités, ainsi que les conseillers
pédagogiques, les dirigeants du système éducatif et les
membres de la communauté. En définitive, on arrive à
comprendre que la migration du champ de la littéracie en didactique du
français, ainsi que sa portée heuristique traduisent
l'impossibilité de réduire le sens de cette notion pour garder
une seule acception, elle ne doit pas être restreinte à une
compétence, ni réduite à la sphère écrite.
Elle doit comporter l'ensemble des pratiques langagières perçues
dans un continuum et appuyées sur des outils et des supports en
évolution permanente. Au niveau de l'enseignement supérieur,
l'université devrait donc administrer des opportunités permettant
l'acquisition et le développement des compétences
littéraciques, vu que leur appropriation forme la condition capitale du
maintien des études universitaires.
37
5- La littéracie universitaire :
L'angle d'étude des littéracies universitaires,
présente de nos jours une large zone de discussion, qui traite les
problèmes des étudiants avec l'écriture à
l'université et surtout le souci de leur adaptation vis-à-vis de
cette compétence. La littéracie universitaire réside une
habileté à parfaire tout au long de la scolarisation obligatoire
et à l'université bien évidemment. Elle est un concept
récent, complexe et pluridisciplinaire qui vient de gagner du terrain
dans les publications scientifiques. Alors qu'est-ce que la littéracie
universitaire ? Et en quoi elle se distingue de la littéracie ?
5-1 la littéracie universitaire : tour d'horizons
:
Le traitement des pratiques scripturales à
l'université est un phénomène anxieux, situé au
coeur des recherches linguistiques et didactiques. Tout d'abord, « La
littératie universitaire constitue un champ de recherche suscitant de
plus en plus d'intérêt. Cela n'est pas sans raison, on constate
que les compétences qu'elle requiert sont parmi les plus
recherchées sur le marché du travail » (Beaudet, 2015,
p.99). Ensuite, « Les littéracies universitaires sont
considérées comme une discipline à part entière
autorisant la description des genres discursifs universitaires aussi bien
académiques, que de recherche des problèmes que ceux-ci peuvent
engendrer chez les étudiants suivant un parcours universitaire
».(Delcambre et Lahanier-Reuter, 2010, Delcambre, 2012, p.153-154), cette
définition accentue clairement la différence entre la
littéracie universitaire, les sciences du langage et la didactique des
langues. Certes, elles représentent ses ancrages théoriques, mais
avec des finalités différentes, dans la mesure où, la
littéracie universitaire vise le développement des connaissances
et des compétences relatives à la réussite universitaire
et liées surtout à l'appropriation de l'écrit.
A l'origine, le concept de littéracie universitaire,
est issu de « New literacy studies » développé au
Royaume-Uni, son apparition était basée sur une
méthodologie dite ethnologique, dans le but de mieux comprendre le
terrain universitaire, comme l'indique son nom « Academic literacy »
ou « littératie universitaire ». Ce mouvement de recherches va
se développer par la suite dans le contexte francophone, à partir
des années 2000: « c'est un champ de recherche relativement
exclusif en France, qui commence à se développer grâce
à des manifestations et publications scientifiques » (le colloque
à Villeneuve d'Ascq en 2010), et même à l'appui des travaux
de Pollet (2001, 2004) ; Delcambre et Lahanier-Reuter (2010,2012) ; Thyrion
(2011) ; Delcambre, Pollet (2014) ; et Messier (2016), au niveau desquelles,
l'écriture est vue comme
38
un outil d'apprentissage qui correspond à chaque
discipline, et qui nécessite une aide appropriée et un soutien
adéquat.
D'ailleurs, les raisons qui ont favorisé
l'émersion des littéracies universitaires à cette
époque sont surtout, les changements du paysage académique, le
nombre grandissant de la population étudiante, la diversité du
public étudiant, et l'arrivée des étudiants
immigrés ou issus des milieux sociaux défavorisés.
En effet, selon Delcambre et Lahanier-Reuter en 2010, la
littéracie universitaire peut être appréhendée selon
trois axes majeurs :
l Sociologique : puisqu'elle forme les étudiants à
utiliser les écrits utiles à leur profession.
l Cognitif : puisqu'elle actualise les déficits
langagiers.
l Didactique : puisqu'elle décrit les écrits
disciplinaires à l'université, et elle suggère des
dispositifs et des voies de remédiation.
En fait, la littéracie universitaire n'est pas une
compétence neutre que les étudiants doivent apprendre au
préalable avance, elle englobe aussi un ensemble complexe de pratiques
sociales auxquelles tous les membres de la communauté universitaire
devraient accorder une attention sérieuse. Donc les littéracies
universitaires « exigent une longue élaboration personnelle [...]
et sont le résultat d'une construction individuelle d'une confrontation
à une discipline à travers des objets, des méthodologies,
des corps de savoirs spécifiques » (Delcambre et Lahanier-Reuter,
2010, p. 12).
Alors, la littéracie universitaire traitée au
niveau des recherches didactiques, sociologiques et psychopédagogiques
principalement francophones réside un thème riche en questions
qui se rapportent aux pratiques d'écrit à l'université. La
richesse de ce concept se montre d'une part à travers, les
différents champs de recherche qui l'ont pris pour objet d'étude,
citant des travaux en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en
Amérique et en Australie. Et d'autre part, grâce aux discours qui
l'ont traité, tels que « le second numéro de la revue
Pratique » (Delcambre et Lahanier-Reuter, 2012), réservé
spécialement aux pratiques langagières dans un lieu
institutionnel particulier : l'université, et, le numéro 58 de la
revue «communications » intitulé : l'écriture des
sciences de l'homme en 1994. Sans négliger également, le
dévoilement des publications fondatrices, comme celles qui
décrivent les écrits de recherche à partir d'un point de
vue linguistique et didactique (Dabène et Reuter, 1998), ou encore les
articles (Dion et Maldonado, 2013 ; Graves et Slomp, 2013) qui mentionnent
39
l'importance de développer des compétences comme
: l'efficacité dans la transmission du message, la qualité de la
présentation des idées, et la structuration du texte etc...
propres au milieu universitaire.
Donc, à l'université, les étudiants
doivent acquérir de nouvelles compétences littéraciques,
ils doivent également comprendre que le recours aux connaissances
acquises au secondaire est insuffisant, et que l'appropriation des normes
disciplinaires du supérieur et de la discipline choisie demeure
nécessaire. Ceci constitue donc un premier pas vers une réussite
académique et professionnelle, puisque la majorité des
diplômés universitaires se sont orientés vers des fonctions
qui nécessitent des rédactions fonctionnelles.
En définitive, dans un contexte précis tel que
l'université,
La littéracie couvre aujourd'hui un sens assez
spécifique, puisqu'on reconnait l'importance du rôle des pratiques
littéraciques dans une formation universitaire articulée autour
de dimensions socioculturelles, cognitives et affectives,
particulièrement déterminantes dans les processus d'acculturation
aux écrits universitaires. (Deshepper, 2010, p. 93).
5-2 Les besoins des étudiants et les aspects
propres à l'écriture en université :
Vers les années 90, des chercheurs et des linguistes
français et belges ont travaillé sur les différentes
lacunes et les multiples besoins des étudiants universitaires, surtout
du côté de l'écriture. Certains d'entre eux ont
traités dans leurs travaux les besoins linguistiques, tels que ceux de
Cavalla (2010), qui ont étudié les structures langagières
(présent atemporel ; effacement du sujet ; tournures nominales et
impersonnelles ; collocation). Ou bien ceux de Boch et Buson (2012),
axés sur les besoins orthographiques, grammaticaux, et de ponctuation.
Ou encore d'autres, qui ont été élaborés du
côté des besoins énonciatifs, sous-titre d'exemple ceux de
Rinck et Sitri (2012), qui évoquent principalement les problèmes
de cohésion textuelle, de positionnement énonciatif, et de
reformulation. Et finalement, on cite les études de Goes et Mangiante
(2010), autour des besoins cognitifs, et ceux de Dezutter (2015), concernant
les aspects métacognitifs comme la planification et la réflexion
etc...
Certes, les étudiants qui viennent d'intégrer
l'université ne sont pas illettrés, mais l'adaptation aux
écrits universitaires reste un défi linguistique, cognitif et
socioculturel majeur, relatif à l'incomplétude de la
compétence écrite. En général, les premiers
problèmes que rencontrent les étudiants universitaires entamant
leur parcours dans l'enseignement supérieur, sont principalement
liés à la production écrite. Ils concernent surtout les
questions linguistiques et morphosyntaxiques, les compétences cognitives
et méthodologiques, et la maitrise de langue
40
d'apprentissage. Plus des difficultés qui se rapportent
aux constructions textuelles, tel que la cohérence et la cohésion
du texte à produire, par exemple, du texte littéraire si on prend
le français comme discipline universitaire.
D'ailleurs, au début du cursus universitaire, un
étudiant novice face à une nouvelle situation d'écrit, va
faire appel automatiquement à des structures paralysées et
à des modèles figés qui découlent de sa
scolarité et qui sont implantés déjà dans sa
mémoire. Cet aspect flagrant était remarqué au niveau des
copies du test diagnostique qu'on a proposé pour les étudiants de
la première année département du français, afin de
cerner leurs difficultés avant la programmation de l'action tutorale. Le
résultat était alors une variété d'erreurs
récurrentes, essentiellement syntaxiques, grammaticales, phoniques,
morphologiques et morphosyntaxiques (Annexe 2), auxquelles s'ajoutent la
non-compréhension des consignes et des mots-clés du support. Ces
besoins répétés continuellement dans la plupart des copies
analysées, peuvent être référés à la
non-maitrise des fondements de base de l'écrit, à l'absence des
habiletés discursives, sémantiques et rhétoriques, et
à l'imagination limitée et non suffisante de
l'étudiant.
Dans le même ordre d'idée, la
compréhension du texte littéraire, rejoint la liste des
défis qui bloquent l'apprenant, vu que ce dernier n'a pas
été étudié convenablement au cycle secondaire. Ceci
rappelle en fait, l'observation du critique français Jean Peytar :
«si l'on pose que le texte littéraire est un produit relatif, ni
sacré, ni absolu, on est conduit à montrer le fonctionnement dans
l'évolution et la contradiction de la société ; si l'en
fait un objet de langage, singulier, certes, on est amené à
souligner ce qui dans le langage fonctionne littéralement » (1982,
p. 102). En effet, c'est jusqu'à l'université que commence une
réelle initiation au texte littéraire et poétique, qui
nécessitent un niveau psycholinguistique enrichie, un progrès
cognitif profond, des signifiés puissants et des changements scriptaux
et lecturaux positifs. Toutes ces compétences demandées sont
regroupées sous le vocable des littéracies universitaires.
Quant aux origines des besoins mentionnés, elles
peuvent être liées, au niveau socio-économique, au genre,
au dossier scolaire de l'étudiant, au choix de la filière,
à l'engagement dans les études, à la convention
institutionnelle, à l'équilibre entre le temps d'étude et
des loisirs, ainsi qu'à la méthodologie utilisée et sa
cohérence avec le programme académique de l'apprenant. Dans la
même veine ces difficultés exprimées sont liées
principalement à de nouvelles pratiques d'écriture, au niveau
desquelles existe un grand écart entre les conduites des apprenants et
les attentes des enseignants. Ces nouvelles pratiques d'écriture sont
souvent relatives à la découverte des genres discursifs nouveaux,
alors que, les conduites des
41
apprenants, et les attentes des enseignants, désignent
la rupture entre le secondaire et le supérieur marquée par
l'écart considéré entre les représentations des
étudiants, et celles des enseignants. A tous ces aspects peut s'ajouter
aussi, l'absence de préparation précoce des étudiants
vis-à-vis des règles d'écriture à
l'université, dans la mesure où
La connaissance et l'assimilation de ces règles de
production constituent une compétence à la fois culturelle et
méthodologique nécessaire aux étudiants tout au long de
leur parcours académique. Le non-respect de certaines règles ou
principes méthodologiques, qui peuvent doubler une fragilité
linguistique, est souvent source d'échecs. (Mangiante et Parpette, 2011,
p.123).
L'étudiant est donc appeler à maitriser les
dimensions qui entrent en jeu dans l'acte scriptural académique. Tout
d'abord, il faut qu'il perçoive l'enjeu de la communication
écrite (compétence linguistique, réception de
l'écrit), qui le mobilise dans la compréhension de l'écrit
(compétence méthodologique), pour acquérir un
positionnement discursive (compétence discursive), qui oriente vers
l'organisation des énoncés textuels (compétence
linguistique). Donc, il s'agit de tout un processus à respecter pour
acquérir la compétence écrite à
l'université.
5-3 Les différentes formes d'aide existantes pour
contribuer au développement des compétences littéraciques
:
La mise en place d'une démarche d'aide et de soutien,
de remédiation et d'outillage pour combler les lacunes des
étudiants universitaires réside importante. On peut trouver une
multiplicité de mesures de remédiation qui varient en fonction
des universités qui les proposes, sous-titre d'exemple, on peut trouver
: des cours de mise à niveau, des modules des techniques d'expression et
de communication, une autoformation en ligne ou bien à travers la
consultation des guides de rédaction, une aide ponctuelle dans un centre
d'aide en français écrit, un accompagnement individualisé
par les formateurs. Parmi les mouvements qui visent l'aide à
l'écrit au service de la réussite universitaire on cite :
Ceux du contexte anglo-saxon, tels que : Writing to learn
(Britton, 1970) ; Writing Across The Curriculum (WAC) ; Writing In the
Discipline (WID) (Bazerman, Little, Bethel, Chavkin, Fouquette et Garufis, 2005
; Russel, 2002) Etc... D'une façon plus détaillée,
l'ambition du mouvement (WAC) sous-titre d'exemple est d' « aider les
apprenants à mettre l'écrit au service de leurs apprentissages
» (Donahue, 2010), tandis que le (WID) vise l'acquisition des
écrits en fonction des disciplines, alors que les modules des techniques
d'expression et de communication offrent un enseignement constructif en
matière d'écriture.
42
Au niveau du monde francophone et au Québec où
l'écrit à l'université ne fait pas objet d'une formation
spécifique, quelques figures de remédiation s'accroitent dans des
universités, tel que, l'université du Québec en Outaouais,
dont se trouve, les programmes du premier cycle en formation à
l'enseignement (FRA 1353-littératie universitaire pour la formation
à l'enseignement), ou encore, le dispositif de formation en sciences de
l'éducation, à l'université de Laval (DID 7000-analyse et
écriture de texte de genre universitaire). Auxquelles s'ajoute le
programme du doctorat professionnel (DED 903-lire et écrire pour
mobiliser la recherche au profit de l'intervention) de l'université de
Sherbrooke, et le plan « réussir en licence »
développé depuis 2008 dans les universités
françaises.
Conclusion du deuxième chapitre :
Au niveau de ce deuxième chapitre, nous avons
abordé au début, l'une des notions clés de notre travail :
« la littéracie », tout en essayant de la situer et de la
concrétiser davantage, par le biais d'un bref historique, d'une
multitude de définitions, de caractéristiques, et de dimensions
etc...
Concernant l'emploi du terme littéracie, nous avons
accentué une forme au singulier (la littéracie, dont l'approche
est cognitive), et une autre au pluriel (les littéracies, dont
l'approche sociale). Nous avons également traité le débat
relatif à la traduction du mot et à son orthographe, d'où
l'émergence de plusieurs variantes qui n'impactent pas vraiment le sens
de la notion, mais qui soulignent la difficulté de la limiter en une
seule définition englobante.
Le traitement de cette notion riche et plurielle, et le
contexte de notre recherche nous ont conduits pour dédier une partie
à un type particulier de la littéracie, celui des «
littéracies universitaires », désormais connu comme le
terrain des problématiques et des débats autour de
l'écriture à l'université. Après l'étude
consacrée à la littéracie et particulièrement celle
universitaire, un ensemble d'interrogations évidentes se posent :
Pourquoi la littéracie vue comme un terme accrédité au
niveau des recherches didactiques, notamment celles francophones, n'a pas
encore trouvé sa place dans les documents officiels marocains, en
conjointure la vision stratégique de la réforme 2015-2030 ?
Il semble que cette notion doit gagner davantage du terrain,
dans le contexte académique marocain confronté à plusieurs
problèmes, elle a de même le mérite de remporter
l'attention de la communauté scientifique, surtout dans un monde
où le pouvoir de l'écrit s'étende de plus en plus avec
l'apport des technologies et avec l'avancée de la didactique en
général et de la
43
didactique de l'écrit en particulier. Dans ce sens, la
littéracie universitaire émergée entant que nouvelle
sensibilité dans le domaine des études francophones et
considérée comme un paramètre fondamentale de
l'enseignement supérieur, aura besoin d'un projet pilote et d'un
dispositif pédagogique pertinent visant sa diffusion auprès des
étudiants. Ce dispositif d'appui en matière de littéracie
universitaire pourra être bel et bien le tutorat. Un outil destiné
à venir en aide aux étudiants. Sa visée réside
alors assister les apprenants dans leur acquisition des pratiques sous-jacentes
à la littéracie universitaire, les accompagner pour surmonter
leurs difficultés et répondre à leurs attentes et
demandes, essentiellement en matière de l'écrit.
CHAPITRE 3 : LES PRATIQUES FAVORISANT L'ACCES DES
ETUDIANTS EN LITTERACIE UNIVERSITAIRE : LE TUTORAT
La première année d'enseignement
supérieur remplit plusieurs missions : « celle de formation bien
sûr, mais aussi celle d'orientation, voire de solution d'attente pour les
étudiants qui auraient préféré opter pour une
filière plus sélective » (Romainville et Michaut, 2012,
p.254), elle représente la transition entre l'enseignement secondaire et
l'enseignement supérieur, marquées par des changements
considérables. « Bref, c'est un moment de bouleversement de
l'ensemble des repères pour chacun des étudiants » (Alberti
et Laterrasse, 2002, p.87-88). Face à cette situation, et même si
« tous les étudiants ne font pas la même expérience de
l'enseignement supérieur et ne doivent pas résoudre les
mêmes problèmes » (Millet, 2012, p.76), mais
l'université réside un monde méconnu pour les futurs
étudiants, dans la mesure où, « lorsqu'ils arrivent à
l'université, les étudiants découvrent un univers qu'ils
connaissent par ouï-dire, leurs enseignants du lycée leur ont
parlé beaucoup, ou un parent ou un ami qui est déjà
passé par un premier cycle »( Felouzis, 2001, p.145). D'ailleurs,
c'est dans ce sens que Lahire, évoque en 1997 la « socialisation
silencieuse » de l'étudiant.
Dans cette perspective, les pouvoirs publics et les
universités s'interrogent sur la manière d'aider ces
étudiants. De ce fait, « l'accompagnement est devenu une figure
dominante du discours éducatif, qu'il survienne dans des lieux
d'enseignement, comme l'enseignement supérieur E...]» (Vitali et
Barbier, 2013, p.231). Avec la démocratisation des études
universitaires, ainsi que la dominance des théories
socioconstructivistes qui favorisent le travail en groupe, plusieurs pratiques
d'accompagnement par les pairs ont été
privilégiées, parmi les on trouve le tutorat, qui trouve sa place
dans la scène pédagogique, pour s'écarter de l'aspect
individuel, et se centrer plus sur le social.
44
1- Le tutorat :
1-1 L'histoire du tutorat :
Au début, l'université a été
réservée à un public élitiste issu des classes
sociales privilégiées, ce qui fait référence
à l'ancienne fonction du « précepteur » à
l'antiquité. De cette réalité, l'histoire du tutorat
découle du préceptorat. En effet, les origines de la formule
tutorale sont très lointaines, elles datent déjà de 7000
années avant J.C. Dans l'occident chrétien, les tuteurs,
étaient choisis soit parmi des prêtres, ou bien ils étaient
des tuteurs royaux qui s'occupaient de l'éducation morale des jeunes
enfants de la société aristocratique. Plus tard, Aristote aurait
utilisé « le tutorat » pour désigner l'accompagnement
au travail. Et dans la Grèce antique, la formation morale et
l'éducation à la vie sociale vont être basées sur le
même principe.
Par la suite, le tutorat va être visible à Rome
où le rôle de « tutela » s'amplifie de plus en plus pour
désigner la surveillance des enfants qui apprennent la
rhétorique, la philosophie, la peinture, la littérature, le grec,
et le latin. Donc ici, nous avons également affaire à des
pratiques proches du préceptorat, puisque les tuteurs étaient des
personnes bien choisis pour participer d'une manière
individualisée à l'éducation des enfants des familles
aisées.
Cependant, cette formule existe bien avant cette
période mentionnée. Déjà au Vème
siècle avant J.C, le philosophe chinois Confucius avait noté que
« l'on apprend mieux de ses pairs que de ses maitres », dans ses
réflexions sur l'éducation. Mais, c'est Comenius qui va poser en
occident, dans son oeuvre intitulé « la grande didactique »
(1627-1632), les repères de base d'un modèle éducatif
appuyé essentiellement sur le principe d'entraide entre les
élèves.
Au XIIème siècle, le tutorat a fait
son apparition en Angleterre dans des établissements prestigieuses comme
Oxford et Cambridge, au niveau desquelles le développement intellectuel,
moral et social était préconisé, et le tuteur est
appelé à préparer un programme adapté aux
apprenants. Ensuite, au XVIIIème siècle plusieurs
pédagogues comme, Lancaster en Angleterre ou encore Pestalozzi en Suisse
ont pris les idées de Comenius comme référence, pour
créer des écoles réservées aux enfants issus des
milieux sociaux défavorisés.
A son tour, Le maitre romain Quintilien soulignait
l'importance du contact des jeunes élèves avec les plus grands.
Et dans le même ordre d'idée, une école de
rhétorique à Rome (Instituo Oratoria), soutenait le fait que
« celui qui vient d'apprendre était le meilleur des enseignants et
qu'il était l'un des mieux placés pour rendre l'enseignement plus
humain, plus moral, plus
45
pratique, et plus profond » (Wagner, 1990, p.22).
Cependant, l'expansion réelle du tutorat ne sera qu'à partir de
l'époque médiévale, dans laquelle le rôle de
l'église était centré sur l'éducation des enfants
et des adolescents.
Grace au développement des pratiques d'enseignement et
de formation, le tutorat va devenir une principale forme d'accompagnent,
inscrite dans le courant des « pédagogies nouvelles » et de la
tradition anglo-saxonne, où on « n'enseigne plus à l'enfant
mais avec et par l'enfant » (Reboul, 1981, p.67). Grâce à
cette conception, le centre de gravité de la situation éducative
ne va plus être le maitre, possesseur du pouvoir et du savoir, mais
plutôt l'apprenant, son rythme d'appropriation, ses besoins, son
insertion sociale...
1-2 Le tutorat : un dispositif :
Avant de définir le « tutorat », il est
important à titre d'éclairage et de précision de traiter
le concept du « dispositif ». Le tutorat est avant tout un dispositif
ou « un réseau » permettant de tracer différents
éléments pour répondre à un problème urgent.
En effet, Linard souligne que le dispositif est un moyen qui « organise un
champ de relations fonctionnelles entre humains et outils, but et moyens,
intention et actions » (2002, p.144). Le dispositif est donc une
construction logique qui a pour finalité l'atteinte d'un objectif. Au
niveau du fonctionnement du dispositif, c'est l'usager joue un rôle
très important. Et concernant sa réussite, il est
nécessaire que ce dispositif soit flexible, individualisé,
centré sur l'apprenant et sur la Co construction entre celui-ci et
l'enseignant, et surtout basé sur le volontariat.
Donc pour répondre à
l'hétérogénéité de l'enseignement
supérieur, la plupart des universités recourent à mettre
en place des dispositifs d'accompagnement et de soutien, destinés aux
étudiants en général et aux plus fragiles en
particularité. Parmi ces dispositifs on trouve le tutorat, qui
représente la pratique la plus ancienne et la plus appliquée. Et
donc, Qu'est-ce que le tutorat ?
1-3 Le tutorat : essai de définitions
:
Dans le but de faciliter l'adaptation et l'intégration
des étudiants dans le contexte universitaire, et suite aux incitations
gouvernementales, plusieurs dispositifs ont vu le jour dans différents
systèmes éducatifs. Le tutorat avec ses formes multiples
était l'un des dispositifs préconisés pour accompagner les
étudiants et garantir leur affiliation et leur maitrise des normes et
des contenus disciplinaires.
46
Concernant l'étymologie latine du terme « tutorat
», elle renvoie à des significations comme : « protéger
», « s'occuper de » ou « prendre soin de ».
Par rapport aux définitions proposées à
ce concept, elles sont nombreuses, tout comme les travaux qui le traite. Tout
d'abord, et pour montrer les origines du tutorat comme une pratique d'aide,
Danner, Kempf et Rousval, avancent que « le tutorat, terme
générique, propose tout à la fois une forme moderne de
l'enseignement mutuel qui faisait la part belle à l'enseignement par les
pairs et d'une guidance pédagogique consolidant le processus
d'apprentissage de la relation d'enseignement-apprentissage » (1999,
p.247). Dans la lignée de l'approche développée par
Vygotsky et Bruner, le tutorat est vu comme étant un processus
d'assistance de sujets plus expérimentés à l'égard
des sujets moins expérimentés, chatouilleux d'enrichir les
acquisitions de ces derniers. Cette idée représente la base du
tutorat, qui va être reprise par différents auteurs et
spécialistes. Commençant par Endrizzi, qui voit dans le tutorat
une « une déclinaison particulière de l'accompagnement qui
associe une personne débutante et une personne moins novice dans un
domaine de compétence donné, sur une période
déterminée » (2010, p.16). Brixhe, à son tour
souligne que le tutorat est « une aide sur laquelle s'appuie celui qui
n'est pas encore assez solide pour être autonome » (1998, p.8).
Et puisque les deux protagonistes de la formule tutorale sont
le « tuteur » et le « tutoré ». La définition
du tutorat va devenir : un « moyen d'apprentissage planifié dans
lequel un apprenant plus compétent (le tuteur) veut soutenir un de ses
pairs apprenant (le tutoré) dans l'acquisition ou le
développement de connaissances et de compétences » (Annot,
2001, p.383203 ; Papaioannou, 2015, p. 46-55 ; Topping et Ehly, 2001,
p.113-132). Le tutorat est donc une relation régulière de
compagnonnage, basée sur la coopération entre tuteur et
tutoré, caractérisée par l'alternance entre le travail
individuel et le collectif dans le but de compléter l'apport de
l'enseignant, et de combler l'insuffisance de l'enseignement classique.
Un autre point à prendre en considération est
celui du statut non professionnel du tuteur, dans la mesure où, le
tutorat est
Une situation pédagogique d'accompagnement
individualisé au sein de laquelle chacun apprend, notamment sur la base
d'un mécanisme d'identification, alors qu'aucun des acteurs n'est a
priori un professionnel de l'enseignement. (Romainville et Lepage, 2009,
p.13).
En somme, on peut avancer que les « ingrédients
» de la formule tutorale sont essentiellement: l'intervention humaine au
niveau d'un petit groupe, comme l'avait souligné l'article 3 de
l'arrêté du 18 Mars 1998, modifié par l'arrêté
du 30 Novembre 2009 en
47
France que « [...] chaque étudiant-tuteur a la
responsabilité d'encadrer par une aide personnalisée un groupe
d'étudiants de taille restreinte (au maximum dix étudiants)
» , la situation de travail sur une période courte, la
socialisation (la relation entre tuteur/tutoré) et la formation (savoirs
académiques).
Il est essentiel de marquer, que lors de notre consultation
des différentes définitions du tutorat, on s'est trouvé
confronter à deux expressions différentes, à savoir :
« le tutorat entre pairs » et « le tutorat par les pairs »,
dont la première renvoie au milieu d'enseignement scolaire, et la
deuxième se rapporte au domaine de l'enseignement supérieur. On
va donc opter pour la deuxième, vu que notre cadre de recherche est
consacré à l'université. En définitive, le tutorat
a fait donc l'objet de maintes définitions, à travers lesquelles
les notions d'aide et d'accompagnement sont préconisées.
1-4 Les différentes formes du tutorat
:
Les différentes formes du tutorat reposent sur une
étude récente de Romainville et Lepage (2009) qui était
réalisée à la base des pratiques tutorales de la
communauté française en Belgique. Ces auteurs avancent que les
formes du tutorat varient selon les perspectives, les fonctions, les
compétences visées, la méthodologie suivie etc...
D'ailleurs, Michaut (2003, p.102) montre que les pratiques
tutorales sont très hétérogènes, en termes d'offres
et d'objectifs, elles doivent combler des manques qui ont été
classés par Gerbier et Sauvaitre (2003, p.18), en quatre grandes
catégories :
1- Le manque d'outil et de méthodes de travail.
2- Le manque de connaissances et de compétences
disciplinaire.
3- Le manque d'adaptation à la vie universitaire.
4- Le manque de projet personnel et professionnel.
De ce fait, le tutorat peut avoir diverses fonctions : «
affiliation », « information » et « formation avec un
savoir méthodologique ou disciplinaire», qui renvoient à
trois grandes formes, qui ont été suggérées par
Laterrasse, Alberti et De Léornardis en 2002:
Le tutorat d'accueil : Il se déroule pendant les
premières semaines, généralement, les deux ou les trois
semaines après la rentrée. Il apporte un soutien d'ordre
administratif et organisationnel. Il s'assure de l'accueil des primo-entrant et
de leur adaptation. Son rôle consiste également à
48
donner aux nouveaux bacheliers qui viennent d'intégrer
l'université les repères nécessaires à la
construction de leur projet de formation.
Le tutorat d'accompagnement : selon la classification
d'Alberte et Laterrasse (2002, p. 113), le tutoral d'accompagnent est «
régulier », « soutenu », adressé à «
un petit groupe d'étudiants ».
Il s'appuie sur les relations humaines pour préparer
les étudiants aux sessions d'examens, ainsi que pour les aider à
mieux travailler durant l'année universitaire. Il se base sur les
contenus des enseignements, et il concerne la reprise des cours, le
développement de la compétence écrite, le travail sur la
langue (syntaxe, orthographe etc...), l'entrainement à l'oral, l'aide au
travail personnel (organisation et gestion de l'emploi du temps, prise et
exploitation des notes).
Les formes du tutorat d'accompagnement sont certes multiples,
mais orientées vers le même but : outiller les
étudiants.
Le tutorat méthodologique : souvent
associé au « tutorat d'adaptation, qui est un soutien
méthodologique ayant pour but de faire acquérir aux
étudiants les méthodes de travail universitaire ou de
répondre à des difficultés d'apprentissage ponctuelles
» (Danner, Kempf et Rousval, 1999, p.248).
Il est le complément du tutorat d'accueil et
d'accompagnement, qui consiste à résoudre les problèmes
des primo-entrants concernant les méthodes du travail à
l'université, comme le travail documentaire, l'analyse des textes
scientifiques ou littéraires, la rédaction des discours
universitaires etc...
1-5 La différence entre le tutorat et le mentorat
:
Au niveau des écrits, les notions du « tutorat
» et de « mentorat » sont souvent confondues. Cette confusion
découle avant tout de la traduction de l'académie de la langue
française pour le mot anglais « mentoring » en « tutorat
». Cette même traduction était adoptée par des auteurs
comme Boru (1996) et Wittorski (1996), alors que d'autres, tels que, Agulhon et
Lechaux (1996) emploient des termes comme « guidance » et «
supervision » pour faire référence à la même
idée.
Nous avons déjà eu l'occasion de faire le tour
des définitions du tutorat. Et par rapport au « monitorat »,
il est un système de guidage, élaboré pas Lancaster et
suggéré par la société pour l'enseignement
élémentaire. Il engage des élèves appelés
moniteurs, qui se réfèrent uniquement au maitre, et qui exercent
leur fonction dans un local spacieux. D'ailleurs, les deux collègues
49
Finkelstein et Ducros, qui étaient en 1989, à
l'origine des enquêtes du « tutorat » et « mentorat »
dans des écoles belges, ont montré que les deux conceptions
éducatives recourent au travail avec les élèves et
préconisent l'accompagnement pour surmonter les difficultés, mais
avec un nombre de différences considérable.
La différence entre les deux notions réside tout
d'abord au niveau des modes d'organisation :
Alors que le monitorat se caractérise par une certaine
rigidité, le tutorat semble être une formule
particulièrement souple, adaptable à de nombreuses situations, ce
qui en fait une réalité assez difficile à saisir dans ses
modalités comme dans ses effets. (Alberti et Laterrasse, 2002,
p.110).
L'écart entre les deux concepts se voit même au
niveau du choix des accompagnateurs, dans la mesure où, les moniteurs
sont souvent pris des élèves les plus compétents, qui
montrent un certain degré d'expertise et de maturité, alors que
les tuteurs sont embauchés à base du volontariat. Certes, ils
« peuvent avoir des caractéristiques scolaires opposées
» (Duquesne, 1983, p .60), mais, ils connaissent bien le programme
d'étude.
Le rôle pédagogique, ainsi que le nombre de
personne qu'un tuteur ou un moniteur accompagne, sont également des
facteurs qui créent la distinction. D'une part, le rôle des
moniteurs consiste à répéter avec autorité, et pour
une dizaine d'apprenants, le cours du maitre sans aucun ajout. Ils sont donc
des subalternes de l'enseignant ou bien des sous-maitres. D'une autre part, les
tuteurs « ont au contraire un rôle d'assistant ou d'auxiliaire, ce
qui les rend apte à seconder les instituteurs » (Charconnet, 1975,
p.12). Ils agissent pour compléter le travail de l'enseignent
auprès d'un groupe restreint voire d'une seule personne. On peut donc
avancer que si les premiers sont soumis au contrôle du maitre, les
seconds peuvent exécuter leur tâche librement, et que «
l'autorité et la discipline exercées par les uns contrastent avec
le rôle pédagogique des autres » (Lesage, 1975, p.67), dans
la mesure ou lorsque « les premiers corrigent ou rectifient les erreurs de
leurs tutorés, les seconds se chargent de leurs fournir des
explications, de les conseiller » (Lesage, 1975, p.66).
Goodlad en 1998, a identifié encore deux
critères de différenciation entre « tutorat » et «
mentorat », qui sont : la spatialisation et la durée. Dans la
mesure où, le premier se déroule en classe, pendant quelques
semaines, alors que le second, peut se pratique « E...] souvent dans un
lieu hors classe, E...] sur une durée de plusieurs moins ou
années » (Peyrat-Malaterre, 2011, p.46),
En définitive, on peut déduire que, le tutorat,
est une organisation fonctionnelle d'aide éducative non
pédagogique, alors que, le mentorat, représente une instruction
d'aide massive.
50
Chacun avec des traits distinctifs qu'une fois pris en
considération, la confusion semble impossible.
1-6 Les conditions à mobiliser pour garantir la
réussite du tutorat :
Pour que le tutorat atteinte ses objectifs, rien ne doit
s'improviser, et tout doit être bien orchestré. Certes, il
n'existe pas une formule magique pour garantir le succès du tutorat,
mais un certain nombre d'éléments doit y figurer.
D'emblée, Stassen a suggéré deux
conditions nécessaires pour générer le tutorat. Ces
conditions sont « mieux identifier les étudiants à risque
d'échec, et mieux mettre en lumière les processus qui sont
à l'oeuvre derrière ces déterminations » (2012,
p.135). Ensuite, Pourcelot va affirmer que le tutorat ne pourrait être un
facteur de réussite, qu'à travers un mode d'emploi plus au moins
optimal. Ce dispositif ne peut être pertinent qu'avec la présence
d'une bonne conception, d'une mise en oeuvre réussie, et d'un retour sur
l'expérience approprié. Le choix d'une période
d'implantation convenable, s'avère crucial également pour mettre
en place un tutorat de qualité : « le moment où le tutorat
est proposé doit être bien pensé ; ni trop tôt pour
que les étudiants y voient un intérêt au regard de leurs
premières expériences universitaires, ni trop tard pour qu'il
reste utile » (Borras, 2011, p.2).
La suggestion d'un environnement cordial au tutorat est de
même une condition importante, dans la mesure où cet environnement
ne doit pas limiter la liberté du tutoré, ni privé son
autonomie. Il doit être le garant d'un climat de coopération entre
les participants et d'un autre de compétition nécessaire pour
l'accomplissement de la tâche. Il doit de même favorisé la
productivité personnelle, la prise de parole, l'échange, et
l'interaction. L'environnement propice à l'action tutorale est donc
celui qui répond à trois types de besoin : « besoin de
relations positives avec les autres, besoin d'autonomie et besoin de
compétence » (Brzezinska, Appelt, 2013, p.21).
Parmi les aspects permettant le succès du tutorat, on
trouve ceux relatifs au tuteur. Ce tuteur doit avant tout être vigilant
dans ses choix pour éviter la contreproductivité des
tutorés, dans la mesure où, Il ne doit pas les contrôler
d'une manière exagérée, il doit déclarer à
tout moment son soutien pour ses apprenants, les encourager et les pousser
à progresser sans faire à leur place. De ce fait, on fait
référence aux deux composantes clés de la formule
tutorale, qui sont : la composante participation liée à
l'activité du tutoré, et la composante, guidage qui
représente celle du tuteur. Les deux doivent évoluées
inversement pour donner des rendements positifs.
51
Autrement dit, lorsque le tutoré arrive à
s'impliquer dans la tâche et prend de plus en plus l'initiative, le
tuteur doit automatiquement agir de moins en moins, pour que l'équilibre
et la souplesse du tutorat soient garantis.
Toujours, dans le cadre du choix des tuteurs, l'âge se
présente comme un critère considérable.
Généralement, les jeunes tuteurs ou encore les
tuteurs-étudiants sont les favoris. Ce paramètre de
différence d'âge entre les partenaires du tutorat est un
thème qui a été abordé par Lippitt en 1976. Cette
dernière a évoqué la notion « d'influence
constructive » pour souligner le travail d'un tuteur qui consiste à
faciliter l'appropriation de son tutoré, et qui nécessite une
différence d'âge optimale. Elle avance aussi qu'« un camarade
de 2 à 4 ans plus âgé peut avoir une relation de travail
moins distante et morcelée à l'égard de plus jeunes que
celle d'un adulte » (Lippitt, 1976, p.158). Elle a ensuite
interprété ces observations en avançant que : « les
jeunes enfants peuvent bénéficier d'un enseignement
individualisé et d'encouragement personnel apportés par des pairs
suffisamment âgés pour être des modèles
crédibles, mais assez jeune pour être « en connexion »
(Lippitt, 1976, p.158). Elle veille à ce que la différence
d'âge ne soit ni trop faible, pour que les acteurs du tutorat se
comprennent, ni trop importante, pour que l'un puisse tirer l'autre vers le
haut. D'ailleurs, cette auteure est arrivée à ces
résultats après l'étude qu'elle a faite durant sa
supervision de l'expérience tutorale : « Michigan Design Detroit
Pilot Program ».
D'autres auteurs, tels que Devin-Sheehan et Allen (1976) ont
fait la même remarque que Lippitt, sauf qu'ils ont avancé un motif
différent. Certes, ils ont insisté sur l'importance d'une
différence d'âge d'au moins de deux ou trois ans entre les tuteurs
et les tutorés, mais cette fois ci la raison est la suivante : «
une différence d'âge importante amoindrit la possibilité
pour le tuteur, de bénéficier de manière académique
du tutorat » (1976, p.257). Leur remarque convient à ne pas
négliger l'effet-tuteur. Linton (1973) a également insisté
sur ce principe, quand il a mis au travail des élèves de
huitième année (faibles en mathématiques) avec des tuteurs
de huitième, dixième ou douzième années. La
déduction de cette expérience était que les tutorés
se développent plus quand la différence d'âge avec leur
tuteur est de quatre ans. Ce sujet a été largement traité.
En somme, tous ces auteurs étaient d'accord avec le fait que beaucoup
sont plus âgés, les tuteurs resteront, plus compétents au
niveau de la matière ou de la discipline enseignée que leurs
tutorés.
Finalement, on peut dire que lors de la mise en place du
tutorat, il est important de se rappeler qu'il n'existe pas de méthode
pédagogique unanimiste, et que les situations ne sont pas toujours
similaires, chaque classe à ses particularités et chaque public
à ses propres
52
caractéristiques. D'où le fait de penser
à une modalité générale valable pour n'importe
quelle formule tutorale, réduit la pertinence de cette dernière.
Le plus important c'est donc d'avoir un regard critique et un recul pour
pouvoir garder des idées et extraire d'autres, selon le contexte et la
situation.
1-7 Les avantages du tutorat :
Les bienfaits du tutorat sont multiples, ils
s'échelonnent d'une manière positive sur la vie professionnelle
et personnelle des participants. On va les traités plus du
côté du tutoré, car ceux du tuteur font
référence à un autre phénomène pour lequel
on va dédier toute une partie.
Faire appel au tutorat comme étayage de l'enseignement
magistral permet :
l La remise en question des pratiques des étudiants et
l'offre d'un nouveau regard sur l'enseignement.
l La découverte des tutorés pour leurs
motivations, leurs forces et leurs faiblesses.
l L'outillage des apprenants pour qu'ils puissent se
positionner face aux transformations culturelles, économiques et
sociales.
l L'instauration des techniques de construction de savoir qui
rendent l'apprenant capable d'explorer son environnement.
l L'amélioration des compétences, des
connaissances et des habiletés des apprenants contribuant à leur
réussite.
l La rectification instantanée des réponses
erronées et le renforcement de celles correctes.
l La développement de l'empathie et des
capacités permettant de comprendre les difficultés et de les
surmonter par la suite.
l La favorisation de la démarche individuelle du
tutoré grâce à la proximité du tuteur, à
l'immédiateté de ses interventions, ainsi que « sa figure
amicale ».
l Le progrès positif sur les plans cognitif, affectif
et social des tutorés.
l La création de l'esprit groupale à travers le
contact entre les anciens étudiants et les primo-entrants.
l La valorisation de la confiance des étudiants et les
rendre capables de prendre la parole et de poser des questions.
l
53
Le passage des méthodes scolaires à celles
universitaires.
l La complémentarité des parties inaccessibles
dans le cours magistral.
l La découverte de l'aspect caché de la
formation.
l L'installation d'un avant-gout opportun du métier
d'enseignant qui éveille l'envie de pratiquer cette profession.
l L'émergence dans le milieu professionnel et le fait
« de sentir l'odeur des classes dans les narines ».
Avec tous les avantages qu'on a cités, Barrette
souligne encore des atouts : « il (le tutoré) obtient une
rétroaction immédiate et personnalisée » (2017).
Cordary ajoute à son tour qu'« il peut acquérir et
consolider des connaissances disciplinaires ou des stratégies
d'apprentissage » (2016). Ensuite, une enquête
réalisée par Ben-Abid-Zarrouk et Weisser en 2013 a montré
que le tutorat est devenu un facteur de réussite déterminant pour
les étudiants qui l'utilisent de manière optimale. Egalement,
Weisser (2008) a affirmé que les étudiants tutorés
multiplient en moyenne de 1,65 leur chance de réussir la première
année universitaire par rapport aux non tutorés. De même
grâce au tutorat « le tutoré augmente le temps
consacré à des activités d'apprentissage » (Annoot,
2001). Damon aussi voit dans le tutorat entre pairs « une technique
efficace lorsqu'il s'agit de rappeler des règles de fonctionnement,
d'échanger des informations ou des savoir-faire » (1984, p.339).
Pourtant, les bienfaits demeurent nombreux et constructifs.
D'une manière récapitulative, Brzozowski (2017)
a mentionné au niveau d'un riche passage un éventail de
bénéfices du tutorat, dans la mesure où :
Le tutorat contribue à acquérir l'autonomie,
à construire la responsabilité pour sa propre éducation,
pour la systématisation et la planification. Il apprend à choisir
ses objectifs, sa voie de vie, son chemin de développement, à
réaliser ses projets et à combattre ses difficultés. Il
mène à être autonome dans la recherche des sources des
informations et dans leur sélection, à une auto-acceptation et
une estime de soi, forme les attitudes d'ouverture et de bienveillance envers
les autres. De plus, il permet une augmentation de niveau de confiance,
renforce le courage pour présenter publiquement ses opinions, apprendre
une pensée créative et autonome, l'acceptation pour
l'altérité et des comportements à caractère
subversif. Il apprend le respect, la coopération en groupe et forme une
sensibilité au destin des autres avec la responsabilité qu'en
découle.
1-8 Les failles et les limites de l'introduction
officialisée du tutorat à l'université :
54
La majorité des obstacles posant problème quant
à l'officialisation du tutorat sont souvent liés à la
rigidité de l'administration universitaire, à l'absence d'une
formation obligatoire et d'une récompense financière, et à
l'attitude fermée des décideurs universitaires qui rejettent
chaque nouvelle proposition pédagogique. Concernant les failles du
tutorat, Laterrasse, Alberti et De léornardis (2002, p.161-162) ont
rappelé que ces dernières constituent des pistes de
réflexion pour apporter des améliorations au dispositif. Ces
failles ont été énoncées en 1999, par l'institut de
Recherche sur l'Economie de l'Education (IREDU) à l'issue de sa
deuxième enquête locale intitulée : « le tutorat en
DEUG : effets et limites d'une bonne idée »
Ces pistes s'articulent principalement autour :
l Du volontariat et du taux de participation diminue.
l Des raisons qui poussent les bons étudiants à
s'intéresser à de tels dispositifs, ainsi que celles qui sont
à l'origine du rejet de la part des plus fragiles.
l Des causes de la fragilité du programme.
l Des circonstances qui rendent le tutorat efficace dans un
contexte et inopérant dans un autre.
2- le tutorat dans différents contextes
académiques : 2-1 le tutorat dans le contexte académique
anglo-saxon :
Le tutorat a fait son émergence dans le contexte
anglo-saxon à partir des années soixante, suite au constat fait
par Peggy et Ronald Lippitt. Ce constat était relatif aux multiples
difficultés que les professeurs rencontrent avec certains publics
socialement défavorisés, ou encore avec les enfants des
immigrants. De cela, leur idée était de chercher des solutions or
que l'enseignement essentiel. Le choix était alors la mise en place des
pairs un peu plus âgés pour les aider. De ce fait, « le
tutorat apparait à cette époque dans les programmes
d'éducation compensatoire » (Topping, 1988, p.16-17). Par la suite,
« l'idée s'est largement propagée dans les pays anglo-saxons
et ailleurs, au-delà du cadre strictement scolaire, où les
domaines professionnels et universitaires sont désormais
concernés » (Baudrit, 2000, p. 8-9), puisqu'ils accueillent un
public qui nécessite une attention particulière.
Cependant, le statut scientifique du tutorat ne va se
manifester vraiment qu'à partir des années soixante-dix,
où nombreux vont être les chercheurs qui vont exprimer leur
intérêt pour ce dernier. Ensuite, et selon les propos de
Bédouret en 2003, le tutorat dans les pays anglo-saxons a connu de
réelles transformations, notamment, concernant le statut des tuteurs.
55
Aux Etats-Unis, ce concept va être proposé pour
faire face à l'arrivée massive des enfants immigrés. Cette
formule était choisie parmi d'autres pour apporter de l'aide à
ces enfants et les faire entrer dans le système éducatif
américain, par le biais de l'apprentissage de la langue du pays
d'accueil ainsi que le travail des cours et des devoirs. En somme, La
méthode tutorale présente un grand intérêt dans ce
contexte malgré sa suspicion qui règne à son égard
Outre-Atlantique.
2-2 le tutorat dans le contexte académique
français :
La mise en place du tutorat en France était
liée dès 1996 « à l'arrivée de nouvelles
catégories d'étudiants à l'université et au constat
récurrent dans les années quatre-vingt de la faible
rentabilité des premiers cycles universitaires » (Alberti et
Laterrasse, 2009, p.99). Ce dispositif a été donc
suggéré soit sous l'étiquette « d'un dispositif
d'aide à la réussite », soit sous celle d'un «
dispositif dans un contexte de lutte contre l'échec en premier cycle
». Cette question d'échec universitaire va susciter les
inquiétudes des décideurs politiques et des membres du
système éducatif français. De ce fait, l'entrée du
tutorat à l'université française a été
officialisée par l'Arrêté du 18 Mars 1998, pour garantir la
réussite des néo-bacheliers. Le tutorat, va être
considéré comme une réponse au phénomène de
massification à l'enseignement supérieur, ainsi qu'une solution
aux difficultés aperçues chez les étudiants du
Diplôme d'Etudes Universitaire Générales (DEUG). Il
était donc « établi à partir d'un cadre national aux
marges de l'institution », et il « était censé
contribuer à résoudre les difficultés pédagogiques
de la gestion d'un problème central, la massification et la
démocratisation de l'enseignement supérieur » (Sirota, 2003,
p.15). De plus, deux autres raisons ont poussé la France à
recourir au tutorat dans les universités : « la première est
liée au défi [...] de :
Faire mieux avec moins ». La seconde a trait à la
difficulté qu'à l'université à atteindre ses
objectifs les plus nobles, à savoir amener les étudiants à
penser par eux-mêmes. Le développement de pareilles
compétences exige des confrontations actives, en petits groupe durant
lesquelles l'étudiant est acteur de son apprentissage. (Noël et
Romainville 1998, p.133).
Face à cette demande, le tutorat sera
officialisé dans l'arrêté du 18 Mars 1998, dans la mesure
où il est « bénéficie à tous les
étudiants de première année de premier cycle qui le
souhaitent » et « l'action de tutorat est assurée par les
étudiants-tuteurs-eux-mêmes [...] en lieu avec l'équipe
pédagogique et sous la responsabilité d'un enseignant ou d'un
enseignant-chercheur ».
En effet, le cadrage institutionnel et les circonstances
d'officialisation du tutorat en France ont été
détaillés au niveau de plusieurs textes, sous-titre d'exemple on
cite : L'arrêté du
56
26 Mai 1992, la circulaire du 24 Octobre 1996, la circulaire
du 16 Mars 1997, l'arrêté du 9 Avril 1997 et l'arrêté
du 18 Mars 1998. Vers la fin des années 2000, le cadre institutionnel du
tutorat sera renforcé davantage, à travers des dispositifs
légaux comme : le Plan Réussite Licence (PRL) de 2007 et la
consolidation en Décembre 2009.
En France, le tutorat est donc non seulement la
conséquence des réflexions des enseignants qui s'ingénient
à chercher des solutions pédagogiques pertinentes pour
prévenir l'échec des étudiants, mais il est
également le produit d'une politique éducative qui encourage sa
pérennisation et son maintien.
2-3 le tutorat dans le contexte académique
marocain :
L'enseignement supérieur au Maroc est
considéré comme un paramètre fondamental du
développement humain et social. C'est pour cette raison que les
politiques éducatives ont concédé un intérêt
exclusif pour ce contexte. Ce système universitaire est confronté
à plusieurs défis et enjeux liés principalement aux
problèmes de gestion de l'effectif étudiants en permanente
augmentation. D'ailleurs, et comme les autres contextes universitaires qu'on a
cité, au Maroc, l'obstacle qui contribue les primo-entrants à
quitter les bancs des universités est éventuellement la
difficulté d'adaptation au sein d'un nouvel environnement,
complètement différent du secondaire. Le conseil supérieur
de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique a
déjà mis la lumière sur ce point, dont « plus de 25%
des étudiants abandonnent leurs études après une
année d'inscription » (CSEFRS, 2009, p.21). Face à cette
situation, et dans la finalité d'améliorer le rendement de
l'université marocaine, le ministère de tutelle a pris
l'initiative pour déclencher plusieurs réformes de
développement des dispositifs d'aide et d'accompagnement. Sous-titre
d'exemple « le tutorat » qui a vu le jour dans différentes
universités marocaine, suite au programme d'urgence 2009-2012. Parmi les
universités qui ont préconisées le programme du tutorat au
Maroc on cite, l'université Mohammed Premier d'Oujda et
l'Université Ibn Zohr d'Agadir
- L'université Mohammed Premier d'Oujda :
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet
universitaire, l'université Mohammed Premier d'Oujda a envisagé
l'application d'un tutorat d'accompagnement destiné aux étudiants
de la première année cycle licence, après plusieurs
réunions d'entente avec les tuteurs, ainsi que nombreuses séances
de formation organisées par la cellule d'accompagnement
pédagogique (CAP-FLO). Le tutorat proposé constitue un dispositif
d'aide mis à la disposition des étudiants
57
souhaitant bénéficier d'un soutien et d'un suivi
pour améliorer leur niveau et multiplier leurs chances de
réussite. Au niveau de cette action tutorale, les tuteurs sont des
étudiants du master ou de doctorat, sélectionnés suite
à un appel de candidature. Le choix de ces tuteurs repose sur le fait de
ne pas les considérer comme étant des enseignants, mais de les
voir plutôt comme des animateurs qui connaissent la discipline et le
fonctionnement de l'université, et qui peuvent écouter,
conseiller, et aider les novices. Donc à nombre de 24, ces tuteurs
commencent à travailler au sein de la faculté des lettres et des
sciences humaines d'Oujda, avec 60 étudiants inscrits en deuxième
semestre de la session printemps 2010. Les tutorés concernés
étaient de différentes filières comme : les études
arabes, françaises, anglaises, et amazighes, la géographie,
l'histoire et civilisation, les études islamiques etc...
Les objectifs de cette action tutorale peuvent alors être
résumés comme suit :
l Informer les futurs étudiants sur les formations
existantes à l'université.
l Soutenir les tutorés dans les matières qui leur
posent problèmes.
l Aider les étudiants à retrouver confiance en
eux.
l Promouvoir la réussite des étudiants.
l Optimiser l'accompagnement pédagogique des
différents acteurs engagés (enseignants, tuteurs et
étudiants).
- L'université Ibn Zohr d'Agadir :
La faculté des lettres et des sciences humaines de
l'université Ibn Zohr d'Agadir, a conçu un dispositif du tutorat
pour les étudiants qui souhaitent avoir un accompagnement
spécifique. L'université a décortiqué le terme
« tutorat » d'une manière captivante pour marquer les
éléments qui le forme ainsi que c'est atouts : LE TUTORAT
:
Tuteur : accueillir, informer, faciliter
l'intégration, aider Université : MTU, TIC,
bibliothèque
Ténacité : efficience,
efficacité, management personnel Orientation : guider,
faciliter l'acquisition des savoir-faire Réussite :
savoir entreprendre ses études
Accompagnement : savoir écouter /
être à l'écoute
58
Tutoré : motivation, attitude positive,
organisation, autonomie
Le dispositif du tutorat suggéré permet aux
étudiants de différentes filières, de
bénéficier d'un accompagnement, d'une préparation aux
cours, et d'un encadrement permettant l'intégration au sein de
l'université. Cette faculté a donc organisé le mercredi 6
Septembre 2017 une semaine d'accueil et du tutorat avec la proposition d'un
menu riche en séminaires, composé d'un assortiment de formations,
de cours de langue, d'ateliers de communication et de prise de parole devant un
public, de gestion de temps, de citoyenneté, d'engagement et de travail
associatif. Au niveau du tutorat mis en place, le travail s'organise dans des
petits groupes, où un tuteur, qui est à la base un
étudiant du master ou de doctorat, multiplie ses services pour offrir
aux étudiants une aide personnalisée concernant la langue
française, arabe et anglaise, la communication d'information, le travail
documentaire, la préparation aux examens etc...
Au sein de la même faculté, un deuxième
type de tutorat a été offert, c'est le tutorat de
bibliothèque qui initie les nouveaux étudiants aux techniques et
aux outils de recherche documentaire à travers quatre étapes
majeurs :
- L'identification
- La connaissance
- L'utilisation des différentes bibliothèques - La
pratique autonome de la documentation
Le contenu proposé lors de ce dispositif, se rapporte
au travail documentaire, à la maitrise des instruments bibliographiques
et à l'usage de la bibliothèque. Durant le déroulement du
tutorat, le responsable organisait régulièrement des
réunions d'encadrement pour discuter le cours des séances, pour
pointer les difficultés et faire le bilan permettant d'améliorer
le dispositif. Cette faculté a eu recours à un troisième
type de tutorat : le tutorat de remise à niveau en français. Il
était adressé à priorité aux étudiants du
département français et son principe était de renforcer et
d'enrichir leurs compétences en langue française, à orale
comme à l'écrit.
Certes, le tutorat au Maroc est préconisé dans
quelques universités, mais ce dispositif doit être
généralisé dans tous les autres établissements,
comme l'avait souligné l'ancienne ministre par intérim de
l'enseignement supérieur, Jamila El Moussali, lors de sa visite au
nouvel espace d'accueil et d'accompagnement des nouveaux étudiants
à la faculté des lettres et des sciences humaines de
l'université Ibn Zohr d'Agadir. Elle a mentionné que « le
projet
59
d'accompagnement universitaire est l'un des plus importants
projets pour l'université marocaine compte tenu de son impact sur
l'intégration des nouveaux étudiants et sur l'ensemble de leur
parcours universitaire ». El Moussali a insisté également
sur les propos qu'elle a avancés, quand elle a visité les
nouveaux locaux de l'école nationale des sciences appliquées
(ENSA) relevant de l'université Ibn Zohr d'Agadir. Elle s'est
informée sur les mécanismes de fonctionnement du tutorat, la
nature des formations proposées et le profil des tuteurs qui encadrent
les primo-arrivants.
2-4 le tutorat dans le contexte académique
polonais :
Le tutorat possède un statut très positif dans
le contexte éducatif polonais, dans la mesure où, le ministre de
l'éducation en 2016 a encouragé les organisations
non-gouvernementales à participer à un concours appelé
« Méthode de tutorat en tant que moyen innovant du travail
d'éducation, de prévention et de resocialisation ». Dans le
contexte polonais, on trouve souvent un tutorat de type scientifique qui domine
le terrain. Ce tutorat est en général associé aux
filières universitaires qui proposent des formations
interdisciplinaires, comme celles de l'université de Varsovie ou encore
de Cracovie.
La place primordiale qu'occupe le tutorat en Pologne est
manifestée par le fait que ce dispositif est placé au centre d'un
vaste projet dirigé par Beata Karpinska-Musical dans les années
2014-2016, à l'université de Gdansk, où 29 tuteurs ont
travaillé avec 222 étudiants. Au bout de ce projet, les feed-back
des tuteurs et des tutorés ont été collectées pour
mettre en exergue les avantages et les bienfaits de ce dispositif, et pour
accentuer de même son futur potentiel dans le cadre de l'enseignement
supérieur polonais.
Dans plusieurs universités anglaises dès le
XIIIème, au Québec suite au Rapport Parent de 1964,
dans les « Gesamtschulen » allemandes crées en 1968, en
France, en Pologne et au Maroc, le tutorat a pu trouver sa place dans le monde
éducatif.
3- les protagonistes de l'action tutorale : le tuteur
et le tutoré : 3-1 le tuteur :
Etymologiquement, le terme « tuteur » vient du
latin « tutor » qui désigne « défenseur »,
« protecteur » et « gardien ». Danner, Kempf et Rousval
avancent que :
Si en jardinage, le tuteur est une tige, une armature de bois
ou de métal fixé dans le sol pour soutenir ou redresser les
plantes, en pédagogie, le tuteur est un médiateur entre
l'apprenant et l'institution à laquelle ce dernier se doit de s'adapter.
(1999, p .247).
60
Ceci montre que le tutorat ne se limite pas uniquement
à une maitrise des connaissances liées aux processus
d'apprentissage, mais également, il nécessite un accompagnement
approprié. D'ailleurs, Plusieurs divergences ont concerné la
définition du tuteur et ses fonctions. Certains préfèrent
les modalités liées à la discipline et voient en tuteur,
un bon étudiant ayant une aisance disciplinaire, et une bonne maitrise
du contenu, qui peut jouer le rôle d'un compagnon, un associé ou
un vulgarisateur qui accompagne l'activité d'enseignement. D'autres
préfèrent les dimensions relatives au contact humain et à
la maitrise du relationnel. Encore plus, on trouve ceux qui estiment que le
tuteur, est un répétiteur patient qui insiste sur les
apprentissages. Il est donc un facilitateur. Ces mêmes remarques ont
été mentionnées dans des interviews qu'a faites Du
Marchais avec des tuteurs en 1990. Ces dernières montrent que
principalement un tuteur est censé : amener les étudiants vers
une compréhension poussée des matières enseignées ;
guider ces derniers dans les domaines d'études ; faciliter
l'échange entre les étudiants. Annoot a remarqué à
son tour plusieurs modes d'investigation propres aux tuteurs, elle site
sous-titre d'exemple : « conseiller, guide, confident, modèle de
réussite... » (2001, p.287), d'où la référence
au rôle disparate de ces derniers : « ils sont moins prisonniers des
attentes institutionnelles et donc moins rigides, plus créatifs. Ils ont
donc une perception moins formelle des apprentissages, ce qui les rend plus
aptes à appréhender les difficultés des tutorés
» Alberti et Laterrasse, 2002, p.111).
De toutes ces divergences, un aspect commun se forge, c'est
le fait que les tuteurs ne sont pas des professionnels, car ils « [...] ne
peuvent pas se prévaloir (ou pas encore) d'être des professionnels
de l'enseignement ou de l'accompagnement » (Devilliers et Romainville,
2013, p.25). Alors, le tuteur ne peut pas remplacer les enseignants qui «
[...] ont une approche plus au moins formelle des contenus enseignés
» (Baudrit, 2000, p.126). Egalement, ce tuteur se distingue du coach vu
que la fonction de ce dernier est fondée essentiellement, sur la
relation individuelle qui vise l'atteinte des objectifs sur une période
déterminée. Alors que le tuteur s'intéresse plus à
« un développement harmonisé et durable, où l'erreur
ou l'échec vécus dans un cadre de sécurité sont
considérés comme une étape à franchir sur ce chemin
» (Brzozowski, 2017, p.298). Le tuteur n'est donc ni un enseignant, ni un
formateur, ni un coach, mais un accompagnateur sans formation
pédagogique spécifique. Il peut être étudiant,
parent d'élève ou membre d'association, ou
généralement un adulte non professionnel d'enseignement. Le
tuteur est donc un pair capable d'assister le développement personnel et
professionnel de son tutoré, de lui porter toute son attention, de
veiller sur lui, et de s'assurer qu'il bénéficie de tout dont il
a besoin.
61
3-2 le rôle et les fonctions du tuteur
:
La relation des tuteurs avec leurs tutorés leurs
confèrent plusieurs tâches :
Tout d'abord, leur rôle ne consiste pas à ce
qu'ils se calquent sur enseignants pour former leur double, leur rôle est
tout à fait différent. Premièrement, « ils ont pour
rôle de guider et d'assister leurs « tutorés », en leur
délivrant les clés pour combler leurs « manques » et
réussir à l'université » (Gerbier et Sauvaitre, 2003,
p.18). De ce fait, les tuteurs doivent retrouver une manière d'agir
originale et adéquate avec les besoins de leur public, et ils doivent de
même penser à la façon d'aider le tutoré à
appréhender les principes de base lui permettant de construire petit
à petit ses repères. On peut alors déduire que la
responsabilité du tuteur réside dans la réalisation d'un
travail pédagogique différent de celui du maitre, qui valorise
davantage le relationnel, et qui s'appuie sur deux dimensions : la dimension
productive importante pour la réalisation des tâches
demandées, et la dimension constructive qui aide à organiser et
à ajuster la manière d'agir ». Ensuite, ces tuteurs peuvent
également offrir à leurs tutorés un soutien pour
l'intégration, au niveau duquel, ils partagent leurs connaissances par
rapport aux services de l'université, aux programmes d'études,
aux orientations de carrière etc...
Comme nous avons souligné au niveau des
définitions que les notions d'aide et d'accompagnement dominent le champ
du tutorat, on va encore une fois accentuer cet aspect dans les fonctions du
tuteur. Selon Boultin et Camaraire (2001) les fonctions du tuteur sont à
nombre de trois:
La fonction psychologique : le tuteur contribue
à la confiance en soi de son tutoré par le biais d'un dialogue
constructif.
La fonction pédagogique : le tuteur soutient
l'étudiant dans ses apprentissages en lui donnant les moyens
nécessaires pour appréhender la vie dans le milieu, et en lui
montrant l'importance d'intégrer ses besoins individuels dans le groupe
de travail.
La fonction technique : le tuteur porte un regard sur
une partie importante des prestations des tutorés.
Pour que la fonction du tuteur soit accomplie, ce dernier
doit être informé par rapport à sa mission, il doit
être conscient de l'importance de son rôle, il doit étudier
l'ensemble des
62
stratégies sociales, cognitives et informationnelles
utiles pour l'apprentissage. Le tuteur est appelé aussi à
repérer ses réussites et ses échecs. Il doit
également être capable de s'informer des faiblesses de son
tutoré, de les prendre en compte, et de les pallier vers la fin. Cette
mission ne peut s'aboutir qu'avec la volonté du tuteur. Le langage
présente également un point non négligeable, à
prendre en pleine considération pour garantir la réussite des
différentes fonctions du tuteur. Le langage dans l'activité du
tuteur est utilisé pour guider l'apprenant dans sa démarche et
aussi dans la finalité de changer « la logique de résolution
du tutoré » (Barnier, 1994, p.71). Alors, chaque tuteur ayant envie
d'accomplir cette mission, est appeler à effectuer un travail sur son
langage de manière à ce qu'il soit commode avec le niveau des
tutorés et coïncident avec leurs besoins.
En définitive, les tuteurs sont amenés à
jouer sur un double registre : relationnel, avec la proximité sociale
qu'ils ont avec les étudiants. Et cognitif, grâce à leur
niveau d'expertise. Dans leur activité, l'aide est centrale, sous
témoignage d'exemple : aider à apprendre et à travailler,
aider à se familiariser avec la langue du pays d'accueil, aider à
l'adaptation dans un nouveau milieu, et la liste reste longue si nous voulions
cerner tout ce qui est demandé aujourd'hui des tuteurs dans le domaine
de l'éducation.
3-3 les critères du choix du tuteur :
Le tutorat comme tout procédé
pédagogique, répond à un certain nombre de règles
de fonctionnement, parmi les, le choix des tuteurs. En général,
des critères comme l'âge, l'expérience, et le niveau de
compétences sont cherchés lors du choix des tuteurs. D'ailleurs,
Baudrit rappelle que Moust (1993) a identifié six critères pour
le choix des étudiants tuteurs : « l'utilisation de savoirs
académiques, l'usage de l'autorité, la recherche de la
réussite, l'incitation à la coopération, la congruence
sociale et la congruence cognitive » (2000, p.145).
Tout d'abord, la congruence cognitive :
Est perçue comme la capacité toujours pour les
tuteurs, de s'exprimer dans le langage des tutorés, en des termes
compréhensibles par eux ou de faire usage de notions et de concepts qui
leur sont familiers », et quant à la congruence sociale, elle
« témoigne d'une volonté, de la part des tuteurs,
d'être des étudiants parmi d'autres, à la recherche de
relations spontanées, bienveillants à l'égard de leur
pairs. (Baudrit, 2000, p.145).
Dans cette perspective, Papi insiste à son tour
surtout sur cette congruence cognitive, dans la mesure où il affirme que
: « dans l'enseignement supérieur, l'accompagnement par des
étudiants-tuteurs est souvent pensé comme favorable à une
meilleure « congruence cognitive »
63
(Moust, 1993) que celui assuré par des
enseignants-tuteurs dans la mesure où, ils ont un langage plus proche
des tutorés ainsi qu'une plus grande sensibilité aux
difficultés rencontrées par ceux-ci » (Papi, 2013, p.16). Un
bon tuteur est donc celui qui possède « l'association de
compétences académiques (l'expertise) et de qualités
personnelles (la congruence sociale). Ce savant mélange dote la personne
de qualité très appréciée. « La congruence
cognitive » (Baudrit, 2000, p.51), considérée comme un
équilibre entre ces deux composantes difficiles à coordonner.
Ensuite, le paramètre d'âge demeure à son
tour important dans la sélection des tuteurs. Concernant ce point,
Feldman, Devin-Sheehan et Allen, ont insisté en (1976) sur l'importance
de la différence d'âges entre les tuteurs et les tutorés,
dans la mesure où, les tuteurs plus âgés, qui ont
bénéficié d'une expérience universitaire
importante, possèdent des compétences académiques
avérées, et arrivent à apporter l'aide, le conseil, le
suivi, la motivation, et l'accompagnement nécessaire pour leurs
tutorés. D'un autre angle de vue, les tuteurs adultes sont plus
crédibles et plus prix au sérieux par les tutorés, ils
montrent aussi une certaine efficacité dans l'acte de soutenir les
étudiants. Certes, la différence d'âge est importante pour
le choix des tuteurs et pour la qualité de la formule tutorale
proposée, pourtant, elle ne doit pas être exagérée.
Cette conception a été traitée dans la théorie des
rôles développée pas Allen qui met en exergue la
favorisation des « tuteurs-étudiants » (1976, p.5). Allen a
mentionné qu'une proximité d'âge et de compétences
est essentielle pour faciliter l'acquisition des tutorés, dans la mesure
où, un tuteur de la même génération du tutoré
peut facilement se mettre à sa place. C'est pour cette raison que la
différence d'âge (Cross age tutoring) est demandée plus
qu'une équivalence d'âge (Same age tutoring). Cette posture du
tuteur-étudiant est la préférée même du
côté des tutorés, qui voient en ces derniers des apprenants
leurs portant un soutien scolaire et motivationnel.
Les universités qui préconisent le tutorat sont
conscientes du rôle primordial que joue les tuteurs-étudiants dans
l'accompagnement des apprenants, elles voient que ces derniers sont «
favorisés par la proximité d'âge, la proximité
sociale et culturelle, la proximité du parcours scolaire ou encore la
proximité de difficultés dans le tutorat de pairs »
(Devilliers et Romainville, 2013, p.25) et du coup l'action tutorale dans ces
universités se réalise par la participation des pairs qui
interviennent naturellement avec les tutorés, et qui sont souvent des
étudiants dont la différence d'âge ne dépasse pas
quelques années.
A part le paramètre d'âge, d'autres aspects
doivent figurés chez le bon tuteur, sous-titre d'exemple on cite, le
fait que le tuteur ne doit pas dominer l'échange, ni intervenir
directement dans la tâche, il doit être patient pour diriger le
travail. Il doit de même expliquer, conseiller,
64
poser des questions et donner au tutoré le temps de
répondre, sans rien faire à place. Il faut également
mentionner que lorsqu'on veut engager des tuteurs au sein des classes ou des
institutions, le choix des meilleurs éléments n'est pas toujours
judicieux, ce qui compte plus c'est de trouver des personnes courageuses, qui
ne baissent pas les bras devant les problèmes des tutorés,
sérieuses au point de considérer ces problèmes comme
étant les leurs.
Un autre critère s'avère cruciale dans le choix
des tuteurs est bel et bien le langage. Un tuteur doué est
communément celui qui s'exprime d'un langage proche de celui de son
tutoré, dans la mesure où, il fait attention à son
vocabulaire et il choisit un lexique qui leur soit accessible.
Un tuteur qualifié comme capable d'assumer sa fonction
est également celui qui maitrise bien les contenus disciplinaires, de
même :
l'assimilation des codes et habitus universitaires, met ainsi
en jeu des mécanismes identificatoires à un autre qui parait
beaucoup plus proche que l'enseignant car le tuteur présente des traits
physiques, psychologiques et comportementaux qui l'apparient à
l'étudiant à aider. (Alberti et Laterrasse, 2002, p.111-112).
Les propos de ces deux auteurs soulignent l'importance de
connaitre les enjeux de l'environnement universitaire, de les transmettre au
tutoré qui va les mettre en pratique pour garantir son
intégration.
Or l'âge, la maitrise du contenu, le recours à
un langage adéquat et le fait de donner au tutoré la
liberté dont il a besoin, les tuteurs doivent être avant tout des
personnes prêtes à s'intéresser à d'autres. Leur
action doit encourager l'autre et l'amener à progresser.
Finalement, et dans le cadre du choix des tuteurs, on
évoque une méthode qui décrit plus au moins le processus
tutoral et qui insiste surtout sur ce que le tuteur doit faire pour
réussir sa fonction. Cette méthode est nommée (Pause,
Prompt and Praise) expérimentée tout d'abord en 1981 à
Nouvelle Zélande, puis objectée dans d'autres pays tel que
l'Australie et le Royaume-Uni en 1985. Pour détailler davantage cette
méthode, on va commencer d'emblée par « Pause » :
Lorsque l'élève fait une erreur ou
hésite, le tuteur doit attendre avant d'intervenir. Ce délai est
d'au moins cinq secondes [...]. Cette façon de faire lui offre la
possibilité de rectifier ses erreurs et, une fois ce temps
écoulé, de bénéficier d'une explication
donnée par le tuteur. En général, les enseignants, comme
les tuteurs, ont du mal à respecter ce délai. Ils ont hâte
d'aider ou d'apporter des informations. Même s'ils s'en défendent,
les enseignants sont souvent enclins à fournir les réponses
correctes à leurs élèves juste après qu'ils aient
buté sur un terme, effectué une prononciation impropre.
(Wheldall, Wenban-Smith, Morgan et Quance, 1989).
65
Ensuite, « Prompt » : c'est la deuxième
phase, qui commence après les cinq secondes. Au niveau de laquelle, le
tuteur peut intervenir si son tutoré n'arrive pas à
répondre. Cette intervention est conditionnée par la nature du
blocage rencontré. Enfin, « Praise », cette phase concerne le
renforcement de l'activité du tutoré ainsi que son comportement,
au niveau de laquelle, les tuteurs peuvent complimenter les apprenants, et les
félicités car ils ont pu trouver eux-mêmes les
éléments de réponse à la base des conseils
délivrés lors de la phase précédente (Prompt). En
gros, la méthode (PPP) peut être résumée en trois
grands temps attendre et patienter, intervenir, puis encourager et motiver.
3-4 l'effet-tuteur :
Au niveau du tutorat, le tutoré et le tuteur
échangent et profitent réciproquement. Barnier montre son accord
avec cette idée avancée, lorsqu'il a mentionné que le
tutorat :
Permet une plus grande participation des élèves
à leurs propres apprentissages [...] Il sollicite conjointement les
processus de transmission, d'appropriation et de réinvestissement des
connaissances. [...] ses effets bénéfiques peuvent aussi bien
concerner les tutorés (ceux qui sont aidés) que les tuteurs.
(2001).
Le tutorat est généralement perçu comme
une formule d'aide mise à la disposition du tutoré et visant son
progrès. Cependant, au sein de ce dispositif, même le tuteur se
répand d'une manière remarquable. La formule tutorale est un
outil d'apprentissage qui a une influence directe sur les études et la
vie du tuteur. Cette partie va être alors consacrée aux
apprentissages personnels et professionnels qu'un tuteur peut tirer de son
activité dans le cadre tutorat. Ce phénomène est
nommé : « l'effet-tuteur ». Il y a longtemps que
l'effet-tuteur a était signalé dans la littérature
relative au domaine de l'éducation, pour désigner les
bénéfices qu'un tuteur peut retirer de son rôle
d'accompagnement auprès d'un pair moins expert que lui. Il
représente alors l'ensemble des caractéristiques capacitantes
ayant comme origines les différentes tentatives d'aide. Cependant, les
travaux scientifiques concernant ce phénomène demeurent
récents, comme ceux de (Topping, 1996) ; (Galbraith et Winterbottom,
2011) ; (De Backer, Van Kerr et Valcke, 2012).
Au début, c'était Comenius (1592-1670) qui a
parlé de son existence, lorsqu'il a évoqué « Docemur
docendo », un concept qui fait référence à
l'idée que celui qui enseigne peut apprendre et bénéficier
de son enseignement. Ensuite, et vers la fin du XVIIIème
siècle, un pionnier britannique de l'enseignement mutuel appelé
le Docteur Bell, a repris ce phénomène pour dire que : « les
élèves qui remplissent les fonctions des maitres apprennent
eux-mêmes » (Propos rapportés par Charconnet, 1975, p.12).
66
Les américains vont à leur tour traiter ce
concept, et lui accorde l'appellation de « Learning Through Teaching
» (Garthner et kolher Riessman, 1973, p.20). Ils ont affirmé qu'au
sein du (LTT), « le jeune est obligé d'étudier la
matière à fond avant de l'enseigner à un camarade ; il
faut qu'il organise son cours, qu'il observe l'autre élève et
parvienne à établir un contact avec lui » (1973, p.27). Ces
auteurs interprètent ceci par le fait que le tuteur « devient un
élève actif, si bien qu'il comble rapidement des lacunes dans
celles-ci se trouvent en outre renforcées par une compréhension
nouvelle. En somme, il bénéficie de tous les avantages du
réapprentissage » (Garthner et kolher Riessman, 1973, p.139).
Alors, on peut déduire que la condition nécessaire pour qu'un
tuteur profite de son activité est le fait, qu'il travaille d'une
manière approfondie les contenus qu'il va diffuser, qu'il revoit les
éléments du programme en question et qu'il maitrise bien
évidemment les interventions qu'il va présenter. Burner (1983) va
dans le même ordre d'idée et montre que le tuteur ne doit pas
être vu pour un simple pourvoyeur des savoirs et du savoir-faire. Au
contraire, il doit réinvestir ce qu'il livre pour son tutoré.
L'effet-tuteur s'explique alors par le biais de cet acte de
réinvestissement :
C'est ce travail d'élaboration et de mise en oeuvre
d'un guidage de l'action de l'autre qui peut être profitable au tuteur
à travers le type d'activité qu'il requiert, surtout s'il ne se
contente pas de guider directement l'action du tutoré, mais recherche
à lui expliquer comment s'y prendre. (Filippaki, Barnier et
PapaMichaël, 2001, p.29).
Ceci va accentuer davantage ce que les anglo-saxons ont
l'habitude de dire « qu'enseigner c'est apprendre pour une seconde fois
», c'est plus au moins le principe de base de l'effet-tuteur. Le tuteur
peut progresser à travers l'enseignement qu'il offre pour ses apprenants
et aussi par la situation de communication réelle et l'échange
qu'il réalise avec eux.
D'un point de vue expérimental, c'est Cloward (1967)
qui a montré la présence de l'effet-tuteur. Déjà,
il fut le coordinateur majeur d'un grand programme d'aide aux devoirs à
domicile dans la ville de New York, nommé « Mobilization for youth
». L'objectif de la mise en place de ce programme est de combler les
lacunes principalement en lecture, des enfants portoricains habitant à
Manhattan. Et pour cette mission, des adolescents ont été
recrutés pour les aider à raison de quatre heures d'une
façon hebdomadaire, pendant vingt-cinq semaines. Durant cette
expérience les tutorés ont tiré des bienfaits
appréciables, mais ils n'étaient pas les seuls à profiter.
Cloward a d'ailleurs vérifié au début comme à la
fin du programme, le niveau en lecture des 240 tuteurs engagés dans
cette action. L'étude menée par cet auteur a montré, qu'en
comparaison avec un groupe-témoin composé d'adolescents non
participants, le progrès des premiers est notable deux fois plus par
rapport à celui des seconds. Gatti et Blary (2017),
67
Morand (2015) ont insisté également sur le fait
que grâce au tutorat, le tuteur arrive à acquérir des
compétences d'aide, à consolider des connaissances
académiques ainsi qu'à développer diverses méthodes
et stratégies. Ces bénéfices ne peuvent être
garantis qu'avec deux conditions nécessaires: La maitrise suffisante du
tuteur de la matière enseignée, et la structuration de sa
démarche. Ces conditions relatives à l'origine de l'effet-tuteur
ont été d'ailleurs relevées par Scruggs, Mastropieri et
Richter (1985).
En effet, les avantages qui émanent de l'effet-tuteur
peuvent être perçus au niveau des interactions et des conduites
sociales comme le prouve Cohen (1986). Elles peuvent être aussi sous
forme des améliorations qui se rapportent à la confiance en soi
et au niveau d'aspiration comme le note Haggarty (1971). Ou encore, des
progrès sur le plan affectif et socio-émotionnel comme l'estiment
Lippitt et Lohman (1965). Ils peuvent être également remarquables
au niveau du parcours du tuteur, sa prise de parole, ses notes, ses examens
etc...Alors, l'effet-tuteur peut avoir un impact direct sur les performances
universitaires des tuteurs et sur leur niveau cognitif, comme il peut
être constructif au niveau de la connaissance de leur entourage ainsi
qu'au sein de leurs relations sociales.
Pour parler maintenant de la production de cet effet-tuteur,
les spécialistes avancent deux conceptions : certains insistent sur le
fait que les tuteurs bénéficient de cet effet jusqu'à la
fin de l'action tutorale. D'autres, tels que Strodtbeck, Ronchi et Hansell
(1976) qui supportent l'idée d'un effet-tuteur rapide. Plus tard, cet
effet-tuteur va faire l'objet de nombreuses investigations, au niveau
desquelles, les chercheurs vont déduire à la base des
tests/retests que cet effet se produit généralement d'une
manière tardive, souvent après l'interruption du programme
tutoral. Donc, il faut du temps pour que les tuteurs engagés voient
leurs activités récompensées. Les différentes
formes de production d'effet-tuteur que nous avons cité peuvent
être expliquées d'emblée par le fait que, « les
tuteurs interviennent de plus en plus dans des secteurs différents,
auprès des publics variés, pour des missions diverses »
(Baudrit, 2000, p.164), c'est pour ça que les retombés sont vus
de manières distinctes.
Malgré les différentes opinions des auteurs,
mais ils se sont mettes d'accord pour confirmer la présence de l'effet
tuteur malgré son caractère non immédiat dans la plupart
des expériences. Ils insistent donc sur l'idée qu'à chaque
fois un tuteur vient en mesure d'aider un tutoré et d'être
attentif aux difficultés qu'il éprouve, il tirera certainement
profit de ses interventions. Finkelstein et Ducros (1989), avancent que les
tuteurs qui peuvent bénéficier de leurs actions, sont
majoritairement ceux qui se situent proches de ce Vygotsky « la zone
68
proximale du développement » (1934), qui
présente l'écart entre ce que l'apprenant peut réaliser
seul, et ce qu'il n'arrive pas à accomplir même avec l'aide d'un
adulte.
Plusieurs facteurs peuvent être derrière
l'émergence de l'effet-tuteur. Tout d'abord, le degré
d'organisation du tutorat. Plus ce dernier n'est élevé, plus
l'effet-tuteur à de grandes chances d'apparaitre. Ensuite, les
tutorés sont des éléments déterminants dans
l'avènement de l'effet-tuteur, vu qu'ils sont ceux qui poussent le
tuteur à préparer ce qu'il va dire ou faire, à parfaire
ses connaissances disciplinaires, ainsi que ses démarches de travail.
Enfin, le choix des tuteurs est un paramètre d'une grande importance,
quant à l'éclosion de l'effet-tueur. Il demeure donc
évident de choisir des tuteurs capables de comprendre les
problèmes des tutorés et de les remédier. Ces tuteurs
doivent aussi être conscients de l'apport positif qui peut tirer de leur
participation au sein du tutorat.
Cette prise de conscience peut être facile à
provoquer surtout si on ne choisis pas les très bons étudiants
pour occuper la fonction du tuteur, puisque ces étudiants brillants
possèdent à l'avance une estime de soi, et une flexibilité
dans la prise de parole, de même, ils sont déjà conscients
de leurs compétences académiques. D'où, il est fort
probable que ces étudiants n'aperçoivent même pas cet
effet. Alors, qu'il peut être facile à repérer chez ceux
ayant des résultats et des capacités scolaires qualifiées
comme « moyennes », vu qu'ils vont se situer à un niveau
proche de celui des tutorés, il leur serait donc facile d'identifier les
difficultés auxquelles ces apprenants sont confrontés, puisque
généralement, ils ont vécu les mêmes, d'où la
recherche des solutions adéquates va être complaisante et elle va
demander que ces étudiants réinvestissent d'une manière
audible pour les rendre accessibles aux apprenants. La totalité de ce
processus amène le tuteur à progresser positivement :
l'effet-tuteur. En somme et malgré son importance, cet effet-tuteur
réside un phénomène complexe et peu documenté pour
plusieurs raisons, tel que l'insuffisance statistique, le manque des
données et la difficulté à cerner les profils et les
différentes caractéristiques des tuteurs etc...
3-5 Le tutoré :
Selon le philosophe et le pédagogue Antoine de la
Granderie, le dialogue pédagogique se centre sur l'emploi des
élèves des différents moyens visant la réalisation
dans les tâches d'apprentissage. Ce dialogue pédagogique insiste
donc sur l'importance de l'activité de l'apprenant au niveau des
dispositifs éducatifs. A la base de ce concept et dans le cadre du
tutorat universitaire, une place primordiale est accordée au
tutoré, dont la mesure où « l'idée de placer
l'étudiant au coeur du processus d'apprentissage est venue contredire un
modèle
69
académique tourné vers la primauté des
savoirs universitaires » (Annoot, 2012, p.25). Donc, au sein de ce
dispositif, le tutoré, est l'élément autour duquel gravite
toute la programmation du tutorat. Il doit faire preuve de motivation pour
qu'il arrive à construire son projet de formation, « il doit
également tendre vers l'autonomie, être susceptible et capable de
se réorienter, d'opérer des choix. Plus tard, il pourra
être tuteur manifestant ainsi son engagement dans la vie universitaire
» (Alberti et Laterrasse, 2002, p.104-105). On peut donc avancer que
l'intérêt porté au tutoré lui concerne en tant
qu'étudiant soucieux de réussir son parcours académique et
aussi en tant que futur tuteur capable d'aider d'autres personnes à la
base de son expérience.
Conclusion du chapitre 3 :
Au niveau de ce troisième chapitre, nous avons
expliqué les principes théoriques du tutorat, le dispositif
pédagogique préconisé par notre travail de recherche. Nous
avons essayé de faire le tour d'horizon concernant ce concept, de parler
de son histoire, son évolution, d'évoquer un ensemble de
définitions marquant sa richesse. Nous avons également
cité ses différentes formes et fonctions, ses apports et des
limites. Et dans le but d'accentuer davantage sa place dans le champ
éducatif, nous avons traité sa présence dans
différents contextes académiques et surtout celui de
l'université marocaine, pour démontrer encore plus l'idée
de base qu'on avait pour l'expérimenter. Ce chapitre était de
même le garant de nombreuses conceptions concernant le tuteur.
L'attention était centrée aussi sur le tutoré et les
conditions fondamentales qui puissent garantir le succès de la formule
tutorale. Le tutorat présenté avec ses avantages et ses failles,
doit donc inciter les responsables à tenter l'expérience de le
mettre en place, avec une pleine conscience que le programme peut être
poursuivi, comme il peut être interrompu, et d'insister sur le fait que
ce qui prévaut essentiellement c'est l'idée d'essai.
CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE :
La partie théorique consacrée à la mise
en exergue des concepts clés qui dirigent notre travail de recherche,
était articulée tout d'abord autour de l'écrit à
l'université, ensuite autour de la littéracie et de la
littéracie universitaire, et enfin auprès du tutorat. Cette
partie était donc le garant d'une présentation claire de ces
concepts qui vont être traités d'une manière
concrète au niveau de la pratique.
70
PARTIE 2 : PRATIQUE ET EMPIRIQUE
Dans le but de vérifier la pertinence du tutorat, tout
d'abord, comme un dispositif d'aide envisagé pour garantir
l'accès en littéracie universitaire, essentiellement du
côté de l'écrit, pour les étudiants de la
première année licence, département du français
à l'ENS Meknès, et ensuite, comme une méthode
pédagogique permettant l'émergence de l'effet-tuteur, nous avons
opté pour une expérience sur terrain, en nous conformant à
la méthodologie de la recherche-action qui sera développer
davantage dans les parties à venir.
Nous avons usé également deux outils
d'investigation pour évaluer le dispositif proposé, dont le
questionnaire d'appréciation destiné aux tutorés, et le
journal de bord mis à la disposition des tuteurs. La triangulation de
ces modalités nous a permis de collecter des données et de
discuter des résultats pour arriver à une conclusion vers la
fin.
Au niveau de cette partie, nous allons donc présenter
la méthodologie de notre recherche, et le cadre systématique
utilisé pour résoudre le problème posé,
autrement-dit, on va faire référence aux différentes
pratiques, techniques et procédures, que nous avons mis en oeuvre
concrètement pour répondre à la problématique du
départ, pour vérifier l'hypothèse avancée, et pour
être en mesure de la confirmer ou de l'infirmer.
CHAPITRE I : METHODOLOGIE DE RECHERCHE ET
PRESENTATION DE L'INVESTIGATION
1- Techniques d'enquête :
Comme notre démarche de recherche vise à
vérifier, la possibilité d'introduire un tutorat d'accompagnement
dans un contexte d'enseignement supérieur au Maroc, pour émerger
à la fois, l'effet-tuteur et l'effet-tutoré, nous avons
opté pour l'approche qualitative.
Dans ce premier chapitre, nous présenterons donc
l'approche adoptée dans notre travail de recherche : l'approche
qualitative à travers la mise en place d'une expérimentation qui
découle de la recherche-action, et deux autres outils de collecte de
données qui sont : le questionnaire d'appréciation et le journal
de bord.
71
1-1 L'approche qualitative:
Les recherches qualitatives témoignent la richesse, la
fiabilité et la pertinence. Dans le cadre de l'approche qualitative,
nous avons choisi tout d'abord d'expérimenter le tutorat et de
l'appliquer auprès d'un groupe d'étudiants de la première
année licence, département du français à l'ENS
Meknès, pour vérifier son efficacité et son
adéquation avec le développement des littéracies
universitaires, notamment en matière de l'écrit. Ensuite, nous
avons diffusé un questionnaire d'appréciation destiné aux
tutorés participants à l'action tutorale durant un mois
d'expérience, comme premier instrument privilégié dans le
cadre de l'approche qualitative. Ce questionnaire est constitué d'une
diversité de questions, tantôt ouvertes tantôt
fermées, dans la mesure où les enquêtés
répondaient par « oui », « non », « très
utile », « très réussie », « pas du tout
réussie », « beaucoup », « pas du tout »,
« très bien », « bien », « assez bien »,
« médiocre » etc..., aux questions fermées. Et ils
répondent à celles ouvertes, par le biais de leurs expressions
personnelles et leurs propres perceptions des choses, comme la fait de dire
qu'est-ce que le tutorat pour eux, d'expliquer l'objectif du dispositif, ce
qu'ils ont apprécié le plus, les qualités de leur
tutrices, ainsi que leurs propositions pour améliorer le tutorat
davantage. Enfin, nous avons proposé aux tutrices un journal de bord,
pour qu'il soit investi également comme outil à valeur
qualitative permettant la vérification de la présence de
l'effet-tuteur.
l Les critères de rigueur scientifique :
Satisfaire les critères et les conditions de la
scientificité réside le souci de tout chercheur désireux
de traiter une problématique spécifique dans le cadre d'un
domaine précis. C'est le cas de notre travail de recherche qui porte sur
l'efficacité du tutorat dans le développement des
littéracies universitaires chez les étudiants de la
première année spécialité du français, au
niveau duquel on cherche avant tout de respecter l'exactitude scientifique, en
tenant compte que les critères de cette exactitude permettant de mettre
en évidence la qualité du travail, varient selon la posture
épistémologique du chercheur.
Les critères auxquelles on souhaite se conformer sont
principalement :
La crédibilité :
Vu qu'on vise surtout le fait de rapporter d'une
manière authentique et rigoureuse les faits vécus lors du
déroulement de l'expérience du tutorat, en toute justesse et
objectivité pour mettre en évidence le bien fondé de notre
travail. Pour satisfaire ce critère, nous avons eu recours aux
72
retours des sujets concernant la recherche, exprimés au
niveau du questionnaire et du journal de bord.
La transférabilité :
Un deuxième critère qui nous semble
nécessaire lors de la réalisation de notre travail, est celui de
la transférabilité, dans la mesure où les conclusions de
notre recherche peuvent avoir du sens dans différents contextes. On vise
alors le fait de fournir des analyses riches et des descriptions instructives
qui peuvent être réinvesties dans d'autres problématiques
et dans d'autres travaux. Au niveau de notre recherche, on a essayé de
décrire l'expérience d'une façon approfondie et
précise pour que les résultats et le processus suivi soit
suffisant et clair pour celui qui veut bien le réutiliser autrement dans
son propre milieu.
La fiabilité :
Un troisième critère qui réside important
dans toute recherche, est celui associé à la neutralité
des données et à la transparence du chercheur. Ce critère
est bel est bien la fiabilité, dans lequel « se trouve la
lucidité du chercheur à l'égard de ses jugements et la
reconnaissance de ceux-ci en tant qu'éléments influençant
ses analyses et interprétations (triangulation interne du chercheur)
» (Mucchielli, 2009, p.60). Donc, au niveau de toute recherche, le
chercheur doit mobiliser des mesures nécessaires pour témoigner
le fait que les résultats diffusés dans son travail sont issus
des données et non pas de ses propres intérêts, ni de ses
motivations personnelles. Pour que notre recherche soit déchargée
des préjugés et des représentations, nous avons
opté pour le journal de bord et le questionnaire, au niveau desquels
figurent les réflexions personnelles des participants.
L'équilibre :
Or les critères méthodologiques cités
à l'avance, s'ajoute un critère lié au relationnel, et qui
était élaboré par Guba et Lincoln (1989) pour faire
référence aux relations existantes entre les chercheurs et le
sujet. D'emblée, on site l'équilibre entre les points de vue des
différents acteurs de la recherche. Dans cette perspective, notre
travail de recherche a pris en compte, les points de vue des tutorés et
des tutrices, dans la mesure où ceux des tutorés ont
été exprimés par le biais du questionnaire
d'appréciation, et ceux des tutrices, à travers le journal de
bord. Grace à ceci, les tutrices et les tutorés ont parlé
de leur expérience d'une manière équitable, et leurs deux
voix ont été donc entendues. D'où, on pourrait
vérifier le respect de ce critère.
L'authenticité ontologique :
Le deuxième critère à mentionner est
celui de l'authenticité ontologique, qui cherche à
démontrer que les sujets ont pu développer leurs connaissances,
ainsi que leurs représentations concernant l'objet étudié.
Au niveau de notre recherche, les étudiants ont pu penser au tutorat
73
pour surmonter leurs difficultés et pour réussir
dans le contexte universitaire. On a eu leurs témoignages à
travers le questionnaire d'appréciation, qui attestent le fait qu'ils
ont pu développer leur compétence scripturale, d'où leur
niveau en littéracie universitaire.
1-2 La recherche action :
Comme la visée de notre travail, est principalement de
vérifier si le tutorat, comme méthode pédagogique,
permettrait l'installation des compétences littéraciques à
l'université marocaine, et favorisait l'émergence de
l'effet-tuteur, nous avons opté pour une recherche-action,
considérée comme un processus de résolution des
problèmes particulier. Déjà, Roulet en 1989 a
déconseillé le recours aux recherches individuelles
isolées et a insisté sur la nécessité de
préconiser celles collaboratives, car elles permettent une
interprétation judicieuse des résultats par la mise en oeuvre de,
la formulation, l'articulation et la validation expérimentale des
hypothèses. A son tour, Bazin, à affirmer que :
Il n'y a pas a priori de domaines et de problématiques
qui échappent à la recherche-action [dont] la faisabilité
n'est pas une question de contenu mais de processus. Elle ne peut émaner
que d'acteurs en mouvement, dans la conscience d'un état de recherche.
[...]Toute la force de la recherche-action réside dans son potentiel de
développement et de transformation. (Bazin, 2003-2007)
Et comme ajustement aux commandements de ces auteurs, nous
avons donc choisi la recherche-action, qui répond au besoin
d'améliorer des pratiques d'apprentissage, d'enseignement et
d'accompagnement grâce à plusieurs expériences permettant
l'enrichissement de la théorie.
D'un point de vue historique, le terme « recherche-action
» n'est pas récent, il est souvent renvoyé aux années
70, une période dans laquelle les sociétés étaient
tourmentées par des transformations d'une grande importance, pour
lesquels des générations de professionnels, d'éducation,
de santé, et du travail social, cherchaient de nouvelles visions du
monde. Elles étaient ambitionnées pour trouver celles qui mettent
en place les sciences humaines et sociales. Ces chercheurs vont alors avoir
recours à cette démarche collective, pour répondre aux
questions de recherche de leur époque comme nous le faisons aujourd'hui.
Toujours dans cette perspective historique, on ajoute que la recherche-action a
été principalement pilotée au début, par des
courants qui s'intéressent à l'analyse de la dynamique du groupe
au niveau des entreprises (approche psychosociale), puis, elle va être
menée par ceux qui traitent le fonctionnement des groupes dans une
perspective d'enseignement et d'apprentissage (sociologie de
l'éducation).
Comme première définition, on peut dire que la
recherche-action est une manifestation qui sert à réduire
l'écart entre les paradigmes scientifiques et la réalité
contemporaine, elle se
74
trouve au centre des problématiques qui visent le
progrès humain et social, dans divers domaines tels que
l'éducation, la santé, le travail social etc...Elle peut se
définir également comme étant « une expérience
délibérée initiée à une échelle
restreinte, sur un terrain institutionnel réel, dans une double
perspective de généralisation des acquis sur le plan des
connaissances et de transformation effective de la réalité
sociale » (Ardoino, 1977, p. 26), qui valorise l'autonomie des personnes
impliquées puisqu'elle « [...] est une activité de
compréhension et d'explication de la praxis des groupes sociaux par
eux-mêmes » (Barbier, 1977, p.109).
En fait :
Quand nous parlons de la recherche-action, nous entendons
« action-research », c'est-à-dire, une action au niveau
réaliste toujours suivie par une réflexion autocritique objective
et une évaluation des résultats(...) Nous ne voulons pas d'action
sans recherche, ni de recherche sans action » (Kurt Lewin, 1973, p.3),
donc nous sommes dans le cadre d'une recherche originale et singulière,
qui fait interagir l'explication et la compréhension de la situation,
l'implication des acteurs et le temps réel pour « [...] des
visées de production d'un savoir, de changement dans l'action et
d'éducation. (Jacques Rhéaume, 1982, p.44)
D'ailleurs, le point fort et puissant de la recherche-action
est bel est bien son discours, qui repose sur le raisonnement logique et sur
l'expérience concrète, pour formuler des réponses aux
problèmes sociaux complexes capables de produire un changement radical.
Quant à sa richesse, elle découle de la complexité de ses
situations, de la délicatesse de ses terrains, et de la
multiplicité des sujets qu'elle aborde. Ceci, ne doit pas laisser penser
à l'idée que, la recherche-action est une méthode
inapplicable et irréalisable. Il faut retenir que sa complexité
se manifeste dans la manière à travers laquelle elle
considère les situations humaines comme étant des systèmes
dynamiques capables d'évoluer, contrairement aux démarches
classique d'analyse, qui dissocie les éléments de la
situation.
La recherche-action insiste principalement sur l'importance de
mettre en place une expérimentation réelle, qui fait appel aux
liens approximatifs entre les sujets, afin de garantir une compréhension
intégrale. En effet, le point du départ de la recherche-action
est avant tout lié, à une sorte d'insatisfaction à
l'égard des problèmes pour lesquelles, on souhaite aller plus
loin. Concernant l'entrée en recherche-action, elle nécessite
tout d'abord, une atmosphère de travail propice aux échanges et
aux communications entre les intervenants.
Une autre condition s'avère cruciale pour mettre en
pratique la recherche-action, est le fait que les chercheurs et les praticiens
réunit en même temps, dans un même endroit, pour le
même objectif, doivent partager des valeurs comme : le volontariat, la
coopération, la responsabilité sociale et la démocratie
participative. Ils doivent donc absolument dépasser
l'intérêt individuel isolé pour mobiliser un autre qui sera
collectif. Ces intervenants sont invités
75
à croiser leurs perceptions et leurs capacités,
tout d'abord, pour réagir face aux exigences de la production des
connaissances. Ensuite, pour impacter le terrain représentatif des
besoins. Et enfin, pour profiter des bienfaits de ce type de recherche qui
produit une transformation pour tous.
En ce qui est l'évaluation de La recherche-action, il
faut mentionner qu'elle ne peut pas être évaluée comme les
autres projets dont la finalité est opérationnelle. Son
orientation expérimentale différente, ne peut être
examinée qu'à travers des pratiques concrètes.
On peut donc résumer la démarche de la
recherche-action, en trois axes majeurs :
1) La production des connaissances scientifiques : «
-recherche ».
2) Le changement ou la transformation de la
situation-problème : « -action ».
3) Le développement professionnel des chercheurs et des
praticiens. En ce qui concerne les raisons qui nous ont poussées
à suggérer la recherche-action, sont le
fait qu'elle:
l Se pratique dans « des milieux d'action humaine, comme
des milieux de travail ou d'éducation.
l Permet une implication ai niveau de l'action,
autrement-dit, elle garantit la présence du chercheur sur le terrain, et
le partage des espaces de recherche et de pratique.
l Répond à notre désir de fusionner
d'une manière réflexive la recherche et l'action pour mettre en
place des relations sociales enrichies. Et à notre envie
d'améliorer nos pratiques et nos compétences.
l Relie la recherche et le milieu :
La recherche-action, est une activité de
compréhension et d'explication de la praxis du milieu impliqué
(...). Elle cherche à aider le milieu impliqué à
identifier ses propres problèmes, à en réaliser une
analyse critique et à rechercher les solutions correspondantes(...). De
son côté, le client (milieu enquêté) ne demeure pas
passif, il s'implique dans les différentes étapes du processus de
la recherche : diagnostic, action, et évaluation. (Shelton et Laroque,
1981, p.4).
Il est important de mentionner que l'approche adoptée
dans la totalité de notre travail de recherche est une approche
empirico-inductive, dans la mesure où, on part de l'analyse de
l'expérience vers la construction de la théorie. Nous avons
tenté de respecté ce principe fondamental de la recherche-action,
par le fait d'effectuer dans un premier temps, l'expérience, de
recueillir ses données et de les analyser, pour remonter par la suite
vers la partie théorique, et la composée en fonction des axes et
des éléments qui figurent dans celle pratique.
Notre travail de recherche va donc répondre aux
principes de base de la recherche-action par le fait de fixer un
problème : les besoins des étudiants de la première
année en littéracie
76
universitaire du côté de l'écrit. Et la
modification du réel par le biais d'une solution ordonnée: le
tutorat. En définitive, la recherche-action reste l'approche
méthodologique souple, audible et incontournable pour les situations qui
visent un changement profond et qui ne peut pas être produit par le biais
des approches classiques.
Avant de se projeter davantage dans ce chapitre, il est
important de mentionner que l'approche adoptée dans la totalité
de notre travail de recherche est une approche empirico-inductive, qui consiste
à partir de l'analyse de l'expérience vers la construction de la
théorie. Nous avons tenté de respecté ce principe, par le
fait d'effectuer dans un premier temps, l'expérience, de recueillir ses
données et de les analyser, pour remonter par la suite vers la partie
théorique, et la composée en fonction des axes et des
éléments de la pratique.
? Les critères de la rigueur scientifique
pour la recherche-action :
La recherche-action fait partie du paradigme
pragmatico-intérprétatif, interprétatif car elle vise
à comprendre le sens que les acteurs donnent à leur
réalité, et pragmatique vu que le savoir, comme étant un
produit de la recherche a des implications pratiques et concrètes dans
la vie professionnelle de ces acteurs. Le rôle de cette recherche-action
est donc d'apporter des changements à un milieu professionnel, et pour
se faire il est important d'impliquer les acteurs dans la mesure où, ils
deviennent des Co chercheurs, comme le souligne Gauthier, qui indique, que la
recherche-action est une « modalité de recherche qui rend l'acteur
chercheur et qui fait du chercheur un acteur, qui oriente la recherche vers
l'action et qui ramène l'action vers des considérations de
recherche»( Gauthier, 1984, p.522). Dans la finalité de garantir
une amélioration dans la pratique des acteurs, la recherche-action,
adopte un processus méthodologique de résolution de
problèmes, basé sur la planification, l'observation et la
réflexion. A cet ensemble d'éléments, Savoie-Zajc (2001) a
mis en exergue d'autres nouveaux critères pour tenir compte des
spécifitées de la recherche-action.
Et ce sont ces critères qu'on a essayé de
respecter lors de notre recherche :
Le respect des valeurs et des principes
démocratiques :
Le critère du respect des valeurs et des principes
démocratiques, fait partie du groupe de critères relationnels qui
préconisent l'éthique des procédures. Ce critère
renvoie à la position du chercheur par rapport aux sujets (les Co
chercheurs) et à son travail qui consiste à garantir la
qualité des échanges, par exemple, en instaurant un climat de
travail qui favorise l'échange, l'interaction et la collaboration. Un
environnement qui garantit également les droits des participants, qui
leurs donnent la possibilité de s'exprimer librement et qui leurs
permettent de prendre des décisions concernant les différentes
phases de la recherche. Dans la même veine, on a essayé de
satisfaire ce critère lors de notre travail .D'une part à travers
la programmation
77
d'un dispositif du tutorat qui offre aux participants la
liberté d'expression. D'une autre part, par la mise en place d'un
questionnaire d'appréciation qui repose sur l'anonymat. Ce
critère va être également respecté lors de la
description des séances du tutorat, et quant à l'utilisation des
exercices d'application, ou des paragraphes que les tutorés ont
réalisés. Le point qui porte sur l'échange et la
collaboration était également respecté, vu que notre
expérience était surtout basée sur l'implication des
tutrices et des tutorés, et sur la relation d'aide et de soutien qui
était présente tout au long de l'expérience.
Dans le but de vérifier davantage le respect de ce
critère, on a suggéré le journal de bord des tutrices, qui
contient des informations et des données objectives liées au
déroulement des séances, et même on a eu recours aux
retours des tutorés produits après les séances
hebdomadaires.
La faisabilité :
Toujours dans l'ordre de l'éthique des
procédures, le critère de faisabilité renvoie à la
pertinence de la recherche-action, soit au niveau de la planification de
l'action, ou du choix de l'environnement, qui doivent garantir des
résultats satisfaisants, tout en surmontant les différents
contraintes et difficultés. Autrement dit, dans la recherche-action, les
solutions proposées pour résoudre le problème et
modifié l'action, doivent absolument être conformes avec le
milieu, puisque ça reste absurde de mettre en place une
problématique inappropriée avec le milieu et le contexte, ou de
proposer des solutions qui ne pourront pas être mises en oeuvre. L'enjeu
réside alors le fait de choisir une problématique
appropriée, et d'offrir solutions fidèles et adéquates au
milieu. Dans le cadre de notre recherche, on a choisi la problématique
des littéracies universitaires conforme avec le milieu des études
supérieures, on a également prôné le tutorat pour
développer cette littéracie, tout en adaptant ce dispositif avec
les particularités du milieu. Sous-titre d'exemple, on a fait appel au
tutorat à distance vu l'indisponibilité des salles à
l'ENS, vu le fait que les tutrices ne sont pas sur place, et même aussi
parce que les tutorés ont un emploi chargé par des séances
d'études essentielles, sans oublier la période de
l'expérience qui était durant le mois de ramadan. Donc
automatiquement la programmation du tutorat était selon les conditions
et la faisabilité, dans la mesure où, les séances
étaient planifier en fonction des propositions des apprenants
(travailler pendant le week-end et le choix des horaires était fait
selon leur demande, dans le but d'augmenter un taux de participation
élevé, choisir les contenus diffusés en fonction des
besoins des apprenants, développer les exercices d'application en
conformité avec les cours travaillés). Ce sont toutes des mesures
qui doivent se présentent pour répondre au critère de
faisabilité.
78
L'appropriation :
Le critère d'appropriation insiste sur l'importance
d'engager les acteurs et de s'assurer qu'ils poursuivent le processus
initié par la recherche. Ce critère renvoi également
à l'importance de consolider les connaissances des sujets et la
nécessité d'accompagner le développement de leurs
pratiques, vu que la finalité de la recherche-action demeure avant tout,
la production d'un changement durable et une transformation permanente au
niveau de pratiques professionnelles des sujets. Pour associer ce
critère avec notre travail, nous avons visé le
développement des littéracies universitaires surtout du
côté de l'écrit chez les étudiants et les amener
à progresser à ce niveau d'une manière immuable durant
leur vie personnelle et professionnelle.
La cohérence systémique :
Le critère de la cohérence systémique
s'ajoute aux critères méthodologiques et fait
référence à la cohérence de la démarche de
recherche, ainsi qu'à la rigueur de la collecte et de l'analyse des
données et des résultats. On peut dire que cette condition de la
recherche-action se rapproche à celle de crédibilité,
puisque les deux préconisent les descriptions riches, minutieuses et
approfondies du processus. Déjà ce caractère de
cohérence systémique est considéré comme
étant l'implantation de la recherche-action car il vise la
cohérence de la méthodologie avec les objectifs centrés,
dans notre cas, le développement des littéracies universitaires
doit faire appel à un dispositif capable d'assurer ce
développement. Ce dispositif peut être bel et bien le tutorat. On
peut résumer cette partie consacrée aux critères propres
à la recherche-action par le fait que cette dernière,
représente un processus enchevêtré qui implique
l'interaction des sujets et le changement de leur action, et qui
nécessite le respect de plusieurs critères qui peuvent être
résumés sous l'angle de trois composantes majeures, qui sont : le
savoir, le pouvoir et le vouloir (Pourtois, Desmet et Humbeeck, 2013) :
l La production d'un savoir valide (les
critères de fiabilité, de crédibilité et de
transférabilité).
l Le partage du pouvoir au niveau de la
recherche à la base du respect et de l'implication de l'autre (le
critère d'équilibre et du respect des valeurs et des principes
démocratiques).
l Le vouloir d'agir pour instaurer un
progrès long termite de la pratique professionnelle (les critères
d'authenticité ontologiques, de faisabilité et
d'appropriation).
1-3 les instruments de collecte de données :
1-3-1) Le questionnaire :
Les enquêtes de satisfaction ou d'appréciation
tiennent une place primordiale dans la gestion de la qualité et de la
pertinence d'un programme ou d'un service. Ils sont d'une grande importance
également, concernant le fait d'apporter des améliorations aux
prestations offertes.
79
Le questionnaire d'appréciation qu'on a proposé
sera donc l'outil de notre collecte des données concernant la pertinence
du tutorat auprès des tutorés.
1-3-2) le journal de bord :
Comme notre recherche tente de s'assurer de la présence
de l'effet-tuteur dans la pratique des tutrices, nous avons
suggéré le journal de bord comme instrument permettant la
collecte des données qui se rapporte à ce
phénomène. Ce journal de bord va être le conservateur des
propos des tutrices qui relatent leur expérience du tutorat pour mettre
en exergue ce qu'elles ont pu tirer de cette action d'aide et
d'accompagnement.
2- Expérimentation du tutorat : 2-1 Terrain
d'études :
Nous avons mis en pratique notre expérimentation au
sein de l'école normale supérieure de Meknès.
2-2 Motivation du choix :
Nous avons opté pour le choix d'ENS Meknès afin
de mettre en pratique notre investigation pour les raisons suivantes :
D'une part, le fait que notre encadrante prend en charge des
classes de licence dans cet établissement va nous faciliter la
réalisation de notre expérience. Et d'une autre part, les tuteurs
et les tutorés qui vont participer à titre bénévole
dans cette action tutorale sont des étudiants de l'ENS Meknès. Ce
choix réside donc logique et pertinent.
2-3 Présentation d'ENS Meknès :
L'Ecole Normale Supérieure de Meknès est un
établissement d'enseignement supérieur qui a été
créée en 1983. Elle a commencé sa mission éducative
à partir de l'année universitaire (1983-1984) avec la
création du cycle de formation des professeurs de l'enseignement
secondaire de français dans le cadre du Département de Langue
française. Par la suite, l'ENS a connu l'instauration d'un autre
département est celui de la langue arabe, dans l'année
universitaire (1984-1985). D'autres départements vont voir le jour
après, plus précisément au cours de la deuxième
moitié des années quatre-vingts, et qui sont : les Sciences de
l'Education, les Etudes Islamiques et la Traduction. L'Ecole va renforcer
davantage son offre de formation par l'ouverture du Département de
Philosophie en 1995.
80
Depuis sa création et jusqu'à l'année
universitaire (2010-2011), l'ENS de Meknès à amener à la
consolidation des compétences pédagogiques du personnel de
l'enseignement secondaire dans diverses disciplines.
A côté de sa participation à la formation
des enseignants spécialisés, l'ENS de Meknès a
contribué à l'élaboration et à l'enrichissement des
programmes de formation continue au niveau du secteur de l'Education Nationale
dans la ville de Meknès et sa région.
Depuis son transfert à l'Université de Moulay
Ismail en 2010, en vertu de la loi 08 - 47, l'ENS de Meknès s'est
fortement engagée dans le système de formation et de recherche de
l'enseignement supérieur en tant qu'établissement à
accès régulé. Cet engagement s'est
concrétisé par l'instauration des licences professionnelles, des
masters et des masters spécialisés en langues,
littératures, philosophie et sciences humaines, qui offrent une
ouverture sur l'environnement socioculturel.
2-4 Présentation de l'expérience
:
Les nouveaux bacheliers quittent leurs établissements
d'origine pour entrer dans l'enseignement supérieur, au niveau duquel,
ils se trouvent confrontés à un contexte d'études et
à un mode de vie diamétralement opposés à ceux du
secondaire. On trouve que« Les moins motivés des étudiants,
ou les plus fragiles, abandonnent immédiatement parce qu'ils ne peuvent
pas vivre dans ce tourment permanent » (Coulon, 1997, p. 147). Devant
cette situation et dans le but de garantir une poursuite d'études
supérieures réussite, l'objectif réside d'une part la
nécessité, de trouver une solution pour atténuer le taux
d'abandon au sein de l'université, et d'une autre part, l'importance de
suggérer des propositions permettant de garantir l'intégration et
l'adaptation des étudiants avec le nouveau contexte. La totalité
est alors inscrite dont le but est d'accompagner en vue de favoriser la
réussite des étudiants.
Tout au long de leur parcours universitaire, les
étudiants en formation à l'enseignement, sont appelés
à lire et à produire des écrits variés à
plusieurs finalités. En particulier, ils doivent rédiger
différents textes, parmi lesquelles on trouve souvent : l'analyse, la
synthèse, le résumé, le compte-rendu etc... Et donc pour
être en mesure de les réaliser d'une manière
appropriée, il est nécessaire que les étudiants
reconnaissent les caractéristiques grammaticales et textuelles de ces
écrits. Le travail sur ces caractéristiques doit être fait
et développé tout au long du cursus universitaire. C'est pour
cette raison que nous avons trouvé judicieux de de renforcer cet aspect
à travers la mise en place des pratiques et des mesures visant
l'accompagnement de l'appropriation des écrits universitaires pour les
étudiants ayant besoin. L'enjeu est donc le fait d'administrer des
solutions qui assurent le suivi des étudiants de la première
année, et qui visent
81
également le renforcement de leur engagement
vis-à-vis de leurs études, à travers la contribution au
développement de leur niveau en écriture, composante majeure de
la littéracie universitaire, et élément central pour
lutter contre l'abandon dans l'enseignement supérieur. En somme, «
envisager des réponses aux abondants permettraient de ne plus les
considérer comme des échecs, mais d'envisager au contraire des
poursuites aux cursus commencés, pouvait inaugurer de nouvelles
modalités de formation ou d'insertion » (Beaupère et
Boudesseul, 2009, p .197).
Doter les étudiants d'un certain savoir par rapport aux
compétences littéraciques à l'université et leurs
permettre de surmonter leurs difficultés en vue d'atteindre une
amélioration favorable des apprentissages, est le défi qui nous
occupe en tant que chercheurs en domaine de la didactique et de la
pédagogie dans une sphère de la discipline du français. Ce
défi tire sa valeur essentiellement, de l'attention accordée
actuellement à la notion de l'écrit et des littéracies
universitaires auprès des professionnels, des chercheurs, et des
décideurs du monde éducatif et politique.
On a centré notre préoccupation concernant les
littéracies universitaire, du côté de l'écrit vu
que, la maitrise du français écrit représente un fardeau
pour les primo-entrants qui n'arrivent pas à atteindre un niveau
suffisant pour la passation des examens écrits importants pour
l'obtention des diplômes. D'où, il nous semble nécessaire
d'agir dans le but de développer le niveau de l'enseignement
supérieur, à travers le renforcement du niveau de la
compétence scripturale, considérée comme étant un
critère de la réussite universitaire. Pour répondre
à ce besoin littéracique, et comme forme de remédiation
possible, nous avons choisi d'introniser « le tutorat », une
tentative originale et un dispositif d'expérimentation qui va être
placé au centre de notre investigation. Il est important de souligner
que ce choix ne peut pas faire l'objet d'une généralisation, car,
il revient à chaque université ou à chaque
établissement de sélectionner le dispositif conforme aux besoins
de ses étudiants. Nous avons opté pour la méthode
tutorale, tout en prenant en considération les contraintes et les
exigences de l'enseignement supérieur. Le recours au tutorat comme
dispositif axé pour faciliter l'entrée à la
littéracie universitaire, est d'abord, puisqu'il est une sorte aide
efficace qui facilite l'intégration institutionnelle ». Ensuite,
car ce dispositif est capable de répondre aux besoins spécifiques
des étudiants en matière d'écrit rentable, et de les
permettre d'échanger d'interagir, de communiquer, et d'apprendre. Le
choix du tutorat était aussi parce qu'il est une expérience
anticipée du métier d'enseignement et de l'éducation, qui
va aider l'étudiant-tuteur qui souhaite être un futur enseignant,
à développer ses compétences et à approfondir ses
connaissances, dans cette veine en reprenant alors ce que les anglo-saxons ont
l'habitude de dire « qu'enseigner, c'est apprendre pour une seconde fois
»,
82
donc les séances du tutorat vont être porteuses
d'atouts et d'opportunités pour les tuteurs également, qui vont
avoir l'opportunité de se familiariser avec les fonctions des
enseignants.
L'hypothèse que nous avons fixé pour notre
investigation est que, si d'une part, les étudiants universitaires
inscrits dans le programme tutoral, ont développé leur niveau en
compétence écrite, et d'une autre part, les
étudiants-tuteurs ont pu tirer profit de leur fonction d'accompagnement,
est que le tutorat comme mesure d'aide mise en place est efficace pour
favoriser l'entrée des étudiants en littéracie
universitaire et pour émerger l'effet-tuteur.
Notre idée de base, est donc un programme
expérimental du tutorat destiné aux étudiants de la
première année licence, département du français qui
débutent leur cursus avec de sérieux problèmes en
écriture. A l'échelle de cette expérimentation, le
dispositif pyramidal « le tutorat » fait entrer en lice enseignants,
tuteurs et tutorés dans la même synergie.
Pour la mise en place de notre dispositif du tutorat, nous
avons eu référence aux propos de Narcy-Combes J-P, qui soulignent
l'importance de prendre en considération le contexte de production, et
son impact sur la construction du savoir. Dans notre cas, nous étions
chanceux car notre objet de recherche est adéquat avec le contexte, dans
la mesure où notre encadrante l'a encouragé, vu sa
déception face au niveau de ses étudiants en écriture
universitaire. Grace à ces paramètres, nous avons eu
l'opportunité de travailler avec un groupe d'étudiant d'ENS
Meknès dans le dessein de : fournir un accompagnement renforce à
ces derniers au niveau des études supérieures qu'ils ont choisi
d'entreprendre, réparer leurs lacunes et insuffisances, stimuler leur
attention pour qu'ils retrouvent le sens de l'éducation, et finalement,
valoriser les ressources humaines volontaires engagées dans ce
programme.
2-5 Les objectifs de l'expérimentation
:
Vu que tout échec ou blocage momentané peut
être rectifié et modifié, notre projet est de mener
à bien un dispositif d'encadrement des pratiques d'écriture
à l'université, pour un public cible ayant de véritables
difficultés en écriture. Pour passer d'un paradigme
d'enseignement à celui d'apprentissage, on cherche à:
+ Identifier les besoins des étudiants en termes de
littéracie universitaire.
+ Comprendre les origines et les sources des lacunes
identifiées.
+Appliquer le tutorat pour doter les apprenants des
compétences littéraciques, surtout en matière de
l'écrit.
+Vérifier le bienfondé du tutorat pour valider
sa pertinence du côté des tuteurs (l'effet-tuteur) et des
tutorés (l'effet-tutoré).
83
2-6 Echantillon de référence :
Comme il y a peu de recherches et d'expériences par
rapport à l'application du tutorat dans le contexte universitaire au
Maroc, et vu que notre objectif s'articule autour de l'introduction du tutorat
à l'université, nous avons permis à 32 étudiants,
de la première cycle licence, de bénéficier de cette
action tutorale. Qui va forger cinq fonctions chevauchantes dans une
visée éducative: Le diagnostic, la planification de l'action, la
réalisation de l'action, la vérification de l'action et
l'identification des apprentissages réalisés.
2-7 La description de la mise en place et du
déroulement de l'expérimentation (le tutorat):
Au niveau du programme du tutorat proposé pour faire
l'expérience, nous avons essayé de respecter les conditions
nécessaires pour garantir une implémentation réussite de
ce dispositif.
D'emblée, commençant par la période du
déroulement du tutorat, qui pour donner les résultats
souhaités, ne doit être ni trop tôt, nit trop tard. Nous
avons choisi alors, le début du deuxième semestre, vu que c'est
une période qui ne sera pas interrompue par les vacances, donc on va
éviter les possibles déficits en termes d'apprentissages et on va
de même garantir une continuité dans le programme qui favorise
davantage sa réussite. Le choix de cette période était
également, car elle se situe après les examens du premier
semestre, donc les étudiants ont été informés par
rapport à leurs résultats, chose qui va leurs permettre de se
positionner face à leurs difficultés, afin de trouver des
solutions pertinentes pour les surmonter. Ensuite, nous avons estimé que
la suggestion de cette période est adéquate avec la forme du
tutorat qu'on souhaite appliqué, « le tutorat d'accompagnement
» qui consiste à renforcer et à soutenir les
étudiants dans leur travail au cours du semestre pour réussir
leur examens et valider leur première année à
l'université. Par rapport au calendrier du tutorat, les jours et les
horaires des sessions, nous avons opté pour des séances
programmées à la fin de la semaine, durant les week-ends suite
à la demande des tutorés et des tutrices, qui ont
préférer cette proposition vu la surcharge de leur emploi du
temps. Ces derniers ont trouvé que cette possibilité va leur
offrir plus de chance pour participer à ce dispositif :
Tutrice 1 : « On a opté pour des séances
durant le week-end et on s'est mis d'accord sur des horaires convenables pour
tous les membres du groupe, dans le but de garantir d'avantage leur
84
présence. Les tutorés ont choisi de faire la
séance à 17h samedi, et de la commencer à 12h dimanche
».
Tutrice 2 : « L'horaire était choisi selon un
consentement commun et en prenant en considération la
disponibilité des participantes. Les tutorées ont choisi de
commencer les séances à 20h ».
Tutrice 3 : « Le choix de l'heure de travail était
fait par les tutorées. Nous avons fixé un horaire compatible
à tout le monde. On s'est mis d'accord sur le travail durant le week-end
à 11h du matin, une heure où toutes les tutorées seront
disponibles et beaucoup plus mieux concentrées ». Tutrice 4 :
« On a pu fixer tous ensemble les horaires de différentes
séances du tutorat, les weekends à 12h30min ».
Tutrice 5 : « L'horaire était choisi selon un
consentement commun et en prenant en considération la
disponibilité des participantes. Les tutorées ont choisi de
commencer les séances à 20h chaque week-ends ».
Il est important de mentionner que les propos des tutrices que
nous avons utilisé, étaient sous-forme des enregistrements audio
de la première séance de rencontre et de sensibilisation, pour
lesquels nous avons effectué un travail de transcription.
Nous avons pensé que suite au choix d'une telle
période, les étudiants vont montrer un certain
intérêt envers le dispositif proposé, et ils vont choisir
la participation au niveau de ce dernier. Concernant la modalité du
tutorat choisi, nous avons eu recourt au tutorat à distance, tout
d'abord, vu que la majorité des tutrices engagées dans l'action
tutorale n'habitent pas à la ville de Meknès. Ensuite, ce choix
était également dans le but d'encourager les tutorés
à s'inscrire au niveau des sessions proposées, sachant que la
majorité à exprimer sa préférence pour le
distanciel, vu le programme d'étude chargé et la coïncidence
de l'expérience avec le mois sacré du ramadan. Enfin, nous nous
sommes trouvés en obligation de se prononcer pour ce mode de diffusion,
vu le problème de disponibilité des salles à l'ENS
Meknès. Par cette suggestion, nous avons fait preuve d'organisation d'un
dispositif à basé sur les ressources disponibles et adapté
en fonction des sujets participants.
Ce tutorat à distance va être
réalisé à travers le de recours à un outil
informatique disponible pour tous les participants. Après leurs poser
question, ils ont suggéré la plateforme de messagerie
instantanée « WhatsApp ». Les tutrices également
étaient d'accord avec ce choix, d'où nous avons
préconisé « WhatsApp » pour garantir la participation
de la plupart des tutorés, même ceux qui n'ont pas accès
à une bonne connexion internet, et pour qui on souhaite offrir la
même qualité du service des technologies tels que Zoom ou Teams,
mais sans avoir besoin d'un haut débit. Déjà «
WhatsApp suscite de plus en plus l'intérêt du corps enseignant
comme
85
plateforme facilitant la mise en place de situations
d'enseignement-apprentissage à distance et la continuité
pédagogique » (Bouhnik et Deshen, 2014 ; Dounla, 2022, p.61-73), vu
que « c'est un réseau connu par sa gratuité, sa faible
consommation de bande passante et sa facilité d'accès sur les
dispositifs mobiles favorisent son usage croissant à des fins
éducatives » (Dounla, 2022, p.61-73). Et donc, plus la demande et
le choix effectué par les tutrices et les tutorés concernant le
recours à «WhatsApp » dans une visée éducative,
nous avons opté pour cette application grâce à la place
importante qu'elle occupe et qui était confirmé par plusieurs
spécialistes, qui voient en cette dernière la garant de :
- « Accès facilité aux ressources
pédagogiques et communications instantanées entre les personnes
enseignantes et étudiantes ; ouverture à l'apprentissage
collaboratif en raison de son affordance sociale » (Adjanohoun et
Agbanglanon, 2022, p.7-24).
- « Possibilité de créer des
communautés virtuelles d'apprentissage, de partage et de Co-construction
de connaissances » (Huitt et Monetti, 2017, p.43-65).
- « Facilité de partage de liens vers des contenus
disciplinaires et des possibilités de rétroaction
immédiate de la part du personnel enseignant » (Bouhnik et Deshen,
2014, p.217-231).
- « Opportunités de tutorat et d'accompagnement
des étudiantes et étudiants en ligne » (Dounla, 2022,
p.61-73).
- « Ouverture à l'apprentissage hybride
intégrant des pratiques formelles et informelles » (Messaoui, 2020,
p.14).
On a pu alors utiliser ce réseau social souvent
employé dans un contexte social et informel, pour diffuser un contenu
éducatif dans un cadre d'apprentissage formel.
Par rapport à l'environnement conçu pour
appliquer le tutorat, nous avons mis en place un dispositif orienté vers
l'accompagnement des étudiants de la première année, qui
met en relation diverses logiques et postures d'intervention : Une posture
dialogique, qui repose sur le fait que les savoirs diffusés en cours
d'action se font à la base des échanges entre tuteurs et
tutorés. Et une posture spéculative, qui consiste à
encourager le sentiment d'auto-efficacité et de confiance en soi chez
les étudiants, appréciable pour mettre en oeuvre des savoirs et
des contenus d'apprentissage. Ce climat de travail, répond aux exigences
de l'environnement propice du tutorat, qui repose essentiellement sur la
coopération entre les acteurs du dispositif, et sur l'autonomie du
tutoré, pour se distinguer des cours d'enseignement magistrales
habituels.
De ce qui est les formules proposées aux
étudiants universitaires en formation à l'enseignement, elles
sont des cours d'approfondissement et d'explication de matière
disciplinaire, qui portent principalement sur la reformulation des
réponses, les règles
86
syntaxiques, lexicales, orthographiques et grammaticales. La
planification des séances autour de ces cours était, dans le but
de répondre à un élément important de toute formule
tutorale, qui est la nécessité de proposer des contenus
adéquats avec les besoins des étudiants. Le choix de notre
contenu n'était pas donc dû au hasard, au contraire, il
résulte de l'observation, l'analyse et la correction des copies du test
diagnostic proposé aux étudiants avant le début du
tutorat, qui avait pour but le fait d'identifier et de cerner leurs besoins.
Ces cours vont conduire les tutorés au respect des normes
langagières primordiales, prises en considération chez tous les
évaluateurs qui attendent que les apprenants produisent des
écrits bien structurés, corrects, cohérents et
cohésifs.
A côté des contenus des cours, on va mettre
à la disposition des tutorés des tâches porteuses de sens,
comme des exercices d'application et des textes orientés vers l'objectif
fixé, dans le but de montrer des améliorations notables en
matière d'écriture et de témoigner un degré d'essor
en termes de littéracie universitaire. Les textes choisis pour mesurer
la pertinence du tutorat et pour dégager l'effet-tutoré sont des
textes courts et simples qui garantissent un taux de réponse notable et
une implication considérable de côté des tutorés.
Les contenus et les exercices vont être communs, mais il
revient à chaque tutrice la liberté de préparer ses
outils, d'aménager le matériel didactique qui lui semble
pertinent et de mobiliser les stratégies et les méthodes
efficaces pour transmettre le cours prévu. On insiste toujours sur
l'autonomie et l'indépendance. La diffusion de ces contenus de cours,
s'effectue au sein des petits groupes de travail. Un choix commode avec le
principe qui différencie le tutorat du monitorat, et qui consiste
à accompagner un groupe restreint de tutorés. Ce choix
répond à une simple équation : moins qu'il y a
d'étudiants à aider, plus l'assistance et le soutien produits
gagnent du terrain et apportent des bénéfices notables.
Cependant, nous n'avons pas pensé à la forme individuelle du
tutorat, car au niveau de cette dernière, le tutoré voit en son
tuteur, un expert de la discipline, chose qui contribue à un attachement
de celui-ci à celui-là. C'est-à-dire, qu'au niveau du
tutorat individuel, le tutoré n'arrive pas à agir ou à
accomplir la tâche qui lui a été demandée sans la
présence de son tuteur, il n'est pas autonome, ni capable pour
réaliser son travail. Cet aspect est connu sous l'appellation de «
la dépendance au tuteur » (Baudrit, 1997, p.30), au sein des petits
groupes un tel risque est moins probable, car le tuteur doit s'occuper de
l'ensemble du groupe, doit partager ses interventions et ses idées avec
tout le monde, d'où il se trouve moins enclin à rendre une
personne inhérente à lui. Sous-titre d'exemple, dans notre cas,
la tutrice va travailler avec l'ensemble du groupe dans le but de provoquer
chez eux une réflexion optimale vis-à-vis du fonctionnement de la
langue, nécessaire pour toute production de textes. Donc, faire appel
aux petits groupes de travail, se rapporte à la
87
théorie socioconstructiviste qui insiste sur la
dimension sociale pour rendre l'apprentissage efficace et puissant, et qui met
en avant « l'importance du dialogue et de l'argumentation entre pairs dans
la construction des connaissances de l'apprenant. Elle met en pratique les
vertus du « peer teaching », du « peer learning », et de la
résolution des problèmes.
Il est important de mentionner que les contenus des
séances ont été discutés au préalable avec
l'enseignante et avec l'ensemble des tutrices, dans le but de mettre en place
un cours commun admettant de réduire la marge des fausses routes. Ceci
montre, le fait que notre dispositif interpelle l'engagement des acteurs
pédagogiques.
Quant à la participation au niveau de ces sessions,
elle est à titre volontaire et à libre-accès, pour les
tutrices comme pour les tutorés. L'insistance sur le volontariat est une
sorte de prise en considération des principes fondamentaux du tutorat,
elle présente l'aspect de base de sélection et de recrutement des
tutorés, dans la mesure où, c'est l'étudiant qui prend
librement la décision de participer au dispositif, c'est lui qui oriente
la planification et la réalisation de ses objectifs d'apprentissage, car
au niveau de tel dispositif, le tuteur proposait mais n'exigeait rien, il
attend toujours que les étudiants lui déclare ce qu'ils veulent
faire, ou ce qu'ils souhaitent travaillés davantage.
Le volontariat est également l'origine du choix des
tutrices, qui se proposent sans aucune obligation, ni pression pour aider les
tutorés et les accompagner. Au sujet des tutrices engagées au
sein du tutorat, nous avons pris en considération les critères du
choix du bon tuteur, dans la mesure où, les tutrices choisies
âgées de 22-23 ans, adoptent une posture de
tutrice-étudiante, capable de garantir davantage le progrès des
élèves. Un étudiant est donc le plus qualifié pour
être le tuteur d'un autre étudiant, vu qu'un tuteur passé
par là, peut mieux se mettre à la place du tutoré pour
comprendre ses difficultés et proposer des solutions pour l'aider
à les paliers. Ce tuteur-étudiant va lui permettre de maintenir
des relations avec lui, pour mieux faciliter la tâche de rectification et
de régénération des habiletés de cet apprenant en
littéracie universitaire. Toujours dans le cadre du choix des tutrices,
nous avons cherché à part le paramètre d'âge, des
tutrices prêtes à aider l'autre, à l'encourager, à
le motiver et à l'accompagner. Nous avons également
insisté sur le fait que ces tutrices trouvent absolument
l'équilibre entre leurs interventions et celles du tutoré.
Pourtant, nous n'avons pas exigé un niveau d'expertise
accéléré dans la désignation de ces tutrices, pour
leurs permettre de profiter à leur tour du tutorat, d'où la
référence à l'idée du « Learning Through
Teaching » ou apprendre en enseignant, connue en Europe sous l'appellation
d'effet-tuteur.
Il est important de mentionner que les tutrices inscrites dans
le programme tutoral, n'ont bénéficié d'aucune formation.
Le fait d'opter pour ce choix est tout d'abord, dans le but de se
88
conformer aux conditions de choix des tuteurs, qui consistent
à engager des tuteurs qui n'ont pas un statut professionnel
d'enseignement et d'éducation. Et ensuite, parce que nous avons
pensé que doter une personne prête à aider et à
accompagner volontairement des étudiants, d'autres connaissances, risque
à perdre l'éventuel naturel positif qui existe chez eux. Une
formation peut conduire à une sorte de désorientation, de
transformation, ou de professionnalisation. C'est pour cette raison, que les
compétences, les capacités, ainsi que les habiletés des
tuteurs doivent rester en dehors de n'importe quelle formation.
Au nombre de 32, sont donc les étudiants aidés
par les tutrices deux fois par semaine, pendant cinq semaines. Les groupes de
travail sont constitués de quatre tutorés, pris en charge par une
tutrice qui suit le même cursus universitaire que ces derniers.
Les étudiants se présentent donc avec plusieurs
besoins et s'adressent à la tutrice pour combler les erreurs
récurrentes repérées au niveau du test diagnostique, non
noté. (Le test diagnostique, annexe 5) et (la liste des lacunes
annexe2).
Le dispositif du tutorat proposé va se dérouler
dans une visée éducative et selon cinq fonctions chevauchantes,
qui sont : Le diagnostic, la planification de l'action, la réalisation
de l'action, la vérification de l'action et l'identification des
apprentissages réalisés.
Cette évaluation diagnostique était la
première étape du tutorat, envisagée pour repérer
les difficultés et les problèmes des étudiants, et prendre
les décisions nécessaires permettant la facilitation de
l'enseignement et de l'appropriation.
Après le fait de diagnostiquer les besoins des
étudiants et avant le début de la diffusion des cours, les
tutrices vont être renseignées par rapport au public, à la
constitution du groupe, à la répartition des séances et
des heures de travail. Elles sont appelées donc à mettre en place
leur bonne volonté, leur motivation, leur capacité
d'écoute, leur aisance disciplinaire, leur maitrise du contenu et leur
expérience personnelle d'étudiante, pour les investir dans le
cadre du tutorat d'accompagnement.
Les ateliers du tutorat vont s'étaler sur une
durée d'une heure, et vont être diffusées par le canal de
l'application de la messagerie instantanée « WhatsApp ».
La première séance du tutorat était
consacrée à l'accueil et à la sensibilisation, au niveau
de laquelle les tutrices se présentaient devant leurs groupe de
tutorés, pour faire connaissance avec eux, pour partager leurs propre
expérience estudiantine, pour les convaincre des bienfaits de
l'éducation et de l'intérêt d'assister aux cours et de
suivre l'enseignant. De même, les tutorés se présentent
chacun à son tour, pour faire connaissance avec leur tutrice ainsi que
le groupe dans lequel, ils vont suivre les séances du tutorat. Le but
central était de créer une certaine proximité et une
familiarisation entres les sujets impliqués. Cette discussion sert
pareillement à
89
expliquer le fonctionnement du tutorat d'accompagnement,
à évoquer les informations principales qui se rapportent à
ce type à savoir : ses objectifs, son déroulement etc... Et
même, c'était l'occasion pour diffuser des mots sur la
littéracie universitaire et la place cruciale qu'elle occupe.
Après l'intervention des tutrices, les tutorés ont eu le temps
pour poser des questions sur les aspects qui leurs semblent flous, et d'avoir
plus de clarification de la part des tutrices. En gros, les interrogations
formulées ont étaient les suivantes :
Tutoré 1 : « est-ce-que le tutorat va être
considéré dans la note générale du semestre ?
»
4 Réponse de la tutrice 1 : « non ce tutorat est
une sorte d'accompagnement qui ne sera pas noté, mais qui va vous
être utile pour que vous puissiez écrire d'une manière
correcte davantage, surtout dans vous examens qui seront notés bien
évidemment ».
Tutoré 2 : « est-ce que dans les séances
du tutorat on peut avoir des informations sur la formation du master ?
»
4 Réponse de la tutrice 2 : « bien sûr,
dans le cadre du tutorat nous sommes à votre disposition, et on va
répondre à toutes vos questions, quelle que soit celles relatives
au contenu disciplinaire, ou bien d'autres qui se rapportent aux choix de
carrière, aux orientations après la licence, aux modules
enseignés dans les prochaines semestres, aux stages et aux projets de
fin de formation etc... Il suffit que vous notiez vous questions, auxquelles on
va répondre vers la fin de chaque séance ».
Tutoré 3 : « est-ce que je peux rejoindre un
autre groupe du tutorat, ou bien je suis obligée de rester dans celui-ci
? »
4 Réponse de la tutrice 3 : « dans le cadre de
tutorat rien n'est obligatoire, notre mission est de vous amener à
progresser toute en tenant compte de votre liberté. Bien sûr, tu
peux changer de groupe si ton emploi du temps est conforme avec celui de
l'autre groupe. Vers la fin de la session des questions/réponses, on va
voir avec les membres de l'autre groupe, si quelqu'un souhaite te donner sa
place et sera d'accord de rejoindre ton groupe sans problème ».
Tutoré 4 : « j'ai des choses à faire ce
weekend, pouvez-vous changer l'heure du travail pour moi ? »
4 Réponse de la tutrice 4 : « les heures du
travail au niveau du tutorat sont adaptées en fonction de votre choix et
de votre disponibilité, on va négocier ceci avec l'ensemble du
groupe pour se mettre d'accord sur une heure qui sera convenable pour tout le
monde, comme ça tu pourras terminer ton travail sans rater ta
séance ».
Les propos des tutrices et des tutorés ont
été avancés sous formes des enregistrements audio, dans
différents groupes du tutorat au niveau de la première
séance de rencontre et de
90
sensibilisation, et pour les utiliser d'une manière
concrète, nous avons effectué un travail de transcription.
Vers la fin de cette première séance, les
tutrices ont demandé à leurs tutorés de formuler un petit
mot, dans le but de mesurer leur satisfaction vis-à-vis de l'idée
du dispositif et à tel point ils veulent participer à ce
dernier.
Cette première rencontre entre les protagonistes du
tutorat était donc la clé d'accès à
l'expérience, au niveau de laquelle les tutrices ont eu la chance
d'encourager les étudiants, de les convaincre des bienfaits du tutorat
et de les pousser à participer à ce dispositif. De même,
les tutorés ont profité de cette expérience, ils ont eu
des réponses à leurs questions grâce au contact avec les
anciens étudiants, ils ont pu également lever le voile sur les
points ambiguës qu'ils avaient concernant le tutorat et la
littéracie universitaire.
Concernant les séances qui suivent, elles vont se
dérouler selon trois temps clés : D'abord, les étudiants
vont bénéficier d'un cours portant sur l'une de leurs
difficultés, qui sera présenté et expliqué par la
tutrice. Ce cours va être construit en fonction des interactions des
tutorés. Ensuite, ils seront appelés à corriger ces
paragraphes collectivement à la base de ce qu'ils ont appris dans le
cours, et à échanger leurs points de vue sur ces
rédactions dans le but de renforcer davantage l'appropriation. Enfin, au
bout de la semaine, c'est-à-dire après les deux séances
hebdomadaire, les tutorés sont appelés à faire le
récapitulatif de ce qu'ils ont appris, pour annoncer par la suite des
prévisions pour la séance à venir. Par la suite, la
tutrice va mettre à la disposition de ces tutorés des textes qui
contiennent des erreurs liées au contenu des cours qu'ils ont
travaillés. Les étudiants doivent corrigés ces textes et
les réécrire tout en respectant la correction de la langue. Cet
exercice proposé est comme une sorte d'évaluation formative, qui
permet à la tutrice d'examiner sa prestation et celle de ces
tutorés, dans la finalité de se positionner face au dispositif et
de le modifier en cas de besoin. Les réponses des tutorés aux
textes figurent dans les annexes (annexe 7).
Grâce à cette démarche
préconisée, les étudiants vont construire un «
méga outil » (Shneuwly, 1995) permettant le développement de
leurs compétences d'écriture à l'université,
d'où l'enrichissement de leur niveau en littératie universitaire.
Cette façon de faire va leurs accorder de même, des occasions
favorables pour qu'ils puissent décrocher une image positive
d'eux-mêmes, de leurs méthodes et de leurs pratiques face aux
exigences et aux attentes du contexte universitaire.
Il est important de mentionner que la proposition de ce
canevas de séance était dans le but de mener à bien son
déroulement, pourtant, il est possible par exemple, que les tutrices
91
accordent plus de temps à une étape,
réduit la durée d'une autre, tout dépend de la demande des
tutorés et de leurs activités. Le tutorat qu'on propose
réside donc flexible d'utilisation.
Après les séances du tutorat, les tutrices
seront appelées à échanger entre elles, les informations,
les données, les expériences, ainsi que leurs analyses et
perceptions par rapport aux sessions, afin de mettre en lumière
l'effet-tuteur, et aussi pour embellir davantage le scénario des
séances à venir. Dans cette visée de montrer
l'effet-tuteur dans leurs actions, les tutrices notent dès le
début de l'expérimentation et jusqu'à sa fin, au niveau
d'un journal de bord, leurs traces, leurs témoignages, leurs
réflexions, leurs pratiques et leurs actions, dans l'intention de
pointer le progrès et le non progrès tout au long de
l'expérience. Elles mentionnent également sous forme de
paragraphes réflexifs leurs ressentis et leurs acquis après les
séances du tutorat, dans une vue informative qui permet de
dégager l'effet-tuteur ou bien l'impact du tutorat sur le
tuteur-étudiant. (Le modèle vierge du journal de bord, annexe 3)
et (l'exemplaire d'un journal de bord de tutrice rempli, annexe 4). Ces
journaux de bord des tutrices vont être pareillement utilisés pour
recueillir des propositions de remédiations et d'amélioration du
dispositif initial.
En ce qui concerne, l'évaluation de l'efficacité
du dispositif du tutorat, elle va être du côté des
tutorés (l'effet-tutoré), à la base des exercices
d'application et des retours qu'ils ont exprimés au niveau du
questionnaire d'appréciation. Et du côté des tutrices
(l'effet-tuteur), elle va s'appuyer sur l'analyse des journaux de bord.
En définitive, on peut avancer qu'on a essayé de
prendre en considération le fait d'aborder le terrain, de
l'étudier, et de respecter sa complexité. Nous mentionnons
également que la démarche qu'on a suivie, répond aux
conditions fondamentales qui font du tutorat une formule pédagogique
efficace et qui sont: l'environnement favorable, l'engagement volontaire,
l'instruction concentrée des contenus, l'évaluation des
apprentissages et les remarques régulières des tuteurs et des
tutrices. Et s'intéresse de même, à déclencher le
désir d'apprendre par l'éveil de la valeur du défi chez
les étudiants, vu que « les élèves sont
motivés pour apprendre lorsqu'ils pensent pouvoir réussir des
activités qui ont une valeur de défi » (Miller, 2003,
p337).
92
CHAPITRE II : RECUEIL, PRESENTATION, ANALYSE DES
DONNEES ET DISCUSSION DES RESULTATS
1- L'effet-tutoré : Recueil, présentation
et l'analyse du contenu d'exercices proposés aux tutorés, et
discussion des résultats
Les dispositifs d'aide et d'accompagnement sont souvent
programmés pour rendre service à l'apprenant. Le tutorat comme
étant l'un de ces dispositifs vise à son tour le fait
d'accompagner les étudiants pour faciliter leur affiliation, ainsi que
leur maitrise des normes et des contenus disciplinaires. Au niveau de cette
partie, nous allons donc traiter les bénéfices que les
tutorés ont tirés de leur expérience du tutorat, tout en
analysant leur progrès en termes d'écriture, composante centrale
de la littéracie universitaire. Nous allons procéder par une
sorte de comparaison entre les réponses des tutorés au test
diagnostic proposé avant le tutorat (annexe 6), et celles de leurs
exercices d'application durant la période de l'expérimentation
(annexe 7). Comme nous l'avons avancé lors de la description du tutorat
et de son déroulement, l'évaluation de l'effet-tutoré
était faite à la base des exercices d'application (annexe 7),
proposés à la fin des séances hebdomadaires,
étaient soit des textes avec des questions de compréhension, soit
des textes que les tutorés doivent corriger à la base de ce
qu'ils ont appris.
Nous allons donc analyser et discuter, les réponses des
tutorés concernant ces exercices, tout en tenant compte du
progrès en matière de l'écrit, que les tutorés ont
pu garantir au fil des séances.
l La première semaine du tutorat : formulation et
justification des réponses :
Comme la première séance du tutorat
était réservée à la rencontre et à la
sensibilisation, la deuxième séance jouera donc l'objet de
l'exercice d'application envisagé pour évaluer la prestation et
l'apprentissage des tutorés.
En conformité avec le cours « Formulation et
justification des réponses », l'exercice suggéré dans
ce cas, était un texte extrait de « Histoire d'un voyage en terre
du Brésil », de Jean de Lery, avec des questions de
compréhension.
Nous allons donc étudier le travail des tutorés
concernant : la formulation et la justification des réponses.
D'ailleurs, la formulation et la justification des réponses
étaient les premières remarques, que nous avons faites lors de la
correction du test diagnostic, qui portait sur « La cigale et la fourmi
» de Jean de La Fontaine (annexe 1), dans la mesure où, la plupart
des résultats ont été mal formulé avec une absence
de justification. Le choix de ce cours de nature méthodologique
s'avère donc nécessaire.
93
Le tableau ci-dessous, représente une sorte de
comparaison entre, les réponses formulées par les tutorés
au niveau du test diagnostic (annexe 6), et celles avancées concernant
le texte proposé après le travail durant la deuxième
séance du tutorat, sur la formulation et la justification des
réponses.
Tableau 1: comparaison des réponses S1
Questions du test
diagnostic : « La
cigale et la fourmi, Jean de
la Fontaine »
|
Exemples de
formulation et de
justification des
réponses du test
diagnostic
|
Questions du texte
d'application :
« Histoire d'un
voyage en terre du
Brésil, Jean de Lery »
|
Exemples de
formulation et de
justification des
réponses d'exercice
d'application
|
Question1 :
|
Réponse1 : « une
|
Question1 : Quel est le
|
Réponse1 : « il s'agit
|
Définissez le genre
|
histoire imaginaire
|
type de ce texte.
|
d'un texte narratif-
|
auquel appartient ce
|
dont le but de
|
Justifiez votre réponse.
|
descriptif, puisque le
|
texte. Justifiez votre
|
critiquer ».
|
|
narrateur raconte son
|
réponse.
|
Réponse2 : « la
cigale et la fourmi qui nous donne la leçon de vie
».
Réponse 3 : « la
fable, la morale »
Réponse 4 : « la
fable ».
|
|
aventure avec ses
compagnons ». Réponse2 : « ce texte
est de nature
narrative-descriptive. Cela est
justifié par le fait que le narrateur,
narre et décrit son
voyage ».
|
|
|
|
Réponse3 : « en ce
qui concerne le type de texte, il est narratif, descriptif,
parce qu'il raconte et il décrit à la
fois le voyage du
narrateur ».
|
|
|
|
Réponse
|
|
|
|
4 : « l'extrait en
question est un texte narratif et descriptif, parmi les
indices qui le montre en trouve :
|
|
|
|
un ensemble de
description et de
narration concernant
son voyage au
|
|
|
|
Brésil ».
|
Question2 : Pourquoi
|
Réponse1 : « les
|
Question2 : Décrivez
|
Réponse1 : « la
|
les initiales des deux
|
initiales des deux
|
la nature de la relation
|
relation entre la
|
substantifs « Cigale »
|
substantifs « cigale »
|
entre la nation des
|
nation des Margajas
|
et « Fourmi », sont-
|
et « fourmi » sont-
|
Margajas et les
|
et les portugais est
|
elles écrites en
majuscule ?
|
elles écrites en
majuscule car sont-
elles des personnes
principales dans la
fable ».
|
Portugais, puis avec
les Français.
|
une relation amicale, par contre elle est très
agressive avec les
français ».
Réponse2 : « à partir du texte, la nation
des
|
|
94
Réponse2 : « la cigale et la fourmi sont
écrites elles la
majuscule car elles
sont les noms propres des animaux
».
Réponse3 : « les
initiales des deux
substantifs « cigale »
et « fourmi » sont-
elles écrites en
majuscule car ils sont
les personnages
principale de la
fable ».
|
|
Margajas et alliée des portugais et ennemie des
français ». Réponse3 : « les
Margajas sont les
alliées des portugais et les ennemis
des français ».
Réponse4 : « la
relation amicale allie les
Margajas et les
portugais, pourtant
cette nation est
l'ennemie des
français ».
|
|
Réponse4 : « le titre
et les personnages
principaux, ils sont
écrites en
majuscule ».
|
|
|
Question3 : étudiez la
|
Réponse1 : « le texte
|
Question3 : Relevez
|
Réponse1 : « au
|
structure de ce texte.
|
est la fable elle parle
|
du texte le champ
|
niveau du champ
|
|
de la cigale et de la
|
lexical d'alimentation
|
lexical d'alimentation
|
|
fourmi. Le texte est le
laconisme et la
fonction de la fable
est critiquer la
société ».
|
et de la nourriture.
|
et de la nourriture, on
trouve des termes
comme : les fruits, la
farine, les
jambons... ».
|
|
Réponse2 : « ce texte
|
|
Réponse2 :
|
|
est la fable écrite en
vers de l'écrivain
Jean de la Fontaine qui a
utilisé la cigale et la fourmi comme personnages
principales de
l'histoire, la fourmi
qui travaille toute
l'été pour gagner du
grains et la cigale qui est toujours entrain de chanter, et dès que
l'hivers est venu, la
|
|
« concernant le
champ lexical
d'alimentation et de nourriture on trouve des
mots comme : la farine, des vivres, des jambons, des fruits, la chaire...
».
Réponse3 : « le
champ lexical
d'alimentation et de la nourriture est présent dans le
texte à travers
des mots comme :
|
|
cigale il n'a pas pu
trouver de quoi
manger, à ce moment là elle
a allé chez la fourmi pour lui prêtez
quelques graines
jusqu'à la saison
nouvelle, mais elle
n'a pas donner. La
morale ici est
implicite, elle passer
|
|
(farine, jambon,
victuailles, fruits...) ».
Réponse4 : « le
champ lexical qui
domine le texte est celui de nourriture et
d'alimentation,
représenté par
plusieurs termes tels
|
|
95
au lecteur d'une
manière indirecte
c'est de « travailler
pour vivre ».
Réponse3 : « l'écrit
en vers on a
allégorique ou
personnification ; des animaux qui
parlent ; aussi on a la consisme c'est pour ça ce texte est court et
briève.
|
|
que : « jambon, fruits, farine... ».
|
|
Ensuite le thème de
cette fable est une
demande de l'aide.
|
|
|
|
En de plus il y a une morale implicite. Et
finalement, la
fonction de cette
fable c'est une
fonction éducative ».
|
|
|
|
Réponse4 : « la fable est structurée par
des vers écrite par Jean de la Fontaine d'où on a des personnages
« la
cigale » et « la
fourmi », la satire,
une moralité à la fin
de cette fable, le
thème utilisé et le
laconisme (bref et
court), sa fonction
éducative (morale) et
explicite d'après la
morale de cette
fable ».
|
|
|
Question4 : la cigale
|
Réponse1 : « oui, elle
|
Question4 : Comment
|
Réponse1 : « Les
|
demande-t-elle
|
alla crier famine chez
|
les sauvages ont
|
sauvages ont bien
|
l'aumône ? Justifiez
votre réponse en
|
la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter
|
accueils le narrateur et
ses compagnons ?
|
accueils le narrateur et ses compagnons, ce
|
relevant des indices du
|
quelques grains pour
|
justifiez votre réponse
|
qui le montre du texte
|
texte.
|
substituer jusqu'à la saison nouvelle ».
Réponse2 : « l'indice qui montre que la cigale demande-t-elle
l'aumône c'est elle
alla crier famine chez la fourmi
sa voisine. La priant de lui prêter quelque grain pour
subsister jusqu'à la
saison nouvelle ».
|
à partir du texte.
|
est la phrase
suivante : « pour nous
les offrir et nous
souhaiter les
bienvenue, six
hommes et une
femme ne firent pas
de difficultés à
monter en barque et à
venir nous voir dans le bateau ».
Réponse2 : « les
sauvages étaient
|
|
96
Réponse3 : « non, la cigale demande-t-elle quelque
grain pour subsister ».
Réponse4 : « la
cigale demande
l'aumône : « la priant de lui prêter quelque
grain pour subsister
jusqu'à la saison
nouvelle ».
|
|
gentils quand ils ont accueillis le narrateur et ses
compagnons, on peut le remarquer à
travers la phrase
suivante : « pour nous
les offrir et nous
souhaiter les
bienvenue, six
hommes et une
femme ne firent pas
de difficultés à
montrer en barque et à
venir nous voir dans le bateau ».
|
|
|
|
Réponse3 : « les
sauvages ont accueilli
le narrateur et ses
compagnons de
manière chaleureuse, dans la mesure
où, ils
ont apporté de la
nourriture à ces
derniers, ce qui le
montre dans le texte est bien
évidemment
cette phrase : « pour
nous les offrir et nous
souhaiter les
bienvenue, six
hommes et une
femme ne firent pas
de difficultés à
montrer en barque et à
venir nous voir dans le bateau ».
|
|
|
|
Réponse4 :
|
|
|
|
« l'accueil des
sauvage était
sympathique. La
justification du texte
est la suivante :
|
|
|
|
« « pour nous les
offrir et nous
souhaiter les
bienvenue, six
hommes et une
femme ne firent pas
de difficultés à
montrer en barque et à
venir nous voir dans le bateau ».
|
Question5 : En vous
|
Réponse1 : « la
|
Question5 : Relevez à
|
Réponse1 : « Les
|
rappelant la condition
|
morale prise pour
|
partir de l'extrait, des
|
éléments qui
|
du fabuliste, quelle
|
cette fable c'est tout
|
éléments qui
|
distinguent les
|
|
97
est, d'après vous, la morale de cette fable ?
Développez votre
réponse.
|
le monde doit prendre
la responsabilité de
tout ce qu'il a fait et ne jamais
perdre le temps »
Réponse2 : « la
morale de cette fable
c'est d'invité le
lecteur de ne pas se
|
distinguent les
habitants de cette terre des autres ».
|
habitants de cette
terre des autres sont qu' « ils avaient tous le corps
peint en noir. Et les hommes étaient tondus de près sur le devant
de la tête ». Réponse2 :
« plusieurs éléments
|
|
caractérisé par les
|
|
créent la différence
|
|
comportements du
|
|
entre les habitants de
|
|
cigale (donner une
|
|
cette terre des autres
|
|
leçon de vie) et de
|
|
sont : un corps peint
|
|
travailler comme la
|
|
en noir, le fait qu'ils
|
|
fourmi ».
|
|
étaient tondus de prés
|
|
Réponse3 : « la
|
|
sur le devant de la
|
|
morale : les gens qui
|
|
tête, ils portaient une
|
|
font des efforts et qui
|
|
pierre verte, la femme
|
|
travaillent bien vont
|
|
n'avait pas la lèvre
|
|
trouver le succès ». Réponse4 : « la
fable
|
|
fendue, à ses oreilles,
si affreusement
|
|
dit qu'il faut travailler
|
|
percées qu'on aurait
|
|
pour réussir ».
|
|
pu passer le doigt
dans les trous ».
|
|
|
|
Réponse3 : « les
éléments qui
distinguent les
habitants de cette
terre des autres sont
leur peinture
corporelle noire, leur rasage de tête,
leur
pierre verte, leurs
trous d'oreilles et
leurs pendentifs
d'os ».
|
|
|
|
Réponse4 : « les
habitants de cette
terra avaient le corps peint en noir
»
|
|
Commentaire 1 :
Le cours de « formulation et de justification des
réponses », était proposé suite au besoin
exprimé au niveau des copies du test diagnostique des tutorés
(les copies des tutorés figurent dans les annexes).
Ce cours de type méthodologique est d'une grande
importance, car, quel que soit la question, le correcteur attend des
étudiants une bonne rédaction des réponses, à
travers des phrases claires, correctes, complètes et porteuses de sens.
Egalement, la plupart des questions posées
98
Aux examens et aux épreuves exigent le fait
d'accompagner la réponse par des justifications afin de la
préciser davantage.
Une séance du tutorat était donc
réservée pour ce cours. Tout d'abord, le cours à
présenter aux tutorés, les types majeurs des réponses
à savoir : (les réponses affirmatives et négatives, les
réponses courtes, les réponses longues et formulées, les
réponses directes et d'autres fermées etc...). La suite du cours
était orientée vers, les astuces nécessaires pour formuler
efficacement une réponse et qui sont en gros : le fait de bien former
une phrase, c'est-à-dire, la commencer régulièrement par
une majuscule et la terminer par un point ; utiliser la ponctuation (virgule
pour marquer une pause, deux points pour expliquer etc...) ; répondre
par la reprise des termes évoqués dans la question, uniquement
ceux indispensables à la réponse, comme si la personne qui nous
lit ne connais pas la question ; supprimer les marques d'interrogation
(l'adverbe d'interrogation, l'inversion du sujet et le point d'interrogation) ;
éviter les réponses directes par « car ou parce que »,
et échapper surtout la copie du texte du support.
Quant à la justification des réponses, une
conduite langagière utilisée pour montrer le bien fondé
des propos, le cours présenté a articulé les visées
de la justification (explicatives et affirmatives), ainsi que les
différentes manières qu'un énonciateur peut utiliser pour
justifier sa réponse, et qui sont principalement : la justification par
relevé d'indice et qui consiste à recopier exactement ce qui
figure dans le texte en l'introduisant par des guillemets, et en montrant la
ligne dans laquelle il se trouve. Puis, la justification par citation au niveau
de laquelle, il faut absolument se référer aux
éléments pertinents du texte et les présenter par des
formules tels que : (ainsi le narrateur juge, comme l'indique, le montre le
narrateur... ».
A la base du tableau présenté ci-dessus et des
éléments avancés dans le passage précédent,
on peut donc remarquer une progression au niveau des pratiques des
tutorés, qui ont fait preuve de bonne assimilation du cours, à
travers l'emploi de leurs acquis dans leurs réponses à l'exercice
d'application. Ils ont mis en pratique, les astuces et les techniques apprises
pour surmonter leurs difficultés, ils sont passés des
réponses mal formulées (reprises des marques d'interrogation (les
réponses de la quatrième question du test diagnostique par
exemple), (réponses sans justifications), (réponses mal
structurées), aux réponses correctes et bien exposées.
L'effet-tutoré a donc commencé à
apparaitre dès la première semaine du tutorat.
Nous allons vérifier davantage l'émergence de
cet effet à travers l'analyse du travail des tutorés dans les
autres séances du tutorat.
l La deuxième semaine du tutorat : structure des
phrases et déterminants :
99
Nous avons remarqué lors des réponses des
étudiants au test diagnostic, que la majorité des tutorés
ne respectent pas la structure des phrases en français, et qu'ils
utilisent d'une manière inappropriée les déterminants.
C'est pour cette raison que les séances de la deuxième semaine du
tutorat, ont étaient orientées vers la structure des phrases et
les déterminants.
Au bout de ces séances, les étudiants sont
censés corriger le texte proposé à la base des
éléments acquis durant ces séances. Le texte en question
contenait plusieurs fautes et lacunes au niveau de la structure des phrases qui
le composait, ainsi qu'une fausse utilisation des déterminants.
Nous allons examiner dans le tableau ci-dessous, les
réponses des tutorés au texte proposé :
Tableau 2 : comparaison des réponses S2
Les phrases incorrectes au niveau du texte
intitulé (le déplacement en ville n'est pas facile)
|
Les propositions de correction des tutorés (en
termes de déterminants et de structure des phrases)
|
Se déplacer en ville ce n'est toujours facile
|
Se déplacer en ville ce n'est pas toujours facile
|
La grande villes proposent depuis longtemps les moyens de
transport, mais des derniers ont aussi leur inconvénients.
|
Les grandes villes proposent depuis longtemps des moyens de
transport, mais ces derniers ont aussi leurs inconvénients.
|
Un métro est très fréquent à
l'heure de pointe, et on se s'y sent toujours en sécurité
après quelques heures.
|
Le métro est très fréquent aux heures de
pointe, et on ne s'y sent pas toujours en sécurité après
quelques heures.
|
Un bus est certes très pratiques, très
dépendant d'une qualité le trafic. Un taxis sont trop chers pour
de utilisation quotidienne.
|
Le bus est certes très pratique, mais très
dépendant de la qualité du trafic. Les taxis
sont trop chers pour une utilisation quotidienne.
|
De tramway quant à lui, couvre qu'une zone
limitée de l'espace urbain.
|
Le tramway quant à lui, ne couvre qu'une zone
très limitée de l'espace urbain.
|
On peut bien sur prendre mes voitures, mais le embouteillages
ou une difficultés pour ce garer sont nombreuses et des heures
d'arrivée à se rendez-vous est jamais garantie.
|
On peut bien sur prendre sa voiture, mais les embouteillages
ou les difficultés pour se garer sont nombreuses et l'heure
d'arrivée à un rendez-vous n'est jamais garantie.
|
Depuis les années 2000, on constate mes changement de
mentalités. Les médias, leur entreprises, votre
municipalités, ces écologistes, invitent de plus en plus un
citoyens à utiliser quelles vélo pour circuler dans quel grandes
villes, par laquelle, ils peuvent protéger quel
environnement.
|
Depuis les années 2000, on constate un
changement de mentalité. Les médias,
les
entreprises, les municipalités, les écologistes invitent
de plus en plus les citoyens à utiliser leurs vélos, pour
circuler dans les grandes villes,
et par lesquels ils peuvent
protéger
l'environnement.
|
|
Commentaire2 :
Les deux cours de la deuxième semaine du tutorat
étaient des cours de syntaxe, proposés suite aux besoins des
apprenants, exprimés dans leurs copies du test diagnostic. Nous avons
trouvé important de présenter ce type de cours, pour donner aux
tutorés les outils nécessaires de la construction correcte des
phrases en français, qui réside un aspect fondamental dans le
développement de la compétence scripturale.
100
Le cours portait sur la structure des phrases, était
organisé selon une certaine hiérarchie, qui part d'abord, de
définir la phrase comme étant l'unité de base de
l'écrit, de montrer que sa structure n'est pas standard (pouvant aller
d'un seul mot, à une composition plus complexe), et de mentionner que la
construction des phrases en français est appelée syntaxe et elle
doit obéir à des règles bien déterminées et
propres à chaque type de phrase (déclarative, interrogative,
exclamative et impérative).
Le cours s'est étalé par la suite sur la phrase
simple, complexe (coordonnée et juxtaposée) et composée
(la proposition subordonnée relative et la proposition
subordonnée conjonctive). Pour traiter enfin les deux formes des
phrases, à savoir la forme affirmative et négative.
Nous pouvons alors remarquer à travers les
données présentées dans le tableau ci-dessus, une
progression notable au niveau de la structure des phrases, dans la mesure
où, les tutorés ont commencé à soigner la
composition des phrases, sous-titre d'exemple, ils arrivent à respecter
la négation, à faire la différence entre les phrases
simples, complexes et composées etc...
Concernant les déterminants, les tutorés ont pu
également exploiter pertinemment ce cours, à travers leur choix
rationnel des déterminants à utiliser. Le fait qu'ils
réussissent à distinguer entre les articles (définis et
indéfinis), les déterminants (possessifs, démonstratifs,
relatifs, exclamatifs et interrogatifs), et le cas d'emploi de chacun d'entre
eux.
l La troisième semaine du tutorat : l'accord et
la nominalisation :
Au niveau de la troisième semaine du tutorat, le choix
était fait pour l'accord et la nominalisation. La suggestion de ces deux
cours, tout comme les autres, découle des difficultés des
étudiants qui figurent sur leurs copies du test diagnostic.
Tout d'abord, l'accord posait un véritable
problème pour ces étudiants, surtout l'accord des adjectifs
qualificatifs et l'accord du sujet/verbe.
Le tableau ci-dessous, montre une variété des
phrases construites par les étudiants, qui accentuent bien
évidemment leur besoin relatif à l'accord :
101
Tableau 3: comparaison des réponses S3
Accord des adjectifs qualificatifs
|
Accord sujet/verbe
|
« les personnes principales »
|
« la fable est présenté »
|
« les initiales des deux substantif »
|
« les initiales des deux substantifs est écrit en
|
« le texte a une fonction éducatif »
|
majuscule »
|
« les comportement de la cigale »
|
« nous avons trouvé des personnes qui ne
travaille
|
« Jean de la Fontaine a écrit plusieurs fable
»
|
pas »
|
« Jean de la Fontaine est un des plus
célèbres fabuliste
|
« les gens doit travailler car il n'y a pas de vie sans
|
et cette fable à une idée principal »
|
travail »
|
« la situation final, la situation initial »
|
« le titre et l'écrivain de la fable ont très
connus »
|
« un schéma narrative »
|
« la cigale n'a pas demandée l'aumône, il a
demandée
|
« les personnage principaux »
|
quelques grains pour subsister »
|
« la fable raconte de façon plaisant »
|
« parmi les indices qui montre que ce texte est une
|
« les personnages du textes sont »
|
fable »
|
« on trouve divers type de personnage »
|
« dans cette fable on trouvons deux personnes
|
« quelque grains »
|
principaux »
|
« on trouve plusieurs forme »
|
« comme on a deux animaux qui parle »
|
« des bons affaires »
|
« les évènements de la fable se
déroule pendant
|
« deux fonctions éducatif divertissante »
|
l'hivers »
|
« une relation fictif »
|
« les gens de la littérature en France ne gagne
pas
|
« les écrits des écrivain »
|
l'argent de leurs écritures »
|
|
« Jean de la Fontaine visent à donner des
leçons de vie »
|
|
« une morale est exprimé à la fin de la fable
»
|
|
« la cigale cherche les moyens qui est exactement la
nourriture »
|
|
« la fable il est écrit en vers »
|
|
« les événements de ce texte se
déroule chez la fourmi »
|
|
« la présence des animaux qui parle »
|
|
« la cigale et sa voisine la fourmi qui ont dans une
forêt »
|
|
« la cigale a partie chez sa voisine pour chercher du
grain »
|
|
Les besoins des étudiants ont été
également au niveau de la nominalisation, dans la mesure où, on a
remarqué que ces derniers utilisent d'une manière
inappropriée les nominalisations. En gros, nous avons relevé les
lacunes qui se répètent d'une façon récurrente sur
les copies des étudiants, et qui sont : « le moque, la demandation,
le perdre, la nourritation etc... ».
Pour mesurer la progression des tutorés en
matière de l'accord et de la nominalisation, nous avons tracé les
deux tableaux ci-dessous, dans lesquels nous constaterons les réponses
des tutorés quant au texte et aux exercices proposés lors de
cette troisième semaine du tutorat :
102
Tableau 4: comparaison des réponses S3 suite
Les phrases incorrectes au niveau du texte
intitulé « l'identité numérique »
|
Les propositions de correction des tutorés (en
termes d'accord)
|
L'identité numérique est l'ensemble des
traces
numérique qu'une personnes ou une collectivités
laisse sur internet.
|
L'identité numérique est l'ensemble des
traces
numériques qu'une personne ou une collectivité
laisse sur internet.
|
Toutes ces information, laissé au fil des navigation,
sont collecté par les moteurs de recherche, comme Google, et sont rendus
public.
|
Toutes ces informations laissées au fil des
navigations, sont collectées par les moteurs de recherche comme Google,
et sont rendues publics.
|
Une identité numérique, ou IDN, peut être
constitué par : un pseudo, des nom, des image, des vidéos, des
adresse IP, des favori, des commentaire etc...
|
Une identité numérique, ou IDN, peut être
constituée par : un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des
adresses IP, des favoris, des commentaires etc...
|
Cette identité virtuel se créent par le biais
des réseaux
sociaux, comme Facebook, Twitter, ou des
publications sur
un blogs, les site web de tous genre construise également une
identités, grâce à laquelle l'on peut donc être connu
et avoir une présences en lignes. Mais ces donnée, qui se trouve
à la portées de
tous, constitue un risques permanentes par les
utilisateur
et pour la protections de leur vies privée.
|
Cette identité virtuelle se crée par le biais
des réseaux
sociaux, comme Facebook, Twitter, ou des
publications sur
un blog, les sites web de tous les genres construisent également une
identité, grâce à laquelle l'on peut donc être connu
et avoir une présence en ligne. Mais ces données, qui se trouvent
à la portée de tous, constituent un risque permanent par les
utilisateurs et pour la protection de leur vie privée.
|
Même si Google a mis en place un formulaires pour
adresser des demande de droits à l'oubli, celui-ci restent très
compliquées à remplir. Cependant, la plateforme en ligne
Forget.me est un outil gratuites qui permettent de remplir plus facilement,
puis d'envoyer des demande de retrait des donné. Dès lors sur
l'identités numérique ont aussi étés voté
dans le but de protéger les utilisateur.
|
Même si Google a mis en place un formulaire pour
adresser des demandes de droits à l'oubli, celui-ci
reste très compliqué à remplir.
Cependant, la
plateforme en ligne Forget.me est un outil gratuit qui permet
de remplir plus facilement, puis d'envoyer des
demandes de retrait des données. Dès lors
sur
l'identité numérique ont aussi été
voté dans le but de protéger les utilisateurs.
|
|
Tableau 5: comparaison des réponses S3
suite
la phrase verbale
|
Les réponses des tutorés par la
nominalisation
|
Un ensemble de chercheurs ont découvrent une momie
égyptienne sur le chantier d'une grande surface.
|
la découverte d'une momie égyptienne sur le
chantier d'une grande surface.
|
Un enfant de dix ans a disparu dans les environs de Rabat.
|
La disparition d'un enfant de dix ans dans les environs de
Rabat.
|
Le musée de la ville a été incendié
hier soir.
|
L'incendie du musée de la ville hier soir.
|
L'équipe nationale marocaine du football est enfin
victorieuse.
|
La victoire de l'équipe nationale marocaine.
|
Un bébé panda a été
découvert dans une forêt à l'Est de la France.
|
La découverte d'un bébé panda dans une
forêt à l'Est de la France.
|
Les programmes scolaires ont été
modifiés par le ministère.
|
La modification des programmes scolaires par le
ministère.
|
|
Commentaire3 :
Nous avons consacrée la troisième semaine du
tutorat à l'accord de l'adjectif qualificatif (attribut et
épithète), tout en exposant des règles
générales de l'accord des noms, des nombres, des adjectifs de
couleur. La séance était également destinée
à l'accord des verbes (avec un sujet singulier et pluriel).
103
Quant à la nominalisation, nous avons
réservée toute une séance pour traiter ce moyen qui
élargi le vocabulaire, qui garantit une grande quantité
d'informations, qui aide à la prise des notes et à la
réorganisation et à la reformulation des phrases.
Nous avons donné aux tutorés, les règles
à prendre en considération et à suivre, pour effectuer
correctement la nominalisation : (l'ajout des suffixes « -eur, -ance,
-esse, -erie etc.. », la suppression de la terminaison verbale, la
nominalisation sans changement du verbe etc...).
A travers les réponses des étudiants, il est
possible d'avancer que les séances de la troisième semaine du
tutorat, ont été utiles. D'une part, les tutorés ont pu
accorder intelligemment les adjectifs et les verbes, et ont de même
nominalisé les phrases d'une manière correcte, tout en mobilisant
ce qu'ils ont appris lors des sessions tutorales.
l La quatrième semaine du tutorat :
Quant à la quatrième et la dernière
semaine du tutorat, elle a été réservée aux
connecteurs logiques et aux modes et temps verbaux. Le fait de
préconiser ces cours est dû au manque de cohérence au
niveau des réponses des étudiants, qui avançaient une
idée sans la liée à une autre, ou bien qui veulent
articuler entre deux propositions, mais ils ne savaient pas quel est le
connecteur adéquat à être utilisé.
Quant à la conjugaison, elle pose à son tour un
grand problème aux étudiants qui ne savent pas quel mode ou quel
temps, doivent-ils employés dans leurs phrases.
Nous avons collecté dans le tableau ci-dessus, les
erreurs les plus communes des étudiants, en termes de connecteurs
logiques et des modes et temps, relevées de leurs copies du test
diagnostic bien évidemment :
Tableau 6:comparaison des réponses S4
|
Les phrases des étudiants, qui expriment leur
besoin en termes des connecteurs logiques
|
Les phrases des étudiants, qui expriment leur
besoin en termes des modes et temps
|
|
« la cigale a demandé l'aumône à la
fourmi grâce à sa
|
« si la cigale à travailler et n'a pas demandé
des grains
|
|
faim ».
|
de la fourmi ».
|
4 confusion entre « grâce à » et «
à cause de ».
|
4 si + conditionnel.
|
« la cigale a voulu des grains cependant elle veut
|
« les événements passés dans l'hivers
».
|
subsister »
|
4 le passé composé.
|
4 emploi du « cependant » au lieu de « car ou
parce
|
« la cigale a demander l'aumône à sa voisine
».
|
que ».
|
4 confusion entre le « é » et le « er
».
|
« les initiales des deux substantifs « Cigale »
et
|
« la cigale rendrais les grains à sa voisine
».
|
« Fourmi » sont écrits en majuscule, certes,
ce sont des
|
4 confusion entre le futur simple et le conditionnel
|
animaux principaux dans la fable »
|
présent.
|
4 Fausse utilisation de la concession.
|
|
|
Nous allons comparer maintenant, dans le tableau ci-dessus,
l'amélioration du niveau des tutorés quant à ces deux
aspects, à travers l'examen de leur réponse au texte de la
dernière semaine :
104
Tableau 7: comparaison des réponses S4 suite
|
Eléments incorrects au niveau du texte
d'application intitulé « le selfie
»
|
Propositions de correction des tutorés (en
termes des modes et temps)
|
|
Le selfie spectaculaire permettons au sujet
d'été exceptionnel en se metté en scène dans des
situations exceptionnelles et spectaculaires, mais très
risquées.
|
Le selfie spectaculaire permet au sujet d'être
exceptionnel en se mettant en scène dans des situations
exceptionnelles et spectaculaires, mais très risquées
|
|
Certains faisons même le buzz avec le « chinning
», photographie redoutable de leur double menton en contre plongée,
devant les sites touristiques. Des grands déprimés se prendront
en selfie, « ce qui permettent aussi d'existerais ».
|
Certains font même le buzz avec le « chinning
», photographie redoutable de leur double menton en contre plongée,
devant les sites touristiques. Des grands déprimés se prennent en
selfie, « ce qui permet aussi d'exister »
|
|
Le « photobomb » eus été un selfie
parfois hilarant où l'arrière-plan viennent délivrant un
message incongru, à l'insu du photographe créatif, transgressif,
militant.
|
Le « photobomb » est un selfie parfois hilarant
où l'arrière-plan vient délivrer un message incongru,
à l'insu du photographe créatif, transgressif, militant.
|
Le tableau suivant représente la progression
remarquée au niveau de l'emploi des liens logiques :
Tableau 8: comparaison des réponses S4 suite
|
Eléments incorrects au niveau du texte
d'application
|
Propositions de correction des tutorés (en
termes de connecteurs logique)
|
|
Faire du sport serait bon à cause de la santé :
les médecins, les psychologues, les professeurs de sport le disent.
|
Faire du sport serait bon pour la santé : les
médecins, les psychologues, les professeurs de sport le disent.
|
|
Tantôt, il serait le remède contre la violence
des adolescents, ou bien beaucoup de parents qui ont des enfants un peu trop
agressifs se précipitent par les inscrire dans un club de tennis
où de foot, et dans les écoles le sport des vu comme la solution
miracle contre l'agressivité.
|
En fait, il serait le remède contre la violence des
adolescents, et beaucoup de parents qui ont des enfants un peu trop agressifs
se précipitent par les inscrire dans un club de tennis où de
foot, et dans les écoles le sport des vu comme la solution miracle
contre l'agressivité.
|
Commentaire4 :
Avoir recours à ces deux cours était
nécessaire vu leur importance dans tout type d'écriture, dont
l'écriture à l'universitaire. Nous avons insisté dans le
cours présenté aux tutorés sur la portée des
connecteurs logiques dans la cohérence, la progression et le rapport
logique du texte, tout en mentionnant l'ensemble des relations logiques
(addition, cause, conséquence, opposition, concession, but, comparaison,
reformulation, conclusion, condition, classification, illustration et
justification) et leurs différents connecteurs.
Par rapport aux modes et temps, nous avons tenté
d'accentuer le rôle du verbe comme étant l'élément
essentiel de la phrase, d'indiquer ses modes (personnel « indicatif,
impératif, conditionnel et subjonctif »), impersonnel «
infinitif, participe et gérondif »), ses temps (simple «
présent, imparfait, passé simple, futur simple) composé
(passé composé, plus que parfait, futur antérieur,
passé antérieur).
105
Nous avons pu vérifier la pertinence des cours
présentés à travers les réponses des
étudiants aux exercices d'application, dans lesquels, ils ont fait
preuve d'une bonne maitrise du contenu diffusé.
2-L'effet-tuteur :
Au niveau des dispositifs d'aide et d'accompagnement,
l'attention est souvent accordée aux apprenants. Suite à cette
tendance, le tutorat est perçu comme étant une formule de soutien
qui vise le progrès du tutoré. Cependant, au sein de ce
dispositif, le tuteur qui vient pour travailler et assister son tutoré,
peut se développer également de manière constructive
grâce à son activité. Le tutorat devient alors, un
dispositif qui peut influencer la vie personnelle et professionnelle du tuteur,
on parle donc de « l'effet-tuteur ».
Dans notre présente recherche, nous avons tenté
de mettre en exergue ce phénomène, pour témoigner le fait
que le tuteur peut tirer des bénéfiques à partir de son
action et de son intervention dans le cadre du tutorat.
2-1 Présentation du journal de bord et son
objectif :
« Le journal de bord est régulièrement
mentionné comme un outil primordial des méthodologies
qualitatives » (Baribeau, 2005 ; Wacheux, 1996 ; Miles et Huberman, 1994),
« [...] constitué de traces écrites, laissées par un
chercheur, dont le contenu concerne la narration
d'événements[...] des idées, des émotions, des
pensées, des décisions, des faits [...] contextualisées
(le temps, les personnes, les lieux) [...] dont le but est de se souvenir des
évènements, d'établir un dialogue entre les données
et le chercheur [...] » (Baribeau, 2005, p. 108 ». Dans le cadre de
notre recherche et suite au tutorat expérimenté auprès des
étudiants de la première année, département du
français, nous avons eu recours au journal de bord pour dégager
l'émergence de l'effet-tuteur, chez huit tutrices engagées dans
l'action.
2-2 Elaboration du journal de bord :
Comme notre objectif est de vérifier l'effet-tuteur
dans l'activité des tutrices, l'architecture du journal de bord
proposé vise principalement cette finalité, dans la mesure
où, les questions ciblées au niveau de ce dernier reposent
surtout sur : l'actions et les pratiques mises en place par les tutrices, ainsi
que l'expérience et le vécu de ces dernières dans le cadre
du tutorat ou « le dire sur le faire ». Ces questions vont être
notre base de référence pour vérifier l'effet-tuteur.
Les caractéristiques du journal de bord
suggéré sont principalement :
l
106
Destiné aux tutrices ayant participées dans
l'expérience du tutorat.
l Rédigé dans la finalité qu'il soit
remplit immédiatement après chaque séance.
l Adapté selon le déroulement des sessions
tutorales.
l Anonyme suite à la demande des tutrices, mai
pourtant il contient d'autres informations indicatives tels que : (l'âge
et le niveau d'études)
Par rapport à la modalité du journal de bord
préconisée, nous avons décidé de saisir la version
initiale du journal de bord avec Word, puis le mettre à la disposition
des tutrices. (Le modèle du journal de bord figure dans les annexes).
2-3 Recueil et analyse des données du journal de
bord :
Les journaux de bord des tutrices ont été
rédigés après les séances hebdomadaires du tutorat.
L'expérience a été prévue pour le mois de Mars,
durant laquelle les tutrices volontaires étaient totalement
engagées et impliquées au niveau du dispositif. Le tableau
ci-dessous relate la période de rédaction des journaux de bord
des tutrices, réparti en fonction des séances :
Numéro du
journal de
bord
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Date des
séances
|
Séance1 : 04/03/2023 Séance 2 : 05/03/2023
|
Séance 3 : 11/03/2023 Séance : 4 12/03/2023
|
Séance 5 : 18/03/2023 Séance 4 : 19/03/2023
|
Séance 6 : 25/03/2023 Séance 7 : 26/03/2023
|
|
Notre échantillon composé de ces journaux de
bord est un corpus riche sur lequel on va se baser pour extraire les
informations et les idées nécessaires à la
vérification de l'effet-tuteur. Nous avons analysé et
traité les journaux de bord manuellement pour faire une synthèse
des extraits convaincants et appropriés avec l'aspect recherché :
« l'effet-tuteur ».
- L'implication des tutrices :
Les tutrices volontaires engagées dans le dispositif
du tutorat proposé, remplissent systématiquement le journal de
bord, directement après la fin de chaque séance. Elles font
preuve d'énergie et d'impatience pour décrire leurs vécus
et pour parler de leurs expériences. Leur attitude désireuse,
montre leurs flammes et leurs envies de remarquer leurs progrès et les
bénéfices qu'elles ont pu tirer du réinvestissement et de
la transmission de leurs connaissances pour un groupe d'étudiants.
D'ailleurs, le fait d'apercevoir leurs développements dans leurs
107
pratiques d'accompagnement et l'idée qu'elles vont
apprendre également en enseignant était le motif qui a
stimulé davantage l'attention et la curiosité des tutrices.
Certes, leur première mission est de garantir le progrès de leurs
tutorés, mais, le fait d'assister à la récompense de leurs
efforts demeure un paramètre de grande importance.
L'implication des tutrices et leur véritable
accrochage, nous ont permis en tant qu'observatrice d'adopter une posture
directive importante dans le suivi de ce phénomène complexe, dans
la mesure où, nous avons eu à notre disposition au bout de chaque
semaine, les journaux de bord des tutrices remplis et détaillés,
pour qu'on puissent vérifier la progression de l'effet-tuteur au fil des
séances. En fait, nous avons, nous même rédigé notre
journal de bord vu que nous avons participé également à
l'expérience et on souhaite aussi remarquer nos progrès, pour
arriver vers la fin à organiser une réflexion concrète et
réelle de ce dernier.
- l'analyse de l'évolution de l'effet-tuteur :
Notre investigation est articulée sur un double
objectif, l'un relatif à « l'effet-tutoré » et l'autre
autour duquel s'articule cette partie, correspond à l'émergence
de l'effet-tuteur à travers la mise en place du tutorat
universitaire.
Pour tenir compte de ce phénomène et pour
valider sa présence au niveau de notre dispositif expérimental,
nous allons effectuer l'analyse qualitative des journaux de bord. Dans cette
perspective, nous avons choisi de se pencher sur l'essentiel pertinent du
corpus, autrement-dit, nous allons trier les données des journaux de
bord pour se focaliser uniquement sur celles signifiantes et nécessaires
pour formuler des réponses à la question suivante : Les tutrices
arrivent-elles à tirer profit de leur activité d'accompagnement
dans le cadre du tutorat ?
La réponse à cette question est donc
conditionnée par la nature des propos avancés par les tutrices et
inscrits au niveau des journaux de bord.
- L'analyse qualitative :
Afin d'analyser qualitativement des données obtenus de
l'expérience, nous allons procéder pour un traitement des propos
des tutrices et leurs réactions vis-à-vis de leurs
activités, pour savoir à tel point le tutorat est utile pour
favoriser l'émergence de l'effet-tuteur.
l La première séance du tutorat
:
Comme nous avons précisé lors de la description
de l'expérience du tutorat, la première séance
était consacrée à la rencontre et à la
sensibilisation. Au niveau de cette première séance, les tutrices
avançaient dans leurs journaux de bord les propos suivants :
Tutrice 1 : « J'ai beaucoup apprécié cette
initiative d'accompagnement des étudiants, ce n'est que la
première séance, mais je me sens très familiarisée
avec les étudiants. J'ai pu capter leur
108
attention, à travers l'évocation de mon cursus
universitaire, du choix de l'éducation comme domaine d'études,
des bienfaits de l'enseignement, et de l'objectif ultime du tutorat
d'accompagnement. Approximativement, dans une durée qui ne
dépassait pas une heure, j'ai pu avoir la confirmation des
étudiants concernant leur participation au tutorat. Au niveau de cette
séance, j'ai plutôt senti un renforcement de nature relationnelle
».
Tutrice 2 : « Personnellement, et à partir de la
première rencontre avec mes tutorés, j'ai ressenti les ondes
positives de cette expérimentation, l'échange avec eux, et
comment ils expriment leur gratitude et leur reconnaissance pour l'action me
motivent davantage pour tenir à bien ma mission ».
Tutrice 3 : « Je trouve que l'expérience va
être utile et instructrice pour les tutorés et même pour
nous. De ma part, lors de la première séance, j'ai su que vers la
fin de l'action tutorale je vais récolter plusieurs
bénéfices, car dès ma première prestation en tant
que tutrice, j'ai pu surmonter un problème que j'ai rencontré, et
qui était relatif à l'accès d'une tutoré à
la session. J'ai donc vite pris la décision de passer de l'appel que
j'avais choisi au début pour rendre l'échange actif, aux messages
écrits et aux enregistrements vocaux pour que cette étudiante
pourra trouver des traces de la séance, quand elle va régler son
problème de réseau et accéder à la session.
C'était le premier atout que j'ai tiré de ma première
séance en tant que tutrice : gérer le problème et adapter
la situation en fonction de mon public ».
Tutrice 4 : « Suite à ma première
séance en tant que tutrice, j'ai appris à comment changer les
représentations des étudiants par rapport à un sujet ou un
concept. J'ai pu organiser mes interventions pour répondre à cet
objectif, et pour mieux expliquer aux tutorés les bienfaits de ce
dispositif et conduire au changement de leur conception de base. Vers la fin de
la séance, ma démarche était bénéfique et
les étudiantes ont été intéressées par la
participation à cette action pédagogique ».
Tutrice 5 : « Personnellement, j'ai trouvé en
tant que tutrice, la première séance très motivante.
L'engagement, l'interaction et l'échange avec les tutorés
était une véritable source d'encouragement, qui m'a
impliqué davantage dans l'action et qui m'a poussé à faire
mon maximum pour aider ces étudiants désireux pour apprendre et
se développer ».
Commentaire 1 :
La première séance du tutorat était la
séance dans laquelle les tutrices ont presque eu le même ressenti.
Le progrès qu'elles ont pu remarquer de leur première
expérience de tutrice était de nature relationnelle et
motivationnelle. La plupart d'entre elles, ont insisté sur l'importance
de ces aspects dans le maintien de leur activité de suivi et
d'accompagnement. Un deuxième progrès a était
mentionné également au niveau de cette première
séance : la résolution des
109
problèmes, à travers lequel les tutrices ont pu
développer leur processus mental et cognitif permettant de gérer
la situation et de la diriger utilement. L'amélioration des
compétences communicatives était le troisième garant de la
satisfaction des tutrices au niveau de leur première séance. On
peut donc résumer l'effet-tuteur de la première séance du
tutorat en trois aspects majeurs : un progrès relationnel et
motivationnel, mental et cognitif, et finalement communicative.
l Les séances 2, 3,4 et 5 du tutorat
:
Par rapport aux deuxième, troisième,
quatrième et cinquième séances du tutorat, les propos
s'articulaient cette fois-ci autour du progrès cognitif, vu que les
contenus ont été plus formels, sous formes des cours de
méthodologie et de syntaxe comme « la formulation et la
justification des réponses, la structure de la phrase, l'accord et la
nominalisation ». Il est important de rappeler que notre démarche
de travail est d'origine qualitative, chose qui nous a poussés à
retenir l'essentiel dans les propos des tutrices concernant ces séances,
dans le but de mettre la lumière sur l'évolution de
l'effet-tuteur au fil des semaines.
Les propos des tutrices par rapport à ces
séances ont été présentés comme suit :
Tutrice 1 : « Dans ces séances qui sont formelles
et orientées vers des cours permettant le renforcement et la
consolidation de la compétence scripturale des étudiants, j'ai pu
développer un point qui me posais souvent problème dans mon
parcours, quand je présente un exposé ou un travail en classe,
est celui d'annoncer l'objet du cours d'une manière créative, au
lieu de se contenter juste sur la formule classique : « le cours ou
l'exposé d'aujourd'hui portera sur... » Au fil des séances
du tutorat, sous-titre d'exemple celle de la formulation et de la justification
des réponses, j'ai annoncé un défi avec moi-même, de
ne plus aborder mon cours d'une manière traditionnelle. Au niveau de la
deuxième séance, j'ai opté pour la question suivante pour
commencer mon cours : « Quel genre de film préférez-vous ?
». Cette question à vite capter l'attention des tutorés qui
commençaient automatiquement à produire leurs réponses.
J'ai enchainé ensuite par une autre question : « Pourquoi
aimez-vous ce genre ? », ce jeu de questions/réponses interactif
m'a permis de présenter avec fluidité l'intitulé de mon
cours : « La formulation et la justification des réponses »,
d'une manière différente qui implique les tutorés, qui
suscite leur curiosité et capte leur attention.
Tutrice 2 : « Tout au long de ces séances du
tutorat, j'ai développé une capacité qui repose sur le
fait, de ne jamais avancer la réponse au tutoré, mais
plutôt de leur donner le temps pour réfléchir, et les
outiller pour qu'ils réalisent individuellement le travail. Sous-titre
d'exemple, dans la séance de l'accord, j'ai expliqué les
règles de l'accord d'une manière détaillée et
claire, j'ai formulé des exemples pour concrétiser mon
explication, j'ai recueilli d'autres exemples
110
cette fois-ci ceux des tutorés dans le but de les
impliquer au niveau de la construction des cours. Mais quant au moment
où ils doivent appliquer ce qu'ils ont appris, j'occupe moins l'espace
didactique pour leur donner plus d'autonomie nécessaire à
l'accomplissement de la tâche. Et même lorsqu'ils ne trouvent pas
la réponse, j'essaye de la formuler à la base de la rectification
de leurs propos. Le plus important pour moi était de les aider et de les
orienter pour se responsabiliser ».
Tutrice 3 : « En tant qu'étudiante en master,
j'ai toujours entendu parler de l'importance du tissage dans l'apprentissage.
Ce que je connaissais par rapport à cet aspect était d'un point
de vue théorique. Ma visée était donc de
concrétiser ma connaissance par rapport à ce point et les
séances du tutorat demeurent le terrain au niveau duquel cette
visée sera réalisable. Pour ce faire, j'ai donc
procédé toujours avant le début de tout nouveau cours, par
un rappel des éléments traités durant les séances
précédentes. Grace à cette action pratique, j'ai fini par
toucher l'intérêt du tissage dans la construction des savoirs
».
Tutrice 4 : « Durant mon parcours scolaire et
universitaire, je n'ai jamais osé sortir de ma zone de confort,
sous-titre, quand j'avais des exposés à présenter en
licence et même au master avant le tutorat, je me base uniquement sur le
contenu que j'ai préparé, et j'évite toutes sorte de
prolongement ou d'ouverture du sujet.
De ce fait, quand j'ai entendu parler d'une expérience
du tutorat, je n'ai pas hésité à participer dans le but
d'aider autrui, mais également de développer ce point qui me pose
problème.
Au niveau des séances que j'animais, je me basé
sur les expériences des tutorés, sur leurs propositions et leurs
perceptions, tout en s'écartant de ma conception isolée.
Au fil des séances, j'ai touché vraiment
l'importance d'apprendre à gérer les imprévus, et la
nécessité de les prendre toujours en compte lors de la conception
du cours ».
Tutrice 5 : « Pendant les séances hebdomadaires
du tutorat, j'ai enrichi mes connaissances méthodologiques, syntaxiques
et langagières, grâce à la préparation de mes
interventions, à l'élaboration et la mise en oeuvre de mon
activité, et au réinvestissement de mes acquis en situation.
C'est tout un processus et un effort qui ne sert non seulement à doter
les tutorés des connaissances dont ils en besoin pour développer
leur niveau en écriture, mais également qui permet à la
tutrice d'apprendre et de progresser d'une manière notable »
Commentaire 2 :
Au niveau dans lesquelles les tutrices sont censées
présenter un cours auprès des tutorés, l'effet-tuteur
prend d'autres formes or le social et le relationnel. Cette fois-ci le
progrès est souvent de nature cognitive et didactique. Du
côté du progrès cognitif, les tutrices sont arrivées
à développer davantage leurs savoirs, à enrichir leurs
connaissances et à consolider leurs acquis.
111
Ces atouts ont donc comme origine les différentes
tentatives d'aide des tutrices, plus leur étude approfondie du contenu
transmis. Un travail grâce auquel, cette tutrice devient à son
tour étudiante active, capable d'améliorer son niveau et de
garantir de nouveaux apprentissages.
De ce qui est développement des méthodes et des
techniques didactiques de diffusion d'un cours et d'instauration d'un savoir,
les tutrices ont pu passer, d'une démarche de travail magistrale,
à une autre active basée sur l'interactivité,
l'échange mutuel et la créativité. Dans cette perspective,
plusieurs ont été les tutrices qui ont fait preuve d'un
progrès remarquable au niveau de cet aspect, chose remarquable surtout
quand elles ont pris la décision de laisser de côté la
procédure magistrale classique, pour adopter une autre formalité
orientée vers la construction collaborative du cours et la prise en
compte des propositions et d'autonomie des apprenants (la mise en place du
cours par le biais du : tissage, des exemples, des questions/réponses
etc...). Ces tutrices qui souhaitent intégrer au futur le domaine
d'enseignement, sont alors familiarisées avec différentes
facettes du métier au niveau du tutorat. Avec le découverte
concrète de l'utilisation des méthodes de diffusion du cours et
de transmission du savoir, ainsi que leur identification de celles qui
impliquent l'apprenant et le rend attentif davantage.
Le tutorat est vu donc conçu comme une sorte de
préprofessionnalisation qui permet l'intégration rapide des
tutrices dans le corps enseignant et qui vise leur insertion pour
découvrir la réalité du métier. Ces bienfaits
peuvent être garantis à travers la construction des tutrices de
leur répertoire professionnel fondé sur leur activité
d'aide et d'accompagnement.
Les séances 6,7 et 8 du tutorat :
Ce sont les dernières séances du tutorat
réservées aux « connecteurs logiques » et aux «
modes et temps ». Il faut mentionner que c'est au niveau de ces
séances, que toutes les tutrices ont vu leurs efforts
récompensés et ont pu vraiment remarquer l'avantage que peut
tirer celui qui enseigne de son activité.
Les propos saisis concernant ces dernières
séances au niveau des journaux de bord des tutrices étaient comme
suit :
Tutrice 1 : « J'ai souvent entendu « qu'enseigner
est apprendre pour la deuxième fois », et en réalisant mon
travail en tant que tutrice, j'ai vécu une expérience profitable,
dans la mesure où j'ai pu approfondir mes connaissances et construire
mon identité professionnelle à travers les cours que j'ai
présenté aux tutorés. J'ai pu de même renforcer mon
relationnel grâce l'empathie, au contact et à la proximité
que j'avais avec les étudiants »
Tutrice 2 : « Le tutorat a été très
bénéfique pour moi à plusieurs niveaux, tels que : la
préparation des cours, la gestion du temps et des interactions, le choix
des travaux qui visent
112
l'enrichissement des connaissances, et le développement
d'esprit d'engagement et de responsabilité »
Tutrice 3 : « Mon expérience en tant que tutrice
des étudiants de la première année était
enrichissante, d'un point de vue cognitif et relationnel. Dans la mesure
où, j'ai pu consolider mes acquis, et même j'ai eu de fortes
relations sociales avec mes étudiantes grâce à la
proximité d'âge. Je suis consciente que mon activité au
sein du tutorat va me rendre service de mon futur métier qui
nécessite des habiletés comme : la structuration des cours, la
gestion de la séance et la motivation, que j'ai pu développer
durant ce mois d'expérience ».
Tutrice 4 : « Ma mission en tant que tutrice m'a permis
essentiellement de comprendre l'importance d'être patient, et d'accorder
aux tutorés le temps dont ils ont besoin pour réfléchir.
Au niveau des premières séances, je n'avais pas cette
compétence, mais au fil des semaines, j'ai appris à
réduire ma prise de parole, à contrôler mes interventions,
à laisser à part mes idéaux, à se positionner du
côté des tutorés et à ne pas dominer
l'échange pour qu'ils puissent profiter davantage. Le tutorat est donc
une véritable occasion de préparer le métier d'enseignant
et de connaitre le rapport à l'institution.
Tutrice 5 : « Ce que j'ai vraiment gagner du tutorat est
de voir la pratique de mes tutorés se développer. Ma source de
satisfaction était quand ils parlent positivement de ce qu'ils ont
appris, quand ils apprécient la manière dont les contenus ont
été harmonisés avec leurs attentes et leurs besoins. Dans
mon expérience, c'est donc plus la dimension humaine et sociable qui
s'est manifestée ».
Tutrice 6 : « Dans le cadre du tutorat, nombreuses ont
été les compétences nécessaires au métier
d'enseignants que j'ai pu améliorer : la reformulation, le
questionnement, l'échange et l'interaction, la vérification des
acquis, la gestion de l'hétérogénéité du
groupe, l'encouragement etc...Le développement de cet avant-goût
du métier d'enseignant, était possible grâce à la
liberté qu'on avait lors de l'élaboration des séquences
pédagogiques ».
Commentaire 3 :
Les étudiantes-tutrices jugent leur première
expérience du tutorat comme étant bénéfique pour
leur projet professionnel. Elles voient en bénévolat une
activité fructueuse pour l'enrichissement de leurs connaissances et la
consolidation de leurs compétences. Elles considèrent le tutorat,
comme une approche indirecte du métier d'enseignant, permettant leur
familiarisation avec le monde professionnel. C'est dans le tutorat, qu'elles
ont pu identifier leurs forces et leurs faiblesses pour les développer
davantage en vue de les mettre en pratique concrètement dans diverses
situations d'enseignement/apprentissage. Le tutorat présente pour elles
une sorte de prise de recul nécessaire pour se positionner face aux
réalités des classes,
113
grâce auquel elles ont remet en question leurs
conceptions du métier d'enseignant et ont construit de nouvelles
aspirations relatives à cette profession.
2-4 Discussion des données de l'expérience
: (en termes d'effet-tuteur et d'effet-tutoré) :
A partir de l'expérience du tutorat faite durant un
mois, et en examinant la progression des tuteurs et des tutorés, nous
avons pu retenir les conclusions suivantes :
l Au niveau de notre dispositif, le tutorat était
proactif, c'est-à-dire que se sont surtout les étudiants qui ont
un bon niveau qui ont pu profiter davantage. Ce sont donc les étudiants
qui ont le moins besoin d'aide, qui étaient assidus et impliqués
au niveau du dispositif. Ces étudiants étaient toujours
présents pour ne rien rater, ils étaient motivés et ils
souhaitent bénéficier de toute formule d'aide.
l Les regards des tutorés et des tuteurs confirment
l'importance de l'interaction dans l'apprentissage à
l'université.
l La formule tutorale est une expérience
équilibrée et constructive qui a marqué la vie personnelle
et professionnelle des tuteurs et des tutorés.
l Le tutorat est envisagé comme une sorte de
préparation aux fonctions à venir.
l l'effet-tuteur apparu chez les tutrices était
surtout de nature cognitive et relationnelle.
l Le tutorat était souple, il permet une rectification
immédiate des erreurs et des incompréhensions, car il est «
un contexte d'éducation entre pairs à l'intérieur duquel
le tutorés observe les réponses correctes
présentées par le tuteur » (Madrid, 1998, p.243).
l « Sa spécifité est de mettre en relation
à un moment précis et régulièrement, des
étudiants avancés avec des étudiants novices dans le cadre
de petits groupes de travail où chacun peut s'exprimer. Bien que tous
les étudiants qui rencontrent des difficultés ou qui sont
susceptibles d'en avoir ne participent pas aux séances, les
témoignages des étudiants assidus montrent que le dispositif ne
les a pas laissés indifférents et qu'ils en ont retiré des
bénéfices » (Annot, 2001, p.384).
l Le tutorat était le garant d'une implication
positive et des échanges avantageux entre tutrices et tutorés.
114
Chapitre III : Retour sur l'expérimentation et
vérification des hypothèses :
1- Le questionnaire d'appréciation : (retours des
tutorés)
La description de l'action tutorale, ainsi que l'analyse des
exercices réalisés par les tutorés durant un mois
d'expérience étaient insuffisantes pour estimer la
validité du tutorat et son introduction au niveau de l'enseignement
supérieur, pour garantir l'accès aux littéracies
universitaires, d'où on a trouvé qu'il est nécessaire
d'interroger les participants qui ont été intégré
dans ce dispositif pour connaitre leur ressenti vis-à-vis de dernier, vu
qu'ils sont les acteurs centraux de l'expérience et leurs avis demeure
indispensable. En conséquence, on a proposé un questionnaire
d'appréciation ou de satisfaction (annexe 5), dans le but d'utiliser les
réponses avancées pour mesurer la pertinence de notre
expérience.
1-1 Présentation du questionnaire
d'appréciation et son objectif :
Ce questionnaire d'appréciation qui a été
nourri de divers travaux liés à l'accompagnement tutoral à
l'université, va être doublement utilisé. D'une part, afin
de collecter des données par rapport à la qualité du
dispositif suggérer et d'une autre part, il va être avantageux
pour accueillir des propositions d'amélioration et du perfectionnement
du tutorat.
1-2 Elaboration du questionnaire :
Nous avons essayé lors de l'élaboration du
questionnaire, de varier les questions proposées
pour qu'elles englobent celle qui portent sur les avantages et
les contraintes, et d'autres qui
visent l'enrichissement et la bonification du dispositif
initial.
La population interrogée :
Comme notre rechercher porte surtout sur la qualité, et vu
que nous voulions optimiser notre
questionnaire, nous avons décidé de le
diffusé auprès d'un petit échantillon, englobant le
public
cible qui a participé au tutorat, et qui était
à nombre de 32 étudiants et étudiantes.
- Le questionnaire été mis à la disposition
des étudiants de la première année, département
du français à l'ENS Meknès, qui ont
participé à l'action tutorale durant un mois.
- A nombre de 32 sont les tutorés qui ont répandu
au questionnaire proposé.
La composition du questionnaire :
Le questionnaire d'appréciation créé,
comprend des informations qui portent sur :
- L'objectif du questionnaire.
- L'anonymat et la confidentialité des réponses
avancées.
115
- Des remerciements pour les personnes qui vont prendre de leur
temps et répondre au
questionnaire.
Le questionnaire d'appréciation des tutorés se
compose de 16 questions, essentiellement
orientées vers :
- L'expérience du tutoré.
- L'organisation générale du dispositif.
- Les contraintes et les difficultés que les tuteurs ont
rencontrées.
- L'accueil, l'accompagnement et la qualité d'encadrement
des tutrices.
- Les propositions d'amélioration du dispositif.
Les types des questions :
Ce questionnaire met en exergue divers types de questions :
- Des questions fermées à échelle
ordinale (Satisfaisant, Peu satisfaisante, Pas du tout
satisfaisante, Très bien, Bien, Assez bien,
Médiocre, Très utile, Assez utile, Peu utile,
Pas du tout utile).
4 Ce genre de questions permet de mesurer d'une
manière rapide et efficace le degré de satisfaction des
participants.
- Une question fermée dichotomique (Oui,
Non).
4 Ce type de question est le plus facile pour garantir un taux
de réponse élevé.
- Deux questions fermées multiples
(La gestion du temps, la connexion, la disponibilité, la
formation, la qualité du travail).
4 Ce type de question permet la simplification des
réponses et sert à éviter l'alourdissement de ces
dernières.
- Des questions ouvertes, qui interrogent le
point de vue des questionnés (propositions d'amélioration, propre
perception par rapport au tutorat etc...).
4 Ce type de question permet le recueil des informations qui
reposent sur une marge de créativité, qui ne réduisent pas
la liberté du questionné, qui ne limitent pas sans imagination,
et qui n'influencent pas sa vision par des réponses
déterminées.
Il est important de mentionner que le questionnaire a
été analysé tout en respectant l'anonymat.
1-3 Recueil, analyse et discussion des données du
questionnaire
Notre méthode d'analyse du contenu intrigue l'approche
qualitative, pour laquelle nous présenterons les résultats
obtenus, ainsi que leur interprétation.
116
Question1 :
Toutes les réponses des tutorés concernant ce que
représente le tutorat pour eux étaient
principalement :
- Le tutorat est une démarche pour apprendre et se
développer.
- Le tutorat est une forme d'aide envisagée pour
dépasser les difficultés.
- Le tutorat est le lien entre le tuteur et un apprenant, pour
aider ce dernier à atteindre ces
objectifs.
- Le tutorat est une relation formative entre un tuteur qui guide
les apprentissages d'un
tutoré et l'aide également.
- Le tutorat est un mode d'accompagnement qui permet à
l'étudiant de recevoir une aide
supplémentaire et personnalisée pour
améliorer son niveau.
- Le tutorat est un dispositif interactif entre un tuteur
compétent et un groupe d'étudiants
dont l'objectif d'améliorer les performances
académiques et de favoriser la réussite.
- Le tutorat est une relation d'aide entre un tuteur et un
tutoré dont le but de fournir une
assistance aux étudiants pour faire face à leurs
besoins.
- Le tutorat est une aide personnalisée qui sert à
faciliter les apprentissages et les
transmettre à un tutoré pour l'orienter vers la
réussite.
- Le tutorat est un travail d'entraide et de collaboration au
niveau duquel les étudiants
s'organisent en groupe pour résoudre la même
tâche et afin d'atteindre un objectif
commun.
Question2 :
Les tutorés interrogés associent le mot tutorat
essentiellement à :
- Aide et soutien.
- Enseignement et apprentissage.
- Formation et révision.
- Guidage et accompagnement.
- Approfondissement et facilitation.
Commentaire1 :
Les deux premières questions ont été
proposées pour vérifier à tel point la première
séance du tutorat, réservée à une
sorte de rencontre et de sensibilisation était bénéfique
pour les
tutorés. D'ailleurs, cette séance était
consacrée à la présentation des tuteurs, qui vont
partager
leur expérience d'étudiant pour convaincre les
participants des bienfaits de l'éducation et
l'intérêt d'assister aux cours et de suivre
l'enseignant, dans le but de les encourager pour
s'inscrire au niveau du tutorat. Cette discussion sert
pareillement à l'évocation des informations
117
principales sur le tutorat d'accompagnement, ses objectifs et
son déroulement, des mots sur la littéracie universitaire
également.
Lors de cette séance, les tutrices ont mentionné
que l'objectif primordial derrière l'expérience du tutorat
d'accompagnement est de concourir à la réussite universitaire des
tutorés, à travers le fait de les doter d'un certain savoir pour
qu'ils développent leurs compétences littéraciques
à l'université, pour qu'ils dépassent leurs
difficultés en écriture, et pour qu'ils intègrent leurs
acquis dans différents contextes. Les tutrices ont souligné lors
de cette première séance, que le contenu proposé va
être sous forme de, cours de remédiation et de mise à
niveau en français, permettant de renforcer la compétence
scripturale et de la mobiliser au service des apprentissages. Elles ont bien
évidemment insisté sur le fait que les participants sont
déjà des étudiants universitaires, ayant une
expérience scolaire et universitaire importante, et qu'ils
possèdent également un éventail de connaissances et des
compétences, qu'on cherche à concrétiser et à
mettre en pratique ensemble.
Concernant les définitions présentées aux
tutorés autour de la notion du tutorat étaient regroupées
comme suit :
Le tutorat, est un dispositif d'aide proposé pour faire
face aux difficultés des étudiants. Il met en situation, des
tuteurs, souvent âgés que les tutorés, ayant un niveau
d'études avancé par rapport à ces derniers, pour qu'ils
puissent leur fournir le soutien et le suivi adéquats. La nature
d'accompagnement dans notre cas est de faciliter l'entrée des
étudiants en littéracie universitaire, à travers la
consolidation de leur compétence scripturale.
On peut donc déduire à partir des
réponses avancées par les enquêtés, que les
tutorés ont compris l'objectif du tutorat, sa visée et sa
finalité ainsi que son principe fondamental, dont la mesure où
ils ont répondu de différentes manière à la
question, mais en gardant la même idée de base qui tourne autour
de : forme d'aide et d'accompagnement visant le développement des
compétences, et la conduite vers la réussite. Alors, on peut
avancer que la première séance de rencontre et de sensibilisation
était utile pour mettre en évidence le concept du tutorat, pour
clarifier davantage son potentiel et pour éviter toutes nuances qui
peuvent créer des confusions et des désorientations pour les
tutorés.
Question3 :
L'utilité du tutorat selon les participants (figure
1)
- 26 tutorés ont répondu que le tutorat leur
était très utile.
- 6 autres ont répondu par assez utile.
- Personne n'a répandu par peu utile ou pas du tout
utile.

19% 0%
utilité du tutorat
81%
Très utile
Assez utile
Pas du tout utile
118
Figure 1: utilité du tutorat
Commentaire 2 :
Cette question était posée dans le but de
s'assurer de l'utilité du dispositif mit en oeuvre au
développement des littéracies universitaires du côté
des tutorés ayant participés dans l'action, de voir si la formule
proposée était adéquate à leurs attentes et s'ils
trouvent vraiment le tutorat intéressant et captivant. Les
réponses de la plupart des enquêtés par « très
utile », montrent qu'ils ont compris le potentiel du tutorat ainsi que ses
bienfaits.
Les tutorés qui ont répandu par « assez
utile » expriment également leur conscience quant à la
commodité et la convenance du tutorat, mais avec un degré
inférieur par rapport à ceux qui le trouve très utile,
c'est- à-dire qu'ils estiment que le dispositif doit être
amélioré davantage. Cette différence en degré
d'utilité peut avoir plusieurs causes, parmi les on trouve : une
satisfaction par rapport au contenu diffusé, au volume horaire, à
la répartition des séances etc... Question 4
:
Les aspects que les tutorés ont appréciés
plus dans le dispositif du tutorat :
Les réponses des tutorés ont été
diverses, où chaque participant a réagi selon sa propre
expérience. Leurs appréciations peuvent se résumer comme
suit :
- les astuces apprises pour développer la
compétence scripturale.
- la communication avec la tutrice ainsi que l'interaction et
l'échange.
- le progrès et la confiance en soi ressenti.
- La prise de parole, la participation et le partage des
idées avec l'ensemble du groupe.
- l'écoute et la patience de la tutrice.
- Le recours au rappel avant le début de chaque nouvelle
séance, et le fait de souligner les
points appris et assimilés.
- les leçons présentées sont utiles,
résumées et expliquées d'une manière
simplifiée.
119
- l'occasion de travailler chacun à son propre rythme, le
sentiment de motivation et de
confiance qui se dégagent de ces séances.
- La correction des fautes au fur et à mesure et le
travail d'un ensemble d'exercices pour
pratiquer les apprentissages.
- Le travail en groupe et la relation d'aide omniprésente
entre la tutrice et les tutorés.
- La gentillesse de la tutrice et son empathie envers ses
tutorés.
- Le programme du tutorat cible précisément les
difficultés des étudiants.
- La manière dont la tutrice anime le cours avec le
recours aux exemples et aux
explications détaillées.
Commentaire 3 :
Cette question ouverte était posée dans le but de
collecter les points de vue des tutorés,
sans les limiter à des choix
prédéterminés. De cette manière, on a pu cerner
concrètement les
points positifs qui ont attiré l'attention des
participants, qui ont suscité leur intérêt et qui
montrent que le tutorat proposé est réussi. Grace
aux réponses des tutorés concernant cette
question, on a pu résumer les aspects positifs du tutorat
et les mentionnés ci-dessus.
Question 5 :
L'avis des tutorés par rapport à l'emploi du temps
et la répartition des séances du tutorat.
- 30 tutorés ont jugé que la répartition des
séances et l'emploi du temps était très réussie.
- Deux autres tutorés ont répandu par bien
réussie.
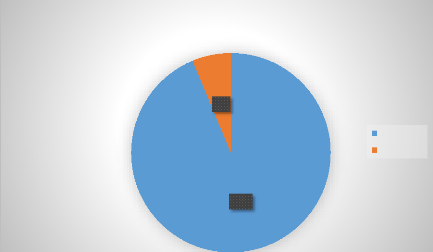
emploi du temps et répartition des
séances
6%
94%
Très réussie Bien
réussie
Figure 2: emploi du temps et répartition des
séances
120
Commentaire 4 :
Le recours à cette question est envisagé pour
savoir si les tutorés étaient satisfaits concernant la
répartition et l'horaire des séances, et si cette dernière
a été adaptée à leur demande. D'ailleurs, la
majorité a répondu par « très bien réussie
» ou « bien réussie ». Ceci est dû à la
première séance du tutorat, au niveau de laquelle chaque tutrice
a programmé les séances en tenant compte des
préférences des tutorés. Après cette séance,
tous les participants ont choisi de travailler pendant les week-ends, pour
qu'ils puissent être totalement engagés dans l'action.
La seule différence qui existe réside au niveau
de l'heure du travail, dans la mesure où, des groupes ont opté
pour les matinées, d'autres pour les après-midi. Ce qui compte
est que le choix et l'organisation du tutorat était faite suite à
la demande des protagonistes de dispositif.
Question 6 :
L'avis des tutorés concernant l'atmosphère ou le
climat du travail :
- Tous les tutorés interrogés ont répandu
par « beaucoup », c'est-à-dire qu'ils trouvent que
l'atmosphère des séances tutorales était propice au
travail et aux apprentissages. Commentaire 5 :
Cette question est indispensable pour mesurer la pertinence du
tutorat. Elle était donc posée dans la finalité
d'interroger la qualité de l'environnement du travail
préconisé durant l'expérience. Pendant les séances
du tutorat et vers la fin de chaque session hebdomadaire, les tutrices, ont
l'habitude de poser cette question aux tutorés, dans le but de
vérifier, si le climat du travail est favorable aux apprentissages ou
pas. D'ailleurs, les tutorés dès les premières
séances ont mentionné une certaine appréciation concernant
l'atmosphère dans laquelle se déroule le tutorat. Ils se sentent
acceptés, à l'aise et en sécurité dans un milieu
qui suscite un sentiment d'appartenance et d'affiliation. Ils avançaient
qu'ils sont satisfaits, et que l'origine de cette satisfaction est dû
à la description claire des objectifs et des buts d'apprentissage,
à la bonne organisation des séances, à la prise de parole,
aux échanges, et aux interventions.
Les participants ont souligné de même leur
appréciation vis-à-vis de l'ambiance des séances, qui
dégage beaucoup d'énergie positive, de confiance, d'esprit de
collaboration, d'aide et de soutien.
Au fil des séances du tutorat, nous avons
remarqué que la majorité d'entre eux trouvent dans ce dispositif,
un climat favorable aux apprentissages grâce à la capacité
de communication des tutrices, qui sont de la même
génération que les tutorés, qui arrivent à les
comprendre facilement, à s'ajuster pour répondre à leurs
attentes, et à être attentives pour prendre en pleine
considération leurs propos. Des tutrices, qui pointent le fait de rendre
le cours attractif et
121
amusant comme une priorité pour capter l'attention des
participants, qui viennent toujours au tutorat pour bénéficier
des cours différents de l'enseignement habituel auquel ils sont
confrontés toute la semaine. Ils viennent chercher l'empathie, la
compassion, la compréhension ainsi que le savoir et les connaissances.
On peut dans la même perspective, renvoyer l'émergence de cet
environnement avantageux et positif au travail en petits groupes, dans la
mesure où les étudiants se trouvent familiarisé avec leurs
camarades de groupe, ils commencent à avoir l'habitude de travailler
ensemble, de se connaitre davantage, surtout pour les tutorés timides,
qui ont trouvé cette opportunité majeure pour garantir une
intégration et une adaptation avec le milieu universitaire.
Question 7 :
L'avis des tutorés concernant l'organisation du tutorat
:
- Tous les tutorés enquêtés avancent que
l'organisation du tutorat était « très bien organisée
».
Commentaire 6 :
L'organisation du tutorat était bien réussie,
une opinion a été partagée par tous les tutorés
ayant participé à l'action. Le premier point qui rend cette
organisation aboutie et remarquable, est la communication du programme et la
gestion du temps de chaque séance. Par exemple, lors de la séance
de rencontre et de sensibilisation, l'heure, la date, le programme, le
déroulement, et les temps clés des sessions du tutorat ont
étaient fixés, communiqués et confirmés par
l'ensemble du groupe. De ce fait, ces aspects ont été
respectés durant le mois d'expérience et par les tutrices et par
les tutorés. Ensuite, un deuxième point qui a garanti la bonne
organisation du tutorat, est la planification à l'avance de chaque
séance, pour ne perdre du temps à penser au déroulement de
cette dernière à chaque fois, dont, un début
réservé au rappel comme une sorte de tissage, par la suite un jeu
de questions/réponses pour arriver à l'objectif du cours et le
cerner, une autre partie consacrée à la présentation du
cours et sa construction basée sur les interactions et l'échange
entre tutrice/tutorés, et puis un axe de temps pour appliquer les
éléments appris et partir vers une fin de séance
destinée aux retours des tutorés concernant le travail
réalisé. Ce cheminement était communiqué pour tous
les groupes, chose qui rend connu la démarche du travail. Grace à
cette façon de faire, l'objectif de chaque séance est atteint, la
motivation des tutorés est garantie et la bonne gestion du travail est
réussie.
Un autre aspect est considéré rentre dans la
bonne organisation du tutorat est bel et bien la communication des rôles
de chaque composante intégrée au niveau du dispositif :
Le tutorat : un dispositif qui comporte le contenu, les
compétences, les capacités, le travail, la démarche
privilégiée et les objectifs visés.
122
Le tuteur : un tuteur-étudiant avec une petite
différence d'âge que les tutorés, ayant le même
parcours universitaire que ces derniers, est choisi pour ses compétences
et son niveau, pour rendre service au tutoré, pour l'orienter et pour le
guider vers les apprentissages et les connaissances nécessaire lui
permettant de surmonter ses difficultés.
Le tutoré : un apprenant ayant des besoins et des
difficultés, cherche à les dépasser en vue
d'améliorer son niveau et de garantir la réussite de son
parcours.
L'annonce au préalable des étapes distinctes du
tutorat est également le garant d'une bonne organisation du tutorat. Ces
étapes ont été bien évidemment annoncées et
communiquées lors de la première séance du tutorat :
La compréhension du tutorat : une sorte
d'accompagnement visant la transmission et l'acquisition d'un certain nombre de
compétences dont la finalité de réussir le cursus
universitaire. Où, un étudiant novice est mis en relation avec un
ancien étudiant, plus expérimenté, chargé de
l'accueillir, de l'accompagner et de lui transmettre les savoirs
nécessaires à son parcours.
La préparation du tutorat : organisation
concrète et préparation générale du programme en
question.
L'accueil des tutorés : la rencontre et la
réunion entre les différents sujets du tutorat est une
étape structurée et décisive qui marque la suite du
programme.
L'accompagnement des tutorés : la construction
d'une relation basée sur la confiance mutuelle, sur la création
d'un cadre de bienveillance permettant la préservation du progrès
et du développement. Insister sur le fait de garantir aux tutorés
une écoute active, une compréhension constante, un accompagnement
guidé, une analyse neutre et objective de leurs besoins, et des conseils
constructifs. Des tâches certes compliquées mais possibles et qui
conduisent à la réussite du dispositif.
Evaluer les tutorés : même si le tuteur
n'est pas un enseignant, mais pourtant l'évaluation des tutorés
réside nécessaire, pour savoir si la démarche
préconisée est porteuse de résultats, et si les
participants font preuve d'une certaine progression.
Question 8 :
Les aspects ayant posés problèmes pour les
tutorés lors de l'action tutorale :
- 26 tutorés affirment que l'aspect qui leur posé
problème est surtout la disponibilité. - 4 autres ont
avancé que la connexion était la contrainte rencontrée.
- 2 autres personnes ont mentionné la gestion du temps.
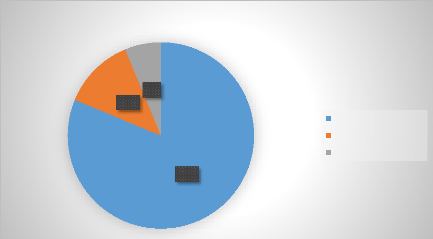
6%
13%
les problèmes rencontrés
81%
la disponibilité
la connexion
la gestion du temps
123
Figure 3 : les problèmes rencontrés
Commentaire 7 :
Le fait de citer la disponibilité comme la contrainte
la plus rencontrée par les tutorés est normal vu la
période de l'expérimentation qui a coïncidée avec le
mois du ramadan, d'où les tutorés ont était pris par les
séances d'étude à l'université et le jeûne,
chose qui rend l'engagement au niveau du dispositif tutoral délicat.
Plusieurs tutorés lors de cette question n'ont pas
juste répandu par choisir une proposition, mais ils ont également
expliqué leurs choix :
Tutoré 1 : « ce qui m'a posé
problème c'est la disponibilité lors du mois du ramadan
étant donné que je ne le passe pas chez moi ».
Tutoré 2 : « la chose qui m'a privé des
fois à participer au tutorat est la disponibilité, surtout avec
les études et ramadan ».
Tutoré 3 : « le fait de passer le ramadan loin de
ma famille et en période d'étude, rend le fait de travailler dans
le cadre du tutorat difficile ».
Donc, on peut estimer que les tutorés souhaitent la
programmation du tutorat pendant une période durant laquelle ils ne
seront pas pris par d'autres préoccupations.
Les autres qui ont mentionné les problèmes de
connexions, le relie avec des complications associées au réseau,
car lors de la conception du tutorat à distance, on a essayé de
recourir à un outil informatique qui soit disponible pour tous les
participants, même on leurs est posés question par rapport
à ce point, et ils ont suggéré la plateforme de messagerie
instantanée « WhatsApp », qu'on a préconisée
comme canal d'assistance personnalisé pour garantir la participation de
la plupart des tutorés.
124
Question 9 et 10 :
Quant à l'accompagnement et au suivi des tutrices, les
tutorés ont répandu par:
- 22 tutorés ont répandu par « très
bien » quant à l'accompagnement et le suivi des
tutrices.
- 10 autres tutorés ont choisi « bien » pour
juger cet aspect.
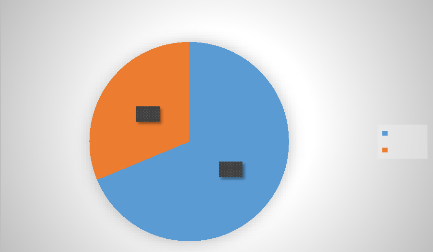
l'accompagnement et le suivi des
tutrices
31%
69%
Très bien Bien
Figure 4: accompagnement et suivi des tutrices
Par rapport aux qualités que les tutorés
préfèrent chez leurs tutrices, vont être regroupé
dans le paragraphe qui suit.
Commentaire 8 :
Dans leurs réponses et même lors des
séances du travail du tutorat, les tutorés ne cessent d'avancer
leur satisfaction concernant la qualité du suivi offert par les
tutrices.
C'était plus au moins le point le plus avantageux pour
la plupart des participants, qui ont apprécié le fait de
travailler avec une personne de la même génération, une
tutrice-étudiante qui vient de vivre la même expérience
qu'eux et qui a passé du même chemin que celui des participants.
Ils trouvent qu'un tuteur inscrit dans la même filière qu'eux est
celui qui peut leurs aider plus, vu qu'un jour, il était dans la
même situation, donc il arrive facilement à comprendre leurs
angoisses et leurs proposer des solutions également.
D'ailleurs, cette question était très importante
au niveau du questionnaire, vu qu'à travers laquelle, on a pu estimer
que le fait de choisir un tuteur-étudiant pour travailler avec les
tutorés était utile et pertinent.
125
Avancé par les tutorés ayant répandu par
« très bien » et « bien » le suivi des tutrices
occupe donc une place primordiale dans les dispositifs d'accompagnement tels
que le tutorat, où l'aide et l'assistance favorisent l'implication du
tutoré, suscitent sa motivation et le place au coeur de l'action.
Les enquêtés quand ils ont avancés des
réponses par rapport aux qualités des tutrices, ils ont
cité des propos comme :
Tutoré 1 : « notre tutrice était
très gentille, elle s'intéresse toujours à nous
transmettre les informations d'une manière facile. Elle insiste surtout
sur notre compréhension du contenu travaillé ».
Tutoré 2 : « elle a la capacité d'expliquer
le cours d'une manière simple. J'ai apprécié comment elle
nous encourage, nous motive et comment, elle arrive à comprendre nos
besoins ». Tutoré 3 : « la tutrice utilisait des explications
claires, elle était toujours à l'heure et même elle nous
envoyait des messages pour nous rappeler la séance ce qui montre son
implication. Elle nous donnait des chances pour poser nos questions, et elle
réexplique à chaque fois si on arrive pas à comprendre
».
Tutoré 4 : « j'ai aimé le fait que notre
tutrice donne la parole à tout le groupe pour participer ».
Tutoré 5 : « notre tutrice était sérieuse,
compétente et intelligente ».
Tutoré 6 : « j'apprécie chez ma tutrice sa
capacité d'expliquer et d'avoir une relation de confiance avec
nous».
Tutoré 7 : « les qualités de ma tutrice sont :
sa sympathie et sa motivation».
Tutoré 8 : « la bonne explication surtout car les
cours étaient à distance et la communication sont les
qualités de ma tutrice ».
Tutoré 9 : « j'ai aimé plusieurs
qualités chez ma tutrice, principalement : son enthousiasme ».
Tutoré 10 : « j'ai aimé chez ma tutrice, sa
disponibilité, sa communication, ainsi que ses efforts fournis
».
Tutoré 11 : « personnellement, j'ai
apprécié beaucoup la façon dont laquelle elle explique le
cours, elle nous donne plusieurs exemples et détails mais d'une
manière simplifiée ».
D'après ces réponses on peut donc déduire
les principales qualités d'un bon tuteur : D'emblée, ce qui rend
un tutorat réussi est bien évidemment le lien et la relation
établie entre le tuteur et le tutoré, développée au
fil des séances, et qui vise le fait de garantir un degré de
familiarisation entre les sujets inscrits au dispositif. En plus, le tuteur
doit se faire comprendre dans ces explications, il doit s'exprimer clairement
tout en adoptant la vulgarisation des différentes notions
présentées, avec une bonne maitrise du contenu diffusé,
ainsi qu'une pertinence au niveau des propos avancés. Egalement, ce
tuteur doit avoir une bonne
126
communication avec les tutorés, une communication qui
transmis au-delà du savoir et des apprentissages, la confiance et
l'estime de soi. Ce point peut être atteint, si le tuteur en question est
une personne énergique, qui démontre un certain enthousiasme
vis-à-vis de son tutoré, déçu et
démoralisé peut être par ses notes ou son parcours. Donc,
c'est par sa bonne humeur et son esprit positif, que le tuteur peut devenir un
modèle de réussite pour le tutoré et arrive à
l'inciter à s'impliquer davantage dans sa réussite
universitaire.
De même, la bonne écoute s'avère cruciale
pour réussir la fonction du tuteur, car la compréhension de la
situation et l'identification des besoins des tutorés repose sur le fait
d'être ouvert et à l'écoute. Le tuteur doit être
curieux et intéressé par l'aide de son tutoré, comme
ça ce dernier se voit valorisé et prit en considération,
chose qui garantit éventuellement son implication et son engagement.
Aussi, le tuteur engagé dans l'action tutorale, doit être
flexible, ajusté, polyvalent, et doté d'une faculté
d'adaptation, car il se trouve face à différents tutorés,
avec divers besoins, et vu la non-existence d'une formule préfaite qu'on
peut appliquer à tous sans distinction, cet acteur pédagogique se
trouve dans la nécessité de varier ses pratiques et sa
démarche pour offrir un soutien personnalisé aux apprenants.
Question 11 et 12 :
L'expérience et le point satisfaisant au niveau du
tutorat selon les tutorés :
- La totalité des enquêtés ont jugé
leur expérience du tutorat comme étant satisfaisante.
Commentaire 9 :
Cette question autour de la satisfaction des tutorés
est posée dans une finalité de porter un jugement sur leur
ressenti durant l'action tutorale, également, elle permet une
inscription dans une logique de régulation qui contribuera vers un
pilotage des actions au sein du dispositif. On vise donc le fait de recueillir
des données réelles admettant la prise des décisions
appropriées et adéquates.
Cette question représente donc pour nous, une
opportunité pour décider les suites de cette action, ainsi que
son amélioration.
L'étudiant est le principal acteur de l'enseignement
supérieur, il est donc le noyau central de l'action tutorale
également, c'est autour de lui et à son service que gravitent
tous les autres constituants. En fait, l'analyse de la question relative
à la satisfaction des tutorés à l'égard du tutorat
est importante pour comprendre l'efficacité de ce dispositif, et pour
chercher à mieux l'appréhender dans le contexte universitaire.
En effet, tous les participants étaient satisfaits de
leur expérience du tutorat, chose qui peut être signalé
comme signe de réussite et d'efficacité de ce dispositif.
127
Les éléments qui ont suscité la satisfaction
des apprenants sont différents et ils varient selon la conception de
chaque tutoré, et selon sa propre expérience. Ces aspects de
satisfaction sont regroupés comme suit :
- 20 tutorés ont apprécié la relation d'aide
omniprésente durant les sessions.
- 5 ont jugé que la formation était le point
bénéfique du tutorat.
- 5 autres ont mentionné la qualité du travail.

16%
les points de satisfaction
17%
67%
la relation d'aide la formation la qualité du travail
Figure 5: les points de satisfaction
Le fait que la majorité, soit 20 personnes qui ont
cité la relation d'aide omniprésente durant les sessions du
tutorat, comme le point le plus apprécié montre que, le premier
aspect qui fait la particularité du tutorat était atteint, vu que
le tutorat est principalement, une relation d'aide et de soutien entre tuteurs
et tutorés dans le but de faciliter l'apprentissage. Donc, les
tutorés s'intéressent plus à cette relation qui leur
aident à percevoir leurs qualités et leurs besoins, à
exprimer leurs idées, leurs points de force et de faiblesse sans
jugement, et qui leur offre également l'opportunité de comprendre
leur responsabilité face à leurs études, sans les
culpabiliser. Cette relation d'aide a dominé tous les groupes du tutorat
grâce à la communication entre les intervenants, l'empathie et la
surveillance, les encouragements et les motivations, l'écoute active et
la patience, plus le respect et la confiance.
Ce qui compte plus pour les tutorés d'après ces
réponses est surtout le soutien motivationnel. Et d'ailleurs, c'est ce
point qui crée la différence entre l'enseignant et le tuteur,
dans la mesure où ce dernier se centre plus sur le fait de cerner et de
comprendre les connaissances, les croyances, les attitudes et les comportements
de son tutoré pour lui apporter
128
l'aide appropriée, et pour s'occuper de son
bien-être. C'est pour toutes ces raisons, que la dimension d'aide sociale
doit se manifester avant tout, et que le tuteur doit être absolument une
personne prête pour rendre service à autrui.
Pour les autres tutorés qui ont répandu à
la fois par la formation et la qualité de travail comme étant les
atouts majeurs et bienfaits du tutorat, montre que le contenu
présenté durant les séances était adéquat
avec les besoins des participants, autrement dit que la planification et la
programmation du dispositif était réussie et conforme aux
attentes des tutorés, car tout enseignement abouti doit s'adapter aux
besoins des apprenants et les prennent en considération. Alors, le fait
de travailler sur un contenu porteur de sens pour les apprenants, a garanti
leur attention et leur implication.
Concernant le point relatif à la qualité du
travail, révèle le fait que les tutrices ont pris au
sérieux leur mission, dans la proportion où, elles ne travaillent
que pour accomplir la tâche qui leur était confère, elles
essaient de traiter les points de chaque cours avec soin et attention dans le
but d'assurer la compréhension et l'assimilation des tutorés.
Question 13 :
Quelques causes du rejet du tutorat selon les
enquêtés :
Peu nombreux ont été les tutorés qui ont
répandu à cette question.
Commentaire 10 :
Cette question était placée au niveau du
questionnaire pour comprendre les raisons pour lesquelles quelques
étudiants inscrits dans le programme tutorale ne participaient pas, ou
bien assistaient à quelques séances et abandonnaient d'autres.
Cependant, ces étudiants n'ont pas répandu même au
questionnaire, les propos qu'on va avancer concernant cette question sont ceux
des tutorés qui ont bénéficié du programme, mais
qui suggère quelques points comme étant l'origine du rejet. Ces
suggestions sont les suivantes :
Tutoré 1 : « il existe des raisons pour lesquelles
les gens peuvent rejeter l'expérience du tutorat, ils peuvent avoir des
difficultés à établir une relation avec leur tuteur, ils
sont mal à l'aise au niveau du groupe »
Tutoré 2 : « les étudiants qui ont
rejeté le tutorat peuvent être très timides, ils trouvent
du mal à se trouver dans une nouvelle situation, ils ne sont pas
capables de participer au tutorat » Tutoré 3 : « quelques
étudiants ne peuvent pas suivre les cours à l'université
et les cours du tutorat chez eux»
Tutoré 4 : « les gens qui ont rejeté
l'expérience du tutorat n'ont pas compris les avantages de cette
dernière, parce que s'ils les connaissent ils vont regretter».
129
Question 14 :
L'avis des tutorés concernant l'officialisation et la
standardisation du tutorat dans les universités marocaines.
Commentaire 11 :
Toutes les réponses avancées par les
étudiants-tutorés étaient par « oui », dont le
but est de montrer leur accord avec l'idée d'officialiser le tutorat
dans les universités marocaines comme nécessité.
Discussion des données du questionnaire
:
A l'issu des résultats du questionnaire
d'appréciation, nous avons retenu les grandes lignes qui correspondent
à notre sujet de recherche :
l Les tutorés voient en le tutorat un dispositif
d'aide et de soutien, basé sur le principe d'accompagnement et de
collaboration, permettant de faciliter l'apprentissage.
l Les tutorés considèrent le tutorat comme
étant une formule pédagogique utile pour développer les
littéracies universitaires en termes de l'écrit.
l Les tutorés apprécient dans le tutorat des
aspects tels que : la communication, l'interaction, l'échange, la prise
de parole, la participation, le partage d'idée, le travail en groupe, la
relation d'aide et d'accompagnement des tutrices, l'empathie et la
clarté des explications et des cours.
l Les tutorés apprécient l'emploi du temps et
la répartition des séances du tutorat.
l Les tutorés ont trouvé que le climat du
travail du tutorat est propice aux apprentissages.
l Les problèmes que les tutorés ont
trouvés ont été principalement liés à la
disponibilité.
l Les tutorés avancent que le tutorat doit être
officialisé et standardisé au niveau des universités
marocaines.
2- Difficultés rencontrées et propositions
d'amélioration du dispositif à partir du questionnaire
d'appréciation et des journaux de bord
2-1 Les apports :
Tout au long de notre travail de recherche, nous avons
essayé de vérifier d'une part, la pertinence du tutorat en
développement des littéracies universitaires des
étudiants, du côté de l'écrit, autrement dit, nous
avons tenté de s'assurer de l'effet-tutoré, et d'une autre part,
de prouver l'émergence de l'effet-tuteur toujours par le biais de ce
dispositif.
Les outils de recherche que nous avons utilisée
à savoir : l'expérimentation, le questionnaire et le journal de
bord, nous ont été utiles pour construire une idée sur la
mise en place du tutorat dans les universités. L'expérimentation
du tutorat nous a permis de mettre en place concrètement le dispositif
et de suivre régulièrement son fonctionnement durant un mois.
130
A travers cette expérimentation, nous avons pu examiner
le développement des littéracies universitaires des
étudiants du côté de l'écrit. Le journal de bord,
nous a aidés par la suite, pour dégager l'émergence de
l'effet-tuteur et de dire que toutes les tutrices ont tiré
bénéfices de leurs pratiques. Le questionnaire, nous a
été profitable à son tour, c'est grâce à lui,
que nous avons pu conclure que notre dispositif a été
apprécié de la part des étudiants-tutorés.
Notre travail de recherche pourrait donc être une piste
profitable pour les chercheurs ou les établissements qui souhaitent
tester le tutorat, et qui veulent effectuer des recherches concernant les
littéracies universitaires. Il serait donc utile pour ceux qui ne
pratiquent pas le tutorat, dans la mesure où, il contribuera à la
prise de conscience de la nécessité d'incorporer ce dispositif
d'aide et d'accompagnement dans les universités et l'utiliser pour
faciliter l'apprentissage des étudiants. La totalité de ce
travail est donc une invitation aux universités marocaines pour
prévoir des dispositifs comme le tutorat et pour réfléchir
sur leur officialisation.
2-2 Les difficultés rencontrées
:
Les difficultés et les contraintes ont trouvé
leur place au niveau de notre dispositif du tutorat, tout comme la plupart des
expériences et des investigations. Les principales difficultés
que nous avons rencontrées sont principalement :
l Le manque d'interaction de quelques tutorés.
l L'absence de deux groupes durant toute l'expérience.
l Le manque d'implication au niveau des exercices
d'application, dans la mesure où, le nombre des tutorés qui
réalisent régulièrement ces exercices est diminué,
par rapport au nombre des tutorés qui assistent aux sessions
tutorales.
l Les difficultés des tutorés sont beaucoup
plus grandes d'être surmonter dans quelques semaines, et le tutorat ne
peut pas être la méthode miracle permettant la disparition de
l'échec universitaire.
2-3 les propositions d'amélioration du dispositif
:
Dans le but d'améliorer et de perfectionner le
dispositif de base que nous avons proposé, et pour qu'il soit
réinvesti de manière efficace davantage, nous avons posé
cette question tout d'abord aux tutorés, vu qu'un tel dispositif est
généralement conçu pour eux, et par la suite aux tutrices.
Nous avons donc trouvé judicieux de collecter leurs suggestions.
Comme réponse à la question « que
pouvez-vous proposez pour améliorer davantage le dispositif du tutorat
proposé ? », les tutorés à travers le questionnaire
d'appréciation, et les
131
tuteurs au niveau du journal de bord, ont avancé
plusieurs suggestions d'amélioration du dispositif, que nous avons
trouvé judicieux de les collecter. Leurs suggestions étaient
orientées souvent vers le fait que :
- Le tutorat doit impliquer d'une manière
concentrée les différents acteurs pédagogiques (le corps
administratif et pédagogique de l'université).
- Le tutorat doit s'inscrire dans un continuum, car les
étudiants ont besoin de pratiquer l'écriture tout au long de leur
parcours à l'université, et chaque rupture avec cette
dernière risque d'engendrer les mêmes blocages et
difficultés.
- Le tutorat doit faire appel à une liste de
présence obligatoire, et à une sanction des absents.
- Le tutorat doit également laisser aux tutorés
le temps pour qu'ils comprennent le potentiel d'un tel dispositif.
- L'administration doit intégrer le tutorat au niveau
des emplois du temps avec les autres séances.
- Les universités responsables du tutorat doivent
organiser un ensemble de rencontres de sensibilisation sous la supervision des
enseignants, dans le but d'accentuer l'importance de ce programme.
- Les tuteurs et les enseignants doivent montrer d'une
manière concrète aux tutorés des statistiques, des
données, et des résultats qui soulignent l'efficacité et
les bénéfices du tutorat, pour qu'ils puissent le prendre en
considération.
- L'administration de l'université doit annoncer le
tutorat d'une manière officielle à travers l'envoi des emails aux
tutorés, la communication par affiches et annonces écrites et sur
site web, tout dans le but de légaliser davantage le recours à ce
programme.
- Les enseignants et le personnel administratif doivent
suivre régulièrement et d'une manière collaborative les
tutorés après le programme tutoral proposé.
- Les tuteurs doivent tisser des liens de coopération
avec les enseignants, dans le but de se conformer aux attentes de l'institution
et aux demandes du public.
- Les enseignants doivent intervenir au niveau des
premières séances de rencontre et de sensibilisation afin de
capter l'attention et l'implication des tutorés.
- Les concepteurs du tutorat doivent envisager des rencontres
entre les nouveaux tutorés et ceux qui ont déjà
bénéficiés du dispositif, pour mettre la lumière
sur les bienfaits de ce dernier dans la réussite universitaire.
132
- Les enseignants ainsi que les anciens étudiants
doivent se mettre à la disposition des nouveaux tutorés, pour
répondre à leurs questions en cas de doute ou
d'incompréhension de la démarche et du fonctionnement du
tutorat.
- Les résultats du test diagnostic doivent être
communiqués et envoyés à chaque participant. Autrement
dit, chaque étudiant, va recevoir avant le début du tutorat, sa
copie corrigée et accompagnée par l'avis de l'enseignant ou du
chef du département, comme ça il va être conscient plus de
l'intérêt de la participation au niveau de l'action tutorale
proposée. Ces résultats doivent donc être exploités
pour valoriser le tutorat.
- Les tuteurs doivent préparer leurs contenus avec les
enseignants, et doivent de même enrichir leurs interventions par les
directifs et les orientations de ces professeurs.
- Des certificats de participation doivent être remis
aux étudiants-tutorés pour les encourager.
CONCLUSION DE LA PARTIE PRATIQUE:
Au niveau de cette partie pratique, nous avons essayé
de décrire judicieusement notre expérience du tutorat, tout en
présentant, analysant et discutant les différentes données
collectées par le biais de l'expérimentation, du journal de bord
et du questionnaire.
Nous avons mentionné également les apports, les
difficultés rencontrées, ainsi que les propositions
d'amélioration possibles. Ce travail nous a donc montré
l'utilité du tutorat, dans le développement des
littéracies universitaires des étudiants du côté de
l'écrit (l'effet-tutoré), et dans l'émergence des
qualités personnelles et professionnelles des tutrices
(l'effet-tuteur).
133
Conclusion générale :
Le travail de recherche que nous avons effectué sur le
tutorat et les littéracies universitaires au Maroc, le cas d'Ecole
Normale Supérieur de Meknès avait donc pour objectif, le fait de
cerner le rôle de ce dispositif d'aide et d'accompagnement dans
l'acquisition et/ou le développement des littéracies
universitaires du côté de l'écrit. Autrement dit, il
était principalement question, de prouver la pertinence du tutorat en
émergence d'effet-tuteur et d'effet-tutoré à
l'université.
Ce travail été donc élaboré
à la base de deux grandes parties : la théorie et la pratique. La
première était dédiée à la
présentation des concepts clés et des notions indispensables pour
la compréhension du tutorat et des littéracies universitaires. La
deuxième était réservée à la pratique du
tutorat au sein de l'université marocaine, et à la
vérification de son rôle pertinent dans l'émergence de
l'effet-tuteur et de l'effet-tutoré.
Nous pouvons alors avancer tout en se basant sur les
résultats de notre travail de recherche que, la majorité des
tutrices et des tutorés ont tiré bénéfices du
dispositif du tutorat, dans la mesure où, les tutorés ont pu
développer leur compétence scripturale, d'où leur rapport
aux littéracies universitaires. Les tutrices sont sorties à leurs
tours gagnantes de cette affaire, vu qu'elles ont profité d'une
expérience anticipée du métier d'enseignement. Cependant,
il reste nécessaire de développer davantage le dispositif initial
du tutorat proposé, pour qu'il puisse être garant de la
réussite universitaire au Maroc.
En définitive, des interrogations évidentes se
posent : Pourquoi la littéracie vue comme un terme très
répandu au niveau des recherches didactiques en particulier dans le
paradigme francophone, et le tutorat considéré comme un
dispositif d'aide à la réussite dans le contexte universitaire,
n'ont pas encore trouvé leurs places dans les documents officiels
marocains, même au sein des plus récents, en l'occurrence la
vision stratégique de la réforme 2015-2030 ?
Il s'avère alors incontournable, que ces concepts
doivent absolument gagner du terrain, elle et attirer l'attention de la
communauté scientifique, surtout dans un monde où le pouvoir de
l'écrit s'accroit de plus en plus avec l'apport des technologies aussi
puisqu'en dépit des avancées de la didactique en
général et de la didactique de l'écrit et en particulier.
Un monde où l'université marocaine novice, reste encore
confrontée à divers problèmes exprimés par qui
peuvent etre résolus à l'aide des dispositifs de soutien et
d'accompagnement.
134
BIBLIOGRAPHIE
Alava, S., & Clanet, J. (2000). Éléments pour
une meilleure connaissance des pratiques tutorales: regards croisés sur
la fonction de tuteur. Revue des sciences de l'éducation,
26(3), 545-570.
Annoot, E. (2001). Le tutorat ou «le temps
suspendu». Revue des sciences de l'éducation, 27(2),
383-402.
Baudrit, A. (2000). Note de synthèse. Revue
française de pédagogie, 132(1), 125-153. Baudrit,
A. (2002). Le tutorat: richesses d'une méthode
pédagogique. De Boeck,.
Baudrit, A. (2010). Le tutorat: une solution pour les
élèves à risque?. De Boeck Supérieur.
BAZIN, H. (2003). Questions fréquentes sur la
recherche-action, in
rechercheaction. fr (document
électronique).
BENABBES, S. Littéracies universitaires: quel
accompagnement pour des étudiants universitaires algériens en
FLE?.
Blanchet, P., & Chardenet, P. (Eds.). (2015). Guide pour
la recherche en didactique des langues et des cultures: approches
contextualisées. Archives contemporaines.
Charlier, B., Docq, F., Lebrun, M., Lusalusa, S., Peeters, R.,
& Deschryver, N. (1999). Tuteurs en ligne: quels rôles, quelle
formation?.
Crahay, M. (2012). Les littéracies universitaires
peuvent-elles s'enseigner? Quelques questions suscitées par une pratique
de formation en première année d'université. De la
maîtrise du français aux littéracies dans l'enseignement
supérieur, 63-78.
Danner, M., Kempf, M., & Rousvoal, J. (1999). Le tutorat
dans les universités françaises. Revue des sciences de
l'éducation, 25(2), 243-270.
De Grève, M. (1979). Dictionnaire de didactique des
langues: Galisson, Robert and Daniel Coste, Paris, Hachette, 1976; in-8°
obl., 612p. System, 7(1), 72-74.
Delcambre, I., & Lahanier-Reuter, D. (2010). Les
littéracies universitaires: influence des disciplines et du niveau
d'étude dans les pratiques de l'
écrit. Forumlecture.
ch, 3, 1-17.
ESEGHIR, I., & EL MEDIOUNI, A. (2019). La littéracie
au Maroc: entre textes officiels et pratiques des enseignants. Langues,
Cultures et Communication, 3(1), 163-184.
Goyette, G., & Lessard-Hébert, M. (1986). La
recherche-action: Ses fonctions, son fondement et son instrumentation.
PUQ.
Grossmann, F. (1999). Littératie, compréhension et
interprétation des textes. Repères: Recherches en didactique
du français langue maternelle, (19), 139-166.
Hébert, M., & Lépine, M. (2012). Analyse et
synthèse des principales définitions de la notion de
littératie en francophonie. In Actes de la 17e Conférence
européenne sur la lecture (pp. 8898).
135
Hébert, M., & Lépine, M. (2013). De
l'intérêt de la notion de littératie en francophonie: un
état des lieux en sciences de l'éducation 1. Globe,
16(1), 25-43.
Kadi, L. (2009). De la littéracie et des contextes1.
Synergies Algérie, 11-17.
Lafontaine, L., Emery-Bruneau, J., & Guay, A. (2015).
Dispositifs didactiques en littératie universitaire: le cas du Centre
d'aide en français écrit à l'Université du
Québec en Outaouais. Linx. Revue des linguistes de
l'université Paris X Nanterre, (72), 39-54.
Lamoureux, S. A., Vignola, M. J., & Bourdages, J. S. (2020).
Littératie universitaire en milieu francophone minoritaire: vers une
amélioration des habiletés scripturales. Enjeux et
société, 7(2), 156-183.
Lang, E. (2019). L'écrit (ure) universitaire, une
tâche située et complexe: approche holiste du processus
d'adaptation de la compétence scripturale chez les apprenants
avancés en
FLE (Doctoral dissertation, Université de
Strasbourg).
Miniac, B. D. (2003). La littéracie: au-delà du
mot, une notion qui ouvre un champ de recherches variées.
Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften,
25(1), 111-123.
Pourcelot, C. (2016, June). La réussite étudiante
confrontée au non-recours au tutorat méthodologique. In
Rencontres Jeunes Chercheurs-Environnements Informatiques pour
l'Apprentissage Humain 2016.
Pourcelot, C. (2020). Le tutorat universitaire en France:
quelles mises en oeuvre pour quelle évaluation et amélioration?.
La Revue L'Evaluation en Education Online.
Pourcelot, C., & Valéry-Montpellier, P. (2019). La
désaffection du tutorat par les étudiants à
l'Université: enjeux, mises en oeuvre et analyse du
phénomène par les tuteurs. La Recherche en
Éducation, 19(1), 68-83.
Rispail, M. (2011). Littéracie: une notion entre
didactique et sociolinguistique-enjeux sociaux et scientifiques. In Forum
lecture (No. 1).
Sujecka-Zajc, J. (2022). Le tutorat-un dispositif d'aide
à la réussite dans le contexte universitaire.
Néofilologue, 59 (2), 29-42.
Thévenaz-Christen, T. (2011). La littératie, un
concept. In Forum Lecture.
ANNEXES
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'APPRECIATION :
Bonjour, Parce qu'il est très important pour nous de
répondre au mieux à toutes vos demandes, nous vous proposons de
vous exprimer librement sur l'action tutorale après un mois
d'expérience, pour que nous puissions recueillir le maximum
d'informations, afin de développer la formule proposée. Ce
questionnaire est anonyme donc n'hésitez pas à nous faire part de
vos idées. Merci de contribuer avec nous à l'amélioration
du tutorat.
l Qu'est-ce-que le tutorat pour vous ?
l Donnez-moi des mots que vous associez au tutorat ?
l Est-ce que le tutorat vous a été utile ?
Très utile
Assez utile
Peu utile
Pas du tout utile
l Si « peu utile » ou « pas du tout utile
» dites pourquoi ?
l Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce
dispositif ?
l Comment vous avez trouvé l'emploi du temps et la
répartition des séances du tutorat ?
Très réussie
Bien réussie
Pas du tout réussie
l L'atmosphère des séances était-elle
propice et studieuse au travail ?
Beaucoup
Pas du tout
l Trouvez-vous que le tutorat était bien organisé
?
136
Très bien organisé
Pas du tout organisé
l Quels sont les aspects qui vous ai posé
problème lors du tutorat ?
Les heures fixées pour chaque session.
Le nombre d'heures envisagé.
L'adéquation du contenu proposé et vos
besoins.
La qualité d'accompagnement des tutrices.
La gestion du temps.
La connexion.
La disponibilité.
Autres.
l Comment évaluez-vous l'accompagnement et le suivi
des tutrices ?
Très bien.
Bien.
Assez bien.
Médiocre.
l Quelles sont les qualités que vous avez
apprécié chez votre tutrice ?
l Votre expérience du tutorat était :
Satisfaisante
Peu satisfaisante
Pas du tout satisfaisante
l Entant que tutoré je suis satisfait de :
La formation.
La qualité du travail
La relation d'aide omniprésente durant les sessions
l Pour ceux qui ont rejeté l'expérience,
expliquez les causes de ce rejet.
l Est-il nécessaire à votre avis de
standardiser le tutorat dans les universités marocaines ?
Oui
Non
l Résumez votre expérience du tutorat en
quelques lignes.
l Citez à votre tour, des propositions pour
améliorer le dispositif du tutorat.
137
ANNEXE 2 : LISTE DES LACUNES
Analyse de l'évaluation diagnostique
proposée
= J'ai relevé une variété d'erreurs
récurrentes :
Linguistique :
+ Syntaxique :
- Structure syntaxique (formulation des phrases)
- Déterminant
- Accord des adjectifs. Exemple : « Les personnages
principales »
- Nominalisation
- De+infinitif
- A et à, ou et où, à le (au), et, est...
- Omission d'un constituant obligatoire. Exemple : le verbe (la
fourmi toujours...), complément (la cigale
demande-t-elle...)
+ Grammaticale :
- Genre grammatical (Masculin/féminin).Exemple : le
satire, le moral ...)
- Préposition. Exemple : la fable parle sur (de) la cigale
et la fourmi...
+Les graphèmes :
- Omission : en position finale : scénn
- Adjonction : en position finale : parmis
+ Signes diacritiques :
- Accent aigu : En position initiale : etait
: En position médiane : recit
: En position finale : ete
- Accent grave : En position initiale : etait
: En position médiane : recit
: En position finale : etè
- Accent grave : a (à).
- Accent circonflexe : En position initiale : etre
: En position médiane : l'aumone
+Phonique :
- Confusion phonique dont la cause est les variantes des
phonèmes : Exemple : commonce, ropot,
contrère...
+ Morphologique et morphosyntaxique :
- Formes verbales. Exemple : (deux verbes qui se suivent, mettre
le deuxième à l'infinitif).
- Accord sujet-verbe.
- Temps et modes.
+ Méthodologique :
- Absence de formulation des réponses. Exemple : (les deux
substantifs sont-elles écrites en majuscule, car
elles sont les personnages principaux).
- Absence des justifications des réponses.
- Utilisation des abréviations lors de la
rédaction. Exemple (tmps=temps ; vrmnt=vraiment...).
+ Autres problèmes :
- L'influence de la langue maternelle (arabisme), au niveau des
idées et de l'orthographe).
- Choix lexical.
- Les répétitions et la paraphrase.
- Absence des liens logiques (et parfois une fausse
utilisation de ces connecteurs). Exemple : (employer
« à cause
de » pour exprimer « grâce à », utiliser «
cependant » pour marquer l'addition...)
- Des fautes par rapport au sens. Exemple (provocation, pour
dire évocation ; cours, pour dire court ; son pour dire sans ; vert pour
dire vers...).
138
ANNEXE 3 : LE MODELE VIERGE DU JOURNAL DE BORD :
Journal de bord Âge de la tutrice : Niveau d'études
: Date de la séance :
|
Actions et pratiques mises en place (à
adapté et à compléter en fonctions des
séances)
|
Description et observations du tuteur
|
|
Présentation (tuteurs et tutorés engagés
dans le dispositif et exposition des rôles)
|
|
|
Organisation du calendrier des séances (dates,
durée et horaires)
|
|
|
Déroulement de la séance (sensibilisation,
informations et précisions utiles, objectifs et visées, contenus
et cours, outils et supports, compétences travaillées,
activités proposées)
|
|
|
Qualité d'échange (réponses aux questions
des tutorés, interactions)
|
|
Expérience personnelle des tuteurs « le dire sur le
faire » : Propositions d'amélioration du dispositif :
ANNEXE 4 : EXEMPLAIRE D'UN JOURNAL DE BORD DE
TUTRICE
REMPLI :
Age de la tutrice : 22ans
Niveau d'études : Deuxième année master
Date de la séance : la première séance,
samedi le : le 04/03/2023
|
Actions et pratiques mises en place (à
adapté et à compléter en fonctions des
séances)
|
Description et observations du tuteur
|
|
Présentation (tuteurs et tutorés
engagés dans le dispositif et
exposition des
rôles)
|
Lors de cette première séance de rencontre et de
sensibilisation, on s'est présentés les tutorés et moi,
chacun par son nom, prénom, et âge. Egalement c'était une
opportunité à travers laquelle on a évoqué notre
expérience scolaire et universitaire, avec les difficultés, les
besoins, et les exigences qu'on a rencontré.
En ce qui concerne trois tutorés de mon groupe, ils ont
affirmé qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat scientifique,
même deux étudiants ont déjà commencé leurs
parcours universitaire à la FST, et à la faculté des
sciences dans une filière des sciences de la vie et de la terre. Par la
suite on a parlé des rôles qu'on va jouer au niveau de ce
dispositif comme une sorte de mise en situation et pour que chacun se
positionne face à sa tâche.
|
|
Organisation du calendrier des séances (dates,
durée et horaires)
|
On a opté pour des séances durant le week-end et
on s'est mis d'accord sur des horaires convenables pour tous les membres du
groupe, dans le but de garantir d'avantage leur présence. Les
tutorés ont choisi de faire la séance à 17h samedi, et de
la commencer à 12h dimanche.
|
|
Déroulement de la séance
(sensibilisation, informations et
précisions utiles, objectifs et
visées, contenus
et cours, outils et
|
Pendant cette séance nous avons entamé une
discussion par rapport aux bienfaits de l'éducation et
l'intérêt d'assister aux cours et de suivre l'enseignant,
également par rapport au choix de la filière du français
et du domaine de l'enseignement.
|
139
supports, compétences travaillées, activités
proposées)
|
Ensuite on a évoqué les principales idées
concernant le tutorat
d'accompagnement, ses objectifs, ses avantages, les contextes
dans lesquels il est favorisé, aussi par rapport à la notion de
la littéracie universitaire et surtout la compétence scripturale.
Nous avons montré aux étudiants la visée de ce programme
et le fait que leur implication, va nous servir dans notre mémoire de
fin d'étude, et qu'il s'agit d'une aide
réciproque, c'est-à-dire, qu'à leur tour
, ils vont bénéficier de ce
programme pour dépasser
leurs difficultés.
|
|
La séance a duré approximativement une heure, vu
la grande implication du public, qui était à l'heure et qui a
exprimé ses besoins et son expérience.
|
|
Enfin, j'ai annoncé le déroulement des
séances à venir, j'ai également accentué les
étapes de chaque séance, et même l'évaluation qui va
être formative dans chaque semaine, et sommative vers la fin du
dispositif.
|
|
Aussi, les tutorés ont été au courant par
rapport aux contenus des cours et aux exercices de pratique.
|
|
Qualité d'échange (réponses aux
|
Cette séance était riche en interaction et en
échange, chaque tutoré a pris
|
|
questions des tutorés, interactions)
|
la parole même ceux qui ont affirmé au
préalable qu'ils sont timides, ils répondaient aux questions
posées, ils réagissent avec les propos avancés par leurs
camarades et ils expriment leur point de vue face à ce que j'annonce.
Les quatre membres étaient impliqués et intéressés
par la session.
|
Expérience personnelle des tuteurs « le
dire sur le faire » :
« Personnellement, et à partir de la
première rencontre avec ses tutorés, j'ai ressenti des ondes
positives face à cette expérimentation, l'échange avec eux
et comment ils expriment leur gratitude et leurs reconnaissance pour l'action
me motive plus, pour leurs rendre service et pour être à leur
disposition. Et je pense que dans les séances à venir l'action
va-nous porter des bénéfices pour nous en tant que tutrices
également. En somme, J'ai beaucoup apprécié cette
initiative d'accompagnement des étudiants, ce n'est que la
première séance, mais je me sens très familiarisée
avec les étudiants. J'ai pu capter leur attention, à travers
l'évocation de mon cursus universitaire, du choix de l'éducation
comme domaine d'études, des bienfaits de l'enseignement, et de
l'objectif ultime du tutorat d'accompagnement. Approximativement, dans une
durée qui ne dépassait pas une heure, j'ai pu avoir la
confirmation des étudiants concernant leur participation au tutorat. Au
niveau de cette séance, j'ai plutôt senti un renforcement de
nature relationnelle ».
Propositions d'amélioration du dispositif
:
Personnellement, je vois que le tutorat doit continuer, car
les étudiants ont besoin de pratiquer l'écriture tout au long de
leur cursus université.
140
ANNEXE 5 : LE TEST DIAGNOSTIC :
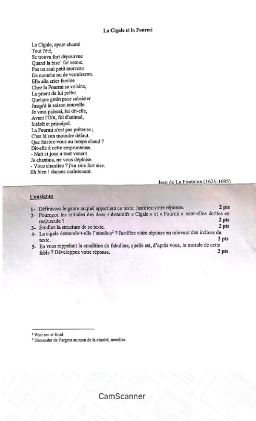
141
ANNEXE 6 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AU TEST
DIAGNOSTIC :
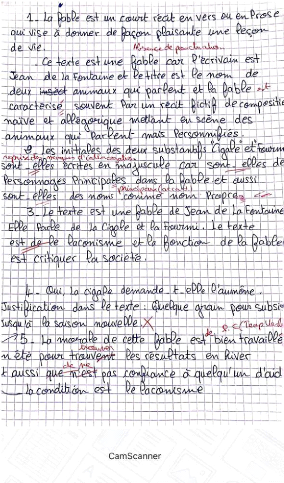
142
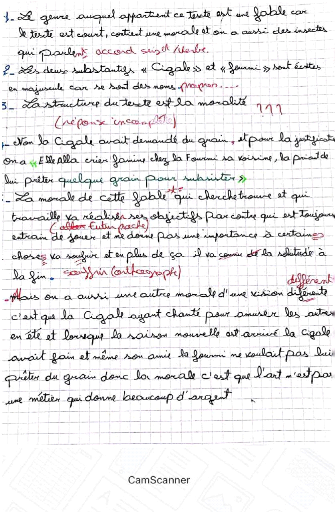
143
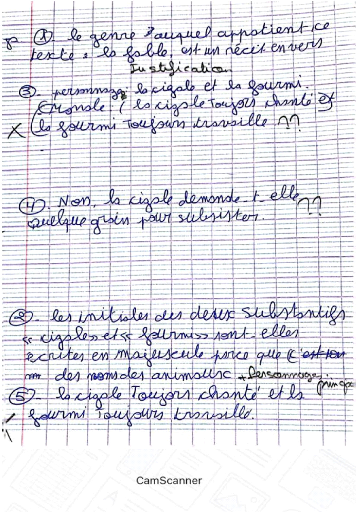
144

145

146
ANNEXE 7 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AUX
EXERCICES D'APPLICATION DU TUTORAT
Exemple1 :
1) Le type de ce texte est un récit de voyage, et
parmi les indices qui l'indiquent, on trouve l'auteur qui raconte une partie de
sa vie.
2) La relation entre la nation des Margajas et les portugais
est une relation amicale. Par cette relation avec les français est
très agressive.
3) Le champ lexical d'alimentation et de la nourriture : les
fruits, la farine, les jambons...
4) Les sauvages ont bien accueilli le narrateur et ses
compagnons, ce qui le montre du texte est la phrase suivante : « pour nous
les offrir et nous souhaiter les bienvenue, six hommes et une femme ne firent
pas de difficultés à montrer en barque et à venir nous
voir dans le bateau ».
5) Les éléments qui distinguent les habitants
de cette terre des autres, est le fait qu' « ils avaient tout le corps
peint en noir. Et les hommes étaient tondus de près sur le devant
de la tête ».
Exemple2 :
1) Il s'agit d'un texte narratif vu la présence des
temps du récit (l'imparfait, le passé simple, le présent
de la narration), ainsi que le schéma narratif.
2) La relation entre la nation des Margajas et les portugais
est une relation amicale, alors qu'avec les français est agressive.
3) Concernant le champ lexical d'alimentation et de la
nourriture on trouve : la farine, des vivres, des jambons, des fruits ...
4) Les sauvages ont accueils le narrateur et ses compagnons
gentiment, ce qui le montre dans le texte est : « pour nous les offrir et
nous souhaiter les bienvenue, six hommes et une femme ne firent pas de
difficultés à monter en barque et à venir nous voir dans
le bateau ».
5) Les éléments qui distinguent les habitants
de cette terre des autres sont : le corps peint en noir, les hommes
étaient tondus de prés sur le devant de la tête, ils
portaient une pierre verte, la femme n'avait pas la lèvre fendue,
à ses oreilles, si affreusement percées qu'on aurait pu passer le
doigt dans les trous.
Exemple3 :
Le déplacement en ville n'est pas facile.
Se déplacer en ville n'est pas toujours facile. Les
grandes villes proposent depuis longtemps des moyens de transport, mais ces
derniers ont aussi leur inconvénient. Le métro est très
fréquent aux heures de pointe et on ne s'y sent pas toujours en
sécurité à certaines heures.
Le bus est certes très pratique, mais il dépend
beaucoup de la qualité du trafic. Les taxis sont trop chers pour une
utilisation quotidienne. Le tramway, quant à lui, ne couvre qu'une zone
limitée des espaces urbains.
On peut bien sûr prendre nos voitures, mais les
embouteillages ou la difficulté pour se garer sont nombreuses et l'heure
d'arrivée à un rendez-vous n'est jamais garantie.
Depuis les années 2000, on constate des changements de
mentalités.
Les médias, les entreprises, les municipalités
et les écologistes invitent de plus en plus les citoyens à
utiliser le vélo pour circuler dans les villes, pour qu'ils puissent
protéger l'environnement.
147
Exemple 4 :
Faire du sport serait bon pour la santé : les
médecins, les psychologues, les professeurs de sport le disent. En fait,
il serait le remède contre la violence des adolescents, et beaucoup de
parents qui ont des enfants un peu trop agressifs se précipitent par les
inscrire dans un club de tennis où de foot, et dans les écoles le
sport des vu comme la solution miracle contre l'agressivité.
Exemple 5 :
Le selfie spectaculaire permet au sujet d'être
exceptionnel en se mettant en scène dans des situations exceptionnelles
et spectaculaires, mais très risquées. Certains font même
le buzz avec le « chinning », photographie redoutable de leur double
menton en contre plongée, devant les sites touristiques. Des grands
déprimés se prennent en selfie, « ce qui permet aussi
d'exister ». Le « photobomb » est un selfie parfois hilarant
où l'arrière-plan vient délivrer un message incongru,
à l'insu du photographe créatif, transgressif, militant.
Exemple 6 :
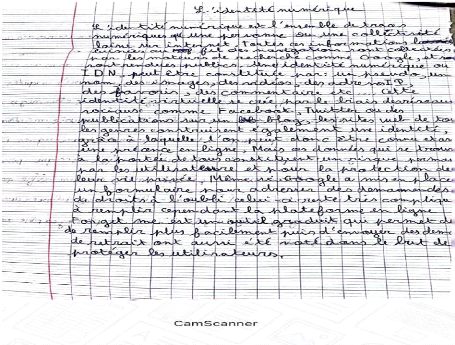
148
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE 2
LISTES DES TABLEAUX 4
LISTES DES FIGURES 4
REMERCIEMENT 5
DEDICACE 6
INTRODUCTION GENERALE 7
PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE 11
CHAPITRE 1 : L'ECRITURE EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE. 11
1- La notion de l'écrit. 12
1-1 Qu'est-ce que l'écrit : 12
1-2 la compétence scripturale : 13
1-3 L'écrit comme un objet et un outil
d'enseignement/apprentissage : 14
2-Le contexte universitaire. 14
2.1- l'enseignement supérieur au Maroc : 14
2.2- Le Français Sur Objectif Universitaire : 15
2.3- la didactique du français et les littéracies :
16
2.4- L'écriture à l'université : un enjeu
complexe : 18
2.5- L'importance de l'écriture à
l'université : 19
Conclusion du chapitre 1 19
CHAPITRE 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA LITTERACIE ET LA LITTERACIE
UNIVERSITAIRE. 20
1- La littéracie. 21
1-1 L'histoire de la littéracie : 21
1-2 La littéracie : essai de définitions : 23
1-3 Les caractéristiques de la littéracie : 26
1-4 Les dimensions de la littéracie : 27
1-5 Les types de littéracies : 28
2- Les principaux débats autour de la littéracie :
l'orthographe et la classification du terme 29
3- L'importance de la littéracie. 31
3-1 l'objectif de la littéracie : 31
3-2 les atouts majeurs de la littéracie: 31
3-3 la place accordée à la littéracie:
32
4- Les éléments favorisant la mise en place des
compétences littéraciques. 32
4-1 Concevoir un environnement adopté à
l'apprentissage de la littéracie : 32
4-2 L'enseignement efficace de la littéracie : 33
149
4-3 L'évaluation de la littéracie : 35
4-4 la complexité de la littéracie : 36
5- La littéracie universitaire : 37
5-1 la littéracie universitaire : tour d'horizons : 37
5-2 Les besoins des étudiants et les aspects propres
à l'écriture en université : 39
5-3 Les différentes formes d'aide existantes pour
contribuer au développement des
compétences littéraciques : 41
Conclusion du deuxième chapitre : 42
CHAPITRE 3 : LES PRATIQUES FAVORISANT L'ACCES DES
ETUDIANTS EN LITTERACIE
UNIVERSITAIRE : LE TUTORAT 43
1- Le tutorat : 44
1-1 L'histoire du tutorat : 44
1-2 Le tutorat : un dispositif : 45
1-3 Le tutorat : essai de définitions : 45
1-4 Les différentes formes du tutorat : 47
1-5 La différence entre le tutorat et le mentorat :
48
1-6 Les conditions à mobiliser pour garantir la
réussite du tutorat : 50
1-7 Les avantages du tutorat : 52
1-8 Les failles et les limites de l'introduction
officialisée du tutorat à l'université : 53
2- le tutorat dans différents contextes
académiques : 54
2-1 le tutorat dans le contexte académique anglo-saxon :
54
2-2 le tutorat dans le contexte académique
français : 55
2-3 le tutorat dans le contexte académique marocain :
56
2-4 le tutorat dans le contexte académique polonais :
59
3- les protagonistes de l'action tutorale : le tuteur et le
tutoré : 59
3-1 le tuteur : 59
3-2 le rôle et les fonctions du tuteur : 61
3-3 les critères du choix du tuteur : 62
3-4 l'effet-tuteur : 65
3-5 Le tutoré : 68
Conclusion du chapitre 3 : 69
CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE : 69
PARTIE 2 : PRATIQUE ET EMPIRIQUE 70
CHAPITRE I : METHODOLOGIE DE RECHERCHE ET PRESENTATION DE
L'INVESTIGATION 70
1- Techniques d'enquête : 70
1-1 L'approche qualitative: 71
1-2 La recherche action : 73
150
1-3 les instruments de collecte de données : 78
1-3-1) Le questionnaire : 78
1-3-2) le journal de bord : 79
2- Expérimentation du tutorat : 79
2-1 Terrain d'études : 79
2-2 Motivation du choix : 79
2-3 Présentation d'ENS Meknès : 79
2-4 Présentation de l'expérience : 80
2-5 Les objectifs de l'expérimentation : 82
2-6 Echantillon de référence : 83
2-7 La description de la mise en place et du
déroulement de l'expérimentation (le tutorat): 83 CHAPITRE II :
RECUEIL, PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET DISCUSSION DES RESULTATS . 92
1- L'effet-tutoré : Recueil, présentation et
l'analyse du contenu d'exercices proposés aux
tutorés, et discussion des résultats 92
2-L'effet-tuteur : 105
2-1 Présentation du journal de bord et son objectif :
105
2-2 Elaboration du journal de bord : 105
2-3 Recueil et analyse des données du journal de bord :
106
2-4 Discussion des données de l'expérience : (en
termes d'effet-tuteur et d'effet-tutoré) : 113
Chapitre III : Retour sur l'expérimentation et
vérification des hypothèses : 114
1- Le questionnaire d'appréciation : (retours des
tutorés) 114
1-1 Présentation du questionnaire d'appréciation
et son objectif : 114
1-2 Elaboration du questionnaire : 114
1-3 Recueil, analyse et discussion des données du
questionnaire 115
2- Difficultés rencontrées et propositions
d'amélioration du dispositif à partir du questionnaire
d'appréciation et des journaux de bord 129
2-1 Les apports : 129
2-2 Les difficultés rencontrées : 130
2-3 les propositions d'amélioration du dispositif :
130
CONCLUSION DE LA PARTIE PRATIQUE: 132
Conclusion générale : 133
BIBLIOGRAPHIE 134
ANNEXES 136
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'APPRECIATION : 136
ANNEXE 2 : LISTE DES LACUNES 137
151
ANNEXE 3 : LE MODELE VIERGE DU JOURNAL DE BORD :
138
ANNEXE 4 : EXEMPLAIRE D'UN JOURNAL DE BORD DE TUTRICE REMPLI
: 138
ANNEXE 5 : LE TEST DIAGNOSTIC : 140
ANNEXE 6 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AU TEST
DIAGNOSTIC : 141
ANNEXE 7 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AUX EXERCICES
D'APPLICATION DU
TUTORAT 146
TABLE DES MATIERES 148
| 


