|

REPUBLIQUE DU CAMEROUN FACULTE D'AGRONOMIE ET
DES
SCIENCES AGRICOLES
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix-travail-Patrie FACULTY OF AGRONOMY AND
Peace-Work- Fatherland
AGRICULTURAL SCIENCES
UNIVERSITE DE DSCHANG Dschang school of Agriculture
and
Environmental Sciences
UNIVERSITY OF DSCHANG
Scholae Thesaurus DschangensisIbiCordum B.P.96, Dschang
(Cameroun)-Tél./Fax: 233 45 13
BP 222, Dschang (Cameroun) Tél'/Fax(237)33 45 1566
81 Website:
http://www.univ-dschang.org
E-mail:
udsrectorat@univ-dschang.org
E-mail:
fasa@univ-dschang.org
DEPARTEMENT DE FORESTERIE
DEPARTMENT OF FORESTRY
LABORATOIRE DE FAUNE ET AIRES PROTEGEES, SYLVICULTURE ET
TECHNOLOGIE DU BOIS (LAFAPSYTEB)
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET AMELIORATION DES INVENTAIRES
FAUNIQUES : CAS DES DRONES ET CAMERA-PIEGES DANS LA GESTION DURABLE DES
HIPPOPOTAMES DE L'UTO BENOUE, NORD CAMEROUN
Mémoire en vue d'obtention du diplôme
d'ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses
Par : MELI
MERLIN
Ingénieur des Travaux des Eaux, Forêts et
Chasses
Matricule : CM-UDs-15ASA0454
Option : Forêts et
Agroforesterie
22ieme promotion
Juillet 2019

REPUBLIQUE DU CAMEROUN FACULTE D'AGRONOMIE ET
DES
SCIENCES AGRICOLES
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix-travail-Patrie FACULTY OF AGRONOMY AND
Peace-Work- Fatherland
AGRICULTURAL SCIENCES
UNIVERSITE DE DSCHANG Dschang school of Agriculture
and
Environmental Sciences
UNIVERSITY OF DSCHANG
Scholae Thesaurus DschangensisIbiCordum B.P.96, Dschang
(Cameroun)-Tél./Fax: 233 45 13
BP 222, Dschang (Cameroun) Tél'/Fax(237)33 45 1566
81 Website:
http://www.univ-dschang.org
E-mail:
udsrectorat@univ-dschang.org
E-mail:
fasa@univ-dschang.org
DEPARTEMENT DE FORESTERIE
DEPARTMENT OF
FORESTRY
LABORATOIRE DE FAUNE ET AIRES PROTEGEES, SYLVICULTURE ET
TECHNOLOGIE DU BOIS (LAFAPSYTEB)
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET AMELIORATION DES INVENTAIRES
FAUNIQUES : CAS DES DRONES ET CAMERA-PIEGES DANS LA GESTION DURABLE DES
HIPPOPOTAMES DE L'UTO BENOUE, NORD CAMEROUN
Mémoire en vue d'obtention du diplôme
d'ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses
Par : MELI
MERLIN
Ingénieur des Travaux des Eaux, Forêts et
Chasses
Matricule : CM-UDs-15ASA0454
Option : Forêts et
Agroforesterie
22ieme promotion
SUPERVISEUR
Pr BOBO KADIRI Serge
Maître de Conférences
Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles
Université de Dschang
ENCADREUR
Mr MBAMBA MBAMBA Jean
Paul
Kévin
MSc, Ingénieur des Eaux, Forêts
et
Chasses
Spécialiste de la Faune
Conservateur du Parc
National de la
Bénoué
Juillet 2019
i
FICHE DE CERTIFICATION DE L'ORIGINALITE DU
TRAVAIL
Je, soussigné MELI MERLIN, atteste que
le présent mémoire est le fruit de mes propres travaux
effectués dans le Parc National de la Bénoué sur «
les nouvelles technologies et amélioration des inventaires fauniques :
cas des drones et camera-pièges dans la gestion durable des hippopotames
du PNB», sous la supervision de Pr. BOBO KADIRI Serge,
Maître de Conférences à la Faculté d'Agronomie et
des Sciences Agricoles de l'Université de Dschang, et l'encadrement
technique de M. MBAMBA MBAMBA Jean Paul Kevin, Conservateur du
Parc National de la Bénoué.
Le présent mémoire est authentique et n'a pas
été antérieurement présenté pour
l'acquisition de quelque grade universitaire que ce soit.
Signature de l'auteur Visa du superviseur
MELI MERLIN Pr. BOBO KADIRI Serge
Date / / Date / /
Visa du chef de département
Pr. TCHAMBA Martin
Date / /
ii
DEDICACE
A
Mon père DJIAFOUET Daniel et ma mère MAFOUO
Rose.
iii
REMERCIEMENTS
Les résultats présentés dans le
présent document n'auraient vu le jour, sans la bienveillante
contribution de certaines personnes. Puisse chacune d'elles, en lisant son nom
sur cette page, recevoir l'expression de toute ma considération et de ma
sincère gratitude. Il s'agit particulièrement de :
- Pr. BOBO KADIRI Serge, Maître de Conférences
à la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles de
l'université de Dschang, qui m'a donné l'occasion d'effectuer ce
travail et également a accepté de le superviser ;
- M. MBAMBA MBAMBA Jean Paul Kevin, Conservateur du Parc
National de la Bénoué (PNB), pour son encadrement technique, ses
encouragements et les aides apportées pendant cette étude ;
- Tout le personnel enseignant de la FASA et
particulièrement ceux du Département de Foresterie, pour les
enseignements reçus durant toute notre formation. Il s'agit notamment du
Pr. TCHAMBA, Pr. EFOLE, Dr. AVANA, Dr. MAYEBEME, Dr. TEMGOUA Lucie ;
- Mes parents DJIAFOUET Daniel et MAFOUO Rose, qui m'ont
donné l'occasion de voir le jour et de pouvoir effectuer cette
étude ;
- Mon cousin Mr KAZE Severin, pour l'accueil, son aide
financier et assistance matériel, durant tout mon cursus
académique ;
- Mr DIFOUO AIME Bertrand, qui m'a toujours soutenu quand
besoins s'imposait malgré ses multiples obligations ;
- Mr MELI Simplice pour ses encouragements ;
- Ma nourrisse Mm DOUMTSOP PIATA Yvonne, pour tout son aide ;
- Mes grandes soeurs DJIMELIE Annette et TIOMELA PARRO
Chantal, pour leurs assistance ;
- Tout le personnel éco-garde du PNB et
particulièrement NDANDJON Marcel, KOSGA Robert, BOLAP Patrick, EKANI,
SANDA, TCHOUOBONG Maurice, pour leur aide et soutien pendant l'étude
;
- Tous les volontaires du PNB et particulièrement
HAMADOU et Mr PAIL, pour leur aide ;
- Mes compagnons de stage, KEBIWA Ulrich, CHEBOU Luc, pour l'aide
et le soutien moral ;
- Mes camarades de promotion pour les meilleurs moments
passés ensemble ces dernières années.
iv
TABLE DE MATIERES
FICHE DE CERTIFICATION DE L'ORIGINALITE DU TRAVAIL i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
TABLE DE MATIERES iv
LISTE DES TABLEAUX viii
LISTE DES FIGURES ix
LISTE DES ANNEXES x
LISTE DES ACRONYMES xi
RESUME xiii
ABSTRACT xiii
CHAPITRE I : INTRODUCTION 1
I.1. Contexte et justification 1
I.2. Problématique 2
I.3. Objectifs 4
I.4. Intérêt de l'étude 5
1.5. Limite de l'étude 5
CHAPITRE II : DEFINITION DES CONCEPTS ET REVUE DE LA LITTERATURE
6
II.1. Définition des concepts 6
II.1.1. Drone 6
II.1.2. Camera-pièges 6
II.1.3. Gestion durable 6
II.1.4. Inventaire de faune 6
II.1.5. Aire protégée 6
II.1.6. Parc national 7
II.1.7. Conservation 7
II.1.8. Habitat 7
II.1.9. Abondance absolue 7
II.1.10. Abondance relative 7
II.1.11. Méthodes directes d'inventaire 7
II.1.13. Piégeage photographique 7
II.1.14. Population 8
II.1.15. Saline 8
II.2. Revue de la littérature 8
II.2.1. Problématique de la conservation de la
biodiversité au Cameroun 8
v
II.2.2. Cadre politique des inventaires fauniques 9
II.2.3. Cadre juridique des inventaires fauniques 10
II.2.4. Cadre institutionnel des inventaires fauniques 12
II.2.5. Utilisation des pièges photographiques comme
méthode d'inventaire 13
II.2.6. Quelques caractéristiques techniques de Bushnell
ESTD 13
II.2.7. Utilisation des drones en inventaire faunique 14
II.3. Généralités sur les hippopotames 15
II.3.1. Classification systématique de l'hippopotame 15
II.3.2. Comportement 16
II.3.3. Alimentation 16
II.3.4. Reproduction 16
II.3.5. Habitat 16
II.3.6. Distribution des hippopotames en Afrique 17
II.3.7. Hippopotames au Burkina Faso 17
II.3.8. Hippopotames au Benin 18
II.3.9. Hippopotames au Cameroun 19
II.3.10. Importance culturelle et socio-économique des
hippopotames 19
II.1.12. Méthodes indirectes d'inventaire 20
II.1.13. Principe de recensement des hippopotames 20
II.1.13.1. Recensement par camera-traps 20
II.1.13.2. Recensement par drone 20
CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODES 21
III.1. Zone d'étude 21
III.2. Milieu biophysique 22
III.2.1. Climat 22
III.2.2. Relief et topographie 22
III.2.3. Hydrographie 23
III.2.4. Flore 23
III.2.5. Faune 24
III.3. Milieu Humain 25
III.3.1. Population 25
III.3.2. Usage socio-économique du parc et de sa zone
périphérique 25
III.3.2.1. Tourisme de vision 25
III.3.2.2. Tourisme cynégétique 26
III.3.2.3. Agriculture 26
vi
III.3.2.4. Orpaillage 27
III.3.2.5. Elevage 27
III.3.2.6. Braconnage et Commerce de la viande de brousse 27
III.3.2.7. Pêche 28
III.3.3. Bois de chauffage et de service. 28
III.3.3.1 Bois de chauffage 28
III.3.3.2. Bois de service 28
III.3.4 Produits forestiers non ligneux 28
III.3.4.1. Espèces utilisées pour la
pharmacopée 29
III.3.4.2 Paille 29
III.3.4.3 Espèces fruitières 29
III.3.4.4. Espèces utilisées pour la corde 30
III.3.4.5. Champignons 30
III.3.4.6. Miel 30
III.4. Collecte des données 30
III.4.1. Données secondaires 30
III.4.2- Données primaires sur l'évaluation de la
structure de la population d'hippopotames 30
III.4.3. Données sur les menaces qui pèsent sur la
faune en générale et les hippopotames en
particulier 31
III.4.4. Déroulement de l'inventaire 31
III.5. Traitement des données 32
III.5.1 Evaluation de la structure de la population
d'hippopotames 32
III.5.1.1. Sélection d'images 32
III.5.1.2. Comptage à l'aide d'images 32
III.5.1.3. Comptage par station 32
III.5.2. Evaluation de l'influence des activités
anthropiques sur les indices d'hippopotames 33
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSIONS 34
IV.1. Résultats 34
IV.1.1. Structure de la population d'hippopotames 34
IV.1.1.1. Effectif d'hippopotames par mare visitée 34
IV.1.1.2. Distribution par groupe 35
IV.1.1.3. Caractérisation des mares 36
IV.1.1.4. Organisation sociale et structure de la population
37
IV.1.1.5. Calcul de quelques paramètres 38
IV.1.1.6. Distribution spatiale des hippopotames 39
IV.1.1.7. Tendance évolutive des effectifs d'hippopotames
dans le PNB 40
vii
IV.1.1.8. Hautes valeurs de conservation 41
IV.1.1.9 Période de détectabilité des
hippopotames 41
IV.1.2. Proposer une stratégie de gestion des hippopotames
dans le PNB 43
IV.1.2.1. Etat des lieux des menaces qui pèsent sur les
hippopotames et leur habitat 43
IV.1.2.1.1. Braconnage 43
IV.1.2.1.2. Orpaillage clandestin 44
IV.1.2.1.3. Pêche illégale 45
IV.1.2.1.4. Variations climatiques 46
IV.1.2.1.5. Transhumance de troupeaux de boeufs 46
IV.1.2.1.6. Abondance des activités anthropiques de
manière générale dans l'UTO Bénoué 47
IV.1.2.1.7. Distribution spatiale des menaces sur les
hippopotames 48
IV.1.2.1.8. Relation entre les activités humaines et les
indices hippopotames 48
IV.1.2.2. Stratégie de gestion des hippopotames dans l'UTO
Bénoué 50
IV.1.2.2.1. Vision 50
IV.1.2.2.2. But 50
IV.1.2.2.3. Axes stratégiques 50
IV.1.2.3. Cadre temporel des différentes actions 53
IV.1.2.4. Evaluation des coûts 53
IV.2. DISCUSSION 55
CHAPITRE V : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 57
BIBLIOGRAPHIE 59
ANNEXES 66
viii
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Caractéristiques de la camera Bushnell 14
Tableau 2: Effectifs d'hippopotames par mare 34
Tableau 3: Caractérisation des mares 36
Tableau 4: IKA d'indices d'hippopotames 38
Tableau 5: Abondance des signes de braconnage 44
Tableau 6: Abondance des signes d'orpaillage 45
Tableau 7: Abondance des signes de pêche 46
Tableau 8: Abondance des signes de transhumance 47
Tableau 9: Abondance des activités humaines dans l'UTO
Bénoué 47
Tableau 10: Evaluation des coûts de la stratégie
de gestion des hippopotames 53
ix
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Distribution des hippopotames en Afrique 17
Figure 2: Parc National de la Bénoué dans le
complexe des aires protégées du nord 21
Figure 3: Diagramme ombrothermique (1982-2012) 22
Figure 4: Diagramme des effectifs d'hippopotames par mares
35
Figure 5: Distribution des hippopotames par groupe 37
Figure 6: Groupe d'hippopotame dans une mare de l'UTO
Bénoué 38
Figure 7: Distribution des hippopotames dans l'UTO
Bénoué 39
Figure 8: Tendance évolutive des populations
d'hippopotames dans l'UTO Bénoué 40
Figure 9: Hautes valeurs de conservation 41
Figure 10 : Heure de sortie des hippopotames 42
Figure 11: Heure de retour des hippopotames 42
Figure 12: Carcasse d'hippopotame (a) et braconnier
interpellé (b) 43
Figure 13: Signe de présence humaine dans le PNB 45
Figure 14: Carte des activités anthropiques dans l'UTO
Bénoué 48
Figure 15: Relation entre les activités humaines et les
indices d'hippopotames 49
Figure 16: Carte des interactions entre les activités
humaines et les indices d'hippopotames 49
x
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1: Fiche des données sur la structure de la
population d'hippopotames 66
Annexe 2 : Fiches des données sur les menaces sur les
hippopotames 66
Annexe 3: Planche photographique 67
xi
LISTE DES ACRONYMES
CEIBC : Centre d'Echange d'Information sur la
Biodiversité du Cameroun.
CITES : Convention sur le Commerce International
des Espèces de faune et de
flore sauvage menacées d'extinction
COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique
Centrale
DRFFN : Délégation
Régionale des Forêts et de la Faune du Nord
FAO : Organisation des Nation Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
FASA : Faculté d'Agronomie et des
Sciences Agricoles
IKA : Indices Kilométriques
d'Abondance
INS : Institut Nationale de la Statistique
MINEF : Ministère de l'Environnement et
des Forêts
MINEP : Ministère de l'Environnement et
de le Protection de la nature
MINEPDEDD : Ministère de l'environnement,
de la Protection de la Nature de du Développement Durable
MINFOF : Ministère des Forêts et de
la Faune
OAB : Organisation Africaine du Bois
OIBT : Organisation Internationale des Bois
Tropicaux
PAFN : Plan d'Action Forestier National
PAFT : Plan d'Action Forestier Tropical
PFBC : Programme des Forêts du Bassin du
Congo
PNB : Parc National de la
Bénoué.
PNBN : Parc National de Bouba-Ndjiddah
PNF : Parc National du Faro
PNGE : Plan National de Gestion de
l'Environnement
UICN : Union Internationale pour la Conservation
de la Nature
PSFE : Programme Sectoriel Forêt et
Environnement
xii
WWF : World Wild Fund for Nature/ Fond
mondial pour la nature
ZIC : Zone d'Intérêt
Cynégétique
xiii
RESUME
La présente étude réalisée dans
l'Unité Technique Opérationnelle Bénoué (UTO
Bénoué) durant la période allant du 1er janvier
au 31 mai 2019 a essentiellement porté sur les « nouvelles
technologies et amélioration des inventaires fauniques : cas des drones
et camera-pièges dans la gestion durable des hippopotames de l'UTO
Bénoué ». D'une façon globale, l'étude avait
pour objectif d'apporter des informations qualitatives et quantitatives dont la
portée est de contribuer à la meilleure connaissance des
effectifs d'hippopotames dans l'UTO Bénoué afin de planifier la
gestion durable de cette espèce. La méthode de comptage
utilisée durant cette étude est le comptage total qui s'est
déroulé à travers plusieurs techniques entre autres le
piégeage photographique, la station de comptage pédestre et le
survol par drone. Après analyse des données, 287 hippopotames ont
été inventoriés dans 16 mares permanentes situées
sur les 120 km que couvre le cours du fleuve Bénoué soit environ
2 individus par km. La mare ayant la plus forte concentration de cette
espèce se trouve sur le Mayo-Oldiri située dans la ZIC 3 soit 34%
de l'effectif total. La tendance évolutive de cette espèce se
présente en trois phases notamment la période allant de 1975
à 1999 où il y a un accroissement de la population d'hippopotame
puis de 2012 à 2014 caractérisée par une baisse de
l'effectif et la période allant de 2016 à 2019 marquée par
une augmentation progressive des effectifs d'hippopotames. Les plus
récents sont ceux réalisés par MBAMBA en 2013, 2016 et
2018 dont les résultats sont 205, 228 et 217 respectivement. Les
principales menaces qui affectent les hippopotames sont entre autre le
braconnage, la transhumance, la pêche et les changements climatiques.
Afin de réduire l'impact de ces dynamismes, le service de la
conservation effectue des patrouilles pour refouler les contrevenants.
Plusieurs axes stratégiques ont été définis pour
assurer la gestion durable de cette espèce dans le PNB. Il s'agit de la
lutte anti-braconnage, la valorisation de l'espèce, le renforcement de
la collaboration entre les parties prenantes, la coordination,
suivi-évaluation du plan de gestion et le financement durable. Compte
tenu des observations faites sur le terrain, l'étude recommande une
bonne collaboration entre les parties impliquées dans la gestion des
ressoudes fauniques, l'amélioration des conditions de travail des
éco-gardes, le renforcement des capacités des gardes
communautaires.
Mots clés : Camera-piège, Drones, Gestion durable,
Hippopotame, UTO Bénoué.
xiii
ABSTRACT
The present study, carried out in the Benue Operational
Technical Unit (Benue UTO) during the period from 1 January to 31 May 2019,
focused on new technologies and improvement of wildlife inventories using
drones and camera-traps in sustainable management of hippopotamus in UTO Benue.
Overall, the aim of the study was to provide qualitative and quantitative
information which will contribute to improve knowledge of hippopotamus numbers
in the Benue UTO in order to plan the sustainable management of this species.
The method used during this study is the total count through several techniques
(photographic entrapment, pedestrian counting station and drone flyover).
Analysis of the data showed that 287 hippopotamuses (2 ind per km) were counted
in 16 permanent pools located on the 120 km covered by the course of the Benue
River. The pond with the highest concentration of this species is found on
Mayo-Oldiri located in ZIC 3, ie 34% of the total population. The evolutionary
trend of this species is presented in three phases, particularly the period
from 1975 to 1999 when there is an increase in the hippopotamus population and
then from 2012 to 2014 characterized by a decline in the population and the
period from 2016 in 2019 marked by a gradual increase in hippopotamus numbers.
The most recent are those made by MBAMBA in 2013, 2016 and 2018, with results
of 205, 228 and 217 respectively. The main threats to hippos are poaching,
transhumance, fishing and climate change. In order to reduce the impact of
these dynamics, the conservation department conducts patrols to repress
offenders. Several strategic axes have been defined to ensure the sustainable
management of this species in the GNP. These are the fight against poaching,
the valorization of the species, the strengthening of the collaboration between
the stakeholders, the coordination, monitoring and evaluation of the management
plan and the sustainable financing. Given the observations made on the ground,
the study recommends a good collaboration between the parties involved in the
management of wildlife resources, the improvement of the working conditions of
the eco-guards, the capacity building of the community guards.
Keys words: Benue UTO, Camera-traps, Drone, Sustainable
management, Hippopotamus.
1
CHAPITRE I : INTRODUCTION
I.1. Contexte et justification
La grande variété de climats, de reliefs et
d'habitats ont fait du Cameroun un pays pourvu de nombreux
écosystèmes et d'une biodiversité exceptionnelle
(Eba'à et Bayol, 2009). Cette richesse est préservée par
un grand nombre d'aires protégées qui couvrent 20,3% du
territoire national (INS, 2015). Le Nord-Cameroun présente une grande
zone d'intérêt international pour la conservation de la faune
sauvage. Cette importante richesse faunique a permis la création de
plusieurs aires protégées occupant près de 44% de la
superficie de la région (DRFFN, 2008). Ces aires protégées
sont constituées de 28 Zones d'Intérêts
Cynégétiques (ZIC) et trois Parcs nationaux dont le Parc National
de la Bénoué (PNB), le Parc National du Faro (PNF) et le Parc
National de Bouba-Ndjiddah (PNBN). Le PNB renferme une faune diversifiée
qui compte près de 35 espèces de grands et moyens
mammifères diurnes appartenant à 11 familles (Tsakem et al.,
2004). Parmi ces mammifères figure l'hippopotame qui fait l'objet
de la présente étude. L'espèce Hippopotamus amphibius
Linné (1758) est un gros mammifère typiquement africain.
L'Hippopotamus amphibius a été placé dans la
classe A de la loi 94. En 2017, l'UICN a publié la liste rouge des
espèces menacées et l'hippopotame fait partir des espèces
« vulnérables » et est par ailleurs exclu du commerce
national, et même du commerce international, puisqu'il est classé
dans l'annexe II de la Convention sur le Commerce International des
Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES). Malgré toutes ces mesures de sauvegarde et de protection
adoptées aussi bien au niveau national qu'international, cette
espèce subit un déclin tantôt à cause de la faible
applicabilité des politiques, tantôt à cause de la non
maitrise des caractéristiques des populations d'hippopotame au Cameroun,
notamment dans les aires protégée UICN (2009).
Depuis une dizaine d'années, les drones et
caméras ont fait leur apparition dans le domaine civil et leurs
applications n'ont cessé de se développer, ouvrant de nouvelles
perspectives pour la gestion de l'environnement et de la faune (Jones et
al., 2006 ; Hardin et Hardin, 2010 ; Getzin et al., 2012 ; Koh et
Wich, 2012 ; Wing et al., 2013). Leurs avantages, tels que les
coûts d'achat et de maintenance faibles pour les mini-drones
habituellement utilisés dans les applications civiles (Berni et
al., 2008 ; Dunford et al., 2009), la logistique facile avec un
déploiement et une prise en main rapide (Dunford et al., 2009 ;
Xiang et Tian, 2011), l'empreinte écologique réduite et la
possibilité de voler dans une large gamme de conditions
météorologiques et à basse altitude, leur confèrent
une haute résolution spatiale et temporelle
2
par rapport aux plates-formes classiques de
télédétection (Xiang et Tian, 2011 ; Turner et
al., 2012). Ces caractéristiques combinées à des
capteurs de plus en plus performants permettent d'obtenir des images dont la
résolution spatiale est de quelques centimètres, bien
en-delà de l'imagerie aérienne et satellite classique. Il devient
dès lors possible de repérer et d'identifier sur de telles
images, animaux, humains, véhicules et infrastructures.
Les études utilisant les techniques drone et
caméras dans le domaine de la faune se sont multipliées mais
restent cependant cantonnées à un petit nombre d'espèces,
principalement des oiseaux (Chabot et Bird, 2012) et des espèces marines
telles que les crocodiles (Djeukam, 2007). Quelques mammifères
terrestres ont également été observés à
l'instar de l'éléphant (Loxodonta africana) (Vermeulen
et al., 2013). Cependant, bien que les possibilités de
détection soient très encourageantes, peu d'auteurs ont
réalisé de réels comptages de population et tenté
de mettre au point un protocole spécifique. Finalement, l'imagerie
provenant du drone constitue une base permanente de données qui peut
donc être analysée par plusieurs opérateurs à
posteriori de manière à augmenter la fiabilité des
résultats. Les drones et caméras ont donc le potentiel de devenir
les prochains outils pour assurer le suivi de la faune et appuyer les
équipes de comptage sur le terrain.
I.2. Problématique
La répartition des espèces et la dynamique des
populations animales sont essentielles pour comprendre les processus
sous-jacents qui permettront de mieux préserver ces ressources (Koh et
Wich, 2012). Ces éléments soulignent l'importance de
développer de nouvelles approches de gestion efficaces basées sur
des techniques innovantes, abordables et multifonctionnelles. Plusieurs
études ont déjà été réalisées
sur les hippopotames au Cameroun au cours desquelles l'évaluation de la
taille de la population faisait partir des objectifs. En effet, d'avril
à juin 2001, (Nchanji et al. 2007) ont compté les
indices d'hippopotames communs le long des rives, et les individus qui
émergeaient de la rivière Djérem, dans le parc national du
Mbam et Djérem. En avril, 18 hippopotames ont été
comptés contre 79 entre mai et juin sur le Djérem, ce qui
suggère qu'il y avait des effectifs différents à chaque
période, mais que les individus réagissaient différemment
aux stimuli physiologiques ou au bruit utilisés lors du scenario de
comptage. D'où la nécessité de développer une
nouvelle approche de comptage. Quelques aspects de l'écologie de
l'hippopotame amphibie dans le PNB réalisée par Bakowé
(2012) dont l'approche méthodologique était basée sur le
comptage le long du cours d'eau Bénoué. Le dénombrement se
faisait chaque fois qu'un individu ou groupe d'individus était
aperçu. Les observations se faisaient en journée et le temps
d'observation
3
était fonction du nombre d'individus présent
dans la mare. En 2013, Scholte a réalisé une étude sur le
déclin de la population d'hippopotame commun au PNB entre 1976 et 2013.
La méthodologie de comptage était celle appliquée par Ngog
Njie (1988). Tous les comptages sauf un ont eu lieu vers la fin de la saison
sèche, lorsque la rivière Bénoué était la
seule source d'eau du parc et que la région était facilement
accessible. La seule exception était le décompte de juillet 2013
effectué pendant la saison des pluies au cours de laquelle le comptage
fut quelque fois perturbé par les pluies et la montée des eaux
qui n'était pas favorable car les hippopotames étaient
immergés. Un dénombrement d'hippopotames a aussi
été réalisé dans le PNB par Maha (2012). Du fait
des détours et des rebroussements de chemins, l30 km étaient
parcourus en 11 jours. Pour ce qui est du travail d'inventaire, il s'est fait
dans les cours d'eau qui arrosent le PNB. Ce dénombrement s'est
effectué en début de saison de pluies, ce qui a
représenté quelquefois, une difficulté majeure du fait des
crues des cours d'eaux par endroits, d'où l'immersion des hippopotames.
La méthode de comptage utilisée est celle du comptage à
pied le long du cours d'eau (Ngog Njé, 1988). Par ailleurs, la
navigation sur le cours d'eau à l'aide de la pirogue présente des
risques d'attaques d'hippopotames qui pourraient avoir des dégâts
d'ordre matériels et humains. De même, aucune de ces études
n'avait utilisé des nouvelles technologies telles les drones ou alors
les cameras-pièges dans le processus de dénombrement.
Après l'interdiction du commerce de l'ivoire
d'éléphant en 1989, on a noté une augmentation de
l'exploitation des canines d'hippopotames (UICN, 2006). Suite à cette
augmentation, l'UICN (2006) affirme que cette croissance du commerce des dents
du cheval de l'eau a atteint la barre de 53% du nombre d'exportation initial et
s'est traduit par la baisse considérable de la population de l'amphibie
en Afrique (7 à 20%). D'autre part, l'UICN (2006) souligne que la chasse
illégale et la dégradation des habitats sont les principales
menaces à la survie de cet amphibie. Dans ce sens, pour justifier
l'ampleur des menaces, Dibloni et al. (2010) affirment qu'en
République Démocratique du Congo, la population d'hippopotames
était estimée à 30.000 individus dans le Parc National des
Virunga (Delvingt, 1978), et qu'aujourd'hui celle-ci est passée à
3000 individus, soit un taux de décimation de 90%. Au Cameroun,
l'hippopotame est une espèce à haute valeur
éco-touristique. Le plan de gestion élaboré par le MINFOF
en 2015 prévoit un quota de prélèvement attribué
après élaboration d'un plan de tir qui fixe les quotas relatifs
à chaque espèce. La méthode d'estimation des quotas
d'exploitation théorique de Martin et Thomas (1991), fixe un taux
d'exploitation maximum de l'hippopotame à 10% de son effectif total. Le
prélèvement par la
4
chasse sportive sanctionnée par l'obtention d'une
autorisation spéciale délivrée par le Ministre des
Forêts et de la Faune est estimé à 5% (MINFOF) alors
même que l'effectif total d'hippopotame reste méconnu.
Au niveau local, les populations riveraines du PNB
constituées pour une grande partie des immigrants, sont pauvres et
tirent l'essentiel de leurs ressources de la nature en pratiquant entre autre
l'orpaillage, la pêche, l'élevage sédentaire et la coupes
abusive du bois (MINFOF, 2009). Les conséquences plus ou moins directes
sont la dégradation de l'habitat faunique en général et
des hippopotames en particulier, à travers les fosses creusées
sur le lit du fleuve Bénoué. Pendant les périodes
d'étiage, seules les mares permanentes sont les zones de pêche.
Les problèmes restants de l'exploitation de ces ressources halieutiques
sont des conflits hippopotames-pêcheurs avec des pertes en vie humaine.
C'est le cas par exemple au lac Lagdo au nord du PNB où on a
enregistré deux décès des pêcheurs résultant
de l'affrontement avec les hippopotames (MINFOF, 2011).
Afin d'améliorer les connaissances sur les hippopotames
dans le temps et dans l'espace, dans le but d'assurer leur gestion durable, le
conservateur du PNB intègre les drones et cameras-pièges dans le
processus d'inventaires de ceux-ci afin d'apporter une plus-value sur les
méthodes de comptages existantes. Afin de mener à bien la
présente étude, la question principale est de savoir :
Quelle est la contribution de l'utilisation des drones et
cameras-piège dans l'amélioration des inventaires des
hippopotames au Nord Cameroun en général et dans l'UTO
Bénoué en /particulier afin d'assurer une gestion durable de
cette espèce ?
Les questions secondaires suivantes ont été
formulées pour répondre à cette question.
- Quelle est la structure de la population d'hippopotames dans
l'UTO Bénoué ?
- Quelles sont les stratégies efficaces pour la bonne
gestion des hippopotames dans l'UTO Bénoué ?
I.3. Objectifs
L'objectif global de l'étude est de contribuer à
la meilleure connaissance des effectifs d'hippopotames dans le PNB afin de
planifier la gestion durable de cette espèce.
Plus spécifiquement, il sera question de :
- Evaluer la structures de la population des hippopotames dans
l'UTO Bénoué en utilisant les nouvelles technologies;
- Proposer une stratégie de gestion durable des
hippopotames dans l'UTO Bénoué.
5
I.4. Intérêt de l'étude
- Sur le plan technique, la présente
étude va contribuer à la mise sur pied d'un nouveau protocole
d'inventaire des grands et moyens mammifères à l'aide des drones
et camera-pièges ;
- Sur le plan environnemental et social, la
présente étude contribuera non seulement à
la sauvegarde, à la protection et à la gestion
durable des hippopotames mais aussi à identifier les facteurs qui
menacent l'intégrité des populations d'hippopotames. Les
résultats obtenus pourront contribuer à la fixation du quota
d'abattage du pachyderme et de permettre de prendre des mesures
conséquentes afin de réduire les conflits Hommes-Hippopotames
fréquents dans la zone.
1.5. Limite de l'étude
Cette étude, comme toutes les autres faites auparavant
sur la question, comporte ce qu'on appelle en jargon scientifique un «
biais méthodologique ». Les effectifs issus du comptage par drone
étaient différents des observations directs. L'estimation du
nombre d'hippopotames à l'aide de ces vidéo n'est pas du tout
évident dans la mesure où il n'est pas du tout facile d'observer
l'ensemble du groupe compte tenue de la turbidité de l'eau, des
plongées individuel des hippopotames dans la mare et la hauteur du drone
qui réduit non seulement le champ de vision de la camera mais aussi la
qualité des images. De même, les cameras n'ont pas au
préalable un champ de vision prédéfinie qui permettrait de
garantir avec certitude que l'angle de vision est la bonne mais offrent de
résultats plus acceptables par rapport aux drones. C'est pourquoi
l'utilisation des camera traps est jugée plus efficace et facile
à mettre oeuvre.
6
CHAPITRE II : DEFINITION DES CONCEPTS ET REVUE DE LA
LITTERATURE II.1. Définition des concepts
II.1.1. Drone
Selon Grenzdörffer (2013), le drone est un engin volant
de taille réduit, sans pilote ni humain à bord et le plus souvent
télécommandé, équipé de camera permettant de
filmer et réaliser des prises de vue aériennes.
II.1.2. Camera-pièges
Une caméra-piège est un dispositif permettant de
faire de photographies d'êtres vivants sans intervention humaine.
L'appareil se déclenche automatiquement selon divers
procédés.
www.ornithomedia.com (consulté le 5 février 2019)
- Il peut être muni d'un capteur de contact. L'animal
touche le capteur et déclenche la photographie ;
- Il peut être muni d'un capteur photosensible. Dans ce
cas c'est l'ombre de l'animal qui déclenche l'appareil ;
- Il peut utiliser une barrière infrarouge ou laser.
Lorsque l'animal traverse cette barrière, la photo est prise.
II.1.3. Gestion durable
Une gestion durable est un mode de gestion qui vise à
satisfaire les besoins des générations présentes sans
toutefois compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs (Buttoud et al., 2005).
II.1.4. Inventaire de faune
Un inventaire de faune est l'évaluation des ressources
fauniques dans le but d'apporter des informations qualitatives et quantitatives
sur le statut de ces ressources, leur utilisation, leur gestion et leur
évolution (MINEF, 1997).
II.1.5. Aire protégée
Selon l'UICN (1994), une aire protégée est une
portion de terre et/ ou de mer vouée spécialement à la
protection et au maintien de la biodiversité, ainsi que les ressources
naturelles et culturelles associées, et gérée par des
moyens efficaces, juridiques ou autres. Le décret n°95/466/PM du 20
juillet 1995 portant application du régime de la faune dans son article
2, alinéa 1, défini une aire protégée comme
étant une zone géographiquement délimitée et
gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de
conservation et de développement durables d'une ou de plusieurs
ressources données.
7
II.1.6. Parc national
Le décret 95/466 du 20 juillet 1995 en son article 2,
alinéa 8 définie un parc national comme étant un
périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de
la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en
général, du milieu naturel, présente un
intérêt spécial qu'il importe de préserver contre
tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute
intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et
l'évolution.
II.1.7. Conservation
La conservation telle que définie par l'IUCN (1980) est la
gestion de l'utilisation humaine de la biosphère de sorte qu'elle puisse
produire le plus grand bénéfice soutenable aux
générations présentes tout en maintenant son potentiel
pour satisfaire aux besoins des générations futures.
II.1.8. Habitat
L'habitat est défini comme étant un emplacement
particulier où se rencontre une espèce donnée. Il s'agit
en quelque sorte l'adresse de l'animal (Triplet et Poilecot, 2009).
II.1.9. Abondance absolue
L'abondance absolue est le nombre total d'individus
présents ou le nombre estimé dans la zone inventoriée ; on
parle également de taille de la population pour une espèce
donnée par unité de temps (Wikipédia, 2018).
II.1.10. Abondance relative
L'abondance relative est le nombre d'individus ou d'indices
d'une espèce par unité de surface (généralement
désigné par la Densité), par unité de distance ou
encore par unité de surface (Wikipédia, 2018).
II.1.11. Méthodes directes d'inventaire
Les méthodes directes d'inventaire sont basées
sur le comptage des individus directement observés. Le comptage direct
peut être exécuté au niveau terrestre (marche à pied
ou tout autre moyen de déplacement), ou au niveau aérien
(Bonin et al., 2018).
II.1.13. Piégeage photographique
Selon les nouvelles directives d'inventaires de grands et
moyens mammifères dans les écosystèmes forestiers du
Cameroun, le piégeage photographique est un dispositif permettant de
faire des photographies d'êtres vivants sans intervention humaine,
à travers un déclenchement automatique grâce à des
capteurs de vibrations, de lumière ou des barrières infrarouge et
laser. Les méthodes utilisant les pièges photographiques
permettent de collecter des données en respectant les principes de base
de la méthodologie utilisée (Manet et Herman, 2003).
8
II.1.14. Population
Une population est l'ensemble d'individus de la même
espèce vivant dans un espace déterminé et à un
moment donné. Dans le cadre des inventaires par échantillonnage,
la taille des populations représente une valeur estimée (Lexique
forestier, 2017).
II.1.15. Saline
Une saline est une zone marécageuse ou rocheuse
où divers animaux viennent consommer la terre pour en tirer les sels
minéraux essentiels à leur organisme.
II.2. Revue de la littérature
II.2.1. Problématique de la conservation de la
biodiversité au Cameroun
Le grand braconnage des espèces charismatiques reste en
général assez localisé. Mais l'effort de chasse à
des fins monétaires sur des antilopes de forêt reste une constante
inquiétude, et concourt à la disparition de la biomasse majeure
présente en forêt. Delvingt et al. (2002), cités
par Vermeulen et Doucet (2006), démontrent pour de nombreux cas le
manque de durabilité de la chasse villageoise quand elle vise une
monétarisation même partielle. L'ouvrage de Robinson et Bennett
(2000) cité par Vermeulen et Doucet (2006) est également
édifiant sur le sujet : le temps mythique où les populations
locales vivaient en équilibre avec leur environnement semble
définitivement révolu. Il serait donc important, temps soit
très peu de s'intéresser à la problématique de la
conservation de la biodiversité. La pression anthropique sur les
ressources fauniques a rendu le gibier rare dans de nombreuses régions
forestières habitées (Ngandjui, 1998). C'est un problème
d'avenir pour les peuples forestiers si rien n'est fait en faveur de la gestion
rationnelle de ces ressources.
Selon Knick (1990), dans les régions où les
populations animales sont chassées régulièrement et de
manière intensive, les espèces fauniques ne pourront maintenir
des populations viables que si elles disposent de « refuges » non
perturbés par les activités humaines pour se reproduire et
assurer ainsi la pérennité de l'espèce tout en assurant le
repeuplement des zones chassées. Et selon Kunin et Lawton (1996), la
perte d'une espèce représente la perte d'une information.
La recherche du bien-être matériel,
associée à l'augmentation galopante de la population et à
la surexploitation des ressources naturelles par l'homme, a donné lieu
à la destruction de l'environnement, et partant, à celle de la
faune. Cela a entraîné l'extinction de certaines espèces
d'animaux et la perte de la diversité biologique (FAO, 2007).
Une nouvelle approche dans la conservation des ressources
naturelles dans le bassin du Congo est inspirée directement de la vision
américaine de la conservation. L'USAID et l'Union
9
Européenne (UE) financent notamment le « Congo
Bassin Forest Partnership » qui est un programme régional
annoncé par les Etats-Unis au sommet mondial pour l'environnement de
2002 et dont l'importance a été réaffirmée au
sommet de Brazzaville par le président de la République
Française. Ce vaste programme axé sur la conservation d'un
réseau d'immenses paysages répartis dans six pays d'Afrique
Centrale, piloté par la France. Soit au total, près de 685.500
km2 (36% du massif forestier d'Afrique Centrale) inclus dans une
stratégie globale annoncée comme « cadre tangible pour une
gestion basée sur des relations humaines fortes entre les intervenants
locaux » (PFBC, 2005), mais surtout conçu pour la conservation
d'espèces animales et végétales nécessitant de
vastes espaces. Vermeulen et Doucet (2006) affirment que partout, les
ressources naturelles (et particulièrement la grande faune)
régressent.
II.2.2. Cadre politique des inventaires fauniques
Sur le plan politique, la nouvelle politique forestière
et environnementale définie par la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche,
enrichie par la loi cadre n°96/006 du 12 août 1996 relative à
la gestion de l'environnement définit les orientations politiques et
stratégiques du Cameroun en matière de gestion de la
biodiversité et s'accorde aux orientations internationales et sous
régionales (MINFOF, 2008). Les principaux axes de ladite gestion
pourraient se résumer en :
- La protection du patrimoine forestier, la participation
à la sauvegarde de l'environnement et la préservation de la
biodiversité à travers la création d'un domaine forestier
permanent ciblant au moins 30% du territoire national ainsi qu'un réseau
national d'aires protégées représentatif des
écosystèmes du pays ;
- L'amélioration de la contribution des ressources
forestières et fauniques à l'économie nationale ;
- L'implication de la population locale dans la gestion
durable des ressources naturelles. L'une des grandes innovations de ces lois
est la reconnaissance du rôle privilégié des populations
dans la gestion durable des ressources biologiques. Ces progrès
réalisés dans le domaine politique et règlementaire pour
le passage de la gestion monolithique et conflictuelle de la faune et des aires
protégées à une gestion participative se sont traduits par
de nombreuses initiatives pilotes qui devront être capitalisées et
consolidées dans le cadre du PSFE. Pour garantir une implication
effective et durable de la population dans la gestion durable des ressources,
les dispositions législatives et règlementaires prévoient
une participation active des populations à tous les niveaux
(accès aux ressources, aux
10
retombés économiques et aux prises de
décisions). Cette politique de conservation de la biodiversité
s'accorde avec les orientations internationales, sous régionales et
nationale en la matière. Sur le plan international, elle intègre
notamment les dispositions de :
- La convention de Washington (1973) sur le commerce
international des espèces faunique et de flores menacées
d'extinction (CITES) ;
- La convention sur la diversité biologique
signée en 1992 et ratifiée en 1994 et qui met l'accent sur la
conservation, l'utilisation durable des ressources biologiques et le partage
équitable des bénéfices.
Au plan régional, elle est non seulement en
adéquation avec la déclaration de Yaoundé (1999)
adoptée au sommet des chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la
conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers
d'Afrique centrale et le Plan de Convergence de la COMIFAC (2014) pour la
gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale de
2015 à 2025 mais aussi avec la déclaration de Brazzaville issue
de la conférence internationale sur l'exploitation illégale et le
commerce illicite de la flore et de la faune sauvage en Afrique.
Au plan national, elle participe à travers des
contributions sectorielles à apporter à la réalisation de
la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.
La politique de gestion durable des ressources
forestières et fauniques est mise en oeuvre à travers une
série de programmes tels que le Plan Nation de Gestion de
l'Environnement (PNGE), le Plan d'Action Forestier Tropical (PAFT) et le
Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE). Le PSFE, le dernier
né de ces programmes, est aujourd'hui le principal cadre de
référence et d'orientation des actions du Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement
Durable (MINEPDED) et du Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF). L'objectif du PSFE étant d'assurer la conservation, la gestion
et l'exploitation durable des écosystèmes forestiers en vue de
répondre aux besoins locaux, nationaux, régionaux et mondiaux des
générations présentes et futures.
II.2.3. Cadre juridique des inventaires fauniques
Le Cameroun, signataire d'un ensemble de texte internationaux,
nationaux et régionaux, est, depuis la réforme de 1994,
doté d'un cadre juridique bien développé avec des
conventions, de règlements et autres textes applicables directement ou
indirectement à la faune.
Sur le plan international, la convention sur la
diversité biologique du 14 juin 1992 ratifiée par le Cameroun le
29 décembre 1994 est considérée comme l'un des guides pour
l'aménagement ou l'exploitation des forêts et de la faune. Elle
est épaulée par d'autres textes parmi lesquels la
11
convention de RAMSAR sur les zones humides (ratifiée
par le Cameroun en 2006) ; la convention d'Alger sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles ; la convention de Paris sur la
désertification de 1994.
Sur le plan régional, reconnaissant l'importance des
forêts en Afrique Centrale, et les menaces croissantes affectant
l'écosystème, les chefs d'Etat de la sous-région ont
adopté à l'issue du sommet une importante déclaration
dénommée Déclaration de Yaoundé. Par cette
déclaration, ils se sont engagés à oeuvrer pour des
politiques appropriées en vue de la conservation durable des
forêts du Bassin du Congo. C'est une initiative qui a
bénéficié du soutien de l'Assemblée
générale des Nation Unies exprimé à travers la
résolution A/RES/54/214 UN. L'initiative du Programme des Forêts
du Bassin du Congo (PFBC) vient également en appui à
l'implémentation de la Déclaration de Yaoundé.
Créée en septembre 2002, lors du sommet de Johannesburg sur le
développement durable, elle associe une trentaine d'organisations qui
entendent impulser la coordination des diverses initiatives et politiques de
conservation des forêts du Bassin du Congo.
Sur le plan national, la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche (en
son Titre IV « DE LA FAUNE ») ainsi que le décret N°
95/466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du
régime de la faune sont considérés comme les principales
sources juridiques du domaine de la gestion de la faune. Ces dispositions
juridiques sont complétées par dives textes d'applications tels
:
- L'arrêté N°082/PM du 21 octobre 1999
portant création d'un Comité National de lutte contre le
braconnage ;
- Le décret N°96/237/PM du 10 avril 1996 fixant
les modalités de fonctionnement des fonds spéciaux prévus
par la loi de 1994 ;
- L'ordonnance N°99/001/ du 31 août 1999
complétant certaines dispositions de la N°94/01 du 20 janvier 1994
;
- Des textes particuliers permettant la gestion de la faune,
notamment les arrêtés répartissant les espèces par
classe de protection, portant réglementation des activités de
chasse notamment en ce qui concerne les quotas annules d'exploitation
autorisés ainsi que les latitudes d'abattage par titre d'exploitation
;
- L'arrêté N°0244/MINFOF du 02 mai 2006
fixant les normes d'inventaire des espèces de fauniques en zones de
savane ;
- L'arrêté N°0221/MINFOF du 02 mai 2006
fixant les normes d'inventaire des espèces fauniques en milieu forestier
;
12
- La décision N°000857/D-MINFOF du 10 novembre
2009 portant organisation du commerce de la viande de brousse.
II.2.4. Cadre institutionnel des inventaires fauniques
Au cours des dernières décennies, les
activités anthropiques ont grandement contribué à la
dégradation des forêts, la déforestation, la disparition du
couvert végétal, la dégradation de l'environnement et les
changements climatiques. A causes de ces pressions multiformes sur la
végétation, l'environnement et la biodiversité, des voix
ont commencés à s'élever pour décrier et
dénoncer les modes de gestion des forêts surtout dans les pays
tropicaux. Vers les années 1980 on assiste à une véritable
prise de conscience internationale sur les menaces qui pensent sur
l'environnement en général et les forêts en particulier.
Sous la houlette des Nation Unis, les débats internationaux ont connu
une grande ferveur sur les autres fonctions de la forêt. C'est le cas du
Plan d'Action Forestier Tropical (PAFT) lancé en 1945 par la FAO pour
remédier au déboisement des forêts tropicales. En dehors de
la conférence de Rio de 1992, des groupes d'écologistes se sont
créés dans les pays du Nord pour exiger des politiques et
législations forestières et environnementales qui contribuent
à la préservation de l'environnement, la protection de la nature
et la conservation de la biodiversité. Les Etats vont se lancer dans la
signature des conventions attestant leur volonté d'assurer une bonne
gestion des ressources forestières et fauniques.
Au niveau du Cameroun, la gestion des ressources
forestières était jusqu'en 1992 caractérisée par
une dispersion de sens de décisions. La forêt relevait du
ministère de l'agriculture et la faune du ministère du tourisme.
Cependant, depuis 1992 la création d'un ministère de
l'environnement et des forêts (MINEF) a mis fin à cette
cacophonie. Grace au décret N°2004/320 du 08 décembre 2004
portant organisation du gouvernement, et dans le souci de mieux prendre en
compte les aspects liés à la protection de l'environnement et des
forêts, le MINEF a été scindé en 2005 en deux
ministères à savoir le Ministère des Forêts et de la
Faune(MINFOF) et le Ministère de l'Environnement et de la Protection de
la Nature (MINEP) qui devient en 2011 le Ministère de l'Environnement,
de Protection de la Nature et du Développement Durable(MINEPDED).
Le MINEP est chargé de l'élaboration, de la mise
en oeuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en
matière d'environnement. Le MINFOF quant à lui, conserve ainsi
les Directions en charge des Forêts, et celle en charge de la Faune ainsi
que celle des Aires Protégées de l'ancien MINEF. Placée
sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et d'Aires
Protégées est chargée de :
13
- L'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique
du gouvernement en matière de faune; - Les études
socio-économiques et techniques dans le domaine de la faune ;
- L'inventaire, de l'aménagement, de la gestion et de
la protection des espèces fauniques en liaison avec les administrations
concernées ;
- L'élaboration des normes d'inventaires et
aménagements en matière de faune, en liaison avec les
administrations concernées ;
- Le contrôle technique, du suivi de l'exécution
et de la réception des programmes d'inventaires et d'aménagements
en matière de faune ;
- La surveillance continue du patrimoine faunique ;
- La création et de suivi de la gestion des zones
cynégétiques, des game-ranches et des zones
d'intérêt cynégétique à gestion communautaire
;
- La liaison avec les organismes internationaux et nationaux
chargés de la conservation de la faune ;
- La planification et de la création des aires
protégées et réserves écologiques
représentatives de la biodiversité et des
écosystèmes nationaux, en liaison avec la direction des affaires
générales.
II.2.5. Utilisation des pièges photographiques comme
méthode d'inventaire
Le piège photographique est un excellent outil
d'appréhension de la diversité de la faune sauvage. Cet appareil
est une caméra de prise de photos et/ou vidéos par
déclenchement Infrarouge passif ou par déclenchement
automatisé. Le déclenchement infrarouge est actionné par
un capteur de type mouvement/thermique (Chapman, 1927, cité par
Rowcliffe et Carbone, 2011). La photo est extrêmement précieuse
pour enregistrer les espèces difficiles à dépister. La
pose de l'appareil à déclenchement automatique permet de
surveiller avec peu de personnel les sites fréquemment visités
par les animaux, les sites appâtés et leurs lieux de passage
habituels. Les pièges photo permettent aussi de déterminer les
schémas d'activité (nocturne ou crépusculaire, diurnes),
les réactions aux perturbations (Griffiths, 1994), les
déplacements, les comportements de reproduction saisonniers et la
structures sociales. Si l'on a assez d'appareils, on peut aussi réunir
des informations sur l'abondance des espèces.
II.2.6. Quelques caractéristiques techniques de
Bushnell ESTD
Plusieurs marques de cameras infra-rouge sont utilisées
pour la détection des animaux de la faune. L'emploi d'une caméra
dépend des objectifs visés et des moyens financiers pour une
acquisition d'une telle. On rencontre entre autre Reconyx HC500, Scoutguard
SG550,
14
Moultrie I65 et aussi Bushnell ESTD qui à servit lors
de cette étude. Le tableau 1 présente les caractéristiques
techniques de la camera Bushnell.
Tableau 1: Caractéristiques de la camera
Bushnell
|
Caractéristiques
|
|
|
Modèle
|
119877
|
|
Résolution du capteur
|
2,8,24MP
|
|
Résolution des images
|
Capteur 3MP avec interpolation à 2MP ou 8 et 24MP
|
|
Flash
|
48 LEDs No-Glow
|
|
Portée du flash (ft/m)
|
100ft/30m
|
|
Affichage
|
LCD couleur
|
|
Couleur
|
Camo
|
|
Type de pile
|
AA(8)
|
|
Durée de vie des piles
|
Jusqu'à 12 mois
|
|
Résolution vidéo
|
1920*1080p
|
|
Portée du capteur infrarouge (ft/m)
|
80ft/ 25m
|
|
Mode multi Flash
|
Oui
|
|
Hyper Night Vision
|
Oui
|
|
Field Scan 2x
|
Oui
|
Source : Service de la conservation du PNB (2019).
II.2.7. Utilisation des drones en inventaire faunique
Afin de protéger et conserver les espèces
animales, un recensement du nombre d'individus et l'inventaire sont des
techniques incontournables pour estimer la taille d'une colonie de population.
Il existe pour cela différentes techniques de terrain. Par contre, en
fonction de la qualité d'individus ou de leur localisation, ces
techniques peuvent s`avérer fastidieuses voire impossible à
mettre en oeuvre (Linchant et al., 2013). Face à ce constat,
une solution de comptage par drone associée à un logiciel
d'acquisition et de traitement d'image trouve tout son intérêt. En
effet, le drone permet de voler à basse altitude jusqu'à 150 m.
Cette technique peut être utilisée dans le milieu naturel, aussi
bien pour la faune sauvage que pour les animaux d'élevage, mais aussi en
ville, pour suivre les populations de certains d'oiseaux invasifs comme le
pigeon géant. La prise de vues par drone s'avère être une
technique très efficace pour repérer, inventorier et
cartographier le faune. Il permet de récolter de nombreuses
données à haute résolution spatiale et temporelle, avec de
faibles couts opérationnels. De plus, sans odeur, il approche et capture
plus facilement des images de
15
certains espèces sensibles à la présence
humaine, il est en capacité de couvrir de grandes surfaces en un temps
record et permet d'atteindre des zones éloignées, inaccessibles
ou impraticables comme décrite par (Getzin et al., 2012).
II.3. Généralités sur les
hippopotames
II.3.1. Classification systématique de
l'hippopotame
Règne : Animal
Embranchement : Chordé
Sous-embranchement : Vertébré
Classe : Mammifère
Sous-classe Thérien
Infra-classe : Euthérien
Ordre : Ongulé
Sous-ordre : Artiodactyle
Famille : Hippopotamidae
Genre : Hippopotamus
Espèce : Amphibius (Linnaeus, 1758).
L'hippopotame amphibie ou hippopotame commun (Hippopotamus
amphibius) est une espèce de mammifère semi-aquatique
d'Afrique sub-saharienne et l'une des deux dernières espèces
existantes au sein de la famille des Hippopotamidae, l'autre étant
l'hippopotame nain. Les deux espèces se différencient par la
hauteur au garrot. En effet l'hippopotame commun mesure 1,5 m au garrot pour
une longueur de 3 m Alor que l'hippopotame nain mesure 0,90 m garrot. Il est
reconnaissable à son bustre en forme de baril, sa gueule qu'il peut
très largement ouvrir pour révéler de grandes canines, son
corps dépourvu de poil, ses membres semblables à des colonnes et
leur grande taille. Les adultes pèsent en moyenne 1500 kg pour les
mâles et 1300 kg pour les femelles. En dépit de son aspect trapu
et de se couts membres, il est capable de courir à 30 km/h sur de
courtes distances (Eltringham et al., 1993).
L'hippopotame commun comprendrait 3 à 5
sous-espèces difficiles à distinguer sur le terrain (Jeannin,
1945 ; Eltringham et al., 1993). L'examen de la diversité et de
la structure génétique des populations d'hippopotames à
travers le continent sur la base de l'ADN mitochondrial a permis de prouver que
la différentiation génétique est basse mais significative
parmi 3 des 5 groupes présumés (Okello et al., 2005).
Cela voudrait dire que les hippopotames communs
16
comprennent 3 sous espèces qui sont : Hippopotamus
amphibius amphibius, H. a. capensis et H. a. kiboko.
Celui du PNB est hippopotamus a. amphibius.
II.3.2. Comportement
L'hippopotame est un animal très agressif et
imprévisible et il est considéré comme un des plus
dangereux animaux d'Afrique. Néanmoins, il est toujours menacé
par la perte de son habitat et le braconnage pour sa viande et l'ivoire de ses
canines. Il vit en communauté dans les lacs, rivières, et marrais
de mangrove, ou les males défendent une portion de la rivière.
Aux abords de son habitat aquatique, il délimite son territoire en
projetant à plusieurs mètres ses excréments, fèces
et urines (Eltringham, 1999 ; Olivier, 1975 ; Boisserie 2005).
II.3.3. Alimentation
L'hippopotame se nourrit d'herbes et de graminées
à proximité des berges. Mais, à la nuit tombée, il
s'éloigne des berges pour rejoindre des pâturages par des sentiers
précis, parcourant pour cela jusqu'à 10 km. Pendant sa
quête de nourriture, il arrive parfois qu'il pénètre dans
des plantations occasionnant alors d'énonces dégâts. Il
sort de l'eau au crépuscule pour manger de l'herbe. Il broute durant
quatre à cinq heures et peut consommer 68 kg d'herbe chaque nuit
(Jonson, 2010).
II.3.4. Reproduction
La femelle d'hippopotame commence sa puberté des 3 ou 4
ans et atteint l'âge de la maturité sexuelle à 5 à 6
ans et une période de gestation de 8mois, et le male atteint sa
maturité sexuelle entre 7 ans ou 8 ans. L'accouplement à lieu
dans l'eau avec la femelle immergée durant la majeure partie du temps,
sa tête émergeante périodiquement pour respirer. Les petits
naissent toujours à la saison des pluies. Si bien qu'il n'y a qu'une
vague de naissances dans les régions où il n'y a qu'une saison
des pluies par an, comme en Afrique du Sud, et deux vagues, dans l'Est de
l'Afrique, où il y a deux saisons. Elle met son petit au monde en eau
peu profonde, ou bien à terre, mais dans une zone bien
protégée. Le petit tète sur la terre ferme et le sevrage
commence vers 6 à 8 mois et la plupart des jeunes sont totalement
sevrés à l'âge d'un an. Elle le défend
férocement, contre les grands prédateurs, et contre les
mâles adultes de sa propre espèce. Après la naissance, la
femelle reste isolée une dizaine de jours avant de rejoindre le groupe
(Laws et Clough, 1966).
II.3.5. Habitat
L'hippopotame peut se rencontrer dans la savane ou les zones
de forêt. Il leur faut un habita qui présente suffisamment d'eau
pour qu'ils puissent s'immerger et de l'herbe à proximité. De
grande densité d'animaux se rencontre dans les eaux calmes avec les
plages fermes à la pente
17
douce. On peut rencontrer quelques males dans des eaux plus
rapides dans les gorges rocheuses. A l'exception de l'alimentation, la plupart
de la vie de l'hippopotame se déroule dans l'eau ou il se bat avec ses
congénères, s'accouple et met bas (Eltringham, 1993).
II.3.6. Distribution des hippopotames en Afrique
Initialement et jusqu'au début du 20ème
siècle, l'hippopotame se retrouvait du Nil au Cap, partout où la
présence simultanée d'eau et d'herbages était remplie
(Figure 1) et ce, jusqu'à une altitude de 2000 m (Eltringham, 1993). Sa
distribution est toujours relativement large bien qu'elle soit de plus en plus
constituée de populations toujours plus isolées les unes des
autres.

Figure 1: Distribution des hippopotames en Afrique
Source : Lewison et Oliver (2008).
II.3.7. Hippopotames au Burkina Faso
L'étude de l'effectif, de la structure en classes
d'âges et des mouvements de Hippopotamus amphibius a
été conduite dans la Réserve de Biosphère de la
Mare aux Hippopotames au Burkina Faso. Pendant trois années
d'affilée (2006, 2007 et 2008), des prospections et des inventaires de
terrain ont été menés à l'intérieur et
à la lisière de la réserve. La méthodologie
était basée sur les observation directes le long du cour d'eau
par trois équipes dont l'une s'est servie d'une barque en suivant l'axe
central du plan d'eau et les deux autres à pieds en suivant le long des
deux rives (Ollo et al., 2010).
18
Les résultats des inventaires ont permis de
dénombrer 41 hippopotames en 2008 contre 35 têtes en 2006,
répartis en trois troupeaux distincts. La structure en classes
d'âges de cette population était de 32 adultes, cinq subadultes et
quatre juvéniles. L'emplacement de leurs aires de repos dans la mare
variait suivant le niveau de l'eau. L'inventaire a identifié huit sites
de sorties, sur chaque rive de la mare, utilisées par les hippopotames
pour se rendre dans les gagnages (Ollo et al., 2010).
II.3.8. Hippopotames au Benin
Dans les zones humides des départements du Mono et du
Couffo situés au Sud-ouest du Bénin, l'extension
incontrôlée des activités anthropiques est devenue un
danger permanent pour la faune sauvage en général et les
hippopotames en particulier. Ainsi, il est devenu impérieux de trouver
des alternatives de conservation intéressantes pour les
communautés riveraines des plans d'eau abritant des hippopotames. Dans
ce cadre, une étude a été conduite en 2002 dans cette
localité. Les hippopotames ont été comptés par
observation directe couplée à la recherche d'indices de
présence (empreintes, beuglements (cris), crottes, pistes de passage,
etc.) comme l'ont préconisé divers auteurs (Ghiglieri, 1983 ;
Tembo, 1987 ; Onyeanusi, 1996 ; Sinsin et Assogbadjo, 2001 ; Assogbadjo et
al., 2004). La méthode de transects linéaires
utilisée par Onyeanusi (1996) et Assogbadjo et al. (2004) a
permis d'étudier les caractéristiques des habitats et
pâturages des hippopotames.
Plusieurs groupes de familles d'hippopotames ont
été notés, allant des solitaires à des groupes de
cinq individus. Cependant, l'effectif des groupes atteint parfois 10
têtes selon les populations riveraines. Ils sont répartis dans des
lacs, mares, étangs, lagunes et fleuves. Au total, 30 hippopotames ont
été directement observés contre un effectif de 45 obtenu
par enquêtes auprès des populations locales. Les hippopotames sont
facilement observables les matins entre 6 h et 8 h, les soirs entre 17 h 30 mn
et 19 h 30 mn (Amoussou et al., 2006).
Les cultures les plus ravagées par les hippopotames
sont le maïs (Zea mays), le manioc (Manihot utilissima),
la patate douce (Ipomea batatas), le coton (Gossypium sp.),
le niébé (Vigna sp.) et la canne à sucre
(Saccharum officinarum) pour la plupart à des fins
alimentaires. Les activités de pêche et la navigation sur l'eau
sont également perturbées par les hippopotames. Les
espèces végétales de la famille des graminées et
des cypéracées sont les plus représentées dans
l'alimentation des hippopotames. Les pâturages naturels des hippopotames
que sont les végétations herbacées des abords
immédiats de leur habitat sont considérablement réduits au
profit des champs, des plantations et des activités
maraîchères.
19
II.3.9. Hippopotames au Cameroun
Une étude s'est déroulée de juin à
novembre 2011 et a porté sur « l'étude de la structure,
de la croissance et du régime alimentaire de la population
d'hippopotames au Parc National de la Bénoué et sa
périphérie » par Maha. Les principaux objectifs
étaient de déterminer l'effectif, la densité et la
distribution de la population d'hippopotames au Parc National de la
Bénoué et ses environs, déterminer leur régime
alimentaire, identifier les facteurs qui menacent l'intégrité des
populations d'hippopotames et faire ressortir la perception de l'animal par les
populations riveraines ainsi que les rapports issus de cette cohabitation (tout
le long du fleuve Bénoué). La méthode utilisée pour
évaluer la dynamique de la population d'hippopotames a été
le dénombrement à pied le long d'un cours (Ngog Njé,
1988). Ainsi, une distance totale de 94,5 kilomètres (à vol
d'oiseau) a été parcourue. Une population d'hippopotames de 180
individus a été estimée dans le PNB avec un IKA de 1,90
individu au km. Au total, 17 mares d'hippopotames ont été
observés et la taille moyenne d'un groupe a été
estimée à 5,8 individus; les individus solitaires sont les plus
couramment rencontrés, suivis des groupes binaires, des groupes de 30
individus. En fonction de la taille de groupes d'hippopotames observés,
trois catégories de mares ont été distinguées: les
mares à faible concentration d'hippopotames (l à 10 individus),
les mares à concentration moyenne (11 à 20 individus) et les
mares à forte concentration (21 à 30 individus). Le régime
alimentaire des hippopotames s'est révélé être
très diversifié. Les rapports Hommes/Hippopotames sont surtout
conflictuels. Les hippopotames occasionnent des dégâts aussi bien
matériels qu'humains. Ceux-ci semblent apprécier les cultures de:
maïs, riz, sorgho et arachide. Les riverains tentent de réduire ces
dégâts par la surveillance, le refoulement ou l'appel aux
autorités en charge de la faune (MINFOF).
II.3.10. Importance culturelle et socio-économique
des hippopotames
Le fait que l'animal soit vénéré dans
plusieurs localités en Afrique constitue un atout important à
utiliser pour sa conservation. C'est ainsi qu'au Nigeria, dans l'Etat de
Sokoto, les habitants du village Kalele sont arrivés à conserver
avec succès une population de 40 hippopotames (Afolayan, 1980). Ce
succès provenait de la sacralisation des hippopotames dans ladite
localité. Ces mêmes croyances culturelles ont permis de conserver
les hippopotames dans plusieurs autres pays (Igboh, 1986). Jusqu'au
siècle dernier, dans la vallée Bisa, en Zambie, l'hippopotame
était un animal totem, qu'on n'avait pas le droit de tuer ni de manger.
Ajayi (1978) a mentionné que diverses parties de l'animal sont
utilisées dans la médecine traditionnelle pour guérir
l'hypertension, la lèpre et pour traiter la malchance,
20
l'ensorcellement et la stérilité. Onyeanusi
(1996) a estimé à 77,27 % le pourcentage des habitants d'un
village qui ont consommé une fois la viande d'hippopotame au Nigeria. Il
a, en outre, constaté que la peau de l'animal est très
recherchée dans la fabrication des sacs, chaussures et fouets, ses dents
étant utilisées pour fabriquer les prothèses dentaires, et
la graisse est très utile dans la médecine locale.
Les populations d'hippopotame sont protégées par
des croyances et des tabous qui dans certaines communautés à
l'instar du peuple Bamoun de la région de l'ouest Cameroun et des Batas
au Nord Cameroun, qui leur confèrent un statut de totem et limitent de
ce fait leur chasse et la consommation de leur viande. Les hippopotames communs
bénéficient d'une pleine protection légale au Cameroun
mais des insuffisances existent dans l'application de la
réglementation.
II.1.12. Méthodes indirectes d'inventaire
Les méthodes indirectes sont basées sur
l'observation des signes/indices laissés par les animaux. Les
méthodes indirectes sont généralement terrestres.
Cependant, pour les indices de grandes tailles tels que les nids de
chimpanzés de savanes arborées, les drones et avions peuvent
être utilisés (Bonin et al., 2018).
II.1.13. Principe de recensement des hippopotames
II.1.13.1. Recensement par camera-traps
L'estimation du nombre d'hippopotame présents dans une
mare à l'aide des caméras consiste à installer des
caméras à proximité des mares afin d'enregistrer des
séquences vidéo ou faire des photos sur lesquelles
l'espèce sera comptée.
II.1.13.2. Recensement par drone
La méthode consiste à faire survoler un drone
au-dessus des mares afin d'enregistrer soit les séquences vidéos
soit les photos.
21
CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODES
III.1. Zone d'étude
La région du Nord est couverte par un réseau
d'aires protégées parmi lesquelles le PNB où la
présente étude sera réalisée.
La figure 2 illustre le PNB dans le réseau des aires
protégées du Nord Cameroun.
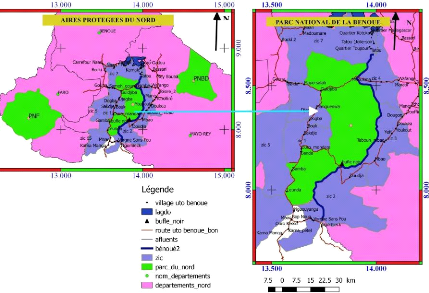
Figure 2: Parc National de la Bénoué
dans le complexe des aires protégées du Nord-Cameroun
Source : Base des données du PSFE
Situé dans la région du Nord, le PNB se trouve
dans le département de Mayo Rey, localisé au coeur du site
prioritaire de conservation de savanes soudanaises. Du haut de ses 180000 ha,
il est limité (UICN-PAPACO, 2010). :
- Au Nord par les cours d'eau Mayo Ladé et Laindelaol ;
- Au Sud par le cours du Mayo Dzoro ;
- A l'Est par la cours d'eau Bénoué ;
- Et à l'ouest par la nationales N°1
Ngaoundére-Garoua, du pont sur le Mayo Dzoro jusqu'au village Banda par
l'ancienne route Ngaounéer-Garoua, de Banda à l'ex-Djaba par la
nationale N°1 de l'ex-Djaba au pont le Mayo Salah par le cours du Mayo
Salah jusqu'au point de confluence avec le Mayo Ladé.
III.2. Milieu biophysique
III.2.1. Climat
Le climat est de type soudanien de nuance humide (Suchel,
1971) ou soudano-guinéen au sens d'Aubreville (1950)
caractérisé par deux saisons bien contrastées et
d'inégale importance. Une saison pluvieuse de six à sept mois
allant de mai à octobre et une saison sèche de cinq à six
mois entre novembre et mars. Le PNB subit l'influence du plateau de
l'Adamaoua.
La figure 1 représente la courbe ombrothermique de la
localité d'étude.
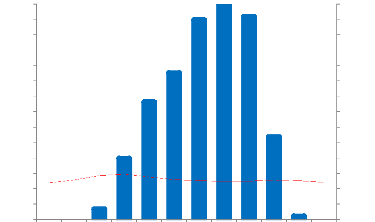
Précipitation (mm)
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
40
80
60
20
0
40
90
80
0
70
60
50
30
20
140
130
120
110
100
10
Temperature (°C)
22
JAN FEV MARSAVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
Figure 3: Diagramme ombrothermique de la région
du Nord-Cameroun pour la période de 1982 à 2012
Il ressort de cette courbe que les mois de juillet, août
et septembre sont les mois les plus pluvieux de l'année. Tandis que les
mois de mars et avril sont les plus chauds de l'année. Compte tenu de la
moyenne annuelle des précipitations qui restent favorables à la
production, le caractère sec de la région tient davantage
à la longueur de la saison sèche, et à
l'irrégularité des précipitations qu'au total des pluies
précipitées annuellement (MINEF, 2002). La variation des
précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est
de 280 mm. La pluviométrie annuelle moyenne est de 1347 mm et la
température moyenne annuelle est de 25,9°C (Climate-data, 2018).
III.2.2. Relief et topographie
La topographie est formée d'une succession de collines
aux versants à pente moyenne ou faible, séparés par de
petits vallons à fonds évasés, souvent
érodés ou ravinés. La pente moyenne des versants varie de
2 à 5% en moyenne avec un gradient latéral plus marqué que
le
23
gradient longitudinal. Le PNB comprend un système de
massifs rocheux dits hossérés dont les altitudes varient entre
220 m et plus de 700 m, séparés par des plaines plus ou moins
vastes. On les rencontre surtout dans la partie Nord du parc. C'est le cas par
exemple du Hosséré Mbana qui culmine à 759 m (MINEF,
2002).
III.2.3. Hydrographie
Le PNB appartient entièrement au bassin de la
Bénoué. Cette rivière est le seul cours d'eau permanent de
la région et ces principaux affluents (les Mayos Mbam et Na) drainent
largement le Parc. Parmi les nombreux affluents de la rive gauche, on note du
Sud au Nord les Mayos Dzoro, Alim, Pem, Mbam, Sona, Biem, Na, Gour, Beleli,
Birma, Laindelaol, Lada et Salah. A côté de ces cours d'eau
à débit intermittent, on rencontre suivant les saisons de mares
d'eau plus ou moins importantes (MINEF, 2002).
III.2.4. Flore
D'après le profil environnemental réalisé
en 2004, la végétation de la zone soudano-sahélienne est
composée de steppes arbustives de la région de Garoua, de savanes
arbustives de la vallée de la Bénoué et de savanes
médio-soudaniennes sur sols plus ou moins caillouteux (ERE
Développement, 2009). Cette végétation est dominée
par les savanes soudanaises avec une présence de galeries
forestières qui jonchent les lits des cours d'eau (Letouzey, 1968). Ce
sont des facteurs qui favorisent l'habitat de la faune sauvage et qui font de
l'UTO de la Bénoué et ses environs un gîte par excellence
pour les animaux.
Les espèces d'arbres et d'arbustes les plus
représentées dans les savanes arborées/boisées et
les savanes herbeuses sont: Burkea africana, Combretum
glitinosum, Anogeissus leiocarpus, Daniellia oliveri,
Prosopis africana, Boswellia dalzielli, Piliostigma
thonningii, Terminalia laxiflora, Ceiba pentandra,
Isoberlinia doka, Terminalia macroptera, Afzelia
africana, Lophira lanceolata, Sclerocarya birrea,
Mimosa pigras, Diospyros mespiliformis, Acacia
polyacantha, Tamarindus indica, Ficus spp., Annona
senegalensis, Borassus aethiopum, Detarium microcarpum,
Butyrospermum parkii, etc (Letouzey, 1968).
La strate herbeuse est à dominance de Loudetia
spp. et de graminées parmi lesquelles
Andropogon gayanus, Andropogon schirensis, Andropogon
pseudapricus, Hyparrhenia subplumosa, Hyparrhenia
smithiana, Hyparrhenia rufa, Pennisetum unisetum,
Sporobolus pectinellus, Setaria barbata, Vetiveria
nigritana et Chloris robusta (Letouzey, 1968).
24
III.2.5. Faune
La grande variété de la diversité
biologique du PNB et de sa périphérie lui concède la
représentativité de la diversité animale en Afrique
Centrale. Il abrite de nombreuses espèces et populations de
mammifères, d'oiseaux et de poissons (WWF/FAC, 1998).
La classe des mammifères recensée dans le PNB
compte plus de 26 espèces appartenant à 11
familles (WWF/FAC, 1998). Les grands et moyens
mammifères sont les plus représentés et comprennent
principalement le bubale (Alcelaphalus buselaphus major),
l'éland de Derby
(Taurotragus derbianus), l'hippotrague
(Hippotragus equinus), le buffle (Syncerus cafer
cafer), le redunca (Redunca redunca), le
cobe Defassa (Kobus defassa), le cobe de Buffon (Kobus kob
kob), le guib harnaché (Tragelaphus scriptus),
l'ourébi (Ourebia ourebi), le
céphalophe à flancs roux (Cephalophus
rufilatus), le phacochère (Phacochoerus aethiopicus),
l'hippopotame (Hippopotamus amphibus), l'éléphant
(Loxodonta africana africana), le lion (Panthera leo),
l'hyène tachetée (Crocuta crocuta), le patas
(Erythrocebus patas), le Babouin (Papio anubis), le colobe
à manteau blanc (Colobus guereza) et le singe vert
(Cercopithecus aethiops) (MINEF, 2002).
L'avifaune comprend plus de 306 espèces. Les
principales espèces sont le touraco (Tauraco leucolophus),
l'oie de Gambie (Plectropterus gambensis), le busard des roseaux
(Circus
aeruginosus), le coucal du Sénégal
(Centropus senegalensis), le héron gardeboeuf
(Nycticorax leuconotus), le héron goliath
(Ardea goliath), la tourterelle (Streptopelia sp.),
l'ombrette (Scopus umbretta), le francolin (Francolinus
bicalcaratus) et la pintade commune
(Numida meleagris). Par ailleurs les espèces
telles que la cicogne (Ciconia sp.), le jabiru d'Afrique
(Ephippiorhynchus senegalensis) et l'ibis sacré
(Threskiornis aethiopicus) sont en voie de disparition de la
région (MINEF, 2002).
L'important réseau hydrographique axé sur le
fleuve Bénoué comprend une gamme variée d'espèces
halieutiques parmi lesquelles le hareng (Pellonula miri),
l'hétérotis (Heterotis
niloticus), le clarias (Clarias albopunctatus,
Clarias anguillaris, Clarias gariepinus), le
tilapia (Tilapia rendalli, Tilapia zillii), le
tetraodon (Tetraodon lineatus), le barbus (Barbus spp.), le
poissons-chat (Auchenoglanis biscutatus, Auchenoglanis occidentalis),
le binga
(Hydrocinus vittatus, Hydrocinus brevis,
Hydrocinus forskalli) et le capitaine (Lates niloticus).
Malgré la grande diversité des poissons qu'on y trouve (Vivien,
1991), deux espèces seulement (le binga et le capitaine) sont
très prisées pour la pêche sportive par les touristes
(MINEF, 2002).
25
III.3. Milieu Humain
III.3.1. Population
La population vivant autour de la partie Ouest-Sud du PNB est
estimée à plus de 5000 habitants répartis dans environ 12
villages (Kachie, 2011). Le taux moyen de croissance démographique qui
est de l'ordre de 5,1 %, est le plus élevé du pays. Il s'explique
par une migration massive des populations de l'Extrême-Nord vers le Nord
autrefois encouragée par le projet Nord-Est Bénoué.
Différents groupes ethniques se rencontrent dans cette zone : les Dii
originaires des collines, sont installées dans la région depuis
40 à 60 ans et représentent la population de base des villages
riverains du PNB; les Foulbés ; les Mafas ; les Toupouri et Massa
(groupes en pleine expansion) originaires de l'Extrême-Nord ; les Laka ;
Gambaye et Mboum qui viennent du Tchad et les Bororo. Les Dii, (Anonyme, 2004).
Dans la partie Nord du parc, la mise en eau du barrage de Lagdo a
entraîné des modifications avec l'installation de nombreux
pêcheurs étrangers (Nigérians et Tchadiens) et
l'exploitation des pâturages de saison sèche par de nombreux
troupeaux.
Les migrations sont une source importante de conflits. Parce
qu'elles sont intimement liées à la culture du coton ; elles sont
à l'origine de défrichements anarchiques. L'exploitation et la
vente du bois de chauffage, qui participent à la destruction de
l'habitat sont des activités importantes pour les immigrants.
L'activité humaine se manifeste par les
défrichements culturaux, les prélèvements de bois et
d'autres ressources végétales, les feux de brousse et les
activités de chasse. L'extension de la culture du coton,
favorisée par une vulgarisation de la culture attelée,
accroît la pression sur les terres et entraîne une fragmentation de
l'habitat de la faune, avec des conséquences sur les espèces
menacées de disparition (MINEF, 2002).
III.3.2. Usage socio-économique du parc et de sa
zone périphérique
III.3.2.1. Tourisme de vision
Il existe six accès possibles pour
pénétrer dans le parc : Guidjiba, ex-Djaba, Banda, Mayo Alim, le
Buffle Noir et le Grand Capitaine. Des postes de garde se trouvent dans les
quatre dernières `entrées' seulement et sont peu fonctionnels en
dehors du Buffle Noir et de Banda. Les axes Guidjiba-Grand Capitaine, et
Banda-Buffle Noir sont des routes nationales et départementales. On ne
peut donc exiger de ceux qui les empruntent de payer les droits
d'entrée. Actuellement ces droits d'entrée se payent uniquement
au Buffle Noir. En principe, un visiteur peut donc se rendre au Buffle Noir ou
emprunter certaines pistes (ex-Djaba -Bel Eland - Banda) sans rien payer.
Généralement, les visiteurs ne s'acquittent des droits
qu'à
26
partir du moment où ils empruntent les pistes
spécifiques du parc, le long de la Bénoué par exemple.
Cette situation ne facilite pas les contrôles d'accès et de
recettes, et complique la tenue de statistiques sur les visiteurs. Le prix
d'accès au parc est de 1500 FCFA pour les nationaux, 3000 FCFA pour les
résidents et 5000 FCFA pour les non-résidents. Le billet
d'accès est valable pour une journée. Tout détenteur d'une
caméra photo doit payer une taxe de 2000 FCFA par jour. Les
déplacements à l'intérieur du parc se font,
théoriquement, accompagnés d'un guide ou d'un garde qui sont
payés 2500 FCFA par jour (MINEF, 2002). III.3.2.2. Tourisme
cynégétique
Des huit ZIC périphériques du PNB, deux sont
actuellement gérées en régie par l'Etat et six
affermées aux guides professionnels. Ces ZICs dépendent
administrativement du Conservateur du PNB auquel elles sont rattachées.
Des quotas d'abattage sont fixés pour chaque ZIC par le MINFOF, sur la
base des réalisations des années précédentes et des
indications transmises au MINFOF par les guides professionnels de chasse. Ces
quotas ne sont donc pas basés sur des estimations rigoureuses des
populations animales qui ne peuvent être effectuées faute de
moyens (MINEF, 2002).
Les taux de réalisation des quotas sont
généralement inférieurs à 50%. Soit donc les quotas
sont trop importants par rapport aux prélèvements raisonnables
qui sont effectués et il faudrait alors diminuer ces quotas, soit les
quotas sont réalistes mais le système actuel d'exploitation n'est
pas efficient. Faute de pouvoir vérifier l'exactitude des animaux
tués et déclarés par les guides professionnels et face
à l'absence d'estimations fiables de populations d'espèces de
gibier, l'on ne peut prétendre à une gestion durable de la chasse
dans la région. (MINEF, 2002).
III.3.2.3. Agriculture
L'agriculture constitue la principale activité de
production dans la zone et est pratiquée par toutes les couches
sociales. Les principales cultures de la zone classées par ordre
d'importance par rapport à l'amélioration de niveau de vie et de
revenu monétaire sont : l'igname (Dioscorea dumetum), le
maïs (Zea mays), le mil (Sorghum spp.), le coton
(Gossypium hirsitum), et l'arachide (Arachis hypogea)
(Siroma, 2007). Par ailleurs, en dehors des engrais minéraux, les
paysans ont très peu de solutions adéquates à
l'appauvrissement des sols. On ne saurait donc parler d'une agriculture
prospère, car beaucoup reste encore à faire. C'est une
agriculture extensive, très destructrice de la végétation.
La force de travail est surtout constituée de la main d'oeuvre familiale
(Boum et al., 2009).
27
III.3.2.4. Orpaillage
Le Parc National de la Bénoué et les zones de
chasse périphériques sont situés dans un site dont le
sous-sol est assez riche en minerais et surtout de l'or alluvionnaire et
parfois du Saphir. Certaines zones telles que le lit de la Bénoué
et bien d'autres cours d'eau dans le Parc et les ZIC sont souvent envahies par
des centaines de personnes à la recherche de ce précieux
métal. Il arrive souvent que des villages entiers se déplacent et
se reconstruisent à l'intérieur du Parc ou des ZIC.
Conséquence on assiste à une véritable destruction de
l'habitat au centre du Parc et surtout à un braconnage
généralisé exercé par ces orpailleurs (MINEF,
2002).
III.3.2.5. Elevage
L'élevage est inexistant dans la plupart des villages
et n'occupe que 25 % des paysans. On ne saurait donc parler de troupeaux, car
il s'agit de quelques chèvres, moutons, volaille par paysan -
éleveur. Il est décrié la présence de la mouche
tsé-tsé qui ne permet pas l'élevage bovin et des animaux
sauvages (civette et hyène) qui dévorent la volaille (MINEF,
2002). L'élevage est quasi inexistant dans la plupart des villages et
n'occupe que 25 % des paysans. Toutefois, il existe deux types d'élevage
dans la zone :
- un élevage dit familial pratiqué dans les
zones à usages multiples autour des villages, par moins de 25 % de
paysans, et qui concerne la volaille, les caprins, les ovins et les bovins pour
des effectifs de 20 bêtes au plus (Koulagna et Weladji, 1996).
- un élevage commercial, le plus conflictuel, concerne
les grands troupeaux de bovins, caprins et ovins. Il est pratiqué par
les sédentaires autochtones ou Bororo autour des villages, soit par des
transhumants Bororos qui se déplacent chaque saison à la
recherche du meilleur pâturage et des points d'eau. Si le premier
système cause moins de problèmes à la conservation, il
n'en est pas de même pour le second système qui favorise la
destruction de l'habitat, la perturbation des mouvements de la faune et
l'aggravation des risques d'infestation de certains bovidés tels que
l'éland de derby, le buffle (Gomsé et Mahop, 2000).
III.3.2.6. Braconnage et Commerce de la viande de
brousse
Le braconnage demeure un fléau pour la faune. Toutes
les couches sociales y sont impliquées. Dans le parc de la
Bénoué et ses zones environnantes, la situation est bien plus
inquiétante. Cette région fait l'objet d'un véritable
braconnage qui alimente les villes de Ngaoundéré et Garoua en
viande de brousse. En effet, c'est surtout en saison des pluies, lorsque les
pistes sont impraticables et les touristes absents, que le braconnage prend une
ampleur considérable. Certaines espèces d'antilopes sont en voie
de raréfaction tandis que le rhinocéros noir est
éliminé du parc de la Bénoué.
28
Il est à noter que, les femmes jouent un rôle
très important en tant qu'intermédiaire dans les circuits de
commercialisation de viande du gibier. Le commerce des trophées vient
aggraver le statut de certaines espèces (MINEF, 2002).
III.3.2.7. Pêche
La pêche au lancer en épervier des poissons
carnassiers (capitaine, binga) est la technique la plus utilisée dans la
réserve de biosphère Bénoué. Des spécimens
de plus de 20 kg sont régulièrement sortis de la
Bénoué (MINEF, 2002). L'importante potentialité de la zone
vis-à-vis de la pêche pourrait certainement être mieux
valorisée. Les moyens utilisés par les pêcheurs incluent
les produits chimiques qui sont une menace pour le potentiel ichtyologique de
la Bénoué (Gomsé et Mahop, 2000).
III.3.3. Bois de chauffage et de service.
III.3.3.1 Bois de chauffage
Le bois est la principale source d'énergie
utilisée dans la région. Les espèces les plus
utilisées comme bois de feu sont Anogeissus leiocarpus
(88,56%), Acacia polyacantha (57,4%), Pterocarpus luscens
(42,85%). La préférence est portée sur ces
espèces parce qu'elles se sèchent très vite, conservent la
flamme, prennent feu rapidement et ne font pas trop de fumée.
Généralement, le bois est utilisé pour la cuisson des
aliments. La consommation est en moyenne d'un fagot par jour et par foyer, soit
environ 4,5 à 5 kg (Tagueguim, 1999). Cette consommation double dans les
cabarets de bil-bil. Une partie est vendue en bordure de la route pour
ravitailler les centres urbains tels que Garoua et Ngaoundéré
(MINEF, 2002).
III.3.3.2. Bois de service
Les espèces les plus utilisées sont Monotes
kerstingii, Anogeissus leiocarpus, Burkea africana,
Stereospermum kunthianum, Prosopis africana, Diospyros
mespiliformis, Pterocarpus lucens, Pseudocedrella
kotschyi. Parmi ces espèces Monotes kerstingii,
Anogeissus leiocarpus, Burkea africana et Prosopis
africana sont plus appréciées grâce à leur
solidité, leur durabilité et leur résistance aux attaques
des termites. Ce bois est utilisé pour la toiture, les barrières,
les enclos à bétail, les manches des outils (houe, hache etc.).
Le bois est également utilisé pour servir de tuteurs d'ignames
dans les champs. Les tiges les plus utilisées sont celles ayant un
diamètre de 4 à 5 cm et de 125 à 140 cm de hauteur, les
jeunes tiges étant les plus sollicitées (MINEF, 2002).
III.3.4 Produits forestiers non ligneux
Les données sur les produits forestiers non ligneux ne
semblent pas attirer l'attention des opérateurs dans la région.
Ceci peut expliquer le manque des données sur cette activité.
Ce
29
paragraphe ressort les informations à partir des
données collectées autour du parc National de la
Bénoué (MINEF, 2002).
III.3.4.1. Espèces utilisées pour la
pharmacopée
Des enquêtes dans les villages des ZIC ont permis de
montrer que plus de 25 espèces végétales sont très
connus dans la pharmacopée à Sakdjé contre 35 à
Doudja (Tagueguim, 1999). Les prélèvements sont effectués
sur les différentes parties de l'arbre (feuilles, écorces,
racines, sève). Généralement ces
prélèvements ne portent pas préjudice à l'arbre,
car ils sont effectués en faible quantité (MINEF, 2002).
D'autres plantes sont utilisées dans le traitement des
maladies les plus courantes telles que la jaunisse, la dysenterie, le
paludisme, ou les maladies sexuellement transmissibles. Ces espèces
à large spectre subissent de plus en plus de fortes pressions, elles
sont notamment Anogeissus leiocarpus, Khaya senegalensis, Piliostigma
thonningii, Entada africana, etc. Pour trouver certaines plantes rares,
les populations sont obligés de parcourir de longues distances
(jusqu'à 20 km). Les populations pensent que les plantes
médicinales se raréfient déjà dans la
localité. C'est sans doute l'explication que l'on peut utiliser pour
expliquer l'écart entre le nombre d'espèces citées
à Doudja (35) moins accessible et Sakdjé (25) plus accessible
(MINEF, 2002).
III.3.4.2 Paille
La paille constitue une ressource très utilisée
dans la région. Elle est utilisée pour les toitures, la
fabrication des palissades « Secko ». Les espèces comme
Hyparrhenia barteri, Andropogon pinguipes, Andropogon tectorum sont
résistantes et peuvent faire plusieurs années sur le toit avant
d'être remplacées. Le problème de la paille ne se pose pas,
mais pour avoir les espèces les plus appréciées il faut
aller loin du village avant d'en trouver en grande quantité (MINEF,
2002).
III.3.4.3 Espèces fruitières
Les fruits comestibles comme la mangue, le citron, la goyave
sont produits par les formations naturelles ou cultivés. Mais les
fruitiers sauvages sont plus nombreux dans la région, il s'agit de
Ximenia americana, Annona senegalensis, Vitellaria paradoxa, Vitex doniana,
Vitex simplicifolia, Borassus aethiopum, Parkia biglobosa, Haematostaphis
barteri, Detarium microcarpum, Tamarindus indica, Diospyros mespiliformis,
Zizyphus mauritiana, Grewia barteri. Ces fruits sont auto consommés
ou vendus périodiquement sur le marché local. Certains de ces
fruits sont utilisés pour produire de l'huile (Butyrospermun parkii,
Lophira lanceolata) (MINEF, 2002).
30
III.3.4.4. Espèces utilisées pour la
corde
Les écorces de certaines espèces d'arbres et
certaines espèces herbacées sont utilisées comme corde.
Elles servent à tresser la paille, attacher le bois en fagot, etc. Les
espèces les plus utilisées sont Bombax costatum,
Dichrostachis cinerea, Lannea acida, Lannea
kerstingi, Panicum gracilicole, Piliostigma thonningii,
Borassus aethiopum, Imperata cylindrica (MINEF, 2002).
III.3.4.5. Champignons
Chez les Dii, 12 espèces de champignons sont connus
comme comestibles. Ils sont produits en saison des pluies dans les lieux
touffus et ombragés (MINEF, 2002).
III.3.4.6. Miel
L'exploitation du miel occupe une bonne partie de la population.
Il est vendu dans les marchés locaux et en bordure de la route, et
procure des revenus non négligeables aux producteurs. Il est aussi
utilisé par les populations pour préparer la bouillie (MINEF,
2002). III.4. Collecte des données
III.4.1. Données secondaires
Les données secondaires ont été
collectées à partir des informations nécessaires dans la
bibliothèque de l'Université de Dschang plus
précisément au Département de Foresterie. Les documents du
service de la conservation du PNB à savoir, le Plan d'Aménagement
du PNB en cours de révision et les résultats des
précédents inventaires d'hippopotames ont servies de sources de
données secondaires. De même, les articles, les publications
scientifiques nationales et internationales ont également
été consultées pour la revue de la littérature
III.4.2- Données primaires sur l'évaluation
de la structure de la population
d'hippopotames
Afin d'apporter des informations quantitatives et qualitatives
sur le statut des hippopotames dans le PNB, un dénombrement a
été effectué dans toutes les mares permanentes se trouvant
sur le lit du fleuve Bénoué et ses affluents. Ce
dénombrement s'est effectué en saison sèche
c'est-à-dire durant le mois d'avril, période durant laquelle le
fleuve Bénoué a complètement tari et dont il ne reste que
les mares permanentes où les hippopotames se regroupent.
La méthode de comptage utilisée durant cette
étude est le comptage total qui s'est déroulé à
travers plusieurs techniques entre autres le piégeage photographique, la
station de comptage pédestre et le survol par drone.
Dans la zone inventoriée et à proximité
des mares situées à 2 km du campement du Buffle noir, ont
été installées des caméras infrarouges sur des
arbres à une hauteur de 10 cm du sol
31
car la base de ces arbres avait une dénivelée de
1m par rapport à la surface de la mare. La camera elle-même
était inclinée vers le champ de détection. La technique de
piégeage photographique avait pour objectif de réduire le biais
lié au dénombrement obtenue à la station de comptage par
les observateurs. Les cameras étaient programmées de façon
à ménager un intervalle de temps entre deux vidéos pour
éviter de filmer les animaux qui restent longtemps dans le champ de
vision de la caméra. Les piles installées dans chaque camera
étaient rechargées tous les cinq jours par ailleurs, des cartes
mémoires de 32 Gb étaient installées dans les
caméras pour le stockage des données. De même, ces mares
ont été survolées par un drone afin d'enregistrer des
séquences vidéo qui ont facilité le dénombrement et
évaluer la richesse des mares.
III.4.3. Données sur les menaces qui pèsent
sur la faune en générale et les hippopotames en particulier
Afin d'avoir les données sur les menaces qui
pèsent sur les hippopotames les indicateurs de présence humaine
ont été identifiés dans la zone d'étude. Il s'agit
des campements des orpailleurs, les pistes de transhumance, les munitions, les
pièges, les traces de feux, les coups de feu, les coupes arbustives, les
pêcheurs et les trophées. Une fois chaque indice identifié,
les coordonnées géographiques ont été prises
à l'aide d'un GPS
III.4.4. Déroulement de l'inventaire
Entré au parc par la pénétrante
situé au Mayo-Alim, le dénombrement a débuté dans
les mares situées dans la ZIC 2 et a pris fin à celles
situées au campement du grand capitaine. Une fois arrivés dans
chaque ZIC où sont situées les mares, deux guides étaient
affectés pour accompagner l'équipe de comptage.
? Devant les mares un comptage systématique
s'effectuait immédiatement. A chaque comptage, les prises de photo y
étaient accompagnées pour réduire le biais lié au
comptage des différents membres de l'équipe. Les
coordonnées de chaque mare étaient enregistrées à
l'aide d'un GPS. La durées minimal devant une mare était de 25
minutes car la présence humaine entraine la méfiance des
hippopotames avec pour conséquence leur plongeon dans l'eau pour
émerger quelques minutes plus tard.
? Les caméras étaient installées en
matinée devant les mares en saison sèche et
récupérées tous les dix jours d'exposition. Les
séquences vidéo ont été visionnées afin de
faire des captures d'écran pour ressortir les photos où un
comptage s'y effectuait. Chaque soir nous nous regroupions dans chaque
campement pour faire le point et y passer la nuit. De même, les
données relatives sur les menaces qui pèsent sur les
32
hippopotames ont été collectées et par la
même occasion, les coordonnées ont été prises et
enregistrées à l'aide d'un GPS.
? Le comptage à l'aide du drone a consisté
à faire voler le drone au-dessus des mares.
En effet placé à 100 m de chaque mare, le drone
est lancé dans les airs et guidé à l'aide d'une commande,
une fois dans l'espace aérien, le drone enregistre des séquences
vidéo et effectue également des prises de photos selon que les
hippopotames sont à la surface de l'eau. Ces vidéos sont
visualisées à plusieurs reprises pour le comptage.
III.5. Traitement des données
Les données obtenues durant la présente
étude ont été traitées grâce au logiciel
cartographique QGIS pour l'établissement des cartes ; les données
statistiques sur la structure de la population d'hippopotames ont
été traitées à l'aide du tableur Excel 2010 afin de
produire les différents graphiques et courbes.
III.5.1 Evaluation de la structure de la population
d'hippopotames
III.5.1.1. Sélection d'images
Plusieurs séquences vidéo ont été
enregistrées aux mares proches du campement du buffle noir, des captures
d'écran ont été faites pour effectuer un comptage manuel.
Quand plusieurs photos sont valables après capture, celle jugée
visuellement comme la plus claire et permettant le mieux de discerner les
individus sont choisis. Le critère de sélection dans ce cas est
la netteté maximale et un reflet minimal du soleil sur l'eau.
III.5.1.2. Comptage à l'aide d'images
Après sélection d'images, elles sont soumises
à six personnes pour comptage. Parmi les personnes
sélectionnées, deux ont travaillés sur le terrain et les
quatre autres n'avaient aucune connaissance du contexte avant leurs comptages.
La présentation des images a été faite de façon
aléatoire pour éviter l'autocorrélation de la position des
hippopotames entre les images successives et ainsi ne pas influencer les
observations d'une photo à l'autre. Après comptage quatre
personnes ont obtenu un même nombre d'observation et les deux autre tous
n'ayant pas une connaissance au contexte ont quant à eux eu une
différence d'un et de trois respectivement.
III.5.1.3. Comptage par station
? Abondance relative ou Indice kilométrique
d'abondance (IKA)
Les données collectées ont été
analysées en utilisant les statistiques descriptives. Par ailleurs,
l'Indice Kilométrique d'Abondance (lKA) a été
utilisé pour estimer la densité linéaire des
hippopotames. L'IKA permet ainsi d'avoir une idée de la
tendance évolutive de cette espèce. Elle a été
calculée à l'aide de la formule 1.
(1)
? Densité
Elle a été calculée par la formule suivante
2.
(2)
La surface de l'espace vitale de l'hippopotame est donnée
par :
Avec S= surface espace vitale L= largeur totale en km du domaine
vital des hippopotames estimée à 3 km (soit 1,5 km en moyenne de
chaque côté du cours d'eau.
D= la longueur du cours d'eau (Olivier et Laurie, 1974).
Pour le cas spécifique de cette étude, D= 120
km.
III.5.2. Evaluation de l'influence des activités
anthropiques sur les indices d'hippopotames
Afin d'évaluer l'influence des activités
anthropiques sur les hippopotames, le coefficient de corrélation linaire
de Pearson a été calculé à l'aide de la formule
3.
v (3)
Avec ? ? ?
; ? ?
33
Et ? ?
34
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSIONS
IV.1. Résultats
IV.1.1. Structure de la population d'hippopotames
IV.1.1.1. Effectif d'hippopotames par mare
visitée
Les résultats de l'inventaire ont permis de
dénombrer 287 hippopotames, répartis dans 16
mares permanentes comme le présente le tableau 2.
Tableau 2: Effectifs d'hippopotames par
mare
|
Secteur
|
Mare
|
Position
|
Effectif
|
Proportion(%)
|
Village
|
Observation
|
|
Buffle noir
|
Mare 1
|
Bénoué
|
35
|
12
|
|
|
|
Mare 2
|
Bénoué
|
9
|
3
|
|
|
ZIC 2
|
Mare 1
|
Bénoué
|
0
|
0
|
Doudja
|
Ensablée et probable migration
|
|
Mare 2
|
Bénoué
|
0
|
0
|
Ensablée et probable migration
|
|
ZIC 3
|
Mare 1
|
Bénoué
|
02
|
1
|
Mbaou et Taboun
|
|
|
Mare 2
|
Bénoué
|
22
|
8
|
|
|
Mare 3
|
Bénoué
|
28
|
10
|
|
|
Mare 4
|
Mayo Oldiri
|
26
|
9
|
|
|
Mare 5
|
Mayo Oldiri
|
97
|
34
|
Dans cette mare se trouve quatre familles
|
|
Mare 6
|
Mayo Oldiri
|
21
|
7
|
|
|
|
Mare 7
|
Mayo Oldiri
|
0
|
0
|
|
Migration
|
|
Mare 8
|
Mayo Oldiri
|
27
|
9
|
|
|
|
ZIC 26
|
Mare 1
|
Mayo Oldiri
|
0
|
0
|
Mbaou
|
|
|
ZIC 9
|
Mare 1
|
Bénoué
|
06
|
2
|
Mboukma
|
En face se trouve un site d'orpaillage récemment
débusqué par l'équipe de patrouille
|
|
Mare 2
|
Bénoué
|
01
|
0
|
Un solitaire
|
|
Mare 3
|
Bénoué
|
13
|
5
|
Des menaces par les pêcheurs et les braconniers
|
|
TOTAL
|
16
|
|
287
|
|
|
|
Il ressort du tableau 2 que les effectifs des hippopotames
diffèrent d'une zone à l'autre. En effet la ZIC 3 renferme la
plus forte concentration des hippopotames soit 223 individus correspondant
à 78% des effectifs, suivi du secteur du Buffle noir qui compte 44
hippopotames soit 15% des effectifs et la ZIC 9 qui totalise 20 hippopotames
soit 7% de l'effectif total. Dans le Mayo Oldiri, affluent de la
Bénoué situé dans la ZIC 26 et plus spécifiquement
au village Mbaou, il n'y a pas hippopotame bien qu'une mare permanente y
35
est. De même les deux mares situées près du
campement de la ZIC 2 étaient ensablées ce qui justifie le fait
qu'il n'y a pas d'hippopotames.
IV.1.1.2. Distribution par groupe
Il est à noter qu'un groupe d'hippopotames est le nombre
d'observations faites en un lieu précis ou dans une mare. Cette
distribution s'illustre à travers la figure 4.
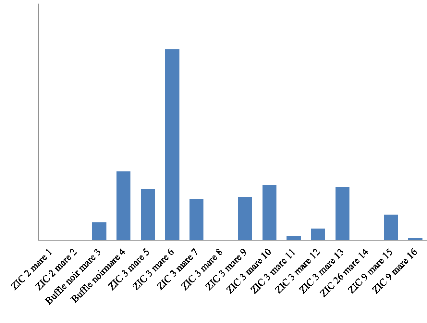
Mares par secteur
120
100
80
Effectifs
60
40
20
0
97
35
28
27
26
22
21
13
6
1
2
0
0
9
0 0
Figure 4: Diagramme des effectifs d'hippopotames par
mares
Il ressort de la figure 5 que toutes les mares du PNB ont des
concentrations variées en effectif. En effet une proportion des mares
n'a pratiquement pas d'hippopotame dû à l'ensablement de
celles-ci. Lorsque la profondeur des mares diminue soit par l'ensablement, soit
par évaporation, les hippopotames migrent des mares peu profondes vers
les mares profondes. De même la mare située dans la ZIC 3 dans
laquelle on dénombre 97 individus repartis en quatre familles.
36
IV.1.1.3. Caractérisation des mares
La littérature catégorise les mares en fonction de
la taille des groupes. C'est ainsi qu'on
distingue :
? des mares à faible concentration d'hippopotames (1-7
individus) ;
? des mares à concentration moyenne (8-16 individus) ;
? des mares à forte concentration (17-31 individus) ;
? des mares à très forte concentration (+ de 31
individus).
Les données collectées durant la présente
étude ont permis de catégoriser ces mares comme l'indique le
tableau 3.
Tableau 3: Caractérisation des mares
|
Nombre de mares
|
Intervalle
|
Effectifs
|
proportion
|
concentration
|
|
3
|
(1 à 7)
|
9
|
19%
|
faible
|
|
2
|
(8 à16)
|
22
|
12%
|
moyenne
|
|
5
|
(17 à 31)
|
124
|
31%
|
Forte
|
|
2
|
(+ de 31)
|
132
|
13%
|
Très forte
|
|
4
|
0
|
0
|
25%
|
nulle
|
Il ressort du tableau 3 que 31% des mares ont des fortes
concentrations et cumulent un total de 124 individus, suivi des mares de
concentration nulle. Les mares de faible concentration ont une proportion de
19% soit 9 individus. Les mares de très forte concentration
malgré leur faible proportion de 13%, cumulent un total de 132 individus
soit 86% de l'effectif total.
La collecte des données à l'aide du GPS a permis
de matérialiser cette distribution de groupe sur une carte. La figure 6
montre la distribution des groupes d'hippopotames dans l'UTO
Bénoué

37
Figure 5: Distribution des hippopotames par
groupe
Il ressort de la figure 5 que la plus grande concentration des
hippopotames se trouve dans la partie centrale de la zone d'étude
c'est-à-dire dans la ZIC 3. Ceci se justifie non seulement par
l'implication des populations dans le processus de conservation mais aussi par
la présence permanente des mares profondes dans cette zone. Les mares de
faible concentration et de concentration nulle se trouvent respectivement dans
la partie nord et dans la partie sud de la zone d'étude plus
spécifiquement au campement du grand capitaine et celui de la Zic 2.
IV.1.1.4. Organisation sociale et structure de la
population
Les hippopotames vivent en groupe de plusieurs individus
(figure 8) et quelque fois en solitaires comme celui du camp du grand capitaine
observé durant la présente étude. Dans chaque groupe, il y
a un seul mâle dominant qui joue le rôle de géniteur.
Après la naissance
38
d'un mâle, sa protection est assurée par sa
mère contre les potentiels prédateurs et contre mâle
dominant. Une fois que ce petit mâle peut se battre, il affronte son
géniteur dans un combat soit à mort, soit jusqu'à
l'abandon d'un adversaire. Le vainqueur du combat devient le nouveau mâle
dominant qui restera dans le groupe. Autour d'un groupe et dans le même
habitat cohabitent les crocodiles avec les hippopotames. Cette cohabitation est
due au fait qu'après défécation des hippopotames, les
poissons se nourrissent des résidus d'excréments qui constituent
un appât qu'utilisent les crocodiles pour attraper les poissons qui
constituent leur source de protéines. La figure 6 illustre un groupe
d'hippopotames dans le PNB.

Figure 6: Groupe d'hippopotame dans une mare de l'UTO
Bénoué
Le caractère amphibie du pachyderme lui
conférant un exercice régulier d'immersion et d'émersion
pour satisfaire ses besoins physiologiques notamment en oxygène, rend
l'étude de la structure tant sociale que démographique difficile
Ngog Njie (1988). Il n'est pas très évident pour les observateurs
de dégager des données fiables sur la structure d'âge et de
sexe des hippopotames. Dans le cas spécifique de la présente
étude, 18 groupes essentiellement composés d'adultes ont
été observés durant l'inventaire. Il est à noter
que les mares du secteur du buffle noir contenaient un effectif de 44
hippopotames dont 11 petits.
IV.1.1.5. Calcul de quelques paramètres
Le tableau résume les différents
paramètres calculés.
Tableau 4: IKA d'indices d'hippopotames
|
Type d'indices
|
IKA
|
|
Individus observés
|
2,4
|
|
Pistes
|
1,25
|
|
Carcasses
|
0,025
|
|
Mares
|
0,13
|
|
IKA général
|
3,8
|
|
Densité
|
0,008 ind/ha
|
Il ressort du tableau 4 que ce sont les individus
observés qui présentent une grande proportion d'IKA soit 2,4
individus par kilomètre suivi des pistes avec 1,25 piste par
kilomètre. Les mares et les carcasses quant à elles ont
respectivement 0,13 et 0,025 observation par kilomètre. Le nombre
d'individus par unité de surface est très faible soit 0,008
individu.
IV.1.1.6. Distribution spatiale des hippopotames
La figure 7 présente la distribution spatiale des
hippopotames dans l'UTO Bénoué.
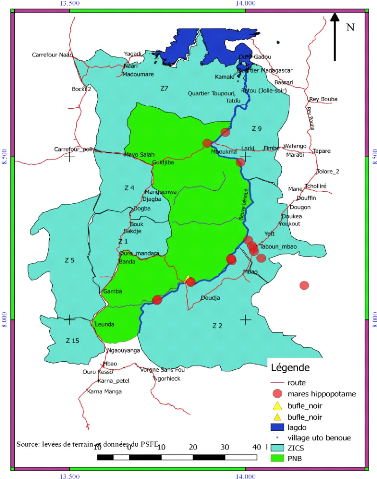
39
Figure 7: Distribution des hippopotames dans l'UTO
Bénoué
40
La distribution des hippopotames (figure 9) dans l'UTO
Bénoué s'étend de la partie Sud du parc dans le village
Doudja, en passant par les villages Mbaou et Taboun dans la ZIC 3 jusqu'au
village Mboukma dans la ZIC 9 où est situé le campement du grand
capitaine
IV.1.1.7. Tendance évolutive des effectifs
d'hippopotames dans le PNB
Depuis 1975 plusieurs méthodes de dénombrements
d'hippopotames ont été mises en place au PNB avec des techniques
différentes. La méthode d'inventaires la plus utilisée
était celle de Ngog Njie mise en place en 1988 et utilisée dans
le même écosystème par Zibrine, Maha, Scholte et Mbamba. La
principale innovation est celle apportée par Mbamba en 2018 qui a
consisté à intégrer le drone dans le processus de
comptage, ce qui a permis de dénombrer un effectif supplémentaire
de 80 individus sur le cours du Mayo Oldiri un des affluents de la
Bénoué. L'évolution de l'effectif des hippopotames est
illustrée par la figure 8.
450
400
Evolution des effectifes
350
300
250
200
150
100
50
0
400
350
325
205 228 217
180 181
287
1975 1988 1999 2012 2013 2014 2016 2018 2019
Années
Figure 8: Tendance évolutive des populations
d'hippopotames dans l'UTO Bénoué
La figure 8 présente trois phases d'évolution
des effectifs de la population d'hippopotames dans l'UTO Bénoué.
En effet la période allant de 1975 à 1999 correspond à la
phase où il y avait un grand nombre d'hippopotames (358 #177; 31) dans
l'UTO Bénoué. De 2012 à 2014 correspond à la phase
de décroissance (188 #177; 11) des effectifs d'hippopotames cette
décroissance justifie non seulement l'intensité du braconnage
durant cette phase mais aussi la période d'inventaire et la
méthode utilisée. De 2016 à 2019 un accroissement
progressif des effectifs (244 #177; 30) est observé l'UTO
Bénoué. Ceci témoigne non seulement les efforts
41
déployés par le service de la conservation pour
faire face au braconnage mais aussi l'efficacité des nouvelles
technologies utilisées pour le recensement de cette espèce.
IV.1.1.8. Hautes valeurs de conservation
La figure 9 présente la partie Est du parc comme HVC.

Figure 9: Hautes valeurs de conservation
Il ressort de la figure 9 que le fleuve Bénoué
situé dans la partie Est du PNB est une haute valeur de conservation, de
même que toutes les salines disposées dans le PNB où toutes
les espèces animales viennent consommer du sel sont également des
hautes valeurs de conservation.
IV.1.1.9 Période de détectabilité des
hippopotames
Le suivi nocturne et régulier des mouvements des
hippopotames à l'aide des caméras a montré que ces
mammifères utilisaient les pistes situées sur le rives des mares
entre 18h et 20h pour se rendre dans les pâturages pour ne retourner dans
les mares qu'entre 5h et 6h
- Heure de sortie
La figure 10 illustre l'heure à laquelle la
majorité des hippopotames sortent des mares dans l'UTO
Bénoué.
nombre de vidéos
140
|
57%
|
|
120
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
80
|
30%
|
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
|
|
|
13%
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18h 19h 20h
|
heures de sortie
Figure 10 : Heure de sortie des hippopotames
Il ressort de la figure 10 que sur les 227 vidéos
enregistrées par les caméras installées devant les mares,
57% ont été prise à 19h, 30% des vidéos ont
également été enregistré à 18h et 13% des
vidéos ont été enregistrées à 20h. Il
ressort donc que l'heure de sortie des hippopotames des mares est 19h.
- Heure de retour
nombre de vidéos
|
160
|
|
|
57%
|
|
140
|
|
|
|
|
|
120
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
26%
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17%
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
5h 5h 30 min 6h
heures de retour
42
Figure 11: Heure de retour des hippopotames
43
Sur les 247 vidéos enregistrées à l'aube,
57% ont été prises à 5h, 26% à 5h30 min et 17%
à 6h. Il ressort donc que l'heure de retour des hippopotames dans les
mares est 5h du matin IV.1.2. Proposer une stratégie de gestion
des hippopotames dans le PNB
IV.1.2.1. Etat des lieux des menaces qui pèsent sur
les hippopotames et leur habitat IV.1.2.1.1. Braconnage
L'hippopotame est principalement braconné dans la zone
d'étude pour sa viande qui est une source importante de protéine
animale. Cela se justifie par les carcasses d'hippopotames découvertes
où l'on peut voir les mâchoires qui possèdent encore toutes
les dents (figure 12). Dans le PNB et ses environs, les indices de braconnage
sont nombreux notamment: des campements de braconniers, des trous de
piégeage, des coup de feu, des douilles et carcasses d'hippopotames. Ces
indices ont été les plus nombreux s'agissant des activités
humaines au sein du parc et ses environs. Les indices de braconnage son
illustrées par la figure 12.

Carcasse d'hippopotames (PNB, mai 2019) (a) Braconnier
interpellé (PNB, avril 2019) (b)
Figure 12: Carcasse d'hippopotame (a) et braconnier
interpellé (b)
L'abondance des signes de braconnage sont consignées dans
le tableau 5.
44
Tableau 5: Abondance des signes de braconnage
|
Signes de
|
Nombre
|
Distance parcourue
|
IKA
|
|
braconnage
|
d'observation
|
(km)
|
|
|
Coups de feu
|
4
|
120
|
0,033
|
|
Carcasses
|
3
|
120
|
0,025
|
|
Trous de pièges
|
18
|
120
|
0,15
|
|
Campements
|
11
|
120
|
0,092
|
|
Douilles
|
9
|
120
|
0,075
|
|
Empreintes de pas
|
32
|
120
|
0,27
|
|
Pistes
|
27
|
120
|
0,23
|
|
IKA global
|
104
|
|
0,87
|
Le tableau 5 permet de constater que, parmi les signes du
braconnage et pour une distance totale parcourue égale à 120 km,
les empreintes de pas prédominent avec un IKA de 0,27, suivi des pistes
(0,23) et des trous de pièges (0,15). Les coups de feu (0,033) et les
carcasses d'hippopotames (0,025) sont les moins représentés.
L'IKA moyen pour le braconnage et pour une distance totale parcourue
égale à 120 km le long du lit du fleuve Bénoué est
de 0,13. De manière globale, l'IKA des activités anthropiques est
de 0,87 indice/ km.
IV.1.2.1.2. Orpaillage clandestin
Considéré comme l'une des principales
activités de la zone, l'orpaillage semble incontournable et constitue le
poumon de l'économie des populations locales. Cette importance tient
également au fait que l'orpaillage est la seule activité qui
draine les migrants dans la zone. Tout le cours situé en amont du fleuve
est truffé des trous d'orpaillage. Ces trous constituent non seulement
des facteurs responsables de l'érosion hydrique du lit du fleuve
Bénoué, modifiant ainsi l'habitat des hippopotames mais aussi des
pièges involontaires pour cette espèce. Une étude
réalisée par Tamba en 2018 dans le même
écosystème dont la comparaison des résultats à ceux
obtenus par Mbamba lors d'une étude réalisée en 2014
montre une diminution considérable du nombre de huttes construites dans
les différents sites d'orpaillage visités, soit une diminution de
94% dans le site « Bakassi », de 99,28% dans le site « Gabon
» et de 76% dans le site de Mayo Doubi, ce qui pourrait indiquer une
diminution de l'activité dans ces sites. La figure 13 illustre les
mesures prises par le service de la conservation du PNB à l'encontre des
orpailleurs et un orpailleur dans le parc.
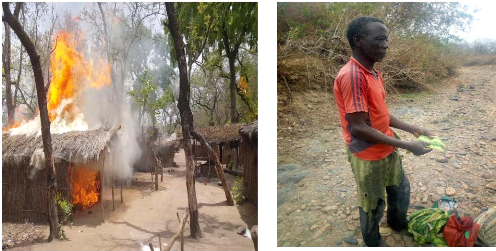
45
Orpailleur interpellé (PNB, avril 2019) (b)
Destruction d'un village d'orpailleurs (PNB, 2019) (a)
Figure 13: Signe de présence humaine dans le
PNB
Le tableau 6 présente l'abondance des signes
d'orpaillage.
Tableau 6: Abondance des signes
d'orpaillage
|
Signes d'orpaillage
|
Nombre
d'observations
|
Distance parcourue (km)
|
IKA
|
|
Orpailleurs
|
125
|
120
|
1,04
|
|
Chantiers
|
17
|
120
|
0,14
|
|
Huttes
|
21
|
120
|
0,18
|
|
IKA global
|
163
|
|
1,36
|
Il ressort du tableau 6 que les orpailleurs interpelés
constituent les indices d'orpaillage les plus observées soit un IKA de
1,04 indice par kilomètre suivit des huttes et des chantiers qui ont
respectivement pour IKA 0,18 et 0,14 indice/ km.
IV.1.2.1.3. Pêche illégale
La pêche est l'une des activités
génératrice de revenus de la population locale. Cette
activité présente des conséquences diverses sur la faune
en générale et les hippopotames en particulier. Les mailles des
filets utilisés ne permettent pas de sélectionner des poissons de
grandes tailles mais ramassent aussi les alevins qui constituent la population
d'avenir. En ce qui concerne les hippopotames, la menace provient du fait que
ces pécheurs peuvent être de véritables braconniers ou des
indicateurs aux braconniers de la présence des hippopotames dans une
mare spécifique, de même, la présences constante d'homme
à proximité des mares
46
modifie non seulement le comportement naturel des hippopotames
mais aussi présente un risque d'attaque pour ces hommes. L'abondance des
signes de pêche est représentée dans le tableau 7.
Tableau 7: Abondance des signes de
pêche
|
Signes de pêche
|
Nombre
d'observation
|
Distance parcourue (km)
|
IKA
|
|
Filets
|
15
|
120
|
0,125
|
|
Pirogues
|
3
|
120
|
0,025
|
|
Pêcheurs
|
16
|
120
|
0,133
|
|
IKA global
|
34
|
|
0,28
|
Les pécheurs interpelés constituent l'indice de
pêche la plus représenté avec un IKA de 0,133, suivi des
filets rencontrées (0,125) et des pirogues (0,025).
IV.1.2.1.4. Variations climatiques
Le changement climatique global représente une menace
potentielle sur les populations d'hippopotames. La réduction de la
pluviométrie et une longue sécheresse qui se vit dans la
région du Nord peuvent entraîner non seulement le tarissement des
mares où vivent les hippopotames mais aussi une raréfaction des
pâturages, un stress de chaleur et une plus grande
vulnérabilité aux maladies.
IV.1.2.1.5. Transhumance de troupeaux de boeufs
La transhumance est l'une des principales activités
anthropiques répandues dans le PNB et l'une des menaces qui
pèsent sur les hippopotames. La réduction du fourrage en saison
sèche pousse les bergers en quête de pâturages à
faire paître leurs bêtes dans le parc en général et
sur les berges du fleuve Bénoué en particulier. La couverture
abondante en Afzelia Africana et de la végétation
herbacée dans le parc est la cible de ces derniers. Pour
régénérer le pâturage, les pasteurs mettent du feu
afin d'avoir de l'herbe fraiche pour leur bétail. Toutes ces actions des
bergers conduisent à une diminution de la nourriture dans l'espace
vitale de l'hippopotame qui affectionne les graminées prisées par
le bétail. La compétition pour la nourriture pousse les
hippopotames à aller chercher leur aliment sur des sites toujours plus
éloignés des points d'eau, générant ainsi une
compétition entre les troupeaux de boeufs et les hippopotames.
L'abondance des indices de transhumance est consignée dans le tableau
8.
47
Tableau 8: Abondance des signes de
transhumance
|
Signe de
transhumance
|
Nombre
d'observations
|
Distance parcourue (km)
|
IKA
|
|
Troupeaux de
boeufs
|
23 120 0 ,19
|
Campements 7 120 0,06
Pistes 13 120 0,1
IKA global 43 0,35
Il ressort du tableau 8 que, parmi les observations des indices
liés à la transhumance, les troupeaux de boeufs avec un IKA de
0,19 sont les plus représentés suivi des pistes (0,1) et des
campements (0,06). L'IKA moyen pour la transhumance et pour une distance totale
parcourue égale à 120 km est de 0,12. Les effets néfastes
de ces intrusions se font ressentir au niveau du parc, notamment avec la
dégradation du milieu (coupe excessive de Afzelia africana,
piétinement et compactage du sol), la concurrence dans l'utilisation des
points d'eau, du pâturage, des salines avec la faune sauvage, voire la
transmission des maladies. IV.1.2.1.6. Abondance des activités
anthropiques de manière générale dans l'UTO
Bénoué
Les principales activités humaines recensées dans
l'UTO Bénoué sont consignées dans le Tableau 9.
Tableau 9: Abondance des activités humaines dans
l'UTO Bénoué
Activités Nombre d'observations IKA
braconnage 104 0,87
Orpaillage 163 1,26
Transhumance 43 0,35
pêche 34 0,28
D'après le tableau 9 l'orpaillage (1,26%) est
l'activité anthropique menée avec une plus grande
fréquence, suivi du braconnage (0,87%), de la transhumance (0,35%) et
enfin de la pêche (0,28%).
48
IV.1.2.1.7. Distribution spatiale des menaces sur les
hippopotames La figure 14 présente les activités anthropiques
dans l'UTO Bénoué.
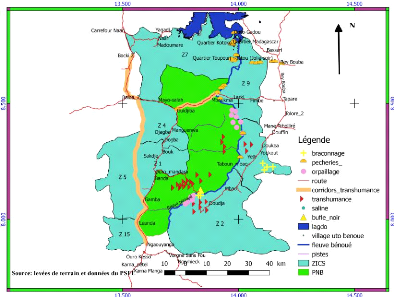
Figure 14: Carte des activités anthropiques dans
l'UTO Bénoué
Il ressort de l'analyse de la figure 14 que les
activités anthropiques sont reparties dans tout l'habitat des
hippopotames. L'on peut aisément deviner la complicité qui existe
entre les braconniers chasseurs d'hippopotames et les pêcheurs comme le
témoignent la distribution des pêcheries et du matériel de
pêche où il y'a eu des abattages dans l'aire de distribution des
hippopotames dans l'UTO Bénoué. L'omniprésence des
transhumants dans l'UTO Bénoué est marquée par les
campements de Mbororos et les nombreux troupeaux rencontrés durant la
présente étude.
IV.1.2.1.8. Relation entre les activités humaines et
les indices hippopotames
La figure 15 présente la relation entre l'IKA des
activités anthropiques et les IKA des indices d'hippopotames.
49
|
180 160 140 120 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activités humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 y = 0,0288x + 89,284
R2 = 0,0041
|
|
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
20
0
0 50 100 150 200 250 300
Indices hippopotames
Figure 15: Relation entre les activités humaines
et les indices d'hippopotames
Le coefficient de détermination (R2 =0.004) est
très faible ce qui signifie que la présence des hippopotames
n'est pas influencée par celle des activités humaines. La figure
16 présente l'interaction entre les activités anthropiques et les
indices d'hippopotames.
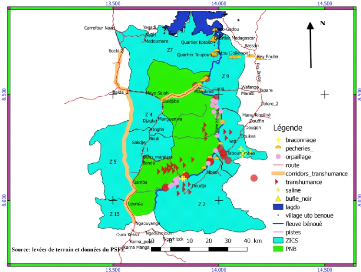
Figure 16: Carte de superposition entre les
activités humaines et les indices d'hippopotames
50
Il ressort de la figure 15 que l'orpaillage est
l'activité anthropique la plus rependue sur l'habitat des hippopotames
suivi de la pêche et la transhumance. La proximité des
activités anthropiques aves les mares aux hippopotames témoigne
le degré d'empiètement de l'homme sur cette espèce.
IV.1.2.2. Stratégie de gestion des hippopotames dans
l'UTO Bénoué
IV.1.2.2.1. Vision
La mise en place de la stratégie de gestion des
hippopotames dans la PNB consiste à définir une orientation qui
intègre à la fois la nécessité de conservation de
l'espèce et de développement socio-économique durable des
communautés riveraines du l'UTO Bénoué.
IV.1.2.2.2. But
L'objectif étant de renforcer les mesure de gestion et
de protection des hippopotames dans le parc de manière conjointe pour
l'amélioration du bien-être des populations, pour la contribution
au développement économique local et pour l'équilibre
écologique.
IV.1.2.2.3. Axes stratégiques
Les observations faites sur le terrain lors de la présente
étude ont permis de définir cinq axes
stratégiques prioritaires d'intervention.
- Lutte anti-braconnage ;
- Valorisation de l'hippopotame ;
- Renforcement de la collaboration entre les parties prenantes et
la conservation des
hippopotames ;
- Coordination et suivi-évaluation du présent plan
de gestion ;
- Financement durable.
Le tableau 10 présente la stratégie de gestion des
hippopotames dans l'UTO Bénoué.
51
Tableau 10: Stratégie de gestion des hippopotames
dans l'UTO Bénoué
|
Axes
stratégiques
|
Objectif
|
Actions
|
Acteurs
|
Résultats attendus
|
|
Lutte anti-
|
Réduire les pertes
|
- Installer permanemment les cameras devant
|
- MINFOF ;
|
- Patrouille de lutte anti-
|
|
braconnage
|
des populations
|
les mares à hippopotames ;
|
- MINDEF ;
|
braconnage effectué ;
|
|
d'hippopotames liées
|
- Installer des puces sur des hippopotames;
|
- LAMIDO du
|
- Nombre de sessions de
|
|
au braconnage
|
- Identifier et renforcer les aspects culturels de
|
Rey-Bouba ;
|
formation organisées ;
|
|
|
la conservation de l'hippopotame ;
- Renforcer le contrôle à l'accès et à
la
circulation des armes et munitions ;
|
- ONG
|
- Capitalisation du savoir-faire
androgène ;
- Sensibilisation renforcée ;
|
|
|
- Assurer le contrôle effectif de la circulation
et de la vente des produits et sous-produits des hippopotames
;
|
|
- Circuit de vente des produits
et sous-produits
d'hippopotame déterminé.
|
|
|
- Intensifier les opérations de lutte anti-
braconnage.
|
|
|
|
Valorisation
|
Améliorer la
|
- Développer l'éco-tourisme autour de
|
- MINFOF ;
|
- Sites touristiques aménagés ;
|
|
des
|
contribution de cette
|
l'hippopotame ;
|
- MINTOUL ;
|
- Nombre de touristes accru ;
|
|
hippopotames
|
espèce au bien-être
|
- Mener une étude sur les autres formes de
|
- Universités
|
- Recette engrangée ;
|
|
des populations
|
valorisation de l'hippopotame ;
|
- Médias ;
|
- Tournages réalisés et publicité
|
|
|
- Aménager les bâtiments pour les touristes ;
|
- EFG;
|
sur les hippopotames faite ;
|
|
|
- Réaliser des tournages pour la publicité dans
les médias
|
- ENEF
|
- Nombre de personnes
sensibilisées
|
52
Renforcement
|
Capitaliser les atouts
|
- Capitaliser les résultats des études
réalisées
|
- ONG
|
-
|
|
de la
|
de chaque partie
|
par les institutions de recherches en faveur de
|
- Service de la
|
Application des résultats
|
|
collaboration
|
prenante dans le
|
la conservation des hippopotames ;
|
conservation
|
d'étude par les conservateurs ;
|
|
entre les
|
processus de gestion.
|
- Capitaliser les connaissances
|
- Populations
|
- Plate-forme crée ;
|
|
parties
|
|
ethnobotaniques sur les hippopotames ;
|
riveraines ;
|
- Feuille de route dressée ;
|
|
prenantes et la
|
|
- Créer les plates-formes d'échange entre les
|
- Autorités
|
- La participation des
|
|
conservation
|
|
partie prenantes ;
|
traditionnell
|
populations dans la gestion
|
|
des
hippopotames
|
|
- Renforcer la coopération et l'échange
d'informations entre le service de la conservation et les
partenaires ;
|
es.
|
des hippopotames est accrue.
|
|
|
- Renforcer la participation active des
populations à la gestion des hippopotames.
|
|
|
|
Coordination
|
Assurer une
|
- Mettre en place un cadre de pilotage, de
|
- ONG
|
- Chronogramme et suivi des
|
|
et suivi-
|
application effective
|
coordination, du suivi-évaluation de la
|
- Service de la
|
activités établi ;
|
|
évaluation du
|
et efficace des
|
présente stratégie ;
|
conservation
|
- Cadre de pilotage, de
|
|
présent plan de
|
différents axes de la
|
- Etablir un chronogramme d'activités ;
|
;
|
coordination et du suivi-
|
|
gestion
|
présente stratégie.
|
|
|
évaluation mis en place
|
|
Financement
|
Développer et
|
- Concevoir des projets de conservation et de
|
- Service de la
|
|
|
durable
|
opérationnaliser des
|
valorisation des hippopotames qui sont
|
conservation
|
- Le partenariat avec le secteur
|
|
mécanismes de
|
soumis pour financement auprès des
|
;
|
privé pour le financement de
|
|
financement durable
|
partenaires ou des institutions internationales
|
- Partenaires
|
la conservation est développé ;
|
|
pour pallier à l'insuffisance du
|
visées ;
- Faire le lobbying et le plaidoyer afin de
|
financiers,
- Médias.
|
- Une stratégie pour la
recherche et la mobilisation
|
|
budget annuel de
|
susciter un intérêt pour la conservation et la
|
|
des financements
|
|
l'Etat pour la gestion
|
mise en valeur de cette espèce auprès des
|
|
internationaux est développée
|
|
d'une part du PNB et
|
potentiels partenaires financiers et
|
|
et mise en oeuvre.
|
|
d'autre part des
|
techniques ;
|
|
- Le mécanisme de financement
|
|
hippopotames
|
- Communiquer à travers le blog, le site
internet du parc.
|
|
sécurisé du service de la conservation est mis en
place par l'Etat.
|
53

53
IV.1.2.3. Cadre temporel des différentes
actions
Sous la responsabilité du MINFOF et sur une
période de cinq ans, la mise en oeuvre de cette stratégie de
gestion à travers les actions citées ci-dessus, sera
assurée par un ensemble de parties prenantes parmi lesquels : l'Etat,
les organisations de la société civile, les centres de
formations, les collectivités territoriale, les communautés
locales et avec l'appui des partenaires techniques et financiers.
IV.1.2.4. Evaluation des coûts
Le tableau 11 présente en détail les coûts
de chaque action de la stratégie de gestion des hippopotames dans l'UTO
Bénoué.
Tableau 10: Evaluation des coûts de la
stratégie de gestion des hippopotames
|
Désignation
|
Nombre en 5 ans
|
Prix unitaire
|
Prix total
|
|
lutte anti-braconnage
|
|
Actions
|
|
|
|
|
Installer les puces sur les hippopotames
|
500
|
50.000
|
25.000.000
|
|
Installer permanemment les cameras devant les mares
|
64
|
300.000
|
13.000.000
|
|
Identifier les aspects culturels de l'hippopotame
|
1
|
1.000.000
|
1.000.000
|
|
Renforcer le contrôle à l'accès et à
la circulation des armes et munitions
|
|
15.000.000
|
15.000.000
|
|
Sous total 1
|
63.000.000
|
|
Valorisation de l'hippopotame
|
|
Actions
|
|
|
|
|
Développer l'éco- tourisme autour de
l'hippopotame
|
Aménagement des bâtiments existants
|
25.000.000
|
45.000.000
|
|
construction des bancs d'observation
|
10.000.000
|
|
tournages vidéo pour publicité médiatique
|
20.000.000
|
|
Mener une étude sur les autres formes de valorisation de
l'hippopotame
|
1
|
2.000.000
|
2.000.000
|
|
Sous total 2
|
65.000.000
|
|
Renforcement de la collaboration entre les parties
prenantes et la conservation des hippopotames
|
|
Capitaliser les résultats des études
réalisées par les institutions de recherches en faveur de la
conservation des hippopotames
|
Financer les stages sur :
|
|
25.000.000
|
|
L'inventaire d'hippopotames
|
5.000.000
|
|
Le suivie écologique des hippopotames
|
10.000.000
|
|
Régime alimentaire d'hippopotames
|
10.000.000
|
54
Créer les plates-formes d'échange entre les parties
prenantes
|
Site web, groupe watsapp et rencontres physiques
|
5.000.000
|
5.000.000
|
|
Renforcer la participation des populations à la gestion
des hippopotames
|
|
5.000.000
|
5.000.000
|
|
Sous total 3
|
35.000.000
|
|
Coordination et suivi-évaluation du
présent plan de gestion
|
|
Actions
|
|
|
|
|
Mettre en place un cadre
de pilotage, de
coordination, du sui-
évaluation de la présente
stratégie
|
|
10.000.000
|
10.000.000
|
|
Etablir un chronogramme d'activités
|
|
10.000.000
|
10.000.000
|
|
Sous total 4
|
20.000.000
|
|
financement durable
|
|
Actions
|
|
|
|
|
La conception et soumission des projets de conservation et de
valorisation des hippopotames pour financement auprès des partenaires
|
|
45.000.000
|
45.000.000
|
|
le lobbying et le
plaidoyer afin de susciter un intérêt pour la
conservation et la mise en valeur de cette espèce auprès des
potentiels partenaires financiers et techniques
|
|
10.000.000
|
10.000.000
|
|
la communication à travers le blog, le site internet du
parc et les chaines de télévision locales
|
|
5.000.000
|
5.000.000
|
|
Sous total 5
|
|
|
60.000.000
|
|
TOTAL
|
|
|
243.000.000
|
Il ressort du tableau 11 que sur les cinq années que
doit durer cette stratégie de gestion, les dépenses totales
s'élèvent à 243000000 FCFA. Le financement durable qui
permet de développer les mécanismes permettant aux partenaires
financier de financer les différentes actions est l'axe
stratégique prioritaire. La lutte anti-braconnage quant à elle,
est l'axe stratégique qui vient en seconde position afin de
réduire les pertes d'effectifs d'hippopotames liées au
braconnage.
55
IV.2. DISCUSSION
Le PNB à connue des inventaires d'hippopotames à
des intervalles de temps pas régulières. Lors de la
présente étude, 287 hippopotames ont été
inventoriés dans 16 mares permanentes le long du lit du fleuve
Bénoué et celui du Mayo Oldiri un des affluents majeur de la
Bénoué. Ce résultat présente une augmentation de
l'effectif d'hippopotame comparativement aux inventaires réalisés
par Mbamba en 2013 ; 2016 et 2018 dont les résultats étaient 205,
228 et 217 respectivement. Cette augmentation peut s'expliquer non seulement
par les efforts déployés par le service de la conservation du PNB
pour lutter contre le braconnage mais aussi par la méthodologie
utilisée durant la présente étude. La présente
étude s'est déroulée en saison sèche période
durant laquelle le fleuve Bénoué à tari et il ne reste que
les mares permanentes dans lesquelles un comptage total s'est effectué,
comparativement à l'étude réalisée par Maha en 2012
en début de saison pluvieuse, basée sur la méthode de Ngog
Njié (1988), dont les résultats ont présenté un
effectif de 180 individus. Cette différence peut s'expliquer par la
montée des eaux de la Bénoué qui représente une
difficulté dans le processus de comptage.
Sur les 16 mares inventoriées, 25% ne contenaient pas
d'hippopotames. Ce résultat est fortement lié à
l'ensablement de la mare et aux changements climatiques. En effet, lorsqu'une
mare perd la profondeur à cause de ces phénomènes, les
hippopotames migrent vers les mares plus profondes où ils pourront
s'immerger. C'est dans cette optique que plusieurs mares de fortes
concentrations avec plusieurs groupes ont été observées.
Les conflits de leadership entres les mâles sont la conséquence de
cette migration. L'effectif de la présente étude donne une
densité de 0,8 individus/km2 par rapport au domaine parcouru
par l'espèce en saison sèche. Il représente environ 72% de
la population d'hippopotame inventorié en 1988 par Ngog Njié. Les
causes de la régression sont essentiellement imputées au
braconnage.
Malgré les efforts déployés par le
service de la conservation pour assurer la préservation des
hippopotames, quatre dynamismes majeurs affectent la croissance des effectifs
d'hippopotames entre autre le braconnage, la transhumance, les changements
climatiques et la pêche. Les observations de terrain
révèlent que cette espèce est essentiellement
braconnée pour sa viande et le commerce de sa peau pour la fabrication
des sacs à main. Ceci serait dut non seulement à la recherche de
protéines animales mais aussi à la pauvreté des
populations. Cette activité de braconnage peut justifier son
intensité par la migration des peuples, l'accès illégal
facile dans le parc et le manque d'effectif d'éco-gardes pour assurer la
surveillance continue du parc. En effet l'insécurité qui
règne dans la partie septentrionale et à la frontière
56
avec la RCA oblige les populations à migrer vers
l'intérieur du pays. L'action récente de surveillance nocturne
à l'aide des camera a permis de constater la présence des
pêcheurs dans les mares proches du campement du Buffle noir, ces hommes
peuvent se présenter dans les mares aux hippopotames comme des simples
pécheurs alors qu'ils sont soit des braconniers soit des indiques aux
chasseurs d'hippopotames.
57
CHAPITRE V : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
VI.1. CONCLUSION
Réalisée dans l'UTO Bénoué, la
présente étude a porté sur les « nouvelles
technologies et amélioration des inventaires fauniques : cas des drones
et camera-pièges dans la gestion durable des hippopotames de l'UTO
Bénoué ». L'objectif global était de contribuer
à une meilleure connaissance des effectifs d'hippopotames de l'UTO
Bénoué afin de planifier la gestion durable de cette
espèce. Des investigations menées sur le terrain, 287
hippopotames ont été inventoriés sur les 120 km du cours
du fleuve Bénoué avec 97 individus dans une mare du Mayo Oldiri,
affluent majeur du fleuve. Les indices de présence d'hippopotames
varient en fonction des types d'indices. La taille des populations
d'hippopotames à fortement variée entre les différentes
périodes d'étude de 1975 à 2019. La distribution spatiale
des hippopotames a montré que cette espèce est présente
tout le long du fleuve allant du campement de la ZIC 2 situé dans la
partie Sud du parc jusqu'au campement du grand capitaine situé au nord
du parc avec une forte concentration d'effectif dans la ZIC 3. Les hippopotames
n'ont pas été observés dans certaines mares durant la
présente étude.
Plusieurs dynamismes affectent grandement les effectifs de
cette espèce, il s'agit notamment du braconnage, de l'orpaillage, de la
transhumance et des changements climatiques. La gestion durable de cette
espèce passe par quatre axes stratégiques prioritaires entre
autres la lutte anti-braconnage, la valorisation de l'espèce, le
renforcement de la collaboration entre les parties prenantes, la coordination,
suivi-évaluation du plan de gestion et le financement durable.
VI.2. RECOMMANDATIONS
Afin d'améliorer la conservation et la gestion des
hippopotames dans l'UTO Bénoué, les
recommandations suivantes doivent être prises en compte par
chaque partie prenante.
Au MINFOF
- Créer un sanctuaire à hippopotames dans l'UTO
Bénoué;
- Développer des mécanismes pour favoriser l'auto
financement du parc afin de relever les
faiblesses de gestion liées à l'insuffisance des
moyens financiers et techniques.
Aux partenaires du PNB
- Créer un club des amis d'hippopotames qui va regrouper
les populations riveraines afin
qu'ils s'approprient d'avantage de la conservation de cette
espèce;
- Appuyer la recherche et assurer la disponibilité des
données afférentes au profit du service
de la conservation du PNB afin d'améliorer la
planification ciblée des actions de gestion ;
58
Aux populations locales
- Respecter les limites établies par le micro-zonage et
maintenir les activités de développement humain dans les terroirs
villageois ;
- Etre davantage réceptifs et adhérents aux
initiatives engagées par le service de la conservation et qui visent
à garantir des avantages socio-économiques et une gestion
participative des ressources naturelles.
59
BIBLIOGRAPHIE
Afolayan T.R. (1980). A synopsys of wildlife
conservation in Nigeria. Environmental Conservation 7 (3): 207
Ajayi S.S. 1978. The utilisation of tropical
forest wildlife: State of knowledge and research priorities. Proceedings
of the eighth World Forestry Congress, Jakarta, Indonesia.
Amoussou K.G., Mensah G.A. et Sinsi P.
(2006). Données biologiques, éco-éthologiques
et socio-économiques sur les groupes d'hippopotames (Hippopotamus
amphibius) isolés dans les terroirs villageois en zones humides des
départements du Mono et du Couffo au Sud-Bénin. Pp
22-24-3.
Anonyme (1998). Abondance,
distribution et Biomasse de quelques grands mammifères dans le Parc
National de la Bénoué. WWF/FAC/MINEF, Garoua, Cameroun.
48p.
Arrête n° 0565 / A/MINEF/DFAP/SDF/SRC fixant la
liste des animaux des classes A, B et C, répartition des espèces
animales dont l'abattage est autorisé ainsi que les latitudes d'abattage
par type de permis sportif de chasse.
Arrêté n° 0648/MINFOF du 18 décembre
2006 fixant la liste des animaux par classe de protection.
Assogbadjo A.E., Kassa B., Sinsin B. et Mensah G.A.
(2004). Notions sur les méthodes de dénombrements de
la faune sauvage mammalienne : quelques expériences du laboratoire
d'Ecologie Appliquée au Bénin. In : Actes du
séminaire-atelier sur la mammalogie et la biodiversité,
Abomey-Calavi/Bénin 2004-13. Pp 177-182.
Bauer H., Kamgang S.A., Tumenta P. et Kirsten I.
(2015). Rapport de l'inventaire des grands carnivores dans le
complexe de la Bénoué. MINFOF. EFG. 5p.
Béné Béné L. et Lawan A.
(2006). Rapport de suivi de la faune et de
l'intégralité des corridors, dans et autour du PNB. Rapport
d'étude WWF/PSSN Garoua. 25p.
Bonin T., Kaethur G. et Harder P. (2018).
Suivi de la dynamique paysagère au sein d'un espace naturel
protégé : cas du parc national de Taza (wilaya de Jijel,
Algérie). 48p.
Boum R., Bene Bene L., Noutsawou D et Ngwesse B.
(2009). Plan de développement de l'unité de
planification de la ZIG 1 (Sakdjé, Bouk, Ouro Bobo). WWF/NSSP,
Garoua, Cameroun. 34p.
Buttoud G., Karsenty A., Memvie J.B., Sollo J.W et
Tissari J. (2005). Mission technique de
diagnostic de la gestion durable des forêts en vue d'atteindre l'objectif
2000 de l'OIBT en
60
appui au gouvernement de la république gabonaise
(janvier-juin 2005). Rapport de mission de diagnostic.96p.
Chabot P et Bird J. (2012). Evaluation of an
off-the shelf unmanned aircraft system for surveying flocks of geese,
Waterbirds. 23p.
Delvingt W. et Dethier M. (2002). Les
forêts et les hommes. Terroirs villageois en forêt tropicales
africaine. Les presses agronomiques de Gembloux (Belgique). 58p .
Dibloni T.O., Vermeulen C., Wendengoudi G. et Millogo
N.A. (2010). Structure démographique et mouvements
saisonniers des populations d'hippopotame commun, Hippopotamus amphibius
Linné 1758 dans la zone sud soudanienne du Burkina Faso. 96p
Dibloni Théophile O., Vermeulen C., Guenda,
Wendengoudi et Belem M. (2009). Caractérisation paysanne de
Hippopotamus amphibius Linné 1758 , dans la Reserve de Biosphère
de la Mare aux Hippopotames en zone Sud soudanienne du Burkina Faso.
58p.
Djeukam R. (2007). La législation
faunique camerounaise comme outil d protection des espèces animales
menacées d'extinction au Cameroun. 15p.
Dunford R., Michel K., Gagnage M., Piegay H. et Tremelo
M. (2009). Potentiel et contraintes de la technologie UAV pour la
caractérisation de la forêt riveraine
méditerranéenne. 88p.
Eba'à Atyi R. et Bayol D. (2009). Les
forêts du bassin du Congo. Etat des forets, Office des publications de
l'union européenne. 24p.
Eltringham S.K. (1993). Les cochons.
Pécaris et hippopotames. Enquête de situation et plan d'action
pour la conservation, Pp55-60.
Eltringham S.K. (1993). The Common
Hippopotamus (Hippopotamus amphibious). In: Pigs, Peccaries and
Hippos: Status Survey and Action Plan. Olivier, W.L.R. (Ed), Pp 161-171.
Kouague G. (2005). impacts des barrages sur les
populations d'hippopotames et gestion du conflit avec l'homme : le cas du
barrage de kandadji sur le fleuve Niger. 4p.
Getzin S., Wiegand K. et Schöning I.
(2012). Assessing biodiversity in forests using very high-resolution
images and unmanned aerial vehicles. Methods in Ecology and Evolution,
3 (2): 397-404.
Ghiglieri G. (1983). Le dénombrement
au bord de la rivière dans la réserve de gibier de
Selous en Afrique. 26p.
Gomsé A. et Mahop J.P. (2000).
Dénombrement de grands mammifères dans le Parc
National de la Bénoué et les zones de chasse 1 et 4. Rapport
d'étude. WWF/PSSN. Garoua. 41p.
61
Grenzdörffer W. (2013). Archives
internationales de la photogrammétrie, de
télédétection et des sciences de l'information spatial.
La potentielle photogrammétrie des UAV à faible cout en
foresterie et en agriculture. Pp 1207-1214
Griffiths M. (1994). Population density of
Sumatran tiger in Gunung Leuser National Park. In: Sumatran Tiger
population and Habitat Viability Analusis Report. (Eds. R. Tilson, K.
Soemarna, W. Ramono, S. Lusil, K. Traylor-Holzer et U. Seal). Indonesian
Directorat and Forest Protection and Nature Conservation and UICN/SSC
Conservation Breeding Specialist Group. Apple Valley, Minnesota, USA. 35p.
Igboh R. (1986). Crocodile worship in
Anambra State. Higher Diploma Project Report, Federal College of Wildlife
Management, New Bussa. 22p.
Institut Nationale de Statistique (INS).
2015. Annuaire statistique du Cameroun : environnement- Faune et
Foret. chapitre 16. 272p.
Jeannin A. (1945). Les bêtes de
chasse de l'Afrique française. Payot, Paris. 22p.
Jones P.G., Pearlstine L.G. et Percival H.F.
(2006). An assessment of small unmanned aerial vehicles for wildlife
research. Wildlife Society Bulletin 34(3): 750-758.
Kemeth A., Pélissier C. et Tchamou N.
(2005). La gestion des aires protégées dans les
paysages du PFBC : Un état des lieux. Chapitre 10.UICN, WWWF,
USAID/CARPE. [En
ligne]. [
https://www.observatoire-comifac.net/docs/edf2005/FR/EDF_2010_FR_10.pdf].
(Consulté le 19 février 2019 à 09 h 10
min).
Koh D. et Wich G. (2012). Dawn
of Drone Ecology : des véhicules aériens autonomes à
faible coût pour la conservation. 45p.
Koulagna K.D. et Wéladji R.B. (1996).
Gestion participative des aires protégées dans la
province du Nord Cameroun. SNV. 120p.
Kpetere J., Nago S., Natta K., Houesou L. et Keita N.
(2015). Connaissances ethno zoologiques et importance de
l'hippopotame commun (Hippopotamus amphibius amphibius) pour les populations du
nord-est bénin : implication pour sa conservation et sa valorisation
durable. Université de Parakou. Série des sciences
naturelles et agronomiques. 102p.
Kunin J. et Lawton P. (1996). Gender
differences in wayfinding strategies and anxiety about wayfinding: Across-
Cultural Comparison. 95p.
Letouzey R. (1968). Etude phytographique du
Cameroun, encyclopédie biologique. Le chevalier, Paris. 511 p.
Lewison K. et Oliver P. (2008). Statut de
conservation des hippopotames communs dans le parc national des Virunga.
Université du Cap. 89p.
62
Linchant J., Lejeune P. et Vermeulen C.
(2013). Les drones voleront-ils au secours de la faune
menacée de la RDC ? 66p
Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche.
Maha G. (2012). Etude de la structure de
la croissance et du régime alimentaire de la population d'hippopotames
au parc national de la Bénoué et sa
périphérie. Mémoire de Master. Université de
polytechnique de BOBO-DIOULASSO. Institut de Développement Rural.
25p.
Manet B. et Herman R. (2003).
Photographie automatique et animaux a activités
nocturne. Centre de Recherche sur la Nature, de Forêts et du bois,
Laboratoire de Faune Sauvage et de Cynégétique, avenue Marechal
Juin, 23 B-5030 Gembloux. 78p.
Martin R.B. et Thomas D.J. (1991). Quotas
for sustainable utilization in the communal lands. A manual for district
council with appropriate authority. The Zimbabwe trust, Zimbabwe Park
Publication. 46p.
Mbamba M.J.P.K. (2013). Rapport
`inventaire des hippopotames du parc national de la Bénoué.
MINIFOF-Nord 10p.
Mbamba M.J.P.K. (2016). Rapport
`inventaire des hippopotames du parc national de la Bénoué.
MINIFOF-Nord 12p.
Mbamba M.J.P.K. (2018). Rapport
`inventaire des hippopotames du parc national de la Bénoué.
MINIFOF-Nord 6p.
Meli M. (2019). Nouvelles technologies et
améliorations des inventaires fauniques : cas des drones et
camera-pièges dans la gestion durables des hippopotames de l'UTO
Bénoué. Mémoire de fin d'études.
Université de Dschang, Cameroun. 68p.
Ministère de l'Environnement et des
Forêts (MINEF). (1997). Guide de l'élaboration des
plans d'aménagement des forets de production du domaine forestier
permanant du Cameroun. Yaoundé, Cameroun. 58p.
Ministère de l'Environnement et des
Forêts (MINEF). (2002). Parc National de la
Bénoué : Plan d'Aménagement du Parc et de sa zone
périphérique. Programme de conservation et de gestion de la
biodiversité au Cameroun, WWF/SNV/MINEF, Yaoundé. 97p.
Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF). (2002). Convention entre l'Etat du Cameroun
représenté par l'administration en charge de la faune et des
aires protégées (MINFOF) et le collectif des villages riverains
de la zone d'intérêt cynégétique Numéro1,
représenté par l'UCVF 1 pour la cogestion de la zone
d'intérêt cynégétique Numéro 1 dite
Sakdjé. MINFOF/SG/DFAP. 13p.
63
Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF). (2002). Convention entre l'Etat du Cameroun
représenté par l'administration en charge de la faune et des
aires protégées (MINFOF) et le collectif des villages riverains
de la zone d'intérêt cynégétique Numéro 4,
représenté par l'UCVF 4 pour la cogestion de la zone
d'intérêt cynégétique Numéro 4 dite Bel
éland. MINFOF/SG/DFAP. 11p.
Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF). (2012). Stratégie 2020 du sous-secteur
forêts et faune. Plan d'actions 2013-2017. Yaoundé, Cameroun.
172p.
Nchanji A.C. et Fotso R.C. (2007). Common
hippopotamus (Hippopotamus amphibius): a survey on the River Djerem,
MbamDjerem National Park, Cameroon. Mammalia 70: 9-13
Ngandjui, G. (1998). Etude de la chasse
en vue de sa gestion durable cas du Sud-Est Cameroun. Projet WWF.
98p.
Ngog Njie, J. (1988). Contribution à
l'étude de la structure de population des hippopotames (Hippopotamus
amphibius L.) au Parc National de la Bénoué. Garoua,
Cameroun. 59p. Okello J.B.A., Nyakaana S., Masembe C., Siegismund H.R.
et Arctander P. (2005). Mitochondrial DNA variation of the common
hippopotamus: evidence for a recent population expansion.
Heredity 95: 206-215.
Ollo D., Vermeulen C., Wendingoudi G. et Mollongo N.
(2010). Structure démographique et mouvements saisonniers
des populations d'hippopotame commun, (Hippopotamus amphibius Linné
1758) dans la zone sud soudanienne du Burkina Faso. 35p.
Onyeanusi A. (1996). The ecology of
hippopotamus in Nigeria's conservation areas with special reference to Kainji
Lake National Park. Ph.D. These, University of Ibadan. 202p
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation (FAO). (2007).
Situation des forêts du monde 2007. Rome,
Italie.143p.
Rowcliff J.M., Carbone C., Jansen P.A., Kays R. et
Kranstauber B. 2011. Quantifying the sensitivity of camera traps: an
adapted distance sampling approach. Methods in Ecology and Evolution
2: 247-476
Scholte P. et Iyah E. 2013. Declining
population of the vulnerable common hippopotamus Hippopotamus amphibius in
Bénoué national park, Cameroon (1976-2013): the importance of
conservation presence. Oryx 50: 506-513.
Sinsin B. et Assogbadjo A.E. (2001).
Dénombrement des hippopotames (Hippopotamus amphibius) dans
la Réserve de Biosphère de la Pendjari. GTZ. 6p.
Siroma J. (2007). Impact des
activités humaines sur les aires protégées de la Province
du Nord : Cas des corridors dans le complexe du Parc National de la
Bénoué. Mémoire DESS
64
(Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées). Centre Régional d'Enseignement
Spécialisé en Agriculture (CRESA) forêt-bois,
Yaoundé, Cameroun. 65p.
Tagueguim E. (1999). Anthropisation et
utilisation des ressource naturelles dans les zones d'intérêt
cynégétique autour du parc national de la Bénoué :
cas de la zic1 Sakdjé. Mémoire de fin d'études.
Université de Dschang, Cameroun. 76p.
Tembo. (1987). Etat de la population
d'hippopotame sur le fleuve Luangwa, Zambie. Afrcan Journal of Ecology
25(2) : 71-77.
Triplet et Poilecot. (2009).
Manuel de gestion des aires protégées d'Afrique
francophone. 5p.
Tsakem S.C. et Bene Bene L. (2004). Etat
des lieux de la faune du Parc National de la Bénoué et les ZICZ1
et 4 : une analyse basée sur les grands et moyens
mammifères. Rapport d'étude WWF/PSSN Garoua. 50p.
Tsi E.A., Tomedi E., Talla F. et Nguimkeng D.
(2011). Status and dynamics of hippopotamus (hippopotamus
amphibious) during the rainy season in faro national park Cameroon.
79p.
Turner Katrina B., Thomas M., Claude G., Holly K.G.,
Keith S.L. et Russell A.M (2012). Global bioversity conservation and
alleviation of poverty. Bioscience 62 (1): 85-92.
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN). (1994). Aires protégées et catégories
de l'UICN. 17p.
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(IUCN). (1980). Stratégie mondiale de la conservation.
La conservation des ressources vivantes au service du développement
durable. 56p.
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(IUCN)-PAPACO, (2010). Evaluation de l'efficacité de
gestion des aires protégées. 54p.
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN). (2006). Liste rouge de l'UICN des espèces
menacées. Disponible sur le site <<
http://www.develloppement
-durable-lavenir.
Com/2006/05/03/ liste rouge de l'UICN des espèces-
menacées2006.
Union Internationale pour le Conservation de la Nature
(IUCN). (2009). La grande chasse en Afrique de l'Ouest:
quelle contribution à la conservation? 12p.
Vermeulen C. (2016). Cartographie de la
dynamique de terroirs villageois à l'aide d'un drone dans les aires
protégées de la RDC. 78p.
Vermeulen C. et Doucet B. (2006). Le
facteur humain dans l'aménagement des espèces de ressources en
Afrique centrale forestière : application aux Badjoué de
l'Est-Cameroun. Thèse
65
de doctorat en agronomie et ingénierie
biologique. Faculté Universitaire des sciences agronomiques de
Gembloux. 69p.
Vermeulen C., Lejeune P., Lisein J., Sawadogo P. et
Bouche P. (2013). Unmanned Aerial survey of Elephants. 69p.
Vivien J. (1991). Faune du Cameroun :
Guide des mammifères et poissons. Les presses de l'imprimerie
Saint-Paul, Mvolyé, Yaoundé, Cameroun. 271p.
White L. (1994). Biomasse des
mammifères de forêts pluviales dans la réserve de
Lopé, Gabon. Journal of Animal Ecology 63 : 499-512.
Wing L., Francois Z., et Leh P. (2013). Small
flying Drones: Application for Geographic Observation.65p.
World Wildlife Fund (WWF/FAC). (1998).
Abondance, distribution et biomasse de quelques grand mammiferes
dans le Parc National de la Bénoué. WWF/FAC/MINEF Garoua
Cameroun. 48p.
Xiang L. et Tian P. (2011).
High-positioning and Real-time data Processing of UAV system. 96p.
Zibrine M. et Gomse A. (1999).
Distribution et dynamique des populations d'hippopotames et des
espèces animales liées aux galeries forestières dans le
Parc National de la Bénoué. WWFIPSSN, Garoua, Cameroun.
89p.
66
ANNEXES
Annexe 1: Fiche des données sur la structure de
la population d'hippopotames
N° de la mare : . Secteur :
Nom de l'observateur : date :
|
Heure
d'observation
|
Nombre d'individus
|
Adultes
|
Subadultes
|
Juvéniles
|
Latitude
|
Longitude
|
Commentaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe 2 : Fiches des données sur les menaces
sur les hippopotames
Date Secteur heure
Observateur .
|
N° d'ordre
|
Latitude
|
Longitude
|
Description des activités humaines
|
commentaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe 3: Planche photographique

Photo 1 : Installation d'une camera
Photo 2 : Groupe d'hippopotames dans une mare
67
Photo 3 : Troupeau d'hippopotames dans une saline

68
Photo 4 : Déploiement du drone
Photo 6 : Campement de braconniers
Photo 7 : Arme du braconnier
Photo 5 : Enseignement sur l'utilisation du drone par le
conservateur
69
| 


