|
1.
2. ETAT DE LAQUESTION.
L'Etat de la question est un exercice de consultation des
littératures antérieures en rapport avec le sujet traité.
La revue de toutes ces littératures des travaux réalisés
pendant d'autres époques ou d'autres endroits permet également de
ressortir le point de démarcation entre ces travaux et l'enquête
en cours, c'est-à-dire, elle fait ressortir l'originalité et
l'authenticité de la présente étude1(*).
De ce fait, plusieurs auteurs se sont attachés
à étudier le marketing, mais chacun se conforme à son
sujet de recherche bien déterminé.
De ce qui précède,
nous nous sommes référée aux travaux des :
STANIS MANGALA SOSOABO2(*)qui a parlé de l'Etude comparative de la
préférence de produits laitiers dans la cité de Bunia; cas
de Cowbell et Nido de 2009 à 2012, l'un de ses objectifs
était de démontrer, identifier les déterminants de la
consommation du lait NIDO et COWBELL à travers le bon prix et bon
goût au choix de la population de la cité de Bunia. Ce dernier
conclut quele goût et la disponibilité seraient des raisons
majeures, c'est-à-dire les critères qui justifient les choix des
consommateurs pour les produits laitiers NIDO et COWBLL.
Monsieur HAMADOU PALE ERIC3(*)s'est intéressé à l'Analyse de la
consommation de lait et des produits laitiers, ce dernier a
démontré que la dépense aux produits laitiers est fonction
du revenu : plus le revenu augmente, plus la dépense (consommation)
en lait et produits laitiers augmente.
Pour sa part, Jean Louis PALUKU SIWAKO, qui a traité
des perspectives du service marketing sur la production au sein de la
SONAS/Goma de 2003-2006, a mis l'accent sur le fait que le service marketing
doit chercher à ce que le client soit au centre de l'entreprise. Et pour
ce faire, il vise la valeur, la satisfaction et la fidélité du
client4(*).
En croire SOKI KATAVALI Nadine, les
stratégies marketing appliquées dans les compagnies de transport
aérien de Goma, cas de la CETRACA/CAS/Goma de 2006-2007 qui a
martelé sur le Mix marketing et de leur application dans la compagnie
CETRACA/CAS. Elle est parvenue à conclure que quand la compagnie
était en monopole, elle a appliqué la politique du prix
élevé ou d'écrémage5(*).
Notre travail se démarque de ceux de nos
prédécesseurs dans ce sens qu'il touche surl'analyse du circuit
de distribution de produits laitiers dans le marché d'Aru. Cas de
superettes de la commune d'Aru de 2016 A 2019.Dans un sens plus large nous
allons marteler sur les circuits de distribution.
3. PROBLEMATIQUE
Avec l'évolution du marketing et la
multiplicité des produits, les entreprises doivent non seulement
produire, mais aussi écouler leurs produits des meilleures
façons. Et ce, en choisissant un réseau de distribution
adéquat à leurs produits.
Deux considérations font du choix d'un circuit de
distribution l'une des décisions les plus importantes en marketing.
D'une part, la nature des canaux choisis a une incidence sur toutes les
variables du mix-marketing. Une entreprise ne saurait fixer ses prix avant de
savoir si elle distribuera par des intermédiaires ou bien de la grande
distribution. Elle doit aussi intégrer à sa politique la
collaboration éventuelle des distributeurs. D'autre part, le choix d'un
circuit de distribution lie l'entreprise pour une période relativement
longue. De ce fait, la survie d'une entreprise dépend beaucoup plus de
sa politique de distribution, et c'est ça qui fait que le choix d'un
circuit de distribution soit très difficile à prendre au sein
d'une entreprise surtout avec la grande variété des produits
alimentaires et leur forte substitution6(*).
Pour réussir à satisfaire le consommateur,
l'entreprise doit présenter son produit au bon moment et au bon endroit.
Et dans ce cas l'entreprise doit choisir le circuit de distribution
adéquat à ses produits.
Ainsi donc, la fonction principale dans une entreprise est la
fonction commerciale qui prend en compte les approvisionnements et la vente des
marchandises.La distribution joue un rôle capital car, non seulement il
sert à fabriquer le produit et le faire connaître au client pour
l'inciter à l'achat, mais faudrait-il que ce produit puisse atteindre le
consommateur final quand il en a besoin7(*). C'est ce qui explique la mise en place des politiques
de distribution efficaces par les entreprises car les décisions y
relatives peuvent avoir des conséquences à moyen et long
terme.
En nous inscrivant dans le contexte spécifique de la
distribution de produits laitiers qui est le sujet principal de notre travail,
notre étude tentera de réunir les éléments de
réponse aux questions ci-après :
1. Quels sont les circuits de distribution utilisés
dans la commercialisation des produits laitiers par lasuperette GAD ?
2. Quelle politique cette superettea mis en place dans la
distribution de leurs produits ?
3. Cette politique permet-elle d'atteindre les consommateurs
dans toute la commune d'Aru?
Voilà autant des questions qui forment l'objet
d'étude tout au long de ce travail.
4. HYPOTHESE DU TRAVAIL
L'hypothèse peut être envisagée comme une
réponse provisoire, anticipée que le chercheur formule
àses questions spécifiques de recherche. MONHEINE et RICH la
décrivent comme un énoncédéclaratifprécisant
une relation anticipée et plausible entre des phénomènes
observées ou imaginés8(*).
Allons plus loin retrouver dans le cours d'initiation à
la recherche scientifique qu'une «hypothèse est un projet des
solutions d'une situation-problème difficile que le chercheur transforme
en problématique, àlaquelle, il doit élaborer des
réponses provisoires»9(*)
C'est ainsi que sur base de nos questions suscitées
dans notre problématique, nous émettons les hypothèses
selon lesquelles :
1. Le circuit de distribution qu'utiliserait lasuperette
GADdans la commercialisation des produits laitiers serait le circuit direct.
2. Lasuperette GADpratiquerait la politique de distribution
intensive.
3. Cette politique permettrait d'atteindre les consommateurs
dans toute la commune d'Aru.
5. OBJECTIFS DU TRAVAIL
L'objectif poursuivi dans le cadre du présent travail
d'une part, est de procéder à l'analyse des différents
circuits de distribution et politique qu'utilise la superette GAD de la commune
d'Aru dans la commercialisation deses produits laitiers. D'autre part,
Puisqu'il existe un lien entre la distribution et la consommation, étant
donné que ces activités sont menées dans le but de
satisfaire un besoin, pour y arriver, nous étudierons le niveau de
satisfaction des consommateurs dans l'obtention de produits laitiers.
6. DELIMITATION DU SUJET
Pour bien mener une recherche, vue l'étendue de la
science, la délimitation du sujet s'avère indispensable. C'est
ainsi que tout travail scientifique doit être situé dans le temps
et dans l'espace.
a. Délimitation Spatiale
Notre étude étant très vaste, on a
jugé bon restreindre notre champ d'investigation sur les superettes
oeuvrant dans la commune d'Aru.
b. Délimitation Temporelle
Les activités de distribution étant une branche
importante dans les entreprises en général,
particulièrement dans la Commune d'Aru depuis plusieurs
décennies, dans le but d'éviter toute ambigüité, nous
avons limité nos recherches dans l'intervalle compris entre 2016-2019,
soit une période de 4ans.
7. INTERET DU SUJET
Ayant opté pour la
formation en management et sciences économiques option Marketing, il
nous a semblé intéressent d'élaborer un travail qui cadre
avec ce domaine de formation.
L'intérêt
porté à ce sujet, revêt une importance capitale.D'une part
dans la vie d'une entreprise, dans la mesure où ça lui permet
à comprendre les différents critères importants qui
stimulent les consommateurs pour l'achat les produits laitiers.
D'autre part, il s'agit là d'un sujet
d'actualité et nouveau qui apparaît devant les analystes, les
intellectuels, les chercheurs, les scientifiques, ... et en tant que futur
marqueteur, dans notre formation nous tenons chercher à comprendre les
contours du marketing et le management de distribution.
Et Sur le plan social enfin, les sentiments d'un agent d'une
entreprise ne peuvent laisser indifférent tout homme qui vit et qui voit
la concurrence que mènent les autres entreprises à la sienne. Le
marché lui-même a l'honneur de constater la concurrence et les
conditions dans lesquelles ces concurrents distribuent les produits.
8. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
La méthodologie étant définie comme une
combinaison des méthodes et techniques afin d'atteindre
l'explication10(*).
En définissant la méthode comme un ensemble de
démarche rationnelle qui permet de découvrir et démontrer
la vérité11(*).
De ce fait, nous avons adopté pour la
réalisation de ce présent travail la méthode inductive qui
obtient des conclusions générales à partir des
données individuelles, caractérisées par quatre
étapes :
· Observation et enregistrement des faits
· Analyse et classification des faits
· La dérivation inductive d'une
généralisation à partir des faits
· La vérification des faits.
Et la méthode de la corrélation de Bravais
Pearsonqui est un indice statistique qui exprime l'intensité et le sens
(positif ou négatif) de la relation linéaire entre deux variables
quantitatives. C'est une mesure de la liaison linéaire, c'est à
dire de la capacité de prédire une variable x par une autre y
à l'aide d'un modèle linéaire. Il permet de mesurer
l'intensité de la liaison entre deux caractères
quantitatifs.12(*)
Quant à ce qui concerne aux techniques. Les
techniques sont des moyens de récolte des données pour atteindre
l'objectif poursuivi. Elles sont des instruments des procédés
opératoires, pour récolter les données sur le terrain.
Elles sont l'ensemble de moyens et d'outils qui permettent à un
chercheur de rassembler des informations originales ou de seconde main sur un
sujet donné.13(*)
Les techniques sont nombreuses mais nous avons
utilisé deux :
Ø La technique documentaire qui nous a servi à
consulter les ouvrages, les cours, les mémoires, l'internet et d'autres
documents.
Ø L'entretien structuré sur base d'un
guide d'interview nous permettra d'échanger directement et verbalement
avec notre sujet d'étude.
9. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction, notre travail sera subdivisé en
troisgrands chapitres, dont le premier portera sur la conceptualisation et la
présentation de la commune d'Aru, le deuxième portera sur le
circuit de distributionet le troisième en fin, est consacré
à la présentation des données, analyse et
interprétation de résultats.
10. DIFFICULTES RENCONTREES
La réalisation de ce travail s'est butée devant
plusieurs difficultés dont les plus saillants sont entre autre :
- Insuffisance des ouvrages pouvant nous permettre de bien
retracer et reconstituer l'historique de la commune d'Aru ;
- Indisponibilité parfois de certains responsables de
l'établissement pouvant nous fournir des informations fiables que les
gérants ou vendeurs ne peuvent en connaitre,
- Absence de rapport ressentde la commune d'Aru,
- En fin les contraintes financières ne nous ont pas
épargné.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM............................................................................................i
EPIGRAPHE................................................................................................ii
DEDICACE................................................................................................iii
REMERCIEMENTS......................................................................................iv
ABREVIATIONS ET
SIGLE........................ ...................................................v
1. ETAT DE
LAQUESTION.....................................................................
1
2. PROBLEMATIQUE
2
3. HYPOTHESE DU TRAVAIL
3
4. OBJECTIFS DU TRAVAIL
3
5. DELIMITATION DU SUJET
3
a. Délimitation Spatiale
4
b. Délimitation Temporelle
4
6. INTERET DU SUJET
4
7. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
4
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
9. DIFFICULTES RENCONTREES
5
Table des matières
6
CHAPITRE PREMIER : CONCEPTUALISATION ET LA
PRESENTATION DE LA COMMUNE D'ARU
8
I.1. Distribution
8
I.2. Réseau de distribution
9
I.3. Canal/canaux de distribution
9
I.4. Circuit de Distribution
9
I.1.5. Mise en place d'un circuit de
distribution
11
I.1.6. Gestion d'un circuit de distribution
12
I.1.7. Choix d'un circuit de distribution
13
I.1.8. PRODUIT
16
SECTION II : PRESENTATION GENERALE DU
TERRITOIRE ET DE LA COMMUNED'ARU
17
2.1.1.TERRITOIRE D'ARU
17
A. Données géographiques
17
B. Coordonnées
géographiques
17
2.1.2.PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE (COMMUNE
D'ARU)
20
1. Le secteur primaire
23
2. Secteur Secondaire
24
3. Secteur Tertiaire
24
3.1.6.1.Institutions des enseignements
supérieurs et universitaires.
27
CHAPITRE DEUX : CIRCUIT DE DISTRIBUTION
28
Section I : GENERALITES RALATIVES AU CIRCUIT
DE DISTRIBUTION :
28
DISTRIBUTION COMME POLITIQUE DU MARKETING
28
A. STRATEGIE PUSH
30
B. LES STRATEGIES D'ASPIRATION (PULL)
30
2. 1.5. Les niveaux d'un circuit de
distribution.
35
2.1.6. La distribution des services.
35
2.1.7. Les formes de la distribution
36
A. La distribution isolée :
36
B. La distribution associée :
37
C. La distribution intégrée
:
39
2.1.8. L'efficacité économique d'un
circuit de distribution :
41
2.1.9. Le choix d'un circuit de distribution :
42
A LES CRITERES DE CHOIX :
42
B. ETAPE DE CHOIX DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
43
SECTION2 : DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES
MARKETING
46
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DE CIRCUIT DE
DISTRIBUTION DES PRODUITS LAITIERS DANS L'ETABLISSEMENT GAD Cas de NIDODE
2016- 2019.
49
III.1. PRESENTATION DES DONNEES ET DES RESULTATS
49
Conclusion
55
BIBLIOGRAPHIE
57
CHAPITRE PREMIER :
CONCEPTUALISATION ET LA PRESENTATION DE LA COMMUNE D'ARU
Le premier chapitre de ce travail est subdivisé en deux
sections dont, la première parle de clarification des concepts et la
seconde la présentation du cadre logique.
Section I : La conceptualisation
Le monde scientifique présente une immensité
dans le domaine de la recherche, ce qui amène des orientations de
connaissances, lesquelles se distinguent d'une recherche à une autre et
cela selon l'objectif poursuivi. C'est pourquoi plusieurs définitions
regorgent en partant des concepts employés et selon les auteurs
différents.
C`est ainsi que dans le cadre de cette étude, il nous
est utile de clarifier certains concepts clés pour faciliter une analyse
approfondie du sujet à traiter, ces derniers sont les suivant :
I.1. Distribution
D'après LAMBIN, J.J., la
« Distribution » est le stade qui suit celui de la
production des biens, à partir du moment où ils sont
commercialisés jusqu'à leur prise en possession par le
consommateur, où l'utilisateur final14(*).
En terme est aussi défini comme
« l'ensemble des activités réalisées par le
fabricant avec ou sans concours d'autres institutions, à partir du
moment où les produits sont finis jusqu'à ce qu'lis soient en
possession du consommateur final et prêts à être
consommés au lieu, au moment sous les formes et les qualités
correspondant aux besoins des utilisateurs15(*).
La distribution désigne également
« l'ensemble des diverses qui assurent la mise en oeuvre ou la mise
à disposition des acheteurs, qu'ils soient transformateurs ou
consommateurs, des marchandises ou services, en leur facilitant le choix,
l'acquisition et l'usage.16(*)
Dans son sens strict, la distribution, est souvent
considérée comme étant « une partie de
l'ensemble des diverses opérations qui assurent la mise en oeuvre ou la
mise à la disposition des acheteurs visible par les consommateurs et le
grand public » ou la totalité de point de vente qui sont en
contact avec le consommateur final du produit17(*).
La distribution, selon SERRAF, suppose « toutes
les décisions de vente par voie de négociation dont les
résultats sont aléatoires, avec des partenaires dont le poids
économiques et la puissance d'achat sont très souvent
considérables.
I.2. Réseau de
distribution
Le réseau de distribution représente tous les
intermédiaires qui interviennent dans l'acheminement du produit ou du
service, depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Les
différentes entités du réseau de distribution sont donc
l'importateur, le grossiste, le semi-grossiste et le détaillant. Le
réseau de distribution peut aussi faire référence aux
différents points de vente d'une marque18(*).
I.2.1. Politique de distribution
La politique de distribution recouvre l'ensemble des actions
qui visent à mettre le produit à la disposition du consommateur
dans de bonnes conditions.19(*)
Elle représente l'organisation de la mise à
disposition des produits ou services pour le consommateur20(*).
I.2.2. Un circuit de distribution
Un circuit de distribution peut se comprend comme un
réseau de vente des produit, composé de plusieurs canaux. Comme
écrit SERRAF, le circuit de distribution est une méthode
d'analyse des marchés reposant sur la proximité
géographique des consommateurs utilisés pour optimiser
l'implantation des nouveaux points de vente ou stimuler des stratégies
de distribution. Pour les autres ; c'est un système d'exploitation
des marché cibles par des intermédiaires21(*).
I.3. Canal/canaux de
distribution
Un canal de distribution est une voie d'acheminent des biens
entre le producteur et le consommateur et qui connaît
éventuellement l'intervention des commerçants
intermédiaires. Exemple : grossiste, demi-grossiste.
D'une manière générale, le rôle de
la distribution est de réduire les disparités qui existent entre
les endroits, les moments et des modes de fabrication et de consommation, par
la création d'utilité de lieu, du temps et d'état qui
constituent ce que l'on appelle « valeur ajoutée de la
distribution »22(*).
I.4. Circuit de Distribution
Quant à Philippe Kotler et Bernard Dubois est un mode
d'organisation permettant d'accomplir des activités qui ont toutes pour
but d'amener au bon endroit, au bon moment et en quantité
adéquate les produits appropriés. Le circuit de distribution peut
être direct ou indirect23(*)
a) Circuit directe
Dans un circuit direct, il n'y a pas d'intermédiaire
qui prend le titre de propriété, le producteur vend directement
au consommateur ou à l'utilisateur final. On l'appelle aussi une vente
directe
Ce circuit était fréquent dans les
économies rurales. Il se caractérise par l'absence de tout
intermédiaire indépendant entre le producteur et le consommateur.
Il s'agit d'une distribution directe.
· Avantage de circuit direct :
La réduction de la distance production - consommateur
permet une meilleure connaissance qualitative et quantitative du marché,
une meilleure communication et un contrôle total. De plus la
rapidité de la distribution est réelle et la concurrence est
relativement absente au sein du circuit. En conséquence, le circuit fait
preuve d'une plus grande souplesse.
· Inconvénient de circuit direct :
Le circuit direct présente plusieurs
inconvénients majeurs. Il exige de rassembler des ressources
financières et humaines très importantes vu son besoin en
magasins. De ce fait, les coûts sont élevés :
coûts de logistique (coûts liés à l'entreposage des
marchandises et coûts liés aux stocks), charges inhérentes
à un service après-vente plus étoffé (charges
financières résultant éventuellement des crédits
à accorder à la clientèle).
b) Circuit indirect
Dans un circuit indirect, il y a un ou plusieurs
intermédiaires qui prennent le titre de propriété. Un
circuit indirect peut être long ou court, selon le nombre
d'intermédiaires entre producteur et utilisateur final.
ü un circuit de distributeur est dit court, lorsqu'il
part du producteur au consommateur en passant par un seul intermédiaire
qui est le détaillant.
ü un circuit de distribution est dit long, lorsqu'il
comporte deux intermédiaires : grossiste et le
détaillant.
On peut aussi parler de circuit intégré dans
lequel les fonctions de gros et de détail sont assurées par une
même société.
I.1.5. Mise en place d'un
circuit de distribution
Mettre en place un circuit de distribution comporte plusieurs
étapes : il faut successivement étudier les besoins des
clients, définir les objectifs poursuivis, identifier les solutions de
distribution envisageables et les évaluer.
I.1.5.1. Etude des besoins de la
clientèle
Au préalable il faut chercher par une étude de
marché à comprendre qui achète quoi, où, quand,
comment et pourquoi dans un marché déterminé.
ü Qui : femme ou homme, enfant ou adulte ;
ü Quoi : quel produit aiment-ils acheter ;
ü Où : supermarché, boutique du
quartier, grand-marché ;
ü Quand : le soir ou la journée ;
ü Comment : au comptant, à crédit, en
coopérative ;
ü Pourquoi : la motivation d'achat.
I.1.5.2. Définition des objectifs et des
contraintes
Chaque producteur doit concevoir ses objectifs de
distribution à partir des principales contraintes qui lui sont
imposées par : le produit, les intermédiaires, les
consommateurs.
· Les caractéristiques du
produit :
Les plus importantes à considérer dans le choix
de circuit de distribution sont la durée de vie, le volume, le
degré de standardisation, la technicité et la valeur unitaire.
Les produits périssables exigent en général un circuit
court, la raison de les acheminer rapidement.
· Les caractéristiques des
intermédiaires :
En général tous les intermédiaires n'ont
pas les mêmes aptitudes à assumer les fonctions aussi
variées que le transport, la promotion, le stockage et le contact avec
les clients, pas plus qu'ils n'ont les mêmes exigences en matière
de crédit, de remise et de délais.
· Les caractéristiques de
l'entreprise :
Les caractéristiques propres à l'entreprise
telles que sa taille, sa puissance financière, sa gamme de produits, son
expérience passée en matière de distribution et sa
stratégie marketing affectent évidemment le choix de circuit.
· Les caractéristiques liées
à l'environnement :
Le choix d'un circuit dépend enfin des variables
liées à l'environnement. Lorsque la conjoncture économique
est très frappante, cela affecte la vente des produits sur le
marché, ce qui poussera les producteurs à changer leurs
stratégies marketing de façon à minimiser les
dépenses, par conséquent ils préfèrent le circuit
court pour distribuer leurs produits au moindre coût.
De plus il y a le législateur qui s'efforce
d'empêcher tout système de distribution qui aurait comme
conséquence d'affaiblir la concurrence et de favoriser la
création de monopole.
I.1.5.3. Identification des solutions
Cette identification veut que l'entreprise procède
à une analyse des différentes solutions possibles. Une solution
en matière de distribution comporte trois éléments,
à savoir :
ü La nature des intermédiaires qui assurent la
vente et le transfert du produit sur le marché ;
ü Le nombre des intermédiaires utilisés
à chaque stade de distribution ;
ü Les responsabilités et engagements respectifs du
producteur et de ses intermédiaires.
I.1.6. Gestion d'un circuit de
distribution
Après avoir déterminé les grandes lignes
de son système de distribution, l'entreprise doit sélectionner,
motiver et périodiquement évaluer ses intermédiaires.
I.1.6.1. Le choix des
intermédiaires
A ce sujet les producteurs ont un sérieux travail pour
choisir des intermédiaires qui conviennent pour distribuer leurs
produits ; car ces intermédiaires diffèrent les uns des
autres selon un certain nombre des caractéristiques auxquelles ils sont
soumis.Par conséquent avant un quelconque choix des
intermédiaires, le fabricant doit s'efforcer à connaître
l'expérience des intermédiaires, leur solvabilité, leur
aptitude à coopérer et leur réputation.
I.1.6.2. La motivation des
intermédiaires
Comme dans tout contrat de travail, il faut savoir motiver
ses partenaires pour qu'ils travaillent au mieux de leurs
possibilités.
En effet, le producteur ne peut pas rester
égocentrique dans le sens de se contenter seulement à regarder
les intermédiaires distribuer son produit, mais plutôt il doit les
encourager, les motiver de façon constante ; cet encouragement peut
être par exemple des libéralités accordées à
chaque semestre. Surtout que l'on sait que ce sont les mieux choisis des
intermédiaires et qui font un travail de qualité à la
satisfaction du producteur, donc ils doivent être encouragés de
leur savoir-faire.
I.1.6.3. L'évaluation des
intermédiaires
Un fabricant doit régulièrement évaluer
les résultats de ses revendeurs s'il veut continuer à tirer le
maximum de leurs efforts. Lorsque les résultats d'un distributeur sont
très en dessous de la moyenne, il faut s'efforcer d'en déterminer
les causes avant d'envisager d'y porter remède. Le fabricant peut
même tolérer de mauvais résultat si l'abandon ou le
remplacement du distributeur détaillant risque d'aggraver la situation.
Dans le cas contraire, il doit exiger que l'intermédiaire atteigne les
résultats escomptés dans un délai raisonnable faute de
quoi, il sera obligé de s'en séparer.
I.1.7. Choix d'un circuit de
distribution
Le choix d'un circuit de distribution consiste à faire
une combinaison des différents canaux possibles. Par la suite, pour un
canal donné, il faudra choisir les entreprises partenaires.
A. CONTRAINTES
Pour ce faire, cinq grandes contraintes doivent être
prises en considération par le producteur lors du choix d'un circuit de
distribution.
1. les contraintes légales
Pour certains produits (médicaments, tabac), le
circuit de distribution est imposé par la législation. De
même, faut-il tenir compte de la réglementation en matière
de refus de vente (un fabricant ne peut pas refuser de livrer à un
intermédiaire) ou de vente discriminatoire.
2. Les contraintes financières
Ces contraintes qui s'imposent au producteur vont
également conditionner son choix d'un circuit de distribution. Si les
ressources du producteur sont limitées, il aura des difficultés
à financer lui-même l'achat des moyens de transport,
d'entrepôts, des points de vente et il sera donc obligé de
déléguer la distribution de ses produits à des
intermédiaires.
3. Les contraintes liées au produit
Elles concernent aussi bien ses caractéristiques
techniques que son image. Les produits périssables exigent des circuits
courts où l'acheminement des marchandises s'effectue le plus rapidement
possible. Les produits à haut degré de technicité
nécessitant la sélection d'intermédiaires
spécialisés et compétents.
4. Les contraintes liées à la
clientèle
Elles portent principalement sur le nombre des clients et sur
la dispersion géographique. Plus les clients sont nombreux et
dispersés, et plus il est nécessaire de recourir à des
intermédiaires pour réduire le nombre de contacts et donc les
coûts de distribution.
5. Les contraintes liées à l'appareil
commercial
Ces contraintes demandent de prendre en considération
les pratiques des intermédiaires déjà en place (nombre et
répartition géographique des points de vente et entrepôts,
politique de crédit et de remises, nature des services rendus).
B. Les stratégies de distribution
En outre des contraintes, le producteur a le choix entre
trois grandes politiques de distribution : intensive, sélective ou
exclusive. Chacune peut être caractérisée en fonction du
nombre de détaillants présents et ainsi détermine le
nombre d'intermédiaire pouvant intervenir dans le choix d'un circuit de
distribution24(*).
· Distribution intensive
Dans une distribution intensive, entreprise recherche le plus
grand nombre de points de vente possible, des centres de stockage multiples
pour que soient assurés la couverture maximale du territoire de vente et
un chiffre d'affaires élevé. Cette stratégie de couverture
est appropriée pour des produits d'achat courant, des matières
premières de base et des services à faible implication25(*).
L'avantage d'une distribution intensive est de maximiser la
disponibilité du produit et de donner une part de marché
importante grâce à l'exposition, élevée de marque.
Cette augmentation du chiffre d'affaires du fait de la couverture
élevée du marché peut présenter toutefois des
inconvénients non négligeables.
ü Le chiffre d'affaires réalisé
diffère largement entre les différents distributeurs alors que le
coût du contact est identique par intermédiaire ;
l'augmentation du coût de la distribution peut donc compromettre la
rentabilité d'ensemble.
ü Lorsque le rapport est très largement
distribué dans des points de vente multiples et
différenciés, l'entreprise risque de perdre le contrôle de
sa politique de commercialisation : base des prix, réduction de la
qualité du service, manque de coopération des détaillants.
ü Une distribution intensive est souvent incompatible
avec le maintien d'une image de marque et d'un positionnement précis
dans le marché, du fait du manque de contrôle exercé
sur le réseau de distribution.
Ce sont ces difficultés qui incitent les entreprises
à évoluer progressivement vers un système de distribution
plus sélectif, une fois les objectifs de notoriété
atteints.
· LA DISTRIBUTION SELECTIVE
On parle de distribution sélective lorsque le
producteur recourt, à un certain niveau du circuit, à un nombre
d'intermédiaires inferieur au nombre d'intermédiaires
disponibles. Cette stratégie de couverture est indiquée pour des
produits d'achat réfléchi, là où l'acheteur
procède à des comparaisons des prix et des
caractéristiques des produits.
Il est à noter qu'une distribution sélective
peut également résulter du refus d'un pourcentage significatif de
détaillants d'accepter le produit dans leur assortiment. Pour
qu'il y ait distribution sélective voulue par le fabricant, celui - ci
doit donc sélectionner ses intermédiaires. Plusieurs
critères de choix peuvent être utilisés.
1. La taille du distributeur, mesurée par son chiffre
d'affaires, est le critère le plus utilisé. Dans la plupart des
marchés, un petit nombre de distributeurs réalise une part
très importante du chiffre d'affaires total (loi de concentration).
2. La qualité du service offert est également un
critère important. Le distributeur est payé pour exercer un
certain nombre de fonctions et certains distributeurs peuvent exercer ces
tâches plus efficacement que d'autres.
3. La compétence technique et l'équipement du
destructeur sont des critères importants, surtout pour les produits non
standardisés pour lesquels le service après- vente est important.
En optant pour une distribution sélective, le
producteur accepte donc de limiter volontairement la disponibilité du
produit dans le but de réduire ses coûts de distribution et
d'obtenir une meilleure coopération de ses distributeurs. Cette
coopération peut se manifester de diverses manières :
ü Participer aux dépenses de publicité et
de promotion ;
ü Accepter le référencement de produits
nouveaux ou de produits qui se vendent moins facilement ;
ü Accepter de tenir des stocks plus importants ;
ü Transférer de l'information vers le
fabricant ;
ü Accorder davantage de service.
Le risque principal d'un système de distribution
sélectif est de ne pas assurer une couverture suffisante du
marché. Le fabricant doit donc s'assurer que le consommateur ou
l'utilisateur final est capable d'identifier facilement les distributeurs,
sinon la disponibilité réduite conduit à des pertes trop
importantes d'opportunités de vente. Il arrive que l'entreprise n'ait
pas le choix et soit forcée de pratiquer une certaine
sélectivité dans sa distribution.
En adoptant un système de distribution
sélectif, il faut bien réaliser que l'entreprise est pratiquement
obligée d'adopter un circuit indirect court et d'exercer elle-même
la fonction grossiste. Il est peu probable en effet que les grossistes
acceptent de voir leur champ d'action limité par le producteur26(*).
· LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE
Un système de distribution exclusive est la forme
extrême de la distribution sélective. Dans une région
prédéfinie, un seul distributeur reçoit le droit exclusif
de vendre la marque et s'engage généralement à ne pas
vendre de marques concurrentes. En retour, le distributeur accepte de ne pas
référencer des marques concurrentes dans la même
catégorie de produits. Une stratégie de couverture exclusive est
utile lorsque le fabricant veut différencier son produit par une
politique de haute qualité, de prestige ou de qualité du service.
La coopération étroite entre fabricant et distributeur facilite
la mise en oeuvre de ce programme de qualité. Les avantages et
inconvénients de ce système sont ceux de la distribution
sélective, mais amplifiés. Une forme particulière de
distribution exclusive est le franchisage.
I.1.8. PRODUIT
Un produit correspond à toute entité
susceptible de satisfaire un besoin ou un désir. La notion de produit
fait immédiatement penser à des articles tangibles27(*). (HAMADOU PALE 2008 :
9).
I.1.8.1. PRODUIT LAITIER
Le produit laitier : actuellement
appelé laitage, est un aliment produit de matière artisanale ou
industrielle, à base de lait de vache le plus souvent ; cependant
on peut également trouver sur les marchés des produits laitiers
à base de lait de chèvre, de brebis, de chamelle ou de bufflonne
par exemple (FAO ; produit animaux, édition 47/8,47)28(*),
On entend par produit laitiers, le produit dérivés
exclusivement du lait, étant entendu que des substances
nécessaires pour leur fabrication peuvent être
ajoutées ; pourvu que ces substances ne soient pas utilisées
en vue de remplacer, en tout partout, un quelconque des constituants du lait.La
dénomination utilisée pour désigner les produits laitiers
qui peuvent également être employées conjointement avec un
ou plusieurs termes pour designer de produit composés dont aucun
élément ne remplace ou est destiné à remplacer un
constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une
partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet
caractérisant le produit29(*).
A. LES CATEGORIES DES PRODUITS LAITIERS.
Ils existent de plusieurs ordres ; on regroupe donc dans la
catégorie des produits laitiers les fromages, les yaourts, le lait bien
entendu, la beurre, le lait congelé, le lait
réfrigéré, le lait pasteurisé, le lait
stérilisé, le lait forment, lait à poudre, lait
gélifié, le lait concentré non sucré, le lait
sucré et le lait sec, etc.
B. CARACTERISTIQUES GENERALES DE PRODUITS LAITIERS
La dénomination, lait est réservé
exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu
par une ou plusieurs traités, sans aucune addition ni soustraction.
Toutefois, la dénomination de lait peut être
utilisée :
ü Pour lait ayant subi un traitement qui n'entraine pas une
modification de sa composition ou pour lait dont on a standardisé la
teneur en matière grasse,
ü Conjointement avec un ou plusieurs termes pour
désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation
envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel
il a été soumis ou les modifications qu'il a subis dans sa
composition, à condition que les modifications soient limitées
à l'addition et à la soustraction de ses constituants
naturels.
C. UTILISATION DE PRODUITS LAITIERS
Sauf pour le lait cru, la réglementation n'impose pas
de durée de conservation. Celle-ci est fixée par le fabricant,
sous sa propre responsabilité, et mentionnée sur
l'étiquetage, sous la forme d'une date limite accompagnée si
nécessaire des conditions de conservation à respecter. Les
produits laitiers peuvent être consommés jusqu'au jour de leur
date limite de consommation.
I.1.8.2. LE LAIT
D'une façon simple, le lait est défini comme un
aliment complet. Cet aliment contient les glucides, les lipides, les
protéines et les oligo-éléments (FAO ; édition
47/8,68). Selon le Dictionnaire Larousse (2005 :756), le lait est un
liquide produit par les mamelles des mammifères, aliment de grande
valeur nutritive qui assure, en particulier, la substance du jeune au
début de sa vie grâce à sa richesse en graisses
émulsionnées, en protéines, en lactose, en vitamines et en
sels minéraux. Le lait est définit aussi comme un liquide
nutritif ou blanchâtre destiné à l'alimentation et
secrété par les glandes laminaires des vaches et des quelques
autres mammifères femelles domestiques30(*).
SECTION II : PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE ET DE LA
COMMUNED'ARU
2.1.1. TERRITOIRE D'ARU
A. Données géographiques
Le Territoire d'Aru est l'un de cinq territoires de la
province de l'Ituri. Il a été créé juridiquement
par le Décret du Roi du 10 Mai 1957. Dans son actuelle organisation
administrative il est subdivisé en neuf entités dont sept
chefferies (Aluru, Kakwa, Kaliko-Omi, Lu, Nio-Kamule et Zaki), un secteur
(Secteur des Ndo) et une commune (Commune de Aru). Les chefferies et
secteurs sont subdivisés en groupements (47 au total) qui, de leur part,
sont subdivisés en villages (382 dans l'ensemble). La commune d'Aru
compte 33 avenues réparties en 4 quartiers : Essefe, Katanga, Route-Aba
et Rumu.
Ce Territoire est situé au nord de la province de
l'Ituri (Est de la RDC). Il est limité au nord par la
république du Soudan du Sud, à l'est par la république de
l'Ouganda, au sud par les territoires de Djugu et Mahagi (tous deux en province
de l'Ituri) et enfin à l'ouest par les territoires de Faradje et Watsa
(tous en province de Haut Uélé).
B. Coordonnées géographiques
· Longitude : entre 30°10' et 30°90' de
longitude Est;
· Latitude : entre 2°40' et 3°65' de latitude
nord;
· Altitude : L'altitude moyenne est à 1 300
mètres au-dessus du niveau de la mer.
De par ses coordonnées géographiques le
Territoire d'Aru est situé à l'Est du méridien d'origine
et entièrement dans l'hémisphère Nord.
a. Climat
Ce territoire connaît un type de climat de la
région subtropicale plus ou moins doux, avec alternance de deux saisons
: la saison sèche qui couvre la période de Novembre en
Février de l'année suivante et la saison des pluies qui
s'étend du mois de Mars en Octobre. Mais au cours de l'année 2016
il a été constaté des perturbations saisonnières
dues au changement climatique.
Par manque de dispositif technique (station
météorologique), il est difficile de déterminer la
variation des températures. Néanmoins, selon les archives,
l'amplitude thermique varie de 20° à 14°C avec une
température moyenne annuelle de 25°C.
Quant à la pluviométrie, il existe deux saisons
pluvieuses : la saison A et la saison B. La première est celle qui va de
Mars à Juin et la seconde débute normalement en Août et se
poursuit jusqu'à mi-novembre de chaque année.
b. Hydrographie
Les rivières Aru, Kibali et Nzoro sont
les trois principaux cours d'eau traversant le territoire d'Aru.Ces
rivières ont leurs affluents qui les alimentent en eaux.
· Rivière Aru : Onyi, Mati, Asada, Belu, Okini,
Alle II, Omi, Anguru, Katabha, Waru, Adumini, Esisiya, Ewavio, Ofoo, Agobi,
Adraa;
· RivièreKibali : Lokoro, Lowa, Tole, Aroa, Kiya,
Mii;
· RivièreNzoro :Ebi, Kebi, Kaliga, Aka, Aro.
c. Végétation
Le Territoire d'Aru est situé dans une zone de savane
steppique au nord-est, herbeuse au centre et au sud, et boisée à
l'ouest avec quelques galeries forestières en secteur des Ndo ainsi
qu'à l'ouest des chefferies des Kakwa et Kaliko-Omi. Il existe
également une petite forêt dense de type équatorial
à Endru en secteur des Ndo.
d. Sol et sous-sol
Partant de sa nature, on distingue trois types de sol en
territoire d'Aru :
· Le sol argileux-sablonneux : il est couvert de la
savane boisée. Ce type de sol se situe au Noord-ouest du territoire :
cas des chefferies des Kaliko-Omi, des Aluru, des Kakwa et secteur des Ndo.
· Le sol argilo-sablonneux : il est
caractérisé par la présence de quelques montagnes et
plaines notamment en chefferie des Aluru, Nio-Kamule et Zaki.
· Le sol sablo-argileux : présent en chefferies
des Otso, Nio-Kamule, Lu et Zaki, ce sol est couvert de savane pure.
e. Les quelques montagnes importantes sont
:
· Le mont Hawa : en chefferie des Lu;
· Le mont Kengezi : en chefferie des Kakwa;
· Les monts Abha au Nord et Adja au Sud de la Chefferie
des Zaki;
· Les monts Nzinzi, Atia, Endri et Egi au Sud; les monts
Wara, Aku et Angbo au centre; le mont Apayi à l'Ouest de la chefferie
des Kaliko-Omi;
· La chaine des monts Manziriko, Eseyi, Mau, Ayi, Osi et
Leri en chefferie des Otso;
· Le mont Monoko-Mibale en secteur des Ndo;
· Le mont Meyo en chefferie des Aluru.
Le sous-sol regorge de l'or exploité artisanalement en
certains endroits tels que Apodo en chefferie des Aluru et Shaba en
secteur des Ndo. Le fer fut exploité de la même manière par
la communauté Ndo à l'époque ancestrale pour la
fabrication des outils aratoires, flèches, lances, etc. Aujourd'hui les
forges semblent disparues et les minerais demeurent en veilleuse.
f. Particularités et richesses du
territoire
Les particularités du territoire d'Aru résident
au niveau des frontières qu'il partage avec les deux pays voisins :
l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le Shillings Ougandais est la monnaie la plus
utilisée à Aru au détriment de la monnaie nationale. En
plus le territoire possède de grands potentiels hydroélectriques
avec d'importantes chutes.
C. Données culturelles
Le territoire d'Aru est habité principalement par
quatre tribus à savoir
1. Les Lugbara : ils sont majoritaires et occupent cinq
entités dont les chefferies des Aluru, des Lu, des Nio-Kamule, des Otso
et des Zaki;
2. Les Kakwa : ils occupent la chefferie des Kakwa;
3. Les Kaliko-Omi : en chefferie des Kaliko-Omi;
4. Les Ndo en secteur des Ndo.
Notons que ces quatre tribus sont regroupées en deux
éthnies : la souche Soudanaise (Lugbara, Kaliko-Omi et Ndo) et la souche
Nilotique constituée des Kakwa.Les principaux clans sont : Lugbara,
Madhi, Kaliko, Omi et Kakwa.
1) Langues parlées dans ce
Territoire
1. Lugbarati ;
2. Omiti ;
3. Ndo ;
4. Kakwa ;
5. Lingala ;
6. Swahili ;
7. Fançais;
8. Anglais;
9. Autres.
Les langues des tribus autochtones sont plus parlées
avec en tête le Lugbarati suivi de Omiti. Le Lingala est l'une des 4
langues nationales parlée dans ce territoire. C'est la langue la plus
parlée en territoire d'Aru. Le Swahili est surtout parlé par une
petite portion venue d'autres territoires du pays mais aussi sous l'influence
de la frontière avec l'Ouganda où cette langue est
également parlée.
2) Principales activités
1. Agriculture (73%) ;
2. Elevage (60%) ;
3. Commerce (12%) ;
4. Artisanat (3%).
Le Territoire d'Aru est une entité en vocation
fortement agropastorale. La population pratique une agriculture destinée
avant tout à l'autoconsommation. Une autre partie de cette production
est destinée au marché local pour essayer d'accroitre le revenu
ménager. Le manioc, le maïs, le haricot, les arachides, le sorgho
et le riz constituent les principaux produits de base. Notons aussi que les
agrumes sont produits en territoire d'Aru : cette catégorie est
essentiellement importée en Ouganda voisin où se trouvent des
industries agroalimentaires.
L'élevage de Gros-bétails (Bovins) compte
144.926 têtes. Le Petit- bétail compte 307.142 têtes et il
comprend 3 principales spéculations : les caprins sont les plus
élevés (54,7%), les ovins représentent 31,6% et en
dernière position viennent les porcins avec 17,7%.
Le commerce dans ce territoire est bien
développé car il est frontalier à 2 pays (l'Ouganda et le
Soudan). Le petit commerce est pratiqué pour couvrir certains besoins
primaires.
2.1.2. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE (COMMUNE
D'ARU)
a. Historique
L'histoire renseigne que Aru fut un poste d'Etat qui
dépendait du territoire de MAHAGI, ce n'est que par le décret
Royal du 10 Mai 1957, soit 3 ans avant l'indépendance de la
République Démocratique du Congo qu'il est devenu un territoire
à part entier. En 1987, dans l'initiative de nommer 17 cités
dans la région de haut -zaïre, Aba fut la première
cité puis la cité d'Aketi et ensuite celle d'Aru revient à
la troisième position par l'ordonnance présidentielle n°
87-236 du 29 Juin 1987 du président MOBUTU, portant création et
délimitation des 17 cités dans la région du
Haut-Zaïre, actuelle province Orientale démembrée.
b. Acte de la création de la
commune
Dans la juridiction d'ordre administratif congolais, est
appelé «commune» toute agglomération urbanisée
comptant au moins dix mille habitants et ayant une fonction
politico-administrative ou commerciale.
La commune d'Aru qui porte le même nom du territoire est
érigé à une entité territoriale
décentralisée(ETD).C'est à partir de :
ü La constitution de la
RépubliqueDémocratique du Congo du 18 février 2006,
à son article deuxième ;
ü La loi Organique n° 08/016 du 07 Octobre 2008
portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports
avec l'Etat et les provinces ;
ü La loi Organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant
fixation et subdivision territoriale à l'intérieur de la
province ;
ü Ordonnance présidentielle n° 11/043 du 15
avril 2016 portant investiture du gouverneur et vice-gouverneur de la province
de l'Ituri;
ü Conformément à l'arrêté
Provinciale n° 01/JAPM/042/CAB/PROGOU/P.I/2016 du 05 Novembre modifiant
l'arrêté provinciale n° 01/JAPM/040/CAB/PROGOU/PI/2016 du 27
septembre 2016 portant à titre intérimaire des bourgmestres et
bourgmestres adjoint des communes de la province de l'Ituri. C'est à
cette date(le 05 novembre 2016) que l'ex cité d'Aru devenue une commune
effective.
c. Situation géographique et
délimitation de la Commune d'Aru
La commune d'Aru qui héberge le chef-lieu du territoire
de même nom se situe au Nord-est de la République
Démocratique du Congo distante de 300 km du chef-lieu de la province de
l'Ituri et à 2000 km à vol d'Oiseau de la capital KINSHASA. Elle
partage ses limites de la manière suivante :
- Au Nord: par le centre ONDOLEA(le Nord du quartier Route-Aba
et de la localité OKUAMANI;
- A l'Ouest : par la localité NGELE ;
- Au Sud : par la rivière Aru, soit le sud du
quartier Essefe ;
- A l`Est : par la chefferie des OTSO.
Elle couvre actuellement 50 km2,selon la
délimitation prévisionnelle de la commune d'Aru d'après le
décret du premier ministre n°13/002 du 13 juin 2013 sursis.
d. La démographie
Durant la dernière décennie, la Commune d'Aru a
connu une forte expansion tant spatiale que démographique.
Majoritairement peuplée de l'ethnie Lugbara, Kakwa, Kaliko et Ndo. Elle
est aussi cosmopolite, car nombreux sont des non originaires ayant choisis de
s'installer dans cette agglomération.
Statistiques de la population de la commune d'Aru de
2016-2019
|
SUBDIVISION ADMINISTRATIVE
|
POPULATION CONGOLAISE ET ETRANGERE
|
|
ANNEE
|
NOMBRE
|
DENSITE
|
|
COMMUNE ARU
|
2016
|
166425
|
3228.5 hab/km2
|
|
COMMUNE ARU
|
2017
|
172135
|
3442.7 hab/km2
|
|
COMMUNE ARU
|
2018
|
173366
|
3467.3 hab/km2
|
|
COMMUNE ARU
|
2019
|
176939
|
3538.7 hab/km2
|
Source : rapports administratifs de la
commune 2016, 2017, 2018 et 2019.
Selon la statistique de l'année ressente 2019, la
population recensée dans la commune d'Aru s'élève à
176.939 Habitants, avec une densité de 3.538 Hab/km2.
e. Animateurs,Subdivision Administrative et services
Conformément à l'arrêté provincial
n° 01/JAPM/042/CAB/PROGOU/P.I/2016 du 05/11/2016 modifiant
l'arrêté provincial n° 01/JAPM/040/CAB/PROGOU/PI/2016 du 27
septembre 2016 portant nomination à titre intérimaire des
Bourgmestres et Bourgmestre Adjointdes communes de la province de
l'Ituri : Mr Johnny WADRI ADYOMA et Madame Marie URSULE ALEKU MADJU sont
respectivement Bourgmestre et Bourgmestre Adjoint de la commune d'Aru.
L'entité est divisée à quatre
quartiers :
Ø Quartier KATANGA ;
Ø Quartier RUMU ;
Ø Quartier ROUTE-ABA ;
Ø Quartier ESSEFE.
Et subdivisée à 42 Avenues mais qui doivent
subir une revisitassions car des grandes étendues sont encore sans
Avenues claires. En tant que chef lieude Territoire d'Aru, tout l'arsenal de
l'administration publique y est organisé, notamment :
Ø Les services étatiques (EPSP, ESU,
HOPITAUX....)
Ø Les services paraétatiques (SONAS, DGI,
DGDA....)
Ø Les services spécialisés (ANR, DGM)
etc....
f. Situation-Economie
La commune d'Aru est constituée de plusieurs classes
sociales ou l'on trouve les commerçants, les fonctionnaires, les
chômeurs, les paysans, les humanitaires etc. Sur le plan religieux, la
population de la commune d'Aru est composée des chrétiens, des
musulmans, des non-croyants. Se référantà la note du cours
de la géographie économique et de l'économie de transport,
toutes les activités sont classées selon le secteur
d'activité. C. CLARK et J. FOURASTE distinguent trois grands secteurs
d'activité économique. Ainsi réalisées dans la
commune d'Aru, nous regroupons en trois grands secteurs les
activités économiques:
1. Le secteur primaire
1.1. Définition :
Le secteur primaire regroupe l'ensemble des activités
et
agents
économiques exerçant directement dans l'exploration,
l'extraction, l'exploitation, la
production et
la distribution de
matières
premières auprès de particuliers ou de
professionnels.
Dit autrement, le secteur primaire inclut l'
agriculture,
pèche, chasse, l'extraction minière, etc.
1.1.1. Agriculture
L'agriculture dans la commune d'Aru semble être
réservée à quelques habitants disposant d'une
étendue de terre non loti. Les familles qui s'en investissent, font des
jardins de survie dont une partie est vendue sur le marché.
Généralement il s'agit d'une culture de subsistance.
1.1.2. L'élevage
A dépit de l'agriculture, la population de la commune
d'Aru pratique aussi l'élevage des gros et petits bétails et des
volailles. Ces animaux domestiques sont entre autres les bovins, les caprins,
les ovins, les porcins, les canards, les poules.... Cet élevage n'est
pas développé puisque c'est un petit nombre de la population qui
s'en occupe dans le but de la consommation, et d'utilisation dans plusieurs
circonstances qui peuvent survenir dans le ménage notamment : le
cas de mariage, scolarisations des enfants, cérémonie de
funérailles et tant d'autres.
1.1.3. La pèche
L'activité de la pèche est quasi inexistante
dans la commune d'Aru pour la simple raison que cette dernière ne
renferme pas des cours d'eaux favorables pour la pèche. Les poissons que
consomme cette population proviennent de l'Ouganda et MAHAGI-PORT.
1.1.4. Mine
L'exploitation minière exercée par cette
entité est orientée vers l'exploitation de sable, moellon et
fabrication des briques. Néanmoins, signalons la présence de
quelques négociants des matières précieuses y sont.
1.1.5. Chasse
L'activité de chasse n'est pas développée
dans la commune d'Aru pour simple raison que cette dernière ne renferme
pas des forets peuplée des animaux ou espèces sauvages.
2. Secteur Secondaire
2.1. Définition
Le secteur secondaire rassemble l'ensemble des actions et
opérateurs de type industriel ; en rapport avec la transformation
des matières premières en produits finis ou semi-finis dont
l'usine ou la
manufacture symbolise
son existence.
On parle aussi d'
industrie
manufacturière pour désigner cette filière
importante de l'économie.
La commune d'Aru manque des industries dignes dans son sein,
néanmoins, signalons la présence des quelques activités
lucratives consécutives à l'intégration locale de la
petite industrie, notamment :
2.1.1. Energie
La commune d'Aru bénéficie d'une importante
source énergétique : Solaire, à base de bois de
chauffage et des braises.
2.1.2. L'eau
L'ONGD CIDRI assure la distribution d'eau dans la commune
d'Aru depuis 2005. Pour les grands travaux de gâchage, les petits
ruisseaux communément appelés MAYI YA ARU aident la population
dans ses besoins.
2.1.3. Industrie de
décorticage
On y trouve les rizeries et également des moulins
privés pour la monture de manioc.
2.1.4. Industries de rabotage et de sciage
Dans la commune d'Aru signalons la présence des
quelques ateliers qui transforment les planches en différents mobiliers
et autres, notamment: les tables, chaises, cercueil armoires etc.
3. Secteur Tertiaire
3.1. Définition
Quant au secteur tertiaire, il réunit l'ensemble des
activités et agents économiques qui sont exclus des secteurs
primaires et secondaire dont la symbolique est représentée par
les entreprises de services ou le
commerce
de détail. En bref, Il regroupe tous les autres services produisant
des biens qui ne sont pas matérielstels que les activités de
commerce, de transport, banques et messageries financières, la
communication, le tourisme, enseignement et tant d'autres.
3.1.1. Le commerce
Les activités commercialesdéveloppées
dans la commune d'Aru sont orientées vers l'importation des produits
manufacturés provenant des pays étrangers, mais la population de
cette entité exporte plus les produits agricoles vers l'Ouganda, la
plupart des activités sont celles des petits commerçants de
détail et des grossistes.
3.1.2. Le transport
Nous en retenons deux voies de communication :
- La voie terrestre : la commune d'Aru
regorge d'importantes infrastructures de communication terrestre. Elle assure
le déplacement des engins de petits tonnages, de poids lourds et des
véhicules légers en destination d'Arua (Ouganda), Ariwara, Bunia
et Durba via Adranga. Quelques agences de transport des biens et des personnes
dans la commune d'Aru :
a. NA NGOLU COACH ;
b. LA VIE EST UN COMBAT(LVC) ;
c. DIEU MERCI ;
d. KAKWA KOBOKO TRAVELLER(KKT) ;
e. DIEU SEUL SAIT(DISSA) ;
f. LA COLOMBE(AVC).
- La voie Aérienne
La commune d'Aru regorge dans son sein deux aérodromes,
notamment d'OKABIA et d'ANIA. Ce dernier (d'Ania) reste impraticable
après la rébellion de 1997. Par ailleurs, le transport
aérien a été assuré jadis dans cette entité
par plusieurs compagnies entre autre : CETRACA, MALU- AVIATION.
Présentement il ya aussi quelques compagnies qui exercent cette
activité dans le domaine humanitaire, il s'agit des UNHAS, MAF-AVIATION,
PARC NATIONAL DE GARAMBA, ECHO FLYT.
3.1.3. Banques et messageries
financières
Les banques occupent une importante place dans le monde des
affaires car elles facilitent les transactions commerciales à grandes
distance par l'opération de virement, transfert, dépôt et
prêt.
La commune d'Aru est bénéficiaire des deux
banques commerciales notamment la FBN-BANK et la BCDC.
A part ces banques citées ci-haut, la commune d'Aru
bénéficie aussi d'une caisse d'épargne
dénommée la CADECO. Sise au quartier Route-Aba sur la route
principale.
Seule agence ou messagerie financière qui assure le
transfert de l'argent dans la commune d'Aru est SOFICOM-TRANSFERT.
Néanmoins il est important à signaler la présence de
certains services de transfert électronique moyennant les réseaux
de communication. Nous avons :
a. M'PESA avec VODACOM
b. ORANGE
c. AIRTEL MONEY (RDC et OUGANDA)
d. MTM TRANSFERT(OUGANDA)
Les deux derniers utilisent la connexion de pays frontaliers
installés tout au long des limites nationales.
3.1.4. La communication
Dans cette entité on y trouve trois grands
réseaux de communication cellulaire tels qu'AIRTEL RDC, VODACOM RDC et
ORANGE RDC. MTN, AIRTEL tous du pays voisin l'OUGANDA a une forte influence
dans la commune d'Aru suite a ses tarifs de communication a faible prix et
surtout en monnaie que est utilisée dans le milieu le Shillings
Ougandais.
Il existe aussi plusieurs stations radio diffusion dans cette
contré qui permettent a la population de s'informer sur le plan locales,
nationales et internationales. Nous citons entre autres :
a. La radio TangazeniKristo (RTK);
b. La radiotélévision Communautaire
Pacifique(RTCP) ;
c. L radio SALAMA
En plus de ces radios, signalons aussi la présence
d'une antenne relai de la radio OKAPI, utilisation des antennes paraboliques et
en fin un cybercafé de communication par internet (SUN LIGHT).
3.1.5. Tourisme
Lacommune d'Aru ne dispose pas d'énormes
potentialités touristiques. Néanmoins un mausolée en face
du bureau administratif du territoire d'Aruest érigé en
mémoire du feu Monsieur ENEKO NGUAZA (ancien gouverneur de la province
orientale à l'époque de la rébellion). Quelques flats
hôtels sont déjà disponibles pour accueillir les visiteurs
et une vingtaine qui sont ordinaires.
3.1.6. Enseignement
Les statistiques scolaires de l'année 2017 nous
fournissent le nombre d'école maternelle, primaire, secondaire et
universitaire implantées dans la commune d'Aru.
La commune d'Aru dispose de 13 écoles maternelles dont
61.5% estgérée par des confessions et 15.4% par l'Etat, 23 Ecoles
Primaires reconnues sont organisées et on trouve 26 Ecoles Secondaires
en commune d'Aru.
3.1.6.1. Institutions des enseignements
supérieurs et universitaires.
Quant aux Enseignements Supérieurs et Universitaires,
en commune d'Aru et à deux kilomètres de périmètre,
on compte cinq institutions d'enseignements supérieurs et universitaires
dont ISP, ISTM, ISTHEA, UNIC-CEPROMAD et ISEAV/ARU.
Cette commune a un avenir, un jour pourra offrir la
possibilité de s'organiser en ville, en force d'une campagne de
sensibilisation pour son meilleur développement.
CHAPITRE DEUX : CIRCUIT
DE DISTRIBUTION
Section I : GENERALITES
RALATIVES AU CIRCUIT DE DISTRIBUTION :
DISTRIBUTION COMME
POLITIQUE DU MARKETINGCOMMERCIAL
Ce chapitre traite de la partie essentielle de notre
travail dans la mesure où une société à la
recherche d'une croissance doit consacrer beaucoup d'effort à la
conquête des nouveaux clients. Et cela passe par la diffusion des
publicités dans les Médias, l'envoi de messages écrits et
téléphoniques ainsi que la participation des vendeurs aux
foires et salons. Toutes ces activités aboutissent à une liste
de prospects qu'il faut ensuite finaliser en interrogeant et en
vérifiant leur solidité financière. La force de vente
contacte en priorité les prospects à plus fort potentiel et
essaie de Convertir clients.
C'est pourquoi, nous nous proposons de parler d'une
généralité sur le circuit de distribution.
Pour créer de la valeur, il faut disposer des
circuits de distribution Performants afin que les produits et services
soient à la portée des clients visés. Aujourd'hui,
l'analyse des réseaux des entreprises ne se limitent pas aux
grossistes et aux détaillants mais intègre tout la chaine
d'approvisionnement en mont et en aval, depuis les matières
premières, les composants et les produits manufacturés
jusqu'à la livraison des produits finis aux clients finaux, ce que
l'on appelle en anglais le Supply Chain management.
Dans cette section, nous allons voir comment une entreprise
doit élaborer etgérer ses réseaux de distribution pour
permettre aux clients visés d'avoir accès à ses produits.
Deux intermédiaires interviennent dans l'utilisation des produits
finaux qui remplissent des nombreuses fonctions et que l'on regroupe sous
le terme de circuit de distribution31(*).
On appelle circuit de distribution, l'ensemble des
organisations indépendantes qui interviennent dans le processus
par lequel les produits ou services sont mis à la disposition des
consommateurs et des utilisateurs.
Certains intermédiaires tels que les grossistes et
les détaillants, achètent en leur nom propre les bien
qu'ils revendent ; ce sont des marchands. Ils remplissent des fonctions
importantes32(*), ils
ajustent l'offre et la demande en fonctionnant, en reconditionnant parfois, en
assemblant les produits pour leur donner le format souhaité par
les consommateurs ; ils diffusent des informations et des conseils sur
le produit, ils prévoient la demande pour les produits et commandent
ceux-ci en conséquence, ils gèrent des stocks de façon
à éviter les ruptures autant que possible ; ils placent
dans un même lien ces offres concurrents pour permettre aux
acheteurs complémentaires, permettant aux acheteurs de faire
plusieurs achats à un même endroit , etc.
D'autres acteurs au circuit de distribution - les
courtiers, les représentants, les attachés commerciaux -
prospectent la clientèle et passe des contrats au nom du fabriquant
mais ne s'engagent pas à titre personnel : on les appelle
des agents. D'autres afin, ces compagnies de transport, les
sociétés, d'entrepôts, les banques, facilitent des
opérations de distribution sans prendre part à la
négociation commerciale.
2.1.1. L'importance des circuits de
distribution.
Plusieurs considérations font du choix d'un circuit de
distribution, l'une des décisions la plus importante en marketing.
D'une part, la nature des canaux choisis a une clientèle sur toutes
les autres variables du marketing mix. Une entreprise ne saurait fixer
ses prix avant de savoir si elle distribuera par
l'intermédiaire des revendeurs exclusifs ou de la grande
distribution. Elle doit intégrer sa politique publicitaire, la
collaboration éventuelle des distributeurs. Elle organise enfin
différemment sa force de vente selon qu'elle vend directement
aux détaillants ou passe par l'intermédiaire des
grossistes.
Ensuite, les coûts de distribution sont
importants : ils peuvent représenter 30 à50% du prix de
vente final, parfois d'avantage à l'inverse la publicité
représentent entre 5 et 10 du chiffre d'affaire33(*)
Les circuits de distribution représentent
également des coûts d'opportunités. En effet, un de
leurs principaux rôles est de convertir des acheteurs potentiels
en demandes effectives et rentables. Ils ne doivent donc pas simplement
servir les marchés mais les constituer. En fin, le choix de
circuits de distribution lie l'entreprise pour une période
relativement longue.
Dans les accords passés avec le distributeur, il
existe une forte pression en faveur du statut quo ; aussi
l'entreprise doit-elle à ses circuits de distribution en
fonction de ses plans de développement aussi bien que de sa
situation actuelle. Lorsqu'elle gère les intervenants
intermédiaires, une entreprise doit décider quelle
importance, elle leur accorde dans son programme marketing en
comparaison des outils de communication direct au client. Cette
distribution correspond à l'arbitrage fait une stratégie
push et une stratégie pull.
A. STRATEGIE PUSH
Une stratégie de pression (push) consiste à
orienter par priorité les efforts de communication et de promotion sur
les intermédiaires de manière à les inciter
àréférencer la marque, à stocker le produit en
quantité importantes, à lui accorder l'espace de vente
adéquat et à inciter les consommateurs à acheter le
produit. L'objectif est de susciter une coopération volontaire du
distributeur qui, en raison des incitants et des conditions de vente qui lui
sont faites, va naturellement privilégier ou pousser le produit chaque
fois qu'il le peut. C'est la force de vente ou la communication personnelle,
qui sera ici le moyen marketing le plus important. Une stratégie de
pression implique l'existence de relations harmonieuses avec les distributeurs
et il est évident que ce sont surtout les représentants et
vendeurs qui ont un rôle important à jouer à cet
égard. On a repris à la figure suivante les principaux incitants
que l'entreprise peut utiliser pour favoriser cette coopération
volontaire des intermédiaires.
Une stratégie de pression est indispensable pour
obtenir la coopération des distributeurs sans laquelle l'entreprise n'a
pas accès au marché. Plus le pouvoir de négociation des
distributeurs est important, moins l'entreprise aura le choix. Dans les
marchés ou la distribution est très concentrée, ce sont
généralement les distributeurs eux-mêmes qui imposent ces
incitants aux fabricants. Le risque d'une stratégie de communication
exclusivement orientée sur les distributeurs est donc de rendre
l'entreprise entièrement dépendante de leur bon vouloir et sans
contrôle réel sur système de distribution.
Seule l'entreprise qui adopte un circuit direct peut se
passer complètement du soutien de la distribution ; par contre,
elle doit assumer la totalité des tâches exercées par les
distributeurs, ce qui représente un coût élève. Les
développements récents dans les technologies de la communication
offrent des possibilités nouvelles à cet égard.
Stratégie push (s'appuyant sur la distribution et
force de vente).
Intermédiaire
Entreprise
Consommateurs
B. LES STRATEGIES
D'ASPIRATION (PULL)
Une stratégie d'aspiration (pull)
concentre les efforts de communication et de promotion sur la demande finale,
c'est-à-dire sur le consommateur ou l'utilisateur final, en
court-circuitant les intermédiaires. L'objectif est de créer au
niveau de la demande finale des attitudes positives vis-à-vis du
produit, ou de la marque et de faire en sorte que l'acheteur demande, voire
idéalement exige, telle marque chez le distributeur qui sera de cette
manière contraire de référencer pour rencontrer la demande
de ses clients. Au contraire de la stratégie de pression, on tente ici
de créer une coopération forcée de la part des
intermédiaires, les consommateurs jouant en quelque sorte le rôle
d'une pompe ; la marque est en effet aspirée dans le circuit de
distribution par la demande finale.
Stratégie pull (fondée sur la communication aux
consommateurs en particulier la publicité).
Intermédiaire
Entreprise
Consommateurs
2. 1 .2. LE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS DE
DISTRIBUTION.
Typiquement, une nouvelle entreprise
commence ses activités sur un marché limité
géographiquement en ayant recours aux intermédiaires existants.
Elle en limite le nombre à quelques agents commerciaux, quelques
grossistes, transports et entrepôts, identifier les meilleurs
acteurs n'est pas difficile à ce stade ; ce qui est
délicat en revanche c'est de convaincre les intermédiaires
identifiés comme efficaces de collaborer.
Si le succès est au rendez- vous, l'entreprise
élargit son champ et fait appel à des circuits de
distribution distincts sont les marchés. Sur les marchés de
petite taille, elle peut vendre directement aux détails ; sur les
plus gros, elle a recours à des grossistes. Dans les zones rurales,
elle passe par des marchands généralistes ; dans les
villes, par des distributeurs spécialises ; dans certaines zone,
elle adopte un système de distribution exclusive, dans d'autres, elle
souhaite être présent dans le plus grand nombre de magasins
possible à travers une distribution intensive. Ainsi, le circuit de
distribution évolue en fonction des opportunités et des
conditions locales.
Des nombreuses entreprises privilégient
aujourd'hui des circuits de distribution hybrides. Une telle politique
implique de vérifier que les circuits employés sont
compatibles entre eux et correspondent aux souhaits de chaque segment de
marché. On peutdistinguer différents types de consommateurs
selon leur comportement face aux circuits hybrides. Les acheteurs
routiniers achètent toujours de la même manière dans
les mêmes endroits.
Les chercheurs comparent ces différent canaux de
distribution avant de choisir le moins cher. L'amateur de diversité
rassemble des informations sur plusieurs canaux, profitent du conseil fourni
dans les boutiques puis achètent dans leur canal proféré
indépendammentdu prix de vente. Les acheteurs très
impliqués collectent également de l'information sur tous les
canaux ; achètent dans le moins cher mais profitent de l'aide et
du soutien offerts dans les canaux les plus personnalises34(*)
Un même individu peut avoir des comportements distincts
selon les catégories des produits ; s'orientant vers les boutiques
pour des produits haut de gamme. Un même client peut également
passer d'un canal à l'autre selon les étapes du processus
d'achat : il peut feuilleter un catalogue pour se renseigner sur les
produits.
2. 1.3. LE ROLE DES CANAUX DE DISTRIDUTION
D' une manière
générale, le rôle de la distribution dans une
économie de marché est d'éliminer les
disparités qui existent entre l'état des biens au stade
de l'offre et l'état des biens requis au stade de la demande
de bien et de services.
Ici le rôle de la distribution ne se limite pas qu'au
producteur, mais s'étend également au consommateur.35(*)
Le rôle de la
distribution vis-à-vis du producteur :
ü La distribution opère une régulation de
fabrication en permettant son étalement sur toute l'année, par le
stockage et la commande à l'avance, les hauts et les bas de la demande
sont amortis ;
ü La distribution participe à l'effort financier
du producteur en payant les biens qu'elle stocke sans avoir la certitude de les
vendre ;
ü La distribution permet au producteur d'acheminer
partout sa production ;
ü La distribution participe à des
opérations publicitaires destinées à mieux vendre le
produit et service.
· Le rôle de la distribution
vis-à-vis du consommateur :
La distribution met à sa disposition ou qu'il se trouve
et souvent quelque soit la saison, le bien qu'il désire dans la
quantité voulue. Elle lui évite ainsi d'avoir à faire des
gros achats et de mobiliser des sommes qu'il n'a peut-être pas.
Les intermédiaires commerciaux ont
également pour rôle de transformer les gammes de produits des
différents fabricants en un assortiment cohérent avec les
besoins des acheteurs.
Figure 2 : comment un intermédiaire peut
réduire le nombre des transactions ?
P
P
P
c
c
c
I
1
2
4
3
6
5
P
P
P
P
c
c
9
1
2
3
4
5
6
8
Nombre de contactsNombre de contacts
P X C =3 X 3 =9
P+C=3+3=6
Source : livre de Marketing management
Légende.
P= Producteur
C=Consommateur
I=Intermédiaire.
Cette figure illustre l'un des types d'économies
réalisées en faisant appel aux intermédiaires. La
partie gauche du schéma représente trois producteurs
vendant directement à trois clients. Un tel système exige
neuf intermédiaires en contact avec tous les clients. Un tel
système n'exige plus que six contacts.
2. 1.4. Les fonctions de la distribution
Un circuit de distribution est un mode d'organisation
permettant d'accomplir des activités qui ont toutes pour but
d'amener au bon endroit, au bon moment, et en quantité
adéquate les produits appropriés. Ces activités
gravitent autour de neuf fonctions principales.
1. Le recueil d'information sur le client actuel et
potentiel mais également sur les concurrents et les autres acteurs
del'environnement marketing.
2. La consommation, c'est-à-dire l'élaboration
et la diffusion d'informationpermissives susceptibles de stimuler l'achat.
3. La négociation, c'est-à-dire la recherche
d'un accord sur les termes d'échanges.
4. La prise de commande, transmise et au fabricant à
partir des intentions d'achatdes clients.
5. Le financement, en particulier des stocks
nécessaires à chaque niveau du circuit des clients.
6. La prise de risque liée aux différentes
opérations de distribution.
7. La distribution physique : transport, stockage,
manutention.
8. La fabrication etla gestion des encaissements.
9. Le transfert de propriété du vendeur vers
l'acheteur.
Ces fonctions concernent tous à la fois dans le flux
aval (promotion, transfert de propriété), flux amont (prise de
commande, facturation) et bidirectionnels (Négociation, risque).
Figure 3 (a) : Exemples de circuit de
distribution à plusieurs niveaux pour les biens de
consommations.
Fabricant
Consommateur
Détaillant
Grossiste
Détaillant
Grossiste
Semi grossiste
Détaillant
Figure 3 : Exemples de circuit de distribution
à plusieurs niveaux pour les
biens industriels.
Fabricant
Entreprise
Cliente
Distributeur
Industriel
Représentant
Du fabricant
Succursale de
Vente du
fabricant
Source: Douglas Lamont, conquering the unreels world: The Age
of m-commerce
(New-York: Wiley, 2001)
La figure 3 illustre cinq flux dans le cas de la distribution
de chariots élévateurs. La représentation
simultanée de tous les flux par un seul schéma illustratif, la
grande complexité d'un circuit de distribution. Un fabricant qui vend
des biens et des services doit élaborer trois circuits : un pour la
vente, un pour la livraison et un pour les services. La redoute, par exemple
utilise le courrier, le téléphone et l'Interne.
Le circuit de distribution, le plus court ne comporte aucun
intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Cette forme de
vente directe est pratiquée dans divers secteur36(*).
Un circuit de distribution à un niveau comporte un seul
intermédiaire. Pour des produits de grande consommation, cet
intermédiaire est le plus souvent le détaillant. Sur les
marchés industriels, il peut s'agir d'un revendeur
spécialisé.
Un circuit de distribution à deux niveaux comporte,
deux intermédiaires. Sur les marchés de consommation, il s'agit
en général, d'un grossiste et d'un détaillant ; en
milieu industriel, on peut trouver un agent commercial et grossiste.
Un circuit de distribution à trois niveaux comporte
trois intermédiaires. On rencontre un tel circuit dans l'industrie de la
salaison où un semi-grossiste intervient souvent entre le grossiste et
le détaillant.
Naturellement, le problème de contrôle s'aggrave
à mesure que s'accroît-le nombre de niveaux, le fabricant
n'étant le plus souvent en contact qu'avec les niveaux situés
juste en dessous de lui.
La figure 3(b) montre les circuits de distribution les plus
fréquents dans l'industrie. Un fabricant des biens industriels peut
utiliser sa propre force de vente pour vendre directement aux entreprises
client ; il peut recourir à des distributions industrielles ou des
représentants indépendants ; il peut employer une succursale
de vente ; ou encore associer ces différentes options en passant
à deux niveaux.
Bien que l'on associe généralement le terme de
circuit de distribution à des transferts de produits vers le
marché, on peut également l'applique à des processus
« remontants », par exemple pour les produits susceptibles
d'être modernisés, recyclés ou pour le traitement des
détritus. Certains intermédiaires interviennent dans le circuit
rapide et les sous-traitants pour la livraison, et du personnel local pour les
services.
L'analyse de fonctions et des flux est intéressante cas
elle met en évidence la question centrale de la distribution.
Le problème n'est pas de savoir s'il faut ou non
remplir ces fonctions (qui doivent l'être de toute façon) mais de
savoir qui va les remplir. Toutes les activités commerciales partagent
trois caractéristiques : elles mobilisent certaines
ressources ; Elles bénéficient d'une certaine
spécialisation et elles sont permutables entre les Différent
membres du circuit. Si le producteurles prend en charge, il devra les
répercuter dans, ses prix de vente. Si c'est le consommateur, il devra
bénéficier des Tarifs préférentiels. Si c'est une
intermédiaire, enfin, c'est la marge qui sera affectée. Le
problème de la répartition des fonctions est donc celui de la
productivité économique. Pour autant que des
intermédiaires, spécialisés (transporteurs, entreposeurs,
détaillants) bénéficient d'économies
d'échelle dans la gestion de leurs opérations, il est de
l'intérêt du producteur et du consommateur de leur confier les
activités correspondantes. En définitive, toute l'histoire de
l'appareil commercial et toutes les innovations qui y ont été
introduites ne sont que le résultat d'efforts visant à modifier
la répartition des fonctions dans le sens d'une amélioration de
l'efficacité.
2. 1.5. Les niveaux d'un
circuit de distribution.
Tout circuit de distribution peut être
caractérisé par sa longueur c'est-à-dire le nombre de
niveaux qu'il comporte, correspondant aux différents partenaires entre
lesquels le produit transite.
La figure 3 (a) illustre différents circuits de
longueur variable dans la grande consommation. Processus remontants comme les
sociétés des ordures ménagères, le centre de
recyclage ou les entrepôts.
2.1.6. La distribution des
services.
La notion de circuit de distribution ne s'applique pas
seulement aux biens tangibles mais également aux services. Ceux-ci ont,
besoin d'être disponibles et accessibles. De nombreuses entreprises et
organismes cherchent à décentraliser sous forme d'unités
mobiles. Il en est ainsi de banques, qui se déplacent dans les
universités, des bibliobus dans les petites villes ou des troupes de
théâtre en tournée. Les heures de permanences
assurées en mairie par un avocat ou un psychologue relèvent de la
même approche. Avec le développement d'Internet, les services
comme la banque, l'assurance ou les agences de voyage diversifient leur circuit
de distribution.
Plus généralement, la mise en place d'un
système de circuit de distribution requiert dans le domaine des
services, une bonne connaissance des besoins du public et du coût des
différentions. Par exemple, les hôpitaux ont recours des formules
à des soins à domicile, souvent moins coûteuses que
l'hospitalisation classique confortable pour les malades.
2.1.7. Les formes de la
distribution
La forme de distribution est un système
organisé en vue de proposer une offre commerciale compétitive aux
consommateurs par opposition à la formule que désignent les
caractéristiques visibles par le client (format, assortiment, etc.).
Les formes renvoient à ce que les clients ne voient
pas, l'ensemble des structures, liens juridiques et mode de fonctionnement mise
en oeuvre pour permettre la réalisation de la prestation au client final
et de bénéficier de quelques avantages.
A. La distribution
isolée :
Le commerce indépendant non associé dans lequel
le commerçant assume seul la responsabilité de ses achats. Le
petit commerce indépendant est encore la forme dominante de distribution
à travers le monde.
Cependant, dans certains pays où l'appareil commercial
est plus moderne, leur importance s'est quelque peu amoindrie au profit des
formes organisées, associées ou intégrées de
distribution.
Pour faire face à la concurrence des nouvelles formes
d'organisation commerciale, les commerçants indépendants ont
dû adopter certaines stratégies comme l'hyperspécialisation
de leur assortiment, le service à la clientèle (heures
d'ouverture, livraisons à domicile, ...), l'intégration dans les
centres commerciaux, ...etc.
On distingue deux formes de commerce isolé :
A. 1. Commerce de gros :
La fonction de gros consiste à acheter les
marchandises aux producteurs ou aux importateurs, les stocker et les revendre
aux détaillants.
· Caractéristiques
ü L'importance de la fonction de stockage,
ü Le caractère sous régional de
l'entreprise : un distributeur qui assure unefonction de gros couvre
généralement plusieurs départements.
ü La spécialisation de l'entreprise par
clientèle ou par produit.
· Rôles : Son rôle
est de :
ü Constituer un trait d'union entre le producteur ou
l'importateur et les détaillants.
ü Acheter régulièrement et en grandes
quantités.
ü Assurer pour le détaillant un rôle de
"centralisateur" de marchandises et de stockage.
· REMARQUE :
Cette fonction est
généralement assurée par des entreprises
spécialisées ou par les producteurs eux-mêmes. Mais elle
est de plus en plus exercée par des centrales d'achat ou des
chaînes volontaires.
A. 2. Commerce de détail :
La fonction de détail consiste à
s'approvisionner en marchandises pour les revendre en détail au
consommateur final. Cette fonction offre la proximité de l'alimentation
aux clients, des heures d'ouverture plus large, un assortiment de produits de
premières nécessités et la vente au micro
détail.
B. La
distribution associée :
Un réseau de commerce associé est
constitué par des petites et moyennes entreprises de détail
réunies en un groupement d'achat ou collaborant avec un fabricant, un
grossiste ou une centrale d'achat.
Les commerçants sont propriétaires de leur
magasin mais dans le cadre d'un réseau quiles apporte des avantages
(conditions d'achat, enseigne commune, logistique, accès à une
marque renommée,...) en échange d'une contribution
financière et du respect des
règles du réseau. Le
commerçant exploite seul son entreprise et en assume les risques.
B.1. Le groupement de commerçants
:
Le GC a connu une forme traditionnelle sous forme de
coopératives : des indépendants mettent des moyens en commun pour
développer leur activité ou réduire leurs coûts. Des
coopératives traditionnelles, les groupements gardent l'influence
décisive des adhérents qui en sont en principe les
véritables dirigeants (le groupement étant au service des
adhérents et non l'inverse) et la relative égalité des
membres (une personne, un vote). Cependant beaucoup de groupements ont connu
une évolution qui les éloigne du fonctionnement traditionnel des
coopératives : les équipes centrales de management y jouent
souvent un véritable rôle de direction, et certains
adhérents y ont acquis un poids « politique » ou
économique sensiblement plus important que les autres.
B. 2. La franchise :
La franchise est une méthode de collaboration entre
une entreprise - le franchiseur - et plusieurs entreprises - les
franchisés - pour exploiter un concept de distribution.
Le concept de franchise, mis au point par le franchiseur, est
de tout ou partie des trois éléments suivants :
ü Le droit d'utiliser une marque et sa
signalétique ;
ü Le partage d'une expérience et la mise à
disposition auprès du franchisé d'un certain savoir-faire ;
ü Un ensemble de produits, de services ou de
technologies.
Dans le cas de franchise de distribution, le franchiseur
produit les biens distribués par les franchisés, ou bien le
franchiseur joue le rôle d'une centrale d'achat ou de centrale de
référencement.
Tableau 1 : Avantages et inconvénients de
franchise
|
Le franchiseur
|
Le franchisé
|
|
Il a un droit de regard sur
|
Il bénéficie de la notoriété de la
marque
|
|
la gestion
|
Il ne prend pas trop de risques
|
|
Avantages
|
Les franchises sont des indépendants donc ils sont
|
Il bénéficie d'une assistance commerciale,
technique et d'un savoir-faire
|
|
motivés
|
L'investissement au départ n'est pas trop
|
|
Pas d'investissement
|
lourd
|
|
Il doit prouver la réussite
|
Il ne peut pas vendre les produits d'autres
|
|
commerciale de ses idées ou
|
marques
|
|
Inconvénients
|
de ses produits
|
Il a des obligations financières : un droit
|
|
Il doit assurer l'information
|
d'entrée puis des royalties chaque mois
|
|
de ses franchisés
|
Le franchiseur a un droit de regard sur la gestion
|
Source : Jean-Marc LEHU,
L'encyclopédie du marketing, Edition d'Organisation, 2004
B. 3. Chaînes volontaires :
Association entre un groupe de détaillants et des
grossistes pour organiser en commun l'achat, la gestion et la vente.
B. 4. Concession :
Contrat par lequel un commerçant ou un industriel
(concédant) délivre à un nombre limité de
commerçants (concessionnaires) le droit de vendre ses produits.
C. La
distribution intégrée :
Le commerce intégré désigne les
réseaux qui exploitent en propre au moins 10 points de vente. Les
magasins sont la propriété d'un groupe et sont dirigés par
des directeurs salariés. Le réseau fonctionne
généralement avec une centrale d'achat interne. Les
coopératives de consommateur en sont des cas particuliers.
C. 1. Les grands magasins :
Offrent en centre-ville, dans une vaste surface un large
assortiment de produits à dominante non alimentaire. Ce type de magasins
connaît actuellement des difficultés liées à
l'importance de leurs charges de structure et à la concurrence des
nouvelles formes de commerce.
C. 2. Les magasins d'usines :
Créés par les producteurs, ils ont pour
fonction d'écouler les stocks de produits directement aux consommateurs
à des prix dits « d'usine ».
C. 3\. Les grandes chaînes
d'hypermarché et de supermarché :
Les hypermarchés: sont des
magasins de détail de plus de 2 500m2 à dominant
Alimentaire, mais dans les nombreuses références
(40 à 80 000) couvrent également de très nombreux produits
de grande consommation. Situés en périphérie des villes de
façon isolée où, le plus fréquemment, au sein d'un
centre commercial dont ils sont le moteur, ils drainent une clientèle
importante par leur prix attractif. Leurs marges réduites (18 à
22%) sont compensées par une rotation des stocks
élevée.
Les supermarchés : sont des
magasins de détail à dominante alimentaire (notammentles produits
frais), dont la surface est inférieure à 2 500m2.
L'assortiment laisse une place très importante à l'alimentaire
que les hypermarchés. Situés en centre-ville ou en proche
périphérie, les supermarchés, qui avaient beaucoup
souffert du développement des hypermarchés, ont su regagner leur
part de marché en jouant sur la proximité et enredevant
compétitifs sur les prix. Mais sur ce dernier point, ils doivent
affronter aujourd'hui la concurrence très agressive des maxi
discounts.
C. 4. Les maxi discomptes ou hard
discounters :
Il s'agit de chaînes de magasins qui offrent un choix
limité à des prix particulièrement bas. De surface moyenne
(600 à 900m2), les maxidiscomptes ont un assortiment
étroit et peu profond (environ 600 références alimentaires
et non alimentaires). Ils vendent principalement des marques propres sans
notoriété nationale ou des produits « premier prix »
sans marque, mais certains enseignes ont élargi leur offre vers les
marques nationales.
Leurs prix très compétitifs sont dus à un
taux de marge faible (environ 15%) et à une réduction des
coûts de gestion : moins de personnel, décor sommaire, moins de
coûts de mise en rayon, peu de référence mais avec un taux
de rotation élevé. Leur rentabilité est aujourd'hui
supérieure à celle des supermarchés et des
hypermarchés.
Tableau 2 - Les caractéristiques du grand
commerce intégré37(*).
|
Hypermarchés
|
Grands magasins
|
|
- Une formule inventée par les français
|
- Très grande surface de vente :
|
|
aujourd'hui arrivée à maturité sur le
|
.grands magasins seniors : plus de 30 000 m2
|
|
marché domestique
|
.grands magasins juniors : plus de 15 000 m2
|
|
- Grande surface de vente : 2 500 m2 au
|
- Jusqu'à 200 000 références
|
|
Minimum. Moyenne : 5 800 m2
|
- Dominante non alimentaire. Point forts : textile
|
|
- Libre services pour la quasi-totalité des
|
et nouveautés
|
|
rayons
|
- Situation économique contrasté selon le lieu,
|
|
- Large assortiment : 40 000 à 80 000
|
Selon la spécialisation des grands magasins. Les
|
|
références
|
multi spécialistes, cherchent à se positionner
sur
|
|
- Parking avec vente de carburant (plus de
|
des axes plus précis
|
|
50 % des ventes totales de carburant sont faites par des
hypermarchés)
|
|
|
- Marges et prix réduits (marge moyenne
|
|
|
17 %)
|
|
|
- Souvent, l'hypermarché est la locomotive d'un centre
commercial
|
|
|
Supermarchés
|
Hard discounters
|
|
- Stagnation de leur nombre mais progrès
|
- Une formule en très forte progression au cours
|
|
en CA et évolution qualitative
|
des quinze dernières années
|
|
- Surface de vente : 400 à 2 500
|
- Surface de vente : 600 à 800 m2
|
|
m2.Moyenne 1 200 m2
|
- Assortiment très étroit et peut profond :
environ
|
|
- Libre-service pour tout l'alimentaire et
|
600 références, principalement produits « secs
»
|
|
pour une part variable des rayons de
|
alimentaires
|
|
marchandises générales
|
- Vendent peu ou pas du tout de
|
|
- 3 000 à 5 000 références. 90 % des
ventes
|
marque « nationales »
|
|
en alimentaire, le frais peut atteindre 50 % chiffre
d'affaires
|
- Les prix les plus bas du marché
|
|
- Les petits supermarchés (moins de 1 000 m2)
sont plutôt situés en centre-ville, les grands en
périphérie proche
|
|
Source : LENDREVIE J. & LINDON
D. Le e-commerce :
Repose sur une boutique en ligne accessible via Internet
permettant la commande, un système de paiement sécurisé en
ligne et une infrastructure logistique puissante pouvant assurer les livraisons
dans le monde entier. Le commerce électronique se développe aussi
bien sur le marché B to B (entreprise à entreprise) que sur le
marché B to C (entreprise à consommateur).
C'est un puissant outil de segmentation, puisqu'il est
possible, à travers le site web, de s'adresser personnellement à
chaque client.
Toutes les formes de commerce traditionnelles
(indépendant, associé ou intégré) l'ont mis en
place. Le e-commerce constitue pour l'instant, une voie complémentaire
aux points de ventes et pour certains commerçants indépendants un
moyen de survie.
2.1.8. L'efficacité
économique d'un circuit de distribution :
On croit généralement qu'un circuit long est un
circuit coûteux. Le fabricant qui exploite un circuit direct et propose
des produits à très bon rapport qualité prixsemble
être l'illustration des avantages d'un circuit direct.La publicité
et la promotion des ventes exploitent largement cette perception. Ainsi, tel
fabricant qui vent à la fois par correspondance et par son propre
réseau demagasins, proclame dans sa publicité, qu'ayant
supprimé les intermédiaires, il peut vendre au « prix usine
». En réalité, il n'a pas pu faire disparaître les
coûts de stockage, de transport, d'investissement dans des fonds de
commerce, ainsi que la paie des vendeurs, les taxes supportées par le
commerce local, et la publicité qui permet de vendre par correspondance,
toutes choses qui grèvent, en fin de compte, le prix supporté par
le consommateur.
Ce producteur a intégré un certain nombre de
fonctions généralement assurées par des distributeurs
indépendants. L'intégration économique permet au
producteur de contrôler totalement sa distribution mais n'a pas
automatiquement pour conséquence de diminuer les coûts de revient,
la marge de distribution qui est prélevée, et a fortiori, les
prix de vente. Si ses volumes ou sa productivité sont insuffisants, le
poids de ses prix fixes pèse très lourdement sur ses marges et
donc le prix de vente : il aurait avantage alors à écouter sa
production par le biais d'intermédiaires.
L'efficacité économique d'un circuit tient
moins à sa longueur qu'à sa productivité, à chaque
stade de distribution.
2.1.9. Le choix d'un circuit de
distribution :
Le choix d'un circuit de distribution est une décision
importante pour l'entreprise car cela lui impose des investissements. Pour
faire un bon choix, il est important de sélectionner le canal qui
maximise le rapport produit marché, pour faire ce choix il y a des
critères et des étapes à suivre pour choisir un canal de
distribution.
A LES
CRITERES DE CHOIX :
Pour choisir un circuit de distribution on prend deux
critères de choix, le facteur externe et le facteur interne à
l'entreprise38(*) :
a) Facteurs externes : Au niveau du
marché il s'agit de prendre en considération :
ü Les concurrents (les canaux déjà
utilisés par les concurrents);
ü Les distributeurs (leurs moyens matériels et
humains, leur image La méthodede la notification pondérée
des facteurs peut aider le producteur)
ü La clientèle (degré de segmentation,
taille de la population, situation géographique, comportement et
attitude d'achat, les mobilités d'achat, etc.);
ü La réglementation (le contrôle de
qualité des produits, réglementationspécifique aux
modalités d'usage (sécurité d'utilisation), etc.).
b) Facteurs internes :
ü les caractéristiques de l'entreprise (sa taille,
ses moyens financiers, sa
capacité de production, sa force de vente,
et sa stratégie marketing);
ü Le produit (la nature du produit impose des conditions
de stockage et conservation de transport, le niveau de vendeur);
ü Les coûts de circuits (il faut calculer le
coût de chaque circuit potentiel et déterminer le plus
rentable).
ü L'image de marque (le style de vente doit être
cohérent avec le canal, exemple : la franchise).
B. ETAPE DE
CHOIX DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Première étape : Le diagnostic d'entreprise
dans une optique de choix des circuits :
L'intérêt d'effectuer un diagnostique est de
définir la politique de distribution en prenant en considération,
d'une part, l'ensemble des facteurs environnementaux et, d'autre part, les
forces et les faiblesses de la firme. Le diagnostique d'entreprise dans une
optique de choix des circuits nécessite au moins :
ü Une étude des consommateurs,
ü Une étude de la concurrence,
ü Une étude de la distribution,
ü Une étude du potentiel de la firme.
Deuxième étape : La détermination
des objectifs :
Le fabricant est tenu de fixer les objectifs de son
système de distribution et de déterminer ses critères de
choix à partir des données collectées par l'étude
de passé et futures de potentiel et de l'environnement de la firme.
Le coût de rentabilité du système de
distribution est, il faut bien le reconnaître, les éléments
déterminants du choix d'un réseau. Il n'en demeure pas moins vrai
qu'un réseau de distribution peut être retenu pour sa
capacité à couvrir le marché ou pour la compétence
de ses membres, ou encore pour le contrôle que le fabricant compte avoir
sur lui, le contrôle assurer une meilleure coordination des
activités des intermédiaires et le respect de sa politique
marketing.
Troisième étape : La détermination
des solutions de distribution possible :
Une fois les objectifs, les critères et les
contraintes de sa politique de distribution identifiés, le
créateur du réseau se doivent découvrir les
différents systèmes de distribution envisageables.
Quatrième étape : Le choix final du ou
des réseaux de distribution :
A ce stade du processus séquentiel de prise de
décision, le dirigeant va sélectionner, à l'aide d'un
certain nombre de méthodes, le réseau de distribution qu'il
jugera le plus satisfaisant.
En fonction du nombre de ses objectifs, de la quantité
et qualité desinformations dont il dispose, le concepteur du
réseau adoptera soit une méthode unique, soit une méthode
multicritère.
Cinquième étape : La mise en place d'un
réseau de distribution :
Elle consiste à collecter les
informations qualitatives et quantitatifs nécessaires, l'étude de
toutes les contraintes, les avantages et les inconvénients de chaque
réseau de distribution qui sera suivis par une étude de
contrôle de l'efficacité de ce réseau.
2.1.10. La mise en place d'un circuit de
distribution
Mettre en place un système de distribution comporte
plusieurs étapes. Il faut successivement étudier les besoins des
clients, définir les objectifs poursuivis, identifier les solutions de
distribution envisageables et les évaluer.
2.1.11. Comment étudier les besoins de la
clientèle.
Il s'agit de comprendre qui achète quoi, où,
quand, comment et pourquoi au sein du marché visé. Les attentes
s'expriment le plus souvent à travers cinq dimensions.
1. Le volume unitaire : Il traduit la quantité du
produit souhaité, par un client à chaque occasion d'achat. Plus,
il est réduit, plus le service rendu par circuit s'élargit
(stockage, éclatement.).
2. Le délai : il sépare la commande du
moment de livraison. Plus, il est court, plus le client est satisfait.
3. L'endroit : il est pratique pour un consommateur de
trouver ce qu'il désire dans de multiples endroits,
ce qui exige un réseau compose denombreux point de vente.
4. Le choix : Il correspond à la largeur de
l'assortiment du distributeur. En général, les clients
apprécient un large choix.
5. Le service : Il Comporte tous les
éléments intangibles (crédit, livraison,installation,
réparation) fournis par le circuit. Plus, ceux-ci sont nombreux, plus
les fonctions dévolues au circuit s'accroissent.
Pour chaque dimension, il convient d'apprécier le
niveau attendu par le client et la dispersion des attentes selon les segments
du marché. La recherche du rapport optimal entre le prix de vente et les
services rendu est à l'origine des nombreuses formules de distribution
(vente à domicile, supermarché boutique de luxe, etc.)
2.1.12. La définition des objectifs et des
contraintes.
L'objectif d'un mode de distribution se détermine
à partir du niveau de service souhaite. En pratique, le choix des
segments et celui des circuits sont donc étroitement liés.
Chaque producteur doit ensuite concevoir ses objectifs de
distribution à partir des principales contraintes qui, hier sont
imposées par les produits, les intermédiaires et
l'environnement.
a) Les caractéristiques du produit.
Le plus importantes est la durée de vie, le volume, le
degré de standardisation, la technicité et la valeur unitaire.
Les produits périssables exigent en général, un circuit
court, en raison de la nécessite de les acheminer rapidement. Les
produits volumineux tels que les matériaux de construction ou les
liquides, requièrent de circuits qui minimisent les distances et le
nombre de manipulation. Les produits non standardises, tel que les produits
à façon ou les biens d'équipements spéciaux, sont
les plus souvent vendus directement par les représentants de
l'entreprise, en raison de la difficulté de trouver des
intermédiaires ayant la compétence technique nécessaire.
Les produits qui besoin d'un service après-vente intensif sont en
général vendus et entretenus soit directement par l'entreprise,
soit par un réseau de concessionnaires exclusifs.
En fin, les produits ayant une valeur unitaire
élevée, notamment les équipements industriels, ont
tendance à être pris en charge par la force de vente de
l'entreprise plutôt que par des intermédiaires.
b) Les caractéristiques des
intermédiaires.
La force et faiblesse des différents types
d'intermédiaires dans l'accomplissement des fonctions de distribution
jouent également un rôle important. Les agents multicartes, par
exemple, représentent un moyen peu onéreux de toucher la
clientèle, du fait que les couts sont partagés entre plusieurs
fabricants, mais l'effort de vente par contact est moins intense que celui
fourni par un représentant exclusif.
En général, tous les intermédiaires
n'ont pas les mêmes aptitudes à assumer des fonctions aussi
variées que le transport, la promotion, le stockage et le contact avec
le client, pas plus qu'ils n'ont les mêmes exigences en matière de
crédit, de remises, et des délais.
c) Caractéristiques de
l'environnement.
Lorsque la conjoncture économique est mauvaise, les
producteurs sont soucieux de distribuer leurs produits à moindre cout.
Ils ont alors tendance à privilégier les circuits courts et
à renoncer aux services non indispensables. La réglementation en
vigueur est également très importante.
En général, le législateur s'efforce
d'empêcher la formation de tout système de distribution qui aurait
pour résultat d'affaiblir la concurrence et de favoriser la
création de monopoles. Les domaines d'application les plus courants
concernent le refus de vente, les accords d'exclusivité et de concession
et de franchisé.
2.1.13. L'identification des solutions
possibles.
Après avoir identifié les objectifs et les
contraintes de sa politique de distribution, l'entreprise doit procéder
à une analyse des différentes solutions possibles en identifiant
leurs avantages et leur inconvénient. Si elle envisage d'avoir recours
à plusieurs circuits en parallèle (franchise et succursale, force
de vente et internet), elle doit s'assurer qu'ils toucheront des segments de
marché distincts et n'entreront pas en concurrence. Une « Solution
» en matière de distribution comporte trois
éléments :
ü La nature des intermédiaires qui assurent la
vente et le transfert des produits sur le marché ;
ü Le nombre d'intermédiaires utilisés
à chaque stade de distribution ; et
ü Les responsables et engagements respectifs du
producteur et de ses intermédiaires.
SECTION2 :
DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES MARKETING
Cette section a la tâche de montrer comment la mise en
place d'un circuit de distribution peuvent développer les
systèmes marketing.
2.2.1. Le système marketing
verticaux.
Les systèmes marketing sont un mécanisme de
circuit traditionnel qui met en relation les fabricants, les grossistes et les
détaillants, sépares les uns des autres. Ils discutent les
conditions de vente et se comportent de façon indépendante. Au
contraire, un système marketing vertical, est constitué des
réseaux centralisés et professionnellement gères,
construits de façon à réduire les frais d'exploitation et
à avoir le plus d'impact possible sur le marché. Ainsi, trois
types de système marketing verticaux sont donnes : le
système intègre, les systèmes contrôles et les
systèmes contractuels37
10. Le système
intégré.
Dans un système intégré, les niveaux
successifs de production et de distribution appartiennent a une seul et
même société ; par exemple, la moitié des
produit vendus par GAD proviennent de multiples fournisseur de firmes Africaine
et Asiatiques. On la considère comme détaillant, on simplifie
à l' extrême la complexité de leurs activités et ont
ignoré la réalité du marché.
20. Le système
contrôle.
Dans ce système, les étapes de la distribution
sont coordonnées non pas par participation du capital mais par
prédominance d'une des parties ; en d'autres termes, les fabricants
d'une marque leader peuvent s'assurer une collaboration fidèle et
soutenu de la part des distributeurs. Tout comme le distributeur peut s'assurer
une nette collaboration fidèle des détaillants.
30. Le système
contractuel.
Ce dernier se compose de différents stades du cycle
produit - commercialisation qui décident de coordonner leur programmes
d'action afin de réduit leurs coûts et/ ou augmenter le nombre des
réseaux d'entrepris sur le marché. De tous ces trois
systèmes marketing verticaux, la GAD n'utilise aucun et par
conséquent, les autres entreprises commerciales vendent les mêmes
gammes bénéficiant de marchés plus rentables.
2.2.2. Les système marketing
horizontaux.
Une autre évolution importante en marketing est le
développement des systèmes marketing horizontaux. Ceux-ci
consistent à la formation d'une alliance provisoire et permanente, ou de
fonder une filiale commune entre deux entreprises vendant les mêmes
produits ou pas afin d'exploiter ensemble les possibilités du
marché. Aucune des deux entreprises ne peut ni ne veut amasser le
capital, le savoir-faire, les ressources de production et de marketing
nécessaire pour faire cavalier seul. Sans doute, les risques sont trop
importants et que la voie d'association leur permettre de partager les
risques39(*).
2.2.3. Le développement des systèmes
multi circuits.
Traditionnellement, les entreprises commerciales avaient
pour habitudes de s'adresser à un marché à travers un seul
circuit. Puis, on vit à développe des systèmes bi circuits
s'impliquant deux de réseaux différents. Aujourd'hui, du fait de
la fragmentation des marchés et de la multiplicité des
réseaux, de nombreuses sociétés pratiquent une
distribution multi circuits.
Une telle approche vise à optimise le volume
grâce àune meilleure couverture du marché, une
diversification des risques et une adaptation des produits ; en même
temps, elle suppose une organisation par divisions séparées afin
de limiter les zones de conflit.
En fait, les entreprises attraient par cette forme de
distribution doivent repenser l'ensemble de leur architecture commerciale.
2.2.4. La procédure de segmentation des
circuits de distribution.
En réalité, la segmentation du marché est
une demande actuellement préalable au choix des cibles ; elle
repose sur sept étapes présentées par le tableau
ci-après.
|
Etapes
|
Caractéristiques
|
|
1. Identification des segments
2. Etude des segments circuits
3. Evaluation des segments
4. Choisir des cibles
5. Choisir de positionnement
6. Test du positionnement
7. Elaboration du marketing
|
1. Identifier les groupes des consommateurs ayant des besoins et
des comportements homogènes face a un produit donne.
2. Etudier les caractéristiques géographiques,
sociodémographiques psycho graphiques et comportementales de chaque
segment afin de mieux l'identifier.
3. Evaluer de chaque segment en fonction de son attrait
général de sa cohérence avec les objectifs et les
ressources de l'entreprise.
4. Choisir le/ou les segment (s)auxquels l'entreprise va
s'adresser.
5. Elabore une proposition de valeur et un positionnement pour
chaque segment cible en fonction de ses besoins et ses
caractéristiques.
6. Créer des concepts pour évalue
l'attractivité de chaque positionnement envisage auprès du
segment visé.
7. Déchirer le positionnement sur marketing du produit ou
service.
|
CHAPITRE TROISIEME :
ANALYSE DE CIRCUIT DE DISTRIBUTION DES PRODUITS LAITIERS DANS L'ETABLISSEMENT
GAD Cas de NIDODE 2016- 2019.
Pour ce dernier chapitre axé sur l'analyse de circuit
de distribution de produits laitiers. En effet, comme ce troisième
chapitre est organisé autour d'une idée essentielle sur la
distribution dans une entreprise commerciale, cas de l'établissement
GAD à la période allant de 2016 à 2019, nous
étions contraint de descendre sur le terrain pour nous permettre de
mieux cerner la problématique soulevée ainsi le tenant de la
présupposition avancée pour vérifier la
véracité dans le cadre d'infirmer ou de confirmer cette
thèse aux travers les résultats des enquêtes soumises
à l'interprétation.
III.1. PRESENTATION DES DONNEES ET DES RESULTATS
III.1.1. PRESENTATION DE CIRCUIT DE DISTRIBUTION DE
GAD.
Les circuits de distribution utilisée par
l'établissement GAD dans la commercialisation des produits laitiers est
basé sur le circuitdirectultracourts l'établissement GADvend
directement ses produits aux consommateurs.
Concerne la politique de distribution, l'établissement
fait recourt à la distribution intensive avecdeux segments dont un
à Aru et l'autre à Ariwara, ces deux point de vente permet
à l'entreprise de couvrir son marché des produits laitiers
à la satisfaction des consommateurs.
III.1.2. PRESENTATION STATISTIQUE DE LA QUANTITE IMPORTEE
ET VENDUES DES PRODUITS LAITIERS DE 2016 à 2019.
A. QUANTITE IMPORTEE ET VENDUE PAR EMBALLAGE
a. Quantité importée par emballage
Tableau N° 1 : Quantité importée par
Emballage et par an
|
CONTENU
|
UNITE
|
QUANTITES IMPORTEES PAR EMBALL.
|
TOTAL
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
15 Gramme
|
SACHET
|
17560
|
18000
|
19100
|
20000
|
74660
|
|
50 Gramme
|
SACHET
|
5100
|
5500
|
6000
|
5200
|
21800
|
|
400 Gramme
|
BOITE
|
4608
|
4000
|
4500
|
4600
|
17708
|
|
900 Gramme
|
BOITE
|
3600
|
4000
|
4000
|
6000
|
17600
|
|
2500Gramme
|
BOITE
|
1729
|
2000
|
1200
|
1500
|
6429
|
Source : Rapports annuels du service
Administratifl'établissement GAD/Données enquête
Graphique N°1 : Quantité importée par
emballage

Interprétation
Ce qui ressort de ce graphique est que la quantité de
l'importation par emballage s'est dérouler en 4 années pour
chaque produit de la manière suivante :
- Emballage de 15 gramme (sachet) : en 2016 était
17560, en 2017 était 18000, en 2019 était 19100, en 2019
était 20000 ce qui fait un total de 74660 sachets. On constate au cours
de cette période de quatre ans d'importation une augmentation sensible
de la quantité.
- Emballage de 50 gramme (sachet) : en 2016 était
de 5100, en 2017 était 5500, en 2018 était 6000, en 2019
était 5200 ce qui fait un total de 21800 sachets. On constate une
légère augmentation de la quantité de l'importation.
- Emballage de 400 gramme (boites) : en 2016 était
4608, en 2017 était 4000, en 2018 était 4500, en 2019
était 4600 ce qui fait un total de 17708 boites. On constate une
légère diminution de la quantité de l'importation.
- Emballage de 900 gramme (boites) : en 2016 était
3600, en 2017 était 4000, en 2018 était 4000, en 2019
était 6000 ce qui fait un total de 17600 boites. On constate une
augmentation de la quantité de l'importation.
- Emballage de 2500 gramme (boites) : en 2016
était 1729, en 2017 était 2000, en 2018 était 1200, en
2019 était 1500 ce qui fait un total de 6429 boites. On constate une
diminution de la quantité de l'importation.
b. Quantité vendue par emballage
Tableau N°2 :
Quantité vendue par emballage
|
CONTENU
|
UNITE
|
QUANTITES VENDUES PAR EMBALL.
|
TOTAL
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
15 Gramme
|
SACHET
|
17500
|
18000
|
19100
|
20000
|
74660
|
|
50 Gramme
|
SACHET
|
5100
|
5500
|
6000
|
5000
|
21600
|
|
400 Gramme
|
BOITE
|
4000
|
3950
|
4500
|
4550
|
17000
|
|
900 Gramme
|
BOITE
|
3560
|
4000
|
4000
|
5900
|
17460
|
|
2500Gramme
|
BOITE
|
1729
|
1800
|
1200
|
1500
|
6229
|
Source : Rapports annuels du service
Administratifl'établissement GAD/Données enquête
Graphique N°2 : Quantité vendue par
emballage
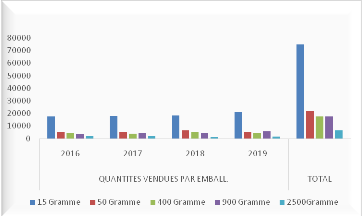
Interprétation
Ce qui ressort de ce graphique est que la quantité de
marchandise vendue sur l'importation s'est déroulée en 4
années pour chaque produit de la manière suivante :
- Emballage de 15 gramme (sachet) : en 2016 sur 17560
importée, 17500 étaient vendues, en 2017 sur 18000
importée, 18000 étaient vendues, en 2019 sur 19100
importée, 18000 étaient vendues, en 2019 sur
20000importée, 20000 étaient vendues, ce qui fait un total de
74660 sachets. On constate au cours de cette période de quatre ans que
toutes les quantités importéesétaient vendues.
- Emballage de 50 gramme (sachet) : en 2016 sur 5100
importée, 5100 étaient vendues, en 2017 sur 5500 importée
5500 étaient vendues, en 2018 sur 6000 importée, 6000
étaient vendues, en 2019 sur 5200 importée, 5000 étaient
vendues, ce qui fait un total de 21600 sachets vendues. On constate qu'une
quantité de 200 sachets su l'importation de 2019 étaient
restées.
- Emballage de 400 gramme (boites) : en 2016 sur 4608
importée, 4000 étaient vendues, en 2017 sur 4000 importée
3950 étaient vendues, en 2018 sur 4500 importée, 4500
étaient vendues, en 2019 sur 4600 importée, 4550 étaient
vendues, ce qui fait un total de 17608 boites vendues. On constate qu'une
quantité de 708 boites importées étaient restées.
- Emballage de 900 gramme (boites) : en 2016 sur 3600
importée 3560 étaient vendues et une 40 boite étaient
restées, en 2017 sur 4000 importée 4000 étaient vendues,
en 2018 sur 4000 importée 4000 étaient vendues, en 2019 sur 6000
importée, 5900 étaient vendues, ce qui fait un total de 17500
boites. On constate qu'une quantité de 140 boites de l'importation
étaient restées pour l'année 2019.
- Emballage de 2500 gramme (boites) : en 2016 sur 1729
importée 1729 vendues, en 2017 sur 2000 importée, 1800 vendues et
une quantité de 200 étaient restées, en 2018 sur 1200
importée, 1200 étaient vendues, en 2019 sur 1500 importée,
1500 étaient vendues, ce qui fait un total de 6229 boites. On constate
qu'une quantité de 200 boites de l'importation étaient
restées.
B. Quantité importée et vendue en gramme et
par an
a. Quantité importée en gramme et par an
Tableau N° 3 :
Quantité importée en gramme
|
CONTENU
|
UNITE
|
QUANTITES IMPORTEES EN GRAMME
|
TOTAL
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
LAIT
|
GRAMME
|
9924100
|
10745000
|
8986500
|
11550000
|
41205600
|
Source : Rapports annuels du service Administratif
l'établissement GAD/Données enquête
Graphique N° 3 : Lait importé en gramme par
an
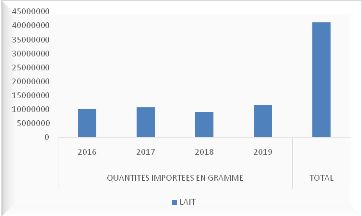
Interprétation
Ce qui ressort de ce graphique est que la quantité de
l'importation pour tous les emballages qui se sont déroulées en 4
années pour chaque année était de la manière
suivante :
- En 2016 : nous avons 9924100 quantités
importées ;
- En 2017 : nous avons 10774500 quantités
importées ;
- En 2018 : nous avons 8986500 quantités
importées ;
- En 2019 : nous avons 11550000 quantités
importées. Ce qui fera un chiffre total de 41205600 quantité
importées.
b. Quantité vendue en gramme par an
Tableau N° 4 : Quantité vendue en
gramme par an
|
CONTENU
|
UNITE
|
QUANTITES VENDUES EN GRAMME
|
TOTAL
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
LAIT
|
GRAMME
|
9644000
|
10200900
|
9525700
|
11665000
|
41035600
|
Source : Rapports annuels du service Administratif
l'établissement GAD/Données enquête
Graphique N° 4 : Lait vendu en gramme
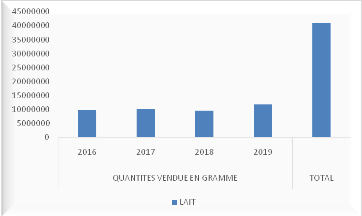
Interprétation
Ce qui ressort de ce graphique est que la quantité
vendue de l'importation pour tous les emballages qui se sont
déroulées en 4 années pour chaque année
était de la manière suivante :
- En 2016 : nous avons sur 9924100 quantités
importées, 964400 vendues;
- En 2017 : nous avons sur 10774500 quantités
importées, 10200900 vendues;
- En 2018 : nous avons sur 8986500 quantités
importées, 9525700 vendues;
- En 2019 : nous avons sur 11550000 quantités
importées, 11665000 vendues. Ce qui fera un chiffre total de 41205600
sur quantité importées, 41035600 vendues.
N.B : Comparant le total de l'importation (41205600) en
gramme et celui de la distribution (41035600), il se dégage une
variation de stock de 0,41% soit 170000 gramme pour une période de 4ans
dont la moyenne annuelle est de 42500 gramme.
III.1.3. EVOLUTION DE PRIX DE PRODUITS LAITIERS DE 2016 A
2019 EN $ SELON LES EMBALLAGES.
Tableau N° 5 : EVOLUTION DE PRIX DE
PRODUITS LAITIERS
|
CONTENU
|
UNITE
|
QUANTITES IMPORTEES PAR EMBALL.
|
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
15 Gramme
|
SACHET
|
0,14$
|
0,13$
|
0,14$
|
0,15$
|
|
|
50 Gramme
|
SACHET
|
0,42$
|
0,40$
|
0,43$
|
0,45$
|
|
|
400 Gramme
|
BOITE
|
6,4$
|
6,5$
|
6,5$
|
6,4$
|
|
|
900 Gramme
|
BOITE
|
13$
|
13$
|
12,6$
|
13$
|
|
|
2500Gramme
|
BOITE
|
28$
|
27,5$
|
27,7$
|
27,7$
|
|
Source : Rapports annuels du service Administratif
l'établissement GAD/Données enquête
Interprétation
Ce qui ressort de ce graphique de l'évolution des prix
des produits laitiers vendus par an après l'importation pour tous les
emballages qui se sont déroulées en 4 années, une
augmentation légère de 0,1$ pour le produit de 15 gramme ;
0,03$ pour le produit de 50 gramme et une diminution légère de
0,3$ pour le produit de 2500 gramme. Mais pour les autres produits, les prix
restent les mêmes.
Conclusion
Nous voici
arrivée au terme de notre étude intitulée : Analyse
de circuit de distribution des produits laitiers dans le marché d'Aru.
Casde NIDO dans la superette GAD de 2016- 2019.
Etude ayant pour objectifs, de procéder à
l'analyse des différents circuits de distribution et politique
qu'utilisent la superette GAD de la commune d'Aru, nous étudierons le
niveau de satisfaction des consommateurs dans l'obtention de produits
laitiers.
Objectif ayant suscité une problématique
résumée par les préoccupations ci-après :
1. Quels sont les circuits de distribution utilisés
dans la commercialisation des produits laitiers par lasuperette GAD de la
commune d'Aru ?
2. Quelle politique cette superettea mis en place dans la
distribution de ses produits ?
3. Cette politique permet-elle d'atteindre les consommateurs
dans toute la commune d'Aru?
Ces préoccupations ontengendré des
hypothèses selon lesquelles :
1. Le circuit de distribution
qu'utilisent lasuperette GAD de la commune d'Aru dans la commercialisation des
produits laitiers serait le circuit direct.
2. La superette GADde la commune d'Aru pratiquerait la
politique de distribution intensive.
3. Cette politique permettrait d'atteindre les consommateurs
dans toute la commune d'Aru.
Pour
atteindre les objectifs assignés à cette recherche et pour
vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la
méthode inductive, pour soutenir ces méthodes, nous nous
sommes servis des techniques documentaires et d'entretien libre.
Pour rendre la rédaction de cette étude
compréhensible et intelligible, nous l'avons subdivisée, hormis
l'introduction et la conclusion, en trois chapitres répartis comme
suit :le premier chapitre avait porté
sur la conceptualisation et la présentation de la commune d'Aru, le
deuxième chapitre avait porté sur le circuit de distribution et
le troisième en fin, était consacré à la
présentation des données, analyse et interprétation de
résultats.
Après la récolte et
traitement de données disponibles par la méthode
susmentionnée et par les techniques indiquées ci-haut, nous avons
constaté quetoutes nos hypothèses sont affirméescar la
superette GAD de la communed'Aru utilise le circuit direct dans la
commercialisation des produits laitiers et ce circuit est basé sur la
politique de distribution intensive qui arrive à satisfaire l'ensemble
des consommateurs.
Nous encourageons les superettes d'Aru en
général et GAD en particulier par leur circuit de distribution et
politique qui donne une influence significative à l'augmentation de leur
activité et surtout à la satisfaction de leurs consommateurs.
Nous osons croire que le présent travail servira de
jalon pour les recherches ultérieures autour de la même
thématique.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
1. Alain Bultes, Distribution des roles dans le canal
commercial, publiés dans deux numeros consécutifs de
décision Marketing, n°38, janvier -mars 2005, p.33-44, n° 39
Avril -Juin 2005, p.31-46 respectivement.
2. Anne Conglan, Erin Anderson, louis Stern et Adel- El.
Ansan, Marketing charnel, 6em éd. Upper Saddle rivers, Prestice
Hall.2001
3. Bruce Mallen, le concept de délégation des
fonctionns de marketing, Encyclopédie du marketing, paris, éd.
Technique, 1977, vol 4,
4. JUSTEAU, J.J. et GRABY, F., le marketing : objectifs
et méthodes, paris, Dunod, 1983
5. Kotler& Dubois; Marketing management, 10e
édition
6. KOTLER P. et BERNARD DUBOIS, Marketing Management,
Publi-union Ed, 9ème éd, Paris, 1997
7. LAMBIN, J.J., Le marketing stratégique. Fondements
et applications, paris, MC Graw-Hill, 1991 cité par Google :
http:/www.marketing stratégique. Htl. consulté le 15/05/2020.
8. LENDREVIE J. & LINDON D, « Mercator :
théorie et pratique du marketing », 8eme édition, Paris,
Dalloz, 2006
9. Louis Stem et Batron weilz, the revolution in distribution,
challengers and opportunities long range planning, vol 30, n°6, 1997
10. Marc VANDERCAMMEN & Martine CANTHY-SINECHAL; Recherche
marketing, outil fondamental du marketing; éd Deboeck Université;
1999,
11. MONHEINE et RICH, Méthodes des recherches en
sciences sociales, 11e édition, PUF, Paris
12. Paul Nunes et Fred Cespedes, The custoner has Escaped,
Harward Business Review, Novembre 2003
13. PITON et GRAWITZ, Méthodes de
recherche en sciences sociales, éd. Dally, Paris, 1971,
14. Pierre Louis du BOIS et Patrick Nicholson, Le Marketing
direct intégre, Paris chetard et Associés, 1987A
15. VANDERCAMMEN, M. & N, Jospin PERNET, La distribution
1ér Ed, de BOECK Bruxelles, 2002
16. YVE CHIROUZE ; le marketing études et
stratégies; édition ellipses marketing S.A., Paris, 200
II. NOTES DES COURS
1. DRANI-A, Méthode de recherche en science sociale,
inédit, G2 MSE, UNIC/Aru, 2010-2011,
2. 3. LISENDJA. B., Initiation à la recherche
scientifique, G1 FSEG, UNIKIS, 2003-2004 cours inédit.
4. MATENGO M. cours de Théorie générale du
marketing, inédit UNIC, 2016-2017
5. MATENGO M. Cours de distribution économique, L2 Gestion
Marketing, UNIBU, inédit
6. MULEKA NGINDO, cours de Gestion marketing, inédit,
FSEG, 2007-2018,
7. KABONGO KANDA, Politique d'entreprise, cours inédit, L2
Département de gestion, FSEG, UNIKIS, 2009-2010,
8. SALAMBIAKU S, Cours de l'initiation de recherche scientifique,
USB, G1 FAGE, inédit, 2011
9. LUSENDI M., Méthode de recherche en marketing,
L2FSEG, cours inédit, UNIKIS, 2007-2009
10. MULEKA, Gestion marketing, cours inédit, G3 FSEG,
UNIKIS, 2007-2008,
III. TFC ET MEMOIRE
1. HAMADOU PALE ERIC,l'Analyse de la consommation de lait et
des produits laitiersMémoire inédit, L2 Economie Rurale, UPB,
2008.
2. PALUKU SIWAKO J.L., Perspectives du service marketing sur
la production au sein de la SONAS/Goma 2003-2006, TFC inédit, ISC/Goma,
G3 Comptabilité, 2006-2007
3. SOKI KATAVALI N., les stratégies marketing
appliquées dans les compagnies de transport aérien de Goma, cas
de la compagnie de transport aérien CETRACA/CAS/Goma, TFC inédit,
ISC/Goma 2006-2007
4. STANIS MANGALA SOSOABO, l'Etude comparative de la
préférence de produits laitiers dans la cité de Bunia; cas
de Cowbell et Nido de 2009 à 2012, université de CEPROMAD
de Bunia - management et sciences économiques 2014
IV. AUTRES
1. SERRAF, G. Dictionnaire méthodologique du marketing,
paris, les EO, 1985
2. FAO, Utilisation des aliments tropicaux, produits animaux,
édition 47/8.
3. GEM RCM, Laits et produits laitiers, édition, Paris,
2009
4. Zarrouk Fayçal, statistiques, ISSEP Ksar-Said,
2011-2012,
V. WEBOGRAPHIE
www.google.com.

* 1LISENDJA. B., Initiation a
la recherché scientifique, G1 FSEG, UNIKIS, 2003-2004 cours
inédit.
* 2STANIS MANGALA
SOSOABO, l'Etude comparative de la préférence de produits
laitiers dans la cité de Bunia; cas de Cowbell et Nido de 2009
à 2012, université de CEPROMAD de
Bunia - management et sciences économiques 2014
* 3 HAMADOU PALE
ERIC,l'Analyse de la consommation de lait et des produits
laitiersMémoire inédit, L2 Economie Rurale, UPB, 2008.
* 4PALUKU SIWAKO J.L.,
Perspectives du service marketing sur la production au sein de la
SONAS/Goma 2003-2006, TFC inédit, ISC/Goma, G3 Comptabilité,
2006-2007
*
5SOKI KATAVALI N., les
stratégies marketing appliquées dans les compagnies de transport
aérien de Goma, cas de la compagnie de transport aérien
CETRACA/CAS/Goma, TFC inédit, ISC/Goma 2006-2007
* 6 Marc VANDERCAMMEN &
Martine CANTHY-SINECHAL; Recherche marketing, outil fondamental du
marketing; éd Deboeck Université; 1999, pg 275.
*
7 Kotler& Dubois;
Marketing management, 10e éditionPg 436
*
8 MONHEINE et RICH,
Méthodes des recherches en sciences sociales, 11e édition, PUF,
Paris, 2001
* 9 SALAMBIAKU S, Cours de
l'initiation de recherche scientifique, USB, G1 FAGE, inédit,
2011
*
10PITON et GRAWITZ,
Méthodes de recherche en sciences sociales, éd.
Dally, Paris, 1971, P.62
*
11DRANI-A,Méthode de recherche
en science sociale, inédit, G2 MSE, UNIC/Aru, 2010-2011, P.18.
*
12Zarrouk Fayçal, statistiques,
ISSEP Ksar-Said, 2011-2012, P.1
* 13 BOLINDA WA BOLINDA,
Initiation en recherche scientifique G2ISC, 2008-2009, cours inéd
*
14LAMBIN, J.J., Le marketing
stratégique. Fondements et applications, paris, MC Graw-Hill, 1991
cité par Google : http:/www.marketing stratégique. Htl.
consulté le 15/05/2020.
* 15 VANDERCAMMEN et JOSPIN-
PERNET, N., La distribution, Bruxelles, Ed. De Boeck, 2003, Pg.26
* 16 Lambin, J.J.,
op.cit.
* 17 JUSTEAU, J.J. et GRABY,
F., le marketing : objectifs et méthodes, paris, Dunod, 1983,
Pg.183.
* 18 SAMART P, La distribution,
Ed, Foucher, Paris, 2002, Pg 37
* 19 MULEKA NGINDO, cours de
Gestion marketing, inédit, FSEG, 2007-2018, p5.
* 20VANDERCAMMEN, M. & N,
Jospin PERNET, La distribution 1ér Ed, de BOECK Bruxelles, 2002 Pg 22
* 21 SERRAF, G. Dictionnaire
méthodologique du marketing, paris, les EO, 1985, Pg.93
* 22 MATENGO M. cours de
Théorie générale du marketing, inédit UNIC,
2016-2017, p 56
*
23KOTLER P. et BERNARD DUBOIS, Marketing
Management, Publi-union Ed, 9ème éd, Paris, 1997,
P663
* 24 MATENGO M. Cours de
distribution économique, L2 Gestion Marketing, UNIBU, inédit Pg
39
* 25 Idem
* 26 MATENGO M., Op.cit. Pg 51
*
27HAMADOU PALE E, Analyse de la
consommation du lait et produit laitiers, Mémoire inédit, L2
Economie Rurale, UPB, 2008
* 28FAO,
Utilisation des aliments tropicaux, produits animaux, édition
47/8.
* 29GEM RCM, Laits
et produits laitiers, édition, Paris, 2009
* 30GEM RCM, Laits
et produits laitiers, édition, Paris, 2009
* 31 Anne Conglan, Erin
Anderson, louis Stern et Adel- El. Ansan, Marketing charnel, 6em éd.
Upper Saddle rivers, Prestice Hall.2001. Pg 586
* 32 Alain Bultes, Distribution
des roles dans le canal commercial, publiés dans deux numéros
consécutifs de décision Marketing, n°38, janvier -mars 2005,
p.33-44, n° 39 Avril -Juin 2005, p.31-46 respectivement.
* 33 Louis Stem et Batron
weilz, the revolution in distribution, challengers and opportunities long range
planning, vol 30, n°6, 1997, pg 823-829
* 34 Paul Nunes et Fred
Cespedes, The custoner has Escaped, Harward Business Review, Novembre 2003,
p 96
* 35 Bruce Mallen, le
concept de délégation des fonctions de marketing,
Encyclopédie du marketing, paris, éd. Technique, 1977, vol 4, p.
21
*
36Pierre Louis du BOIS et Patrick
Nicholson, Le Marketing direct intégre, Paris chetard et
Associés, 1987A
* 37LENDREVIE J. &
LINDON D, « Mercator : théorie et pratique du marketing »,
8eme édition, Paris, Dalloz, 2006, page 398.
* 38YVE CHIROUZE ;
le marketing études et stratégies; édition ellipses
marketing S.A., Paris, 2003
*
39 KOTLER Ph. Opcit
| 


