|
Université Lumière Lyon 2 Faculté
d'Anthropologie
Note d'avancement du Mémoire
Comment la forêt traverse les hommes
Étude des représentations de
l'écosystème forestier La Ceiba au Costa Rica

Pont d'accès à La Ceiba (Credit : Jaguar
Rescue Center)
Marion Picard, juin 2020
Sous la direction de Béatrice Maurines et de Julien
Bondaz
Dans le cadre du Master 1 Anthropologie

2
REMERCIEMENTS
J'aimerais remercier chaleureusement l'équipe du Jaguar
Rescue Center, et notamment Encar et Nerea, pour m'avoir accueilli au sein de
la fondation et sans qui ce travail n'aurait vu le jour. C'est avec une passion
sincère que ses membres m'ont transmis leurs volontés, leurs
savoirs, leurs inquiétudes et leurs espoirs. Je pense notamment à
mes managers, Ashley et Auger, qui m'ont fait découvrir la beauté
de la faune et de la flore costaricaine, et m'ont tant appris. Mais je n'oublie
pas mes compagnons volontaires, Daniel, Nanouk, Victor, Manuela, Pablo, Julie,
Mona, Emma et Laura, que je remercie pour les moments précieux que nous
avons partagés ensemble à La Ceiba. Et bien sûr, la
forêt, qui m'a tant offert en me laissant entrevoir son monde, et dont
j'espère me souvenir à jamais de l'effet de son
omniprésence.
J'aimerais également remercier sincèrement mes
directeurs de recherche, Béatrice Maurines et Julien Bondaz, pour leur
bienveillance et leur soutien tout au long de cette année
particulière. Leur collaboration m'a été d'une grande aide
pour construire ce travail et l'enthousiasme qu'ils y ont porté ont
été un véritable moteur. Grâce à leurs
encouragements et à leur confiance, j'ai pu accomplir mes objectifs
sereinement et construire mes projets futurs, qui n'auraient probablement pas
abouti sans l'attention sincère de Béatrice Maurines.
Je tiens à remercier Denis Cerclet, qui, m'ayant suivi
l'année passée, m'a apporté des conseils d'une richesse
intellectuelle émérite. Sa vivacité d'esprit et son
soutien m'ont permis d'avancer sur le terrain sans m'y égarer. Je
remercie également Martin Soares pour ces encouragements sincères
en début d'année 2018, qui m'ont permis d'aborder le terrain avec
confiance.
Enfin, un grand merci à mes camarades de promotion,
pour la richesse de leurs échanges, à mes colocataires et
compagnons de confinement, à mon plus proche ami, pour son aide et son
soutien dans la rédaction de ce travail, et à ma mère,
qui, malgré les aléas de la vie, m'a toujours apporté un
soutien financier et émotionnel inconditionnel.
3
SOMMAIRE
INTRODUCTION 4
I. LA FORÊT, DANS LA SPHÈRE DE L'ANTHROPOLOGIE DE LA
NATURE 6
1. Émergence de la question de la forêt en
anthropologie 6
a. La question de la nature en anthropologie 7
b. L'intérêt pour l'objet forêt dans le
courant de l'anthropologie de la nature 8
2. Aborder la forêt en anthropologie 9
a. La forêt : un objet d'étude à angles
multiples 9
b. Manières d'aborder la forêt dans cette
étude 11
II. LA FORÊT DE LA CEIBA ET SES
PROTAGONISTES 13
1. Terrain d'enquête : La Ceiba 13
a. Généralités botaniques sur les
forêts équatoriales au Costa Rica 13
b. L'inscription de La Ceiba dans le Refuge national de vie
sylvestre Gandoca Manzanillo 16
c. La Ceiba 19
2. Les enquêtés : le collectif du Jaguar Rescue
Center 21
a. Généralités sur la fondation du
Jaguar Rescue Center 21
b. Le Jaguar Rescue Center, un zoo nouveau ? 23
c. Le collectif à La Ceiba 25
III. CONSERVATION, ÉCOTOURISME, ET
RÉHABILITATION : VISIONS DE L'ESPACE
FORESTIER 27
1. Les champs thématiques issus des premières
observations de terrain 27
a. La conservation de la forêt 27
b. L'écotourisme, producteur d'images de la
forêt 30
c. La réhabilitation à travers
l'éthique du care : une instrumentalisation de la forêt 34
2. Émergence et formulation de la problématique
37
IV. AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 40
1. Accès au terrain 40
a. Démarches et prise de contact 40
b. Payer sa place 41
2. Méthodologie appliquée sur le terrain 43
a. La participation observante et ses biais 43
b. Le choix des informateurs et les conversations
informelles 44
c. Biais méthodologiques liés au sujet de
l'étude 46
3. Choix rédactionnels 47
a. L'emploi du « je » méthodologique
47
b. Un état de l'art parsemé 47
CONCLUSION 49
RÉFÉRENCES 50
ANNEXES 55
4
INTRODUCTION
« La Ceiba is not a fucking jardin. »
Voici la manière dont mon manager Auger commentait le
travail d'un collègue qui taillait à ras la
végétation forestière, ne laissant que l'herbe pousser. Il
s'indignait de cette manière de faire : La Ceiba n'était pas un
jardin, elle n'avait pas à être traitée ainsi.
Cette parole m'a conduit à construire mon enquête
autour de la forêt, conçue non pas comme une entité
indépendante de l'humain mais comme un microcosme englobant « des
gens et des arbres qui ont fait histoire les uns avec les autres, les uns par
les autres, et jamais indépendamment de leurs connexions à
d'autres encore » (I. Stengers, 2017, p. 12).
La Ceiba est une zone privée, délimitée
par des frontières invisibles, qui appartient au collectif du Jaguar
Rescue Center depuis 2014, une fondation d'origine européenne qui
pratique la prise en charge de la faune costaricaine. Elle s'inscrit dans
l'histoire de ce collectif, tout comme il s'inscrit dans la sienne.
Située sur la côte Sud-Est du Costa Rica, au coeur du Refuge
National de Vie Sylvestre Gandoca-Manzanillo, elle se compose d'une seule
unité biotique : la forêt dense équatoriale.
Dans l'ontologie occidentale, la définition de la
forêt rend souvent compte d'un écosystème abritant une
large communauté d'espèces non-humaines animales et
végétales, mis en valeur à travers des fonctions
économiques, écologiques ou sociales. La forêt est souvent
perçue selon les bénéfices qu'elle apporte à
l'humain, tantôt productrice de matières premières,
tantôt réservoir de ressources nécessaires et jugées
fragiles. Pourtant, cette définition est loin d'être universelle
ou même de l'avoir été.
Depuis l'origine de l'humanité, l'être humain
arpente les forêts, évolue en son sein, et entretient avec elles
des relations tout aussi diverses que les époques dans lesquelles elles
se situent. La forêt fait partie des histoires humaines (G. Michon 2003),
et sa définition évolue avec celles-ci. Quelle est l'histoire de
la forêt pour le collectif du Jaguar Rescue Center ?
Engagée en tant que volontaire auprès du
collectif, j'ai essayé d'apprendre à voir la forêt avec les
yeux de ses membres humains et d'intégrer au mieux leurs pratiques. Il
m'a alors semblé que le collectif du Jaguar Rescue Center cristallisait
un ensemble de représentations singulières du
5
monde végétal non-humain, lisibles à la
fois dans les pratiques et dans les discours. De là, je me suis
interrogée sur les bases conceptuelles ayant menées le collectif
à interagir de façon si directe avec la forêt, et dont
découle des visions particulières du monde
végétal.
Pour aborder ce questionnement, je commencerai par situer
l'objet forêt dans le champ de l'anthropologie de la nature et
par rendre compte de la multiplicité des manières de l'aborder.
Par la suite, à travers une succincte analyse, je présenterai La
Ceiba, en tant que terrain et objet d'étude, ainsi que le Jaguar Rescue
Center, qui détient la particularité d'intégrer à
la fois des humains et des non-humains animaux dans son collectif.
Je tâcherai alors de problématiser les
représentations de la forêt des membres humains du collectif
à partir de thématiques sous-tirées des premières
observations de terrain, à savoir la conservation, l'écotourisme,
et la réhabilitation. Cela me permettra d'effleurer certaines pistes
d'analyse aboutissant à la problématique.
En dernier lieu, je discuterai la méthodologie
employée pour aborder le terrain en tant qu'apprentie anthropologue, en
mettant en évidence les biais qui en découlent.
La forêt de La Ceiba est soumise à des
représentations multiples que la démarche anthropologique aide
à mettre en évidence. Cette note d'avancement aura pour projet
d'éclairer la diversité des manières de percevoir la
forêt à travers les yeux, les mots et les pratiques des humains du
collectif du Jaguar Rescue Center ; elle amorcera alors une réflexion
sur un hypothétique changement de paradigme des représentations
de la forêt dans les consciences européennes, passant d'un monde
hostile à un monde vulnérable.
6
I. LA FORÊT, DANS LA SPHÈRE DE
L'ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE
S'il existe quelques études anthropologiques à
ce sujet, je pense notamment à celles d'Eduardo Kohn et de Paulin Kialo
publiée respectivement en 2017 et en 2007, la forêt reste un objet
timide et récent dans le domaine des sciences sociales. Loin
d'être traitée par l'anthropologie générale (S.
Froidevaux, 2007), la forêt s'étudie à travers des champs
de l'anthropologie aussi divers que le suggère la multiplicité de
son caractère, si bien que c'est « aujourd'hui un terrain
contesté » (R. Hardin, 2005, pp7). Elle peut ainsi être
l'objet de l'ethnolinguistique, étudiant l'expression de la culture
à travers le langage, de l'anthropologie économique et de
l'anthropologie du travail, qui s'intéressent aux organisations
collectives mises en place par les sociétés humaines et à
leurs rapports d'exploitation et de production des biens (F. Gollain, 2001), de
l'anthropologie environnementale, émergente avec les idées
récentes de gestion et de protection de l'environnement (R. Hardin,
2005). En somme, d'autant de sous champ anthropologique qu'il existe de pistes
de lecture de l'objet forêt.
Dans cette étude, c'est à travers le champ de
l'anthropologie de la nature, introduit en 2001 par Philippe Descola au
Collège de France, que je m'intéresserai à la forêt.
Ce champ questionne la nature des relations entretenues par les hommes avec
leurs espaces de vie et les non-humains et, j'y viendrai, actionne
l'idée d'une pluralité des ontologies humaines.
Parler de l'objet forêt à travers ce champ de
recherche permet d'interroger le rapport qu'entretient l'humain avec celle-ci
et d'appréhender l'ensemble des concepts et outils qui lui permettent de
concevoir cet écosystème complexe et particulier en sachant que
« l'apparente unité du terme « forêt » cache la
diversité des représentations que chaque société se
fait de l'espace forestier » (G. Michon, 2003, pp15).
1. Émergence de la question de la forêt en
anthropologie
L'origine des travaux sur la forêt en anthropologie
émane d'un intérêt pour ce qu'elle nomme les « peuples
de forêt », vivant pour la plupart en forêt
équatorienne, et notamment dans les termes de leur intégration
avec l'environnement (R. Hardin, 2005). Ce fût un sujet d'étude
renommé de la discipline à partir du XXème siècle,
entraînant la marginalisation de ces collectifs (Ibid.). Or,
l'étude du rapport qu'entretient les sociétés humaines
avec cet objet pluriel dans des
7
cadres plus globaux n'émerge que récemment, en
parallèle de l'intérêt anthropologique pour la question de
la nature.
a. La question de la nature en anthropologie
En France, l'intérêt anthropologique pour la
question de la nature s'est éveillé à la fin du XXeme
siècle et à pris forme au début du XXIème, à
travers les travaux de Philippe Descola, fort influencé par
l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss. Cet anthropologue
inspiré des Achuars, peuple d'Amazonie auprès duquel il
exerça trois années de terrain avec sa compagne Anne-Christine
Taylor, s'est porté au-delà des conjectures expliquant les
rapports humains avec la nature par un certain déterminisme culturel ou
environnemental, et a permis de poser la nature comme « un fétiche
propre [à l'Occident] » (P. Descola, 2017) ouvrant ainsi les portes
à de toutes nouvelles réflexions critiques.
En effet, Philippe Descola détermina l'origine
épistémologique de la dichotomie nature/culture et mit en
évidence que ce découpage particulier du monde, nommé le
Grand Partage, a fait naître une façon tout à fait
singulière de percevoir les réalités du monde, autrement
dit, une ontologie relative au monde occidental appelée le naturalisme
(Ibid.). Il en appelle alors à repenser avec une nouvelle
intelligence l'étude des manières de composer le monde par le
biais d'un détour ontologique ne prenant pas en considération la
dissociation nature/culture pour base de lecture. Ce détour a pour but
de mettre en évidence les origines de l'identification du monde des
collectifs enquêtés, afin de saisir la forme profonde et
générale de leurs interactions avec les êtres, humains et
non-humains, qui le compose (Ibid.). Philippe Descola innove ainsi et
abouti à une science générale des êtres et des
relations se portant au-delà de la science sociale en intégrant
à la fois la philosophie, l'éthologie, la sociologie, la
psychologie, l'écologie, les sciences historiques, la
cybernétique. (Ibid.).
Eduardo Kohn cherche à s'émanciper de
l'interprétation anthropocentrée des sciences sociales d'une
toute autre manière. En s'appuyant sur la théorie
sémiotique de Charles Sanders Peirce, l'anthropologue canadien aborde
une anthropologie au-delà de l'humain en instaurant un cadre
interprétatif novateur, basé sur une interprétation
sémiotique des phénomènes. Tout comme Philippe Descola, il
évolua auprès d'un peuple amazonien, les Runas, pendant quatre
ans, et inscrivit ses observations dans le débat entre nature et
culture, entre humain et non-humain (J. Fayer, 2018). En revanche, il pose un
cadre théorique surplombant l'interprétation symbolique
8
descolienne et étend à l'ensemble du vivant la
capacité d'interprétation, de représentation et de
pensée, de sorte que tout être vivant animé est
considéré comme un sujet actif et individuellement conscient,
qu'il nomme un « soi » (E. Kohn, 2017). S'inspirant de la tradition
nord-américaine, Eduardo Kohn projette ainsi la notion de pensée
au-delà de l'humain et montre qu'il existe des formes de pensée
plus grandes que celles des hommes, ce qu'il introduit par la formulation
« les forêts pensent » et ce, dans la mesure où tout
être vivant est capable d'interpréter des signes et d'agir en
conséquence (Ibid.). Néanmoins, une certaine faiblesse
structurelle et un flou conceptuel (J. Fayer, 2018) lui ont été
reproché mais l'originalité de son approche amène une
toute nouvelle réflexion sur les cadres de l'analyse anthropologique et
permet de repenser ses modes d'observations.
b. L'intérêt pour l'objet forêt dans le
courant de l'anthropologie de la nature
Ces auteurs emblématiques de l'anthropologie de la
nature ont pour projet de repeupler les sciences sociales avec les non-humains,
entendus comme tout être animé tel que les plantes, les animaux
non-humains ou les esprits. Or, lorsque l'anthropologie vient à
s'intéresser à l'objet forêt, c'est un ensemble complexe et
diversifié de non-humains qu'elle aborde à travers l'étude
des peuples humains et non un ensemble homogène et palpable.
Il existe près de mille cinq cents groupes humains en
forêt équatoriale, et chacun d'entre eux adopte des modes de vie
spécifiques en relation avec l'écosystème forestier (S.
Bahuchet, 1993). Ils en dépendent, autant que la forêt est
marquée par leur passage depuis des millénaires, de sorte
qu'« il n'y a pas de forêt vierge » (Ibid., p. 11). La
forêt cristallise un ensemble de relations constantes entre humains et
non-humains, qui suggère que l'un ne peut être pensé sans
l'autre. De ce constat d'inter-relation et d'interdépendance semble
naître l'intérêt des anthropologues de la nature pour la
forêt.
Par ailleurs, si la plupart des recherches contemporaines
rattachées au courant de l'anthropologie de la nature concerne les
forêts équatoriales et, plus précisément, les
peuples forestiers, c'est, je crois, par un soucis de tradition anthropologique
qui a longtemps posé comme légitime l'étude des
sociétés dites non-modernes, des sociétés de
l'ailleurs, voire primitives et sauvages, porté et alimenté par
l'idéologie évolutionniste (P. Descola, 2017). Et bien que les
débats liés à l'idée de Grand Partage tendent
à dépasser les conceptions eurocentriques et anthropocentriques
de la lecture des réalités sociales (Ibid.), le poids de
la tradition se ressent dans
9
le choix des terrains anthropologiques, bien souvent
porté sur un ailleurs lointain, sur un peuple autre et
marginalisé (R. Hardin, 2005), présenté comme isolé
du monde.
2. Aborder la forêt en anthropologie
La singularité de l'objet forêt suggère
une certaine appropriation par les sciences sociales, différente mais
pas tout à fait étrangère à la définition
des sciences dures, afin de comprendre les phénomènes multiples
qui le sous-tendent. Il n'est pas simple d'en délimiter les contours, ou
de lui donner des caractéristiques précises et strictement
définies ; mais il est nécessaire de clarifier l'approche
adoptée par les sciences sociales et la manière dont la
forêt sera abordée dans cette étude, à la fois pour
poser le cadre théorique de la recherche mais aussi pour mieux cerner
son sujet.
a. La forêt : un objet d'étude à angles
multiples
Aujourd'hui, il nous paraît évident que la
forêt est loin de se limiter à une juxtaposition d'arbres, mais
bien à une association de plantes et d'animaux, au sein de laquelle on
observe de multiples interactions (L. Mathot, 2016). Dans le langage des
sciences de la vie, il est question d'une « communauté de plantes
et d'animaux organisée, structurée qui apparaît comme un
ensemble unique possédant des propriétés collectives
» (Ibid. p. 42). Autrement dit, c'est sa constitution biologique
qui prime et donne à voir la forêt comme un système vivant
et autonome, constitué d'une population animale et
végétale dominée par les arbres (G. Michon, 2003).
L'anthropologie, quant à elle, vient ajouter le facteur humain à
cette définition et l'intègre dans la complexité de
l'écosystème forestier, dans la mesure où chaque
forêt connaît un phénomène d'anthropisation, qu'il
soit direct ou indirect (S. Bahuchet, 1993 ; G. Michon, 2003 ; P. Descola, 2005
; C. Larrère, 2015). Et si les anthropologues de la nature s'accordent
plus ou moins sur cette définition généraliste de la
forêt, la plupart y intègre les non-humains invisibles comme
sujets politiques agissant.
Dans les lectures abordées, l'analyse anthropologique
de l'objet forêt porte généralement sur le symbolisme et
les significations que lui donnent les sociétés humaines à
travers une démarche visant la compréhension de la
pluralité des visions de la forêt existantes en ce monde.
Autrement, comme se conçoit la forêt selon telle ou telle culture
?
10
Pour ce faire, les angles d'approche sont multiples et
s'entrecroisent. L'étude des modes de classification linguistique, en
s'inspirant de la terminologie langagière et de la catégorisation
des forêts adoptée par les collectifs observés (G. Michon,
2003 ; F. Brunois-Pasina, 2004 ; P. Kialo, 2005 ; P. Descola, 2005 ; S.
Froidevaux, 2007) est une approche pertinente pour aborder les
représentations et les perceptions de la forêt. A celle-ci
s'ajoute la lecture de l'expression symbolique contenue dans les pratiques
sociales, les usages et les modes de vie des collectifs (F. Brunois Pasina,
2004 ; P. Kialo, 2005 ; P. Descola, 2005, 2009 ; E. Kohn, 2017).
L'objet forêt s'analyse également sous la focale
plus large des ontologies humaines, notamment de l'animisme, vision du monde
dans laquelle chaque forme d'être visibles et invisibles constitue un
collectif à part et est perçu comme un individu qui entretient
des rapports (de continuité intérieure et de discontinuité
physique) avec l'être humain (P. Descola, 2000-2001, p. 564). Cette
perspective est commune et constante aux écrits de Philippe Descola et
de Florence Brunois-Pasina ; elle permet de nommer l'univers forestier
par-delà le monde visible et de questionner les visions naturalistes
occidentales. De la même manière, Eduardo Kohn s'intéresse
à l'animisme, mais plutôt que de l'attribuer aux humains, il fait
glisser cette conception du réel vers son objet d'étude, par le
biais d'une analyse sémiotique novatrice bien que complexe. Il parle
alors d'un animisme de la forêt, en ce sens où la forêt
pense à sa manière, tout comme le fait singulièrement tout
être vivant, et avec laquelle l'être humain peut penser (E. Kohn,
2017).
Il est important de noter que malgré cette
prévalence d'une lecture anthropologique de la forêt portée
sur les ontologies humaines, la dimension invisible de l'espace forestier peut
être abordée en dehors de ce champ. L'anthropologue gabonais
Paulin Kialo, dans l'Anthropologie de la forêt (2007), traite du
monde invisible de la forêt, et notamment des génies, par
l'intermédiaire de l'imaginaire et des croyances des Pové, peuple
gabonais, sans pour autant les inscrire dans une ontologie animiste bien qu'il
nous partage que « la forêt invisible est celle qui imprègne
l'imaginaire [des Pové] et qui donne sens aux éléments de
l'écosystème forestier » (P. Kialo, 2007, p. 96). En
dépit de son attachement à l'anthropologie structurale
d'André Georges Haudricourt, Paulin Kialo tire des conclusions dualistes
semblables à celles des anthropologues pensant les ontologies. Par
exemple, Florence Brunois-Pasina, inspirée des concepts d'Augustin
Berque et de Philippe Descola, voit dans le peuple animiste Kasua de
Nouvelle-Guinée une conception de la forêt « avec-soi »,
et non « pour-soi » comme c'est le cas chez les naturalistes (F.
Brunois-Pasina, 2004, p. 105) ; tandis que Paulin Kialo distingue une
population « pro-forêt », les Pové, et une population
« anti-forêt », les exploitants forestiers issus de culture
européenne (P. Kialo, 2007). Ainsi, si l'approche de ces anthropologues
diffère, l'un favorisant une lecture ontologique quand
11
l'autre se contente de lire les pratiques sociales et les
représentations, ils finissent tout deux par émettre une
réflexion similaire sur la diversité des visions de la
forêt.
b. Manières d'aborder la forêt dans cette
étude
Cette étude concerne les visions de la forêt du
collectif Jaguar Rescue Center et cherche à s'inscrire dans la
lignée offerte par l'anthropologie de la nature. Pour l'aborder, il est
nécessaire de présenter la construction de l'objet forêt
selon des termes précis. En m'appuyant sur les lectures
précédemment évoquées et sur le terrain
ethnographique, je tâcherai de traiter la forêt comme un
écosystème1 particulier dominé par les arbres,
intégrant humains et non-humains, dont l'image est propre à un
collectif et dépend d'une construction mentale modulée par les
rapports sociaux, les pratiques, les modes de vie, le symbolisme et
l'imaginaire de ce collectif. En ce sens, l'objet forêt sera lu comme un
espace hautement socialisé dont les représentations
dépendent de la particularité culturelle des
sociétés.
Si l'objet forêt est lisible selon divers angles
anthropologiques, l'approche favorisée ici sera l'analyse des pratiques
sociales du Jaguar Rescue Center. Il s'agira alors de comprendre les rapports
entretenus avec l'écosystème forestier à travers cet angle
d'étude, en s'inspirant des démarches de Philippe Descola, de
Florence Brunois-Pasina et de Paulin Kialo, car les pratiques sociales
dessinent certaines logiques inhérentes aux systèmes de
représentations (P. Kialo, 2007) et sont, je pense,
révélatrices de certains traits conceptuels relatifs à la
vision du monde des collectifs.
Par ailleurs, si l'analyse des rapports sociaux entretenus
à travers les pratiques sociales sera le coeur de ce travail, l'objet
forêt va être abordé à travers la dimension
discursive de l'imaginaire européen, du fait de l'appartenance du
collectif Jaguar Rescue Center à celui-ci (que je préciserai dans
la partie suivante). Dans cet imaginaire, la forêt est ambivalente et
plurielle. D'ailleurs, le terme en lui-même est générique
et détient, par conséquent, une certaine faiblesse terminologique
(G. Michon, 2003).
En effet, il désigne à la fois un lieu de
refuge, d'introspection, de recueillement, ou un espace de loisir, mais aussi
un espace inhospitalier, sauvage ou un espace d'enchantement (S.
1 A noter que le terme « écosystème»
est un outil conceptuel qui permet d'analyser et de représenter la
complexité du vivant par son niveau d'organisation le plus
élevé. Lorsque l'on parle d'« écosystème
», il s'agit de désigner l'ensemble des êtres vivants
composé entre autres de communautés végétales et
animales interdépendantes, en relation avec le milieu physique
environnant (L. Mathot, 2016, pp 133). En d'autres termes, le terme
écosystème forestier désigne la relation entre la
biocénose (très diversifiée où domine les
espèces végétales) et le biotope de la forêt
(déterminé géographiquement et par ses conditions
écologiques).
12
Froidevaux, 2007). C'est également un lieu de ressource
et un symbole de richesse économique, et selon de récentes
perspectives, un réservoir patrimonial des cultures humaines, de
biodiversité et d'oxygène, en outre, un espace à
protéger (Ibid.). De plus, les discours scientifiques
contemporains viennent apporter une nouvelle dimension à ce que l'on
nomme forêt en Europe : celle d'un réseau d'être vivants
interconnectés et complémentaires qui communiquent et ressentent
(P. Wohlleben, 2017). Cependant, cette perspective des sciences de la vie
écarte l'humain, se focalisant sur sa nature intrinsèque et son
existence propre et indépendante (G. Michon, 2003). Alors, comment le
collectif du Jaguar Rescue Center construit la forêt face à cette
pluralité terminologique ? C'est par cet angle d'approche ajouté
à celui de l'analyse des rapports sociaux que je tâcherai
d'aborder la forêt dans cette étude.
13
II. LA FORÊT DE LA CEIBA ET
SES PROTAGONISTES
La dimension générique du terme forêt ne
fait pas de distinction sur ses caractéristiques micro-régionales
(R. Hardin, 2005). Pourtant, elle est présente sur près d'un
tiers des terres émergées et possède des
caractéristiques diverses, éloignées de
l'universalité que suggère sa terminologie. Celle qui concerne
notre enquête se localise entre le Tropique du Cancer et
l'Équateur, dans un pays d'Amérique Centrale, le Costa Rica, et
se rattache au grand ensemble des forêts équatoriales,
qualifiées de denses et humides (S. Bahuchet, 1993).
Elle est nommée La Ceiba par le collectif du Jaguar
Rescue Center, qui a privatisé ces terres forestières il y a une
dizaine d'années dans le cadre de leur projet de réhabilitation
des animaux costaricains. Au sein de ce territoire de quarantaine-neuf
hectares, délimité par des frontières parfois visibles
mais le plus souvent invisibles, une micro-société
particulière se dessine, qui intègre humains et non-humains dans
son collectif.
Afin d'aborder ce terrain ethnographique particulier, il est
nécessaire d'introduire La Ceiba en évoquant les
caractéristiques particulières de ce que l'on nomme forêt
dense équatoriale et son ancrage dans le territoire costaricain. C'est
ensuite à travers un portrait ethnographique portant sur le collectif du
Jaguar Rescue Center et sur la forêt, que je rendrai compte de la
construction du terrain, en évoquant notamment les
caractéristiques constitutives de La Ceiba et les logiques structurelles
du Jaguar Rescue Center2.
1. Terrain d'enquête : La Ceiba
a. Généralités botaniques sur les
forêts équatoriales au Costa Rica
La forêt n'est pas immuable, elle change et
évolue constamment selon des facteurs internes ou externes, allant des
phénomènes anthropiques jusqu'à l'action des plus maigres
champignons formant le mycélium, en passant par les conditions
topographiques. D'un point de vue scientifique, ce sont principalement les
éléments climatiques locaux (notamment en terme de
température et de pluviosité) et l'action du sol qui
déterminent les caractéristiques d'une forêt (Y. Bastien,
M.
2 Régulièrement désigné par
l'acronyme JRC dans la suite de ce travail
14
Bournérias, 2020). Mais si ceux-ci sont
représentatifs, ils ne sont pas suffisant à déterminer
l'implantation d'un type forestier. Les êtres vivants qui constituent la
forêt et vivent en son sein (les humains, les non-humains animaux et les
non-humains végétaux) exercent « une influence
considérable sur le peuplement forestier, et aussi sur son
évolution » et l'action humaine est « inséparable de
l'étude de l'évolution forestière »
(Ibid.).
Le Costa Rica bénéficie d'un climat tropical
défini par la chaleur, la permanence des températures et par des
saisons pluviométriques (F. Hallé, 2010, pp. 68-pp73) ; et «
bien qu'il y fasse chaud et lumineux, le temps ne ressemble pas à
l'été en Europe, encore moins au printemps »
(Ibid., p. 79), en effet l'air y est très humide, contrairement
à ce que l'on peut ressentir dans nos latitudes.
De ce climat particulier résulte des forêts tout
à fait singulières, tantôt appelées forêts
denses tropicales, en référence au climat, tantôt
forêts denses équatoriales, en référence à
leur situation géographique. Ces forêts sont
caractérisées ainsi en raison de la densité des
végétaux constituant leur écosystème et
l'humidité atmosphérique résultant du climat
régional. En termes botaniques, leur structure est rendue compte par les
différentes strates de végétation qui la composent, que
l'on assimile au niveau maximal d'expansion des végétaux
forestiers.
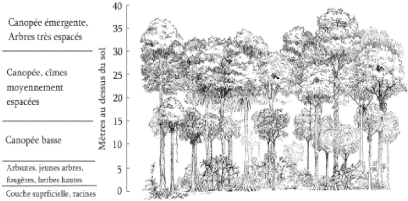
Figure 1: Niveaux de stratification en forêt
équatoriale (Source: N. Cauwe, 2008)
Si les strates de végétation sont difficiles
à délimiter dans le cas des forêts denses
équatoriennes, dans la mesure où elles se superposent (Y.
Bastien, M. Bournérias, 2020), les scientifiques en dénombre cinq
: une strate de végétaux « géants » (hauts de
quarante à cinquante
15
mètres), une strate d'arbres plus petits (de quinze
à vingt-cinq mètres)3, une strate arbustive
formée par les jeunes arbres et les buissons, une strate herbacée
et la strate cryptogamique, principalement composée de champignons
(Ibid. ; Figure 1, p.14).
La Ceiba se situe dans la région de Limon, à
quelques kilomètres de Puerto Viejo. Elle bénéficie d'une
pluviométrie forte, allant jusqu'à plus de trois mètres
par an (Figure 2, p.15), et rentre dans la sous-catégorie des
forêts denses équatoriales. Dans le langage scientifique, elles
sont appelées forêts denses sempervirentes (toujours vertes) ou
ombrophiles (se développant dans une région pluvieuse) (J-P.
Lanly, H-F Maître, 2020). Toutefois, dans cette étude, le terme de
forêt dense équatoriale sera employé, afin d'éviter
la charge sémantique contenu dans le terme tropical et la
complexité des termes issus du discours scientifique.
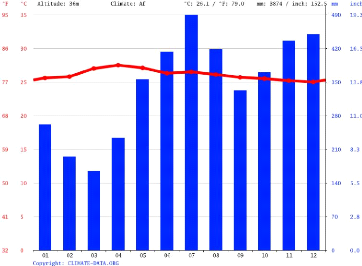
Figure 2: Diagramme ombrothermique attestant de la moyenne
des données de température et de précipitation
récoltées entre 1982 et 2012 dans la ville Puerto Viejo (source :
climate-data.org)
3 Les végétaux de ces deux strates sont
entremêlés à des lianes et sont garnis d'épiphytes
(fougère, orchidées, broméliacées, etc.) (Y.
Bastien, M. Bournérias, 2020).
16
b. L'inscription de La Ceiba dans le Refuge national de vie
sylvestre Gandoca Manzanillo
Au Costa Rica, un peu plus du quart du territoire est
géré par une instance gouvernementale, le SINAC4, qui
institue des « aires sylvestres protégées » ou des
« aires de conservation » (N. Raymond, 2007 ; Figure 3, p.16). Les
aires constituées sont soumises à une catégorisation
précise délimitant différentes zones auxquelles
s'appliquent des politiques de gestion et de juridiction particulières.
L'institution de ces zones a débuté par la promulgation de la
Ley Forestal 4465, en 1969 (Annexe 1), et fût
complétée par la Ley de Biodiversidad 7788, en 1998. Ces
lois ont donné naissance à des parcs nationaux, des
réserves biologiques, des réserves forestières, des zones
protégées, des zones humides et des refuges de vie sylvestre
(Ibid. ; Annexe 1) et ont introduit le concept de conservation
dans le discours politique.

Figure 3: Carte des zones sylvestres protégées
et des couloirs biologiques (source: SINAC, 2016)
4 Le Système National des Aires de Conservation,
créé en 1989, une instance gouvernementale rattachée au
département du MINEA, le ministère de l'environnement et de
l'énergie, créé en 1986. Cette instance est chargée
de la gestion des nombreuses zones protégées du territoire.
17
Depuis plus de 2000 ans, l'humanité protège des
sites, des forêts et des écosystèmes (C. Guilleux, 2018).
Aujourd'hui, les aires protégées sont devenues une composante
essentielle de la stratégie de conservation de la biodiversité
(C. Guilleux, 2018), concept émergeant à la fin du XXe
siècle, en lien avec les préoccupations sociales contemporaines
et l'idée d'une « crise environnementale » (F, Drouilleau,
2015 ; R.Dumez, M. Roué, S. Bahuchet, 2014). La gestion
réglementée des espaces au Costa Rica est éminemment
politique, et semble imposer des changements économiques,
environnementaux et sociaux qui viennent bouleverser les dynamiques
territoriales (C. Guilleux, 2018).
A l'époque de la promulgation de ces lois, en
Amérique Centrale, la grande majorité des forêts
étaient surexploitées (J-P. Lanly, H-F Maître, 2020). Au
Costa Rica, le taux de déforestation allait croissant dès les
années 70, atteignant 89 % en 2000 (Fournier, 1991 ; N. Raymond, 2007).
Ce phénomène, a été si intense que la
pérennité des aires protégées fut
questionnée (N. Raymond, 2007, 8). La création et le maintien des
aires protégées participent ainsi à la transformation du
territoire (C. Guilleux, 2018, Dery, 2007 ; Depraz, 2008), soulève des
questions éthiques et philosophiques quant à la viabilité
et la pertinence de leur existence (C. Guilleux, 2018), et révèle
une vision particulière du monde vivant, que je tâcherai
d'entrevoir dans le troisième axe de ce travail.
Le gouvernement du Costa Rica gère à
présent près de cent soixante zones protégées
réparties dans onze secteurs de conservation régionales plus
larges. L'aire qui intéresse cette étude concerne les refuges
nationaux de vie sylvestre, comptés au nombre de neuf. Cette
catégorisation correspond à des terres délimitées
dont la priorité politique est la protection, la conservation, la
croissance et la gestion des espèces de la faune et de la flore sauvage,
selon la Ley Forestal de 1969 (Annexe 1). Je m'intéresserai ici
au refuge de Gandoca-Manzanillo, dans lequel se situe la forêt dense
équatoriale de La Ceiba (figure 4, p.18).
Situé sur la côte caraïbe sud-est, à
la frontière du Panama, le refuge national de vie sylvestre
Gandoca-Manzanillo est un refuge de type mixte, qui s'étend sur 4,436
hectares de zone maritime et sur 5,010 hectares de terre (SINAC, 1996). Il a
été créé le 29 octobre 1985, à l'issu du
décret exécutif n°16614-MAG, et fait parti du secteur de
conservation de la caraïbe. Hormis la partie maritime, le refuge
connaît une seule unité biotique, la forêt dense
équatoriale, qui s'étend sur une surface relativement plane, dont
l'altitude maximale est de cent quatre vingt cinq mètres (Ibid.).
18
Parmi les espèces végétales dominantes,
on trouve notamment le cativo (prioria copaifera), le sangrillo (pterorcarpus
officinale) et le carapa (carapa guianensis) auxquelles s'additionnent une
multitude d'espèces endémiques (dont l'amandier, dipteryx
panamensis). Cette forêt renferme également une grande
diversité d'espèces animales comprenant parmi d'autres, le singe
hurleur (allouatta palliata), le singe araignée (ateles geoffroyi), le
singe capucin (cebus capucinus), des grands aras verts (ara ambiguus), diverses
espèces de toucan et une multitude d'espèces d'amphibien et de
reptiles (Ibid.).

Figure 4: Localisation de La Ceiba, au sein du Refuge de vie
sylvestre Gandoca-Manzanillo (source: ACBTC, 2014)
Le Refuge de Gandoca-Manzanillo n'est pas exclusivement
l'affaire du domaine public. Son territoire forestier comprend des petites
zones privées, qui sont gérées individuellement par leurs
propriétaires. L'existence des réserves privées est
courante au Costa Rica, elles sont nombreuses et souvent dédiées
à des activités écotouristiques (N. Raymond, 2007). La
Ceiba se trouve être l'une de ses zones : située au coeur du
Refuge, elle appartient à la fondation du JRC, dont le fondateur a
acheté les terres avec l'aide financière de ses pairs en 2014.
19
c. La Ceiba

Figure 5: Topographie de La Ceiba (source: M. Borros,
)
Le territoire privé de La Ceiba est donc situé
dans la zone ouest du refuge national de vie sylvestre Gandoca-Manzanillo et
intègre les mêmes caractéristiques florales et fauniques.
Bien qu'il s'étende sur quarante neuf hectares de zone
forestières humide et dense5, ses frontières ne sont
pas toujours physiquement visibles et délimitées. Officiellement,
le site est accessible par la Paraíso Road, un large chemin caillouteux
perçant la forêt au départ de la route 256, et qui
débouche sur un grand portail arborant l'effigie des
propriétaires (Figure 6, p.20), bordé d'une longue clôture
empêchant son accès libre. Ce passage est le seul endroit
où les frontières de La Ceiba sont marquées ; sur le reste
du territoire, rien n'empêche son accès ni ne le limite, hormis la
dense végétation.
5 D'après les modifications apportés au site
officiel du Jaguar Rescue Center le 18 juin 2020, le JRC possède
aujourd'hui 12 hectares de La Ceiba et a mis en location le reste du territoire
à un tierce. Cette situation peut-être temporaire et pourrait
s'expliquer par une fragilité économique liée à la
fermeture aux visiteurs imposée par l'État dans le cadre de la
pandémie du Covid-19. Mais ceci reste à vérifier sur le
terrain.

20
Figure 6: Portail d'accès à La Ceiba (source:
E. Rizzon, 2018)
Passé ce portail, c'est un territoire nettement
anthropique traversé par une rivière qui se dessine. Les
aménagements sont multiples et comptent un garage, un pont, un chemin
dallé (Annexe 6) ; sur le camping site (Figure 5, p.19) se
trouve trois hébergements, un lieu de restauration, une tour de fer,
plusieurs enclos et des aménagements pour les animaux non-humains du
collectif. Pour implanter ces dernières infrastructures, l'environnement
a été modifié par un éclaircissement des zones
où la végétation se devine anciennement dense. Des
étroits cours d'eau ont également été
détournés afin de former des mares.
Une colline marque une certaine frontière invisible
entre cette zone de vie quotidienne humaine qu'est le camping site et
la dense forêt. Au delà de celle-ci, les traces de l'homme sont
moins visibles, le chemin dallé s'arrête pour être
remplacé par des sentiers tracés à la machette et battus
par les passages répétitifs des humains et des animaux
non-humains. De petites zones ont tout de même été
déboisées par delà la colline en réponse à
certaines activités anthropiques, comme l'installation d'enclos ou la
mise en place de petits aménagements destinés aux animaux
non-humains du collectif tels que des plateformes. De manière
générale, du moins durant mon séjour au printemps 2019, le
territoire de La Ceiba n'avait pas été entièrement
exploré par le collectif du JRC.
En son sein, humains et non-humains interagissent de
manière singulière, me poussant à dire que La Ceiba forme
un microcosme représentatif d'une certaine vision plus large de la
forêt, corrélée aux représentations et aux
activités humaines qui s'y déroulent.
21
2. Les enquêtés : le collectif du Jaguar Rescue
Center
L'usage du terme collectif fait écho à
la réflexion de Philippe Descola portant sur les méthodes et les
concepts d'étude des sciences sociales. Par une tentative de refonder
l'unité de leur analyse, il se détache des concepts de
société, de communauté et de culture, tout aussi abstraits
que chargés de sens multiples, et définit le terme collectif
comme « une forme stabilisée d'association entre des êtres,
[humains et non-humains], qui peuvent être ontologiquement
homogènes ou hétérogènes, et dont aussi bien les
principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont
spécifiables et susceptibles d'être abordés
réflexivement par des membres humains de ces assemblages » (P.
Descola, 2018, pp. 130-131).
Ce terme permet d'intégrer les non-humains dans les
groupes sociaux et de les considérer comme des sujets politiques
agissants. C'est à travers cette idée que le collectif du Jaguar
Rescue Center sera abordé, dans la mesure où la diversité
des êtres le composant intègre à la fois humain et
non-humain dans sa manière de faire monde.
a. Généralités sur la fondation du
Jaguar Rescue Center
Le JRC est officiellement né en 2008. D'un point de vue
juridique, c'est une fondation privée à but non lucratif, dont
l'objectif principal est la conservation de la faune endémique. Le
couple fondateur est formé par d'anciens employés du zoo de
Barcelona, la primatologue d'origine catalane Encar Vila Garcia, et
l'herpétologiste Sandro Alviana d'origine italienne
(décédé le 28 février 2016). Selon les termes
d'Encar Vila Garcia, leur volonté était « d'offrir un refuge
pour les animaux »[traduction personnelle], son rêve depuis sa
jeunesse, et c'est en tant que spécialiste des primates et pour
rejoindre son compagnon qui s'y était établi, qu'elle a choisi de
mener ce projet au Costa Rica.
La fondation est définie comme un lieu de
rétablissement pour les animaux dits sauvages et mis en danger,
souvent par des causes anthropiques (circulation routière, chasse et
trafic illégaux, attaque de chien domestiqués) ou par leur
environnement (abandon, attaque, accident). Elle se décrit
elle-même comme « une maison temporaire ou permanente pour les
animaux blessés, malades ou orphelins [offrant] un service
vétérinaire et des soins 24h sur 24 » [traduction
personnelle]. L'idée d'accueil temporaire va de pair avec leur
activité principale, la réhabilitation, que j'aborderai
dans le troisième axe de cette étude.
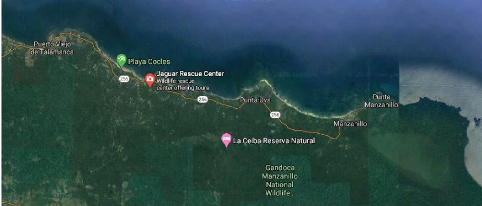
22
Figure 7: Localisation du Jaguar Rescue Center, en rouge, et
de La Ceiba, en rose (source:
googlemaps.com)
Le centre principal du JRC se trouve à quelques
kilomètres de La Ceiba, dans la zone caraïbes au sud-est du pays,
proche de la route 256 (Figure 7, p.22). Au fur et à mesure des
années, la propriété de Sandro et d'Encar s'est largement
agrandie et couvre à présent environ vingt-deux milles
mètres carrés. Quotidiennement, la structure peut accueillir
près de cent soixante animaux non-humains, et autant d'individus
humains.
Un grand nombre d'espèces animales endémiques,
placées en captivité ou en semi-captivité, s'y trouve et
compte des mammifères, des reptiles et des volatiles.
Généralement, ces animaux non-humains sont découverts par
la population locale et sont amenés au centre ou
récupérés par celui-ci. Ils vont alors être
nommés, soignés et dans la mesure du possible,
relâchés selon le processus de réhabilitation. Il
s'agit de paresseux à deux doigts (choloepus didactylus) et
à trois doigts (brasypus tridactylus), de cerfs à queue
blanche (odocoileus virginianus leucurus), d'ocelots (leopardus
pardalis), de margays (leopardus wiedii), d'agoutis
(dasyprocta), de collard-peccaries (pecari tajacu), de
différentes espèces de singes (hurleur, araignée et
capucin), de chevaux, d'écureuils, de ratons laveurs du Nord
(procyon lotor), d'opposums (caluromys derbianus), de grisons
(galictis vittata), d'armadillos (dasypus novemcinctus), de
kinkajous (potos flavus), de caïmans (caiman
crocodilus), diverses espèces de serpents, de crocodiles et de
lézards, et différentes espèces d'oiseaux dont des
toucans, des perroquets, des rapaces.
Par ailleurs, les humains y sont également nombreux.
Une dizaine d'individus sont salariés et forme une équipe
permanente, structurée et dirigée par Encar Vila Garcia (Annexe
2). Chacun d'eux ont un rôle défini et des tâches
quotidiennes précises. A ce nombre s'ajoute une trentaine
23
d'autres individus, les volontaires, qui intègrent le
JRC via un programme de volontariat-payant pour une durée
déterminée qui s'étend habituellement de un à six
mois. Ces derniers sont là pour aider les salariés, ils sont
polyvalents et suivent des directives quotidiennes diverses mais
répétitives. Ils ont un statut particulier dans la fondation, par
leur passage éphémère, leur caractère
interchangeable et l'apport financier qu'ils représentent, que je
tâcherai de questionner dans le troisième axe. A ces membres
s'additionnent alors les milliers de visiteurs se rendant au JRC chaque
année, attirés par la découverte de la faune locale.
b. Le Jaguar Rescue Center, un zoo nouveau ?
Si l'on s'attache à la définition que donne le
JRC de lui-même, il est décrit comme un centre de sauvegarde ou un
refuge pour les animaux menacés. Pourtant, les pratiques touristiques
qui y sont menées et l'exhibition quotidienne de certains
animaux6 au grand public (placés soit en captivité
dans des enclos soit en semi-liberté dans des parcs surveillés),
posent la question de son attachement aux pratiques habituelles
appliquées dans les zoos. En effet, la Ley de conservación de
la Vida Silvestre de 1992 (loi de conservation de la vie sylvestre en
français), stipule que tout centre de sauvegarde doit être
fermé au public, or ce n'est pas le cas du JRC, et, dès lors que
la structure détient des animaux et rend possible sa visite moyennant
une contribution financière, il est doté du statut de zoo (Annexe
3).
Cependant, les textes de la juridiction costaricaine ne
permettent pas de classer le Jaguar Rescue Center strictement dans la
catégorie de zoo, ou dans celle de centre de secours, dans la mesure
où ses pratiques concernent les deux parties (Annexe 3). Il
détient alors une position ambiguë, le faisant pencher dans l'un ou
dans l'autre selon l'opinion. Tout de même, il ne peut échapper au
statut de zoo, malgré ses efforts pour s'en extraire, tant les aspects
communs avec la définition donnée et la réalité du
site lui font écho.
Par ailleurs, si l'on accorde un regard aux conceptions
évolutionnistes, la conservation semble être devenue une mission
essentielle des parcs zoologiques de ce siècle, dont l'activité
ne se limite plus à l'exhibition (J-L. Berthier, 2020 ; Figure 8,
p.24).
6 Notons que les s animaux non-humains ne sont pas tous
livrés à une exhibition, malgré que cela ne concerne que
les animaux fragilisés pour lesquels une telle pratique aurait un effet
perturbateur direct sur leur bien-être ou sur leur réintroduction
future.

24
Figure 8: Regard évolutionniste sur les termes et les
fonctions donnés à ce que l'on nomme couramment zoo (source:
Encyclopedia Universalis)
Le Costa Rica ayant exigé la suppression des parcs
zoologiques publics en 2013, transformant ceux du territoire en jardin
botanique, l'existence même de ces lieux privés questionne les
logiques ontologiques auxquelles ils se rattachent. En effet, si la
frontière homme-animal est au coeur du dispositif des zoos (E. Leroy,
2018 ; J. Estebanez, J-F. Staszak, 2012), c'est la différence
d'intériorité présente dans l'ontologie naturaliste, dans
lequel s'inscrit l'Occident et l'Europe (Descola, 2005 ; C. Larrère,
2015), qui semble rendre possible l'émergence de ces lieux
(Ibid.).
Par leurs anciennes fonctions, les fondateurs du JRC sont
imprégnés de certains codes rappelant les institutions
zoologiques européennes (E. Leroy, 2018). Involontairement ou non, ils
semblent avoir exporté leur conception et leur manière d'agir
avec les animaux non-humains sur le territoire costaricain, ainsi que leurs
perspectives en matière de conservation de la faune et de la flore
(rappelant malheureusement certains traits issus du colonialisme). C'est sans
compter que la majeure partie des humains du collectif, salariés,
volontaires ou visiteurs, sont également d'origine européenne et
habitués à ces pratiques (Ibid.).
Le Jaguar Rescue Center, semble ainsi se construire entre le
zoo classique et « le centre de secours » [traduction personnelle du
terme centro de rescate, employé dans la juridiction]. Tout
de
25
même, il semble inverser la logique des zoos classiques
: plutôt que d'amener certaines espèces animales en Europe dans un
objectif d'exhibition, ce sont les européens qui se déplacent
dans leur environnement d'origine dans un objectif de sensibilisation.
c. Le collectif à La Ceiba
La Ceiba est nommée ainsi en hommage au très
vieil arbre ceiba pentandra (Annexe 4) y résidant, et
représente aujourd'hui une annexe au centre principal. Bien que le site
soit difficile d'accès et manque de réseau satellite, les humains
qui y résident sont en contact permanent avec la base centrale,
située à quelques kilomètres, et les mêmes logiques
structurelles s'appliquent.
Dans l'imaginaire du collectif, la parcelle de forêt est
décrie comme la « station de libération en forêt
primaire » [traduction personnelle]. Il s'agit, toujours selon les termes
du collectif, du site où le JRC relâche les animaux non-humains
qu'il accueille, mais aussi, selon le processus de réhabilitation
mis en place, d'un site de ré-habituation de ces derniers
à leur environnement d'origine, concept que je tâcherai
d'expliquer plus loin.
L'ayant évoqué plus tôt, il est inutile de
rappeler la diversité des espèces qui compose cet
écosystème forestier. Cependant, cette diversité vient
s'élargir avec l'arrivée du Jaguar Rescue Center. En effet, cette
implantation nouvelle implique une légère modification de son
écosystème, qui ne peut plus, dès lors, être
conçu sans les humains. Les aménagements structurants à
présent une partie de ces terres, comme évoqué plus
tôt, sont relatives aux activités du collectif et viennent combler
le besoin d'infrastructures pour la vie quotidienne et le passage des humains
(maisons, sentier dallé, restaurant, garage etc.) et des animaux
non-humains (enclos).
Les humains résidant quotidiennement à La Ceiba
sont peu nombreux et excèdent rarement dix individus. Ils se rattachent
tous au collectif du JRC et composent une population allogène au
territoire. Durant mon séjour, ils étaient sept : Auger,
d'origine catalane, et Ashley, d'origine anglaise et espagnole,
managers-employés assignés à la gestion de La Ceiba, une
famille du Panama (un couple et deux filles adolescentes que je n'ai
malheureusement pas eu l'occasion d'aborder) dont les parents étaient
également salariés, et une volontaire, Manuella, d'origine
catalane, engagée pour six mois au sein du collectif.
D'autres résidents se comptent parmi le collectif du
JRC à La Ceiba, à savoir, les animaux non-humains. Plus nombreux
que les êtres humains, ils étaient une vingtaine durant mon
séjour, comprenant des individus en semi-liberté ou en
captivité temporaire dans les enclos (cinq raton-
26
laveurs, quatre singes hurleurs, un écureuil et deux
ocelots), des individus en liberté (quatre perroquets verts), et
d'autres encore, résidant dans les enclos à des fins
d'élevage (une trentaine de rats). Hormis les rats, chaque individu se
voyait attribué un nom par les membres humains du collectif.
A ces résidents, s'ajoutent les volontaires de courte
durée, dont je faisais partie, et les visiteurs. Chaque semaine, un
nouveau groupe de volontaires (de deux à six personnes) étaient
conduits sur le site. Si j'ai choisi de rester trois semaines à La
Ceiba, la plupart d'entre nous ne restait que quelques jours, et leur
séjour dépassait rarement cinq nuits. Quant aux visiteurs, des
visites étaient organisées quotidiennement, ainsi que des
séjours longs, mais leur nombre était restreint à moins de
dix personnes. Le plus souvent, les visites concernait des groupes de deux
à quatre individus.
En définitive, c'est un large collectif d'êtres
humains allogènes et d'animaux non-humains qui s'est implanté au
coeur de ce territoire forestier. Le Jaguar Rescue Center semble alors
constituer un univers social qui lui est propre, invitant à repenser les
modes d'associations possibles entre les êtres.
27
III. CONSERVATION, ÉCOTOURISME, ET
RÉHABILITATION : VISIONS DE L'ESPACE FORESTIER
Le Jaguar Rescue Center ne s'est pas implanté à
La Ceiba par hasard. En tant que collectif, il mène des pratiques
singulières qui, à mesure du développement de sa structure
et de l'augmentation du nombre de ses membres, l'ont mené à
étendre son territoire sur ces terres forestières. Par leur
implantation sur le sol costaricain, les membres du JRC véhiculent une
ontologie intégrant une vision du monde forestier particulière,
qui semble se manifester à travers les pratiques sociales qu'ils mettent
en place.
Les premières observations de terrain m'ont permis de
faire émerger trois thématiques de recherche liées aux
pratiques menées par le collectif à La Ceiba, à savoir la
conservation, l'écotourisme et la réhabilitation. A travers
l'analyse anthropologique de ces thématiques, rendue compte notamment
par des éléments discursifs, je tâcherai de dégager
une problématique pertinente tournée vers la détermination
et la compréhension de la manière dont le Jaguar Rescue Center se
représente la forêt.
1. Les champs thématiques issus des premières
observations de terrain
La construction suivante des champs thématiques
liés à cette étude provient des premières
observations de terrain réalisées entre le 25 mars et le 14 avril
2019, et ont été complété par les données du
site internet du JRC. La pré-analyse de ces données sera
tournée vers des questionnements concernant les représentations
et les pratiques du collectif du JRC. Il s'agira alors d'essayer de cerner
anthropologiquement les phénomènes sociaux qui sous-tendent les
diverses représentations de la forêt.
a. La conservation de la forêt
Dans le langage courant, la conservation désigne «
l'acte de maintenir quelqu'un ou quelque chose hors de toute atteinte
destructrice, de s'efforcer de faire durer et de garder en bon état ou
dans
28
le même état [cet individu ou cette chose
]»7. Aujourd'hui, le terme revêt une approche
éminemment politique liée à l'émergence des
discours portant sur la situation environnementale contemporaine, largement
relayée par les sciences naturelles depuis les années 1980 (R.
Dumez, M. Roué, S. Bahuchet, 2014). La conservation est devenue un enjeu
majeur de l'époque, une solution face à l'extinction des
espèces animales et végétales, un moyen essentiel pour
lutter contre ce phénomène contemporain appelé «
crise environnementale ».
Or, les actions de conservation sont des comportements
exclusivement humains (C. Guilleux, 2018 ; Fox, 2006) et tirent leurs origines
d'une vision particulière que les collectifs portent sur le monde vivant
et sur l'environnement (C. Guilleux, 2018). Si l'humanité
préserve des territoires depuis deux milles ans (Ibid.), les
manières de faire et les raisons d'agir sont multiples, dépendent
des diverses manières de faire monde et sont historiquement
situées.
La stratégie la plus répandue menée par
les collectifs environnementalistes pour conserver un espace ou des
espèces se trouve être la délimitation de zones
particulières, intégralement protégées, dans
lesquelles on cherche à limiter la propagation de l'homme. Cette
stratégie provient de l'institutionnalisation du parc Yellowstone en
1872 (C. Guilleux, 2018) et du concept américain de wilderness
(W. Cronon, 2009 ; C. et R. Larrère, 2015), qui, relayant une vision
sacrée de la nature, propage l'idée de « sanctuaire
immaculé où l'on peut, pour quelque temps encore, rencontrer les
dernières brides d'une nature inaltérée, exempte de cette
souillure contagieuse de la civilisation » (W. Cronon, 2009, 6).
Le Jaguar Rescue Center a créé en 2018 La
Ceiba Primary Forest Foundation qui, selon leurs termes, contribue
à la « conservation de la nature sauvage dans la région sud
caraïbe du Costa Rica ». Celle-ci intègre un « programme
de protection de la forêt pluviale tropicale à travers
l'acquisition de territoires stratégiques » [traduction
personnelle]. Voici la manière dont le collectif relate les
événements qui ont poussé son fondateur à prendre
en charge la conservation de ce territoire :
« When our founder Sandro first visited the area,
researching reptiles and amphibians, he was was fortunate (for a herpetologist)
to cross paths with a Bushmaster snake (lachesis stenophrys). With a
conservation status of vulnerable it is the largest and one of the deadliest
vipers in the New World. He took this rare sighting as a divine sign that he
should try to preserve the land where he encountered the Bushmaster from any
future human development. »
7 D'après la définition du Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) publiée en 2012, url :
https://www.cnrtl.fr/definition/conserver
29
Si l'usage de l'expression « Nouveau Monde » n'est
pas sans rappeler le passé colonial et dénote une posture
largement ethnocentrique, parler de « signe divin » est
également surprenant. Selon les termes du collectif, le fondateur Sandro
aurait interprété sa rencontre avec une espèce
endémique de serpent, le lachesis stenophrys (Annexe 5), comme
un signe divinatoire lui confiant la mission de préserver les lieux.
Plus loin, le collectif poursuit :
« Sandro encouraged some environmentalist friends to
visit the area and they were so impressed with the beauty of the local nature
that they joined finances to buy another small piece of neighboring land. Our
only chance of protecting this land from potentially being sold to property
developers is to buy the leased areas ourselves. »
Ainsi, de cette rencontre jugée extraordinaire
découle une volonté d'appropriation du territoire dans l'optique
de le préserver de « tout futur développement humain »
et de « garder [sa] beauté » [traduction personnelle]. Or, ces
terres sont situées dans l'aire de conservation étatique du
Refuge National de Vie Sylvestre et disposaient déjà d'un
principe de conservation local.
Le Jaguar Rescue Center semble alors adopter une posture
salvatrice, se posant comme un acteur légitime de la conservation de ce
territoire costaricain. Ce témoignage pose une question éthique :
l'interprétation d'un signe divin suffit-il à justifier une
appropriation territoriale ? Et, par-delà, une question de
représentation sociale, le mythe d'une nature vierge, de la
wilderness aurait-il conditionné les pratiques de conservation du
JRC ?
En continuité de cette idée, La Ceiba est
fréquemment désignée comme une « réserve
naturelle » [traduction personnelle]. Cette appellation est proche de
l'idée de sanctuaire et fait référence à un lieu
à protéger, un territoire présentant un
intérêt exceptionnel sur le plan biologique ou esthétique,
qui doit être défendu à tout prix de toutes interventions
susceptibles de le dégrader, par des mesures de protection
particulières8. Le JRC semble construire le territoire de La
Ceiba de cette manière. Se posant comme le garant de son maintien en
état, il conçoit la forêt comme un lieu précieux,
méritant une intervention. Comment ce phénomène se
traduit-il en terme de relation humaine entretenue avec l'environnement ?
Par ailleurs, La Ceiba est également nommée
« forêt primaire » [traduction personnelle], selon les termes
suivants :
8 D'après les définitions du CNRTL et de l'INSEE,
publiées respectivement en 2012 et 2016.
30
« Primary forest is classified as an area where there
are no visible indications of human activity and therefore this mature and
untouched property is the ideal place to locally release many of the animals
that arrive at the JRC as it gives them the best chance of a clean and
naturally safe environment with little chance of interaction with humans in the
future. »
Si une forêt primaire est effectivement une
forêt qui ne semble pas avoir été affecté par
l'action humaine depuis deux ou trois siècles (P. Descola, 2014), cette
idée oublie que toute représentation donnée à la
nature est fondamentalement prise dans l'histoire sociale de la
société usant de cette image. Parler de forêt primaire
est une construction culturelle d'une réalité qui se veut
naturelle (W. Cronon, 2009 ; C. et R. Larrère, 2015). Elle
reflète l'idée de forêt originelle, non habitée, ce
qui s'avère être une réalité erronée dans la
mesure où « l'homme a probablement parcouru ou habité toutes
les forêts du monde » (A Schnitzler-Lenoble, 1996 p. 3).
De plus, La Ceiba, compte aujourd'hui de nombreux
aménagements qui ont nécessité un remaniement de l'espace
et, inévitablement, un défrichement d'une parcelle de ces terres
boisées. En ce sens, parler de forêt primaire est-il
toujours viable ?
Et si cette idée rejoint celle de forêt
vierge, de forêt naturelle et sauvage, voire
de jungle, fait-elle également écho au concept de
wilderness ? Par l'usage de cette terminologie, le JRC semble nier son
implantation sur le territoire, son influence sur le paysage et, dans le
même temps, paraît renforcer l'attractivité touristique de
La Ceiba en construisant un imaginaire particulier.
b. L'écotourisme, producteur d'images de la
forêt
Récemment, la société européenne a
vu naître diverses alternatives au tourisme de masse qui s'incarnent dans
les pratiques dites écotouristiques, dont l'objectif est de
restituer une éthique à l'image du tourisme (D. Valayer, 2002 ;
J. Hérault, 2013 ; Manço et Sarlet ; 2008). L'éco-tourisme
s'apparente à un tourisme de nature, et instaure des pratiques
d'observation de la faune et de la flore dans les zones
protégées, non perturbées par l'homme et qui offrent une
grande diversité biologique (J-M. Breton, 2004 ; Blangy, 1993).
L'émergence de cette pratique crée un nouvel imaginaire
porté sur la mystification d'une nature vierge et
immaculée, et se construit en parallèle de la
quête européenne pour une nature non anthropisée,
jugée inexistante sur le continent (C. et R. Larrère, 2015).
Comment expliquer l'émergence de cette nouvelle pratique touristique ?
Cette conception concorde-t-elle avec l'idée de la wilderness
?
31
Le Jaguar Rescue Center s'est emparé de cette forme
touristique afin de pérenniser son implantation et son activité
sur le territoire costaricain. Cette stratégie de financement est loin
d'être un tabou au sein du collectif : « when I see tourists, I
think about money » confiait la directrice d'exploitation Nerea
Irazabal aux volontaires. Peu de questions éthiques se posent, le
tourisme étant considéré comme une nécessité
absolue. D'ailleurs, une stratégie de responsabilisation dirigée
vers de potentiels visiteurs et donateurs prime au sein du JRC :
« Your donations and the income generated from tours
will enable us in the future to keep the beauty of La Ceiba Natural Reserve
available for future generations of animals and humans to enjoy. »
Le JRC offre trois opportunités d'écotourisme
à La Ceiba, à savoir les visites guidées, les
séjours en nuitée, et l'écovolontariat (que je nommerai
volontourisme). Si les visites guidées et les séjours en
nuitée sont des formes « classiques » de tourisme,
l'écovolontariat est une forme récente reposant sur la
participation active du voyageur qui va s'engager auprès de l'organisme
d'accueil pour mener une activité d'intérêt
général (C. Baillet, O. Berge, 2010). Dans le cadre des
programmes de volontariat offerts par le JRC, la contribution du voyageur est
triple : il s'implique à la fois par son travail, par son énergie
mais aussi par son financement (Ibid.). Ce triple engagement n'est pas
toujours bien vu par les volontaires ni par les managers. Manuela, une
volontaire long terme à La Ceiba, me signala son incompréhension
: « for me, it doesn't make any sense, I give my energy and my time, I
think it's enough », et Pablo, lui aussi volontaire depuis plusieurs
mois au JRC, me présenta son indignation à devoir payer pour
travailler à La Ceiba : « because we have to pay, fuck it !
»
Cette participation financière me pousse à
parler de volontourisme. En effet, si Manuela intègre le programme de
volontariat du JRC dans le cadre d'un stage pratique et Pablo par passion pour
les animaux non-humains, la majorité des volontaires y participe afin
d'expérimenter de nouvelles manières de voyager, de sortir de
leur quotidien et de se découvrir à travers la découverte
de nouveaux horizons. Alors, La Ceiba était bien souvent une
étape parmi d'autres du parcours touristique. Nanouk, une jeune suisse,
illustre parfaitement cette figure : voyageant depuis près de quatre
mois en Amérique Centrale, elle s'arrêta au JRC pour un mois, et
me confia être sur la route « to discover the world, meet poeple
and to find [herself] ».
Ainsi, le volontourisme reste fondamentalement une approche
touristique particulière, alternative certes, mais dont la valeur repose
essentiellement sur celle de l'expérience vécue
(Ibid.).
32
Les deux premières offres écotouristiques, les
visites guidées et les nuitées, sont présentées
comme des moments propices à la découverte de la faune et de la
flore et, cherchant à rendre ces pratiques et La Ceiba attractives, le
JRC renvoie des représentations particulières de la forêt
à ses visiteurs, créant un imaginaire touristique particulier.
La notion d'imaginaire touristique cristallise l'ensemble des
représentations se référant au lieu, aux
expériences attendues et aux pratiques qu'elles induisent, ainsi qu'aux
acteurs touristiques, à savoir la population réceptive et la
population émettrice (M. Garvari-Barbas, N. Graburn, 2012). Celles-ci
sont alimentées ou associées à des images
matérielles et immatérielles, telles qu'on les retrouve sur les
réseaux sociaux, le site officiel, les guides touristiques, les
souvenirs, les témoignages, les récits et les anecdotes
(Ibid.). En voici un exemple sous-tiré du site officiel,
concernant les visites guidées de nuit :
« The jungle truly comes alive at night, and on this
magical 2 hour hike led by a professional guide, you will see and hear
nocturnal animals that stay hidden during the day - an experience you won't get
anywhere else. You won't have to go far before you come across frogs, snakes,
opossums and more. The sights and sounds of the jungle at night will surely be
something you'll never forget! »
Dans cet extrait, le collectif utilise à plusieurs
reprises le terme de jungle et évoque le caractère
unique et inoubliable du lieu. Il joue sur l'imaginaire européen, qui,
fort marqué de la distinction entre le sauvage et le domestique (P.
Descola, 2005 ; C. et R. Larrère, 2015), se représente la
jungle comme une nature non apprivoisée et
authentique, qui n'a plus d'existence en soi sur les terres
européennes (C. et R. Larrère, 2015). La notion de jungle
est ainsi une idée, une manière de percevoir
l'écosystème forestier, qui ne décrit qu'une vision
ethnocentrique du monde et non une réalité objective.
Ce récit semble également contenir une notion
implicite, celle de l'exotisme. Situant La Ceiba dans le «
Nouveau Monde » [traduction personnelle], et pointant les espèces
endémiques y régnant, « grenouilles, serpents, opossums et
autres » [traduction personnelle], le JRC participe à la
construction de ce territoire comme un haut lieu de l'exotisme, un
ailleurs lointain, un inconnu fascinant. En effet, l'exotisme renvoie
à une conception asymétrique du monde, issu de la relation et de
la vision que l'Europe porte sur l'ailleurs, et bien souvent sur les pays dits
tropicaux tels que le Costa Rica (J. Estebanez, 2008). Naissante de
l'époque coloniale, cette notion est fort critiquable et
33
doit être manipulée avec soin. Tout de
même, l'exotisme a longtemps forgé notre rapport au monde
et il apparaît que son idée persiste dans l'imaginaire touristique
européen.
D'ailleurs, auprès des volontaires, l'imaginaire
véhiculé par le JRC n'est pas éloigné de
l'idée de jungle. Voici comment il présente La Ceiba
dans le cadre du volontariat :
« The work at La Ceiba is hard but incredibly
rewarding, giving animals another chance at living where they belong, the wild.
You will be working in an environment that is often very hot, humid and wet
with a variety of biting insects (including mosquitoes). The rainforest here
has a lot of wild animals (including venomous snakes and spiders, biting ants,
scorpions etc) so it is important that you are aware of this before committing
to volunteering at La Ceiba. »
La caractère sauvage de l'environnement est
mis en avant, diffusant un imaginaire de la forêt comme un environnement
inhospitalié composé d'espèces animales non-humaines dont
l'image inspire bien souvent la peur ou, plus rarement, la fascination (serpent
vénéneux, araignées, scorpions etc.).
Le JRC adopte ainsi une stratégie d'attractivité
touristique portée sur la valorisation de l'expérience de la
forêt et mystifie l'écosystème forestier en lui-même.
Il met en avant le caractère sauvage et exotique d'une
forêt qui n'a pas son pareil en Europe. Et si le regard que le JRC
cherche à transmettre aux visiteurs connote un imaginaire collectif
proprement européen, qu'en est-il de sa vision réelle de
l'écosystème forestier ?
Il est important d'ajouter que si l'imaginaire ainsi construit
par le JRC se veut attractif et propage des représentations
particulières de la forêt, il s'agit d'une stratégie
marketing visant à embellir la réalité pour la rendre
alléchante, bien que celle-ci repose sur un imaginaire
déjà constitué. Le tourisme à La Ceiba suscitait de
nombreuses controverses, et était souvent perçu comme une
obligation par ses acteurs directs, comme les managers s'improvisant guide
touristique. L'objectif du JRC était de récolter des financements
en affichant une image plaisante de la forêt, et non de coller à
la réalité effective de leurs représentations. Alors,
comment le JRC perçoit-il réellement la forêt ?
34
c. La réhabilitation à travers l'éthique
du care : une instrumentalisation de la forêt
Nous l'avons évoqué, pour le JRC, la Ceiba est
également une « station de relâche en forêt primaire
» [traduction personnelle]. Cette appellation est étroitement
corrélée à l'activité de réhabilitation des
animaux non-humains et réfère à ses deux dernières
étapes protocolaires, la ré-habituation au cadre de vie et la
libération dans l'environnement.
Afin de mieux cerner cet aspect, il est nécessaire de
discuter la notion de réhabilitation. A l'origine, elle désigne
un principe médical visant au rétablissement d'une personne
malade, blessée, ou handicapée afin de la rééduquer
et la réadapter à un mode de vie et d'activité le plus
proche possible de la « normale » (Kamen, 1972). Ce principe est
aujourd'hui appliqué aux animaux non-humains et est devenu une pratique
courante dans le cadre de la conservation et de la protection de ceux-ci, dans
lequel s'inscrit le Jaguar Rescue Center.
La réhabilitation est une conception et une pratique
particulière du soin, qui est, je crois, étroitement liée
à une éthique naissante dans la pensée philosophique et
pratique européenne, l'éthique du care. Celle-ci
suggère « une forme d'engagement [...] vers une autre que soi
», un soucis de l'autre qui, implicitement, conduit à entreprendre
une action de soin, par la saisie des besoins et des préoccupations de
cet autre (J. Tronto, 2009, pp. 142-146). Bien que discutable, la raison de
l'existence du Jaguar Rescue Center réside dans cette attention
portée à cet autre qu'est l'animal ; alors, les humains,
considérant la vulnérabilité des animaux non-humains, ont
mis en place le centre de secours que l'on connaît aujourd'hui.
Dans le cadre de sa pratique de réhabilitation, le JRC
cherche à rétablir un animal non-humain ayant subit une blessure
ou un mauvais traitement, dans l'objectif de le relâcher dans son
environnement d'origine. Pour ce faire, le collectif accorde une attention
sensible et quotidienne au sujet recevant les soins. Et si des protocoles
généraux se répètent, tous suscitent une adaptation
stricte à l'individualité de l'animal non-humain en raison
notamment de son histoire singulière et de ses traits
caractéristiques. Pour le JRC, la condition même de
l'efficacité de la réhabilitation réside dans la
rigoureuse considération des besoins de l'animal non-humain, principe
fondamental dans l'éthique du care. Ainsi, le collectif va
mettre en place des méthodes de réhabilitation
particulières pour les singes, différentes de celles
assignées au ratons-laveurs ou aux oiseaux et, dans la même
idée, va traiter différemment un animal non-humain recueilli
parce qu'il a été percuté par une voiture, s'il est
tombé d'un arbre ou s'il a subi une certaine maltraitance.
35
Par ailleurs, l'éthique du care intègre
l'idée de vulnérabilité comme une part constitutive du
vivant (J. Tronto, 2009) et renvoie des images et des représentations
particulières de l'agent recevant l'attention et le soin, et de l'agent
réalisant l'action de soin, qui s'engage et agit auprès du
premier. Ces images vont construire des logiques relationnelles
particulières, sur lesquelles se baseront le care
(Ibid.) et il semblerait que la réhabilitation suive
étroitement cette logique.
Dans le cadre de l'activité de réhabilitation
menée par le JRC, on constate un glissement des représentations
de l'être à réhabiliter, décrit premièrement
comme sauvage, vers un être dont il faut prendre soin, un
être fragile et fragilisé par des agents extérieurs, qu'il
faudra ensuite réensauvager dans la mesure du possible afin de
réussir sa relâche (E. Leroy, 2018). Alors, chaque phase
protocolaire renvoie des images spécifiques de l'animal et du rôle
que doit adopter l'agent réhabilitant. Cela va inévitablement
instaurer des relations singulières entre l'humain et l'animal
non-humain, dépendantes des agents inclus dans celle-ci.
Par exemple, lorsque le JRC réalise une transfiguration
de l'état de sauvage de l'animal vers un état de
vulnérabilité nécessitant son intervention (phase
correspondant à celle où ses membres interviennent auprès
de l'animal et vont lui apporter des soins), un processus d'accoutumance entre
l'humain et l'animal non-humain va être instauré, qui glisse
parfois vers une domestication involontaire rendant la relâche
impossible. Autrement dit, l'image de la vulnérabilité de
l'animal non-humain va susciter une réaction humaine qui prend forme
à travers la figure du soigneur et du protecteur. Cette figuration
conduit à instaurer une relation dans laquelle l'animal non-humain va
s'habituer à l'humain, et dans laquelle l'humain va essayer de nouer une
relation de proximité avec l'animal non-humain.
Les illustrations de ce phénomène sont
nombreuses à La Ceiba. La plus flagrante est l'histoire de Mimi, un
amazone à lores rouges (aumazona autumnalis ; Annexe 7), qui a
été sauvé par la manageuse Ashley. Depuis, malgré
qu'il soit libre de ses mouvements et toutes les tentatives d'Ashley pour le
repousser, il ne quitte plus le périmètre du camping
site, et entretient une étroite relation avec elle, si bien qu'il
chante dès qu'il l'aperçoit, essaie de se poser sur ses
épaules et la suit.
Cependant, cette accoutumance n'est pas toujours possible. A
l'autre extrême, Pocahontas, une femelle raton-laveur s'est
retrouvée grièvement blessée au cou. Le collectif a pu
l'attraper à l'aide d'une poubelle lorsqu'elle s'est infiltrée
dans la maison touristique de La Ceiba ; alors, emmenée au centre pour
recevoir des soins, son état de stress était tel qu'elle accoucha
de deux morts nés et mangea les deux autres. Agressive, personne ne
pouvait accéder à son enclos sans se faire attaquer et
jusqu'à sa relâche, jamais elle ne s'est accoutumée
à la présence humaine.
36
Si ces exemples sont deux extrêmes, ils illustrent la
variabilité des relations entre humains et animaux non-humains
instaurées par le JRC, à travers sa pratique de soin par laquelle
l'animal non-humain est perçu comme un sujet politique agissant
indépendamment de la volonté humaine9. Pour aller plus
loin, ils mettent en évidence le rôle de la réhabilitation
dans le renvoie d'images et de représentations de l'être à
réhabiliter et de l'acteur de la cette pratique. Ainsi, le Jaguar Rescue
Center semble construire le réel de son activité sur la base
relationnelle qu'il instaure entre l'homme et l'animal par son activité
de soin.
Ces questionnements mériteraient une profonde
réflexion anthropologique, mais s'ils ne sont pas à proprement
parler le sujet de cette étude, ils permettent de comprendre
l'idée de « station de relâche en forêt primaire »
[traduction personnelle].
Par cette appellation, le JRC semble accorder une dimension
fonctionnelle à La Ceiba. Dorénavant, elle n'est plus le
territoire à conserver ou une terre rentable, décrit par sa
beauté ou par son caractère mystique, mais devient un lieu
idéal de réhabilitation des animaux non-humains du collectif.
Dans le cadre de la réhabilitation voici comment le collectif
évoque la forêt :
« After being rehabilitated of their injuries, or
when baby orphans have grown to an age of independence, we can take animals
from the JRC to the La Ceiba Release Station and either release them
immediately, or temporarily house them deep in the property in one of our
prerelease enclosures so that they can acclimatise to the smells and sounds of
the forest at their own peace. The diverse range of flora at La Ceiba also
naturally provides approximately 90% of the food required by the animals prior
to their release. »
La forêt prend alors une place secondaire dans le
discours dont la focale est tournée vers l'activité de
réhabilitation des animaux non-humains. Elle est perçue à
travers cette pratique, comme l'environnement idéal pour préparer
et réaliser la relâche. Ainsi, le JRC semble attribuer un
rôle à la forêt, lui donner une utilité sociale dans
le cadre de son activité. Ce n'est pas uniquement un
écosystème qu'il faut conserver, c'est un territoire rendu utile.
En ce sens, le collectif instrumentalise la forêt pour mener à
bien ses pratiques.
9 Pour reprendre les termes de Philippe Descola, « De la
nature universelle aux natures singulières : quelles leçons pour
l'analyse des cultures ? », dans P. Descola (dir.) « Les natures en
question », Collège de France, Odile Jacob, 2017,
pp. 121-155
37
Par ailleurs, l'éthique du care,
révélée dans l'analyse de la notion de
réhabilitation, ouvre de nouvelles perspectives quant aux
fondements de la prise en charge de la conservation de La Ceiba : cette
éthique peut-elle nous donner des éléments de
réflexion concernant les fondements de cette prise en charge
particulière de la forêt ?
Selon Berenice Fischer et Joan Tronto, le care est
« une activité générique qui comprend tout ce que
nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer « notre
monde », de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce
monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les
éléments que nous cherchons à relier en un réseau
complexe, en soutien à la vie »10. Le care
ainsi décrit ne se limiterait pas seulement aux autres humains et
animaux non-humains mais aussi à des objets de l'environnement et
s'associerait, par exemple, avec l'éthique environnementale (J. Tronto,
2009, p. 144).
Alors, existerait-il une corrélation entre
l'éthique du care et la pratique de conservation de La Ceiba ?
Les méthodes de préservation de l'écosystème
forestier mises en place par le JRC prennent-elles leur source dans cette
éthique ?
2. Émergence et formulation de la
problématique
La pré-analyse des discours et des pratiques du JRC,
réalisée à travers ces trois champs thématiques,
permet de révéler une certaine pluralité des visions de
l'écosystème forestier. A la fois, présenté comme
un lieu touristique, un territoire à conserver et un site de
réhabilitation, l'approche multidimensionnelle de La Ceiba insinue une
pluralité des conceptions de cet écosystème particulier.
Mais, dans leurs fondements, ces visions de la forêt expriment-elle
réellement une pluralité de perception, ou sont-elles des reflets
issus d'une même manière de construire le monde forestier ? Alors,
sont-elles des manifestations plurielles qui tirent leurs origines et se
fondent dans une ontologie particulière ?
Certains phénomènes ne se lisent pas dans les
concepts d'écotourisme et de réhabilitation, et ne sont que
partiellement effleurés dans celui de conservation, il s'agit de la
sacralisation des arbres et de l'attribution d'une conscience à la
forêt et aux non-humains végétaux. Au détour de
diverses discussions informelles, j'ai pu constater que certains humains
entretenaient des relations avec les arbres et la forêt qui
dépassaient l'objectivation du non-humain végétal.
10 Dans « Toward a feminist theory of care », E. Abel
et M. Nelson (dir.), « Circles of Care : Work and Indentity in Women's
lives, State University of New York Press, Albany, NY, 1991, p. 40
38
En effet, avec une touriste venue rendre visite à
Manuela, nous discutions de Julie, une volontaire française qui,
après avoir hésité longtemps à se rendre
au-delà de la colline pour s'enfoncer dans la forêt, a
glissé dans la boue et s'est heurtée le dos à
l'entrée même de celle-ci. Cet événement lui imposa
un retour au camping site et elle me confia tristement « j'ai
l'impression de rater mon aventure » (en langue originale). Cette touriste
me dit alors « La Ceiba doesn't accept everyone ». Que
voulait-elle dire par là ? Accordait-elle une conscience propre à
la forêt ?
Par ailleurs, au sein de La Ceiba, il existe une règle
taboue, dictée par la fondatrice : l'interdiction de s'approcher d'un
arbre ceiba pentandra, en raison de sa « perte d'énergie
» [traduction personnelle]. L'arbre en question a cinq cent ans et est
considéré comme l'« arbre mère » de la
forêt [traduction personnelle]. Que signifie cet interdit ?
Ces multiples réflexions et questionnements m'ont
poussé à émettre l'hypothèse d'un potentiel
changement de paradigme dans l'imaginaire de certains collectifs
européens envers l'écosystème forestier. Dans les logiques
instaurées par le JRC, il semblerait qu'il existe une ambivalence de
perception, me menant à l'hypothèse d'une remise en question du
dualisme objet/sujet, fort représentatif des perceptions de la
nature dans l'imaginaire européen (P. Descola, 2005 ; C.
Larrère, 2015)
Alors, l'objet de cette étude se fondera sur une
analyse des représentations sociales qui sous-tendent les discours et
les pratiques du Jaguar Rescue Center, et qui sont corrélés
directement ou indirectement à ce que l'on nomme forêt. Cette
idée inclut une réflexion sur notre propre culture
européenne, qui, et ceci constituera un postulat nécessaire
à la progression de cette analyse, se rattache à celle de la
culture dominante représentée par l'Europe.
Ainsi, à partir de quelles bases conceptuelles le
collectif du Jaguar Rescue Center compose-t-il sa relation avec
l'écosystème forestier de La Ceiba et quelle vision du monde
végétal en découle ?
Afin d'appréhender cette problématique,
j'essaierai de suivre la méthode prescrite par Philippe Descola,
cherchant à déterminer les origines des collectifs à
travers une analyse sociale remontant jusqu'aux modalités
premières de l'identification du monde qu'ils entreprennent (P. Descola,
2017). Bien que déjà évoquée, cette méthode
est rendue possible par un détour ontologique qui tend à
comprendre comment les collectifs singuliers s'instaurent, plutôt que de
les considérer comme des réalités déjà
constituées (Ibid.). C'est ce regard que je souhaite porter sur
le collectif du JRC, afin de mieux cerner les manières par lesquelles il
s'instaure dans le monde et se construit.
39
Et si aux premiers abords, le collectif du Jaguar Rescue
Center paraît être en marge culturelle à l'égard de
ce que l'on nomme ontologie européenne, je crois pourtant qu'il n'en est
rien, et que la représentation du monde qu'il véhicule manifeste
un léger changement de paradigme expérimenté plus
largement dans nos sociétés dites « modernes », rendu
inévitable sous la pression des menaces environnementales. Mais ceci
reste une supposition que cette étude a pour but d'éclaircir.
40
IV. AU PLUS PRÈS DU
TERRAIN
Afin de cerner les fondements de ce travail
énoncé précédemment, il est nécessaire de
revenir aux processus d'acquisition des données et de rendre compte de
l'entrée sur le terrain, de la posture que j'ai choisi d'adopter et de
la méthodologie que j'ai appliqué dans le cadre de
l'enquête ethnographique et de la rédaction.
Si le terrain est au coeur du travail de l'ethnologue (J.P.
Olivier de Sardan, 1994, p71), au sein du collectif, j'étais reconnue
à travers le statut de volontaire, un statut permettant d'être
admis au JRC pour un temps déterminé. Cette attribution m'a
imposé une certaine posture, des codes de conduite et des règles
qui ont nécessité une adaptation de la méthodologie
d'enquête ethnographique impliquant des biais d'étude non
négligeables.
1. Accès au terrain
a. Démarches et prise de contact
J'ai choisi d'effectuer mon enquête auprès du
Jaguar Rescue Center car il complétait trois conditions qui
m'étaient alors fondamentales, à savoir le lieu,
l'opportunité de stage et la nature de leur activité. En effet,
si le dépaysement permet d'engager un changement de regard sur la
culture d'origine (F. Laplantine, 2010, p. 13), j'aspirais à me rendre
en Amérique Centrale, après la déception d'un projet
d'étude avorté en Honduras. Je souhaitais également
réaliser mon terrain et mon stage auprès du même collectif
par un soucis d'implication, pensant que le stage serait une porte
d'entrée idéal sur le terrain. Aussi, l'étude des rapports
entre humains et non-humains me paraissait tout à fait
intéressante, et pertinente en vue des troubles que ces rapports
suscitent dans notre culture européenne contemporaine.
J'ai contacté le Jaguar Rescue Center par mail (Annexe
9) en décembre 2018 afin d'effectuer un stage en mars 2019. Par soucis
de transparence, je leur ai transmis mes motivations universitaires et mon
projet d'enquête. Celui-ci n'a pas suscité de commentaires, et la
réponse que je reçu de Tamara, la responsable administrative,
évoquait uniquement les démarches à suivre pour
intégrer le collectif. Il s'agissait de remplir et de leur soumettre un
formulaire d'inscription
41
téléchargeable sur le site du JRC (Annexe 8) et
une attestation de vaccination contre la tuberculose, puis de verser une partie
de la participation demandée d'un total de 350 dollars11.
Une fois ces démarches complétées, Tamara
valida mon stage du 4 mars au 1 avril 2019 et m'indiqua que ma tutrice serait
Nerea Irazabal. Je n'avais alors que très peu d'information.
Jusqu'à mon arrivée, je ne doutais pas de la
nature de mon stage, malgré le versement financier. Pourtant, ne
m'étant pas en place de dispositif dans le cadre de stage, le collectif
m'avait affilié au statut de volontaire court-terme, fait que je ne
compris que le premier jour. Je n'étais pas seule dans ce cas, d'autres
stagiaires venus exercer leur pratique en lien avec leurs études
s'étaient confronté à cette déconvenue.
Ce programme de volontourisme, le 4-week volunteer
program, consiste à effectuer un séjour de trois semaines au
centre du JRC et de passer la dernière semaine à La Ceiba. Les
rôles alors attribués aux individus sont l'assistance dans la
prise en charge des animaux non-humains et l'entretien des sites. Ces
rôles se limitaient à des tâches simples nécessitant
guère un savoir-faire particulier bien qu'une certaine rigueur. Ainsi,
nous assistions les membres permanents et les salariés dans leur
tâche et étions polyvalents.
b. Payer sa place
L'accès à La Ceiba et l'intégration au
collectif du JRC m'a été possible par la transmission d'un apport
financier. Par ce biais, je me suis inconsciemment inscrite dans les logiques
fonctionnelles du collectif, mais aussi dans ses logiques structurelles, en
recevant un statut précis faisant sens pour ses membres. L'attribution
du statut de volontaire m'a inséré dans le réseau
relationnel du JRC et m'a désigné une place qui, en tant
qu'apprentie anthropologue, m'a imposé l'acceptation de certaines
règles (F. Fogel, I. Rivoal, 2009).
Dans les logiques structurelles du JRC, le volontaire a un
statut particulier et des images lui sont rattachées. Le plus souvent
son passage est éphémère, ne restant que pour la
durée de son séjour ; il a un caractère interchangeable,
dans le sens où les volontaires constituent une équipe dont les
membres diffèrent chaque semaine et sont peu formés. Et si les
tâches confiées aux volontaires sont identiques chaque jour, les
individus à leur charge change continuellement. D'une certaine
11 Cette somme est une participation financière fixe
demandée à chaque nouveau volontaire, peu importe la durée
du volontourisme et le nombre de fois qu'il revient au centre (E. Leroy, 2018).
Elle ne comprend pas les frais d'hébergement, de transport et de
premières nécessités. A La Ceiba, la logique
financière est quelque peu différente dans la mesure où le
travail volontaire et l'isolement du site impose de loger sur place. Ainsi,
chaque mois coûte 300 dollars aux volontaires, à savoir 75 dollars
par semaine.
42
manière peu importe quel individu rempli la mission,
tant que celle-ci est menée à bien. De plus, l'usage du
volontourisme comporte un intérêt financier non négligeable
pour le collectif du JRC, sans compter l'apport d'une main d'oeuvre gratuite,
lui permettant de pérenniser son activité d'un point de vue
économique.
En tant que volontaire, j'ai facilement intégré
l'espace d'observation par une implication continue sur le terrain. Ce statut
m'a permis d'être reçue et d'être perçue par les
membres du collectif, qui m'ont alors donné un rôle dans la
structure et des tâches à accomplir. Et si « l'ethnographe
est celui qui doit être capable de vivre en lui la tendance principale de
la culture qu'il étudie » (F. Laplantine, 2010, p. 22),
intégrer le JRC par le biais du volontourisme m'a offert la
possibilité de m'y immerger, d'intégrer rapidement les codes de
conduite appropriés et d'adopter les us adéquats.
Le statut de volontaire m'a cependant imposé une
certaine marge d'action ethnographique. En terme de hiérarchie, le
volontaire se situe en bas de l'échelle (Annexe 2), ce qui rend
difficile la création d'un lien autre que professionnel avec les
managers, les salariés, et plus encore avec la fondatrice. En effet,
l'image projetée du passage momentané du volontaire a pour
conséquence une certaine prise de distance par les membres permanents du
collectif, qui peut être évincée par un séjour plus
long.
De plus, si le genre impacte l'expérience de
l'ethnographe (M. Blondet, 2008), j'ai pu constater sur le terrain une
différence de perception de la femme et de l'homme, notamment dans la
distribution des tâches à accomplir. Cependant, cela s'explique
par un soucis d'efficacité, pour des missions nécessitant une
grande force physique par exemple, et n'a jamais entravé le processus
d'acquisition des données.
Ainsi, le statut de volontaire m'a donné une certaine
marge d'action mais m'a aussi assigné à des codes de conduite
particuliers. A partir de ces éléments, une posture d'observation
s'est imposé à moi, celle de la participation
observante.
43
2. Méthodologie appliquée sur le terrain
a. La participation observante et ses biais
Étant un territoire privé, l'accès
à La Ceiba reste sous la supervision du JRC et n'est pas accessible
à tous. Le seul moyen de dépasser le portail (Figure 6, p. 20)
qui symbolise la frontière de ce milieu végétal singulier,
est d'intégrer le collectif par le biais d'une participation active,
comme volontaire ou salarié, ou en tant que visiteur ponctuel. Cette
condition impose au chercheur de se positionner au-delà du « simple
» observateur en « prenant part et [en occupant] une fonction
déterminée dans ce qui est l'objet de l'observation » (C.
Makaremi, 2008, 4).
Si la participation observante est un terme
alternatif à celui d'observation participante (S. Bastien,
2007), il me paraît plus propice pour exprimer la méthode
d'enquête adoptée. En effet, mon implication dans les
activités du JRC surplombait bien souvent l'observation, en raison de
l'engagement que j'avais pris auprès des humains et des animaux
non-humains du collectif.
En tant que volontaire, je me suis engagée
auprès du collectif avant même d'avoir accès au terrain. Je
n'étais pas seulement présente pour effectuer une enquête
ethnographique mais également pour participer activement à
l'activité du JRC, c'est d'ailleurs comme cela que j'étais
perçue. Dans la même idée, une forme moins consciente
d'engagement persistait dans mes activités quotidiennes. Il s'agissait
de l'engagement indirect pris envers les animaux non-humains du collectif,
lié à l'activité de soin qui leur était
apportée.
De ce double engagement a découlé une posture de
participatrice qui observe, pour reprendre les termes de Jean-Pierre Olivier de
Sardan (D. Lavigne, 2018). Cela nécessite d'apprendre à «
gérer les risques de la subjectivation » (S. Bastien, 2007, p. 129
; Favret-Saada, 1977). A ce propos, il me semble m'être laissée
happer par le terrain, si bien qu'il me manquait parfois le temps de noter mes
observations dans mon carnet. C'est un biais dont je n'avais pas conscience en
adoptant cette méthode d'observation mais que je souhaite
résoudre en optant pour une posture d'observation participante
périphérique (Ibid., p. 129 ; P. A. Adler, P.
Adler, 1987) dans mes projets futurs, si le terrain le permet.
Par ailleurs, François Laplantine rappelle que «
nous ne sommes jamais des témoins objectifs observant des sujets, mais
des sujets observant d'autres sujets au sein d'une expérience
44
dans laquelle l'observateur est lui-même observé
» (F. Laplantine, 2010, p. 23). C'est d'autant plus vrai dans le contexte
d'une participation observante au sein du JRC. En tant que volontaire,
ma participation dans les activités du JRC à La Ceiba impliquait
un regard attentif des membres permanents du collectif, et notamment des
managers. Rien n'était fait sans qu'ils en soient avertis a priori ou a
posteriori.
En tant que membres salariés et permanents du
collectif, ils avaient la position légitime pour juger du
caractère profitable de la présence des volontaires à La
Ceiba. Les activités sur place nécessitaient une rigueur stricte
et un don de soi exigeant ; « mal » effectuer les tâches
entraînait une réprimande voir un parfait rejet, comme ce
fût le cas pour un volontaire ayant un comportement jugé
inapproprié avec les animaux non-humains du collectif. Ashley mit tout
en oeuvre pour avancer la date de son départ : « I'm gonna make
him leave on wednesday » me confia-t-elle lors d'une conversation
à son sujet. Je dois avouer avoir moi-même développé
une certaine animosité envers ce volontaire, me faisant omettre de
récolter des données à son sujet, alors qu'il aurait
été un informateur fort pertinent pour ce sujet
d'étude.
Le souci de ces regards a contribué à me faire
évoluer dans ce biais méthodologique. Plus je m'impliquais, plus
on m'apportait une certaine attention et m'intégrait au sein des membres
permanents du collectif. C'est d'ailleurs par ce moyen que j'ai pu nouer des
relations autres que professionnelles avec les membres humains et
accéder à certaines informations tabous, notamment sur la
présence de l'arbre ceiba pentandra.
b. Le choix des informateurs et les conversations
informelles
Me positionnant comme un membre du collectif, plus que comme
une observatrice extérieure, j'ai constaté après coup une
certaine ambiguïté de la méthode ethnographique
adoptée quant aux relations entretenues avec mes interlocuteurs et
à la mise en place d'entretiens.
En effet, être perçue comme volontaire a
engendré des barrières invisibles m'empêchant
d'accéder à certaines sphères du JRC. La hiérarchie
étant effective au sein du collectif, je n'avais pas la position
légitime pour engager une discussion avec les visiteurs ou avec les
acteurs décisionnaires dont Encar, ce qui limita mon champ d'action
ethnographique aux volontaires et aux managers.
De plus, mon implication sur le terrain limitait un
détachement et une prise de recul, et seuls les informateurs avec
lesquels je développais une affinité étaient avertis de
mon travail
45
ethnographique (bien que j'avais renseigné le collectif
au préalable, mais l'information n'avait pas été retenue
ni transmise). Ce phénomène est rendu visible dans l'acquisition
des données récoltées directement sur le terrain et me
plongea dans un biais méthodologique limitant ma considération
des autres individus comme informateurs.
A ce propos, le carnet de terrain a
régulièrement fait un travail de médiateur entre mon
statut d'apprentie anthropologue et mes interlocuteurs, dans la mesure
où son utilisation régulière et visible suscitait un
questionnement engageant une discussion sur les raisons de ma venue. Les
réactions étaient multiples, allant de la simple ignorance,
jusqu'à une envie sincère de prendre part à
l'enquête, en passant par une méfiance visible12. Elles
ont aiguillé mes choix d'interlocuteurs mais m'ont indirectement
conduite à m'inscrire dans « le principe de l'« informateur
privilégié » » (J.P. Olivier de Sardan, 2003, p. 36),
impliquant un biais d'invisibilisation de certains acteurs du terrain
ethnographique. La triangulation m'a tout de même permis de croiser les
regards, et de construire les hypothèses d'étude de ce travail,
mais n'a pas été « complexe » (Ibid., pp.
43-44) n'intégrant que cinq interlocuteurs réguliers.
Par ailleurs, si le temps passé à
m'intégrer dans le collectif a fait défaut à l'exercice
d'entretien formel, il a contribué à élargir les
possibilités d'avoir des conversations informelles avec les acteurs du
JRC. Cette méthode d'acquisition de données permet
d'éviter le caractère imposé des entretiens et le biais
lié au manque de spontanéité de la situation ainsi
construite (J. P. Olivier de Sardan, 1995). Suivre la conversation banale et
l'amener vers une conversation semi-directive permet d'atteindre « une
réelle liberté de propos » (Ibid., 32). Cependant,
cette méthode nécessite une improvisation et une adaptation
constante du discours, et impose une longue imprégnation sur le terrain
afin de connaître le mode de communication approprié du collectif
(Ibid., 32 ; 2003, pp. 30-31). Dans le cadre de ce travail, qui s'est
effectué sur un temps relativement court13, elles ont suffit
à construire les premières hypothèses liées
à l'objet d'étude, mais devront être
complétées par la mise en place d'entretiens formels afin d'en
approfondir les questionnements.
12 Lorsque j'expliquais à l'un des volontaires en quoi
consistait mon carnet et pour quelles raisons je le complétais
quotidiennement, il me dit « Tu nous étudies en fait. » (en
langue originale) ce qui dénotait une certaine méfiance et a
limité nos interactions par la suite. Tandis qu'à l'autre
extrême, l'un des volontaires a voulu s'impliquer dans ce projet
d'étude avec un grand enthousiasme et m'indiqua être tout à
fait disponible si j'avais besoin d'informations.
13 J'ai intégré le collectif du JRC le 4 mars
2019 mais le temps d'immersion à La Ceiba s'est établi du 25 mars
au 14 avril 2019, soit 21 jours et 20 nuits. Un temps que j'estime suffisant
pour l'imprégnation avec le terrain, mais insuffisant pour entrer dans
le vif de l'enquête.
46
c. Biais méthodologiques liés au sujet de
l'étude
Dans la mesure où cette étude a pour projet de
rendre compte des représentations des membres humains du JRC concernant
l'écosystème forestier La Ceiba, il est important
d'évoquer les biais existants à travers cette notion de
représentation.
Étudier les représentations peut conduire
à un biais et donner « l'illusion ontologique de l'unité, de
l'identité, de la stabilité et de la permanence de sens »
(F. Laplantine, 2010, p. 37). Or, au sein d'un même collectif,
l'enquêteur est amené à faire face à une
multiplicité de représentations car celles-ci diffèrent
selon l'informateur ( (J.P. Olivier de Sardan, 2003, p.44). En ce sens, et dans
la mesure où l'humain est doté d'une grande subjectivité,
son discours l'est aussi et ne peut être présenté comme
« [le reflet] d'une culture » (Ibid., p. 50). Alors, porter
une analyse des représentations en se basant uniquement sur des
éléments discursifs implique un biais d'étude non
négligeable. L'étude des pratiques sociales vient contrebalancer
ce biais, mais il s'agit toujours d'« une description des principales
représentations que les principaux groupes d'acteurs locaux se font
» (Ibid., p. 51) et non la lecture de
généralités présentes par-delà le collectif
concerné. Si cette étude a pour ambition de s'étendre
à d'autres collectifs, il sera important de voir d'autres configurations
méthodologiques (Ibid., p. 51).
Par ailleurs, l'étude des représentations rendue
compte dans le travail rédactionnel est un « discours produit sur
le discours » (E. Leroy, 2018, p. 38), en ce sens où elle est le
produit de l'interprétation subjective du chercheur. En effet ce dernier
appréhende la réalité sociale du terrain et construit un
récit à partir des données saisies, si bien que si elle
existe « hors de lui [...] elle n'a aucun sens indépendamment de
lui » (F. Laplantine, 2010, p. 39).
Il est important de noter que toute étude
ethnographique s'inscrit toujours dans un temps donné et s'effectue
auprès d'un univers social particulier en évolution constante. En
ce sens, si un propos anthropologique peut être une vérité
scientifiquement viable à un moment précis et pour un collectif
donné, il peut être tout à fait confus et faussé
pris dans un autre instant et dans un autre collectif.
47
3. Choix rédactionnels
a. L'emploi du « je »
méthodologique
Si cette note d'avancement est un écrit dont l'un des
objectifs est de cristalliser les données de l'observation sur le
terrain, la littérature grise et la littérature savante, c'est
également une manière de dire ce qui a été
perçu à l'issu de cette expérience en mettant en jeu
« les qualités d'observation, de sensibilité, d'intelligence
et d'imagination scientifique du chercheur. » (F. Laplantine, 2010, p.
10). Si je ne me considère pas comme chercheuse mais bien comme
apprentie, je pense tout de même que ce travail s'apparente à une
écriture du voir, pour reprendre les termes de François
Laplantine, qui implique ma seule subjectivité.
La tradition anthropologique suggère un effacement
total du narrateur dans la rédaction mais l'idée que « le
texte ethnographique [...] résulte d'une expérience subjective
» (C. Ghasarian, 1997, p. 193) et l'usage du « je »
méthodologique sont de plus en plus assumés au sein de la
communauté scientifique, qui exerce un certain rejet du positivisme en
faveur d'une posture plus critique (J.P. Olivier de Sardan, 2000, p. 422).
J'ai alors choisi d'employer le « je » afin de
mettre en avant mon « rôle méthodologique » pris dans la
production des données à la fois sur le terrain et en dehors
(Ibid., p.425) mais aussi afin d'inscrire ma parole dans cette
enquête, et non celle d'un autre qui se donnerait à voir à
travers les figures du « on » indéfini, ou du « «
nous » professionnel » (F. Laplantine, 2010, p. 48). Et si j'ai
manqué à maintes reprises de faire usage de ce dernier pronom,
notamment pour m'intégrer dans le groupe social formé par les
volontaires ou dans les membres humains du JRC en général, je ne
pense pas qu'en tant qu'étudiante, je sois dans une position
légitime pour le faire. De plus, cela impliquerait de parler en leur nom
et induirait un autre biais.
b. Un état de l'art parsemé
Les consignes pour cette note d'avancement suggéraient
de construire un état de l'art dans une partie unique ; or, par soucis
d'argumentation, celui-ci est étalé tout au long de
l'écrit. En effet, mon argumentaire s'est construit au fur et à
mesure des lectures savantes que j'abordais et qui étaient
croisées directement à la littérature grise et aux
données récoltées sur terrain. De cette
48
manière, plutôt que d'élaborer un
état de l'art en un bloc théorique et bibliographique, j'ai
construit un état de l'art parsemé, rendant compte du fil de ma
pensée argumentative.
Je tiens à préciser que la littérature
grise a été abordée avant d'entrée sur le terrain,
pendant, mais aussi après, tandis que les lectures savantes, même
celles concernant les savoirs méthodologiques, ont suivi la
première expérience de terrain et ont par ailleurs
découlé de celle-ci.
49
CONCLUSION
Autrefois brillante d'un humanisme hégémonique
anthropocentré, la réalité européenne semble
aujourd'hui bouleversée dans ces fondements. La prolifération des
discours sur le déclin du monde non-humain végétal et
animal, l'incertitude de la pérennité humaine et la diffusion des
réalités issues de l'ailleurs, remettent en question les
pensées communément admises et enclenche les prémisses
d'une reconsidération des visions du monde.
Si l'européen a sans cesse questionné l'assise
de ses relations avec les non-humains, il subit aujourd'hui les effets
négatifs de ses modes de vie qui déséquilibrent l'harmonie
du vivant tel qu'il le concevait jusqu'alors. Notre époque est tant
troublée par les enjeux écologiques que la communauté
scientifique instaure consensuellement une nouvelle ère,
l'Anthropocène. Et si cette ère s'inscrit dans un
anthropocentrisme extrême, s'alignant sur l'humanisme métaphysique
fort de la pensée européenne, elle n'omet pas moins de placer
l'individu face à sa responsabilité. Tout de même, et que
l'on y adhère ou non, il s'agit bien là d'une vision
particulière du monde ne remettant que très peu en cause la
frontière ontologique entre les humains et les non-humains. Elle ne
reconsidère pas la place de l'homme, bien ancrée dans la
conscience collective européenne, mais nous dit plutôt que ce
« maître du monde » se doit de prendre soin de la nature
pour vivre dans l'abondance et la tranquillité.
Malgré cela, l'instauration de cette idée tend
à bouleverser les comportements et les manières de vivre. Les
européens voient l'environnement changer à grande vitesse si bien
que l'ampleur des conséquences démontrées scientifiquement
dépasse leur entendement. La grande solution présentée
dans l'imaginaire collectif est d'agir, et ce, dans une idée flatteuse
feignant l'héroïsme : « agir pour sauver notre Planète
». Si certains choisissent le scepticisme, ceux qui ont
intéressé notre étude ont choisi l'action ; leurs actions
viennent-elles transcender les visions européennes
préétablies sur le monde végétal ? Alors, si cette
hypothèse se vérifie, comment la forêt traverse-t-elle les
hommes ?
Malheureusement, cette note d'avancement n'aura pas la
possibilité d'aboutir sur un mémoire approfondi, pour des raisons
financières et pour des conditions d'accès au terrain
d'enquête restreintes. Cependant, j'espère pouvoir approfondir
certaines réflexions concernant le rapport humain avec le monde
végétal forestier au sein d'un autre collectif en Master 2.
50
RÉFÉRENCES
BAILLET Caroline, BERGE Orélien, « Comprendre
l'expérience de l'éco-volontariat : une
approche par la valeur de consommation »,
Deuxième Colloque International sur les Tendances du
Tourisme [en ligne], 2009, mis en ligne le 11 mars
2010
URL:
https://hal.univ-cotedazur.fr/hal-00463062/document
BASTIEN Yves, BOURNERIAS Marcel, « Forêts - La
forêt, un milieu naturel riche et diversifié »,
Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 5 juin 2020
URL:
http://www.universalis-edu.com.bibelec.univ-lyon2.fr/encyclopedie/forets-la-foret-un-milieu-
naturel-riche-et-diversifie/
BERTHIER Jean-Luc, « ZOO ou PARC ZOOLOGIQUE »,
Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 30 mars 2020
URL :
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/zoo/
BLONDET Marieke, « 3 : le genre de l'anthropologie. Faire
du terrain au féminin », dans Alban
Bensa, « Les politiques de l'enquête », Paris,
La découverte, 2008, pp. 59-80
URL :
https://www.cairn.info/politiques-de-l-enquete--9782707156563-page-59.html
BRETON Jean-Marie, « Paradigme d'écotourisme et
sociétés traditionnelles en mutation : le cas de
l'outre-mer français », Téoros [en
ligne], no. 23, 2004, pp. 54-60, mis en ligne le 01 septembre
2010, consulté le 21 juin 2020
URL :
http://journals.openedition.org/teoros/668
BRUNOIS-PASINA Florence, « La forêt peut-elle
être plurielle ? Définitions de la forêt des Kasua
de Nouvelle-Guinée », Anthropologie et
Sociétés [en ligne], vol. 28, no. 1, 2004, pp. 89-107
DOI :
https://doi.org/10.7202/008572ar
CAUWE Nicolas, « Introduction à l'agroforesterie
», Jardinons la planète [en ligne], nov. 2008
URL :
https://jardinons.wordpress.com/2008/11/08/agroforesterie-lexemple-du-cacao/
CHOWRA, Makaremi, « 8 : Participer en observant.
Étudier et assister les étrangers aux
frontières », dans Alban Bensa, « Les
politiques de l'enquête », Paris, La découverte,
2008, pp. 165-
183
URL :
https://www-cairn-info.bibelec.univ-lyon2.fr/politiques-de-l-enquete--9782707156563-page-
165.htm
CRONON, William. « Le problème de la wilderness,
ou le retour vers une mauvaise nature »,
Écologie & politique, vol. 38, no. 1,
2009, pp. 173-199
DESCOLA Philippe, « Par delà nature et culture
», Editions Gallimard, 2005, 792 p.
51
DESCOLA Philippe, « Anthropologie de la nature »,
L'annuaire du Collège de France [En ligne], 2014, mis en ligne
le 15 août 2014, consulté le 20 juin 2020
URL :
http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/2580
DESCOLA Philippe « De la nature universelle aux natures
singulières : quelles leçons pour l'analyse des cultures ?
», dans Philippe Descola (dir.), « Les natures en question
», Collège de France, Odile Jacob, 2017, pp.
121-155
DROUILLEAU Félicie, « L'anthropologie du « fait
environnemental » : retours réflexifs sur une
spécialité en devenir », Sciences de la
société, no. 96, 2015, pp. 169-184
DUMEZ Richard, ROUE Marie, BAHUCHET Serge, « Conservation de
la nature : quel rôle pour les sciences sociales ? », Revue
d'ethnoécologie [En ligne], no. 6, 2014, mis en ligne le 31
décembre 2014, consulté le 18 juin 2020
DOI :
https://doi.org/10.4000/ethnoecologie.2089
ESTEBANEZ Jean, « Les jardins zoologiques ou l'exotique
à portée de main », Le Globe [En ligne], 2008, pp.
89-105, mis en ligne le 5 janvier 2009
URL :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00344635
ESTABANEZ Jean, STASZACK Jean-François, « Animaux
humains et non-humains au zoo. L'expérience de la frontière
animale », dans Annik Dubied, « Aux frontières de l'animal.
Mises en scène et réflexivité », Genève,
Librairie Droz, Travaux de Sciences Sociales, 2012, pp. 149-174 DOI
:
https://doi.org/10.3917/droz.dubie.2012.01.0149
FISCHER Berenice, TRONTO Joan, « Toward a feminist theory of
care », dans Emily K. Abel et Margaret K. Nelson (dir.), « Circles of
Care : Work and Identity in Women's lives, State University of New York
Press, Albany, NY, 1991, p. 40
FOGEL Frédérique, RIVOAL Isabelle, «
Introduction », Ateliers d'anthropologie, no. 33, 2009 FOYER
Jean, « Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts : vers une
anthropologie au-delà de l'humain », Cahiers des
Amériques latines [En ligne], no. 88-89, 2018, pp. 179-183, mis en
ligne le 23 janvier 2019, consulté le 26 mai 2020,
URL :
http://journals.openedition.org/cal/9003
FROIDEVAUX Sylvain, « Anthropologie et ethnolinguistique de
la forêt », Dr ès Sciences Sociales, Genève,
2007
GHASARIAN Christian, « Les désarrois de l'ethnographe
», dans Jean Pouillon, « Histoire d'homme » L'Homme 37,
no. 143, pp. 189-198
DOI:
https://doi.org/10.3406/hom.1997.370313
GRAVARI-BARBAS Maria, GRABURN Nelson, « Imaginaires
touristiques », Via [En ligne], no. 1, 2012, mis en ligne le 16
mars 2012, consulté le 21 juin 2020
52
URL :
http://journals.openedition.org/viatourism/1178
GOLLAIN Françoise, « Penser le travail dans son
historicité. Quelques réponses à Yolande Benarrosh »,
Revue du MAUSS, n°18 (2), 2001, pp. 176-195
DOI:
https://doi.org/10.3917/rdm.018.0176
GUILLEUX Céline, « Conservation de la
biodiversité : quels modèles de conception et de gestion pour les
aires protégées ? », Appel à contribution,
Calenda [En ligne], publié le mardi 24 juillet 2018
URL:
https://calenda.org/460189
HALLE Francis, « La condition tropicale. Une histoire
naturelle, économique et sociale des basses latitudes », Actes
Sud, 2010, 574 p.
HARDIN Rebecca, « A travers la forêt, une nouvelle
anthropologie environnementale », Anthropologie et
Sociétés [en ligne], vol. 29, no. 1, 2005, pp. 7-20
DOI :
https://doi.org/10.7202/011738ar
HERAULT Juliette, « Les nouvelles pratiques touristiques des
jeunes à destination de l'Australie, Enjeux et perspectives du Visa
Vacances Travail », Mémoire de Master professionnel, Tourisme
spécialité Économie du Développement, Paris,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2013, 141 p. KALAORA
Bernard, SAVOYE Antoine, « La forêt pacifiée. Les forestiers
de l'Ecole de Le Play, experts des sociétés pastorales »,
Paris, L'Harmattan, 1986, 134 p.
KIALO Paulin, « Anthropologie de la forêt »,
Paris, L'Harmattan, 2007, 391 p.
KOHN Eduardo, « Comment pensent les forêts : vers
une anthropologie au-delà de l'humain », Bruxelles, Zones
sensibles, 2017
LAPLANTINE François, « La description
ethnographique : l'enquête et ses méthodes », ed. Armand
Collin, 2010, 128 p.
LANLY Jean-Paul, MAITRE Henri-Félix, «
Forêts - Les forêts tropicales », Encyclopædia
Universalis, [en ligne] consulté le 5 juin 2020
URL :
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/forets-les-forets-tropicales/
LARRERE Catherine et Raphaël, « Penser et agir avec
la nature, une enquête philosophique », Paris, La
Découverte, 2015, 336 p.
LAVIGNE DEVILLE Philippe, « Comprendre la production des
politiques foncières au Bénin : de la participation observation
à l'observation engagée », dans Marion Fresia et Philippe
Lavigne Delville, « Au coeur des mondes de l'aide. Regards et postures
ethnographiques », Paris, APAD/Karthala/IRD, pp. 245-270
53
LEROY Elisabeth, « Born to be wild, les contradictions de
la figure du sauvage au Jaguar Rescue Center » Mémoire de Master,
Anthropologie à finalité approfondie, Liège,
Université de Liège, 2018, 83 p.
MATHOT Léon, « Connaître, comprendre et
protéger la forêt. Initiation à l'écologie
forestière », Broché, 2016, 178 p.
MICHON Geneviève, « Ma forêt, ta
forêt, leur forêt : perceptions et enjeux autour de l'espace
forestier », Bois et forêt des tropiques, no. 278 (4),
2003, pp. 15-24
OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, « La rigueur du
qualitatif, l'anthropologie comme science empirique », Esapces
Temps, no. 84, 1994, pp. 38-50
OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, « La politique du terrain.
Sur la production des données en anthropologie », Les terrains
de l'enquête (1), 1995, pp. 171-109
DOI :
https://doi.org/10.4000/enquete.263
OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, « Le « je »
méthodologique. Implication et explicitation dans l'enquête de
terrain », Revue française de sociologie, no. 41 (3),
2000, pp. 417-445
OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, « L'enquête
socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et
recommandations à usage des étudiants », Laboratoire
d'études et recherches sur les dynamiques sociales et le
développement local LASDEL, Études et Travaux, no. 13,
2003, 58 p. RAYMOND Nathalie, « Costa Rica : du petit pays «
démocratique, sain et pacifique », au leader de
l'écotourisme et de la protection de l'environnement »,
Études caribéennes [en ligne], no. 6, 2007, mis en ligne
le 7 avril 2007
DOI :
https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.432
SCHNITZLER-LENOBLE Annick, « En Europe, la forêt
primaire », Liège,
LaRecherche.fr [en
ligne], 1996
URL :
https://urlz.fr/dadA
SINAC, UCR - ProAmbi - MINAE, « Plan de Manejo para el
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM) Vol.I »,
Programe de Estudios Ambientales, Escuela de Biologia, Universidad de
Costa Rica, San José, 1996
URL :
https://urlz.fr/cSRJ
SOULE Bastien, « Observation participante ou
participation observante ? Usages et justifications de la notion de
participation observante en sciences sociales », Recherches
qualitatives, vol. 27 (1), 2007, pp. 127-140
STENGERS Isabelle, « Préface », dans Anna
Lowenhaupt Tsing, « Le champignon de la fin du monde. Sur les
possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme », coll. Les
empêcheurs de tourner en rond, ed. La découverte, Paris,
2017, pp. 7-19
54
TRONTO Joan, « Un monde vulnérable, pour une
politique du care », Editions La découverte,
Paris, 2009, 239 p.
WOHLLEBEN Peter, « La vie secrète des arbres : ce
qu'ils ressentent. Comment ils communiquent », Paris, Les
Arènes, 2017, 300 p.
55
ANNEXES
Annexe 1 - Loi Forestal n°4465, datant de 1969,
extraits en version d'origine
Ley Forestal 4465, Fecha 1969
(NOTA: texto vigente hasta que fue derogada por Ley N° 7575 de 13
de febrero de 1996)
Artículo 1.- La presente ley establece
como función esencial y prioridad del Estado, velar por la
protección, la conservación, el aprovechamiento, la
industrialización, la administración y el fomento de los recursos
forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los
recursos naturales renovables.
Artículo 7.- Se entiende por
régimen forestal el conjunto de disposiciones, entre otras, de
carácter jurídico, económico y técnico,
establecidas por esta ley, su reglamento y demás normas y actos
derivados de su aplicación, que regulen la conservación, la
renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y de los
terrenos de aptitud forestal del país.
Artículo 35.- Dentro del patrimonio
forestal del Estado se constituirán:
a) Reservas forestales: Estarán formadas por los
bosques cuya función principal sea la producción de madera, y por
aquellos terrenos forestales que por naturaleza sean especialmente aptos para
ese fin.
b) Zonas protectoras: Estarán formadas por los bosques
y terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la
protección del suelo, la regulación del régimen
hidrológico y la conservación del ambiente y de las cuencas
hidrográficas.
c) Parques nacionales: Son las regiones establecidas para la
protección y la conservación de las bellezas naturales y de la
flora y la fauna de importancia nacional, a fin de que, al estar bajo
vigilancia oficial, el público pueda disfrutar mejor de ellas.
Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas no
transformados y poco modificados por la explotación y ocupación
humana, en que las especies vegetales y animales, los sitios
geomorfológicos y los habitats son de especial interés
científico y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza.
Corresponde a la más alta autoridad competente del país adoptar
medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, la
explotación y para hacer respetar las características
ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han
determinado su establecimiento.
56
Los parques nacionales y reservas biológicas
serán administrados por el Servicio de Parques Nacionales.
ch) Refugios nacionales de vida silvestre: Estarán
formados por aquellos bosques y terrenos cuyo uso principal sea la
protección, la conservación, el incremento y el manejo de
especies de la flora y la fauna silvestres.
d) Reservas biológicas: Estarán formadas por
aquellos bosques y terrenos forestales cuyo uso principal sea la
conservación, el estudio y la investigación de la vida silvestre
y de los ecosistemas que en ellos existan.
Sistema Costarricense de Información
Jurídica
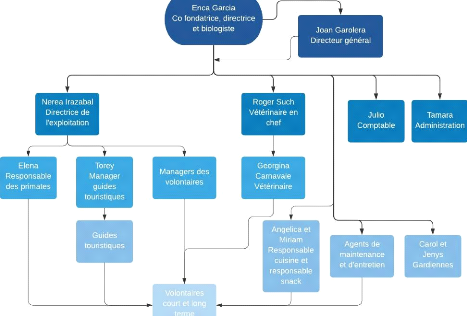
Joan Garolera Directeur général
Enca Garcia
Co fondatrice, directrice et biologiste
Elena
Responsable
des primates
Torey
Manager
guides
touristiques
Guides
touristiques
Managers des
volontaires
Georgina
Carnavale
Vétérinaire
Nerea Irazabal
Directrice de
l'exploitation
Roger Such
Vétérinaire en
chef
Julio
Comptable
Tamara
Administration
Angelica et
Miriam
Responsable
cuisine
et
responsable
snack
Agents de
maintenance
et d'entretien
Carol et
Jenys
Gardiennes
es
court et long terme
57
Annexe 2 -- Organigramme du Jaguar Rescue Center,
réalisé à partir des données
récoltées sur le terrain et sur le site
www.jaguarrescue.foundation/
58
Annexe 3 - Loi de conservation de la vie sylvestre
n°7317, datant du 30/10/1992, extrait de l'article 2, en version
originale.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley
se entiende por:
Áreas oficiales de conservación de la
vida silvestre(*): áreas silvestres protegidas por
cualquier categoría de manejo, áreas de protección del
recurso hídrico y cualquier otro terreno que forme parte del patrimonio
forestal del Estado.
Centro de rescate: sitio de manejo de vida
silvestre cuyo objetivo es rehabilitar vida silvestre que haya sido rescatada,
decomisada o entregada voluntariamente, para su recuperación y
reinserción al medio natural cuando lo amerite. Aquellos organismos cuya
condición no permita su reinserción al medio natural serán
depositados en sitios de manejo de vida silvestre definidos en esta ley. No
tienen fines de lucro y no están abiertos al público.
Fauna silvestre: la fauna silvestre
está constituida por los animales vertebrados e invertebrados,
residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales o que hayan sido
extraídos de sus medios naturales o reproducidos ex situ con cualquier
fin en el territorio nacional, sea este continental o insular, en el mar
territorial, en aguas interiores, zona económica exclusiva o aguas
jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su
supervivencia; así como aquellos animales exóticos, vertebrados e
invertebrados, declarados como silvestres por el país de origen; incluye
también los animales criados y nacidos en cautiverio provenientes de
especimenes silvestres. La clasificación taxonómica de las
especies se establecerá en el reglamento de esta ley.
Flora silvestre: la flora silvestre
está constituida por el conjunto de plantas vasculares y no vasculares,
algas y hongos existentes en el territorio nacional, continental o insular, en
el mar territorial, aguas interiores, zona económica exclusiva o aguas
jurisdiccionales, que viven en condiciones naturales o que hayan sido
extraídas de su medio natural o reproducidas ex situ con cualquier fin,
las cuales se indicarán en el reglamento de esta ley; así como
aquellas plantas vasculares y no vasculares, algas y hongos exóticos
declarados como silvestres por el país de origen; incluye también
las plantas vasculares y no vasculares, algas y hongos que hayan sido
cultivados en cautiverio provenientes de especimenes silvestres. Se
exceptúan de ese conjunto las plantas vasculares que correspondan al
concepto de "árbol forestal" y las plantas, hongos y algas de uso
agrario, de acuerdo con la definición dada por la ley o la
reglamentación que regula esta materia.
59
Sitio de manejo de vida silvestre: lugar o
espacio que provee diferentes grados de manejo y protección a la vida
silvestre. Incluye las siguientes categorías: zoológico,
zoocriadero, centro de rescate, vivero, acuario, jardín botánico,
herbario, museos naturales, banco de germoplasma, exhibiciones y otras
áreas delimitadas para el manejo ex situ, con o sin fines comerciales,
con el objetivo de conservación, educación, investigación,
reproducción, reintroducción, restauración y
exhibición, quedan excluidos los jardines domésticos y
decorativos.
Vida silvestre: conjunto de organismos que
viven en condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio
nacional, tanto en el territorio continental como insular, en el mar
territorial, aguas interiores, zona económica exclusiva y aguas
jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su
supervivencia. Los organismos exóticos declarados como silvestres por el
país de origen, los organismos cultivados o criados y nacidos en
cautiverio provenientes de especímenes silvestres, sus partes, productos
y derivados son considerados vida silvestre y regulados por ley.
Zoocriadero: sitio que puede tener o no fines
comerciales, en el cual se propaga o reproduce vida silvestre, con conocimiento
del manejo de las especies, fuera de su hábitat natural y donde se
involucra el control humano, en el proceso de selección y
elección de los organismos que se reproducirán.
Zoocriadero artesanal con manejo restringido:
sitio de manejo que reproduce vida silvestre cuyas poblaciones no
están reducidas o en peligro de extinción. Los fines principales
son el suministro del plantel parental para otros zoocriaderos, el consumo
familiar, la educación ambiental y la restauración de
ecosistemas. La supervisión será realizada por el personal
técnico del área de conservación respectiva.
Zoológico: sitio de manejo que
mantiene vida silvestre en cautiverio, puede ser con fines comerciales o no,
bajo la dirección de un cuerpo de profesionales que les garantiza
condiciones de vida adecuada en una forma atractiva y didáctica para el
público. Sus principales objetivos son la conservación,
educación, investigación y exhibición de la fauna
silvestre de una manera científica.
Sistema Costarricense de Información
Jurídica
60
Annexe 4 - Le ceiba pentandra, description et
illustrations
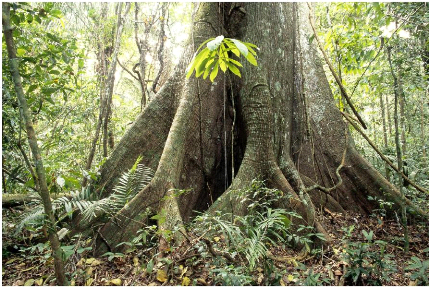
Figure 9: Exemple de fût de ceiba pentandra (photo de
François Gohier, source:
sciencesourceimages.com)

|
Figure 10: couronne de jeune ceiba pentandra
(source:plantes-botanique.org)
|
Figure 11: fût de ceiba pentandra (source:
plantes-botanique.org)
|
Le ceiba pentandra est un arbre géant
présent du Mexique jusqu'au Brésil, dont la taille varie entre 20
et 60 mètres. Il possède un tronc gonflé à la base
s'étendant sur 2 à 5 mètres de diamètre, des
branches allant jusqu'à 10 mètres de large, et une grande
couronne feuillue. Semi-persistant, il perd ses feuilles à la saison
sèche, ce qui n'arrive pas à La Ceiba en raison du climat.
61
Annexe 5 - Description et illustration du serpent lachesis
stenophrys
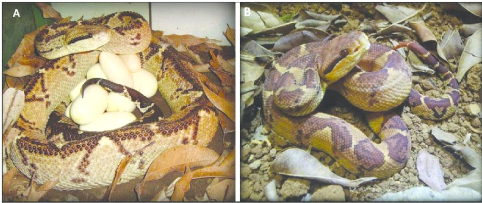
Figure 12: Femelle lachesis stenophrys (A) Nouveau né
lachesis stenophrys (B) (source: ResearchGate, 2013)
Espèce endémique du Nicaragua, du Costa Rica et
du Panama, ce serpent fait partie de la famille des viperidae et est
considéré comme l'une des espèces les plus dangereuses au
monde. Il vit dans les forêts dont le taux d'humidité est
extrême et atteint 200 centimètres de longueur à
l'âge adulte.
62
Annexe 6 - Photo du sentier dallé aménagé
par le Jaguar Rescue Center à La Ceiba
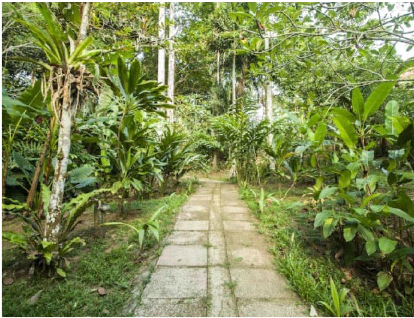
Figure 13: Sentier dallé de La Ceiba menant jusqu'aux
maisons touristiques (source: site officiel du JRC:
https://www.jaguarrescue.foundation/en-us/SupportUs/StaywithUs/LaCeibaHouse
)
63
Annexe 7 - Illustration de l'espèce animal amazone
à lores rouges (amazonia autumnalis)

Figure 14: amazonia autumnalis (source:
oiseaux.net)
64
Annexe 8 - Formulaire d'inscription au Jaguar Rescue Center

JAGUAR RESCUE CENTER FOUNDATION
Volunteer
Application Form
YOUR PICTURE
Arrival date: Departure date:
Full name:
Country of origin: Passport number: Date of birth:
E-mail:
Contact phone: Address:
Donation Fee:
The minimum stay is of 4 weeks: 21 nights at the JRC + 7 nights
at La Ceiba. Accommodation is included.
The total price is $825 ($350 volunteering donation fee + $475
accommodation). You will have to place 2 payment upon reservation in order to
confirm your stay. In any case of cancellation, we do not refund the
deposit.
The other half of the payment you have to pay 2 months before
your arrival.
In the case of a cancellation on the part of the volunteer, no
refund will be given. The JRC is not
responsible for any unforeseen event that may cause you to cancel
your booking. This includes viruses, disease, sickness, pregnancy, weather, act
of nature, or any other event non-related to the JRC. We recommend that you
purchase a third party travel insurance in advance of your travel here in Costa
Rica.
Occupation or academic qualifications:
Experience in the animal field (if possible species and dates):
NONE Spoken languages (score from 1 to 5, where 1 = very low and 5 = very
high)
65
|
Language
|
Written level
|
Spoken level
|
|
SPANISH
|
|
|
|
ENGLISH
|
|
|
|
Other:
|
|
|
Why would you like to volunteer at the JRC?
Do you have any chronic disease? Medical restrictions?
Allergies?
It is obligatory to run a Tuberculosis test
to discard a transmission of the illness to the animals. If
you haven't run it yet, remember to do it before coming and bring a copy of the
results, or you won't be able to work with our primates.
Date of your tuberculosis test:
Results of the test:
Details of your health insurance (in case of emergency):
Emergency contact person:
COSTA RICA is a nice and calm place but sometimes visitors that
come here want to experience with different drugs. We have a very strict
anti-drug policy, so if we find out that one of our volunteers is related to
any kind of drug is going to be directly expelled from the Jaguar Rescue
Center. People who use, please, abstain.
I hereby declare that I know fully and fully accept the risks
inherent in visiting / volunteering Jaguar Rescue Center, and participate in
activities and use of this service, and hereby waive any compensation for all
kind damage that may occur in my physical or moral concept. Under this waiver I
agree to not promote or engage in any action against the Jaguar Rescue Center,
or against their owners or legal representatives, or against any person
participating or assisting in such activities, or against any person or entity
that directly or indirectly involved in any way that I have to participate in
such activities.
I hereby agree that photos and videos of me could be taken and
uploaded to social network.
The use of mobile phones and electronic devices at the Center
during working hours is prohibited. Use of these devices in the Coffee Shop or
outside during break time is permitted.
Volunteers are not allowed to take photographs or videos during
their workday. It is imperative that volunteers understand that because of the
Law of Conservation of Wildlife in Costa Rica and our own policy is totally
forbidden to take pictures of animals in contact with people.
Signature
66
Annexe 9 - Contenu du mail de prise de contact
envoyé au JRC en décembre 2018
Object: internship demand Hello Jaguar Rescue!
My name is Marion, I am 23 years old and currently, I am in
the first year of Master in Anthropology at Lyon 2 University. I am contacting
you on internship possibility. I am looking for an internship (one month and a
half) starting in February or March 2019 in order to achieve my first year. I
found your foundation online and, among other organisms in America, yours fits
perfectly with my plans of a thesis that I am going to explain. Moreover, it
holds my interest in its history, its values, its purposes, and its
organization.
Sensible about the ecological disorders of our time and the
animals' conditions, I am writing a thesis about the ecologist and humanitarian
consciousness through the animals' protection. As an anthropologist, I am
focusing on the relationship between humans and animals on contexts of
ecological emergency such as disease and natural or human disasters. I would be
honored to intern your staff to take part in your activities, to gain
experiences in animals protection and to highlight the scope of your actions.
Furthermore, integrate your foundation would allow me to further my study of
«environmental consciousness» by being a volunteer and meeting
others. Indeed, I am particularly curious about your educational program with
tourists and locals but I also want to discover the biodiversity of this
country and how your work contributes to protecting the Costa Rican's and the
Ceiba forest's ecosystem.
I can offer you my help in every kind of jobs as long as it
does not require higher skills in medicine. I am a hard worker, always have
eager to learn, and I have an endless energy and curiosity. I love animals, of
course, and I am a good student, strongly passionated by my field. I plan to be
an anthropologist specialized in nature and focused on human relationships with
animals and its environment. My goal through this job is to show how necessary
is to respect animals, the biodiversity and the environment in order to
maintain a sustainable and healthy life. In other words, to make people realize
our impact on the earth and how dangerous it is for us, for animals and for
every life forms. I also want to be implicated in my job, therefore, I would be
happy to take part in your action as a volunteer and not as an extern
researcher.
Thus, your foundation would be the perfect place for me to
start my thesis. If you are interested in it, I would be really happy to be
part of your team. I am reachable by email and by phone (+33632502161), I hope
to hear from you soon.
Best wishes
Marion Picard
Student in Anthropology Lyon 2 University
FRANCE
|
|



