|
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 1
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
L'Université de Yaoundé II et l'EIFORCES
n'entendent donner aucune approbation ou improbation aux idées ou
opinions contenues dans ce document. Celles-ci doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DEDICACE iv
REMERCIEMENTS v
SIGLES ET ABREVIATIONS vii
LISTE DES ILLUSTRATIONS ix
LISTE DES ANNEXES x
RESUME EXECUTIF xi
EXECUTIVE SUMMURY xii
INTRODUCTION GENERALE 13
PREMIERE PARTIE : CADRE DE DEROULEMENT DU STAGE
29
CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ECOLE
INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE (EIFORCES) ET LA PLACE DU CENTRE DE
RECHERCHE ET
|
DEDOCUMENTATION
|
31
|
|
Section I : Organisation, Fonctionnement et les Missions de
EIFORCES
|
..31
|
|
Section II : Coopération et Partenariats de l'EIFORCES
|
42
|
|
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE A L'EIFORCES
|
45
|
|
Section I : Acquis, Difficultés et Suggestions Eventuelles
|
45
|
|
CONCLUSION PARTIELLE
|
47
|
|
DEUXIEME PARTIE : REDYNAMISATION DU DISPOSITIF DE
VEILLE
|
|
|
SECURITAIRE AU CAMEROUN SOUS LA MENACE BOKO HARAM
|
48
|
|
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou
|
Page 2
|
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 3
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
CHAPITRE 3 : SOCIOGENESE DE LA MENACE BOKO HARAM ET
LA
REDYNAMISATION DU DISPOSITIF DE VEILLE SECURITAIRE 49
Section I : Sociogenèse de la menace Boko
Haram 49
Section II : De la difficulté de riposte
opérationnelle à la construction du dispositif de veille
sécuritaire camerounais et cooperations 62
CHAPITRE 4 : RESILIENCE DE LA MENACE BOKO HARAM
: ENTRE FACTEURS STATIQUES, DYNAMIQUES ET LES PERSPECTIVES STRATEGIQUES,
OPERATIONNELLES INNOVANTES 81
Section I : Les facteurs statiques et dynamiques de
résilience de BH à l'épreuve de la
redynamisation du dispositif de veille sécuritaire 81
Section II : Combattre autrement BH : Perspectives et
Impératifs Sécuritaires
Stratégiques, Opérationnelles. 95
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 102
CONCLUSION GENERALE 103
BIBLIOGRAPHIE 105
TABLE DE MATIERE 109
ANNEXES 112
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 4
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
DEDICACE
Je dédie ce modeste travail :
A la mémoire de mon regretté père Saidou
KOUOTOU que Dieu le tout puissant l'accueille dans son vaste paradis et lui
accorde toute sa miséricorde.
A ma mère Abiba NJAPNDOUNKE
A Fadimatou MIMCHE
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 5
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
REMERCIEMENTS
Le moment est venu pour moi, alors que s'achève cette
aventure unique qu'est la rédaction d'un mémoire, d'exprimer mon
infinie reconnaissance à l'égard de toutes celles et de tous ceux
qui d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la
rendre possible. Comme le disait Hamadou HAMPATE BA « Quelle que soit la
valeur du présent fait à un homme, il y a qu'un seul et unique
mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la
liberté et ce mot c'est : Merci ».
Mes premiers mots de remerciements vont naturellement
A mes directeurs de mémoire, Monsieur le Professeur
EBOGO Frank et le Lieutenant-Colonel NJOYA Motapbemo Mannoni Thierry qui, en
acceptant de m'accueillir au sein du CREPS ; à l'EIFORCES et de diriger
ce travail, m'ont fait confiance. Directeurs de mémoire à la fois
disponibles, méthodiques et compréhensifs, leurs conseils
toujours précieux et leurs encouragements constants m'ont
été d'une aide inestimable durant ces années de
recherches.
Ils s'adressent ensuite :
A l'ensemble des membres et du personnel du CREPS. Une
pensée particulière pour Messieurs les Directeurs ; du CREPS le
Pr NTUNDA Ebode Vincent et de l'EIFORCES le Général de Brigade
BITOTE Andre Patrice pour la formation reçue au niveau théorique
et méthodologique ces deux années d'études, ainsi que pour
les Docteurs NZOKOU et NJIFON Njoya pour leurs conseils avisés et leur
disponibilité.
A mes relecteurs pour le temps qu'ils m'ont accordé et
qui ont contribué à l'accomplissement de ce travail : Colonel
MABALY Christian, Madame CHOPPI Victorine Dany épse TCHAKOUNTE, aux
Capitaines WITOUANGA Léopold, EBANGA, KPOLONG, TCHOUKOU ; aux
Lieutenants HANDOU ; AYONG ; AYIWOUO ; Sergent-Chef Ismaël Yaya ILLALOVE ;
Sergent NGOE SONE E ; Caporal-Chef MBOUOMBOUO Tengbet M M ; Dr LEKINI, Pr NDAM
Ngoupayou ; Mohamed Zedan Ngouyamsah Njikam ; Cheirkh Yaya Mfoncha ; Pr Joseph
CHANDINI ; A mes amis qui, de près ou de loin, par leurs prières
ou leur présence à mes côtés, ont permis que cette
aventure soit moins solitaire.
A mes frères et soeurs NGOUPAYOU Mama ; Aicha NKWENGAM
; Adamou KOUOTOU ; OUMA ; RAHIMAT, BINTOU, YOUSSOUF Dilan, pour le soutien
spirituel et matériel tellement précieux dont j'ai
bénéficié durant toutes ces années de recherches et
même au-delà.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 6
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Enfin :
A la grande famille royale Nji Titah Mfon LOUMBOU ; Nji MONTIE
Issoufou, Mme Ali SINE AICHETOU NJAPDOUKOUET, NJOUNDIYIMOUN Salifou, Officier
de Police1 Serange ESSOUA, MILHANE Uriel, KEYLANE Sayid et Alida Darelle
KOUETCHA ; Madame NGOU Evelyne.
Devant nos maîtres et les membres du jury de cette
présentation, je m'incline en signe de révérence et
d'humilité. Nous les remercions d'avance pour leurs critiques et leurs
évaluations. Toutefois, comme le signifie le propos d'initiation Bamoun
(langue locale du Cameroun) : « Si je me suis trompé, que l'erreur
me pardonne ; si j'ai omis quelque chose, que l'omission me pardonne ».
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 7
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
SIGLES ET ABREVIATIONS
ACRI: African Crisis Response Initiative
ACOTA: African Contingency Operations and
Training Assistance;
BESS : Brevet d'Études
Supérieures de Sécurité ;
BH : Boko Haram ;
BIR : Bataillon d'intervention Rapide ;
CEEAC : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale ;
CEDEAO : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest ;
CONOPS : Concept d'Operations
Stratégiques ;
COPAX : Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale ;
CPTMO : Centre de Perfectionnement aux
Techniques de Maintien de l'Ordre ;
CPPJ : Centre de Perfectionnement à la
Police Judicaire ;
DTL : Direction Technique et Logistique ;
DAF : Direction des affaires Administratives
et Judiciaires ;
DE : Direction des Études ;
DEMFS : Diplôme d'Etat-major des Forces
de Sécurité ;
EIFORCES : École Internationale des
Forces de Sécurité ;
EMA : État-major des Armées
;
ENVR : École (s) Nationale (s)
à Vocation Régionale ;
FAA : Force Africaine en Attente ;
FOMAC : Force Multinationale de l'Afrique
Centrale ;
FOP : Formateur en Ordre Public ;
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 8
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
IP : Intervention Professionnelle ;
MARAC : Mécanisme d'Alerte Rapide
d'Afrique Centrale ;
MINDEF : Ministère de la
Défense ou le chef de ce Département ministériel ;
NEDEX : Neutralisation Enlèvement et
Destruction des Explosifs ;
ONU : Organisation des Nations Unies ;
OSP : Opérations de Soutien à
la Paix ;
RECAMP : Renforcement des Capacités
Africaines de Maintien de la Paix ;
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 9
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
LISTE DES ILLUSTRATIONS
Les tableaux
Tableau 1 : Régularité des
attaques sur le territoire camerounais entre mai et août 2014
Tableau 2 : Nombre d'attaques menées par BH par
circonscriptions administratives dans l'Extrême-Nord entre le
1Er Janvier 2013 et le 31 Janvier 2017
Les figures
Figure 1 : Organigramme de l'EIFORCES
Figure 2 : Carte de l'Extrême-Nord
montrant les zones touchées par les attaques de Boko
Haram
Figure 3 : Cartes des différentes bases
de la FMM
Figure 4 : Intensité des attaques
menées par Boko Haram dans l'Extrême-Nord entre 2013 et
2014
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 10
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 : Décret portant création
de l'EIFORCES
ANNEXE 2 : Décret portant organisation et
fonctionnement de l'EIFORCES
ANNEXE 3 : Lettre de demande du Directeur du
CREPS sollicitant le stage académique pour ses étudiants
ANNEXE 4 : Lettre du Directeur de l'EIFORCES
accordant le stage académique à certains étudiants de
Master II en stratégie, défense, sécurité, gestion
des conflits et des catastrophes ANNEXE 5 : L'Attestation de
fin de stage
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 11
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
RESUME EXECUTIF
Depuis plusieurs années, l'Afrique en
général n'est pas à l'abri du terrorisme au cliché
de Boko Haram. Avec la hausse des activités de ce groupe violent, le
Cameroun est particulièrement frappé par BH si bien qu'il est
désormais courant de parler d'un arc de crise dans la région de
l'Extrême-Nord. En effet, Boko Haram et son caractère
transnational appelle à court terme des réponses
sécuritaires nationales et internationales. Le présent
mémoire examine la problématique de la construction du dispositif
de veille sécuritaire camerounais à l'aune de la menace Boko
Haram. Cette construction est déterminée par la
sociogenèse de la menace ainsi que sa résilience dans ses zones
sièges du Cameroun. Dans un tel contexte, ce travail relève des
hypothèses selon lesquelles le Cameroun est parvenu à redynamiser
son dispositif de veille sécuritaire au regard de l'évolution et
la complexité des modes opératoires de la menace. Les
stratégies hétéroclites jadis peu organisées
expliquent la résilience de Boko Haram et exigent l'adaptation et le
renforcement des forces de défense et de sécurité comme
point d'ancrage d'une nouvelle dynamique sécuritaire. Le fonctionnalisme
et le constructivisme sécuritaire ont permis de comprendre le
fonctionnement et la réorganisation du dispositif de veille
sécuritaires, ainsi que le commandement territorial obsolète sous
l'emprise de la menace. Dès lors, la résilience de Boko Haram
exige de nouvelles perspectives et impératifs sur le plan
stratégique et opérationnel.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 12
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
EXECUTIVE SUMMARY
For several years, Africa in general has not been immune to
terrorism like the cliché of Boko Haram. With the increase in the
activities of this violent group, Cameroon in particularly truck by BH so that
it is now common to speak of an are of crisis in the far north region. Indeed,
the expression of BH and its transnational character call for national and
international security responses in the short term. This project examines the
issue of building the cameroonian security monotoring system on the eve of the
Boko Haram threat. This construction is determined by the sociogenesis of the
threat as well as its resilience in the headquater areas of Cameroon. In such a
context, this work is based on the hypotheses according to wich Cameroon has
succeded in the rivializing its monotoring system in view of the evolution and
complexity of the operating methods of the threat. The disparate and poorly
organized explain the resilience of BH and require the adaptation and
strengthening of the defense and security forces as an ancher for a new
security dynamic. Fonctionalism and security constructivism have made it
possible to understand the functioning and reorganization of the security
monotoring system the obsolete territorial command under the influence of the
threat. Boko Haram's resilience therefore require new perspectives and
imperatives on both strategie and operational levels.
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
INTRODUCTION GENERALE
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 13
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 14
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
La fin de la bipolarité a ouvert la voie à des
nouvelles formes de menaces sécuritaires au cliché du terrorisme.
Si l'Afrique en générale est considérée comme un
continent conflictogène, le Cameroun souffre d'un véritable
déficit sécuritaire à cause des actes terroristes
perpétrés par la secte islamiste Boko Haram.
L'insécurité dans ce pays de la sous-région du continent
demeure une préoccupation majeure, car elle y hypothèque tous les
efforts de développement. Les exactions terroristes
générées au Cameroun exigent une riposte
sécuritaire dictée par la doctrine d'emploi des forces. En effet,
les différentes politiques de défense et de
sécurité mises en place par l'Etat du Cameroun sont
essentiellement en voie de construction avec l'apparition de la nouvelle menace
sécuritaire que représente BH. Malgré l'accent mis sur
cette menace par l'Etat du Cameroun, la résilience de BH
observée, constitue un véritable baromètre de carences,
voire de l'inefficacité des stratégies contre-terrorisme. C'est
à la lumière de ces échecs constatés et au regard
de leurs conséquences drastiques et dramatiques sur la vie des
populations Camerounaises qu'il est temps de sécuriser autrement les
zones sièges du terrorisme. Pour cela, le dispositif de veille
sécuritaire devrait être envisagé dans une perspective
évolutive. Une telle approche est la justification de la
thématique portée sur : « la Construction du dispositif de
veille sécuritaire au Cameroun sous la menace Boko Haram ». En
admettant que la sécurité se construit sur la confiance et se
redéfinit tout le temps, en fonction des exigences sociales,
institutionnelles ou diplomatiques, BH a frappé de
désuétude le dispositif de veille sécuritaire du Cameroun.
Cette secte djihadiste impose une redynamisation du schéma
sécuritaire voire sa refondation. La lutte contre BH paraît
désormais au coeur de la recomposition stratégique et
opérationnelle du dispositif de veille sécuritaire du Cameroun.
De ce fait, l'introduction générale repose sur deux grandes
parties : la construction de l'objet de recherche (section 1) et la
construction du cadre théorique et méthodologique (section 2). La
section 1 le contexte et justification de l'étude (I), le choix et
l'intérêt de l'étude (II), la délimitation de
l'étude (III), la clarification des concepts (IV), la
problématique (V), et les hypothèses de recherche (VI). La
section deux est la présentation du cadre théorique (I), le cadre
méthodologique (II). Toutes finalisées par l'annonce du plan de
travail.
SECTION 1 : DE LA CONSTRUCTION DE L'OBJET DE
RECHERCHE
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 15
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
La construction de l'objet d'étude est une étape
très fondamentale qui repose sur le contexte et justification de
l'étude (I), le choix et l'intérêt de l'étude (II),
la délimitation (III), la clarification des concepts (IV) et la
problématique de la recherche (V).
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE
Cette étude s'intéresse aux contours et aux
motivations du choix du thème de recherche. Au regard de la
sociogenèse de BH et le dispositif mis en oeuvre pour son endiguement,
cette étude sera déroulée sur deux axes reposant sur les
contextes géopolitique (A) et géostratégique (B).
A- CONTEXTE GEOPOLITIQUE
Boko Haram apparaît en 2002 au Nigeria, dans certains
États du Nord-Est (Yobe, Adamawa et Borno), frontaliers du Cameroun, du
Tchad et du Niger. S'il procède des dynamiques sociopolitiques
nigérianes, le groupe n'en étend pas moins de manière
progressive sa présence et son influence dans certaines localités
des pays voisins, en exploitant la continuité socioculturelle desdites
localités (langues, coutumes et pratiques religieuses sont
similaires)1.
Les premières actions significatives que pose le groupe
terroriste, au Cameroun, sont l'attaque du 10 Avril 2012 à
Amchidé zone frontalière de la ville nigériane de
Banki2. Cette attaque fait état de 11 morts dont 10
nigérians et un camerounais. Le mode opératoire laisse entrevoir
des individus clairement identifiés comme membres du groupe islamiste BH
car à la sortie de la mosquée, l'un d'eux poussait de vive voix :
« nous sommes venus pour accomplir un travail, nous n'avons pas besoin de
vous, rentrez chez vous »3. La scène se déroule
devant le poste frontalier regroupant les administrations nigérianes de
la douane, et de la police à proximité de deux églises
protestantes dont les fidèles chrétiens sont leur cible. C'est
d'ailleurs
1 Germain-Hervé MBIA YEBEGA, janvier 2015
Terrorisme et contre-terrorisme en Afrique centrale : quelle
vision stratégique pour le Tchad et le Cameroun?
2 Op.cit
3 Germain-Hervé MBIA YEBEGA, janvier 2015
Terrorisme et contre-terrorisme en Afrique centrale : quelle
vision stratégique pour le Tchad et le Cameroun?
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 16
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
ce qui justifie l'accroissement du nombre de
réfugiés en provenance du Nigeria qui pèse aussi
défavorablement sur les équilibres (sociétaux)
déjà précaires dans cette partie du pays
économiquement fragilisée, dont le développement est
notamment lié à l'essor du tourisme. Une série
d'enlèvements de personnes d'origine étrangère, va suivre
dès février 2013. Cette série va culminer avec
l'enlèvement d'une dizaine d'employés chinois d'une entreprise de
travaux publics le 16 mai 2014 à Waza, suivi de celui de proches parents
et de l'épouse d'un membre du gouvernement, ainsi que d'autres habitants
de la localité de Kolofata le 27 juillet 2014. Le groupe commet aussi de
manière régulière des massacres, dans des villages et
villes frontaliers du Nigeria, à l'Extrême-Nord du Cameroun. La
menace de Boko Haram questionne ainsi les capacités
d'appréhension et de réaction des États de la
sous-région face au défi du terrorisme. Ce qui justifie pas mal
les grandes assises dont le «Sommet de Paris sur la sécurité
au Nigeria», tenu le 17 mai 2014 »4. En raison de sa
capacité de nuisance devenue régionale, le chef de l'Etat
Camerounais va, à l'issue de cette assise, déclarer la guerre
contre BH. Cette dernière met particulièrement à
l'épreuve les forces de défense et de sécurité de
l'Etat du Cameroun dans sa double fonction de préservation de la
stabilité interne et de protection contre les menaces externes. La
récurrence de la menace justifie la nécessité de
construire un dispositif de veille sécuritaire et à penser la
guerre5.
B- CONTEXTE GEOSTRATEGIQUE
La poussée meurtrière de Boko Haram, dans les
zones transfrontalières du Nord Cameroun, s'inscrit dans des dynamiques
antérieures de dégradation de la situation sécuritaire.
Dans ces zones excentrées et en déshérence, la
marginalisation économique a conduit progressivement à
l'enracinement et au développement de certaines activités
illicites, ainsi qu'à des formes de violence dont le terrorisme n'est
qu'une des variantes récentes. Cinq phénomènes principaux
caractérisent l'insécurité transfrontalière
endémique dans le pourtour du Lac Tchad : «le banditisme militaire
transfrontalier et le vagabondage des groupes armés; le trafic d'armes
légères et de produits de contrebande (carburant, produits
pharmaceutiques, véhicules et pièces
4 Le sommet de Paris annoncé le 11 Mai 2014
par François Hollande depuis Bakou (Azerbaïdjan) a
été initié par Goodluck Jonathan. Il s'est tenu le 17 Mai
2014 au Palais de l'Elysée. Les chefs d'Etats invités furent : le
Nigerian Goodluck J, le Tchadien Idriss Deby Itno, le Nigérien Mahamadou
Issoufou, le Béninois Thomas Boni Yayi et le Camerounais Paul Biya.
L'idée de ce sommet fut celui d'insuffler un rapprochement entre des
voisins qui ont bien souvent du mal à s'entendre et d'aboutir à
la mise en place d'une coordination militaro-politique dans le cadre de la
lutte contre la secte islamiste Boko Haram.
5 Honneur et Fidélité, magazine des
forces de défense du Cameroun, Edition spéciale, décembre
2015, p. 52.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 17
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
détachées); le braconnage transfrontalier et le
trafic du bétail; le trafic d'êtres humains et de documents
d'identité; l'insécurité foncière
transfrontalière»6.
La prise en compte par l'État Camerounais des urgences
sécuritaires dans la partie septentrionale du pays et le
déploiement de moyens, ont eu lieu de manière graduelle.
L'État a essayé de répondre à l'aggravation
progressive de certains phénomènes d'insécurité,
par des solutions qui ne leur étaient pas toujours adaptées aux
effets du sous-développement et de la pauvreté. A l'insuffisance
de l'analyse et aux contraintes politiques et économiques, ont
succédé des réponses prioritairement
sécuritaires.
Au cours de ces dix dernières années, par
ailleurs, le Cameroun est aussi devenu terre d'accueil des
réfugiés provenant des pays frontaliers en crise. Les
différentes rébellions et crises de « succession
présidentielle » dont le Tchad a été familier ont
drainé un nombre considérable de réfugiés, qu'ils
soient civils ou en armes. Les derniers développements de cette
insécurité sont des attaques orchestrées par des bandes
armées, visant des postes frontaliers camerounais, des brigades de
gendarmerie et des commissariats de police. La perte de contrôle de
l'État sur une partie du territoire national est ainsi devenue une
réalité : des convois de véhicules doivent être
escortés par les forces de défense et de sécurité
pour relier les chefs-lieux de régions (et de départements) de la
partie septentrionale du pays. Le Bataillon d'intervention rapide (BIR), une
unité d'élite de l'armée de terre, très
engagée aujourd'hui dans les combats contre Boko Haram. Ce bataillon
résulte de la transformation du Bataillon léger d'intervention
(BLI), crée en 19997.
II- CHOIX ET INTERET DE L'ETUDE
Le choix et l'intérêt du sujet
révèlent dans toute entreprise scientifique majoritairement des
motivations profondes. Le choix du thème « la redynamisation du
dispositif de veille sécuritaire au Cameroun sous la menace Boko Haram
» découle d'un regard projeté sur la conjoncture
sécuritaire du Cameroun depuis l'avènement de Boko Haram. Cette
étude revêt un double intérêt, à savoir
scientifique (A) et pratique (B).
6 Cyril Musila, « L'insécurité
transfrontalière au Cameroun et dans le bassin du lac Tchad », Note
de l'IFRI, juillet 2012.
7 Décrets de 2001 sur la réorganisation
de l'armée.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 18
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
A- INTERET SCIENTIFIQUE
Ce travail s'inscrit dans une perspective des nouveaux axes
stratégiques de l'évolution et du développement
organisationnel des forces de défense et de sécurité qui
s'imposent face à la complexité du groupe terroriste Boko Haram.
C'est dans cette optique que les pistes sur les modes d'actions
stratégiques telles que la redynamisation du dispositif de veille
sécuritaire restent envisagée pour la véritable
planification des opérations de défense et de
sécurité. La prévention et la lutte contre ce groupe
terroriste nécessite une interaction entre les acteurs locaux et
internationaux. En matière de défense et de
sécurité, la présente investigation peut servir de base
pour des études plus approfondies pour endiguer les menaces terroristes.
C'est un véritable outil d'aide à la décision qui expose
au public la vérité abyssale sur Boko Haram et une interpellation
à plus de vigilance. C'est un supplément d'enseignements et de
données relatives à la vulnérabilité des
régions en proie au terrorisme Boko Haram, son impact et comment sont
mises en oeuvre et opérationnalisées les stratégies de
sécuritisation8 durable.
D'un point de vue méthodologique, cette aventure
scientifique pourrait servir à la fois de tremplin et de boussole aux
recherches ultérieures.
B- INTERET PRATIQUE
Ce travail de recherche se construit afin de documenter et de
mettre en oeuvre les nouvelles stratégies de défense et de
sécurité aux menaces terroristes, mais aussi de comprendre
comment la secte terroriste Boko Haram a frappé d'obsolescence le
dispositif de veille sécuritaire qui nécessite d'être. Il
se présente aussi comme une réponse pertinente contre Boko Haram
en faisant toutefois ressortir les facteurs de sa résilience. Si en
quelque sorte malheur est bien, Boko Haram a ouvert la voie pour les nouveaux
choix stratégiques et tactiques en raison de son mode opératoire
très souvent diffus.
Il s'inscrit dans la lignée des travaux de
réflexion sur les nouveaux axes stratégiques pour faire face aux
crises à dominance asymétrique en Afrique en
général et au Cameroun en particulier. Il convient davantage de
penser à la notion de « construction » et saisir
l'adaptabilité
8 Au sein des études de
sécurité, la sécuritisation occupe une place
singulière (Williams 2011). Elle est nourrie par les apports du
réalisme et du libéralisme politiques tout en restant ouverte aux
critiques de la sécurité (Floyd 2010 ; Balzacq 2016). Elle se
charge des questions classiques de sécurité, telles que la
guerre. Le concept est propre dans ses débuts à l'école de
Copenhague.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 19
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
du Cameroun aux nouveaux besoins sécuritaires auxquels
il fait face, afin de comprendre sa capacité à produire ou non
des politiques publiques dans le domaine. Le sujet prend alors appui sur les
pratiques camerounaises dans la veille sécuritaire en situation de Boko
Haram (BH). L'intrusion de BH au Cameroun a favorisé le renouvellement
de la gouvernance sécuritaire par la démultiplication d'acteurs
de la sécurité et la lente et imparfaite démonopolisation
étatique sur la question. Les autorités camerounaises ont
dû, par la force des choses, concéder une restructuration de leurs
politiques publiques de défense et sécurité en acceptant
un double accompagnement en la matière. Par le haut, un accompagnement
par des partenaires bilatéraux et multilatéraux, et par le bas,
un accompagnement issu de l'adoubement et de l'exploitation de la
générosité des groupes d'auto-défense qui
s'activent sur le terrain. L'analyse entend partir de cette
réalité pour interroger les apports théoriques et
empiriques de la lutte contre BH dans la préservation sécuritaire
au Cameroun. A cet effet, la réorganisation du dispositif de veille
sécuritaire, l'interaction et les interrelations
sécuritaro-militaires doivent être systématisées et
normalisées pour mieux affronter le groupe terroriste. Quelles seraient
les éléments d'une initiative stratégique commune apte
à relever ce défi ? La réponse à cette question
prescrit une vision globale et une capacité d'anticipation, de veille et
du partenariat stratégique au sein duquel le Cameroun sera un acteur et
actant crédible de la lutte contre la menace terroriste.
III- DELIMITATION DE L'ETUDE
La délimitation permet de circonscrire notre champ
d'investigation, de nous positionner par rapport au thème en fonction
des indices d'espace et de temps.
A- DELIMITATION GEOPOLITIQUE
Cette étude s'intéresse fondamentalement
à la partie septentrionale du Cameroun en proie à BH. À la
suite de la déclaration de guerre à Boko Haram, les
autorités camerounaises ont également procédé, en
août 2014, à la réorganisation partielle de la carte
territoriale du commandement militaire, par la création d'une
région militaire spécifique(RMIA4), qui regroupe les
départements les plus touchés par les actions du groupe
terroriste. Ces décisions s'inscrivent dans ce qui s'apparente à
un réajustement du dispositif de veille sécuritaire au Cameroun.
Elles traduisent une nouvelle orientation déjà amorcée en
2001, avec l'élargissement de la politique de défense à
l'échelle sous régionale et la redéfinition progressive
des missions des forces de défense et de sécurité, ainsi
que la dotation en ressources
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 20
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
et outils adaptés auxdites nouvelles
missions9. Le pays avait jusqu'ici inscrit prioritairement son
action militaire dans une vocation purement défensive de sa
souveraineté10.
Le déploiement d'un important contingent de troupes
permet de contenir les velléités de Boko Haram dans ses
tentatives de prendre racine au Cameroun, bien que sa capacité de
nuisance demeure considérable. Le groupe occupe une large bande de
territoire côté nigérian, tandis que les forces
gouvernementales nigérianes semblent éprouver des
difficultés à lui tenir tête. Mais pourquoi le Cameroun ?
Le groupe a-t-il des projets expansionnistes ? Sur le plan des interactions
sous régionales, il convient de rappeler la continuité
territoriale et socioculturelle entre les communautés
frontalières, du Cameroun, du Nigeria et du Tchad, dans lesquelles Boko
Haram semble bénéficier de certaines complicités,
soient-elles passives, pour mener ses incursions. C'est d'ailleurs ce qui
justifie la prise en compte de la redynamisation du dispositif de veille
sécuritaire au Cameroun dans une vision stratégique du
contre-terrorisme.
B- DELIMITATION CHRONOLOGIQUE
Au Cameroun, les premières actions significatives que
pose le groupe terroriste, date d'Avril 201211. En effet, le 10
Avril 2012 les localités frontalières
nigériano-camerounais (Banki et Amchidé) sont attaquées
faisant état de 11 morts dont 10 nigérians et un Camerounais. Ces
actions sont relayées en 2013 et va culminer avec l'enlèvement
d'une dizaine d'employés chinois d'une entreprise de travaux publics le
16 mai 2014 à Waza, suivi de celui de proches parents et de
l'épouse d'un membre du gouvernement ainsi que d'autres habitants de la
localité de Kolofata le 27 juillet 2014. Le groupe commet aussi de
manière régulière des massacres, dans des villages et
villes de l'Extrême-Nord du Cameroun. C'est ainsi que dans une
perspective de sécurité globale, la redynamisation du dispositif
de veille sécuritaire apparait comme une alternative contre la menace BH
de 2013 à 2018.
9 Joseph Vincent Ntuda Ebode,
ibid. et Léon Kongou, « Boko
Haram : imbroglio dans le Nord du Cameroun », Revue Défense
nationale, n° 775, décembre 2014.
10 Cette mutation se traduit par une projection timide
mais de plus en plus régulière des forces camerounaises dans la
sous-région et sur le continent, à la demande de la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC), la Communauté économique des États d'Afrique
centrale (CEEAC), ou de l'Union Africaine. Voir notamment Note N°5 -
Architecture et contexte sécuritaire de l'espace CEMAC-CEEAC, 25
février 2014.
11 «Pourquoi Jonathan n'est pas arrivé
à Yaoundé », Le Camerounais infos, 28 janvier 2014.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 21
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
IV- CLARIFICATION DES CONCEPTS
« Philosopher c'est savoir ce que parler veut dire
», avait coutume d'affirmer le Philosophe PLATON pour démontrer la
rigueur dans le choix et l'emploie des mots et concepts auxquels nous faisons
appel pour exprimer nos pensées. La clarification conceptuelle
ci-dessous tient lieu d'assemblage de sens et de significations des mots et
concepts que compose ce thème d'étude.
- VEILLE
Elle désigne l'attitude des forces de défense et
de sécurité du Cameroun ; acteurs opérationnels à
appréhender les zones vulnérables de Boko Haram afin de
prévenir ou d'anticiper sur les menaces potentielles. Elle est cette
action prospective des forces de défense et de sécurité
qui consiste à surveiller les points d'ancrage de BH. Elle relève
de la tactique du dispositif visant à capter, détecter les
positions et les intentions des adeptes de BH
- SECURITE
A l'aune d'une définition opérationnelle, la
sécurité renvoie à la capacité des forces
armées camerounaises acteurs principaux à résister aux
attaques de Boko Haram, à poursuivre la lutte par la mise en place d'un
dispositif de veille adapté à cette forme de menace terroriste.
Elle vise objectivement l'absence de la menace et subjectivement l'absence de
peur dans les zones cibles de BH au Cameroun.
- MENACE
Elle renvoie aux actes criminels de nuisance
perpétrés par le Bokostan12 qui pèsent sur la
sécurité du Cameroun. C'est un tout composé des
attaques-suicides, des attaques contre les
12 Le Bokostan renvoie à l'Etat de Boko
Haram. A ce titre lire : La guerre hybride entre le Cameroun et le Bokostan
; Publibook EBOGO Frank
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 22
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
positions des forces de défense et de
sécurité, ainsi que la projection des bombes et engins explosifs
improvisés.
V- PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
La problématique est définie par QUIVY
et CAMPENHOUDT comme « l'approche ou la
perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le
problème posé par la question de départ. Elle est une
manière d'interroger les phénomènes étudiés.
Selon Ferdinand de Saussure, « le point de vue crée l'objet ».
Cela veut dire, au sens de Janvier Onnan, que « c'est le regard que
l'observateur pose sur la réalité qui donne une configuration
à son objet de recherche ». Ainsi, notre problématique se
déploie autour de deux types d'interrogations, à savoir la
question principale et les questions secondaires.
A- QUESTION PRINCIPALE
Comment le Cameroun est-il parvenu à construire son
dispositif de veille sécuritaire à l'aune de la menace Boko Haram
?
B- QUESTIONS SECONDAIRES
? Comment la sociogenèse de Boko Haram impose-t-elle la
construction du dispositif de veille sécuritaire au Cameroun ?
? Comment s'explique la résilience de la menace Boko
Haram face à la construction du dispositif de veille sécuritaire
national et des mécanismes régionaux et comment combattre
autrement BH ?
VI- HYPOTHESES DE RECHERCHE
Alfred Kafuza Kalende définit une hypothèse
comme étant « une proposition des réponses aux questions que
l'on se pose à propos de l'objet de la recherche ». Elles
s'articulent autour de deux ordres, à savoir l'hypothèse
principale et les hypothèses secondaires.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 23
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
A- HYPOTHESE PRINCIPALE
Le Cameroun est parvenu à construire son dispositif en
matière de veille sécuritaire au regard de l'évolution et
la complexité des modes opératoires de la menace Boko Haram.
B- HYPOTHESES SECONDAIRES
? La sociogenèse de Boko Haram impose la construction
du dispositif de veille sécuritaire par l'adaptation et le renforcement
comme point d'ancrage d'une nouvelle dynamique sécuritaire.
? La résilience de la menace Boko Haram face à
la construction du dispositif de veille sécuritaire s'explique par une
chaine de stratégies hétéroclites et peu organisées
qui exigent des nouvelles perspectives pour combattre autrement Boko Haram.
SECTION 2 : CONSTRUCTION DU CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE
Tout travail de recherche en sciences sociales et
précisément en stratégie défense repose sur des
assises théoriques et conceptuelles à même de faciliter une
compréhension aisée de la stratégie défense. La
méthode et la théorie donnent à l'activité
scientifique la crédibilité.
I- CADRE THEORIQUE
La théorie apporte ordre, signification et
intelligibilité à une masse de phénomènes de telle
sorte qu'on puisse rompre avec le sens commun et mieux saisir la
réalité sociale. le physicien américain d'origine
allemande Albert Einstein disait à propos de la théorie que :
« c'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons
observer » 13 . Et si nous partons du sens étymologique du mot
« théorie », le « theoros »14
(spectateur, témoin) et « theorein » (observer
attentivement ce qui se passe afin de le décrire, l'identifier et le
comprendre), nous pourrons dire avec le secours de Philippe Braillard15
que la théorie est une expression cohérente et
13 Albert Einstein. L'éther et la
théorie de la relativité. La géométrie et
l'expérience.
14 Envoyé des cités grecques à
Delphes dont la mission était d'observer les oracles et de les
rapporter, et dans la mesure du possible en expliquant leur signification.
15 In Théories des relations
internationales, Paris, PUF, 1977, p.13.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 24
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
systématique de la connaissance que l'on se fait de la
réalité. En réalité, « les théories en
sciences sociales énoncent généralement les
possibilités plutôt que des lois. Elles consistent pour la plupart
de temps en des cadres conceptuels élargissant notre
compréhension du réel. [...] Toutefois, cet effort de rupture (du
sens commun) passe par l'adoption d'un système d'interprétation
donnant signification et cohérence aux pratiques sociales. (...) il vise
à dévoiler le sens de pratiques sociales, de symboles et de
mythes orientant l'action politique. » Ainsi, le champ théorique de
référence dans le cadre de notre travail se déploie
particulièrement sur le constructivisme sécuritaire et le
fonctionnalisme sécuritaire ou théorie transactionnaliste.
A- LE CONSTRUCTIVISME SECURITAIRE
Le constructivisme peut se définir comme une approche
abordant la réalité sociale comme résultante de l'action
des individus. Comme l'explique Jean Louis Le Moigne : « le réel
existant et connaissable peut être construit par ses observateurs qui
sont dès lors ses constructeurs »16. De même, pour
Paul Valéry : « Les vérités sont choses à
faire et non à découvrir, ce sont des constructions et non des
trésors ». Bachelard soutient également la même
position en affirmant que « rien n'est donné, tout est construit
»17. Dans le même son de cloche, Simon défendit
aussi cette théorie dans sa thèse d'Economie Politique soutenue
en 1943 : « les organisations sociales ne sont pas des données,
elles sont conçues ».
En effet l'émergence du constructivisme vers la fin des
années 1980 coïncide avec l'incapacité des approches
orthodoxes de prévoir et d'expliquer les bouleversements survenus au
courant de la décennie 1980. En effet, le constructivisme
sécuritaire est la première théorie qui nous semble la
mieux indiquée pour comprendre et analyser notre sujet de
mémoire. En tant que théorie des relations internationales, le
constructivisme vient de l'ouvrage de Nicholas Onuf et surtout du
célèbre article « Arnachy is What States Make of it
» d'Alexander Wendt. L'idée centrale de cette théorie
est que ce sont les idées et les normes qui constituent la
réalité et non l'inverse18. Toutefois, c'est le
constructivisme dans sa dimension sécuritaire qui est notre principal
centre d'intérêt et plus précisément les travaux de
Barry Buzan et d'Ole Waever sur la sécurité dont les
études sur la sécurité ont été menées
au sein de l'Ecole de Copenhague. Pour cette dernière, « la
sécurité est une démarche où l'on quitte le cours
normal des négociations et des compromis politiques pour entreprendre
une construction, un processus de
16 Le MOIGNE., Jean-Louis. Les
épistémologies constructivistes. PUF, 1995
17 BACHELARD, Gaston. La formation de l'esprit
scientifique. Paris, Librairie philosophique Vrin, 1999
18 Charles-Philippe David, La guerre et la paix,
3e édition, revue et augmentée, Paris, Presses de
Sciences Po, 2013, p.59.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 25
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
securitization»19. Elle met ainsi en
relief trois principales idées : une conception élargie de la
sécurité, une sécurité sociétale et une
sécurisation. Barry Buzan et Weaver expliquent que la
sécurité ne devrait plus être réduite à sa
simple expression réaliste qui voudrait que la sécurité
soit uniquement confinée à la protection de l'État,
l'aspect militaire, mais que la sécurité devrait concerner
d'autres aspects tels que le politique, l'économie, la
société et l'environnement. Cette sécurité
sociétale aura une influence remarquable sur la sécurité
humaine qui intervient lorsque l'Etat est dans une incapacité totale
à assurer le bien-être de ses populations.
B- LE FONCTIONNALISME SECURITAIRE
Théorie dite de l'intégration et de la
coopération, le fonctionnalisme est une théorie d'essence
libérale initiée par David Mitrany dans son A Working Peace
System paru en 1966. En effet après la deuxième guerre
mondiale, les tenants de l'approche fonctionnaliste estiment que la voie par
excellence par laquelle les Etats peuvent éviter de se faire la guerre
et par conséquent la paix et la sécurité internationales
est la création des institutions techniques qui ont auront des fonctions
bien définies par les Etats eux-mêmes. De ce fait,
l'intégration des Etats au sein des instances de coopération
internationale doit, de façon pragmatique être menée
fonction après fonction20. C'est ainsi qu'ayant des
intérêts partagés, les Etats, dans ces conditions, ne
peuvent plus se faire la guerre ; d'où il règnera alors un climat
de sécurité mutuelle, gage de la paix interétatique. C'est
de ce fonctionnalisme sécuritaire que se revendique Karl Deutsch dans
ses travaux sur les « communautés de sécurité »
à travers la théorie transactionnaliste.
Par communautés de sécurité, Karl Deutsch
entend des groupes de personnes qui sont transformés en entités
intégrées et parmi eux, il survient un sentiment de
communauté qui se dote d'institutions stables. L'auteur estime que les
communautés de sécurité reposent sur « la
conviction des individus et des groupes qu'ils sont arrivés à un
accord sur un point au moins, à savoir les problèmes sociaux
communs doivent et peuvent être résolus par des mécanismes
de changement pacifique ».21 Et que ces communautés
requièrent trois conditions d'existence : un partage des valeurs, des
avantages économiques anticipés et un vouloir-vivre ensemble de
la part des membres de la communauté. Pour cela, Deutsch et ses pairs
font le distinguo entre communautés de sécurité «
amalgamées » et communautés de sécurité «
pluralistes ». Par
19 Ibid.
20 Jean-Jacques Roche, Théorie des relations
internationales,
21 Karl Deutsh et S.A. Burrel, Political
Community and the North Atlantic Area, Princeton University Press, 1957,
p.5, cités par Jean-Jacques Roche Ibid, pp.58-59.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 26
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
communautés de sécurité
amalgamées, il y a fusion des États constituant des unités
plus petites dans une institution nouvelle constituant une unité plus
grande. Ceci étant, par cette fusion, il y a perte partielle de
l'autonomie des États au profit de l'institution ; une sorte de
fédéralisme. En revanche, dans les communautés de
sécurité pluralistes, il y'a respect de l'indépendance des
gouvernements. Pour cette raison, trois facteurs sont indispensables : une
compatibilité des valeurs, une approche pacifique dans la
résolution des conflits et la capacité de prédire le
comportement politique, économique et social de tous les membres de la
communauté.
Cette approche théorique de communauté de
sécurité de Karl Deutsch a toute sa pertinence dans le cadre de
notre sujet puisque la thématique implique plusieurs institutions
sécuritaires.
II- CADRE METHODOLOGIQUE
Pour une bonne recherche, il sied pour le chercheur d'avoir
une méthode de recherche, d'où l'importance de la méthode
dans un travail de mémoire. Ainsi afin d'aborder aisément notre
thème sur « La construction du dispositif de veille
sécuritaire au Cameroun à l'aune de la menace Boko Haram
», la collecte des données et leurs analyses sont
indispensables comme condition de crédibilité scientifique du
travail.
A- LA METHODE DE COLLECTE DES DONNEES
La méthode renvoie à un « dispositif
spécifique de recueil ou d'analyse des informations, destinées
à tester les hypothèses de recherche. » la collecte des
données ayant servi à cette étude s'est effectuée
au moyen de deux (02) instruments : l'approche documentaire, et les techniques
vivantes.
La recherche documentaire nous a permis de rassembler le
maximum de documents possible, notamment les ouvrages généraux et
spéciaux y compris certains cours magistraux nécessaires à
l'exploitation du sujet. Les articles scientifiques périodiques,
thèses, textes juridiques, mémoires et autres publications
pouvant servir à la compréhension de notre travail, ont
également été retenus. En outre, l'on ne manquera pas de
compléter les informations par une fouille méthodique des sites
internet à même de démêler l'écheveau de cette
étude.
L'entretien étant une méthode de collecte de
données qui se particularise par la mise en oeuvre des processus
fondamentaux de communication et d'interactions humaines a aussi valu dans le
cadre de ce travail. Il a plus une fonction idiographique en laissant
l'individu observé
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 27
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
contribuer au cheminement de l'interview et en lui laissant
une plus grande liberté d'expression. De ses multiples variantes, celle
semi-directif a été préférée en raison de
ses caractéristiques ni entièrement ouverts ni trop
canalisés. En outre, des questions guide de la recherche ont
été posé aux sujets informateurs
privilégiés. Ces derniers sont, dans le cadre de cette
étude, des personnes ressources à l'expertise
avérée dans leurs domaines respectifs. L'on fera mention ici des
hauts responsables des Forces de Défense et de Sécurité,
et les représentants de la société civile. Toutefois, nous
n'avons pu faire ce travail de recherche sans l'apport des sources
numériques et audiovisuelles, incontournables de nos jours dans un monde
plus jamais tourné vers les Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication.
B- METHODES D'ANALYSE
Selon Madeleine Grawitz, la méthode « est
constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie ». A cet effet,
notre étude est abordée sous le prisme de deux approches.
Si le champ de la recherche sur les questions de
défense et de sécurité est de plus en plus dynamique et
pluriel, eu égard à la complexité des
phénomènes conflictuels sur le continent africain, la
méthode constructivistes de sécurité est indiquée
dans le cadre de ce travail. Dès lors, de nombreuses approches sont
à l'oeuvre pour en rendre compte. Deux idées majeures marquent
l'histoire des théories de la sécurité : la
première met l'accent sur l'approche globale de la
sécurité, entendue au plan de la coopération
interétatique et de l'interdépendance dans les relations
internationales ; la seconde renvoie à la garantie de la
sécurité au plan national par l'appareil
d'État22. L'apport des constructivistes demeure important
pour comprendre l'analyse de la sécurité au plan global. Les
études constructivistes posent leurs questions avec des « comment
» : « comment les acteurs composent-ils (et modifient-ils) leurs
identités, et définissent-ils ainsi leurs intérêts
en matière de sécurité ? », « comment
comprennent-ils le monde, conditionnant ainsi la menace constituée par
certains facteurs et rendant logiques ou inévitables certains processus
(tels que la formation d'une alliance, la lutte contre la prolifération
des armes, l'éclatement d'un conflit)23 ? ». Dans
l'approche constructiviste, les « comment » précèdent
les « pourquoi » : l'idée est d'établir, avant de faire
certains choix (qui
22 McSweeney 1999
23 Roxanne Doty, « Foreign Policy as Social
Construction: A Post-positivist Analysis of US Counterinsurgency Policy in the
Philippines », International Studies Quarterly, vol. 37,
no 3, September 1993, pp. 297-320; Martin Hollis/Steve
Smith, Explaining and Understanding International Relations,
Clarendon Press, Oxford, 1991.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 28
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
s'inscrivent dans les chaînes causales), toute une gamme
d'alternatives possibles ou plausibles et de comprendre comment certains
intérêts (tels que « préserver la réputation
» ou « accroître son prestige ») sont définis et
deviennent des facteurs déterminants. En d'autres termes, il s'agit de
reconstituer la manière dont se définissent les acteurs, de
retrouver leurs intérêts et leurs identités. L'objectif de
la théorie n'est pas l'explication, voire la prédiction, dans un
contexte transhistorique et généralisable, de la
causalité, mais plutôt la compréhension d'un contexte et la
connaissance pratique. Cette approche a permis d'examiner l'origine de la
menace Boko Haram, d'évaluer dans quelle mesure BH a frappé de
désuétude le dispositif Camerounais en matière de veille
sécuritaire, son influence sur la politique de défense et de
sécurité. Les études menées en la matière
s'articulent le plus souvent autour de ce que l'on appelle « culture
stratégique » et soulignent à la fois l'empreinte historique
et l'influence des facteurs institutionnels sur les stratégies
militaires établies par l'Etat. Une bonne illustration de ce type
d'approche réside dans l'analyse de la manière dont le Cameroun
avant la menace o invulnérables, a infléchi sa doctrine d'emploi
des forces, ou encore dans l'étude de la construction, en
réaction à l'échec des politiques offensives BH avec ses
multiples conséquences.
La seconde méthode choisie pour cette étude est
celle exposée par François THUAL dans ses « Méthodes
de la Géopolitique », consistant à poser les bonnes
questions face à un évènement déterminé. Il
s'agit en somme, de se poser les questions de savoir « Qui veut quoi ?
Avec qui ? Comment ? Pourquoi ? Où ? ». À travers ce
questionnement, il est possible d'identifier dans la mesure du possible les
connaissances fondées au milieu des vraisemblances et les antinomies,
tout en formulant des hypothèses sur ces dernières. Cette
approche du géopoliticien français nous a conduit à
centrer notre analyse sur la redynamisation du dispositif de veille
sécuritaire à l'aune de BH et les facteurs de la
résilience.
ANNONCE DU PLAN DE TRAVAIL
Ce travail se structurera en deux parties. La première
partie dévoile le cadre de déroulement du stage. Le chapitre I de
ladite partie sera consacrée à la présentation
générale de l'EIFORCES suivi du déroulement du stage en
chapitre II. Pour apporter les éléments de réponse
à notre problématique, la deuxième partie présente
la construction du dispositif de veille sécuritaire au Cameroun à
l'aune de la menace Boko Haram.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 29
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
PREMIERE PARTIE :
CADRE DE DEROULEMENT DU STATGE
Les lacunes capacitaires relevées par les Nations
Unies, des forces de police d'Afrique déployées dans le cadre des
opérations de maintien de la paix, ont amené le Cameroun et ses
partenaires à entamer une réflexion dès 2005 sur la mise
sur pied d'un centre dédié à la formation des
unités de police constituées et des experts de la
sécurité pour les opérations de soutien à la paix.
C'est ainsi que va naitre l'Ecole Internationale des Forces de
Sécurité (EIFORCES). Elle est l'expression de la volonté
politique de son Excellence Monsieur Paul BIYA. Elle est un projet de
coopération multipartenaires qui a germé depuis 2005 et qui
répond à un besoin sécuritaire continental. L'EIFORCES a
véritablement été mise sur pieds en 2008 par décret
présidentiel N°2008/179 du 22 Mai 2008, et sa mission s'est
précisée en 2009. Au sens de l'article 3 du décret portant
sa création, l'EIFORCES est implantée à AWAE,
Arrondissement d'AWAE, Département de la Mefou et Afamba, adresse : B.P
100 AWAE. La dynamique de l'école s'est accélérée
en 2011 avec le début des premiers stages courts et a poursuivi son
envol avec les premiers stages longs organisé depuis 2013. Aux termes de
l'article 2 du décret N°2012/307 du 25 Juin 2012 portant
organisation et fonctionnement de cette Institution, l'EIFORCES est un
établissement public administratif de droit camerounais, doté de
la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est
sous la tutelle financière du Ministre des Finances et technique du
Ministre de la Défense (Gendarmerie Nationale) et de la
Sûreté Nationale. Il faut préciser qu'au moment de la
rédaction du présent travail, l'EIFORCES étant encore en
pleine montée en puissance, en ce sens que le site à lui
réservé à AWAE, Région du Centre,
Département de la Mefou et Afamba, Arrondissement d'AWAE, étant
encore en chantier, l'ensemble des Services Administratifs de cette Institution
sont logés dans un immeuble aux couleurs traditionnelles «
bleu-blanc », au quartier Ngousso, Arrondissement de Yaoundé Ve,
Département du Mfoundi, Région du Centre, sis en face de
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 30
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
l'Hôpital Général de Yaoundé.
L'EIFORCES poursuit depuis lors un triple objectif : la contribution au
renforcement de la stabilité régionale, l'amélioration de
la gouvernance sécuritaire des pays africains et la promotion des
standards communs au sein des forces de police et de la gendarmerie
destinées aux opérations de paix dans le cadre de missions
onusiennes et de l'Union Africaine.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 31
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
CHAPITRE 1 :
PRESENTATION GENERALE DE L'ECOLE
INTERNATIONALE DES
FORCES DE SECURITE
(EIFORCES)
En réponse à la correspondance du Coordonnateur
du Centre de Recherche d'Études Politiques et Stratégiques
(CREPS) de l'Université de Yaoundé II-Soa, sollicitant les Stages
en faveur des étudiants de Master II de la Douzième Promotion du
Master en Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion des
Conflits et des Catastrophes, Monsieur le General de Brigade, Directeur
Général de l'EIFORCES y a répondu favorablement par
courrier N°190107/LE/EIFORCES/DG/CRD du 21 Février 2019, tout en
demandant aux étudiants concernés de prendre l'attache, du
Professeur Wullson MVOMO ELA, Directeur du Centre de Recherche et de
Documentation de son Institution. C'est ainsi que préalablement
prévu pour la période allant du 01 Mars 2019 au 01 Juin 2019,
ledit Stage a effectivement débuté le 1er Juin 2019 pour une
période de trois (03) mois. Ce Stage qui s'est déroulé en
deux grandes phases, nous a permis de vivre le quotidien du personnel de
l'Ecole Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES). Il sera
donc question dans le présent Chapitre, de la présentation pour
un premier temps de l'organisation, fonctionnement et les missions de
l'EIFORCES, (section I), et ses coopérations et partenariats (section
II).
SECTION 1 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET LES
MISSIONS DE
L'EIFORCES
Dans cette partie il est important de présenter
l'architecture de l'EIFORCES
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 32
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
PARAGRAPHE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
L'EIFORCES
L'organisation et le fonctionnement de l'EIFORCES seront
énoncés à travers la présentation de ses Organes
d'Administration et de Gestion (A), la Direction Générale (B) et
les Organes consultatifs (C), tels que prévus par les décrets de
2008 et 2012 susvisés.
A- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EIFORCES
Au sens de l'article 5 du décret de 2012, le Conseil
d'Administration est l'Instance supérieure de gestion de l'EIFORCES. Il
est chargé de :
V' Approuver les modalités d'organisation et de
fonctionnement ;
V' Approuver l'organigramme, le statut, le règlement
intérieur et le tableau unique des
effectifs et des matériels ;
V' Adopter sur proposition du Directeur Général et
après avis du Conseil Pédagogique,
le programme d'activités et le plan de formation
périodique ;
V' Fixer les règles de répartition des quotas des
stagiaires entre les Etats demandeurs ;
V' Approuver les règles de recrutement des enseignants,
chercheurs et personnels
associés ;
V' Adopter après contrôle et/ou audit, les bilans
d'activités, les comptes administratifs et
financiers de l'exercice précédent
V' Approuver le rapport d'activités et le plan d'action,
adopter le budget de l'exercice
suivant ;
V' Fixer les règles de réception et d'affectation
des différents concours financiers ;
V' Approuver les règles de tarification des prestations
effectuées par l'EIFORCES ;
V' Faire toutes propositions relatives à
l'évolution des statuts de l'EIFORCES ;
V' Approuver les programmes de formation et de recherches
conduits par l'EIFORCES ;
V' Approuver les manuels de procédure.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 33
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
? COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'EIFORCES
Outre ses missions, la composition du Conseil d'Administration
de l'EIFORCES obéit aux critères de l'internationalité. En
effet, les membres du Conseil d'Administration de cette Institution sont des
citoyens Camerounais d'une part et d'autre part, les ressortissants des
Organismes internationaux et Etats contributeurs. Pour les membres Camerounais,
ils sont nommés par décret du Président de la
République, pour une durée de trois (03) ans renouvelables. Quant
aux représentants des Organismes et Etats contributeurs, ils sont
désignés conformément aux procédures internes
desdits Organismes et Etats. Le Conseil d'Administration se réunit deux
fois par an en Session ordinaire sur convocation de son président et en
Session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son
président ou de la majorité des trois tiers de ses membres. Ses
décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés, la voix du président étant
prépondérante en cas de partage de voix. Sa composition est
constatée par décret du Président de la République
et son secrétariat est assuré par le Directeur
Général de l'EIFORCES, assisté d'un Officier de la
Division de la Coopération Militaire du Ministère de la
Défense. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret de
2012, le Conseil d'Administration de l'EIFORCES est composé comme suit
:
Président : le Ministre délégué
à la Présidence Chargé de la Défense ; Membres :
- Le Ministre Chargé des Relations Extérieures ou
son représentant ;
- Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de
la Défense, Chargé de la Gendarmerie
Nationale ou son représentant ;
- Le Délégué Général à
la Sûreté Nationale ou son représentant ;
- Un représentant de la Présidence de la
République ;
- Le Préfet du Département de la Mefou et Afamba
;
- Un représentant de chaque Organisation internationale ou
de chaque État Contributeur ;
- Un représentant du Système des Nations Unies au
Cameroun ;
- Un représentant de l'Union Africaine ;
- Un représentant de la Communauté
Économique des États de l'Afrique Centrale.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 34
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
B- LA DIRECTION GENERALE DE L'EIFORCES
Au sens de l'article 14 du décret N°2012/307 du 25
Juin 2012 portant organisation et fonctionnement de l'EIFORCES, l'EIFORCES est
dirigé par un Directeur Général, Officier
Général de la Gendarmerie Nationale, nommé par
décret du Président de la République. Il est
assisté d'un Directeur Général Adjoint, haut fonctionnaire
de la Police, nommé dans les mêmes conditions et le remplace en
cas d'absence. Le Directeur Général de l'EIFORCES est responsable
de la gestion et de l'application de la politique de l'EIFORCES. À ce
titre, il est chargé de :
- Exercer toutes les fonctions d'administration qui ne sont
pas expressément réservées au Conseil d'Administration
;
- Soumettre au Conseil d'Administration le projet du budget et
les comptes annuels ;
- Soumettre au Conseil d'Administration, les rapports
d'activités et financiers annuels ; - Soumettre au Conseil
d'Administration le plan d'activités triennal et le programme
d'activités pédagogiques annuel ;
- Mettre en oeuvre le plan d'activités triennal et le
programme annuel d'activités académiques, approuvés par le
Conseil d'Administration
- Exercer tout pouvoir hiérarchique qui lui est
délégué par le Conseil d'Administration - Exercer
l'autorité hiérarchique sur les personnels de tous statuts mis
à la disposition de l'EIFORCES ;
- Exercer son entière autorité sur les
personnels propres à l'EIFORCES, qu'il recrute et licencie
éventuellement conformément à la réglementation en
vigueur ;
- Signer les baux, contrats et conventions ;
- Représenter l'EIFORCES dans tous les actes de la vie
civile et aussi en justice ;
- Faire au Conseil d'Administration, toute proposition
relative à l'évolution du statut de l'EIFORCES.
La Direction Générale de l'EIFORCES comprend :
- Le Cabinet du Directeur Général ;
- La Direction des Études ;
- La Direction Administrative et Financière ;
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 35
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
- La Direction Technique et Logistique ;
- Le Centre de Recherches et de la Documentation.
? LE CABINET DU DIRECTEUR GENERAL
Il comprend :
- Les Conseillers Techniques ;
- La Division de la Coopération et des relations
publiques ;
- Le Secrétariat particulier du Directeur
Général ;
- Le Secrétariat du Directeur Général
;
- Le bureau des moyens généraux ;
- Les Officiers de liaison ;
- L'Unité de commandement et des services ;
- La Porte-fanion ;
- Le bureau des transmissions.
? DE LA DIRECTION DES ETUDES
Placée sous l'autorité d'un directeur, Officier
de Gendarmerie ou haut fonctionnaire de Police nommé par décret
du Président de la République, la direction des études est
chargée de la prospective, de la planification, de l'exécution et
du suivi du programme pédagogique, de la gestion des services
multimédia et de la traduction. Elle comprend :
- La Division de l'Enseignement Supérieur de
sécurité et de préparation aux opérations de
soutien à la paix ; Placée sous la responsabilité d'un
Officier de Gendarmerie ou d'un fonctionnaire de Police Expert en
opérations de soutien à la paix, nommé par décret
du Président de la République,
- La Division de l'Enseignement Supérieur est
chargée de la formation des cadres de maîtrise, de conception, des
décideurs et gestionnaires de missions de sécurité et de
soutien à la paix. Elle comprend, un bureau formation, un bureau
évaluations et un secrétariat.
- La Division de l'Enseignement Fondamental de
sécurité et de préparation aux opérations de
soutien à la paix ; Aux termes des dispositions de l'article 21 du
décret de 2012, la Division de l'Enseignement fondamental est
placée sous la responsabilité d'un Officier de Gendarmerie ou
d'un fonctionnaire de Police Expert en opération de
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 36
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
soutien à la paix nommé par décret du
Président de la République. Elle est chargée, en liaison
avec l'Ecole Nationale Supérieure de Police et le Commandement des
Ecoles et Centres d'Instruction de la Gendarmerie, de planifier, d'organiser et
de dispenser les enseignements de niveau tactique dans les domaines de l'Ordre
public, de la Police judiciaire et du Commandement des Unités de Police
Constituées.
Elle comprend :
· Un pôle Police Judiciaire,
· Un pôle ordre public, un bureau
d'évaluations et un secrétariat ;
· Le Service de la traduction et de l'interprétariat
;
· Le service multimédia ;
· Les assistants techniques ;
· Le secrétariat.
? LE CENTRE DE RECHERCHE ET DEDOCUMENTATION
(CRD)
Placé sous la responsabilité d'un Officier de
Gendarmerie ou fonctionnaire de Police ou Expert civil nommé par
décret du Président de la République, le Centre de
Recherche et de la documentation de l'EIFORCES est chargé de conduire
des recherches scientifiques et techniques dans le champ de la
sécurité et de la préparation aux opérations de
soutien à la paix. Le Centre de recherche et de la documentation
comprend ; les laboratoires de recherches, la Cellule de documentation et le
Secrétariat.
? LA DIRECTION ADMINISTATIVE ET FINANCIERE
(DAF)
Elle est placée sous l'autorité d'un directeur,
Officier de Gendarmerie ou haut fonctionnaire de Police, nommé par
décret du Président de la République. La Direction
administrative et financière est chargée de :
- Satisfaire aux besoins des formations et du personnel dans
les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations
définies par le Conseil d'Administration en matière
d'administration générale. Dans ce cadre, elle participe à
l'élaboration de la réglementation relative à
l'administration générale et au soutien de l'École, des
textes
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 37
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
réglementaires intéressant l'organisation de
l'École et des services de soutien et du
budget et du suivi de son exécution.
- La production des rapports financiers et des documents
comptables ;
- L'expression des besoins et de l'élaboration des plans
financiers et d'amortissement
des équipements, matériels et des infrastructures
;
- Veiller à la régularité, à la
fidélité et à la sincérité des
comptabilités
- Elle s'assure du respect des procédures comptables,
participe à l'organisation et à la
mise en oeuvre du contrôle interne budgétaires et
comptable ;
- Contribuer à l'évaluation de la performance
financière de l'École et des services de
soutien ; elle leur apporte le concours de ses moyens d'audit
interne comptable et
financier ainsi que dans d'autres domaines, à la demande
du commandement ;
- Assister le directeur général dans la passation
des marchés et l'exécution des contrats
et conventions de toute nature ;
- L'administration des personnels ;
- L'alimentation, l'hébergement, l'hôtellerie et les
loisirs.
La Direction Administrative et Financière comprend :
- Le Secrétariat ;
- Le Service Administratif et Financier ;
- Le Service Restauration, Hôtellerie, Hébergement
et Loisirs.
? LA DIRECTION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Au sens de l'article 30 du décret de 2012, cette
direction est placée sous l'autorité d'un Directeur, Officier de
Gendarmerie ou haut fonctionnaire de Police, nommé par décret du
Président de la République.
Elle est chargée :
- Du soutien technique et logistique des services ;
- Des études, de la planification et de la gestion
prévisionnelle des approvisionnements - De la production des documents
comptables ;
- De l'expression des besoins et de l'élaboration des
plans d'amortissement des équipements, des matériels et des
infrastructures en rapport avec la direction administrative et
financière ;
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 38
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
- De la gestion des matériels ;
- D'assurer l'exploitation, le contrôle et l'entretien des
matériels en dotation ;
- D'assurer le transport des biens et des
personnels ;
- De contribuer à la rédaction des rapports
financiers ;
- De tenir la comptabilité des matériels ;
- D'entretenir les infrastructures et les installations
techniques ;
- De la gestion des approvisionnements, de l'armement, des
minutions, de l'optique, des matériels roulants et de maintien de
l'ordre ;
- Des études, des spécifications, du
contrôle et de la maintenance des matériels relevant de sa
compétence ;
- De la gestion des approvisionnements et des stocks
correspondant ;
- D'assurer la réception, l'entreposage, la livraison
et la tenue de la comptabilité «
matières » de l'ensemble du matériel mobile
placé en position d'approvisionnement ; - De l'habillement, du couchage,
du campement, l'ameublement, de la substance et des
prestations accessoires de vie courante, soutien santé,
hygiène et salubrité.
C- LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'EIFORCES
Prévus par l'article 35 du décret de 2012
portant organisation et fonctionnement de l'EIFORCES, les Organes consultatifs
sont constitués à la demande du Conseil d'Administration et donne
leur avis sur tous les problèmes soumis à leurs
appréciations. Ils sont au nombre de deux, à savoir le Conseil
Pédagogique et le Comité de Gestion.
? LE CONSEIL PEDAGOGIQUE Il a pour principales
attributions :
- L'élaboration des programmes de formation ;
- L'établissement des programmes d'activités
annuels ;
- L'évaluation et le contrôle des formations ;
- La consultation pour l'organisation des examens ;
- La promotion des relations avec les autres Centres de maintien
de la paix.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 39
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Elle est composée d'un Président (Directeur
Général de l'EIFORCES) ; un Vice-président (Directeur
Général adjoint) et des Membres (Instructeurs permanents)
? LE COMITE DE GESTION
Il a pour mission principale d'assister le Directeur de
l'École dans ses tâches d'administration et de gestion.
Sa composition :
Président : Directeur Général de
l'EIFORCES.
Membres : Directeur Général Adjoint ; Directeur
affaires Administratives ; Les chefs de service de ladite Direction.
Le Département des Opérations de Maintien de la
Paix (DOMP) de l'ONU et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale (CEEAC) y ont voix délibérative. Pour étayer
cette brève présentation de l'EIFORCES, nous allons la
schématiser en y joignant ci-dessous son Organigramme
Figure 1 : Organigramme de l'EIFORCES
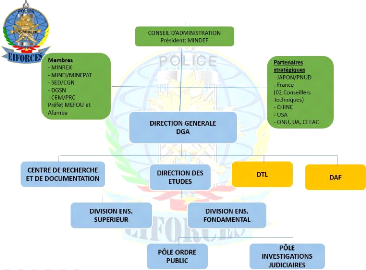
Source : Bulletin d'analyse Stratégique et
Prospectives, «VIGIE» N°s 003 et 004 -Décembre 2014.
/EIFORCES.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 40
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
PARAGRAPHE 2 : LES MISSIONS DE L'EIFORCES
Aux termes des dispositions de l'article 3 du même
décret, l'EIFORCES a pour mission de former, entraîner, recycler
et perfectionner les cadres de maîtrise et de conception, civils et
militaires, aux missions de police à l'intérieur ; les
Unités constituées de types Gendarmerie et Police dans le cadre
des opérations de soutien à la paix. Elle est un cadre par
excellence de formation et de perfectionnement des experts civils et
militaires, des commandants des Unités de Police Constituées aux
opérations de soutien à la paix. En outre, l'EIFORCES est un
centre de recherche dans les domaines du soutien à la paix et de la
sécurité. C'est un cadre d'accueil aux stagiaires des pays
partenaires partageant les mêmes idéaux de paix et de
sécurité. Tout compte fait, force est de constater que ses
missions sont orientées vers la formation et la recherche.
A- LA FORMATION
Pour observer sa mission de formation, l'EIFORCES s'appuie sur
la direction des études qui développe des enseignements
pluridisciplinaires aux plans stratégique, opératif et même
tactique dans le sillage de la sécurité intérieure et des
opérations de soutien à la paix destinés aux civils,
policiers et gendarmes. Elle est tenue autour de deux divisions
d'enseignements.
? La division de l'enseignement supérieure.
Elle conduit les formations suivantes :
? Le Brevet d'Etudes Supérieures de Sécurité
(BESS) ;
? Le Diplôme d'Etat-major des Forces de
Sécurité (DEMFS) ;
? Les séminaires thématiques relatifs à
la gouvernance sécuritaire, la protection des civils et des enfants, la
lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la
négociation et médiation dans les opérations de soutien
à la paix.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 41
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
> La division de l'enseignement
fondamental
Elle comprend deux pôles : ? Le pôle ordre public
Il a plusieurs visés divers à savoir :
V' Formation des formateurs en ordre public (FOP) ;
V' Perfectionnement au Commandement opérationnel niveau 2
(PCO2) ;
V' Recyclage des formateurs en ordre public ;
V' Moniteurs en franchissement opérationnel ;
V' Neutralisation/ Destruction des Engins Explosifs (NEDEX) ;
V' Technicien opérationnel en protection des hautes
personnalités ;
V' Formation des unités de police constituées
(UPC/FPU) ;
V' Formation pré déploiement des policiers
individuels.
? Le pôle police judiciaire
Il offre une formation multiple relevant de :
V' Equipe Projetable d'Experts en Investigation (EPEI) ; V'
Police d'accompagnement (prévôté) ;
V' Police Technique et Scientifique ;
NB : les partenaires sont dotés d'une liberté de
solliciter le site de l'EIFORCES basé à Awaé, et les
formateurs pour la réalisation de leurs formations.
Somme toute, de la création de l'EIFORCES à nos
jours, plus de 2500 civils, gendarmes et policiers originaires de 24 pays
d'Afrique y ont été formés. Par ailleurs, 555 policiers et
gendarmes d'une vingtaine de pays africains et européens ont
été entrainés lors de l'exercice de la composante police
baptisé « EUPST » Awaé 2014 pendant un mois, dans le
cadre du projet « European Union Police Service Training (EUPST).
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 42
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
B- LA RECHERCHE
A travers son Centre de Recherche et de Documentation (CRD),
l'EIFORCES effectue des travaux de recherche fondamentale et appliquée
dans les domaines de la sécurité, toutes les déclinaisons
confondues, et des OPS. Les travaux de recherche du CRD/EIFORCES sont
destinés à éclairer les évolutions de
l'environnement sécuritaire ; renforcer les capacités
d'anticipation des systèmes de sécurité africains ;
assurer la veille stratégique, contribuer à l'aide à la
décision ; élaborer des concepts pour la doctrine d'emploie des
forces ; tirer les leçons des expériences pour consolider aussi
bien la formation que les mécanismes et capacités d'intervention
de paix et de sécurité. C'est autour de deux axes que le CRD
oriente ses activités.
> Publications
Le CRD fait des publications scientifiques périodiques
dont les plus en vue sont : la note de conjoncture, le bulletin d'analyse
stratégique et prospective intitulé VIGIE, la Revue Africaine de
Sécurité Internationale (RASI). Il réalise
également des publications thématiques ad hoc, liées
à des évolutions spécifiques de l'environnement
sécuritaire, ainsi que des rapports et publications des résultats
de ses rencontres scientifiques, dont les actes de colloques. Les travaux
récents d'analyse stratégique et prospective du CRD ont
été focalisés sur des thèmes de première
importance :
V' Les motos taxis comme vecteurs d'insécurité en
zone urbaine et périurbaine.
V' Les menaces transfrontalières en Afrique centrale
V' La compréhension et la lutte contre le terrorisme de
Boko Haram
V' Les réfugiés et déplacés dans les
systèmes de conflits Bassin du Lac Tchad
V' Les dynamiques et perspectives de la force multinationale
mixte du Bassin du Lac
Tchad.
Le CRD organise des colloques et symposiums, conduit des
travaux spécifiques sur des thématiques relatives à la
paix et à la sécurité nationale et internationale.
> Séminaires et colloques internationaux
organisés
V' 2013 : « l'efficacité des opérations de
maintien de la paix en Afrique centrale : rétrospective critique et
prospective » ;
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 43
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
y' 2014 : « Quelle paix, quelle sécurité,
quel développement durable pour la République Centrafricaine ?
» ;
y' 2016 : « Quelle gouvernance globale face à la
montée de l'extrémisme violent en Afrique médiane »
;
y' 2016 : « Les synergies populations-forces de
défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme
au Cameroun » (en partenariat avec l'ESIG de Yaoundé Simbock) ;
y' 2017 : « Gouvernance et gestion démocratique
des foules en Afrique : dispositifs, pratiques, défis et enjeux
transformationnels » ;
y' 2018 : - « Séminaire de programmation de la
recherche sur les problématiques sécuritaires dans le Bassi du
Lac Tchad » ; - « Séminaire de recherche sur les défis
et enjeux de la cybercriminalité en Afrique centrale ».
SECTION 2 : COOPERATION ET PARTENARIATS
Il convient de noter préalablement que les
activités conduites par l'EIFORCES en vue d'accomplir ses missions sont
soutenues à titre principal par les moyens mis à sa disposition
par le gouvernement de la République du Cameroun. En effet elle
reçoit une dotation budgétaire annuelle pour son fonctionnement,
ainsi que des dotations spécifiques pour l'investissement, notamment
dans le domaine infrastructurel et des équipements. Quant au personnel
de cet établissement public, il est issu des corps de la Gendarmerie et
de la police ainsi que des corps civils de l'Etat. L'emploi optimal de
l'ensemble des ressources humaines, financières et matérielles
est assuré conforment aux exigences de la bonne gouvernance. L'EIFORCES
est un établissement public de droit Camerounais jouissant de la
personnalité juridique et d'une autonomie financière. La tutelle
technique est assurée par la Gendarmerie Nationale (GN) et la
Délégation Générale à la Sûreté
Nationale (DGSN) et la tutelle financière par le Ministre des finances.
Certaines administrations nationales sont membres du conseil d'administration
aux cotés des pays contributeurs et certaines institutions et
organisations internationales partenaires. La coopération est
bilatérale et multilatérale.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 44
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
PARAGRAPHE 1 : AU PLAN BILATERAL
Plusieurs Etats soutiennent depuis 2012 les programmes de
formations, de recherches, d'équipements et de renforcement des
capacités institutionnelles de l'école. Il s'agit
particulièrement de :
? La Chine qui soutient l'EIFORCES avec des moyens roulants et
divers équipements ; ? Les Etats Unis d'Amérique avec son appui
dans l'acquisition des équipements ;
? La France avec un accent particulier sur la formation au niveau
pole ordre public et
apporte son expertise à travers la mise à
disposition de deux Conseillers Techniques
permanents, ainsi que l'organisation des missions d'expertise
ponctuelles.
? Le Japon à travers le programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) qui appuie la formation, la recherche et
l'acquisition des équipements.
PARAGRAPHE 2 : AU PLAN MULTILATERAL
L'ONU organise avec l'EIFORCES des stages pilotes de formation
des formateurs des UPC/FPU et de pré déploiement (policiers
individuels, protection des enfants dans les OSP). Labellisée centre
d'excellence de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
et l'Union Africaine, l'EIFORCES est inscrite dans le processus de
reconnaissance comme centre d'excellence et de certification de ses formations
par les Nations Unies. Le PNUD appuie l'école dans l'acquisition des
équipements, le financement des formations et des activités de
recherche, ainsi que le développement des capacités
institutionnelles et la mise en réseau avec des institutions ayant des
activités similaires ou complémentaires. L'Union
Européenne (UE) est l'un des partenaires privilégiés de
l'EIFORCES. En plus de l'organisation de l'exercice EUPST et d'un
séminaire d'évaluation des programmes ainsi que de divers dons de
matériels pédagogiques, didactiques, informatiques et autres,
elle a financé conjointement avec le Cameroun et l'appui de la CEEAC,
sept (07) promotions des formations de longues durées au niveau
stratégique et opératif.
L'EIFORCES est affiliée au réseau international
francophone de formation policière (FRANCOPOL) ; au réseau
d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix.
(REFFOP) ; à l'African Peace Support Trainers Association (APSTA) qui
fédère la quasi-
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 45
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
totalité des centres oeuvrant à la formation en
matière d'opérations de soutien à la paix en Afrique, et
dont la mission principale est de faciliter le développement des
capacités pour le paix et la sécurité grâce à
la coordination, l'harmonisation, la standardisation de la préparation
de la force africaine en attente et le soutien à a la perception et la
mise en oeuvre des politiques de formation et de recherche entre ses
institutions membres. International Association of Peacekeeping Training Center
(IAPTC), l'Association mondiale dont l'APSTA est le chapitre africain ;
Peacekeeping Operation Training Institute (POTI), centre de formation en ligne
en font aussi partie
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 46
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
CHAPITRE 2 :
DEROULEMENT DU STAGE A
L'EIFORCES
Ce chapitre présente les acquis et les
difficultés rencontrées à l'EIFORCES et des suggestions
dans la perspective assez innovante pour l'évolution de ladite
structure.
SECTION 1 : ACQUIS, DIFFICULTES ET SUGGESTIONS
EVENTUELLES
Cette section est une opportunité pour nous d'exprimer
notre gratitude sur les éléments nouveaux, quantitatifs et
qualitatifs que nous avons acquis pendant la période de notre Stage et
de relever les difficultés rencontrées durant la période
considérée (Paragraphe I). C'est également le lieu par
excellence d'y envisager une étude prospective (Paragraphe II),
salutaires pour les promotions futures qui seront acceptées à
l'EIFORCES.
PARAGRAPHE 1 : LES ACQUIS ET LES DIFFICULTES
RENCONTREES
Ce paragraphe sera développé à travers le
profit que nous a procuré notre passage à l'EIFORCES (A) et les
épreuves que nous été amenés à surmonter
pour la réalisation de notre étude (B).
A- L'APPORT DU STAGE
Ce Stage nous a permis l'accès à un milieu
prioritairement consacré aux questions de sécurité
nationale en général et plus spécifiquement aux question
de Défense. De la sorte, notre passage à l'EIFORCES nous a permis
de relever que certaines missions que nous pensions être la chasse
gardée de la Sûreté Nationale, notamment en matière
de renseignement prévisionnel et de la Police Judiciaire,
relèvent également, malgré leur subsidiarité, de la
compétence du
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 47
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
MINDEF. Ledit Stage nous a également été
d'un grand privilège. En effet, notre contact avec cette prestigieuse
Institution de Formation en matière de Sécurité
intérieure et d'opérations de soutien à la paix nous a
permis d'approcher des hauts cadres, nationaux et étrangers. Quant au
volet pédagogique, il est centré sur notre participation, (en
auditeur libre), aux cours de haut niveau, dispensés au sein des
formations de l'EIFORCES, en l'occurrence à la Division de
l'Enseignement fondamental et à la Division de l'Enseignement
Supérieur.
B- LES DIFFICULTES RENCONTREES
L'obstacle majeur de notre Stage a été
l'indisponibilité du responsable de la Direction de la Recherche et de
la Documentation de l'EIFORCES rencontré durant le séjour une
seule fois après maintes attentes et rendez-vous manqués. Cette
indisponibilité a également porté un sérieux coup
sur la période de notre Stage Académique. Une telle
complexité nous a conduit au cabinet du Directeur de ladite institution
plus précisément dans le service du Conseillé Technique
n°3 par ailleurs Chef du Cabinet du Directeur Général. La
deuxième difficulté a été le manque d'un planning
de suivi pour le stage qui n'a pas favorisé les échanges avec
certains hauts cadres de l'EIFORCES répartis dans les deux sites qui
constituent cette structure (Yaoundé et Awaé). La dernière
difficulté non négligeable a été le manque
d'information. A l'EIFORCES, les questions de sécurité
relèvent des informations sensibles intéressant le très
haut commandement. C'est ainsi que sous cet aspect, certains hauts cadres
classifient même les informations les plus générales en
rapport avec la Structure ou l'administration considérée.
PARAGRAPHE 2 : LES SUGGESTIONS
Relativement aux difficultés rencontrées, les
mesures suivantes paraissent nécessaires pour un meilleur encadrement
des étudiants admis en Stage académique à l'EIFORCES.
L'Administration de l'EIFORCES devrait mettre un accent
particulier dans l'accueil des étudiants en fin de cycle de Master II en
Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion des Conflits
et des Catastrophes compte tenu de la spécificité du contenu des
enseignements de cette Filière. Le Centre de Recherche et de
Documentation, véritable laboratoire en matière de
Sécurité et de missions non militaires de l'ONU, parait mieux
outillé pour leur encadrement sous la coordination de la Direction des
Études. Cet encadrement aurait également pour objectif
l'identification des compétences futures en la matière, pour leur
éventuelle contribution à l'émergence de ce Centre
d'Excellence.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 48
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
CONCLUSION PARTIELLE
Pour terminer, le Stage Académique que nous avons
effectué à l'Ecole Internationale des Forces de
Sécurité (EIFORCES) pendant la période allant de Mars
à Mai 2019, en vue de l'obtention du Master en Stratégie
Défense Sécurité Gestion des Conflits et des Catastrophes,
s'est déroulé sous la supervision du Général de
brigade, Directeur Général de l'EIFORCES et la coordination du
Lieutenant-Colonel NJOYA MOUTAPMBEMO Mannoni Thierry. L'encadrement
académique est reconnu au Pr Frank EBOGO, Coordonnateur Adjoint du
Master en SDSGCC au CREPS.
En effet, Il avait pour principal objectif, l'enrichissement
de nos connaissances professionnelles en données techniques non
classifiées sur l'option « Stratégie Défense
Sécurité Gestion des Conflits et des Catastrophes ». Les
obstacles rencontrés durant ce Stage ont été
surmontés ; ce qui nous a permis de procéder à une
étude prospective de notre séjour, en faveur des promotions
futures du CREPS et d'autres étudiants des Universités et Grandes
Ecoles qui pourraient solliciter la même structure d'accueil que nous.
Enfin il est impératif de noter que l'EIFORCES est en bonne voie de
relever les défis pluriels à court, moyen et long termes relevant
du domaine de la stratégie, défense, sécurité
gestions des conflits et des catastrophes en rapport aux opérations de
soutien à la paix ceci à travers la recherche des financements
pour la réalisation de plan de développement infrastructurel et
d'équipement en vue de satisfaire de façon optimale les besoins
en formation et recherche pour la paix, la sécurité et la
stabilité en Afrique et dans le monde.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 49
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
DEUXIEME PARTIE :
CONSTRUCTION DU DISPOSITIF DE VEILLE
SECURITAIRE AU
CAMEROUN A L'AUNE DE LA
MENACE BOKO HARAM.
Le travail d'analyse de cette deuxième partie permettra
de répondre à la problématique du travail de recherche en
montrant comment le Cameroun est parvenu à la redynamisation du
dispositif de veille sécuritaire sous la menace Boko Haram. Dans le
chapitre III, il sera question de présenter la sociogenèse de la
menace Boko Haram et les répercussions sur le développement de
l'Extrême-Nord Cameroun en rapport en prenant appui sur l'idée
selon laquelle, Boko Haram est issu d'un mouvement de protestation sociale
à la constitution d'un ordre terroriste qui pose une
problématique de la mise en oeuvre des stratégies de lutte. Le
chapitre IV sera l'occasion de développer le premier argument, qui
démontre que la résilience de la menace Boko Haram à
l'épreuve de la construction s'explique par les facteurs
statiques-dynamiques stratégiques et opérationnels. Le second
argument, expose les autres moyens de combats appropriés contre BH,
faisant ressortir des perspectives et les impératifs
stratégiques, opérationnels. Ce travail de recherche sera
clôturé par une conclusion générale.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 50
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
CHAPITRE 3 :
SOCIOGENESE DE LA MENACE BOKO HARAM ET
REPERCUSSIONS
SUR LE DEVELOPPEMENT A
L'EXTREME-NORD DU CAMEROUN.
Si Boko Haram est aujourd'hui un phénomène
transnational bien connu, il est nécessaire de préciser qu'il est
l'aboutissement de plusieurs mouvements pour la constitution d'un ordre
terroriste.
SECTION 1 : SOCIOGENESE DE LA MENACE BOKO HARAM
La sociogenèse de la menace Boko Haram est un travail
d'exposé sur BH dans sa diachronie et sa synchronie. BH est issu d'un
mouvement de protestation sociale au Nigeria voisin du Cameroun. Ce groupe
djihadiste transfrontalier bascule dans la clandestinité et le
terrorisme au fil de temps.
PARAGRAPHE1 : D'UN MOUVEMENT DE PROTESTATION
SOCIALE A LA CONSTITUTION D'UN ORDRE TERRORISTE.
Boko Haram a émergé au début des
années 2000 comme un minuscule groupe de contestation au Nigéria
(A), avant de croitre et devenir un ordre terroriste transnational (B)
très actif au Nigéria à la fin de l'an 2009 pour se
régionaliser à partir de 201124.
24 Agbiboa Daniel (2013a), Is
Might Right? Boko Haram, the Joint Military Task Force, and the Global Jihad;
Military and Strategic Affairs | Volume 5 | No. 3 |.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 51
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
A- BOKO HARAM : MOUVEMENT DE CONTESTATION
SOCIALE
De l'an 2000 à 2008, BH était un mouvement de
contestation sociale aussi minuscule au Nigéria. Au début des
années 2000, lorsque Mohamed Yussuf, le premier leader et fondateur de
Boko Haram, avec le soutien de plusieurs de ses adeptes et autorités
locales, a décidé de créer le groupe Boko Haram, il
s'agissait d'un groupuscule ou groupe minuscule qui avait plusieurs
revendications. La principale revendication de Boko Haram était le
retour aux valeurs pures de l'Islam et de l'éducation selon des valeurs
islamiques qui ne seraient pas en contradiction avec leur conception de la foi
et la tradition25. Force est de retenir que Boko Haram, dans sa
première phase, était un minuscule groupe qui n'utilisait la
violence que par moment26, mais dénonçait surtout les
tares de la société nigériane et revendiquait avec
insistance une application stricte de la Sharia, de l'éducation
islamique et les meilleures conditions socio-économiques dans le nord du
Nigéria. À cette période, une réponse des
autorités nigérianes visant à s'adresser à ces
multiples dénonciations et revendications de manière constructive
à travers une politique de développement visant les zones pauvres
du nord du pays, l'amélioration des conditions socioéconomiques
des populations du nord du Nigéria, la lutte contre la corruption et la
mauvaise gouvernance, et surtout à la réalisation des promesses
faites lors des élections qu'elles soient locales ou nationales, aurait
peut-être pu endiguer cette menace, mais elle n'a pas eu lieu.
B- BOKO HARAM : UN ORDRE TERRORISTE
TRANSNATIONAL
BH va basculer dans la clandestinité et le terrorisme,
après l'exécution extrajudiciaire de Mohamed Yusuf par la police
nigériane, en 2009. Reprise en main par un imam autoproclamé,
Abubakar Shekau, la « Congrégation des Compagnons du
Prophète pour la propagation de la tradition sunnite et la guerre sainte
» (Jama'atu Ahlis-Sunnah Lidda'awati Wal Jihad) est aujourd'hui plus
connue sous le nom de Boko Haram (« l'éducation d'inspiration
occidentale est un sacrilège »), sobriquet qu'elle récuse.
Avec la proclamation d'un état d'urgence et l'établissement de
milices paragouvernementales en 2013, le groupe a commencé à
massacrer
25 Azumah John (2015) Boko Haram in Retrospect, Islam
and Christian-Muslim Relations, 26:1, 33-52.
26 Tran Ngoc Leatitia (2012), Boko Haram-Fiche
documentaire, Note d'analyse du Groupe de Recherche et d'Information sur la
Paix et la Sécurité
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 52
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
des civils pour les dissuader de collaborer avec les forces de
sécurité. Parallèlement, il s'est criminalisé et a
viré au brigandage en attaquant des banques, en rançonnant les
commerçants et en kidnappant des notables ou les rares expatriés
encore présents dans la zone. Privé de chef charismatique depuis
la disparition de Mohamed Yusuf, il s'est également fractionné,
certains de ses éléments contestant la brutalité
d'Abubakar Shekau, lui reprochant de tuer essentiellement des musulmans.
Dès 2012, apparaissait ainsi une dissidence appelée Ansaru ou, de
son nom complet, la « Communauté des défenseurs des
musulmans noirs » (Jama'at Ansar Al Muslimin Fi Bilad al-Sudan). Tandis
que se mettait en place une coalition antiterroriste internationale avec les
forces armées du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun,
début 2015, une partie des combattants de Boko Haram prêtait
allégeance à l'organisation État islamique (souvent
désignée par son acronyme arabe, Daech), se faisant
désormais appeler « Province de l'État islamique en Afrique
de l'Ouest » (Wilayat Gharb Ifriqiyah). Force est de souligner que De 2009
à 2012, BH connait des mutations qui l'érigent au rang d'un
groupe terroriste d'envergure transnationale et régionale jusqu'à
nos jours. Les revendications croissantes des adeptes du groupe Boko Haram et
l'augmentation de son emprise sociale dans le Nord du Nigéria ont
été une source d'inquiétude pour le gouvernement
nigérian. En juin 2009, Boko Haram a refusé de se conformer
à une directive locale exigeant de porter des casques lors de tout
déplacement motorisé dans l'État de Bauchi, au Nord du
Nigéria27. Il est singulier à la lecture de ses modes
opératoires divers et parfois confus.
Les modes opératoires du groupe terroriste BH sont
connus et apparaissent évolutives dans l'espace et le temps. BH a
d'abord commencé par. Si l'argumentaire idéologique de Boko Haram
est relativement simple : celui qui tue des Infidèles pour Allah aura
droit à la vie éternellement heureuse au Paradis des Justes ; Le
but de l'existence humaine étant l'instauration du Califat Islamique
mondial ; BH fait recours aux moyens les plus extrêmes de la
confrontation militaire.
? L'attaque-suicide et la projection
incontrôlée des bombes et engins explosifs improvisés dans
les zones urbaines.
C'est le cas par exemple des attentats dans la capitale
nigériane Abuja visant d'une part le siège de la police en juin
2011, et d'autre part le bâtiment des Nations Unies en août
201128.
27 Maiangwa Benjamin (2014b), Soldiers of God or
Allah': Religious Politicization and the Boko Haram Crisis in Nigeria, Journal
of terrorism Research.
28 Lire Mbia Yebega Germain-Herve (2015),
Terrorisme et contre-terrorisme en Afrique centrale : quelle vision
stratégique pour le Tchad et le Cameroun ? Note d'analyse No15,
Observatoire pluriannuel des enjeux
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 53
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Des attentats ont aussi ciblé des Églises et des
marchés publics dans le nord du Nigéria et en particulier dans
l'État de Borno, fief de Boko Haram. Les moyens humains de Boko Haram
sont obtenus en outre, par l'instrumentalisation des
misérables29 abandonnés par les Etats africains, par
l'endoctrinement sectaire et par le rapt continu des personnes isolées
des dispositifs de défense nationaux. D'un bout à l'autre, la
violence est la cause et la finalité de l'action bokoharamique. Boko
Haram transforme une personne ordinaire en bombe. Le corps en munition. Ici, la
volonté de tuer à foison se fait raison de vivre. Boko Haram
fabrique méchamment et perfidement des hommes-momies, des zombies. La
prédication et la guerre sont deux aspects du même modus operandi
morbide dont le but ultime est la suprématie sur un territoire
transcontinental impressionnant. La tactique et la stratégie sont
liées chez Boko Haram. D'un point de vue tactique, comme le signale le
drapeau sombre de l'organisation sectaire, la mort gratuite et violente est
à la fois l'emblème, la devise et le mot de passe de Boko Haram.
Suprême détresse de l'homme, la mort signe l'impuissance absolue
de la conscience. Celui qui peut la donner sans limite se donne dès lors
un pouvoir absolu sur ses victimes réelles et potentielles.
? Les attaques contre les positions des forces de
défense et de sécurité.
BH cible aussi les positions des forces de défense et de
sécurité. Il attaque les postes de
combat avec des effets graves sur la vie des hommes. BH exploite
le terrain par la surprise.
Tableau1 : Régularité des attaques sur le
territoire camerounais entre mai et août 201430
|
Date
|
Lieu et circonstance de l'attaque
|
Bilan
|
|
4 mai
|
Brigade gendarmerie de Kousseri
|
2 mort dont 1 gendarme ; 3 kalachnikov, 1 fusil d'assaut
léger et des munitions emportés
|
|
5 mai
|
Localités de Gambarou Ngala-Fotokol
|
|
sociopolitiques et sécuritaires en Afrique
Équatoriale et dans les Îles du Golfe de Guinée, Groupe de
Recherche et d'Information sur la paix et la Sécurité (GRIP), 06
février
2015.
www.grip.org/fr/node/1596.
29 « Comment Boko Haram prospère sur les
inégalités, l'analphabétisme, la corruption et
l'arbitraire »
http://www.bastamag.net/Comment-Boko-Haram-prospere-sur-les-inégalités-l'analphabétisme-la-corruption-etl'arbitraire
30 Ce tableau présente les cas
récurrents d'attaques menées par les insurgés de Boko
Haram contre les
populations civiles, les positions militaires et les biens. Il
est tiré de Kaliao Volume Spécial Novembre 2014 ; Revue
pluridisciplinaire de l'École Normale Supérieure de Maroua
Série Lettres et Sciences Humaines publiée sous la direction du
Pr Saïbou Issa, Directeur de l'École Normale Supérieure de
Maroua
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 54
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
|
17 mai
|
Attaque de la base d'une
entreprise chinoise des
travaux publics à Waza
|
1 soldat mort, 4 blessés, 10 chinois kidnappés
et 12 voitures emportées
|
|
23 mai
|
Attaque d'une
embarcation sur le fleuve
Logone près de Hilé
Alifa
|
1 mort
|
|
27 mai
|
Attaque du village Guitsinad-Hitawa vers Tourou (Mayo-Tsanaga)
|
2 morts, 1 blessé
|
|
7 juin
|
Attaque du siège du
tribunal militaire de
Maroua
|
Pas de victimes
|
|
7 juin
|
Attaque du poste du BIR
de Blangochi vers
Tourou
(Mayo-Tsanaga)
|
4 mots dont 2 soldats, 3 blessés, une jeune fille
kidnappée
|
|
16 juin
|
Attaque du village
Kerawa (Mayo-Sava)
|
2 morts dont le chef de quartier de Dogolé-Kerawa
|
|
22 juin
|
Attaque du camp du 35e BIM en poste avancé
à Kidjimatari-Kolofata
|
1 soldat blessé
|
|
8 juillet
|
Brigade de gendarmerie de
Zina
|
1 gendarme blessé, 22 armes à feu
emportées
|
|
9 juillet
|
Razzia à Bamé-Kolofata
|
1 mort, 57 boeufs emportés
|
|
11 juillet
|
Attaque du poste de
gendarmerie de Bonderi (Mora)
|
1 gendarme blessé ; une voiture militaire, une caisse
à munitions et trois motos emportées
|
|
18 juillet
|
Attaque du commissariat de Limani-Mora
|
1 policier tué et un autre blessé
|
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 55
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
|
21 juillet
|
Attaque du village Naba vers Bonderi
|
1 mort, 1 blessé, des maisons brûlées
|
|
24 juillet
|
Attaque du camp du BETAP à Bagaram par Hilé
Alifa
|
6 soldats tués, 6 soldats blessés, une dizaine
de soldats portés disparus, 2 voitures, armes lourdes, munitions de
service emportés
|
|
25 juillet
|
Embuscade contre une colonne de l'armée Camerounaise entre
Kousseri et Kamouna
|
Plus de 10 soldats tués
|
|
27 juillet
|
Localité de Kolofata
|
14 personnes tuées, 6 voitures emportées, 17
personnes kidnappées dont l'épouse du vice-premier ministre du
Cameroun Amadou Ali
|
|
6 août
|
Attaque de la localité de Zigagué
|
12 personnes tuées, 2 voitures emportées, une
voiture de
police incendiée
|
|
8 août
|
Attaque du village
Tchkramari
|
2 morts, 5 motos emportées
|
|
13 août
|
Attaque de Bonderi
|
3 soldats blessés, une voiture militaire
emportée
|
|
17 août
|
Attaque de la bourgade de Greya (Mokolo)
|
3 personnes égorgées, 17 personnes prises en
otage, 300 chèvres et 200 sacs de riz emportés, une école
incendiée
|
Source : Dikalo, N°1574 du
6 mai 2014 ; L'OEil du Sahel, N°601 du 12 mai 2014 ; L'OEil du Sahel,
N°617 du 10 juillet 2014 ; L'OEil du Sahel, N°623 du 31 juillet 2014
; L'OEil du Sahel, N°622 du 29 juillet 2014, L'OEil du Sahel, N°629
du 21 juillet 2014, L'OEil du Sahel, N°629 du 21 août 2014.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 56
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
PARAGRAPHE 2 : LES REPERCUSSIONS DE LA MENACE SUR LE
DEVELOPPEMENT A L'EXTREME-NORD DU CAMEROUN
Les postes frontières de la région de
l'Extrême-Nord étaient généralement très
actifs jusqu'en 2011, en dépit de leur gestion défaillante. La
situation géographique de l'extrémité septentrionale du
Cameroun, entre Nigéria et Tchad, explique l'importance de la
région pour le commerce avec ces deux voisins. La forte baisse et les
grandes fluctuations enregistrées par les volumes de ces échanges
sont indicatives des répercussions que les violences associées
à Boko Haram ont eues sur la région. Le secteur du tourisme a
aussi été durement touché. D'autres secteurs mis à
mal sont l'agriculture, l'éducation et l'administration publique. Les
effets cumulés de la crise sur ces activités ont eu de profondes
répercussions sur les conditions de vie déjà
précaires de la population de l'Extrême-Nord ainsi que sur les
caisses de l'État camerounais en général. Les
dépenses sécuritaires supplémentaires engagées et
les pertes de recettes essuyées dans la région se sont
avérées considérables. Ces effets sont examinés
dans les paragraphes qui suivent.
A- EFFET SUR LE COMMERCE REGIONAL ET LE TOURISME
Les effets de BH se font ressentir sur le commerce
régional et le tourisme avec le risque de basculement dans la crise
économique.
1- SUR LE COMMERCE REGIONAL
Quoique mal organisés, les postes frontières, en
particulier ceux du Nord, ne manquent habituellement pas de travail. La plus
grande partie du Cameroun septentrional dépend largement du commerce des
biens à destination et en provenance du Nigéria. Les deux tiers
environ du carburant qui s'y négocie sous l'appellation locale de
zua-zua proviennent du voisin pétrolier. Parmi les autres produits
d'importation nigérians figurent les pagnes, les pièces de
véhicules automobiles, les bicyclettes, les motocycles, les sandales et
autres articles en plastique, et l'huile végétale. Les flux
commerciaux d'avant décembre 2011 s'estimaient en
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 57
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
centaines de millions de dollars des États-Unis. La
situation a changé du tout au tout à partir de 2012 et ces
chiffres se sont effondrés.
Les importations nigérianes qui transitaient
annuellement vers le Cameroun par le poste frontière de Limani-Banki
entre 2000 et 2010 sont estimées à 145 000 tonnes. Pendant la
même période, le Nigéria a importé par la même
voie des produits camerounais d'un poids annuel total estimé à
112 000 tonnes. Les produits camerounais présents sur le marché
nigérian comprennent le riz, le riz paddy non transformé du
projet de la Semry à Maga, le coton, les céréales, le
poisson, les bovins, les ovins, l'arachide, l'oignon et l'ail. Selon la
Société de Développement du Coton du Cameroun (SODECOTON),
c'est un accord commercial conclu entre le Cameroun et des partenaires
nigérians dans les années 1980 qui a ouvert la voie aux
exportations de coton camerounais vers le Nigéria où la fibre est
très demandée.31 Outre cette forte demande, le prix du
coton au Nigéria est environ trois fois plus élevé que le
cours pratiqué sur le marché camerounais. Les producteurs locaux
ont également eu recours à la contrebande pour tirer parti du
prix et de l'attractivité de leur produit au Nigéria. Fadimatou
montre, par exemple, que les deux tiers de tout le coton récolté
dans le Mayo-Tsanaga et le Mayo-Sava ont rejoint le Nigéria par voie
clandestine32.
Le commerce du poisson figurait également en bonne
place dans les échanges transfrontaliers. Jusqu'en 2011, environ 93 % du
poisson pêché dans l'Extrême-Nord était
acheminé au Nigéria en passant par Limani-Banki33. Les
exportations au Nigéria de bovins, d'ovins et de volailles
élevés dans le département du Logone-et-Chari
étaient également courantes à l'époque. Tout comme
pour le coton, les exportateurs de bétail profitaient des prix
élevés pratiqués au Nigéria, le prix d'achat d'une
tête de bétail y étant près de deux fois plus
élevé que dans l'Extrême-Nord camerounais.
La plus grande partie du carburant consommé dans la
région de l'Extrême-Nord est importée du Nigéria.
Selon Funteh, 67 % de la consommation totale de la région est
acheminée
31 Funteh, M.B., 2014, « Border Shutting and
Shrivel of Human and Merchandise on the Nigeria-Cameroon Passage of Banki and
Limani », dans ISSA S. (dir.), novembre 2014, Effets économiques et
sociaux des attaques de Boko Haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun,
Kaliao : Revue pluridisciplinaire de l'École normale supérieurs
de Maroua (Cameroun)
32 Fadimatou, M.I., 2011, Crise cotonnière
et exportation clandestine de coton entre l'Extrême-Nord du Cameroun et
le Nord-Est du Nigéria :1974-2011, mémoire de maîtrise
(histoire), Université de Maroua (Cameroun).
33 Bello, A., Hamso, D., et Dissia, A., 2013, La
SEMRY : DE 1971 À 2012, mémoire d'études (histoire),
diplôme de professeur de l'enseignement supérieur (grade II),
École normale supérieure, Université de Maroua
(Cameroun)
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 58
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
du Nigéria par voie de contrebande34. Bien
que principalement d'origine clandestine, ce carburant joue un rôle de
toute première importance dans l'économie locale. Lorsque les
prix du carburant sont plus élevés, ils entraînent
habituellement une hausse des prix d'autres produits de base dans
l'Extrême-Nord et ailleurs au Cameroun. Les chiffres officiels tendent
à sous-estimer la quantité de carburant qui entre dans la
région par le Nigéria. Certaines sources situent toutefois la
part de marché du zua-zua dans l'Extrême-Nord aux environs de 90 %
de la consommation totale de carburant35. Une perturbation de cet
approvisionnement peut donc avoir des répercussions non
négligeables sur l'économie locale.
Depuis 2012, le commerce a été fortement
perturbé par l'insécurité croissante résultant des
activités de Boko Haram dans l'Extrême-Nord. Sont
particulièrement touchés les marchés frontaliers qui
étaient d'importants centres de négoce pour les commerces
camerounais comme nigérians. La situation a affecté les
commerçants, les fermiers et les services de collecte de recettes
publiques. La fermeture de la frontière et des marchés a eu une
incidence sur les recettes douanières. Ainsi le bureau principal des
douanes de Fotokol n'a-t-il perçu que 2 180 000 francs CFA pendant la
première quinzaine de janvier 2012, par rapport à 19 millions de
francs CFA pendant la même période en 2011. Il en est de
même du bureau principal des douanes de Limani avec ses 50 millions de
francs CFA perçus en 2012 contre 100 millions pour la même
période l'année précédente. La situation a
été bien pire encore pendant les périodes de fermeture de
la frontière pour raisons de sécurité, entraînant
une recrudescence des activités de contrebande, une réduction
supplémentaire des exportations et des importations, et une perte
importante de perceptions douanières36. Les attaques de Boko
Haram visent principalement des endroits populaires et populeux tels que les
marchés, les bâtiments publics et les postes de
sécurité. Les grands marchés comme ceux de Maiduguri et
Banki sont des objectifs de premier ordre. La localité
frontalière de Banki, avec son effervescence et sa présence
policière accrue, est devenue une cible clé37.
La crise a également eu des répercussions sur
l'agriculture et l'élevage. Oignon, millet, arachide, maïs et
autres produits agricoles exportés de façon continue vers le
Nigéria constituent
34 Funteh, M.B., mars 2015, « The Paradox of
Cameroon-Nigeria Interactions: Connecting between the edges of
opportunity/benefit and quandary », International Journal of Peace and
Development Studies, vol. 6 (3).
35 ibid
36 Kindzeka, M., 2014, « Border trade between
Cameroon and Nigeria at a standstill »,
http://www.dw.com/en/
border-trade-between-cameroon-and-nigeria-at-a-standstill/a-17481473.
37 Pérouse de Montclos, M.-A., 2012, «
Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigéria : insurrection
religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? » Questions
de Recherche / Research Questions, no 40, juin 2012.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 59
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
une importante source de revenus pour de nombreux acteurs
économiques camerounais. Les marchands de bétail ont connu un
sort similaire. Franchir la frontière était chose impossible
lorsque les attaques s'intensifiaient ou que la frontière était
fermée. D'où une perte totale de revenus pour la plupart des
négociants en bétail. Depuis 2012, le commerce des biens
transitant par Banki-Limani et d'autres lieux importants de franchissement de
la frontière s'est réduit de plus de 50 %, ce tarissement
atteignant 90 % aux moments les plus forts du conflit. La contrebande
elle-même est devenue une activité très dangereuse par
suite de la sécurité renforcée le long de la
frontière lorsque celle-ci est fermée, et de la menace que
représente Boko Haram. En cas de fermeture complète de la
frontière, les affaires tombent pratiquement au point mort de part et
d'autre de la frontière38.
2- SUR LE TOURISME
La région de l'Extrême-Nord abrite des sites
touristiques et des attractions culturelles qui comptent parmi les plus
prisés du Cameroun ; 13 % des sites touristiques du pays s'y
trouvent39. Jusqu'en 2012, la région constituait la
première destination camerounaise pour les touristes d'Europe et
d'Amérique du Nord40. Depuis 2012, son secteur touristique a
été gravement touché par l'insécurité
associée à Boko Haram. Selon les statistiques nationales pour
l'année 2007, des 364 sites touristiques que compte le Cameroun, 67 se
trouvent dans l'Extrême-Nord41. Ses paysages attrayants en
avaient fait la destination préférée des touristes et des
entreprises du secteur jusqu'en 2011. Le paysage de Rhumsiki, le parc national
de Waza et les plaines d'inondation ou yaérés du Logone font
partie des attractions touristiques les plus populaires du Cameroun.
Les attaques de Boko Haram augmentent depuis 2012,
entraînant une baisse du taux d'occupation des hôtels de 50 %
à 10 %42. Outre ces difficultés dans le secteur
hôtelier, la crise du secteur touristique a également des
répercussions sur le commerce des produits de
38 Kindzeka, 2014.
39 March 2015, « Ce que
l'insécurité aux frontières fait perdre à
l'économie camerounaise »
http://www.journalducameroun.com/ce-que-linsecurite-aux-frontieres-fait-perdre-a-leconomie-camerounaise/.
40 Gaëlle Laleix, 22 September 2016 «
Cameroun : relancer le tourisme sinistré par l'insécurité
»
http://www.rfi.
fr/emission/20160922-cameroun-relancer-le-tourisme-sinistre-insecurite.
41 Djanabou Bakary, « Insécurité
transfrontalière, perturbation des échanges et léthargie
des marchés » in ISSA S. ed., November 2014, p. 86.
42 Ministère de l'Economie, de la
Planification et de l'Aménagement du Territoire du Cameroun (MINEPAT),
2015 « Impact de la crise sécuritaire aux frontières sur
l'économie camerounaise » MINEPAT.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 60
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
l'artisanat43. La plupart des sites touristiques
dans l'Extrême-Nord sont aujourd'hui désertés pendant la
majeure partie de l'année, les touristes craignant d'être
enlevés par Boko Haram ou pris au piège de la violence. À
la suite de l'enlèvement d'une famille française en
février 2013 et d'un prêtre français en novembre 2013, les
résultats du secteur touristique ont brutalement chuté
44 . Autour de Waza par exemple, sur 1906 arrivées seules
1403 nuitées ont été enregistrées. Avec l'escalade
de la crise en 2013, la situation s'est aggravée ; 1179 arrivées
ont été enregistrées contre 975 nuitées en 2013.
Les effets de cette baisse sur d'autres secteurs de l'économie sont
visibles sur les chiffres de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui
varient. Entre 2005 et 2013, le montant moyen de la TVA pour la zone de camping
de Waza était de 8 882 950 francs CFA45 ; en 2013, il
était de 1 654 338 francs CFA, soit une perte de 7 228 612 francs
CFA46.
B- EFFETS SOCIOECONOMIQUES ET RECRUDESCENCE DES
PERSONNES REFUGIEES
L'insécurité due à la psychose des
attaques ainsi qu'aux opérations de Boko Haram au Cameroun a eu des
effets socioéconomiques (1) et d'impacts démographiques qui
s'analysent aussi bien en termes de floppée des personnes
réfugiées (2)
1- SUR LE PLAN SOCIOECONOMIQUE
La région de l'Extrême-Nord enregistre les taux
de pauvreté les plus élevés du Cameroun47 au
regard de tous les indicateurs de l'indice de pauvreté
multidimensionnelle48. Cette donnée est importante pour
comprendre pourquoi Boko Haram peut sévir depuis toutes ces
années.
43 Comité catholique contre la faim et pour
le développement-Terre Solidaire (CCFD- Terre Solidaire), avril 2015,
Aide d'urgence pour les populations fuyant Boko Haram au Nord Cameroun,
http://ccfd-terresolidaire.org/
projets/Afrique/Cameroun/aide-d-urgence-pour-les-5009.
44 France 24, décembre 2013 « Georges
vandenbeusch (photo), le prêtre français enlevé dans le
nord du Cameroun, le mois dernier, a été libéré, a
déclaré mardi le cabinet du Président François
Hollande »
http://www.
france24.com/en/20131231-french-priest-vandenbeusch-cameroon-boko-haram-kidnap.
45 Bernard Gonné, 2014, « Kidnappings,
crise du secteur touristique et ralentissement de l'aide au
développement », in ISSA S. ed., novembre 2014, Effets
Économiques et Sociaux des Attaques de Boko Haram dans
l'Extrême-Nord du Cameroun, Maroua, KALIAO, p. 102.
46 Ibid.
47 Institut national de la statistique (INS), 2014,
Réalisation de la quatrième Enquête Camerounaise
Auprès des Ménages (ECAM 4), Yaoundé, INS.
48 Programme des Nations Unies pour le
développement, Indice de pauvreté multidimensionnelle,
http://hdr.
undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 61
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Selon les enquêtes sur les ménages n° 2, 3
et 4 réalisées par l'Institut national de la statistique,
l'Extrême-Nord comptait 74,3 % de pauvres en 2014 contre 65,9 % en 2007
et 56,3% en 2001 ; suivi du Nord avec 50,1 % de pauvres en 2001, 63,7 % en 2007
et 67,9 % en 201449. Par bien des côtés, cette
situation bénéficie à Boko Haram50. La
pauvreté fait de cette région un terreau fertile de recrutement
pour Boko Haram, qui, compte tenu des circonstances, est le plus grand
employeur. Malheureusement, cet état de fait s'aggrave depuis le
début de la crise en 2012. Du fait des infrastructures
déjà détruites dans de nombreux villages reculés et
des nombreuses personnes déplacées, les jeunes ne disposent
pratiquement d'aucune autre source de travail.
Les villages et les marchés ne sont pas les seules
cibles du groupe, qui s'attaque également aux exploitations agricoles ;
or, l'agriculture est la principale source de revenus de plus de 80 % de la
population. La destruction d'exploitations agricoles et les déplacements
de population ont non seulement renforcé la pauvreté alimentaire,
déjà favorisée par les mauvaises conditions climatiques,
mais aussi d'autres formes de pauvreté. Selon la Commission
européenne, 180 000 personnes ont besoin d'une aide alimentaire
immédiate dans la région de l'Extrême-Nord51.
Selon les estimations, 80 % de la population de la région est pauvre ou
très pauvre, disposant d'un accès limité aux services de
base et aux produits alimentaires essentiels52. Le nombre de
chômeurs parmi la population, très jeune, est déjà
très élevé ; la pauvreté croissante due à la
destruction des moyens de subsistance a donc fait de la région un
terrain de recrutement fertile pour Boko Haram. Par ailleurs,
l'Extrême-Nord est la région la moins développée du
Cameroun. À ce titre, elle manque cruellement d'infrastructures
socioéconomiques de base et offre peu de possibilités de
formation et d'éducation ainsi que peu de débouchés
économiques, en particulier aux jeunes. Les activités de nombreux
organismes publics (dispensaires, écoles publiques, services de douane
et de police) ont également été perturbées par les
actes de violence de Boko Haram. En octobre 2015, la localité de
Kerawa
49 Institut national de la statistique, 2014.
50 Camer News, 16 août 2016, Boko Haram :
Extrême-Nord, la Région la Plus Pauvre
http://www.camernews.
com/boko-haram-extreme-nord-la-region-la-plus-pauvre/#JOjj8X7qJU421GYy.99
51 Commission européenne, mai 2017, Fiche
info sur le Cameroun, ECHO, consultée le 21 août 2017 à
l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/cameroon_fr.pdf.
52 Ibid.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 62
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
(département du Mayo-Sava) a été
temporairement occupée par Boko Haram53, de même que
celles de Balochi et d'Ashigashia (département du Mayo-Tsanaga).
Figure 2 : carte de l'Extrême-Nord montrant les
zones touchées par les attaques Boko Haram

Source :
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-confronting-
boko-haram#.
2- RECRUDESCENCE DES PERSONNES DEPLACEES ET
REFUGIEES
Depuis le début du conflit dans l'Extrême-Nord,
des milliers de personnes ont été déplacées et la
région a également accueilli des milliers de
réfugiés fuyant les exactions de Boko Haram au Nigéria.
À la fin de 2016, plus de 198 899 personnes ont été
déplacées dans la région de l'Extrême-Nord en raison
des actes de violence de Boko Haram54. Les chiffres continuent
d'augmenter. D'après la matrice de suivi des déplacement (DTM) de
l'Organisation internationale pour les migrations, réalisée en
mars 2017, les attaques perpétrées par Boko Haram au Cameroun ont
entraîné le déplacement de 223 000
Camerounais55. Outre les
53 Le Figaro, octobre 2015, « Cameroun : Boko
Haram prend la ville de Kerawa »,
http://www.lefigaro.fr/flashactu/2015/10/23/97001-20151023FILWWW00203-camerounboko-haram-prend-la-ville-de-kerawa.php
54 Organisation internationale pour les migrations,
novembre 2016, « Près de 200 000 personnes sont
déplacées à l'intérieur du Cameroun »
https://www.iom.int/fr/news/pres-de-200-000-personnes-sont-deplacees-linterieur-du-cameroun.
55 Commission européenne, mai 2017, Fiche
info sur le « Cameroun », ECHO, consultée le 21 août
2017 à l'adresse suivante :
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/cameroon_fr.pdf.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 63
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
déplacements internes, qui posent des problèmes
croissants, la région de l'Extrême-Nord a accueilli 64 000
réfugiés du Nigéria, qui vivent dans le camp de Minawao
(département du Mayo-Tsanaga). La gestion de la crise des
réfugiés a lourdement pesé sur l'administration locale,
qui connaissait déjà des problèmes de gouvernance.
L'afflux de réfugiés s'accompagne de problèmes de
sécurité, les militants de Boko Haram étant
soupçonnés de s'infiltrer dans le camp56. Les
conditions de vie dans le camp sont également très mauvaises :
peu d'accès à des soins de santé, à l'alimentation
et à l'eau. On estime que 41 % de la population du camp est en situation
d'insécurité alimentaire. Faire de l'agriculture vivrière
autour du camp pour compléter l'approvisionnement alimentaire est
très difficile en raison de l'aridité du sol. La crise des
réfugiés et des personnes déplacées exerce donc une
pression supplémentaire sur la situation alimentaire déjà
précaire dans la région.
SECTION 2 : DE LA DIFFICULTE DE RIPOSTE OPERATIONNELLE
A LA CONSTRUCTION DU DISPOSITIF DE VEILLE SECURITAIRE CAMEROUNAIS ET
COOPERATIONS
BH de par ses modes opératoires confus liés
à la difficulté à reconnaitre les adeptes de la secte BH,
sa capacité de dissimulation dans la masse et sa mobilité
transfrontalière rendent difficile la dynamique de réponse
opérationnelle.
PARAGRAPHE 1 : DIFFICILE DYNAMIQUE OPERATIONNELLE
CONTRE BH ET CONSTRUCTION DU DISPOSITIF DE VEILLE SECURITAIRE
Le mode opératoire de Boko Haram est en effet
évolutif dans l'espace et le temps. Il faut rappeler que depuis 2012, la
capacité de nuisance du groupe a changé sur le plan
conventionnel. Son positionnement sur le territoire est de nos jours
perceptible avec une logistique militaire appropriée et une offensive
militaire conventionnelle pour la conquête des territoires. La difficile
dynamique opérationnelle contre BH dérivée de la
complexité et ou de la variabilité des modes opératoires
de BH trouve son levier dans l'obsolescence du DVS et l'hypothèse de la
transfrontalité de la menace.
56 AFP, novembre 2014, « Refugees fleeing Boko
Haram flood Cameroon camp », consulté le 17 août 2017
à l'adresse suivante :
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2836282/Refugees-fleeing-Boko-Haram-floodCameroon-camp.html.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 64
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
A- DIFFICILE DYNAMIQUE OPERATIONNELLE ET ACTIONS DES
COMITES DE VIGILANCE CONTRE BH
La difficulté opérationnelle dans la lutte
contre BH s'explique par la désuétude du dispositif
opérationnel de riposte (1) exigeant l'implication des comités de
vigilance (2)
1- OBSOLESCENCE DU DISPOSITIF OPERATIONNEL
Le dispositif de veille sécuritaire adopté par
le Cameroun a ses avantages et ses limites. Elle a certes réussi
à mettre fin à l'ampleur des attaques enregistrées en 2015
dans des localités comme Kerawa et Kolofata, mais elle n'a pas
traité les causes profondes du conflit. Par conséquent, si Boko
Haram a été fragilisé à la suite de l'attaque
militaire contre ses positions menées conjointement par tous les pays
concernés, il est peu probable que le groupe terroriste puisse
être éliminé. La solution essentiellement axée sur
l'action militaire et la sécurité n'a donc pas réussi
à garantir la sécurité des personnes et des biens
nécessaires à la promotion socioéconomique de la
région.
2- LES COMITES DE VIGILANCE DANS LA LUTTE CONTRE
BH
Le recours aux comités de vigilance intègre un
postulat réformateur du dispositif sécuritaire du Cameroun et se
justifie par le caractère asymétrique de la guerre que livre le
Cameroun à BH. Certes, la mobilisation des groupes d'auto-défense
n'est pas nouvelle au Cameroun. Elle remonte aux années 1960 notamment
dans la ville de Douala. Les exactions de BH et la dissimulation de ses membres
parmi les populations ordinaires ont juste favorisé la
réactivation de ces unités privées de
sécurité depuis juillet 2015 à la suite des premiers
attentats-suicides à l'Extrême-Nord57. La
multiplication des exactions de Boko Haram sur le territoire national a
révélé l'ampleur des complicités locales dont
bénéficiaient les insurgés. Soucieux d'affaiblir leurs
soutiens locaux et optimiser le renseignement prévisionnel et
opérationnel, les autorités camerounaises ont
réactualisé la défense populaire inscrite dans le concept
de défense
57 Voir le Rapport de l'International Crisis Group
précité
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 65
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
du Cameroun, qui repose sur l'idée que « les
armées ne suffisent pas pour sauver une nation tandis qu'une nation de
défense par le peuple est invincible58 ». Ces groupes
sont régis par l'instruction interministérielle de 1962
créant les groupes d'autodéfense à l'échelle
nationale et régionale par l'arrêté régional de juin
2014 du Gouverneur de la Région de l'Extrême-Nord, Augustin Awa
Fonka, encourageant la réactivation de ces unités sous
l'appellation « comités locaux de vigilance ». On assiste
à une prolifération sans précédent de vigilants,
estimés aujourd'hui à environ 16 000 dans la
quasi-totalité des villes et villages de l'Extrême-Nord (ICG,
Février 2017). Officiellement, leur objectif est d'améliorer la
réactivité des autorités et des forces de
sécurité à travers l'information, le renseignement et la
dénonciation des situations suspectes. Sur le terrain, les membres des
comités de vigilance ont contribué, au-delà de
l'identification des djihadistes et de l'alerte, à déjouer
plusieurs attentats kamikazes ou à réduire leur
létalité parfois au péril de leur vie. Leur ancrage
communautaire et leur parfaite maîtrise de la géographie, de
l'histoire, des langues et des cultures locales, font d'eux des partenaires
privilégiés de la contre-insurrection pilotée par les
services de sécurité camerounais. Leurs exploits leur valent
d'être régulièrement félicités par les
pouvoirs publics et de bénéficier d'une attention
médiatique inouïe ainsi que des marques de bienveillance.
Cependant, les dénonciations calomnieuses de certains, les extorsions
auxquelles se sont livrés quelques-uns et les soupçons de
collusion des autres avec la milice islamiste, ont quelque peu entaché
l'image de ce corps communautaire de sécurité qui se trouve
désormais dans une posture ambivalente. Les soutiens divers
apportés par l'ensemble des parties prenantes ont nettement
contribué à faire reculer l'emprise des djihadistes sur le front
camerounais et soulager les souffrances des nombreuses victimes. Toutefois
malgré les défaites militaires subies, le pouvoir de nuisance de
Boko Haram demeure et les conséquences du conflit sur le paysage
économique, politique et socioculturel ne cessent de s'alourdir. Dans ce
même son de cloche, les dynamiques bilatérales sont
indispensables.
B- DE LA CONSTRUCTION DU DISPOSITIF DE VEILLE SECURITAIRE
A
L'AUNE DE BH
Les premières incursions de BH au Cameroun ont
fondamentalement changé la perception et le schéma national de
veille sécuritaire. Confinée pour l'essentiel à la
frontière avec le Nigeria, la nébuleuse BH a exprimé sa
volonté de s'accaparer d'un morceau de territoire
58 Discours d'Ahidjo, 15 août 1970
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 66
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
camerounais pour étendre l'assise de son califat depuis
le Nigeria59. Après un moment d'hésitation
marqué par « un manque de discours structuré sur les
objectifs de BH »60; alors considéré comme `une
histoire' nigériano-nigériane, le gouvernement camerounais s'est
ravisé et a engagé des mesures fortes renforçant son
dispositif en matière de gestion de la crise sécuritaire
qu'imposait cette secte terroriste. Le Cameroun s'est alors mobilisé
suivant une réorganisation du schéma anticipatif contre BH, que
les autorités ont vite fait de « légaliser » par des
artifices juridiques assez controversés61. De là, le
combat antiterroriste au Cameroun exige une réorganisation
d'architecture de veille sécuritaire au niveau des zones-sièges
de BH.
1- REORGANISATION PARTIELE DU SCHEMA SECURITAIRE
NATIONAL
La nouveauté du phénomène BH au Cameroun
a entrainé une révision du dispositif de veille
sécuritaire à l'échelle du territoire national, avec une
accentuation dans les zones les plus touchées par BH. Suite à la
déclaration de guerre faite par le Président Biya le 17 mai 2014
à Paris, le Cameroun a inscrit dans son agenda sécuritaire le
combat contre Boko Haram dès 2015 avec la projection territoriale des
unités spéciales de l'armée camerounaise. Le dispositif de
veille sécuritaire va connaitre une redynamisation à travers le
renforcement et l'enrichissement de nouvelles opportunités. D'où
la nécessité de procéder à la réorganisation
partielle du dispositif du commandement terrestre avec la création d'une
région militaire dans la partie Nord du pays, RMIA 462. Il
s'agit d'un réajustement de l'emploi des forces de défense et de
sécurité dans une nouvelle conflictualité longtemps
restée indéfinie la doctrine d'emploi des forces.63 Le
combat contre BH ne pouvait se faire suivant la seule grille
opérationnelle des forces de défense et de sécurité
préparées plutôt aux guerres symétriques. Ainsi, la
réponse sécuritaro-militaire face à la secte BH va
consister en une multiplication des actions articulées autour des
opérations alpha du BIR-Alpha et l'opération
Emergence 4 conduite par la quatrième Région Militaire
Interarmées de l'armée régulière.
Créée le 1er août 2015, l'Opération Alpha
agit au front avancé pour rétablir la confiance
sécuritaire et empêcher toute manifestation de Boko
59 Adam Higazi et Florence
Brisset-Foucault, « Les origines et la transformation de l'insurrection de
Boko Haram dans le Nord du Nigeria », Politique Africaine, n°130,
2013/2, pp. 137-164, P.148.
60 Paul Elvic Batchom, « La
guerre civile "transfrontalière" : note introductive et provisoire sur
les fortunes contemporaines de la guerre civile », Politique et
Sociétés, vol. 35, n° 1, 2016, p. 103-123, p. 141.
61 C'est la loi n°2014/028 du
23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme.
Cette loi prévoit notamment la peine de mort pour toute personne reconnu
coupable d'actes terroriste et institue une telle procédure devant le
tribunal militaire
62 Décret n° 2014/308
du 14 août 2014 portant modification du décret n° 2001/180 du
25 juillet 2001 portant réorganisation du commandement militaire
territorial, art. 3, 1.
63 Doctrine d'emploi des forces approuvée le 4
Décembre 1979 sous le n*425/CABMIL/D 320.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 67
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Haram dans sa zone de Responsabilité qui s'étend
de Tourou et Ngrehi à Fotokol. Son mode de combat est le
harcèlement64. La souplesse et l'élasticité de
ses unités permettent d'adapter leur déploiement à
l'évolution de la situation car, dans ce type d'engagement, il est
primordial de pouvoir saisir les opportunités fugaces d'engagements
contre un adversaire de nature fuyante (Heitman, 2011 : 5).
De l'autre côté, au second échelon,
l'opération Emergence 4, conduite par le commandant de la RMIA4 (COM
RMIA4), est constituée d'un état-major et des postes. Le COM
RMIA4 dispose, dans le cadre d'Emergence 4, des unités du Bataillon
Blindé de Reconnaissance (BBR), du Régiment d'Artillerie Sol-Sol
(RASS) et des Mortiers de calibre 120 lisses rattachés qu'il
déploie selon les besoins opérationnels. De même, des
personnels issus de l'armée de Terre ont été
déployés dans neuf postes de la zone d'action
considérée.
Ce dispositif sera renforcé par une opération
conjointe Cameroun-Tchad dénommée Logone en 2015. Dans
ce même son de cloche, une quatrième région de gendarmerie
(RG4)65 a été créée dans
l'Extrême-Nord suivie d'une spécialement créée
à Kousseri. Cette dernière servira de quartier
général de plusieurs BIM activées. Au passage, force est
de souligner que les missions de l'armée seront redéfinies. Un
tel aspect est visible de par le nouveau statut « d'agent social »
acquis par l'armée à travers les actions humanitaires des forces
de défense et de sécurité. Il est bien remarquable que la
nouveauté du phénomène BH a suscité la
redynamisation du dispositif de veille sécuritaire les zones les plus
vulnérables. Cette réorganisation va permettre la
réappropriation et la réaffirmation de l'Etat du Cameroun en
matière de veille sécuritaire dans le septentrion.
Cette dynamique a également conduit à la
création de la 32eme brigade d'infanterie motorisée
à Maroua, unité qui a, par la suite, été
transformée en la 41e Brigade d'infanterie motorisée
(BIM)66 et délocalisée sur Kousseri. Cette
réorganisation a permis, entre autres, de ramener le centre de
décision opérationnel à proximité du
théâtre des opérations, réduire les
élongations et mettre à disposition un équipement et une
logistique dédiés directement à l'Opération
Emergence 467.
64Ibid.
65 Décret n° 2014/309 du 14 août
2014 portant modification du décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001
portant
organisation de la gendarmerie nationale, art. 72 (nouveau).
66Cameroon-Tribune, n° 10669/6868 du
mardi 9 septembre 2014.
67Honneur et Fidélité, magazine
des forces de défense du Cameroun, Edition spéciale,
décembre 2015, p. 55.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 68
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
2- LA REAPPROPRIATION TERRITORIALE ET REAFFIRMATION DE LA
SOUVERAINTE SECURITAIRE
la construction du dispositif de veille sécuritaire du
Cameroun à l'ère de BH a ceci de positif qu'elle a
accéléré la « réintroduction de l'Etat »
dans les régions septentrionales du Cameroun et a amplifié la
mobilisation gouvernementale autour de projets de développement en
urgence68 de ces zones souvent présentées comme les
`oubliées de la République'. Sur ce plan, il n'est pas
désobligeant de penser qu'« à quelque chose, malheur est bon
», puisque le développement est devenu une préoccupation de
l'Etat dans cette partie et que la présence des services publics de
proximité est de nouveau à l'ordre du jour.
La mobilisation de l'ensemble de la nation camerounaise dans
la lutte contre l'extrémisme violent incarné par Boko Haram est
devenue une question de souveraineté. Il s'agissait pour le Cameroun de
garder inviolable l'intégrité de son territoire face aux
velléités expansionnistes et révisionnistes de l'ennemi.
La réponse souverainiste du Cameroun s'est manifestée par la
mobilisation et l'engagement de son armée, en tant que bras
séculier de l'État chargé de la défense de la
souveraineté nationale.69 BH a favorisé la
réaffirmation de la souveraineté sécuritaire de l'Etat.
Dans cette partie du pays vulnérable, aux indices de
développement humain très faibles par rapport l'Indice du
Développement Humain (IDH) national, l'Etat se réintroduit et
amplifie les mobilisations autour de projets de développement en
urgence70 de ces zones souvent présentées comme les
« oubliées de la République ». Il est à relever
que le secteur éducatif présente des retards enregistrés
et bénéficie à ce titre de statut de « zone
d'éducation prioritaire ». Une aide publique est donc
destinée dans une perspective de l'amélioration, de
redynamisation du niveau d'étude et l'accroissement des résultats
académiques. Les indicateurs d'éducation sont au rouge : 53 % des
enfants non scolarisés se retrouvent dans la seule région de
l'Extrême-Nord ; le taux d'achèvement des études
primaires
68 C'est l'objet principal du Plan d'Urgence de 5,3
milliards de FCFA lancé en 2015 par le gouvernement camerounais, et dont
les priorités sont la reconstruction d'établissements scolaires,
les centres de santé et les routes à l'Extrême Nord.
69 Frank Ebogo, Les Mobilisations collectives
anti-Boko Haram au Cameroun : Entre calculs politiques, patriotisme
exacerbé et solidarités transversales. Publibook 2019, p 143.
70 C'est l'objet principal du Plan d'Urgence de 5,3
milliards de FCFA lancé en 2015 par le gouvernement camerounais, et dont
les priorités sont la reconstruction d'établissements scolaires,
les centres de santé et les routes à l'Extrême Nord
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 69
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
dans les ZEP allait de 46 % (dans l'Extrême-Nord)
à 81 % (à l'Est) contre plus de 94 % dans les autres
régions du pays ; le taux d'alphabétisation est peu
élevé dans les régions septentrionales. Ainsi, on estime
le taux des personnes analphabètes, dans l'Adamaoua (55 %) et dans
l'Extrême-Nord (76 %) En deçà de la moyenne nationale (35
%), et très élevé par rapport aux régions du
Littoral (10 %) et du Centre (13 %)71. De plus, si l'accès au
cycle primaire s'est plus ou moins généralisé, il reste
que 22 % et 29 % des jeunes issus respectivement de l'Adamaoua et de
l'Extrême-Nord ne sont pas scolarisés72. Ces retards
sont encore plus grands, d'autant plus lorsqu'on considère que le taux
d'achèvement du primaire se situe respectivement à 58 % et
à 46 % dans l'Adamaoua et dans l'Extrême-Nord, contre 95 % dans
toutes les régions non septentrionales du pays73. Le
gouvernement a profité du terrorisme BH pour verrouiller davantage les
aspects de la vie collective qui lui échappaient déjà au
nom des libertés politiques et civiques74. Non seulement il
mobilise l'argument de la défense du territoire et de son
intégrité75, mais aussi il instrumentalise
l'idée d'unité nationale pour élargir la répression
du terrorisme à des activités de groupes pouvant susciter une
certaine confusion au sein de la population76.
PARAGRAPHE II : COOPERATION AU PLAN BILATERAL ET
MULTILATERAL
DANS LA LUTTE CONTRE BOKO HARAM
La lutte contre BH exige une coopération au plan
bilatéral et multilatéral visible à travers diverses
contributions.
71 Banque mondiale, « Cahiers
économiques du Cameroun : Examiner les sources de la croissance : la
qualité de l'éducation de base », janvier 2014, n° 7,
p. 14.
72 Cameroun, rapport national de l'Éducation
pour tous (EPT) in :
www.unesdoc.unesco.org/images/0023/002317/231716f.pdfn,
p. 10.
73 Ibid. p 11.
74 Rappelons que la loi antiterroriste
susmentionnée renforce la législation sur les réunions
publiques et la liberté d'expression. Elle insiste notamment sur
l'apologie du terrorisme et les regroupements en masse de personnes qui peuvent
donner lieu à des interprétations larges. D'ailleurs, dans la
pratique, cette loi a recruté sa première clientèle parmi
les leaders des manifestations violentes dans la partie anglophone entre la fin
d'année 2016 et le début d'année 2017. Ainsi, les sieurs
Agbor Balla, Fontem Neba et Mancho Bibixy ont été accusés
de terrorisme, incitation à la violence, à la sécession et
à la guerre civile, et propagation de fausses nouvelles devant le
tribunal militaire de Yaoundé.
75 C'est l'argumentaire essentiel du
Président Biya dans ses discours de fin d'année à la
Nation les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.
76 A titre d'exemple, le Président du
Conseil National de la Communication (CNC) menaçait en janvier 2017 sur
les ondes de la Radio nationale (CRTV) de fermer tous les médias qui
continueront de donner la parole aux « sécessionnistes » de la
partie anglophone ou qui continueraient à faire l'éloge du
terrorisme.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 70
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
A- LES CONTRIBUTIONS DANS LA LUTTE CONTRE BH AU PLAN
BILATERAL
Boko Haram est un ennemi confus et même diffus aux modes
opératoires variables nuisible à la stabilité
sécuritaire au Cameroun, au Nigeria et le Tchad voisin. Cette menace
transfrontalière impose la mutualisation des forces afin d'envisager son
endiguement à travers la mobilisation des formations militaires
combattant pour l'instauration ou la restauration de l'autorité de
l'État dans les zones frontalières
contestées77. Le Cameroun, le Nigeria et le Tchad vont
s'organiser pour mettre en oeuvre une stratégie contre Boko Haram pour
la sauvegarde de leur intégrité territoriale.
1- LA DYNAMIQUE TCHAD- CAMEROUN
Dans le contexte de la guerre contre Boko Haram, on a
observé une revigoration de l'axe translogonéen reliant
Yaoundé à N'Djamena. Au lendemain de la déclaration de
guerre, le président tchadien Idriss Deby Itno effectuait une visite
d'amitié et de travail au Cameroun, les 22 et 23 mai 2014. Au cours des
travaux, les deux chefs d'État exprimèrent « leur
détermination de tout mettre en oeuvre afin que le dynamisme de cette
coopération facilite l'émulation et ait des effets positifs
d'entraînement sur le processus d'intégration dans la
sous-région d'Afrique centrale »78. Le 23 octobre 2007,
sans doute pour endiguer les actes criminels, le Cameroun et le Tchad
décidèrent de resserrer leur coopération
sécuritaire en mettant en place, à N'Djamena, une commission
mixte permanente de sécurité. Très rapidement, les 19 et
20 novembre 2009, les deux pays organisèrent la 1re session
ordinaire de cette commission mixte de sécurité à Maroua
(Cameroun). Reconnaissant que la situation sécuritaire à la
frontière commune restait préoccupante, le Cameroun et le Tchad
adoptèrent une feuille de route de lutte contre
l'insécurité transfrontalière pour l'année 2010,
comportant des actions et opérations précises à mener
conjointement 79 . Malgré toutes les initiatives prises pour
sécuriser l'espace transfrontalier commun, le droit de poursuite en
territoire tchadien ou camerounais ne fut jamais
77 Frank EBOGO : Les mobilisations collectives anti
Boko- Haram au Cameroun
78 Ibid.
79 Communiqué conjoint de la 1re session
ordinaire de la Commission mixte permanente de sécurité
Cameroun-Tchad tenue à Maroua les 19 et 20 novembre 2009.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 71
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
mis en oeuvre. Deux raisons peuvent expliquer l'engagement
militaire du Tchad aux côtés du Cameroun dans la lutte contre Boko
Haram. D'ordre géoéconomique, la première raison tient
à la nécessité de sécuriser les routes commerciales
qui relient le Cameroun au Tchad. Afin d'empêcher un siège
éventuel de la capitale N'Djamena, suite à la chute
stratégique de Baga, siège de la Multinational Joint Task Force
(MNJTF), le Tchad prit la mesure de la menace djihadiste en menant une guerre
préemptive contre Boko Haram. Sa détermination a
été aussi renforcée par la nécessité de
sécuriser le pipeline reliant Doba (Tchad) au port de Kribi
(Cameroun).
La seconde raison est liée aux considérations
géostratégiques. En effet, la prise de la ville nigériane
de Baga par les djihadistes au début du mois de janvier a
débouché sur une reconfiguration du champ
géostratégique du bassin du lac Tchad. Désormais,
N'Djamena était devenue une capitale vulnérable, car à
portée de tirs des éléments de Boko Haram. La
stratégie tchadienne consistait, par conséquent, à briser
tout éventuel verrou en dégageant les passages frontaliers et les
axes de circulation vitaux facilitant l'ouverture du pays au monde. Devant la
puissance de feu de la coalition tchado-camerounaise, l'ennemi recule sans
véritablement abdiquer. En réalité, la
réorganisation du commandement militaire de l'opération Logone
2015 a permis aux deux pays de bâtir un dispositif stratégique
efficace et efficient dans le bassin du lac Tchad. Disposant d'un poste de
commandement à Maroua, cette force avait à sa tête le
général de corps d'armée camerounais René Claude
Meka, secondé par le général de division tchadien Ahmat
Darry Bazine. L'état-major de l'opération disposait
également des bureaux du renseignement opérationnel, de la
logistique, des transmissions électroniques et des relations publiques.
Au terme de plusieurs mois d'opérations militaires en territoire
nigérian, et face au redéploiement de la Force multinationale
mixte (FMM) dans le théâtre géostratégique,
l'opération Logone 2015 fut démantelée en novembre 2015,
sans que l'ennemi soit définitivement défait. Selon
l'état-major tchadien, le bilan de cette intervention restait lourd : 71
soldats tués et 416 blessés80.
80
http://afrique.lepoint.fr/actualites/lutte-contre-boko-haram-le-tchad-retireses-troupes-du-sol-camerounais-09-11-2015-1980244
2365.php, page consultée le 5 novembre 2016.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 72
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
2- LA DYNAMIQUE NIGERIA-CAMEROUN
Au début de la guerre contre Boko Haram, le
Nigéria et le Cameroun ont laissé entendre des voix discordantes
et s'étaient mutuellement refusés un droit de poursuite sur leur
sol respectif. De nos jours, il y a une volonté politique
affirmée entre les deux chefs d'État, compte tenu des effets que
produit la menace terroriste Boko Haram sur les deux pays, à la fois sur
le plan économique et politique. Cette réalité ne doit pas
nier la méfiance latente entre les deux pays. Un échange
d'informations et le renforcement des moyens en termes de renseignement
risquent de se heurter à la méfiance qu'ils éprouvent l'un
envers l'autre, et leur volonté de protéger leur
souveraineté nationale. Cette coopération bilatérale
permanente permet de lutter efficacement contre BH. Les deux pays ont
décidé de réactiver la Grande Commission mixte
bilatérale et de créer un comité de sécurité
transfrontalière chargé de sécuriser la frontière
maritime et terrestre commune.
B- LES CONTRIBUTIONS DANS LA LUTTE CONTRE BOKO HARAM AU
PLAN MULTILATERAL
Ces contributions intègrent les actions menées
par la CBLT et la CEEAC (1) et la contribution de l'UA et des Nations Unies.
1- L'ACTION DE LA CLBT ET L'APPORT DE LA
CEEAC
? L'ACTION DE LA CBLT
La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) est une structure
permanente de concertation qui a été créée le 22
mai 1964 par quatre pays riverains du Lac Tchad : le Cameroun, le Niger, le
Nigeria et le Tchad. Mais le nombre de pays membres est passé à
six depuis l'adhésion de la République Centrafricaine en 1996 et
de la Libye en 2008. Le Soudan, l'Egypte, la République du Congo et la
RD Congo sont membres observateurs. Le siège de l'Organisation est
à N'Djaména, République du Tchad. La CBLT a pour mandat,
la gestion durable et équitable du Lac Tchad et des autres ressources en
eaux partagées du bassin éponyme, la préservation des
écosystèmes du Bassin Conventionnel du Lac Tchad, la promotion de
l'intégration et la préservation de la paix et de la
sécurité transfrontalières dans le
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 73
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Bassin du Lac Tchad. Il convient de relever que l'on assiste
à un renforcement de la coopération régionale pendant
l'été 2015, avec la création de la Force Multinationale
Mixte (FMM) dont le quartier général est à
N'djaména et le commandement opérationnel est assuré par
un général nigérian, Illyah Abbah. La FMM est
constituée des armées nigériane, camerounaise, tchadienne,
nigérienne et béninoise.
La sécurité transfrontalière est une
préoccupation historique des pays du bassin, mais ce n'est qu'au
début des années 2010, après l'insurrection violente de
Boko Haram en 2009, que la coopération militaire s'est davantage
concrétisée sous la forme de la Force multinationale
mixte(MNJTF), une autre Force issue de la CLBT. Celle-ci a été
placée sous commandement nigérian, avec le soutien de l'Union
africaine (UA). La MNJTF a été instaurée par le sommet de
la CBLT, à l'initiative du Nigeria, mais ne comprend que quatre des six
États membres de la CBLT - le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad
et plus le Bénin, qui n'en est pas membre. Les membres de la
MNJTF81 venant à la fois de la CEDEAO (Nigeria, Niger et
Bénin) et de la CEEAC (Cameroun et Tchad), il était difficile
pour une CER reconnue par l'UA et pierre angulaire de l'Architecture africaine
de paix et de sécurité (AAPS) d'en être le chef de file.
Comme la majorité des pays concernés sont membres de la CBLT et
que l'emprise de Boko Haram s'était étendue aux rives du bassin
du lac Tchad, on a estimé que la CBLT offrait un cadre institutionnel
adéquat pour cet effort commun, et une solution pragmatique à un
dispositif inter-régional. Le quartier général de la Force
multinationale mixte a pris ses quartiers à Baga (Nigeria)
jusqu'à ce qu'il en soit délogé par les forces de Boko
Haram en 2015. Il se trouve actuellement à N'Djamena (Tchad).
Le 20 janvier 2015, alors que les troupes tchadiennes se
déployaient au Cameroun, une réunion internationale
convoquée à Niamey, à laquelle participaient notamment les
ministres des Affaires étrangères et de la Défense des
quatre États membres de la CBLT, décidait entre autres mesures
devant favoriser la collaboration régionale contre Boko Haram de
transférer le
81 Le principal outil de coopération
militaire régionale est la Force multinationale conjointe,
souvent désignée sous son appellation anglophone de
Multinational Joint Task Force (MNJTF). Créée en 1998
par trois membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), le Nigeria,
le Niger et le Tchad, la MNJTF avait comme mandat initial de combattre la
criminalité et le trafic d'armes pour assurer la libre circulation des
biens et des personnes dans la région du lac Tchad64. En 2012, en
réponse à la menace accrue de Boko Haram, son mandat a
été étendu à la lutte contre le terrorisme65. En
octobre 2014, lors d'un sommet de la CBLT à Niamey, le quatrième
membre de cette organisation, le Cameroun, ainsi que le Bénin,
confirmaient leur décision - déjà prise plus tôt
dans l'année par leurs ministres de la Défense - de se joindre
à la MNJTF en y apportant chacun 700 hommes (Lac Tchad: 700 militaires
camerounais pour la force multinationale,
Journalducameroun.com,
20 mars 2014 ; Bassin du Lac Tchad : bientôt une force multinationale
contre la secte Boko Haram, Xinhua, 25 juillet 2014 ; Insurgency: LCBC To
Establish Multi-National Joint Task Force, The Street Journal
(Ibadan), 8 octobre 2014 ). Le quartier-général de la MNJTF
était alors situé à Baga, sur la rive nigériane du
lac Tchad. Ses contingents tchadien et nigérien l'ont
déserté en novembre 2014 après une attaque de la
localité par Boko Haram, laissant seuls leurs collègues
nigérians
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 74
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
siège de l'état-major de la MNJTF à
N'Djamena82. Quelques jours plus tard, l'Union africaine (UA)
décidait de porter ses effectifs militaires à 7 500
hommes83. Au début février, un sommet
réunissant à Yaoundé le Bénin et les quatre membres
de la CBLT décidait d'y adjoindre des policiers et des civils, portant
ses effectifs à 8 750 hommes, selon plusieurs
médias84, mais à 10 000 selon un communiqué de
l'UA85. Ce même communiqué, annonçant
l'inauguration du nouveau siège de la MNJTF le 25 mai, précisait
que le Conseil de paix et sécurité de l'UA avait approuvé
un « concept stratégique d'opérations » (CONOPS)
adopté durant le sommet du début février à
Yaoundé.
? L'APPORT DE LA CEEAC
C'est au travers de la gestion de la crise liée
à la secte Boko Haram que le rôle joué par la CEEAC dans la
crise sahélienne doit être envisagé. En effet, plusieurs
Etats d'Afrique centrale, particulièrement le Tchad et le Cameroun, sont
directement touchés par la violence qui affecte les confins du Lac
Tchad, au même titre que leurs homologues de la CEDEAO (Nigeria, Niger,
Bénin). La faible mobilisation de la CEEAC face à cette crise a
révélé à la fois les faiblesses de l'organisation
elle-même mais aussi la nécessité de développer la
coopération entre les CER qui composent l'AAPS. L'agenda de la CEEAC a
largement été dominé depuis le début de la
décennie par les conflits prévalant en RDC et en RCA, unique pays
au sein duquel la FOMAC ait été déployée. Ce n'est
qu'assez tardivement que ces deux instances se sont mobilisées pour
faire face aux menaces incarnées par le groupe Boko Haram. C'est ainsi
lors de la 39ème Session de l'UNSAC, tenue à Bujumbura en
décembre 2014, que les ministres des Affaires étrangères
d'Afrique centrale ont exprimé leur soutien au Tchad et au Cameroun dans
leur lutte contre Boko Haram. C'est tout d'abord en termes d'assistance
mutuelle envers les deux Etats membres de la CEEAC directement affectés
par les violences de la secte islamiste que la CEEAC a abordé cette
question. C'est ainsi que, lors d'une rencontre avec le Président
camerounais Paul Biya en janvier 2015, le Secrétaire
général de l'Organisation a encouragé les Etats membres
à manifester leur solidarité envers le Tchad et le Cameroun,
conformément aux dispositions pertinentes du Pacte d'assistance mutuelle
de la Communauté. Le Secrétaire
82 Boko Haram: Niger, Chad withdraw troops from
multinational force, Premium Times, 6 Janvier 2015; Boko Haram:
Military Probes Fall of Baga, THISDAY, 7 Janvier 2015.
83 Nigeria : Boko Haram s'empare d'une base militaire
sur les rives du lac Tchad, RFI, 5 janvier 2015.
84 Boko Haram's 'deadliest massacre': 2,000 feared
dead in Nigeria, The Guardian, 10 Janvier 2015.
85 Relevé de Conclusions de la
Réunion des Ministres des Affaires Etrangères et de
Défense sur la Sécurité au Nigeria et la « lutte
contre Boko Haram », Union Africaine, 21 janvier 2015.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 75
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
général a alors également plaidé
pour que les plus hautes instances du COPAX adoptent des actions
concrètes en vue d'éliminer la menace que constitue Boko Haram,
allant jusqu'à évoquer un plan militaire destiné à
contenir et à maîtriser la progression de Boko Haram, en
sécurisant les frontières du Cameroun, celles du Tchad et
globalement celles de la sous-région d'Afrique centrale86
.
Sans surprise, la CEEAC s'est plus particulièrement
saisi des questions relatives à la lutte contre Boko Haram lorsque le
Président tchadien Idriss Déby en a assuré la
Présidence. Le 31 janvier 2015, s'est ainsi tenue une Concertation des
Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC à Addis-Abeba, en marge de
la 24ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et
de gouvernement de l'UA. Dans la foulée de cette rencontre, le 16
février 201587, les Chefs d'Etat d'Afrique centrale membres
du COPAX se sont réunis en session extraordinaire, à l'invitation
du Président tchadien également Président en exercice de
celui-ci, pour tenter d'élaborer une stratégie commune visant
à lutter contre le groupe islamiste. C'est à huit clos que les
Présidents tchadien et camerounais se sont exprimés devant le
COPAX, afin d'exposer la gravité de la situation dans les régions
de leur pays touchées par la violence de Boko Haram : « Les
deux Chefs d'Etat ont déclaré que leurs Etats sont en guerre et
mobilisent plus de six mille hommes chacun pour lutter contre le groupe
terroriste Boko Haram. Ils ont conclu leur propos en demandant à leurs
pairs de se mobiliser pour les aider à éradiquer le groupe
terroriste Boko Haram qui, s'il n'est pas neutralisé, pourrait
déstabiliser toute la sous-région»88.
Reconnaissant que le groupe terroriste Boko Haram n'était pas seulement
une menace pour le Cameroun et le Tchad, mais aussi pour l'ensemble de
l'Afrique centrale, les Chefs d'Etat du COPAX ont affirmé leur
volonté de soutenir le Cameroun et le Tchad, dans le cadre des
mécanismes prévus par le Protocole relatif au COPAX et par le
Pacte d'assistance mutuelle. Ils ont également décidé de
la mise en place d'une aide d'urgence en ressources financières d'un
montant de 50 milliards de Francs CFA, en troupes, en soutien génie, en
soutien santé, en équipements militaires divers et en appui
aérien. Ils ont aussi décidé de créer un Fonds de
soutien multidimensionnel dans les domaines de la logistique, de
l'assistance
86
http://www.ceeac-eccas.org/index.php/pt/actualite/113-boko-haram-la-ceeac-veut-contenir-et-maitriser-l
avancée-du-groupe-terroriste
87 Radio France Internationale, « Afrique
Centrale : Sommet de la CEEAC - 50 milliards de francs CFA contre Boko Haram
». Publié le 16-02-2015 :
http://www.rfi.fr/afrique/20150216-cameroun-appui-financier-militaire-lute-contre-boko-haram
88
http://www.ceeac-eccas.org/index.php/en/component/content/article/15-dihpss/128-communique-final-session-extraordinaire-de-la-conference-des-chefs-d-etat-du-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-afrique-centrale-consacree-a-la-lutte-contre-le-groupe-terroriste-boko-haram
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 76
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
humanitaire, de la communication et des actions
politico-diplomatiques, instruisant le Secrétaire général
de la CEEAC d'élaborer un plan d'action dans ces différents
domaines à soumettre aux instances du COPAX pour son adoption et sa mise
en oeuvre. Les Chefs d'Etat ont en outre décidé de renforcer la
surveillance de leurs territoires respectifs et de mener des actions de
sensibilisation au profit de leurs populations pour réduire les risques
d'infiltration des membres de Boko Haram à l'intérieur des
frontières de leurs sous-régions et couper leurs réseaux
de ravitaillement. Les Chefs d'Etat ont aussi salué la décision
de l'Union africaine d'autoriser le déploiement de la FMM.
C'est ainsi que depuis 2015, dans le cadre de la mise en
oeuvre des décisions de cette session extraordinaire du COPAX,
l'approche de la CEEAC a largement consisté à opérer un
rapprochement avec la CEDEAO afin de développer une stratégie
commune visant à traiter les racines de la crise transrégionale
provoquée par les activités et la violence de Boko Haram. Une
telle approche se situe dans le droit fil du rapprochement
précédemment engagé à la faveur de la
stratégie interrégionale CEEAC-CEDEAO de lutte contre la
piraterie maritime dans le Golfe de Guinée89.
Dès le 2 avril 2015, s'est tenue une Réunion des
Experts de la CEEAC et de la CEDEAO consacrée à la mise en place
d'une stratégie commune de lutte contre le groupe terroriste Boko
Haram90. Cependant, l'organisation du Sommet conjoint des Chefs
d'Etat de la CEDEAO et de la CEEAC, initialement prévu pour se tenir en
avril, puis en août 2015 à Malabo, en Guinée
équatoriale, a été reportée à une date
ultérieure. Les travaux de la 44ème et de la 45ème
réunion de l'UNSAC, respectivement tenues en 2017 à
Yaoundé et à Kigali, ont été largement
consacrés à la lutte contre la violence armée et le
terrorisme en Afrique centrale. Une insistance particulière a
été placée sur la nécessité de la tenue d'un
Sommet conjoint avec la CEDEAO consacré à la définition
d'une stratégie interrégionale pour faire face au terrorisme et
à Boko Haram. A Kigali, le représentant de la Force
multinationale mixte de lutte contre Boko Haram, a fait le point sur les
efforts en cours pour mettre hors d'état de nuire le groupe
terroriste.
89 C'est dans ce cadre qu'a été
créé le Centre Interrégional CEDEAO-CEEAC pour la
Coordination de la lutte contre la piraterie et l'insécurité dans
le Golfe de Guinée(CIC).
90
http://ceeac-eccas.org/index.php/fr/component/content/category/15-dihpss?layout=blog&start=45
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 77
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
2- LA CONTRIBUTION DE L'UA ET DES NATIONS
UNIES
L'Union Africaine et les Nations Unies ont mobilisé tant
d'efforts dans le cadre de la lutte contre BH.
? L'UA
Il est frappant de constater le contraste entre l'intense
activité déployée par l'UA dès les prémisses
de la crise malienne et son absence totale de réactivité, voire
sa passivité, face aux agissements de la secte Boko Haram. Suite aux
attaques des 20 et 21 janvier 2011 qui firent plus de 200 morts dans la seconde
ville du Nigeria, Kano, l'UA a publié un communiqué de presse
dans lequel elle a promis son plein appui aux efforts du gouvernement
nigérian pour mettre un terme à « toutes les attaques
terroristes dans le pays» et combattre le terrorisme sous toutes ses
formes91. Le 26 décembre 2011, la Commission de l'UA a
fermement condamné dans un communiqué les activités de
Boko Haram, le Président de la Commission rappelant que l'UA rejetait
tout acte d'intolérance, d'extrémisme et de terrorisme. La faible
fréquence des réunions de haut niveau consacrées au sein
de l'UA à la lutte contre le groupe Boko Haram est pourtant tout
à fait éloquente et significative de certaines
défaillances de l'UA ainsi que de son manque d'anticipation quant
à l'ampleur de la problématique terroriste dans la zone du Lac
Tchad. En réalité, il apparaît que l'enjeu
sécuritaire incarné par Boko Haram a longtemps été
perçu depuis l'UA comme un problème domestique du Nigeria. Ce
n'est que progressivement que l'organisation panafricaine a pris conscience de
la dimension transrégionale du phénomène avant d'inscrire
plus clairement sa contribution à la lutte contre celui-ci dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme.
La Présidente de la Commission de l'UA avait
condamné l'enlèvement des 230 lycéennes de Chibok dans
l'Etat de Borno du Nigeria le 14 avril 2014 tandis qu'un communiqué de
presse du 2 mai a réitéré le soutien de l'UA aux efforts
du gouvernement nigérian tout comme à la coopération
internationale pour combattre le terrorisme. En réalité, ce n'est
qu'après le Sommet de Paris du 17 mai 201492que les pays du
Bassin du Lac Tchad ont décidé d'accroître leur
coopération pour faire face à la menace. « Lors de la
seconde réunion ministérielle de suivi au
91 Rapport du CPS, N° 40, novembre 2012.
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/PSC40Nov12F.pdf
92 Le Cameroun, le Bénin, le
Nigeria, le Tchad et le Niger ont pris part à ce Sommet de Paris.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 78
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Sommet de Paris de mai 2014 qui s'est tenue à
Washington (États-Unis) le 5 août 2014, l'UA a annoncé son
intention de contribuer aux efforts de lutte contre Boko Haram en mettant en
place une force régionale »93.
C'est dans cette perspective que l'Union africaine ainsi que
les Chefs d'État et de gouvernement de la CBLT ont organisé une
série de réunions94 afin de doter la FMM des moyens
d'éradiquer le groupe Boko Haram et les autres activités
terroristes dans le Bassin du Lac Tchad. C'est lors du Sommet de Malabo que la
Conférence de l'UA a appelé à la tenue d'un Sommet
consacré à la lutte contre le terrorisme tout en demandant la
conduite d'une mission évaluation au Nigeria, en vue de
l'éventuelle mise sur pied d'une force destinée à lutter
contre Boko Haram. C'est ainsi que le 23 mai 2014, le CPS a consacré sa
première réunion à la lutte contre la secte islamiste, en
appelant à l'opérationnalisation des instruments dont dispose
l'UA pour combattre le terrorisme95. Lors de la 469ème
réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union
africaine tenue le 25 novembre 2014, le Conseil Paix et Sécurité
de l'UA a examiné les efforts régionaux déployés
pour lutter contre le groupe Boko Haram et a convenu de mesures à mettre
en oeuvre par la Commission de l'UA en appui aux États membres de la
CBLT et du Bénin96. Le 2 septembre 2014, une nouvelle
réunion du CPS, à laquelle 7 Chefs d'Etat prirent part (dont ceux
du Nigeria, du Niger et du Tchad), a été consacrée
à la lutte contre Boko Haram : l'opérationnalisation du Processus
de Nouakchott a notamment été présentée comme l'une
des réponses à la crise, tout comme la possible création
d'unités antiterroristes spécialisées au niveau
régional et sous régional, dans le cadre de la CARIC, dans
l'attente de la pleine opérationnalisation de la FAA. Tout au long de
l'année 2014, l'absence de consensus entre le Nigeria d'une part et les
autres pays de la CBLT d'autre part, quant aux conditions d'intervention de la
FMM, notamment en matière de droit de poursuite et d'opérations
transfrontalières, a empêché l'adoption de décisions
fermes97.
93 William Assanvo, Jeannine Ella A Abatan et
Wendyam Aristide Sawadogo, « La Force multinationale de lutte contre Boko
Haram : quel bilan ? », ISS Africa, n° 19, août 2016 :
https://oldsite.issafrica.org/uploads/war19-fr.pdf
94
http://www.peaceau.org/fr/article/reunion-d-experts-sur-l-elaboration-des-documents-operationnels-pour-la-force-multinationale-mixte-fmm-des-etats-membres-de-la-commission-du-bassin-du-lac-tchad-et-du-benin-pour-la-lutte-contre-le-groupe-terroriste-boko-haram
95 Une réunion extraordinaire de la
Conférence de la CEDEAO s'est en outre tenue au Ghana en mai 2014 :
c'est à l'occasion de cette réunion que la CEDEAO a
décidé de mettre en place un Partenariat de haut niveau avec les
Etats d'Afrique centrale pour combattre le terrorisme, tout en invitant
expressément la CBLT à poursuivre et opérationnaliser ses
efforts en la matière.
96 C'est à cette occasion qu'il a
été demandé à la Présidente de la Commission
de l'UA de produire un rapport sur « les efforts régionaux et
internationaux et la voie à suivre dans la lutte contre le groupe
terroriste Boko Haram » :
http://www.peaceau.org/uploads/cps484-rpt-boko-haram-29-1-2015.pdf
97 Voir Michel Luntumbe, « La CBLT et les
défis sécuritaires du Bassin du Lac Tchad », Note n°
14, Bruxelles ; Groupe de recherche et d'information sur la paix et la
sécurité, 2014, 6,
www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_
ANALYSE/2014/Notes%20DAS%20-%20Afrique%20EQ/OBS2011-
54_GRIP_NOTE-14_CBLT.pdf
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 79
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
La 5ème réunion des ministres des Affaires
Etrangères et de la Défense des États des pays de la CBLT
et du Bénin s'est tenue à Niamey, le 20 janvier
201598. En marge de la 24ème session du Sommet de l'UA,
largement consacrée à la lutte contre Boko Haram, le CPS s'est
réuni le 29 janvier 2015 et a notamment traité de la lutte contre
Boko Haram : les représentants des Etats membres de la CBLT ont alors
été entendus. C'est lors de cette session qu'ont
été examinées : d'une part, la question du cadre
légal nécessaire au déploiement de la FMM ; d'autre part,
l'opérationnalisation de la FMM. C'est ainsi à l'issue de cette
réunion du 29 janvier 201599 que le CPS a formellement
autorisé le déploiement de la FMM. Le Nigeria de Good Luck
Jonathan, jusqu'ici réticent à inscrire dans le cadre de l'UA ou
de la CEDEAO la lutte contre Boko Haram, ne s'opposa pas à cette
décision du CPS d'autoriser le déploiement de la FMM,
composée de 7500 personnels, pour une période initiale de 12 mois
renouvelable100. La CPS a également invité le Conseil
de Sécurité des Nations unies à adopter une
résolution endossant le déploiement de la FMM101. Lors
d'une réunion tenue à Yaoundé du 5 au 7 février
2015, les experts de la CBLT, de la CEDEAO et de l'UA, ont travaillé sur
la définition du concept d'opération, assistés par des
experts de l'ONU et de l'UE. Lors de la 489ème réunion du 3 mars
2015, le CPS valide le CONOPS102 de la FMM103. Le Sommet
extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de la CBLT et du
Bénin (non membre de la CBLT) tenu à Abuja, le 11 juin 2015, a
adopté les CONOPS stratégique et opérationnel de la
FMM104. C'est ainsi qu'à la suite de ces réunions, la
FMM a été ré-opérationnalisée pour engager
de nouvelles opérations à compter du 30 juillet 2015 avec le
Bénin, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le
98 En janvier 2015, la base historique de la FMM
à Baga a été détruite par une nouvelle agression du
groupe islamiste.
99 Le 17 janvier 2015, le Président de la
Commission de la CEDEAO avait demandé à la Présidente de
la Commission de l'UA de transmettre une requête du Président de
la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO,
demandant l'inscription, à l'ordre du jour du Sommet de l'UA à
venir, d'un point sur la menace posée par Boko Haram. Voir aussi le
communiqué de presse [PSC/PR/BR.1 (DLX)] adopté lors de la
560ème réunion tenue le 26 novembre 2015.
100 Les pays affectés par la secte Boko Haram ont
été autorisés à mener des patrouilles conjointes et
simultanées et autres types d'opérations dans les zones
frontalières.
101 Voir Communiqué PSC/AHG/COMM2.CDLXXXIV,
484ème réunion tenue le 29 janvier 2015, au niveau des Chefs
d'Etat et de gouvernement. C'est en outre lors de cette réunion que la
Présidente de la Commission a présenté le Rapport qui lui
avait été commandé. Voir : Union africaine, Rapport de la
Présidente de la Commission de l'UA sur les efforts régionaux et
internationaux et la voie à suivre dans la lutte contre le groupe
terroriste Boko Haram, 29 janvier 2015, www.peaceau.org/
uploads/cps484-rpt-boko-haram-29-1-2015.pdf
102 L'UA a joué un rôle
très important dans la définition des différents concepts
d'opération stratégique, opérationnels et de soutien
logistique. Cf.
103 Le 25 mai 2015 est inauguré le quartier
général de la FMM à N'Djamena
104 Les communiqués adoptés respectivement lors
de sa 580ème réunion tenue le 25 juin 2015 [PSC/PR/BR. (DXVIII)],
lors de sa 500ème réunion tenue le 27 avril 2015
[PSC/PR/COMM.2(D)], ainsi que lors de sa réunion du 3 mars 2015
[PSC/PR/COMM.(CDLXXXXIX)] sont également des références
qu'il convient de mentionner.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 80
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Nigeria en tant que pays contributeurs de troupes sous le
mandat de l'UA. La Force Multinationale Mixte opère donc depuis lors
dans le cadre du mandat autorisé du CPS de l'UA.
? L'ONU
La version actualisée de la stratégie des
Nations Unies de lutte contre Boko Haram de septembre 2016 a été
approuvée par le Secrétaire général au cours de la
première quinzaine du mois d'avril 2017. Suite à la
décision 4a) de son Comité exécutif, prise en date du 23
février 2017, un groupe restreint de l'Équipe spéciale
inter organisations chargée de la question de Boko Haram a
été mis sur pied. Il comprend le Département des affaires
politiques, le PNUD, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et d'autres
organismes chargés de mieux intégrer les efforts des Nations
Unies dans la sous-région et d'aider à guider et/ou à
diriger la mise en oeuvre de la stratégie mise à jour et à
promouvoir une approche coordonnée du système des Nations Unies
dans la région du lac Tchad. Dans le cadre de cette stratégie,
l'ONU fournit un appui technique à la Force multinationale mixte (FMM)
régionale par l'intermédiaire de l'UA. L'un des objectifs
clés visés par la stratégie mise à jour consiste
à améliorer l'accès à l'aide humanitaire, notamment
par le biais d'une coordination et d'une logistique entre civils et militaires.
L'approche adoptée par les Nations Unies a été
conçue pour tenir compte des principes, stratégies et pratiques
de l'architecture antiterroriste de l'Organisation, notamment les
résolutions contraignantes du Conseil de sécurité et le
Plan d'action du Secrétaire général pour la
prévention de l'extrémisme violent. Elle vise également
à promouvoir l'application et le respect de toutes les obligations et
normes internationales en matière de droits de l'homme et
d'égalité des genres. En outre, l'approche des Nations Unies de
l'appui à la stabilisation du bassin du lac Tchad sera guidée par
la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et
conformément à la résolution 2391 (2017) du Conseil de
sécurité. Dans la conception, l'appropriation et la mise en
oeuvre du programme, la Commission du bassin du lac Tchad et ses États
membres réitèrent leur engagement de longue date en faveur de
l'application des meilleures pratiques d'appropriation nationale et en
particulier l'approche « Unis dans l'action ». Au niveau
régional, le PNUD fournira un appui au développement des
capacités de la Commission du bassin du lac Tchad dans le rôle qui
lui est dévolu au titre de la présente stratégie,
notamment par le déploiement de conseillers techniques pour appuyer les
travaux de la Cellule de coopération civilo-militaire CBLT - FMM
envisagée. Les ressources de base des Nations Unies continueront
d'être affectées à la résolution de la crise dans
les zones touchées
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 81
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
par Boko Haram autour du lac Tchad. En outre, l'ONU serait
disposée à appuyer le futur plan de mobilisation des ressources
de la CBLT, en ce qui concerne les actions de plaidoyer au niveau
international, l'exploration de solutions de financement innovantes et la
facilitation de l'accès des intervenants humanitaires et des acteurs de
développement sur le terrain. La création d'un Fonds
d'affectation spéciale pluri partenaires envisagé comme l'un des
instruments financiers utilisables pour apporter un soutien financier devrait
contribuer aux actions prioritaires à mener nécessitant de la
réactivité, des décaissements rapides et la mise en commun
des risques. Ce fonds devrait aider à créer de nouveaux
programmes innovants, promouvoir le financement d'opérations à
mener au titre d'une réponse rapide, améliorer les
capacités d'exécution et catalyser le financement des
partenariats avec le secteur privé. Cependant, ce fonds ne couvrirait
pas le premier pilier de la Stratégie d'appui à la FMM, les
donateurs limitant l'utilisation de l'aide au développement à des
fins militaires.
Figure 3 : Carte des différentes bases de la
FMM

Source : (Assanvo, Abatan et
Sawadogo, 2016 : 3
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
CHAPITRE 4 :
RESILIENCE DE BOKO HARAM : ENTRE FACTEURS
STATIQUES,
DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES STRATEGIQUE,
OPERATIONNELLES
INNOVANTES.
Selon une parabole burundaise enseigne : « Ni Giti
Kerakurira Mu babaji. L'arbre peut grandir malgré la présence des
menuisiers ». Pour dire que Boko Haram persiste et résiste
même faces au dispositif de veille sécuritaire. Il conserve
néanmoins une capacité de nuisance, y compris contre de petites
cibles militaires, en exploitant les vulnérabilités du dispositif
sécuritaire et la complicité de certaines catégories
sociales. La persistance des activités de Boko Haram au Cameroun et dans
le Lac Tchad tient à plusieurs facteurs.
SECTION 1 : LES FACTEURS STATIQUES ET DYNAMIQUES DE LA
RESILIENCE DE BH A L'EPREUVE DE LA REDYNAMISATION DU DVS.
La capacité de résistance de BH s'explique par
plusieurs facteurs statiques et dynamiques relevant de la
géostratégie du côté camerounais en particulier et
en général dans la région du Lac Tchad.
PARAGRAPHE 1 : LES FACTEURS STATIQUES DE RESILIENCE DE
LA MENACE BH.
La résilience de la menace Boko Haram au Cameroun
s'explique par plusieurs facteurs d'ordre stratégiques et
opérationnels.
A- LES LOGIQUES NATURELLES
Elles reposent sur le terrain et le relief (1) ainsi que la
distance et le climat (2). En effet elles sont les atouts
géostratégiques qui expliquent la résilience de Boko Haram
en terre Camerounaise.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 82
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 83
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
1- TERRAIN ET RELIEF COMME ATOUT GEOSTRATEGIQUE POUR
LE GROUPE BH
Le relief dessine des voies les voies naturelles d'invasion
et reste un atout pour la résistance de Boko Haram. Il détermine
les différentes positions étant compris aussi que les fleuves et
les montagnes surtout sont traditionnellement des obstacles
géostratégiques. L'argument topographique vient en
priorité pour l'espace de combat tant pour les forces de
sécurité et de défense ainsi que le groupe djihadiste. Le
terrain rend l'armée inefficace à des combattants de Boko Haram
aguerris et connaissant bien le terrain.
2- LA DISTANCE ET LE CLIMAT COMME DETERMINANT DE
RESILIENCE DE BH
Les facteurs physio stratégiques, jouent un rôle
très important dans un contexte de guerre contre le terrorisme. Boko
Haram est confus et diffus et variable dans son positionnement. C'est ainsi
qu'on enregistre les influences à Mokolo, Maroua, Fotokol, Kolofata et
bien d'autres qui sont séparées par des distances immenses. Boko
Haram se déploie de manière combattante dans diverses niches
territoriales interstitielles ou dans des espaces quasi vides des zones
désertiques. Les groupes et les cellules terroristes se créent et
se reconstituent et face à une telle mobilité, les forces de
défenses et de sécurité ont du mal à se confronter
à des noyaux mobiles, fuyants et déterminés étant
souvent comme des poissons dans l'eau.
L'influence du climat sur les opérations militaires a
été démontrée à maintes reprises. En raison
des circonstances météo logiques défavorables dans les
zones vulnérables du terrorisme, Boko Haram profite de cette situation
pour pousser les entrainements. Ce climat n'est pas toujours favorable pour les
forces de défense et de sécurité car les soldats sont
tombés sur le théâtre des opérations à cause
de la chaleur et du froid relativement intense. Dans cette zone
désertique, les tempêtes arrêtent complètement les
opérations militaires pendant des heures, voir même des jours et
l'appareil militaire n'étant pas adapté, Boko Haram gagne du
terrain.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 84
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Figure 5 : Intensité des attaques menées
par Boko Haram dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord,
2013-2016.

Source : tirée à partir de
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/boko-harams-
B- LES LOGIQUES ORGANISATIONNELLES DE LA RESILIENCE DE
BH
La résilience de BH s'explique aussi par la
réduction de l'effectif voire la diversification des forces dans
l'armée et une inertie à repenser la doctrine de défense
qui favorise la baisse du moral des acteurs de luttes.
1- LA REDUCTION DE L'EFFECTIF ET LA DIVERSIFICATION DES
FORCES
DANS L'ARMEE
A la suite de plusieurs attaques contre les postes militaires
avancés, l'armée a réduit leur nombre au profit de la
consolidation de grandes bases. Si ce nouveau dispositif est efficace pour
protéger les militaires, il rend les populations civiles plus
vulnérables. Les militaires exècrent le combat de nuit, qu'ils
trouvent plus pénible. Bien informé, le groupe lance la
majorité de ses attaques de nuit, et fait rarement face à une
intervention de l'armée. Le moral des troupes semble bas, en particulier
au sein des unités régulières. La fatigue et l'usure de la
guerre, les problèmes logistiques et le sentiment d'être
injustement traitées par la hiérarchie, en particulier concernant
les promotions, créent des frustrations. Cela se traduit par un certain
relâchement, et même par
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 85
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
des incidents : en octobre 2017, par exemple, un militaire du
rang a retourné son arme contre son commandant. L'on relève par
ailleurs un manque d'équipements du combattant en matériels de
communication ou de transmission. Les zones vulnérables de la menace BH
sont enclavées et n'ont presque pas de couverture de réseaux
téléphonique.
La diversification des forces de lutte contre BH est une
faiblesse en raison du cloisonnement et le déficit de coordination des
forces de défense et de sécurité. Boko Haram
représente une menace transnationale. Sa déterritorialisation
oblige les États à déterritorialiser leurs réponses
sécuritaires pour gagner en efficacité. Mais les
difficultés rencontrées à démarrer de
véritables projets de développement transfrontaliers et le retard
observé dans le financement de la FMM donnent encore l'impression que
les intérêts nationaux l'emportent sur les intérêts
régionaux.
2- INERTIE DANS LA PENSEE SECURITAIRE NATIONALE ET LA
BAISSE DU
MORAL DANS LE DVS
Il est à noter au sein du dispositif de veille
sécuritaire une inaptitude chronique à penser la
sécurité nationale. Agir de façon coordonnée sur
les différents leviers dont la nation dispose pour se défendre,
tel est le principe fondamental qui devrait guider la sécurité
nationale. Force est de constater que la sécurité nationale est
restée enfermée dans une approche théorique avec la
multiplication des attaques terroristes de BH. Face à la menace de type
asymétrique BH, les forces de défense et de
sécurité camerounaise ont montré une incapacité
notoire à mobiliser de manière efficace et coordonnée la
réponse contre BH. Le Cameroun ne parvient ni à élaborer
et mettre en oeuvre des stratégies cohérentes, ni à
développer des logiques dites « d'approche globale ». Qu'il
s'agisse des phases de prévention des crises, des phases de gestion des
crises ou des phases de stabilisation nonobstant la mise en oeuvre de la
Commission National pour le Désarmement, la démobilisation et la
réintégration en abrégée CNDDR105. Ces
institutions échouent à fédérer et coordonner des
actions relevant de leurs missions, comme l'exige pourtant aujourd'hui la lutte
contre le terrorisme islamiste BH. Les pouvoirs publics Camerounais n'alignent
pas, à court, moyen et long termes, les leviers d'action dont ils
disposent. Et ce pour des raisons multiples telles que l'absence d'une doctrine
de sécurité couvrant tous les champs ainsi que
l'impossibilité de se référer à des objectifs
politiques clairs et hiérarchisés, le déficit de
réflexion stratégique sur la finalité des actions
engagées et de définition des priorités, la
105 Décret présidentiel du
Portant création et organisation du CNDDR
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 86
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
fragmentation organique et décisionnelle des
différentes administrations et des opérateurs, redoublée
par un partage flou des responsabilités et par l'absence d'organismes en
charge d'études prospectives à l'exception du ministère de
la Défense.
Le moral des soldats n'est pas meilleur au sein du contingent
camerounais de la Force multinationale mixte (FMM) - force sous
régionale réactivée et reconstituée en 2015 par la
Commission du bassin du lac Tchad pour lutter contre Boko Haram - basé
à Mora dans le Mayo-Sava. L'octroi des primes créé
frustrations et frictions. Beaucoup de soldats pensaient qu'en rejoignant la
FMM, ils auraient un statut de salarié d'une force internationale, comme
c'est le cas pour les soldats de la composante camerounaise de la mission des
Nations unies en Centrafrique. Or la FMM n'est pas une mission onusienne et les
contingents sont payés et équipés par chaque pays.
Certains sont persuadés à tort que leurs supposées primes
« internationales » sont détournées. Il est vrai
néanmoins qu'entre 2014 et 2017, les primes mensuelles allouées
à tout soldat à l'Extrême-Nord par le ministère de
la Défense ont parfois été versées en retard. Des
soldats ont accusé les hauts gradés de détourner ces
primes.
La persistance des attaques résulte enfin de la baisse
de moral des comités de vigilance, due au faible soutien matériel
du gouvernement et aux rumeurs qui circulent sur son détournement par
les autorités administratives locales et des chefs traditionnels. Selon
les présidents de certains comités de vigilance, distinctions et
récompenses seraient parfois remises aux proches des chefs
traditionnels, y compris des individus ne faisant pas partie des
comités, plutôt qu'aux membres les plus engagés. Beaucoup
de membres des comités sont lassés et certains quittent les
rangs.
PARAGRAPHE 2 : LES FACTEURS DYNAMIQUES DE LA RESILIENCE
DE BOKO
HARAM
Les facteurs dynamiques de la résilience de BH sont
visibles à travers les obstacles stratégiques (A) et les
obstacles opérationnels (B).
A- LES OBSTACLES STRATEGIQUES
Ils relèvent des problèmes de coordination
minimale, de leadership institutionnel et de précarité
infrastructurelle observable.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 87
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
1- LE PROBLEME DE COORDINATION MINIMALE ET LE MONOPOLE
INSTITUTIONNEL
Dans le cas de la lutte contre Boko Haram, des sommets et
réunions ont été tenus de manière interne dans ces
deux principales organisations régionales aboutissant à des
déclarations officielles qui visaient la jonction des actions entre ces
organisations. Au-delà des déclarations officielles et
engagements mutuels à vouloir travailler ensemble, nous nous rendons
compte que les deux organisations phares du Golfe de Guinée que sont la
CEEAC et la CEDEAO n'ont pas coordonné leur effort pour une action
conjointe et coordonnée contre Boko Haram. Aucune action commune et
aucune coordination n'a été manifeste entre ces deux
organisations majeures ayant reçu mandat des Nations Unies en
matière d'intégration, de maintien de la paix et de la
sécurité. C'est vrai qu'un mandat a été
donné à deux chefs d'État de la CEEAC pour rencontrer les
dirigeants de la CEDEAO afin de rendre commune la stratégie et
l'opérationnalisation de la lutte contre Boko Haram. Après la
mission du président du Congo Denis Sassou Nguesso et du
président de la Guinée Equatoriale Theodoro Obiang Nguéma
et les promesses obtenues des dirigeants de la CEDEAO d'un sommet conjoint des
chefs d'État des deux organisations pour coaliser les efforts, une
réunion d'experts des deux communautés s'est tenue à
Douala au Cameroun le 2 avril 2015 avec pour objectif de préparer le
Sommet des Chefs d'État des deux organisations prévu le 8 avril
de la même année. Cependant, le sommet conjoint des chefs
d'État de la CEDEAO et de la CEEAC, initialement prévu le
mercredi 8 avril 2015 à Malabo, en Guinée Equatoriale, a
été reporté à une date ultérieure. Cette
rencontre qui a déjà fait l'objet d'une réunion au niveau
des experts, tenus le 02 avril dernier à Douala au Cameroun, doit
déboucher sur l'adoption d'une stratégie commune de lutte contre
le groupe terroriste Boko Haram qui sévit au Nigéria, mais aussi
au Cameroun, au Niger et au Tchad106.
Le sommet conjoint qui aurait entériné la
réflexion commune et des décisions stratégiques
collectives entre ces deux pôles majeurs de gestion des crises en Afrique
subsaharienne a donc été annulé sans aucune explication ni
aucun commentaire des deux communautés régionales. Aucune
initiative commune n'a suivi pour permettre une
106 Communiqué de presse, report du sommet conjoint
CEEAC-CEDEAO : 10 avril 2015
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 88
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
coordination des efforts contre Boko Haram, aucune action
commune alors que le Bassin du Lac Tchad est situé sur et entre ces deux
organisations phares et les principaux pays déstabilisés par Boko
Haram appartiennent à parité à la CEEAC et la CEDEAO.
Malgré la conscience d'une action commune et conjointe entre les deux
communautés contre Boko Haram, chacune d'elles a continué de
réfléchir de manière individuelle à la lutte contre
Boko Haram et cela s'est reflété dans les documents officiels de
chaque organisation. Du côté de la CEEAC, bien qu'elle ait
réaffirmé dans la déclaration officielle du sommet de
Ndjamena du 25 mai 2015 son engagement à coopérer sur le plan
stratégique avec la CEDEAO contre Boko Haram, elle rappelle à ses
États membres de s'impliquer aux côtés du Cameroun et du
Tchad dans la lutte contre Boko Haram. La CEEAC a fait siennes les
résolutions de ce sommet extraordinaire du COPAX à Yaoundé
le 16 février 2015 et a exhorté les États membres qui ne
l'ont pas encore fait à honorer leurs engagements multiformes de
solidarité envers le Cameroun et le Tchad107.
Bien plus, le secrétaire général de la
CEEAC, dans un communiqué datant de février 2016 sur la lutte
contre Boko Haram, reconnaît la nécessité d'une action
régionale, mais ne mentionne pas particulièrement quelle
organisation serait le mieux à même de coopérer avec la
CEEAC pour une meilleure efficacité dans la lutte contre Boko Haram.
En dehors des déclarations officielles qui
démontrent que les organisations phares de la région ne
mutualisent pas leur effort contre Boko Haram, il est indéniable de
mentionner que les stratégies de lutte contre le terrorisme donc contre
Boko Haram sont différentes dans les deux communautés. Pour ce
qui est de la CEDEAO, elle a adopté en 2013 une stratégie commune
de lutte contre le terrorisme et son plan d'action engageant les États
de la communauté à renforcer leur capacité de
surveillance, d'harmonisation, de coordination et de réglementation des
politiques et pratiques des États en matière de prévention
et de répression du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Contrairement
à la CEDEAO, la CEEAC n'a pas beaucoup d'initiative en matière de
lutte contre les nouvelles menaces. En dehors des mécanismes du COPAX,
elle a juste ajouté une touche opérationnelle en matière
de contreterrorisme en 2015. Il s'agit entre autres de la création
d'unités spécialisées pour lutter contre le terrorisme, la
mise en place d'une plateforme institutionnelle régionale
d'échange d'informations, de coopération et de collaboration
entre les différents services de sécurité et de
renseignement : ceci étant élaboré par les chefs des
services de renseignement et de sécurité des États de la
CEEAC. Il s'agit donc d'une coopération en Afrique Centrale dont le
107 Déclaration officielle sommet de Ndjamena, 25 mai
2015
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 89
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
but est de mieux contrer les actes terroristes de
manière préventive ou durant la période des
activités terroristes. Ces différentes stratégies dans la
lutte contre le terrorisme semblent donc justifier la persistance de la menace
Boko Haram et le déficit de coordination de la CEEAC-CEDEAO.
En outre, la coordination déficitaire entre les deux
communautés majeures présentes dans le Bassin du Lac Tchad
pourrait aussi s'expliquer car la menace Boko Haram traverse à la fois
la CEDEAO et la CEEAC créant ainsi une entrave à une
réponse efficace. La menace Boko Haram qui traverse les
frontières des deux communautés a à la fois
compliqué la mise en commun des moyens sécuritaire pour faire
face à Boko Haram. Ceci s'explique parce que le Bassin du Lac Tchad a
une position géographique particulière. En effet, le Bassin du
Lac Tchad est à cheval entre la Communauté des États de
l'Afrique de l'Afrique Centrale et la Communauté des États de
l'Afrique de l'Ouest. Aucune de ces deux communautés ne pouvant
réagir de manière autonome et efficace contre le groupe
terroriste Boko Haram sans le soutien et l'action conjointe de l'autre. Cela
veut dire en d'autres termes que si l'une des deux organisations décide
d'intervenir, son champ d'action se délimitera de manière
partielle sur le territoire couvert par l'organisation en question et, en
conséquence l'ensemble du Bassin du Lac Tchad ne connaîtra pas une
accalmie et une sécurité du fait d'une possible et probable
continuation des activités terroristes dans l'autre communauté et
vice versa. Boko Haram a donc dû être favorisé par ce
chevauchement régional pour créer des multitudes de sanctuaires
de la violence en Afrique Centrale et en Afrique de l'Ouest donc les
conséquences continuent de se reprendre dans la région. Ce manque
de coordination entre CEEAC et CEDEAO n'explique pas seul l'échec des
mécanismes de sécurité dans la lutte contre Boko Haram.
Elle s'accompagne de la présence des autres organisations
supranationales dans le Bassin du Lac Tchad et le difficile monopole par
chacune de ces organisations des zones déstabilisées par Boko
Haram.
La multiplication des organisations régionales autour
du Bassin du Lac Tchad n'a pas seulement créé un problème
de coordination inter organisationnelle permettant d'appliquer les
mécanismes régionaux de sécurité afin de contrer la
menace Boko Haram. Cette croissance anarchique des institutions supranationales
dans cette région de l'Afrique a aussi créé des
problèmes liés au manque de monopole institutionnelle de la vaste
région menacée et déstabilisée par Boko Haram afin
d'arrêter les multiples désastres occasionnés par ce
groupe. Une région ou une sous-région donnée devrait avoir
des mécanismes permanents de
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 90
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
coordination entre régions rassemblant les Etats de la
zone géographique et les poussant à agir de manière
commune suivant les règles qu'ils se sont eux-mêmes fixés.
En cas de conflit interétatique ou intra étatique, l'organisation
couvrant la région par la voie de tous ses États applique ainsi
les mesures élaborées à cet effet avec le soutien de tous.
Dans ces conditions, il pourrait être possible d'espérer que des
avancées positives et souvent efficaces seront au rendez-vous en cas
d'intervention régionale. C'est le contraire de la situation dans le
Bassin du Lac Tchad où l'on remarque la division de cette zone
géographique par les organisations régionales qui à la
fois sont actives sur le même terrain et au même moment. La
principale zone déstabilisée par Boko Haram crée un
déficit de monopole d'action d'une organisation régionale.
Ensuite, le manque de monopole des régions déstabilisées
par Boko Haram pourrait s'expliquer par la taille des organisations
supranationales et la légitimité de leur domaine d'action. Avec
la montée en puissance de ce groupe terroriste, plusieurs organisations
régionales ont engagé des démarches pour mettre fin aux
atrocités de Boko Haram. Mais leur champ d'action semble ne pas avoir
réduit l'ampleur de la menace. Le manque de monopole géographique
dans la région touchée par Boko Haram explique donc
l'échec des mécanismes régionaux de sécurité
pour endiguer ce groupe. Le manque de monopole régional ayant
généré l'échec des mécanismes
régionaux de sécurité tient au fait de la présence
de plus huit organisations supranationales dans le Bassin du Lac Tchad et leur
activité de simultanée dans la zone. La plupart de ces
organisations sont à vocation économique, mais se sont
attribué des mandats en matière de maintien de la paix et de la
sécurité. Comme chacune de ces organisations ayant des mandats
sécuritaires occupe au moins une sous-partie de la région, nous
remarquons ainsi une balkanisation de la région en plusieurs zones. Cela
explique le fait que la Communauté des États Sahelo-Saheliens
« CEN-SAD » a un intérêt pour les questions
sécuritaires dans le Golfe de Guinée du fait que le Niger,
Nigéria, Tchad, pays déstabilisés par Boko Haram sont
membres de cette communauté. La Commission du Golfe de Guinée a
aussi un rôle à jouer pour le maintien de la paix dans la
région, car le Cameroun et le Nigéria, troublés par les
activités de Boko Haram, sont membres de la communauté. La CEMAC
a aussi des actions à envisager dans le cadre de la
nécessité de stopper Boko Haram, car la zone qu'elle couvre
abrite les États touchés par ce groupe terroriste. Le fait donc
que toutes ces organisations auxquelles s'ajoutent la CEEAC, la CEDEAO et la
CBLT ont un mandat sécuritaire, partagent la principale zone du Bassin
du Lac Tchad déstabilisée par Boko Haram et non pas le
monopole
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 91
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
de l'action sur toute cette zone géographique, il devient
difficile pour les États de se réunir et d'appliquer les mesures
régionales contre la menace.
Les réponses des Etats Africains face au
phénomène bokoharamique souffrent d'incohérences internes
et externes suffisamment graves. Si les Etats Africains n'y font pas urgemment
face, la réalisabilité du projet de Califat Mondial Islamiste de
Boko Haram ne sera qu'une question de temps. D'autant plus que la secte
mondiale a décidé de déchirer les sociétés
africaines du dedans, par les personnes-bombes et la peur devenue forme
psychologique d'approche collective du réel108.
2- LES OBSTACLES INFRASTRUCTURELS
La résilience de Boko Haram résulte des facteurs
offensifs qui regroupent les ressources multiformes, les voies et
infrastructures de communication et les bases. L'élément des
voies de communication est un danger potentiel pour les forces de
défense et de sécurité en raison de son état
précaire et constitue par là même un atout pour Boko Haram.
Il s'observe un problème de ravitaillement des troupes en zone de combat
qui s'explique par la complexité des voies de communication presque
inexistantes. Une armée moderne a besoin des infrastructures qui doivent
avancer en même temps qu'elle. L'excellent réseau routier, dense
et bien entretenu peut favoriser le déploiement rapide des troupes.
Malheureusement ce facteur capital pour la rapidité du mouvement a fait
défaut dans l'Extrême Nord Cameroun car il n'existe que des
tronçons de piste et des zones très étendues pas
très praticables. Les moyens logistiques parfois rudimentaires impactent
souvent les rapports de forces. Les troupes armées périssent sur
le champ de lutte pour des raisons liées au manque d'infrastructures de
communication. Il se pose de ce fait un problème de liaison et
même de transmission en temps de guerre. Les transmissions constituent
une arme qui unit les armées. Les zones vulnérables par Boko
Haram ne sont pas presque couvertes par le réseau et encore moins
électrifiées. A ce titre il convient de faire ressortir un
écart irrémédiable entre les forces de défense et
de sécurité et les groupes terroristes qui peuvent
résister par la défaillance technologique peu
développés. Ce facteur géostratégique a joué
son rôle en négatif pour la coalition alliée.
108 De l'art de vaincre Boko Haram : contributions pour la
défense du Cameroun et du Nigéria (I & II) Par Franklin
Nyamsi Professeur agrégé de philosophie Président du
Collectif Diasporique Camerounais
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 92
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
B- LES OBSTACLES OPERATIONNELS
Dans ce sillage, le confinement militaire et la
duplicité des lobbies dans l'industrie de l'armement sont notoires ainsi
que l'opportunisme antidémocratique voire antirépublicain qui
constituent un atout pour le groupe BH
1- LE CONFINEMENT MILITAIRE DES ETATS POUR
L'ENDIGUEMENT DE LA MENACE ET LA DUPLICITE DES LOBBIES DANS L'INDUSTRIEL DE
L'ARMEMENT
La différence de perception de la menace, par chacun
des pays de la sous-région, ne favorise pas la mutualisation
annoncée des ressources et des moyens indispensables pour faire face
à la menace terroriste. De même, les pesanteurs d'un souverainisme
empreint de nationalisme exacerbé, commun aux leaders politiques de la
sous-région constituent, ici, un frein à l'élaboration et
à l'application de politiques communes. Enfin, il subsiste d'une
manière générale d'inévitables tensions entre les
contraintes de politique intérieure, et les dynamiques
d'intégration régionale visant l'alignement des pays sur les
projets politiques communautaires. Cette tension entre dynamiques internes et
régionales constitue l'un des principaux écueils à
l'opérationnalisation d'une réponse concertée, entre des
pays qui n'appartiennent pas tous, d'ailleurs, au même cadre
d'intégration régionale.
Le pendant du nationalisme postcolonial des Etats
confrontés à Boko Haram, c'est l'individualisme militaire, se
traduisant par la prétention de chaque Etat à en découdre
tout seul face à la secte pourtant transfrontalière. L'attitude
des autorités camerounaises face à Boko Haram laisse
transparaître, dans un premier temps, entre 2012 et mai 2014, leur choix
de ne pas s'impliquer fortement dans la lutte contre cette organisation
terroriste. Il s'agissait, à ce moment-là, de ne pas «
acheter » une guerre qui, à l'époque, était
perçue comme relevant d'un contentieux nigéro-nigérian
109 . Par ailleurs, le Nigéria, pendant longtemps, refusera
au Cameroun le droit de poursuite contre les membres de la secte Boko Haram
dans son territoire. Pourtant, en débandade par plusieurs fois face
à l'ennemi, on verra des régiments nigérians
109
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/08/boko-haram-menace-le-president-camerounais-dans-une-video_4552038_3212.html,
consulté le 19 janvier 2016.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 93
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
entiers se réfugier110 provisoirement au
Cameroun avant de rebrousser chemin. Le même Nigéria accordera
toutefois ledit droit de poursuite à l'armée tchadienne, avec des
succès évidents, qui montrent que la secte aurait davantage,
voire définitivement reflué si un dispositif de poursuite
collective était vraiment activé. Les résidus des longues
périodes de méfiance entre les régimes politiques
africains seront passés par là. De part et d'autres, on
soupçonne le régime voisin de vouloir soutenir des opposants
politiques au détour d'une lutte contre l'ennemi commun. On voit d'un
mauvais oeil les succès de telle armée contre Boko Haram, parce
qu'ils augureraient de sa capacité à vaincre la sienne. Une
stratégie militaire disparate ne peut vaincre un ennemi
asymétrique, qui joue consciemment des failles avérées de
la cohésion régionale des armées africaines.
En outre, la duplicité des lobbies dans l'industriel de
l'armement est visible à travers la vente des pires armes au plus
offrant, quelle que soit son idéologie et ses projets, quitte à
vendre également des armes ultra-défensives aux adversaires. La
doctrine du preventive war qui a inspiré la guerre lancée par
l'administration Bush en Irak, était adossée sur les pressions et
orientations militaro-industrielles, du puissant lobby américain de
l'industrie militaire, dont la boulimie en débouchés
d'écoulement de produits finis est sans mesure. Il faudra cependant
relever qu'il existe évidemment une corrélation évidente
entre la cupidité de certaines grandes puissances et le type d'armement
qu'elles vendent aux différents groupes armés. Tout se passe en
effet comme si, en entente avec les grandes puissances politiques, les lobbies
d'armement ne vendaient aux uns et aux autres que des armes susceptibles de les
maintenir à égale capacité de nuisance sur le terrain. Il
ressort ici, une manière de fragiliser les Etats Africains dans la
négociation de leurs matières premières avec les grandes
puissances, de telle sorte qu'ils révisent indéfiniment leurs
ambitions de profits à la baisse. Cette hypothèse est loin
d'être absurde, puisque des discours officiels en témoignent. Le
Président Buhari s'est publiquement plaint des autorités
américaines en arguant que le refus de vendre au Nigéria toutes
les armes sophistiquées dont il a besoin pour vaincre Boko Haram est une
manière de favoriser la capacité de nuisance de Boko
Haram111.
110
http://www.jeuneafrique.com/248649/politique/cameroun-plus-de-cent-refugies-nigerians-arrivent-jour-
nordpays/
111 Visite officielle aux Etats-Unis au mois de juillet 2015.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 94
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
2- L'OPPORTUNISME ANTIDEMOCRATIQUE ET
ANTIREPUBLICAIN
Le phénomène a deux versants. Il s'agit, d'une
part, d'une propension des régimes Africains attaqués par la
secte Boko Haram à profiter des circonstances pour réduire
davantage le socle des libertés fondamentales de leurs concitoyens, au
nom de l'état d'exception engendré par la confrontation avec le
terrorisme112. D'autre part, l'opportunisme antidémocratique
prendra aussi les formes sibyllines du cynisme de certains opposants
politiques, qui voient dans la progression criminelle de Boko Haram, un moyen
inespéré d'affaiblir les autocrates africains au pouvoir, afin de
précipiter l'alternance politique. Il est d'une nécessité
de faire comprendre aux hommes politiques des pouvoirs et oppositions
africaines qu'on ne peut rien tirer de bon du projet bokoharamique. En
flétrissant davantage les libertés citoyennes comme l'ont par
exemple fait les autorités camerounaises, à l'occasion de la
nouvelle loi contre le terrorisme, on désolidarise une partie importante
du peuple envers les forces armées nationales. Mais en espérant
de la nébuleuse Boko Haram, qu'elle vienne par exemple faciliter
l'alternance politique, au Cameroun ou au Tchad, on ne risque surtout pas de
sortir du cercle vicieux de la domination autocratique. L'opportunisme
antidémocratique et antirépublicain africain devient dans un
contexte pareil l'allié objectif de Boko Haram, même à son
corps défendant113.
102
http://www.jeuneafrique.com/35267/politique/cameroun-paul-biya-accus-d-instrumentaliser-une-
loiantiterroriste-des-fins-politiques/ ; voir aussi
http://www.rfi.fr/afrique/20150722-tchad-inquietude-oppositionprojet-loi-anti-terrorisme-attentats-boko-haram-saleh-k/
; par opposition, voir en Tunisie,
http://www.jeuneafrique.com/249219/politique/tunisie-parlement-debat-dune-nouvelle-loi-antiterroriste/
113 Franklin NYAMSI. De l'art de vaincre Boko Haram :
contributions pour la défense du Cameroun et du Nigeria (I et II)
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 95
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Tableau 2 : Nombre d'attaques menées par BH par
circonscriptions administratives dans l'Extrême-Nord entre le
1er Janvier 2013 et le 31 Janvier 2017.
|
Départements
|
Nombre d'Attaques
|
Arrondissements
|
Nombre d'Attaques
|
|
Diamaré
|
03
|
- Bogo
|
01
|
|
- Meri
|
01
|
|
- Pette
|
01
|
|
Logone et Chari
|
147
|
- Fotokol
|
33
|
|
- Hile-Alifa
|
22
|
|
- Goulfey
|
02
|
|
- Kousseri
|
03
|
|
- Makary
|
35
|
|
- Waza
|
43
|
|
- Logone-Bimi
|
03
|
|
- Darack
|
05
|
|
- Zina
|
01
|
|
Mayo-Sava
|
250
|
- Kolofata
|
157
|
|
- Mora
|
90
|
|
- Tokomberé
|
03
|
|
Mayo-Tsanaga
|
88
|
- Koza
|
05
|
|
- Mayo-
moskota
|
69
|
|
- Mokolo
|
14
|
|
Mayo-Danay
|
03
|
- Guere
|
01
|
|
- Yagoua
|
01
|
|
- Kai-Kai
|
01
|
Source : tableau élaboré
par nous-même et données collectées dans le contexte de la
crise Boko Haram et ses répercussions dans les régions de
l'Extrême-Nord du Cameroun.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 96
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
SECTION 2 . COMBATTRE AUTREMENT BH : PERSPECTIVES ET
IMPERATIFS
STRATEGIQUES, OPERATIONNELS.
Le Cameroun peut combattre autrement BH par l'observation de
certaines perspectives (1) et impératifs (2) sécuritaires
stratégiques et opérationnels qui passent par une innovation
constante de sa pensée opérative face aux mutations du mode
opératoire de la secte islamiste.
PARAGRAPHE 1 : PERSPECTIVES SECURITAIRES STRATEGIQUES,
OPERATIONNELLES ANTI-BH
Elles sont de d'ordres sécuritaires stratégiques
(A) et sécuritaires opérationnelles (B) A- PERSPECTIVES
SECURITAIRES STRATEGIQUES
Les perspectives sécuritaires stratégiques exigent
dans un premier temps le renforcement de la résilience nationale (1) et
la perfection de la stratégie globale de lutte contre BH.
1- RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE NATIONALE FACE A
LA
MENACE BOKO HARAM
La résilience d'une nation dépend de la
mobilisation de l'ensemble de ses ressources pour assurer sa
sécurité et garantir, en toutes circonstances, la
continuité de la vie nationale. La résilience suppose la
capacité d'absorber un choc, de continuer à fonctionner dans le
respect de ses valeurs mais aussi de s'adapter en tirant les leçons des
événements. L'effet de surprise et la sidération entravent
la résilience. Les populations doivent savoir sur Boko Haram d'où
l'importance cruciale de l'éducation, de l'information et de la
compréhension des risques. La résilience peut aussi être
renforcée par la mise en oeuvre d'une doctrine
pretorianiste114 camerounaise avec une armée de production,
de commercialisation et d'industrialisation dans les zones sièges de la
menace BH.
114 Le prétorianisme est un mode de fonctionnement d'un
régime politique selon lequel les corps armés influencent la
formation et la composition du gouvernement
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 97
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
2- LA PERFECTION DE LA STRATEGIE GLOBALE DE LUTTE
CONTRE
BOKO HARAM
Il est indispensable de repenser dans toutes ses dimensions la
façon dont la sécurité nationale est organisée et
mise en oeuvre. L'objectif consiste à agir de façon efficace et
coordonnée sur les différents leviers dont la nation dispose sur
les théâtres d'opérations à l'échelle
nationale. Cette contrainte d'efficacité doit être au coeur d'une
réforme qui doit garantir, à tous les niveaux, la
cohérence des actions conduites, y compris entre le niveau de
décision le plus élevé (le président de la
République) et les zones d'opération où il faut combiner
réactivité et cohérence, transversalité, et
subsidiarité. Le principe clef qui guide la définition et la
conduite de toute manoeuvre stratégique repose sur la bonne articulation
de trois niveaux essentiels : le niveau stratégique (qui définit
la stratégie), le niveau opératif (chargé de la mise en
oeuvre) et le niveau tactique (responsable de l'exécution sur le terrain
des actions concourant à la stratégie). Cette stratégie
vise à donner une nouvelle cohérence au dispositif de veille
sécuritaire à l'aune de la menace BH. Afin de remédier au
déficit chronique de stratégie et de coordination, il est
impératif d'envisager l'opérationnalisation, auprès du
président de la République, du Conseil nationale de
sécurité115. Si cette idée n'est pas neuve,
elle apparaît aujourd'hui incontournable pour répondre aux risques
et aux menaces qui pèsent sur le Cameroun. Ce conseil assurerait les
missions suivantes :
· le pilotage des analyses globales sur la
sécurité et l'arbitrage entre les priorités ;
· la définition de stratégies globales et
des politiques publiques afférentes ; la coordination de ces politiques
publiques dans leur préparation, leur conception et l'évaluation
des coûts et bénéfices des options suggérées
;
· la formulation des propositions d'orientation de
renseignement prévisionnel et l'élaboration périodique de
la synthèse des renseignements intéressant la
sécurité intérieure et extérieure.
115 Décret n°2009/004 du 8 janvier 2009 portant
création et organisation d'un conseil national de sécurité
en abrégé « CNS »
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 98
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
B- PERSPECTIVES SECURITAIRES OPERATIONNELLES
Elles consistent en la mise en oeuvre des unités de
forces locales (1) et le renforcement des services de renseignement.
1- MISE EN PLACE DES UNITES DE FORCES
LOCALES
La création des unités de forces locales de
défense et de sécurité est un aspect indispensable pour
lutter contre BH. Les forces terrestres y sont largement impliquées. La
qualité de leurs actions dépend souvent la capacité de ces
forces autochtones à les relever et à concrétiser, en
partie, le succès de l'opération. Dans les localités
toujours exposées à Boko Haram, maintenir les comités de
vigilance opérationnels, tout en les soutenant et en les encadrant mieux
via des systèmes de vérification externe, y compris un
contrôle communautaire, et intégrer certains membres dans les
unités de police locale ; proposer à leurs membres des formations
sur des compétences pratiques en matière de renseignement et les
opérations de déminage.
2- LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES SERVICES DE
RENSEIGNEMENT
L'Etat du Cameroun doit s'abstenir de créer de nouveaux
comités de vigilance et se concentrer plutôt sur le
développement de réseaux de renseignement et d'alerte
précoce pour apporter aux civils la protection de l'Etat en cas de
besoin. Le renseignement est une fonction majeure de l'engagement
opérationnel et une clé du succès. C'est la conjugaison
des dimensions techniques et humaines qui permet de donner du sens, car si la
technologie accroît les capacités, elle permet surtout de savoir,
alors qu'il s'agit bien plus souvent de comprendre. La manoeuvre de
l'information participe à la lutte asymétrique de type Boko
Haram. Elle doit être d'autant plus constante qu'une part des actions
adverses repose elle-même sur l'exploitation de cette dimension. Les
forces doivent faire du combat par l'image une dimension nécessaire de
l'action des forces de défense et de sécurité.
Dans le domaine clé de la lutte contre le terrorisme,
il est essentiel de coordonner l'ensemble de la chaîne
opérationnelle, du renseignement en amont jusqu'aux procédures
judiciaires en passant par les forces d'intervention. Cette stratégie
sera conduite par un centre
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 99
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
opérationnel dédié et permanent. Le
renseignement doit faire l'objet d'une coopération entre les
différents services de l'Etat et entre les différentes sciences
humaines. Plus que tout autre champ d'action, le renseignement doit se montrer
le plus englobant possible. Le décloisonnement et le partage
d'informations doivent être les nouvelles règles afin de mieux
saisir la complexité du théâtre d'opérations.
PARAGRAPHE 2 : LES IMPERATIFS SECURITAIRES
STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS ANTI- B H
La lutte contre BH exige l'observation des impératifs
stratégiques et opérationnels à l'échèle
nationale.
A- IMPERATIFS SECURITAIRES STRATEGIQUES
La réactualisation de la doctrine de défense
(1), l'urgence d'un livre blanc et le vote de la loi de programmation militaire
du Cameroun. (2)
1- LA REACTUALISATION DE LA DOCTRINE DE
DEFENSE
Relevant des impératifs stratégiques, le
Cameroun a l'intérêt de réactualiser sa doctrine d'emploi
des forces116. Si la stratégie de défense et de
sécurité nationale définie dans la doctrine d'emploi des
forces garde toute sa pertinence, elle n'est plus trop d'actualité. Et
ce en raison des failles du niveau intermédiaire, point de faiblesse
chronique, qui doit permettre de conduire des manoeuvres combinées
d'acteurs variés délivrant des effets différents. Il a des
forces relativement modestes. Ces forces sont appelées à se
développer et à se moderniser pour faire face aux menaces de Boko
Haram. La doctrine de défense du Cameroun repose sur la
défense
116 La doctrine d'emploi des forces ; Edition 1980 est
approuvée le 4 Décembre 1979 sous le n° 425/CABMIL/D 320.
Cette doctrine d'emploi des forces, énonce des idées directrices
qui doivent permettre la conduite de l'action militaire en cas de conflit
opposant le Cameroun à un autre pays et de menaces terroristes tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur (source anonyme).
Précisons qu'en matière de défense les informations sont
classifiées selon leur nature et leur accès est limité aux
personnes ayant fait l'objet d'une habilitation particulière. On
distingue quatre niveaux de protection des informations en matière de
défense classée par ordre croissant : diffusion
restreinte(il s'agit des informations qui peuvent être
connue de tous les militaires mais en respect des règles de
discrétion professionnelle) ; confidentiel défense
( il s'agit des informations qui, réunies ou
exploitées peuvent conduire à divulguer un secret défense)
; secret défense ( ce sont les informations
dont la divulgation peut nuire à la défense) ;
très secret ( ce sont les informations qui
concernent les priorités gouvernementales de défense).
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 100
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
populaire. Elle trace les grandes lignes à suivre et
définit les objectifs à atteindre à court, moyen et long
terme. Dans sa conception, elle permet aux forces de défense de faire
face à deux hypothèses retenues sur l'ennemi :
· H1 : Ennemi au potentiel matériel et humain
supérieur au nôtre
· H2 : Ennemi au potentiel matériel et humain
égal ou inférieur au nôtre
Le chef de l'Etat précise qu'il convient dans
l'hypothèse d'un conflit avec un pays dont le potentiel matériel
et humain est largement supérieur au nôtre de préparer une
défense SOUPLE117. Les forces armées, orientées
par un système de renseignement en profondeur devraient pouvoir :
· Empêcher une prise de gage terrestre ou maritime
· Gagner des délais par un combat retardateur
· Conduire le combat sur les arrières de l'ennemi et
organiser la défense populaire
· Assurer la protection des points sensibles
d'intérêt national
Les modes d'action définis dans la doctrine d'emploi des
forces reposent sur :
· Mode d'action n°1 : offensive
généralisée
· Mode d'action n°2 : offensive locale
· Mode d'action n°3 ; destruction locale d'un centre
ou d'une infrastructure
· Mode d'action n°4 : violation du sanctuaire
national
· Mode d'action n°5 : création d'un état
de crise en milieu maritime
Force est de souligner que la doctrine d'emploi des forces au
Cameroun souffre d'une obsolescence avec l'apparition des nouvelles menaces
à l'instar du groupe djihadiste Boko Haram. La réactualisation de
la doctrine d'emploi des forces au Cameroun apparait comme un impératif
stratégique pour l'endiguement de BH. Les menaces de type
asymétriques étaient prévisibles mais pas prévues
au Cameroun. Les forces de défense et de sécurité
longtemps n'étaient préparés pour des menaces terroristes
et internes. La revue de cette doctrine suppose la prise en compte des
nouvelles conflictualités pour des stratégies nouvelles
d'endiguement.
117 Directive présidentielle n° 436/
CAB.MIL/150 du 02 Novembre 1972. De
même la Directive présidentielle n° 253/
CAB.MIL du 14 Novembre 1977 prévoit
qu'en cas de conflit avec un Etat puissant, nous devons nous préparer
à endiguer l'avance ennemie en attendant sensibiliser l'opinion et les
instances internationales.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 101
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Elle consiste à redynamiser le dispositif de veille
sécuritaire intégrant de nouvelles hypothèses et modes
d'actions ennemi.
2- ANTICIPER LES NOUVELLES MENACES AU DELA DU
COMBAT
Boko Haram sera gagné par l'adhésion de la
population, non par la destruction de l'ennemi. Cette redéfinition
stratégique de lutte asymétrique, marque un tournant majeur dans
la guerre contre insurrectionnelle en ce qu'elle sous-tend l'impuissance
partielle des FDS à vaincre un ennemi inferieur en nombre et
dépourvu de toute technologie. Une telle vision des faits
réaliste affectera doublement la puissance des FDS et le vote de la loi
de programmation militaire prendra en compte de nouveaux pôles
d'équilibre géopolitiques ou géostratégiques. Le
Cameroun disposera par-là de nouveaux outils afin de comprendre et
d'anticiper sur les conflits asymétriques. Ainsi le service de
renseignements publics comme logique d'intelligence doivent dans cette
perspective être considérés comme le vecteur le plus
discret et le plus efficace d'influence de l'Etat. Il est nécessaire
pour l'Etat du Cameroun d'avoir une claire vision de la possibilité de
guerre, de sa propre vulnérabilité afin de mobiliser les forces
morales de ses sociétés et forger les outils politiques et
militaires pour y faire face. D'où la nécessité
d'envisager le facteur psychologique dans la lutte contre BH. Ce dernier montre
que l'Etat est désarmé et qu'il peut perdre si rien n'est fait
dans ce sens.
B- IMPERATIFS STRATEGIQUES OPERATIONNELS
Pour faire face aux attaques BH que l'on estime aujourd'hui
les plus dangereuses, il impératif de trouver le juste équilibre
des capacités opérationnelles que le dispositif de veille
sécuritaire camerounais doit disposer réellement, pour permettre
aux forces locales de lutte contre BH et d'imposer sa volonté
durablement sur le terrain et au coeur des populations vulnérables qui
constituent désormais un des enjeux majeurs de l'intervention des forces
de défense et de sécurité. Cet équilibre repose sur
trois axes prioritaires de développement capacitaire :
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 102
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
1- LA POURSUITE DE L'EFFORT POUR LA MAITRISE DE
L'INFORMATION ET LE DEVELOPPEMENT DE CAPACITES D'ADAPTATION ET DE REACTION DES
FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE FACE A L'ENNEMI.
La poursuite d'un effort significatif dans la maîtrise
de l'information et dans la compréhension des situations tactiques
constitue sans nul doute la première priorité. Elle contribue
à la conservation de la liberté d'action du chef et se
concrétise par la capacité d'anticiper les
événements, en disposant en temps utile des informations
essentielles à la manoeuvre. Elle couvre la réalisation effective
de la mise en réseau, qu'il faut sécuriser par la
fiabilité des communications, la capacité à organiser et
acheminer des quantités toujours plus grandes de données en temps
quasi réel, et la garantie de leur confidentialité. Elle concerne
également le développement et l'intégration des moyens du
renseignement et de contre-renseignement. A cet égard, il faut
considérer six capacités complémentaires telles que la
surveillance générale et ciblée, la reconnaissance de la
zone d'action des FDS, avec la mise en oeuvre de robots, de drones, de radar de
surveillance au sol, et en bénéficiant des informations au
travers de la chaîne image ; le traitement des données et des
informations ; le partage des situations opérationnelles tactiques et de
théâtres ; les actions dans les champs immatériels ; la
détection des émetteurs sur l'ensemble du spectre
électromagnétique ; la neutralisation des émissions et
désorganisation des moyens de coordination adverses.
Le développement de l'adaptabilité et de la
réactivité des moyens de combat et de contrôle des milieux
représente le troisième axe prioritaire pour répondre aux
exigences des nouvelles réalités tactiques. Pour pouvoir faire
face à un spectre élargi de situations opérationnelles,
dans la durée et au milieu des populations, il s'agit de disposer de
forces de contact flexibles mais robustes, souples dans leur emploi mais bien
protégées face aux menaces Boko Haram, aptes à se fondre
dans des milieux humains compliquées mais disposant toujours d'une
puissance de feu et de choc importante et visible, donc potentiellement
dissuasive.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 103
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Cette transformation du système de contact sera
conduite avec le souci permanent de stricte suffisance, de maîtrise des
coûts et des risques technologiques, sans affecter l'efficacité
opérationnelle des unités. Elle a vocation à fluidifier
l'action au contact et à augmenter l'efficience des forces. A cet
égard, les priorités sont fixées sur :
· La connaissance avant l'action grâce au partage
de la situation et à la mise en oeuvre de capteurs variés
(robots, mini drones) ;
· La réalisation de plates-formes multi
rôles ;
· La combinaison, la variété, la gradation
et la précision des effets adaptés à l'objectif
visé (concentration des trajectoires diverses, armes à
létalité réduite, tir au-delà de la vue directe,
armes à effets dirigés ou thermobariques) ;
· L'amélioration et le renforcement de la
protection, avec des protections active, passive et distribuée, tout en
recherchant l'allègement.
2- LA RATIONALISATION DES MOYENS DE COMMANDEMENT ET LA
REDUCTION DES MOYENS CONSACRES AUX TACHES DE SOUTIEN ET D'APPUI EN OPERATIONS
BH
Afin de réserver les ressources les plus critiques aux
actions vraiment déterminantes en termes d'effets sur les menaces
actives de la secte djihadiste Boko Haram, le commandement des
opérations doit garantir l'initiative dans l'ensemble des champs
d'application des opérations par une organisation, un fonctionnement et
des systèmes robustes, éclatés, distants et flexibles,
présentant systématiquement une plus grande intégration
interarmées et davantage de polyvalence. Cette supériorité
décisionnelle repose sur trois idées forces que sont :
? La fusion du niveau commandement de composante avec le niveau
de commandement de théâtre pour créer un niveau
qualifié de tactico-opératif ;
? L'application du principe de pôles d'expertises distants
pour alléger les centres d'opération projetés et faciliter
leur manoeuvre ;
? L'architecture modulaire et infocentrée du centre futur
des opérations.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 104
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
L'optimisation du soutien vise à rationaliser les flux
et à doter la logistique de capacités à agir partout,
notamment en milieu complexe et hostile avec les moyens strictement suffisants
et juste à temps, dans un dispositif en constante évolution.
Cependant, les fonctions de soutien contribuent également à la
plupart des tâches non strictement militaires de stabilisation, notamment
l'aide aux populations. Plus que de la limitation de leur empreinte au sol,
c'est en fait de leur maîtrise qu'il s'agit. Sous réserve que les
objectifs de mise en réseau et d'intégration interarmées
aient été atteints avec les niveaux de fiabilisation et de
protection requis, les ressources allouées aux fonctions d'aide au
commandement, d'appui «feux», de soutien logistique, pourront
être contenues sans faire d'impasse sur leurs effets et en limitant leur
vulnérabilité.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Dans la présente partie, l'intention a
été de retracer l'historique de l'avènement de BH. Elle
ressort les causes profondes de la crise à Boko Haram, examinées
sous l'angle des liens historiques avec la population voisine du
Nigéria, de l'effet de contagion (propagation) de l'extrémisme
violent depuis le Nigéria, de la vulnérabilité
socioéconomique sous-jacente de l'Extrême-Nord du Cameroun et de
la quasi-inexistence de services publics. La crise a eu de graves
répercussions sur l'économie locale, mais aussi sur
l'économie nationale. Elle a également eu des conséquences
sociales de grande portée. L'approche sécuritaire adoptée
et les actes de violence perpétrés par Boko Haram ont
créé de graves problèmes de gouvernance. De
surcroît, il convient de noter que les perspectives et impératifs
stratégiques et opérationnels exacerbent la situation au regard
d'une vision associationniste sécuritaire ou encore de l'influence
sociale.
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
CONCLUSION GENERALE
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 105
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 106
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
Somme toute, les développements
précédents s'inscrivent à suffisance dans le cadre travail
de recherche portant sur la « construction du dispositif de veille
sécuritaire au Cameroun à l'aune de la menace Boko Haram ».
En effet, la partie septentrionale du Cameroun est en proie aux exactions
insurrectionnelles de la secte islamiste BH. Celles-ci vont contraindre l'Etat
du Cameroun à la construction voire la redynamisation de son dispositif
sécuritaire. Ainsi, pour faire face à cette menace, il est
nécessaire de penser la réorganisation partielle du dispositif de
defense adapté aux menaces de types asymétriques. Les multiples
contributions et mobilisations bilatérales ou multilatérales ont
permis de réduire ou limiter les ambitions idéologiques de BH. Le
renforcement des capacités des FDS a conduit à des
résultats escomptés et probants avec la délocalisation de
BH dans les zones périphériques de l'Extrême-Nord.
Cependant la resilience de BH s'explique par des faiblesses ou influences
stratégiques et opérationnels avec un dispositif aux allures
répressives que préventives. Une telle situation appelle à
sécuriser autrement. Enfin, ce travail est une opportunité pour
l'éveil de la conscience des dirigeants africains pour la mise en oeuvre
des stratégies susceptibles de trouver les solutions aux défis du
terrorisme, qui sont posés aux États du continent en
général et au Cameroun en particulier dans le cadre de la lutte
contre les menaces asymétriques. Il se termine par un ensemble de
recommandations visant à agir et de prochaines démarches qui
pourraient être entreprises pour faire progresser la mise en oeuvre de la
Stratégie et améliorer la coopération antiterroriste en
Afrique. Ces recommandations concernent en particulier le rôle que peut
jouer le Cameroun et la Stratégie dans le réajustement des
efforts antiterroristes en Afrique et le renforcement de la coopération
entre les États dans la sous-région et entre les partenaires de
la sous-région et de l'extérieur, notamment l'UE, les Nations
Unies.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 107
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
BIBLIOGRAPHIE
1- Ouvrages
Albert Einstein, L'éther et la théorie de la
relativité. La géométrie et l'expérience.
Atlas de l'Afrique : Cameroun, Les éditions J.A
Atlas de l'Afrique : Géopolitique du XXIe siècle,
Atlande 2006.
BOUTINOT LAURENCE, Migration, religion et politique au Nord
Cameroun, Paris, Harmattan, 1999, 237p.
DAVID GALULA, Contre-insurrection. Théorie et Pratique,
Paris, Economica, 2008. FRANK EBOGO, Les Mobilisations collectives anti-Boko
Haram au Cameroun, Publibook,2019
FRANK EBOGO, La guerre hybride entre le Cameroun et la Bokostan,
Publibook, 2020 FRANÇOIS THUAL, Méthodes de la
géopolitique : apprendre à déchiffrer l'actualité,
Paris, Ellipses, 1996.
GERARD CHALLIAND, Les stratégies du terrorisme, Paris,
Desclée de Brouwer, 2002. JEAN JACQUES ROCHE, Théorie des
relations internationales
KOUNGOU LEON, Boko Haram : le Cameroun à l'épreuve
des menaces.
KOUNGOU LEON, Boko Haram, parti pour durer, Paris, Harmattan,
2016, 161p. KOUNGOU LEON, Culture stratégique et concept de
défense au Cameroun, Paris, Harmattan, Etudes africaines, 2015, 282
p.
LE MOIGNE, Jean-Louis et CARRE, Daniel. Auto organisation de
l'entreprise, 50 propositions pour l'autogestion. Les Editions
d'Organisation, 1977
MADELEINE GRAWITZ, Lexique des sciences sociales,
8ème édition, Paris, Dalloz, 2004. VICTORIN HAMENI
BIEULEU, Politique de défense et sécurité nationale du
Cameroun, paris, l'harmattan, 2012.
NORBERT ELIAS, La dynamique de l'Occident, Calman Lévy,
Paris, 1975 JEAN-FRANÇOIS BAYART, l'Etat du Cameroun, Presses de la
Fondation Nationale de Sciences Politiques, Paris, 1985.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 108
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
2- Articles
JOSEPH VINCENT NTUDA EBODE,
ibid. et LEON KONGOU, « Boko Haram :
imbroglio dans le Nord du Cameroun », Revue Défense nationale,
n° 775, décembre 2014
La Nouvelle Expression, « Le Cameroun à
l'épreuve de la spirale terroriste du groupe djihadiste Boko Haram
» N°3734, du lundi 26 mai 2014.
La Nouvelle Expression, « Menace terroriste : comment
contrer Boko Haram », N°285 du lundi 18 août 2014.
CYRIL MUSILA, « L'insécurité
transfrontalière au Cameroun et dans le bassin du lac Tchad », Note
de l'IFRI, juillet 2012
SAIBOU ISSA (dir), Les effets économiques et sociaux des
attaques de Boko Haram dans l'Extrême-Nord du Cameroun, Université
de Maroua, KALIAO, volume spécial, Novembre 2014
SALAMATOU YVONE in L'oeil du Sahel, « le chef du
comité de vigilance tué par Boko Haram »
BANGOURA Dominique, « L'Afrique commence à
s'organiser pour sa sécurité collective », Marchés
Tropicaux et Méditerranéens n°3000, mai 2003.
MAMAN JOEL in Cameroun Tribune, « lutte contre Boko Haram :
les comités de vigilance remobilisés »
LE MONDE DIPLOMATIQUE, « Cameroun : les comités de
vigilance contre Boko Haram, de la défense à l'attaque »
DANIELLE MINDEU KADJEU, « Acteurs et instruments dans la
lutte contre Boko Haram. Trajectoires camerounaise et nigériane »,
Sens Public, octobre 2016, p.9. Disponible sur
http://www.senspublic.org/spip.php?article1213
ADAM HIGAZI et FLORENCE BRISSET-FOUCAULT, « Les origines et
la transformation de l'insurrection de Boko Haram dans le Nord du Nigeria
», Politique Africaine, n°130, 2013 AÏCHA PEMBOURA, « la
culture stratégique de l'élite militaire camerounaise a
l'épreuve de la lutte contre Boko Haram » International Journal of
Innovation and Applied Studies ISSN 2028-9324 Vol. 19 No. 4 Mar. 2017, pp.
886-896
YAYA MOUNTAPMBEME, « Aux sources de Boko Haram », Le
Point du Jour, n° 13, septembre 2014, p. 4.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 109
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
3- Travaux universitaires
PELAGIE CHANTAL BELOMO ESSONO, L'ordre et la
sécurité publics dans la construction de l'Etat au Cameroun
Thèse de doctorat en Science politique, Institut d'Etudes Politiques de
Bordeaux, février 2007, Version numérique sur
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00306419.
MATHIAS-ERIC OWONA NGUINI, La sociogenèse de l'ordre
politique au Cameroun : entre autoritarisme et démocratie (1978-1996).
Les régimes politiques et économiques au gré des
conjonctures et des configurations socio-historiques, Thèse de Doctorat,
Université Montesquieu-Bordeaux IV-IEP, CEAN, 1997
LUC SINDJOUN, Construction et déconstruction locales
de l'ordre politique au Cameroun : la sociogenèse de l'Etat,
Thèse de doctorat en Science politique, Yaoundé, 1994
MAHOP JULIEN FRANCIS, La Contribution de l'Ecole
Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES) à la
formation des Forces africaines aux Opérations de Soutien à la
Paix
ELA ELA EMMANUEL, la politique de défense au Cameroun
depuis 1959 : contraintes et réalités, Thèse de doctorat,
Etudes africaines, Nantes, 2000
ELYSEE MARTIN ATANGANA, Le Bassin du Lac Tchad face aux
nouvelles formes de menace : La difficile dynamique de réponse
régionale face à la montée en puissance du groupe
terroriste islamiste Boko Haram, Mémoire présenté à
la Faculté des Études supérieures et postdoctorales en vue
de l'obtention du Grade de Maître ès sciences (M. Sc.) en Etudes
Internationales
Centre de Recherche et d'Etudes Politiques et
Stratégiques, Cours de méthodologie de recherche et de
rédaction d'un mémoire professionnel, Université de
Yaoundé II, SOA, 2015. Economie, N°509, du lundi 5 janvier 2015.
4- Textes juridiques officiels
Décret N° 2001/177 du 25 juillet 2001 portant
organisation du Ministère de la Défense.
Loi N°2014/028 du 23 Décembre 2014 portant
répression des actes de terrorisme.
Le décret N°60/198 du 27 Octobre 1960 portant
Organisation Générale des Forces Armées.
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 110
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
La loi N°67/LF/9, du 12 juin 1967 portant organisation
générale de la défense.
Le décret N°83/540 du 05 novembre 1983 portant
organisation du Ministère des Forces Armées et du
Commandement.
Le décret N°2001/177 du 25 juillet 2001 portant
Organisation du Ministère de la Défense
5- Rapport et études
Rapport 2016 d'Amnesty International, « Bonne cause,
mauvais moyens : atteintes aux droits humains et à la justice dans le
cadre de la lutte contre Boko Haram au Cameroun », rendu public le 14
juillet 2016.
Rapport de l'International Crisis Group « Cameroun :
faire face à Boko Haram », n° 241, 16 novembre 2016
Rapport général des travaux du Colloque,
l'efficacité des Opérations de Maintien de la Paix en Afrique
Centrale : rétrospective critique et prospective, EIFORCES,
Yaoundé, Décembre 2013
6- Revues
Bulletin d'Analyse Stratégique et Prospectives,
«VIGIE» N°s 003 et 004 -Décembre 2014. /EIFORCES.
Bulletin d'Analyse Dynamiques et Prospectives,
«VIGIE» N°s 003 et 007 -Jan-Mars 2018. /EIFORCES.
7- Magazines
Cameroun Tribune.
Le Quotidien LE JOUR. Jeune Afrique.
8- Webographie
www.securityanddevelopment.org
;
www.africansecuritynetwork.org
;
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DEDICACE iv
REMERCIEMENTS v
SIGLES ET ABREVIATIONS vii
LISTE DES ILLUSTRATIONS ix
LISTE DES ANNEXES x
RESUME EXECUTIF xi
EXECUTIVE SUMMURY .xii
INTRODUCTION GENERALE 13
SECTION 1 : DE LA CONSTRUCTION DE L'OBJET DE RECHERCHE 14
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE 14
A- CONTEXTE GEOPOLITIQUE 15
B- CONTEXTE GEOSTRATEGIQUE 16
II- CHOIX ET INTERET DE L'ETUDE 17
A- INTERET SCIENTIFIQUE 17
B- INTERET PRATIQUE 18
III- DELIMITATION DE L'ETUDE 19
A- DELIMITATION GEOPOLITIQUE 19
B- DELIMITATION CHRONOLOGIQUE 20
IV- CLARIFICATION DES CONCEPTS 20
V- PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 21
A- QUESTION PRINCIPALE 22
B- QUESTIONS SECONDAIRES 22
VII- HYPOTHESES DE RECHERCHE 22
A- HYPOTHESE PRINCIPALE 22
B- HYPOTHESES SECONDAIRES 22
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 111
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
SECTION 2 : CONSTRUCTION DU CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE DE
LA RECHERCHE 22
I- CADRE THEORIQUE 23
A- LE CONSTRUCTIVISME SECURITAIRE 23
B- LE FONCTIONNALISME SECURITAIRE 24
II- CADRE METHODOLOGIQUE 25
A- METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 26
B- METHODE D'ANALYSE DES DONNEES 26
III- PLAN DE TRAVAIL 28
PREMIERE PARTIE : CADRE DE DEROULEMENT DU STAGE
29
CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DE
L'ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE (EIFORCES) ET LA PLACE DU CENTRE
DE RECHERCHE ET
DE DOCUMENTATION 31
SECTION 1 : PRESENTATION DE L'EIFORCES 31
PARAGRAPHE 1 : Organisation et Fonctionnement de l'Eiforces 31
A- Le conseil d'administration de l'eiforces 31
B- La direction générale de l'eiforces 33
C- Les organes consultatifs de l'eiforces 37
PARAGRAPHE 2 : Les missions de l'Eiforces 39
A- La formation 39
B- La recherche 41
SECTION 2 : COOPERATION ET PARTENARIATS
42
PARAGRAPHE 1 : Au plan bilateral 43
PARAGRAPHE 2 : Au plan multilateral 43
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE A L'EIFORCES
45
SECTION 1 : ACQUIS, DIFFICULTES ET SUGGESTIONS
EVENTUELLES 45
PARAGRAPHE 1 : Les Acquis Et Les Difficultés
Rencontrées 45
A- L'apport du stage 45
B- Les difficultés rencontrées 46
PARAGRAPHE 2 : Les Suggestions 46
CONCLUSION DE LA PREMEIRE PARTIE 46
DEUXIEME PARTIE : CONSTRUCTION DU DISPOSITIF DE VEILLE
SECURITAIRE AU CAMEROUN SOUS LA MENACE BOKO HARAM 48
CHAPITRE 3 : SOCIOGENESE DE LA MENACE BOKO HARAM ET
LA
REDYNAMISATION DU DISPOSITIF DE VEILLE SECURITAIRE.
49
SECTION 1 : SOCIOGENESE DE LA MENACE BOKO HARAM
49
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 112
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
PARAGRAPHE1 : D'un mouvement de protestation
sociale à la constitution d'un ordre
terroriste 49
A- Boko Haram : mouvement de contestation sociale 49
B- Boko Haram : un ordre terroriste 50
PARAGRAPHE 2 :
les répercussions de la menace sur le développement
à l'extrême-nord du
cameroun 54
A- Effet sur le commerce régional et le tourisme 55
SECTION 2 : DIFFICILE DYNAMIQUE DE REPONSE
OPERATIONNELLE ET LA REDYNAMISATION DU DISPOSITIF DE VEILLE
SECURITAIRE
CAMEROUNAIS 61
PARAGRAPHE 1 : difficile dynamique opérationnelle contre
BH 62
A- Obsolescence du dispositif classique de veille
sécuritaire 62
B- BH comme menace a l'imagologie transfrontalière
64
PARAGRAPHE 2 : de la redynamisation du dispositif de
veille sécuritaire à l'aune de
BH 67
A- Réorganisation partielle du schéma
sécuritaire national 68
B- BH et l'exigence de dépassement stratégique
pour une synergie d'acteurs en matière de
veille securitaire 70
? Les dynamiques bilatérales Nigéria-Cameroun et
Tchad-Cameroun 70
? La FMM dans la dynamique stratégique
opérationnelle contre BH au Cameroun
72
CHAPITRE 4 : RESILIENCE DE BOKO HARAM : ENTRE
FACTEURS STATIQUES, DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES STRATEGIQUE,
OPERATIONNELLES
INNOVANTES 80
SECTION 1 : LES FACTEURS STATIQUES ET DYNAMIQUES DE LA
RESILIENCE
DE BH A L'EPREUVE DE LA REDYNAMISATION DU DVS
80
PARAGRAPHE 1 : les facteurs statiques de
resilience de la menace BH 80
A- Les logiques naturelles 80
1- Terrain Et Relief Comme Atout Géostratégique
Pour Le Groupe BH 81
2- La Distance Et Le Climat Comme Déterminant De
Resilience De BH 81
B- Les logiques organisationnelles de la resilience de BH 81
1- La Réduction De L'effectif Et La Diversification Des
Forces Dans L'Armée 82
2- Inertie Dans La Pensée Sécuritaire Nationale Et
La Baisse Du Moral Dans Le DVS 83
PARAGRAPHE 2 : Les Facteurs Dynamiques De La Resilience De Boko
Haram 84
A- Les Logiques Strategiques 84
1- Le Problèmes De Coordination Minimale Et Le Monopole
Institutionnel 85
2- Les Obstacles Infrastructurels 89
B- Les logiques operationnels 90
1- Le Confinement Militaire Des Etats Pour L'endiguement De La
Menace Et La Duplicité Des
Lobbies Dan L'industriel De L'armement 90
2- L'opportunisme Antidémocratique Et
Antirépublicain 91
SECTION 2 : COMBATTRE AUTREMENT BH : PERSPECTIVES ET
IMPERATIFS
STRATEGIQUES, OPERATIONNELS 94
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 113
Construction du dispositif de veille sécuritaire au
Cameroun à l'aune de la menace Boko
Haram
PARAGRAPHE 1 : Perspectives Sécuritaires
Stratégiques Et Opérationnelles Anti- Boko
Haram 94
A- Perspectives sécuritaires stratégiques 94
1- Renforcement de la resilience nationale face à la
menace 94
2- La perfection de la strategie globale de lutte Contre BH
94
B- Perspectives operationnelles 95
1- Création des unités police locale 95
2- Le renforcement des capacités des services de
renseignement 96
PARAGRAPHE 2 : Les Impératifs Sécuritaires
Stratégiques Et Opérationnels
Anti- BH 96
A - Impératifs sécuritaires stratégiques
97
1- Réactualisation de la doctrine d'emploi des forces au
Cameroun du 04 décembre
1979 97
2- L'urgence d'un livre blanc et le vote de la loi de
programmation militaire 98
A- Impératifs sécuritaires opérationnels
99
1- La Poursuite De L'effort Pour La Maitrise De L'information Et
Le Développement De Capacités D'adaptation Et De Réaction
Des Forces De Defense Et De Sécurité Face A
L'ennemi 99
2- La Rationalisation Des Moyens De Commandement Et La
Réduction Des Moyens Consacrés Aux Taches De Soutien Et D'appui
En Operations
BH 100
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 101
CONCLUSION GENERALE 102
BIBLIOGRAPHIE 104
TABLE DE MATIERE 112
ANNEXS 115
Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU
Sapam Ousmanou Page 114
| 


