|
|
|
|
|
REPUBLIQUE UNIVERSITE FACULTE
CENTRE DE FORMATION SCIENCES,
|
************
************
************
GEOSCIENCES
LABORATOIRE LABORATORY
DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
************
DE YAOUNDE I THE UNIVERSITY OF YAOUNDE
************
DES SCIENCES FACULTY OF SCIENCE
************
RECHERCHE ET DE POSGRADUATE SCHOOL
DOCTORALE EN SCIENCES,
TECHNOLOGIE ET TECHNOLOGY AND
GEOSCIENCES
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA
TERRE
DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES
DE GEOSCIENCES DES FORMATIONS SUPERFICIELLES
APPLICATIONS
OF GEOSCIENCES OF SUPERFICIAL FORMATIONS AND
APPLICATIONS
|
I
OF
ET
|
|
|
CARACTERISATION PHYSIQUE DES
MATERIAUX
ALLUVIONNAIRES DE LA RIVIERE
DJEL A PAN-MAKAK (BOT-MAKAK)
|
|
Mémoire
Spécialité :
Géosciences
Option
|
présenté en vue de l'obtention de Master en
Sciences de la Terre
des Formations Superficielles : Géologie
Minière et Ressources
Par
WELBA Moïse
Matricule
19L2285
Licencié ès - Sciences
Sous la direction
Dr. Elisé SABABA
Chargé de
Cours
|
du Diplôme
et Applications Pétrolières
|
|
Année académique 2021-2022
|
|
|
|
|
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES i
i
REMERCIEMENTS iv
LISTE DES FIGURES v
LISTE DES TABLEAUX vi
LISTES DES ABRÉVIATIONS vii
RÉSUMÉ viii
ABSTRACT ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
CHAPITRE I : MILIEU NATUREL ET CADRE GÉOLOGIQUE 3
I.1. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 4
I.1.1. Situation géographique 4
I.1.2. Climat 5
I.1.3. Sols 5
I.1.4. Orographie 6
I.1.5. Végétation 7
I.1.6. Hydrographie 8
I.2. CADRE GÉOLOGIQUE 9
I.3. GÉOGRAPHIE HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 11
I.3.1. L'histoire des peuplements 11
I.3.2. Population-peuplement et économie 11
CHAPITRE II : TRAVAUX ANTÉRIEURS ET MÉTHODOLOGIE
13
II.1. ÉTUDES ANTÉRIEURES 14
II.1.1. Généralités 14
II.1.1.1. Concepts et définitions 14
II.1.1.2. Mode de mise en place des alluvions 14
II.1.1.3. Utilisation des matériaux alluvionnaires 15
II.1.2. Caractérisation physique des alluvions 16
II.1.3. Synthèses des travaux sédimentologiques
des dépôts alluvionnaires 17
II.1.4. Synthèses des travaux faites sur la
géologie 18
II.2. MÉTHODOLOGIE 19
II.2.1. Étude de terrain 19
II.2.1.1. Éléments de description des puits
d'échantillonnage 19
II.2.1.2. Échantillonnage 20
II.2.2. Travaux de laboratoire 21
II.2.2.1. Analyses sédimentologiques 21
II.2.2.1.1. Analyse granulométrique 21
ii
II.2.2.1.2. Analyse morphoscopique 23
II.2.2.2. Minéraux lourds 24
II.2.2.3. Analyse pétrographique des roches 25
CHAPITRE III : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 26
III.1. ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE. 27
III.1.1. Amphibolite (PR4) 27
III.1.3. Micaschiste à grenat (PR3) 29
III.1.5. Gneiss à grenat et biotite (PR1) 31
III.1.6. Gneiss à micas et grenat (PR2) 33
III.2. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES 36
III.3. ÉTUDE GRANULOMÉTRIQUE 39
III.3.1. Granulométrie 39
III.3.2. Courbes cumulées et indices
granulométriques 41
III.3.3. Analyse des histogrammes 45
III.4. ÉTUDE MORPHOSCOPIQUE 48
III.4.1. Analyse des diagrammes surfacés des grains 48
III.4.2. Formes des grains 50
III.5. ÉTUDE DES MINÉRAUX LOURDS 51
III.5.1. Description des différentes espèces
minérales 52
III.5.2. Présentation analytique des minéraux
lourds 54
CHAPITRE IV : INTERPRÉTATION ET DISCUSSION 56
IV.1. PÉTROGRAPHIE 57
IV.2. ALLUVIONS 57
IV.2.1. Dynamique des alluvions 57
IV.2.2. Origine et mode de dépôts des alluvions
58
IV.3. INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DES
MATÉRIAUX ÉTUDIÉS 59
CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 61
CONCLUSION GÉNÉRALE 62
PERSPECTIVES 63
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 64
ANNEXE 70
iii
DÉDICACE
À MES CHERS PARENTS
KACTOUIN DJONKAMLA et NGABOKO Antoinette
iv
REMERCIEMENTS
Le présent travail est le fruit de la contribution
intellectuelle, morale, financière et amicale de plusieurs personnes.
Ainsi, tout en espérant que je n'oublierais personne, j'exprime ma
gratitude au Dieu tout puissant et à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à sa réalisation.
Je tiens d'abord à adresser ma sincère
reconnaissance à l'endroit du Docteur Elisé SABABA, qui a
accepté de diriger ce travail. Il m'a accueilli dans son équipe
et a cultivé en moi l'envie de bien faire. Son soutien moral, ses
conseils judicieux, sa rigueur au travail et sa grande ponctualité m'ont
été bénéfiques.
Mes remerciements les plus distingués vont à
l'endroit du Chef de Département des Sciences de la Terre de
l'Université de Yaoundé I, Professeur NDJIGUI
Paul-Désiré, pour m'avoir accueilli au sein de son illustre
département.
Ma reconnaissance va à l'endroit de tous les
enseignants du Département des Sciences de la Terre de
l'Université de Yaoundé I pour leurs enseignements et les
nombreux conseils reçus.
J'adresse également mes sincères remerciements
au Docteur EKOA Armel et à Mr DJOKGOUE YONGA Franck qui ont su apporter
à ce travail toute leur rigueur scientifique et la disponibilité
dont ils ont fait preuve durant la finalisation de ce travail.
J'aimerais gratifier les efforts de mes ainés
académiques et mes camarades de promotion membres du Laboratoire de
Géosciences des Formations Superficielles et Applications pour les
nombreux échanges scientifiques et les remarques qui ont
contribué à éclairer plusieurs points d'ombre favorisant
la compréhension de certains phénomènes
géologiques.
Je tiens à remercier la famille KACTOUIN DJONKAMLA et
NGABOKO Antoinette pour leur soutien inconditionnel et leur aide multiforme.
Je ne saurais oublier mes amis et frères AÏNON
Dieudonné, BAYANG Joël, DAWE Ulrich, DONPA Isaac,
DOURWE Willy, GNAZOCK Éliane, NAGONDINSSE Benjamin, RABIATOU
OUSMANOU et WAYANG Joseph avec qui j'ai toujours partagé mes moments de
joie et de peine.
Ma profonde gratitude s'adresse aux autorités
administratives et traditionnelles de l'arrondissement de Bot-Makak. Je pense
particulièrement aux populations du village Pan-Makak et Mintaba pour
leur hospitalité durant mes campagnes de terrain.
Nombreux sont ceux dont leurs noms ne figurent pas ici
à qui j'exprime ma
reconnaissance et ma profonde gratitude.
v
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : carte de localisation de la zone
d'étude 4
Figure 2 : diagramme ombrothermique de la
région de Bot-Makak. 5
Figure 3 : carte géomorphologique du
secteur d'étude. 7
Figure 4 : aperçu partiel du couvert
végétal. 8
Figure 5 : carte hydrographique de la zone
d'étude 9
Figure 6 : carte géologique du secteur
d'étude 10
Figure 7 : modèle des courbes
granulométriques de Mouldi et Chkiou (2007). 17
Figure 8 : carte d'échantillonnage.
20
Figure 9 : affleurement d'amphibolite. 27
Figure 10 : photographie de l'amphibolite
28
Figure 11 : affleurement de micaschiste
à grenat. 29
Figure 12 : photographies du micaschiste
à grenat 30
Figure 13 : affleurement du gneiss à
grenat et biotite. 31
Figure 14 : photographies du gneiss à
grenat et biotite. 33
Figure 15 : affleurement du Gneiss à
micas et grenat. 34
Figure 16 : photographies du gneiss à
micas et grenat 35
Figure 17 : espèces minérales
du niveau sablo-graveleux de la maille 4 mm du puits P 31 38
Figure 18 : profils de puits. 39
Figure 19 : courbes cumulées des
différents échantillons 43
Figure 20 : histogrammes des
différents échantillons. 47
Figure 21 : diagrammes surfacés des
échantillons. 49
Figure 22 : différentes formes des
grains de quartz et minéraux ferrifères observés à
la loupe
binoculaire au grossissement 50 X. 51
Figure 23 : minéraux lourds 54
Figure 24 : pourcentage des minéraux
lourds dans la fraction globale des différents. 55
vi
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: moyenne mensuelle des
précipitations et des températures de Mandoga pour la
période de 2002-2021 5
Tableau 2 : échelle de classification
des sédiments (Wentworth, 1922). 16
Tableau 3 : localisation des points
d'échantillonnage. 21
Tableau 4 : tableau récapitulatif des
formations de Pan-Makak. 36
Tableau 5 : masses des refus, pourcentages
simples et cumulés des échantillons par maille du secteur
d'étude 40
Tableau 6 : indices granulométriques.
42
Tableau 7 : inventaires des grains
observés. 48
Tableau 8 : distribution des minéraux
lourds. 52
vii
LISTES DES ABRÉVIATIONS
CNPE : Chaîne Panafricaine Nord
Equatoriale
GPS : Global Positioning System
LPA : Lumière Polarisée
Analysée
LPNA : Lumière Polarisée Non
Analysée
PCD : Plan Communal de
Développement
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux
SRTM : Shuttle Radar Topography Mission
(Navette pour des missions topographique radar)
Accronyme
AFNOR : Agence Française de
Normalisation
Liste des abréviations utilisées pour
les minéraux (Kretz, 1983)
Amp : amphibole
Bt : biotite
Grt : grenat
Kfs : feldspath alcalin
Ms : muscovite
Op : Minéraux opaques
Pl : plagioclase
Qtz : quartz
Rt : rutile
viii
RÉSUMÉ
Le site d'étude est localisé dans la partie
Sud-Est de Bot- Makak, à l'Ouest de Yaoundé, à
proximité de l'autoroute Yaoundé-Douala. L'objectif principal est
de faire une caractérisation physique des alluvions dans le secteur de
Pan-Makak afin de comprendre l'interaction entre les roches en place et les
minéraux rencontrés dans les alluvions. La zone d'étude
est soumise à un climat tropical humide à quatre saisons. Le
relief est marqué par la présence des collines à pentes
fortes. Le substratum gneissique est recouvert par des sols ferrallitiques
rouges et jaunes. La végétation est une forêt secondaire
avec un réseau hydrographique dense et dendritique.
Afin d'atteindre l'objectif de ce travail, l'approche
méthodologique adoptée a consisté en une prospection au
marteau et à la collecte des échantillons en suite, à la
réalisation des analyses pétrographiques des roches et aux
études sédimentologiques.
Les formations lithologiques du secteur d'étude sont
des roches essentiellement métamorphiques. Il s'agit de l'amphibolite
à texture granoblastique hétérogranulaire, du micaschiste
à texture lépidogranoblastique hétérogranulaire, et
les gneiss avec comme texture granoblastique hétérogranulaire.
L'analyse granulométrique a permis de montrer que les
alluvions sont mal triés. L'allure forte des pentes traduit le fait que
les alluvions sont hétérométriques avec un bon classement.
Les coefficients d'asymétrie indiquent que les alluvions de Pan-Makak se
sont déposés dans un milieu de forte énergie plus ou moins
agité.
La morphoscopie des grains de quartz montre une
prédominance des grains très anguleux (17,66 %), anguleux (55,67
%) et sub-anguleux (27,67 %) contrairement au grain sub-émoussé
(0,66 %) et émoussé (0,34 %). Ce résultat suggère
un court transport et une source d'apport proche.
L'étude des minéraux lourds montre que les
alluvions sont constituées des minéraux tels que : le zircon, le
rutile, le disthène, la tourmaline, la sillimanite, le chloritoïde,
le grenat, la zoïsite, le diopside, la staurotide, l'augite et les
minéraux opaques. Ce résultat montre que les alluvions ont une
origine métamorphique.
Les matériaux alluvionnaires de la rivière Djel
présentent un intérêt économique assez important, et
sont utilisés par les riverains pour la réalisation de plusieurs
ouvrages. Ils renferment tout de même des concentrés de rutile qui
présentent un intérêt économique assez important.
Mots-clés : Pan-Makak, alluvions,
amphibolite, gneiss, micaschiste
ix
ABSTRACT
The study site is located in the southeastern part of
Bot-Makak, west of Yaoundé, near the Yaoundé-Douala highway. The
main objective is to make a physical characterization of the alluvium in the
Pan-Makak area in order to understand the interaction between the bedrock and
the minerals encountered in the alluvium. The study area is subject to a humid
tropical climate with four seasons. The relief is marked by the presence of
hills with steep slopes. The gneissic substratum is covered by red and yellow
ferrallitic soils. The vegetation is a secondary forest with a dense and
dendritic hydrographic network. The parent rock of metamorphic origin has a
composition similar to metapelites.
In order to achieve the objective of this work, the
methodological approach adopted consists of a hammer prospecting and the
collection of samples in continuation, the realization of petrographic analyses
of rocks and sedimentological studies.
The lithological formations of the study area are essentially
metamorphic rocks. They are amphibolites with heterogranular granoblastic
texture, micaschists with heterogranoblastic texture, and gneiss with
heterogranular granoblastic texture.
The particle size analysis indicated that the alluvium is well
sorted. The strong slope pattern reflects the fact that the alluvium is
homometric with good grading. The asymmetry coefficients indicate that the
Pan-Makak alluvium was deposited in a high energy
environment with varying degrees of agitation.
Quartz and iron grains morphoscopy show a predominance of very
angular (17.66%), angular (55.67%), and sub-angular (27.67%) grains in contrast
to sub-blunt (0.66%) and blunt (0.34%) grains. This result suggests a short
transport and a close source of supply.
The study of heavy minerals shows that the alluvium consists
of minerals such as: zircon, rutile, kyanite, tourmaline, sillimanite,
chloritoid, garnet, zoïsite, diopside, staurotide, augite and opaque
minerals. This result shows that alluvium has a metamorphic and magmatic
origin.
The alluvial materials of Djel river are of great economic
interest and are used by the residents for the construction of several
structures. They contain nevertheless rutile concentrates.
Keywords: Pan-Makak, Alluvium, Amphibolite,
Gneiss, Micaschist
INTRODUCTION GÉNÉRALE
2
Le mot alluvion vient du latin « alluvio », qui veut
dire débordement. Il peut être défini comme des
sédiments des cours d'eau et des lacs, composés selon les
régions traversées et la force du courant. Pour la fraction
grossière on a les galets, les graviers et les sables en
dépôts souvent lenticulaires et pour la fraction fine, les limons
et les argiles (c'est la fraction qui domine dans les zones inondables)
(Foucault et Raoult, 2019). C'est aussi le nom donné aux
matériaux sableux, limoneux et argileux charriés par des eaux
poussées du haute vers le bas au travers des crevasses de
l'écorce terrestre. Le secteur d'étude situé dans le
groupe de Yaoundé montre la présence des dépôts des
minéraux lourds riches en rutile (Nyobe et al., 2018). Au Cameroun,
plusieurs études ont été menées sur les alluvions
et les minéralisations associées : Matomb (Tonjé et al.,
2014) ; Nkoléban (Belinga, 2017) ; Ngaye (Ndjigui et al., 2018) ; Lobo
(Nyobe et al., 2018), afin de déterminer l'origine des alluvions, leurs
roches sources et les processus hydrodynamiques de dépôt.
L'utilisation des métaux contenus dans les roches a
été, dès la fin du néolithique une
préoccupation de l'Homme. Des recherches ont d'abord été
centrées sur les métaux natifs représentant les corps
minéralisés à forte teneur puis plus récemment,
l'exploitation de gisements à faible teneur a conduit à la
recherche des concentrations dans les alluvions qui pourraient s'effectuer
simplement quand certaines conditions de dépôt sont favorables
(Pavillon, 1964). Dans le secteur de Pan-Makak, très peu d'études
ont été faites sur les matériaux alluvionnaires.
Dès lors, il sera nécessaire d`effectuer une
caractérisation physique des matériaux alluvionnaires dans ce
secteur, pour essayer de relever le potentiel minier de cette localité,
aux moyens d'une prospection géologique et alluvionnaire.
L'objectif principal est de faire une caractérisation
physique des alluvions dans le secteur de Pan-Makak, et de manière
spécifique il sera question de :
- faire une caractérisation pétrographique de
quelques formations rocheuses ;
- déterminer la composition granulométrique des
sédiments de cette localité ;
- montrer l'interaction entre la roche en place, les
minéraux rencontrés dans les alluvions et souligner leur
'importance.
Pour atteindre ces objectifs, ce travail est structuré
en quatre chapitres, hormis l'introduction générale et la
conclusion générale :
- le chapitre I ressort le milieu naturel du secteur de Bot-Makak
;
- le chapitre II porte sur les travaux antérieurs et la
méthodologie ; - le chapitre III est axé sur les résultats
;
- le chapitre IV présente
l'interprétation et la discussion.
CHAPITRE I : MILIEU NATUREL ET
CADRE
GÉOLOGIQUE
4
Introduction
Le présent chapitre a pour but de donner un
aperçu général du secteur d'étude. Il s'agira
spécifiquement de présenter les traits
géographiques, le cadre géologique, et les activités
socio-économiques.
I.1. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE I.1.1. Situation
géographique
Le secteur d'étude est localisé dans la zone de
Bot-Makak et s'étend entre les latitudes 3°52'- 4°00' Nord, et
les longitudes 10°55'- 11°04'Est (figure 1). Le site d'étude
est localisé dans la partie Sud-Est de Bot- Makak, à l'Ouest de
Yaoundé, à proximité de l'autoroute Yaoundé-Douala,
à 10 kilomètres de l'Arrondissement de Bot-Makak,
Département du Nyong et Kellé, Région du Centre.

Figure 1 : carte de localisation : (a) carte
de l'Afrique montrant le Cameroun ; (b) carte montrant la Région du
Centre Cameroun ;c) zone d'étude (extraite de la carte SRTM).
5
I.1.2. Climat
Le secteur d'étude est soumis à un climat
équatorial de type guinéen classique à deux saisons de
pluies (correspondant aux saisons de cultures) et deux saisons sèches.
La température moyenne de Mandoga oscille entre 22 °C et 25 °C
avec une amplitude thermique variant entre 8 °C et 11 °C. Les
données pluviométriques de Mandoga montrent que les
précipitations annuelles se situent le plus souvent à 1925 mm de
pluie en moyenne par an ; la grande saison sèche va de décembre
à février, la petite saison de pluies va de mars à juin,
une chute de précipitation est observée au mois de juillet et la
grande saison de pluie d'août à novembre (figure 2).
Tableau 1: moyenne mensuelle des
précipitations et des températures de Mandoga pour la
période de 2002-2021 Source : http//
www.weatherbase.com
(téléchargée le 13/10/2020 à 14h)
|
MOIS
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
Moyenne
|
totale
|
|
Précipitations (mm)
|
22
|
50
|
152
|
203
|
240
|
181
|
110
|
167
|
316
|
334
|
125
|
25
|
/
|
1925
|
|
Température(°C)
|
25,2
|
25,5
|
25,4
|
25
|
24,7
|
23,6
|
22,9
|
22,5
|
23,5
|
23,6
|
23,9
|
24,8
|
24,22
|
/
|
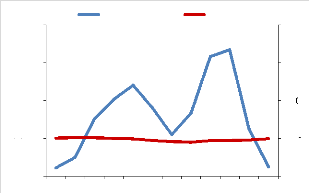
précipitation (mm)
400
300
200
100
0
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sept Oct Nov
Dec
Précipitations (mm) 2T (°C)
50
0
200
150
10
Tiempérature (°C)
Figure 2 : diagramme ombrothermique de
Bagnouls et Gaussen (1957) de la région de Bot-
Makak.
I.1.3. Sols
Les travaux effectués sur les matériaux
d'altération de Yaoundé et ses environs (Angue,
1982 ; Bitom, 1982 ; Kabeyene, 1982 ; Onguene, 1993 ; Ngon Ngon,
1996, 2007 ; Ndjigui et
6
al., 2013 ; Nyeck et al., 2018) montrent que ces formations
sont essentiellement constituées des sols ferrallitiques et des sols
hydromorphes. Les sols hydromorphes et ferralitiques sont les plus
représentés dans la région d'étude. Pour les
formations latéritiques, la distribution spatiale entre sols jaunes et
sols rouges est essentiellement liée aux facteurs pédologiques
(Nyeck, 2004).
- Les sols ferralitiques (ou oxisols)
Ces sols, d'épaisseur souvent importante
(jusqu'à 50 m), sont localisés au niveau des interfluves.
Développés sur différents types de roches
métamorphiques à savoir les micaschistes et les gneiss (Nyobe et
al., 2018), ces sols sont formés de matériaux constitués
par un assemblage des minéraux tels que la kaolinite, la gibbsite, le
quartz, la goethite, l'hématite et accessoirement l'illite, le grenat,
le zircon et le rutile (Nyeck et al., 2018). Cette composition
minéralogique est similaire à celle des profils
d'altérations développés sur des argiles
sédimentaires kaolinitiques (Ndjigui et al., 1999).
- Les sols hydromorphes
Les sols hydromorphes, sont localisés surtout à
proximité des lits du principal cours d'eau Djel, et dans certains
bas-fonds étendus. Leur épaisseur est de l'ordre du mètre.
Ils sont caractérisés par une accumulation en surface de
matière organique peu décomposée (souvent 20% en masse de
l'horizon de surface), riche en débris végétaux divers
(Tonjé, 2013).
I.1.4. Orographie
En termes de relief, le secteur d'étude présente
trois caractéristiques majeures (figure 3) : - une zone qu'on peut
caractériser de basses terres d'altitude de 350 à 450 m qui
représente 25 % de la surface topographique. Elle est constituée
d'interfluves séparés par des larges vallées
marécageuses et drainées principalement par la Djel. Cette zone
se trouve au centre du secteur d'étude ;
- une zone située au Sud-Ouest du secteur
d'étude au relief contrasté alternant des collines et des
bas-fonds plus ou moins plats avec des plateaux par endroit, des vallées
abritant très souvent des marécages avec en leur sein des cours
d'eau. Cette unité morphologique a une altitude comprise entre 450 et
550 m et représente environ 60 % ;
- une zone de hautes terres à l'Est, au Sud-Est et au
Nord du secteur d'étude, d'altitude comprise entre 550 et 700 m et
couvre 15 % de la localité. Elle est caractérisée par la
présence de nombreux reliefs résiduels se raccordant aux mornes,
à versants convexes qui se raccordent brutalement avec les bas-fonds.
Elle est couverte d'une forêt primaire dont l'exploitation peut
7
manifestement présenter des difficultés.
L'aspect un peu tourmenté de ce relief notamment au niveau de Bot-Makak
et de Hegba donne aux visiteurs de la Commune une impression de cuvette
à Bot-Makak et des vues panoramiques dans les hautes terres de Hegba et
Magdoga (figure3).
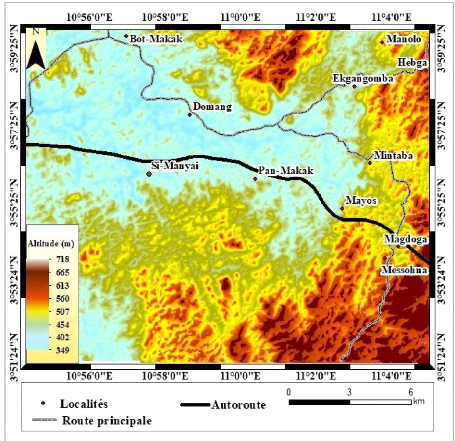
Figure 3: carte géomorphologique du
secteur d'étude (extraite de la carte SRTM). I.1.5.
Végétation
La végétation de la région d'étude
est influencée par les importantes précipitations
enregistrées et présente deux caractéristiques :
- une forêt primaire dans les localité de Lisse,
Mayôs, Manguen 1 ;
- une forêt secondaire dans le reste des villages et aux
abords des agglomérations.
8
La forêt primaire regorge des espèces de bois
exploitées telles que le Moabi (Baillonella toxisperma), le
Sapelli, l'Iroko et l'Ayous. À côté de quelques ventes de
coupe, on enregistre quelques activités clandestines de coupe sauvage de
bois (Letouzey, 1985). De nombreux produits forestiers non ligneux (PFNL) tels
que les mangues sauvages (Irvingia gabonerisis), les fruits de moabi
(Baillonella toxisperma), le ndjansang (Ricinodendron
heudoletti), le rotin (Lacosperma securdiflorum), les plantes
médicinales, le miel sauvage, les fibres de raphia, les fruits sauvages
divers, l'ekok (Gnetum africana), les noisettes, sont exploités
par les populations riveraines (Letouzey, 1968). Le secteur d'étude de
Pan-Makak est une zone forestière riche en biodiversité. Les
espèces floristiques partent des grands arbres à une multitude
d'herbes hautes et basses. Une partie des forêts qui se trouve sur des
collines est préservée et celle se trouvant sur les basses terres
en contrebas des collines est massivement détruites pour des raisons
agricoles ou d'exploitation forestière (PCD de Bot-Makak 2015) (figure
4).

Figure 4: aperçu partiel du couvert
végétal (cliché de février 2020). I.1.6.
Hydrographie
Toute la région d'étude appartient au sous
bassin du Nyong et des fleuves côtiers. Arrosée par plusieurs
cours d'eau : la Kellé (qui traverse les villages Manguen 2, Nkongtock
Kombeng), Pougue (Ngoung, Lamal-Pougue), Ndjimahe (Matomb), Manyaï
(Manyaï, Matomb), Mboye (Lisse), Djel (Mayôs), Masong ma njé
(Nkongtock), Liko'o (Bingogog, Mandoga et Nkenglikock) (Tonjé, 2007).
Cette zone reste coincée entre les deux plus grands fleuves de la
Région : la Sanaga et le Nyong. Le site d'étude est
traversé par les rivière Nsoube,
9
Nkongo'o, Balebem, Hohé, cours d'eau saisonnier et
permanant, tributaire de Mintaba, affluent de la Djel qui est le principal
collecteur de ce réseau hydrographique (figure 5). La Djel, principal
cours d'eau, est respectivement orienté suivant la direction SE-NW. Les
zones marécageuses se trouvant dans les bas-fonds qui constituent des
potentiels pièges de minéraux lourds industriels. Ce
réseau hydrographique est modifié au cours du temps par des
fluctuations climatiques et les travaux du chantier de
l'autoroute Yaoundé-Douala.
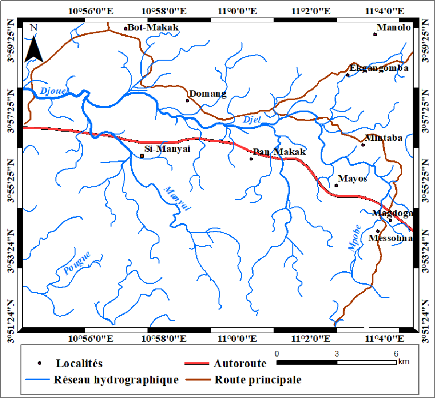
Figure 5: carte hydrographique de la zone
d'étude (d'après la carte topographique de Yaoundé 3c au
1/200000).
I.2. CADRE GÉOLOGIQUE
Le secteur d'étude appartient à la Chaîne
Panafricaine d'Afrique centrale (Penaye et al., 2004 ; 2006) encore
appelée Chaîne des Oubanguides (Podevin, 1983. Trompette, 1994) ou
Chaîne Panafricaine Nord Équatoriale : Nzenti et al.,
1988 ; Davison et Reginaldo,1989). En effet, c'est une méga
structure orientée E-W, d`une longueur supérieure à 5000
Km sur une largeur de 3000 Km et délimitée à l'ouest par
la Chaîne Panafricaine Trans-Saharienne et
10
au Sud par le craton du Congo. Elle se prolonge jusqu`au
Nord-Est du Brésil (province de Borborema) où elle forme la
Chaîne Néoprotérozoïque de Sergipano, l'ensemble
formant la Chaîne Panafricano-Brésilienne (Castaing et
al., 1994 ; Brito de Neves et al., 2001).
D`après les travaux sur la Chaîne Panafricaine au
Cameroun, il ressort qu'elle est subdivisée du Nord au Sud en trois (03)
grands domaines géodynamiques distincts à savoir le domaine Nord,
le domaine Centre ou Adamaoua-Yadé et le domaine Sud ou groupe de
Yaoundé (Mvondo et al., 2007 ; Ngnotue et al., 2000 ; Nzenti et al.,
1998 ; Toteu et al., 2004). La région de Bot-Makak présente une
évolution métamorphique similaire à la série de
Yaoundé avec laquelle elle semble avoir une évolution
pétrostructurale commune (Balep, 1997). Le substratum lithologique est
constitué essentiellement des gneiss à grenat ou disthène,
des amphibolites et des amphibolites et des gneiss migmatitiques (figure 6).
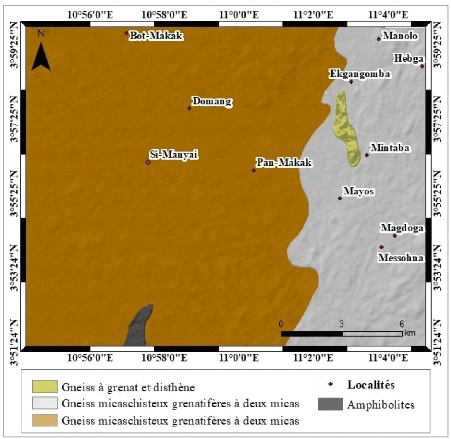
Figure 6 : carte géologique du secteur
d'étude (établie à partir de la carte de Champetier de
Ribes et Aubague 1956).
11
I.3. GÉOGRAPHIE HUMAINE ET ÉCONOMIQUE I.3.1.
L'histoire des peuplements
La zone de Bot-Makak est peuplée par l'ethnie Basaa. En
recoupant les différents profils historiques, les différents
clans peuplant les villages semblent s'être installés au
18ème siècle, venant du côté de l'actuel Sanaga
Maritime, après une traversée de la Sanaga (PCD de Bot-Makak,
2015). De nombreux clans auraient évolué ensemble avant de se
disloquer à Mbokanda dans l'actuel village de Mbonga. Un autre
groupuscule, les Pan auraient traversés tardivement pour s'implanter au
village Njockbanè où il se sont manifestement trouvé
à l'étroit entre les Ndog Nlet et les Ndogbéa
déjà occupants des terres ; ce qui les auraient poussés
à migrer vers d'autres localités de la commune, comme Pan-Makak
et d'autre contrées voisines. La migration semble caractériser
tous ces clans qui se retrouveront plus tard dans d'autres communes du Nyong et
Kéllé, à l'exception des Ndogbatjeck plus
sédentaires qui occupent les hautes terres de l'Est de la zone (PCD de
Bot-Makak, 2015).
I.3.2. Population-peuplement et économie
La population est constituée pour l'essentiel de Basaa
à laquelle s'ajoute une minorité constituée de
représentants des autres tribus du Cameroun (Loung et al.,
1979). Elle est répartie le long des routes et des pistes en une
multitude de petits villages. Ces derniers sont distants les uns des autres de
2 à 4 km. Elle couvre les arrondissements de Ngog Mapubi, Dibang, Bot
Makak et Matomb, appartenant au département du Nyong-et-Kellé.
Les villages sont organisés en chefferies de 1er, 2e et
3e degré. Bot Makak reste la seule chefferie de
1er degré dans ce département. Les autres
arrondissements ne sont plus constitués que de chefferies de
2e et 3e degré. La population totale de la Commune de
Bot-Makak est estimée à 35 572 habitants (femmes 18,882 ; hommes
16,690), soit une densité de 14,2 habitants/km2 (PCD de
Bot-Makak, 2015).
La principale activité économique est
l'agriculture avec des cultures de rente (cacao et palmier à huile),
vivrières (macabo, taro, manioc, arachide, plantain et banane douce)
(Loung et al., 1979), fruitières (mangue, ananas, citron,
orange, pamplemousse, papaye, safou, kola et noisette) et
maraîchères (piment, légumes). Le commerce pratiqué
le long des axes bitumés, dans les chefs-lieux d'arrondissement est la
seconde activité économique après l'agriculture.
L'élevage des caprins, la pêche, le transport inter-villages et la
chasse constituent d'autres sources non négligeables de revenus pour la
population.
12
Conclusion du chapitre
Le site d'étude est localisé dans
l'arrondissement de Bot-Makak, département du Nyong et Kellé,
région du centre. Le climat qui règne est un climat tropical
humide à quatre saisons, permettant l'altération des roches
à savoir les micaschistes et le gneiss donnant naissance aux sols
ferralitiques rouges et jaunes. La végétation est de types
secondaire dominant et primaire par endroit croissant sur des unité
morphologiques d'altitudes variable. La population est constituée pour
l'essentiel de Basaa et la principale activité économique est
l'agriculture.
CHAPITRE II : TRAVAUX ANTÉRIEURS
ET
MÉTHODOLOGIE
14
Introduction
Le présent chapitre est consacré à une
revue bibliographique sur les alluvions au Cameroun, dans le monde, ainsi
qu'à la méthodologie qui sera appliquée au cours de cette
étude.
II.1. ÉTUDES ANTÉRIEURES II.1.1.
Généralités
II.1.1.1. Concepts et définitions
Le terme alluvion est défini comme un accroissement de
terrain qui se fait insensiblement à l'un des bords de la rive d'une
rivière ou qui a lieu lorsque la rivière se retire et prend son
cours d'un autre côté. Les alluvions sont des sédiments
dont la granulométrie est liée au débit de la
rivière (Giroux et Tran, 1996). Ils sont composés de galets, de
graviers, de sables de limons et d'argile. Chacun de ces matériaux
à une granulométrie précise. Historiquement, en
géologie et science du sol, le terme argile correspond à
l'ensemble des minéraux présentant une taille inférieure
à 2 um dans une roche (Foucault et Raoult, 2001). Cette coupure
granulométrique est héritée des études
pétrographiques effectuées par microscopie optique à la
fin du XIX siècle (Giroux et Tran, 1996). On regroupe sous le terme de
dépôts alluviaux ou dépôts fluviatiles ou alluvions,
des sédiments déposés en régime d'eau courantes
continentales depuis la zone d'origine, source, jusqu'à déboucher
dans un bassin, en générale marin, mais parfois lacustre. On
parle d'alluvion pour designer des sédiments très peu
transportés par le ruissellement et le glissement le long des reliefs et
dont le stade initial est rarement conservé.
II.1.1.2. Mode de mise en place des alluvions
Les alluvions proviennent de l'usure des continents,
c'est-à-dire de la destruction des roches (Giroux et Tran, 1996). Cette
destruction se fait par le mécanisme physique conduisant à la
fragmentation des matériaux. Les éléments solides sont
déplacés sous l'effet de la gravité, souvent par
l'intermédiaire d'un fluide transporteur, et sous l'effet des pressions
atmosphériques qui produisent les vents. Les débris, dans leur
majeure partie, sont déplacés puis déposés,
généralement dans l'eau pour former un sédiment
détritique (alluvions au sens large). Les alluvions sont les plus
abondants des dépôts sédimentaires. Au sein de ces
dépôts, ce sont les variétés dont les grains sont
les plus fins qui dominent : argiles/silts : 2/3 ; sables, graviers : 1/3
(Biju, 1999). Une première distinction parmi les alluvions est
fondée sur l'état d'agrégation des particules
sédimentaires. Dans les roches meubles, les grains détritiques
sont
15
entièrement indépendants les uns des autres :
ils forment un assemblage en équilibre mécanique dont les espaces
inter-granulaires (pores) représentent une fraction importante du volume
de la roche. Dans les roches plastiques, la présence de minéraux
argileux en quantité importante permet une déformation sous la
contrainte. La pente, la dimension du réseau de drainage, le climat, la
technique, la charge sédimentaire et la végétation
constituent des paramètres majeurs qui contrôlent les
systèmes fluviatiles.
D'une manière générale, les processus
sédimentaires sont d'abord guidés par la gravité et la
pente est un des facteurs dominants de contrôle. Le transport s'effectue
de l'amont vers l'aval. Si le transport s'effectue à proximités
de la source, on parlera de dépôts proximal ; si la distance
parcourue est très importante, le dépôt sera
qualifié de distal. Le transport par les cours d'eau d'un point haut
vers un point bas, aboutit ainsi à la progradation des
dépôts parfois appelée accrétion latérale. La
caractérisation principale résultant de ce mécanisme sera
l'orientation statistique des formes de dépôts (Biju, 1999).
II.1.1.3. Utilisation des matériaux
alluvionnaires
Les alluvions, formés de divers matériaux,
constituent d'énormes potentialités économiques. Ils
interviennent dans plusieurs domaines, en l'occurrence les galets et les
graviers utilisés dans le domaine du génie civil. Que ce soit
pour une autoroute, une piste d'atterrissage ou une voie ferrée, les
technologies de construction nécessitent de très grandes
quantités de sables et graviers qui peuvent provenir des alluvions des
rivières ou de la mer : ballast des chemins de fer, fondations,
différentes couches qui structurent une chaussée de route... Pour
la fabrication de certaines couches, on met en oeuvre des granulats
mélangés avec un liant qui peut être un ciment, un bitume
ou un laitier (résidu des hauts-fourneaux). Pour les couches de
fondation et de base et pour les accotements, on peut également utiliser
des granulats de recyclage. Localement, un petit volume d'agrégats,
sables, graviers naturels ou roches concassées, est aussi utilisé
comme matière de filtration, pour les travaux de drainage de terrain,
des traitements des eaux. Les alluvions présentent également un
intérêt minier. Des métaux et des pierres rares ou
précieux sont transportés par les cours d'eau, puis se
déposent dans les alluvions. Ces gisements sont appelés placers.
Leur exploitation se fait soit à la main grâce à une
batée ou un pan américain, soit par un traitement
mécanisé. Ainsi, on peut trouver de l'or dans le lit de certaines
rivières. Les alluvions peuvent constituer des plaines alluviales
très fertiles. Il en est ainsi du Nil par exemple, dont les crues
déposaient des tonnes d'alluvions et rythmaient la vie agricole de
l'Égypte ancienne. C'est une des raisons principales de l'essor des
civilisations de l'Égypte antique. Les alluvions constituent des
aquifères. Pour les alluvions les
16
plus fins, les argiles sont utilisées dans les secteurs
de l'industrie du pétrole, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie
chimique, en agronomie, et en céramique
II.1.2. Caractérisation physique des alluvions
Les alluvions se définissent également par la
taille des particules qui les constituent. Cette dernière est fonction
de la présence ou l'absence de particules très fines (de
diamètre inférieur au micromètre) transportées par
voie éolienne et de gros blocs (de taille supérieure au
mètre). La classification des alluvions est assurée par diverses
échelles granulométriques (tableau 2).
Wentworth (1922) fait partie des auteurs à avoir
travailler sur la classification des alluvions. Son étude a
été faite sur les dépôts sédimentaires marins
et sa classification a depuis lors été adoptée pour la
nomenclature des alluvions. Ainsi, en fonction de la taille de ces derniers, il
distingue trois groupes d'alluvion qui varient suivant une échelle
variable (tableau 2).
Tableau 2 : échelle de classification des
sédiments (Wentworth, 1922).
|
Taille en mm
|
Classe de sédiment
|
Groupe de sédiments
|
|
256 >
|
Blocs
|
Rudites
|
|
256 - 64
|
Galets
|
|
64 - 4
|
Cailloux
|
|
4 - 2
|
Graviers
|
|
2 - 1
|
Sables très grossiers
|
Arénites
|
|
1 - 0,5
|
Sables grossiers
|
|
0,5 - 0,25
|
Sables moyens
|
|
0,25- 0,125
|
Sables fins
|
|
0,25- 0,0625
|
Sables très fins
|
|
0,0625 - 0,0039
|
Limons
|
Lutites
|
|
< 0,0039
|
Argiles
|
Mouldi et Chkiou (2007) proposent des modèles
de courbes granulométriques (figure 7) qui permettent d'avoir des
informations sur le mode de transport, de classement ainsi que la
qualité du tri des alluvions. Ainsi, les courbes en forme parabolique
indiqueront la présence des grains de sable
hétérogènes et trié au cours d'un transport en
milieu de forte énergie. Celles en forme de « S » traduiront
des sables homogènes à classement moyen, en milieu plus ou
moins
17
agité et à forte énergie. Les courbes
sous forme de droites montreront un dépôt par excès de
charge dû à la diminution des courants.
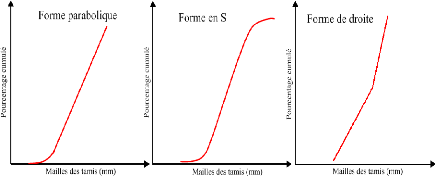
Figure 7 : modèle des courbes
granulométriques de Mouldi et Chkiou (2007). II.1.3.
Synthèses des travaux sédimentologiques des dépôts
alluvionnaires
Les travaux de prospection alluvionnaire en relation avec la
recherche du potentiel métallogénique ont été
intensément menés dans les régions de l'Est (Suh et al.,
2006 ; Asaah, 2010) ; du Centre (Tonjé et al., 2013 ; Evina Nkoto, 2018
; Nyobe et al., 2018) ; du Sud (Belinga, 2017 ; Janpou, 2018) ; de L'Adamaoua
(Boaka Koul et al., 2009) du Nord-Est et du Sud-Ouest Cameroun (Embui et al.,
2013 ; Janpou, 2018). La majorité de ces travaux de recherche ont
effectué des études sédimentologique,
minéralogiques et géochimiques pouvant donner des informations
sur l'altération et l'érosion, les conditions de
dépôts des sédiments, la composition des roches
originelles, la maturité des sédiments, la provenance des
sédiments et le degré d'altération des sédiments.
Certains de ces travaux ont mis en exergue que les dépôts
alluvionnaires sont des sites de minéralisation d'or (Akono, 2015 ;
Belinga, 2017), du rutile (Tonjé et al., 2013 ; Evina Nkoto, 2019 ;
Nyobe et al., 2018, Nzesseu, 2019). D'après ces travaux, les
dépôts alluvionnaires étudiés dans les
régions suscitées sont des sédiments à
granulométrie et à morphoscopie variable dépendant de leur
roches sources et de leur environnement. Ces auteurs ont présenté
que les dépôts alluvionnaires sableux sont
généralement sub-anguleux et anguleux et rarement arrondis
présentant des grains non usés par l'eau d'une fraction comprise
de 2 à 0,02 mm. Par ailleurs, les travaux effectués sur les
minéraux lourds présentés par Minyen et al. (2001) montre
la présence des cristaux centimétriques des minéraux
lourds tel que le rutile dans la série micaschistes et même des
cristaux de la taille du poing notamment dans les niveaux quartzitiques
intercalés dans les micaschistes, en particulier du secteur de Matomb.
D'après Tonjé (2007), les observations à la
18
loupe binoculaire indiquent que les matériaux
alluvionnaires sont constitués en moyenne de 39,41% de quartz de taille
centimétrique à millimétrique, 40,5% de rutile et 6 % de
Zircon. Tonjé (2007), révèle que les
teneurs en rutile évoluent graduellement des niveaux graveleux vers les
niveaux sableux dans les puits alluvionnaires de la rivière Téba
(Matomb) et que l'étude des minéraux lourds montre la
présence d'un cortège riche en quartz, rutile, zircon,
tourmaline, andalousite et disthène. Les travaux réalisés
par Nyobe et al. (2018) révèlent que les minéraux lourds
en place aurait une origine liée aux formations métamorphiques in
situ. Stendal et al. (2006) suggèrent que certains minéraux
lourds se serait mise en place durant les transformations métamorphiques
des grenats contenus dans les métasédiments (schistes et
grès) datant du Néoprotérozoïque dans le groupe de
Yaoundé.
II.1.4. Synthèses des travaux faites sur la
géologie
Stendal et al. (2006) concluent à partir des
études géologiques réalisées dans la
localité de Dibang et ses environs (secteurs situés à
l'Ouest de Bot-Makak) que: (1) le rutile alluvial et éluvial de la
région de Yaoundé provient de la dégradation des
métapélites, des roches métamorphiques et des pegmatites
proches du groupe de Yaoundé; (2) le rutile du groupe de Yaoundé
s'est formé au cours du métamorphisme panafricain ou provient du
rutile détritique de source d'environ 900 Ma; (3) les sédiments
à l'origine du groupe de Yaoundé se sont mis en place dans un
contexte de marge active.
Yonta (2010) a mis en évidence dans la région de
Boumnyebel (située à l'W de Matomb-Makak) deux ensembles
métasédimentaire (micaschistes à grenat et migmatites
à grenat et disthène) aux caractéristiques
pétrologique, chronologiques et structurales différentes. Les
blocs, boudins et intrusions de roches méta-ignées
associées à ces ensembles métasédimentaire sont
observés par endroits dans la région.
Nyobe et al. (2018) montrent que les formations rocheuses
situé dans le bassin versant de Lobo sont constitué des gneiss et
des micaschistes avec presque la même composition minéralogique.
Ces formations sont constituées principalement de quartz, feldspaths, de
biotite, de grenat et de minéraux opaques.
Tonjé (2007) montre trois types lithologiques
identifiés dans la zone de Matomb, il s'agit des gneiss à grenat
et à micas, micaschistes, quartzites et gneiss migmatitique. Ce sont des
roches métamorphiques grisâtres à structure foliée
et à texture granoblastique. Elles sont composées de quartz
(45%), rutile (5%), disthène (7%), plagioclases (10-45%), grenat (<
10%), biotite, muscovite (11%) et minéraux opaques pour les gneiss
à grenat. Les micaschistes sont composés de quartz (35%), rutile
(1%), plagioclases (40%), biotite, muscovite (11%) et
19
minéraux opaques. Les gneiss migmatitiques ont presque
la même composition que les gneiss à grenat sauf qu'ils n'ont ni
de disthène ni de rutile dans leur composition.
II.2. MÉTHODOLOGIE
Cette partie du chapitre est basée sur les
différents procédés utilisés pour l'obtention des
résultats qui sont entre autres la collecte des données sur le
terrain, une étude pétrographique des roches, une analyse
granulométrique, une étude morphoscopique et l'extraction des
minéraux lourds dans les sédiments. Ces différentes
analyses ont été réalisées aux laboratoires du
Département des Sciences de la Terre de l'Université de
Yaoundé I.
II.2.1. Étude de terrain
Les travaux de terrain ont été effectués
en trois principales étapes : la reconnaissance géologique du
secteur d'étude, la description des puits d'échantillonnage et
l'échantillonnage. Sur le terrain, la description macroscopique des
niveaux de puits fluviatiles a été effectuée. Un
échantillonnage a été fait sur les différents
niveaux observés dans l'objectif d'établir une distribution
spatiale des différents niveaux. Cette campagne a
nécessité l'utilisation d'un matériel facile à
transporter, à savoir : la carte topographique de Yaoundé au
1/200000 a servi de reconnaissance du secteur d'étude ; une boussole
chaix universelle, un récepteur GPS (Global Position System) Garmin 60
Cx, un carnet de terrain, un marteau, un double décamètre, des
sacs à échantillons, un appareil photo, une matchette, un
marqueur, des crayons ordinaires, une pelle, des seaux, etc. Les
prélèvements des échantillons ont été
effectués dans la rivière Djel et ses affleurements.
II.2.1.1. Éléments de description des puits
d'échantillonnage
Elle renseigne sur :
- l'épaisseur moyenne des niveaux de
chaque puits.
- la texture des matériaux ;
- la couleur ;
- la forme et la nature des limites ;
- la structure observable à l'oeil nu
(macro -structure) ;
- les particularités du niveau s'il en
présente : la présence de taches, de racines... ;
- la porosité.
20
II.2.1.2. Échantillonnage
Les échantillons prélevés sur le terrain
sont faits respectivement aux affleurements rocheux et dans les alluvions
(rivières au niveau du lit vif et sur les berges au travers des puits).
Neuf (09) échantillons des alluvions au total ont été
prélevés dans les vifs et trois (03) échantillons dans les
puits effectués sur les berges des affluents de la rivière Djel.
Quatre (4) échantillons ont été prélevé sur
les affleurements rocheux (figure 8). Ces échantillons sont
consignés dans le tableau 3 ci-dessous.

Figure 8: carte d'échantillonnage
(extrait du SRTM).
21
Tableau 3 : localisation des points
d'échantillonnage.
|
Types
d'échantillons
|
Échantillons
|
Coordonnées géographique
|
Altitudes
|
|
Alluvions
|
PA 01
|
N03°57'21,7»
|
E11°01'00,3»
|
375 #177; 3 m
|
|
PA 02
|
N03°57'24,2»
|
E11°01'27,1»
|
374 #177; 5 m
|
|
PA 03
|
N03°57'01,8»
|
E11°02'20,3»
|
400 #177; 3 m
|
|
PA 04
|
N03°56'53,7»
|
E11°03'25,3»
|
422 #177; 4 m
|
|
PA 05
|
N03°38'30»
|
E009°38'36»
|
370 #177; 3 m
|
|
PA 06
|
N03°57'29,8»
|
E10°59'17,8»
|
371 #177; 3 m
|
|
PA 07
|
N03°54'53,6»
|
E11°02'56,4»
|
505 #177; 3 m
|
|
PA 08
|
N03°56'25,4»
|
E10°59'18,6»
|
370 #177; 3 m
|
|
PA 09
|
N03°56'30,4»
|
E10°59'02,4»
|
379 #177; 3 m
|
|
PT 11
|
N03°57'19,8»
|
E11°01'00,4»
|
360 #177; 6 m
|
|
PT 21
|
N03°57'32,8»
|
E10°59'38,6»
|
402 #177; 3 m
|
|
PT 31
|
N03°57'01,8»
|
E11°02'20,3»
|
402 #177; 3 m
|
|
Roches
|
PR1
|
N03°56'34,4»
|
E10°58'37,2»
|
392 #177; 3 m
|
|
PR2
|
N03°56'01,7»
|
E11°01'31,2»
|
394 #177; 4 m
|
|
PR3
|
N03°54'56,7»
|
E11°02'39,1»
|
427 #177; 3 m
|
|
PR4
|
N03°54'57,0»
|
E11°03'10,9»
|
428 #177; 3 m
|
II.2.2. Travaux de laboratoire
Au laboratoire, les échantillons de roches ont subi des
analyses pétrographiques. Les échantillons des alluvions ont subi
des analyses granulométriques, morphoscopiques, l'extraction et montage
des lames des minéraux lourds.
II.2.2.1. Analyses sédimentologiques II.2.2.1.1.
Analyse granulométrique
L'analyse granulométrique est une technique qui permet
la séparation d'un ensemble de particules et leur fréquence
statistique en fonction de leur taille. Les ensembles de particules obtenus
sont appelés fractions granulométriques. Ces fractions sont
constituées de particules dont la dimension couvre un intervalle
relativement restreint et diminue d'une fraction à l'autre. La
méthode d'analyses granulométriques utilisée est celles
préconisées par Mathieu et Pieltain
22
(1998). L'application de cette analyse permettra de
connaître les substances associées aux
fractions granulométriques contenu dans les
sédiments. L'analyse granulométrique sert à
déterminer si les alluvions sont situées dans les
fractions fines, moyennes ou grossières. Les
différentes étapes à réaliser sont
:
- mettre l'échantillon dans un tamis
à maille de 0,05 mm de diamètre ;
- laver sous une eau abondante pour
éliminer l'argile et le limon ;
- ajouter à l'échantillon de l'HCl
;
- ajouter à l'échantillon de
l'H2O2 pour éliminer la matière organique ;
- effectuer un deuxième lavage pour
éliminer les substances chimiques utilisées ;
- sécher l'échantillon dans une
étuve ;
- peser l'échantillon prêt à
être tamiser ;
- passer l'échantillon de 1000 gramme
dans la colonne à tamiser ;
- ensuite peser la quantité de chaque
tamis avec soin ;
- tracer des courbes granulométriques.
Les courbes cumulatives logarithmiques pour les
différents points d'échantillons sont
tracés et les indices granulométriques ont
été calculés pour connaître la nature des
sédiments,
leurs classements et leurs origines. Les courbes cumulatives
permettent de déterminer les
différents quartiles Q1, Q2 et Q3 correspondant aux
pourcentages cumulés de 25%, 50% 75%,
avec Q1< Q3. Ces quartiles permettent de calculer les
paramètres granulométriques :
- Le Qdö de Krumbein ou Quartile de
déviation :
C'est l'indice qui permet de faire le classement et
d'apprécier les actions de tri au cours
du transport et du dépôt. C'est le coefficient
d'hétérométrie. Ainsi, le sédiment sera d'autant
mieux trié ou homométrique lorsque sa valeur se
rapprochera de zéro.
Qdö = (Q1 - Q3) /2
Q1 est le quartile à 25% et Q3 est le quartile à
75% (en mm ou en phi). - le sorting index de trask (S0)
So = I Q3 /Q1 (S0 = Q3
/Q1)1/2)
trask (1930) a proposé les limites suivantes :
- S0 < 2,5 sédiments très bien classés
;
- 2,5 < S0 < 3,5 sédiments normalement
classés ; - 3,5 < S0 < 4,5 sédiments assez bien
classés ;
- S0 > 4,5 sédiments mal classés ;
-
le coefficient d'asymétrie (As)
23
As = Q1 X Q3/Q22
Le coefficient d'asymétrie exprime la
répartition des éléments par rapport à la
médiane Q2 (Chamley, 1987). Les limites du coefficient
d'asymétrie sont les suivantes :
- A < 1, le classement maximum s'effectue vers les
éléments grossiers, ces grains sont mieux triés
(dépôts torrentiels).
- A = 1, le mode de la courbe de fréquence
coïncide avec le diamètre moyen des grains (sédiments
évolués).
- A > 1, le classement maximum s'effectue vers les
éléments fins, ils représentent une meilleure
sélection (dépôts de fond de bassin).
II.2.2.1.2. Analyse morphoscopique
La morphoscopie est l'étude de l'aspect de surface des
grains de quartz (Cailleux, 1942). Elle permet de déterminer les
différents modes d'usures, l'agent de transport, et la dynamique
sédimentaire.
- Mode opératoire
Pour cette analyse, trois (03) échantillons (PA 01, PA
04 et PA 09) ont fait l'objet de cette étude. Les échantillons de
grains de quartz choisis sont lavés à l'eau, séchés
à l'air libre pour éliminer les particules fines ; lavés
à l'acide chlorhydrique dilué à 10% et chauffés
à une température de 60°C pendant 15 minutes. La pellicule
d'oxyde de fer recouvrant les grains étant éliminée, les
sables sont à nouveaux rincés à l'eau puis
séchés. Au terme de ce travail, deux fractions sont retenues :
- une fraction très grossière (2 mm - 1 mm) ;
- une fraction moyenne (0,5 mm - 0,25 mm).
Par la suite, 50 grains sont choisis de manière
aléatoire puis séparés à la loupe binoculaire de
marque Aus JENA TECHNIVAL 2, en fonction de leur forme tel que proposé
par Cailleux (1942). En utilisant la charte visuelle de
sphéricité des sables de Powers, (1953), les grains sont
séparés en fonction de leur forme.
Les échantillons des grains ferromagnésiens,
à l'aide d'un aimant, ont été séparés des
grains de quartz, puis comptés et déposés sur la platine
de la loupe binoculaire afin d'être observés. La loupe binoculaire
a servi à l'appréciation des formes des grains de
ferromagnésiens.
- Différents aspects de surface des grains de
quartz
Cailleux (1942) a défini quatre catégories
principales de grains selon leur forme et leur aspect de surface :
24
? les grains non usés (NU) sont
caractérisés par leurs formes anguleuses, que les cristaux soient
automorphes ou non. Les arêtes ne présentent aucune trace de
polissage ou d'arrondi. Leur aspect de surface peut être
indifféremment mât ou luisant ;
? les grains sub-émoussés luisants (SEL)
présentent des sommets et arêtes plus ou moins
émoussés et luisants ;
? les grains émoussés luisants (EL)
présentent une dominance d'arêtes arrondies et peuvent parfois
acquérir la forme d'une sphère presque parfaite. Leur aspect de
surface est toujours très poli, brillant, et luisant sous
l'éclairage de la loupe binoculaire ;
? les grains ronds mâts (RM) ont une morphologie
générale sub-sphérique pouvant atteindre celle d'une
sphère parfaite. Ils ont un aspect de surface toujours poli et
mât. Ils sont caractéristiques d'une évolution en milieu
éolien. Ils sont retrouvés principalement sur les dunes
littorales et dans certains environnements désertiques.
II.2.2.2. Minéraux lourds
Les minéraux lourds peuvent être définis
comme les minéraux dont la densité est supérieure à
2,9 (densité du bromoforme). L'étude des minéraux lourds
permet non seulement, d'identifier les différents types
minéralogiques présents dans le milieu de dépôt,
mais aussi de remonter jusqu'à leur province distributrice. Les
minéraux lourds contenus dans les concentrés alluvionnaires sont
extrait par séparation densimétrique à l'aide du
bromoforme. Les techniques d'extraction, de montage sur lames minces et
d'exploitation des résultats sont préconisées et suit le
protocole ci-dessous :
- la préparation de
l'échantillon
Elle est identique à celle utilisée dans le cadre
de la granulométrie.
- extraction des minéraux lourds
Pour extraire les minéraux lourds des alluvions, on
procède de la manière suivante : le robinet étant
gardé fermé, on remplit l'ampoule à décanter au 3/4
avec du bromoforme, on y verse ensuite les fractions granulométriques de
sable issue du tamisage (0,160 mm et 0,125 mm). À l'aide d'un agitateur
en verre, on tourne le liquide et son contenu. Cette opération est
répétée jusqu'à ce que la séparation soit
totale. Après un temps de repos, on ouvre le robinet afin de recueillir
les minéraux lourds tombés au fond ceci à l'aide d'un
entonnoir muni d'un papier filtre ; l'erlenmeyer placé en dessous permet
de recueillir le bromoforme. La technique de montage des minéraux lourds
sur lame de frottis est celle préconisée par Parfenoff (1970).
- lavage à l'acide chlorhydrique
25
Les minéraux extraits sont ensuite lavés avec
l'acide chlorhydrique dilué à 10 % afin de les débarrasser
de la fine pellicule d'oxyde qui pourrait les recouvrir.
- montage des minéraux lourds entre lames et
lamelles
Les lames sont préalablement chauffées sur une
plaque chauffante, puis imprégnées de baume de Canada. Dès
que le baume prend la coloration jaune, on dispose d'une quantité de
minéraux lourds sur la lame porte-objet à l'aide d'un pinceau.
Cette dernière est ensuite recouverte par une lamelle. Après
refroidissement, le concentré de minéraux lourds obtenu est
trempé dans un bain d'alcool afin d'éliminer le baume
débordant de la lame. Ainsi, quatre (04) lames minces de minéraux
lourds sont confectionnées. Il s'agit des échantillons
nommé PA 07, PA 09, PT 11, PT 31). Les observions de ces lames minces
ont été faite au microscope électronique de marque
leitz wetzelar HM-POL au Laboratoire des Formations
Superficielles et Applications de l'Université de Yaoundé I.
II.2.2.3. Analyse pétrographique des roches
Une lame mince de roche est un échantillon de roche
aminci de manière à le rendre transparent et translucide afin de
permettre l'observation en lumière transmise au microscope polarisant.
La confection des lames minces nécessite plusieurs étapes et tout
un appareillage comprenant : des scies diamantées, une rodeuse, une
rectifieuse, une plaque chauffante, des lames porte-objet, une pointe
diamantée, une colle spéciale des poudres abrasives et de l'eau.
Les principales étapes pour confectionner une lame mince sont :
- sciage des échantillons ;
- polissage et collage des sucres sur les lames
porte-objet protection de la surface polie. Six échantillons de roches
saines sélectionnés dans les principales unités
pétrographiques ont servi à la confection des lames minces, au
Laboratoire du Département des Sciences de la Terre de
l'Université de Yaoundé I (annexe). L'étude des lames
minces s'est effectuée au laboratoire des Géosciences des
Formations Superficielles et Applications de l'Université de
Yaoundé I. Ces lames ont été observées au
microscope binoculaire de marque OPTIC IVYMEM SYSTEM.
Conclusion
Le secteur d'étude est situé dans la
région du Centre dans les arrondissements de Bot-Makak. Il appartient au
Groupe de Yaoundé, correspondant à la bordure NE
remobilisée du craton du Congo. Les lames minces de roches ont
été confectionnées. Les matériaux alluvionnaires
ont subi des sédimentologiques
|
CHAPITRE III : PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS
|
27
Introduction
Le but de ce chapitre est de caractériser du point de
vue pétrographique les formations géologiques de la
localité et d'effectuer des études sédimentologiques des
alluvions rencontrés dans les sites d'étude.
III.1. ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE.
III.1.1. Amphibolite (PR4)
Il affleure en enclave dans les gneiss. Cet affleurement
montre une coexistence de plusieurs types pétrographiques inter
stratifiés. Dans cet endroit, il est observé les migmatites
à grenat interstratifiés qui chevauchent sur les
pyroxénites à grenat dans laquelle on observe des boudins
d'amphibolites (figure 9).
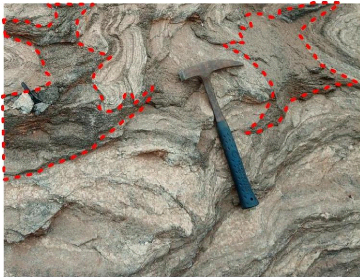
Figure 9 : affleurement d'amphibolite.
Au microscope, l'amphibolite est mésocrate à
mélanocrate et présente une texture granoblastique
hétérogranulaire à cause des cristaux aciculaires
d'hornblende verte. Les minéraux essentiels de la roche sont :
l'amphibole pour les ferromagnésiens, le plagioclase, le quartz et les
feldspaths pour les leucocrates. L'amphibole est le minéral le plus
abondant de la roche (figure 10 B).
L'amphibole (65 %) est la hornblende verte et
représente le minéral le plus abondant de la roche. Elle est sous
forme de cristaux subautomorphe à xénomorphes et s'associe aux
28
plagioclases, aux quartz et aux feldspaths (figure 10D). Les
cristaux d'amphibole ont une dimension de 2,7 mm. Tous les cristaux montrent
une déstabilisation poussée.
Le plagioclase (25%) se présente sous forme de larges
plages subautomorphes de 1 mm de long sur 0,3 mm de large. Il présente
les macles polysynthétiques. Les cristaux de plagioclases sont en
association avec l'amphibole.
Le quartz (8%) se présente sous forme de cristaux
subautomorphes à xénomorphes de taille allant de
l'inframillimétrique au millimétrique, il est en association avec
l'amphibole et le plagioclase (figure 10C).
Le feldspath alcalin (2%) est représenté par
l'orthose. Ses cristaux sont sous formes de plages subautomorphes et de taille
variable (figure 10B). Les gros cristaux peuvent atteindre 1,1 mm.
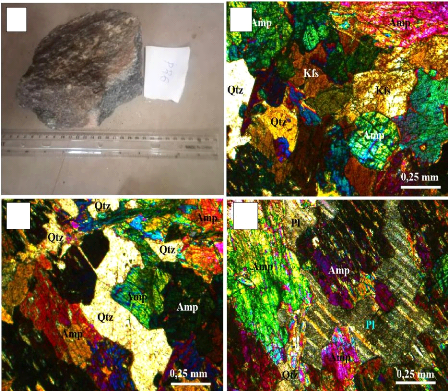
A
C D
B
Figure 10 : l'amphibolite ; A)
Échantillon de roche ; B) texture granoblastique
hétérogranulaire ; C) quartz en association avec l'amphibole et
le plagioclase ; D) plagioclase.
29
III.1.3. Micaschiste à grenat (PR3)
Il est disposé en dôme sur le sommet de colline.
Les observations faites sur le terrain mettent en évidence des filons de
quartzite, témoins de la circulation des liquides hydrothermaux riche en
SiO2. Ces roches présentent un plan de foliation orienté N018E
avec un angle de pendage de 20° ENE. Les veines de quartzite sont
disposées parallèlement à la foliation plongé vers
une direction NNE. Les minéraux observés macroscopiquement sont
représentés par le quartz, la biotite, la muscovite, les grains
de grenat (figure 11).
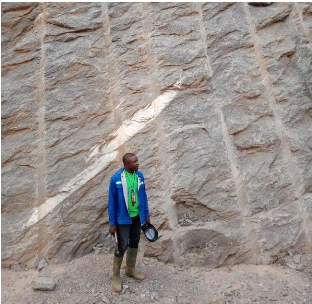
Figure 11: affleurement de micaschiste
à grenat.
Au microscope, la roche à une texture
lépidogranoblastique hétérogranulaire (figure 12 B),
constituée essentiellement de micas, de quartz, de feldspaths alcalins,
de grenat et de minéraux opaques
Le quartz (35 %) se présente sous forme automorphe
à points triples tendant à cristalliser en petits rubans ou en
mosaïque de quartz allongés et non déformés.
Toutefois, il existe de gros cristaux de quartz à extinction roulante.
Les plages de quartz contiennent souvent de petits cristaux de biotite (figure
12 D).
30
La muscovite (25 %) de forme lamellaire, est également
à clivage parallèle et se trouve associée à la
biotite et le quartz. Plus large que la biotite, elle contient des inclusions
de quartz et de minéraux opaques (figure 12 C).
La biotite (20 %) est fraîche,
déchiquetée, étirée et brune. Elle forme autour des
quartz une texture en feuillets composée de beaucoup de petites
lamelles, fortement pléochroïques par endroit (figure 12 C). Cette
dernière est associé au quartz et à la hornblende.
Le grenat (15 %) est soit sous forme de poeciloblaste
polylobé, légèrement allongé suivant la foliation
et de taille variable (0,3 mm à 1,5 mm), soit sous forme de rares
monoblastes sub-sphériques disséminés. Les deux formes
renferment régulièrement le quartz, la biotite et les oxydes
opaques en inclusions.
Les minéraux opaques (5 %) sont xénomorphes,
d'allure squelettique et généralement en inclusion dans la
muscovite.
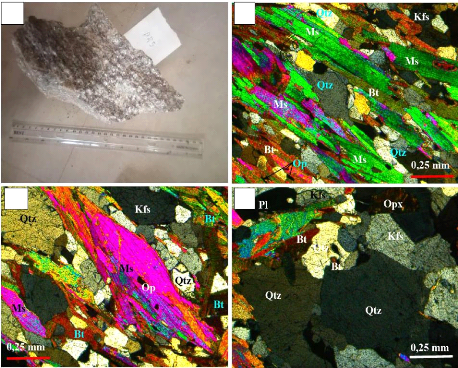
A
B
C
D
Figure 12: micaschiste à grenat ; A)
Échantillon de roche ; B) texture lépidogranoblastique
hétérogranulaire ; C) orientation de la muscovite ; D)
association du quartz avec la biotite et le feldspath.
31
III.1.5. Gneiss à grenat et biotite (PR1)
Le gneiss à grenat et biotite, sur la tranchée
routière montre un aspect général de couleur
grisâtre sur lesquels on observe une alternance de lits clairs et de lits
sombres. Les lits clairs sont centimétriques et constitués de
quartz tandis que les lits sombres de mêmes dimensions sont
constitués de biotite et d'amphibole (figure 13). À
l'affleurement, la roche est dense, compacte et fracturée. Elle affleure
sous forme de dôme et les minéraux observés sur la roche
sont le quartz, la biotite, l'amphibole et le grenat.
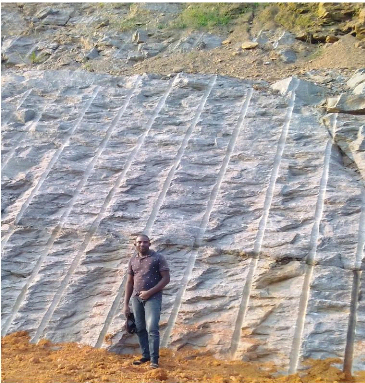
Figure 13 : affleurement du gneiss à
grenat et biotite.
Au microscope, la roche est caractérisée par une
texture granoblastique hétérogranulaire avec comme
minéraux constitutifs le quartz, grenat, biotite, plagioclase,
amphibole, muscovite, rutile et minéraux opaques (figure 14 B).
Le quartz (30 - 35 %) se présente sous forme de
cristaux automorphes à subautomorphes, sous forme de rubans ou sous
forme de granules en inclusions dans le grenat. Les cristaux sont
associés au feldspath, plagioclase, grenat et la biotite (figure 14
C).
32
Le grenat (15 - 25 %) est observé soit sous forme de
cristaux globuleux dispersés dans la roche, soit sous forme de
porphyroblastes. Les cristaux présentent parfois des golfes de corrosion
à biotite. Certains porphyroblastes de grenat présentent des
couronnes de biotite enveloppées par la schistosité externe. Le
grenat est aussi associé au plagioclase, quartz et amphibole (figure 14
C).
La biotite (~ 20 %) se présente soit sous forme de
baguettes allongées soit sous forme de grains sub-arrondies de taille
allant de 0,2 à 1 mm. Certaines baguettes de biotite se
déstabilisent en chlorite et sont en inclusion dans le grenat (figure 14
B).
Le plagioclase (10 - 15 %) se présente sous forme de
cristaux subautomorphes en association fréquente avec le quartz et le
grenat. La dimension moyenne des cristaux de plagioclase est de 0,2 x 1,5 mm.
Les plagioclases renferment des inclusions de muscovite et sont en association
fréquentes avec le quartz, et la biotite.
L'amphibole (~ 5 %) se présente sous forme
subautomorphes avec un bon clivage à deux directions en inclusion dans
le cristal de grenat (figure 14 C), les cristaux d'amphiboles sont
associés à la biotite, plagioclase et quartz.
La muscovite (~ 5 %) est représentée par de
fines paillettes allongées ainsi que des paillettes moyennes dont la
longueur varie entre 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont sub-automorphes et peu
déformés. La muscovite est parfois entourée par le quartz
et encadrée par des cristaux de biotite. La muscovite est
généralement associée au quartz, aux feldspaths alcalins,
au plagioclase à la biotite et tout autour de certain porphyroblaste de
grenat (figure 14 C). Elle est parfois en inclusion dans le plagioclase (figure
14 B).
Les minéraux opaques (~ 2 %) se présentent sous
forme de cristaux sub-automorphes et sont en inclusion dans les porphyroblastes
de grenat.
Le rutile (~ 2 %) se présente sous forme de cristaux
sub-arrondis, en inclusions dans les porphyroblastes de grenat.
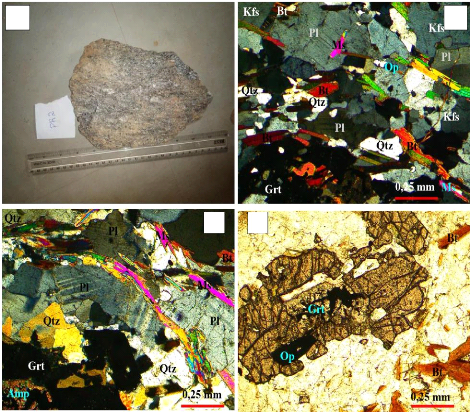
A
C
D
B
33
Figure 14: gneiss à grenat et biotite
; A) Échantillon de roche ; B) texture granoblastique
hétérogranulaire ; C) plagioclase en association avec le quartz,
feldspath, biotite muscovite; D) transformation du grenat en minéraux
opaques.
III.1.6. Gneiss à micas et grenat (PR2)
Cet affleurement de roche présente un plan de foliation
de direction 18° ENE avec un angle de pendage de 20°. À la
cassure, on observe une roche brillante de teinte gris claire avec dominance
des minéraux clairs. L'affleurement est représenté par une
superposition en lit micacé. On observe tout de même les veines de
quartz dans lesquelles sont piégés les cristaux de rutile. Les
minéraux visibles représentant les parties claires sont le
quartz, les feldspaths et les parties sombres la biotite (figure 15).
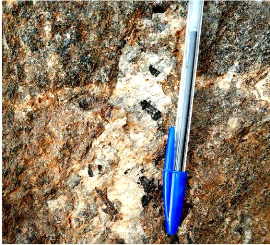
34
Figure 15 : affleurement du Gneiss à
micas et grenat.
En lame mince, la roche présente une microstructure
granoblastique hétérogranulaire constituée du quartz,
biotite, grenat, orthose, plagioclase, hornblende verte, et
l'orthopyroxène. La phase accessoire est représenté par
les minéraux opaques.
Le quartz (25%) forme des individus polycristallins,
sub-automorphes et de taille variable (0,1 à 1,17 mm). Les microcristaux
se rencontrent préférentiellement autour des grands cristaux de
feldspath et de plagioclase (figure 16 B). Il s'observe également le
long des microfractures des cristaux de feldspath potassique.
La biotite (20- 25 %) est sous forme de lamelles
allongées de taille variable de 0,315 à 2,7 mm le grand axe. Ces
lamelles sont enchevêtrées entre elles et sont associées au
quartz, à la muscovite et au plagioclase (figure 16 B). La biotite
renferme des inclusions des minéraux opaques. Certains cristaux moulent
les phénocristaux de feldspath et de plagioclase.
Le grenat (~ 15 %) est observé soit sous forme de
cristaux globuleux disséminés dans la roche, soit sous forme de
porphyroblastes criblés d'inclusions de quartz, biotite, minéraux
opaques. Certains porphyroblastes de grenat présentent des couronnes de
muscovite et biotite enveloppées par la schistosité externe.
Le feldspath potassique (10 %) est représenté
par l'orthose. La taille des cristaux est comprise entre 1 et 3 mm. Ces
cristaux sont entourés par des granulations de quartz (figure 16 D).
Certains cristaux renferment des inclusions de biotite. Dans l'ensemble, le
feldspath potassique s'associe au quartz et au plagioclase pour former les lits
ferromagnésiens.
Le plagioclase (5 - 8 %) est sous forme de larges plages
sub-automorphes de taille inframillimétrique à
millimétrique suivant le grand axe. Ces cristaux présentent
des
35
granulations de quartz en bordure (figure 16 D). Certains
montrent un début d'altération tandis que d'autres renferment des
inclusions de quartz.
La muscovite (5 %) est représentée par de
paillettes allongées avec une taille de 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont
sub-automorphes. Certaines de ces paillettes forment une couronne autour du
porphyroblaste de grenat (figure 16 B).
L'orthopyroxène (< 5%) se présente sous forme
sub-automorphes à xénomorphes avec un clivage perpendiculaire
avec une taille 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont en association avec le quartz et
l'amphibole.
L'amphibole (~ 4%) constitue avec la biotite et
l'orthopyroxène l'essentiel des minéraux ferromagnésiens
de la roche. Les cristaux de hornblende sont xénomorphes de dimension
comprise entre 0,01 x 0,2 mm et 0,1 x 0,5 mm. Ces cristaux sont en association
avec la biotite, l'orthopyroxène et les feldspaths.
Les minéraux opaques (~ 3%) se présentent sous
forme de cristaux sub-automorphes et sont en inclusion dans les porphyroblastes
de grenat.
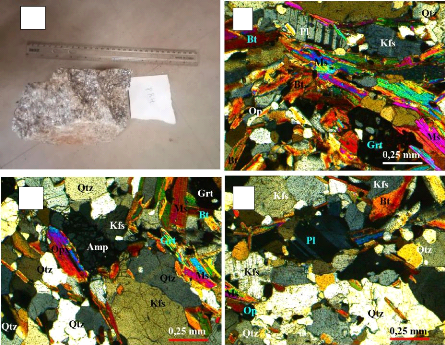
C
A
B
D
Figure 16 : photographies du gneiss à
micas et grenat ; A) Échantillon de roche ; B) texture granoblastique
hétérogranulaire ; C) association du quartz, biotite avec du
grenat ; D) inclusion de biotite dans le quartz.
36
Conclusion
L'étude pétrographique des formations
géologiques du secteur de Bot-Makak a permis de mettre en
évidence trois types pétrographiques distincts appartenant tous
à l'ensemble métamorphique. Il s'agit du micaschiste, des gneiss
(gneiss à grenat et biotite et gneiss à micas et grenat) et
l'amphibolite. Leurs caractéristiques sont résumées dans
le tableau 4 ci-dessous. Tableau 4 : tableau
récapitulatif des formations de Pan-Makak.
|
Types pétrographique
|
Texture
|
Association minérale
|
|
Micaschistes à grenat
|
lépidogranoblastique hétérogranulaire
|
Qtz + Bt + Ms + Pl + Grt + Ru + Op
|
|
Gneiss à grenat et biotite
|
granoblastique hétérogranulaire
|
Qtz + Grt + Bt + Pl + Amp + Mu + Ru + Op
|
|
Gneiss à micas et grenat
|
granoblastique hétérogranulaire
|
Qtz + Bt + Grt + Kfs + Pl + Opx + Hbl + Op
|
|
Amphibolite
|
granoblastique hétérogranulaire
|
Amp + Pl + Opx + Qtz + Kfs + Op
|
III.2. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES
Les échantillons ont été
prélevés sur le terrain respectivement dans les rivières
au niveau du lit vif et sur les berges au travers des puits. Au niveau des
puits, l'échantillonnage est fait essentiellement dans les niveaux
sablo-graveleux et dans les niveaux graveleux.
? Puits (PT11, PT12)
Ce puit a une profondeur de 70 cm et une surface de 70 cm x 60
cm. Les échantillons ont été prélevés
à l'aide d'une pelle. L'échantillon PT 11 et PT 12 a
été prélevés dans le niveau sablo-graveleux et dans
le niveau graveleux (figure 18). Ce puit présente plusieurs niveaux :
Le niveau limono-argileux est marqué par la
présence d'une très fine matière organique, avec une
abondance des racines. Il est de couleur brun jaunâtre foncée (10
YR3/4) pouvant atteindre une épaisseur de 20 centimètres.
Le niveau argilo-sableux a une épaisseur très
faible de 5 cm, marqué de couleur brun grisâtre (10YR5/2) avec une
fraction beaucoup plus sableuse.
Le niveau sablo-graveleux constitue la partie
intéressante où l'échantillon est prélevé.
Ce dernier est de couleur brun claire (10YR5/3), avec des particules de
dimensions
37
centimétriques, de forme sub-arrondie à aplatie,
constitué majoritairement des blocs de quartzites, des nodules
ferrugineux, des fractions micrométriques de grenat. Tous ces
minéraux sont représentés dans le matériau
alluvionnaire échantillonné de façon
disproportionné. Cet horizon est épais de 30 cm.
Le niveau à galets est constitué à
dominance des galets de quartzite décimétrique, des nodules
ferrugineux de dimension centimétrique. Ce niveau est de couleur
grisâtre (5Y7/1). Il est épais de 15 cm.
? Puits : PT 21
Localisé dans le village Mintaba, ce puits a une
profondeur de 60 centimètres, avec un niveau supérieur
constitué de limons et une partie inferieure représentée
de gravier (figure 18). Ce puit présente plusieurs horizons :
Le niveau limoneux a une épaisseur de 10 cm, de couleur
brun foncé (10YR2/2). Ce niveau est représenté par une
fraction fine avec des racines remplies dans cette matrice homogène.
Le Niveau à sable est représenté par des
particules de quartzite, des nodules ferrugineux, du grenat de taille
millimétrique, le niveau est représenté dans son ensemble
par des matériaux de couleurs bruns à grisâtre (10YR4/2),
il est épais d'environ 15cm.
Le niveau à gravier a une épaisseur de 35 cm, ce
niveau représente le niveau où les prélèvements
sont faits. Il est de couleur blanchâtre (10YR8/1) à jaune
brunâtre (10YR6/8) avec une fraction disproportionnée des
éléments grossiers. Ce niveau est constitué de quartz de
forme anguleuse pouvant atteindre des dimensions centimétriques à
décimétriques.
? Puits (PT 31)
Sur les berges de la rivière Hohé affluent dans
le grand collecteur de la rivière Djel, un puit d'une profondeur 110 cm
est réalisé préalablement. Ce dernier présente
plusieurs niveaux (figure 18) quittant de niveau humifère à la
surface vers le niveau graveleux en profondeur.
Le niveau humifère est représenté par une
fine pellicule de 5 cm, de couleur rouge jaunâtre (5YR5/8) à brun
foncé (7.5YR5/8) avec beaucoup de racines apparentes.
Le niveau limono-argileux a une épaisseur de 25 cm, il
contient des grains fins de couleur brun (7,5YR4/2).
Le niveau sableux est constitué pour sa grande partie
des grains millimétriques, de couleur brun jaunâtre (10YR5/6)
à gris clair (5Y7/1). Avec des nodules ferrugineux, il est épais
de 20
cm.
38
Le niveau sablo-graveleux est représenté par une
fraction sableuse de couleur jaunâtre (10YR8/8). Le niveau
sablo-graveleux a une proportion dominante par la fraction grossière qui
a une couleur brun (7,5YR4/2) à jaune brunâtre (10YR6/8). Les
grains de la fraction grossière ont une forme sub-anguleuse. Ce niveau
est épais de 35 cm. À la base de ce niveau on a des fragments de
quartzite.
Le niveau graveleux est épais de 25 cm, ce niveau
montre des fractions grossières dominées par le quartzite, les
nodules de fer ainsi que des nodules de grenat.

Figure 17 : espèces minérales du
niveau sablo-graveleux de la maille 4 mm du puits P 31 a) : disthène, b)
: grains de quartz, c) : grains de rutile, d) : Nodules ferrugineux.
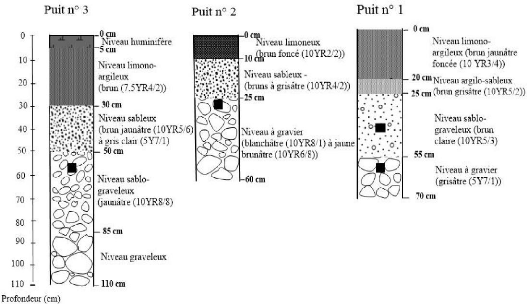
39
Figure 18 : Lithostratigrahie.
III.3. ÉTUDE GRANULOMÉTRIQUE
Cette partie du chapitre présente les résultats
qui portent sur la caractérisation granulométrique des alluvions
de la localité de Pan-Makak.
III.3.1. Granulométrie
L'analyse granulométrique permet de déterminer
les différentes proportions des fractions granulométriques. Pour
cette analyse onze (11) échantillons des sédiments de lit vif et
des puits ont été sélectionnés (PA01, PA02, PA03,
PA04, PA05, PA06, PA07, PA08, PA09 PT11 et PT13). Les données des
analyses granulométriques des différents échantillons ont
été traitées et récapitulées dans les
tableaux 5 en refus simple, refus cumulés, pourcentages simples et
pourcentages cumulés. Les pourcentages de refus simples et
cumulés ont permis de construire diverses courbes
granulométriques telles que les courbes cumulées et les
histogrammes (Figure 19 et 20). Les courbes ainsi obtenues ont permis de
calculer les différents paramètres granulométriques.
40
Tableau 5 : masses de refus (g), pourcentage
simples et cumulés des échantillons par maille du secteur
d'étude.
|
Maille des tamis(mm)
|
4
|
2
|
1,25
|
1
|
0,50
|
0,40
|
0,32
|
0,25
|
0,18
|
0,16
|
0,13
|
0,05
|
0,05
|
|
|
PA01
|
Masse du refus
|
20,97
|
40,40
|
32,36
|
15,38
|
30,00
|
15,94
|
9,08
|
16,11
|
8,10
|
2,62
|
3,78
|
2,94
|
2,32
|
199,99
|
|
% refus
|
10,49
|
20,20
|
16,18
|
7,69
|
15,00
|
7,97
|
4,54
|
8,06
|
4,05
|
1,31
|
1,89
|
1,47
|
1,16
|
|
|
% refus de cumulé
|
10,49
|
30,68
|
46,86
|
54,55
|
69,55
|
77,52
|
82,06
|
90,12
|
94,17
|
95,48
|
97,37
|
98,84
|
100,00
|
|
|
PA02
|
Masse du refus
|
31,83
|
71,55
|
33,93
|
10,66
|
25,01
|
5,52
|
8,24
|
1,48
|
2,72
|
2,51
|
2,37
|
2,12
|
2,05
|
200,00
|
|
% refus
|
15,92
|
35,78
|
16,96
|
5,33
|
12,51
|
2,76
|
4,12
|
0,74
|
1,36
|
1,26
|
1,19
|
1,06
|
1,03
|
|
|
% refus de cumulé
|
15,92
|
51,69
|
68,66
|
73,99
|
86,49
|
89,25
|
93,37
|
94,11
|
95,47
|
96,72
|
97,91
|
98,97
|
100,00
|
|
|
PA03
|
Masse du refus
|
30,07
|
39,87
|
17,81
|
12,81
|
27,65
|
18,12
|
14,50
|
11,36
|
8,76
|
4,04
|
7,67
|
5,45
|
1,89
|
200,00
|
|
% refus
|
15,04
|
19,94
|
8,91
|
6,41
|
13,82
|
9,06
|
7,25
|
5,68
|
4,38
|
3,84
|
2,73
|
2,02
|
0,95
|
|
|
Masse du refus
|
15,04
|
34,97
|
43,88
|
50,29
|
64,11
|
73,17
|
80,42
|
86,10
|
90,48
|
94,32
|
97,05
|
99,07
|
100,01
|
|
|
PA04
|
Masse du refus
|
21,93
|
27,58
|
25,82
|
13,16
|
46,08
|
19,46
|
13,32
|
9,62
|
7,06
|
4,27
|
7,30
|
2,34
|
2,07
|
200,00
|
|
% refus
|
10,97
|
13,79
|
12,91
|
6,58
|
23,04
|
9,73
|
6,66
|
4,81
|
3,65
|
3,53
|
2,13
|
1,17
|
1,03
|
|
|
% refus de cumulé
|
10,97
|
24,76
|
37,66
|
44,25
|
67,28
|
77,01
|
83,67
|
88,49
|
92,14
|
95,67
|
97,80
|
98,96
|
100,00
|
|
|
PA05
|
Masse du refus
|
15,19
|
61,06
|
23,48
|
20,14
|
34,24
|
13,18
|
6,14
|
5,38
|
3,43
|
6,30
|
4,73
|
3,89
|
2,83
|
199,99
|
|
% refus
|
7,59
|
30,53
|
11,74
|
10,07
|
17,12
|
6,59
|
3,15
|
3,07
|
2,69
|
2,36
|
1,94
|
1,72
|
1,41
|
|
|
% refus de cumulé
|
7,59
|
38,13
|
49,87
|
59,93
|
77,06
|
83,65
|
86,80
|
89,87
|
92,56
|
94,92
|
96,86
|
98,58
|
99,99
|
|
|
PA06
|
Masse du refus
|
40,73
|
34,56
|
20,22
|
8,34
|
48,69
|
16,84
|
11,69
|
9,88
|
4,50
|
0,34
|
0,85
|
0,71
|
2,65
|
200,00
|
|
% refus
|
20,36
|
17,28
|
10,11
|
4,17
|
24,34
|
8,42
|
5,85
|
4,94
|
2,25
|
0,17
|
0,42
|
0,36
|
1,33
|
|
|
% refus de cumulé
|
20,36
|
37,64
|
47,75
|
51,92
|
76,27
|
84,69
|
90,53
|
95,47
|
97,72
|
97,89
|
98,32
|
98,67
|
100,00
|
|
|
PA07
|
Masse du refus
|
30,80
|
32,32
|
20,05
|
17,02
|
51,53
|
15,30
|
15,94
|
6,34
|
3,73
|
0,57
|
2,76
|
2,54
|
1,08
|
200,00
|
|
% refus
|
15,40
|
16,16
|
10,02
|
8,51
|
25,77
|
7,65
|
7,97
|
3,17
|
1,87
|
0,29
|
1,38
|
1,27
|
0,54
|
|
|
% refus de cumulé
|
15,40
|
31,56
|
41,59
|
50,10
|
75,87
|
83,52
|
91,49
|
94,66
|
96,52
|
96,81
|
98,19
|
99,46
|
100,00
|
|
|
PA08
|
Masse du refus
|
36,22
|
45,82
|
22,72
|
15,18
|
39,20
|
15,05
|
6,69
|
8,24
|
3,29
|
1,07
|
4,22
|
1,26
|
1,05
|
200,00
|
|
% refus
|
18,11
|
22,91
|
11,36
|
7,59
|
19,60
|
7,53
|
4,12
|
3,34
|
2,11
|
1,65
|
0,53
|
0,63
|
0,53
|
|
|
% refus de cumulé
|
18,11
|
41,02
|
52,38
|
59,97
|
79,57
|
87,10
|
91,22
|
94,56
|
96,67
|
98,32
|
98,85
|
99,48
|
100,00
|
|
|
PA09
|
Masse du refus
|
23,35
|
25,35
|
26,51
|
14,68
|
69,30
|
14,34
|
8,75
|
10,27
|
4,73
|
0,62
|
1,05
|
0,41
|
0,64
|
200,00
|
|
% refus
|
11,68
|
12,67
|
13,26
|
7,34
|
34,65
|
7,17
|
5,14
|
4,38
|
2,36
|
0,31
|
0,53
|
0,20
|
0,32
|
|
|
% refus de cumulé
|
11,68
|
24,35
|
37,61
|
44,94
|
79,59
|
86,77
|
91,91
|
96,29
|
98,65
|
98,96
|
99,49
|
99,69
|
100,01
|
|
|
PT11
|
Masse du refus
|
38,56
|
48,36
|
22,52
|
8,47
|
41,02
|
12,91
|
11,91
|
10,75
|
3,77
|
0,08
|
0,66
|
0,39
|
0,61
|
200,00
|
|
% refus
|
19,28
|
24,18
|
11,26
|
4,23
|
20,51
|
6,45
|
5,95
|
5,37
|
1,89
|
0,04
|
0,33
|
0,20
|
0,31
|
|
|
% refus de cumulé
|
19,28
|
43,46
|
54,72
|
58,95
|
79,47
|
85,92
|
91,87
|
97,25
|
99,13
|
99,17
|
99,50
|
99,70
|
100,00
|
|
|
PT31
|
Masse du refus
|
38,31
|
50,65
|
25,31
|
10,20
|
45,84
|
10,48
|
8,28
|
6,31
|
2,94
|
0,17
|
0,83
|
0,62
|
0,06
|
200,00
|
|
% refus
|
19,15
|
25,33
|
12,66
|
5,10
|
22,92
|
5,24
|
4,14
|
3,15
|
1,47
|
0,08
|
0,42
|
0,31
|
0,03
|
|
|
% refus de cumulé
|
19,15
|
44,48
|
57,14
|
62,24
|
85,16
|
90,40
|
94,54
|
97,69
|
99,16
|
99,24
|
99,66
|
99,97
|
100,00
|
|
41
III.3.2. Courbes cumulées et indices
granulométriques
L'échelle de Wentworth et Ndjeng (1978) a
été utilisée pour identifier les différents types
granulométriques rencontrés. Elle présente trois grands
groupes :
- les rudites qui regroupent les blocs, les galets, graviers
et les granules dont le diamètre est supérieur 2 mm ;
- les arénites dont la taille des grains est comprise
entre 2 mm et 0,0625 mm qui présente : les sables très grossiers
2 à 1 mm ; les sables grossiers 1 à 0,5 mm ; les sables moyens
0,5 à 0,25 mm ; les sables fins 0,25 à 0,125 mm ; et les sables
très fins 0,125 à 0,0625 mm ;
- les lutites qui regroupent les argiles et les limons dont le
diamètre est compris entre 0,0625 et 0,0039 mm.
Le traçage des courbes cumulatives semi-logarithmiques
des différents échantillons et le calcul des différents
indices granulométriques permettent de connaître la nature des
sédiments, leurs classements et leurs hydrodynamismes. Ces courbes ont
des formes paraboliques plus ou moins étalées et
régulières pour la plupart des échantillons (figure
19).
L'observation des courbes cumulées a aussi permis
d'identifier les différents quartiles et de ressortir les indices
granulométriques consignés dans le tableau 6.
42
Tableau 6 : indices granulométriques.
|
INDICES
SEDIMENTOMETRIQUES
|
|
DESCRIPTION
|
|
Codes échantill ons
|
Quartile
1(25%)
|
Quartile
2(50%)
|
Quartile
3(75%)
|
Sorting index (S0)
|
Le coefficient
d'asymétrie
(As)
|
Quartile de déviation
|
|
|
Q1(mm)
|
Q2(mm)
|
Q3 (mm)
|
So = (Q3/Q1)1/2
|
As= (Q1×Q3)/Q22
|
Qdö = (Q1 - Q3) /2
|
|
|
PA 01
|
0,35
|
0,8
|
1,5
|
2,07
|
0,53
|
1,05
|
Sédiment hétérométrique et
normalement classé. Le classement s'effectue vers les
éléments grossiers.
|
|
PA 02
|
1,75
|
1,35
|
1,85
|
1,03
|
3,24
|
0,04
|
Sédiment très bien classé, le classement
des éléments s'effectue vers les fins et sont
homométrique.
|
|
PA 03
|
0,3
|
0,5
|
1,7
|
2.38
|
0,51
|
1,25
|
Sédiment bien classé,
hétérométrique, et le
classement maximum s'effectue vers les éléments
grossiers.
|
|
PA 04
|
0,35
|
0,45
|
1,25
|
1.89
|
0,44
|
0,92
|
Sédiment hétérométrique, les
particules sont très bien classé et le classement s'effectue vers
les grossiers.
|
|
PA 05
|
0,4
|
1
|
1,65
|
2.03
|
0,66
|
1,02
|
Sédiment hétérométrique, bien
classé. Le classement des éléments s'effectue vers les
grossiers.
|
|
PA 06
|
0,41
|
0,55
|
1,9
|
2.15
|
0,78
|
1,11
|
Sédiment très classé,
hétérométrique et le classement maximum s'effectue vers
les grossiers
|
|
PA 07
|
0,39
|
0,51
|
1,6
|
2.03
|
0,62
|
1,02
|
Sédiment grossier, hétérométrique ,
et bien classé.
|
|
PA 08
|
0,42
|
1,1
|
1,75
|
2.04
|
0,74
|
1,03
|
Sédiment bien classé, le classement des
éléments s'effectue vers les grossiers
|
|
PA 0 9
|
0,48
|
0,8
|
1,3
|
1.65
|
0,62
|
0,72
|
Sédiment hétérométrique et
très bien classé. Le classement des éléments
maximum s'effectue vers les grossiers
|
|
PT11
|
0,5
|
1,2
|
1,8
|
1,90
|
0,90
|
0,92
|
Sédiment très bien classé, mal
trié et le classement des éléments s'effectue vers les
grossiers.
|
|
PT13
|
0,55
|
1,25
|
1,85
|
1,83
|
1,02
|
0,88
|
Sédiment hétérométrique, très
bien classé. Le
classement des éléments s'effectue vers les
moyens.
|
43
PA 01
|
PA 03
|
PA 08
|
|
ourcentages cumulés (%)
2 5 7 0
> 5 0 5 0
|
|
|
|
|
|
ourcentages cumulés(%)
2 5 7 0
> 5 0 5 0
D 0
· 0 00 00 00 P ,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ourcentage cumulés (%)
2 5 7 0
> 5 0 5 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 Mailles
|
|
des
0,1
tamis
|
1 (mm)
|
|
10
|
|
0,01 Mailles
|
|
0,1 des tamis
|
|
1
|
(mm)
|
|
10
|
|
0,01
|
Mailles
|
0,1
des tamis
|
1
(mm)
|
|
10
|
|
PA
|
09
|
|
|
|
|
|
|
|
PT
13
|
|
|
|
|
PT
|
11
|
|
|
|
|
PPo
urcentages cumulés (%)
> 52 0 75 00
|
|
|
001
|
|
|
|
ourcentage cumulés (%)
> 52 0 75 00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PP
tages cumulés (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ourcen
>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01
P) Mailles
|
|
des
|
0,1 tamis
|
|
(mm)
1
|
|
10
|
|
0,01
|
Mailles
|
0,1 des
|
tamis
|
1
|
(mm)
|
10
|
|
0,01
|
Mailles
|
0,1
des tamis
|
1
(mm)
|
|
10
|
|
PA
|
05
|
|
|
|
|
|
|
|
PA
|
04
|
|
|
|
|
|
PA06
|
|
|
|
|
Pourcentqge cumulé (%)
> 5 0 5 0
|
|
|
|
|
|
|
|
Pourcentages cumulés (%
2 5 7 0
> 5 0 5 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oucentages cumulés (%)
2 5 7 0
> 5 0 5 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P
0,01 0,1 1 10
Mailles des tamis (mm)
|
|
0,01 Mailles
|
|
0,1 des
|
tamis(mm)
|
1
|
|
10
|
|
0,01 Mailles
|
0,1
des tamis
|
|
(mm)
1 10
|
|
|
PA 07
|
|
|
|
|
|
|
PA2
|
|
|
|
00
75
50
|
|
Pourcentages cumulés (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
Pourcentqges cumulés (%)
2 5 7 0
5 0 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 0,1 1 10
Mailles des tamis (mm)
|
|
0,01 0,1 1 10
Mailles des tamis (mm)
|
Figure 19 : courbes cumulées des
différents échantillons
44
Échantillon PA 01
La courbe cumulative montre une forte pente, le
sédiment est sableux. Le coefficient d'asymétrie As est
inférieur à 1, le classement des matériaux évolue
vers les éléments grossiers et les grains sont
hétérométriques.
Échantillon PA 02
Il présente une courbe cumulative à pente forte.
Les sables sont plus abondants que les graviers, le matériau est donc
sablo-graveleux. Le coefficient d'asymétrie supérieur à 1
montre que le classement de ces matériaux constitutifs s'effectue vers
les sédiments fins. Le quartile de déviation se rapproche de
zéro, dont les sediments sont homométriques.
Échantillon PA 03
Le quartile de déviation est éloigné de
0, ce qui confirme l'hétérométrie des sédiments. La
courbe cumulative est forte ; ce qui justifie le fait que le sable est plus
important que les graviers, le matériau est sablo-graveleux. Le
coefficient d'asymétrie est inférieur à 1, le classement
des particules évolue vers les sédiments grossiers.
Échantillon PA 04
La courbe cumulative montre une pente assez forte, le
matériau est sablo- graveleux et bien classé. Le coefficient
d'asymétrie As est inférieur à 1, le classement des
matériaux évolue vers des éléments grossiers et le
quartile de déviation est proche de 0, les sédiments sont
hétérométriques.
Échantillon PA 05
Il montre une courbe cumulative assez forte, le sable est plus
abondant que les graviers. Le quartile de déviation est de 1,02, ce qui
montre que les sédiments sont mal triés et bien classés.
Le coefficient d'asymétrie As est supérieur à 1, le
classement des matériaux évolue vers les éléments
fins.
Échantillon PA 06
Cet échantillon présente une courbe cumulative
à pente forte. Les graviers sont plus abondants que les sables, le
matériau est donc gravelo-sableux. Son coefficient d'asymétrie
est inférieur à 1, le classement des matériaux
évolue vers des sédiments grossiers. Ces sédiments sont
très bien classés par contre
hétérométrique.
45
Échantillon PA 07
Il présente le coefficient d'asymétrie qui a une
valeur inférieure à 1, dont le classement du matériau
s'effectue vers les éléments de plus en plus grossiers et sont
bien classés. Son quartile de déviation est de 1.02, ce qui
montre que le matériau est hétérométrique.
Échantillon PA 08
La courbe cumulative présente une pente forte, le sable
est plus abondant que les graviers, le matériau est sablo-graveleux et
bien classé. Le quartile de déviation est de 1,03, d'où
les sédiments sont hétérométriques et le
coefficient d'asymétrie est inférieur à 1, ce qui signifie
que les sédiments sont grossiers.
Échantillon PA 09
Ce matériau présente une courbe cumulative ayant
une pente forte, le sable est plus abondant que les graviers, le
matériau est sablo-graveleux. Le quartile de déviation est de
0,72 d'où les sédiments sont mal triés et bien
classés. Le coefficient d'asymétrie est inférieur à
1, ce qui signifie que les sédiments sont grossiers.
Échantillon PT 11
Le quartile de déviation est de 0,92 d'où les
sédiments sont hétérométriques, et bien
classés. Sa courbe cumulative présente une pente forte, les
sables sont plus abondants que les graviers, le matériau est
sablo-graveleux. Le coefficient d'asymétrie est inférieur
à 1, ce qui signifie que les sédiments sont grossiers.
Échantillon PT 13
Il montre une courbe cumulative de pente assez forte, le sable
est plus abondant que les graviers. Le quartile de déviation est de
0,88, ce qui montre que les sédiments sont
hétérométriques. Le coefficient d'asymétrie As est
supérieurs à 1, le classement des matériaux évolue
vers des éléments fins.
III.3.3. Analyse des histogrammes
Échantillon PA 01 et PA 03
Ils présentent des histogrammes bimodaux, de mode
principal 2 mm et secondaire 0,5 mm, Les particules dominantes sont comprises
dans les fractions 4 à 1,25 mm ; et de 0,5 à 0,4 mm. Il s'agit
des graviers, sables très grossiers et moyens
Échantillon PA 02
46
Cet échantillon présente un histogramme
unimodal, de mode principal 2 mm et les diamètres des particules
dominants est compris dans l'intervalle 4 - 1,25 mm. Il s'agit des gravier,
sables très grossiers et des sables moyens.
Échantillon PA 04
Cet histogramme est également bimodal, de mode
principal 0,5 mm et 2 mm pour le secondaire. Les particules dominantes sont
comprises entre 4 - 1,25 et 0,5 mm et sont majoritairement constituées
de graviers, sables grossiers et sables moyens accompagné d'une faible
proportion de sables fins.
Échantillon PA 06
Il présente un histogramme bimodal montrant, deux
principaux modes à 0,5 mm et 4 mm pour le second. Les diamètres
des particules dominantes est situé entre 4 - 2 mm et 0,5 mm. Ils sont
constitués des graviers, sables grossiers et sables moyens.
Échantillon PA 07 et PA 08
Ils présentent des histogrammes bimodaux, de mode
principal 0,5 mm et secondaire 2 mm, Les particules dominantes sont comprises
dans les fractions 4 à 2 mm et 0,5 mm de diamètre. Il s'agit des
graviers, sables très grossiers et moyens.
Échantillon PA 09
L'échantillon présente un histogramme unimodal,
de mode principal 1 mm. Le diamètre des particules dominantes est
compris entre l'intervalles 4 - 1 mm. Il s'agit des graviers, sables
très grossiers et des sables moyens.
Puit PT 11 et PT 31
Les échantillons montrent des histogrammes bimodaux :
de modes respectifs 2 mm pour les premiers et 1 mm pour les seconds. La taille
des particules dominantes est de 4 à 2 mm de diamètre et 1 mm. Il
s'agit des graviers, sables grossiers et sables moyens.
Échantillon PA 05
Il présente l'histogrammes bimodal montrant, deux
principaux modes à 2 mm et 0.5 mm pour le second. Le diamètre des
particules dominantes est situé entre 2 - 0,5 mm. Il est
constitué des graviers, sables grossiers et sables moyens.
47
Pourcentages
|
52 01 PA
simples (%) 02
51
01
5
4 0
2
1,25
tamis des aes(mm) llMi 1
0,5
0,4
0,315
0,25
0,18
0,16 0,125
0,05
<0,05
02
01
0
|
tamis des (mm) aesllMi
Pourcentage simple
(%)
4
2
1,25
1
0,5
0,4
0,315 0,25
0,18
0,16
0,125
0,05
<0,05
04 08 PA
02
0
tamis des (mm) aesllMi
|
Pourcentage simple
(%)
4
2 1,25 1 0,5
0,4 0,315
0,25 0,18 0,16 0,125 0,05 <0,05
|
|
04 04
02 02
0 0
tamis des aes(mm) tamis des aes(mm) llMi llMi
Pourcentage simple
(%)
4
2
1,25
1
0,5
0,4
0,315
0,25
0,18
0,16
0,125
0,05
<0,05
Pourcentage simple
(%)
4
2
1,25
1
0,5 0,4 0,315 0,25 0,18 0,16 0,125 0,05 <0,05
|
|
Pourcentage simple
(%)
4
2
1,25
1
09 PA
0,5 04
0,4
0,315 02
0,25
0,18 0
0,16
0,125
tamis des aes(mm) llMi
0,05
<0,05
|
|
Pourcentage simple
(%)
2 4
0 0 0
4
2
1,25
1
ai 0,5
es 0,4 PA
0,315 04
0,25 mis 0,18
0,16
0,125
0,05
<0,05
|
Pourcentage simple
(%)
2 4
0 0 0
4
tamis des aes(mm) llMi 2
1,25
1
0,5
0,4 0,315
0,25
0,18
0,16
0,125
0,05
<0,05
0
des tamis (mm) aesMill
|
40 PA 06
|
|
|
simple
|
|
|
|
|
Pourcen
4
2
1,25
1
0,5 0,4
0,315 0,25 0,18 0,16 0,125 0,05
<0,05
|
|
Pourcentage simple
(%)
2 4
0 0 0
4
2
1,25
1
e
0,5 P
0,4 ami 0,315 0,25 mm) 0,18 0,16 0,125 0,05 <0,05
|
ples 40,00 PA 02
|
0,05
<0,05
|
|
|
|
2 1,25 1 0,5 0,4 0,315 mi 0,25 0,18 des
aes(mm) llMi
0,16
0,125
|
Figure 20 : histogrammes des différents
échantillons.
48
III.4. ÉTUDE MORPHOSCOPIQUE
La morphoscopie ou étude de la surface des grains de
sable permet de retracer l'histoire et les conditions de transport des
matériaux sédimentaires à travers l'aspect de la surface
des grains (Cailleux, 1942). Les données de cette étude ont
été réalisé sur trois (03) échantillons PA
01, PA 04 et PA 09. Les résultats de cette analyse sont
présentés dans le Tableau 7 et représentés sur les
diagrammes surfacés de la Figure 25.
Tableau 7 : inventaires des grains
observés.
|
Échantillons
|
Mailles (mm)
|
Formes et aspects des grains de quartz
|
|
|
TA
|
A
|
SA
|
SE
|
E
|
TE
|
total
|
|
PA 01
|
2 mm
|
15
|
20
|
15
|
/
|
/
|
/
|
50
|
|
0,5 mm
|
06
|
44
|
/
|
/
|
/
|
/
|
50
|
|
PA 04
|
2 mm
|
05
|
35
|
08
|
02
|
/
|
/
|
50
|
|
0,5 mm
|
06
|
11
|
33
|
/
|
/
|
/
|
50
|
|
PA 09
|
2 mm
|
12
|
33
|
05
|
/
|
/
|
/
|
50
|
|
0,5 mm
|
09
|
24
|
16
|
/
|
01
|
/
|
50
|
|
Total
|
/
|
53
|
167
|
77
|
02
|
01
|
/
|
300
|
|
Pourcentage (%)
|
/
|
17,66
|
55,67
|
25,67
|
0.66
|
0,34
|
|
|
TA= Très Anguleux ; A= Anguleux ; SA= Sub-Anguleux ;
SE= Sub-Émoussé ; E= Émoussé ; TE= Très
Émoussé ; (Pettijhon et al., 1987).
III.4.1. Analyse des diagrammes surfacés des
grains
Les analyses des diagrammes surfacés
représentés dans la figure 21 montrent les différentes
proportions des grains de sable observés.
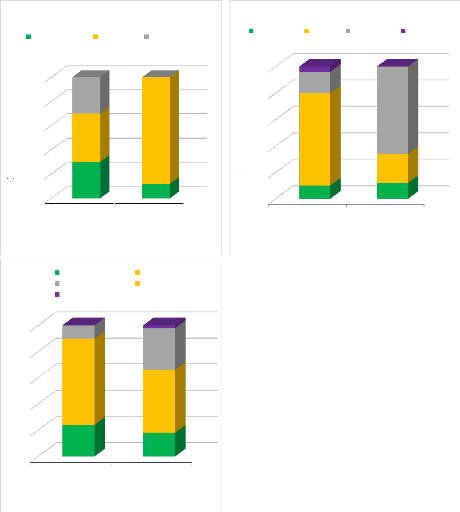
PA 01
très anguleux anguleux sub-anguleux
4 - 2 mm 1- 0,5mm
50
Pourcentage simple (%)
40
30
20
10
0
Mailles des tamis
4 - 2 mm 1- 0,5mm
Mailles des tamis
très anguleux anguleux
sub-anguleux subémoussé
émoussé
50
40
30
20
10
Pourcentage simple (%)
0
PA 09
PA 04
très anguleux anguleux sub-anguleux
subémoussé
4 - 2 mm 1- 0,5mm
Pourcentage simple (%)
40
20
50
30
10
0
Mailles des tamis
49
Figure 21 : diagrammes surfacés des
échantillons. - Les grains Très-anguleux
Ils sont représentés dans les deux fractions de
chaque échantillon avec un pourcentage total de 17,66 %. Ce sont les
plus abondants dans la fraction totale des échantillons.
50
- Les grains anguleux
Ce sont les grains les plus représentés avec un
pourcentage total de 55,67 %. Ils sont présents en très grande
proportion dans toutes les 2 mailles de l'échantillon PA 01 ;
présents dans l'échantillon PA 04, en faible proportion et avec
une proportion moyenne dans l'échantillon PA 09.
- Les grains sub-anguleux
Avec un pourcentage de 25, 67 % et représenté
juste après les grains anguleux dans la fraction totale des
échantillons, les grains sub-anguleux sont présents dans la
majorité des échantillons, à l'exception de la fraction
0.5 mm de l'échantillon PA 01.
- Les grains sub-émoussés
Ils sont présents dans la fraction 2 mm de
l'échantillon PA 04. Ils sont absents dans le reste des fractions des
échantillons PA 01 et PA 04. Ils ont un pourcentage total de 0,66%.
- Les grains émoussés
Présents dans la fraction 0.5 mm de
l'échantillon PA 09. Ils sont absents dans toutes les autres fractions
des échantillons PA 01 et PA 04. Ils ont un pourcentage total de
0,34%.
III.4.2. Formes des grains
Les formes des grains sont observées à partir
d'une loupe binoculaire au grossissement 50 X et sont
représentées sur la Figure 22. L'observation des grains au
travers de la loupe binoculaire a permis de répertorié au total
300 grains de quartz. Le pourcentage des grains très anguleux est de
17,66 %. Les grains de forme anguleuse sont les plus représentés
avec un pourcentage de 55,67 % pour l'ensemble des espèces
minérals. Les grains sub-arrondis ont un pourcentage de 25,67 % dans
l'ensemble constitués des grains de quartz. Les grains de quartz
représentent 0,34 % des grains émoussés, contrairement aux
grains de formes sub-émoussés ayant un pourcentage de 0,66 % pour
les grains de quartz (Tableau 7).
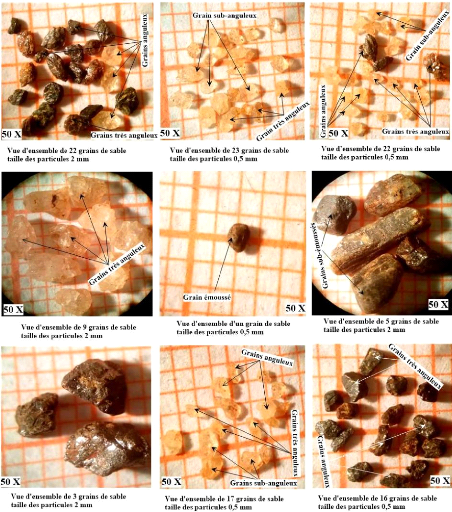
51
Figure 22 : différentes formes des
grains de quartz et minéraux ferrifères observés à
la loupe
binoculaire au grossissement 50 X.
III.5. ÉTUDE DES MINÉRAUX LOURDS
L'analyses des minéraux lourds a été
faite par observation des lames minces au microscope optique. Quatre
échantillons des alluvions (PA 07, PA 09, PT 11, PT 31) ont
été sélectionnés pour les analyses. Elle permet,
ainsi à partir des minéraux caractéristiques de
déduire la source distributrice des sédiments. Cette étude
a permis de reconnaitre les minéraux
52
lourds tels que : le zircon, le rutile, le disthène, la
tourmaline, la sillimanite, la chloritoïde, le grenat, la zoïsite, le
diopside, le staurotide, l'augite et les minéraux opaques (tableau
8).
Tableau 8 : distribution des minéraux
lourds.
|
PA09
|
Pt31
|
PA07
|
PT 11
|
|
Sillimanite
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Rutile
|
2
|
20
|
4
|
7
|
|
Zoïsite
|
1
|
1
|
5
|
3
|
|
Zircon
|
7
|
3
|
4
|
2
|
|
Grenat
|
4
|
3
|
9
|
7
|
|
Disthène
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
Staurotide
|
1
|
3
|
1
|
4
|
|
Diopside
|
1
|
1
|
2
|
3
|
|
Augite
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
Chloritoïde
|
1
|
3
|
2
|
1
|
|
Tourmaline
|
0
|
6
|
20
|
0
|
|
Minéraux opaques
|
68
|
79
|
37
|
71
|
|
Total
|
88
|
121
|
87
|
102
|
III.5.1. Description des différentes espèces
minérales
Le cortège minéralogique (figure 23) ici est
constitué de :
? zircon : il se présente sous forme
de fragments de prismes plus ou moins allongés aux arêtes
légèrement émoussées et parfois zonés.
Certains grains très usés sont ovoïdes. Ce minéral
est caractérisé par de nombreuses inclusions. Il est
présent dans tous les échantillons avec un pourcentage oscillant
de 2 à 7% ;
? rutile : c'est un cristal prismatique allongé
généralement avec des contours très usés. Certains
grains sont très arrondis et marqués par la présence
d'inclusions aciculaires. En LPA comme en LPNA, il a un relief fort avec des
tons brun et rouge foncé. Présent dans tous les
échantillons mais en faible proportions (2 - 16 %) ;
? disthène : il se présente sous forme de prisme
aplati usé avec des formes courbes. Ses formes ovoïdes sont de
grandes dimensions. Il possède un clivage à 90° et une
extinction
53
droite, il est présent dans tous les
échantillons mais avec des proportions très faible (1 - 2%) ;
- tourmaline : elle présente une forme
fragmentée et prismatique. Ses grains sont bien roulés et sa
couleur est Rose - clair. Elle a une macle polysynthétique. Il faut
aussi noter la présence de nombreuses inclusions en grains de zircons ou
en aiguilles de quartz ou de rutile, il a un pourcentage de 0 à 20% et
uniquement présent dans les échantillons PA 07 et Pt 31 ;
- sillimanite : elle est souvent prismatique et incolore en
lumière naturelle. Son extinction est droite et sa structure fibreuse.
Elle est distribuée de manière proportionnelle dans tous les
échantillons avec un pourcentage d'environ 1% ;
- chloritoïde : elle se rencontre en
général en grains écailleux à contours arrondis,
doués d'un relief assez accentué. Son pléochroïsme
caractéristique, visible sur la plupart des grains, est un des
caractères les plus nets qui permettent d'en faire la discrimination.
Elle est présente dans tous les échantillons mais en faible
proportions (1- 2 %) ;
- grenat : il est présent dans tous les
échantillons avec un pourcentage de 2 à 10%. Ce minéral se
présente sous la forme de grains sub-sphériques à
sphériques. Il a parfois une texture grenue avec quelquefois des
cristaux cassés et sa couleur est brune ;
- zoïsite : elle se présente en grain plus ou
moins roulés ou en fragments de prismes courts sans pointements. Elle
est représentée par l'épidote au sens strict. La
zoïsite au sens large, est une espèce très rare. Elle est
habituellement incolore en LPNA et de couleur variant au gris, brun
jaunâtre, vert pâle, rose en LPA. Elle est présente dans
tous les échantillons avec des proportions élevées variant
de 1- 5% ;
- diopside : il présente une forme
prismatique. En LPNA, il est incolore à verdâtre avec un relief
fort, il présente des tâches d'altération sombre. En LPA,
il présente une extinction droite et présent dans tous les
échantillons avec des proportions de 1 à 3 % ;
- staurotide : elle se présente sous forme de grains
irréguliers ou aplatis avec des cannelures. Elle possède une
zonation concentrique avec parfois des fragments de prismes aux
extrémités en dents de scies. Des inclusions de quartz sont
présentes dans ce minéral. Elle est présente dans tous les
échantillons avec des proportions faibles (1- 4%) ;
- augite : elle se présente sous des formes très
anguleuses à anguleuses, rarement sub-anguleuses, sub-arrondies à
arrondies et parfois allongé. Elle est mauve, de nuance allant de mauve
franc au gris mauve plus ou moins foncé. En LPNA, elle est de couleur
verdâtre, brunâtre à jaunâtre. Son relief est
très fort et ses clivages fis et réguliers. En LPA, elle
54
présente une extinction oblique. Pour la plupart, elles
présentent des inclusions des minéraux opaques. L'augite est
présente dans l'échantillons PA 9 et PT 11.
? minéraux opaques : ils présentent des formes
très anguleuses à arrondies. En LPNA, ils ont une couleur noire
et en LPA ils sont toujours éteints. Présents dans tous les
échantillons avec de très fortes proportions (42 - 77 %).
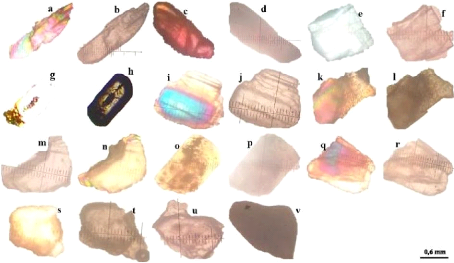
Figure 23 : minéraux lourds. a)
Sillimanite LPA, b) Sillimanite LPNA ; c) Rutile LPA, d) Rutile LPNA ; e)
Zoïsite LPA, f) Zoïsite LPNA ; g) Zircon LPNA, h) Zircon LPA ; i)
Disthène LPA, j) Disthène LPNA ; k) Staurotide LPA, l) Staurotide
LPNA ; m) Diopside LPNA, n) Diopside LPA ; o) Tourmaline LPA, p) Tourmaline
LPNA ; q) Augite LPA, r) Augite LPNA ; s) Chloritoïde LPA, t)
Chloritoïde LPNA, u) Grenat ; v) Minéral opaque.
III.5.2. Présentation analytique des minéraux
lourds
Les différentes proportions des minéraux lourds
sont consignées dans le Tableau 8 et représentés sur les
diagrammes circulaires de la figure 24. Les minéraux opaques sont
prédominants dans tous les échantillons avec des proportions
oscillant de 50 à 80 %. Les minéraux comme le rutile, la
tourmaline ont des proportions moyennes et représentent respectivement 2
- 20 %, et 6 - 20 %. La zoïsite, le zircon, le grenat, le disthène,
la staurotide, le diopside, l'augite, la chloritoïde, sont en faibles
proportions comprises entre 1 et 9 %. La sillimanite quant à elle
présente des proportions égales dans tous les échantillons
(1%).
55
PA07
|
Sillimanite
1%
Minéraux opaques
43%
|
Rutile
5%
|
Zoïsite
6%
|
Tourmaline
23%
Zircon
5%
|
Grenat
10%
Staurotide
1%
Disthène
2%
Diopside
2%
Augite
Chloritoïde
2%
|
0%
PA
|
Sillimanite
09 Zoïsite Zircon
Rutile
3% 1% 8%
1%
|
Grenat Disthène
5% 1%
Staurotide
1%
Augite
1%
Diopside
1%
Chloritoïde
1%
Tourmaline
0%
|
|
Minéraux opaques
77%
|
|
|
|
PT 11
Minéraux opaques
69%
|
Sillimanite
1%
|
Rutile
7%
|
Zoïsite
3%
|
Zircon
2% Grenat
7%
Staurotide
4% Disthène
2%
Diopside
3%
Augite
|
|
PT31
Sillimanite
1%
|
Rutile
17%
|
Zoïsite
1%
|
Tourmaline Zircon
3% Grenat
2%
Disthène
1%
Staurotide
2%
Diopside
1%
Augite
0%
Chloritoïde
2%
5%
|
|
1%
Chloritoïde
1%
Tourmaline
0%
|
|
|
Minéraux opaques
65%
|
|
|
|
Figure 24 : pourcentage des minéraux
lourds dans la fraction globale des différents
échantillons.
Conclusion
La pétrographie des roches est constituée
essentiellement des roches métamorphiques repartie en trois types
pétrographiques constitués des micaschistes, des gneiss (gneiss
à grenat et biotite et gneiss à micas et grenat) et de
l'amphibolite. Les matériaux alluvionnaires de la rivière Djel
sont des sédiments hétérométriques, mal
triés, et bien classés. L'étude morphoscopique montre une
dominance des grains très anguleux. Le cortège
minéralogique est constitué de onze minéraux parmi
lesquels les minéraux opaques dominent.
CHAPITRE IV : INTERPRÉTATION ET
DISCUSSION
57
Introduction
Le présent chapitre se propose d'interpréter et
de discuter les principaux résultats obtenus. Il intègre les
observations de terrain associées à la pétrographie des
roches et la dynamique des matériaux alluvionnaires.
IV.1. PÉTROGRAPHIE
Le secteur de Pan-Makak appartient au groupe de
Yaoundé, partie intégrante du domaine Sud Cameroun.
Les études pétrographiques dans ce secteur
montrent la présence d'un ensemble lithologique de nature
métamorphique qui est constituée de micaschistes à grenat,
de gneiss à grenat et biotite, de gneiss à micas et grenat et
d'amphibolites. Toutes ces roches affleurent, soit en blocs, soit en
dômes. Les roches présentent une structure foliée avec deux
types de textures différentes, soit une texture granoblastique
hétérogranulaire pour l'amphibolite, les gneiss à grenat
et biotite, les gneiss à micas et grenat et une texture
lépidogranoblastique pour le micaschiste à grenat. L'ensemble des
roches est caractérisé par des assemblages typomorphiques de
faciès amphibolite de haut degré marqué par une
paragenèses Qtz + Grt + Bt + Pl + Ms pour les gneiss à grenat et
biotite, une paragenèse Qtz + Bt + Grt + Kfs + Pl pour les gneiss
à micas et grenat, l'assemblage minéralogique Amp + Pl + Qtz +
Kfs #177; Opx pour l'amphibolites et Qtz + Bt + Ms + Pl + Grt pour le
micaschiste à grenat. Toutes ces roches sont de type
métamorphique et ont des caractéristiques proches de celles des
métasédiments de Yaoundé (Nzenti et al., 1988), de Dibang
(Stendal et al., 2006), et de Boumnyebel (Yonta et al., 2010).
IV.2. ALLUVIONS
IV.2.1. Dynamique des alluvions
Les alluvions étudiées sont des matériaux
détritiques constitués des graviers, sables et limons
déposés par la rivière Djel et ses affluents. Elles
forment des dépôts stratiformes subhorizontaux observables au
travers des puits. Les courbes cumulées des échantillons
similaires à celles de Mouldi et Chkiou (2007) ont permis permet de
montrer que les sédiments sont mal triés. L'allure parabolique
des pentes traduit le fait que les sédiments sont
hétérométriques avec un bon classement. Les coefficients
d'asymétrie indiquent que les alluvions de Pan-Makak se sont
déposées dans un milieu de forte énergie plus ou moins
agité. L'allure unimodal à bimodale des histogrammes
témoigne une source influencée par un affluent. Le
caractère divers des histogrammes (unimodal et bimodaux) indique
plusieurs
58
modes, correspondant à un dépôt
favorisé par des courants irréguliers ou à des
sédiments déposés après un faible parcourt et
à un mélange de sédiments de diverses provenances (Pomerol
et Blondeau, 1968). Ces résultats sont semblables à ceux de Nyobe
(2019), Tonjé (2014). Par contre les travaux effectués dans la
localité de Batoké montrent que les histogrammes ont pour la
plupart un caractère unimodal (Tsanga, 2020).
Cinq (5) types morphologiques des grains ont été
mis en évidence à savoir les grains très anguleux,
anguleux, sub-anguleux, émoussés et sub-émoussés.
Les grains très anguleux, anguleux et sub-anguleux traduisent un
transport court suite à la désagrégation mécanique
de la roche source (Cailleux, 1942) tandis que les formes
émoussés et sub-émoussé traduisent un transport
long par roulement en milieu fluviatile (Pye et Blott, 2016). Les
matériaux alluvionnaires du secteur d'étude montrent une
abondance des grains anguleux. Ce qui conduit à dire que les
sédiments de la rivière Djel auraient effectué un
transport court à partir de la zone amont et seraient pour la plupart
locaux. Dans le même ordre d'idée, les travaux
réalisés par Nyobe et al., (2018) sur le bassin versant de Lobo,
montrent que les grains du rutile sont anguleux et dans une moindre mesure
sub-émoussés à prismatiques, ces auteurs montrent que la
nature angulaire des grains est une caractéristique principale de la
relique conservée pendant le transport.
IV.2.2. Origine et mode de dépôts des
alluvions
Les analyses morphoscopiques effectuées ont permis de
montrer que les grains sont majoritairement anguleux, ce qui explique le fait
que les alluvions du secteur d'étude ont pour origine des zones
environnantes.
Dans les trois (3) puits effectués, les
sédiments sont positionnés en couches relativement minces. Dans
la partie supérieure, les particules fines sont plus abondantes.
À la base, les particules grossières prédominent. Cette
disposition représente le classement positif et semble indiquer un bon
modèle de dépôt des sédiments. Cette disposition des
sédiments alluvionnaires serait aussi fonction de la taille des
particules (Nyobe et al., 2018), d'autre part, la vitesse de la lame d'eau
aurait également joué un rôle important dans cette
distribution (Eno, 1983). Les matériaux constitués de sables fins
se seraient déposés lors des décrues à l'endroit
où les crues avaient déposées les particules
grossières. La morphologie des sédiments alluvionnaires du
secteur d'étude est similaire à celle des alluvions des petits
collecteurs du bassin versant de Lobo (Nyobe, 2019).
59
L'observation des lames minces de minéraux lourds des
alluvions du secteur d'étude contribue à mieux
caractériser ces dépôts. Elle apporte des renseignements
sur l'origine et la dynamique de dépôt des minéraux
détritiques. Leur abondance et leur nature dans les sédiments
dépendent des roches sources, ainsi que des conditions
d'altération, de transport et de dépôt. Dans cette
perspective, les échantillons de minéraux lourds qui ont
été analysés ont présenté une série
de onze espèces minérales. Les minéraux lourds sont
classés en deux groupes : les minéraux ubiquistes, qui sont des
minéraux communs aux roches magmatiques et métamorphiques
(zircon, augite, diopside, grenat, minéraux opaques) ne donnent pas
d'indication particulière et peuvent être rattachés aux
formations métamorphiques en place dans ce secteur d'étude et les
minéraux caractéristiques du métamorphismes (sillimanite,
zoïsite, disthène, staurotide, chloritoïde tourmaline) qui
confirme la lithologie qui est essentiellement métamorphique. La
présence de certains minéraux (minéraux opaques et
diopside) du premier groupe de minéraux et du deuxième semble
illustrer que, la roche source des matériaux alluvionnaires de la
rivière Djel serait composée des roches métamorphiques
(Tonjé et al., 2014 ; Nyobe et al., 2018). Ainsi, l'abondance de
minéraux opaques, rutile, tourmaline, grenat et zircon, dans tous les
échantillons indique une source distributrice métamorphique
provenant des roches a proximités tel que le revèle Stendal et
al. (2006) qui montrent à partir des études géologiques
réalisées dans la localité de Dibang et ses environs
(secteurs situés à l'Ouest de Bot-Makak) que : (1) le rutile
alluvial et éluvial de la région de Yaoundé provient de la
dégradation des métapélites, des roches
métamorphiques ; (2) le rutile du groupe de Yaoundé s'est
formé au cours du métamorphisme panafricain ou provient du rutile
détritique de source d'environ 900 Ma. Les roches étudiées
ont presque le même cortège minéralogique. Ils sont
principalement composés de quartz, feldspaths, plagioclase, biotite,
amphibole, pyroxène, grenat et minéraux opaques. Les
différences observées sur les plans minéralogiques et
texturaux pourraient être liées à la variation des
conditions du métamorphisme (Maurizot et al., 1986, Nyobe et al., 2018).
Leur composition chimique serait semblable à celle de Nyobe et al.,
2018). D'après Bouyo et al., (2015), les roches telles que gneiss et
micaschistes pourraient résulter du métamorphisme d'un protolithe
felsique et les amphibolites d'un protolithe mafique.
IV.3. INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DES
MATÉRIAUX ÉTUDIÉS
Les matériaux alluvionnaires constituent
d'énormes potentialités économiques. Ils interviennent
dans plusieurs domaines de la société et représentent
l'une des premières ressources exploitables (Pomerol et al., 1972). Leur
utilisation plus courante est faite sous formes d'agrégats pour les
fondations, les routes, les voies ferrées et les ponts. Ils sont
utilisés
60
comme des matières de filtration, pour les travaux de
drainage de terrain et de l'assainissement des eaux (Robert et al., 1972). Ces
matériaux s'étendent sur toute l'étendue du territoire
national, par exemple les alluvions fluviatiles de Mbanjock (centre Cameroun),
de la Bénoué (Nord Cameroun), de Ndop et de Mbos (Nord et
Sud-Ouest du Cameroun). Ils sont exploités par plusieurs
sociétés et par les populations locales qui pratiquent de
l'activité artisanale, au regard de nombreux chantiers (construction des
routes, autoroutes, barrage, ...) lancés au Cameroun depuis plusieurs
années (Thomas et al., 2008).
Les matériaux alluvionnaires étudiés dans
la rivière Djel à Pan-Makak recèlent des concentrations
importantes en rutile. Ces résultats sont conformes à ceux
obtenus à Lobo (Nyobe et al., 2018), à Matomb (Tonjé et
al., 2014). Par ailleurs, certains dépôts alluvionnaires
possèdent des minéralisations en or (Akono, 2015 ; Belinga,
2017).
Les alluvions les plus fins, telles que les argiles alluviales
ont un grand intérêt dans l'industrie céramique pour la
fabrication des briques et des tuiles (NgonNgon et al., 2013). Ils sont aussi
utilisés comme adjuvants dans les procédés industriels
notamment la production du papier, du ciment, la filtration chimique, les
peintures, la réalisation d'ouvrage d'étanchéité.
De plus, leur capacité est exploitée pour la rétention des
métaux lourds des eaux usées et pour la purification de l'air.
CONCLUSION GÉNÉRALE ET
PERSPECTIVES
62
CONCLUSION GÉNÉRALE
La présente étude a permis de
caractériser les roches, les alluvions et de comprendre l'interaction
entre la roche source et les minéraux rencontrés dans les
alluvions.
Du point de vue lithologique, les différentes
associations minéralogiques établies au cours des observations
microscopiques révèlent la présence de trois types
pétrographiques à savoir : l'amphibolite qui a une texture
granoblastique hétérogranulaire composées essentiellement
d'amphibole, de quartz, de feldspath alcalin, de plagioclase, de biotite et de
minéraux opaques ; les gneiss qui ont une structure foliée et une
texture granoblastique hétérogranulaire. Ils sont composés
de quartz, muscovite, biotite, feldspath alcalin, plagioclase,
orthopyroxène, amphibole, rutile et minéraux opaques ; et enfin
les micaschistes à grenat a une texture granolépidoblastique
hétérogranulaire et ont une composition minéralogique
constitué du quartz, muscovite, biotite, amphibole et minéraux
opaques.
La caractéristique des alluvions de la rivière
Djel sur le plan sédimentologique montre que les sédiments sont
mal triés. Les pentes fortes des courbes paraboliques traduisent
l'hétérométrie des sédiments et un bon classement.
Les coefficients d'asymétrie indiquent leur dépôt dans un
milieu de forte énergie plus ou moins agitée. Ces
sédiments ont subi un transport fluviatile. Les analyses morphoscopiques
des grains de quartz et ferromagnésiens montrent la prédominance
des grains très anguleux, anguleux et sub-anguleux. Ceci illustre un
court transport et une source proximale.
L'étude des minéraux lourds montre que les
alluvions sont constitués des minéraux tels que : le zircon, le
rutile, le disthène, tourmaline, sillimanite, Chloritoïde, le
grenat, Zoïsite, Diopside, Staurotide, Augite et les minéraux
opaques ce qui traduit que la roche source des alluvions est
métamorphique.
Les matériaux alluvionnaires de la rivière Djel
présentent un intérêt économique assez important, et
sont utilisés par les riverains pour la réalisation de plusieurs
ouvrages. Ils renferment tout de même des concentrés de rutile.
63
PERSPECTIVES
- augmenter le nombre d'échantillon afin d'avoir des
plus amples informations sur le secteur d'étude ;
- effectuer des analyses minéralogiques et
géochimiques afin de mieux comprendre le potentiel minier du secteur
d'étude.
64
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Angue, A. M., 1982. Étude géologique des
séquences et faciès d'altération des gneiss migmatitiques
du secteur sud - ouest de Yaoundé. Mém. Maît., Univ.
Ydé. 60 p.
Asaah, V.A., 2010. Lode gold mineralization in the Neoproterozoic
granitoids of Batouri, South eastern Cameroon. Unpublished Doct Thesis,
Clausthal. Univ. Technology, 202 p.
Balep, J., 1997. Contribution à l'étude
pétro structurale des métamorphites de la région de
Matomb. Mém. Maît., Univ. Ydé. 59 p.
Belinga, C. 2017. Caractérisation sédimentologique
et chimique des placers d'or de Nkoléban (Département de la
Mvila-Région du Sud). Mém. Maît., Univ. Ydé I, 46
p.
Biju-Duval, B., 1999. Bassin, environnement de
dépôts, formation du pétrole, ed. technip. Paris.
312p.
Bitom, D., 1988. Organisation et évolution d'une
couverture ferralitique en zone tropicale humide (Cameroun). Genèse et
transformation d'ensembles ferrugineux indurés profonds. Thèse de
doctorat, Université de Poitiers, 164 p. multigr.
Boaka à Koul, L.M., Yongue, F.R., Ndjigui, P-. D.,
2009. The alluvial sapphire profiles of Mayo Kewol placer in the Adamawa region
(North- Cameroon): Granulometric and mineralogical features. J. Afr. Earth
Sci. 56: 121-126.
Bouyo Houketchang, M., Zhaa, Penaye, J., Zhang, S.H., Njel,
U.O., 2015. Neoproterozoic subduction-related metavolcanic and metasedimentary
rocks from the Rey Bouba Greenstone Belt of north-central Cameroon in the
central African Fold Belt: New insights into a continental arc geodynamic
setting. Precambrian research. 02/2015; 261. DOI: 10. 1016/j. precamres.
2015.01.012.
Brito De Neves, B.D., Van, S., Fetter, A., 2001. North-West
Africa North-Eastern Brazil. Major tectonic links and correlation problems.
J. Afri. Earth. Sci, 34, 275-273.
Cailleux, A., 1942. Distinction des sables marins et fluviatiles.
Bulletin of social Geology, 125138.
Castaing, C., Triboulet, C., Feybesse, J.L.,
Chèvremont, P., 1994. Tectonometamorphic Evolution of Ghana, Togo, Benin
in the light of the Pan-African/ Braziliano orogeny. Tectonophysics
218, 323-347.
65
Champetier De Ribes, G., Aubague., 1956, Carte
géologique de reconnaissance du Cameroun au 1/500 000, feuille de
Yaoundé-Est, avec notice explicative, Dir, Mines, Géol,
Cam, 35 p.
Davidson et Reginaldo., 1989. Tectonic evolution for the
seripano Fold Belt, NE Brazil, during the Braziliano Orogeny. Precambrian
Research 45, 319-342.
Embui, V. F., Omang, B.O., Che, V.B., Nforba, M.T., Suh, E.C.,
2013. Gold grade variation and stream sediment geochemistry of the Vaimba-Libi
drainage system, Northem Cameroon (West Africa). Natural Science 5,
282-290.
Eno, B.S.M., 1999.Le Cameroun à l'aube d'un avenir
minier florissant. Librairie Universitaire, Univ, Ydé I. 306 p.
Evina Nkoto, S., 2018. Contribution à l'étude
sédimentologique, minéralogique et géochimique du rutile
de Mbili-Medoumou-Nkol Djaa près d'Akonolinga (Centre Cameroun).
Mém. Maît., Univ. Ydé I, 89 p.
Foucault, A., Raoult, J. F., 2001. Dictionnaire de
Géologie. Foucault, A., Raoult, J. F., 2019. Dictionnaire de
Géologie.
Giroux, M., Tran, S., 1996. Critères agronomiques et
environnementaux liés à la disponibilité, la
solubilité et la saturation du phosphore des sols agricoles du
Québec. Agrosol, 9, (2), 51-57.
Janpou, A., 2018. Pétrologie et géochimie des
sables littoraux de Batoké Camp Secteur Sud, Limbé, Sud- Ouest
Cameroun. Mém. Maît., Univ. Ydé I, 77 p.
Kabeyene, B. V., 1982. Contribution à l'étude
géologique de l'aplanissement dans le secteur nord de Yaoundé,
Mém. Maît., Univ. Ydé I, 88 p.
Letouzey, R., 1968. Étude phytogéographique du
Cameroun, Ed P, Lechevalier, Paris, 508p.
Letouzey, R., 1985. Carte de la végétation du
Cameroun (8 feuilles au 1/ 500,000, 5 notices explicatives), Institut de la
carte internationale de la végétation, Université Paul
Sabatier, Toulouse.
Loung, J. F., Laclavère, G., 1979. Atlas de la
république unie du Cameroun. Ed. Jeune Afrique, Groupe J. E, Paris
Mathieu, C., Pieltain, F., 1998. Physical analysis of soil.
Masson, 274. Mathieu, C., Pileltain, F., 1998. Analyse
physique des sols. Masson, 274p.
66
Maurizot, P, A., Feybesse, A,, Abessolo, Johan, J,L,, et Le
Compte, P,, 1986, Etude et prospection minière du Sud-Ouest Cameroun,
Synthèse des travaux de 1978 à 1985, Rapp, BRGM, 85, CMR 066, 274
p,
Minyem, D., 1994. Contribution à l'étude de
l'évolution métamorphique et structurale du secteur
Eséka-Makak (Cameroun, Département du Nyong et Kellé,
Province du Centre). Thèse de Doctorat 3è Cycle, Univ. Ydé
I : 166p.
Mouldi, B., Chkiou, A., 2007. Répartition
granulométrique et minéralogique des sédiments de surface
dans le golfe de Tunis. Bulletin institut national des sciences et Technologies
Mer de Salammbô, 34, 9.
Mvondo, H., Owona, S., Mvondo, J., Essono, J., 2007. Tectonic
evolution of the Yaoundé segment of the Neoproterozoic Central African
Orogenic Belt in southern Cameroon. Canadian J. of Earth Sci. 44:
433-444.
Ndjigui, P.- D, Bilong, P., Nyeck, B., Eno Belinga, S.M.,
Vicat, J.P., Gerard, M., 1999. L'étude morphologique,
minéralogique et géochimique de deux profils latéritiques
dans la plaine côtière de Douala (Cameroun), Géologie et
environnement du Cameroun. Ed. Collect. GEOCAM. 2/1999. Press. Univ. Ydé
I. pp. 189-201.
Ndjigui, P.- D., Badinane, M.F.B.B., Nyeck, B., Nandjip,
H.P.K., Bilong, P., 2013. Mineralogical and geochemical features of the coarse
saprolite developed on orthogneiss in the SW of Yaoundé, South
Cameroon. J. Afr. Earth Sci. 79: 125-142.
Ndjigui, P-. D., Bayiga, E. C., Onana, V.L., Djenabou-Fadil,
S., Assomo Ngono, G.S., 2018. Mineralogy and geochemistry of recent alluvial
sediments from the Ngaye River watershed, northern Cameroon: implications for
the surface processes and Au-PGE distribution. J. Afr Earth Sci. 150.
pp, 136-157.
Ngnotue, T., Nzenti, J.P., Barbey, P., Tchoua, F.M., 2001. The
Ntui-Betamba high grade gneisses: a northward extension of the pan-african
Yaoundé gneisses in Cameroon. J. Afr Earth Sci. 312. pp,
369-381.
Ngon Ngon, G.P., Etame, J., Ntamak-Nida, M.J., Mbog, M. B.,
Malliengue Mpondo, A, M., Gerard, M., Yongue Fouateu, R., Bilon, P., 2013.
Geological study of sedimentary clayey materials of the Bomkoul area in the
Douala region (Douala Sud-basin, Cameroon) for the ceramic industry.
Comptes Rendus Geoscience, 344 (6-7), 366-376.
67
NgonNgon, G. P.,1996. Étude de la genèse des
dépôts de rutile alluvionnaire du Cameroun : le cas des
dépôts de rutile alluvionnaires du bassin versant de la
Messié Mezoa, Département de la Mefou-et-Akono, province du
centre. Mém. Maît., Univ. Ydé I, 60 p.
Nyeck, B., Ngimbous, R.V., Ndjigui, P.-D., 2019. Petrology of
saprolite developed on gneisses in the Matomb region, south Cameroon. J.
Afr. Earth Sci. 150 : 107-122.
Nyobe, J.M., 2019. Étude minéralogique et
géochimique des fractions alluvionnaires riches en rutile des
différents affluents de la rivière Lobo, Centre-Cameroun,
Thèse de Doctorat Ph. D, Univ, Ydé I, 176p.
Nyobe, J.M., Sababa E., Bayiga, E.C., Ndjigui, P-D., 2018.
Mineralogical and geochemical features of alluvial sediments from the Lobo
watershed (Southern Cameroon): implications for rutile exploration. C.R.
Geoscience. 350, 119-129.
Nyobe, J.M., Sababa, E., Bayiga, E, C., Ndjigui, P.- D., 2018.
Mineralogical and geochemical features of alluvial sediments from the Lobo
watershed (Southern Cameroon): Implications for rutile exploration. Compte
Rendu Géoscience 350, 119-129.
Nzenti, J. P., Barbey, P., Macaudiere, J., Soba, D., 1988.
Origin and evolution of late Precambrian high-grade Yaoundé gneisses.
Precambrian Research 38: 91-109.
Nzenti, J. P., Barbey, P., Tchoua, F. M., 1999.
Évolution crustale au Cameroun : élément pour un
modèle géodynamique de l'orogenèse
Néoprotérozoïque, Géologie et environnement du
Cameroun. Ed. Collect. GEOCAM. 2/1999. Press. Univ. Ydé I. 397-407p.
Nzesseu, N. V.,2019. Caractéristiques
sédimentologiques du rutile alluvionnaire de Minto, Département
de la Mvila, Sud-Cameroun. Mém. Maît., Univ. Ydé I, 61
p.
Onguene, M., 1993. Différenciation pédologique
dans la région de Yaoundé, Transformation d'un sol ferrallitique
rouge à horizon jaune avec évolution du modelé.
Thèse de Doctorat Ph. D, Univ. Paris VI. 254p.
Parfenoff, A., Pomerol, C., Tourenq, J., 1970. Minerals in
grains: methods of study and determination. Masson and Cie, Edition, Paris,
571.
Pavillon, M. J., 1964. Paléogéographie
dévonienne et minéralisation ferrugineuses de Dielette (Manche)
et plombo-zincifères de Surtainville (Manche). Bulletin de la
société Géologique de France 7 (1), 121-126.
68
Penaye, J., Toteu, S.F., Tchameni, R., Van Schmus, W.R.,
Tchakounté, J., Ganwa, A., Minyem, D., Nsifa, E.N., 2004. The 2.1 Ga
West Central African Belt in Cameroon: extension and evolution. J. Earth
Sci. 39 : 159-164.
Poidevin , J.L., 1991. Les ceintures de roches vertes de la
République Centre Africaine. Contribution à la connaissance du
précambrien du nord du craton du Congo. Thèse de Doctorat
d'État, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France :
440p+annexes.
Pomerol, C., Feugueur, L., 1968. Bassin de Paris : Ile-de-France,
Masson, 415. Pomerol, C., Fouet, R., 1972. Minerais et terres rares. Masson,
135.
Powers, M.C., 1953. A new roundness scale for sedimentary
particles. J. Sedimentary Research. 23 (2): 117-119p.
Pye, K., Blott, S.J., 2016. Assessment of beach and dune erosion
and accretion using LIDAR: impact of the stormy winter and longer term trends
on the sefton Coast, UK. Geomorphology, 266, 146-167p.
Robert, F., Charles, P., 1972. Minerais et terres rares. Masson,
136.
Stendal, H., Toteu, S.F., Frei, R., Penaye, J., Njel, U.O.,
Bassahak, J., Nni, J., Kankeu, B., Ngako, V., Hell, J.V., 2006. Derivation of
detrital rutile in the Yaoundé region from the Neoproterozoic
Pan-African belt in southern Cameroon (Central Africa), J. Afr. Earth
Sci. 44: 443-456.
Suh, C. E., Lehmann, B., Mafany, G.T., 2006. Geology and
geochemical aspects of gold mineralization at Dimako-Mboscorro, SE Cameroon.
Geochemistry, Exploration, Environment, Analysis 6, 295-309.
Thomas, T.T., Madjadoumbaye. J., caractérisation et
évaluation des dégradations sur routes en terre dans une
perspective d'aide à la décision : Application au Cameroun.
J. decision Systems 17 : 225-243.
Tonje, J. C., 2007. Contribution à l'étude des
dépôts alluvionnaires riches en rutile dela rivière Teba,
secteur de Matomb (Plateau Sud-Camerounais), Thèse Doct. Ph. D., Univ.
Ydé I. 84p.
Tonje, J. C., Ndjigui P.-D., Nyeck, B., Bilong, P., 2014.
Geochemical features of the Matomb alluvial rutile from the Neoproterozoic
Pan-African belt, Southern Cameroon (in press). Chemie der Erde,
Geochemistry. 74, 557-570.
69
Toteu, S.F., Penaye, J., Poudjom D. Y. H., 2004. Geodynamic
evolution of the Pan-African belt in Central Africa with special reference to
Cameroon. C. J. Earth Sci 41 : 73-85.
Trompette, R. (1994): Geology of western Gondwana (2000-500
Ma). Pan-African- Braziliano aggregation of South America and Africa. A.A.
Balkema, Rotterdam, the Netherlands, 350p.
Tsanga, D. A., 2020. Pétrographie et géochimie des
sédiments littoraux de la localité de Campo, Sud-Ouest Cameroun.
Mém. Maît., Univ. Ydé. 83p.
Wentworth, C. K. (1922). A scale of grade and class terms for
clastic sediments. J. Geology. 30 : 377-392.
WWW. Wetherbase.com
Yonta-Ngouné, C., 2010. Le contexte géologique
des indices de talc de la région de Boumnyebel (chaîne
panafricaine d'Afrique Centrale, Cameroun). Thèse. Doct. Ph. D., Univ.
Ydé I: 221 p +annexes.
I
ANNEXE

A)
B)
C)
D)
Annexe 1 : travaux de terrain. a)
récupération des fonds de batée ; b) réalisation de
puits ; c) bloc de gneiss montrant la veine de quartz contenant le rutile ; d)
prélèvement des échantillons d'alluvions.
|
|



