|
Fribourg - mars 2022
Haute école de travail social Fribourg
HETS-FR
Rte des Arsenaux 16a 1700 Fribourg
Adolescence, amour et violence
Prévenir la violence dans les relations amoureuses chez
les adolescent-e-s.
TRAVAIL DE BACHELOR
Présenté par
Cindy Chevalier & Zoé Niggeler
En vue de l'obtention du Bachelor of Arts HES-SO en
Travail
social
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Remerciements
Nous tenons à remercier notre directrice de travail de
Bachelor, Marie-Lou Janin, pour son écoute, sa précieuse aide et
ses nombreux conseils. Nous tenons particulièrement à la
remercier pour la confiance qu'elle nous a donnée et l'empathie dont
elle fait preuve.
Nous remercions également notre lectrice externe,
Laurence Wicht pour son investissement et son implication tant dans la lecture
que l'évaluation de ce travail de Bachelor.
Un grand merci à nos différentes relectrices
Fabienne D.- Fiona G.- Christine N.- Amélie V. - Sylvie G. - Pierre M.
et Olivier M. pour leur regard critique et leurs conseils toujours
appréciables tant sur la forme que sur le fond de notre travail.
Un grand merci à nos collègues que nous
côtoyons régulièrement et qui sont toujours d'une
écoute réconfortante entre deux portes ou autour d'un
café.
Nos derniers remerciements s'adressent à nos familles
respectives, plus particulièrement à Sheryl, Lyam, Erin, Olivia,
Lilou, Charlotte et Arthur qui n'ont pas eu leur maman aussi souvent
qu'ils-elles le souhaitaient. Un grand merci à nos conjoints respectifs,
Frédéric et Thibault, qui ont toujours su trouver les mots de
réconfort et prendre le relai aux moments importants de notre
processus.
Nous dédions ce travail de Bachelor à la
mémoire de Lison Jud-Maréchal.
P a g e 1 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Table des matières
Introduction 4
1. Problématique 5
1.1. L'adolescence 5
1.1.2. Relations interpersonnelles chez les adolescent-e-s 6
1.2. Qu'est-ce que la violence ? 7
1.2.1. Définitions de la violence 7
1.2.2. Violence juvénile 7
1.2.3. Violence domestique - violence conjugale 8
1.3. La violence dans les relations amoureuses (VRA) chez les
adolescent-e-s 10
1.3.1. Définition de la VRA 10
1.4. Cadre légal et aspects juridiques 11
1.4.1. La violence domestique 11
1.4.2. La violence juvénile 12
1.5. Causes et facteurs de risques de la VRA 13
1.6. Quelles conséquences de la VRA sur les
adolescent-e-s et sur leur avenir ? 14
1.7. État de la situation 14
1.8. Traumatisme et résilience 15
1.8.1. Le traumatisme 15
1.8.2. La résilience 16
1.9. Lien avec le travail social 16
2. Question de recherche 17
2.1. Les finalités de recherche 18
3. Méthodologie 20
4. Corpus de textes : choix et motivations 21
4.1. Texte 1 21
4.2. Texte 2 22
4.3. Texte 3 23
4.4. Texte 4 25
4.5. Texte 5 26
5. Analyse des contenus sélectionnés 27
5.1. Violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s 27
5.2. Analyse bio-psycho-sociale de la VRA 30
5.3. La VRA, un problème qui manque de visibilité
33
5.4. Les champs d'intervention de la VRA : prévention et
prise en charge 34
6. Synthèse des résultats 37
P a g e 2 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
7. Discussion 39
7.1. Quel rôle pour les professionnel-le-s du
social face à la violence dans les relations amoureuses
chez les adolescent-e-s 39
7.2. Comment comprendre et interpréter les
facteurs bio-psycho-sociaux de la VRA en tant que
professionnel-le-s du social ? 41
7.3. Comment peut-on pallier le manque de visibilité de
la VRA ? 43
7.4. La prévention de la VRA et le travail social 44
Conclusion 48
Références bibliographiques 50
Annexes 55
Annexe 1 : Grille d'extraction 55
Annexe 2 : Fiche pratique - les formes de violence 58
Annexe 3 : Fiche pratique - relation saine vs relation toxique
59
Annexe 4 : Fiche pratique - les signes de la violence 60
Annexe 5 : La jalousie ce que les adolescent-e-s en disent
61
Nous avons choisi de rédiger ce travail de Bachelor
avec le langage épicène, car nos recherches nous ont fait prendre
conscience que l'on ne peut pas enfermer les victimes et les auteur-e-s dans un
genre. Cela est une volonté, qui nous l'espérons, participera
à la remise en question des préconstruits normatifs.
P a g e 3 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Introduction
Pour l'année 2020, la Suisse comptait 10 879 auteur-e-s
prévenu-e-s de violences domestiques (toutes infractions confondues),
soit 8098 hommes et 2781 femmes (Office fédéral de la statistique
[OFS], 2021). Ce chiffre, aussi élevé soit-il, reflète la
partie émergée de l'iceberg. En effet, ces statistiques sont
basées sur le nombre d'interventions de la police. Il existe
néanmoins de nombreux actes de violence laissés sous silence qui
ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte. Comment ces adultes en
sont-ils arrivés là ? La violence domestique, plus
précisément la violence au sein des couples, est une
problématique connue et qui a déjà fait l'objet de
plusieurs études. Cette problématique, plus
particulièrement la violence dirigée envers les femmes, se
visibilise d'autant plus depuis la création du mouvement Me too, en
2007.
Lorsque l'on évoque la violence au sein du couple, cela
est majoritairement associé aux adultes, mais rarement aux
adolescent-e-s. Pourtant, les actes de violence ne sont pas liés
à l'âge des protagonistes; les jeunes sont également
touchés par la violence au sein de leur couple.
Dans le cadre d'actions de prévention dans les
écoles et en côtoyant des adolescent-e-s dans le cadre
professionnel, nous avons été à plusieurs reprises
confrontées à des jeunes en difficulté. Des adolescent-e-s
qui subissaient ou exerçaient eux-elles-mêmes de la violence dans
le cadre de leurs relations amoureuses et qui n'arrivaient pas à s'en
sortir ou alors qui ne considéraient pas cela comme de la violence.
L'adolescence est une période charnière dans la
vie, elle permet à chacun-e de se construire, et c'est à ce
moment-là que se posent les jalons de l'adulte en devenir. Il nous a
donc paru important de comprendre les différents enjeux liés
à cette période de la vie.
C'est pourquoi, nous avons décidé d'explorer et
d'investiguer la violence dans les relations amoureuses chez les adolescent-e-s
hétérosexuel-le-s entre 13-18 ans. Nous avons bien conscience que
la violence existe dans les couples homosexuels, mais cela exigerait une
orientation différente de notre travail et devrait faire l'objet d'une
étude distincte.
Pour définir plus précisément notre objet
de recherche, nous avons ciblé et mis en commun les questions qui nous
paraissaient pertinentes:
- Quelles sont les spécificités du
développement d'un-e adolescent-e, en particulier sous l'angle
émotionnel, cognitif et social?
- Comment se développe une relation amoureuse à
l'adolescence?
- Comment définir les différentes formes de
violences dans les relations amoureuses à l'adolescence (VRA) ?
- Quelle place la violence peut-elle avoir au sein des couples
adolescents?
- Comment la violence au sein du couple d'adolescent-e-s est-elle
définie sur le plan juridique?
- Des actions de prévention sont-elles déjà
mises en place au niveau de ce public, si oui,
lesquelles?
Au travers de ce travail de recherche, nous espérons
démontrer la nécessité de s'intéresser à ce
sujet, car il nous semble essentiel que cette problématique encore peu
connue chez nous, suscite plus d'intérêt auprès des
chercheur-se-s et qu'elle devienne un terrain de recherche à part
entière au vu des répercussions que la violence entraîne
sur ceux et celles qui la vivent. Nous observons que certaine-s
professionnel-le-s n'ont même pas connaissance de l'existence de cette
problématique qu'est la violence au sein des relations chez les
adolescent-e-s.
P a g e 4 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Ce travail se présente en trois parties. La
première partie expose des éléments indispensables
à la compréhension de notre thème. Qu'est-ce que
l'adolescence? Pourquoi s'intéresser aux violences spécifiquement
dans cette tranche d'âge ? De quel type de violence parle-t-on ? En peu
de temps, vous avez croisé les termes de violence domestique et
conjugale, qu'est-ce qui les différencie?
Nous nous intéresserons également au cadre
juridique, afin de mieux comprendre quelles lois interviennent dans notre
problématique. Puis, nous proposerons une définition de la VRA
chez les adolescent-e-s. Nous exposerons aussi les facteurs de risques, les
conséquences de cette violence sur le développement des
adolescent-e-s, notamment par les notions de traumatisme et de
résilience. Nous terminerons cette partie sur les liens qu'il y a entre
la VRA chez les adolescent-e-s et le travail social. Quel est la place et le
rôle des professionnel-le-s du social?
La deuxième partie est le coeur théorique de
notre travail. Il s'est construit à partir d'une sélection
d'études, de littérature et de travaux de recherche au niveau
national, mais surtout international puisque ce sujet est encore peu connu en
Suisse. Nous y exposerons notre méthodologie, nos critères de
sélection pour notre corpus de recherches. Nous analyserons nos
différents textes en fonction de nos quatre axes. Tout d'abord, la
violence dans les relations amoureuses chez les adolescent-e-s nous permettra
de comprendre les mécanismes qui sont concernés dans la VRA chez
les jeunes. Puis, selon le modèle d'Engel, nous analyserons les
spécificités biologiques, psychologiques et sociales de la VRA.
Ensuite, nous tenterons de comprendre les raisons liées au manque de
visibilité de la VRA chez les adolescent-e-s. Pour terminer, nous
regarderons ce qui existe au travers des champs d'intervention de la VRA, plus
précisément au niveau préventif et de la prise en
charge.
La troisième partie consistera à discuter nos
principaux résultats, notamment par le prisme du domaine social. Il
s'agira principalement de mettre en lien les violences dans les relations
amoureuses chez les adolescent-e-s et le travail social. Nous mettrons en lien
nos connaissances acquises au niveau théorique sur la base de plusieurs
apports tels que nos lectures, nos cours au sein de la Haute école de
travail social (HETS) à Fribourg ainsi que nos observations au travers
de notre pratique professionnelle.
1. Problématique 1.1. L'adolescence
L'étymologie du mot adolescent vient du latin «
adulescens » qui signifie grandissant (Guerry, 2019).
Papalia & coll. (2010) définissent l'adolescence
comme une « période de transition développementale qui
comporte des changements physiques, cognitifs, affectifs et sociaux et qui se
manifeste sous différentes formes selon les milieux sociaux, culturels
et économiques» (p.256).
D'après Cloutier & Drapeau (2015), «
l'adolescence est la période qui sépare l'enfance de l'âge
adulte. Du point de vue psychologique, cette période fait le passage
entre la dépendance enfantine et l'autonomie adulte» (p.3).
C'est une période très importante dans le
développement de tout être humain, qui se produit principalement
entre 12 et 18 ans, durant laquelle des bouleversements considérables
s'entremêlent (Cloutier & Drapeau, 2015). D'après H. Erikson,
le développement humain se fait en huit stades qui s'étendent de
la naissance à l'âge adulte; le stade cinq, celui de
l'adolescence, est évoqué comme étant la période de
la crise d'identité (cité dans Cloutier & Drapeau, 2015).
Durant cette crise nécessaire à son autonomisation,
l'adolescent-e fait un bilan personnel et se questionne sur son
identité, ses origines. Les questions que chaque individu se pose sont
personnelles, personne ne peut y répondre pour l'autre. Toutefois, un
environnement stable avec des repères clairs rendra ce bilan
P a g e 5 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
plus facile à effectuer, contrairement à
l'absence de famille ou la présence d'importantes difficultés
sociales (Cloutier & Drapeau, 2015).
Selon Rey (1996), l'adolescence est une phase complexe et qui
suscite parfois l'incompréhension; certain-e-s adolescent-e-s sont
stéréotypé-e-s comme violent-e-s et/ou ayant des
comportements déviants tant par le discours populaire, que les
médias.
H. Erikson mentionne que l'autonomie de certain-e-s
adolescent-e-s peut être influencée par la pression des pair-e-s
et des parents. Dans le but d'être accepté-e-s, reconnu-e-s et/ou
valorisé-e-s, certain-e-s adolescent-e-s peuvent se faire subir
certaines épreuves allant à l'encontre de leur propre
volonté et contre leur intérêt personnel (cité dans
Cloutier & Drapeau, 2015). Ceci uniquement pour ne pas se faire rejeter ou
exclure par leur groupe de pair-e-s. Le milieu familial dans lequel
évolue l'adolescent-e joue également un rôle important dans
la manière qu'il-elle aura de se percevoir. Selon les auteur-e-s,
l'adolescent-e évoluant dans une famille où les membres se
respectent, où règnent la chaleur, l'affection, la
sécurité et un sentiment d'appartenance, aura potentiellement une
meilleure estime de lui-elle-même, adoptera une attitude positive face
à l'avenir et aura de meilleures chances de se sentir bien dans sa peau.
À l'opposé, un-e adolescent-e qui vivra de la violence au sein de
sa famille et que les parents ne respecteront pas, aura plus de chances de se
sentir mal dans sa peau, sera moins à l'aise dans ses relations avec ses
pair-e-s et à l'école. H. Erikson précise que les analyses
de leurs études sur le sujet ne leur permettent pas de lier de
manière univoque la façon dont l'adolescent-e se sent dans sa
peau, avec les problèmes personnels qu'il-elle vit et sa consommation de
cigarettes/drogues/alcool (cité dans Cloutier & Drapeau, 2015).
Nonobstant, il apparaît que ces éléments sont
corrélés de manière significative à la
cohésion familiale que l'adolescent-e vit à la maison (Cloutier
& Drapeau, 2015).
Selon Maïdi (2014), l'adolescent-e est fasciné-e
par lui-elle-même et l'image qu'il-elle renvoie est une
préoccupation centrale dans sa vie. Renvoyer une image négative
ou qui ne serait pas à la hauteur de ses attentes, ni à celle de
ses pair-e-s, risquerait de lui nuire, dans sa relation avec ces derniers et
dernières. Pour se construire et se sentir en sécurité,
l'adolescent-e a à la fois besoin de s'identifier aux autres, tout en
souhaitant être celui-celle qui arrive à se démarquer et
à être original-e. Ainsi, l'autre reflète sa propre
identité et rassure l'adolescent-e dans cette période de
changements.
1.1.2. Relations interpersonnelles chez les adolescent-e-s
D'après le cours de S. Guerry, l'adolescence est une
période charnière dans le développement de l'être
humain durant laquelle l'adolescent-e doit exécuter un certain nombre de
tâches. Il s'agit notamment d'accepter son corps d'adulte et d'en prendre
soin, de construire son identité d'adulte, de choisir une profession et
de s'y former. Parmi toutes ces tâches, une des plus importantes est
celle de construire son propre univers social avec ses pair-e-s, et ce tant en
amour, qu'en amitié (communication personnelle, 12 décembre
2019).
Qu'est-ce que l'amour à l'adolescence ? Nous n'avons
pas trouvé de définition qui explique clairement et
scientifiquement ce qu'est l'amour à l'adolescence. Winter (2001)
explique que pendant la période de l'adolescence, les adolescent-e-s
confondent amour et idolâtrie en précisant que c'est une
période de la vie où l'amour n'est pas dans le coeur, mais dans
les yeux, il parle alors « d'idolescence ».
Les interactions avec les pair-e-s sont donc
nécessaires et jouent un rôle primordial dans le
développement des adolescent-e-s. L'amour adolescent n'échappe
pas à cette dynamique. Une étude française menée
auprès de jeunes lycéen-e-s conclut qu'être amoureux-se au
lycée, c'est être
P a g e 6 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
socialement reconnu-e; l'auteur emploie la métaphore de
l'arène comme lieu de l'action, mais aussi de l'observation (Juhem,
1995). Avoir une relation de couple à l'adolescence est une façon
de manifester sa position sociale. Plus un-e adolescent-e sera populaire au
sein de son groupe de pair-es, mieux il-elle sera considéré-e par
ces derniers et dernières. Ceci lui permettra d'avoir plus de chances de
sortir avec un-e partenaire plus enviable. De plus, si son-sa partenaire fait
également partie des personnes les plus valorisées, cela
augmentera sa cote de popularité dans son groupe. Une fois le couple
formé, les adolescent-e-s se montreront publiquement et exhiberont leur
amour à tout le monde, car une relation discrète n'apporterait
aucune supériorité; la relation amoureuse nécessite
d'être débattue par les pair-e-s (Juhem, 1995).
1.2. Qu'est-ce que la violence?
La violence constitue un vaste sujet, elle est multiple et
protéiforme, elle ne tient pas compte des classes sociales. Pour mieux
comprendre la violence, il nous paraît nécessaire de nous attarder
sur les définitions de la violence. Cela a pour objectif principal de
définir les types de violence qui se manifestent dans une relation
amoureuse d'adolescents.
1.2.1. Définitions de la violence
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2002),
définit la violence au sens large, comme étant «
l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menace à l'endroit
des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui
entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des
dommages physiques, des problèmes de développement ou un
décès ».
Le rapport mondial sur la Violence et la Santé (OMS,
2002) de l'Organisation Mondiale de la Santé présente la violence
en trois types:
- La violence auto-infligée (regroupe les comportements
suicidaires et sévices auto-infligés).
- La violence interpersonnelle se divise en deux
catégories:
o La violence familiale à l'égard d'un-e
partenaire intime et/ou membre d'une même famille.
o La violence communautaire qui concerne des personnes qui ne se
connaissent pas. - La violence collective est commise par de grands groupes de
personnes ou par des États, elle peut être économique,
sociale et politique.
Toutes les violences évoquées sont autant
causées que subies, « en effet, qu'il s'agisse de violences
infligées ou de violences subies, la présence de violences
implique toujours la rencontre d'un auteur avec une victime»
(Courtecuisse, 1996, p.15).
1.2.2. Violence juvénile
La prévention Suisse de la Criminalité (2015)
définit la violence juvénile ainsi :
[...] la violence psychique et verbale (par exemple
harcèlement), violence physique et sexuelle (bagarres,
harcèlement sexuel), agressions, voire meurtre ou homicide. Les actes de
violence peuvent viser des personnes, des animaux ou des choses (des actes de
vandalisme par exemple). En général, lorsque l'on parle de
violence juvénile, on ne fait pas de distinction entre les actes commis
par de jeunes adultes (de 18 à 25 ans) ou par des mineurs
(jusqu'à 17 ans). Mais la justice n'intervient pas de la même
manière pour les délits commis par des mineurs. En effet, le
droit pénal des mineurs vise davantage la resocialisation des
délinquants que la punition pour leurs actes.
P a g e 7 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Selon Courtecuisse (1996), il peut arriver qu'auteur-e et
victime soient la même personne, cela serait associé au
comportement suicidaire. Il explique également que la violence se fait
par interaction, cela implique de facto une relation entre victime et
agresseuse ou agresseur; l'auteur s'est intéressé à la
violence chez les jeunes et il fait référence à trois
niveaux:
1. La violence interne est spécifique aux
adolescent-e-s, elle concerne la métamorphose physique que le-la jeune
ne peut que « subir», cela engendre des réactions
pulsionnelles aux intensités variables.
2. La violence intime correspond aux réponses
données par les parents et/ou les adultes proches du-de la jeune. Il
s'agit de guider les adolescent-e-s à comprendre cette violence interne,
en leur offrant un cadre ferme, flexible et cohérent, sans faire preuve
d'une trop grande rigidité. Ce cadre doit être autoritaire et non
violent, si l'adulte devient violent-e, il-elle transgresse une limite et se
discrédite face au-à la jeune.
3. La violence sociale qui débute au sein de la
sphère privée fonctionne comme un système de pression
visant à donner des réponses aux adolescent-e-s afin de se
soumettre, de régresser ou de se révolter.
1.2.3. Violence domestique - violence conjugale
Selon l'article 3, alinéa b de la Convention du Conseil
de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul,
2011) le terme violence domestique « désigne tous les
actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui
surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou
actuel-le-s conjoint-e-s ou partenaires, indépendamment du fait que
l'auteur-e de l'infraction partage ou a partagé le même domicile
que la victime» (p.8). De ce fait, le terme de violence conjugale qui
définit la violence au sein d'un couple rentre dans la catégorie
des violences domestiques.
Dans le cadre de la violence domestique, plus
précisément dans la violence conjugale chez l'adulte, il existe
deux manières d'interagir dans la relation violente. Selon la Fondation
Jeunesse et Famille1 & La Fondation MalleyPrairie
2 (Violence dans le couple : pour un changement de langage,
2010), il existe la violence dite punition (complémentaire), qui est
intime et que l'on cache. L'autre manifestation est la violence dite agression,
symétrique, bidirectionnelle dont les auteur-e-s ont conscience et qui
n'est pas dissimulée.
Selon le bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes [BFEG] (A1, 2020), la violence
conjugale est une forme de violence principalement faite aux femmes. Henrion
démontre que les travaux de recherches sur ce sujet s'intéressent
« massivement aux victimes femmes et très peu aux hommes»
(cité dans Daligand, 2019, p. 16). D'ailleurs, les femmes cumulent un
nombre plus élevé d'incidents de violence que les hommes. De
plus, les violences qu'elles subissent sont plus graves et les
conséquences le sont également (Lessard & coll., 2015).
Chez les adultes, la violence conjugale peut se traduire par
de la violence physique, de la violence sexuelle, de la violence psychologique
et/ou de la violence économique entre partenaires actuel-le-s ou
ancien-ne-s (BFEG, A1, 2020). Si chaque situation est singulière, le
schéma de la violence conjugale
1 La Fondation jeunesse et famille (FJF) s'occupe
d'enfants, d'adolescent-e-s et d'adultes rencontrant des difficultés
sociales. La FJF propose des prestations comme la prise en charge en foyer
d'enfants et d'adolescent-e-s victimes de violence domestique ou alors
l'accompagnement mère-enfant (AEME)
2 Malley Prairie est un centre d'hébergement
d'urgence situé dans le canton de Vaud qui accueille des femmes avec ou
sans enfants.
P a g e 8 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
se manifeste de manière cyclique. La figure 1 illustre
le « cycle de la violence », il s'agit d'exposer les comportements
typiques de chaque phase ainsi que leur durée. Ce cycle s'intensifie
avec les années et/ou lors d'événements particuliers comme
un licenciement, une grossesse, maladie/accident (Daligand, 2019). Ce cycle
n'est pas spécifique à une relation amoureuse chez les
adolescent-e-s, car ils-elles n'ont pas (encore) les préoccupations
professionnelles, financières et familiales qui incombent aux adultes et
qui génèrent des tensions supplémentaires au sein du
couple (Glowacz & Courtain, 2017).
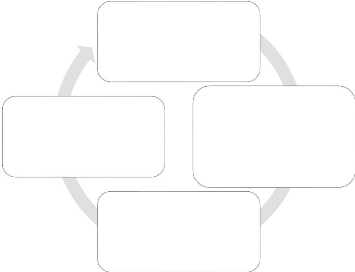
La tension
Cette phase est longue, elle s'étend de plusieurs
semaines à plusieurs mois. C'est la période
désenchantée
qui comprend désillusion, cris,
bousculades, angoisses et peur.
L'explosion de la violence
Cette phase se déroule sur une période
très brève (quelques jours). La violence se manifeste de
manière
très intense par des agressions
directes.
La lune de miel
La durée de cette période est
très
variable. Elle mêle bonheur,
euphorie,
idéalisation et bien-être
de la part des partenaires.
La justification et le pardon
Cette période est de durée variable en fonction
des conjoint-e-s. Il s'agit d'évoquer des excuses de causalité
externe (travail, enfants, ...) et des
promesses de changement. Une
phase emplie de culpabilité et de
pardon.
Figure 1 : Cycle de la violence, adapté de Daligand,
2019.
Les ministres fédéraux et communautaires de
Belgique (2006) définissent la violence conjugale comme suit:
Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de
comportements, d'actes, d'attitudes, de l'un des partenaires ou ex-partenaires
qui visent à contrôler et à dominer l'autre. Elles
comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques,
sexuelles, économiques, répétées ou amenées
à se répéter, portant atteinte à
l'intégrité de l'autre et même à son
intégration socioprofessionnelle. Ces violences affectent aussi
l'entourage de la victime et de l'agresseur, notamment les autres membres de la
famille, dont les enfants (cités dans Amnesty International, s.d.,
s.i.).
Le bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes (BFEG, 6A, 2020) explique que la violence domestique ne
concerne pas que le couple. Cependant, la violence dans le couple est
communément appelée: la violence conjugale. C'est-à-dire
que cette dernière est intégrée à la violence
domestique. Ce constat est appuyé par la Convention d'Istanbul (2011)
qui désigne la violence domestique « comme tous les actes de
violence » (s.i.).
La violence domestique englobe donc la maltraitance
infligée aux enfants, lorsqu'elle est subie au sein de leur famille. Il
peut s'agir d'actes de violences exercées sur les enfants, mais
également une
P a g e 9 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
exposition des enfants à de la violence entre adultes
(par exemple dans les situations de violence conjugale). Selon Cheseaux &
coll. (2013), elle peut entraîner des conséquences potentiellement
graves qui peuvent entraver le développement de l'enfant et de
l'adolescent. De plus, selon certain-es auteur-e-s, la violence subie par
l'enfant constitue un facteur de risque pouvant mener à adopter
soi-même des comportements violents, commettre des délits,
à présenter des comportements dangereux, tels que la consommation
excessive d'alcool et/ou de drogues avec, dans les cas les plus graves, le
risque de faire une tentative de suicide.
À ce stade, si nous reprenons les trois types de
violences décrites au chapitre 1.2.1, nous constatons que la VRA
intègre la violence domestique, car elle concerne des partenaires, mais
qu'elle ne s'apparente pas à de la violence conjugale. En effet, les
adolescent-e-s ne sont pas encore soumis aux enjeux économiques qui sont
généralement liés à une charge de famille.
Toutefois, il est important d'avoir conscience que les enfants et jeunes ayant
connu de la violence conjugale sont vulnérables et risquent de
reproduire cette violence à l'égard de leurs pair-e-s (Cheseaux
& coll., 2013).
Le bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes (4B, 2020) définit la VRA chez les adolescente-s
comme étant une forme de violence juvénile de même qu'un
type de violence domestique visée par la Convention d'Istanbul (2011).
La VRA chez les jeunes entre également dans la violence juvénile
puisqu'elle concerne les mineur-e-s au niveau légal, mais aussi au
niveau développemental comme la violence intime, interne et sociale qui
est liée au développement des adolescent-e-s.
1.3. La violence dans les relations amoureuses (VRA)
chez les adolescent-e-s
À ce stade, nous pouvons dire que la violence dans les
relations amoureuses chez les adolescent-e-s englobe de nombreuses composantes
et ne se présente pas sous une forme univoque. Juhem (1995) constate que
les premières relations sont généralement brèves et
n'incluent pas systématiquement des relations sexuelles; nonobstant, les
adolescent-e-s plus âgé-e-s (16 ans et plus) seront mal
perçue-s si leurs relations amoureuses sont courtes, car cela serait
considéré comme une instabilité par leurs pair-e-s.
Selon Vagi & coll. (2013), les jeunes peuvent être
confronté-e-s à la VRA entre 10-24 ans, car les
expériences des relations amoureuses font partie intégrante de
l'apprentissage et qu'il s'agit d'un processus normal du développement
(cités dans Glowacz & Courtain, 2017).
1.3.1. Définition de la VRA
Malgré les multiples recherches effectuées dans
les différents textes législatifs, nous n'avons pas pu trouver
une définition spécifique de la violence au sein des couples chez
les adolescent-e-s, en Suisse. Toutefois, au vu de ce qui est mentionné
ci-dessus, nous proposons de classer la violence au sein des couples
d'adolescent-e-s dans la violence interpersonnelle tout en ayant conscience
qu'il y ait une possibilité, selon les situations, que les
catégories puissent s'entremêler.
La définition du Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes citée au point 1.2.3 du
présent écrit nous semble lacunaire pour expliquer ce qu'est la
violence au sein du couple chez les adolescents-e-s. Afin de compléter
cette définition et de mieux cerner cette problématique, nous
avons décidé de construire une définition en reprenant
plusieurs éléments.
· L'Organisation Mondiale de la Santé
définit la violence au sens large, comme étant «
l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à
l'endroit des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une
communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner
P a g e 10 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
un traumatisme, des dommages psychologiques, des
problèmes de développement ou un décès'> (OMS,
Violence, 2021,).
· Le Rapport mondial sur la violence et la santé
définit la violence exercée par des partenaires intimes comme
suit: « tout comportement au sein d'une relation intime qui cause un
préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles, aux
personnes qui sont «impliquées dans» cette relation, y compris
des actes d'agression physiques, psychologiques, de la coercition sexuelle, de
la violence psychologique et des comportements autoritaires et tyranniques'>
(Heise & Garcia-Moreno, 2002, p.99).
· Le Rapport québécois sur la violence et
la santé définit la violence au sein des relations amoureuses
(VRA) des jeunes comme « tout comportement ayant pour effet de nuire au
développement de l'autre [c'est-à-dire] le partenaire en
compromettant son intégrité physique, psychologique et
sexuelle'> (cité dans Hébert & coll., 2014, p.99).
En nous basant sur ces trois définitions, nous pouvons
résumer que la violence dans les relations amoureuses (VRA) chez les
adolescent-e-s peut prendre plusieurs formes - physique, psychologique et
sexuelle, être d'intensité variable, intentionnelle ou non. La
violence peut avoir lieu pendant la relation ou post-relation (rupture).
De plus, nous soulignons que la VRA chez les adolescent-e-s
n'est pas spécifique à un genre, les filles aussi bien que les
garçons peuvent se retrouver tant en position de victimes que celle
d'auteurs-es. Comme nous allons vous le présenter tout au long de ce
travail, la violence au sein du couple chez les adolescent-e-s se
présente principalement sous une forme symétrique et
bidirectionnelle (Glowacz & Courtain, 2017). En d'autres termes, cela
signifie que la violence est perpétrée dans le couple avec la
même intensité, tant par l'un que par l'autre.
1.4. Cadre légal et aspects juridiques
En partant de cette définition et comme expliqué
au chapitre 1.3.3, la violence au sein des relations amoureuses chez les
adolescent-e-s ne correspond pas à un seul aspect juridique. Cette
thématique est transversale. Pour protéger les mineur-e-s dans le
cadre de leurs relations amoureuses, cela nécessite de présenter
un peu plus en détail les textes législatifs.
Il faut souligner que le cadre législatif
présenté ci-dessous concerne des personnes majeures et vivant une
situation de couple; les enfants mineur-e-s n'y sont pas soumis-e-s.
1.4.1. La violence domestique
Afin d'avoir une définition claire de la base
légale suisse, nous reprenons celle de la Conférence Suisse
contre la Violence Domestique (CSVD, 2018), qui la décrit comme ceci:
La violence domestique a de nombreux visages et elle influence
différentes sphères de la vie. La lutte contre ce fléau
exige des moyens d'intervention juridiques à plusieurs niveaux. C'est
pourquoi les dispositions relatives à la violence domestique se trouvent
dans plusieurs lois fédérales dont : Le Code pénal (CP, RS
311.0), le Code civil (CC, RS 201) et la Loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5).
Sur le plan pénal, certaines infractions sont
poursuivies sur plainte comme la diffamation (art. 173 CP), les injures (art.
177 CP) et d'autres le sont d'office comme les menaces (art. 180 CP), la
séquestration
P a g e 11 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
(art. 183 CP), les lésions corporelles simples et
graves3 (art. 123 et 122 CP), le viol (art. 190 CP). Cependant, dans
le cadre des violences domestiques, en cas de récidive, les infractions
poursuivies sur plainte le seront d'office comme les voies de fait (art. 126 du
CP), c'est-à-dire les comportements intentionnels et/ou agressifs
n'engendrant pas ou peu de lésions corporelles. Pour les infractions
poursuivies d'office, elles ne le seront plus après une année de
divorce, séparation, dissolution du partenariat. Toutefois, un rapport
sera fait au ministère public, par la police, lui laissant ainsi le
choix de statuer.
1.4.2. La violence juvénile
Sur le plan international, la Suisse fait partie des
états signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Celle-ci prévoit, à l'article 2, que:
Les États partis prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille (RS 0.107).
En Suisse, la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineur-e-s est le droit pénal des mineur-e-s
(DPMin).
Cette loi s'applique à toute personne ayant commis un
acte punissable entre 10 et 18 ans. La priorité des autorités est
de réinsérer les jeunes délinquant-e-s plutôt que de
les sanctionner. Une attention particulière sera donnée sur le
lieu et les conditions de vie de l'enfant, ainsi que la protection et
l'éducation du-de la mineur-e afin de comprendre les raisons qui l'ont
conduit-e à commettre des actes punissables (DPMin).
De plus, le Code civil suisse (CC) contient dans son chapitre
III relatif à l'autorité parentale, plusieurs articles qui
prévoient la protection du-de la mineur-e. Par exemple, l'article 307 CC
mentionne, que si le développement de l'enfant est en danger ou
menacé, l'autorité de protection peut prendre les mesures
nécessaires pour protéger celui-ci ou celle-ci. Des instructions
relatives aux soins, à la formation et à l'éducation de
l'enfant, ainsi qu'un droit de regard par un office qualifié peuvent
être exigés de la part de l'autorité de protection.
Le droit pénal des mineur-e-s ainsi que le Code
pénal suisse ne peuvent pas se cumuler pour permettre une base
législative afin de traiter la VRA chez les adolescent-e-s. Dans cette
perspective, il nous est apparu intéressant d'explorer le cadre
législatif qui régit les mineur-e-s, avec un focus particulier
sur la pornographie et la pédopornographie.
En Suisse, la très grande majorité des
adolescent-e-s (99 %) entre 12-19 ans possèdent un
téléphone portable et près de 85 % des enfants entre 6-13
ans surfent sur l'internet de manière occasionnelle (Prévention
de l'enfance suisse, s.d.). Cela implique une facilité d'accès
à du contenu pornographique. La Confédération
dénombre 605 mineur-e-s condamné-e-s, en 2019, pour violation de
l'art. 197 du Code pénal. Cet article est lié à la
diffusion, production et distribution de contenu pornographique par
3 Le Code pénal précise que les
lésions corporelles sont infligées de manière
intentionnelle dans les deux cas; tuméfactions, gros hématomes,
lésions cutanées profondes ou importantes et lésions
orthopédiques sont considérées comme des lésions
simples. Les lésions graves concernent les mutilations du corps et/ou
mettant en danger immédiat la vie.
P a g e 12 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
des mineur-e-s de moins de 16 ans. Le cadre législatif
suisse distingue la responsabilité pénale en deux
catégories; les enfants de moins de 16 ans et ceux qui sont plus
âgés:
N'est ainsi pas punissable le mineur âgé de 16
ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un
autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des
représentations à caractère pornographique (art. 197, al.
8, CP). En revanche, les enfants de moins de 16 ans qui se filment lors d'actes
sexuels produisent du matériel pédopornographique interdit et
sont donc passibles de poursuites (Prévention de l'enfance suisse, s.
d., p.6).
Dans le cadre de notre travail, il est nécessaire
d'évoquer la facilité d'accès à la pornographie,
car des enfants peuvent en visionner et/ou considérer le contenu comme
le reflet de la réalité. Or la pornographie doit se dissocier
d'une relation amoureuse (Junguenet, 2012).
A contrario, comme l'évoque l'art 197, les
adolescent-e-s peuvent de leur volonté créer du contenu
pornographique (sextape, sexto, etc.) sans pour autant faire preuve de
violence. La gestion du contenu est un paramètre complexe, car le faire
visionner à une tierce personne sera considéré comme de la
diffusion. Dans les relations amoureuses des adolescent-e-s, il est probable
que certain-e-s n'en considèrent pas les conséquences surtout si
les jeunes n'intègrent pas la même catégorie d'âge,
par exemple avec un-e partenaire de moins de 16 ans.
1.5. Causes et facteurs de risques de la VRA
Selon Bernèche (2014), le milieu
socio-économique et l'environnement dans lequel évolue le-la
jeune, sont des facteurs sur sa capacité à subir ou à
infliger de la violence dans ses futures relations amoureuses.
Ce constat ressort également dans les études
réalisées dans les cantons de Vaud (Lucia & coll. 2015) et de
Neuchâtel (Lucia & coll. 2018). Les facteurs de risques suivants
peuvent être corrélés avec le fait de devenir auteur de VRA
chez les adolescent-e-s: avoir déjà commis des délits
contre le patrimoine, des délits violents, fugue du domicile, avoir
vécu plusieurs événements de vie négatifs, avoir
subi de la violence parentale pendant l'enfance, bénéficier d'un
faible soutien parental, l'absentéisme scolaire et vivre des conflits
parentaux. Il semblerait que les élèves issu-e-s des classes de
section de maturité soient moins sujet-te-s à avoir recours
à la VRA que les élèves issu-e-s des classes section
préprofessionnelle.
Selon Magdol & coll. (1998), O'Donnell & al. (2006),
Brendgen & al. (2001), Capaldi & Clark (1998), Simons & coll.
(1998), Lavoie & coll. (2002), parmi les nombreux facteurs de risques de
devenir auteur-e de VRA, le plus significatif est le fait d'être ou
d'avoir été soi-même victime de comportements violents ou
abusifs au sein d'une précédente relation de couple tant pour les
filles que pour les garçons. Avoir déjà commis des
délits violents, avoir commis des délits contre le patrimoine et
posséder une faible maîtrise de soi sont également des
prédispositions à devenir auteur-e de violence, tant pour les
filles que pour les garçons (cités dans Hébert &
coll., 2018).
Au sein des couples d'adolescent-e-s, la VRA peut être
reconnue comme une preuve d'amour, notamment chez les enfants ayant grandi au
sein d'un contexte violent (Peppler, 2012, cité dans Lafrenaye-Dugas
& coll., 2021).
La peur de vivre une rupture et la douleur qu'elle
entraîne peuvent aussi être un facteur qui amène à
tolérer et accepter la VRA au sein d'une relation. Même si les
garçons reconnaissent que leur partenaire présente des
comportements violents, ils peinent à se reconnaître dans le
rôle de
P a g e 13 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
« victime» et à chercher de l'aide, ceci peut
en partie être expliqué par l'adhésion aux normes et aux
stéréotypes de genre dictés par la société
(Lafrenaye-Dugas & coll., 2021).
1.6. Quelles conséquences de la VRA sur les
adolescent-e-s et sur leur avenir?
Les relations entre pair-e-s, qu'elles soient amicales, de
flirt ou amoureuses, ont un impact direct sur le développement, ainsi
que sur la manière d'aborder les futures rencontres et relations
à l'âge adulte (Seidah & coll., 2004). Les premières
relations amoureuses entretenues lors de l'adolescence et de la vie de jeune
adulte sont un élément majeur dans la manière de se
construire en tant que personne. Ces relations, si elles sont malsaines,
peuvent avoir de lourdes conséquences, tant au niveau physique que
psychique (anxiété, manque de confiance en soi, angoisses,
déficit des compétences sociales) sur une personne qui subit de
la violence (Cloutier & Drapeau, 2015). L'adolescence est une
période de grands changements, l'enfant change et expérimente.
Il-elle se détache de ses parents pour évoluer avec ses pair-e-s.
Une période où les premières expériences amoureuses
se dessinent et participent à l'apprentissage de la vie amoureuse. Ces
explorations sont nécessaires, elles seront passionnées pour
certain-e-s, teintées d'émotions positives et/ou
négatives, et plus soutenues que dans leur relation familiale ou
amicale. Collins (2003) affirme que les adolescent-e-s amoureux et amoureuses
ont tendance à moins bien gérer leurs émotions que les
adolescent-e-s ne vivant pas de relations amoureuses (cité dans Glowacz
& Courtain, 2017).
Selon le BEFG (4B, 2020), les adolescents qui ont vécu
de la violence dans leur-s relation-s amoureuses risquent de consommer
davantage d'alcool, de tabac ou de drogues et prennent souvent plus de risques
dans les relations sexuelles qu'ils-elles entretiennent (p. ex. relations
sexuelles non protégées ou sous emprise de produits). Toutefois,
le fait de vivre une expérience de victimisation, dans le cadre de la
VRA, peut avoir pour conséquences une perte de confiance en soi et la
peur de revivre une mauvaise expérience, ce qui constitue un frein pour
expérimenter de nouvelles relations amoureuses. Des études
démontrent que les jeunes qui ont vécu de la violence domestique
dans leur enfance ont par la suite un risque plus élevé
d'être victimes pour les filles et auteurs pour les garçons, de
violence domestique à l'âge adulte.
1.7. État de la situation
Au niveau international, Wincetak & coll. (2016) ont
effectué une méta-analyse de plus de 100 études
menées auprès des jeunes de différents pays, il ressort de
cela que le nombre de victimes et d'auteur-e-s (c'est-à-dire la
prévalence) diffère considérablement. Cependant, en
moyenne, la violence physique est subie par 20 % des adolescent-e-s et 9 %
d'entre elles-eux subissent des violences sexuelles (cités dans
Hébert & coll., 2018).
Outre-Atlantique, ce phénomène suscite un
intérêt plus développé tant au niveau de la
recherche scientifique qu'au niveau de la prévention. On trouve les
premiers écrits scientifiques aux États-Unis en 1980 et
l'intérêt s'est fait ressentir à la suite de la
création de la Semaine nationale de Sensibilisation et de
Prévention de la VRA chez les adolescent-e-s en 2006 (Hébert
& coll., 2018). Le Québec a institutionnalisé le premier
programme de prévention de la violence dans les relations amoureuses
chez les jeunes, destiné directement au public visé
(Hébert & coll., 2018).
En Suisse, la VRA chez les adolescent-e-s est une
thématique encore peu explorée et nous manquons de données
spécifiques sur le sujet. Toutefois, deux enquêtes
populationnelles menées dans les cantons de Vaud (Lucia & coll.
2015) et de Neuchâtel (Lucia & coll. 2018) montrent que 20,3 % des
jeunes sont victimes de violences physiques (Lucia & coll., 2018) et que
seulement 14,3 % des jeunes
P a g e 14 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
ont déjà dénoncé des violences
physiques auprès des autorités (Lucia & coll., 2015).
Concernant la violence sexuelle, elle représente un chiffre de 9 %
(résultat incluant filles et garçons), mais elle est
majoritairement subie par des adolescentes. Les chiffres sont stables entre
2015-2018 et la cyberviolence est la forme de violence la moins courante au
sein des VRA chez les adolescent-e-s. Ceci démontre que la violence au
sein des couples adolescents se divise en plusieurs catégories, la
violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique, le
monitoring4 et la cyberviolence. Il ressort également de cela
que les filles sont tout aussi victimes que les garçons et que le taux
de filles auteures est légèrement supérieur à celui
des garçons. Il est intéressant de relever que les adolescent-e-s
ont, de manière générale, tendance à banaliser
et/ou à excuser les comportements violents au sein de leur propre
couple. Selon leur lecture de la situation, les actes violents correspondent
plus à une dynamique de couple qu'ils-elles estiment normale.
L'impact et les répercussions sur les personnes ayant
subi de la violence au sein de leurs relations amoureuses à
l'adolescence sont souvent sous-estimés, car les jeunes ne se confient
pas ou peu à des adultes (Lucia & coll., 2015 ; Lucia & coll.,
2018). C'est une des raisons qui expliquent en partie pourquoi la VRA chez les
adolescent-e-s est très souvent ignorée aussi bien par les
professionnel-le-s que par les particuliers.
1.8. Traumatisme et résilience
Le traumatisme et la résilience sont deux notions qui
nous semblent pertinentes à aborder dans ce travail, car toutes deux ont
un impact sur le développement des individus. Comme nous le verrons, ces
deux concepts sont directement rattachés à la notion
d'attachement, qui joue également un rôle central dans le
développement psychocognitif des individus.
1.8.1. Le traumatisme
« Traumatismos signifiant action de se blesser et trauma
signifiant blessure constituent les racines grecques du mot traumatisme. Selon
Crocq (2014), le traumatisme psychique ou trauma est un phénomène
d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par
les excitations violentes afférentes à la survenue d'un
événement agressant ou menaçant pour la vie ou
l'intégrité physique et/ou psychique d'un individu, qui est
exposé comme victime, témoin ou acteur» (cité dans
Tilmant, 2019, p.15).
Les événements traumatiques chez l'enfant ne
débouchent pas systématiquement sur du stress post-traumatique.
Cependant, les violences commises intentionnellement envers les enfants sont
plus traumatisantes pour ceux-celles-ci, spécialement si l'auteur-e de
ces violences est un proche de l'enfant (Baudet & Rezzoug, 2018). Le
traumatisme psychique se manifeste à la suite d'événements
comme des violences physiques ou sexuelles, ou de vécu d'abandon que
l'enfant n'a pas pu verbaliser de façon adéquate à un-e
adulte (Roman, 2016). Selon le même psychanalyste, il s'agit d'un
processus qui se déroule en deux temps, le premier aux moments où
les violences sont vécues et relayées dans l'inconscient de
l'enfant et dans un deuxième temps, elles ressurgissent à
l'adolescence:
L'agir violent à l'adolescence remobilise des traces
traumatiques, non liées, non élaborées, non
représentées... restées en souffrance dans la vie
psychique et qui sont
4 Comportement du-de la partenaire visant à
surveiller, contrôler voire restreindre les contacts avec d'autres
personnes (amis, famille, etc.).
P a g e 15 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
appelées à prendre sens, dans la mise en jeu,
suffisamment consistante, de la figure du répondant (Roman, 2016,
p.28)
Pour résumer, un-e enfant témoin de violence ne
sera pas nécessairement « traumatisé-e » sur le court
terme, mais assimilera de manière inconsciente ces
événements qui ressurgiront à l'adolescence.
D'après le cours sur les adolescent-e-s de S. Guerry, il y a un risque
que ce traumatisme interfère sur l'image qu'il aura de lui. Il se peut
même que cela ait un impact sur le champ des possibles que l'adolescent-e
espère ou imagine pour lui-elle. Un-e adolescent-e qui aura une mauvaise
estime de soi risque notamment d'avoir des problèmes dans les relations
avec ses pair-e-s (communication personnelle 12 décembre 2019).
1.8.2. La résilience
La notion de résilience selon Manciaux & coll.
(2001) est « la capacité d'une personne ou d'un groupe à
bien se développer, à continuer à se projeter dans
l'avenir en dépit d'événements déstabilisants, de
conditions de vie difficiles, de traumatismes sévères»
(cités dans Théroêt, 2005, p.17).
Malgré une trajectoire de vie entachée par de la
violence, un-e adolescent-e peut tout à fait réussir à
devenir un-e adulte épanoui-e. Comme le décrit Cyrulnik (2019),
le traumatisme, quel qu'il soit, n'est pas déterminant pour le devenir
de la personne qui le subit. Il explique qu'il n'y a pas de barème du
traumatisme et que ce qui peut atteindre profondément une personne ne
touchera pas une autre de la même manière et inversement. Cyrulnik
se base sur la théorie de l'attachement pour expliquer comment une
personne peut devenir résiliente.
La théorie de l'attachement proposée par Bowlby
(1973) affirme « que les enfants et les adultes sont biologiquement
prédisposés à former des attachements [qui ont] de vastes
répercussions sur le reste de l'existence» (cité dans Gerrig
& Zimbardo, 2008, p.283). Ces attaches agissent aussi bien comme facteurs
de risque, mais également comme facteurs de protection.
La qualité de l'attachement participe grandement
à développer la résilience. Si l'enfant a reçu un
attachement sécurisé, avec une stabilité affective de la
part de ses parents ou d'une figure d'attachement à laquelle
s'identifier, lorsque le traumatisme arrivera, il-elle sera mieux
préparé-e à faire face à la situation, pourra mieux
appréhender ce qu'il-elle vit, en comparaison avec un-e enfant ayant
reçu un attachement moins sécurisé.
Loin de tout déterminisme, Cyrulnik (2019) explique
qu'un-e enfant qui aura connu un attachement « peu sécure »
pourra aussi être résilient-e, mais que cela prendra plus de
temps. Un autre facteur pour la résilience est la qualité de
l'entourage (familial, amical, professionnel, social) au moment du traumatisme.
Il explique l'importance de laisser des espaces de paroles et de partage pour
les personnes ayant subi un traumatisme, car cela contribue à
réduire le syndrome psychotraumatique. Selon lui, les ressources
externes, mises en place après le traumatisme, sont tout aussi
bénéfiques que les ressources internes acquises avant le
traumatisme; elles permettent aux victimes de reprendre une vie humaine
après un traumatisme qui, dans certains cas, peut même devenir une
force, voire une vocation dans leur existence.
1.9. Lien avec le travail social
Les violences dans les relations amoureuses concernent-elles le
travail social ?
Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales ont une
responsabilité face à la société comme le mentionne
le code de déontologie du travail social en Suisse « les
professionnel-le-s [...] font connaître au public, aux chercheuses et
chercheurs et aux politiques leur connaissance des problèmes sociaux,
P a g e 16 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
de leurs causes et des effets possibles aux niveaux
individuels et structurels, et contribuent ainsi à rendre leurs
expertises utiles» (Avenir social, 2010, p.13).
Comme nous venons de le voir dans le cadre législatif,
la Suisse a le devoir de protéger les mineur-e-s de la violence tant
physique, psychologique que sexuelle. Toutefois, il n'y a pas une loi
spécifique concernant cette problématique et la diversité
des textes législatifs complexifie l'intervention des
professionnel-le-s, tous domaines confondus.
Il a été constaté que les relations
amoureuses sont principalement discutées et analysées entre
paire-s. Cela ne laisse que peu de place à des intervenant-e-s
sociaux-ales et de manière plus générale aux adultes.
Pourtant, les professionnel-le-s du travail social sont amené-e-s
à fréquenter des adolescente-s dans de nombreux lieux dans
lesquels ils-elles interagissent: écoles - foyers - centres
aérés - domicile - travail hors murs - centre de
prévention - hôpitaux, etc. Nous supposons que la proximité
entre professionnel-le-s et adolescent-e-s n'est visiblement pas suffisante
pour que les jeunes puissent évoquer des sujets intimes et personnels.
La VRA concerne l'intimité et cela rend les discussions et les
interactions plus complexes, surtout en période d'adolescence où
l'expérimentation et l'émancipation sont manifestes (Zimmermann
& coll., 2017).
Cependant, l'un des objectifs et devoirs du travail social est
d'initier et de favoriser des pistes pour résoudre des problèmes
sociaux (Avenir social, 2010).
Les violences dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s manquent de visibilité et suscitent un
intérêt récent de la part de la recherche. Cela implique
une méconnaissance de ce sujet et donc une difficulté pour
intervenir. Comme le dit l'adage: « Rome ne s'est pas construite en un
jour! ». Prenons l'exemple de la violence conjugale qui est une
problématique connue et reconnue. Il existe de nombreux organismes et
institutions actives dans la prise en charge et la prévention, ce qui
n'a pas toujours été le cas (Prévention Suisse de la
criminalité, 2015).
Précédemment, nous exposions les
différences et les similitudes entre violences conjugales et violences
dans les relations amoureuses chez les adolescent-e-s. Force est de constater
que la violence est la base de ces deux thèmes et qu'elle a des
répercussions sur les victimes et sur les auteur-e-s. En effet, un-e
adolescent-e vivant de la VRA risque de développer des troubles
psychosociaux tant dans sa vie présente que future; les comportements
subis ou vécus à l'adolescence peuvent se répercuter
à l'âge adulte (Glowalcz et Courtain, 2017).
Le devoir des professionnel-le-s du domaine social est de
prévenir et de sensibiliser les jeunes sur la thématique des
violences au sein de leurs relations amoureuses et des répercussions de
celle-ci.
Dans notre problématique, le contrôle social se
manifeste par les normes sociales et le cadre légal (Glowacz et
Courtain, 2017). Toutefois, cela n'est pas suffisant pour endiguer cette
violence au sein des relations amoureuses.
2. Question de recherche
Si notre thématique a été rapidement
décidée, la formulation de notre question de recherche s'est
avérée être une tâche plus complexe. Cette
difficulté résidait dans le fait que toute la documentation
répertoriée ne mentionnait jamais un domaine en particulier.
Au moment de la rédaction de notre plan de revue de la
littérature (PDRL), nous proposions un titre et non une question de
recherche:
P a g e 17 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Ø Amour, violence et adolescence: Comment
prévenir la violence au sein des relations amoureuses chez les
adolescent-e-s entre 13 et 18 ans?
Dans un premier temps, nous étions focalisées
sur notre thématique et nous n'avons pas suffisamment
considéré le travail social dans notre question de recherche. De
plus, nous avons émis plusieurs propositions, non satisfaisantes, car
l'emploi du vocabulaire ne correspondait pas au contenu de notre travail.
Ø Comment détecter une relation amoureuse
violente chez les adolescent-e-s entre 13-18 ans? Nous ne proposons pas
d'outils ni de méthodes liées à la détection des
violences amoureuses chez les adolescent-e-s.
Ø Comment se manifeste la violence dans une
relation amoureuse chez les adolescent-e-s entre 13-18 ans?
Le terme manifeste renvoie à des faits observables,
cela implique une présentation trop restrictive de cette
thématique.
Ø Comment peut-on comprendre la violence dans les
relations amoureuses d'adolescent-e-s entre 13-18 ans?
Ø Comment interpréter les relations amoureuses
violentes des adolescent-e-s entre 13-18 ans? La compréhension et
l'interprétation sont des notions vastes. De plus, ces termes ne nous
apparaissent pas adaptés à un travail de recherche dans le
domaine social.
La rédaction de notre problématique nous a
permis de distinguer trois axes dans notre thématique, à savoir
les risques, les impacts et les enjeux présents dans une relation
amoureuse:
Ø Quels sont les risques, les impacts, les enjeux,
d'une relation amoureuse marquée de violence chez les adolescent-e-s
entre 13-18 ans?
Néanmoins, le travail social était toujours
invisible, alors qu'il nous apparaissait fondamental d'en évoquer sa
dimension dans notre question de recherche. Toutefois, nous nous sommes
heurtées aux mêmes difficultés quant au choix du
vocabulaire.
Ø Quelle est la nécessité pour les
travailleurs sociaux et travailleuses sociales (TS) de savoir détecter
les risques, les impacts, les enjeux d'une relation amoureuse marquée de
violences chez les adolescent-e-s entre 13-18 ans?
Ø Quel pouvoir d'agir les travailleurs et travailleuses
sociales (TS) ont-ils-elles sur les risques, les impacts et les enjeux d'une
relation amoureuse marquée de violence chez les adolescent-e-s entre
13-18 ans?
Si la notion de fonction est importante pour les
professionnel-le-s du travail social, nous avions envie de sortir du cadre
prescriptif en allant au-delà de la fonction. C'est pourquoi, nous avons
favorisé le rôle des TS, cela correspond à l'implication
professionnelle et personnelle de celles-ci et de ceux-ci dans cette
thématique :
Quel est le rôle des travailleurs sociaux et
travailleuses sociales face aux risques, impacts et
enjeux d'une relation
amoureuse violente chez les adolescent-e-s entre 13-18 ans?
2.1. Les finalités de recherche
La thématique de la VRA chez les adolescent-e-s est un
sujet de niche et de ce fait, nous souhaitons, par le biais de ce travail,
proposer un regard complémentaire à cette thématique. Sur
la base de cette dernière, nous avons fait émerger quatre axes
principaux:
P a g e 18 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
1. La violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s
Nous avons exposé les multiples formes de violence
auxquelles les jeunes peuvent être confronté-e-s (domestiques,
juvéniles, conjugales...). Parmi ces violences, nous retrouvons les
violences physiques, psychologiques et sexuelles qui interviennent
également dans la violence conjugale, dans les couples d'adultes. En
revanche, les mécanismes ne sont pas similaires. C'est pour cela que
nous souhaitions analyser de quelle manière ces violences surviennent,
comment elles sont interprétées et comprises dans une relation
amoureuse à l'adolescence.
2. Les spécificités bio-psycho-sociales de la
VRA
L'adolescence est une période complexe qui marque le
passage de l'enfance à l'âge adulte. Cette phase peut être
une période de vulnérabilité. Les risques de VRA chez les
adolescent-e-s sont une réalité. Nous avons constaté que
plusieurs facteurs peuvent déclencher des comportements de victimisation
et de perpétration de la violence. Afin d'aller plus en détail,
nous utiliserons le modèle bio-psycho-social proposé par Engel
(Siksou, 2008), afin de relever les facteurs sociaux (famille, contexte
socio-économique, relations personnelles), les facteurs psychologiques
(estime de soi, perceptions, mémoire et émotions), les facteurs
biologiques (réponses physiologiques au stress, prédispositions
génétiques et traumatismes) pouvant influer la VRA à
l'adolescence.
3. Le manque de visibilité de la VRA
La VRA chez les adolescent-e-s ne fait pas la « une
» des journaux ni des magazines scientifiques. Nous l'avons
évoqué, la violence amoureuse chez les adolescent-e-s est plus
étudiée en Amérique du Nord qu'en Suisse. C'est pourquoi,
il nous paraît fondamental de comprendre ce qu'il faut mettre en place
tant pour le domaine de la recherche que pour les professionnel-le-s (du
social, de la santé, etc.) et pour le grand public, pour faire
connaître davantage cette problématique.
4. La prévention de la VRA
Nous allons d'abord exposer les différentes formes de
prévention (universelle, ciblée et spécifique), avant de
présenter les outils, les méthodes et les formations existantes
ou à développer, qui seraient pertinents dans le champ du travail
social.
Nous baserons notre analyse sur ces quatre axes. Pour ce
faire, nous exploiterons une sélection de cinq textes scientifiques.
P a g e 19 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
3. Méthodologie
Dans un premier temps, nous avons décidé de
centrer notre recherche sur des articles, des rapports ou des programmes de
prévention suisse, datés de 2010 et plus. Toutefois, la
littérature autour de ce sujet a été rapidement
explorée. Les programmes de prévention n'étaient pas
spécifiques à notre thématique centrale. Dans un
deuxième temps, nous avons poursuivi nos recherches en
élargissant les supports tels que l'écoute d'émissions
radiophoniques, de podcasts, d'articles de presse. Puis, nous avons
exploité de la littérature provenant d'autres pays, notamment la
Belgique, la France et le Canada, car ces sources qui sont en français
nous ont semblé pertinentes pour construire notre problématique.
Nous avons trouvé une quantité non négligeable de textes
en langue anglaise. Cette littérature s'est imposée à
nous, dans un second laps de temps. Elle présentait l'avantage de
proposer une méthodologie de recherche et des résultats d'ordre
qualitatif, alors que la majorité des études francophones se
basaient sur des données quantitatives, allant d'une centaine
d'individus à plusieurs milliers de jeunes sondé-e-s.
Dans un premier temps, nous avons fait des
résumés de lecture pour chacun des textes
sélectionnés. Ces résumés comprennent tous les
mêmes rubriques, pour que le lecteur puisse se faire une idée
claire de la complémentarité des textes. Puis, nous avons
établi une grille d'extraction (Annexe 1) que nous avons construite avec
nos quatre thèmes liés à nos finalités:
1. Violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s
2. Les spécificités bio-psycho-sociales de la
VRA
3. Manque de visibilité de la VRA
4. Les champs d'intervention : prévention et prise en
charge
Pour une analyse plus détaillée et approfondie,
nous avons subdivisé chaque axe en différents chapitres. Nous
avons utilisé une couleur pour chaque texte de notre corpus et
superposé les informations que nous avons extraites. Nous avons
procédé de cette manière dans le but d'obtenir des
informations les plus précises possibles. Ceci a également permis
de comparer et mettre en lien les données d'un texte à l'autre,
en simplifiant le travail de recherche pour l'analyse des textes. Au terme de
l'extraction, notre grille faisait près de trente-deux pages. Nous avons
ensuite décidé de nous répartir les thèmes pour
procéder à l'analyse des contenus sélectionnés.
P a g e 20 | 62
P a g e 21 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
4. Corpus de textes : choix et motivations
4.1. Texte 1
Glowacz, F., Courtain, A. (2017). Violences au sein des relations
amoureuses des adolescents et jeunes adultes: une réalité
à ne pas négliger. Champ pénal/Penal field, XIV.
Récupéré de http ://
champpenal.revues.org/9582
Problématique
La violence dans les relations amoureuses d'adolescent-e-s
n'est pas similaire à la violence conjugale. Les mécanismes sont
plus symétriques et bidirectionnels, ce qui a pour conséquence
que les adolescent-e-s ne les considèrent pas comme tels et peuvent les
associer à une forme de jeu. Cela implique que les attitudes face aux
violences subies et/ou infligées des jeunes filles et garçons ne
seront pas comprises ni considérées systématiquement comme
pouvant entraîner des conséquences. Les adolescent-e-s
considèrent la VRA comme pouvant être (selon le contexte)
plutôt favorable ou défavorable.
Question de recherche
Il n'y a pas de question de recherche formulée
distinctement.
Objectifs/hypothèses de la recherche
Le principal objectif est de montrer les différences
entre les violences dans une relation d'adolescent-e-s et au sein d'un couple
d'adultes. L'accent est mis sur les mécanismes de violence
(unidirectionnel, bidirectionnel, symétrique), mais aussi d'analyser les
risques de cumuls entre les violences subies et celles infligées.
Concepts, théories et ancrage
Cet article est une analyse faite par deux chercheuses belges
travaillant toutes deux dans le service de psychologie clinique de la
délinquance, des inadaptations sociales et des processus d'insertion
à l'université de Liège. Elles se basent sur les travaux
de Wincentak et coll. (2016) pour montrer la symétrie de la violence
présente dans les relations amoureuses des adolescent-e-s (Glowacz,
& Courtain, 2017).
Design de la recherche
La principale enquête se fait avec des données
quantitatives: des questionnaires ont été distribués
à 179 jeunes dans le cadre scolaire. Le principal outil utilisé
est le CADRI (Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory), il
comporte 50 questions thématisant sur la violence par menaces, la
violence relationnelle, la violence physique, la violence sexuelle et la
violence émotionnelle. L'article expose les différentes formes de
violences présentes dans les relations amoureuses, sous forme de
tableaux avec des taux si violence subie ou infligée.
Principaux résultats
Les résultats de l'étude montrent bien les
mécanismes de polyperpétuation et de polyvictimisation. Ces
mécanismes sont spécifiques aux relations amoureuses des
adolescent-e-s. Nous soulignerons aussi que ce texte a l'avantage d'être
récent et de traiter de données belges, ce qui permet une
comparaison plus fine et proche des données helvètes que nous
possédons.
P a g e 22 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
4.2. Texte 2
Lafrenayse-Dugas, A.-J., Fernet, M., Hébert, M., Blais,
M. & Godbout, N. (2021). Expérience amoureuse la plus difficile :
Qu'en disent les garçons rapportant un vécu de violence physique
dans leurs relations amoureuses? International Journal of Child and
Adolescent Resilience/Revue https ://
doi.org/10.7202/1077721ar
Problématique
Les adolescents sont aussi à risque de vivre de la VRA
et particulièrement physique. Les normes sociales construites
liées au genre masculin ne facilitent pas la demande d'aide de ces
garçons et ceux-ci n'osent pas évoquer qu'ils sont victimes. En
effet, la violence physique infligée par les filles/femmes sur des
garçons/hommes semble être plus tolérée
qu'inversement.
Question de recherche
La question de recherche n'est pas explicitée dans le
texte, mais dans le titre: qu'en disent les garçons rapportant de la
violence physique dans leurs relations amoureuses?
Objectifs/hypothèses de la recherche
L'objectif de cet article est de montrer que les
garçons sont victimes de violences physiques au même titre que les
filles.
Ce dernier point est une source importante, car peu
d'études proposent cela. À ce stade de nos recherches, il s'agit
de la seule chose que nous ayons trouvée. De plus, les auteur-e-s
déclarent que cette étude est innovante tant par la
méthode que par la thématique.
Concepts, théories et ancrage
Cet article est une étude menée par quatre
chercheuses et un chercheur de l'unité de recherche et d'intervention
sur le trauma et le couple au sein de l'Université du Québec
à Montréal (UQAM). Lafrenaye-Dugas est sexologue au sein de
l'université du Québec et de Montréal, elle a notamment
soutenu sa thèse sous la direction d'Hébert, spécialiste
de la VRA chez les adolescent-e-s. Les autres auteur-e-s ayant participé
à la rédaction de l'article sont également
rattachés au département de sexologie de la même
université. La plupart des auteur-e-s ont également pris part
à la rédaction du chapitre 4 du Rapport sur la violence et la
santé (voir Texte 3).
Design de la recherche
Pour mener à bien cette recherche, les auteur-e-s ont
sélectionné les participants de l'enquête Parcours amoureux
des jeunes (PAJ), menée au Québec entre 2011-2014. Une
sélection de 184 adolescents sur 8194 adolescent-e-s de l'enquête
PAJ a été faite, car ils ont révélé avoir
vécu au moins un événement de VRA physique et ont
décrit un épisode considéré comme le plus
éprouvant pour eux. Ces adolescents étaient âgés de
13-19 ans, ils se sont catégorisés comme étant
hétérosexuels.
Les outils de mesure pour cette enquête sont le CADRI et
le SES (Sexual expériences survey) proposant 17 items tant sur les
violences psychologiques que physiques et sexuelles.
Les données sont quantitatives et qualitatives.
Principaux résultats
Cet article est une source pertinente pour notre travail, car
il s'intéresse à la notion de genre. La difficulté des
garçons à s'identifier comme victimes de VRA, ainsi que les
difficultés à demander de l'aide pour ces adolescents sont
démontrées. De plus, les stéréotypes de genre sont
exposés comme étant des obstacles pour ces jeunes hommes.
P a g e 23 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
4.3. Texte 3
Hébert, M., Lapierre, A., Lavoie, F., Fernet, M.,
Blais, M. (2018). La violence dans les relations amoureuses des jeunes. Dans
Laforest, J., Maurice, P. et Bouchard, L M. (dir.), Rapport
québécois sur la violence et la santé (pp. 116-129).
Montréal: Institut national de santé publique du Québec.
Récupéré de https ://
inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380chapitre-4.pdf
Problématique
Le chapitre fait un bilan sur la problématique de la
VRA, plus particulièrement au Québec. Les auteur-e-s constatent
que les principaux travaux sur ce thème sont faits par données
auto rapportées. Cela permet d'obtenir des
données en très grand nombre, mais comprenant un biais, celui de
la normalisation sociale; les participant-e-s répondraient davantage ce
qui est plus accepté par la société que les faits
réels.
Question de recherche
La question de recherche n'a pas lieu d'être puisqu'il
s'agit d'un rapport et non d'une recherche.
Objectifs/hypothèses de la recherche
Le rapport est un état des lieux sur la
problématique de la VRA au Canada avec une ouverture sur les
États-Unis. Il s'agit de faire l'état de la situation, puis
proposer des pistes d'amélioration tant pour la recherche que
l'accompagnement.
Concepts, théories et ancrage
Ce chapitre regroupe de nombreuses informations, elles sont
toutes spécifiques et spécialisées. Il n'est donc pas
facile de prioriser l'extraction des données. Cependant, le chapitre
offre un passage très complet sur la prévention tant universelle
que spécifique. Cela n'est pas le fruit du hasard, car au sein des
auteur-e-s, nous trouvons F. Lavoie, psychologue émérite à
l'université de Laval, considérée comme une
pionnière dans la prévention de la violence. Le sous-chapitre de
la prévention explique clairement comment développer
l'intervention auprès des adolescent-e-s vivant des violences dans leurs
relations amoureuses. C'est pourquoi dans le cadre de notre travail de
Bachelor, nous nous concentrerons sur le sous-chapitre de la prévention
(pp. 116-122).
Design de la recherche
Ce chapitre se base sur deux enquêtes
québécoises: Enquête Québécoise sur la
Santé des Jeunes du Secondaire 2010-2011 [EQSJS] (Hébert, Blais,
Lavoie, cités dans Hébert & coll., 2018) et l'enquête
sur les Parcours Amoureux des Jeunes [PAJ] (Pica & coll., cités dans
Hébert & coll., 2018). Cependant, de nombreuses autres études
et enquêtes sont mentionnées dans ce chapitre, grâce au
travail réalisé par les psychologues, professeur-e-s et
enseignant-e-s qui, pour la majorité, sont rattaché-es au
département de sexologie de l'Université de Québec et de
Montréal [UQAM]. Ils et elles proposent un état de la recherche
de grande qualité, mais ils et elles analysent des méta-analyses
comme celle de Garthe & coll. (cités dans Hébert & coll.,
2018). De ce fait, cela amène une grande diversité et permet le
constat de différents résultats, notamment des enquêtes
avec des données contradictoires. Prenons l'exemple de la consommation
d'alcool des adolescent-e-s. Certains résultats montrent que cela ne
participerait pas à augmenter la violence au sein des relations
amoureuses, alors que d'autres affirment que c'est un facteur à risque.
La richesse des nombreuses références évoquées dans
ce chapitre fait ressortir que les enquêtes sont majoritairement
quantitatives et peu qualitatives; les auteur-e-s soulignent aussi le besoin de
recourir davantage aux études longitudinales.
P a g e 24 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Principaux résultats
Ce chapitre nous a permis de bien comprendre le contexte et
l'histoire de la VRA chez les adolescente-s. Le chapitre est bien construit, il
propose une contextualisation historique de la recherche scientifique sur notre
sujet. Il y est fait mention des types de violences vécues et/ou
engendrées par les jeunes comme la violence physique, sexuelle,
psychologique, ainsi que la cybervictimisation. Toutes les violences sont
définies et exemplifiées.
P a g e 25 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
4.4. Texte 4
Bernèche, F. (2014, mai). La violence dans les relations
amoureuses chez les jeunes: des liens avec certains comportements à
risque ? Institut de la statistique du Québec. Zoom santé (44).
Récupéré de http ://
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201405-44.pdf
Problématique
Cet article nous paraît pertinent pour notre travail de
Bachelor, car il met en corrélation la violence au sein des relations
amoureuses avec la consommation de produits addictifs tels que l'alcool et le
cannabis. De plus, ce document met en lien la violence et les comportements
sexuels à risque comme la multiplication des partenaires.
Il nous paraît important de faire ressortir les
conséquences sur la santé de la VRA chez les adolescents.
Question de recherche
La question de recherche n'apparaît pas distinctement
dans le texte. En tenant compte du titre, nous proposons la question de
recherche suivante:
Quels liens peut-on faire entre la violence dans les relations
amoureuses chez les jeunes et les comportements risqués qu'ils-elles
adoptent?
Objectifs/hypothèses de la recherche
Le premier objectif est d'analyser et de lier la VRA à
des facteurs sociodémographiques et économiques.
Le second objectif est de faire un lien entre la consommation
de substances psychoactives et la fréquence de celles-ci sur les
violences subies et agies durant la relation.
Le troisième concerne la corrélation entre les
comportements sexuels à risque et la violence dans les relations
amoureuses.
Concepts, théories et ancrage
L'auteure Francine Bernèche est chargée de
projet au sein de l'institut de la statistique du Québec pour la
direction des statistiques de santé.
Les sources principales de cette étude sont
l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au
secondaire (EQSJS) menée entre 2010 et 2011 et l'enquête sociale
de santé auprès des enfants et des
adolescent-e-s-québécois-es (ESSEA) de 1999.
Design de la recherche
Plusieurs tableaux apportent des données
spécifiques aux genres, tout en distinguant violences subies et
violences infligées avec un accent mis sur les violences sexuelles. La
présentation des indicateurs thématiques (la VRA, la consommation
d'alcool et de drogues et des comportements sexuels) a permis la récolte
de données, par le biais d'outils tels que DEP-ADO (consommation
problématique d'alcool et de drogue).
Principaux résultats
Il ressort de cela que les violences dans les relations
amoureuses chez les adolescent-e-s sont liées à de nombreux
critères et facteurs. La consommation de produits psychoactifs, les
comportements sexuels à risque augmentent le risque de VRA chez les
adolescent-e-s. La corrélation augmente si la consommation et/ou les
comportements sont réguliers.
P a g e 26 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
4.5. Texte 5
Taylor, S., A. Calkins, C., Xia, R. & Dall, L. (2017).
Adolescent Perception of Dating violence: A qualitative Study. Faculty
Publications, Departement of Child, Youth, and family studies. 181.
Récupéré de
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=famconfacpub
Problématique
La VRA chez les adolescent-e-s est un problème de
santé publique aux USA. Les conséquences sur la santé
physique et psychique sont nombreuses. Afin de pallier cette
problématique, il paraît nécessaire de s'intéresser
à la théorie de l'interaction des symboles, c'est-à-dire
à la signification des expériences des individus et des
interactions avec autrui. Par conséquent, l'analyse des symboles,
notamment le langage, permettrait d'offrir un meilleur accompagnement et
d'adapter une prévention compréhensible aux adolescent-e-s. De
plus, l'interaction et les symboles ne sont pas identiques entre les filles et
les garçons.
Question de recherche
1) What is the adolescent language in regard to ADV definitions,
risk factors, and protection ?
2) What gender differences exist in the adolescent language when
reffering to ADV definitions, risk factors, and protection
?
Objectifs/hypothèses de la recherche
Selon les chercheuses, il existe peu d'études
s'intéressant à la perception des adolescent-e-s sur la
problématique de la violence dans les relations amoureuses. Il s'agit
d'analyser la VRA au travers du regard des adolescent-e-s.
Concepts, théories et ancrage
Il s'agit d'une étude qualitative basée sur la
phénoménologie afin de comprendre la vision et la perception des
adolescent-e-s de cette problématique.
Design de la recherche
Il s'agit de données qualitatives récoltées
auprès d'une trentaine de jeunes âgé-e-s entre 1419 ans,
scolarisé-e-s dans une école secondaire publique du Midwest. Les
récoltes de données se faisaient au travers de groupes de
discussion et d'entretiens semi-structurés. Les thèmes suivants
ont été abordés:
· Définition de la violence dans les relations
amoureuses
· Les facteurs de risque et de protection face à la
VRA
· Soutien aux auteur-e-s et aux victimes
· Améliorations à développer dans la
prévention
Principaux résultats
Il est constaté qu'il y a peu de réponses pour
résoudre la VRA de la part des écoles, des politiques et des
praticien-ne-s. Il est donc nécessaire d'adapter le langage afin que la
problématique des violences amoureuses soit mieux comprise par les
jeunes.
Une prévention et un accompagnement des jeunes vivant de
la VRA devraient plus considérer les spécificités
liées au genre.
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Actuellement, notre corpus est composé de textes
complémentaires. Il comprend un texte relatif aux mécanismes de
la violence chez les adolescent-e-s (Glowacz, & Courtain, 2017). Un article
mettant le focus sur les garçons et les violences subies par ceux-ci
(Lafrenayse-Dugas & coll., 2021), ce qui nous permet d'explorer la
thématique du genre plus en détail. Bernèche (2014)
propose une analyse des comportements à risque tels que la mise en
danger sur le plan sexuel et/ou la consommation d'alcool et de cannabis.
Hébert & coll. (2018) font un état de la situation sur la
prévention et les enjeux liés à celle-ci. Taylor &
coll. (2017) proposent de considérer davantage le langage des jeunes
pour parler de la VRA chez les adolescent-e-s. Cela améliorerait la
prévention et l'intervention auprès de celles et ceux-ci.
5. Analyse des contenus sélectionnés
Au travers de nos quatre axes, nos finalités, nous
avons mis en évidence plusieurs thèmes et sous-thèmes qui
nous ont permis d'apporter des éléments de compréhension
de la VRA ; parmi ceux-ci, les types de violence, le fonctionnement de la VRA
chez les adolescent-e-s, la compréhension qu'ont les adolescent-e-s de
la VRA, l'interchangeabilité des statuts auteur/victime. Notre grille
nous a permis de révéler des facteurs de risques et de protection
de la VRA chez les adolescent-e-s. Analyser les conséquences
biologiques, psychologiques, sociologiques permettra de mieux saisir quel est
le public le plus à risque de vivre des événements de
VRA.
L'analyse permettra aussi de mieux saisir les enjeux de cette
problématique au travers des différents programmes de
prévention existants: de quel type de prévention s'agit-il ?
Comment le public reçoit-il ces différents programmes de
prévention? Pour chaque point, des extraits ont été
choisis pour illustrer et appuyer les résultats.
5.1. Violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s
Il existe différentes formes de violences: physique
(qui peut aller d'une bousculade à la mort), psychologique
(contrôle, isolement, insulte, humiliation, menace, etc.) et sexuelle
(forcer une personne à avoir des rapports, contraindre une personne
à la prostitution, etc. ) (Glowacz & Courtain, 2017). Lavoie et
coll. (2009) définissent les violences comme « tout comportement
ayant pour effet de nuire au développement de l'autre, en compromettant
son intégrité physique, psychologique ou sexuelle»
(cités dans Glowacz & Courtain, 2017).
Selon diverses études, la violence au sein des
relations amoureuses des adolescent-e-s et des jeunes adultes atteint toutes
les couches sociales, filles et garçons confondu-e-s. Comme pour la
violence conjugale, ceci questionne sur les dynamiques de couple à
l'adolescence et renvoie aux questions de la bidirectionnalité et de la
symétrie des couples à transaction violente (Glowacz &
Courtain, 2017).
Comment fonctionne la violence à l'adolescence? Les
résultats de diverses études analysées par
Langhinrichese-Rohling & coll. (2012) exposent que 51,9 % des violences
sont bidirectionnelles et que dans le pourcentage restant elles sont
unidirectionnelles; il ressort de cela que les filles ont deux fois plus de
risques de commettre des violences sur leur partenaire que les garçons
(cités dans Glowacz & Courtain, 2017). Ces chiffres
démontrent que la VRA chez les adolescent-e-s se démarque par un
mécanisme bidirectionnel plutôt que par un fonctionnement qui
polariserait les individus en victime ou en auteur (Glowacz & Courtain,
2017).
P a g e 27 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Leen & coll. (2013) constatent que selon le type de
maltraitance le genre des victimes change (cités dans Glowacz &
Courtain, 2017). Ainsi, il ressort de cela que pour les violences
psychologiques, les taux de victimisation des filles et des garçons sont
semblables. Concernant les violences physiques, les garçons semblent
être davantage victimes et enfin pour les violences sexuelles, les filles
sont les principales victimes. Ce constat est aussi fait par Bernèche
(2014) qui évoque que cette forme de violence est plus souvent
perpétrée par les garçons. Même si les chiffres de
victimisation sont plus élevés pour les adolescentes, les
résultats démontrent une symétrie de celle-ci, puisque les
filles, tout comme les garçons, peuvent être autant victimes
qu'auteures (Glowacz & Courtain, 2017).
Il faut aussi prendre en compte que les garçons et les
filles ne sont pas égaux-les face à la violence physique subie.
Il semblerait que les filles soient plus sujettes aux blessures graves et les
garçons quant à eux n'ont pas les mêmes possibilités
d'accès aux institutions reconnaissant leur statut de victime (Mahalik,
& coll., 2010, cités dans Lafrenaye-Dugas, 2021).
Dans leur étude, Powers & Kerman (2006)
émettent l'hypothèse que les filles soient plus enclines à
prendre la responsabilité de leurs actes et à assumer les
conséquences de la violence qu'elles ont commise, contrairement aux
garçons qui eux, tenteraient plutôt de « nier> ou de
« minimiser> leurs actes délictueux commis envers des filles
(cités dans Bernèche, 2014).
Selon Reeves & Orpinas (2012) ceci pourrait être en
partie expliqué par le fait que les filles ne craignent pas de raconter
la violence qu'elles ont perpétrée, puisque celle-ci est vue
comme normale par les deux sexes, contrairement à celle
perpétrée par les garçons qui pourrait être mal
perçue (cités dans Glowacz & Courtain (2017). Cette
hypothèse est également soutenue par Price & coll. (1999),
les auteur-e-s expliquent que les adolescent-e-s, indépendamment de leur
genre, sont beaucoup plus tolérant-e-s et trouvent la violence plus
acceptable, lorsque celle-ci est perpétrée par des filles
(cités dans Glowacz & Courtain, 2017).
Une autre hypothèse serait que les garçons
peinent à avouer avoir été victimes de leurs petites amies
puisque la violence perpétrée par celles-ci est perçue
comme moins grave et que les prescriptions de genre dictées par la
société discréditent la parole des garçons qui se
trouvent en position de victime (Reeves & Orpinas, 2012, cités dans
Glowacz & Courtain, 2017, pp.14-15).
La manière de percevoir la violence est
différente entre adolescents et adolescentes. Selon les auteur-e-s Sears
& coll. (2006) ce serait plutôt le contexte que l'acte violent en
lui-même qui définirait l'acte comme violent; les garçons
se basent sur les intentions alors que les filles se fixent sur les effets de
l'acte pour le qualifier de violent (cités dans Glowacz & Courtain,
2017).
Lafrenaye-Dugas & coll. (2021) appuient ce constat en
expliquant que les garçons victimes risqueraient d'avoir peur de ne pas
être crus et pourraient « ne pas se sentir légitimes de
dénoncer> les violences qu'ils ont subies. Cela pourrait même
impacter leur manière de se percevoir comme victime, malgré le
fait qu'ils connaissent bien les comportements qualifiés de violents.
Ceci vient également appuyer les résultats de l'étude de
Taylor & coll. (2017) qui déclarent que dans de nombreux cas, les
filles sont plus souvent les agresseuses au sein des relations chez les
adolescent-e-s.
De manière plus générale, il semblerait
que « la violence dans un contexte d'auto-défense, de vengeance et
de jeu qui va trop loin> soit assez bien tolérée (Cauffman
& coll., 2000, cités dans Glowacz & Courtain, 2017).
P a g e 28 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Pour mieux comprendre le mécanisme de la VRA chez les
adolescent-e-s, il faut revenir sur les explications de Glowacz & Courtain
(2017). À partir de leurs analyses, il a été
démontré que plus une forme de violence est subie, plus une autre
forme l'est également. Elles parlent de polyvictimisation, de même
que plus une forme de violence est exercée, plus une autre forme l'est
aussi. Elles parlent alors de polyperpétration. Selon elles, il est peu
fréquent qu'une seule violence soit subie et/ou perpétrée
tant par les filles que par les garçons.
Glowacz & Courtain, (2017) parlent de la «
cooccurence » entre le fait de perpétrer de la violence et celui
d'en être victime, ceci pour expliquer que plus un-e adolescent-e
perpètre de la violence physique, plus il-elle en subit lui-même
ou elle-même et que cela doit être mis en lien avec les changements
de statuts de victime et d'auteur-e, c'est-à-dire avec la
bidirectionnalité de la violence au sein du couple. Il est aussi
démontré que plus un-e adolescent-e trouve une certaine forme
d'acceptabilité à un comportement violent, plus il-elle en sera
auteur-e, ainsi que plus il-elle trouvera une certaine forme
d'acceptabilité à être victime, plus il-elle en sera
victime (Glowacz & Courtain 2017). Lafrenaye-Dugas & coll. (2021),
viennent compléter cette hypothèse avec les résultats de
leur test en soulignant que plus un-e adolescent-e a subi des formes
différentes de violence, plus il-elle a un seuil de tolérance
élevé envers celle-ci. Les auteures Glowacz & Courtain,
(2017) soulignent que la violence au sein des couples est bien polymorphique et
que l'acceptation d'une forme de violence ouvre le chemin vers l'acceptation
d'autres formes de cette dernière; de plus, les résultats de
leurs recherches expliquent « l'interchangeabilité des statuts
d'auteurs et de victimes» ce qui corrobore d'autres études qui
mettent en avant la bidirectionnalité au sein des couples
adolescents.
Pour Pepler (2012) l'acceptation de la violence au sein des
couples amoureux chez les adolescent-e-s peut être perçue comme
une preuve d'amour et ce, d'autant plus chez les jeunes ayant
évolué dans un environnement violent (cité dans
Lafrenaye-Dugas, & coll., 2021).
Cette marque d'amour semblerait aussi assimilée par les
garçons. Le fait de subir de la violence physique durant une relation
amoureuse ne représente pas l'événement le plus douloureux
(contrairement à la rupture), car elle peut être ressentie comme
preuve d'amour (Lafrenaye-Dugas & coll., 2021). Cette interprétation
de la violence est pour Garcia-Diaz & coll. (2017) une perception qui
favorise un acte violent comme étant de l'amour; ce qui augmente la
tolérance et l'attitude de mauvais comportements (Garcia-Diaz &
coll., 2017, cités dans Lafrenaye-Dugas, 2021, p. 10). Des
résultats d'analyses montrent que le fait d'accepter et/ou d'excuser des
comportements brutaux dans les relations amoureuses, augmenterait le risque
d'en être victime; de même que le fait d'avoir
expérimenté d'autres formes de violences dans d'autres relations
est un risque supplémentaire chez les garçons de subir de la
violence physique (Lafrenaye-Dugas & coll., 2021). Selon Glowacz &
Courtain, (2017) il est possible que les filles soient plus auteures de
violences physiques à l'adolescence, car elles n'ont pas encore
assimilé les exigences liées aux rôles du genre, mais que
cela pourrait disparaître à l'âge adulte.
D'après leurs résultats Glowacz & Courtain,
(2017) affirment que le nombre de filles qui perpètrent de la violence
physique est plus élevé que celui du nombre de garçons.
Ceci corrèle avec Wincentak & coll. (2016) qui stipulent que les
garçons ont conscience des normes sociétales qui prévalent
que la brutalité physique envers les filles n'est pas acceptable et que
de fait, cela pourrait expliquer un plus faible taux de violence physique
perpétrée par les garçons. De plus, les jeunes qui sont
très investis dans leur relation de couple sont plus à risques
que les autres de ne pas mesurer un comportement déviant et de le
percevoir comme « un jeu ou une blague» (Arriage, 2002, cité
dans Glowacz &
P a g e 29 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Courtain, 2017, p.7). Chaque acte dans une relation amoureuse,
peut-être interprété de façon différente et
cette interprétation peut être favorable ou pas et ainsi,
entraîner des conséquences sur la suite de la relation (Glowacz
& Courtain, 2017).
5.2. Analyse bio-psycho-sociale de la VRA
Vives-Cases & coll. (2011) mentionnent que la VRA peut
entraîner des conséquences négatives pour la santé
à long terme comme des douleurs chroniques, des maladies
cardiovasculaires, l'hypertension et de la détresse psychologique
(cités dans Taylor & coll., 2017). Il existe peu de données
faisant référence aux facteurs biologiques. A contrario, les
conséquences psychologiques sont prédominantes dans la
littérature scientifique. La VRA nuit à l'estime de soi, elle
peut engendrer des troubles psychologiques, elle impacte la capacité
d'adaptation de même que l'identité personnelle. Cela peut aller
jusqu'à provoquer des « symptômes physiques et psychologiques
comme des nausées et un abattement émotionnel»
(Lafrenaye-Gugas & coll., 2021, p.9).
De manière générale, il y a un espoir que
la désistance5 se manifeste auprès d'adolescent-e
auteur-e de violence lorsque celui-ci ou celle-ci deviendra adulte. Cependant,
la recherche a démontré qu'une partie des auteur-e-s de violence
à l'âge adulte l'avait déjà été
à l'adolescence (Greeman & Matsuda, 2016, cités dans Glowacz
& Courtain, 2017).
Avoir une relation dite « positive» à
l'adolescence contribue au bon développement et à avoir une
meilleure estime de soi. L'adolescent-e qui vit une expérience amoureuse
négative, sera impacté-e dans sa confiance en soi et dans son
aptitude à pouvoir maintenir une relation sentimentale (Furman, Shaffer,
2003, cités dans Glowacz & Courtain, 2017). De surcroît, Ali
& coll. (2011) relèvent que l'insuffisance de ressources est un
facteur qui contribue au manque de résilience et qui renforce le risque
de victimisation (cités dans Lafrenaye-Gugas & coll., 2021). Lors de
témoignages, des adolescents ont déclaré qu'ils avaient eu
le sentiment d'avoir été « utilisés» et «
trahis» lors d'une séparation; certains ont même eu le
sentiment d'avoir été « jetés» par leur
partenaire, après avoir eu une relation sexuelle (Lafrenaye-Gugas &
coll., 2021). D'après Joyner & Udry (2000), le risque de
dépression est davantage lié à la séparation
qu'à la relation en elle-même (cités dans Glowacz &
Courtain, 2017). Les expériences qui résultent des relations
amoureuses ont un impact sur le développement de la construction
identitaire des adolescent-e-s et sur leur futures relations conjugales
(Glowacz & Courtain, 2017). Joyner & Udry (2000) montrent que cette
période exploratoire de l'adolescence est fragile et qu'il existe un
risque que la violence vienne la marquer (cités dans Glowacz &
Courtain, 2017). Ce constat est également celui de Bernèche
(2014) :
Les relations amoureuses font aussi partie des
découvertes de l'adolescence et peuvent, au départ, contribuer
à la valorisation des jeunes, mais aussi les confiner ensuite dans un
cercle vicieux lorsque ces relations sont entachées de violence. Les
liens entre la violence et les comportements à risque sont complexes,
car ils peuvent se rapporter à la fois aux causes, aux contextes et aux
conséquences de l'exercice de la violence dans les relations amoureuses.
(p.2)
La capacité d'adaptation peut s'inscrire dans une
dynamique néfaste pour l'adolescent-e qui vit une situation avec
laquelle il-elle n'est pas en accord. Un-e adolescent-e qui subit ou qui
inflige des comportements avec lesquels il-elle n'est pas en accord, peut
développer des stratégies afin de s'adapter et de justifier ce
qu'il-elle fait ou ce qu'il-elle vit (Glowacz & Courtain, 2017). Cette
adaptation
5 Processus individuel qui consiste aux personnes
à sortir de la délinquance.
P a g e 30 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
visant à se protéger ou à se couvrir a
pour conséquence d'engendrer d'autres formes de violence (Glowacz &
Courtain, 2017). Lafrenaye-Dugas & coll. (2021) constatent que sur les
participants de l'enquête; huit adolescent-e-s sur quatorze sont mieux
outillé-e-s face aux conflits dans leur relation amoureuse. Ils-elles
arrivent à sortir de l'impasse avec leur partenaire. Néanmoins,
près de la moitié accuse le partenaire d'être la cause du
problème sans eux-elles-mêmes se remettre en question. Grynch
& coll. (2015), invoquent la résilience comme une ressource pour
sortir du cercle de la violence, cependant, cette capacité est mise
à mal par les stéréotypes de genre (cités dans
Lafrenaye-Dugas & coll., 2017). Easton & coll. (2014) confirment que
l'adhésion à ces stéréotypes est liée
à une détresse psychologique et que celle-ci entrave la demande
d'aide chez les jeunes hommes (cités dans Lafrenaye-Dugas & coll.
2017). Taylor & coll. (2017) ajoutent que le langage des adolescents
répond aux normes de la masculinité en parlant de la VRA tant en
termes de choix et que de contrôle. De plus, les adolescents
interrogés ont mis en cause le stress et la colère comme pouvant
être des facteurs de risques et même de perpétration de VRA
(Taylor & coll., 2017).
Les relations amoureuses font partie du développement
normal de l'adolescent-e et permettent à ces derniers-ères de se
construire. Les difficultés à court et à long terme d'une
relation amoureuse, comme une séparation, peuvent devenir un rempart au
bon développement des jeunes, surtout si ces dernier-ère-s
manquent de ressources personnelles et utilisent la violence comme moyen
d'adaptation. Utiliser cette violence peut engendrer des conséquences
psychologiques telles que « pensées suicidaires, dépression
et anxiété'> (Ellis & al., 2009, cités dans Taylor
& coll., 2017, p.2). La théorie de Taylor & coll. (2017) est
appuyée par le fait que les jeunes femmes ont déclaré que
les relations familiales, amicales, fraternelles et scolaires sont des
ressources personnelles qui participent à la prévention de la
violence.
Ces expériences amoureuses participent activement
à réaliser « des tâches socio-émotionnelles
reposant sur l'équilibre entre recherche d'intimité et
affirmation d'autonomie, et cela, au rythme de la découverte de la
passion et de la sexualité'> (Glowacz & Courtain, 2017, p.1). De
plus, cela permet aux jeunes de développer leur conception de la romance
(Glowacz & Courtain, 2017).
La découverte de la sexualité intervient
normalement dans les relations amoureuses des adolescente-s cependant, elle
peut aussi devenir un facteur de risque favorisant la VRA chez les
adolescent-e-s. Bernèche, (2014), recense plusieurs risques, comme avoir
des rapports sexuels non protégés, être sexuellement
actif-ve avant 14 ans et la multiplication des partenaires. Les jeunes ayant eu
trois partenaires ou plus, seront plus à risque d'infliger de la
violence à leur partenaire : à savoir 27,2 % pour les
garçons et 49,2 % pour les filles (Bernèche, 2014). La recherche
démontre que les jeunes qui ont un comportement sexuel responsable
(utilisation de préservatif) sont moins nombreux-euses à vivre
des relations sous l'emprise de violence (Bernèche, 2014).
Il semblerait qu'il existe une corrélation entre la VRA
et le fait de consommer des produits tels que l'alcool et le cannabis et la
manière de les consommer. La consommation d'alcool et/ou de cannabis
contribue à augmenter tant la victimisation que la perpétration
de violences dans la relation amoureuse chez les adolescent-e-s
(Bernèche, 2014). La non-consommation de produits diminue de
manière significative le risque de VRA, au même titre qu'une
personne qui a une consommation élevée (plus de 3-4 fois par
semaine) aura un risque élevé de perpétrer ou de subir de
la VRA (Bernèche, 2004). Ce constat concerne les élèves du
secondaire de manière générale, mais le risque augmente en
fin de scolarité (Bernèche, 2004). Dans l'étude
menée par Taylor & coll. (2017), les adolescent-e-s justifient
P a g e 31 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
leurs actes de violence en invoquant l'alcool comme
étant la cause de leurs gestes, pensant que la société
accepterait mieux leur comportement.
Le contexte familial peut être un facteur originel de
victimisation ou de perpétration de violence dans les relations
amoureuses chez les adolescent-e-s (Bernèche, 2014). Parmi ces facteurs,
Bernèche (2014) stipule que les adolescent-e-s ayant
évolué dans des familles monoparentales ou reconstituées
ont plus de risques de subir de la VRA ; l'auteure constate aussi que le risque
de violence dans les relations amoureuses des adolescent-e-s est à
mettre en corrélation avec le niveau d'études des parents.
Trahoré & coll. (2013) évoquent que la défavorisation,
qu'elle soit sociale et/ou économique contribue à la violence
dans les relations amoureuses, plus le niveau est bas, plus le risque de subir
ou d'infliger de la violence est présent (cités dans
Bernèche, 2014)
L'exemple familial impacte également la perception de
certain-e-s jeunes qui ont vécu de la violence dans leur environnement.
Bernèche (2014) présente le milieu familial et
socio-économique comme une représentation importante pour les
adolescent-e-s. Celle-ci participe à la propension de subir ou a
contrario, à infliger de la VRA. Ce même constat est établi
par Taylor & coll. (2017), soulignant que les adolescentes mentionnent les
violences présentes dans la famille comme pouvant être
assimilées à un modèle comportemental qui augmenterait le
risque de victimisation ou de perpétration. Les modèles
participent à la compréhension de ce que vivent les
adolescent-e-s. Pepler (2012) mentionne les ruptures comme étant plus
difficiles à surmonter que les violences dans la relation : « la
violence étant parfois perçue comme une démonstration
d'attention ou une façon de demander de l'attention, voire une preuve
d'amour, particulièrement chez les jeunes qui ont grandi dans un
environnement familial empreint de violence» (cité dans
Lafrenayse-Dugas & coll., 2021, p.10). En d'autres termes, il est plus
facile de vivre avec ce que l'on connaît ou l'on a connu que d'être
abandonné-e. Taylor & coll. (2017) abondent dans ce sens. Toutefois,
lors des entretiens, des adolescentes ont mentionné la famille comme un
facteur de protection face aux violences dans les relations amoureuses.
Les adolescent-e-s victimes de violence dans leur relation
amoureuse rencontrent également des difficultés dans leur cursus
estudiantin comme l'absentéisme, l'abandon afin d'éviter le-la
partenair-e (Ball & Rosenbluth, 2008 ; Banyard & Cross, 2008 ;
cités dans Taylor & coll., 2017). Pourtant, des adolescents ont
mentionné que si les jeunes restaient impliqué-e-s dans leur
scolarité et dans leur activité parascolaire, cela leur
permettait de ne pas prendre des décisions préjudiciables comme
être violent-e avec sa-son partenaire (Taylor & coll., 2017). Les
adolescentes ont également mentionné les enseignant-e-s et les
personnes de la communauté comme des personnes de confiance pouvant agir
sur la protection de la VRA (Taylor & coll., 2017). Les jeunes hommes ont
quant à eux identifié plusieurs programmes au sein des clubs
scolaires ou des programmes parascolaires, comme une forme de protection contre
la VRA, car ceux-ci permettaient de développer des compétences
spécifiques comme la communication (Taylor & coll. 2017).
Comme nous l'avons vu précédemment, les pair-e-s
jouent un rôle fondamental dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s, ils-elles sont les arbitres. Taylor & coll. (2017) exposent
que les adolescentes semblent accorder davantage d'importance aux personnes qui
leur fournissent un contexte normé comme facteur de protection que leur
environnement physique. De surcroît, les adolescentes évoquent que
des relations de mentorat avec leurs pair-e-s agissent en tant que facteurs de
protection face au risque de VRA (Taylor & coll., 2017). Les pair-e-s sont
important-e-s pour les jeunes filles. De jeunes adultes ont mentionné
qu'un nombre insuffisant d'ami-e-s ou grandir seule
P a g e 32 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
durant l'adolescence sont des facteurs de risques pouvant
amener des problèmes liés à l'attachement, les
empêchant par conséquent, de quitter leur partenaire violent
(Taylor & coll., 2017).
Concernant les garçons, le regard des pair-e-s renvoie
à l'adhésion sociale de leurs actes. Munoz-Rivaz et coll. (2021)
invoquent les normes sociales comme incitateur pour accepter la violence
physique, pour autant qu'il n'y ait pas de blessures graves ou alors si cette
violence est infligée par une fille et non pas par un garçon
(cités dans Lafrenayse-Dugas & coll., 2021). A contrario, la
prédominance du genre masculin sur le genre féminin semble encore
présente dans les relations amoureuses chez les adolescent-e-s:
Les hommes et les femmes sont socialisés pour des
rôles différents avec des partenaires romantiques, et
malgré des changements progressifs vers l'égalité des
sexes, les interactions des adolescents continuent de mettre l'accent sur la
dominance masculine (Hawley & coll., 2008 ; Katz & al., 2002 ;
cités dans Taylor & coll., 2017, p. 14).
Selon Feiring (1999) ; Hill & Lynch (1983), les
stéréotypes liés au genre dans les rôles d'une
relation amoureuse et/ou intime sont plus marqués durant l'adolescence,
car les jeunes filles et garçons expérimentent et apprennent les
attentes de leur genre (cités dans Taylor & coll., 2017).
Il existe des différences entre les rôles
assignés au genre masculin et féminin, et cela engendre des
difficultés. Mahalik & coll. (2010) constatent que les
garçons, mais également les hommes adultes éprouvent des
difficultés à se considérer comme des victimes et par
conséquent à demander de l'aide. Ils ne se sentiraient pas pris
au sérieux (cités dans Lafrenayse-Dugas & coll., 2021). Selon
Reyes & coll. (2016) cette difficulté trouve ses origines dans les
normes sociales stéréotypées (cités dans
Lafrenayse-Dugas & coll., 2021). Le genre masculin est prescrit comme
devant être supérieur, combatif et ne pas se laisser guider par
ses émotions (Easton & coll., 2014, cités dans
Lafrenayse-Dugas & coll., 2021). Evoluer dans un milieu empli de violence
et adhérer aux stéréotypes du genre masculin engendre un
risque considérable de violence au sein des relations amoureuses, mais
également, diminue la potentielle demande d'aide pour ces hommes en
devenir (Ali & coll., 2011 ; cités dans Lafrenayse-Dugas &
coll., 2021).
5.3. La VRA, un problème qui manque de
visibilité
La violence au sein des relations amoureuses chez les
adolescent-e-s peut-être la conséquence du cumul de plusieurs
problématiques: violence juvénile, violence domestique,
consommation d'alcool et de cannabis. Ceci s'inscrit dans une période
marquée de changements significatifs entre l'enfance et l'adolescence.
La VRA est une problématique à part entière qui tend
à être négligée et reléguée au second
plan. Rondeau & coll. (2008) affirment que cette banalisation des relations
amoureuses se manifeste tant chez les jeunes que chez les adultes, bien que la
violence impacte le développement des adolescent-e-s (cités dans
Glowacz & Courtain, 2017). De surcroît, il faut relever que la VRA
n'est pas liée à une classe sociale, ni à un genre
(Glowacz & Courtain, 2017).
Bien que cette problématique puisse toucher toutes les
strates sociales, la violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s et les jeunes est peu considérée au niveau de la
société. Par ailleurs, des études constatent des
différences entre les formes de violences au sein des relations
amoureuses des adolescent-e-s (Glowacz & Courtain, 2017). Les
résultats diffèrent par manque de recherche spécifique.
Bernèche (2014) constate que les résultats des enquêtes
populationnelles sont rares, et celles traitant uniquement de la VRA sont
encore peu nombreuses.
P a g e 33 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Il en va de même pour les études
spécifiques au sein de la VRA. Lafrenaye-Dugas & coll. (2021)
soulignent qu'il en existe encore moins sur la manière dont les
adolescents perçoivent leur vécu de violence. Taylor & coll.
(2017) expliquent qu'en plus de prendre en compte l'avis et la lecture qu'ont
les adolescent-e-s des situations de VRA, il serait judicieux de les mettre en
lien avec leur origine et leur âge, afin de permettre le
développement de programmes de prévention efficaces. Sears &
coll. (2007) affirment qu'il y a un lien entre l'attitude et le comportement
qu'un-e adolescent-e adopte face à la VRA en fonction du contexte
(cités dans Glowacz & Courtain, 2017). Malgré
l'adhésion à cette hypothèse par plusieurs auteur-e-s, Mc
Closkey, Lichter (2003) ; Slep & coll. (2001) d'autres remettent en
question les résultats des études longitudinales par manque de
constance (cités dans Hébert & coll., 2018).
A ce jour, il existe peu de données sur la VRA et ses
sous-thématiques, certains thèmes associés à cette
problématique sont encore en phase exploratoire. Hébert &
coll. (2018), affirment la nécessité « au cours des
prochaines années de renforcer la recherche longitudinale, de soutenir
la réalisation de méta-analyses, et de donner de meilleurs moyens
à la recherche évaluative sur les interventions» (p.122).
Les auteur-e-s Fernet & coll., 2016 ; Schumacher & Smith-Slep, 2004 ;
précisent que la recherche se concentre sur la protection des
adolescent-e-s en général et oublie de faire la distinction avec
les besoins spécifiques liés au genre (cités dans
Lafrenaye-Dugas & coll., 2021). De plus, l'utilisation d'un langage
technique ne permet pas aux adolescent-e-s de comprendre de façon
optimale la signification complète d'actes de violence (CDC, 2016 ;
Rickert, Wiemann, Vaughan, & White, 2004, cités dans Taylor &
coll., 2017). Lal (1995) souligne l'importance de la compréhension du
langage des adolescent-e-s par les chercheur-se-s et les praticien-nes-s, afin
de pouvoir optimiser leur accompagnement (cité dans Taylor & coll.,
2017).
5.4. Les champs d'intervention de la VRA : prévention et
prise en charge
Les programmes de prévention universelle pour la VRA
chez les adolescent-e-s sont peu nombreux. Au Canada et aux États-Unis,
ils se concentrent pour l'essentiel directement auprès des jeunes
(Hébert & coll., 2018). Selon ces auteur-e-s, les programmes de
prévention universelle (qui visent à informer le plus grand
nombre de personnes possible) se développeront davantage, si
l'élaboration de méta-analyses est effectuée sur des
programmes globaux. De plus, Zang & coll. (2011) affirment qu'il est plus
favorable de transmettre des outils aux plus grands nombres, au lieu d'outiller
les victimes et/ou les agresseur-se-s (cités dans Hébert &
coll., 2018). Lavoie & coll. (2012) mentionnent que cette prévention
universelle serait bénéfique à l'échelle locale
(école, quartier), car des animations seraient dispensées tant
aux jeunes qu'aux adultes évoluant auprès de ceux-ci et celles-ci
(cités dans Hébert & coll., 2018). Mercy & Tharp (2015)
abondent dans ce sens, car il est constaté que l'environnement des
adolescent-e-s n'est que peu impliqué dans les programmes de
prévention (cités dans Hébert & coll., 2018).
Pourtant, il existe des programmes visant à mobiliser la
communauté. Coaching Boys into Men dispense des formations
courtes à des entraîneurs de sport d'équipe masculine afin
de sensibiliser et de développer l'initiation en tant que témoin
de VRA chez les adolescent-e-s (Hébert & coll., 2018).
Le contexte de prévention doit être bien compris
et ciblé. Hébert & coll. (2018) soulignent qu'il existe de
nombreux programmes de prévention interactifs et que la vitesse de
transmission des informations, notamment par les réseaux sociaux impacte
les programmes de prévention sur la manière d'interagir avec les
jeunes.
P a g e 34 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
La prévention ciblée est destinée
spécifiquement aux jeunes, ce qui est le cas pour la plupart des actions
de prévention outre-Atlantique (Hébert & coll., 2018).
Toutefois, certains programmes ont des finalités et des objectifs plus
spécifiques et précis. Expect Respect promeut les
relations amoureuses saines notamment par le biais des pair-e-s. Le programme
propose des groupes de soutien séparés (pour les filles et pour
les garçons) dans le cadre de l'école; cela dans le but
d'atteindre les jeunes considéré-e-s à risque
(Hébert & coll., 2018). Ce programme a fait l'objet d'une
évaluation. Le résultat révèle que les jeunes
à risque développent des compétences afin de gérer
plus sainement leur conflit dans leur relation amoureuse, en les nommant et/ou
en les exprimant à des tiers. En revanche, le programme n'a pas permis
de diminuer les risques liés à la perpétuation et à
la victimisation de la VRA (Ball & coll., 2012, cités dans
Hébert & coll., 2018). La prévention par les pair-e-s montre
de bons résultats. Fernet & coll. (2019) soulignent que
l'accompagnement et le soutien par les pair-e-s sont efficaces et permettent
d'accroitre les connaissances au sujet de la violence au sein des relations
amoureuses, mais aussi le pouvoir d'agir en développant des
compétences communicationnelles et des capacités de
résilience (cités dans Lafrenayse-Dugas & coll., 2021).
Il existe des programmes destinés aux témoins de
violences sexuelles et de VRA, la finalité étant de sensibiliser
les gens à intervenir en tant que témoins dans ces situations.
Les résultats montrent que les personnes sont plus disposées
à agir, mais cela ne modifie que peu les croyances, notamment sur le
viol et n'incite pas davantage les individus à parler de leurs propres
expériences (Storer & coll. 2016, cités dans Hébert
& coll., 2018). Cependant, l'unique programme de prévention
québécois sensibilisant les jeunes (16 -17 ans) à la
thématique des violences sexuelles est le programme PASSAJ
(Hébert & coll., 2018).
Taylor & coll. (2011) ont évalué le
programme Shifting Boundaries qui intervient auprès de
préadolescent-e-s (10-13 ans) visant à promouvoir les relations
saines dans les relations amoureuses; les résultats soulèvent une
baisse des comportements de victimisation comme le harcèlement sexuel et
la violence sexuelle dans une relation amoureuse, mais le programme n'aurait
pas de répercussions sur la perpétration de ces violences
(cités dans Hébert & coll., 2018)
Le lien entre ces programmes de prévention est qu'ils
évaluent principalement l'impact sur la victimisation et ou la
perpétration. Loveisrespect (2013) souligne que les facteurs de
protection sont trop souvent ignorés dans ces programmes « Instead,
programs emphasize protection for victims after the ADV has occurred. In
addition, many curriculums tend to not reference protection against ADV
perpetration, only victimization» (cité dans Taylor & coll.,
2018, p.16). En plus de mettre les facteurs de protection en avant, plusieurs
auteurs insistent sur l'importance de la communication, et plus
particulièrement du langage dans le cadre des programmes de
prévention. Cela permettrait de renforcer le changement et les
comportements des adolescent-e-s dans le cadre de VRA. (Ajzen, 1985 ; Peterson
& coll., 2016 ; Weisz & Black, 2001, cités dans Taylor &
coll., 2017). Un langage préventif et adapté aux jeunes
augmenterait les connaissances des violences amoureuses des adolescent-e-s. Ces
derniers et dernières soulignent un besoin plus accru de
compréhension de la VRA, les jeunes eux-mêmes et elles-mêmes
évoquent un besoin d'éducation dans ce domaine (Taylor &
coll., 2017).
Il existe peu de programmes spécifiques dans la prise
en charge des jeunes victimes ou auteur-e-s de VRA. Toutefois, la
création de Violence Prevention Mentoring Program intervient
auprès des adolescent-e-s ayant commis des délits avec violence
(pas nécessairement de la VRA) ; l'évaluation de ce programme a
relevé que les connaissances relatives à la VRA augmentaient mais
ne modifiaient pas
P a g e 35 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
la posture de jeunes sur ce sujet (Salazar & Cook, 2006 ;
cités dans Hébert & coll. 2018). Ce programme met
également le focus sur la perpétration de la violence.
Il existe un plan de protection destiné aux jeunes
vulnérables qui ont été exposé-e-s à de la
violence conjugale. Safe Dates répond à un besoin
spécifique qui consiste à réduire le risque de
victimisation et de perpétuation dans le cadre d'une relation amoureuse
chez les adolescent-e-s; l'évaluation de ce programme fait ressortir des
résultats satisfaisants concernant la réduction de la
victimisation au niveau de la violence physique et psychologique. Ce même
constat est fait pour la perpétuation de ces deux types de violence.
Toutefois, les résultats ne montrent pas de changements significatifs
dans les comportements de victimisation et de perpétuation en ce qui
concerne la violence sexuelle (Hébert & coll., 2018).
L'analyse se poursuit sous l'angle de la prise en charge, il
s'agit d'évoquer les pratiques proposées par les
professionnel-le-s, mais aussi les lieux de l'intervention, il s'agira de
comprendre ce qui est entrepris et/ou d'exposer les pistes d'intervention.
Les programmes de prévention évoqués
précédemment montraient que certain-e-s jeunes
développaient des compétences dans leur pouvoir d'agir ou
d'intervenir comme témoins. Selon Glowacz & Courtain (2017), les
interventions permettant l'empowerment tant pour les victimes que pour
les auteur-e-s favoriseraient l'acquisition de compétences sociales et
émotionnelles. Pour Taylor & coll. (2017), les professionnel-le-s
accompagnant des adolescent-e-s doivent employer un vocabulaire axé sur
l'action et les émotions. Ce travail doit se faire de manière
similaire auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes. Cependant, les
professionnel-le-s doivent être particulièrement attentifs et
attentives aux adolescent-e-s. Selon Easton & coll. (2013), la gent
masculine serait moins encline à dévoiler les abus subis, mais
s'ils bénéficiaient d'un accompagnement, ils seraient plus
disposés à le faire, car ils se sentiraient soutenus
(cités dans Lafrenayse-Dugas & coll., 2021). Selon Gynch & coll.
(2015), les interventions permettraient d'augmenter la capacité de
résilience de ces jeunes hommes et de développer les demandes
d'aide et de soutien adéquats (cités dans Lafrenayse-Dugas &
coll., 2021).
Qu'il s'agisse de développer des compétence
d'empowerment, de résilience et de mobilisation de ressources,
pour les garçons et pour les filles, l'objectif des professionnnel-le-s
est d'initier un changement pour gagner en sérénité afin
d'instaurer des dynamiques qui ne sont pas empreintes de violence (Glowacz
& Courtain, 2017).
Selon Hébert & coll. (2018), l'intervention doit se
faire à tous les niveaux avec intensité et s'instaurer dans la
durée, l'intervention singulière et isolée ne permettra
pas d'amélioration. Les auteur-e-s soulignent que la formation des
intervenant-e-s et l'adaptation des outils doivent être
encouragées et développées (Hébert & coll.,
2018). De surcroît, la prévention doit se baser sur les
expériences des adolescent-e-s victimes ou auteur-e-s de VRA et non
refléter le point de vue des professionnel-le-s (Taylor & coll.,
2018).
L'école est un lieu de fréquentation pour les
adolescent-e-s, mais aussi un lieu dans lequel des relations amoureuses se
créent. Il existe des programmes de prévention actifs dans le
milieu scolaire comme Safe Dates et Fourth R (Hébert
& coll., 2018). Parmi les programmes intervenant en milieu scolaire aux
États-Unis et au Canada qui ont été évalués,
il ressort que seuls trois des programmes (Safe Dates, Fourth R, Shifting
Boundaries) montrent des changements de comportement des participant-e-s
vis-à-vis de la VRA (Koker & coll., 2014, cités dans
Hébert & coll., 2018). Taylor & coll. (2018) soulignent le
P a g e 36 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
manque d'éducation sur les violences dans les relations
amoureuses dans le milieu scolaire, surtout lorsque l'on se
réfère aux chiffres élevés de la VRA. Selon les
auteur-e-s (Taylor & coll., 2018), cela nécessite d'évaluer
les programmes mis en place par les institutions scolaires surtout lorsque les
jeunes eux-mêmes et elles-mêmes expriment le besoin d'être
mieux informé-e-s sur cette thématique, les programmes doivent
aller plus loin que de présenter et définir la VRA :
Adolescents also requested that dating violence be discussed,
openly and honestly, by both adolescents and adults. Adolescents asked that
dating violence awareness be incorporated into the high school's learning
agenda. (p.13)
Dans le cadre de leur entretien, de jeunes filles ont
mentionné que l'éducation dispensée durant leur
scolarité se focalisait sur une sexualité saine « We need
relationship classes, because there are so many messed up relationships, but
the only thing I ever learned in school is safe sex, that's all I ever learned
(Taylor & coll., 2018, p.14).
Les travaux de Taylor & coll. (2018), montrent le besoin
des adolescent-e-s de pouvoir être informé-es et de pouvoir
échanger librement et honnêtement de la VRA avec des adultes.
Si l'école est un lieu dans lequel il est courant de
rencontrer la thématique de la sexualité, d'autres
thématiques doivent être aussi abordées. Selon
Lafrenayse-Dugas & coll. (2021), il est nécessaire de mettre en
place des programmes d'éducation sexuelle, de prévention de la
violence afin de diminuer l'impact des stéréotypes de la
masculinité, mais également endiguer la tolérance face aux
comportements violents.
Hébert & coll. (2018) constatent que si certains
programmes n'interviennent qu'en milieu scolaire, Safe Dates et Fourth R
proposent un accompagnement extra muros en offrant un service d'aide aux
victimes, des séances d'informations pour les représentant-e-s
légaux-légales, des documents écrits (livres, flyers)
visant à impliquer les proches et la communauté des jeunes
à prévenir la VRA.
Cependant, la thématique des violences amoureuses chez
les adolescents (garçons) manque de documentation et de ressources.
L'intervention en amont pour la sensibilisation sur le thème des
relations amoureuses et sujets associés chez les jeunes, auprès
de ceux-celles-ci, des professionnel-es et de tout autre adulte dans
l'environnement des adolescent-e-s, exige un travail à grande
échelle (Lafrenayse-Dugas & coll., 2021).
Au niveau pénal, nous n'avons pas recensé
beaucoup d'information à ce sujet. Mis à part, le Violence
Prevention Mentoring Program agissant auprès de jeunes
adolescent-e-s auteur-e-s de violence qui ne montrait pas de modification de
posture (Salazar & Cook, 2006 ; cités dans Hébert & coll.
2018). Glowacz & Courtain (2017) avancent qu'une prise en charge judiciaire
trop précoce pour des jeunes a « un risque d'effets
délétères pour l'auteur et la victime, notamment en termes
de stigmatisation » (p.17).
6. Synthèse des résultats
La revue de la littérature sélectionnée
nous montre que le milieu social et familial des adolescent-e-s joue un
rôle prépondérant dans la construction de ceux-ci et
celles-ci. Les modèles familiaux influent les mécanismes de
protection, de victimisation et de perpétration face à la
violence. La présence de violence dans l'environnement des jeunes est un
facteur de risque pour les adolescent-e-s. Ils-elles se construisent sur des
modèles comportementaux favorisant la reproduction tant au travers de
la
P a g e 37 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
victimisation que de la perpétration. Précisons
que la problématique de la VRA se rencontre dans toutes les classes
sociales.
Les risques et les conséquences psychologiques de la VRA
chez les adolescent-e-s sont nombreux. La littérature
sélectionnée évoque que les jeunes vivant de la violence
dans leur relation amoureuse ont une estime et une confiance
d'eux-elles-mêmes altérées, augmentant un risque de
dépression. Il est établi que les jeunes consommateurs et
consommatrices d'alcool et/ou de cannabis sont plus à risque
d'être confronté-e-s à de la VRA.
L'analyse relève une différence entre les
adolescentes et les adolescents tant au niveau de violences
perpétrées qu'au niveau des violences subies. Toutefois, les
mécanismes de la violence sont davantage bidirectionnels et
symétriques. Il a également été constaté que
les jeunes n'identifient pas certains comportements violents comme tels, mais
les associent comme faisant partie intégrante de la relation
amoureuse.
La violence des relations amoureuses chez les adolescent-e-s
est impactée par les constructions stéréotypées
liées au genre. Les adolescents seront moins enclins à parler des
violences subies et infligées, car toutes deux ne répondent pas
aux normes socialement construites qui prévalent que les hommes ne
doivent pas taper les femmes et qu'en même temps ils doivent être
forts.
De surcroît, le manque de documentation dû au
récent intérêt concernant la victimisation des
garçons et des hommes ne permet pas une analyse détaillée
et complète de ce phénomène.
Ce constat de manque de visibilité ne s'applique pas
seulement à la gent masculine. La problématique de la violence
dans le cadre des relations amoureuses chez les adolescent-e-s n'est pas
suffisamment étendue. A ce jour, peu de recherches ont été
menées sur ce thème. Cela engendre des résultats
disparates et contradictoires. Il est également constaté qu'il
existe peu d'études longitudinales ce qui ne permet pas une connaissance
de l'évolution de cette problématique.
Il existe des programmes de prévention, cependant la
littérature analysée met en avant les faiblesses et évoque
des pistes d'amélioration afin d'accroitre la sensibilisation de ce
sujet au plus grand nombre. La plupart de ces programmes ne sont pas
universels, ils sont ciblés pour les jeunes, ce qui restreint
l'information au public-cible. De plus, les rares campagnes universelles
effectuées n'ont pas été évaluées ce qui ne
permet pas d'avoir des connaissances de leur impact. Les programmes ciblant les
jeunes n'ont également pas tous été évalués,
toutefois, pour ceux qui l'ont été, on constate une
évolution du comportement et un développement des connaissances
des jeunes vis-à-vis de la VRA. Les programmes spécifiques mis en
place sont principalement pour les personnes ayant déjà
été victimes et/ou auteur-e-s de violence.
Les chercheur-se-s proposent d'améliorer la
prévention en proposant des programmes axés sur le
développement des compétences personnelles afin pouvoir activer
ses propres facteurs de protection au lieu d'emprisonner les jeunes dans leur
rôle de victime et/ou d'auteur-e.
Quel est le rôle des travailleurs sociaux et
travailleuses sociales face aux risques, impacts et enjeux d'une relation
amoureuse violente chez les adolescent-e-s entre 13-18 ans?
Cette analyse permet de mettre en avant le fait que cette
problématique commence à émerger. En revanche, elle nous
donne peu d'indications sur quels types de professionnel-le-s interviennent, ni
dans quelles infrastructures/lieux et à quel moment il est le plus
approprié d'intervenir.
P a g e 38 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Le travail social à un rôle à jouer dans
cette problématique et cela à tous les niveaux. Les travailleurs
sociaux et travailleuses sociales ont la mission d'accompagner les personnes
afin qu'elles puissent développer leurs compétences
d'empowerment. Les professionnel-le-s du travail social contribuent
à la visibilisation des problématiques et répondent
à un devoir de protection vis-à-vis des mineur-e-s (Avenir
social, 2010).
L'analyse montre que l'emploi d'un vocabulaire adapté
aux adolescent-e-s permet de faciliter l'accompagnement et d'augmenter la
compréhension de la problématique de la VRA. Si les jeunes sont
les principaux et principales concerné-e-s, les professionnel-le-s du
travail social peuvent intervenir auprès de l'environnement des
adolescent-e-s. Cela permet de sensibiliser les adultes (parents,
enseignant-e-s, coachs sportives et sportifs,...) à cette
thématique.
À ce stade, nous avons des propositions de
réponse à notre question de recherche, mais il nous manque
certains éléments que nous aborderons dans la discussion.
7. Discussion
Ce chapitre a la finalité de reprendre les
résultats analysés et de les mettre en lien avec le travail
social. L'objectif est de proposer des pistes d'intervention et/ou de
présenter des initiatives afin de lutter contre les violences au sein
des relations amoureuses des adolescent-e-s. Pour ce faire, nous
développerons ces perspectives en fonction des axes analysés:
1. La violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s
2. Les spécificités bio-psycho-sociales de la
VRA
3. Le manque de visibilité
4. Les champs d'intervention de la VRA : prévention et
prise en charge
7.1. Quel rôle pour les professionnel-le-s du social
face à la violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s
Au terme de l'analyse, il ressort que la violence dans les
relations amoureuses chez les adolescent-e-s n'est pas identique à de la
violence conjugale. Les jeunes en fonction de leur genre interprètent
différemment la violence subie et infligée. Les mécanismes
de la violence sont majoritairement bidirectionnels comparés à
ceux de la violence conjugale qui sont unidirectionnels. Pour Douai (2019), la
réciprocité de la violence est en corrélation avec la
période de l'adolescence, où les jeunes se cherchent et testent
leurs limites et celles d'autrui. L'auteure souligne également que les
adolescente-s craignent le désamour (cité dans Breton, 2019). En
d'autres termes, le processus développemental des adolescent-e-s inclut
de la violence, mais celle-ci peut être intensifiée, car
l'expérimentation de soi et des autres peut générer une
cessation d'amour et d'intérêt des pair-e-s.
Une autre raison de la violence dans les relations amoureuses
est son côté pernicieux qui s'invite comme une preuve d'amour.
Beaucoup d'adolescent-e-s attribuent leurs actes de violence sous le couvert de
la jalousie. Grignard (2019) constate que la surveillance par le-la partenaire
peut être considérée comme de la jalousie sous
prétexte qu'on tienne à celui ou celle qu'on aime, mais cela peut
également être le début d'un cycle de violence (cité
dans Breton, 2019). La jalousie n'est pas un sentiment facile à
évaluer, si l'on se réfère aux propos des adolescent-e-s
(voir annexe 5). Nous constatons que la jalousie est autant indispensable
à une relation amoureuse qu'inutile, car c'est le résultat d'un
manque de confiance en soi.
P a g e 39 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
La peur de l'abandon, plus particulièrement la rupture,
conjuguées des émotions présentes comme la jalousie sont
des facteurs pouvant générer des violences dans une relation
amoureuse à l'adolescence. Cela nécessite une attention de la
part des parents et/ou des professionnel-le-s de ne jamais minimiser ou
banaliser ce que les jeunes ressentent.
L'accompagnement en amont est indispensable pour endiguer la
violence dans les relations amoureuses chez les adolescent-e-s. Taylor &
coll. (2018) évoquaient l'importance pour les jeunes filles
interrogées d'être entourées par des adultes de confiance.
Cette personne de confiance peut s'incarner par les parents, un membre de la
famille, mais également être un-e professionnel-le. Melchiori
(2018) est conseiller éducatif, il prône une écoute
attentive des parents, sans pour autant que ces derniers s'immiscent dans la
relation amoureuse de leur enfant, cela évitera des conflits potentiels.
Il conseille aux parents de recourir à de tierces personnes
(conseillère ou conseiller en éducation ou psychologue) afin que
le-la jeune s'exprime librement et puisse évoquer cette relation sans le
risque que le parent s'identifie et lui parle de sa propre expérience
(Melchiori, 2018). Si les parents ne se sentent pas assez outillés pour
évoquer les relations amoureuses avec leur adolescente, ils doivent
solliciter le recours d'une tierce personne ceci afin de garder une
communication la plus sereine possible.
La problématique de la VRA implique de nombreux
thèmes, notamment liés à des changements de
société. Parmi ces normes, nous avons constaté que
l'adhésion aux stéréotypes de genre participe à
alimenter cette violence. Selon Spence & coll., 1991 ; Steg &
Pirog-Good, 1987, les hommes emploieraient la violence pour contrôler la
relation amoureuse alors que les femmes emploieraient la violence à la
suite d'une perte de contrôle émotionnelle (cités dans
Gagné & Lavoie, 1995). Cette analyse de l'emploi de la violence
adhère par conséquent aux stéréotypes que la femme
agit sous l'émotion et que l'homme doit employer la force pour
contrôler sa relation amoureuse. L'adhésion aux
stéréotypes de genre crée une violence
supplémentaire dans la VRA, elle n'est pas générée
directement par les adolescent-e-s, mais par une société qui
peine à casser de nombreux préjugés.
L'adhésion aux normes socioculturelles ne facilite pas
la prise en charge des victimes et des auteur-es de violences dans les
relations amoureuses. Nous l'avons vu, les adolescents doivent se heurter
à une double injonction - être un homme viril, dominant et fort,
mais sans employer la force contre autrui et les adolescentes sont des victimes
toutes désignées, surtout au niveau des violences sexuelles.
Lichter et McCloskey (2004) évoquent que des études ont
souligné les attitudes positives envers les rôles traditionnels
liés au genre, qui est en-deçà des violences de couples et
cela tant pour les victimes et que les auteur-e-s (cités dans Dosil
& coll., 2020). Parmi ces rôles, on trouve celui du
stéréotype que les filles doivent se trouver un homme. Parrot
(1998) relève que certaines filles se sentent obligées d'avoir
une relation amoureuse, qu'elles y resteront même si cette
dernière est malsaine (cité dans Smith & Donnelly, 2008). Il
est préférable pour certaines filles/femmes d'avoir une relation
que d'être seules.
Delsinne (2019), éducatrice spécialisée,
abonde dans ce sens. Pour elle, les filles ont une tendance à se mettre
en danger en fréquentant des jeunes de milieux violents et/ou
délinquants, car elles obtiennent de l'attention et de la protection, ce
qui augmente les risques d'entretenir une relation abusive. Quant aux
garçons, l'éducatrice constate qu'ils ont une fausse
représentation d'une relation amoureuse, mais aussi de la femme. Ce
biais se construit dans la sphère familiale, mais également par
les médias (cité dans Breton, 2019).
P a g e 40 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Pourtant, Honnis (2019), assistante sociale, constate un
équilibre dans les violences commises par les garçons et les
filles. Si les violences physiques (pas spécifiques à la VRA)
sont commises par un plus grand nombre d'adolescents, les adolescentes sont
tout aussi violentes (cité dans Breton, 2009). Les jeunes filles sont
intrusives et enferment leurs pair-e-s tout autant que les jeunes hommes. En
tant que travailleurs sociaux et travailleuses sociales, il est important de ne
pas renforcer ces stéréotypes liés au genre. Il est
également important d'évaluer régulièrement les
faits de violence au sein d'un groupe d'adolescent-e-s, cela pourrait permettre
de saisir les enjeux et les finalités qui s'y rattachent.
La VRA au sein de la communauté
LGBTIAQ+6, mêmes enjeux, mêmes types de violences ?
Si la VRA chez les adolescent-e-s est une problématique peu
explorée, celle qui concerne les violences des relations amoureuses au
sein de la communauté LGBTIAQ+, l'est encore moins. Violence que faire?
(2011-2021) souligne que les regards et l'attention sont dirigés
majoritairement vers les couples hétérosexuels, pourtant les
autres types de couples sont également concernés par la violence.
Le site mentionne qu'il est particulièrement important que ces personnes
se sentent libres et légitimes d'oser se confier.
Ces changements sociétaux impactent l'accompagnement,
il est donc nécessaire et important de se former. Cottin & Boudet
(2019) ont constaté que l'une des difficultés pour les
conseillères conjugales et familiales en intervention résidait
dans la posture qu'elles adoptaient face à une thématique qui les
devançait, car les jeunes étaient souvent plus au fait que ces
dernières. Si certaines professionnelles se sentent
dépassées par ces questions, il est important que tous les
professionnel-le-s s'y attardent.
La votation du 26 septembre 2021, Mariage pour tous, va de
facto engendrer des changements. Parmi ceux-ci, nous évoquerons à
nouveau, le cadre légal des violences domestiques, qui pour rappel
condamne le ou la partenaire violent-e. Toutefois, ce changement de paradigme
exige de la part de tout un chacun de reconsidérer ces normes
liées aux genres, en acceptant que la violence dans une relation
amoureuse n'enferme pas les femmes dans le rôle de victimes et les hommes
dans celui d'auteurs. Les victimes et les auteur-e-s ne devraient pas
être lié-e-s à un genre, mais à une personne. Quand
bien même, si un homme est victime de violence de la part d'un autre
homme, ce dernier ne sera pas un homme faible, mais un homme victime; il sera
une victime.
7.2. Comment comprendre et interpréter les facteurs
bio-psycho-sociaux de la VRA en tant que professionnel-le-s du social?
Lors de l'analyse, il a été mis en
évidence que les facteurs de risques sont majoritairement
psychologiques. Cependant, ces conséquences psychiques se manifestent
par des symptômes physiques sur le long terme comme des maladies
cardiovasculaires, de l'hypertension, etc. De plus, la violence physique peut
laisser des traces. Les symptômes physiques (hématomes, griffures
ou autres) peuvent donner des indications sur d'éventuelles violences
dans la relation. Il en va de même pour les symptômes
psychosomatiques comme des maux de ventre et de tête et ou des crampes.
Les scarifications sont aussi une indication d'un mal-être chez les
adolescent-e-s. Tous ces signes doivent être considérés par
les professionnel-le-s, car les maux cachent généralement des
mots. Calden (2019) souligne que la violence est la manifestation d'un
mal-être:
6 Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Trans, Queers,
Intersex-e-s, Assexuel-le-s et le + correspond à tous les autres.
P a g e 41 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
La violence va toujours signaler un mal-être ou une
souffrance, un besoin certainement - et une impossibilité souvent - de
se faire entendre, de faire entendre quelque chose; elle signale une
difficulté à se situer par rapport aux autres, qui doit alerter
forcément (cité dans Breton, 2019, p.121).
Pour Honnis (2019), le manque d'estime de soi est un des
premiers facteurs à considérer pour les professionnel-e-s. Cela
est valable tant pour les victimes qui s'assujettissent par manque de confiance
en elles-eux que pour les auteur-e-s qui perpétuent la violence afin de
s'attribuer une identité (cité dans Breton, 2019).
Ces violences peuvent s'expliquer également par
résonance, il s'agit d'une analyse systémique. L'utilisation de
la violence serait non pas la cause, mais le symptôme d'un mal plus
profond. Delsinne (2019) éducatrice spécialisée, constate
que les violences (de toutes formes) dans une relation amoureuse, sont
dirigées envers une personne ou une situation précise, car cela
remémore à l'auteur-e, un épisode douloureux ou
insupportable survenu durant l'enfance. L'utilisation de cette violence permet
aux auteur-e-s de pallier ce traumatisme (cité dans Breton, 2019).
Une autre hypothèse que souligne O'Keefee (1986) est
que la violence psychologique est peu décelée par les
adolescent-e-s, car l'estime de soi se développe principalement au
moment de l'adolescence. De ce fait, cette compétence s'acquiert et elle
ne permet pas encore de déceler ce qu'est la violence psychologique et
de s'affirmer face aux dires dommageables de son-sa partenaire (cité
dans Smith & Donnelly, 2000).
A ce jour, les recherches en neurosciences démontrent
que la violence agit dans des zones spécifiques du cerveau. M. Keaser
nous a exposé l'exemple du cortex cingulaire antérieur qui
intervient comme une alarme neuronale lors de détresse
émotionnelle et de conflits, qui réagit lors
d'événements impliquant une douleur physique et/ou morale
vécue par soi-même ou par une tierce personne (communication
personnelle, 01 mars 2021). La docteure Kaeser atteste que les traumatismes
psychiques ou physiques modifient les fonctions cérébrales
liées aux émotions et aux situations stressantes (Khali, 2016).
Il est possible de soigner ces traumatismes par le biais d'Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (EMDR), de thérapies
cognitivo-comportementales, familiales dirigées par la communication
intra-familiale et le soutien parental (Khali, 2016). Il est donc
intéressant de s'intéresser aux sciences neuronales pour
comprendre comment la VRA se manifeste dans le cerveau de ces jeunes. Certes,
cela exige de mettre le focus sur les auteur-e-s et les victimes, mais cela
permettrait d'ouvrir un champ exploratoire encore peu investigué.
Les travailleurs sociaux et travailleuses sociales ne peuvent
pas tout endosser. Le choix d'évoquer certains types de thérapie,
ne sous-entend pas que les professionnel-le-s du travail social doivent
appliquer ces méthodes avec les jeunes qu'ils-elles accompagnent. En
revanche, ils-elles doivent entreprendre les démarches auprès du
réseau pluridisciplinaire. Les professionnel-le-s du travail social
peuvent être amené-e-s à solliciter des suivis
psychologiques et psychiatriques pour les jeunes qu'ils-elles accompagnent. De
ce fait, il est intéressant d'évoquer quelques pistes
d'intervention spécifiques qui sont conseillées lors de
traumatismes liés à la violence.
Si la VRA chez les adolescent-e-s peut s'expliquer par un
mal-être et/ou par un traumatisme enfoui, nous pouvons aussi
considérer l'environnement socio-économique. Le milieu familial
peut être un facteur de protection comme un facteur de risques face
à la VRA. Pour rappel, nous avons évoqué qu'un-e
adolescent-e victime de violence conjugale durant son enfance est plus à
risque de vivre de la VRA. Il en va de même pour les enfants qui n'ont
pas acquis un modèle d'attachement sécurisant.
P a g e 42 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
L'influence des pair-e-s est également à
considérer comme un facteur de risques pour la VRA chez les jeunes. Les
pair-e-s exercent une influence sur la consommation d'alcool et de cannabis
(Hébert & coll., 2018). Il est également constaté que
côtoyer des pair-e-s violent-e-s ou délinquant-e-s participe au
risque de VRA (Morris & coll., 2015, cités dans Hébert &
coll. 2018). Ces facteurs de risques doivent être
considérés, mais attention à ne pas tomber dans le
piège du déterminisme. Nous rappelons que la violence dans les
relations amoureuses chez les adolescent-e-s n'est pas liée à un
genre, ni à une classe sociale, ni même à une culture.
De surcroît, nous devons souligner que ces facteurs de
risques sont liés à la victimisation, mais aussi à la
perpétuation de la violence. Cela nécessite de la part des
travailleurs sociaux et travailleuses sociales de ne pas se focaliser
uniquement sur les victimes potentielles, mais de considérer
également les auteur-e-s.
7.3. Comment peut-on pallier le manque de visibilité de
la VRA ?
Le manque de visibilité de notre thématique est
préjudiciable. Le Canada et les États-Unis possèdent des
données conséquentes sur la VRA chez les jeunes. Cela permet
d'établir un état de la situation assez précis
(Hébert & coll., 2018). En revanche, en Europe cela n'est pas encore
le cas. Dosil & coll. (2020), soulignent l'importance que les sciences
sociales s'intéressent à la VRA chez les adolescent-es, car il
n'y a pas suffisamment de données et il y a encore beaucoup
d'incohérences. De plus, les auteur-e-s soulignent que si cette
problématique est liée à de la violence conjugale, la VRA
chez les adolescent-e-s ne doit pas être analysée et
traitée de manière similaire.
Avant de distinguer ces deux fléaux, il est
nécessaire de visibiliser cette problématique au plus grand
nombre. Afin de récolter des données en suffisance, il est
important de varier les méthodes de récoltes. Des questionnaires
auto-reportés permettent de récolter des milliers de
données, mais s'inscrivant dans un temps court et incluant quelques
biais liés aux normes et attentes de la société. Une autre
méthode de récolte est l'entretien semi-directif qui permet
d'approfondir le thème auprès de quelques candidat-e-s. La
récolte de données doit également s'instaurer dans le
temps. C'est pourquoi, il est nécessaire de développer des
études longitudinales. Cela permettra de mieux comprendre les
mécanismes de la violence en fonction de l'âge des jeunes.
Nous pouvons également utiliser ces deux
méthodes de recherches (quantitatives et qualitatives) auprès des
différent-e-s professionnel-le-s évoluant auprès
d'adolescent-e-s pour permettre d'analyser l'état de connaissance de ce
sujet.
Comme nous le stipulions ci-dessus, de nombreux
professionnel-le-s ignorent ou minimisent la problématique de la VRA et
de ce fait, ils ne sont eux ou elles-mêmes pas ou peu informé-e-s
à ce sujet. Afin d'agir de manière la plus efficiente possible,
il serait pertinent de pouvoir informer les professionnel-le-s sur cette
problématique. Un-e professionnel-le bien informé-e sera plus
à même de pouvoir détecter un problème de VRA chez
un-e adolescent-e. Lors d`une rencontre avec ce dernier, cette dernière
le-la professionnel-le pourra ainsi lui offrir un soutien plus adéquat.
Tou-te-s les professionnel-le-s qui ont un lien avec les
enfants/adolescent-e-s, devraient avoir les connaissances et outils
nécessaires pour aider, le cas échéant orienter, l'enfant
et ou l'adolescent-e en difficulté vers un-e professionnel-le du travail
social.
Le rôle des médias participe également
à la visibilisation de la violence domestique, surtout lors de ces
journées de sensibilisation, mais pas seulement. Récemment, un
article évoquait spécifiquement la VRA chez les adolescent-e-s.
L'auteure y mentionne quelques chiffres, évoque le peu de structures
qui
P a g e 43 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
accueillent ces jeunes, mais surtout insiste sur le fait que
cette violence était ignorée jusqu'à peu « le
phénomène des violences qui s'immiscent dans les couples
d'adolescents et de jeunes adultes a longtemps échappé à
tous les radars» (Reybaud, 2021).
La prévention universelle doit s'intensifier. Il existe
pourtant des journées internationales et nationales contre la violence
comme:
· Le 2 octobre : Journée internationale de la
non-violence.
· Le 20 novembre : Journée internationale des droits
de l'enfant.
· Le 25 novembre : Journée internationale contre les
violences faites aux femmes.
Ces journées peuvent être l'occasion d'aborder la
problématique de la VRA chez les adolescent-e-s tant au niveau
privé qu'au niveau institutionnel (écoles, foyers, centres
d'animation). En revanche, il serait peut-être plus intéressant
d'aborder une prévention par zone communautaire, comme
évoqué précédemment. L'avantage de l'approche
communautaire serait de cibler les lieux où les facteurs de risques sont
plus importants.
Il existe pourtant des programmes de prévention
(SE&SR, programme de la prévention de la violence dans les relations
amoureuses - ViRAJ, Programme de prévention et de la promotion traitant
de la violence dans les relations amoureuses et du harcèlement sexuel
[PASSAJ, Safe Dates,...) sont indispensables, car ils participent
à la visibilisation de la VRA chez les adolescent-e-s. C'est
également un premier accompagnement professionnalisé qui tend
à favoriser l'empowerment de ces jeunes.
7.4. La prévention de la VRA et le travail social
La prévention est l'une des missions des travailleurs
sociaux et travailleuses sociales qui promeut le changement social afin de
résoudre les problématiques en tenant compte « de la
capacité et la libération (empowerment) des personnes
afin d'améliorer leur bien-être» (Avenir social, 2010, p. 8).
Afin de favoriser cette action, les professionnel-le-s du travail social ont
besoin d'outils (formations, collaborations, documentations) leur permettant de
promouvoir ce changement.
Lors de l'analyse de nos textes, nous constations que la
thématique de la prévention qu'elle soit ciblée,
spécifique ou universelle ressort dans plusieurs textes.
Greenman & Matsuda (2016) expliquent que la plupart des
adultes, qu'ils-elles soient auteur-e-s ou victimes de violences graves
à l'âge adulte, avaient déjà perpétré
ou subi de la violence à l'adolescence (cités dans Glowacz &
Courtain, 2017).
Keaser explique que les personnes victimes d'un traumatisme
souffrent de modifications cérébrales fonctionnelles et que ceci
engendre une moins bonne capacité à gérer certaines
situations. Elles auront donc tendance à recourir à l'agression
pour gérer les conflits (Khali, 2016).
Glowacz & Courtain (2017) invoquent qu'une intervention
précoce pour les jeunes vivant de la violence devrait être mise en
place, toutefois, elles précisent que celle-ci ne devrait pas uniquement
être faite de manière répressive et mettent en garde sur le
risque de stigmatisation.
Hébert & coll. (2018) mettent en avant le fait que
les programmes de prévention ciblent principalement les victimes et/ou
les auteur-e-s de violence, mais que si l'on espère de meilleurs
résultats, il serait préférable de pouvoir effectuer des
programmes de prévention ciblant un public plus large. Ils parlent
également des programmes de prévention en ligne via des
plateformes interactives, mais qui pourraient comporter certains risques
(inconfort psychologique pendant ou après l'utilisation de la
plateforme, manque de soutien direct) s'ils ne sont pas encadrés.
P a g e 44 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Taylor & coll. (2017) parlent du programme Shifting
Boundaries qui touche les préadolescents de 10 à 13 ans dans le
cadre des violences sexuelles, qui aurait permis de diminuer la victimisation,
mais n'aurait pas eu d'impact sur la perpétration.
Tous ces points sont très pertinents et mettent bien en
avant toute la difficulté de la prévention.
Selon la prévention suisse de la criminalité, il
existe plusieurs formes de prévention, soit générale en
lien avec les politiques sociales, la famille qui joue un rôle central
dans le développement de l'enfant, l'école qui détecte et
intervient dans les relations entre les enfants, soit la prévention dans
l'espace public, qui concerne notamment l'aménagement de l'espace public
et la mise à disposition des professionnel-le-s pour les jeunes. Un
point intéressant à relever, dans la prévention
générale est la prévention précoce, qui a d'abord
été menée afin de combattre la toxicomanie, mais qui
aujourd'hui est utilisée pour la violence de manière plus
générale.
En cherchant d'autres informations à ce sujet, Garcia
& coll. (2015) expliquent que dans le cadre de la prévention,
même si un âge spécifique n'a pu être établi,
il est essentiel, de pouvoir mettre en place des interventions de
prévention aussi rapidement que possible, afin que les enfants puissent
bénéficier au mieux des interventions mises en place.
Dans le cadre de la violence au sein du couple chez l'adulte,
une des premières recommandations pour lutter contre la violence est la
prévention primaire. Les auteurs Guedes & Bott (2009) mentionnent la
prévention primaire comme le moyen « le plus
stratégique» pour mettre un terme à la violence faite aux
femmes. Dans l'étude Violence envers les enfants - Concept pour une
prévention globale, les auteur-e-s définissent la
prévention primaire comme la manière de renforcer les ressources
de protection personnelle. Ceci rejoint les propos de Glowacz & Courtain
(2017) qui promeuvent l'empowerment et le développement de
compétences socio-émotionnelles afin de pouvoir régler les
conflits autrement qu'au travers du prisme de la violence.
A la suite de l'analyse de nos résultats, il nous
paraît évident que les travailleurs sociaux et travailleuses
sociales ont un rôle central à jouer dans la prévention des
VRA chez les adolescent-e-s, au vu des conséquences que celle-ci peut
avoir sur la santé des jeunes qui la vivent.
Comment les professionnel-le-s et les proches
appréhendent ces adolescent-e-s vivant de la violence au sein de leur
relation amoureuse?
L'approche des professionnel-le-s se déploie à
plusieurs niveaux et de façons différentes. Il est
intéressant d'observer quelques pratiques et d'analyser les impacts de
celles-ci.
Au niveau microsocial, il existe des initiatives individuelles
comme celle d'une assistante sociale franco-canadienne qui exploite sa propre
histoire afin d'aider les jeunes vivant des violences dans leur relation
amoureuse. En effet, lors d'un stage au Canada dans un centre d'aide et
d'accueil mère-enfant 7 la jeune femme prend conscience
qu'elle a vécu de la violence dans son adolescence, à l'âge
de 16 ans (Breton, 2019). L'auteure a décidé d'exploiter ce
douloureux passé afin que d'autres jeunes prennent conscience de cette
violence. Le témoignage qu'elle propose dans son livre est un bon outil,
car il se présente comme un journal intime, évoquant divers
mécanismes de violences:
Il a commencé à venir à quelques matchs
à domicile, puis à chaque match, et finalement, même durant
nos déplacements. Lors des matchs, il passe son temps à regarder
toutes les personnes présentes dans chaque salle et il fixe les plus
jeunes pour voir s'ils me
7 La Bouée à Lac-Mégantic
P a g e 45 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
regardent. Si c'est le cas, Léo se montre très
froid, distant, parfois même en colère, comme si tout était
ma faute (Breton, 2019, pp. 50-51)
Breton (2019) ne se contente pas de partager son vécu,
elle l'exploite et propose un cahier pédagogique et des fiches pratiques
dans son ouvrage. Ce dernier contient une série de tests (Annexe 3 &
4) permettant aux jeunes de prendre conscience qu'ils-elles sont dans une
relation amoureuse violente et de distinguer ce qu'est une relation saine d'une
relation toxique. Toutefois, il faut souligner que ce témoignage et ces
outils s'exploitent avant tout dans des situations où la violence occupe
déjà une place dans la relation amoureuse.
En Suisse, il existe depuis 2011 un programme de
prévention Sortir ensemble et se respecter (SE&SR) qui sensibilise
la problématique de la VRA chez les jeunes et les adolescent-e-s; ce
programme « cherche donc à combattre les préjugés et
à mettre en place une prévention précoce des violences de
couple et de leurs effets désastreux, tout en offrant une ouverture vers
des relations gratifiantes» (De Puy & coll., 2013, p.153).
L'association propose une formation destinée aux professionnel-le-s du
travail social, de l'éducation, de l'enseignement et de la santé.
Les cours sont dispensés à la Haute école de travail
social de Lausanne (HETSL) sur trois jours et s'axent sur les savoirs,
savoir-être et savoir-faire (Clerc & coll., 2017). Cette formation
permet aux différents professionnel-le-s d'acquérir des outils et
des connaissances sur la problématique de la VRA. De plus, des
formations sont également proposées aux jeunes entre 13-18 ans,
mais peuvent être adaptées en fonction de l'âge du public et
également du contexte institutionnel. Il s'agit d'un programme de neuf
modules, d'une heure et quart chacun évoquant les thèmes
suivants:
|
·
|
Module 1 :
|
Définir ce que je veux dans une relation
|
|
·
|
Module 2 :
|
Définir les abus dans une relation
|
|
·
|
Module 3 :
|
Pourquoi les comportements abusifs
|
|
·
|
Module 4 :
|
Comment aider les ami-e-s en difficulté
|
|
·
|
Module 5 :
|
Des exemples pour aider les ami-e-s
|
|
·
|
Module 6 :
|
Ce qu'on s'imagine à propos des relations
|
|
·
|
Module 7 :
|
Les agressions sexuelles
|
|
·
|
Module 8 :
|
Partager le pouvoir et communiquer
|
|
·
|
Module 9 :
|
Mes sentiments, mes réactions
|
En proposant une formation dispensée directement au
public cible et par l'intermédiaire des professionnel-le-s, cela
augmente le potentiel d'information et de sensibilisation. Toutefois, il faut
spécifier que les programmes destinés directement aux
adolescent-e-s doivent être initié-e-s et mis en place par un-e
professionnel-le du travail social, de la santé ou de l'enseignement.
Cela souligne donc l'importance et la nécessité de diffuser la
problématique de la violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s auprès des profesionnel-le-s.
La prise en charge n'est jamais aisée surtout si la
violence est déjà présente. Les conseillères
conjugales et familiales interrogées ont souligné que certains
thèmes comme les violences sexuelles ou l'inceste sont difficiles
à gérer émotionnellement et que l'accompagnement l'est
également. En revanche, ces professionnelles ont souligné que
certaines personnes viennent simplement les consulter pour que ces violences
soient verbalisées par autrui (Cottin & Boudet, 2019).
P a g e 46 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Au niveau mesosocial, l'environnement scolaire est important,
car les adolescent-e-s le fréquentent de manière
régulière. De plus, il est important de rappeler l'importance des
pair-e-s. Ces relations sont essentiellement développées à
l'école et au collège pour s'élargir par la suite (Juhem,
1995).
A ce jour, de plus en plus de travailleurs sociaux et
travailleuses sociales ont leur place dans les écoles, ce qui semble
tout à fait cohérent avec le fait de vouloir endiguer la violence
dans ces lieux. Mais ont-ils-elles les outils suffisants pour travailler?
Comme nous l'avons vu, le risque de mener une
prévention ciblée sur les auteur-e-s ou les victimes est que ces
dernier-ères soient ensuite étiqueté-e-s et mis-es
à l'écart. De ce fait, il serait préférable de
faire de la prévention générale avec une meilleure
formation des professionnel-le-s, afin que la détection soit plus
efficiente. Ensuite, au cas par cas, de proposer des soutiens
personnalisés à chaque protagoniste qu'il-elle soit victime ou
auteur-e afin de l'accompagner, de l'aider à conscientiser et
développer ses propres ressources pour sortir de ce cercle de la
violence.
Dans cette perspective, la collaboration avec les
infirmier-ères scolaires des établissements est tout à
fait pertinente, car d'une part il est probable qu'elle-il puisse être la
personne qui constate des stigmates de violence. D'autre part,
l'infirmier-ière reste une intermédiaire de qualité quant
à la prise en charge au niveau de la santé, notamment au niveau
des consommations d'alcool et de cannabis. Pour rappel, la consommation de
produits augmente le risque de vivre ou de commettre de la VRA. Les
infirmier-ères ont un rôle non négligeable à jouer
dans le cadre de la prévention(Bernèche, 2014).
Une collaboration pluridisciplinaire entre l'enseignant-e,
l'infirmier-ère et la-le professionnel-le du travail social pourrait
renvoyer un message clair et sécurisant aux jeunes, qu'ils-elles vivent
une situation difficile ou non. Les adolescent-e-s doivent pouvoir se
référer à un-e adulte, d'autant plus s'ils-elles ne
peuvent pas en parler et trouver du soutien auprès de leur famille.
De ce fait, nous nous demandons si la prévention des
violences, plus précisément la violence au sein du couple
adolescent, mais aussi adulte, devrait être mise en place dès
l'école primaire ? Si l'éducation sexuelle commence au niveau
primaire, pourquoi la prévention de la violence doit-elle attendre le
secondaire, sachant que les répercussions sur la santé peuvent
être aussi importantes que celles en lien avec la santé
sexuelle?
A ce jour, en Suisse, la prévention concernant les
violences est faite dans les écoles principalement à partir du
niveau secondaire. Si l'on se réfère aux recommandations
expliquées plus-haut, la prévention devrait être mise en
place le plus tôt possible afin d'espérer un maximum d'impact.
De plus, comme nous l'avons vu, un-e enfant vivant une
problématique de violence, aura de la peine à se concentrer, aura
de moins bons résultats et sera plus à risque de le
répéter plus tard.
P a g e 47 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Conclusion
« La violence nuit gravement à l'amour»
(Campagne jurassienne contre la VRA, 2007). La violence dans les relations
amoureuses est nocive pour les adolescent-e-s. Ce travail a l'ambition de
mettre en lumière cette problématique peu connue. Une violence
qui se manifeste au travers des violences psychologiques, physiques et
sexuelles, dont les mécanismes ne sont pas identiques à de la
violence conjugale. Une violence qui, comme chaque maladie, trouve ses origines
parmi différents domaines: psychologiques, biologiques et sociaux. Nous
avons mis en évidence les facteurs de risque et de protection permettant
de mieux saisir les impacts possibles. Toutefois, il est important de ne pas
minimiser cette problématique et de ne pas tomber dans le
déterminisme. La violence dans les relations amoureuses n'a pas de
culture, ni de classe sociale.
Nous espérons avoir mis en avant les apports et les
limites qui concernent cette thématique.
La problématique de la VRA chez les adolescent-e-s
comporte plusieurs obstacles. Il n'est pas aisé de définir des
violences qui s'inscrivent dans le monde de l'enfance et dans le monde des
adultes. En nous intéressant au cadre légal, nous ouvrons bon
nombre de textes législatifs suisses, mais également des
conventions internationales, mais force est de constater qu'il n'y a pas une
base légale spécifique.
La violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s n'est pas propre à de la violence juvénile, ni
à de la violence conjugale. Tout comme le sont les adolescent-e-s,
ils-elles ne sont plus des enfants, mais pas encore des adultes. Une violence
qui intervient entre l'enfance et l'âge adulte. Cela explique
peut-être que cette problématique ait échappé aux
radars des professionnel-le-s de plusieurs domaines y compris le travail
social. Pourtant, la recherche en sciences sociales s'y intéresse, mais
l'intérêt récent que suscite ce thème engendre des
données contradictoires et disparates. A ce jour, les recherches
quantitatives existent, mais les qualitatives sont plus rares. Il est important
d'augmenter le travail préventif directement avec le public cible par le
biais d'entretiens ou de groupes de discussion. De plus, il manque de
méta-analyses, mais également d'évaluation des programmes
de prévention.
Si la VRA chez les adolescent-e-s manque de visibilité,
il est prouvé que la violence a des impacts directs et indirects sur le
développement des jeunes. De surcroît, les risques de
perpétration et de victimisation peuvent s'accroitre sans une prise en
charge adaptée. La violence n'est pas une compétence, il est
important que les adolescent-e-s trouvent une autre issue pour résoudre
leurs conflits et/ou exprimer un mal-être plus profond. Comment peut-on
intervenir auprès de ces jeunes qui évoluent essentiellement
auprès de leurs pair-e-s?
Ce travail a mis en en lumière le rôle des
professionnel-le-s du travail social face à cette problématique.
Ce rôle n'est pas restreint et se déploie sous de multiples
formes. Les travailleuses sociales et travailleurs sociaux peuvent s'investir
dans la prévention autant dans l'accompagnement individuel que dans la
collectivité. Il en va de même pour la prise en charge, si un-e
jeune se confie sur sa relation amoureuse, le-la professionnel-le ne doit pas
minimiser celle-ci et pouvoir conseiller et détecter des violences que
l'adolescent-e ne sera peut-être pas en capacité
d'interpréter. Il est important de considérer tous les champs de
possibles. Une prise en charge adéquate considère tous les
domaines (suivi psychologique et/ou psychiatrique, judiciaire, groupe de
paroles, enseignement, etc.). Cette pluridisciplinarité est essentielle,
elle permet un accompagnement et une prise en charge complète, mais
surtout, elle ouvre des portes supplémentaires qui favorisent la
visibilisation de cette problématique.
Les professionnel-le-s du travail social peuvent
également participer à la déconstruction des
stéréotypes liés au genre. Comme nous l'avons
évoqué, la VRA chez les jeunes peut trouver ses origines dans les
préconstruits culturels qui sont attribués aux hommes et aux
femmes. Les professionnel-le-s
P a g e 48 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
doivent être vigilant-e-s pour ne pas renforcer cette
adhésion aux normes socio-construites. Ce thème serait d'ailleurs
un objet d'étude intéressant et d'actualité.
La violence dans les relations amoureuses à
l'adolescence peut être envisagée sous différents focus. Ce
travail s'est concentré pour l'essentiel sur les relations amoureuses
violentes hétérosexuelles chez les adolescent-e-s. Nous avons
fait ce choix afin d'apporter un éclairage supplémentaire sur
cette période charnière du passage du monde de l'enfance à
celui du monde adulte, qui représente un véritable chamboulement
pour chaque individu. Il serait tout aussi important, afin de pouvoir mieux
étayer le sujet de la violence au sein des relations, de
s'intéresser aux adulescent-e-s (18-24 ans), qui représentent une
population tout aussi fragile qui est également en quête dans sa
construction identitaire et aussi, à la violence dans les relations
amoureuses homosexuelles chez les jeunes et chez les adultes.
Nous avons survolé les enjeux liés à la
démocratisation et l'emploi très fréquent des technologies
de l'information et de la communication (TIC) par les adolescent-e-s, notamment
par le biais des réseaux sociaux. L'emploi de ces différentes
plateformes amplifie le risque de victimisation et de perpétuation de la
violence. Une analyse plus détaillée de ce
phénomène participerait à étayer la VRA chez les
jeunes.
La violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s est un sujet complexe. C'est un sujet de niche, mais il existe
néanmoins des solutions que les travailleurs sociaux et travailleuses
sociales peuvent proposer, initier et construire; c'est l'une des missions du
travail social.
P a g e 49 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Références bibliographiques
Amnesty International (s.d.). Violence conjugale. Qu'est-ce
que la violence conjugale?
Récupéré de
https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/les-violences-
conjugales/article/violence-conjugale
Avenir Social. (2010). Code de déontologie du travail
social en Suisse: Un argumentaire pour la pratique des professionnel-le-s.
Berne, Suisse : Avenir Social.
Baudet, T. & Rezzoug, D. (2018). Troubles liés aux
traumatismes chez les enfants. La Revue du praticien. 68. 307-311.
Récupéré de
https://www.larevuedupraticien.fr/article/troubles-lies-aux-traumatismes-chez-les-enfants
Bernèche, F. (2014, mai) La violence dans les relations
amoureuses chez les jeunes: des liens avec certains comportements à
risque? Institut de la statistique du Québec. Zoom santé
(44). Récupéré de
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201405-44.pdf
Breton, A. (2019). C'est pas ça l'amour. Les
violences amoureuses à l'adolescence. Tournai, Belgique :
Formbox.
Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes - BFEG. (Juin, 2020). Feuilles d'informations
spécifiques à la violence domestique - 4 B. La violence dans
les relations de couple entre
jeunes. Berne: Confédération suisse.
Récupéré de
https://ebg.admin.ch/efg/fr/home/documentation/publications-en-général/publactions-violence.html
Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes - BFEG. (Juin, 2020). Feuilles d'informations
spécifiques à la violence domestique - A1. Violence
domestique: définition, forme et
conséquences. Berne: Confédération
suisse. Récupéré de
https://ebg.admin.ch/efg/fr/home/documentation/publications-en-général/publactions-violence.html
Bureau fédéral de l'égalité entre
femmes et hommes - BFEG. (juin, 2020). Feuilles d'informations
spécifiques à la violence domestiques - 6 A. Violence
domestique: formes sexospécifiques et conséquences. Berne:
Confédération suisse. Récupéré de
file:///C:/Users/zo ni/AppData/Local/Temp/a6
formes-sexospecifiques-et-consequences-des-violences-domestiques.pdf
Cheseaux, J.-J., Duc Marwood, A., Romain Glassey, N. (2013).
Exposition de l'enfant à des violences domestiques. Un modèle
pluridisciplinaire de détection, d'évaluation et de prise en
charge.
Revue Médicale Suisse. Récupéré de
https://www.revmed.ch/view/480537/403996/RMS
idPAS D ISBN pu2013-07s sa02 art02.pdf
Clerc, K., Kuenzli, A., Hofner, M.-C. & Minore, R. (2017,
février). Formation à l'animation du programme de
prévention des violences et des comportements abusifs auprès des
jeunes (documents à titre d'exemple). Sortir ensemble et se
respecter (SE&SR). Récupéré de
https://www.sesr.ch/fileadmin/userupload/FR/Autres/InformationsformationSEESR01.pdf
Cloutier, R. & Drapeau, S. (2015). Psychologique de
l'adolescence (4ème éd.). Montréal,
Canada: Chenelière.
P a g e 50 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (= CC, RS 210 ;
état le 1er janvier 2021) Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (= CP ; RS 311.0 ; état le 1er juillet
2021)
Conférence Suisse contre la Violence Domestique (2018).
Approbation et mise en oeuvre de la Convention d'Istanbul.
Récupéré de
https://csvd.ch/bases-legales/suisse/
Convention d'Istanbul. (2011). Convention du Conseil de
l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes et la violence domestique (= RS 0.311.35.9).
Récupéré de
https://rm.coe.int/1680462533
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (=
RS 0.107 ; état le 25 octobre
2016)
Cottin, J. & Baudet, M. (2019). Comment les
conseillères conjugales et familiales abordent-elles la santé
affective et sexuelle auprès des adolescents? [Thèse de
doctorat, Université d'Angers]
Récupéré de
https://dune.univ-
angers.fr/fichiers/16010646/2019MCEM11644/presentation/11644P.pdf
Courtecuisse, V. (1996). Interactions entre violences agies et
violences subies. Dans Rey, C. (dir.), Les adolescents face à la
violence (pp. 13-24). Paris, France : Syros.
Cyrulnik, B. (2019, 24 janvier). Rencontre avec Boris
Cyrulnik : « La résilience » [vidéo] In Les
conférences. Youtube.
https://youtu.be/bKfyNIRdVQU
Daligand, L. (2019). La violence conjugale
(2ème éd.). Paris, France: Presses
universitaires de
France.
De Puy, J., L. Hamby, S. & Monnier, S. (2013). Sortir
ensemble et se respecter. Tout un
programme... In Des Nouvelles questions
féministes, 32, 151-155.
https://doi.org/10.3917/nqf.321.0151
Dosil, M., Jaureguizar, J., Bernaras, E. & Burges Sbicigo
(2020). Teen Dating Violence, Sexism, and Resilience : A multivariate Analysis.
International Journal of environnemental research and public Health 17
(2652). Récupéré de
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/8/2652
Gagné, M.-H. & Lavoie, F. (1995). La violence physique
et la maltraitance affectives dans les fréquentations chez un groupe
d'adolescent(e)s. Revue canadienne de counseling 29. 26-36.
Récupéré de
https://cjc-rcc.ucalgary.ca/article/view/58517/44016
Garcia, M., Rouchy, E., Soulet, E., Meyer. E. & Michel, G.
(2015). De la prévention précoce des conduites antisociales,
agressives et délictueuses chez l'enfant et l'adolescent: une revue
systématique des programmes d'intervention. Sciences directes.
Récupéré de
https://doi.org/10.1016/j.amp.2019.02.003
Gerrig, R. & Zimbardo, P. (2008) Psychologie (18e
éd.). Paris, France: Pearson Education.
P a g e 51 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Glowacz, F. & Courtain, A. (2017). Violences au sein des
relations amoureuses des adolescents et jeunes adultes: une
réalité à ne pas négliger. Champ
pénal/Penal field, XIV. Récupéré de
http://champpenal.revues.org/9582
Guedes, A. & Bott, S. (2009). Encourager la
prévention primaire. ONU FEMMES. Centre de Connaissances Virtuel
pour Mettre Fin à la Violence contre les Femmes et les Filles.
Récupéré de
https://www.endvawnow.org/fr/articles/318-encourager-la-prvention-primaire.html
Hébert, M., Lapierre, A., Lavoie, F., Fernet, M. &
Blais, M. (2018). La violence dans les relations amoureuses des jeunes. Dans
Laforest, J., Maurice, P., Bouchard, L.M. (dir.), Rapport
québécois sur la violence et la santé pp. 98-129.
Montréal : Institut national de santé publique du Québec.
Récupéré de
https://inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380
chapitre-4.pdf
Heise, L. & Garcia-Moreno, C. (2002). La violence
exercée par des partenaires intimes. In : Krug EG et coll. (éd.).
Rapport Mondial sur Violence Santé pp. 87-121. Organisation
mondiale de la santé.
Récupéré de
https://www.who.int/violenceinjuryprevention/violence/worldreport/en/chap4fr.pdf?ua=1
Juhem, P. (1995). Les relations amoureuses des lycéens.
Sociétés contemporaines 21. Les mondes des
jeunes pp. 29-42. Récupéré de
https://doi.org/10.3406/socco.1995.1417
Junguenet, C. (s.d., mis à jour le 10 février
2012). Ado et porno: des liaisons vraiment dangereuses ?.
Psychologies. Récupéré de
https://www.psychologies.com/Famille/Ados/Sexualite-des-ados/Articles-et-Dossiers/Ado-et-porno-des-liaisons-vraiment-dangereuses/4
Khali, F. (2016, 10 mars). Les cicatrices neurologiques de la
violence. Alma & Georges.
https://www.unifr.ch/alma-georges/articles/2016/les-cicatrices-neurologiques-de-la-violence
Lafrenayse-Dugas, A.-J., Fernet, M., Hébert, M., Blais,
M. & Godbout, N. (2021). Expérience amoureuse la plus difficile:
Qu'en disent les garçons rapportant un vécu de violence physique
dans leurs relations amoureuses? International Journal of Child and
Adolescent Resilience/Revue
https://doi.org/10.7202/1077721ar
Lessard, G., Montminy, L., Lesieux, E., Flynn, C., Roy, V.,
Gauthier, S. & Fortin, A. (2015). Les violences conjugales, familiales et
structurelles : vers une perspective intégrative des savoirs,
Enfances familles génération.
Récupéré de
http://journals.openedition.org/efg/425
Loi cantonale neuchâteloise du 5 novembre 2019
d'application sur la lutte contre la violence domestique (=LVD ; RSN 322.05 ;
état au 1er janvier 2020)
Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (=DPmin ; RS 311.1 ; état au
1er juillet 2019)
Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (= LAVI ; RS 312.5 ; État le 1er janvier 2019)
P a g e 52 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Lucia, S., Stadelmann, S., Pin, S. (2018). Amour,
sexualité et comportements violents ou abusifs au sein des jeunes
couples. Dans Lucia, S., Stadelmann, S., Pin, S. Enquêtes
populationnelles sur la victimisation et la délinquance chez les jeunes
dans le canton de Neuchâtel (pp. 91-108). Lausanne: Institut
universitaire de médecine sociale et préventive. Raisons de
santé 288.
http://dx.doi.org/10.16908/issn.1660-7104/288
Lucia, S., Stadelmann, S., Ribeaud, D. & Gervasoni, J.-P.
(2015). Enquêtes populationnelles sur la victimisation et la
délinquance chez les jeunes dans le canton de Vaud. Lausanne:
Institut
universitaire de médecine sociale et préventive.
Raisons de santé 250.
https://serval.unil.ch/resource/serval:BIBFA2A605C8F5C.P001/REF
Maïdi, H. (2014). Narcissime à l'adolescence.
Journal de la psychanalyse de l'enfant 4. 123-140.
Récupéré de
https://doi.org/10.3917/jpe.007.0123
Melchiori, M. (2018). Parents, ados, on se détend !
Toutes les clés pour décoder nos ados et rester en lien. Paris,
France : Flammarion.
Office fédéral de la statistique. (2021, 22 mars).
Code pénal (CP) : Infractions de violence domestique et
prévenus. Confédération suisse.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/police/violence-domestique.assetdetail.15844465.html
Office fédérale des assurances sociales (2005, 5
septembre). Famille & Société. Violence envers les
enfants - Concept pour une prévention globale.
Confédération suisse.
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/kinder/studien/gewalt-gegen-
kinder praevention.pdf.download.pdf/violence envers
lesenfantsconceptdeprevention.pdf
Organisation mondiale de la santé. (2002). Rapport
mondial sur la violence et la santé. Récupéré
de https://www:who.int/violence injury prevention/violence/world
report/en/full fr.pdf
Organisation mondiale de la santé. (2021).
Violence
https://www.who.int/topics/violence/fr/
Papalia, D.E., Olds, S.W., & Felman, R. D. (2010).
Psychologie du développement humain (7ème
éd.). Montréal, Canada : Beauchemin.
Prévention Suisse de la Criminalité (2015).
Péril en la demeure. Pourquoi la violence
domestique n'est pas une affaire privée?
Récupéré de
https://www.skppsc.ch/fr/sujets/violence/violence-domestique/
Prévention Suisse de la Criminalité (s.d.).
Violence. Violence juvénile. Récupéré de
https://www.skppsc.ch/fr/sujets/violence/violence-juvenile
Prévention de l'enfance Suisse (s. d.). La protection
des enfants contre la violence sexuelle sur Internet - prise de position sur la
situation en Suisse. Récupéré de
https://www.kinderschutz.ch/media/3dljsvke/la-protection-des-enfants-contre-la-violence-sexuelle-sur-internet-%C3%A2-prise-de-position-sur-la-situation-en-suisse.pdf
Rey, C. (1996). Les adolescents face à la violence.
Paris, France : Syros.
Reybaud, A. (2021, 20 novembre). Je ne savais pas qu'on pouvait
subir ça à l'adolescence»:
les violences conjugales touchent aussi les jeunes. Le
Monde.
P a g e 53 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/11/20/je-ne-savais-pas-qu-on-pouvait-subir-ca-a-l-adolescence-les-violences-conjugales-touchent-aussi-les-jeunes61029074401467.html
Roman, P. (2016) La violence à l'adolescence, nouvelle
scène des mauvais traitements dans l'enfance ?. Paediatrica 27(3).
26-27. Récupéré de
https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/la-violence-a-ladolescence-nouvelle-scene-des-mauvais-traitements-dans-lenfance/
Seidah, A., Bouffard, T. & Vezeau, C. (2004). Perceptions de
soi à l'adolescence: différences entre filles et garçons.
Enfance. 56. 405-420.
https://doi.org/10.3917/enf.564.0405
Siksou, M. (2008). Georges Libman Engel (1913-1999) : Le
modèle biopsychosocial et la critique du réductionnisme
biomédical. Le Journal des psychologues. 260. 52-55.
https://doi.org/10.3917/jdp.260.0052
Smith, M. D. & Donnelly, J. (2000). Adolescent Dating
violence. Journal of prevention& ; Intervention in the Community
21(1). 53-64.
https://doi.org/10.1300/J005v21n0104
Taylor, S., A. Calkins, C., Xia, R. & L. Dall. (2017).
Adolescent Perception of Dating violence : A qualitative Study. Faculty
Publications, Departement of Child, Youth, and family studies. 181.
Récupéré de
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=famconfacpub
Théorêt, M. (2005). La résilience, de
l'observation du phénomène vers l'appropriation du concept par
l'éducation. Revue des sciences de l'éducation, 31(3),
633-658. Récupéré de
https://doi.org/10.7202/013913ar
Tilmant, J. (2019). Définitions. Dans. J. Tilmant,
Du trauma à la résilience (pp. 15 - 21). Nîmes,
France: Champ social.
https://www.cairn.info/du-trauma-a-la-resilience--9791034604814-page-15.html
UNICEF. (1989). Convention relatives des droits de
l'enfant. Récupéré de
file:///C:/Users/zoni/AppData/Local/Temp/un-kinderrechtskonventionfr-1.pdf
Violence que faire? (2011-2021). Violence dans les couples
LGBTIQ+.
https://www.violencequefaire.ch/fr/zooms/violence-dans-les-couples-lgbt
Winter, J. (2001). Le grand amour. La lettre de l'enfance
et de l'adolescence, 19-26. Récupéré de
https://doi.org/10.3917/lett.045.26
Zimmermann, G., Barbosa Carvalhosa, M., Sznitman, G., Van
Petegem, S., Baudat, S., Darwiche, J., Antonietti, J.-P. & Clémence,
A. (2017). Conduites à risque à l'adolescence : manifestations
typiques de construction de l'identité ? NecPlus. Enfance, 2(2),
239-261.
https://doi.org/10.3917/enf1.172.0239
P a g e 54 | 62
P a g e 55 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Annexes
Annexe 1 : Grille d'extraction
|
Thèmes
|
Axes
|
Dimensions
|
Sous-dimensions
|
Contenu
|
|
Violence dans les relations amoureuses chez les
adolescent-e-s
|
Généralité
|
|
|
|
|
mécanisme
|
|
|
|
Genre
|
|
|
compréhension
|
Adolescent-e-s
|
|
|
Fille
|
|
|
garçon
|
|
|
Physique
|
subie
|
générale
|
|
|
Chez les filles
|
|
|
Chez les garçons
|
|
|
infligée
|
générale
|
|
|
Chez les filles
|
|
|
Chez les garçons
|
|
|
Psychologique
|
subie
|
générale
|
|
|
Chez les filles
|
|
|
Chez les garçons
|
|
|
infligée
|
générale
|
|
|
Par les filles
|
|
|
par les garçons
|
|
|
Sexuelle
|
subie
|
générale
|
|
|
Chez les filles
|
|
|
Chez les garçons
|
|
|
infligée
|
générale
|
|
|
par les filles
|
|
|
par les garçons
|
|
P a g e 56 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
|
Thèmes
|
Axes
|
Dimensions
|
Sous-dimensions
|
Contenu
|
|
Complexité de la VRA
|
Biologique
|
Général
|
|
|
|
Capacité physique
|
|
|
|
Invalidité
|
|
Sexualité
|
|
Traumatisme
|
|
Facteurs endocriniens
|
|
|
|
Prédisposition génétique
|
|
|
|
Psychologique
|
Général
|
|
|
|
Estime de soi
|
|
|
|
Capacité d'adaptation
|
|
|
|
Maladie/troubles
|
|
|
|
Identité personnelle
|
|
|
|
Relation avec les parents (Fratrie)
|
|
|
|
Comportements
sexualité
|
|
|
|
Consommation (alcool
et cannabis)
|
|
|
|
Social
|
Général
|
|
|
|
Pair-e-s
|
|
|
|
Système de valeurs
|
|
|
|
Lié au genre
|
|
|
Contexte familial
|
|
|
|
Ecole
|
|
|
|
Loisirs
|
|
|
|
Niveau socio-
économique
|
|
|
P a g e 57 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
|
Thèmes
|
Axes
|
Dimensions
|
Sous-dimensions
|
Contenu
|
|
Manque de visibilité de la VRA
|
Recherche
|
Type
|
Quantitatives
|
|
|
Qualitatives
|
|
|
Longitudinales
|
|
|
Enquêtes
populationnelles
|
|
|
Pluridisci-
plinaire
|
Société
|
|
|
|
Travail social
|
|
|
|
Santé, médecine
|
|
|
|
Education
|
|
|
|
Société
|
Général
|
Autre
|
|
|
Thèmes
|
Axes
|
Dimensions
|
Sous-dimensions
|
Contenu
|
|
Champs d' intervention
|
Prévention
|
Universelle
|
|
|
|
Moyen outil
|
|
|
Ciblée
|
|
|
|
Outil/moyen
|
|
|
Spécifique
|
|
|
|
Outil/moyen
|
|
|
Prise en charge
|
Professionnel-l-e-s
|
|
|
|
Famille
|
|
|
|
Amis
|
|
|
|
Associations
|
|
|
|
Santé, médecine
|
|
|
|
École obligatoire
|
|
|
|
Ecole professionnelle, postobligatoire
|
|
|
|
pénal
|
|
|
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Annexe 2 : Fiche pratique - les formes de violence
LES FORMES DE VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE
O Il-elle veut toujours savoir où je suis, avec qui et ce
que je fais.
O Il-elle a accès à mes réseaux sociaux.
O Il-elle me harcèle par téléphone, m'envoie
beaucoup de textos.
O Il-elle m'humilie devant les autres.
O Il-elle invente des rumeurs sur moi.
O Il-elle me critique souvent.
VERBALE
O Il-elle m'insulte.
O Il-elle fait du chantage quand il-elle veut quelque chose.
O Il-elle me crie dessus.
O Il-elle me menace.
PHYSIQUE
O Il-elle me bloque le passage quand je veux partir.
O Il-elle me lance des objets pour me blesser.
O Il-elle me tire les cheveux.
O Il-elle me donne des coups.
O Il-elle frappe dans les murs pour me faire peur.
SEXUELLE
O Il-elle m'oblige à avoir un rapport sexuel.
O Il-elle me force à regarder des images
pornographiques.
O Il-elle fait du chantage pour que j'accepte tout acte
sexuel.
O Il-elle ne cesse pas un acte sexuel malgré ma
volonté d'arrêter.
(c) Breton (2019). C'est pas ça l'amour.
p.148
P a g e 58 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Annexe 3 : Fiche pratique - relation saine vs relation toxique
RELATION SAINE VS RELATION TOXIQUE
MES DROITS
q Décider de qui je veux fréquenter.
q Avoir des opinions et des goûts différents de
ceux de mon-ma partenaire.
q Avoir mes croyances, mes valeurs.
q Conserver mes relations avec mes ami-e-s, ma famille.
q Exiger du respect.
q Exprimer mon désaccord.
q Exprimer mes goûts.
q Mettre mes limites.
q Mettre fin à une relation lorsque je le
désire.
MES RESPONSABILITÉS
q Considérer l'autre comme mon égal.
q Considérer autant l'opinion de l'autre que la
mienne.
q Admettre mes torts et mes erreurs.
q Respecter les limites de l'autre.
q Préserver ce qui est important pour moi.
LES SIGNES D'UNE RELATION SAINE
q Je suis écouté-e.
q Je suis respecté-e.
q Je suis moi-même dans cette relation.
q Je me sens en sécurité.
q Mon-ma partenaire tient compte de mes besoins.
LES SIGNES D'UNE RELATION TOXIQUE
q Je suis contrôlé-e : mon-ma
partenaire me dit ce que j'ai le droit de faire, comment je dois m'habiller,
il-elle décide à ma place des ami-e-s que je peux voir, il-elle
vérifie où je suis, ce que je fais et avec qui...
q Je me sens humilié-e : mon-ma
partenaire m'insulte, il-elle me rabaisse, il-elle me met mal à l'aise
devant d'autres personnes, il-elle ne respecte pas mes opinions...
q Il-elle est imprévisible : j'ai
l'impression de marcher sur des oeufs, il-elle se met en colère
rapidement, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de mal agir...
(c) Breton. (2019). C'est pas ça l'amour.
p.147.
Page 59 | 62
P a g e 60 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
Annexe 4 : Fiche pratique - les signes de la violence
Faites le test
LES SIGNES DE LA VIOLENCE
Suis-je victime de comportements violents?
OUI NON
· J'ai peur de ses réactions. O O
· Il-elle critique sa façon de m'habiller. O O
· Je ne peux pas parler à quelqu'un sans son accord.
O O
· Je me sens triste et seul-e. O O
· Il-elle veut toujours savoir ce que je fais, avec qui je
suis et où je suis. O O
· Si je ne réponds pas assez vite à ses
messages, il-elle s'énerve. O O
· Il-elle a toujours une excuse pour justifier son
comportement. O O
· Il-elle exerce une pression sur moi pour avoir un rapport
sexuel. O O
· Il-elle m'insulte et me crie dessus. O O
· Il-elle menace de se suicider si je mets fin à
notre relation. O O
Suis-je responsable de comportements
violents?
|
|
OUI
|
NON
|
|
·
|
Je le-la surveille tout le temps.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je l'empêche de voir certaines personnes.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je critique sa façon de s'habiller.
|
O
|
O
|
|
·
|
J'ai accès à tous ses réseaux sociaux.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je l'insulte et je lui crie dessus.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je l'humilie devant les autres.
|
|
|
|
·
|
Je veux toujours ou il-elle est et ce qu'il-elle fait.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je fais pression sur lui-elle pour avoir un rapport sexuel.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je critique son entourage.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je lui envoie des messages et l'appelle à
répétition.
|
O
|
O
|
|
·
|
Je le-la dévalorise.
|
O
|
O
|
Suis-je témoin de comportements
violents?
|
|
OUI
|
NON
|
|
·
|
Il-elle est toujours en train de le-la comparer aux autres.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle contrôle ses allées et venues.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle fait des crises de jalousie.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle ne supporte pas qu'il-elle sorte avec ses ami-e-s.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle trouve toujours des excuses pour justifier son
comportement.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle semble mal à l'aise en sa présence.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle annule toujours nos sorties au dernier moment.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle est toujours triste.
|
O
|
O
|
|
·
|
Il-elle a arrêté de me parler sans raison.
|
O
|
O
|
(c) Breton (2019). C'est pas ça l'amour. p.150
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s. Annexe 5 : La jalousie
ce que les adolescent-e-s en disent
TU PENSES QUE C'EST NORMAL D'ÊTRE JALOUX OU JALOUSE
LORSQU'ON EST EN COUPLE ?
§ Oui, pour moi c'est normal que mon copain puisse
être jaloux, mais tout dépend du degré de jalousie. Fille
n° 1, France.
§ Je ne pense pas que cela soit normal dans tous les
couples, mais cela peut être dû à un manque de confiance en
soi de la part de la personne jalouse. Fille n° 2, France
§ Un minimum oui, mais pas plus. Fille n° 4, France
§ Non, je crois que la jalousie n'est pas une forme
d'amour. Les deux personnes en couple devraient avoir confiance en l'autre.
Fille n° 6, France
§ Pas forcément; on peut ne pas être jaloux,
mais voir sa copine ou son copain avec un-une autre, ça nous fait
toujours mal et je pense que ça, c'est de la jalousie. Garçon
n° 1, France.
§ Pas obligatoirement; tout dépend de comment est la
personne, mais la jalousie est toujours présente dans un couple, de
différentes manières. Garçon n° 2, France.
§ Oui, car si le garçon va voir une autre fille, sa
copine est jalouse. Garçon n° 4, France
§ Moi, je trouve que c'est normal, ça montre
à l'autre qu'on tient vraiment à lui. Fille n° 13,
Québec
§ Elle est toujours jalouse avec moi, elle peut me faire
confiance, mais des fois, c'est un peu énervant. Garçon n° 7
Québec
§ Moi, je pense qu'on peut être jaloux, mais tout
dépend de l'intensité et de la situation. Quand on est amoureux,
ça arrive d'être jaloux, mais faut pas non plus que ça soit
excessif. Fille n° 14, Québec
§ Oui et non, car il faut quand même faire confiance
à l'autre et surtout à soi-même. Garçon n° 17,
Belgique
§ Je trouve ça normal, cela prouve que la personne
compte pour nous, mais il ne faut pas l'être de trop. Garçon
n° 21, Belgique
§ Bien sûr, mais pas à tout lui interdire.
Garçon n° 23, Belgique
§ D'après moi, non, car il doit y avoir cette
confiance, mais l'humain aime bien créer des sentiments qui n'ont pas
lieu d'être. Garçon n° 27, Belgique
§ Pour moi, être jaloux c'est excessif. Je dirai que
la possession, elle a sa place, mais pas la jalousie. Fille n° 17,
Belgique.
§ Il y a une limite à tout ça ; si ça
reste dans le cadre du respect de l'autre, c'est normal. Fille n° 19,
Belgique
§ Oui, totalement, ça prouve son attachement
à l'autre et son amour pour lui, il ne faut pas aller dans l'abus, mais
c'est normal. Fille n° 20, Belgique
§ Oui, c'est normal, mais il y a certain
«niveaux» de jalousie. On peut être jalouse, mais il ne faut
pas trop l'être, il ne faut pas empêcher l'autre de vivre sa vie.
Fille n° 23, Belgique
§ Cela peut être normal à petite dose, mais si
cela est beaucoup trop, non. Fille n° 25, Belgique
§ Oui, car il n'y aurait pas d'amour. La confiance est
autre chose. Fille n° 27, Belgique.
§ Oui. La jalousie prouve certaines choses, comme la force
des sentiments. Fille n° 30, Belgique.
Page 61 | 62
Adolescence, amour et violence. Prévenir la violence au
sein des relations amoureuses chez les adolescent-e-s.
PENSES-TU QUE LA JALOUSIE EST UNE PREUVE D'AMOUR
?
§ Je pense que la jalousie peut faire partie d'une preuve
d'amour. Fille n° 1, France.
§ Selon moi, c'est à la fois une preuve
d'intérêt et d'attachement, mais aussi de possession, un manque de
confiance en soi ou envers le-la partenaire. Fille n° 2, France
§ Non, plutôt une sorte de « marque
d'appartenance » à la personne avec qui nous sommes en couple.
Fille n° 3, France.
§ Oui, cela prouve que l'on tient à la personne.
Fille n° 10, France
§ Pour certaines personnes, je pense que oui, mais pas dans
mon cas. Ou alors de la jalousie minime, pas des interdictions ou autres.
Garçon n° 1, France
§ Oui, cela peut montrer à la personne avec qui on
est que nous l'aimons, mais tant que la jalousie ne dépasse pas
certaines limites. Garçon n° 2, France
§ Oui, elle est une preuve d'amour. Garçon n°
6, France
§ Pour moi, c'est une façon de montrer à
l'autre qu'on l'aime et qu'on a peur de la perdre. Garçon n° 7,
Québec
§ Oh oui ! Fille n° 13, Québec
§ Moi, ne je suis pas d'accord. Oui, on peut être
jaloux en étant en couple, mais ça prouve rien du tout ! Fille
n° 14, Québec
§ Oui, mais il ne faut pas que cela devienne une «
jalousie excessive ». Fille n° 18, Belgique
§ Oui, ça démontre un attachement, mais si
ça va trop loin, je ne considère plus ça comme de l'amour.
Fille n° 19, Belgique
§ Oui, mais pas dans d'abus. Fille n° 22, Belgique
§ Oui, c'est une preuve d'amour, ça montre bien
qu'on est attaché à la personne et qu'on a peur de la perdre.
Fille n° 23, Belgique
§ Pas forcément, cela dépend de l'égo
et l'estime de soi de chacun. Fille n° 25, Belgique
§ Oui, car on aime la personne. Fille n° 26,
Belgique
§ Oui, car ça prouve qu'il tient à nous. Non,
car c'est un manque de confiance. Fille °29, Belgique
§ Ça peut être une preuve d'amour, mai il ne
faut pas en abuser. Fille n° 30, Belgique
§ Pas forcément, on peut être jaloux en
amitié aussi. Garçon n° 21, Belgique
§ Oui, mais elle peut aussi être signe de manque de
confiance. Garçon n° 24, Belgique
§ Non, je pense surtout que c'est une preuve de manque de
confiance en soi ! Garçon n° 27, Belgique
(c) Breton (2019). C'est pas ça l'amour.
p.116-118.
Page 62 | 62
| 


