|
|
Master 2 Histoire/ Parcours sciences sociales
EHESS 2021/2022
|
D'une montagne l'autre : faire école dans les
Alpes
Comparaison franco-suisse des expériences scolaires en milieu
alpin
(1880-1918)

Lucas BOUGUEREAU - Sous la direction de Monsieur Emmanuel
SAINT-FUSCIEN
Rapporteur : Monsieur Stéphane
AUDOIN-ROUZEAU
Photographie de couverture : Archives départementales
de la Haute-Savoie. 8Fi 1131 : « Inventaire du fonds de cartes postales
anciennes, semi moderne et moderne (1890-2000) », Chamonix [1900].
3
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d'abord à remercier très
chaleureusement mon directeur de mémoire, Emmanuel Saint-Fuscien pour
m'avoir accompagné tout au long de ce travail. Ses remarques et conseils
toujours très pertinents, sa disponibilité soutenue et ses
encouragements constants m'ont été d'une aide plus que
précieuse dans la rédaction de ce mémoire. Je remercie
chaleureusement ma famille pour son soutien moral, ma mère
particulièrement pour ses relectures. Enfin, tous mes sentiments de
gratitude vont à mes camarades et amis qui, par leurs conseils
avisés, leurs lectures patientes, et surtout, leurs sentiments
d'amitié sans faille, ont participé à faire de ces deux
années de Master, des moments enrichissants et heureux. Merci donc
à Alban, Colas, Mehmet, Niya et Jonas.
4
5
SOMMAIRE
INTRODUCTION 7
PREMIÈRE PARTIE. Le lieu scolaire :
matérialité, pratiques et représentations 19
CHAPITRE 1. L'aménagement des lieux 21
CHAPITRE 2. Quand l'école se heurte au climat 31
CHAPITRE 3. Pratiquer l'école dans les Alpes suisses et
françaises 43
DEUXIÈME PARTIE. Jeux de frontières et trajectoires
de vies. 57
CHAPITRE 4. Pour vivre heureux, vivons cachés 59
CHAPITRE 5. Frontières de l'enseignement. 69
CHAPITRE 6. Le tourisme, sauveur des petites patries ? 85
CHAPITRE 7. Le maître, la maîtresse et l'enfant.
103
TROISIÈME PARTIE. Les Alpes protègent-elles de la
guerre ? 119
CHAPITRE 8. Des systèmes scolaires ébranlés.
121
CHAPITRE 9. L'école transfigurée 133
CHAPITRE 10. Les territoires alpins dans la guerre 149
CONCLUSION : L'école des Alpes, quel bilan ? 161
6
7
Introduction générale
« Insensibles aux intempéries des saisons,
endurcis de bonne heure à toutes les fatigues, ardents au travail,
âpres au gain, probes, honnêtes, intelligents, ils ne montrent de
répugnance pour aucun métier. [...] Leur caractère souple,
leur esprit insinuant les font prospérer là où les autres
mourraient de faim »1. Voilà comment sont
présentés les montagnards, dans ce cas précis, les
hauts-savoyards au sein du premier manuel d'histoire à usage local de la
région. On décèle de suite qu'en ce début de
XXe siècle, l'environnement alpin est perçu comme peu
hospitalier malgré les qualités intrinsèques des
populations qui l'habitent. C'est d'ailleurs une constante au moins depuis les
discours naturalistes du XVIIIe siècle : la montagne effraie
mais elle fascine. Pourtant, comme l'indique le manuel, jusque « dans la
plus petite commune, dans chaque hameau, s'élève une coquette
maison d'école où les enfants sont instruits gratuitement par de
dévoués institutrices ou instituteurs »2.
Construire l'école de la nation devient durant La Belle
Époque, l'objectif affiché de bien des pays européens. Le
maillage scolaire s'intensifie : partout, jusque dans les bourgs les plus
reculés, une école se dresse, maintenant un lien entre la nation
et les territoires qui la composent. Mais est ce que proclamer
l'homogénéité de l'éducation populaire suffit
à lui donner une réalité effective ? Enseigner quelque
part, ou être éduqué quelque part n'est pas sans
conséquences sur les expériences, les représentations, et
les trajectoires de vie des acteurs historiques.
Nous plaidons ici pour l'introduction dans le champ de
l'histoire de l'éducation, des études spatiales et
environnementales, trop oubliées, bien qu'ayant prouvé leur
efficience ailleurs. Les travaux en histoire de l'éducation ont pris des
formes diverses et variées, motivées par un fort dynamisme
à partir des années 19603, mais la focale du «
quelque part » est pendant longtemps restée - et l'est
peut-être encore trop souvent - celle de la Nation4. En
gardant cette idée en tête, énonçons ici une
première fois notre problématique de départ. L'on peut
ainsi se demander comment, entre 1880 et 1918 les politiques scolaires
françaises et suisses
1 F. CHRISTIN, F. VERMALE, Abrégé
d'histoire de la Savoie en 10 leçons, Chambéry, Perrin,
1913, p. 164.
2 Ibidem, p. 159-160.
3 Pour un état de la recherche en
éducation (certes un peu daté mais utile) voir Marie-Madeleine
COMPERE, Philippe SAVOIE, « L'histoire de l'école et de ce que l'on
y apprend », Revue française de pédagogie,
n°152, 2005, p. 107-146.
4 On pense ici aux grandes synthèses telles
que Antoine PROST, Histoire de l'enseignement en France, Paris, Armand
Colin, 1968, ou encore, Françoise MAYEUR, Histoire de l'enseignement
et de l'éducation. III. 17891930, Paris, A.Perrin, 1981.
8
s'inscrivent-elles dans les montagnes alpines ? En quoi
façonnent-elles les manières de se représenter et de
pratiquer ce milieu tout en impliquant des reformulations, des adaptations
locales ? Celles-ci sont-elles superposables en France et en Suisse ?
Précisons d'abord le contexte. Le parachèvement
des identités nationales entamé à la fin du
XIXe siècle suppose un lieu, une institution, où les
enfants d'aujourd'hui seront formés à devenir les bons citoyens,
les bons patriotes de demain, en une phrase : à prendre conscience de
leur appartenance à une nation. De ce constat naquit une multitude de
lois scolaires dans les deux pays, toutes visant à transformer
l'école - existant bien évidemment déjà quoique
sous des modalités différentes - en une école populaire,
une école du peuple. On pense naturellement du côté
français aux lois Ferry de 1881-1882 qui instaurent la gratuité,
l'obligation scolaire et la laïcité à l'école de la
IIIe République. Pourtant, la loi fédérale
Suisse de 1874 précède la française et impose
déjà la gratuité et l'obligation scolaire à
l'ensemble des cantons suisses - deux conditions en réalité
déjà largement respectées dans les deux territoires.
Une fois posé ce constat général, il
s'agit d'aller plus avant et de repérer quelques divergences dans les
politiques scolaires de ces deux nations. D'un côté, la
République française, administrativement centralisée,
impose un système scolaire pensé à l'échelle
nationale, très normé, qui s'efforce d'homogénéiser
pratiques et contenus d'enseignement indépendamment des lieux compris
dans ses frontières. De l'autre côté, l'État
fédéral suisse, bien qu'à tendance de plus en plus
centralisatrice, laisse une très large autonomie aux cantons,
particulièrement en matière d'éducation. Cela donne lieu
à de très grandes disparités entre cantons selon leur
richesse, leur intérêt éducatif, et même leurs
contenus d'enseignements ; d'autant que la Suisse compte trois groupes
linguistiques - allemand, français, italien - et une très nette
séparation entre cantons catholiques et protestants. On observe donc un
contraste assez fort entre un État promouvant une unité de fait
et un autre qui favorise une unité dans la diversité des
réalités sociales et culturelles. Se déploient ici deux
manières d'envisager la Nation et sa première instance de
socialisation : l'école. Un deuxième point, découlant du
premier, est la prise en considération de l'adaptation à
l'échelle locale d'une école nationale. Dans la pédagogie
républicaine, le point de vue local est intégré dans la
perspective nationale : il est en effet enseigné, mais
considéré uniquement comme une partie de la grande
synthèse de la nation,
9
il ne peut avoir d'existence en dehors d'elle5. Il
faut pourtant regarder au-delà de l'enseignement proprement dit en
postulant que les expériences scolaires des acteurs s'inscrivent dans un
espace. Une cohorte d'inspecteurs primaires, d'inspecteurs d'académie et
de préfets - sans oublier le rôle des maires - gèrent
l'application des lois nationales dans les différents territoires
administratifs, ce sont des hommes de l'État, dont le pouvoir est
délégué « d'en haut ». Pourtant, certains -
comme les inspecteurs primaires - jouent un rôle d'intermédiaire :
proches de l'administration, mais aussi du terrain, ils conseillent à la
fois leurs supérieurs mais aussi les maires et les enseignants. Nous
reviendrons sur la figure plus ambiguë de l'instituteur. À
l'inverse, si ces personnages ont plus ou moins leur équivalent en
Suisse, ils dépendent du pouvoir cantonal, limité dans l'espace,
plus proche des réalités locales : un chef de l'instruction
publique est présent dans chaque canton. Surtout, l'État cantonal
se positionne en retrait, laissant une large place - du moins en Valais - aux
pouvoirs communal et ecclésial.
Intéressons-nous maintenant aux deux territoires de
l'étude. La Haute-Savoie et le Valais font partie de deux ensembles
organisés différemment mais poursuivant un objectif commun dans
l'instauration d'une école du peuple. Tous deux sont des territoires de
montagne, d'une superficie équivalente et juxtaposés de part et
d'autre d'une frontière politique tracée sur le haut des cimes
alpines. L'environnement géographique est largement similaire, alternant
entre rocs escarpés et coteaux de montagne où vivent des
populations pastorales, comprenant également des vallées plus ou
moins larges, plus propices à l'activité agricole et aux
industries naissantes. D'un point de vue de géographie physique, ces
caractéristiques forment leur dénominateur commun,
entraînant d'ailleurs des spécificités dans l'organisation
scolaire. Les communes de montagne dénombrent jusqu'au début de
notre période une multitude d'écoles temporaires qui changent de
lieux, étant installées auprès des populations dans le
bourg en hiver et les suivant dans les alpages en été. Le
maillage scolaire est également extrêmement dense : la rudesse du
climat hivernal bloque toute circulation, même sur de courtes distances,
et oblige la tenue d'un grand nombre d'écoles de hameau, regroupant une
poignée d'élèves des deux sexes, qui partagent une
même expérience scolaire, isolés du reste du monde pendant
quelques mois chaque année. En conséquence, le nombre
d'instituteurs et institutrices est très élevé pour des
communes de tailles somme toute modestes.
Abordons maintenant le tourisme, vraie pierre d'angle - en
devenir - de ces sociétés montagnardes. L'afflux
d'étrangers, de plus en plus nombreux au fil des ans, fait vivre les
5 Idée développée entre autres
par Michel YOUENN, « Des petites patries au « patrimoines culturels
» : un siècle de discours scolaire sur les identités
régionales (1880-1980) », Carrefours de
l'Éducation, n°38, 2014, p. 1531.
10
économies locales, accroît leurs finances, permet
l'investissement dans les constructions scolaires. Cela modifie
également les conditions d'enseignement dans ces lieux, faisant
naître ici et là des vocations de guide chez les enfants qui
profitent ainsi de conférences tenues dans les locaux scolaires, de
cours d'anglais ou d'allemand - surtout en France. Enfin, l'activité
touristique apporte avec elle une réserve d'hommes et de femmes
fortunés, souvent bien disposés à soutenir les
quêtes et collectes scolaires. Les territoires alpins, repliés sur
eux-mêmes en hiver, deviennent les fleurons du tourisme international en
été : drôle de paradoxe qui influe grandement sur les
trajectoires de vie des habitants. Seulement, il faut se prévenir contre
l'idée d'un déterminisme géographique qui ne recouvre
jamais entièrement le réel : s'il existe des aspects communs des
deux côtés de la frontière, les différences
politiques, sociales et culturelles évoquées plus haut
pèsent très fortement, induisant des écarts sensibles
entre les situations. Il faut ici insister sur la frontière, ou
plutôt sur les frontières. La plus évidente est la
frontière politique, frontière alpine qui est peut-être le
déterminant principal de l'organisation scolaire - surtout dans le
contexte de parachèvement des identités nationales
réalisé par l'école - mais une multitude d'autres
frontières peuvent être pensées pour éclairer les
expériences et représentations des acteurs de l'école.
Pensons ici aux frontières qui opposent enfants des bourgs aux enfants
des hameaux, notamment en raison de la spécialisation des centres dans
le tourisme au détriment des périphéries - Chamonix en
donne un bon exemple. Mais également la frontière entre les
enfants de montagne et les enfants de plaine, où l'industrie naissante
et l'existence de formations professionnelles offrent des opportunités
différentes.
En élargissant la focale, il existe également
des différences notables entre l'école de la ville et
l'école du hameau, que ce soit au niveau des lieux scolaires, des
possibilités d'emplois, des itinéraires de vie, et ce
malgré l'intention d'instaurer un enseignement
homogénéisé. La morale chrétienne qui infuse
l'enseignement valaisan promeut d'ailleurs l'enfant des montagnes, plus «
pur », non contaminé par les vices de la ville. Il existe encore,
des frontières de genre, transfigurées par l'existence des
écoles mixtes évoquées plus haut, où garçons
et filles prennent place sur les mêmes bancs, isolés ensemble dans
leur micro-sociabilité hivernale. Cette liste n'est pas exhaustive, et
ces frontières, loin d'être des catégories arbitraires
plaquées par le chercheur, sont ressenties, partagées,
imaginées, appropriées et parfois instrumentalisées par
les acteurs de l'école alpine. L'enseignement scolaire est producteur de
représentations, de pratiques, mais celles-ci ne sont jamais la
projection unilatérale et uniforme d'un pouvoir national sur des
intelligences vierges. Elles coexistent et se recomposent avec les propres
représentations des élèves, des enseignants, des parents
d'élèves, avec leurs propres expériences sensibles
inscrites dans un milieu, dans des lieux.
11
Les questions ayant trait à la pluralité des
frontières prennent une résonance particulière à
l'aune de la Première Guerre mondiale. L'école de montagne,
l'école « isolée » est percutée par
l'événement guerrier qui heurte brutalement ses frontières
: les Alpes protègent-elles de la guerre ? La réponse ne peut
qu'être partielle et ambiguë. Les frontières se ferment, les
touristes fuient, mais instituteurs français comme instituteurs
valaisans endossent l'uniforme et courent aux frontières. Ici et
là, même angoisse ou du moins même incertitude au moment de
l'appel6 : qui va combattre ? qui va peut-être mourir et
pourquoi ? Les institutions scolaires s'en trouvent
désorganisées, une partie du corps enseignant masculin est
absente : comment les remplacer ? Les frontières de genre bougent : les
institutrices - déjà très nombreuses dans les deux pays -
suppléent aux manques d'effectifs. Des enseignants intérimaires
sans expérience sont propulsés dans les salles de classe, les
élèves-maîtres en formation sont arrachés des bancs
de l'école normale pour aller enseigner dans les écoles vacantes.
Mais cela ne suffit pas toujours : il faut parfois fermer des
établissements et privilégier les regroupements - chose
impossible en montagne au vu de l'enclavement hivernal des populations.
Les références au milieu local qui se
développaient depuis le début du XXe siècle
dans les enseignements français et suisses sont éludées
pour se concentrer sur la nation, sur les nations7. Le sentiment
national renforcé, semble annihiler la pluralité des espaces
d'identification : la patrie devient le seul cadre enseignable. Du
côté français, collectes et quêtes scolaires à
l'adresse des soldats du front et des réfugiés des régions
dévastées se multiplient ; en Valais comme dans la plupart des
cantons suisses, l'école semble remise en cause dans son rôle
d'unificateur national. Le multiculturalisme helvétique qui ne semblait
pas jusqu'ici poser de problème majeur - en étant même
à la base du roman national - devient l'objet de tensions : de part et
d'autre, sympathies plus ou moins assumées aux patries française
et allemande en fonction des communautés linguistiques, attentent
à la cohérence nationale - du moins dans les débuts de la
guerre.
Mais si la nation prend une place majeure dans les
enseignements scolaires des deux pays, la guerre crée des espaces de
solidarité plus larges qui transgressent ses frontières. C'est,
en France, le soutien aux populations étrangères
dévastées, mais aussi aux nations alliées : jusque dans le
hameau le plus reculé, les pavillons des écoles se drapent des
couleurs italiennes et roumaines lors de leur entrée en guerre. En
Valais, c'est le soutien à la Belgique, patrie soeur
6 Étant entendu qu'au moment de l'appel, les
valaisans ne savent pas s'ils vont effectivement combattre.
7 Sur l'apprentissage du milieu local à
l'école voir entre autres Jean-François CHANET,
L'école républicaine et les petites patries, Paris,
Aubier, 1996 et Anne-Marie THIESSE, Ils apprenaient la France :
L'exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris,
Éditions De la Maison de l'Homme, 1997.
12
dont la neutralité a été violée,
mais aussi le soutien à la France de plus en plus explicite et, dans ce
canton catholique, puis le « rêve » de paix chrétienne
européenne. En bref, les frontières physiques sont
bouleversées, mais des frontières moins immédiatement
saisissables pour l'observateur s'ouvrent.
Quelle méthodologie privilégier pour
appréhender les expériences scolaires alpines ? Insistons d'abord
sur la dimension micro-historique8 de l'étude. En effet,
notre terrain se limite aux deux territoires mentionnés, plus
précisément, à quelques communes de montagne comprises en
leur sein. C'est, semble-t-il, la meilleure manière d'appréhender
le vécu quotidien des acteurs scolaires9 et par là, un
moyen privilégié pour appréhender l'école dans son
espace10. Rappelons toutefois que micro-histoire n'est pas
monographie, l'attention portée aux pratiques des acteurs11
informe plus largement sur la conformité ou la déviance par
rapport aux normes sociales en vigueur. De là l'idée de
généralisation de cas particuliers et leurs confrontations
à des changements culturels, sociaux, politiques et économiques
qui débordent les frontières de l'analyse. Cette méthode
appliquée à l'objet scolaire est particulièrement
fructueuse, elle permet de confronter normes nationales et contournements,
négociations, au niveau local.
Nous voyons ici que les échelles coexistent sans
s'annuler : il n'est pas inutile de rappeler les enseignements de la sociologie
pragmatique, à savoir que les généralités entrent
toujours dans les justifications des acteurs12 . Ces observations
ont d'ailleurs été ensuite portées en
histoire13, permettant de réconcilier le
général et le particulier, l'échelle globale et
l'échelle micro14 . Il faut pourtant reconnaître que le
champ de l'histoire de l'éducation a longtemps
8 Sur l'analyse microhistorique, voir l'ouvrage
fondateur de Carlo GINZBURG, Le fromage et les vers. L'univers d'un meunier
du XVIe siècle, Paris, Flammarion, 1980 [1976].
9 Sur l'histoire du quotidien, voir Alf LÜDTKE
(dir), Histoire du quotidien, Paris, Maison des Sciences de l'Homme,
1994 [1989].
10 Les études « spatiales »
constituent un champ très dynamique de la recherche en sciences sociales
depuis quelques décennies, mais nous notons que leur objet est
systématiquement l'étude de territoires urbains et jamais ruraux.
C'est aussi ce qu'écrit Alain BOURDIN, « De la production de
l'espace aux lieux : un itinéraire entre espaces et
sociétés », Espaces et sociétés,
n° 180-181, 2020, p. 79-96, p.82.
11 Sur la prise en compte de croissante des acteurs
dans la pratique historienne, voir Bernard LEPETIT « L'histoire
prend-t-elle les acteurs au sérieux ? », Espace-Temps,
n° 56-61, 1995, p. 112-122.
12 Idées constitutives de la sociologie
pragmatique pour concilier l'échelle individuelle et
générale : les acteurs utilisent des formes de justifications qui
se rapportent à des « généralités civiques
». Voir Luc BOLTANSKI et Laurent THEVENOT, De la justification. Les
économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991.
13 Par exemple, Simona CERUTTI, « Histoire
pragmatique, ou la rencontre entre histoire sociale et histoire culturelle
», Tracés. Revue de Sciences humaines, n°15, 2008, p.
147-168.
14 On trouvera des considérations similaires
dans Jacques REVEL (dir), Jeux d'échelles. La micro-analyse à
l'expérience, Paris, Le Seuil, 1996.
13
privilégié l'analyse des règles, des
lois, des politiques scolaires, calquées sans distinction sur des
territoires aux réalités parfois bien
différentes15 . Nous arguons ici contre l'idée d'une
homogénéité parfaite des expériences scolaires
à l'échelle nationale. Placer l'environnement alpin au centre de
l'étude permet d'aller dans ce sens, en ouvrant l'analyse à
d'autres territorialités16 présentes dans les
expériences des acteurs. Cela permet de distinguer des
différences de pratiques scolaires entre l'école de la ville et
l'école rurale, l'école de montagne et l'école de plaine,
de même pour l'école du bourg et celle du hameau. Au-delà
des pratiques, les représentations changent aussi, l'école est
indissociable du lieu physique où elle se dresse, les acteurs locaux
mobilisent l'environnement alpin pour justifier leurs pratiques scolaires.
Selon Jean-Luc Piveteau, le territoire est « un lieu de mémoire
», un espace « d'appartenance » et «
d'appropriation » 17 , ceci implique que l'appropriation d'un espace
est vecteur d'expériences vécues particulières. Toutefois,
Bernard Debarbieux nous enseigne qu'un lieu peut en contenir un autre, «
échapper à son échelle » sous une forme
symbolique18. L'école est un parfait exemple de cette double
fonction : elle se dresse quelque part - en l'occurrence dans la montagne - et
fait voir un ailleurs - la nation. Entre ces deux pôles, pas
nécessairement de tensions mais plutôt une imbrication des espaces
d'identification19. À travers l'école, aussi bien dans
son corps immatériel - apprentissage - que son corps physique -
géographie du lieu - élèves, maîtres et
maîtresses expérimentent « la République au hameau
»20.
Bien que le présent mémoire se réduise
à l'étude de la scolarisation, il informe plus
généralement sur les rapports dynamiques entre populations et
environnement 21 . Il faut néanmoins se prévenir de
postuler un espace d'appartenance homogène qui traverserait les
15 En réalité certains travaux
revendiquent déjà une forme d'histoire plus attentive aux acteurs
scolaires : voir Antoine PROST, « Pour une histoire « par en bas
» de la scolarité républicaine », Histoire de
l'éducation, n°57, 1993, p. 59-74, mais aussi
Jean-François CHANET, L'école républicaine...
op.cit. et Jacques et Mona OZOUF
, La République des instituteurs, Paris, Seuil, 1992.
16 François WALTER définit la
territorialité par « la pratique de l'identité spatiale
» pour dépasser la limite du « paysage » à la
perception visuelle, François WALTER, Les figures paysagères
de la nation territoires et paysages en Europe (16-20e
siècle), Paris, EHESS, 2004, p. 302.
17 Jean-Luc PIVETEAU, « Le territoire est-il
un lieu de mémoire ? », L'espace géographique,
n°24/2, 1995, p.113-123, p. 114.
18 Bernard DEBARBIEUX, « Le lieu, le
territoire et trois figures de rhétorique », L'Espace
géographique, °24-2, 1995, p. 97-112 p. 101.
19 Maurice AGULHON mettait déjà en
garde en 1968 contre l'idée répandue d'une annihilation des
particularismes par une identité nationale autoritaire. Voir Maurice
AGULHON, Histoire Vagabonde, Paris, Gallimard, 1988, « Conscience
nationale et conscience régionale en France de 1815 à nos jours
», p. 615-639.
20 Formule inspirée de Maurice AGULHON, La
République au Village, Paris, Pion, 1970.
21 Notamment par les concepts de «
médiance » et de « trajectivité » chers à
Augustin BERQUE, La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?
Nanterre, Presses Universitaires de Paris-Nanterre, 2014.
14
frontières étatiques pour créer une
parfaite communion entre les populations alpines françaises et suisses.
Au contraire, en partant du paradoxe apparent de deux systèmes scolaires
fonctionnant différemment tout en étant placés dans un
environnement semblable, il est question de réintroduire avec force la
frontière nationale comme limite de disjonction. En traversant les cimes
alpines, elle donne un rôle significatif au politique : on ne se
représente pas, et on ne pratique pas l'école de la même
manière dans les Alpes françaises ou dans les Alpes suisses. Si
le référentiel alpin est mobilisé dans les deux cas pour
justifier des formes que prend la scolarisation dans ces territoires, il l'est
de manière sensiblement différente22. Insister sur les
représentations, permet de nous prévenir contre toute tentation
d'essentialiser l'environnement, et d'ainsi d'écarter les risques de
tomber dans une forme de déterminisme géographique - longtemps
porté par une lecture positiviste de Vidal de la Blache ou située
dans la longue durée et les lourdes structures braudeliennes. Nous
favorisons ainsi « la pensée de la réalité par
rapport à la réalité elle-même, la
représentation par rapport à l'objet représenté
»23 pour expliquer les modes d'organisation et de
pratiques scolaires différenciées entre la Haute-Savoie et le
Valais. Peut-être faut-il ici invoquer le concept, lui aussi daté
mais ô combien utile, de possibilisme permettant à Lucien Febvre
de voir dans les régions un « ensemble de possibilités pour
les sociétés humaines qui les utilisent mais ne sont point
déterminées par elles »24. Étude
micro-historique donc, mais objet qui traverse les frontières nationales
pour proposer une réflexion élargie des processus de
scolarisation. En somme, nous proposons ici une micro-histoire globale des
expériences scolaires sur la période 1880-191825.
Cette chronologie insérant le temps de guerre nous impose d'affiner
notre problématique. En effet, comment comparer la situation
française, nation en guerre, à celle suisse nation en paix ? Tout
semble les opposer de prime abord. Pourtant, et d'ailleurs
contre-intuitivement, la mobilisation générale dans les deux pays
amène un temps de guerre par-delà la frontière alpine qui
modifie profondément les manières de faire école. De plus,
le territoire haut-savoyard - tant par les vestiges du congrès
22 Bernard DEBARBIEUX montrait récemment
l'importance de la frontière politique dans les représentations
identitaires des habitants du bassin genevois (côté
français et suisse), dans un environnement pourtant similaire et
interconnecté qui tendait à faire disparaître la
frontière physique. Voir « Identités, frontières et
projet de territoire. Une recherche sur les identités dans la
région genevoise [compte-rendu] », Le Globe. Revue genevoise de
géographie, n°150, 2010, p. 136-139.
23 Marie-Vic OZOUF MARIGNIER, La formation des
départements. La représentation du territoire français
à la fin du 18e siècle, Paris, EHESS, 1992, p.
14. Dans la même idée, Michel DE CERTEAU opérait une
distinction entre objet et discours : L'écriture de l'histoire,
Paris, Gallimard, 1975, introduction, p. 13-34.
24 Lucien FEBVRE, La terre et l'évolution
humaine, Paris, Albin Michel, 1970 [1922], p. 204.
25 Projet à la base de l'approche
micro-historique comme l'ont bien compris Romain BERTRAND et Guillaume CALAFAT
en parlant de « micro-histoire globale » ; Romain BERTRAND, Guillaume
CALAFAT, « La microhistoire globale : affaire(s) à suivre »,
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 73e année,
n°1, 2018, p. 1 -18.
15
de Vienne de 1815 que par des justifications liées
à sa géographie - est épargné d'une confrontation
trop directe avec l'appareil guerrier : il n'y a pas d'hôpitaux
militaires, pas de réquisitions de locaux scolaires, peu d'accueil de
réfugiés dans les cantons de montagne. Ces distinctions
infranationales avec les territoires de l'avant, mais également avec les
autres territoires de l'arrière, autorisent alors à rapprocher
les expériences scolaires hauts-savoyardes et valaisannes pendant la
durée du conflit.
Pour mener à bien notre travail, nous avons largement
et presque exclusivement mobilisé les fonds des Archives
départementales de la Haute-Savoie (ADHS) ainsi que les fonds des
Archives Cantonales de l'État du Valais (AEV). Dans les premiers, c'est
principalement la série « T », « Enseignement
général. Affaires culturelles. Sports - 1849-2009 » qui a
servi de pierre d'angle à notre travail. Nous avons pu, entre autres,
consulter les monographies d'instituteurs écrites à l'occasion de
l'exposition universelle de 1889 qui, tout suivant un plan
stéréotypé, permettent d'appréhender l'école
au niveau communal26 . Les plaintes et réclamations des
instituteurs ont permis d'analyser les conflits de représentations, les
jeux de pouvoir, les difficultés d'adaptation au niveau local de
prérogatives nationales27 . Pour appréhender la
formation des instituteurs, pour comprendre ce que l'administration attend
d'eux, nous avons eu recours aux sources relatives à l'école
normale d'instituteurs de Bonneville28 . D'autres sources peuvent
être mentionnées : les affaires générales par
communes, riches en détails sur l'organisation de l'école de la
IIIe république dans les communes
haut-savoyardes29. Nous nous sommes également servis de la
série « O » « Administration et comptabilité
communales. 17141956 », afin d'appréhender au plus proche quelques
communes de montagne française, concentrant surtout des actes du conseil
municipal concernant l'éducation et plus largement la politique
locale30. Enfin, la série « R » « Affaires
militaires, organismes de temps de guerre. 1855-1945 » où sont
conservées les réponses des instituteurs à l'enquête
de l'instruction publique sur les événements de la Grande Guerre,
s'est révélée très précieuse pour
appréhender
26 ADHS, 1 T 236, « Monographies
rédigées par des instituteurs. 1888-1892 ».
27 ADHS, 1 T 54-55, « Plainte contre des
instituteurs ou réclamations d'instituteurs. 1861-1918 ».
28 Notamment sous la côte ADHS, 1T 1235-1236
« Administration générale école normale de
Bonneville. 18871927 ».
29 ADHS, 1 T-38-53, « Affaires
générales par commune. 1860-1940 ».
30 Par exemple ADHS, 2 O 2174, « Archives de
la préfecture concernant l'administration communale de
Chamonix-Mont-Blanc. 1859-1941 ».
16
la période de guerre - chose difficile car les archives
se raréfient31. Notons également le recours aux
questionnaires de Jacques Ozouf concernant les instituteurs ayant exercé
avant 1914, ce recueil de témoignages constitue un matériel
ethnographique très riche - 26 concernent des enseignants
hauts-savoyards32.
Du côté Suisse, les recherches se sont
avérées plus concises bien que fructueuses. Salarié de
l'Éducation Nationale, les contraintes professionnelles ont
limité nos possibilités de déplacement. Il faut
également mentionner la fermeture - assez longue - des archives et
l'impossibilité de se rendre en Suisse en raison de la pandémie
de Covid. Tous ces aléas ont entravé notre recherche. Ajoutons
à cela que les Archives de l'État du Valais ne possèdent
un règlement de conservation structuré que depuis très
récemment. De ce fait, la quantité documentaire est faible et
nous avons été surpris de voir que certains documents
présents dans l'inventaire étaient par ailleurs introuvables sur
le site. Si l'observation au niveau communal est rendue plus compliquée
que du côté français, nous revendiquons une histoire
indiciaire33 qui, sans être exhaustive, a le mérite
d'ouvrir des pistes de recherches, permet de proposer de nouveaux angles
d'analyse et voies d'interprétation sur « un terrain quasiment
inexploré »34. Le fond DIP « Département de
l'instruction publique. 1756-1976 » contient entre autres des rapports du
département de l'instruction publique sur la situation des écoles
valaisannes - utiles pour avoir une vue d'ensemble de la politique scolaire du
canton 35 -, des rapports des inspecteurs primaires, parfois
très précis, qui - quel dommage - s'arrêtent
mystérieusement en 190636, une correspondance très
inégale, mais assez riche entre les différents acteurs de
l'école valaisanne37. Enfin, un très beau fonds
privé d'un instituteur, regroupant un cahier d'élèves et
quelques lettres, permet cette fois d'observer au plus proche une classe
valaisanne - une des
31 ADHS, 8 R 140 « Enquête lancée
par le ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts concernant
la prise de notes communales sur les événements de la guerre
1914-1918 par les instituteurs : circulaire, réponses communales. -
1914-1917 ».
32 Musée National de l'Éducation
(MUNAE), « Fonds Ozouf ».
33 Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes.
Racines d'un paradigme de l'indice », Le débat, n°6,
1980, p. 3-44.
34 Rita HOFSTETTER, Charles MAGNIN, Lucien CRIBLEZ,
Carlo JENZER (dir), Une école pour la démocratie. Naissance
et développement de l'école primaire en suisse au 19e,
Berne, Peter Lang, 1999. Les auteurs parlent de l'histoire de
l'éducation de la Suisse entière en la qualifiant de «
terrain inexploré ». De nouveaux travaux ont néanmoins vu le
jour depuis, mais le Valais semble totalement ignoré.
35 AEV, 1 DIP 29, « Rapports du
Département de l'instruction publique ; imprimés (1876-1911)
»
36 AEV, 1 DIP 30-98, « Rapport des inspecteurs
scolaires. 1854-1873 ». Malgré les dates de l'inventaire, les
rapports s'étendent bien à 1906.
37 AEV, 1 DIP 144.2, « Copies-lettres en
français. 1906-1910 » et 1DIP 145bis, « Correspondance.
1913-1915 ».
17
seules sources « intimes » valaisanne que nous avons
pu consulter38 . Nous nous sommes énormément servis de
L'école primaire, journal pédagogique mensuel du canton
du Valais39, grâce auquel nous avons pu compléter nos
informations lacunaires, notamment sur la période de guerre, encore plus
difficile à saisir qu'en France.
Ce corpus, bien qu'imparfait, permet cependant d'assurer une
comparaison des systèmes éducatifs français et suisses en
milieu de montagne sur la période 1880-1918, de proposer des pistes de
réponses aux questions que nous avons posées dans cette
introduction. Dernière difficulté soulevée :
l'historiographie de la recherche en éducation. Si du côté
français, les productions sont nombreuses et couvrent des objets
variés, la recherche en éducation valaisanne est quasiment
inexistante. Rita Hofstetter écrivait il y a dix ans, que la recherche
en éducation en Suisse pouvait être un laboratoire des plus
intéressants du fait des grandes divergences entre les cantons et la
limitation actuelle du champ à quelques monographies40. Ce
travail n'a pas encore été mené : une seule étude
sur le Valais existe seulement - encore que l'auteure se fonde presque
exclusivement sur des productions travaux français41. Nous
ouvrons ici un champ resté vierge, l'excitation de l'apprenti-chercheur
se mêle à la limite évidente de ne pas pouvoir s'appuyer
sur une littérature existante.
Une première partie de ce mémoire sera
consacrée à la réflexion autour du lieu scolaire, son
implantation dans un environnement contraignant. Nous aborderons le rôle
des différents pouvoirs - État, canton, commune - dans
l'aménagement des locaux scolaires des communes alpines, puis essayerons
de mesurer le fonctionnement de l'école en mesurant les
négociations normes/pratiques qui y prennent place. Celles-ci
s'incarnent au travers des spécificités - réelles ou
supposées - du milieu alpin - isolement hivernal, risques naturels - et
des manières de se le représenter en France et en Suisse. Une
seconde partie sera consacrée aux frontières de l'enseignement,
et aux trajectoires de vies qui en découlent, en pointant tout d'abord
l'étanchéité surprenante entre la Haute-Savoie et la
Valais - pourtant si proches. Y seront abordées les questions relatives
au tourisme naissant et leur influence sur les écoles alpines avant
d'étudier la place de l'environnement local dans les enseignements
haut-savoyard et
38 AEV, « Pitteloud Vincent. 1557-20e
siècle », « 24. Instituteur, 1908-1931 ».
39 Résonances (
resonances-vs.ch).
40 Rita HOFSTETTER, « La suisse et
l'enseignement aux XIXe-XXe siècles. Le prototype
d'une «fédération d'enseignants» ? », Histoire
de l'éducation, n°134, 2012, p. 59-80.
41 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice : jeux et enjeux autour des Écoles normales
du Valais romand, (1846-1994), Thèse de doctorat en Sciences de
l'Éducation, sous la direction de Philippe PERRENOUD, Université
de Genève, 2000.
18
valaisan ainsi que les manières
différenciées de se le représenter. Concernant les
trajectoires de vie, nous parlerons des représentations que les acteurs
scolaires se font de leur milieu en mêlant contraintes « objectives
» et représentations « subjectives » qui pèsent
sur leur parcours et les incitent à déployer certaines
stratégies. Enfin, dans une dernière partie, nous
étudierons l'école des Alpes face à la guerre en montrant
l'ébranlement des systèmes scolaires par
l'événement guerrier la nationalisation de l'école mais
aussi l'éloignement des deux territoires du front, dans un jeu de
ressemblances/différences qui redéfinit les frontières
scolaires, à un niveau tant local que national et même
international.
19
PREMIÈRE PARTIE. Le lieu scolaire :
matérialité, pratiques et représentations
L'école s'inscrit par des lieux dans des milieux et
doit s'y adapter si elle veut s'y implanter. Dans le cas français,
l'école de la IIIe République cherche justement
à s'enraciner dans toutes les localités, tant dans la
matérialité du bâti que par son enseignement. Cela passe
notamment par la largesse des dotations de l'État envers les communes
pour les constructions scolaires42, mais aussi par la volonté
politique d'imposer un programme d'enseignement unique et commun dans toutes
les écoles, de prodiguer aux instituteurs et institutrices une formation
de plus en plus rigoureuse. La Suisse, également prise dans le processus
européen de développement de l'offre scolaire, tend vers le
même objectif. Pourtant, le modèle fédéral de la
Confédération laisse une large autonomie aux cantons en termes de
politique scolaire, ouvrant ainsi la voie à de grandes disparités
entre ces territoires. En Valais par exemple, l'État fait preuve d'une
économie qui contraste avec le canton voisin de Genève - et
même d'une bonne partie de ses voisins européens : la plupart des
charges scolaires est laissée aux communes, les programmes censés
suivre une ligne commune - quoique assez floue - sont en réalité
largement laissés au bon vouloir des instituteurs, très peu
formés jusqu'au début des années 1880, et souvent sous la
tutelle du maire43 et du curé. Pourtant, un réel
effort de « rattrapage » est revendiqué par les acteurs de
l'école valaisanne sur la période 1880-1914, menant à des
réalisations non négligeables en termes de politique scolaire. Il
s'agit ici d'étudier à quels niveaux sont prises les
décisions concernant l'école, d'identifier le rôle de
l'État, du département, du canton et de la commune. Ceci n'est
pas sans conséquences sur les formes que prennent les lieux scolaires
dans le paysage alpin, et permet d'éclairer les « arrangements
» entre prérogatives de l'État et application dans un cadre
géographique particulier. Comme nous l'avons évoqué dans
l'introduction, l'école de montagne n'est pas l'école de la
ville, ni celle de la plaine. Elle possède plusieurs
caractéristiques « physiques » propres qui induisent des
modalités d'organisation différenciées selon les lieux
où elle se dresse. Toutefois, au-delà de la simple insertion du
bâti scolaire au sein du milieu alpin, il s'agit d'analyser les
manières qu'ont les
42 La presse réactionnaire critiquera
d'ailleurs les « palais scolaires » de Jules Ferry.
43 Par souci de clarté, nous utiliserons
systématiquement le terme de « maire » pour le Valais qui
alterne avec celui de « président ».
20
acteurs de se représenter et de pratiquer
l'école de montagne. Leurs justifications s'appuient d'ailleurs
très souvent sur un argumentaire lié à leur environnement
physique.
21
CHAPITRE 1. L'aménagement des lieux
A] Rôle de l'État, Rôle de la
commune
En Haute-Savoie existait avant la IIIe
République la tenue de nombreuses écoles temporaires,
organisées par des maîtres itinérants dans des locaux
souvent modestes, rarement conçus pour y tenir une classe. Ces
écoles fonctionnaient en hiver et pouvaient s'arrêter en
été, selon que le maître décide de suivre les
populations aux alpages, de faire classe parmi les logements rudimentaires -
pensés pour le travail et non le confort - ou qu'il déserte le
pays, souvent pour un emploi de plaine, dans les larges vallées
agricoles des pré-alpes annéciennes.
La IIIe République, par ses investissements
massifs va grandement changer cet état de fait44 . En
Août 1881, Ferdinand Buisson, directeur de l'instruction publique en
voyage à Chamonix relève l'urgence des nouvelles constructions
scolaires et convie l'inspecteur primaire à étudier avec lui
« les emplacements les plus convenables pour mettre les écoles
à portée, non seulement des hameaux principaux, mais aussi des
autres hameaux où se tenaient jusque-là des écoles
temporaires » 45 . L'inspecteur primaire ajoute ensuite que
« jusqu'aujourd'hui, la commune de Chamonix a été
obligée de louer deux locaux pour les écoles de Montquart et des
Pratz » et affirme qu'en acceptant les plans « nous
supprimons pour Chamonix 4 ou 5 écoles temporaires, où
jusqu'alors on n'enseignait absolument rien »46. C'est
dire si ces écoles font taches pour le régime républicain,
elles constituent une anomalie qu'il faut au plus vite conjurer : à
peine la visite de Buisson est entamée en août que quelques jours
plus tard, il convoque l'inspecteur primaire pour discuter des plans des
nouveaux bâtiments scolaires - visite à visée pourtant plus
touristique que pratique au départ. Le 19 août, la chose est
quasiment actée : l'inspecteur rapporte que le maire va faire nommer un
architecte par son conseil à la toute prochaine séance. Et de
fait, le 28 novembre le préfet est averti et donne son accord pour
remplacer les « écoles temporaires ou clandestines »
par « 5 écoles mixtes permanentes ».
L'inspecteur primaire doit veiller à ce que les dossiers relatifs
à la création des écoles soient
44 Sur cette question voir entre autres Antoine PROST,
Histoire de l'enseignement..., op.cit, 1968.
45 ADHS, 1 T 169, Lettre de l'inspecteur primaire de
Bonneville à l'attention de l'inspecteur d'académie d'Annecy, 19
Août 1881.
46 Ibidem.
22
constitués par les communes le plus tôt
possible47. L'administration est efficace et les agents de
l'État étendent leurs actions au niveau communal, que ce soit
pour guider, épauler ou faire pression sur le maire au besoin. Ses
agents prennent à coeur d'appliquer la politique de refondation de
l'instruction publique que proposent Jules Ferry et Ferdinand Buisson. Les
écoles temporaires disparaissent très vite et il n'en est presque
plus jamais fait mention par la suite. À la place vont se dresser des
écoles de hameau dans des locaux neufs, tous construits selon les
mêmes plans48, dont l'inspecteur primaire sera chargé
par l'inspecteur d'académie de vérifier la conformité.
Le pouvoir républicain organise l'instruction
populaire. Il n'agit pas toujours de manière autoritaire et au
contraire, les communes acquises au régime républicain profitent
d'un relai solide pour mener à bien leurs politiques scolaires. Entre
l'autorité centrale et le pouvoir communal, l'inspecteur primaire joue
le rôle d'intermédiaire. Proche du terrain, à
l'écoute du conseil municipal, il transmet ses demandes à
l'inspecteur d'académie - qui dispose du pouvoir décisionnel -
tout en faisant part de son avis personnel. Il peut se montrer favorable ou
opposé aux requêtes, parfois muet sur ses
préférences. Chamonix se montre réceptive aux nouvelles
lois Ferry, la liste des membres des commissions scolaires communales
dressée par l'inspecteur primaire en 1882 la classe parmi les communes
« favorables » à l'école laïque
républicaine49. Et de fait, cette même année, de
nombreux chantiers se mettent en place pour améliorer l'offre scolaire.
L'empressement que met la commune à satisfaire à l'exigence des
nouvelles lois lui vaut même certains traitements de faveur. Par exemple,
en août 1889, sur demande de l'enseignant et du conseil municipal,
l'inspecteur primaire envoie une lettre à l'inspecteur d'académie
pour appuyer la demande de concessions des tableaux d'histoire naturelle
à l'école de La Praz. Il insiste sur les efforts de la commune :
celle-ci a lancé la construction de 6 écoles de hameau qui
devraient ouvrir en octobre50. C'est justement dans ce processus de
négociation qu'un interstice s'ouvre, permettant aux agents locaux
(conseil municipal, enseignants, parfois pétitions de parents) de porter
certaines revendications, acceptées ou non, mais qui atterrissent
toujours sur le bureau de l'inspecteur d'académie. Jean-François
Chanet, relativise d'ailleurs l'idée d'un pouvoir étatique
centralisateur et omnipotent - dominant jusqu'alors dans
47 ADHS, 1 T 418, Lettre du préfet de la
Haute-Savoie à l'inspecteur d'académie d'Annecy, 5
décembre 1881.
48 La mauvaise qualité des documents et
également celle des photos ne permet pas de reproduire les plans des
écoles de hameau. Toutefois, ceux-ci sont conservés sous la
côte 1 T 169, « - Créations d'écoles et d'emplois -
1862-1930 », Chamonix, 1881.
49 ADHS, 1 T 93, Liste des membres de commissions
scolaires du département de la Haute-Savoie, 1882.
50 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire
à l'inspecteur d'académie, 3 Août 1889.
23
l'historiographie - en parlant de «
décentralisation pratique »51. Expression très
juste car, si c'est le pouvoir central qui mène le jeu - en dotant les
communes, en décidant des plans des écoles, en appuyant certaines
demandes et en en refusant d'autres - les acteurs au niveau communal suivent
des stratégies, plus ou moins conscientes - afficher son soutien
à la politique républicaine et redoubler d'efforts pour la mettre
en place, flatter l'inspecteur - qui leur confèrent un pouvoir d'action
sur les décisions prises d'en haut. En étant conciliants avec les
représentants de l'État, les acteurs locaux peuvent justifier des
demandes de matériel scolaire plus importantes, le dédoublement
de certaines classes ou l'ouverture de nouvelles écoles. L'enseignant,
la commune, les parents ne sont pas seulement des serviteurs de l'État,
ils disposent d'une agentivité dans leurs pratiques52.
De l'autre côté de la frontière, le canton
du Valais n'investit pas autant dans l'éducation populaire au
début des années 1880. Certes, de timides lois scolaires ont
déjà vu le jour, mais plus pour répondre aux
prérogatives de la Confédération que par réelle
volonté politique. La loi de 1873, ambitieuse par son contenu propose
une véritable sécularisation de l'enseignement primaire :
augmentation du personnel scolaire, programme d'étude commun aux
écoles primaires du canton, création du collège industriel
de Sion53... Toutefois, en plus de n'être pas appliquée
- faute de moyens suffisants54 - cette loi ne prévoit rien
sur les constructions des écoles primaires. Il faut attendre 1901 pour
que le canton accepte les subventions de la Confédération et
commence à investir dans l'organisation matérielle de
l'école valaisanne55. En réalité, c'est
seulement en 1903 que l'État annonce officiellement sa participation,
encore que très partielle : « les dépenses des communes
résultant de construction et de transformation de bâtiments
scolaires effectuées en 1903 seront mises au bénéfice d'un
subside de 25 % sur les subventions fédérales à
l'école primaire »56. Jusque-là,
l'État se place en retrait et c'est aux
51 Jean-François CHANET, L'école
républicaine...op. cit, p. 67.
52 C'est l'historien britannique Edward Palmer
THOMPSON qui, le premier, met en avant cette notion, voulant se départir
de la tradition marxiste considérant les foules comme totalement
déterminées par la conjoncture économique. Voir, La
formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Gallimard, 1988
[1963]
53 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice... op. cit, p. 148.
54 Elisabeth ROUX, « Le régime de
Torrenté », dans Jean-henri PAPILLOUD, Gérald ARLETTAZ,
Michel REY, Elisabeth ROUX, Patrice FRASS, Georges ANDREY (dir), Histoire
de la démocratie en Valais (1798-1914), Sion, Groupe Valaisan de
Sciences Humaines, 1999, p. 224.
55 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice... op. cit, p. 178.
56 « Décisions du conseil », L'école
primaire, n°1, Janvier 1904, p. 2-3 (frontispice).
24
communes de pourvoir à la mise à disposition de
locaux57, à la construction des écoles, à leurs
entretiens. Cette politique de non-intervention a pour conséquence de
favoriser des situations divergentes en fonction des municipalités,
dénotant avec la politique égalisatrice déployée
dans les Alpes françaises. La qualité des locaux - souvent
médiocre - a pour conséquence de mettre en concurrence les
enseignants pour l'obtention de postes plus « privilégiés
». En guise d'exemple, dans la commune de Martigny-Combes, l'école
de Brocard mesure 9 mètres de long sur 5 de large pour un effectif de 19
élèves, alors que celle des Jears, mesure 6 mètres de long
sur 4 mètres de large pour un effectif de 27
élèves58 . Il semble donc évident qu'en termes
d'attractivité et de conditions d'enseignement, certaines communes - et
même certaines écoles dans une même commune - sont mieux
pourvues que d'autres.
Les écoles temporaires - appelées plus
poétiquement écoles nomades dans ce canton - existent
également. La spécialisation de l'économie montagnarde
dans l'élevage au cours du XIXe vient, comme en France,
légitimer cet état de fait : les populations quittent parfois
entièrement leur village durant une période de l'année.
Cependant, la manière de considérer ces écoles est
différente : Si elles servent aux observateurs à déplorer
le retard de l'éducation populaire en Valais, elles ne dérangent
pas outre-mesure le gouvernement qui s'en accommode comme un mal
nécessaire, une spécificité du canton lié au mode
de vie des habitants qu'il ne faut pas bouleverser. Le chanoine de Cocatrix,
très investi dans la vie scolaire valaisanne, écrit en 1906 un
rapport où il relate la situation de l'enseignement primaire en Valais
et ses progrès des dernières décennies. Il écrit
à propos des écoles nomades : « Nous enregistrons sous
ce titre, un des faits les plus curieux de notre histoire scolaire, inouï,
dans aucun autre canton de la Suisse, et qui mérite de retenir quelques
instants notre attention : fait qui exerce aussi une influence funeste, on s'en
convaincra bientôt, sur la bonne marche et les résultats de
l'école ». Cela ne l'empêche pas de noter ailleurs qu'il
est impossible « d'avoir un plus grand nombre de mois de classe : les
travaux journaliers exigent que les parents puissent disposer des petites
forces de leurs enfants de mai à octobre et toute tentative de
réforme sous ce rapport serait mal accueillie de nos populations
agricoles »59. Ne pas froisser les familles, se
prévenir de toute intervention trop brutale, limiter les investissements
publics, trois raisons qui justifient la
57 Elles décident seules du lieu des locaux
jusqu'en 1907 : Josef GUNTERN, L'école valaisanne au XXe
siècle : de l'école de six mois aux hautes écoles
spécialisées et universitaires, Sion, Vallesia, Archives de
l'État du Valais, 2006, p. 362.
58 AEV, 1 DIP 91, Rapport des inspecteurs scolaires,
commune de Martigny-Combes, 1902-1903.
59 AEV, 1 DIP 102bis, Cahier sur les examens de recrue
par le chanoine Cocatrix, 1906, p. 14-15.
25
politique scolaire du canton. Ces écoles continuent
donc d'exister, même si leur nombre tend à diminuer sur la
période.
Cette brève comparaison a pour mérite
d'éclairer les différences dans l'aménagement des lieux
scolaires d'un côté et de l'autre des alpes. La République
française prend à coeur l'aménagement et la normalisation
des écoles sur son territoire. Les moyens déployés sont
conséquents et l'État surveille de très près les
décisions communales. En Valais, l'État s'affiche en retrait au
profit du pouvoir communal. Un bon exemple de la divergence dans les politiques
scolaires se trouve dans les écoles temporaires/nomades. Elles font
partie du paysage dans les deux territoires de montagne à la fin du
XIXe siècle. Pourtant, la manière de les
considérer diverge et informe de stratégies scolaires
différenciées : anomalie à corriger ou fait « naturel
» inscrit dans les modes de vie des montagnards ? Le vocable
employé pour les qualifier trahit cette différence. Écoles
temporaires (ou clandestines) côté français, implique
qu'elles sont hors de la légalité, vouées à
disparaître ; Écoles nomades côté suisse est purement
descriptif, presque esthétique.
Au-delà de ces divergences dans la politique
d'aménagement des lieux scolaires, il faut s'attarder sur les
spécificités dans l'appréhension du milieu
géographique qui induit des similarités dans les
caractéristiques du maillage scolaire. Pour exemple, écoles
nomades et les écoles de hameaux existent de part et d'autre d'une
frontière étatique, le politique ne peut pas être la seule
variable explicative.
B] Une multitude d'école aux faibles
effectifs
En montagne, pour les mêmes raisons qui justifient les
écoles temporaires, les écoles sont nombreuses et le maillage
scolaire particulièrement dense à l'échelle des communes.
L'exiguïté de certaines vallées ne permet pas
l'étalement urbain. Une constellation de petits hameaux s'organise
autour des bourgs, souvent éloignés de plusieurs
kilomètres et reliés par une unique route sinueuse, qui doit
composer avec une les aspérités d'une topographie
inhospitalière, avec les pentes escarpées des montagnes qui, en
venant obstruer la vue, renforcent la sensation d'isolement de lieux pourtant
proches. En France, l'investissement dans les chemins vicinaux permet une
circulation relativement correcte entre les hameaux et les bourgs, du moins
quand la saison le permet, et c'est justement l'inconvénient : les
hameaux sont souvent perchés au-delà des 1200 mètres
d'altitude, garantissant des hivers rigoureux où les circulations
sont
26
quasiment nulles pendant la moitié de l'année.
En Valais, l'état des routes - et par là l'isolement des hameaux
- est encore plus accentué. L'investissement de l'État est
faible, si bien que certaines communes ne sont reliées que par des
chemins muletiers où, ni voitures - et plus tard automobile - ne peuvent
circuler. L'instituteur Vincent Pitteloud reçoit le 27 Mars 1888 une
lettre de l'inspecteur primaire l'informant de sa visite prochaine dans son
école. Ce dernier écrit que « vu le mauvais état
des chemins » il accepte volontiers « l'offre que vous
[Vincent Pitteloud] aviez bien voulu me faire de venir me chercher
à mulet ». L'inspecteur prévoit de partir à 7
heures de Sion - la capitale cantonale - et souhaite arriver à midi aux
Agettes pour une « visite locale »60. Le trajet
va durer 5 heures, entre des communes qui sont éloignées de moins
de 5 kilomètres à vol d'oiseau et à peine 10
kilomètres par voie pédestre. Cette lettre, si avare soit-elle en
informations, permet à elle seule de rendre compte de l'isolement et des
difficultés de communication de ces territoires de montagne. De plus,
les Agettes, placé à proximité de Sion n'est ni le bourg
le plus élevé, ni le plus isolé. Chaque déplacement
est une expédition : il est aujourd'hui cocasse d'imaginer l'inspecteur
primaire et l'instituteur à dos de mulet, en train de gravir les chemins
pierreux pour assurer l'inspection scolaire. Les archives ne laissent rien du
déroulement de la visite, il est toutefois probable que l'inspecteur
primaire couche dans le bourg avant, soit de repartir dans la capitale
cantonale, soit poursuivre son ascension vers les écoles les plus
reculées du pays, perchées en haut des cimes alpines.
Pour toutes ces raisons, des communes de tailles modestes se
retrouvent avec de nombreuses écoles. Chamonix compte 2400 habitants en
1888 pour une surface de 116 km2. L'instituteur Louis Mauroz,
écrit une monographie de la commune à l'occasion de l'exposition
universelle de 1889, il dénombre « 14 écoles avec en
tout, 16 maîtres et maîtresses » pour une population
scolaire d'environ 250 enfants (et donc une moyenne d'environ 18
élèves par école)61 . Sur ces 14 écoles,
10 sont des écoles de hameaux, c'est dire la dissémination
géographique de l'école communale. Exemple peut-être encore
plus parlant, la commune de Martigny-Combes, en Valais - située à
une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau de Chamonix - compte,
en 1890, 11 écoles pour une population d'environ 1500 habitants.
Certaines écoles - celles du bourg - peuvent compter jusque 40
élèves, d'autres descendent à une fréquentation de
15 élèves62. En 1916, la situation est sensiblement la
même, « Le hameau de Littroz (Trient)
60 AEV, Fonds Pitteloud Vincent, 24.2
Correspondance instituteur, 1886-1913, lettre de l'inspecteur d'académie
du 27 Mars 1888.
61 ADHS, 1 T 236, Monographie de la commune de
Chamonix par l'instituteur Mauroz, 1888.
62 AEV, 1 DIP 58, Rapport des inspecteurs
scolaires, commune de Martigny-Combes, école de Broccard, 18901891.
27
possède l'école certainement la plus
minuscule du Valais. Elle ne comptait en effet, le dernier cours scolaire que 5
élèves, tous garçons »63. Les
particularités du milieu entraînent cet état de fait, il
laisse aussi imaginer la différence dans le vécu scolaire des
populations isolées des hameaux par rapport à celles du bourg, ou
encore à celles des plaines ou celle des villes. La maison-école,
modeste dans son bâti, compte une pièce unique en rez-de
chaussée, pourvue d'un escalier étroit placé à
l'arrière de la classe, donnant sur le logement de l'instituteur ou de
l'institutrice. Fouettée par le vent, alourdie par la neige, elle se
dresse dans chaque localité et accueille le peu d'élèves
qui s'y trouve. Quelques familles voisines s'y retrouvent tous les jours, dans
la classe mêlant tous les niveaux, sous la tutelle de l'enseignant.
Souvent les mêmes noms, frères et soeurs, plus ou moins grands,
s'assoient ensemble sur les bancs scolaires qui voient défiler des
générations de « Chappaz », de « Delaloye »
ou de « Deneriaz ». En Valais dans le hameau de Champex «
sur les 18 élèves présents à l'école, 15
portent le nom de Crettez. Voici une famille qui n'est pas près de
s'éteindre. »64. L'on voit ici, un exemple de la
pénétration de la république - tant française
qu'helvétique - au village, de l'importance renouvelée de
l'enseignement dans l'Europe de ce XIXe siècle : aucun lieu
n'est oublié, l'école pénètre la
société de montagne jusque dans ses confins les plus
inaccessibles, instaurant un lien entre la micro-sociabilité villageoise
et par-delà les cimes, la nation.
C] La fonction spatiale du lieu
Le bâtiment scolaire s'inscrit dans un lieu, mais sa
fonction spatiale n'est pas la même selon qu'il existe dans la montagne
ou par exemple à la ville. Marianne Thivend, dans son étude sur
l'école républicaine en ville montre bien l'amélioration
de l'offre scolaire en France sur la période 1870-1914.
Phénomène partagé en campagne, mais les écoles
urbaines, véritables « usines » peuvent compter jusque 800
voire 1000 élèves65. Celles-ci, par leur taille et
leur fonction sociale, servent souvent de point d'ancrage à
l'aménagement urbain66. La forte densité du maillage
scolaire donne lieu au déploiement de certaines stratégies
scolaires par les habitants des villes : les établissements sont mis en
concurrence en fonction de leur réputation, de leur
63 « Curiosités scolaires », L'école
primaire, n°3, Mars 1916, p. 2 (frontispice).
64 Ibidem.
65 Marianne THIVEND, L'école
républicaine en ville : Lyon, 1870-1914, Paris, Belin, 2006, p.
208.
66 Ibidem, p. 76-77.
28
situation matérielle, afin de suivre un instituteur ou
une institutrice particulièrement appréciée67.
Ce qui a pour effet de créer une attractivité accrue des centres
aux détriments de périphéries, de privilégier une
vraie « ségrégation sociale et spatiale » et
de relativiser ainsi l'image « d'école du peuple
»68. Dans les territoires de montagne, les populations ne
choisissent pas leur école en fonction du niveau supposé - du
moins pour l'école primaire - celle-ci correspond à une
nécessité pratique. C'est d'ailleurs pour cela qu'en France,
certaines écoles temporaires ont pu être tolérées
dans les quelques années suivant les lois Ferry. C'est également
pour cela qu'en Valais, faute de moyens financiers communaux suffisants ou de
dotations de l'État, on s'accommode d'école nomades.
L'école de montagne, disséminée au gré des hameaux
ou dans les bourgs, s'impose par sa proximité, à l'instar de la
petite chapelle69, dans un milieu où les déplacements
sont rendus difficiles - surtout en hiver nous y reviendrons. Le lieu scolaire,
ne remplit pas les mêmes fonctions pour les populations de montagne ou
celles de la ville. Il ne sert pas d'appui à l'aménagement
territorial mais s'inscrit dans un paysage déjà constitué
et relativement stable - du moins pour les hameaux. La taille modeste des
bâtiments, le faible nombre d'élèves qui fréquente
ses bancs n'en font pas un lieu imposant à l'inverse des écoles
de ville. Il ne prend d'ailleurs que rarement place au centre du hameau, les
emplacements sont choisis pour satisfaire aux enfants des hameaux mais doivent
être également proches des « micro-hameaux » ou des
maisons isolées. Le bâtiment scolaire n'est d'ailleurs pas
rattaché au bâtiment de la mairie - il n'en existe pas - comme
c'est souvent le cas dans les bourgs des plaines, il constitue - avec certains
relais de postes - le seul marquage du pouvoir central dans
l'aménagement territorial.
Toutefois, les bâtiments scolaires, si modestes
soient-ils, endossent une fonction spatiale et symbolique qui transgresse les
frontières du hameau. Les écoles intègrent, dans le lieu
physique où ils se dressent, un autre espace, celui du pouvoir central,
celui de la nation. Celle-ci « échappe à son
échelle et se condense dans un des lieux qui la constituent ».
Ainsi, « le signifié du lieu [nation]
présent dans un lieu [école] ne dépend pas du
lieu lui-même mais par les systèmes de significations dans lequel
le lieu est introduit et par les attitudes des individus par rapport à
ces systèmes de représentation » 70 . Le bâtiment
scolaire, au-delà de ses
67 Ibid, p. 137-139.
68 Ibid, p. 121.
69 Bernard DEBARBIEUX écrit que chaque hameau
possède sa chapelle dans la commune de Chamonix. Voir,
Chamonix-Mont-Blanc, 1860-2000, les coulisses de l'aménagement,
Grenoble, Editmontagne, 2001, p. 14.
70 Bernard DEBARBIEUX, « Le lieu, le
territoire... »,
op.it, p.101.
29
caractéristiques physiques, est donc vecteur
d'identité, il combine une fonction spatiale - différente de
celle des villes - et une fonction sociale - qui se veut commune à tout
le territoire national. Les acteurs de l'école primaire sont
multi-situés71, ils existent dans l'espace du village, du
hameau, du bourg, mais ils existent aussi - grâce à l'école
- dans l'espace de la nation. Cette analyse fonctionne mieux dans le cas de la
IIIe république française, car
l'homogénéisation des pratiques scolaires est un des objectifs
que se fixe l'État, mais les écoles valaisannes, bien que moins
investies par le pouvoir central - cantonal et fédéral -
affichent comme objectif sans cesse répété d'oeuvrer
à l'unité nationale.
Cependant, il ne faut pas imaginer le levier scolaire comme
seule résultante de volontés nationales véhiculant
à travers l'école un éventail de représentations et
de pratiques uniformes sur tout le territoire. Un tel postulat impliquerait,
sur un mode diffusionniste, que l'apprentissage scolaire se ferait à
partir du haut vers le bas, sans tenir compte des spécificités de
chaque milieu de réceptions des pratiques scolaires nationales. Pour
exemple, un certain nombre de travaux ont pu considérer que
l'école introduisait des « pratiques urbaines » à la
campagne72 . Cette analyse implique plusieurs
présupposés dont celui de considérer que le monde urbain,
dynamique et modernisé, « avale » un monde rural statique,
laissé jusque-là hors de l'histoire. De plus, il y a une
confusion entre l'inscription de la république dans les territoires et
l'urbanité, thèse discutable : la République se veut
rurale et, si elle est souvent associée à Paris, lieu du pouvoir,
les discours de Méline suffisent à relativiser l'image d'un
pouvoir qui pense la campagne sur un référentiel
urbain73. Or, tout en reconnaissant la part prégnante de
l'État dans l'aménagement des lieux scolaires et la diffusion de
l'idée nationale, l'école doit composer avec un milieu physique,
social et culturel, qui porte lui aussi son lot de représentations. Plus
encore, il y a toujours des processus de réappropriations, de
réceptions, qui déforment et recomposent au niveau local les
politiques nationales. Dans ses travaux, Augustin Berque
dépoussière la mésologie et réhabilite le concept
de milieu74 considéré comme
71 Pour une brève synthèse du concept
voir Denis BOCQUET, « les études multi-situées, entre
pragmatisme et construction scientifique d'une posture », Espaces et
Sociétés, n°178, 2019/3, p. 175-182.
72 Notamment Placide RAMBAUD,
Sociétés rurales et urbanisation, Paris, Seuil, 1969,
chap. 3, ou Jean LEDUC, Histoire de la France, l'enracinement de la
République, 1879-1918, Paris, Hachette, chap. 3.
73 Sur la politique du cabinet Méline voir
Arnaud- Dominique HOUTE, Le Triomphe de la République
(1871-1914), Paris, Le Seuil, 2014, chap. 6.
74 Voir Philippe PELLETIER, « Pourquoi
Elisée Reclus a choisi la géographie et non l'écologie ?
», dans Denis CHARTIER, Estienne RODARY, Manifeste pour une
géographie environnementale, Paris, Sciences Po, 2016, p. 101-124,
p. 109.
30
la relation dynamique entre la société et
l'environnement, récusant l'opposition nature/culture75. Les
sociétés montagnardes en Haute-Savoie et en Valais existent dans
leur milieu, évidemment, ces relations et les manières de se le
représenter varient dans le temps, dans une perspective «
trajective »76 . En guise d'exemple, la spécialisation
de l'économie locale dans l'activité pastorale ne constitue pas
un état naturel, il fait partie d'un processus historique qui s'explique
par le faible rendement de l'agriculture et l'ouverture à des
marchés plus larges, il n'en reste pas moins que cela devient un aspect
de l'identité montagnarde avec sa pénétration dans la
société et sa réappropriation par les acteurs. Plus
encore, le tourisme modifie radicalement la manière de se
représenter son milieu, les terrains les plus dévalués
peuvent prendre une valeur nouvelle et inespérée pour les
habitants, favorisant le passage d'un environnement contrainte à un
environnement ressource 77 et le qualificatif de montagnard finit
d'ailleurs par être revendiqué par les acteurs locaux
eux-mêmes à la fin du XIXe siècle78.
De la même manière, l'école agit sur un milieu,
transformant nécessairement l'identité - au moins le rapport au
monde - des habitants de montagne, redéfinit les représentations
de l'espace, mais elle ne le fait pas seule : elle ne se substitue pas aux
manières de pratiquer et d'expérimenter son milieu, elle compose
avec elles. Si l'école est sûrement le « mode de
spatialisation dominant », il en existe d'autres79. Dans
le milieu de montagne et dans le lieu du hameau « on mange à la
même table et on échange plus entre soi qu'avec les autres. On vit
dans les mêmes paysages, on participe, dans beaucoup de menus faits du
quotidien, d'une même culture régionale ou nationale ; on partage
des représentations affectives : les connivences sont multiples
»80 . Ajoutons que la claustration hivernale ajoute
à ces « connivences », l'école de montagne,
déjà isolée, se retrouve littéralement
prisonnière des neiges pendant plusieurs mois chaque année.
75 Augustin BERQUE, La mésologie... op.
cit, chap. 2.
76 Ibidem.
77 Marie-Claire ROBIC (dir), Du milieu à
l'environnement : pratiques et représentations du rapport homme/nature
depuis la Renaissance, Paris, Economica, 1992, p. 239.
78 Bernard DEBARBIEUX, « Construits
identitaires et imaginaires de la territorialité : variations autour de
la figure du « montagnard » », Annales de géographie,
n°660-661, 2008, p. 90-115, p. 98.
79 Alain BOURDIN, « De la
production...op.cit, p. 83.
80 Jean-Luc PIVETEAU, « Le territoire... »,
op. cit, p.114.
31
CHAPITRE 2. Quand l'école se heurte au climat
« Autant les montagnes sont belles quand les
vallées qui en ceignent la base font une ceinture de feuillage, autant
elles sont effrayantes à voir lorsqu'elles reposent sur un monde de
frimas. Alors un silence terrible repose sur la vaste étendue des
vallées et des montagnes uniformément blanches ; le ciel gris se
confond avec l'horizon dentelé des cimes ; souvent les neiges
tourbillonnent fouettées par la tourmente, et les avalanches
s'écroulent en grondant du haut des rochers. Au milieu de cette nature
inhospitalière, l'homme, blotti dans un souterrain, se sent à
peine le droit d'exister. »81.
Ces phrases d'Elisée Reclus rendent bien compte de la
double figure des Alpes, majestueuses et terribles, mais aussi dangereuses.
Lorsque l'hiver approche, « tout change dans la nature, et telle
maisonnette, tel sentier, qui n'avaient jadis rien à craindre, finissent
par se trouver exposés au danger ; l'angle d'un promontoire a
peut-être disparu, la direction du couloir d'avalanche s'est
peut-être modifiée, une lisière protectrice de forêt
a cédé sous la pression des neiges, et, par suite, toutes les
prévisions des montagnards se trouvent déçues.
»82. On perçoit, à travers ces mots, le
danger de l'hiver montagnard, si rigoureux qu'il change à la fois le
paysage et les manières de vivre dans ces lieux. L'école alpine,
se trouve privée de quasiment toute communication avec
l'extérieur du hameau, dans cette claustration forcée, elle
devient le centre de la sociabilité villageoise. Le bâtiment
lui-même est dégradé par les aléas climatiques, les
frêles écoles ne supportent pas toujours la lourdeur des flocons.
Le froid s'insinue dans la salle de classe, le combattre requiert de fortes
dépenses dans des poêles encombrants et du bois parfois trop
humide qui ne parviennent à réchauffer ni les enfants, ni les
enseignants.
A] L'isolement hivernal
Les hameaux, reliés au reste du monde par l'unique
chemin menant au bourg pendant la belle saison, se replient sur eux-mêmes
pendant l'hiver. Les frontières habituelles se meuvent,
81 Elisée RECLUS, « Excursion à
travers le Dauphine, 1850-60 », Le Tour du Monde, vol 2
n°52, 1860, p. 416, cité par Soizic ALAVOINE-MULLER, « Les
Alpes d'Elisée Reclus », Revue de géographie
alpine, t. 89, n°4, 2001, p. 27-42, p. 36.
82 Elisée RECLUS, Histoire d'une
montagne, Paris, Hetzel, 1880, p. 130-132, cité par Soizic
ALAVOINE-MULLER, « Les Alpes d'Elisée Reclus », op.cit,
p. 37.
32
la sociabilité des habitants se cantonne aux limites
étroites du lieu : plus question d'aller au marché du bourg,
l'accès au transport ferroviaire - plus commun en France qu'en Suisse
pour les communes de montagne - est impossible, les déplacements sont
réduits. L'hiver touche tous les pans de la vie sociale et
économique, le « chômage climatique » selon l'expression
de Paul Guichonnet pousse parfois les populations à migrer en plaine
à l'approche de l'hiver, à la recherche d'une activité
rémunéré83 , souvent dans les industries
horlogères de la vallée de l'Arve pour les hauts-savoyards et
dans le peu d'industries que compte la vallée du Rhône en Valais.
Dans d'autres cas, c'est le travail à domicile, payé pièce
par les firmes des plaines qui permet une activité de subsistance.
Pourtant, l'éloignement trop prononcé des hameaux de montagne par
rapport au tissu économique urbain rend impossible la pratique de ces
activités. Les habitants sont donc réduits à l'inertie et
n'ont parfois d'autres relations que celles des quelques parents et voisins
proches.
Dans ces lieux où, « les jeunes gens
[qui] ne peuvent pas travailler en hiver [...] tiennent
à employer leur temps par la fréquentation scolaire
»84, l'école fissure le temps gelé comme
nulle part ailleurs, en continuant à dispenser son enseignement à
des élèves bien plus nombreux que pendant la saison
d'été. Elle est dès lors le seul lien avec
l'extérieur, avec ce que l'amoncellement de neige cache à la vue
: les leçons de géographie, les ouvrages de la
bibliothèque scolaire, permettent aux enfants d'imaginer un ailleurs, de
les projeter dans des contrées où le climat, moins rude,
n'affecte pas la vie sociale des habitants au-delà du port d'une
écharpe.
Les conditions climatiques, en plus d'entraîner des
difficultés pratiques de déplacements, présentent aussi
des dangers qui, comme une épée de Damoclès, menacent
chaque sortie à l'extérieur du foyer. L'inspecteur primaire de
Bonneville en fait part dans une lettre de 1882 à l'inspecteur
d'académie : « Au Tour par exemple, on a parfois 3
mètres de neige, et les avalanches, là comme dans tous les autres
hameaux, sont fréquentes et terribles. Impossible d'aller d'un hameau
à un autre pendant les 6 mois d'hiver »85 . Les
frontières du hameau, objectivement fermées, sont
traversées par l'école qui leur donne à voir autre chose,
autre part. Cela n'enlève rien pour autant à la rudesse de cette
vie cloîtrée ; une institutrice, ayant exercé pendant 10
ans (1912-1921) dans un hameau de Chamonix perché à 1300
mètres d'altitude
83 Paul GUICHONNET, « Politique et
émigration savoyarde à l'époque des nationalités
(1848-1860) », Hommes et Migrations, n°1166, 1993, p. 18-22,
p. 18.
84 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire
à l'inspecteur d'académie, 17 novembre 1882.
85 ADHS, 1 T 169, Lettre de l'inspecteur primaire
à l'inspecteur d'académie concernant la création des
écoles de hameaux, 6 novembre 1882.
33
témoigne : « Emprisonnée dans la neige
d'Octobre à Avril - Le 25 novembre il en était tombé 80 cm
dans la nuit, j'ai vécu en recluse, me consacrant à mes 19
élèves, lisant des livres empruntés à la
bibliothèque pédagogique, et « Le Volume » journal
pédagogique auquel j'étais abonné. Le jeudi je faisais du
ski avec mon frère. (Ce sport en était à ses débuts
dans la région) »86. Isolée donc,
renfermée sur la sociabilité familiale, l'ennui est presque
palpable chez l'enseignante ou du moins la monotonie du quotidien. Ces
conditions d'enseignement particulières entraînent des pratiques
scolaires différentes dans les écoles de montagne par rapport
à celles de plaine. Par exemple, concernant les moyens de transports,
les skis - à usage exclusivement domestique - sont un moyen
privilégié pour se déplacer sans que le corps s'enfonce
dans la neige, réduisant efforts et distance, et permettant, à
moindre échelle, d'échapper à cette geôle de
flocons. Autre alternative, la luge qui semble plébisciter par de
nombreux écoliers montagnards : l'inspecteur primaire, en visite
à l'école du bourg de Chamonix note en 1912 que « les
luges [sont] alignées contre le mur »87. La mention
est sobre, mais le fait qu'elle existe donne déjà à voir
d'un fait assez inhabituel - aux yeux de l'observateur - pour qu'on prenne la
peine de le noter. L'hiver reconfigure les moyens de se rendre à
l'école, des pratiques spécifiques au milieu montagnard prennent
place pour essayer au mieux d'abolir les distances accentuées par la
neige. Plus anecdotique mais non dénué de sens, un article d'un
instituteur valaisan anonyme, publié dans le journal pédagogique
en janvier 1904, recommande « le balayage à la neige »
des salles de classe, garantissant un « nettoyage bien plus
simple qu'avec le classique arrosage »88.
Les liens de proximité et le vivre ensemble du hameau
sont accentués par la restriction des circulations pendant 6 mois de
l'année. Cette situation d'entre-soi peut également être
vecteur de tensions. Certes, il est impossible d'affirmer que l'isolement
hivernal en est la seule et l'unique cause, mais il renforce
nécessairement cette sociabilité interne au hameau où les
liens se font ou se défont, les amitiés se soudent et les
rancoeurs s'accroissent. Intéressons-nous à la jeune institutrice
Lina Charlet (née Balmat), qui enseigne en 1905 dans le hameau des
Pellerins - sa mère exerce la même profession dans le hameau
d'à côté - dont « les habitants
86 MUNAE, « Fond Ozouf », Questionnaire
n° 940086815, Madame Ephise Jacquer.
87 ADHS, 1 T 793, Dossier individuel de l'instituteur
François-Narcisse Perrin, rapport d'inspection du 27 décembre
1912.
88 « Le balayage à la neige »,
L'école primaire, n°1, Janvier 1904, p. 15.
34
[...] passent pour les moins commodes de Chamonix
»89. Monsieur Alphonse Ancey lui adresse une lettre de
plainte en Mars 1905, il lui reproche d'avoir fait de son fils « le
bouffon de son école » et affirme que « tout ce qui
se passe a été toléré jusqu'à
présent, ce encore pour vous et vos parents en qualité de voisin,
que nous n'avons rien dit, n'y porté plainte contre vous. Voulant rester
en bons termes avec tous »90. Un mois plus tard, une
pétition des pères de famille atterrit sur le bureau de
l'inspecteur d'académie, reprenant les mêmes arguments et accusant
l'institutrice de négligence, notamment de laisser les enfants trop
longtemps en récréation en plein hiver91 (sur les 14
noms, figure un « Balmat » parent de l'institutrice ?). L'inspecteur
primaire reconnaît d'abord que cette plainte ne semble pas fondée
et rappelle que « Madame Charlet a le désavantage d'être
institutrice dans son village » avant d'avancer que «
Monsieur Balmat, père de Madame Charlet, aurait fait d'assez beaux
bénéfices en tenant le chalet de la Pierre pointue et celui des
Grands Mulets ; de là les jalousies et les inimitiés, dont
Monsieur Balmat a déjà souffert »92. Les
sociabilités hivernales « resserrées » de ces hameaux
peuvent générer des mécontentements, surtout au sein de
l'école qui en constitue le centre : les enfants fréquentent
très assidûment ses bancs et les manquements au règlement
de l'institutrice sont plus visibles. De plus, le bâtiment est
considéré comme un lieu où les enfants peuvent être
accueillis utilement pendant l'inactivité saisonnière, dans des
locaux chauffés qui font figure de refuge contre le froid : d'où
l'indignation quand les enfants sont laissés trop longtemps dehors ou
lorsqu'ils sont renvoyés chez eux avant l'heure réglementaire.
Les liens de voisinage, les liens familiaux retardent
l'expression du mécontentement - « les membres de sa famille
étant voisins avec nous avons toujours retardé à porter
plainte »93 - mais ne suffisent pas à la faire taire. Aux
beaux jours, les absences régulières et
répétées inquiéteront moins les parents, profitant
de la saison pour employer leurs enfants à divers travaux, mais, pendant
les mois d'hiver, l'école est une chose sérieuse, importante,
dont les règles doivent être respectées.
Si en France, l'institution scolaire n'est bouleversée
que dans ses marges, l'école valaisanne, située dans sa grande
majorité en moyenne montagne, est remise en cause dans l'ensemble de son
fonctionnement normal. En février 1910, la conférence annuelle
des
89 ADHS, 1 T 486, Dossier individuel de l'institutrice
Lina Balmat, lettre de l'inspecteur primaire à l'inspecteur
d'académie, 19 Août 1905.
90 Ibidem, Lettre d'Alphonse Doncey à
Lina Balmat, 27 Mars 1905.
91 Ibid, Pétition des pères de
famille auprès de l'inspecteur d'académie, 28 Avril 1905.
92 Ibid, Lettre de l'inspecteur primaire
à l'inspecteur d'académie, 19 août 1905.
93 Ibid, Pétition des pères de
famille auprès de l'inspecteur d'académie, 28 Avril 1905.
35
inspecteurs scolaires, prévue à Sion, a vu de
nombreux empêchements « par la détestable, ou
plutôt, abominable température de ces jours derniers »
94, ajoutant plus loin que « c'était le cas
notamment pour MM. Les inspecteurs les plus éloignés,
bloqués dans leurs vallées sans pouvoir momentanément en
sortir ou retenus chez eux grâce aux routes coupées sur
différents points »95. L'hiver handicape la bonne
marche de l'institution scolaire, là où elle n'est que
dysfonctionnement mineur outre-alpes. Cette réunion
empêchée ne semble pas être un fait rare. Chaque hiver,
inspecteurs ou instituteurs sont privés de réunions
professionnelles et même de toutes relations avec leurs collègues
pendant une moitié de l'année. Heureux sont ceux pour qui le
facteur peut encore monter livrer le journal pédagogique, presque le
seul lien entre les instituteurs coincés dans leur école et
l'École en tant qu'entité nationale, administrative et
pédagogique.
En Valais le lieu scolaire se transforme aussi en centre de
village, la fréquentation étant elle aussi bien meilleure en
hiver, nous y reviendrons. Néanmoins, la médiocrité des
bâtiments scolaires et l'investissement différencié selon
les communes en bois et en chauffage créent de grosses
inégalités de situation. L'état matériel des
écoles valaisanne s'améliore lentement, surtout à partir
de 1904, mais si la ferveur scolaire connaît une nette progression sur la
période, l'école n'a pas la même place dans la vie sociale
du canton que dans la vie sociale française. Josef Guntern en rendait
responsable « l'attitude de la population, à savoir son
indolence et son manque d'intérêt »96, il
semble plus probable que ce soit l'investissement tardif dans le champ de
l'éducation populaire qui en soit la cause, il n'en reste pas moins que
cela témoigne de l'importance mesurée assignée à
l'école. Et justement, les bâtiments scolaires alpins souffrent du
climat, qu'ils soient inadaptés à leur milieu ou justement
pensés spécifiquement par rapport au lieu, les expériences
scolaires des écoles alpines ne sont pas totalement les mêmes
qu'ailleurs.
B] Des bâtiments inadaptés
Dans cette sous-partie, nous prendrons exclusivement appui sur
les sources françaises par manque de documentation. Cependant, il n'est
pas à douter que, largement fondée sur les
94 « Conférences des inspecteurs scolaires »,
L'école primaire, n°2, Mars 1910, p. 2 (frontispice).
95 Ibidem.
96 Josef GUNTERN, L'école valaisanne...,
op. cit, p. 15.
36
conditions climatiques, les analyses proposées
ci-dessus s'appliquent également - sinon plus en raison de la
fragilité de l'investissement dans le bâti scolaire - au cas des
écoles valaisannes.
Malgré l'investissement conséquent de la
IIIe République dans les locaux scolaires, les écoles
de montagne restent des bâtiments sommaires, conçus pour parer au
besoin urgent d'instruction primaire. Les nouvelles écoles de hameaux
à Chamonix ont toutes été construites sur les mêmes
plans, respectant les normes républicaines - salle de classe au
rez-de-chaussée et logement de l'enseignant à l'étage - et
contrôlées dans leur conformité par l'inspecteur primaire
pour le compte du préfet. Le solde de subvention de l'État est
délivré seulement lorsque le bâtiment est jugé
conforme « aux plans et aux devis approuvés par
l'administration supérieure »97. Si la marge de
manoeuvre est mince, les autorités s'accommodent pourtant de quelques
manquements aux devis initiaux, lorsque la garniture de cheminée en
marbre n'a pas été montée, ou encore que «
l'évier de la cuisine est en mélèze au lieu d'être
en pierre »98. Toutefois, un des principaux
problèmes soulevés par cette centralisation du bâti
réside en ce que les écoles n'ont pas été
pensées pour les conditions géographiques particulières
qui composent le quotidien de la vie en montagne. En plus des délais de
construction très longs, interrompus pendant les longs mois hivernaux -
7 ans de travaux - les bâtiments scolaires se dégradent
très rapidement. Dès 1893 - 3 années après sa
construction - l'école du Tour nécessite déjà des
travaux urgents. L'inspecteur primaire en reconnaît les failles :
« le reproche que l'on pourrait faire à ces travaux, c'est
qu'ils ont été mal prévus » il ajoute plus loin
que « les cheminées, telles qu'elles ont été
projetées et exécutées ne présentaient pas une
résistance suffisante à la quantité de neige qui tombe
à Chamonix » et conclut : « On aurait dû
modifier les plans primitifs »99 . La politique de
normalisation de l'enseignement primaire a failli, le pouvoir
décisionnel étant trop loin de la réalité du
terrain. Autre exemple, en avril 1905, l'école d'Argentière est
largement dégradée par un tremblement de terre. Ces aléas,
pourtant fréquents en montagne, n'ont pas été pris en
compte lors de la construction du bâtiment. En conséquence, la
classe n'a pas pu se tenir pendant plusieurs semaines et l'inspecteur
d'académie, sous l'égide du préfet, ordonne la
réduction des vacances d'Avril pour rattraper le temps d'enseignement
perdu pendant les travaux100. L'inadaptation des locaux scolaires au
milieu montagnard montre
97 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire
à l'inspecteur d'académie concernant la vérification de
l'école de Pratz, 29 Juin 1890.
98 Ibidem.
99 ADHS, 1 T 418, Lettre n°1245 de l'inspecteur
primaire à l'inspecteur d'académie, 30 Mai 1893.
100 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 5 Septembre 1905.
37
une fois encore l'écart entre la politique
centralisatrice déployée dans les affaires scolaires
françaises et la réalité de la diversité des
situations locales. Les manquements des autorités centrales dans la
construction des bâtiments scolaires entraînent à leur suite
une série d'événements qui modifient les pratiques
scolaires des habitants de montagne - à l'inverse du but initial que se
fixe l'enseignement primaire.
Pour exemple, les écoles de hameaux ne possèdent
pas de jardin. Les instituteurs et institutrices perçoivent une prime
depuis au moins 1885 du fait de ce manque101, mais une grosse partie
du discours républicain, très insistant depuis les débuts
de la IIIe République sur l'apprentissage des cours
d'agriculture et d'horticulture ne peut être mis en pratique. Les
programmes scolaires ne cessent de soulever l'importance de ces cours qui
prennent normalement place dans le jardin attenant à l'école afin
d'une part, d'améliorer les pratiques agricoles des populations rurales,
et d'autre part - pour l'horticulture - de développer un goût de
l'esthétique paysagère102 au coeur d'un enseignement
aux atours parfois naturalistes - nous y reviendrons. Autre point
témoignant de la spécificité de l'école de hameau,
l'accès à l'eau courante. Ces écoles, contrairement aux
écoles de ville qui possèdent de meilleurs équipements, ne
possèdent pour certaines pas d'accès à l'eau jusque dans
la toute fin des années 1890. Le conseil municipal de Chamonix pointe ce
manque dans une séance du 19 août 1897, et propose la prolongation
du conduit d'eau jusqu'à l'école car, « l'instituteur
qui a plus de 400m à parcourir aller et retour chaque fois qu'il a
besoin de s'alimenter, mais encore au point de vue de la propreté et de
la salubrité de la classe qui est privée sous ce rapport de
l'élément le plus utile »103 . En effet,
comment concilier les campagnes hygiénistes au centre des doctrines
scolaires, tant en France qu'en Suisse à la Belle Époque
avec l'impossibilité de s'alimenter en eau courante ? Et que se
passe-t-il lorsque les élèves, en manque d'eau dans les chaudes
journées d'été, doivent, pour s'hydrater, parcourir 800
mètres aller/retour ? De plus, si la régularisation s'effectue
dans les années suivantes, le froid hivernal menace souvent le bon
fonctionnement des canalisations. Toujours durant l'année 1897, les
canalisations de l'école normale de Bonneville, située à
environ 600 mètres d'altitude ont gelé, privant les
élèves-maîtres de l'accès
101 ADHS, 2 O 2175, Chamonix, « Vie scolaire »,
Lettre de l'inspecteur primaire de Bonneville à l'inspecteur
d'académie, 10 Septembre 1885.
102 Voir sur ce point la distinction faite entre agriculture
et horticulture par Yves LUGINBULH, « Le XIXe siècle, de
l'éclatement aux tentatives de recompositions d'une totalité de
la nature », dans Marie-Claire ROBIC (dir), Du milieu à
l'environnement..., op.cit, p. 27-49.
103 ADHS, 2 O 2175, Délibération du Conseil
Municipal de Chamonix, 19 Août 1897.
38
à l'eau courante104, il est facile
d'imaginer que ces faits relèvent du quotidien pour des écoles de
hameau situées entre 1200 et 1400 mètres d'altitude. Les
déplacements rendus difficiles en hiver par la quantité de neige
importante ne favorisent pas non plus l'approvisionnement en eau en cas de gel
des canalisations.
Si les écoles du bourg sont souvent mieux pourvues et
moins enclavées, on constate que l'hiver dévoile les failles dans
les constructions de bâtiments. Le médecin scolaire cantonal des
épidémies, monsieur Servellaz, écrit un rapport au
sous-préfet en 1908 sur la situation de l'école de garçons
du bourg de Chamonix et commence par noter que « l'école est
dépourvue de préau couvert et asphalté (dans un pays ayant
4 mois de neige »105 - les plans des écoles de
hameaux n'en prévoient pas non plus. Il poursuit en précisant que
« les cours sont mal empierrées et non exposées au
soleil, si bien que les enfants jouent dans la boue les jours de pluie ou de
fonte des neiges et de nombreux jours suivants »106.
L'école républicaine n'est pas adaptée au milieu de
montagne, les plans normés des bâtiments peinent à
résister au lieu : les écarts/normes pratiques se creusent. Une
partie des enseignements prévus ne peut pas avoir lieu, les conditions
d'études ne sont pas favorisées par les différents manques
énumérés ci-dessus et de surcroît, toujours selon le
docteur Servellaz, « ces conditions antihygiéniques doivent
jouer un rôle très important dans l'éclosion des maladies
parmi les élèves »107. Il s'agit alors de
déployer des stratégies pour lutter contre le froid, de
manière à assurer le bon fonctionnement de l'école de
montagne et ainsi permettre aux enfants d'étudier dans des conditions
favorables, faits primordiaux pour favoriser l'amélioration des
conditions d'enseignements.
C] Lutter contre le froid
Les épidémies sont fréquentes dans ces
communes de montagne. Les autorités sont particulièrement
vigilantes à éviter leur propagation et promptes à
réagir aux cas d'infections. Le médecin cité plus haut
évoque le fait que « les fièvres éruptives
éclatent avec une certaine gravité toute particulière chez
les enfants exposés au froid lors de l'éclosion de ces
104 ADHS, 1 T 1236, Conseil d'administration de l'école
normale de Bonneville, 26 Juin 1897.
105 ADHS, 2 O 2175, Lettre du docteur Servellaz au
sous-préfet de Bonneville, 14 Novembre 1908.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
39
maladies »108. Sur avis de celui-ci,
décision peut être prise d'isoler les enfants malades ou
même parfois de fermer les classes pendant une certaine période.
En général, les autorités françaises sont plus
frileuses à décider la fermeture de classe, souhaitant à
tout prix ne pas interrompre le bon fonctionnement de l'école
républicaine. En Valais, étant accepté d'une part, que les
écoles n'ont pas toute la même durée en fonction de leur
localisation géographique, d'autre part, que le programme n'est jamais
suivi à la lettre ni vraiment homogène dans le canton -
l'État se tenant plutôt à distance des décisions
scolaires - les fermetures sont décidées plus aisément,
souvent par les pouvoirs locaux, sans que cela ne remette en cause le
bien-fondé de l'enseignement primaire.
Pour exemple, les écoles valaisannes resteront
fermées pendant de longues semaines en 1918 pendant
l'épidémie de grippe, sans qu'il n'en soit fait mention plus de
quelques fois à la commission cantonale de l'instruction
primaire109 . Toutefois, dans les deux territoires, les
épidémies dont la cause est imputée au froid,
déstabilisent pendant la période hivernale la marche normale des
écoles. D'autant plus que la promiscuité dans laquelle vivent les
habitants de hameaux favorise la diffusion rapide des maladies. Celles-ci sont
d'autant plus graves que l'isolement et les rudes conditions climatiques des
hameaux ne favorisent pas l'établissement de médecins sur place,
capables de prendre en charge la patientèle enfantine. L'instituteur
Paul Vigroux, ayant enseigné pendant 6 ans dans la commune de
Petit-Bornand exprime ce manque, constatant « l'absence de docteur
dans un rayon de moins de 12 kilomètres »110.
Introduisons néanmoins une distinction au sein même des communes
de montagne, entre celles qui deviennent des destinations touristiques à
partir de la seconde moitié du XIXe siècle et celles
qui restent dans un relatif isolement. Pour les premières, la
présence de médecins est une nécessité et une
activité lucrative au vu de l'afflux de visiteurs pendant une
période de l'année. La commune de Chamonix par exemple compte
dès 1884 au moins un médecin qui vaccine gratuitement les
enfants111, c'est également le cas de communes valaisannes
comme Nendaz. Pour la seconde catégorie de commune, la faible
attractivité des bourgs n'encourage pas la fixation de médecins
à l'année. Les écoles doivent se contenter de la visite
annuelle du médecin scolaire en Valais ou celle, plus
régulière, du médecin scolaire des épidémies
en Haute-Savoie. Toutefois, même dans les communes
privilégiées, les médecins ne s'installent parfois que
108 Ibid.
109 AEV, 3 DIP 188, Protocole de la commission cantonale de
l'instruction primaire, 22 Octobre 1918.
110 ADHS, 1 T 55, Lettre de l'instituteur Paul Vigroux à
l'inspecteur d'académie, 19 Juillet 1913.
111 ADHS, 2 0 2174, Délibération du Conseil
Municipal, 23 Août 1883.
40
pendant la saison d'été, c'est ainsi que
Chamonix se trouve privée de médecin pendant l'hiver 1887 alors
qu'une épidémie de rougeole sévit.
Dans tous les cas, les épidémies au sein de
l'école sont perçues comme un danger que favorise le rude climat
montagnard. En 1902, des cas de diphtérie sont détectés
dans les écoles de Chamonix : à la question de savoir s'il faut
fermer les classes ou non, le secrétaire général du
préfet adresse une lettre à l'inspecteur d'académie pour
maintenir les classes ouvertes tout en veillant à ce « qu'aucun
des enfants qui ont été atteints ne soit admis en classe avant 40
jours à dater du début de la maladie »112.
Quelques années plus tard, en février 1908, une
sévère épidémie de rougeole touche plus de 130
enfants chamoniards, la fermeture ne peut plus être évitée.
Le docteur Bonnefoy fait un rapport dans lequel il valide la décision de
fermeture des classes pendant 15 jours avec, en contrepartie, une suppression
des vacances d'avril113. Si le froid est tenu responsable, il faut
s'assurer de lutter contre ses conséquences sur la santé des
élèves au sein de classes et ici, le pouvoir communal est
l'acteur décisionnel majeur.
En Valais comme en Haute-Savoie - et plus
généralement en France comme en Suisse - les communes fournissent
certains avantages en nature aux instituteurs. Jean-François Chanet
remettait même en cause l'idée d'égalité de
conditions des postes d'enseignants du fait des différentes faveurs
variant selon les communes - importance des primes ou secrétariat de
mairie114. Dans la même idée, Danièle
Périsset-Bagnoud expliquait le « leurre » selon elle, de la
gratuité scolaire valaisanne : les impôts locaux financent des
avantages plus ou moins larges attribuées aux
instituteurs115. Ce sont les communes qui s'occupent de fournir le
bois aux écoles et aux instituteurs/institutrices, ce qu'elles font en
fonction de leurs moyens et de leur degré de préoccupation quant
aux affaires scolaires. Dans les cahiers référençant le
personnel enseignant valaisan, on trouve parfois au sein d'une même
commune, des instituteurs ou institutrices qui bénéficient du
bois fourni - avec en général 30 francs de retenue sur leur
salaire - et d'autres qui n'y ont pas droit, c'est le cas pour la commune de
Fully pour l'année 1891-1892116. En
112 ADHS, 1 T 418, Lettre du secrétaire
général du préfet à l'inspecteur d'académie,
3 Mars 1902.
113 ADHS, 1 T 418, Rapport du docteur Bonnefoy à
l'inspecteur d'académie, 26 Février 1908.
114 Jean-François CHANET, « Les instituteurs entre
État-pédagogue et État-patron, des lois
républicaines aux lendemains de la Grande Guerre » dans
Marc-Olivier BARUCH, Vincent DUCLERT (dir), Serviteurs de l'État :
une histoire politique de l'administration française, Paris, La
Découverte, 2000, p. 351-363.
115 Danièle PERISSET-BAGNOUD, « L'instruction
primaire publique en Valais 1830-1885 : Des législations cantonales
à leur application », dans Rita HOFSTETTER, Charles MAGNIN, Lucien
CRIBLEZ, Carlo JENZER (dir.), Une école pour la
démocratie...op.cit, p. 137-151, p. 139.
1 DIP 21, Personnel enseignant, commune de Fully, 1891-1892.
116 AEV,
41
Haute-Savoie, les provisions de bois sont presque
systématiquement fournies aux personnels enseignants et plus
généralement aux écoles, où la
nécessité de se chauffer revêt une importance primordiale.
La dépense est telle qu'en 1884, le conseil municipal de Chamonix
décide de demander une contribution de 30 francs par an aux instituteurs
pour l'approvisionnement en bois117. Toutefois, la commune voit
à l'économie en ne fournissant qu'un « poêle
ordinaire de moindre valeur »118 aux écoles de
hameaux nouvellement construites en lieu et place du calorifère
proposé par l'autorité supérieure. Mauvais calcul car le
bois pèse énormément sur les dépenses de la
commune, décision est prise dès 1892 de le remplacer par de
l'anthracite pour chauffer les classes, d'autant plus que le conseil municipal
est de plus en plus vigilant quant à la préservation de la
forêt sur son territoire. Mais les quantités sont mal
estimées au départ : la commune commande 30 tonnes pour chauffer
les écoles pendant l'hiver 1884, cela ne suffit pas. Le conseil communal
se voit donc contraint de recommander dans l'urgence quelques tonnes en plus
alors que son premier souci était que « les transports puissent
se faire avant les neiges »119. En effet, l'enclavement
hivernal ne permet pas les communications entre le bourg et les hameaux pendant
plusieurs mois de l'année. Le transport d'une dizaine de tonnes
supplémentaires de combustibles à acheminer ensuite sur des
distances longues de plusieurs kilomètres, sur des routes
entravées par la neige et le gel n'est pas chose aisée. Pendant
ce temps, les élèves de l'école et l'enseignant doivent
supporter le froid qui s'insinue dans la classe, ou solliciter l'aide des
voisins bienveillants en attendant un temps plus clément pour assurer la
livraison de combustibles. La commune prend note du problème et
investit, en 1897, dans l'achat de 8 calorifères pour remplacer les
fourneaux peu efficaces et énergivores de ses écoles. Les
quantités commandées - environ 40 tonnes par an - se stabilisent
dès le milieu des années 1890, montrant l'intérêt de
Chamonix à régler le problème du chauffage des classes.
Les élèves peuvent profiter de l'atmosphère chaude et
accueillante de la salle de classe, qui contraste avec le froid glacial du
dehors. L'hiver qui sévit d'octobre à mars fait de l'école
le nerf du village, accueillant les nombreux enfants qui viennent y trouver
refuge.
Néanmoins, la plupart des communes de montagne de la
Belle Époque ne disposent ni de finances aussi importantes que
Chamonix, ni de moyens de transport aussi sophistiqués - train
117 ADHS, 2 O 2174, Délibération du Conseil
Municipal, 14 Décembre 1884.
118 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie concernant la vérification de
l'école de Pratz, 29 Juin 1890, op. cit.
119 ADHS, 1 T 418, Délibération du Conseil
Communal, 18 Août 1894.
42
dans le bourg, pour pouvoir à un approvisionnement
aussi conséquent. Il faut, semble-t-il, prendre la mesure du fait que,
dans bien des hameaux, l'enfant a froid.
43
CHAPITRE 3. Pratiquer l'école dans les Alpes
suisses et
françaises
Nous avons jusqu'ici beaucoup insisté sur l'inscription
de l'école dans un milieu, le milieu montagnard qui crée des
expériences scolaires différenciées des autres
milieux120 . Évidemment, les politiques scolaires
françaises et suisses diffèrent et l'école des Alpes n'est
pas la même des deux côtés de la frontière.
Toutefois, en privilégiant les caractéristiques
géographiques communes, nous avons essayé par-là de
transgresser le cadre d'analyse national, quasiment naturalisé dans les
études en histoire de l'éducation. Combiner approche spatiale et
histoire de l'éducation permet de dégager l'école de son
uniformité nationale supposée, en privilégiant une analyse
microhistorique, proche des acteurs locaux et dégageant des défis
propres aux écoles alpines. Toutefois, le milieu géographique
n'entraîne jamais une détermination complète des pratiques
et des représentations. Nous envisageons la montagne dans une
perspective constructiviste, comme un fait social construit comme le proposent
Bernard Debarbieux et Gilles Rudaz121. Roger Chartier a quant
à lui beaucoup insisté sur la fécondité du concept
de représentation, donnant comme tâche à l'histoire de
« reconnaître la manière dont les acteurs donnent sens
à leurs pratiques et à leurs discours »122.
Et dans le domaine des représentations, il faut en premier lieu rendre
justice aux décisions politiques qui donnent un cadre de
référence et des moyens concrets aux acteurs scolaires pour
justifier leurs pratiques - le rapport à l'école n'est pas le
même en Haute-Savoie et en Valais. Ajoutons néanmoins que ces
pratiques, si elles ne sont pas totalement déterminées par le
milieu géographique, ne le sont pas non plus par le niveau
macro-politique, mais plutôt par une combinaison des deux, dans un
processus « d'appropriation de leurs univers par les êtres
humains »123 . Il existe des interstices entre normes
nationales et pratiques locales, souvent justifiées, comme nous le
verrons, par des références au milieu de montagne, mais de
manière
120 Principalement villes ou plaines mais l'on pourrait penser
à d'autres comme le milieu côtier.
121 Bernard DEBARBIEUX, Gilles RUDAZ, Les faiseurs de
montagne, Paris, CNRS, 2013, p. 8-9.
122 Roger CHARTIER, Au bord de la falaise. L'histoire entre
certitudes et inquiétudes, Paris, Albin Michel, 1998, p.
96.
123 Principe au coeur de l'histoire du quotidien allemande
portée par Alf LÜDTKE (dir), Histoire du Quotidien, op. cit,
p. 7.
44
différenciée en France et en Suisse. Ces
justifications découlent d'une perception par les acteurs d'un espace
vécu124. L'anthropologue américain Tim Ingold
rappelait très justement que nous sommes « des êtres
à l'intérieur du monde »125.
A] Des écoles valaisannes à
temporalité variable
Sur toute la période étudiée, les
écoles valaisannes n'ont pas la même rythme annuel qu'elles soient
placées en montagne, en plaine ou en ville. En 1906, le chanoine de
Cocatrix, fait une rétrospective sur l'évolution de
l'enseignement valaisan sur la période 1886-1906. Il constate que
l'année scolaire dans les écoles valaisannes ne dure que rarement
plus de 6 mois car la plupart sont des écoles de montagne126.
Il explique ainsi les difficultés inhérentes au
développement de l'enseignement primaire dans le canton en s'appuyant
sur des contraintes liées à l'environnement alpin: « qui
juge de notre situation en la comparant avec celle d'une grande ville ou
même simplement d'un canton du Jura ou du Plateau est porté
à se tromper grandement » car « dans un grand nombre
de communes, par suite de conditions topographiques et économiques,
l'enfant du Valais ne trouve pas, dans l'intérêt de son
développement intellectuel, toutes les facilités qui se
présentent à chaque pas au petit citadin ou à
l'agriculteur de Soleure ou de Fribourg »127. Les mots
choisis par le chanoine sont lourds de sens, il place la campagne agricole et
la ville sur le même plan, en distinguant pleinement la montagne,
présentée comme une spécificité valaisanne. Or,
bien que le canton soit le plus haut en altitude moyenne (2140 mètres),
de nombreux cantons comme ceux des Grisons (2021 mètres) ou d'Uri (1896
mètres) ont un environnement montagneux similaire et pourtant, comme le
reconnaît lui-même le chanoine, les écoles y durent en
général 10 mois128. Cocatrix oublie également
qu'au sein du Valais même, il existe des plaines agricoles dans la
vallée du Rhône et des villes de taille respectables (Sion ou
Martigny) dont l'année scolaire dure entre 7 et 9 mois. La confusion
entre montagne et Valais, la mise à distance des plaines et des villes
du canton rendent bien compte de l'importance du milieu montagnard dans les
représentations que se font
124 Concept porté par Armand FREMONT, La
région, espace vécu, Paris, Flammarion, 1999 [1976].
125 Tim INGOLD, « Culture, nature et environnement »,
Tracés. Revue de Sciences humaines, n°22, 2012, p. 169187,
p. 180.
126 AEV, 1 DIP 102bis, cahier sur les examens de recrue par le
chanoine Cocatrix, 1906, p. 15.
127 Ibidem, p. 14.
128 Ibid.
45
d'eux-mêmes les valaisans. La différence des
temps scolaires ne constitue pas une anomalie : elle est affirmée par
les autorités et fait partie d'un règlement plus ou moins flou
qui s'adapte au contexte local.
D'ailleurs, les populations semblent s'en accommoder car nous
n'avons repéré aucune contestation de la part des parents
d'élèves. La séance du 11 février 1908 de la
commission cantonale de l'enseignement primaire rappelle que les écoles
de ville ont une durée de 9 mois (mais d'autres de 8 mois), les
écoles de village ont un cycle de 7 mois sauf pour les villages nomades
(6 mois)129. Difficile de s'y retrouver car les règles sont
souples, les écarts par rapport à la norme sont nombreux.
Toutefois, rien ne va être fait pour normaliser la durée de
l'année scolaire, le canton accepte ce traitement
différencié comme un fait naturel lié aux conditions
géographiques et aux modes de vie locaux, alors même qu'à
quelques kilomètres de là, les écoles hauts-savoyardes,
comme toutes les écoles françaises, ont une durée annuelle
de 10 mois. Malgré les efforts déployés par le canton pour
améliorer son offre scolaire, la question de la durée
l'année scolaire va rester inchangée, exemple en est donné
dans L'école primaire en 1917 : « nos écoles
ont rouvert leurs portes, au moins dans les localités de plaine les plus
importantes, car l'on n'ignore pas que c'est à la Toussaint que s'ouvre
le cycle scolaire, pour nos écoles de 6 à 7 mois,
assurément les plus nombreuses »130.
Une question à laquelle nous ne pouvons d'ailleurs pas
répondre avec certitude est de savoir pourquoi les communes de montagne
ont un traitement spécifique ? Le chanoine de Cocatrix évoque
plusieurs raisons. Tout d'abord, les difficultés de déplacement
des élèves dans les lieux de montagne, mais l'implantation de
l'école, renforcée après les lois de 1873, 1903 et 1907
est uniformément présente sur le territoire, même dans les
communes les plus isolées - bien que parfois de qualité
médiocre. De plus, la scolarisation est obligatoire sous peine d'amende
et les mois de fonctionnement de l'école (d'Octobre à Avril) sont
parmi les mois où l'hiver rend difficiles les déplacements,
pourtant, les enfants s'y rendent plus massivement que le reste de
l'année. Il semble donc que l'école soit pratiquement accessible
aux habitants des hameaux. Une seconde raison déjà
évoquée est celle du besoin des parents de disposer de leurs
enfants pour les travaux agricoles d'Avril à Octobre. Or, les
économies de montagne sont plus structurées par l'activité
pastorale que par l'activité agricole, et même si l'inverse
était vrai, on peut se demander pourquoi les écoles de plaine -
dont les populations vivent de l'agriculture - ont une durée annuelle de
7 à 8 mois ? La troisième raison avancée est la
transhumance qui
129 AEV, 3 DIP 188, Protocole de la commission cantonale de
l'enseignement primaire, 11 Février 1908.
130 « La famille et l'école »,
L'école primaire, n°9, Novembre 1917, supplément,
p. 178-180, p. 178.
46
favorise l'existence d'écoles nomades, mais nous avons
déjà montré que si ces écoles existent, elles
restent des exceptions dans le maillage scolaire. L'argumentation
déployée pour justifier la durée des écoles de
montagne est géographique, elle s'inscrit dans un processus de
naturalisation de la montagne comme milieu spécifique qu'il n'est pas
question de contester ; alors même que ce processus est lui-aussi une
construction sociale.
On comprend aisément que les expériences
scolaires des enfants de montagnes diffèrent de celles des enfants des
autres milieux géographiques. Le nombre important de mois de
scolarisation en moins joue nécessairement sur l'instruction de ces
populations. Le chanoine de Cocatrix note cependant que « pendant ce
laps de temps si court, il faut, comme dans les écoles dont la
durée est plus longue, remplir tout le programme sans l'alléger
en rien »131. En plus de paraître difficilement
possible, cette considération se heurte aux réalités
locales. Après avoir consulté les rapports des inspecteurs
primaires, il apparaît que la liberté dans l'application des
programmes est grande pour les régents132 et les
institutrices. Pour l'année scolaire 1890-1891, à l'école
de garçons de la Bâtiaz (Martigny-Bâtiaz) - située
dans la vallée du Rhône, proche de la ville de Martigny -
étaient enseignés entre autres : 1 heure de chant, 1 heure
d'arboriculture et 1h de gymnastique133, alors que l'école
mixte de la Fontaine (Martigny-Combe) n'enseignait aucune des trois
matières, ni d'ailleurs l'histoire nationale134. Ces
différences ne semblent pas poser problème aux autorités
scolaires : aucun inspecteur ne trouve à redire et la rubrique «
observations générales » reste bien souvent vide. Le fait
que, de ces deux écoles, l'une soit en plaine - avec une durée
plus longue - et l'autre en montagne - durée plus courte - peut en
partie expliquer la différence de programmes. Les écoles de
montagne doivent - contrairement à ce qu'écrit de Cocatrix - se
concentrer sur les matières primordiales, expliquant le
délaissement du chant ou du dessin. D'autre part, l'inexistence de
jardins dans les écoles de montagne rend souvent impossible la pratique
de l'arboriculture de même pour la gymnastique qui souffre du manque de
matériel et de locaux des écoles de hameaux - nous y
reviendrons.
Mais au-delà des différences entre les
écoles de montagne et de plaine, il en existe également entre les
écoles de hameaux elles-mêmes, confirmant la souplesse en vigueur
dans l'application des programmes. Pour l'année 1899-1900, au sein de
deux écoles mixtes du même
131 AEV, 1 DIP 102bis, Cahier sur les examens de recrue par le
chanoine Cocatrix, 1906, p. 15.
132 Le terme « régent » est utilisé en
Valais comme synonyme d'instituteur.
133 AEV, 1 DIP 58, Rapport d'inspection de l'école de
garçons de la Bâtiaz (Martigny-Bâtiaz), 22 Février
1891.
134 Ibidem, École mixte de Borgeaud
(Martigny-Combes), 3 Mars 1891.
47
village - Martigny-Combes - les enseignements divergent
énormément. L'institutrice Moret-Rouiller enseigne à
l'école du Borgeaud, sa classe, divisée en 3 sections d'âge
compte 11 élèves, elle enseigne 8 heures de lecture par semaine
à la troisième section, 6 heures de calcul mental et 1 heure de
géographie à la première section135. A quelques
kilomètres de là, dans un autre hameau, l'institutrice
Cécile Saudan enseigne dans l'école mixte du Brocard à 19
élèves regroupant également trois niveaux. En lecture,
elle ne consacre que 3 heures par semaine à la troisième section
et 1 heure de calcul mental à la première section. En revanche,
si elle n'enseigne pas la géographie à la première
section, elle en enseigne 2 heures hebdomadaires aux deuxièmes et
troisièmes sections : matière absente chez sa
collègue136. Les deux écoles sont visitées
à trois jours d'intervalle par l'inspecteur Rouiller qui ne
s'inquiète pas de ces différences et n'en donne aucune
justification : il ne semble pas sommer de rendre des comptes à ses
supérieurs.
Les pratiques scolaires des enseignants sont variables,
dépendant largement de leur volonté et capacités propres.
Dans un même village, des élèves peuvent connaître
une éducation très différente qui ne semble unie que par
des directives très générales, et somme toute assez
floues. En plus du différentiel d'expériences entre école
de la ville, école de la plaine et école de la montagne - se
faisant sentir par la durée de l'année scolaire mais aussi par la
différence dans les enseignements et dans le matériel - il existe
de larges disparités au sein même des communes. De l'autre
côté des Alpes, aucune différence aussi marquée
entre les lieux scolaires, néanmoins le milieu montagnard est
également au centre des justifications de certaines pratiques
scolaires.
B] De la mixité scolaire
Les politiques de développement de l'éducation
populaire qui fleurissent en Europe dans le dernier tiers du XIXe
siècle intègrent petit à petit l'instruction des filles,
jusque-là abandonnées aux congrégations religieuses. En
France, si la loi Guizot de 1833 prévoyait l'obligation d'entretenir une
école de garçons dans toute commune de plus de 500 habitants,
c'est seulement en 1867 avec la loi Duruy que la mesure s'étend aux
écoles de filles, et avec les lois Ferry que l'instruction publique des
filles prend sa pleine mesure. Phénomène similaire
135 AEV, 1 DIP 85, Rapport d'inspection de l'école du
Borgeaud (Martigny-Combes), 11 Avril 1900.
136 Ibidem, École du Brocard (Martigny-Combes),
14 Avril 1900.
48
en Suisse avec la loi de 1874 qui oblige leur scolarisation
dans tous les cantons. Toutefois, les rôles attribués à
chaque sexe divergent fortement : filles et garçons sont
séparés à l'école partout où faire se peut.
Dans la plupart des villes et villages existent une école de filles et
une école de garçons, mais cela n'est pas vrai pour les hameaux
de montagne. La dissémination des populations sur des territoires assez
vastes et les difficultés de circulation hivernale ont obligé les
communes à se doter d'une multitude de petites écoles pour
répondre aux lois d'obligation scolaire, mais, dans ces lieux
isolés, impensable de construire deux bâtiments distincts pour
accueillir filles et garçons. En termes d'investissements, les
dépenses seraient trop lourdes pour les communes et la faible population
d'âge scolaire ne justifie pas un tel coût. Ces écoles sont
donc presque toutes mixtes, filles et garçons vont s'asseoir sur les
mêmes bancs dans la promiscuité de la maison-école,
partageant un enseignement, une expérience scolaire par beaucoup de
points similaires, entorse majeure à la division des sexes en
vigueur.
En France, la situation semble être acceptée sans
trop de problème, aucune plainte des parents ou volonté de
changement de la part de l'administration n'est enregistrée sur la
période. Dans la commune de Chamonix, seul le hameau de Montquart aura
deux classes distinctes à partir de 1882, mais l'inspecteur primaire
appuie la demande de la commune en invoquant l'augmentation récente de
la population scolaire et jamais en se référant à
l'anomalie du mélange des deux sexes137 - l'école
redeviendra d'ailleurs mixte en 1910. Dans toutes les communes de montagne, les
écoles mixtes sont monnaie courante, il en existe à Chamonix,
mais aussi aux Houches, à Saint-Gervais, ou à Vallorcine et
environ 40 sur le département de la Haute-Savoie en 1907138.
Il faut toutefois noter que cet état de fait, s'il est exacerbé
par le milieu montagnard, ne lui est pas spécifique : il existe
également des classes mixtes dans des petits villages de France rurale
hors-Alpes139.
Pourtant, une autre caractéristique de ces
écoles est particulière au milieu alpin. La loi Goblet du 30
Octobre 1886 prévoit que les écoles mixtes soient dirigées
par des institutrices, difficile en théorie qu'un instituteur puisse
enseigner à des jeunes filles. Le texte prévoit tout de
même une possibilité de contournement en indiquant que « le
conseil départemental, peut, à titre provisoire, et par une
décision toujours révocable : 1° permettre un instituteur de
diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint
une maîtresse de travaux de couture ; 2°
137ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire
à l'inspecteur d'académie concernant le dédoublement de
l'école de Montquart, 17 Novembre 1882.
138 ADHS, 1 T 87, « Écoles mixtes : enquêtes
concernant la direction », 1907.
139 Odile ROYNETTE, « La mixité, une
révolution en danger ? », L'histoire, n°455, 2019, p.
12-19.
49
autoriser des dérogations aux restrictions du
second paragraphe du présent article ». C'est en s'appuyant
sur cette seconde clause que les communes de montagne vont renverser la norme
établie de la direction des classes mixtes par des institutrices, tout
en réifiant les frontières morales de distinction des sexes. La
commune de Saint-Gervais va demander, année après année,
le maintien d'instituteurs à la tête de ses 5 écoles de
hameaux, évoquant que celles-ci « sont de trop hautes altitudes
pour être dirigées par une institutrice qui en hiver rencontre
souvent des impossibilités de communication ou même des moyens
d'alimentation. Que les autres écoles mixtes sont trop nombreuses pour
qu'une institutrice souvent jeune et toujours d'un tempérament
délicat puisse suffire à tant de fatigue. Qu'en outre, les
écoles nombreuses exigent beaucoup plus de discipline qui s'obtient
beaucoup plus facilement par l'autorité physique
»140 . La commune voisine de Vallorcine emploie
le même type de justification en « considérant que le
pays [est] mauvais et plus supportable pour des instituteurs que des
institutrices »141. Ces requêtes sont
systématiquement acceptées et on remarque que la politique
scolaire républicaine, souvent taxée d'ultra-centralisatrice,
peut par certains aspects s'adapter aux situations locales comme dans le cas
des classes mixtes. Dans un second temps, si la mixité scolaire est
justifiée par les contraintes géographiques, elle ne signifie pas
égalité de traitement entre les élèves filles et
les élèves garçons. Il suffit pour s'en convaincre de
regarder les rôles - eux-aussi justifiés par le milieu alpin -
attribués aux instituteurs et institutrices : les secondes sont
jugées trop fragiles pour supporter le climat montagnard et tenir les
classes de hameaux. Il semble assuré que ce qui s'applique aux
enseignants s'applique aussi aux élèves, la mixité est
sûrement plus une cohabitation qu'une coopération : la loi
prévoit une séparation des sexes par une cloison et la
séparation dans les cours de récréation - en
réalité peu applicable142. Dans la
micro-sociabilité hivernale des hameaux, où un grand nombre de
frères, soeurs ou cousins fréquentent la même classe, il
est évident qu'une séparation stricte relève de
l'impossible. Ce qui nous pousse à dire qu'encore une fois, les
expériences scolaires des populations alpines diffèrent de celles
du reste du pays.
En Valais, la mixité est plus difficilement voire pas
du tout acceptée - surtout au début de notre période. Un
article favorable à l'école mixte paru dans L'école
Primaire en 1881 fait part des vifs débats autour de cette
question. L'auteur remarque que pourtant, dans toutes les écoles
140 ADHS, 1 T 87, Délibération du conseil municipal
de la commune de Saint-Gervais, 8 Mars 1908.
141 Ibidem, Commune de Vallorcine, 19 Janvier 1908.
142 Odile ROYNETTE, « La mixité... », op.
cit.
50
rurales du canton limitrophe de Genève la mixité
est de mise et qu'elle répond à des contraintes locales autant
qu'elle développe des vertus dans l'émulation des
élèves143 . Dans le numéro suivant, le journal
publie l'avis d'un lecteur qui s'applique à en réfuter tous les
points. Dans tous les arguments déployés, les obstacles à
la mixité scolaire sont de l'ordre de la morale chrétienne. Il
semble impensable que les deux sexes puissent fréquenter les mêmes
bancs pour le pouvoir valaisan - à gouvernement catholique conservateur
durant toute la période et dont l'église a encore une forte
influence sur l'instruction publique.
Pourtant, il existe des différences entre les
prérogatives nationales et l'application concrète dans les
milieux locaux. La mixité n'est pas une norme mais bien une
nécessité ponctuelle, communes aux lieux isolés -
rappelons qu'en France, la situation est similaire : il n'est pas question de
généraliser l'enseignement mixte144 . Les rapports du
département de l'instruction publique rapportent qu'en 1881, toutes les
écoles de montagne de Martigny-Combe sont mixtes145. Pourtant
dans les faits, si les deux sexes fréquentent bien la même
école, ils ne la fréquentent pas toujours en même temps !
Le chanoine de Cocatrix note que jusqu'à l'instauration des soupes
scolaires en 1904, les élèves des écoles de hameaux
n'avaient souvent pendant l'hiver « qu'une seule classe par jour, les
garçons le matin et les filles l'après-midi »146 du
fait des difficultés de déplacements et de la distance des
habitations vis-à-vis de l'école. Si l'on ajoute ce
paramètre à la durée annuelle des écoles de
montagne, on conclut que les heures de classe effectives des enfants valaisans
sont très faibles et que la mixité, à l'inverse du cas
français est parcellaire. Autre différence, ces écoles
peuvent aussi bien être tenues par des instituteurs que des institutrices
au niveau de la loi, mais c'est pourtant systématiquement des
institutrices qui y enseignent. Les conditions de vie difficiles liées
au climat et à l'altitude ne sont jamais évoquées pour
justifier la présence d'un instituteur plutôt que son homologue
féminin contrairement aux écoles haut-savoyardes, situées
à quelques kilomètres seulement.
On voit donc que les écoles mixtes, si elles
constituent une nécessité pratique en milieu alpin ne sont pas
instituées de la même manière, ni justifiées par les
mêmes arguments rhétoriques qui se basent pourtant sur les
contraintes géographiques: preuve que les représentations que
l'on se fait du milieu d'une part et du genre d'autre part et enfin de la
143 C.W, « Les écoles mixtes »,
L'école Primaire, n°4, Avril 1881, p. 33-34, p. 34.
144 Ces questions ont d'ailleurs connu de vifs débats
en 1905, voir Frédéric MOLE, « 1905 : la «
coéducation des sexes » en débats », Clio. Histoire
femmes et sociétés, n° 18, 2003, [En ligne]
http://
journals.openedition.org/clio/610 ; DOI : 10.4000/clio.610.
145 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'Instruction
Publique, 1881.
146 AEV, 1 DIP 102bis, Cahier sur les examens de recrue par le
chanoine Cocatrix, 1906, p. 15.
51
frontière, ne sont pas totalement superposables,
même si toujours utilisées pour légitimer des pratique
scolaires différenciées des autres milieux : La frontière
politique constitue ici un facteur important dans la perception des Alpes.
La mixité scolaire, même incomplète,
crée des expériences scolaires spécifiques qui creusent
une brèche dans la distinction des sexes en vigueur dans les deux
nations. Néanmoins, les élèves filles et garçons
continuent théoriquement d'être séparés aux moments
des enseignements de couture et de certains exercices de gymnastique - si tant
est que ces enseignements peuvent bien avoir lieu.
C] La gymnastique, une oubliée de l'école
montagnarde ?
La gymnastique scolaire revêt une importance croissante
dans les programmes scolaires des deux pays, d'ailleurs souvent liée
à la préparation des enfants-citoyens pour leur future
conscription147, se parant d'un caractère moral
d'apprentissage de l'obéissance, de l'ordre et du patriotisme. En
France, la loi du 27 janvier 1880 rend cet enseignement obligatoire,
complétée par la loi de 1890 qui prévoit au moins deux
heures d'éducation physique journalières pour les enfants de
moins de 10 ans et au moins trois-quarts d'heure pour les autres. En Suisse,
c'est avec la loi fédérale du 16 Avril 1883 que la gymnastique
devient obligatoire148. Toutefois, il est difficile de savoir si ces
exercices étaient réellement pratiqués dans ces deux
territoires, quelques indices laissent à penser que leur application est
limitée.
Nous avons déjà évoqué la modestie
des bâtiments scolaires des hameaux de montagne et ils le sont autant par
leur architecture que dans leur dotation en matériel. En 1906, le
ministère de l'instruction publique informe le préfet de
Haute-Savoie qu'une concession de matériel a été faite
à l'école de Montquart afin de pourvoir au matériel de
gymnastique prévu dans la loi de 1891 - une paire d'échelles
jumelles, une paire de cordes lisses, une corde lisse à lutter de dix
mètres - mais depuis 15 ans, ces équipements manquaient, rendant
impossible la pratique de la gymnastique avec agrès149 . Plus
généralement, les demandes de matériel scolaire - qui
ne
147 Jean-François CHANET, « La férule et le
galon. Réflexion sur l'autorité du premier degré en France
de 1830 à la guerre de 1914-1918 », Le Mouvement Social,
n° 224, 2008, p. 105-122.
148 Contrairement à ce qui a été
récemment écrit par Véronique CZAKA, Histoire sociale
et genrée de l'éducation physique en suisse romande (milieu
XIXe-début du XXe siècle),
Neufchâtel, PUS, 2021, p. 31-32.
149 ADHS, 2 O 2175, Lettre du ministre de l'Instruction publique
au préfet de la Haute-Savoie, 10 Février 1906.
52
relèvent pas seulement de la gymnastique - sont
très nombreuses chaque année, et le préfet fait part de
l'impossibilité de fournir toutes les écoles150. Les
écoles de hameaux, aux marges du département, les plus
inaccessibles et celles qui regroupent le moins d'élèves sont
aussi les moins bien servies. Certes, l'absence ou le manque de matériel
scolaire n'empêche pas les exercices physiques sans agrès, eux
aussi aux programmes, mais limitent une dimension de la pratique sportive.
Est-ce que d'ailleurs la gymnastique sans agrès peut être
pratiquée dans ces lieux de montagne ? En tout cas, le canton du Valais
l'encourage activement à partir de 1916 en proposant des cours aux
instituteurs dont l'école ne dispose « ni appareils, ni salle
», recommandant divers sports comme les « marches, courses,
préliminaires, sauts, levers, lancers »151. Nous ne
pouvons-nous empêcher de remarquer que ces activités sont des
activités d'été, impraticables pendant 6 mois de
l'année en montagne. En effet, le manque de cours empierrées ou
de préau, interdit la pratique de la gymnastique en intérieur
comme en extérieur pendant la saison hivernale. Reste la salle de classe
? L'exiguïté des lieux, composés d'une seule salle de
dimension restreinte ne paraît pas propice à la pratique sportive,
mais il est possible, au moins dans le cas français, que cette solution
ait été privilégiée car les rapports - très
consciencieux - des inspecteurs scolaires n'auraient pas manqué
d'inscrire les manquements aux programmes, or, il n'en est rien. À
l'inverse, il est attesté que dans la plupart des écoles de
hameaux valaisannes, la gymnastique pourtant obligatoire n'est pas
pratiquée. Pour exemple, dans les rapports d'inspections, à la
rubrique « gymnastique » un sobre « oui » est
systématiquement apposé à la question « n'y en a-t-il
pas du tout ? »152.
Même si la pratique de la gymnastique est moins
répandue dans le canton du Valais que dans la Haute-Savoie voisine, les
écoles de hameaux, ne sont pas outillées - ni par le
matériel, ni par le climat - pour appliquer à la lettre les
prescriptions nationales.
D] De vieux élèves
Le nombre d'années de scolarisation des écoles
françaises et suisses est à peu près équivalent :
de 6 à 13 ans pour l'une et de 7 à 13 ans pour l'autre -
scolarité sanctionnée par le brevet d'études primaires et
l'examen d'émancipation. Cet âge révolu, les
élèves peuvent
150 ADHS, 1 T 180, « Achats et concessions de livres, cartes
et matériel scolaire, subventions. 1870-1890 ».
151 « La gymnastique sans engins », L'école
primaire, n°10, Décembre 1917, p. 66-68, p. 67.
152 AEV, 1 DIP 30-98, « Rapport des inspecteurs scolaires
(1854-1906) ».
53
poursuivre leurs études dans les écoles
primaires supérieures - dans de rares cas dans le secondaire - et les
écoles professionnelles, ou bien directement entrer dans le monde du
travail ; Système équivalent en Suisse et dans le Valais, bien
que le canton souffre d'un manque de collèges et de cours
professionnels. La poursuite d'étude est conditionnée aux
possibilités qu'offre le lieu, les villes sont évidemment mieux
pourvues en établissement primaires, secondaires et professionnels que
les plaines qui sont souvent elles même mieux pourvues que les lieux
isolés comme les communes de montagne. Si l'on rétrécit
encore la focale, on peut dire une fois encore, que les hameaux de montagne
sont moins bien pourvus que les bourgs/centre, car plus isolés, surtout
pendant l'hiver. Chamonix compte deux cours supérieurs dans les
écoles du bourg, permettant aux enfants de poursuivre leurs
études au-delà de la seule école primaire,
malheureusement, les enfants des hameaux doivent parcourir plusieurs
kilomètres pour atteindre le bourg. Ces trajets deviennent impossibles
à effectuer pendant la saison hivernale où l'épais manteau
neigeux couvre tous les chemins et les nombreuses avalanches font redouter le
pire aux habitants. Les populations, forcées au cloisonnement l'hiver,
souffrent du manque d'activités, tant économiques que
sociales.
Dans ce contexte, l'école offre un foyer accueillant
pour les enfants. Véritable lieu de vie du hameau, les enfants se
pressent sur les pupitres pour assister à l'enseignement du maître
ou de la maîtresse. Bien souvent - et contrairement à la loi en
vigueur - des enfants parfois trop jeunes, souvent trop vieux, intègrent
momentanément le lieu scolaire pour pallier l'inactivité
saisonnière. La situation n'est pas ici spécifique aux
écoles de montagne. Roger Thabault faisait déjà la
distinction entre les bourgs et les hameaux dans une commune de campagne -
Mazières-en-Gatines - expliquant d'une part que les enfants des hameaux
étaient rares à dépasser le certificat
primaire153, et d'autre part que ceux assistant aux classes avaient
déjà bien souvent dépassé l'âge
scolaire154. L'auteur explique ce fait en avançant que le
développement des bourgs à la Belle Époque - avec
le développement du chemin de fer notamment - a creusé un
écart sensible entre les centres de village et leurs
périphéries, en renforçant une forme de
ségrégation spatiale. Nous partageons le point de vue de
Thabault, mais nous ajoutons que dans le cas des communes de montagne, la
spécialisation des bourgs au détriment des hameaux est
renforcée par les éléments propres au milieu qui viennent
accentuer les frontières physiques - et non pas
153 Roger THABAULT, L'ascension d'un peuple. Mon
village. Ses hommes, ses routes, son école, Paris, Presses de
Science Po, 1982 [1938], p. 207.
154 Ibidem, p. 210.
54
que sociales et culturelles - surtout pendant la
période hivernale, accentuant le phénomène des
élèves « hors d'âge » à l'école.
158.
D'ailleurs, les formes de justifications des acteurs
lorsqu'ils adressent leur demande de dérogations à l'inspecteur
d'académie, se rapportent toujours aux conditions climatiques du milieu.
En 1881, une lettre collective de parents de 4 enfants - âgés de
14 à 17 ans - du hameau du Pratz (Chamonix) demandent « en
raison de la distance du chef-lieu, des mauvais chemins qui, très
souvent, vu la quantité de neige sont impraticables pendant la mauvaise
saison » l'autorisation pour leurs enfants de fréquenter
l'école primaire du hameau « quoique ayant
dépassé l'âge réglementaire » 155 . Les
autorités supérieures - inspecteur d'académie - et
intermédiaires - inspecteur primaire - se montrent le plus souvent
compréhensives face à ces demandes, mais la justification par les
contraintes géographiques est nécessaire pour obtenir gain de
cause. Pour exemple, l'instituteur des Grassonnets (Chamonix) adresse une
lettre à l'inspecteur d'académie en 1886 pour témoigner
son désir d'accueillir un élève de 14 ans au sein de sa
classe. Seulement, pour appuyer sa demande, il précise les dimensions de
la salle - 5 mètres sur 4 pour 1,95 mètre de hauteur - et le
nombre d'élèves inscrits dans son école - 14 - choisissant
ainsi une argumentation sur l'espace disponible pour accueillir cet
enfant156 . La requête est refusée par l'inspecteur
d'académie et le père de l'enfant envoie à son tour une
lettre, indiquant « qu'il est impossible et [...] serait
même imprudent, de la part d'un père de famille soucieux de la
santé de ses enfants de les envoyer à l'école
d'Argentières quand pour s'y rendre, il leur faut faire chaque jour deux
kilomètres et demi pour l'aller et pareil pour le retour
»157 ; il poursuit son argumentation en mettant en avant
les difficultés liées au climat hivernal et aux contraintes
géographiques. Ces deux exemples montrent bien d'un côté,
que l'administration scolaire française peut s'adapter aux situations
locales des acteurs à condition que ceux-ci intègrent la
rhétorique de justification adaptée. Ce discours - dont nous ne
mettons pas en cause la véracité - s'intègre à des
stratégies, plus ou moins conscientes de la part des parents
d'élèves s'ils veulent maximiser leurs chances dans l'acceptation
de la dérogation d'âge
155 ADHS, 1 T 418, Lettre des habitants du hameau du Pratz
à l'inspecteur d'académie, 16 Mars 1881.
156 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'instituteur des Grassonnets,
à l'inspecteur d'académie, 21 Novembre 1886.
157 ADHS, 1 T 418, Lettre de Monsieur Ducroz à
l'inspecteur primaire de Bonneville, 5 Décembre 1886.
158 Arlette FARGE fait une analyse similaire sur les discours
rhétoriques stéréotypés que les personnes
appelées à comparaître au commissariat de police mettent en
place au XVIIIe siècle pour s'assurer les meilleures chances
de non-inculpation. Voir La vie fragile : violence, pouvoirs et
solidarités à Paris au XVIIIe, Paris, Hachette,
1986.
Les écoles valaisannes connaissent également la
présence d'enfants hors-âge réglementaire. Dans la plupart
des cas, on en compte deux ou trois par classe, mais parfois leur nombre est
plus important. C'est le cas à l'école du hameau de Jears
(Martigny-Combes) ou, pour un total de 24 élèves (10
garçons et 14 filles), 5 sont dans leurs quatorzième
année, 2 dans leur quinzième et 4 ont plus de 15 ans : presque la
moitié de l'effectif total a dépassé l'âge
scolaire159. Cette particularité s'étend sur toute la
période, et en Valais, nul besoin de la justifier auprès des
autorités. Les arrangements semblent se faire directement entre les
parents d'élèves et les enseignants car ni les inspecteurs, ni
les autorités centrales ne s'en préoccupent. Il n'existe pas non
plus de formulaire de dérogation et le fait semble accepté comme
pratique habituelle dans le canton.
Il n'en reste pas moins que dans ces deux territoires, la
présence de ces « vieux » élèves n'est pas
anodine. Que cela pallie le manque de formation professionnelle ou
d'écoles de niveau supérieur à proximité, nous
l'avons déjà dit. Leur présence répond aussi
à une envie d'instruction et peut-être une manière de
conjurer l'ennuie due au chômage climatique et à la claustration
hivernale. Le système scolaire français, bien que très
normé, accepte les aménagements locaux des écoles alpines,
et cela, même si elle garde un contrôle fort sur toutes les
décisions. Le système scolaire valaisan, plus en retrait du
processus décisionnel, laisse place aux arrangements locaux. Dans les
deux cas, les contraintes liées au milieu et la manière de se les
représenter - au niveau des pouvoirs centraux ou des acteurs locaux -
influent sur les pratiques scolaires des habitants des montagnes. Nous avons
constaté que les représentations et les pratiques, même si
parfois communes, différent sur bien des points. Là est toute la
question de la frontière politique qui désunit ces deux
territoires alpins et joue sur les trajectoires de vie des acteurs.
159 AEV, 1 DIP 58, Rapport d'inspection de l'école du
hameau de Jears (Martigny-Combes), 28 Avril 1891.
55
56
57
DEUXIÈME PARTIE. Jeux de frontières et
trajectoires de vies.
Nous l'aurons compris, l'école alpine est plurielle, le
même environnement géographique n'entraîne pas une
similarité parfaite des expériences scolaires françaises
et suisses. Nous avons montré le rôle important que jouait la
frontière politique qui sépare les deux territoires, autant dans
l'aménagement des lieux scolaires que dans la manière de les
pratiquer, tout en reconnaissant des spécificités d'organisations
liées à l'environnement alpin. Paul Guichonnet et Claude
Raffestin écrivaient très justement que « la
juxtaposition de systèmes différents, le long d'une ligne,
même imaginaire mais que l'on fait respecter avec beaucoup de rigueur,
détermine des décalages qui se lisent dans le paysage
»160 rappelant que « la frontière, loin
d'être un simple phénomène géographique, est un
phénomène social au sens le plus large
»161. À l'inverse de Daniel Nordman qui
confesse ne pas trop aimer les usages pluriels du concept
frontière162, nous prolongeons dans cette partie, la
réflexion sur la frontière alpine prise dans ses dimensions
multiples - culturelles et sociales - sans évidemment en oublier les
dimensions politiques et spatiales ainsi que leurs effets sur les circulations
des personnes et des savoirs entre la Haute-Savoie et le Valais.
Les écoles des Alpes sont physiquement isolées
par rapport au reste des lieux scolaires de leur nation respective, mais elles
sont également isolées de leurs voisins les plus proches
géographiquement : il existe peu de contact entre les deux territoires.
Pourtant, les frontières sont dans le même temps extensibles. Nous
avons évoqué leur repli hivernal à l'heure des
premières chutes de neige, confinant les habitants à une
micro-sociabilité « hors du monde ». Les beaux jours revenus,
elles s'étirent à l'extrême et certains lieux vont attirer
des foules de visiteurs étrangers qui, en modifiant les manières
de vivre de ses habitants, vont également façonner
l'école. Nous verrons d'ailleurs que l'activité touristique
s'accorde très bien avec certains discours portés par les
institutions scolaires de « La Belle Époque ». Les
enseignants participent à produire une image spécifique des
Alpes, mais la place accordée à l'environnement local n'est pas
la même dans les discours et dans les enseignements français et
suisses,
160 Paul GUICHONNET, Claude RAFFESTIN, Géographie des
frontières, Paris, PUF, 1974, p. 7.
161 Ibidem, p. 221.
162 Daniel NORDMAN affirmait sa volonté de s'en tenir
aux frontières politiques, et sa réticente sur le flou
instauré par l'usage plurielle de la notion, voir Frontières
de France. De l'espace au territoires, XVIe-XIXe
siècle, Paris, Gallimard, 1998, p. 9-19.
58
entraînant un processus de
valorisation/dévaluation des Alpes et de ses habitants qui varie selon
les contextes. En dernier lieu, ni la position géographique, ni
l'activité touristique ne sont sans conséquences sur les
trajectoires de vie des acteurs historiques. Maîtres et maîtresses,
élèves et parents, expérimentent l'école en milieu
de montagne, véhiculant pratiques et représentations,
conditionnant les possibilités d'avenir. Le fait de grandir et
d'être socialisé dans certaines nations, dans certains milieux et
dans certains lieux crée des expériences singulières,
façonnent des identités particulières, souvent vectrices
« d'inégalités spatiales
»163.
163 Voir Isabelle BACKOUCHE, Fabrice RIPOLL, Sylvie TISSOT et
Vincent VESCHAMBRE (dir), Dimension spatiale des
inégalités, Presses universitaires de Rennes, 2011.
59
CHAPITRE 4. Pour vivre heureux, vivons cachés
A] Haute-Savoie, Valais : contigus et pourtant
fermés
Un premier constat s'impose : dans les deux territoires de
notre étude, les politiques scolaires sont strictement
délimitées par la frontière politique. D'ailleurs,
au-delà du seul domaine de l'éducation, peu de routes relient la
Haute-Savoie et le Valais. La plus praticable est celle qui longe le lac
Léman, traversant le village binational de Saint-Gingolph, là
où l'altitude est la plus réduite (389 mètres) et les
obstacles moins rebutants. Toutefois, dans les communes de montagne qui nous
intéressent, rien de tel. Une route-frontière existe et relie la
vallée de Chamonix à la vallée du Rhône en passant
par le col de la Forclaz. Pourtant, si ce passage est connu depuis longtemps,
il ne devient carrossable qu'en 1875, reliant ainsi les communes de Vallorcine
à Martigny - la route désenclavant la vallée de Chamonix
du reste du département avait elle-même été
construite en 1870. Auparavant, seuls les chemins muletiers permettaient les
circulations entre les parties montagneuses des territoires : indice du faible
intérêt commercial et début d'explication de la
quasi-absence d'échange de populations. Quelles sont les raisons de
cette opacité des frontières ? On pourrait être
tenté de la justifier par les reliefs qui enserrent ces territoires dans
d'étroites vallées, où les communications se font par des
chemins sinueux, bordés de ravins profonds, parfois dangereux et surtout
impraticables en hiver. Toutefois, en plus de présenter un tableau trop
naturaliste de la réalité, cette hypothèse a
été mise en cause par les travaux de Peter Sahlins, montrant que
les espaces frontaliers des Pyrénées entre la France et l'Espagne
ne produisaient pas de rupture des échanges entre populations ;
celles-ci faisant parfois fi des frontières étatiques, pouvant
les transgresser à l'occasion de la montée en alpage des
troupeaux164 . Si l'hypothèse de la disjonction par
l'environnement peut être écartée - ou du moins
atténuée - il faut alors privilégier celle de l'absence
d'intérêts commerciaux, ces territoires étant
intégrés dans des espaces économiques très
différents. Autre facteur, la stabilité des frontières,
quasiment fixes depuis plusieurs siècles entre le Valais et le
Duché de Savoie, devenu plus tard les départements
français de la Savoie et de la Haute-Savoie. La frontière semble
étanche et de toute évidence, les frontières
164 Peter SAHLINS, Frontières et identités
nationales. La France et l'Espagne dans les Pyrénées depuis le
XVIIe siècle, Paris, 1996 [1989].
60
pédagogiques ne font pas exception. La proximité
géographique des écoles de montagne françaises et
valaisannes n'entraîne pas d'inter-relations particulières.
Car, en effet, dans les listes scolaires que nous avons pu
consulter, il n'est apparu nulle part en Valais que des élèves
français fréquentaient les écoles du canton suisse. En
Haute-Savoie, il est parfois fait mention « d'élèves
étrangers » sans pour autant spécifier leur
nationalité. Il semble plus probable que ces élèves soient
italiens en raison des fortes migrations en provenance de ce pays dans les
Alpes françaises et suisses, ainsi que de la construction en cours d'un
tunnel dans la commune de Chamonix- employant largement parmi la population
ouvrière italienne. Les archives ne mentionnent qu'une unique fois la
présence d'un élève originaire du Valais, « le
jeune Sylvain Gay né à Trient (Suisse) » accusé
de « manoeuvres impudiques sur sa personne (mast... » 165
pendant le cours d'histoire ainsi que d'avoir « lancé un jet
d'urine sur un condisciple par-dessus la table »166 . Mais
au-delà des transgressions sexuelles du jeune Sylvain Gay - qui lui
vaudra 8 jours d'exclusion - l'archive ne donne aucune information sur le fait
qu'il soit de nationalité suisse. Peut-être est-il simplement
né là-bas en raison de la proximité - environ 25
kilomètres par la route - des deux communes. Toujours est-il que les
frontières pédagogiques, en termes d'échange de
populations scolaires, sont complètement étanches. Cela ne semble
d'ailleurs pas étonnant car l'école réifie les
frontières des États. Damiano Matasci écrivait
récemment qu' « au XIXe siècle,
l'école devient un moyen de « fixer » la nation : elle
contribue à sa matérialité, à son invention, voire
à sa pérennité. Elle constitue le berceau de la
citoyenneté politique propre à chaque pays, ce qui accentue le
caractère prétendument unique de chaque cas national
»167. L'école est une oeuvre nationale, elle
affiche ses fins civiques par l'apprentissage théorique du corps
physique de la nation. Elle est le moyen par lequel les frontières
s'inscrivent dans la chair et l'esprit des élèves-citoyens en
légitimant la délimitation de l'espace national.
Pourtant, la frontière peut être traversée
et elle l'est parfois. En 1904, c'est bien l'hôtel de l'Europe, à
Chamonix, que choisissent les chefs de l'instruction publique romande pour leur
réunion annuelle. Certes, l'accès n'y est pas rendu facile : le
départ est fixé à 9 heures du matin de Vernayaz (proche de
Martigny) et l'arrivée prévue seulement pour le
souper168, et ce, malgré
165 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'instituteur Perrin à
l'inspecteur d'académie, 22 décembre 1902.
166 Ibidem.
167 Damiano MATASCI, L'école républicaine et
l'étranger, Paris, ENS, 2015, p.8.
168 AEV, 2 DIP 21 n° 6, Lettre du chef du département
de l'instruction publique du canton du Valais au chef de l'instruction publique
du canton de Vaud, 22 Aott 1904.
61
le fait que la route soit devenue carrossable. Si les affaires
concernant l'instruction publique des cantons romands sont à l'ordre du
jour, il n'est pas question d'effectuer, à Chamonix, des visites des
écoles du bourg, ni même de convier leurs homologues
français : les affaires pédagogiques sont des questions
nationales. Pourtant, quelques années plus tôt, en 1886, est
née l'idée lors d'une conférence similaire de «
mettre à l'ordre du jour une convention internationale à passer
avec la France, en vue d'assurer la fréquentation des écoles aux
frontières des deux pays »169. Quelles
étaient les modalités de la mise en place d'une telle mesure ?
Comment assurer la fréquentation des écoles alpines
françaises et suisses ? Nous ne le saurons jamais car l'intervention de
Monsieur Gobat ne revêt pas plus de détails. Il affirme seulement
avoir pris l'initiative d'envoyer une lettre auprès du ministre de
l'Instruction publique français, René Goblet. Celui-ci a
balayé la proposition en répondant que la fréquentation
des écoles relevait d'une loi de police et non d'une loi de
l'instruction en France et qu'en définitive, cela ne relevait pas de son
autorité170. Le projet est vite avorté, mais en 1912,
une autre conférence met à l'ordre du jour une proposition
d'échanges de maîtresses et de candidats à l'enseignement
entre la Suisse romande et la Prusse « et d'autres États, entre
autres la France »171. Le 18 juin 1914, ce projet
d'échange est relancé mais, mis à part le canton de
Genève, les autres États de Suisse Romande se montrent frileux,
concédant « qu'il serait plus facile d'envoyer des
institutrices à l'étranger que de les recevoir
»172. Le déclenchement de la guerre quelques
semaines plus tard enterrera définitivement ces velléités
internationales.
Malgré leur juxtaposition le long des crêtes
alpines, la Haute-Savoie et le Valais sont donc hermétiques l'un
à l'autre. Les échanges pédagogiques, mis-à-part
quelques brèves tentatives, ne parviennent pas à franchir les
Alpes. Nous verrons plus bas que si échanges il y a, ils s'effectuent
« par le haut » par le biais d'emprunts ou de réappropriations
des lois et pratiques scolaires entre États voisins, mais rarement
« par le bas » à l'échelle des écoles de
communes - du moins par le Valais. Nous l'avons évoqué,
l'opacité des deux territoires s'explique en partie par
l'intégration des territoires dans des tissus d'échanges
économiques et culturels bien
169 AEV, 2 DIP 21 n°1, Intervention de Monsieur Gobat, chef
du département de l'instruction publique de Berne lors de la
conférence intercantonale romande, 28 Janvier 1886.
170 Ibidem.
171 AEV, 2 DIP 21 n° 54, Conférence intercantonale
romande, 31 Mai 1912.
172 AEV, 2 DIP 21 n° 59, Conférence intercantonale
romande, 18 Juin 1914.
62
distincts. La Haute-Savoie ne regarde pas par-dessus les
montagnes qui occultent sa vue, son attention est tout entière
tournée vers son autre voisin suisse : Genève.
B] Genève, frontière poreuse
Les échanges culturels et commerciaux du
département ne se font donc pas avec le Valais, mais avec le canton de
Genève, dont la capitale du même nom forme un centre urbain et
économique qui transgresse les frontières territoriales. Depuis
le rattachement de la Savoie à la France en 1860, il existe une zone
franche qui comprend le canton de Genève, une partie du pays de Gex et
les trois-quarts nord de la Haute-Savoie. Justinien Raymond n'hésite pas
à qualifier Genève de vraie « métropole du
département »173 au détriment d'Annecy, et
pour cause, le canton investit énormément sur le territoire,
permettant ainsi le développement de l'industrie
horlogère174 - principale activité industrielle avant
le développement du décolletage et de la houille blanche. En plus
du secteur horloger, Genève est le principal attributaire de
crédits pour les paysans ou les petits industriels à la fin du
XIXe siècle, remplacé par les caisses de crédit
agricole seulement au début du XXe
siècle175. L'interdépendance est grande entre les deux
territoires, la Haute-Savoie, en contrepartie des investissements genevois,
fournit la métropole en bois, en céréales, en lait et en
bétail, car le canton, petite enclave au milieu du territoire
français, ne dispose pas de surfaces agricoles suffisantes pour
répondre aux besoins de la population176. Le commerce de la
Haute-Savoie avec le reste de la France est quasiment nul177,
l'absence de douane favorise les échanges dans la zone franche, et
certaines denrées - sucre, café, miel, pétrole, tabac -
sont 15 à 20 % moins chers que dans le reste du territoire. En 1909, le
département de la Haute-Savoie importait pour 23,4 millions de francs et
en exportait pour 25,4 millions178. Pour illustrer l'importance des
liens commerciaux, François Condevaux,
173 Justinien RAYMOND, La Haute-Savoie sous la
IIIe République : histoire économique, sociale et
politique (18751940), Lille, Atelier National de Reproduction des
Thèses, vol. I, 1983, p. 45-46.
174 Une école d'horlogerie est fondée en 1848
dans la ville de Cluses et Antoine PROST la place sur le même plan que
les Écoles Nationales Professionnelles (ENP), voir Histoire de
l'enseignement... op.cit, p. 310.
175 Ibidem, p. 240.
176 Paul GUICHONNET, Claude RAFFESTIN, Géographie des
frontières, op.cit, p. 183.
177 Ibidem.
178 Sébastien CHATILLON, « Le régime des
zones franches franco-suisses en 1914 : objet de tensions diplomatiques »
dans Frédéric TURPIN (dir), Les Pays de Savoie entrent en
Grande Guerre, Chambéry, Université Savoie Mont Blanc, 2014,
p. 65-78, p. 76.
63
instituteur ayant exercé de 1893 à 1923 dans la
commune frontalière de Saint-Cergues, raconte qu'à sa fonction
d'enseignant, s'ajoutait « un imposant secrétariat de mairie
», car les transactions douanières s'effectuaient à la
mairie179. La diaspora haut-savoyarde est nombreuse à
Genève et même ceux qui n'y résident pas peuvent s'y
employer, principalement dans les métiers du bâtiment, toujours
à la recherche de bras solides et nombreux. Autre instituteur
haut-savoyard, Léon Gavard, né en 1884 à Viuz-en-Sallaz,
précise que son grand-père, maçon, allait travailler
à Genève à la belle saison, parcourant chaque lundi 20
kilomètres à pied, pour ne revenir que le samedi soir par le
même moyen180.
En plus de l'attractivité économique et
commerciale de Genève s'ajoute une attractivité culturelle qui
inclut les mondes scolaires. Damiano Matasci écrit que les missions
pédagogiques - avec pour objectif d'étudier les systèmes
scolaires étrangers - qui prennent leur plein essor en France avec la
IIIe République, ont bien souvent pour destination la Suisse
- troisième place - et principalement le canton de
Genève181. La Suisse, et surtout les cantons romands
protestants, jouissent alors d'un grand prestige, souvent
considérés comme le pays le plus alphabétisé
d'Europe182. Lorsqu'il faut choisir en 1886 ou en 1908 une
destination pour les voyages d'étude des
élèves-maîtres de l'école normale de Bonneville,
c'est encore Genève qui est la destination
privilégiée183.
Entre la Haute-Savoie et le canton de Genève, la
frontière s'efface, l'espace de la région du Léman est
pensé comme une continuité par les acteurs historiques. Le
régime zonien crée un espace particulier, complètement
intégré à la métropole genevoise, le franc suisse
circule en Haute-Savoie, les liens économiques sont étroits,
l'abondance et le bas coût de certains produits précieux et les
faibles échanges avec le reste du territoire français produisent
des expériences quotidiennes singulières pour les habitants du
département. Paul Guichonnet en vient même à dire que la
frontière entre Genève et la région environnante
n'était que symbolique avant 1914184. En reprenant les termes
de Ratzel, c'est une « frontière épaisse » qui
ne délimite pas
179 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 6, François Condevaux.
180 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 13, Léon Gavard.
181 Damiano MATASCI, L'école républicaine...
op.cit, p.45.
182 Ibidem, p. 48.
183 ADHS, 1 T 1235, Conseil d'administration de l'école
normale de Bonneville, rapport sur la situation matérielle et morale, 4
Juillet 1889 et ADHS, 1 T 1236, Conseil d'administration de l'école
normale de Bonneville, rapport sur la situation matérielle et morale, 20
Juin 1908.
184 Paul GUICHONNET, Claude RAFFESTIN, Géographie des
frontières, op.cit, p. 184.
64
strictement deux territoires mais crée une
région culturelle frontalière185 . À l'inverse,
la frontière qui délimite la Haute-Savoie et le Valais fait plus
figure de ligne stricte, où les échanges sont, sinon inexistants,
très limités. Il faut tout de même se garder d'insinuer que
Hauts-Savoyards et Genevois partagent une identité commune. Dans un
contexte d'affirmation des identités nationales - porté par
l'école - les deux populations se savent appartenir à des nations
différentes et aucune revendication n'existe pour donner une consistance
identitaire à la région genevoise élargie. Bernard
Debarbieux, étudiant le concept de territorialité dans cette
région - mais dans sa contemporanéité - écrit
d'ailleurs que « les répondants signalent toujours, à
type de lieu équivalent, une plus grande familiarité avec les
lieux situés du côté de leur frontière
»186.
Peut-être semblons-nous loin de notre sujet de
recherche. Toutefois, mettre en lumière ces liens étroits entre
le département de la Haute-Savoie et le canton de Genève permet
d'expliquer la faiblesse des échanges avec le Valais. Avec ce pas de
côté, nous avons pu voir l'opacité réelle mais aussi
l'opacité culturelle entre les deux territoires : le canton est absent
des représentations que les hauts-savoyards se font de la Suisse, il
fait figure de « voisin oublié ». L'inverse est
également vrai et cette ignorance mutuelle impacte les frontières
scolaires. Les visites, les voyages, les emprunts pédagogiques se font
principalement avec le canton de Genève et non avec celui du Valais. Ce
dernier, unanimement jugé « en retard » dans le mouvement
d'amélioration scolaire européen, n'est jamais
évoqué comme modèle de référence. Cette
explication nous permet aussi d'écarter sûrement l'explication de
la fragilité des échanges par la géographie. Certes, les
difficultés liées au déplacement de montagne doivent jouer
un rôle, l'horizon vers Genève étant d'ailleurs largement
moins semé d'embûches. Pourtant, c'est bien à Genève
- à un peu plus de 80 kilomètres par la route - que la commune de
Chamonix décide, en 1912, de s'approvisionner en anthracite pour
chauffer ses écoles, et non en Valais, pourtant bien pourvu sous ce
point, et dont la ville de Martigny ne se situe qu'à une quarantaine de
kilomètres187. C'est aussi avec Genève que le canton
de Chamonix a souhaité son rattachement lors du référendum
de 1860. Nous voyons ainsi que l'hyper-proximité géographique
n'est pas toujours vectrice d'identité spatiale partagée.
185 Voir Federico FERRETTI, « À l'origine de
l'idée de » frontières mobiles » : limites politiques
et migrations dans les géographies de Friedrich Ratzel et
d'Élisée Reclus », BRIT 2011 - Les frontières
mobiles, Septembre 2011, France [en ligne] ffhal-00981037.
186 Bernard DEBARBIEUX, « Identités,
frontières... », op.cit, p. 137.
187 ADHS, 1 T 418, Délibération du Conseil
Municipal de Chamonix, 1912.
65
Le canton du Valais est lui-même dans une position
ambiguë au sein de la Confédération : canton catholique et
bilingue pourtant compté parmi la Suisse Romande, souvent
qualifié « d'en retard » dans la marche pour le progrès
- surtout en termes d'éducation - comme isolé sur le plan
politique et hostile à la coopération. Il faut toutefois nuancer
: sur la période qui nous intéresse, le Valais met en place de
vrais efforts sur le plan éducatif mais aussi dans sa politique de
collaboration intercantonale.
C] Le Valais, aux prises entre isolement et
collaboration
Le régime de Torrenté, à la tête du
Valais de 1870 à 1905 est un gouvernement conservateur, issu de
l'aristocratie catholique, dont la politique est qualifiée de «
fédéralisme violent, exacerbé par la politique radicale
centralisatrice Suisse » 188 . Le canton est économiquement
plus fragile que le reste de la Suisse : l'agriculture prime sur le
développement de l'industrie, les subventions publiques sont de plus en
plus faibles189, le chemin de fer ne prend son essor que dans les
débuts du XXe siècle. En bref, le Valais fait figure
de canton isolé parmi la Suisse, l'émigration y est d'ailleurs
moins importante que dans le reste du pays190. À partir de
1905, le nouveau gouvernement, toujours conservateur, n'est plus
représenté par l'aristocratie. L'État s'engage dans des
politiques plus interventionnistes, ce dont témoignent la loi scolaire
de 1907 ou le timide développement de l'industrie et du tourisme
à partir de 1910. Pourtant le canton freine toujours l'implantation
d'usines sur son territoire, craignant que le développement d'une classe
ouvrière importe les idées socialistes sur son sol191.
Afin de pallier ce risque, se développent plusieurs associations
social-chrétiennes comme « l'Union ouvrière des travailleurs
catholiques du Valais » en 1905 ou la « Fédération
ouvrière valaisanne » en 1909192. Cette
hésitation entre un ordre social traditionnel à préserver
et la volonté de s'intégrer
188 Elisabeth ROUX, « Le régime de Torrenté
», dans Jean-Henri PAPILLOUD, Gérald ARLETTAZ, Michel REY,
Elisabeth ROUX, Patrice FRASS, Georges ANDREY (dir), Histoire de la
démocratie en Valais (1798-1914), Sion, Groupe Valaisan de Sciences
Humaines, 1979, p. 217.
189 Ibidem, p. 223.
190 Gérald et Silvia ARLETTAZ, « Les
étrangers et la nationalisation du Valais, 1845-1945 », dans
Gérald ARLETTAZ, Jean-Henry PAPILLOUD, Myriam EVEQUOZ-DAYEN, Maria-Pia
TSCHOPP, (dir), Le Valais et les étrangers,
XIXe-XXe siècles, Sion, Groupe Valaisan de
Sciences Humaines, 1992, p. 63-122, p. 68.
191 Elisabeth ROUX, « L'évolution politique au
tournant du siècle », dans Jean-Henri PAPILLOUD, Gérald
ARLETTAZ, Michel REY, Elisabeth ROUX, Patrice FRASS, Georges ANDREY (dir),
Histoire de la démocratie en Valais (17981914), op.cit, p.
229-240, p. 236.
192 Ibidem.
66
au développement économique de la Suisse se
ressent particulièrement à l'aune de la Première Guerre
mondiale. En 1915, L'École Primaire reproduit un article de la
Gazette du Valais qui témoigne bien de la manière dont
le canton se représente sa situation au sein de la
Confédération. Il y est question du « calme [...]
si bon, si doux, si agréable nous ne réalisons pas de grandes
fortunes. Mais nous vivons tranquilles, contents de notre sort »
avant d'enchaîner « si nous ne pouvons rester simple, si
nous voulons augmenter tous les jours notre bien-être, il faut bien se
résoudre à imiter ceux qu'on envie » 193. Le
plus lu des quotidiens valaisans constate : « notre canton ne peut
rester toujours isolé. Il y des courants auxquels on ne résiste
pas » pour finalement trouver une position intermédiaire :
« Il nous sera possible de le faire sans saccager les charmes de la
patrie, en sauvant le point de vue esthétique, le point de vue national,
le point de vue moral, le point de vue religieux, nos traditions et nos
goûts »194. Le canton se sait isolé, il en
tire une forme de fierté nationale, dont l'ouverture aux affres du monde
moderne pourrait bouleverser les fondements. En effet, parmi les cantons
romands centralisateurs, représentant « la Suisse protestante,
industrielle et urbaine »195, le Valais fait figure
d'étrangeté. Comme évoqué plus haut, le canton,
à majorité francophone, est tout de même bilingue, il n'est
ni protestant, ni industriel, mais catholique à dominante agricole.
Toutefois, les nécessités du temps présent poussent le
Valais à ouvrir lentement ses frontières aux investissements
étrangers - mouvement qui cohabite avec une peur de la contamination du
canton par « l'extérieur ».
Dans le domaine de l'éducation, le même
schéma se déploie. D'une position particulièrement hostile
à la coopération au sein de la Confédération,
à la nécessité de s'aligner sur les autres cantons, le
système éducatif valaisan ouvre petit à petit au reste de
la Suisse, ses frontières jalousement gardées. Les raisons qui
motivent ce processus sont d'abord extérieures au canton. En effet,
dès 1875, la Confédération publie un classement par canton
des résultats obtenus aux examens de recrues. Pensé comme un
moyen d'émulsion, ce tableau est un bon indicateur pour mesurer les
efforts placés dans l'instruction publique dans chaque
État196. Le Valais finit systématiquement dernier dans
les premières années de sa mise en place. Améliorer son
classement semble une question d'honneur national et le canton s'enorgueillit
de sa place
193 « Nécessité », extrait de la «
Gazette du Valais », L'école primaire, n° 10, 15
Décembre 1915, p. 3-5 (frontispice).
194 Ibidem.
195 Rita HOFSTETTER, « La suisse et l'enseignement...
», op.cit, p. 67.
196 Ibidem, p. 70.
67
de 22e sur 25e en 1880, tout en
concédant que des efforts restent à faire197. Les
autorités scolaires vont mettre un point d'honneur à publier
chaque année des résultats de plus en plus probants : en 1912, le
Valais arrive 17e au classement et en moyenne 14e sur les
5 dernières années (19071912)198. Une autre initiative
de la Confédération consiste en la mise en place de subventions
allouées aux cantons à partir de 1901. Le Valais, d'abord
réticent - car soupçonneux des motifs centralisateurs de la
mesure - accepte finalement ces subventions, qui servent, comme nous l'avons
vu, à améliorer le bâti scolaire, ainsi que la formation
des instituteurs - la durée des écoles normales passe de 2
à 3 ans199. Les initiatives de la Confédération
permettent au niveau fédéral, l'amélioration de
l'instruction populaire sans toutefois entraver totalement l'autonomie dont
disposent les cantons. Danièle Périsset-Bagnoud, une des seules
chercheuses à avoir produit un travail universitaire sur
l'éducation valaisanne, en brosse un portrait peut-être trop
sévère, en concluant que sur la période, le Valais est
resté largement hostile à toute collaboration200 .
À l'inverse, nos propres recherches archivistiques montrent que le
canton ouvre ses frontières, et particulièrement à la
Suisse Romande.
Le canton accuse un « retard » sur ses voisins :
dans les missions pédagogiques françaises en Suisse, il fait
figure de mauvais élève et, à l'inverse de Genève,
est plutôt un repoussoir qu'un modèle à suivre. S'il est
également vrai qu'il constitue un État relativement marginal
parmi les autres, une uniformisation croissante des pratiques
pédagogiques se fait sentir sur la période. Tout d'abord par le
biais des conférences intercantonales romandes, qui débutent
à un rythme discontinu - la première a lieu de 1886 et la seconde
seulement en 1889 - avant de devenir très régulières
à partir de 1903 - jusqu'à une dizaine par an en 1904 et
1905201. Lors de la conférence du 27 Septembre 1904 est fait
mention d'un projet d'accord entre les cantons romands concernant la
transmission des livrets scolaires entre États « en vue de
rendre plus rigoureux le contrôle de la fréquentation des
écoles pour les élèves qui changent de domicile »
202 : ce qui sera appliqué quelques années plus tard. Les
cantons collaborent également dans la confection des manuels scolaires.
Certes, il s'agit le plus souvent de copier
197 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1880.
198 « L'examen pédagogique des recrues en Automne
1912 », L'école primaire, n°8, 15 Novembre 1913, p. 2
(frontispice).
199 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice...op.cit, p. 153.
200 Ibidem.
201 AEV, 2 DIP 21, Conférences intercantonales romandes,
inventaire.
202 Ibidem, Séance n°12, 27 Septembre
1904.
- avec de légers changements - les manuels en vigueur
dans les autres cantons. C'est le cas en 1911 lors d'une séance de la
commission scolaire, Monsieur Pernollaz évoque les négociations
avec Fribourg ayant trait à leur livre de lecture « qui serait
bon si l'on pouvait éliminer les pages par trop fribourgeoises et les
remplacer par des pages valaisannes » 203 . Souvent, ces arrangements
sont acceptés. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une réelle
collaboration et que chaque canton souhaite garder sa
spécificité, cela nécessite néanmoins une
coopération minimum entre États, et surtout, l'acceptation d'une
base de connaissances communes, valable et souhaitable pour l'ensemble de la
Suisse Romande. De plus, les simples copies de manuels remaniées
laissent place, petit à petit, à de vraies collaborations
pédagogiques. En 1917, lors de la conférence intercantonale
romande, l'ordre du jour se porte autour du nouveau manuel d'éducation
civique commun à tous les cantons francophones. La rédaction et
le choix des contenus ont été pensés en commun, tenant
compte de la diversité des situations locales et essayant de
présenter une synthèse satisfaisante pour chacun. C'est ainsi que
Monsieur Burgener, chef du département de l'instruction publique
valaisan indique que dans le canton, « on craignait tout d'abord un
manuel à tendances trop neutres, a-confessionnelles » et
constate « que les auteurs ont tenu compte des voeux et des
aspirations du peuple Valaisan »204. Au fil des
années, la collaboration entre les cantons - romands du moins - devient
de plus en plus prononcée. Se dégage une vision de l'enseignement
commune sur bien des points, motivée au niveau national par la
Confédération et à un niveau intermédiaire par les
conférences intercantonales, qui sort ainsi le Valais de son isolement
relatif. Le canton est de mieux en mieux intégré à
l'espace romand, créant ainsi de nouvelles frontières, notamment
des frontières de l'enseignement.
68
203 AEV, 3 DIP 188, Commission cantonale de l'enseignement
primaire, 7 Février 1911.
204 AEV, 2 DIP 21, Conférences intercantonales romandes,
séance n° 64, 10 Février 1917.
69
CHAPITRE 5. Frontières de l'enseignement.
Après avoir pointé l'opacité
réelle qui existe entre la Haute-Savoie et le Valais de « La Belle
Époque », et montré que ces territoires étaient en
réalité intégrés à des espaces bien
différents, il s'agit maintenant de réfléchir aux
frontières que l'école produit ou participe à diffuser. La
frontière nationale, dont nous avons beaucoup parlé jusqu'ici,
induit une fracture majeure dans les représentations que l'on se fait
des Alpes dans les écoles françaises et suisses. Elle induit
également un mode d'organisation et de culture scolaire bien distinct
entre l'école républicaine laïque et l'école
valaisanne sous tutelle de l'administration ecclésiale. Toutefois, la
frontière nationale, que nous avons jusqu'ici présentée
comme hermétiquement close, est parfois transgressée. Si aucun
échange par en bas n'existe réellement, il ne faut pas oublier
que les idées et les savoirs font fi des Alpes et se propagent partout
en Europe et au-delà. Volatiles et inorganiques, les connaissances et
les représentations scolaires d'une époque circulent au travers
des conférences, des congrès, ou encore des journaux à
vocations pédagogiques. Bien sûr, elles se propagent
inégalement, car elles ne disposent pas des mêmes moyens de
diffusion, ni de réception, ni d'ailleurs du même rayonnement et
de la même attention selon les lieux. Il serait toutefois imprudent
d'affirmer que les systèmes scolaires qui prennent place en France et en
Suisse sont totalement étrangers l'un à l'autre. Au contraire,
les emprunts, les imitations, les adaptations sont nombreux et ne se bornent
pas aux limites territoriales étatiques. Plus encore, il est question de
repérer des frontières internes au sein même des deux
nations, les enseignements inculqués dans - et par - les écoles
ne sont pas systématiquement homogènes à l'échelle
du pays - même lorsque c'est l'objectif affiché - ils
dépendent souvent des lieux.
A] La place des Alpes dans les romans nationaux
français et suisses
Commençons par rappeler une évidence, la Suisse
a une géographie majoritairement montagneuse alors que la France non.
Nous ne sommes pas sans savoir que les figures paysagères sont au centre
de la construction des mythes nationaux du XIXe siècle dans
les pays
70
européens205 . Les discours français
et suisses ne s'appuient pas sur la même géographie nationale : le
premier opte pour l'unité dans la diversité - alors même
que l'État est très centralisé - quand le second place les
Alpes comme dénominateur commun, ferment de l'identité
helvétique - alors que l'État est plutôt
décentralisé.
En France donc, les Alpes n'ont pas de statut
spécifique. Contrairement aux autres nations européennes, le
paysage français n'a pas de forme précise et ne se fixe qu'au
XIXe siècle206, en privilégiant la
diversité plutôt que l'unicité symbolique : Youenn Michel
écrit d'ailleurs que la diversité des paysages français
s'intègre dans « une mosaïque harmonieuse
»207 au sein du discours scolaire républicain. Nous
développerons plus loin le discours sur les « petites patries
» qui sert de pierre d'angle à l'édifice scolaire
français, retenons seulement pour le moment que si des ethnotypes
spécifiques à chaque région s'inscrivent dans les manuels
scolaires, ils ne peuvent avoir d'existence propre en dehors de la
synthèse nationale. Ainsi, le paysan de montagne, décrit comme
« lent, réfléchi, âpre au grain,
procédurier et attaché aux vieux usages »208
ne représente pas plus qu'un autre la nation française. Les Alpes
sont un espace aux marges de la nation, elles constituent une frontière
« naturelle » - du moins pensée comme telle - avec ses voisins
et non une composante majeure de l'identité hexagonale. D'ailleurs, les
ethnotypes attribués aux montagnards dans les manuels français
sont empruntés au modèle suisse209, François
Walter parle « d'appropriation transculturelle » du paysage
alpin qui ne se limite d'ailleurs pas au seul cas
français210. Patrick Cabanel remarquait ainsi que «
la France a les Alpes » mais qu'elle en a « longtemps
abandonné admiration, représentation et parcours à des
Suisses, des Britanniques, des Allemands »211.
L'école française n'adopte pas de discours visant à donner
un statut particulier aux élèves des Alpes, elle dispense son
enseignement uniformément sur le territoire. La référence
au milieu ou aux régions qui fleurissent dans la géographie
vidalienne ne sont pensées que comme des miniatures de la nation.
205 Voir le très bon ouvrage de François WALTER,
Les figures paysagères de la nation... op.cit.
206 Sur ce point, voir Françoise CACHIN, « Le
paysage du peintre », dans Pierre NORA, (dir.), Les Lieux de
Mémoire. t. II, La Nation, Paris, Gallimard, 1997, [1986] p.
435-485.
207 Michel YOUENN, « Des petites patries au «
patrimoines culturels » ... », op.cit, p. 16.
208 Anne-Marie THIESSE, Ils apprenaient la France... op.cit,
p. 38.
209 Idée portée par Bernard DEBARBIEUX et Gilles
RUDAZ, Les faiseurs de montagne, op.cit, p. 42.
210 François WALTER, « La montagne alpine : un
dispositif esthétique et idéologique à l'échelle de
l'Europe », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°
52, 2005, p. 64-87, p. 76.
211 Patrick CABANEL (dir), « Paysages de la nation »
dans Le tour de la nation par des enfants, Paris, Belin, 2007.
71
À l'inverse, « pour la majorité des
Suisses du XIXe siècle, le vrai Suisse ne peut être que
montagnard »212. Les Alpes ne font pas ici figure de
frontière, elles sont un espace de jonction plutôt que de
disjonction, elles fonctionnent comme « une métaphore de
l'association librement consentie des hommes autour de l'image
fédératrice d'une architecture naturelle
»213. Les Alpes sont perçues comme un terreau
commun à tous les suisses, elles opèrent « comme
image-symbole de l'hélvéticité »214.
Pour exemple, Jules Métral, élève de l'instituteur
Pitteloud évoqué plus haut, rédige en 1913 une
dictée dans laquelle il copie : « La Suisse est un pays
élevé, le plus haut de l'Europe : elle a de superbes montagnes,
de vallées profondes »215. Le Valais a d'ailleurs
une position particulière au sein du pays, c'est le canton le plus haut
de Suisse, souvent considéré comme le plus authentique et le
mieux préservé dans ses traditions et sa géographie
naturelle216. Contrairement aux élèves
hauts-savoyards, les élèves valaisans ne sont pas
considérés de la même manière qu'ils vivent en
montagne ou en plaine. Malgré les conditions d'enseignement
défavorables du hameau, la vétusté des bâtiments
scolaires, la durée plus réduite des écoles et le rude
climat hivernal, les enfants des montagnes sont considérés comme
moralement et physiquement supérieurs aux autres. Étrange
paradoxe qui montre bien la force symbolique que revêt le
référentiel alpin en Suisse et particulièrement en Valais.
On assiste à deux naturalisations distinctes : d'un côté
les Alpes comme frontière naturelle, de l'autre les Alpes comme
identité particulière.
B] Une meilleure moralité, un meilleur niveau
scolaire ?
En Valais, l'importance de la figure du montagnard donne lieu
à des positionnements ambigus et difficilement conciliables. Si le
chanoine de Cocatrix justifiait le faible niveau scolaire du canton par les
difficultés topographiques inhérentes à la
géographie alpine, expliquant par-là l'existence d'écoles
nomades et la durée limitée de l'année scolaire dans
les
212 François WALTER, Une histoire de la Suisse,
Neufchâtel, PUS, 2016, p. 366.
213 Bernard DEBARBIEUX, « La (M)montagne comme figure de
la frontière : réflexions à partir de quelques cas »,
Le Globe. Revue genevoise de géographie, n°137, 1997 p.
145-166, p. 151.
214 Marie Claude MORAND, « Notre beau Valais : le
rôle de la production artistique « étrangère »
dans la construction de l'identité culturelle valaisanne », dans
Gérald ARLETTAZ, Jean-Henry PAPILLOUD, Myriam EVEQUOZ-DAYEN, Maria-Pia
TSCHOPP, (dir), Le Valais et les étrangers,
XIXe-XXe siècles, Sion, Groupe Valaisan de
Sciences Humaines, 1992, p. 191-246, p. 202.
215 AEV, Fonds Pitteloud Vincent, 24.3 Dictées, travaux
d'élèves 1910-1924, Cahier d'exercice de Jules Métral.
216 Marie Claude MORAND, « Notre beau Valais... »,
op.cit, p. 198.
72
écoles de montagne, il apparaît paradoxalement
que ces enfants montagnards sont également considérés
comme meilleurs que les autres. La réunion de la société
d'éducation valaisanne qui se tient à Monthey le 28 Avril 1885
rend bien compte de cette tension. D'un côté Monsieur Chappaz,
membre de la société, se désole du fait qu'en termes
d'éducation « nous n'avançons pas et même nous
reculons » 217 . Il cite plusieurs cantons qui ont « comme
le Valais des montagnes, et qui sont cependant plus avancés que le
nôtre » 218. En disant cela, Chappaz entend montrer
que les écoles de montagne valaisanne ne sont pas « dans une
position exceptionnelle comme nous l'avons prétendu
»219 . Il refuse de faire une distinction entre
l'éducation en montagne et celle des autres milieux
géographiques. Monsieur Roten, chef du département de
l'instruction publique lui répond : « le Valais est dans une
position exceptionnelle, non-seulement à cause de ses montagnes, mais
surtout à cause des conditions de certaines populations. J'estime que si
le district de Conches figure constamment parmi les premiers pour les notes
obtenues, cela est dû au fait que les habitants de ces villages se
trouvent enfermés une bonne partie de l'année par les neiges et
que les enfants disposent alors de tout le temps pour fréquenter les
classes, tandis que dans une partie de la plaine on les emploie davantage aux
travaux de la campagne »220. Roten affiche ici un avis
contraire en reconnaissant au canton une position exceptionnelle qui est
directement liée à sa situation géographique : les
élèves de montagne, enfermés par les neiges pendant une
moitié de l'année, sont plus assidus dans leur
fréquentation scolaire. L'article d'un instituteur valaisan en 1889
affirme que l'hiver venu « c'est le moment de faire des
progrès, car le vent, la neige et le froid, semblent s'être
coalisés pour obliger les gens à rester enfermés dans
leurs demeures [...] les élèves ont moins de sujets de
distraction qui les empêchent de travailler »221.
Roten et l'instituteur en question, prennent le contre-pied des affirmations de
Cocatrix qui, au contraire, voyait dans l'école de montagne, une
limitation aux progrès scolaires.
Pourtant, les arguments du chef de l'instruction publique sont
critiquables. En comparant les rapports d'inspection de l'année
1890-1891, il apparaît que le nombre d'absences est variable et ne
dépend pas de la situation de montagne ou de plaine. À
Martigny-Bâtiaz, commune de plaine, l'école des filles
comptabilisait 185 absences sur l'année (pour 33
élèves)
217 « Réunion à Monthey de la
société valaisanne d'éducation », L'école
primaire, n° supplément, 30 Mai 1885, p. 204.
218 Ibidem.
219 Ibid.
220 Ibid, p. 205.
221 « Mémorial d'instituteur »,
L'école Primaire, n°8, Mars 1889, p. 127.
73
et celle des garçons 105 (pour 32
élèves). En regardant les écoles de hameau de la commune
de Martigny-Combes, on trouve des chiffres étonnants : l'école de
Broccard ne comptait que 5 absences sur l'année (pour 15
élèves) alors que celle voisine de Jears, 257 (pour 24
élèves)222. Rien ne semble a priori justifier une
telle différence, les inspecteurs se montrent très souvent
sceptiques sur les chiffres avancés par les instituteurs des
écoles de hameaux : à la question « les absences
ont-elles étés exactement notées et la liste
régulièrement remise à l'autorité compétente
? », les inspecteurs inscrivent souvent « ? » ou
« non », beaucoup plus rarement « oui ».
Difficile donc de mesurer l'assiduité accrue des élèves de
montagne par rapport aux autres. Il est clair que l'isolement hivernal a pour
conséquence une meilleure fréquentation l'hiver, mais n'en est-il
pas pareil des écoles de plaine dont les populations agricoles sont
également réduites à l'inactivité hivernale ? Et
quand bien même un nombre d'absence plus important serait noté
pour les écoles des plaines en raison des travaux agricoles, il ne faut
pas oublier que ces écoles durent environ sept à huit mois, alors
que celles de hameaux six mois : si les élèves de montagne ont
les mêmes travaux (agricoles ou pastoraux) à remplir que ceux de
la plaine, ils sont déjà libérés de la contrainte
scolaire et leurs absences ne sont pas reportées - l'école se
termine en avril. En bref, deux discours s'opposent en comparant les
contraintes/avantages pour l'éducation des communes de montagne alors
même que, nous l'avons montré, les conditions d'enseignement sont
largement plus précaires. À ces arguments, se surajoutent un ou
plusieurs discours qui font intervenir des arguments moraux, essentialisant la
figure du montagnard, naturalisant les Alpes.
« Sacraliser la figure du paysan
»223 , porter une attention accrue aux mondes ruraux,
s'inquiéter du déracinement des populations et s'effrayer de
l'exode rural sont des caractéristiques communes à toutes nations
les européennes de la « Belle Époque »224.
En France, l'opposition rural/citadin cristallise les tensions, donnant souvent
de plus grandes qualités morales au premier qu'au second :
l'école républicaine se pense rurale et met largement en avant
les mondes paysans225. En Valais, un discours équivalent se
met en place, à cela près
222 AEV, 1 DIP 58, Rapport des inspecteurs scolaires, commune
de Martigny-Combes, et Martigny-Batiaz 18901891.
223 Voir Anne-Marie THIESSE, « L'invention du
régionalisme à la Belle Époque », Le Mouvement
Social, n°160, 1992/3, p. 11-32.
224 Voir Anne-Marie THIESSE, La fabrique des identités
nationales, Paris, Seuil, 1999.
225 Sur cette question voir Jean-François CHANET,
« faire aimer le sol natal », chapitre 8, dans L'école
républicaine...op.cit, p. 284-337, Anne-Marie THIESSE, « La
France est variée dans l'unité », chapitre 1, dans Ils
apprenaient... op.cit, p. 3-14.
74
que le discours est double et souvent assez trouble : il tente
de séparer la figure du montagnard de l'habitant de plaine, mais
lorsqu'il s'agit de s'opposer à la ville, plaine et montagne sont
conciliées sous le même dénominatif de « campagne
» ou « rural ». En 1881, lorsque paraît l'article
déjà cité en faveur des écoles mixtes, l'argument
est le suivant « risquera-t-on davantage dans nos montagnes où
l'air est plus vif et plus favorable sous le rapport de la moralité, et
où n'existe pas à un si haut degré ce cosmopolitisme qui
n'est nulle part une garantie en faveur des bonnes moeurs ?
»226.
Ce terme de la moralité des habitants de montagne que
l'on attribue entre autres à la pureté de l'air n'est pas
nouveau227, il fleurit depuis le XVIIIe siècle
sous la plume des naturalistes : Buffon - repris plus tard par Reclus -
écrit que les habitants de montagnes sont plus agiles, plus beaux, plus
intelligents et en meilleur santé que ceux des plaines228.
Mondher Kilani ajoute que cette distinction est très répandue
« le montagnard, de par son « style de vie», apparaît
comme quelqu'un d'attachant et de haute moralité - ses moeurs sont
«hospitalières», il est
«désintéressé», «confiant»,
«généreux» -, alors que l'homme des plaines est
comparé à quelqu'un de «rude»,
d'«austère», d'«indolent»,
d'«intéressé» et particulièrement frappé
par le «crétinisme» et le «goitre» » 229 .
Un écrivain valaisan publie en 1917 un article dans le supplément
de L'école primaire, indiquant que les « filles de la
montagne, solidement charpentées et musclées, donnent un type
à part, qui établit entre elles et les filles de la plaine une
différence qui n 'est pas toute à l'avantage de celles-ci. Leur
teint basané proclame l'excellence de la vie au grand air et leurs yeux
ingénus, la douceur du spectacle qui les frappe chaque jour. Le
hâle de leur front est une auréole de vertu que je souhaiterais
à beaucoup d'autres, c'est le sceau du travail quotidien, sur les pentes
vertigineuses, sous un ciel bleu, ruisselant de soleil.
»230 . Ainsi donc, l'habitant de montagne est perçu
comme supérieur au niveau de la moralité à celui des
plaines, mais celui-ci, à son tour, est d'une meilleure moralité
que le citadin : comme dit plus haut, montagne et plaine font front commun.
226 C.W, « Les écoles mixtes », op. cit,
1881, p. 34.
227 Bernard DEBARBIEUX et Gilles RUDAZ, parlent de la
vicissitude des plaines opposée à la pureté de la
montagne, Les faiseurs de montagne, op.cit, p. 88.
228 François WALTER, Les figures paysagères de
la nation... op.cit, p. 238.
229 Mondher KILANI « Les images de la montagne au
passé et au présent, l'exemple des Alpes valaisannes »,
dans Archives suisses des traditions populaires, vol.1,
Société suisse des traditions populaires, Bâle, 1988, p.
27-55, p. 33.
230 SOLANDIEU « A travers les Mayens (croquis valaisan)
», L'école primaire, n°9, 1917, supplément, p.
191-192, p. 191.
75
L'école primaire valaisanne est accusée de
tourner « trop de regards vers la ville, où déjà
se porte avec excès la population des campagnes » étant
entendu qu'il « n'y a pas de comparaison à établir entre
le délassement intellectuel, la dilatation morale et physique que
procure le travail en plein air dans les allées et planches d'un jardin,
et celle qui résulte d'un travail mécanique dans quelque coin
d'un bâtiment »231. Les articles qui vantent la
supériorité de l'enfant de la campagne sont légion. Ainsi,
la culture livresque de la ville, certes plus savante, ne peut rivaliser avec
l'observation directe des « Alpes fleuries, la première page,
la plus belle, du livre de la nature, dans lequel on ne se lasse jamais de
lire. »232. L'ouvrier est considéré
moralement inférieur au paysan, nous en avons un exemple dans un sujet
de composition française, publié en 1913, proposant aux
élèves de traiter du sujet de la pauvreté. Celui-ci
affirme qu'il n'est pas difficile de devenir pauvre « quand l'ouvrier
se rend irrégulièrement à son travail parce qu'il est
paresseux » ou lorsque « le cultivateur n'a pas le courage
de faire sa moisson en temps utile »233 . Le vocabulaire
employé révèle l'image que donne l'école des usines
et des champs, des campagnes et des villes : l'ouvrier qui ne travaille pas est
paresseux, le paysan n'a simplement pas eu le courage d'achever son ouvrage.
Une série d'autres articles du journal célèbre les
bienfaits de la campagne sur les vices de la ville, tous les citer serait trop
long et inutile. Retenons tout de même que ce traitement
différencié - non pas seulement dans le fonctionnement de
l'école valaisanne mais aussi dans la perception de ses acteurs -
diffuse, en partie par l'école, des frontières morales et
sociales internes au canton, distinguant la montagne, la plaine et la ville
à l'avantage de la première. Cela n'est pas sans rapport avec le
fait que la montagne figure au centre de l'identité helvétique et
également que le canton du Valais, farouchement conservateur, s'oppose
souvent à l'industrialisation. Un autre facteur, brièvement
évoqué qui corrobore les deux premiers est la place
prégnante de l'Église dans l'enseignement valaisan.
C] L'église, pierre d'angle de l'enseignement
valaisan
Ainsi donc, la frontière étatique qui
sépare la Haute-Savoie du Valais exerce une influence sur la
manière de se représenter les habitants des montagnes.
Marie-Claire Robic écrit qu'au fil
231 « L'agriculture à l'école »,
L'école Primaire, n°8, Mars 1889, p. 119.
232 « Nature et éducation », L'école
primaire, n°1, 1910, supplément, p. 3-4, p. 3.
233 « Composition française »,
L'école primaire, n°8, 1913, p. 110.
76
des siècles, les montagnes « ont
suscité des valorisations diverses, souvent même contradictoires
» 234 . En termes de valorisations des montagnards, l'Église
catholique valaisanne jouit d'un grand pouvoir ; selon Danièle
Périsset-Bagnoud, les fins que propose l'enseignement du canton sont les
suivantes : « Il n'est explicitement pas question de pousser le peuple
hors de sa voie naturelle, la culture de la maigre campagne à flanc de
coteaux et de montagnes. Une éducation utile lui est dispensée
pour lui faire accepter, sans soupir ni revendication, cette vie
assignée par la Providence. L'obéissance, la pauvreté et
l'injustice sociale de naissance, sont acceptées comme un don de Dieu.
Le respect craintif de la hiérarchie que comporte l'éducation
catholique romaine abonde dans le sens de la politique cantonale mise en oeuvre
par les gouvernements du Valais » 235 . De l'autre côté
des Alpes, l'école républicaine française est
épurée de toute référence religieuse. Chamonix ne
compte aucune école privée et à Vallorcine, commune
frontière, le vote à gauche est systématique : preuve
à nouveau de l'importance de la frontière étatique qui
sépare les deux territoires, celle-ci influant sur les
expériences scolaires des acteurs de l'école. À l'inverse,
si l'éducation valaisanne est publique et organisée par
l'État, l'Église y tient un grand rôle : L'école
primaire assigne dès 1881 comme fonction à l'instruction
populaire de « contribuer à former de bons citoyens et surtout
de bons chrétiens et des catholiques sans peur et sans reproche
»236. En 1916, dans le contexte de guerre en Europe, la
complémentarité entre la patrie et l'Église est
réaffirmée : « Pour le chrétien, le patriotisme
n'est pas seulement un sentiment, mais un devoir de conscience, un commandement
de Dieu qui oblige l'homme à remplir, dans toutes les circonstances, ses
devoirs de citoyens »237. Les agents de l'Église ne
peuvent enseigner - mis-à-part les cours de religion, obligatoires dans
le canton - ils sont néanmoins présents dans la plupart des
institutions scolaires. La majorité des inspecteurs primaires sont des
clercs : pour exemple, l'abbé Constantin d'Ayent, inspecteur du district
de Sierre, démissionne de son poste, à sa place sera nommé
l'abbé Adrien Bagnoud pour de longues années238. Les
commissions scolaires communales sont systématiquement dirigées
par le curé du village : c'est un organe puissant car une
majorité des décisions concernant l'instruction publique sont
prises au niveau local. Pour l'illustrer, il est utile de revenir à une
lettre déjà mentionnée, où l'inspecteur primaire
234 Marie-Claire ROBIC (dir), Du milieu à
l'environnement..., op.cit, p. 239.
235 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice, op.cit, p. 177.
236 « À nos lecteurs », L'école
primaire, n°1, 1881, p. 2.
237 « À propos d'Instruction civique »,
L'école primaire, n° 10, Décembre 1916, p. 77.
238 AEV 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1880, p. 30.
77
écrit à l'instituteur Pitteloud pour le
prévenir de sa visite prochaine. Dans cette lettre, l'inspecteur lui
demande « d'avoir l'obligeance d'en informer M.M les membres de la
commission scolaire » notant cependant que « Mr. le
curé en est averti »239. Le curé est donc
informé de la visite de l'inspecteur avant les autres membres de la
commission et avant l'instituteur lui-même ! Les enseignants
étaient d'ailleurs présentés en 1910 comme « les
auxiliaires des autorités ecclésiastiques et civiles dans la
formation de l'homme, du chrétien et du citoyen
»240 . Les exemples de la collaboration des deux
institutions sont nombreux : la Société valaisanne
d'éducation - organe qui édite le journal L'école
Primaire - est dirigée par le chanoine Delaloye, les écoles
normales d'instituteurs sont tenues par les Frères de Marie - pour les
instituteurs - et par les Soeurs Ursulines - pour les institutrices - sous
contrat avec l'État, sans que celui-ci trouve à redire.
En bref, pouvoirs publics et pouvoirs ecclésiastiques
coopèrent au sein de l'institution scolaire valaisanne. La situation est
donc symétriquement à l'inverse de la France, où - du
point de vue républicain - l'Église est tenue pour l'agent de la
tradition dont l'école doit s'émanciper si l'instruction
populaire veut progresser. En Valais - et non en Suisse en
général - c'est au contraire l'Église qui est au centre du
processus d'amélioration scolaire. Les analyses de Maurice Agulhon,
faisant, en France, la disjonction entre deux sacralisations de la nation,
celle de l'Église et celle de la République241, celle
de l'école privée et celle de l'école publique, l'une
réactionnaire et l'autre progressiste n'ont pas d'équivalent
outre-alpes. Le discours républicain s'est fondé sur un rejet de
l'Église catholique, et il est vrai que les lois instaurant
l'école du peuple ont été menées par la jeune
République installée depuis 1870. La reconstruction de cette
période a pu, à posteriori, laisser penser que les fins des deux
écoles étaient strictement séparées. En
réalité, Mona Ozouf et bien d'autres historiens après
elle, ont insisté sur le fait que les différences
n'étaient pas tant dans les programmes que dans la manière de
raconter l'histoire242. Toutefois, contre le régime
républicain qu'elle honnissait, l'Église a pu adopter une
rhétorique
239 AEV, Fonds Pitteloud Vincent, 24.2 Correspondance
instituteur, 1886-1913, lettre de l'inspecteur d'académie du 27 Mars
1888.
240 « La rentrée des classes »,
L'école primaire, n°10, Novembre 1910, p. 147.
241 Maurice AGULHON, Histoire Vagabonde. t.1, Ethnologie
et politique dans la France contemporaine Paris, Gallimard, 1988, p.
615-639.
242 Mona OZOUF, L'École, l'Église et la
République : 1870-1914, Paris, Le Seuil, 1982 [1963], p.7-8, et
Christian AMALVI, De l'art et de la manière d'accommoder les
héros de l'histoire de France, Paris, Albin Michel, 1988,
Introduction, p. 15-50.
78
anti-scolaire en critiquant l'obligation243 , ou en
valorisant les patois contre l'imposition du français - voyant une
acculturation dans le processus d'uniformisation linguistique244.
Ainsi, en France, l'institution ecclésiale a pu se revendiquer gardienne
des traditions, contre l'idéologie du progrès, supposée
destructrice du monde social. Or, en Valais, l'Église se pose en agent
du progrès scolaire, si bien que les discours de certains clercs se
rapprochent de la rhétorique employée par l'école
républicaine française. L'usage du patois à l'école
y est souvent fustigé, étant considéré que cet
archaïsme « est funeste aux progrès de l'école
»245 - bien que soit reconnu l'obligation contrainte pour
l'instituteur de l'employer les premiers jours d'école246. Le
curé, l'abbé, à l'instar du hussard noir, s'investissent
énormément pour assurer la fréquentation scolaire.
L'abbé Jérémie Gabbin du village de Loèche
écrit en 1913 à l'inspecteur primaire pour lui notifier que
l'élève « François Gillioz est un gros paresseux
qui n'a même pas oser se présenter à l'examen
d'émancipation » insistant sur le fait qu'il « ne
faut pas qu'il échappe à l'école primaire cette
année 1913-1914 »247.
Cette politique scolaire de complémentarité
entre l'État et l'Église fonctionne. Nous avons
déjà évoqué les lois d'amélioration scolaire
successives qui prennent place dans le canton, bien qu'accusant un certain
retard sur les autres cantons suisses et sur les autres nations
européennes. Il reste que la scolarité devient plus contraignante
qu'en France : les élèves qui ne réussissent pas l'examen
d'émancipation - équivalent du brevet élémentaire -
peuvent passer jusqu'à deux ans supplémentaires sur les bancs de
l'école. Dans le cas d'un succès, ils seront tout de même
astreints à suivre une formation de 100 heures par an entre leurs 15 et
19 ans avec un stage scolaire de deux mois avant l'examen de recrues. Nous
avons déjà mentionné l'avancée du canton au
classement de cet examen, en 1909, le canton parvient à la
sixième place au classement général suisse248,
alors qu'il était dernier 30 années plus tôt.
243 Mona OZOUF, Ibidem, chap 2.
244 Voir par exemple Mona OZOUF, Composition
française, Paris, Gallimard, 2009.
245 AEV, 1 DIP 102bis, Cahier sur les examens de recrue par le
chanoine Cocatrix, 1906 op. cit, p. 16.
246 Jean-François CHANET fait une remarque similaire
dans « Maîtres d'école et régionalisme en France sous
la IIIe République », Ethnologie française,
n°18, 1988, p. 244-256, à propos des instituteurs
français, contre une historiographie qui accusait l'école de
déraciner les élèves, voire de génocide culturel :
voir Eugen WEBER, Peasants into frenchmen, the modernization of rural
France, 1870-1914, Stanford University Press, 1976 et Suzanne CITRON,
Le Mythe National, Paris, Éditions ouvrières, 1987.
247 AEV, 1 DIP 145bis, Lettre de l'abbé
Jérémie Gabbin de Loèche à l'inspecteur primaire,
31 Octobre 1913.
248 « L'examen pédagogique des recrues en 1909
», L'école primaire, n°10, supplément
spéciale, Novembre 1910, p. I.
79
Cela permet de nuancer la thèse de Danièle
Périsset-Bagnoud qui voit dans le rôle de l'Église dans
l'enseignement valaisan, une perpétuation de la société
traditionnelle, fermée sur elle-même, insistant sur le fait que
l'école n'a aucun objectif d'émancipation249. Selon
elle, les lois successives du département de l'instruction publique
valaisan répondent aux invectives de la Confédération sans
susciter pour autant une vraie ferveur scolaire, or, les progrès sont
là ! Le canton améliore son classement année après
année et, soutenu par l'Église, se préoccupe
réellement de l'instruction populaire. Les résultats sont
parlants, de plus qu'ils sont obtenus dans un concours organisé, non pas
par le Valais, mais par la Confédération suisse, de tendance
radicale et centralisatrice, supposément loin des intérêts
du canton. Ne soyons pas injustes, la réflexion de
Périsset-Bagnoud s'appuie sur des sources solides, mais pratiquement que
sur des discours généraux provenant de l'administration scolaire,
or, le fossé entre discours et actions peut être profond. Nous
avons montré que, tout en se pensant isolé - et en l'étant
d'ailleurs parfois - le Valais s'engageait néanmoins dans un processus
de collaboration de plus en plus poussé avec les autres cantons romands
- laïques et radicaux. Pour reprendre le fil de la comparaison
Haute-Savoie/Valais, si les deux systèmes scolaires ne disposent pas des
mêmes moyens matériels, financiers et idéologiques, ils
tendent vers la même fin, à savoir le parachèvement de
l'instruction populaire. L'Église constitue la pierre d'angle du
progrès scolaire valaisan, et pourtant, les parallèles avec
l'école républicaine française sont nombreux, preuve que,
dans cette Europe des années 1880-1914, les objectifs
pédagogiques et les savoirs scolaires circulent au-delà des
seules frontières nationales.
D] Des échanges « par en haut
»
Le canton du Valais est un territoire à majorité
francophone, classé parmi les cantons romands250. Bien qu'il
dénote sur plusieurs aspects de cette partie de la Suisse, le canton est
tout de même intégré à des espaces francophones plus
larges qui témoignent d'une porosité de ses frontières.
L'inexistence d'échanges « par en bas » donne l'impression de
cloisonnement des systèmes scolaires aux limites territoriales. Pour
rendre compte des points communs, des
249 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice, op.cit, p. 157.
250 Nous ignorons ici la partie germanophone du canton, tout
en reconnaissant que cela constitue un point aveugle du présent
mémoire. Notre incompétence en langue allemande nous contraint
à ce choix. Toutefois, le canton est largement intégré
à l'espace romand francophone, et c'est la langue maternelle de 67,2 %
des habitants en 1880 contre 32 % de germanophone : voir Léo MEYER,
Les recensements de la population du Valais de 1798 à 1900,
Berne, Staempfli, 1908, p. 95.
80
inspirations mutuelles - mais aussi des limites à la
diffusion des pratiques et savoirs - il est donc nécessaire d'adopter,
comme le revendique Damiano Matasci, une perspective comparée des
systèmes scolaires européens « par en haut
»251. Ce dernier a bien montré que chaque pays, tout en
taillant son école dans le tissu national, procède en
réalité par échanges, imitations, et jeux d'influences
voilés. En effet, la circulation des idées pédagogiques
est forte au sein de l'Europe de « La Belle Époque ». Nous
pouvons tout d'abord faire quelques constatations sommaires : les lois
scolaires se suivent en France et en Suisse, en Haute-Savoie et en Valais. La
gratuité et l'obligation helvétique, mises en place en 1874,
précèdent de quelques années les lois Jules Ferry de
1881-1882, qui toutefois ajoutent la clause de laïcité, une
première à l'échelle d'un État - mais
déjà en oeuvre dans certains cantons romands252.
Concernant les écoles normales d'instituteurs et
d'institutrices, le Valais semble se calquer petit à petit sur le
modèle français : avant 1873, la formation des enseignants
n'était que de deux mois, elle passe à deux années
complètes puis à trois en 1904. Seront adjointes aux
écoles normales, au début du XXe siècle, des
écoles annexes pour parfaire la formation des élèves
maîtres et maîtresses - comme ce qui existe déjà en
France. Du côté des échanges pédagogiques, nous
avons déjà évoqué l'ampleur des relations entre la
France et certains cantons de Suisse romande253, surtout à
partir des années 1870, moment où la IIIe
République se pense distancée par ses voisins en termes
d'instruction populaire254. La suisse « urbaine et
industrielle »255 fait figure de modèle et les
personnels de l'instruction publique sont missionnés pour observer et
s'inspirer d'un pays considéré comme étant à la
pointe de l'éducation en Europe. Toutefois, les cantons catholiques,
surtout le Valais et son système scolaire jugé archaïque,
gangrené par l'omniprésence ecclésiale, « sont
particulièrement montrés du doigt »256 par
les dirigeants de l'instruction publique française. Il n'en est jamais
fait mention et, à notre connaissance, aucune mission d'observation n'y
est jamais menée. A l'inverse,
251 Damiano MATASCI, L'école républicaine...
op.cit, p. 8.
252 Ibidem, p. 98.
253 Sur les échanges pédagogiques mutuels entre
la France et le Suisse Romande, voir Alexandre FONTAINE, Transferts
culturels et déclinaisons de la pédagogie européenne : le
cas franco-romand au travers de l'itinéraire d'Alexandre Daguet
(1816-1894), sous la direction de Michel Espagne, Université Paris
8, Université de Fribourg, 2013. Notons toutefois qu'il n'est jamais
fait mention du Valais.
187.
254 Ibid, p.
255 Dénominatif des cantons protestants romands.
256 Pierre CASPARD, « Les miroirs
réfléchissent-ils ? Esquisse d'une étude comparée
de la gratuité, l'obligation et de la laïcité scolaires en
France et en Suisse », dans Rita HOFSTETTER, Charles MAGNIN, Lucien
CRIBLEZ, Carlo JENZER (dir.), Une école pour la démocratie...
op.cit, p. 343-358, p. 346.
81
lorsque le canton suisse prend conscience de son retard dans
la marche européenne pour l'éducation populaire, les cantons
romands et la France apparaissent comme des modèles de
référence. Nous avons déjà montré que le
Valais sort de son isolement relatif pour entrer dans une collaboration de plus
en plus étroite avec les cantons romands, allant même
jusqu'à coopérer dans la rédaction des manuels scolaires
et à homogénéiser certains enseignements - comme la
gymnastique. Mais plus encore, le canton, par son intégration dans un
espace francophone, est largement dominé par l'hégémonie
culturelle française. En consultant la liste des livres obligatoires
dans les écoles valaisannes, il apparaît que la plupart des
références littéraires sont des oeuvres d'auteurs
français : Bossuet, Hugo, Chateaubriand, La Fontaine, Voltaire ou encore
Michelet s'y côtoient257. Nombre de ces lectures sont communes
aux enfants valaisans et aux enfants savoyards, preuve qu'au-delà des
différences, un certain référentiel culturel est
partagé et étend les frontières. De même, quelques
indices ténus indiquent que les journaux pédagogiques peuvent,
eux-aussi, traverser les Alpes. Dans un bref article sur l'écriture
cursive publié par L'école primaire en 1884, il est fait
mention des régents qui seraient aussi abonnés au Journal des
instituteurs258 . Quelques années plus tard, en
1888, c'est un instituteur français, Alfred Charron - exerçant
dans le Loiret - qui écrit au journal pour publier un article où
il est question de « bien enseigner » dans les écoles
primaires - sans faire de distinctions entre celles françaises et celles
suisses259 . Difficile de savoir si les journaux pédagogiques
français et valaisans circulent beaucoup entre les deux pays, reste que
l'existence de l'un et de l'autre est connue des instituteurs, sans quoi
Monsieur Charron, n'aurait jamais pu soumettre son article. Plus significatif
cette-fois, le nombre de reproductions d'articles français est
très important. Ceux-ci sont empruntés au Journal des
instituteurs ou encore au Manuel Général sur des
sujets variés touchant à l'éducation : cela montre que les
contenus pédagogiques français sont pour partie valables en
Valais. Toutefois, les échanges sont inégaux, il est peu probable
que des journaux français aient à leur tour reproduit des
articles de L'école primaire, modeste journal à
l'attention d'un petit territoire étranger, mal considéré
outre-Alpes en sus.
Pour autant, livres et articles sont-ils utilisés de la
même manière des deux côtés des Alpes ? Les
mêmes chapitres sont-ils utilisés pour l'analyse en classe ? Tous
les contenus pédagogiques français sont-ils diffusés en
Valais ? Concernant les livres, questions difficiles à
257 AEV, 3 DIP 188, Commission cantonale de l'enseignement
primaire, Novembre 1912.
258 « L'écriture cursive », L'école
primaire, n°12, 25 Avril 1884, p. 185.
259 Alfred CHARRON, « L'enseignement à l'école
primaire », L'école primaire, n°1, 15 Novembre 1888,
p. 2-4.
82
élucider. Néanmoins, en se basant sur les
publications de L'école primaire, nous pouvons esquisser
quelques pistes de réponses. Que ce soit à propos de « la
lecture expliquée »260, de l'attitude des
maîtres261 ou de « l'école et l'abandon des terres
»262, les emprunts ne posent aucun problème : la valeur
des conseils prodigués est la même. Néanmoins, on remarque
que tous les articles sélectionnés sont parmi ceux qui ne font
jamais la moindre référence - si discrète soit-elle -
à la laïcité de l'école française. D'ailleurs,
très peu de publications dénoncent « l'école sans
dieu », comme si le fait de le reconnaître frapperait
d'illégitimité l'importation d'une part importante de sa
pédagogie. La discrétion est de mise : dans le même temps,
le personnel enseignant est arrosé d'un flot d'articles vantant les
bienfaits de l'éducation catholique chrétienne, qui s'articule
finalement assez bien avec les articles français263 . Par
analogie, il est probable que parmi les livres d'auteurs français
utilisés en Valais, l'insistance porte plus sur les chapitres les plus
ouvertement en phase avec une vision chrétienne du monde. La place de la
religion catholique dans l'enseignement est sûrement le plus grand point
de divergences idéologico-pédagogiques entre les enseignements
français et valaisans. Si nous avons montré le rayonnement
culturel du modèle français, son laïcisme est, soit tu, soit
utilisé en repoussoir en Valais. Parmi le maigre fond personnel que
Vincent Pitteloud a laissé aux Archives cantonales, nous trouvons une
coupure du journal La Gazette du Valais fustigeant Ferdinand Buisson
pour son école sans Dieu264 - ce dernier est pourtant loin
d'être le plus anticlérical des républicains265
. Le fond conserve d'ailleurs quelques lettres que des élèves
dévoués ont adressées à l'instituteur. Les
références à la chrétienté y sont
omniprésentes, comme dans cette lettre où David
Pitteloud266 adresse ses meilleurs voeux à l'instituteur
pour
260 « La lecture expliquée »,
L'école primaire, n°11-12, Juillet-Août 1896, p.
183-184 - reproduction d'un article du Journal des instituteurs.
261 « Nos maîtres », L'école
primaire, n°1, 15 Janvier 1904, p. 183-184 - reproduction d'un
article d'un instituteur français.
262 « L'école et l'abandon des terres »,
L'école primaire, n°10, 10 Novembre 1910, p. 5-6 -
reproduction d'un article d'un instituteur français.
263 Pierre OGNIER fait le rapprochement entre la morale
chrétienne et la morale républicaine. Il écrit que cette
dernière étant d'inspiration religieuse selon lui. Voir Une
école sans dieu ? L'invention d'une morale laïque sous la
IIIe République 1880-1895, Toulouse, Le Mirail, 2008.
264 AEV, Fonds Vincent Pitteloud, 24.1, Articles de journaux
concernant les instituteurs.
265 Voir Pierre CASPARD, « Un modèle pour
Ferdinand Buisson ? La religion dans la formation des maîtres à
Neufchâtel (XIXe siècle) » dans
Jean-François CONDETTE (dir), Éducation, religion,
laïcité XVIe-XXe siècles :
continuités, tensions, et rupture dans la formation des
élèves et des enseignants, Lille, Septentrion, 2010, p.
121-143.
266 Un parent de l'instituteur ? Peut-être, dans tous
les cas, David écrit comme un élève à son
maître. L'homonymie témoigne à nouveau de la
micro-sociabilité familiale des hameaux de montagne.
83
l'année 1897 : « permettez-moi donc de faire
des voeux au ciel pour que Dieu protège encore vos jours si chers pour
vos élèves » et plus loin « que votre vie soit
comblée de bénédiction du Tout-Puissant et qu'après
votre carrière de combat dans ce bas monde il vous reçoive dans
les tabernacles éternels » 267 . Plusieurs autres lettres
conservées révèlent la même sainteté
d'expression, il est évident que la cassure est nette avec la
Haute-Savoie française, territoire très favorable aux lois
républicaines268.
Nous avons esquissé un tableau qui permet de
relativiser l'image de deux territoires en vase clos. L'intérêt
heuristique du changement d'échelle réside dans le fait de
montrer que malgré leur imperméabilité apparente,
Haute-Savoie et Valais, en étant intégrés dans des
ensembles plus larges - notamment un référentiel de culture
francophone - partagent indirectement un lot de représentations et de
pratiques communes. Bien sûr, cela n'enlève rien aux
différences marquées dans la sélection et l'utilisation
des contenus pédagogiques, mais permet de rapprocher les deux
systèmes scolaires dans une analyse cohérente, sans faire
intervenir l'idée d'un déterminisme géographique.
Même les aspects qui donnent une forte réalité à la
frontière étatique peuvent être nuancés. Pour
exemple, la congrégation des Frères de Marie, qui dirige
l'école normale d'instituteurs et la plupart des collèges du
canton, a en réalité son siège en France. Le personnel
enseignant de l'école est en majorité français, il est
soumis à sa hiérarchie ecclésiale de l'autre
côté des Alpes, bien que les écoles soient en
Valais269. L'enquête reste à mener, notons toutefois
que la communauté chrétienne et son enseignement constituent une
autre échelle d'analyse qui transgresse les frontières des
États. L'école isolée nous le paraît
déjà moins. Il faut maintenant achever la démonstration en
analysant l'activité touristique, en plein développement sur la
période, qui vient s'agréger autour de l'école et à
nouveau modifier ses frontières.
267 AEV, Fonds Vincent Pitteloud, 24.2, Lettre de bonne
année de David Pitteloud à Vincent Pitteloud, 1er
Janvier 1897.
268 Maurice AGULHON, plaçait d'ailleurs la Haute-Savoie
dans les « démocraties républicaines », voir «
Attitudes politiques » dans George DUBUY (dir), Histoire de la France
rurale. t.III, De 1789 à 1914, p. 477-478.
269 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice, op.cit, p. 166.
84
85
CHAPITRE 6. Le tourisme, sauveur des petites
patries270 ?
« Les sources électriques faisaient sourdre
à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci
devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre
duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les
petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour
apercevoir, lentement balancée dans les remous d'or, la vie luxueuse de
ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celles de poissons et de
mollusques étranges »271.
Marcel Proust exprime ici à merveille l'impossible
rencontre, entre le narrateur de La recherche du temps perdu,
bourgeois parisien en villégiature au Grand-Hôtel de Balbec,
et la population locale, pêcheurs et ouvriers, qui, tout en
déambulant dans les mêmes lieux, se heurtent à diverses
frontières. Frontière sociale tout d'abord, mais aussi
frontière physique, symbolisée par la paroi de verre de la salle
à manger qui sépare deux catégories d'individus. Pour
Placide Rambaud, « avec le tourisme, le village le plus isolé
rencontre la société urbaine dans sa situation de loisir ; de ce
contact, naît une culture singulière, qui n'est plus tout à
fait ni rurale, ni urbaine, avec ses modes, son goût des sports, la
découverte ou la maîtrise de la nature. »272.
Pour le romancier comme pour le sociologue, deux cultures bien distinctes
séparent le touriste et l'habitant local, pourtant, le second
préfère parler d'hybridation plutôt que de
séparation stricte. Toutefois, Aimée, le maître
d'hôtel de La recherche, incarne bien cette existence plurielle
: ni bourgeois ni pêcheur, ni ouvrier ; c'est un être
multi-situé, côtoyant et servant les villégiateurs sans
faire partie de leur monde, vivant une expérience moins
éphémère du lieu.
Une des motivations principales dans le choix des destinations
des voyageurs à partir de la seconde moitié du XIXe
siècle est un certain goût pour la nature, pour le paysage. Lieux
côtiers et lieux de montagne deviennent ainsi des images-symboles du
phénomène touristique.
270 Titre inspiré du chapitre 6 de l'ouvrage
d'Anne-Marie THIESSE, « Le tourisme sauveur de la France », Ils
apprenaient...op.cit, p. 95.
271 Marcel PROUST, À l'ombre des jeunes filles en
fleurs, Paris, Librairie Générale Française, 1992
[1918], p. 247.
272 Placide RAMBAUD, Sociétés rurales et
urbanisation, Paris, Le Seuil, 1973 [1969], p. 32.
86
Pour les habitants du lieu, les rapports à
l'environnement local, à l'identité spatiale s'en trouvent
affectés. Marie-Claire Robic identifie plusieurs types de relations
sociétés/nature qu'elle liste comme suit : «
nature-ressource, nature-contrainte, nature apprivoisée, nature
sauvage ou nature domestiquée, nature inépuisable ou nature
périssable »273. Bien que ces catégories
feraient hérisser les cheveux à un anthropologue, elles ont une
certaine efficience si l'on admet que le paysage du touriste devient le mode de
spatialisation dominant, redéfinissant les manières de vivre.
Dans le cas des communes alpines, la nature contrainte - faible
rentabilité de la culture, isolement hivernal, aléas climatiques
- devient parfois nature ressource - augmentation du prix des terrains,
sociétés de guides, nouveaux emplois274 . La montagne
est perçue, vécue et pratiquée autrement : elle passe de
territoire isolé qui dépend économiquement des plaines
à territoire attractif dont les bénéfices vont
s'étendre jusque dans les vallées275 . Ainsi, les
territorialités276 des habitants des Alpes se modifient, se
reconfigurent, les manières de se représenter et de vivre dans
son milieu également. Pour reprendre Augustin Berque, « en
transformant son environnement, une société se transforme
elle-même, et ce faisant crée un nouveau milieu,
c'est-à-dire une nouvelle relation entre la société et
l'environnement »277.
Quel rapport avec l'école ? Nous avons montré
que le paysage prend une place de plus en plus importante dans le processus de
parachèvement des identités nationales. Une certaine vision de la
nature, des paysages, est enseignée dans les classes, que ce soit sur le
modèle de la « mosaïque » en France ou sur la figure
singulière de la montagne en Suisse. Entre la pédagogie des
petites patries - ou plus largement, les enseignements liés au milieu
local- et la nature du tourisme, on trouve de nombreux parallèles,
notamment dans la dimension d'esthétisation romantique. De plus,
l'école et les oeuvres para-scolaires sont souvent - plus en
Haute-Savoie qu'en Valais - imprégnées par les activités
et pratiques liées au tourisme, si bien qu'une réelle
complémentarité se repère parfois. Enfin, les effets
combinés de la scolarisation populaire et du tourisme grandissant
modifient les trajectoires de vie des acteurs historiques, redéfinissent
de nouvelles frontières sociales et spatiales...
273 Marie-Claire ROBIC (dir), Du milieu à
l'environnement...op.cit, p. 239.
274 Idée similaire chez François WALTER, «
La montagne suisse. Invention et usage d'une représentation
paysagère (XVIIIe-XXe siècle) »,
Études rurales, n°121-124, 1991, p. 91-107, p. 93.
275 Ainsi, les villes de la Vallée de l'Arve comme
Cluses et Sallanches vont profiter de l'attrait de Chamonix en devenant des
points de relais pour les voyageurs avec tout le développement
économique qui s'ensuit (construction d'hôtel, ouverture de
commerces...). Voir Justinien RAYMOND, La Haute-Savoie sous la
IIIe République... op.cit, p. 77.
276 Entendue, rappelons-le, comme la pratique de
l'identité spatiale.
277 Augustin BERQUE, La mésologie...op. cit, p.
20.
87
A] Les petites patries et le tourisme
Le discours scolaire français sur les petites patries a
été très bien été analysé par les
travaux maintenant classiques de Jean-François Chanet et d'Anne-Marie
Thiesse278. Dans la doxa républicaine,
l'apprentissage du milieu local préfigure celui de la nation, il
répond autant à des raisons pratiques - partir du concret vers
l'abstrait, endiguer l'exode rural en attachant les élèves
à leur sol natal - qu'à des raisons idéologiques - l'amour
de la petite patrie préfigure l'amour de la grande, la nation est riche
de la diversité de ses terroirs279. En France, c'est donc
dans l'amour du milieu local - à l'échelle
départementale280- que la pédagogie
républicaine va concentrer ses efforts. Cela commence dès la
formation des aspirants à la carrière d'enseignant - surtout pour
les hommes. En effet, les écoles normales, présentes dans chaque
département, vont s'efforcer de familiariser les
élèves-maîtres avec leur environnement. En 1890, le
directeur de l'école normale de Bonneville recommande de « se
servir dans l'enseignement autant de fois que possible d'exemples locaux »
ce qui permet « d'augmenter l'intérêt et
l'efficacité des leçons », d'autant plus qu'au niveau
des « beautés naturelles [...] la Savoie est si riche
»281. Arguments similaires quelques années plus
tard, quand le nouveau directeur préconise la multiplication des
pratiques sportives « pour faire découvrir aux
élèves les coins pittoresques de leur pays qu'ils ignorent
»282. Ainsi, de nombreuses promenades sont
organisées tous les ans, parfois en marchant, parfois en courant, les
élèves-maîtres pratiquent même « l'alpinisme
bon marché »283 . Les lieux choisis pour les
excursions sont ceux rendus célèbres par l'activité
touristique. Comme l'énonce le directeur : « connaître Le
Mont-Blanc, Chamonix, autrement que par les livres me paraît faire partie
de l'éducation de l'instituteur de la Haute-Savoie
»284.
278 Jean-François CHANET, L'école
républicaine...op. cit et Anne-Marie THIESSE, Ils
apprenaient la France... op.cit.
279 Sur ce point, la géographie régionaliste de
Paul Vidal de la Blache ne semble pas sans importance. Voir Guillaume RIBEIRO
« Question régionale, identité nationale et émergence
du monde urbain-industriel. La modernité dans l'oeuvre de Paul Vidal de
la Blache », Annales de géographie, n° 699, 2014/5,
p. 1215-1238.
280 Voir Jean-François CHANET, « Le cadre
départemental », dans L'école
républicaine...op. cit, p. 39-68.
281 ADHS, 1 T 1235, Conseil d'administration de l'école
normale de Bonneville, Rapport sur la situation matérielle et morale, 11
Juillet 1890.
282 ADHS, 1 T 1236, Conseil d'administration de l'école
normale de Bonneville, Rapport sur la situation matérielle et morale, 26
Juin 1897.
283 ADHS, 1 T 1235, Conseil d'administration de l'école
normale de Bonneville, Rapport sur la situation matérielle et morale, 4
Juillet 1889.
284 ADHS, 1 T 1236, Conseil d'administration de l'école
normale de Bonneville, Rapport sur la situation matérielle et morale, 26
Juin 1897.
88
Nous voyons par ces quelques exemples, que l'apprentissage du
métier d'instituteur par l'excursion touche souvent au pittoresque, au
folklore. La formation des élèves-maitres apprend à
distinguer la nature d'une autre manière que celle de la plupart des
habitants ruraux des montagnes, et pour preuve, en 1897, « Sur trente
élèves, deux ou trois à peine, fils d'instituteurs [...]
connaissent les régions de la Haute-Savoie qui attirent annuellement de
si nombreux touristes »285. Seuls les fils d'instituteurs
ont eu l'opportunité de découvrir ces lieux à travers les
lunettes de l'apprenti naturaliste. La manière d'appréhender leur
milieu naturel se rapproche largement plus de la bourgeoisie voyageuse qui
sillonne ces lieux que des paysans et bergers286. Soyons pourtant
justes, comme l'ont montré les travaux de Jacques et Mona Ozouf, les
instituteurs sont bien souvent des habitants du « crû »,
beaucoup sont fils de cultivateurs287, c'est seulement lors de leur
formation qu'ils apprennent à « voir autrement
»288. Francine Muel-Dreyfus note que ces activités
liées à l'observation « orientent les activités
intellectuelles de l'instituteur vers la monographie locale, l'histoire
régionale, le recueil des « coutumes » paysannes et inspirent
ses goûts en matière littéraire et son attirance pour les
collections (herbiers, fossiles, cartes postales) »289 .
Elle poursuit en affirmant que ceux-ci sont des « consommateurs de
paysage »290 et constituent « l'avant-garde du
tourisme populaire »291 . Muel-Dreyfus va peut-être
trop loin, l'argumentation qui sous-tend l'article repose en somme sur
l'idée que l'instituteur est un agent de la ville qui impose des
pratiques et des représentations urbaines aux habitants des
campagnes292. Néanmoins, elle a le mérite de faire une
corrélation féconde entre les pratiques des touristes et les
pratiques des instituteurs, en liant leurs expériences dans la
manière d'appréhender la nature, le paysage. La présence
du milieu local dans la formation des maîtres se retrouve même au
travers des sujets d'examens, piochés dans
285 Ibidem.
286 Nous ne disons pas ici que l'esthétique est inconnue
des habitants locaux, seulement qu'elle sert de fondement à
l'appréciation du paysage bourgeois. Voir Alain ROGER, Court
traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997.
287 Jacques et Mona OZOUF, La République... op.cit,
p. 359.
288 Bernard DEBARBIEUX, Gilles RUDAZ, insistent sur le fait
que la social est un fait construit, ils parlent de « l'invention des
montagnes », Les faiseurs de montagne,op.cit, p. 8.
289 Francine MUEL-DREYFUS, « les instituteurs, les
paysans et l'ordre républicain », Actes de la recherche en
sciences sociales, n°17-18, 1977, p. 37-61, p. 46.
290 Ibidem, p. 47.
291 Ibid, p. 56.
292 Pourtant, Jacques OZOUF avait déjà
montré par ses questionnaires et son premier livre - certes
destiné au grand public plutôt qu'au milieu de la recherche -
Nous les maîtres d'école, Paris, Julliard, 1967, que les
instituteurs étaient souvent des enfants des régions où
ils exerçaient - Muel-Dreyfus se sert pourtant de ces questionnaires
comme sources.
89
des sujets qui touchent au « pays »293.
Tout les pousse « à porter sur les choses de la terre, un
regard d'apprenti folkloriste épris de pittoresque », une
« disposition de voyageur dont la curiosité est toujours en
éveil »294. Les travaux d'histoire locale dont ils
se font les principaux acteurs incorporent souvent un pittoresque
stéréotypé295 - l'institution les encourage
dans ce sens296. De nombreux autres exemples peuvent être
cités, notamment la collaboration étroite des instituteurs aux
sociétés savantes, souvent à l'occasion des concours
locaux, ou encore les voyages organisés pendant les vacances par les
écoles normales, qualifiées par Chanet de véritable
« tourisme scolaire »297. Ainsi donc,
l'apprentissage du métier d'instituteur comporte une dimension
croissante d'esthétisation de la nature, du milieu naturel, qui se
juxtapose très bien avec les pratiques touristiques,
particulièrement dans ce territoire alpin. Il faut cependant noter
qu'au-delà de la formation des maîtres, ces représentations
se retrouvent logiquement dans l'enseignement primaire.
Anne-Marie Thiesse, en étudiant les manuels à
usages locaux, a bien montré que l'enseignement républicain avait
poussé les élèves à des formes d'écritures
abondantes concernant les régions et la vie locale298 . Si
elle insiste sur le caractère patriotique de l'enseignement local - avec
pour objectif d'attacher les enfants à leur terre et de lutter contre
l'exode rural - elle voit tout de même l'espoir de
régénération des petites patries dans le
développement du tourisme d'entre-deux-guerres. Pour la Haute-Savoie,
région pionnière, c'est bien avant que la rhétorique de la
sauvegarde des petites patries par l'activité touristique prend place.
Un des seuls manuels d'histoire local d'avant-guerre destiné aux deux
départements savoisiens en rend bien compte. Celui-ci reprend les
ethnotypes classiques attribués aux montagnards « Vifs, lestes,
dégagés [...] constitution robuste, florissante
santé »299 en y ajoutant leur « esprit
d'initiative », nécessaire pour assurer « le
développement de leur pays par l'industrie hôtelière
»300. Difficile de savoir si ce manuel a connu une large
diffusion, notons tout de même qu'il a vocation à être
enseigné en classe et qu'un des auteurs est instituteur : ce
293 Jean-François CHANET, L'école
républicaine...op. cit, p. 121.
294 Ibidem, p. 199.
295 Ibid, p. 130. Du moins avant la Première
Guerre mondiale, les travaux deviendront plus rigoureux par la suite.
296 En 1905 les écoles normales laissent du temps aux
aspirant instituteurs lors de leur 3ème année pour rédiger
des travaux d'histoire locale, en 1911, la société des
études locales dans l'enseignement public est créé.
297 Ibid, p. 186.
298 Anne-Marie THIESSE, Ils apprenaient la France... op.cit,
p. 118.
299 F. CHRISTIN, F. VERMALE,
Abrégé...op.cit, p. 164.
300 Ibidem, p. 159.
90
qui témoigne de l'intérêt du corps
enseignant dans l'apprentissage du milieu local. Autre exemple, Monsieur
Perrin, directeur des cours complémentaires à l'école du
bourg de Chamonix - et enseignant « modèle »301 -
est inspecté le 19 Juin 1908. Dans son rapport, l'inspecteur note le
« soin donné à l'histoire de Savoie
»302. Quelques années plus tard, en 1912,
l'inspecteur relèvera que sa leçon d'histoire porte sur «
les origines de Chamonix et son histoire jusqu'au 13e
siècle »303. La formation intellectuelle des
instituteurs rejaillit sur les élèves qui apprennent, sur les
bancs de l'école, à porter un regard érudit et souvent
poétique sur le monde qui les entoure. Pour exemple, en 1907 est
organisée à Poisy, une « fête de l'arbre » par le
Touring club et les écoles communales. Quand Monsieur Guignier,
président de l'association des amis des arbres - et instituteur - prend
la parole, il célèbre « la fin du temps où les
agriculteurs avaient peur de l'avancée des forêts » et
« constate que l'époque n'est pas éloignée
où le cultivateur, relié à la terre par un lien un peu
différent de l'intérêt matériel immédiat
cessera de déserter cette terre, vers laquelle malgré tout, un
ancien ministre de l'agriculture a prédit le retour du paysan, de
l'homme du pays ! »304.
Cet événement est riche en indices sur
l'enseignement du milieu local à l'école. Tout d'abord, la
fête est organisée par le Touring club de France, association
bourgeoise créée en 1890 sur le modèle anglais, afin de
promouvoir le développement du tourisme - des livres étaient
d'ailleurs offerts gratuitement à l'école normale d'instituteur.
Leur engagement dans la vie locale et la protection de la nature, en
collaboration avec l'enseignement primaire, montre la convergence des vues des
deux institutions. Deuxièmement, il est fait mention de la peur des
paysans de l'avancée des forêts : effectivement, les brouilles
entre un monde paysan à qui l'on reproche de surexploiter la
forêt, et les gardes forestiers oeuvrant à sa conservation ont
été un grand sujet de tensions tout au long du XIXe
siècle305. Les paysans, et surtout les montagnards - en
raison du déboisement par l'activité pastorale - sont souvent
qualifiés d'ignorants ne connaissant pas la valeur des forêts. Le
fait que l'école primaire s'associe au Touring club, et indirectement
aux gardes forestiers, appuie à nouveau le lien entre
école/tourisme/pittoresque. Les sociétés alpines
françaises sont donc bien préparées par l'école
à la rencontre avec la
301 Il obtient deux médailles de bronze (1900-1904),
deux médailles d'argent, (1900-1916), devient officier d'académie
(1910) puis officier de l'instruction publique (1920).
302 ADHS, 1 T 793, Dossier individuel de l'instituteur
François-Narcisse Perrin, rapport d'inspection du 19 Juin 1908.
303 Ibidem, 21 Décembre 1912.
304 ADHS, PA 68.3, 4599, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°2, 1907, p. 95.
305 Bernard DEBARBIEUX, Gilles RUDAZ, Les faiseurs de
montagne, op.cit, p. 108.
91
bourgeoisie voyageuse. Sans dire que les deux visent les
mêmes fins, ni même qu'il y a une conscience aiguë ou des
stratégies de rapprochement, il faut néanmoins admettre qu'il
existe un référentiel commun de représentations et de
pratiques de la nature entre l'instituteur, le touriste et, dans certains cas,
l'élève. Si la petite patrie n'est qu'une miniature de la grande
dans l'idéologie républicaine, il semble qu'au sein des Alpes
françaises, l'enseignement du milieu local intègre aussi
l'international par le biais du tourisme : les frontières des communes
de montagnes s'étirent à l'extrême pour laisser entrer en
leur sein la fine fleur des sociétés européennes.
En Suisse, les choses sont différentes : la forme
fédérale de l'État n'incite pas à trouver un ciment
aussi fort que le discours sur les petites patries, entre les cantons et la
Confédération. L'indépendance politique des cantons -
partielle mais bien assise - rend infructueuse toute tentative de
démontrer que le grand contient le petit, que la
Confédération contient les cantons. Paradoxalement, c'est dans un
pays ou l'échelle locale a le plus d'importance politique qu'elle est le
moins enseignée. Dans le canton du Valais, peu de place est faite
à l'histoire locale, il n'y en a d'ailleurs quasiment aucune trace avant
le début du XXe siècle. Toutefois, en 1908, lors d'une
commission cantonale de l'instruction primaire, est évoquée
l'idée de rédiger un précis d'histoire du Valais à
destination des écoles306. La proposition ne fait pas
d'émules mais n'est pas rejetée non plus, pourtant rien ne se
fait. Il en est encore question quelques mois plus tard, puis quasiment chaque
année pour que, finalement, le précis d'histoire soit
rédigé en 1920 - soit 12 ans après sa première
évocation. Il y a donc peu d'empressement de la part du canton pour
enseigner l'histoire valaisanne dans ses écoles. L'institution scolaire
semble se désintéresser de la question. En France, l'école
laïque et ses instituteurs ont peu à peu remplacé les
curés dans leur rôle d'écriture de l'histoire
locale307, vidant ainsi le panthéon local des vieux saints
oubliés pour y mettre leur conception républicaine de l'histoire
des régions. À l'inverse, en Valais ce n'est pas le cas :
l'instituteur agit dans la dépendance du pouvoir ecclésiastique,
le monde rural mis en avant est moins à chercher dans la beauté
pittoresque de la nature que dans « les avantages du côté
religieux et moral »308 des campagnes. Néanmoins,
quelques traces indiquent qu'une rhétorique folkloriste se
déploie également en Valais. En 1910, un article de
L'école primaire recommande aux instituteurs de faire des
excursions, d'organiser des
306 AEV, 1 DIP 188, Commission cantonale de l'enseignement
primaire, 11 Février 1908.
307 Jacques et Mona OZOUF, La république...op.cit,
p. 383-424.
308 « Restez à la campagne », L'école
primaire, n°8, 15 Novembre 1915, p. 73-74.
92
promenades, de s'adonner à leur passion en mentionnant
l'étude de la géologie ou de la flore309. Un autre en
1915 mentionne les traditionnelles grandes promenades scolaires le dernier jour
de l'année310 qui « développent l'amour de la
nature » et « sont la meilleure leçon de choses
» car « c'est en voyant d'autres tableaux, d'autres sites,
d'autres aspects que se développe l'esprit d'observation, Si
nécessaire pour mieux apprécier l'oeuvre du Créateur
»311. L'article mentionne également la
présence du touriste étranger :« Ne vous est-il jamais
arrivé de rougir de honte quand, vous trouvant tout un groupe de
valaisans, il n'en est pas un qui puisse renseigner un étranger qui
passe et dont la légitime curiosité aimerait à
connaître les noms des détails de notre spectacle journalier ?
»312. On voit ici, à l'instar du cas
français, la différence de culture dans l'appréciation du
milieu local entre l'enfant du pays qui en a une vision pratique, quotidienne,
et l'étranger érudit qui a une connaissance livresque et
poétique. Enfin, dernier exemple, à nouveau dans
l'école primaire est publié en 1917 un texte
intitulé « aux promeneurs et aux touristes » mais qui
s'adresse en réalité aux instituteurs et aux enfants
organisateurs des « courses scolaires » 313. Il
est question de conseils pour préserver la flore alpine, d'éviter
toute pollution. C'est une des premières fois que les pratiques des
promeneurs, des touristes et des acteurs de l'institution scolaire sont
réunies dans la protection de la nature. N'oublions pas pourtant que les
articles précédents sont publiés dans un journal à
vocation pédagogique, qui vise un public enseignant : si l'école
n'est pas toujours le sujet central, il n'en reste pas moins que ces sujets
touchant aux excursions, promenades, paysages pittoresques sont perçus
comme susceptibles d'intéresser les instituteurs et institutrices
valaisans.
La culture du pittoresque, du folklore dans l'enseignement est
tout de même moins développée en Valais qu'en Haute-Savoie.
Les enseignants n'ont, dans leur formation, aucune excursion en montagne,
aucune activité développant leur goût des beautés
naturelles du pays. L'histoire locale est quasiment absente de l'enseignement,
les manuels également. Les liens entre tourisme et école,
même s'ils se développent à partir des années 1910 -
bien que plus tardivement qu'en France - ne prennent jamais la même
ampleur. Aucun rapprochement avec
309 E.A « L'art d'être heureux d'après mon
vieux maître », L'école primaire, n°8, 20
Janvier 1910, p. 25-26.
310 Patrick CABANEL (dir) écrit que la
découverte du pays par l'excursion est une tradition helvétique
qui remonte au XVIIIe siècle, Le tour de la
nation...op.cit, p. 602-606.
311 « A l'occasion des promenades scolaires »,
reproduction de « La Gazette du Valais », L'école
primaire, n°5, 15 Mai 1915, p. 6-7 (frontispice).
312 Ibidem.
313 « Aux promeneurs et aux touristes »,
L'école primaire, n°7, supplément, 15 Septembre
1917, p. 126-127.
93
le Touring club ou le Club alpin ; si le tourisme existe,
l'école s'en désintéresse, les frontières scolaires
sont plus marquées. A l'inverse, les pratiques touristiques investissent
parfois l'école française, au-delà même des simples
discours, c'est le cas des écoles des communes de montagne.
B] Un enseignement international
Comme énoncé dans le paragraphe
précédent, l'école alpine française est largement
plus imprégnée par le développement touristique que sa
voisine valaisanne. Cette différence traduit deux manières
distinctes de se représenter l'école, mais également de se
représenter la montagne. Si le phénomène touristique
existe pourtant dans l'ensemble des Alpes, c'est dans celles françaises
que l'enseignement - scolaire et para-scolaire - est affecté dans ses
pratiques. Le tourisme se développe surtout à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle. Certaines communes
alpines vont s'en trouver bouleversées dans leur modèle
économique, architectural et social, ce qui en définitive, va
nécessairement modifier leur territorialité, leur rapport aux
lieux, à la nature, au paysage.
Chamonix - qui deviendra Chamonix-Mont-Blanc en 1923 -
s'institue fleuron français du tourisme alpin. La croissance du nombre
de visiteurs est impressionnante : de 12 000 visiteurs annuels en 1864, la
commune passe à 24 000 en 1892314 puis à 80 000 en
1913315. Pour Jean-Robert Pitte, la croissance exponentielle du
phénomène touristique le fait changer de nature : s'il relevait
auparavant de la consommation de paysage, il en devient
modificateur316. En effet, les hôtels-palaces, accueillant des
visiteurs issus de l'aristocratie et de la bourgeoisie se multiplient au cours
de « La Belle Époque », modifiant profondément
l'architecture du bourg. Des aménagements multiples voient le jour : la
commune bénéficie d'une route carrossable en 1870 puis est
reliée par une ligne de chemin de fer à la vallée de
l'Arve dès 1901, plus tard, en 1908, c'est une ligne
transfrontalière qui verra le jour.
En apposant des boîtes de collectes au sein des
hôtels chamoniards, l'association du Sou des écoles profite de
l'afflux touristique pour remplir ses caisses. En Juin 1884, le directeur de
314 Bernard DEBARBIEUX, Chamonix-Mont-Blanc...op.cit, p.
21.
315 F. CHRISTIN, F. VERMALE, Abrégé...op.cit,
p. 159. Bernard DEBARBIEUX parle lui de 170 000 visiteurs annuels en 1907.
Chamonix-Mont-Blanc...op.cit, « conclusion ».
316 Jean-Robert PITTE, Histoire du paysage français,
Paris, Tallandier, 2020 [1983], p. 300.
94
l'association envoie une lettre au maire pour obtenir une
subvention en vue de la confection de nouvelles boîtes à placer
dans les hôtels avant l'été317. Le conseil
municipal accepte la requête et alloue 150 francs au Sou des
écoles quelques semaines plus tard318. Les indices sont
ténus, mais l'empressement du président de l'association à
réclamer la subvention pour placer les boîtes avant
l'été, et la relative promptitude avec laquelle la commune
l'octroie, laissent penser que les recettes liées à
l'activité touristique ne sont pas négligeables. Cet argent est
important pour la vie scolaire locale, l'association du Sou des écoles
permet entre autres d'organiser et de financer des excursions, de fournir le
matériel manquant aux élèves.
Chamonix s'enrichit par le tourisme et compte désormais
des écoles « riches »319. Cette situation
entraîne de nombreuses inégalités avec d'autres
écoles de montagne placées dans des lieux où le tourisme
ne s'est pas implanté de manière aussi forte - ou pas
implanté du tout320. Avec le tourisme, les frontières
scolaires s'imbriquent et s'étirent : l'école locale dispense un
enseignement national et dispose d'un financement international. L'école
isolée en hiver que nous avons décrite dans la première
partie de ce mémoire se trouve à l'inverse, au carrefour de
l'Europe voyageuse durant la saison d'été. Vont s'agréger
autour de l'école une multitude d'activités qui, tout en ne
relevant pas stricto sensu de l'enseignement primaire, lui sont
liées, par exemple en utilisant les locaux scolaires. C'est le cas des
conférences de langues qui s'organisent petit à petit dans la
commune, après les horaires de cours réglementaires durant la
saison d'hiver. L'afflux d'étrangers principalement anglais et allemands
apporte une variété linguistique inédite dans ces petites
communes de montagne. La part de la population dont les activités sont
liées au tourisme se doit d'en avoir une maîtrise
élémentaire : c'est particulièrement le cas pour les
guides de montagne. Ainsi, en 1889 François Cachat et Paul Payot
souhaitent tous deux obtenir l'autorisation de dispenser des cours d'anglais
dans l'école du hameau de Montquart : l'un dans l'école de filles
et l'autre dans l'école de garçons. L'inspecteur primaire en rend
compte dans une lettre à l'inspecteur d'académie le 20 Novembre -
transmise au préfet le lendemain - « le cours serait suivi par
un certain nombre de jeunes gens du hameau, qui se destinent à
être guides pendant l'été », il ajoute qu'il
« est incontestable
317 ADHS, 2 O 2175, Lettre du directeur de l'association du sou
des écoles au maire de Chamonix, 5 Juin 1884.
318 ADHS, 2 O 2175, Délibération du conseil
municipal, 3 Juillet 1884.
319 Le maire avait d'ailleurs rendu toutes les écoles
gratuites dès 1874 et s'est empressé de lancer la construction de
8 maisons/écoles de hameaux simultanée dès 1881. La
commune investit régulièrement dans de nouveaux poêles pour
les écoles et se fournit une quantité généreuse de
combustibles.
320 Sur l'attractivité renouvelée par le
tourisme de petites bourgades, un parallèle est ici repérable
avec la situation de Célestin Freinet lorsqu'il enseigne à
Saint-Paul de Vence. Voir Emmanuel SAINT-FUSCIEN, Célestin Freinet.
Un pédagogue en guerre, 1914-1945, Paris, Perrin, 2017.
95
que des cours d'anglais seront très utiles aux
jeunes gens dont il s'agit »321. Cette lettre nous apprend
que l'enseignement de l'anglais pénètre jusqu'aux hameaux les
plus reculés de Chamonix, et ne se limite pas au bourg où est
concentrée l'activité touristique. Ces cours sont
également très attractifs pour les jeunes gens des hameaux :
Cachat et Payot se proposent tous deux d'en organiser. Finalement, le
préfet, sur avis de l'inspecteur, conclut que la tenue d'un seul cours
est suffisante pour un hameau de taille modeste. Priorité est
donnée à François Payot le 21 Janvier. Il dispensera son
enseignement d'anglais aux jeunes entre 15 et 18 ans jusqu'en 1892 -
époque où il se fait engager en tant que valet de pied à
Epernay. Concernant les autres hameaux, les archives sont muettes, mais il est
fort probable que des cours similaires y prennent place. Ceux-ci s'installent
systématiquement dans les locaux de l'école, ainsi
détournés de leur usage habituel.
L'activité de guide qui justifie ces pratiques
institue, pour les jeunes de la commune, une activité d'apprentissage
post et para-scolaire qui prolonge l'enseignement primaire. Elle crée
une situation paradoxale où, d'une position géographiquement
isolée avec des perspectives de mobilité limitées, des
adolescents des hameaux chamoniards ont accès à l'apprentissage
d'une langue étrangère, normalement réservée
à une petite élite d'accédants à l'école
primaire supérieure. D'ailleurs, les cours d'anglais sont parfois
financés directement par les touristes étrangers. C'est le cas en
1892, lorsque Monsieur Cairraz, habitant à Chamonix, souhaite organiser
un cours d'anglais dans les écoles du bourg à destination des
fils de guides322 : il signale au préfet son intention, tout
en précisant que la société de guides a reçu une
contribution élevée à 190 francs de la part de Monsieur
Suarez - citoyen anglais - pour la tenue de ce cours323. Il n'est
pas fait mention de l'appartenance ou non de ce dernier à un quelconque
club oeuvrant pour le développement du tourisme. Reste que de telles
initiatives sont souvent prises par des membres du Club alpin anglais,
très influent dans les Alpes françaises324. Plus
tardivement mais suivant le même procédé, s'organisent des
cours de langue allemande. Le 31 Octobre 1908, l'inspecteur primaire informe
l'inspecteur d'académie - à nouveau transmis au préfet par
la suite - qu'un cours « public et gratuit » de langue
allemande a débuté dans la commune depuis le 15 du mois. Il se
déroule tous les soirs de 5 à 6 heures - sauf le jeudi et le
dimanche - et est suivi par 30 personnes des deux sexes, alternant jeunes
filles et jeunes garçons. L'inspecteur
321 ADHS, 1 T 418, Lettre n°6229 de l'inspecteur primaire
à l'inspecteur d'académie, 20 Novembre 1889.
322 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 22 Février 1892.
323 ADHS, 1 T 418, Lettre de Monsieur Cairraz au préfet,
16 Février 1892.
324 François WALTER, Les figures
paysagères...op.cit, p. 270-274.
96
explique qu'en raison du manque de locaux, le cours prend
place dans le groupe scolaire du bourg, précisant qu'il n'y voit aucun
inconvénient car il répond « à une
nécessité locale »325. Ici encore, les
jeunes gens qui habitent la commune peuvent profiter gratuitement
d'enseignements auxquels ils n'auraient pu avoir accès sans
l'activité touristique en développement. Bien que ceux-ci ne
soient pas directement liés à l'instruction publique, les liens
avec l'institution scolaire sont grands. Tout d'abord, notons que dans les deux
exemples, c'est bien l'inspecteur primaire qui transmet la demande de la
commune pour utiliser les locaux de l'école à l'inspecteur
d'académie - puis ce dernier au préfet. Le premier donne son
avis, approuve ou émet des réserves à l'égard des
requêtes. Pour être validées, les demandes doivent avoir une
valeur aux yeux des autorités supérieures de l'instruction
publique, être conformes à l'idée qu'elles se font de
l'éducation populaire, apporter une plus-value certaine. Ensuite, ces
initiatives - certaines financées par la commune - touchent le monde
scolaire par son public : les jeunes gens sont les mêmes qui ont
été - ou qui vont encore en hiver - dans les écoles
communales. D'ailleurs, dans sa lettre du 30 Octobre, l'inspecteur primaire
signale que le directeur et la directrice des cours complémentaires
suivent avec assiduité l'enseignement d'allemand, il signale aussi que
Monsieur Schütt « serait honoré de recevoir [sa]
visite » et envisage « d'assister prochainement à
l'une de ses leçons » 326 . Il existe alors une vraie
coopération entre les institutions scolaires classiques et les
initiatives d'enseignements liées au tourisme, signe à nouveau de
la capacité de l'autorité centrale à s'adapter aux
réalités locales.
Les frontières qui ont trait à l'école
alpine se trouvent une nouvelle fois bousculées. Territoires
isolés ou territoires intégrés à une
activité internationale, tout dépend de la saison. Le territoire
aux marges de la nation tire une valeur renouvelée de sa situation
géographique. Une nouvelle frontière prend forme ici, celle entre
l'éducation primaire et les enseignements - principalement linguistiques
- qui la complètent ou la poursuivent. La première intègre
les communes de montagne à l'espace national, la seconde les
élargit à un espace plus vaste. L'alliage des deux influe sur les
possibilités d'emplois et nécessairement sur les trajectoires de
vie des acteurs historiques, jouant sur leur identité spatiale, leur
rapport au milieu de montagne.
325 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 31 Octobre 1908.
326 Ibidem.
97
C] Nouveaux horizons d'emplois, Guides ou
hôteliers
Éloignons-nous un temps de l'école primaire afin
de suivre les pérégrinations de la jeunesse hors des pupitres
scolaires. Nous avons vu que les enfants des Alpes - au moins français -
étaient préparés par un enseignement qui, tant par le
discours que par les pratiques, tendait à très bien s'accorder
avec l'activité touristique. Plus encore, certaines des missions - ou
des objectifs - que se fixe l'école du peuple sont secondés par
l'économie du voyage qui infuse les communes de montagne.
Tout d'abord, la menace de l'exode rural, la peur du
dépeuplement des campagnes - présente tant en France qu'en Suisse
- se traduit à nouveau dans l'enseignement primaire par la
pédagogie des petites patries, la volonté d'attacher les enfants
à leur sol natal. Anne-Marie Thiesse a raison de considérer que
c'est le tourisme qui peut sauver les petites patries327, car, en
effet, dans les lieux où l'attractivité locale croît, les
enfants devenus adultes sont encouragés à rester. De fait, les
communes qui connaissent une activité touristique perdent très
peu de population, elles en gagnent même parfois. Maurice Agulhon, estime
un seuil migratoire négatif d'environ 10 à 15 % pour le
département de la Haute-Savoie328, ce qui place le territoire
dans la fourchette relativement basse de l'exode rural sur la période
1881-1914. Bien sûr, les différences internes sont énormes
: comme nous l'avons mentionné, le schéma traditionnel s'inverse
et les territoires de montagne deviennent plus attractifs que les plaines. En
1913, la création d'une deuxième classe de garçons est
décidée dans la commune de Saint-Gervais, car la population a
augmenté de 309 personnes depuis 1906 - pour une population de 2084
personnes. L'inspecteur d'académie relaie les arguments du Conseil
municipal en arguant que la population « ne fera que s'accroître
d'année en année en raison du développement de la station
thermale »329. Les espaces à forte activité
touristique tendent donc à augmenter leur capacité d'accueil,
tout est fait pour y attirer le plus de monde possible, pour accroître la
renommée de ces lieux. Chamonix l'a bien compris, dès 1896, le
conseil municipal décide de subventionner la Revue du Mont-Blanc
- créée la même année et éditée
à Thonon - de manière
327 Anne-Marie THIESSE, Ils apprenaient...op.cit,
Chapitre 6 : « Le tourisme sauveur de la France », p. 95-102.
328 Maurice AGULHON, « La grande dépression de
l'agriculture » dans George DUBUY (dir), Histoire de la France
rurale...op.cit, p. 359-382, p. 371.
329 ADHS, 1 T 51, « Affaires générales par
commune », Saint-Gervais, rapport de l'inspecteur d'académie au
préfet concernant la création d'écoles, 1913.
98
à donner plus de visibilité à la
station330. L'année suivante, la commune voit les choses en
grand, elle ne se limite plus aux revues d'intérêt local :
Monsieur Marin, rédacteur de La vie mondaine de
Nice331 propose, moyennant 300 francs, de faire paraître
une annonce permanente dans son journal ainsi que de publier quelques articles
sur la ville pendant l'hiver. Le conseil municipal accepte car «
Chamonix malgré son renom ne doit rien négliger de son
côté pour attirer l'attention des visiteurs étrangers
»332 . Le Valais possède aussi son journal
touristique Le journal des stations du Valais qui promeut les lieux de
tourisme alpestre du canton, ceux-ci passant pour les plus beaux de Suisse.
Et justement, les visiteurs étrangers affluent,
plusieurs dizaines de milliers à Chamonix dans ses «
hôtels-palaces »333, mais également en Valais
- de 58 137 lits d'hôtels disponibles en 1880 à 124 068 en
1905334. Le phénomène existe aussi dans les lieux
où l'afflux est plus modeste : au Grand-Bornand, l'instituteur Cochet
indique à propos des voyageurs que « c'est à grand'
peine quelquefois que les 3 hôtels du village peuvent les contenir
»335 . L'activité hôtelière prend son
essor. Pour exemple, plus de 900 hôtels sont construits en 30 ans dans le
canton suisse336. Bernard Debarbieux relativise néanmoins
cette croissance brutale en estimant qu'en 1892, sur 728 actifs chamoniards,
seuls 22 déclaraient travailler en hôtellerie et 21 dans le
commerce et la banque337. Ne nous laissons pas tromper par ces
chiffres : tout d'abord la forte expansion touristique n'a pas encore eu
lieu338, de plus, l'activité hôtelière ne dure
que trois mois par an, et les habitants ne la déclarent pas toujours
comme leur profession principale339 . Il est évident que les
jeunes gens qui résident dans ces lieux y trouvent une ressource
d'emplois considérable. Les compétences acquises en langue pour
les enfants français ayant suivi les cours/conférences et le
modèle d'appréhension de la nature enseigné par
l'école
330 ADHS, 2 O 2174, Délibération du conseil
municipal de Chamonix, 17 Février 1896.
331 Qui deviendra plus tard « L'hiver au soleil ».
332 ADHS, 2 O 2174, Délibération du conseil
municipal de Chamonix, 19 Août 1897.
333 F. CHRISTIN, F. VERMALE, Abrégé...op.cit,
p. 159.
334 Adrien CLAVIEN, « Valais, identité nationale
et « industrie des étrangers », 1900-1914 », dans
Gérald ARLETTAZ, Jean-Henry PAPILLOUD, Myriam EVEQUOZ-DAYEN, Maria-Pia
TSCHOPP, (dir), Le Valais et les étrangers...op.cit, p.
247-267, p. 255.
335 ADHS, 1 T 236, Monographie du Grand-Bornand
rédigée par l'instituteur Cochet, 1888-1892, p. 3.
336 Adrien CLAVIEN, « Valais, identité nationale
et « industrie des étrangers », 1900-1914 », dans
Gérald ARLETTAZ, Jean-Henry PAPILLOUD, Myriam EVEQUOZ-DAYEN, Maria-Pia
TSCHOPP, (dir), Le Valais et les étrangers...op.cit, p.
247-267, p. 255.
337 Bernard DEBARBIEUX, Chamonix-Mont-Blanc...op.cit, p.
53.
338 Rappelons ces chiffres : 24 000 visiteurs en 1892 et plus de
80 000 en 1913.
339 Bernard DEBARBIEUX donne la même explication pour les
guides, Ibidem, p. 19.
99
doivent être d'une grande ressource pour se faire
employer. Au-delà des hôtels, notons qu'en 1901, c'est
précisément parce que Mademoiselle Coutter maîtrise
plusieurs langues qu'elle est employée au bureau de poste
d'Argentières340 : compétence utile pour
réceptionner lettres et télégraphes étrangers.
Néanmoins, l'activité qui offre le plus d'emplois aux populations
locales est celle de guide de montagne : la compagnie des guides de Chamonix
compte entre 270 et 340 membres sur la période 1860-1890 341 - avant sa
dissolution en 1892. Ici comme pour l'hôtellerie, l'estimation est
difficile à faire puisqu'il s'agit d'un emploi saisonnier qui ne
constitue pas toujours l'activité principale des chamoniards. Reste que
le phénomène est important et comporte par ailleurs une forte
dimension genrée. Pour en rendre compte, les observations de
l'instituteur Louis Mauroz consignées en 1888 dans sa monographie
dressent un tableau sans nuances : « ce sont les femmes qui
travaillent la terre, les hommes eux, sont tous guides ou porteurs, conduisent
les étrangers dans les montagnes ; c'est la principale ressource des
habitants »342 . Si l'instituteur amplifie sûrement
la réalité du phénomène, accompagner les voyageurs
dans des excursions pittoresques constitue une part non négligeable de
revenus pour les habitants locaux : il vaut mieux avoir suivi attentivement les
cours d'anglais et d'allemand dispensés dans les écoles si l'on
souhaite tirer son épingle du jeu.
Au sein même de la commune, les situations ne sont
pourtant pas toutes égales. Une frontière interne sépare
le bourg où est concentrée la grande part de l'activité
touristique343 et les hameaux qui en sont presque dépourvus.
Même si les conditions météorologiques sont plus
clémentes qu'en hiver - permettant ainsi les circulations de populations
- plusieurs kilomètres séparent ces lieux. L'inspecteur primaire
note d'ailleurs dès 1898 que les hameaux ont tendance à se
dépeupler au profit du chef -lieu344 . Indice ténu
à prendre avec précaution, mais en observant les registres
matricules des élèves de l'école du hameau de Montquart,
on remarque que les premiers élèves qui font mention d'être
fils ou filles de guides apparaissent en 1913, soit assez tardivement en
comparaison de l'accroissement rapide de l'activité
touristique345. Cette dernière aurait-elle vraiment
réussi à endiguer l'exode rural ? L'ennemi à combattre est
toujours désigné par le monde urbain, nous savons pourtant que la
réalité de l'exode relève
340 ADHS, 2 O 2174, Personnel communal, Mademoiselle Coutter, 30
Juillet 1901.
341 Bernard DEBARBIEUX, Chamonix-Mont-Blanc...op.cit, p.
19.
342 ADHS, 1 T 236, Monographie de la commune de Chamonix par
l'instituteur Mauroz, 1888.
343 Bernard DEBARBIEUX, Chamonix-Mont-Blanc...op.cit, p.
27.
344 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 1898.
345 ADHS, 1 T 1606, « Registres matricules des
élèves admis à l'école. 1867-1938 »,
école primaire publique des Bossons, hameau de Montquart, 1913.
100
souvent d'un déplacement des populations villageoises
vers les bourgs moyens plutôt qu'une fuite vers la grande ville.
Nuançons tout de même ; par rapport aux inégalités
mentionnées dans le bâti scolaire ou dans l'isolement hivernal,
les hameaux peuvent capter certains bénéfices liés au
tourisme. Certes, il est moins question d'hôtellerie, mais nous avons vu
que certains cours en anglais destinés aux jeunes gens prenaient place
dans les hameaux, étant entendu que ceux-ci pouvaient espérer
accéder à l'activité de guide. De plus, si le point de
départ des excursions se situe dans le chef-lieu, elles empruntent
nécessairement des itinéraires qui passent par les hameaux pour
rejoindre la haute-montagne. Dès 1860, des pavillons touristiques
destinés à l'accueil et la restauration des voyageurs sont
construits par la commune de Chamonix sur les chemins de passage. Ils sont
ensuite donnés en location à des habitants locaux346.
Si l'on a bonne mémoire, l'institutrice Lina Balmat qui a subi les
foudres des pères de familles du hameau des Pellerins en 1905,
était jalousée - selon l'inspecteur primaire - en raison de ce
que son père « aurait fait d'assez beaux
bénéfices en tenant le chalet de la Pierre pointue et celui des
Grands Mulets »347. Les pavillons touristiques sont donc
un moyen pour les habitants des hameaux de récolter les fruits de
l'économie du voyage.
Comme mentionné plus haut, ces activités sont
essentiellement masculines. « Jeunes gens » peut presque être
remplacé par « jeunes garçons » car - à
l'exception de certains emplois commerciaux - les jeunes filles sont quasiment
exclues des nouvelles activités liées au tourisme. Louis Mauroz
écrit que les femmes sont reléguées aux champs, les guides
sont toujours des hommes : ce qu'indiquait implicitement Monsieur Cairraz en
notant que ses conférences étaient pensées pour les fils -
et non pas filles - de guides. Les connivences entre culture scolaire et
culture touristique ont semble-t-il plus profité aux garçons -
à l'exception notable des cours d'allemand où les deux sexes
étaient présents en proportions égales. Rappelons à
nouveau que l'école valaisanne n'a pas la même approche : elle se
désintéresse du tourisme, regarde le phénomène avec
curiosité et méfiance bien qu'il soit devenu nécessaire
aux populations alpines. Malgré ces inégalités de genre,
le tourisme et les opportunités qui en découlent profitent
largement et de manière presque inopinée à des territoires
qui, quelques décennies plus tôt, étaient
considérés comme isolés et dangereux348 . Il y
a donc bien des changements dans
346 Bernard DEBARBIEUX, Chamonix-Mont-Blanc...op.cit, p.
39-46.
347 ADHS, 1 T 486, Dossier individuel de l'institutrice Lina
Balmat, lettre de l'inspecteur primaire à l'inspecteur
d'académie, 19 Aott 1905.
348 Jean MIEGE, « La vie touristique en Savoie »,
Revue de Géographie Alpine, n°21, 1933, p. 749-817.
101
l'identité spatiale des montagnards : les
représentations des Alpes changent, influent sur les trajectoires de vie
des acteurs historiques dont il sera question dans le chapitre suivant.
102
103
CHAPITRE 7. Le maître, la maîtresse et
l'enfant.
Les enseignants et les élèves ont
été mentionnés sans retenir une attention
spécifique jusqu'ici. Il est maintenant temps de se pencher de plus
près sur ces acteurs de l'enseignement primaire qui constituent le coeur
de l'école communale. Concernant les instituteurs français,
l'historiographie est foisonnante : elle est plus avare du côté
valaisan. Néanmoins, il est utile de s'intéresser au rôle
social dont ceux-ci sont investis dans les sociétés
françaises et suisses de la « Belle Époque »,
pour comprendre la manière dont l'environnement alpin s'inscrit
dans leurs représentations et se traduit dans leurs pratiques. Il faut
aussi analyser les capacités d'actions et les stratégies qu'ils
sont en capacité d'user dans les processus de négociations avec
les autorités - par exemple pour être éloignés des
postes les plus pénibles. Le genre prend dans ce chapitre une part plus
importante. Du côté des élèves, il faut ici aussi
les appréhender dans le milieu montagnard qui, tout en leur offrant des
possibilités d'emplois réelles, limite les opportunités de
poursuivre des études. Encore une fois, l'accent est mis sur
l'organisation locale de l'enseignement scolaire national, montrant les limites
- réelles ou imaginées - de la situation d'isolement de ces
communes et les inégalités spatiales qui en découlent,
ouvrant ainsi de nouvelles frontières géographiques et sociales.
Enfin, nous étudions la place des enfants étrangers dans des
territoires où la juxtaposition frontalière avec l'Italie
entraîne une immigration croissante : comment les écoles
valaisannes et haut-savoyardes réagissent-ils à la
présence de ces enfants étrangers sur les pupitres scolaires ?
Ici encore, la frontière nationale prend toute son importance.
A] Instituteurs haut-savoyards, instituteurs
valaisans
Les conditions matérielles des instituteurs
hauts-savoyards et valaisans divergent sensiblement sur la période. Les
premiers, malgré des conditions d'existence précaires qui les
mettent en difficulté pour assurer la fonction sociale qu'ils endossent,
sont tout de même mieux pourvus que les seconds. Leur traitement augmente
régulièrement au cours de « La Belle
104
Époque » 349, bien que la plupart
reconnaissent qu'ils ne peuvent se permettre que peu - ou pas - de loisirs, ils
parviennent tout de même à vivre décemment. Ils gagnent mal
leur vie pour le statut de notable local qu'ils incarnent - souvent moins que
les ouvriers - mais la gagnent toutefois mieux que les paysans350.
Pour commencer, le logement fourni par les mairies est souvent médiocre
mais a le mérite d'exister, il les dispense de pourvoir à une
location qui excéderait d'ailleurs leur bourse. Ensuite, la
possibilité de briguer le secrétariat de mairie assure un surplus
non négligeable à ceux qui peuvent y accéder. Certes,
cette fonction fait partie des avantages en nature que fournissent les mairies,
à côté du bois ou de la qualité du logement,
créant ainsi certaines inégalités entre les postes.
L'instituteur français est dans des conditions plus favorables que son
voisin d'outre-alpes.
Effectivement, les instituteurs valaisans jouissent d'une
situation encore plus précaire. Leur traitement connaît quelques
rehaussements sur la période351 mais reste néanmoins
très bas. En consultant les listes du personnel enseignant du canton,
nous avons constaté qu'il n'était d'ailleurs pas égal
selon le sexe, la langue d'enseignement et le lieu - les femmes sont moins bien
rétribuées que les hommes et les instituteurs de langue allemande
que ceux de langue française - sachant que les avantages en nature
fournis par les communes sont déduits du traitement de base
légal352.
D'ailleurs, les avantages en fonction des communes sont bien
plus creusés qu'en France : elles ne sont pas tenues de procurer un
logement aux enseignants, si bien que la plupart doivent trouver à leurs
frais un endroit où loger. Une requête de la Société
valaisanne d'éducation publiée en 1917 dans le supplément
de L'école primaire fait état de cette situation
miséreuse : « pour ce travail si noble, si ardu, et si ingrat,
l'instituteur reçoit le salaire accordé aujourd'hui à une
jeune fille de 16-17 ans qui ébourgeonne nos vignes »,
« comment ne pas souffrir dans notre amour propre valaisan en
constatant, combien meilleur, combien tout autre est l'enseigne à
laquelle sont logés les instituteurs dans les autres cantons ? »
353. Le problème du logement y est abordé, les
instituteurs doivent « se contenter de l'unique ressource qui vient du
travail scolaire pour se procurer une dispendieuse pension ou se le faire
eux-mêmes en achetant tout,
349 Avec par exemple, le système d'avance à
l'ancienneté mis en place en 1902 ou l'augmentation significative de
1905.
350 Jacques et Mona OZOUF, La République des
instituteurs, op.cit, p. 389.
351 Comme en 1887, 1901, 1904, 1910, 1914.
352 AEV, 1 DIP 21, Personnel enseignants (1889-1900).
353 « Requête de la Société
valaisanne d'éducation », L'école primaire,
supplément extraordinaire, 15 Décembre 1917, p. 1-8.
105
pour se procurer des habits qui seront plus coûteux
etc. »354. Beaucoup d'instituteurs désertent donc
la carrière car « les instituteurs valaisans, ne touchant qu'un
traitement fort minime, ne vieillissent guère dans l'enseignement : se
présente-t-il quelque part une place plus lucrative, soit dans une
compagnie de chemins de fer, soit dans l'administration postale,
télégraphique ou autre, ils s'empressent de la saisir par les
cheveux »355. Le département de
l'instruction publique essaie bien de parer à cette hémorragie,
d'abord par une prime d'encouragement en 1887 - en contrepartie d'un engagement
pour cinq années - puis par une obligation d'enseigner pendant quatre
années en 1907356.
Néanmoins, s'ajoute au salaire précaire le fait
que les périodes de vacances ne sont pas
rémunérées, instituteurs et institutrices sont donc
obligés de trouver une autre activité pendant l'été
: ils exercent souvent comme commerçants, aubergistes, comptables,
arpenteurs, charpentiers ou même sommelier357. Un tel
état de fait est impensable en France. Les grandes
responsabilités morales que la République confère aux
instituteurs oblige à prohiber certains comportements, jugé
dégradant pour l'image de l'école républicaine - tenir une
auberge pendant l'été en fait partie - si bien qu'ils n'ont pas
le droit d'exercer une autre profession que celle d'enseignant. Si
l'instituteur valaisan est moins bien considéré par le pouvoir
que son homologue français, les efforts fournis par le canton dans
l'amélioration scolaire tendent néanmoins à lui
conférer, petit à petit, un rôle similaire - surtout
à partir des années 1910. Un article de L'école
primaire publié en 1913 insiste sur la bonne conduite du
régent : celui-ci doit étendre son autorité morale
au-delà de l'école, il « prolonge ainsi l'action
intellectuelle et morale de ses leçons ; il encourage les pères
et les mères à s'intéresser au travail et à la
conduite de leurs enfants ». Toutefois, il doit également
éviter « une intimité trop familière »
et adopter « une réserve de bonne aloi » car
« l'instituteur demeure l'instituteur public même en dehors de
sa classe »358. Le rôle civique que prend
l'instituteur valaisan est transposable presque mot pour mot aux discours
républicains qui ont cours depuis une trentaine d'années.
Toutefois, les moyens alloués à l'éducation ne sont pas
les mêmes, les pouvoirs communaux et ecclésiastiques contraignent
toujours les enseignants. N'oublions pas qu'ils sont encore
présentés en 1910
354 Ibidem.
355 « Placement des instituteurs dans le Valais »,
L'école primaire, n°3, 15 Décembre 1891, p. 38.
356 Danièle PERISSET-BAGNOUD, Vocation :
régent, institutrice, op.cit, p. 183.
357 « Nos maîtres », L'école primaire,
n°1, 1er Janvier 1904, p. 3.
358 « Les relations sociales de l'instituteur »,
L'école primaire, n°6, 1913, p. 85.
106
comme « les auxiliaires des autorités
ecclésiastiques et civiles dans la formation de l'homme, du
chrétien et du citoyen »359.
Les instituteurs des Alpes n'ont donc pas le même statut
ni les mêmes possibilités d'action qu'ils soient haut-savoyards ou
valaisans. Pour les premiers, le fait que le régime républicain
leur ait conféré un statut légal et social particulier
leur donne un pouvoir d'action plus large que celui des seconds. En effet, les
instituteurs français dépendent directement de l'administration
de l'instruction publique. Bien que celle-ci soit très
hiérarchisée, elle a pour mérite - au moins depuis la loi
de 1889 sur le statut de fonctionnaire - d'émanciper le corps enseignant
de la double tutelle du maire et du curé. Les enseignants rendent des
comptes aux inspecteurs et aux préfets, et non au pouvoir communal et
ecclésiastique. Certes, les frontières entre pouvoir local et
pouvoir national sont plus poreuses qu'on veut bien l'admettre,
Jean-François Chanet remarque très justement que «
Tiraillé entre les pouvoirs nationaux et locaux, l'instituteur n'est
protégé ni administrativement ni financièrement contre les
risques du militantisme, les pièges des politicailleries locales. Pour
peu qu'il ait [...] imprudemment fait campagne pour un maire battu, il
est menacé de perdre le secrétariat de la mairie
»360 . D'ailleurs, les mutations ou rapports d'incidents
sont souvent signalés par les maires, parfois aussi par les parents
d'élèves. C'est le cas en 1887 lorsque l'instituteur Peccoux, en
exercice à Chamonix, est dénoncé par une lettre de la
mairie puis révoqué par le conseil départemental de
l'instruction primaire pour ses « habitudes d'ivrognerie ».
L'instituteur a pourtant déjà été
déplacé 13 fois mais « Il a continué, pour se
livrer à la boisson, à ne faire la classe que d'une façon
tout à fait irrégulière »361. Deux
ans plus tard, L'instituteur Cottin est dénoncé par les parents
d'élèves de Chamonix, puis se fait réprimander pour
« moralité douteuse » par ledit conseil, avec
inscription au bulletin départemental : humiliation publique car le
bulletin est accessible à tous les membres de l'instruction
publique362. En bref, instituteurs et institutrices français
ne sont pas immunisés
359 « La rentrée des classes »,
L'école primaire, n°10, Novembre 1910, p. 147.
360 Jean-François CHANET, « Les instituteurs entre
État-pédagogue et État-patron, des lois
républicaines aux lendemains de la Grande Guerre » dans
Marc-Olivier BARUCH, Vincent DUCLERT (dir), Serviteurs de
l'État...op.cit, p. 351-363.
361 ADHS, 1 T 1274, Réunion du conseil
départemental de l'instruction primaire de la Haute-Savoie, 24 Mars
1887.
362 ADHS, 1 T 1274, Réunion du conseil
départemental de l'instruction primaire de la Haute-Savoie, 1 Juin
1889.
107
contre les dénonciations, et les autorités
scolaires sont très vigilantes au moindre écart dans le
comportement moralement contraignant qu'ils doivent adopter363.
Pourtant, la dépendance au pouvoir hiérarchique
de l'instruction publique constitue également un avantage : tout en
favorisant leur surveillance, elle leur permet également de trouver un
juge extérieur au village, un lieu où leur parole peut être
entendue. Les enseignants peuvent eux-mêmes dénoncer des
situations abusives et démentir des faits qui leur sont reprochés
: à ces occasions, les inspecteurs primaires se déplacent dans
les communes pour faire un véritable travail d'enquêteur et
démêler le vrai du faux. Ils peuvent ainsi, même dans une
situation non conflictuelle, demander leur mutation - à condition de la
motiver par une bonne argumentation. Instituteurs et institutrices ne subissent
pas passivement la domination de la hiérarchie scolaire, ils sont
capables de déployer des stratégies, se dégageant ainsi
une marge d'action allant dans le sens de leurs
intérêts364 . Ils ont également, grâce aux
amicales dont beaucoup font partie365 - puis surtout au début
du XXe siècle, grâce aux syndicats enseignants - un
pouvoir et un sentiment d'appartenance corporatif qu'une partie mobilise au
profit des intérêts de la profession366.
Les enseignants valaisans eux, ne disposent d'aucun syndicat.
La Société valaisanne d'éducation leur donne l'occasion de
se retrouver une fois par an ; néanmoins, elle est dirigée par un
chanoine acquis au département de l'instruction publique : la
contestation n'est pas possible, en tout cas, pas publiquement. D'ailleurs, les
affaires concernant les instituteurs, que ce soient des plaintes de leur part
ou des plaintes contre eux, ne remontent jamais jusqu'au département de
l'instruction publique valaisan : elles sont sûrement résolues au
niveau communal et ne laissent aucune trace archivistique. Cette position
contrainte des enseignants valaisans empêche l'historien d'avoir
accès à des documents donnant des indices sur les
représentations qu'ils se font de leurs conditions d'enseignement. C'est
pourquoi, le sous-chapitre suivant se basera exclusivement sur des sources
haut-savoyardes. Toutefois, les
363 Jacques et Mona OZOUF, notaient la position inconfortable
des instituteurs : entre semi-notable méprisés par les bourgeois
et les paysans, devoir de réserve dû à leur statut et
difficultés à se mêler à la vie villageoise, La
République des instituteurs, op.cit, p. 383-391.
364 L'on peut trouver des parallèles avec les analyses
de Lüdkte à propos des ouvriers allemands des années 1930 :
ceux-ci, sans entrer en opposition frontale avec les ordres, jouent sur les
marges pour se dégager des moments « à eux ». Voir
« La domination au quotidien « sens de soi » et
individualité des travailleurs en Allemagne avant et après 1933
», Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°13,
1991, p. 68-78.
365 Antoine PROST, Histoire de l'enseignement..., op.cit,
p. 388.
366 Sur cette question, voir l'ouvrage détaillé
de Jacques GIRAULT, Instituteurs, professeurs, une culture syndicale dans
la société française (fin. XIXe-XXe
siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 1996.
108
conditions matérielles et géographiques
similaires - voire souvent pires - laissent à penser que la
généralisation au cas valaisan jouit d'une certaine
efficacité heuristique.
B] Enseigner dans les Alpes
Bien souvent, les postes les plus isolés sont aussi les
plus mal-considérés par les enseignants et les pouvoirs
scolaires. Chaque année, le préfet envoie les listes de
déplacement du personnel enseignant à l'inspecteur
d'académie, ce dernier explique parfois les motifs de ses choix. En
1885, il est décidé que Monsieur Déssouassoux remplacera
Mademoiselle Vigroux dans l'école de montagne de Caconaz, hameau de la
commune des Houches ; Le préfet annote ainsi la marge : «
instituteur incapable : ne peut être placé qu'à la
tête d'une école de hameau »367. Quelques
années plus tard, en 1907, en raison du manque de personnel sur la
commune de Saint-Gervais, le conseil municipal demande à l'inspecteur
d'académie « que les écoles de montagne soient
dirigées par des instituteurs débutants
»368. Les écoles de hameaux sont
marginalisées par l'administration, ce sont déjà les moins
bien pourvues en termes de bâti et de matériel, elles se
retrouvent en plus avec les instituteurs les moins compétents. Cela
montre bien l'intérêt d'étudier l'école dans son
espace, brisant le mythe de l'égalité nationale des conditions et
contenus d'éducation souvent porté par l'historiographie
classique369. Au-delà même du fait que ces postes
soient occupés par des enseignants débutants ou « incapables
», ils servent aussi de « punition » à l'égard des
instituteurs fautifs. Charles Malignoud, répondant au questionnaire de
Jacques Ozouf, indique qu'un collègue ayant déplu au conseil
général s'est vu affecté dans « une petite
commune montagneuse » 370 , symbole d'une relégation scolaire
institutionnalisée.
L'école isolée sert de lieu « d'exil »
pour les instituteurs réfractaires, les conditions hivernales que nous
avons décrites plus haut font comprendre qu'y vivre est souvent
difficile. C'est ce que confirme l'institutrice Jacqueline Delacquis, ayant
exercé à Morzine de 1882 à 1897 - poste de montagne. Elle
estime tout de même que son mari et elle avaient « de la
chance
367 ADHS, 1 T 45, Affaires générales par
communes, les Houches, liste de déplacement du personnel enseignant, 16
Octobre 1885.
368 ADHS, 1 T 87, Délibération du conseil municipal
de Saint-Gervais, 17 Novembre 1907.
369 Même lorsque ce postulat n'est pas affirmé,
il n'en reste pas moins que les études historiques sur l'école
prennent systématiquement comme cadre le référent national
sans interroger le cadre spatial comme biais épistémologique
non-neutre de l'analyse.
370 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 19, Charles Malignoud.
109
par rapport aux pauvres paysans de la montagne »
car ils mangeaient « du pain blanc et quelquefois de la viande
fraîche »371. Dans son témoignage
l'institutrice fait une distinction nette entre les postes de plaine et les
postes de montagne. A la question « quelle a été votre
carrière ? » elle répond « 15 ans de montagne
(Montriond), 18 ans de plaine (Margencel) » en précisant
« pas même de bicyclette, se rendre à Thonon en diligence
(5h) »372. On comprend qu'enseigner en montagne et en
plaine ne représente pas la même expérience pour les
enseignants : relier Thonon et Montriond prend cinq heures de diligence alors
que les deux communes sont éloignées de seulement cinq
kilomètres à vol d'oiseau : cruelle géographie alpine...
D'autant plus que ce qui revient souvent sous la plume des instituteurs et
institutrices, est le fait qu'ils décrivent les montagnards comme
pauvres, simples et réactionnaires, nourris en cela de
stéréotypes ambigus qui leur sont attribués depuis le
XVIIIe siècle. Numa Broc en analysant les discours des
naturalistes se demandait justement si « «bon montagnard» ne
serait-il pas la version européenne du «bon sauvage» ?
»373. Toujours est-il que, vrais ou fantasmés, ces
traits de caractères se retrouvent dans les sources. Pour exemple,
l'instituteur Louis Dépingy écrit que « les instituteurs
de montagnes étaient souvent en butte aux tourments des cléricaux
»374, sa collègue, Marguerite Delacquis confirme
« dans les postes de montagne où l'on débute en
Haute-Savoie, il faut encore être prudente et ferme à
l'égard du curé qui, sous prétexte d'enseigner du
catéchisme, vous cherche des complications »375. On
comprend donc que la plaine, surtout pour les vieux enseignants, constitue un
horizon enviable après quelques années passées dans des
postes de montagne376 . Il s'agit alors de convaincre les
autorités scolaires avec argumentaire adapté afin d'obtenir la
mutation souhaitée.
En 1892, les époux Mauroz, exerçant tous deux
à Chamonix écrivent une lettre à l'inspecteur
d'académie, ils expliquent que « leur santé ne leur
permet pas de rester plus longtemps à Chamonix à cause de la
rigueur du climat. Ils désirent être placés dans la plaine
»
371 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 7, Jacqueline Delacquis.
372 Ibidem.
373 Numa BROC, « Le milieu montagnard : naissance d'un
concept », Revue de Géographie Alpine, t.72, n°2-4,
1984 p. 127-139, p. 131.
374 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 9, Louis Dépigny.
375 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 17, Marguerite Delacquis.
376 Petite aparté : les plaintes axées sur le
conservatisme des populations de montagne n'existent pas dans les communes les
plus ouvertes à l'économie du voyage. La politique et
l'économie libérale ont enrichi les communes et les habitants,
modifié les structures de vie « traditionnelles ». Le contact
prolongé avec les riches touristes étrangers et les
bénéfices qui en découlent ont peut-être
privilégié l'éloignement des montagnards d'avec
l'Église. Hypothèse seulement, reste qu'aucune école
privée n'existe par exemple dans les communes de Chamonix ou de
Vallorcine.
110
ajoutant qu'ils aimeraient, si possible « être
à proximité de la ligne du chemin de fer ou du lac
»377. En plus de donner des raisons valables - et celles
concernant la santé sont souvent entendues - il faut que l'instituteur
soit digne de son déplacement : quitter la montagne se mérite. Se
met en place une véritable enquête dans laquelle Monsieur Perrin -
instituteur titulaire de l'école du bourg - doit écrire un
rapport sur son adjoint - Louis Mauroz. Il s'en charge donc, sans être
tendre pour son collègue, notant qu'il n'a plus aucun zèle,
« ne remplit plus ses fonctions », « ne fait rien
pour mettre son instruction au niveau », « affecte de ne pas
saluer son titulaire », disant enfin qu'il est « très
très bien vu du parti réactionnaire : détesté du
parti républicain »378. Les accusations sont
lourdes mais Perrin se prononce tout de même favorable à son
déplacement car il espère la mutation d'un instituteur plus
capable. L'inspecteur primaire rédige lui aussi un rapport, mais
celui-ci va à l'encontre du premier. Il écrit que Mauroz est un
instituteur capable qui a même obtenu une médaille de bronze
l'année précédente. Finalement, l'instituteur
fatigué obtient gain de cause, il est muté à Messery,
proche du lac Léman, commune desservie par la voie ferrée : les
deux requêtes sont acceptées. Autre exemple, l'instituteur Paul
Vigroux, exerçant au Petit-Bornand, demande sa mutation en 1913. Il
commence par mettre en avant son état de service, écrivant qu'il
a « créé plusieurs sociétés post-scolaires
toutes florissantes (société de tir scolaire,
société de tir d'adulte S.A.G, cantine scolaire,
société scolaire forestière, société
protectrice des animaux, sans compter une caisse locale de Crédit
agricole et une société de pêche) » avant
d'assurer qu'il n'en tire aucune gratification. Il énumère
ensuite les raisons de sa requête : « difficultés de
communication, spécialement en hiver, la cherté des
communications, les difficultés d'approvisionnement, l'absence de
docteur dans un rayon de moins de 12 km me font désirer un poste plus
avantageux »379. Ici encore, les postes de plaines sont
considérés plus commodes. Des raisons géographiques
soutiennent ce jugement, mais l'argumentaire n'est pas fondé sur des
questions de santé : le mérite et le zèle
déployés au service de l'instruction publique y prennent une
grande place.
Du côté des institutrices, des stratégies
différentes se mettent en place. Rappelons que celles-ci étaient
quelquefois écartées des écoles de hameaux, de «
trop hautes altitudes pour être dirigées par une institutrice qui
en hiver rencontre souvent des impossibilités de communication ou
même des moyens d'alimentation » mais aussi jugées trop
difficiles pour qu'une « institutrice souvent jeune et toujours d'un
tempérament délicat puisse suffire à tant de
377 ADHS, 1 T 736, Dossier individuel de l'instituteur Louis
Mauroz, lettre à l'inspecteur d'académie, 9 Aott 1892.
378 Ibidem, Rapport de François-Narcisse Perrin,
directeur de l'école du bourg de Chamonix, 30 Aott 1892.
379 ADHS, 1 T 55, Lettre de l'instituteur Paul Vigroux à
l'inspecteur d'académie, 19 Juillet 1913.
111
fatigue »380. Néanmoins, il
arrive que des institutrices soient tout de même nommées sur des
postes de montagne. Lorsque cela arrive, elles réutilisent les
mêmes arguments sexués381 pour obtenir une place plus
clémente. C'est donc systématiquement sur les problèmes de
santé dû aux conditions climatiques que vont s'appuyer les lettres
des institutrices. Ainsi, en 1911, Madame Balmat - devenue Charlet - va
demander sa mutation pour se rapprocher de ses parents en arguant que
« les hivers sont très rigoureux ici, les communications sont
impossibles pendant la mauvaise saison, ma santé s'en ressent car je
suis sujette aux douleurs »382. Sa mutation sera
acceptée quelques semaines plus tard. La même année, Louise
Bugnet, alors en poste à Chamonix demande sa mutation à
Saint-Roche, en plaine à nouveau en raison de ce que «
l'altitude élevée de l'endroit ne convient pas à
[son] tempérament et Monsieur le docteur Bonnefoy de Sallanches
qui [la] soigne, [lui a] déclaré
qu'[elle] ne pourrait y vivre longtemps »383.
L'inspecteur primaire ne va pas accepter sa requête de suite, mais en
septembre, Bugnet écrira une nouvelle lettre faisant part de l'urgente
nécessité de quitter son poste pour des raisons familiales : sa
tante infirme, auparavant confiée à une soeur à Lyon
maintenant décédée, doit revenir en
Haute-Savoie384. N'ayant personne à qui la confier, Louise
Bugnet demande immédiatement sa mutation qu'elle obtient très
vite au vu de de la situation. Il est intéressant de voir les
justifications différenciées utilisées par les
instituteurs et les institutrices pour justifier de leurs mobilités. On
constate que chez les premiers, la mise en valeur du zèle
déployé dans la mission d'enseignement, l'amélioration de
la vie sociale, culturelle et technique des villages, mettent en avant les
mérites individuels des enseignants. A l'inverse, pour les
institutrices, les raisons de santé sont toujours centrales quand ce ne
sont pas celles d'assistance aux membres de la famille, deux dimensions
étroitement associées aux rôles genrés
féminins (santé fragile, rôle de mère, de soin,
d'attention).
Dans tous les cas et indépendamment des
stratégies différenciées utilisées par les
instituteurs et les institutrices, nous constatons que le corps enseignant tout
autant que les autorités scolaires, font une différence nette
entre les postes de plaine et les postes de montagne, introduisant une nouvelle
hiérarchie d'attractivité entre les deux catégories
classiquement
380 ADHS, 1 T 87, Délibération du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Gervais, 8 Mars 1908.
381 Sans dire qu'elles utilisent nécessairement
consciemment ces stéréotypes : il est probable qu'ils soient
intégrés et leurs discours peuvent dans tous les cas contenir des
vérités non manipulées.
382 ADHS, 1 T 486, Dossier individuel de l'institutrice Lina
Balmat, lettre à l'inspecteur d'académie, 5 Juillet 1911.
383 ADHS, 1 T 486, Dossier individuel de l'institutrice Louise
Bugnet, lettre à l'inspecteur d'académie, Juillet 1911.
384 Ibidem, Lettre à l'inspecteur
d'académie, 3 Septembre 1911.
112
opposées de la ville et de la campagne - la montagne
prenant la dernière place. Celle-ci, par les conditions de vie
jugées plus difficiles, particulièrement en hiver, fait office de
« punition » ou de passage obligé en début de
carrière. Les enseignants ont un pouvoir d'action pour tenter
d'éviter ces postes dépréciés - ou d'en sortir le
plus tôt possible - mais il reste que les inégalités
spatiales en termes d'éducation sont grandes entre l'élève
du hameau et celui de la plaine. Justement, si ces inégalités
liées à l'espace se font sentir dès l'école
primaire, elles deviennent surtout flagrantes lorsque l'âge de la
communale est révolu : comment poursuivre ses études ? Où
aller et comment ? Les choix sont en général restreints pour les
enfants des Alpes, peut-être même davantage en Valais...
C] Quitter la montagne pour poursuivre ses études
?
Les lieux de montagne ne sont pas les mieux pourvus en
matière d'offres scolaires professionnelles et supérieures.
Là encore, l'isolement et le faible peuplement jouent en défaveur
des enfants qui auraient les capacités scolaires et financières
pour poursuivre leur cursus au-delà de la communale.
A Chamonix, il y avait jusqu'en 1890 deux écoles
primaires supérieures (E.P.S), une de chaque sexe, placée dans le
chef-lieu. Ces deux écoles sont transformées - sur demande de la
mairie - en simples cours complémentaires en raison de la
fréquentation trop basse et des coûts trop élevés
pour la commune385. Cette rétrogradation en cours
complémentaires affecte déjà la qualité de
l'enseignement dispensé dans la commune. Les E.P.S. préparent au
brevet élémentaire en trois années puis au brevet
supérieur - le même que dans les écoles normales
d'instituteurs - au bout de deux années supplémentaires, alors
que les cours complémentaires ne sont censés prolonger la
scolarité que deux années, même si dans les faits, la
durée peut-être plus longue. De plus, ces cours sont
intégrés à l'école primaire et dispensés par
des instituteurs alors que ceux des E.P.S sont enseignés par des
professeurs ayant la même formation que ceux des écoles normales.
Reste que la présence de ces cours est déjà une bonne
chose pour les enfants du bourg, mais pour les enfants du bourg
seulement. Roger Thabault remarquait déjà qu'à
Mazières-en-Gâtine, il existait une différence
marquée entre les enfants du bourg plus à l'aise socialement et
ceux des hameaux, souvent fils de cultivateurs qui ne dépassaient
385 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 1887.
113
généralement pas le certificat d'études
primaires386 . Pour les communes de montagne, le problème de
l'hiver, que nous connaissons maintenant bien, renforce le
phénomène, enserrant les populations dans les frontières
étroites des hameaux. Les nombreux enfants de plus de 13 ans peuplent
les petites écoles à classe unique pendant l'hiver car ils ne
peuvent se rendre à l'école du bourg. Le père de Jean
Ducroz s'en rend bien compte lorsqu'il écrit à l'inspecteur
primaire qu'il serait « impossible » et même
« imprudent » de sa part « [d'] envoyer
[ses enfants] à l'école d'Argentière quand pour
s'y rendre il leur faut faire chaque jour deux kilomètres et demi
»387. En Valais, ces communes n'ont bien souvent pas du
tout de cours complémentaires, ni professionnels. Josef Guntern note que
ces enseignements se limitent à quelques cours organisés
localement par les communes sans réel contrôle des
autorités centrales388. Le canton en général a
très peu développé l'enseignement post-primaire, ayant
déjà assez de difficultés à organiser les
écoles communales. Le Chanoine de Cocatrix estime que 4 % des jeunes
gens ayant passé les examens de recrues avaient eu accès à
une école supérieure au primaire en 1887, puis seulement 7 % en
1905 - contre une moyenne de 27 % dans toute la Suisse389. Les
chiffres augmentent un peu ensuite : environ 10 % en 1912 mais restent tout de
même très bas390.
Les écoles professionnelles tendent à se
développer en Haute-Savoie, le département compte l'école
d'horlogerie de Cluses - qu'Antoine Prost classe au même niveau que les
écoles professionnelles nationales391 - l'école
nationale d'industrie laitière à La Roche-sur-Foron et quelques
écoles ménagères destinées aux jeunes
filles392. L'offre reste tout de même limitée et toutes
ces écoles sont en plaine, loin des populations de montagne, surtout
avec les difficultés de circulation que connaissent ces territoires.
Pour que les élèves des hameaux y accèdent, il est
nécessaire qu'ils y soient acceptés dans l'établissement,
que leurs parents puissent subvenir au frais d'internat, qu'ils voient assez
d'utilité dans la poursuite d'étude pour accepter de faire le
sacrifice financier et émotionnel de leur enfant : en somme, beaucoup de
choses peu habituelles dans les trajectoires de vie des paysans de montagne. De
tels parcours sont souvent accessibles à une petite classe aisée
d'habitants ruraux, vivant souvent des bourgs, au premier
386 Roger THABAULT, L'ascension d'un peuple...op.cit, p.
171 et p. 207.
387 ADHS, 1 T 418, Lettre de Monsieur Ducroz à
l'inspecteur primaire de Bonneville, 5 Décembre 1886.
388 Josef GUNTERN, L'école valaisanne..., op. cit,
p. 177.
389 AEV, 1 DIP 102bis, Cahier sur les examens de recrue par le
chanoine Cocatrix, 1906, p. 16.
390 « L'examen pédagogique des recrues en 1912
», L'école primaire, n°8, 15 Novembre 1913, p. 2
(frontispice).
391 Antoine PROST, Histoire de l'enseignement..., op.cit,
p. 310.
392 Justinien RAYMOND, La Haute-Savoie...op.cit,
chapitre 1, p. 130-256.
114
chef les enfants d'instituteurs393. De l'autre
côté des Alpes, les écoles professionnelles sont encore
plus rares, on sait qu'une partie est en général très
liée à l'industrie, comme la politique valaisanne a longtemps
essayé de ralentir le mouvement d'industrialisation pour
privilégier le travail de la terre, le développement de ces
enseignements s'est trouvé freiné.
Toutefois, même si la poursuite d'études est plus
que compromise pour les garçons, elle reste possible. Concernant les
filles, elle est complètement bloquée. La morale
chrétienne qui imprègne le Valais prône sans cesse le
retour à une vie simple, de cultivateurs heureux. Si la ville constitue
le danger ultime pour le noble peuple paysan, les appels
répétés à la méfiance face aux vices urbains
visent principalement les filles. Les articles sont nombreux pour leur
enjoindre de rester à la campagne ou à la montagne. Un article au
titre sans équivoque « Jeunes filles, restez chez vous ! »
publié en 1916 dans L'école primaire en rend
parfaitement compte. L'auteure commence par déplorer « la
dissolution de l'esprit de famille qui a entraîné tant de
déchéances morales » avant d'affirmer que « le
retour pour la femme aux activités domestiques à son rôle
béni au foyer, même modeste, même sans luxe et sans
éclat, voilà ce qu'il faudrait avoir appris
»394. Même lorsque des observateurs réclament
une éducation post-primaire pour les jeunes filles, c'est parce que
« la petite instruction primaire ne leur sera pas utile dans la vie
pratique » car elle tient « la jeunesse
éloignée des tâches ménagères »,
seules conditions pour que les filles « remplissent ce beau
rôle de mère »395. Est-ce que les choses sont
vraiment différentes en Haute-Savoie ? On peut en douter, à part
l'école normale d'institutrice et, ici aussi, les écoles
ménagères, les jeunes filles n'ont pas beaucoup d'autres
perspectives. Marcel Puthod, instituteur du département, reconnaissait
dans sa réponse au questionnaire de Jacques Ozouf que « les
filles de la campagne demeuraient paysannes à quelques exceptions
près »396.
Les populations de montagne ont donc en général
peu de mobilité scolaire après leur passage à
l'école primaire. Les assez larges possibilités d'emplois
qu'offrent - dans certaines communes - la manne touristique, permettent aux
habitants de s'employer sur place, même si beaucoup vivent encore de
l'agriculture ou de l'élevage. On pourrait dire, un peu
schématiquement, que les territoires de montagne connaissent peu de
mobilité vers l'extérieur
393 Pour exemple, les quatre fils de Monsieur Picandet,
instituteur à Chamonix vont faire des études supérieures,
l'un rentrera à l'Ecole Centrale de Paris en 1912. ADHS, 1 T 800,
Dossier individuel de l'instituteur Joseph Picandet, Lettre de l'inspecteur
primaire à l'inspecteur d'académie, 19 Juillet 1912.
394 « Jeunes filles restez chez vous ! »,
L'école primaire, n°4, supplément, 15 Avril 1916,
p. 71-72, p. 71.
395 Lucie DE COURTEN, « L'école
ménagère », L'école primaire, n°8, 15
Novembre 1913, p. 65-66.
396 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 22, Marcel Puthod.
115
mais qu'au contraire, « l'extérieur » vient
à eux. Nous l'avons vu dans le cas du tourisme, il est maintenant temps
de jeter un oeil par-delà les Alpes françaises et suisses. En
effet, un des points aveugle du mémoire est l'absence des Alpes
italiennes, pourtant collées aux deux autres. L'immigration italienne
est très forte dans les territoires haut-savoyards et valaisans, il est
intéressant d'étudier les écoles primaires
françaises et suisses au contact de personnes étrangères.
Cette fois-ci, ce ne sont plus les riches étrangers venant admirer les
paysages alpins pendant la saison estivale, mais des populations souvent
modestes, venues pour trouver du travail et/ou s'installer dans ces lieux -
phénomène souvent vecteur de tensions, parfois d'acceptation.
D] Enfants étrangers, entre rejet et
acceptation
L'école est le lieu d'apprentissage de la nation, de la
citoyenneté, des droits et devoirs civiques. Pour toute ces raisons,
l'arrivée d'un élément étranger qui ne partage pas
la même culture, le même référentiel patriotique,
parfois même pas la même langue peut, aux yeux des acteurs de
l'institution, faire figure d'un grain de sable qui vient se loger dans les
engrenages de la machine scolaire. L'intégration parfois difficile
d'enfants étrangers au sein de l'école républicaine
française se laisse bien voir au travers de l'exemple de Chamonix.
En 1905 débutent les travaux de percement d'un tunnel
devant relier la commune à la ville valaisanne de Martigny. Le lieu du
percement est situé aux Frasserands, assez proche de l'école du
hameau. La question de sa fermeture pendant les travaux est posée par
les entrepreneurs, mais l'inspecteur primaire s'y refuse arguant qu'il
« est probable que les entrepreneurs aimeraient disposer du local
scolaire pour y installer leurs bureaux ». Il poursuit en affirmant
que l'école est éloignée d'environ 120 à 150
mètres du chantier et qu'ainsi « les travaux bruyants ne
s'exécuteront pas dans [son] voisinage immédiat » avant
de conclure : « on ne dispose d'ailleurs d'aucun autre local pour y
transporter l'école, le mieux est encore de la laisser où elle
est »397. L'affaire semble réglée, la
stratégie d'appropriation du local scolaire par les entrepreneurs a
été déjouée, il est de toute manière
impossible de déplacer l'école pendant plusieurs années,
surtout dans des hameaux isolés où les enfants ne peuvent
être rattachés à une autre : l'école restera
ouverte. Une peur persiste tout de même. Pour réaliser l'ouvrage,
il est
397 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 3 Juillet 1905.
116
fait appel à environ 120 ouvriers398, pour
la plupart italiens qui viennent avec femmes et enfants s'installer plusieurs
années sur le chantier. L'inspecteur estime que « la
présence de nombreux ouvriers dans le hameau serait jusqu'à un
certain point, dangereux pour l'institutrice » et propose son
remplacement par un instituteur399. C'est finalement Madame qui est
nommée sur le poste après sa dispute avec les parents
d'élèves de Pellerins. L'inspecteur primaire accepte qu'une
institutrice enseigne là-bas car ses parents habitent le même
hameau, sans cette proximité familiale, l'école serait «
assez dangereuse pour une institutrice isolée »400
. La défiance exprimée n'est pas clairement indexée sur la
nationalité des ouvriers mais sur leur statut social, signe de la
défiance quant à leur moralité, surtout vis-à-vis
des femmes. Les problèmes liés à la nationalité des
nouveaux arrivants interviendront plus tard. Le 5 décembre 1905,
François Lioret, habitant du hameau et employé sur le chantier du
tunnel, envoie une lettre à l'inspecteur d'académie en se
plaignant que sa fille de 13 ans est refusée par l'institutrice en
raison de son âge alors qu'ont été acceptés
« dans cette même école, plusieurs enfants du même
âge et dont une même plus âgée, de nationalité
étrangère » ; Il le prie donc « de faire droit
et justice »401.
Pendant un peu plus d'une année, la présence des
enfants italiens ne semble plus faire d'émules - en tout cas jamais
assez graves pour remonter jusqu'à l'inspecteur d'académie -
avant d'atteindre sa tension maximale en Janvier 1907. Après plusieurs
plaintes des parents français et de l'institutrice, disant que les
parents italiens refusaient de payer l'école et ne cherchaient pas
à faire entrer les enfants dans les normes scolaire
républicaines, l'inspecteur d'académie écrit à
l'inspecteur d'académie en lui demandant : « Ne conviendrait-il
pas de recevoir d'abord les enfants français ? On ne prendrait les
italiens que dans la mesure du possible et on inviterait les refusés
à aller soit à Argentières, soit au Tour où il y a
toujours de la place », l'inspecteur d'académie signale son
accord et transmet la lettre au préfet402 . Néanmoins,
les travaux qui s'effectuent toute l'année et surtout l'hiver - en
raison des infiltrations d'eau à la fonte des neiges - font douter des
possibilités pour les enfants italiens de se rendre aux écoles
d'Argentières ou du Cour. Rappelons que l'hiver « toute
communication
398 ADHS, 2 O 2175, Lettre de Monsieur Convert, responsable
des travaux publics au maire de Chamonix, 7 Juillet 1905.
399 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 3 Juillet 1905.
400 ADHS, 1 T 486, Dossier individuel de l'institutrice Lina
Balmat, lettre de l'inspecteur primaire à l'inspecteur
d'académie, 19 Aott 1905.
401 ADHS, 1 T 418, Lettre de François Lioret à
l'inspecteur d'académie, 5 Décembre 1905.
402 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 2 Janvier 1907.
117
avec les hameaux voisins est devenue impossible »
403 . Les pouvoirs scolaires préfèrent contrevenir à
l'obligation scolaire - sans l'exprimer noir sur blanc - pour désamorcer
les tensions, preuve peut-être que l'école de la nation
française a du mal à composer avec l'altérité dans
une telle situation. Signe aussi - autant de la part des parents, des
enseignants et des inspecteurs - que l'intégration du territoire
savoyard à la nation française 45 ans plus tôt a bien
fonctionné, la frontière est nettement marquée et
revendiquée entre hauts-savoyards et leurs anciens compatriotes devenus
italiens404 - l'école n'y est d'ailleurs pas pour rien.
À l'heure où la frontière chamoniarde entre le Valais et
la Haute-Savoie va s'ouvrir405, la frontière culturelle entre
les enfants français et italiens s'entérine.
De l'autre côté des Alpes, les stratégies
scolaires d'accueil des populations étrangères ne sont pas
semblables. Il faut rappeler que le modèle fédéral et
multi-culturaliste de la nation helvétique autorise plus facilement
l'intégration des étrangers. Tout d'abord, la barrière
linguistique ne joue pas le rôle de ciment national, la Suisse
reconnaît trois langues officielles - l'allemand, le français et
l'italien. Ensuite, les conditions d'immigration sont beaucoup plus
aisées, le territoire étant, au moins depuis le début du
XIXe siècle, une terre d'accueil privilégiée.
En 1915, sur les 3 700 000 âmes que comptait le pays, il y avait 552 000
étrangers, dont 220 000 allemands, 64 000 français, 42 000
autrichiens et 203 000 italiens406. Même si le canton du
Valais est légèrement en dessous de la moyenne suisse, la part
d'étrangers y est tout de même de 11 % en 1910 et ne cesse
d'augmenter407. Parmi eux, une forte part d'italiens, pour la
plupart ouvriers, qui débarquent à l'occasion des grands travaux
de percement des tunnels - à l'instar de la France. Certes, ces
populations italiennes ne sont pas toujours convenablement reçues, les
conditions de travail sont dures et le pouvoir conservateur s'inquiète
parfois de l'effet de leur présence sur la moralité des
valaisans408 . Toutefois, en matière de politique scolaire,
les autorités valaisannes semblent plus conciliantes que leurs voisins
français. Dans le rapport de
403 ADHS, 1 T 169, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 26 Septembre 1881.
404 La plupart des ouvriers italiens viennent des proches
territoires anciennement unis dans le Royaume de Sardaigne.
405 En réalité pour des motivations
économiques liées au tourisme beaucoup plus qu'au circulations
des populations locales. Voir Pierre-Louis ROY, LE Mont-Blanc Express,
l'invention du tourisme alpin, Glénat, 2008.
406 « Statistique suisse », L'école
primaire, n°1, supplément, 15 Janvier 1915, p. 24.
407 Gérald et Silvia ARLETTAZ, « Les
étrangers et la nationalisation du Valais, 1845-1945 », dans
Gérald ARLETTAZ, Jean-Henry PAPILLOUD, Myriam EVEQUOZ-DAYEN, Maria-Pia
TSCHOPP, (dir), Le Valais et les étrangers...op.cit, p. 68.
408 Ibidem, p. 81 et p. 87.
118
l'instruction publique valaisanne de l'année 1898, on
peut par exemple lire ceci : « On comprendra sans peine que,
dès le premier jour, le Conseil d'État se soit
préoccupé de l'avenir intellectuel et moral des nombreux enfants
qu'amenaient à Brigues et à Naters l'entreprise du percement du
Simplon. L'ouverture d'une école italienne s'imposait et grâce au
concours des autorités de Naters, nous avons réussi à la
créer. Notre prochain rapport de gestion contiendra certainement
d'intéressants détails sur la marche de ces nouvelles
écoles qui portent à trois le nombre de langues enseignées
dans les classes primaires du canton »409. Le ton est
évidemment grandiloquent, le canton se flatte de sa grandeur d'âme
envers les populations italiennes, laissant de côté les conditions
de vie difficiles et les morts qui ponctuent régulièrement
l'avancée des chantiers. Toutefois, cela montre que l'école
valaisanne - et plus largement suisse - ne se considère pas
menacée par le multiculturalisme de son enseignement. Les
réponses scolaires à l'immigration sont plus souples qu'en France
et la création d'une école de langue italienne publique,
subventionnée par le canton et les communes ne pose, pour ainsi dire,
aucun problème.
Au travers de ces deux cas de figure, on peut aisément
généraliser l'analyse et réfléchir aux logiques
d'intégrations scolaires qui prennent place en France et en Suisse. En
élargissant la focale, ces exemples donnent des indices sur la
manière de concevoir la nation et l'identité nationale dans les
deux pays. On observe une distinction nette entre l'école
française, privilégiant une identité plus stricte,
fondée sur un fort référentiel culturel commun et
l'école suisse, qui accepte la pluralité des cultures en son sein
sans que cela bouleverse l'ordre social410. Ici, le centralisme de
la IIIe République et la fédéralisation de la
Confédération orientent des choix différents dans les
pratiques scolaires. Enfin, ces deux exemples réifient l'importance de
la frontière étatique entre la Haute-Savoie et le Valais ; les
écoles alpines, éloignées de quelques kilomètres
seulement, ne fonctionnent pas de la même manière, ne
véhiculent pas les mêmes représentations et ne donnent pas
lieu aux mêmes pratiques.
409 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1898, p. 29.
410 Sur ce point voir : Didier FROIDEVAUX « Construction de
la nation et pluralisme suisses : idéologie et pratiques »,
Swiss Political Science Review, 1997, n°3/4, p. 1-58.
119
TROISIÈME PARTIE. Les Alpes protègent-
elles de la guerre ?
En adoptant une perspective micro-historique, il apparait que
l'école de montagne n'est pas tout à fait la même
qu'ailleurs : elle est pourtant différente d'un côté et
l'autre des crêtes alpines. En privilégiant cette échelle,
il est possible d'observer des contournements des normes scolaires nationales
et les justifications qui les motivent. L'intérêt est double,
d'une part : cela permet d'aller à rebours d'une historiographie qui
considère bien souvent l'uniformité des systèmes scolaires
nationaux de fait, sans réfléchir aux implications
épistémologiques qu'un tel postulat suppose - nous avons pu comme
cela opérer un jeu de frontières intraétatique. D'autre
part, cela autorise, en prenant les Alpes comme cadre d'analyse, à
repérer les aspects communs et différenciés de deux
systèmes scolaires dans un même espace géographique qui,
cette fois-ci, permet de jouer sur les frontières interétatiques.
La situation des écoles de montagne a pu paraître parfois
isolée et parfois intégrée à des espaces plus
larges, principalement ceux des nations françaises et suisses. En
réalité, les deux dimensions coexistent : elles touchent des
aspects du réel, car les espaces se superposent sans s'annuler : on peut
revendiquer sa territorialité alpine tout en se sentant français
ou suisse, on peut être valaisan tout en se sentant appartenir à
la patrie helvétique. Justement, avec la guerre, un cadre spatial de
référence prend le pas sur les autres, il s'agit
évidemment du cadre national. Dans les écoles, les
références au milieu local sont évincées au profit
de la nation. Les spécificités dû au milieu
géographique - et politique - alpin existent certes toujours, mais elles
ne rentrent plus dans les formes de justifications des acteurs. Les
particularités s'effacent - ou du moins sont reléguées
temporairement.
Quand l'appel sous les drapeaux se fait entendre : il faut
participer à l'effort national. Cette description fonctionne
évidemment pour la France, patrie belligérante, mais -et ce fut
une surprise dans le cadre de cette étude- elle fonctionne aussi pour ce
pays neutre qu'est la Suisse. Certes, les expériences de guerre sont
sans commune mesure, un pays est en guerre, l'autre non, mais l'appareil
étatique helvétique se met en branle et promeut, comme de l'autre
côté des Alpes, l'unité de la nation, la beauté du
sacrifice, la défense de la patrie. Vocabulaire surprenant, nous en
convenons, il faut pourtant se prévenir de toute reconstruction
mythifiée du passé : l'image de la Suisse patrie de la paix,
éternellement neutre, n'est pas tout à fait juste. L'enga-
120
gement de l'armée suisse dans les combats n'est pas
advenu. Pour autant, la sécurité des frontières
n'était pas garantie au déclenchement du conflit : personne ne
pouvait savoir avec certitude si la nation allait combattre, surtout dans
l'émulsion et l'angoisse qui accompagnent le début de la guerre.
Une certaine culture de guerre traverse la forteresse alpine, d'ailleurs, la
mobilisation générale est déclarée et, tout au long
du conflit, des soldats suisses garderont - avec plus ou moins
d'intensité - les frontières montagneuses des crêtes
alpines. Le pays n'est pas non plus étanche aux conséquences
économiques désastreuses qu'entraînent les combats
acharnés déchirants l'Europe. Le système scolaire
valaisan, comme son voisin français, est largement percuté par
l'événement guerrier. Les deux écoles sont très
liées avec les institutions militaires de leur pays respectif, les
mobilisations touchent le personnel enseignant, désorganisant
complètement les ministères de l'Instruction publique.
L'école n'est pas non plus étanche à la crise
économique dans son fonctionnement quotidien : papier, carton, bois de
chauffage, viennent à manquer, travaux, réparations, chantiers,
sont remis à plus tard. Une caractéristique commune aux deux
territoires est leur éloignement des combats : les imbroglios
administratifs liés au traité de Vienne de 1815 et, dans une
certaine mesure, la position d'isolement des communes de montagne,
protègent les populations haut-savoyardes - et par là
l'école - d'une confrontation trop directe avec l'appareil guerrier.
Ici, les expériences scolaires peuvent parfois présenter des
éléments de similitudes entre les enfants valaisans et
hauts-savoyards, à condition toutefois de ne pas oublier les divergences
majeures, dont la principale sans doute : l'expérience du deuil. Enfin
les frontières sont largement impactées par le conflit. Celles
entre États se durcissent, renforçant ainsi l'hermétisme
entre deux nations. Elles se ferment également au tourisme et
reconfigurent les manières de vivre des habitants des montagnes.
Toutefois, d'autres frontières, moins perceptibles parce que plus
symboliques que physiques s'ouvrent. Les importantes tensions politiques qui
traversent la Suisse créent de nouvelles lignes de rivalités
à l'in-térieur même du pays. A l'inverse, le soutien plus
ou moins affiché à l'un ou l'autre des belligérants,
l'entrée dans le conflit en cours de guerre de certaines nations et
l'espoir de paix chrétienne ouvrent des frontières de
solidarité qui transgressent le cadre national tout en traversant
l'école.
121
CHAPITRE 8. Des systèmes scolaires
ébranlés.
Il faut reconnaître d'emblée que les sources
scolaires concernant la période de guerre sont beaucoup moins nombreuses
que dans celles qui précèdent. Les systèmes scolaires se
trouvent désorganisés par l'événement. Le corps
enseignant mais aussi les autorités administratives sont
mobilisées pour le front : en résulte une diminution sensible de
la correspondance, les rapports d'inspections n'ont presque plus lieu. Il faut
parer au plus urgent, les pratiques habituelles des acteurs de l'institution
scolaire qui ne sont pas jugées primordiales s'effacent : nombre de
réunions sont annulées des deux côtés de la
frontière, il en va de même pour les rapports d'incident, les
demandes de mutations, les affaires scolaires locales. En bref, les gestes de
l'histoire quotidienne de l'école sont transfigurés au sein d'une
culture de guerre. L'historiographie scolaire a longtemps mis de
côté l'étude de la première guerre mondiale,
postulant une sorte de continuité dans les périodes de l'avant et
de l'après. Un certain nombre de travaux - sur lesquels nous ne
manquerons pas de nous appuyer - rendent aujourd'hui justice à
l'école en guerre. Effectivement, nous prenons le parti de ne pas
postuler une stricte continuité des institutions sociales dans
l'événement guerrier mais à l'inverse, de le
considérer dans toute sa force de rupture et de recomposition
historique411. En définitive, l'école primaire est une
école en crise.
A] L'appel et la mobilisation des corps
enseignants
Nous le savons maintenant bien, à l'heure de l'appel
sous les drapeaux, une grande part du corps enseignant français est
mobilisée. Environ 35 000 instituteurs partent pour le
front412 sur les quelques 150 000413 - hommes et femmes
confondus - que compte l'instruction primaire au moment de l'entrée en
guerre : soit environ 23 % du total414. Peut-être plus
étonnant, la
411 François DOSSE décrit le retour de
l'événement en histoire et les manières de concilier
rupture et discontinuité : voir « Événement »
dans Christian DELACROIX, François DOSSE, Patrick GARCIA,
Nicolas OFFENSTADT (dir), Historiographie, concepts et débats,
t.II,, Paris, Gallimard, 2010, p. 744-756.
412 Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « Les instituteurs
combattants de la Grande Guerre : des soldats comme les autres ? »,
dans Jean-François CONDETTE (dir), Les écoles dans
la guerre, Lille, Septentrion, 2014, p. 215232, § 16 [en ligne] <
http://books.openedition.org/septentrion/7199>.
413 Antoine PROST, Histoire de l'enseignement..., p.
377.
414 Les chiffres semblent avoir été à peu
près équivalent sur l'ensemble du territoire.
122
mobilisation suisse est d'une ampleur équivalente. Bien
que nous n'ayons pas trouvé de chiffres concernant la mobilisation des
enseignants sur l'ensemble du territoire helvétique, ceux que
contiennent les archives valaisannes en donnent une bonne indication. Sur les
quelque 616 régents et institutrices que compte le canton, 150 à
160 servent sous les drapeaux en 1914415, soit environ le quart du
corps enseignant, taux comparable au cas français. La mobilisation est
massive et par ailleurs soutenue - avec des périodes plus creuses que
d'autres - jusqu'à la fin de la guerre. Dans les deux pays, les
institutions scolaires privées d'une bonne part de leur personnel
enseignant doivent pourvoir à leur remplacement. Qui placer sur les
estrades maintenant vides des salles ? Albert Sarraut, ministre de
l'Instruction publique française publie une circulaire à
l'attention des préfets départementaux dès le 18
Août 1914, il y indique que le service des instituteurs censés
partir à la retraite à la fin de l'année scolaire est
prolongé416. Le ministre poursuit : « Je n'ai pas
besoin de spécifier que les élèves maîtres et les
élèves maîtresses en cours d'étude peuvent
être choisis par vous, sans limite d'âge, si vous les jugez aptes
à des fonctions provisoires »417. Prolonger
l'activité des vieux instituteurs, projeter les
élèves-maîtres et maîtresses dans les salles de
classes avant la fin de leurs études, voici les mesures trouvées
pour endiguer l'hémorragie du personnel enseignant dans
l'éducation française. Elles sont appliquées en
Haute-Savoie où 180 instituteurs primaires et 47 élèves
maîtres ont été appelés sous les drapeaux dès
les débuts de la guerre418. Suite à la publication de
la circulaire, le préfet décide que les
élèves-maîtresses en deux et troisième année
de l'école normale de Rumilly ainsi que les trois classes
d'élèves-maîtres de l'école normale de Bonneville
seront pris dans le service actif419 . Toutefois, ce nouveau vivier
d'instituteurs potentiels va vite être épuisé. En 1915, en
plus des 5 instituteurs sortis de leur retraite et des 21
élèves-maîtres des écoles normales, l'enseignement
primaire haut-savoyard emploi 11 instituteurs venus des régions envahies
par les Allemands mais également 95 intérimaires sans
qualifications particulières pour exercer le
métier420.
415 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1915.
416 ADHS, PA 68.3, 4600, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°9, Septembre 1914, p. 191.
417 Ibidem, p. 192.
418 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°11, Octobre 1915, p. 238.
419 ADHS, PA 68.3, 4600, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°9, Septembre 1914, p. 198.
420 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°11, Octobre 1915, p. 238.
123
L'envoi de tous les hommes en âge au front - y compris
les élèves-maîtres - a renforcé le
phénomène déjà largement entamé de
féminisation du corps enseignants. Pendant toute la durée du
conflit, des élèves-maîtresses sont envoyées en
qualité de stagiaires dans les écoles, les intérimaires
sont quasiment exclusivement des femmes et les titularisations sont
également essentiellement féminines : le 23 décembre 1915,
28 institutrices sont titularisées pour seulement 2
instituteurs421. Les institutrices suppléent au manque
d'hommes dans des fonctions dont elles étaient auparavant exclues. Pour
exemple, le 29 Juillet 1915, 5 d'entre elles sont employées au
secrétariat de mairie sur le département422.
En Valais, les moyens utilisés sont similaires. La
mobilisation des instituteurs en Août 1914 fait que le canton «
a dû envisager l'éventualité imminente de manque de
maîtres qualifiés, soit des titulaires effectifs pour un certain
nombre de postes. L'ont dû ainsi, pour combler les vides creusés
par la mobilisation, faire appel à d'anciens régents ou y
suppléer pour le mieux »423. La formule « y
suppléer pour le mieux » veut dire, à l'instar du cas
français, engager des personnels non formés pour la fonction
d'instituteur. Ainsi, le Valais délivre des certificats temporaires
permettant à un certain nombre de personnes d'exercer des fonctions
d'enseignement à condition de se présenter à un concours
de fin d'année pour, soit prolonger ledit certificat, soit obtenir le
brevet de capacité424 - équivalent du certificat
d'aptitude pédagogique français. Les solutions provisoires sont
donc les mêmes, il s'agit de pallier l'urgence. Ici aussi, ce sont
principalement des femmes qui pourvoient au remplacement des instituteurs
appelés. Il faut néanmoins introduire une différence assez
large qui se situe dans la durée. La mobilisation française,
nation en guerre, va être soutenue pendant les 4 années du
conflit. À l'inverse, la mobilisation suisse, une fois les
premières frayeurs passées et la certitude de la
préservation de son statut de neutralité confirmée, baisse
en intensité. Les autorités cantonales négocient avec
l'État-major pour obtenir la démobilisation des instituteurs sous
les drapeaux. La première année, les requêtes
échouent, le chef du département de l'instruction publique de
Lausanne répond à une lettre de son homologue valaisan, et lui
fait part du fait que le canton n'a pu obtenir le renvoi que de 30 instituteurs
sur les 240 sous les drapeaux425.
421 ADSH, 1 T 1279, Séance du conseil
départemental de l'enseignement primaire de la Haute-Savoie, 23
Décembre 1915.
422 Ibidem, 19 Juillet 1915.
423 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1915, p. 43.
424 « Instruction primaire », L'école
Primaire, n°5, Mai 1916, p. 2 (frontispice).
425 AEV, 1 DIP 145bis, R380, lettre du chef du
département de l'instruction publique de Lausanne au chef du
département de l'instruction publique du Valais, 24 Novembre 1914.
124
Mais l'année suivante, on apprend que
l'État-major « s'est départi de sa rigidité
» en accordant « la libération de service pour tous
les instituteurs dont nous avions absolument besoin pour assurer la marche
normale de nos écoles »426. À partir de
l'année scolaire 19151916, l'enseignement valaisan et plus
généralement suisse est moins touché par la mobilisation
de son personnel enseignant. Certains moments de crise appellent toutefois
à des remobilisations ponctuelles, et certains instituteurs ne peuvent
échapper au service. Malgré ces événements, le
département de l'instruction publique valaisan peut déclarer que
l'année scolaire 1917-1918 s'est déroulée presque
normalement dû à la quasi-absence de mobilisation des
instituteurs427.
Les enseignements français et suisses ont tous deux
étés percutés par l'événement guerrier. La
ressemblance dans les moyens utilisés pour parer à la situation
d'urgence ne doit pas cacher le fossé entre les expériences
vécues, illustré par la durée et l'intensité de
l'événement touchant un pays en guerre et un pays qui ne l'est
pas. En réalité, les instituteurs français sont eux aussi
partiellement démobilisés avant la fin de la guerre, comme en
témoigne le bulletin départemental en septembre/octobre 1918 :
« Le retour des instituteurs mis en sursis d'appel a permis de
procéder à une sélection et d'écarter les
intérimaires les moins qualifiés »428 .
Toutefois, la démobilisation progressive est tardive et sans commune
mesure avec celle des régents valaisans. Autre différence
majeure, les instituteurs français combattent et meurent : environ 7400
vont succomber au feu ennemi429 , dont 59 en
Haute-Savoie430 . Le corps enseignant - à l'instar de la
société française - est largement endeuillé,
beaucoup d'instituteurs ne réintégreront jamais leur classe,
d'autres si, mais amoindris, parfois invalides431. La guerre
désorganise l'enseignement valaisan, elle fait de même en
Haute-Savoie, sauf qu'en sus, elle laisse les traces d'une expérience
combattante et non pas seulement d'une expérience de
mobilisation. Effectivement la guerre traverse les Alpes, elle réifie
néanmoins les frontières
426 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1915, p. 44.
427 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1918.
428 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°8-9,Août/Septembre 1918, p.
219.
429 Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « Les instituteurs
combattants de la Grande Guerre : des soldats comme les autres ? »,
dans Jean-François CONDETTE (dir), Les écoles dans
la guerre...op.cit, p. 215- 232, § 16 [en ligne] <
http://books.openedition.org/septentrion/7199>.
430 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°8-9,Août/Septembre 1918, p.
219.
431 On pense ici au dur retour en classe de Célestin
Freinet. Voir Emmanuel SAINT-FUSCIEN, Célestin Freinet...
op.cit.
125
nationales en étant vecteur d'expériences
vécues différenciées pour les instituteurs alpins
français et suisses.
Au-delà du corps enseignant mobilisé, il faut
maintenant s'intéresser au fonctionnement de l'école en temps de
guerre. Nous avons vu qu'il fallait suppléer au personnel absent, mais
l'école est plus largement touchée dans son organisation
générale, maintenir sa bonne marche n'est pas chose
aisée.
B] Faire fonctionner l'école en temps de
guerre
Il faut absolument que les enseignements scolaires se
poursuivent. L'école primaire est devenue en quelques décennies
d'une importance telle dans les sociétés européennes qu'il
est difficilement imaginable qu'elle s'interrompe, même en temps de
guerre. Malgré l'investissement de l'institution pour la poursuite des
enseignements, les moyens humains manquent pour assurer une marche normale.
Localement, les situations divergent : dans le cas français, les
territoires proches du front sont évidemment physiquement
impactés par la guerre, le déplacement du front, les occupations
de bâtiments scolaires pour les besoins de l'armée, ou encore
l'exode des populations rendent l'objectif de continuité scolaire
impossible à assurer. Toutefois, même les écoles des
territoires de l'arrière sont touchées par les
conséquences de la guerre, il s'agit néanmoins d'assurer leur
fonctionnement du mieux possible.
En Haute-Savoie, pour satisfaire à la bonne tenue des
écoles, l'inspecteur d'académie indique que 81 classes ont
été fusionnées sur l'année 1914-1915, il
précise que cela s'est fait « partout où la chose
était possible »432. Ces fusions entraînent
nécessairement des effectifs scolaires décuplés pour les
enseignants restés à l'arrière, l'instituteur Léon
Gavard témoigne que son épouse « robuste et courageuse,
femme de la campagne a beaucoup travaillé [...] Pendant 4 ans et demi de
guerre elle a eu tous mes élèves »433, il
faut ajouter qu'en plus de donner du travail supplémentaire à un
corps enseignant majoritairement féminin, elles créent ou
accentuent le processus de mixité scolaire : deux
phénomènes qui participent à une redéfinition des
frontières de genre pendant la guerre. Toutefois, les fusions ont
été faites lorsque cela était possible : dans les
écoles de hameaux des Alpes, les classes uniques ne
432 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°11, Octobre 1915, p. 238.
433 MUNAE, « fond Ozouf », Questionnaire n°
9400868 13, Léon Gavard.
126
peuvent pas être fusionnées sans entraîner
la fermeture d'une école au profit d'une autre, avec toutes les
conséquences que cela implique. L'école du hameau des Grasonnets
à Chamonix est fermée dès l'entrée en guerre, les
enfants la fréquentant sont censés se rendre à
l'école d'Argentières. Le 25 Novembre 1914, une pétition
des mères du hameau est envoyée au préfet, il y est fait
mention de l'impossibilité d'envoyer les enfants à
Argentières « vu la quantité de neige »
arguant « qu'il serait très malheureux que les enfants
fréquentant ladite école soient privés de maître
alors que tous leurs parents font leur devoir à la frontière
»434. L'inspecteur primaire relate la demande des
mères à l'inspecteur d'académie dans une lettre du 15
Janvier où il insiste à nouveau sur les difficultés de
regroupement liées aux conditions topographiques : « des
avalanches précoces ont été à craindre ces jours
derniers, et depuis avant-hier la couche de neige tombée doit interdire
les communications ». Il finit par écrire - avec l'appui du
maire de la commune - « qu'il vaudrait mieux rouvrir l'école
»435. Elle le sera effectivement quelques semaines plus
tard. Ce bref exemple montre qu'au-delà de la volonté de
l'État d'assurer au mieux la poursuite de la scolarité, les
parents se mobilisent également dans ce sens : en « haut »
comme en « bas », l'école n'est pas une chose à prendre
à la légère, guerre ou non. En témoigne d'ailleurs
la justification des habitants du hameau : tous les hommes font leurs devoir
à la frontière, maintenir une scolarité décente
relève d'un devoir de l'État. Les fermetures d'école ont
d'ailleurs été limitées en nombre : en Octobre 1914, le
département comptait 840 écoles436, puis 835 en
Août-Septembre 1918437. Les enfants haut-savoyards ont - pour
la plupart - eu accès à l'enseignement primaire durant le
conflit. En Valais, les sources sont plus rares, toutefois, une note fait
sobrement mention du fait « [qu'] exceptionnellement pour
l'année 1914-1915, un certain nombre d'écoles n'auront pas eu le
même maître pendant tout le cours scolaire par le fait de la
mobilisation »438. Il est à n'en pas douter qu'une
organisation scolaire plus fragile que sa voisine française a
été pris de court par l'événement et le manque de
personnel qui en découle. D'ailleurs, le chef de l'instruction publique
fait état du fait que plusieurs écoles ont dû être
temporairement supprimées et certaines classes provisoirement
fusionnées439. En somme et
434 ADHS, 1 T 418, Pétition des parents du hameau des
Grassonnets à l'intention du préfet, 25 Novembre 1914.
435 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 15 Janvier 1915.
436 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°10, Octobre 1915.
437ADHS, PA 68.3, 4600, Bulletin de l'instruction
primaire du département de la Haute-Savoie, n°8-9,
Août-Septembre 1918, p. 208.
438 « Part de l'État aux traitements »,
L'école primaire, n°4, 14 Avril 1915, p. 3
(frontispice).
439 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1915, p. 43.
127
malgré des situations largement divergentes - les
moyens employés sont similaires des deux côtés de la
frontière, : en France comme en Suisse, l'enseignement primaire doit se
poursuivre le plus normalement possible.
Nuançons cependant : la guerre amène
nécessairement des compromis pratiques qui entravent la bonne marche des
écoles. Dans les deux pays, l'appareil scolaire est en partie
paralysé. Pour exemple, les conférences pédagogiques
s'interrompent quasi-totalement, de même que les inspections scolaires
qui deviennent de plus en plus irrégulières pour quasiment
disparaître. En Haute-Savoie, 4 des 5 inspecteurs primaires sont
mobilisés dès le début de la guerre440. S'ils
sont peu à peu remplacés, la machine administrative marque un
temps d'arrêt et perd en efficacité du fait des mouvements de
personnels incessants : leurs remplaçants sont souvent novices, ne
connaissent pas les situations locales aussi bien et sont d'ailleurs
susceptibles d'être mobilisés à leur tour. En Suisse,
l'examen pédagogique des recrues - couronnant les achèvements des
cantons les plus impliqué dans d'instruction populaire - est
supprimé pendant au moins deux années441, même
chose pour le certificat d'aptitude français442.
Au-delà du seul niveau administratif, les écoles sont
confrontées à un absentéisme accru. Les enfants,
déjà mobilisés pour les travaux agricoles pendant la bonne
saison, remplacent systématiquement les pères
absents443. Un article français à propos de deux
enfants publié dans l'école primaire en fait d'ailleurs
l'éloge : « On leur a expliqué que leurs papas et leurs
frères étant partis pour la guerre, ce sont eux maintenant qui
sont « les hommes », et ils ne s'en montrent pas peu fiers. Sous la
fourche agile, le foin blond voltige, doré par le soleil couchant. Des
brindilles légères, soulevées par la brise de montagne,
dansent autour des petits faneurs. »444. Au niveau local,
la désertion scolaire est vue avec un certain pragmatisme pratique -
quoiqu'avec un certain retard ; En 1918, la commune de Chamonix, par
délibération de la commission scolaire accorde un «
droit d'absentéisme » à certains enfants qui
travaillent aux champs en raison de « la dureté des temps
»445. Manon Pignot écrit d'ailleurs très
justement que
440 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°10, Octobre 1915.
441 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1914, p. 21.
442 ADHS, PA 68.3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°1, Janvier 1915, p. 15.
443 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU remarque que la garde des
enfants au domicile pour les travaux agricoles est plus fréquente, cela
entraîne une désorganisation de la cellule familiale. Voir La
guerre des enfants, 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2004 [1993], p.
85-87.
444 « Les remplaçants », L'école
primaire, n°8, supplément, 15 Octobre 1915, p. 149-150.
445 ADHS, 1 T 418, Délibération du conseil
municipal de Chamonix, 20 Septembre 1918.
128
« pour un enfant de paysan, le départ du
père entraîne d'abord le bouleversement affectif de la cellule
familiale, mais il perturbe aussi toute l'organisation du travail agricole
»446.
L'école continue donc à fonctionner, mais elle
ne fonctionne pas pareil qu'en temps de paix. En France comme en Suisse, la
mobilisation du personnel enseignant - plus généralement de la
population masculine - déstabilise les ministères de
l'instruction publique. Mais par-delà la question du personnel,
l'école subit aussi les conséquences matérielles de la
guerre, le conflit ne vient pas sans une crise économique qui touche
l'institution scolaire de plein fouet.
C] L'école subit les conséquences de la
guerre
L'école n'est pas étanche aux bouleversements
socio-économiques plus larges qui touchent les sociétés
européennes pendant le conflit. Effectivement, la Grande guerre va avoir
des effets désastreux. Dans les réponses à l'enquête
lancée par le ministère de l'instruction publique français
auprès des instituteurs restés à l'arrière, des
remarques touchant aux difficultés économiques auxquelles font
face les populations sont souvent consignées. L'instituteur des Houches,
petite commune alpine écrit que « la disette de monnaie
divisionnaire se fait aussitôt sentir au point que le premier Août,
il était impossible de trouver à changer un billet de cinquante
francs chez tous les négociants du canton, mais même dans les
caisses publiques »447 . L'instituteur Marrulaz qui exerce
dans la commune de Morzine témoigne en 1916 du fait que « tout
a renchéri, la plupart des articles d'au moins un tiers, d'autres ont
fait plus que doubler, certains manquent complètement
»448. Jean-Claude Favez nous apprend qu'en Suisse, le prix
de la plupart des denrées alimentaire a doublé449.
Certains matériaux, nécessaires au fonctionnement des
écoles viennent à manquer comme le papier, si important pour tous
les exercices scolaires. Le directeur des éditions Payot adresse une
lettre au chef de la conférence intercantonale romande en 1917 pour lui
signifier qu'il ne pourra pas tenir le coût fixé pour l'impression
des manuels de cours de langue car le prix du papier a
446 Manon PIGNOT, « Les enfants », dans
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Jean-Jacques BECKER (dir),
Encyclopédie de la Grande Guerre, Paris, Bayard, 2004, p.
587-600, p. 595.
447ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur
des Houches à l'enquête du ministère de l'instruction
publique, événements du 1 Août 1914.
448 Ibidem, Réponse de l'instituteur de Morzine
à l'enquête du ministère de l'instruction publique, 16 Mai
1916.
449 Jean-Claude FAVEZ, « La suisse pendant la guerre
», dans Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Jean-Jacques BECKER
(dir), Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918, Paris,
Bayard, 2004, p. 815-824, p. 819.
129
augmenté de 80 % et ceux du carton 130 %450.
Il n'est d'ailleurs pas rare que des communiqués soient publiés
pour encourager les membres de l'instruction publique valaisanne à
réutiliser des papiers usés pour écrire leurs lettres - ce
qui sera fait. De même, de nombreux journaux tendent à
disparaître et L'école primaire s'en sort de justesse en
réduisant la taille de ses numéros.
La restriction est de mise, mais comment mener à bien
les exercices scolaires sans le support papier, indispensable à bien des
égards ? Concernant le matériel scolaire, les caisses des
écoles se vident : les subventions de la commune de Chamonix qui
s'élevaient à environ 2000 francs en 1914 tombent à un peu
plus de 1400 en 1915, soit une diminution d'environ un quart et seulement pour
la première année de guerre451. D'autant plus que les
autres sources de financement disparaissent également. La disparition de
la manne touristique influe directement sur les finances des écoles
alpines. Certes, au moment de la déclaration de guerre, certains
villégiateurs bloqués dans les stations alpestres sont
restés : l'instituteur des Houches témoigne du fait que
« plusieurs touristes en villégiature dans la commune ont tenu
à participer aux travaux et ont avec ardeur manié la fourche et
le râteau, faisant ainsi, d'un travail utile, un nouveau sport pour eux
»452. Mais à part ces menus actes de
solidarité, leur départ imminent entraîne une baisse
drastique de revenus pour les sociétés alpines qui vivent pour
une grande part de cette activité. À Saint-Gervais l'instituteur
en témoigne : « le commerce local a beaucoup souffert de la
guerre. Le pays étant un centre de villégiature, à la
déclaration de la guerre, les hôtels et les villas se sont
vidés. Ainsi, au grand hôtel, il y avait 172 pensionnaires, ils
n'en sont restés que 34. Même proportion pour les autres
hôtels »453. Cette situation joue sur l'instruction
à deux niveaux, d'abord à celui des écoles qui ne peuvent
plus compter sur le remplissage de leurs boîtes de collectes
placées dans les hôtels - ce qui est dommageable pour l'achat du
matériel scolaire - et ensuite, sur les communes elles-mêmes qui
financent leurs politiques scolaires sur ces mêmes revenus. Le chef de
l'instruction publique valaisanne confirme dans son rapport de 1914. Il
témoigne des manques à gagner dues « à l'exode
des étrangers aux premiers bruits de guerre [et] au brusque
arrêt de toutes les affaires durant la
450 AEV, 2 DIP 21, n° 63a, Lettre du directeur des
éditions Payot au chef de la conférence intercantonale romande,
10 Février 1917.
451 ADHS, 1 T 418, Délibération du conseil
municipal de Chamonix, 22 Mai 1915.
452ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur
des Houches à l'enquête du ministère de l'instruction
publique, événements du 3 Août 1914.
453 Ibidem, Réponse de l'instituteur de
Saint-Gervais à l'enquête du ministère de l'instruction
publique, non daté.
130
plus grande partie de la bonne saison
»454. Les pertes économiques engendrées par
la guerre influent alors directement sur la bonne marche des écoles.
D'ailleurs, celles-ci souffrent jusque dans leur bâti.
L'instituteur de Morzine indique que dans le village, les travaux ont
été réduits au strict minimum et les améliorations
ajournées455 : cet état de fait touche aussi les
bâtiments scolaires. En Août-Septembre 1918, le bulletin de
l'instruction publique haut-savoyard déclare que les écoles sont
en mauvais état mais que les travaux ne peuvent être
effectués en raison du coût et de la rareté des
matériaux456 : nul doute que la situation a été
semblable durant toute la guerre. Les conséquences de ce manque
d'investissement se font sentir : souvenons-nous des fragiles écoles de
hameau qui, à peine quelques années après leur
construction, nécessitaient déjà des travaux
conséquents en raison des mauvaises conditions climatiques. D'autant
plus qu'ici encore des inégalités spatiales se creusent entre les
écoles de montagne et les autres. Comme l'écrit Manon
Pignot457, l'enfance - sur tout le territoire et dans toutes les
classes sociales - connait le froid pendant la guerre il est vrai que les
pénuries de bois de chauffage ont durement impacté les foyers et
les salles de classes pendant les 4 années et demie de guerre. Il n'est
pas moins vrai que certains lieux ont été plus impactés
que d'autres, les écoles alpines ont dû particulièrement en
souffrir. En effet, si les sources sont avares en Valais, les archives
concernant Chamonix permettent de rendre compte d'une situation qui
paraît généralisable à l'ensemble des territoires
qui connaissent les rudes hivers alpins. La commune se fournissait en
anthracite à destination des écoles auprès d'un marchand
de Genève à raison de 40 tonnes par an - à 40 francs la
tonne - depuis 1913458, la guerre l'amène ses dépenses
à la baisse. La fermeture de la frontière oblige Chamonix
à se rabattre sur des marchands locaux dont les prix sont plus
élevés - notamment en raison de la disparition de la zone franche
qui garantissait des produits à bas coût. En effet, en 1916, le
conseil municipal passe un contrat avec un marchand local, Monsieur Valoud,
pour une quantité de seulement 19,5 tonnes au prix de 66,9 centimes la
tonne459. La baisse drastique de la quantité de combustible
pour nourrir les calorifères a nécessairement impacté la
scolarité des enfants
454 AEV, 1 DIP 29, Rapport sur la situation de l'instruction
publique, 1914, p. 31.
455 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur de Morzine
à l'enquête du ministère de l'instruction publique, 16 Mai
1916.
456ADHS, PA 68.3, 4600, Bulletin de l'instruction
primaire du département de la Haute-Savoie, n°8-9,
Août-Septembre 1918, p. 213.
457 Manon PIGNOT, Allons enfants de la patrie.
Génération Grande Guerre, Paris, Le Seuil, 2012, p.
107-114.
458 ADHS, 1 T 418, Délibération du conseil
municipal de Chamonix, 1913.
459 Ibidem, 1916.
131
des écoles de hameaux, encore plus si on pense à
l'état précaire des bâtiments. L'école, lieu
accueillant pour les enfants pendant la mauvaise saison, perd de sa superbe
lorsque la chaleur réconfortante des salles de classes n'est plus
garantie.
Il faut ajouter au froid la faim, bien qu'en
général les campagnes sont moins touchées que les
villes460. L'école primaire publie très
régulièrement à partir de 1915 dans son supplément
des « recettes économiques éprouvées »
qui se constituent souvent d'une soupe de pommes de terre : 1 litre et
demi d'eau, 500 grammes de pommes de terre, 100 grammes d'oignons, 50 grammes
de graisse, 40 grammes de farine, 10 grammes d'arôme Maggi, le tout pour
31 centimes de francs461. Les appels à la restriction sont
nombreux, parfois cyniques, le journal fait par exemple l'éloge du pain
rassis car « sous une moindre quantité, il nourrit mieux et il
est meilleur pour l'estomac [...] mastiqué avec soin, il prend
une saveur délicieuse que n'a jamais le pain frais
»462. Si les populations alpines pratiquent l'agriculture,
cette activité n'offre que peu de rentabilité en raison de la
rareté des surfaces cultivables et des conditions climatiques peu
clémentes, la principale activité est l'élevage, mais pour
nourrir ce bétail, les produits agricoles sont nécessaires.
L'importation est compromise, encore plus en Valais qu'en Haute-Savoie, le
conseil d'État publie une proclamation en 1916 annonçant «
le séquestre des pommes de terre » et conseillant de
nourrir le bétail, non plus avec la fécule et le grain de
maïs de privilégier l'orge et « les déchets divers
»463 . De l'autre côté des Alpes, ce sont
surtout les réquisitions de l'armée qui inquiètent
progressivement les habitants. Aux Houches, la première
réquisition de bétail - 20 vaches - le 7 décembre 1914
semble communément acceptée, de même pour celle du 21
Janvier, répartie le plus équitablement possible, la
troisième deux semaines plus tard, concernant une tonne d'avoine est
plus difficile car « dans la commune toutes les terres cultivables ont
été converties en prairies artificielles
»464. C'est surtout à partir de la quatrième
- 15 bêtes - que l'instituteur reconnaît qu'elle «
paraît devoir être acceptée plus difficilement »
d'autant plus que les habitants se plaignent du fait que les frais
d'expédition restent à leur charge465. Enfin le 22
Février 1917, l'armée demande 400 quintaux de foin, chose
460 Jay WINTER parle de « prospérité des
campagnes ». Voir « Les villes », dans Stéphane
AUDOIN-ROUZEAU, Jean-Jacques BECKER (dir), Encyclopédie de la Grande
Guerre...op.cit, p. 608.
461 « Recette économique éprouvée
», L'école primaire, n°2, supplément, 15
Février 1915, p. 40.
462 « Du pain rassis », L'école
primaire, n°3, supplément, 1915, p. 55-56.
463 « Une proclamation du Conseil d'État »,
L'école primaire, n°10, 15 Octobre 1916, p. 4-5
(frontispice).
464 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur des Houches
à l'enquête du ministère de l'instruction publique.
465 Ibidem, 13 Février 1915.
132
impossible pour la commune qui en propose l'envoi de seulement
175 466 . On sent ici l'amenuisement des ressources des communes
autant que la lassitude des habitants : il faut participer à l'effort de
guerre mais les réquisitions semblent les travailler à l'usure.
Cet exemple ne concerne pas directement l'école, il est vrai, mais il
offre un tableau assez large des conditions de vie - et morales - des
populations qui ne sont pas sans impact sur la scolarité des enfants et
la condition des enseignants. L'enfant a faim, l'enfant a froid, sur les bancs
scolaires, les objets de son quotidien d'écolier viennent à
manquer, il vit dans l'angoisse de la mort d'un proche - pour le cas
français - ce qui, pour finir, crée des expériences
scolaires bien différentes du temps de paix.
Un dernier point qui doit être abordé pour
approcher l'école alpine dans son fonctionnement local et quotidien, est
celui de l'accessibilité des lieux scolaires. Souvenons-nous de la
pétition des parents des élèves du hameau des Grassonnets
contre la fermeture de l'école fin 1914. Les mères comme
l'inspecteur insistaient sur le fait que l'isolement des hameaux était
accentué par le départ des hommes aux fronts, les
premières écrivaient que « cette année, la route
sera d'autant plus impraticable faute de bras pour l'ouvrir vu que tous les
hommes sont appelés sous les drapeaux »467, et le
second confirmait : « l'abattage de la neige sur les chemins est moins
facile à faire »468. Indices ténus à
nouveau, mais les habitants des hameaux déjà privés de
communications avec l'extérieur pendant la moitié de
l'année ont dû être encore plus entravés dans leurs
déplacements au sein même de leur lieu de vie.
L'impossibilité de déblayer les routes resserre encore les
frontières des hameaux de montagne, l'école isolée l'est
cette fois-ci pour de bon, et non dans les meilleures conditions.
Les institutions scolaires françaises et suisses
subissent de nombreux bouleversements suite au déclenchement du conflit
mondial. La guerre n'épargne pas l'école qui en subit les
conséquences des deux côtés des crêtes alpines.
Malgré les difficultés, le mot d'ordre est partout d'assurer une
marche normale des écoles. Cela est-il possible ? Même si
l'école reste ouverte, est-elle la même qu'avant le conflit ?
466 Ibid, 22 Février 1917.
467 ADHS, 1 T 418, Pétition des parents du hameau des
Grassonnets à l'intention du préfet, 25 Novembre 1914.
468 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 15 Janvier 1915.
133
CHAPITRE 9. L'école transfigurée
« Les écoles ont fonctionné comme
à l'ordinaire » écrit l'instituteur de Morzine en Mai
1916469. Que veut dire par là Antoine Marullaz ? Probablement
que les écoliers ont pu se rendre à l'école
quotidiennement. Cela, il est vrai, a été assuré par les
efforts conjoints de tous les acteurs de l'institution scolaire. Malgré
la mobilisation du corps enseignant, la désorganisation administrative,
les conséquences matérielles et économiques de la guerre,
l'école a tenu bon. Pourtant, l'événement guerrier a
violemment bousculé la manière de faire classe, que ce soit au
niveau des contenus ou des pratiques d'enseignement. L'école n'est pas
étanche aux mouvements de la société qui l'englobe. Le
conflit et les conséquences qui en découlent se font sentir
jusque dans sa chair - plus dans le cas français que suisse, il est
vrai. L'école devient ainsi l'usine du front, on ne compte plus les
initiatives, d'abord locales puis nationales de confection de vêtements,
de collectes de fonds, de nourriture au profit des soldats470. Elle
devient aussi le terreau de l'agriculture : l'implication des enfants et des
instituteurs dans la production agricole - d'ailleurs demandée par les
pouvoirs publics - favorise la mobilisation de l'institution dans le soutien
à la nation. Les différentes oeuvres scolaires - ouverture de
garderies, cantines gratuites, accueil des réfugiés, collectes
diverses...- poursuivent l'intégration de l'école à la
situation de guerre. Enfin, le renforcement de l'enseignement patriotique
national participe lui aussi à transfigurer l'école. En bref, la
guerre introduit des expériences scolaires particulières, en
rupture nette avec celles d'avant Août 1914.
A] L'école, usine du front, terreau nourricier de
la nation
Les écoles françaises s'investissent dans la
guerre. Partout sur le territoire, enseignants et élèves
s'appliquent pour confectionner des objets utiles aux soldats du front. Ces
initiatives sont souvent prises par les instituteurs et institutrices
eux-mêmes avant 1916 car, comme l'écrit
469 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur de Morzine
à l'enquête du ministère de l'instruction publique, 16 Mai
1916.
470 Voir Hugues MARQUIS, « L'École primaire de la
Charente dans la Grande Guerre. Un aspect de l'effort de guerre par la
mobilisation patriotique », dans Jean-François CONDETTE
(dir), Les écoles dans la guerre...op.cit, p. 137- 158, §
16 [en ligne] <
http://books.openedition.org/septentrion/7199>.
134
Stéphane Audoin-Rouzeau, le cadre de la
pédagogie de guerre est fort général durant les deux
premières années du conflit, laissant ainsi une assez grande
marge de manoeuvre aux instituteurs471. Les mots d'Albert Sarraut
l'illustrent bien : « je m'abstiens d'édicter, en ce qui
concerne les horaires et le programmes de ces classes exceptionnelles, le
moindre règlement général. Vous pourrez en varier
l'organisation selon la diversité des besoins locaux
»472. Drôle de paradoxe, c'est au moment où
l'école républicaine est le plus tournée vers la nation
qu'elle est en même temps soutenue par les initiatives locales : les
échelles s'imbriquent dans l'effort national. Les écoliers sont
donc mis à contribution dès l'école maternelle pour faire
de la charpie destinée aux coussins des trains sanitaires473.
Ils confectionnent également des passes montagne, des couvertures, des
chandails et des chaussettes474. Suite à la circulaire
Sarraut, le préfet de la Haute-Savoie adresse une lettre aux maires des
communes pour recommander l'emploi des femmes et des jeunes filles à la
confection d'habits, il propose aux communes d'ouvrir des ateliers partout
où faire se peut475 - ceux-ci prendront bien souvent place
dans les locaux scolaires des communes. Une année plus tard, le
Bulletin de l'instruction primaire revendique la fabrication et
l'envoi au front de plus de 10 000 objets476. L'implication de
l'école et de ses acteurs est forte et soutenue, l'instituteur des
Houches explique que dès le début de la guerre, les institutrices
de la commune ont participé à l'achat de la laine
nécessaire à la fabrication des gants, des mitaines et des
ceintures477. L'école devient une sorte d'usine du front.
Dans les salles de classe, au lieu des habituels leçons, s'ajoutent - ou
se substituent - les ateliers de confections d'objets à destination des
soldats. Les élèves sont directement concernés par
l'événement guerrier depuis les pupitres scolaires et sous
l'impulsion des enseignants. Lors de la conférence pédagogique du
canton de Thonon, tenue le 6 Novembre 1915, l'inspecteur primaire s'exprime
ainsi : « continuons à travailler pour les soldats
»478.
471 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, La guerre des enfants...
op.cit, p. 35.
472 ADHS, PA 68 3, 4600, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°9, Septembre 1914, p. 159-160.
473 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, La guerre des enfants...
op.cit, p. 222.
474 Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « Ce que la guerre fait
à l'institution : l'école primaire en France autour du premier
conflit mondial », Guerres mondiales et conflits contemporains,
2020, n°278, p. 5-22, p. 14.
475 ADHS, PA 68 3, 4600, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°10, Octobre 1914, p. 104-105.
476 ADHS, PA 68 3, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°10, Octobre 1915, p. 246.
477 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur des Houches
à l'enquête du ministère de l'instruction publique.
478 ADHS 1 T 294, « Conférences
pédagogiques cantonales. Conférences de l'Automne 1915 sur la
première guerre mondiale », conférence du canton
d'Abondance, 6 Novembre 1915.
135
Assez logiquement, les écoles valaisannes ne semblent
pas réquisitionnées de la sorte pour la confection d'objets
à destination d'un front qui n'existe pas. La nation helvétique
n'étant pas en guerre, les besoins de matériels pour
l'armée sont beaucoup moins conséquents. Néanmoins,
Françoise Breuillaud-Sottas remarque que dans les cantons romands - sans
que le Valais soit spécifiquement mentionné - plusieurs caisses
de vêtements sont envoyées en France sous l'initiative
d'institutrices en solidarité aux populations en guerre. Elle mentionne
également qu'une d'elles, exerçant à Neufchâtel, a
fait réparer des vêtements par ses élèves afin
qu'ils servent aux réfugiés479. Ces initiatives sont
pourtant isolées et les expériences scolaires en temps de guerre
divergent diamétralement sur ce point entre les écoles
françaises et les écoles suisses. Un autre aspect les rapproche
cependant tout en prenant des formes différentes : celui de
l'agriculture et de la mise à contribution de l'institution scolaire
pour assurer la culture des terres face à la menace grandissante de la
faim.
La Confédération suisse comptait beaucoup
avant-guerre sur ses importations en produits agricoles en provenance des pays
voisins. La fermeture totale puis partielle des frontières a largement
remis en cause ce modèle. En France, la guerre a aussi eu son lot de
conséquences sur l'agriculture - d'autant plus dans les pays montagneux.
Le manque d'hommes dû à la mobilisation force les deux pays
à se tourner vers de nouveaux acteurs pour assurer la culture des
champs. Qui mieux que les enfants et les enseignants restés à
l'arrière ? D'autant plus que les écoles comportaient
déjà des cours d'agriculture et que les enseignants s'acharnaient
à propager les meilleures techniques agricoles à travers les
campagnes. L'école a été moins regardante sur les absences
pendant les périodes de récolte, elle a également
joué un rôle de relais et de diffusion de l'urgence agricole,
celle-ci comptant dorénavant au nombre des actions patriotiques de
première importance.
En Valais, un instituteur appelle par exemple dès 1915
ses collègues à organiser des conférences d'agriculture,
à traduire des manuels pratiques, afin de « suppléer
à la cherté, la difficulté, à la lenteur des
approvisionnements du dehors »480. Il revient donc aux
instituteurs de continuer et d'intensifier leur travail de diffusion des
connaissances agraires, activité primordiale en temps de guerre. De
nombreux articles paraîtront pendant toute la durée de la guerre
dans l'École primaire pour inciter les valaisans à
rester à la campagne et valoriser la
479 Françoise BREUILLAUD-SOTTAS «
Réfugiés, évacués,et internés. L'accueil des
populations civiles dans le Nord de la Haute-Savoie au début de la
Grande Guerre. (Août 1914-Février 1915) », dans
Frédéric TURPIN (dir), Les Pays de Savoie... op.cit,
p. 235-264, p. 246-247.
480 « L'instituteur et la culture intensive du sol »,
L'école primaire, n°6, Juin 1915, p. 44-46, p. 44.
136
culture des champs contre les attraits de la ville :
thématique ancienne mais intensifiée dans les colonnes du journal
avec le manque prégnant de denrées agricoles. Pour exemple, dans
un article d'Octobre 1915, il est question d'élever les enfants dans
l'amour des champs, l'auteur se pose cette question : « Est-il
nécessaire de répéter cette recommandation dont les
événements actuels nous ont démontré si clairement
toute la valeur ? »481. Il poursuit en s'adressant aux
parents : « intéressez-les [les enfants] dès
leur plus jeune âge à tous les travaux. Expliquez-leur toute la
suite des phénomènes de la végétation. Qu'ils se
réjouissent avec vous du bon rendement de vos champs ; qu'ils vous
accompagnent au marché, aux foires, dans les expositions, partout
où ils pourront apprendre quelque chose se rapportant à
l'exploitation de vos terres. Ne craignez pas de leur faire donner des
connaissances théoriques et utilisez autant que possible les
écoles d'agriculture »482.
Il faut donc agir sur la jeunesse afin de pallier les
conséquences désastreuses du désintérêt
agricole. La guerre dévoile le manque d'éducation en ce domaine
au sein des écoles du canton. En 1917, un autre instituteur pointe le
fait que le canton ne possède pas - à l'inverse des autres
nations européennes - de jardins scolaires, plus qu'utiles dans le cadre
d'une pédagogie hors-les-murs « pour encourager l'adoption de
méthodes améliorées d'horticulture, d'arboriculture, de
viticulture etc »483. Ainsi, la guerre permet une prise de
conscience des limites de la politique scolaire valaisanne, mais les mesures ne
sont que prospectives, elles visent à corriger et à
prévoir un après, et non à modifier les pratiques
présentes. Avant le conflit, la politique scolaire du Valais
était déjà très conciliante vis-à-vis des
absences au moment des travaux des champs. Elle libérait même la
plupart des élèves à ce moment - souvenons-nous que les
écoles de montagne se terminaient en Avril et reprenaient en Octobre.
Une mesure effective est à noter cependant lorsqu'en Mars 1917, le
Département de l'instruction publique dispense les élèves
ayant échoué à l'examen d'émancipation d'effectuer
une année supplémentaire sur les bancs scolaires, et cela
« afin de favoriser la mise en culture des terrains et d'augmenter la
production agricole »484 .
Dans le cas français, les choses sont
différentes. Tout d'abord, la mobilisation plus massive et plus soutenue
de la population masculine se fait davantage sentir dans les territoires
481 « Élevons nos enfants dans l'amour des champs
», L'école primaire, n°8, Octobre 1915, p. 159.
482 Ibidem.
483 Raphaël MORET, « L'enseignement agricole dans nos
écoles primaire (suite) », L'école primaire,
n°6, Juin 1917, p. 43-44, p. 43.
484 « Dispenses scolaires », L'école
primaire, n°3, Mars 1917, p. 2 (frontispice).
137
ruraux. En plus de cela, la volonté d'assurer un
fonctionnement « normal » des écoles fait que les
élèves sont censés être scolarisés au moment
des travaux des champs. Il faut alors trouver des moyens d'assurer la culture
et les récoltes, ressources primordiales pour assurer la survie de la
nation dans la durée. Contrairement aux confections d'objets, ces
initiatives interviennent plus tardivement - à partir de 1916 - et sont
prises majoritairement « par le haut » au moyen de circulaires -
même si des initiatives locales les devancent. Le 10 Juin 1916, Paul
Painlevé, ministre de l'instruction publique, publie une circulaire
vantant « l'utilité des travaux horticoles auxquels peuvent se
livrer, durant leurs moments de loisir, les élèves de nos
lycées, collèges et écoles de tout ordre » et
leurs résultats « loin d'être négligeables,
à une heure où tous les bras disponibles doivent travailler
à tirer de la terre de France son produit maximum
»485. Ainsi, pour suppléer au manque d'hommes, les
enfants sont encouragés par l'institution scolaire à s'adonner
autant que faire se peut aux travaux agricoles durant leur temps libre. En
réalité - nous l'avons déjà mentionné -
l'école est beaucoup plus conciliante qu'auparavant concernant les
absences dues aux activités des champs. Les décisions sont
souvent prises au niveau local - comme dans le cas de Chamonix
évoqué dans le chapitre précédent. Les enfants,
sans oublier les femmes, vont remplacer les pères et frères
partis au front. L'instituteur de Morzine, Monsieur Marullaz, témoigne
de cette situation tout en la jugeant d'un regard cynique : « On
constate que les jeunes gens de 14 à 18 ans s'émancipent
rapidement : le père n'est plus là pour commander, la mère
est moins écoutée. La direction et la charge du travail leur
incombent, ils prennent la direction de la famille avec beaucoup de suffisance
et se croient des hommes »486. Toutefois, la mobilisation
de l'école dans les travaux agricoles se fait jusqu'alors hors les murs,
bien que les instituteurs soient utilisés comme relais de l'appel
national : en 1917, les choses changent. La circulaire de Viviani, alors
ministre de l'Instruction publique vient introduire les pratiques agricoles au
sein même de l'école. Les enseignements agricoles doivent
maintenant servir la production effective de denrées alimentaires. Sont
réquisitionnés pour cet objectifs, les jardins scolaires, les
champs de culture expérimentales des écoles et/ou - avec l'accord
des mairies - les terrains communaux laissés en friches - ces travaux
peuvent même empiéter sur les heures d'éducation
physique487. Cette fois-ci et à l'inverse du cas suisse, la
guerre modifie les pratiques proprement pédagogiques des enseignants et
enfants jusque sur le temps scolaire.
485 ADHS, PA 68 4, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°3-4, Mars/Avril 1916, p. 102.
486 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur de Morzine
à l'enquête du ministère de l'instruction publique, 16
Mai
1916.
487 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, La guerre des enfants...
op.cit, p. 223-224.
138
L'année suivante, dans une circulaire du 14 Janvier
1918, Lafferre se félicite des résultats et invite à
« intensifier l'effort accompli l'an dernier » afin
« que les surfaces cultivées par nos élèves
soient encore plus étendues cette année [...] Pour que
le nombre des animaux élevés soit plus grand, pour que les
cueillettes de plantes, les collectes de matériaux utiles à la
défense nationale soient plus fréquentes et plus abondantes
»488.
Comme l'écrit Emmanuel Saint-Fuscien : « la
guerre a transformé les pratiques pédagogiques comme elles ne
l'avaient jamais été dans l'histoire de l'éducation sur un
temps si court »489 . L'école a fonctionné
oui, mais les pratiques et contenus d'enseignement ont largement
été altérés. L'école française met
à contribution ses élèves dans des activités
proto-industrielles et agricoles, la faisant pleinement entrer au service de la
nation, d'abord à l'initiative des enseignants puis, au fil des mois,
à celle de l'État. On peut donc légitimement dire que
l'école est transfigurée par l'événement guerrier,
les expériences scolaires de ses acteurs s'en trouvent
profondément modifiées. L'école suisse, bien que moins
directement touchée est néanmoins traversée par la guerre,
l'encouragement dans les activités agricoles pour sauver la nation
helvétique en témoigne. Au-delà même de ces
nouvelles pratiques, l'appareil scolaire est imbriqué dans un tissu
d'oeuvres sociales qui, à nouveau, lui fait tourner tous ses regards
vers la nation - mais pas seulement.
B] L'école solidaire
Avec la guerre, les lieux et les personnels scolaires sont
encore plus investis qu'en temps normal en faveur des oeuvres solidaires.
Celles-ci prennent différentes formes, organisées pour des causes
locales, souvent nationales et parfois même internationales.
L'école devient le coeur d'un réseau de mobilisation solidaire
qui lui confère des nouvelles prérogatives - ou en intensifie
d'anciennes. Ces différentes actions transgressent les frontières
traditionnelles : l'école de montagne, dont l'isolement
géographique est renforcé durant cette période, est
paradoxalement mobilisée pour des causes qui étirent ses
frontières à l'extrême.
En France, les collectes de fonds pour différentes
oeuvres sociales prennent un essor sans précédent. Nous nous
appuierons ici sur le témoignage de l'instituteur des Houches,
très riche
488 ADHS, PA 68 4, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°1, Janvier 1918, p. 7.
489 Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « Ce que la guerre... »
op.cit, p. 6.
139
en détails, pour montrer que même dans les
villages alpins les plus aux marges de la nation, instituteurs, institutrices
et élèves s'organisent localement dans un soutien qui
débordent les intérêts locaux. Principalement à
partir de l'année 1915, les collectes de fonds se multiplient. Le 26
Mai, 218 francs sont récoltés pour la journée
française du secours national. Le lendemain, une autre collecte a lieu
dans les écoles pour une somme de 23 francs 35 centimes. Le 27 Juin, une
souscription pour la journée de l'orphelinat des armées rapporte
137 francs, le 4 Octobre, à l'occasion de la journée des
éprouvés de guerre, c'est un total de 176 francs. La vente de
cartes postales des 26 et 27 Décembre pour la journée des poilus
vient terminer l'année 1915 (122 francs). Continuons sur l'année
1916 : le 11 Juillet, la journée serbe collecte 77 francs, le 7
Septembre, la souscription pour les militaires tuberculeux de Haute-Savoie 46
francs490. Les oeuvres caritatives sont extrêmement
nombreuses, enseignants et enfants sont régulièrement
mobilisés pour les relayer, pour collecter des fonds. La population du
village est, quant à elle, sans cesse mise à contribution. Cette
brève liste, non-exhaustive, montre bien que les collectes se font pour
des causes diverses et variées dans leurs objets et dans leurs
échelles, allant des militaires tuberculeux hauts-savoyards au soutien
aux réfugiés serbes - remarquons cependant que ce sont les
oeuvres pour des causes nationales qui incitent à une contribution plus
généreuse. Au sein même de leur classe, les enseignants
renforcent - par des exercices bien choisis sur la guerre - la
solidarité avec les soldats du front, mais ils étendent
également cette solidarité aux nations alliées. En 1915,
lors d'une conférence pédagogique tenue dans le canton
d'Abondance, l'inspecteur primaire énonce à propos du programme
de géographie à destination des cours moyens : «
commençons par étudier l'Alsace, puis le bassin Parisien et
même le bassin de Londres - ne furent-il pas réunis pendant des
siècles ? Remontons vers le nord, la Belgique, la Hollande [...]
l'Autriche, l'Italie, puis les Balkans et la Russie. Disons pourquoi ces
pays sont convoités par les Boches »491. Face
à l'ennemi commun, la solidarité dépasse les limites de la
nation.
Localement, les enseignants primaires prennent une place
centrale dans la vie des villages en temps de guerre. C'est par exemple
à leur initiative qu'est créée l'association «
L'accueil français » en 1916 pour l'accueil des enfants
réfugiés492 ; C'est également eux qui, à
Chamonix,
490 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur des Houches
à l'enquête du ministère de l'instruction publique.
491 ADHS 1 T 294, Conférence du canton d'Abondance, 6
Novembre 1915.
492 ADHS, PA 68 4, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°3-4, Mars/Avril 1916.
140
se cotisent pour verser 200 francs à l'oeuvre de
l'orphelinat de l'enseignement primaire493. Plus largement,
l'instituteur organise des garderies au détriment de ses congés,
il devient un véritable administrateur local, il « est
sollicité pour dresser des bons de réquisitions, des passeports,
des états de denrées : il devient garde champêtre,
appariteur municipal, afficheur public ou gérant de boulangerie
coopérative »494 . Les acteurs de l'institution
scolaire débordent le cadre de l'école. En témoigne le
rôle des élèves, sollicités pour participer aux
collectes scolaires, et même incités à y contribuer
financièrement. Au sein même des classes, les correspondances
entamées avec les instituteurs mobilisés et plus largement, avec
les soldats du front, finissent d'intégrer l'école dans un
réseau solidaire qui recoupe les échelles à l'aune de la
guerre. Ici encore, les expériences scolaires sont largement
bouleversées.
Côté suisse, les écoles développent
là aussi des actions et des sentiments de solidarité qui
dépassent les reliefs helvètes. Ce sont moins les collectes
d'argent qui sont mises en avant - encore qu'elles existent - mais plutôt
un soutien idéologique aux nations alliées, surtout vrai pour la
Suisse Romande - nous y reviendrons. Si la nation helvétique n'a pas
été directement engagée dans la guerre, cela ne veut pas
dire qu'elle ait été strictement neutre, comme la reconstruction
des événements à posteriori - et le mythe national aidant
- ont pu le laisser penser495. L'exemple le plus frappant est
sûrement l'identification du pays à la Belgique dès les
débuts de la guerre. La rapide violation du statut de neutralité
belge a immédiatement provoqué des vagues de solidarité en
Suisse. En effet, « le plat pays » partage plusieurs
caractéristiques avec la Suisse - sauf évidemment l'adjectif
« plat » - que ce soit au niveau de sa taille modeste, de son
multiculturalisme revendiqué ou de sa position géographique :
nation proclamée neutre au milieu des belligérants. Le manque de
considération du statut belge et les exactions dénoncées
plus tard font craindre un sort semblable à la nation Suisse, non
assurée au début des hostilités du respect de sa
neutralité. Ainsi, les colonnes de l'école primaire vont
rapidement se couvrir d'articles de solidarité envers la patrie belge,
bafouée par les bottes allemandes. En septembre 1914, est publié
un article au nom éloquent « Le héros », dans lequel
est fait l'éloge
493 ADHS, PA 68 4, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°8, Août 1916.
494 Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « Ce que la guerre... »
op.cit, p. 10.
495 Charles HEIMBERG écrit que les mythes constitutifs
de la nation suisse (intelligence, neutralité, paix...) ont
été fort prégnant jusqu'au moins la Seconde Guerre
mondiale et qu'ils continuent d'infuser encore aujourd'hui. Voir «
L'histoire scolaire édifiante de la Suisse » dans
Benoît FALAIZE, Charles HEIMBERG, Olivier LOUBES, L'école
et la nation, Lyon, ENS, 2013, p. 45-55.
141
d'un bourgmestre belge ayant résisté à
l'envahisseur allemand496 . Suivra par la suite une multitude
d'autres papiers visant à « envoyer un salut d'admiration
ému au petit peuple qui défend avec un héroïsme digne
des temps anciens la liberté de son territoire et les droits de la
civilisation »497. La défense du peuple belge
glisse vers la défense des alliés et logiquement vers la
condamnation de l'Allemagne. Celle-ci perd son rayonnement d'avant, et
même des débuts, de la guerre. L'exemple le plus frappant est
peut-être dans les suggestions de sujets de rédaction à
destination des maîtres du canton en 1917 - extrait un peu long mais qui
mérite d'être cité :
« Depuis la guerre, vous vous intéressez plus
que jamais au pays et au peuple de Belgique. Pourquoi ? Dites ce que vous
pensez de l'héroïsme des Belges et de la conduite de leurs
Souverains, le roi Albert Ier et la reine Élisabeth ? Indications. - En
un court, mais substantiel récit, les élèves devront
résumer la partie de la guerre relative à la Belgique, montrer
l'injustice de l'envahissement de ce pays qui était neutre ; rappeler
son héroïque défense, les ravages irréparables commis
dans les villes et les cruautés dont furent victimes les habitants. Ils
s'étendront davantage sur le courage et la grandeur des Belges, à
qui leurs Souverains ont donné, et donnent encore de si admirables
exemples. Ils termineront, après avoir apprécié comme il
convient une telle conduite et en exprimant les sentiments de fraternité
effectifs que la France a voués à, jamais à cette
vaillante nation. »498.
Au-delà des élans de solidarité
idéologique, la Suisse accueille de nombreux réfugiés sur
son sol. Le 12 Novembre 1914, le Comité valaisan de secours pour les
Belges adresse une lettre au chef de l'instruction publique pour lui
transmettre une liste des enfants belges hospitalisés en Valais tenus de
fréquenter les écoles du canton : la liste ne compte que 8 noms
mais il est à n'en pas douter que le nombre n'a cessé d'augmenter
sur la période499. Les chiffres des Belges internés
nous sont inconnus mais pour exemple, le seul canton du Valais a accueilli plus
de 9000 internés français sur la période
1914-1918500. De plus, l'institution scolaire valaisanne ne se
contente pas de l'accueil des enfants sur les bancs scolaires, elle organise
également à partir de 1916, des conférences tenues par des
instituteurs auprès des internés français et belges
hospitalisés dans le canton « dans le but de familiariser les
internés [...] avec nos institutions
496 « Le héros », L'école primaire,
supplément au n°9, Décembre 1914, p. 95-96.
497 « L'éducation du patriotisme chez les belges
», L'école primaire, n° 4, Avril 1915, p. 25-27, p.
25.
498 « Composition française »,
L'école primaire, n° 3, Mars 1917, p. 23.
499AEV, 1 DIP 145bis, R 347, Lettre du
Comité valaisan de secours pour les Belges au chef de l'instruction
publique, 12 Novembre 1914.
500 Voir Marianne WALLE, « Les prisonniers de guerre
français internés en Suisse », Guerres mondiales et
conflits contemporains, n°253, 2014, p. 57-72.
142
politiques et militaires, avec notre histoire, notre
littérature, notre industrie, nos conditions économiques etc.
»501 . Ici encore, les sources sont avares, il faut
néanmoins remarquer que l'école valaisanne et plus largement
l'école suisse a elle aussi été bousculée dans ses
pratiques scolaires habituelles, que ce soit au niveau de la pédagogie -
défense de la Belgique et des alliés - et même de certaines
pratiques scolaires - accueil de réfugiés, investissement des
instituteurs pour les internés. Le pays a également
été secoué par de forts troubles politiques qui ont
directement impacté le bien-fondé du pacte national, faisant
craindre des risques de rupture, nous y reviendrons plus largement dans le
chapitre suivant. En France aussi, l'accueil massif de réfugiés a
eu des conséquences sur les pratiques pédagogiques,
entraînant dans certains endroits, la saturation des salles de classes -
ici encore, nous l'aborderons au moment d'analyser les territoires alpins dans
la guerre.
Après l'école usine, l'école terreau de
l'agriculture, l'école solidaire, il s'agit maintenant d'ajouter un
dernier aspect de l'école en guerre : l'école nationale. En
effet, si toutes les thématiques précédentes ont bien
montré la transfiguration des pratiques et expériences scolaires
pendant la période de guerre, il en est une autre qui cette fois
rapproche beaucoup plus les écoles françaises et suisses, c'est
l'importance pédagogique renouvelée que prend l'enseignement
national et patriotique.
C] L'école nationale et patriotique
Au déclenchement de la guerre, la Suisse traverse des
troubles politiques majeurs, le conflit est vecteur de tensions entre les
territoires de langue française et de langue allemande, chacun soutenant
plus ou moins le belligérant dont ils partagent la langue. Nous avons
déjà évoqué les échanges économiques
et culturels entre la Suisse romande et la France, les liens entre la partie
alémanique et l'Allemagne sont encore plus prononcés. Au
début du conflit, les oppositions déjà présentes
entre les deux Suisses sont poussées à leur paroxysme, si bien
que Pierre Du Bois parle de « menaces de désunion »
ressenties par les populations502. Du côté romand,
la violente politique de dénonciation de l'Allemagne est
contrebalancée par un soutien plus timide mais réel des cantons
alémaniques à l'empire de Guillaume II. La presse s'emballe,
501 AEV, 1 DIP 29, Rapport sur la situation de l'instruction
publique, 1914, p. 40.
502 Pierre DU BOIS, « Le mal suisse pendant la
Première Guerre mondiale : Fragments d'un discours sur les relations
entre alémaniques, romands et tessinois au début du
vingtième siècle », Revue européenne des sciences
sociales, n° 53, 1980, p. 43-66, p. 44.
143
l'armée est accusée de germanophilie et
d'espionnage anti-alliés, une enquête interne est ouverte et deux
colonels sont sanctionnés - de manière trop clémente pour
les romands503. Plus encore, des jeux d'influence des deux voisins
belligérants vont se dérouler au sein même du territoire
helvétique, là où la censure n'a pas muselé la
presse. Romands pro-français et alémaniques pro-allemands, tous
deux soutenus par les nations française et allemande vont alors
s'affronter au travers des journaux504. Dans ce tableau
dépeint à larges traits l'on observe à nouveau que la
guerre déborde ses frontières505 . Comment
préserver l'unité nationale ainsi menacée par la guerre ?
Plusieurs tentatives de la part d'intellectuels suisses prennent place,
notamment à travers la création de la Nouvelle
Société Helvétique, au premier Février 1914 afin de
travailler à la consolidation de l'identité suisse. Une branche
locale se forme d'ailleurs en Valais au 28 Novembre 1915, réunissant
entre autres des professeurs et des inspecteurs scolaires, dans le but de
« sauvegarder le patrimoine national, [...] fortifier le
sentiment national » et enfin « développer
l'éducation nationale »506 . Les objectifs que se
propose d'atteindre la société passent très largement par
l'éducation. En effet, l'école, par ses fins civiques et sa
capacité d'action sur le corps social, est l'outil
privilégié d'un tel projet. D'autant plus que les tensions
politiques se sont immiscées jusque sur les bancs scolaires. Pierre du
Bois, faisant référence à sa propre expérience
d'élève, souligne que « les rognes débordent
quelquefois le cadre des criailleries. Dans les écoles, les
élèves alémaniques et allemands sont l'objet de quolibets
ou de brimades »507. Dans le cas du Valais, le
dépouillement des archives fait apparaître les premières
agitations dues au bilinguisme du canton - situation qui ne semblait pas poser
problème auparavant. Le 14 Octobre 1914, le maire de la commune de
Savièse écrit une lettre au chef de l'instruction publique pour
se plaindre du fait que Monsieur Geiger - suisse allemand - n'envoie pas ses
enfants à l'école - francophone - du village. Il anonce qu'il lui
« paraît que lui [Geiger] et sa famille doivent
s'assimiler et s'habituer à vivre de la vie de la commune »,
rappelant que la famille Geiger est « dans une commune
française. Il n'avait qu'à s'établir à Sion s'il
voulait que ses enfants restent allemands »508 . Les
termes du maire de
503 Voir Jean-Jacques LANGENDORF, Pierre STREIT, Face
à la guerre. L'armée et le peuple suisses. 1914-1918 /
1939-1945, Infolio, Gollion, 2007.
504 Landry CHARRIER, « La neutralité suisse
à l'épreuve de la Première Guerre mondiale.
L'Internationale Rundschau, une entreprise de médiation internationale
», Histoire@Politique, n°13, 2011/1, p. 146-160.
505 Nous paraphrasons ici une phrase du
journaliste/écrivain Sorj CHALANDON à propos de l'IRA : « Je
trouvais étrange que la guerre déborde ainsi ses
frontières », Mon traître, Paris, Grasset, 2007, p.
84.
506 « Nouvelle société helvétique
», L'école primaire, n°10, 15 Décembre 1915,
p. 3 (frontispice).
507 Pierre DU BOIS, « Le mal suisse... » op.cit,
p. 60.
508 AEV, 1 DIP 145bis, Lettre du maire de Savièse au chef
de l'instruction publique, 14 Octobre 1914.
144
Savièse sont lourds de sens, et laissent clairement
transparaître le clivage culturel qui traverse la Suisse : la commune est
« française » et Geiger et ses enfants sont « allemands
», tous restent pourtant suisses. La politique scolaire du canton va alors
s'efforcer de mettre en application les idées de la Nouvelle
Société Helvétique, en 1916, le rapport annuel du
département de l'instruction publique insiste explicitement sur le
renforcement de l'éducation nationale dans les programmes du
supérieur au primaire509. La même année se
tiennent trois séances de la conférence générale
des chefs des départements de l'instruction publique - contre une au
maximum les années précédentes - avec pour sujet principal
« l'éducation nationale », de même pour la
conférence romande510. Les administrateurs scolaires ont
conscience du potentiel de gravité des troubles politiques qui agitent
le pays. Le modèle étatique fédéral n'est
sûrement pas le meilleur système pour coordonner les politiques
scolaires, mais c'est pourtant la première fois que tous les cantons se
mettent d'accord à différentes échelles - cantonale,
intercantonale, fédérale - de manière à oeuvrer
à l'intérêt général. Jusque-là
jalousement gardée, l'autonomie relative des cantons suisses est
temporairement mise de côté. Le temps de la guerre, il faut
insister sur l'helvéticité de l'ensemble du territoire
plutôt que sur ses particularismes si l'on veut sauvegarder
l'unité nationale. Le climat de tension retombe à partir du
milieu de l'année 1915, l'heure est à la conciliation. Un article
paru en Octobre 1915 dans L'école primaire l'illustre bien :
« A vouloir défendre une langue contre l'autre, à
s'acharner à ce jeu, ne court-on pas le risque de dépasser le but
proposé et de ne plus défendre la langue, mais la
mentalité même d'un pays voisin ? » et conclue
« nous devons conserver la mentalité suisse
»511. L'école suisse se nationalise, elle insiste
davantage sur les fins civiques de l'enseignement. Elle change
d'échelle, insiste davantage sur l'appartenance au territoire national
qu'au territoire linguistique ou même qu'à celui du canton. Jay
Winter écrit que les villes ont été nationalisées
pendant la guerre512, on peut aisément étendre la
remarque aux territoires ruraux : cette nationalisation passe largement par
l'école et l'objectif de communion nationale.
De l'autre côté des Alpes, en territoire
français, un phénomène similaire prend place, sauf qu'il
ne s'agit pas d'endiguer des conflits internes mais d'oeuvrer pour
l'unité nationale contre
509 AEV, 1 DIP 29, Rapport du département de l'instruction
publique, 1916, p. 6.
510 Ibidem, p. 38-39.
511 « Utilité des langues », L'école
primaire, n°8, 15 Octobre 1915, p. 166-167, p. 166.
512 Jay WINTER, « Les villes », dans
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Jean-Jacques BECKER (dir),
Encyclopédie de la Grande Guerre...op.cit, p. 601-610, p.
601.
145
l'ennemi qui la menace. À l'école, les
références spatiales changent, certes, la nation a toujours
été au centre de l'enseignement, mais elle coexistait avec des
entités territoriales plus restreintes, à l'échelle de la
région, de la petite patrie - sans d'ailleurs que l'une et l'autre
soient contradictoires car comme Chanet, Thiesse et d'autres l'ont
montré, l'enseignement scolaire utilisait souvent ces entités
locales comme des miniatures de la nation, englobées en
elle513. Dans le Bulletin de l'instruction primaire de la
Haute-Savoie, il n'y a plus aucune référence à des
événements locaux qui ne seraient pas directement en contact avec
la guerre et donc avec la nation. Les concours des sociétés
savantes locales, les articles d'histoire locale, les réunions des
sociétés comme celle des amis des arbres ou d'autres,
disparaissent.
De même au sein des séances du conseil
départemental de l'instruction publique, lorsque des personnages du pays
sont fêtés c'est parce qu'ils ont été cités
à l'ordre du jour, à l'image de l'instituteur Laponnier,
capitaine dans l'armée et cité au moins 5 fois entre 1916 et
1918514. Les instituteurs, eux aussi dans leurs réponses
à l'enquête, recensent tous les enfants du village morts au front,
tous les blessés mais aussi chaque décoration qu'un habitant de
la commune a obtenu pour ses faits d'armes contre les Allemands. Les contenus
pédagogiques se tournent entièrement vers la guerre, d'abord sous
les initiatives des enseignants et des revues pédagogiques avant que
l'institution reprenne la main : Stéphane Audoin-Rouzeau et Emmanuel
Saint-Fuscien l'ont trop bien décrit pour qu'il soit utile de s'y
attarder515. Néanmoins, les quelques mémoires
d'instituteurs préparés à l'occasion des
conférences pédagogiques conservés aux archives
départementales de la Haute-Savoie rendent bien compte du fait que toute
la pédagogie est tournée vers la guerre et vers
l'éducation patriotique. Pour exemple, Madame Thurin, institutrice de
Nouglar, écrit dans son papier : « le rôle de
l'école est de faire que le pays tout entier sache pourquoi il combat,
pour quelle histoire, pour quel avenir pour quels faits quelles idées
et, en éclairant ainsi de sa science le sentiment national, comme en
l'affermissant de son exemple, de l'entretenir et le fortifier dans une
confiance inébranlable et une volonté de victoire totale
». L'institutrice poursuit sur les pratiques d'enseignement qu'elle
met en place pour parvenir à ces fins : « Nous lisons beaucoup
: communiqués officiels, lettres de soldats patriotes, lectures sur la
guerre actuelle prises dans les « Livres roses », les
513 Voir entre autres, Jean-François CHANET,
L'école républicaine...op. cit et Anne-Marie
THIESSE, Ils apprenaient la France... op.cit.
514 ADHS, 1 T 1276, Réunion du conseil
départemental de l'instruction publique, 16 Février 1916, 30
Octobre 1917, 21 Février 1918, 30 Mai 1918.
515 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, La guerre des
enfants... op.cit, Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « Ce que la guerre...
»
op.it.
146
« Lectures pour tous », les journaux etc. »
mais encore « les dictées et les rédactions sont
empruntées à la guerre, nous apprenons des chants et
poésies patriotiques qui réveillent l'âme du peuple
»516.
A travers ce chapitre, nous avons essayé de montrer que
la guerre induit une rupture dans les pratiques pédagogiques et dans les
expériences scolaires que peuvent avoir enseignants et
élèves. Notre propos a été de faire voir que la
guerre ne s'arrêtait pas aux Alpes mais qu'elle traversait, sous
certaines formes, la Suisse, provoquant ici aussi son lot de bouleversements
dans la manière de faire école : « il n'y a pas besoin
d'une guerre pour avoir un temps de guerre »517.
Néanmoins il faut nous prévenir contre l'idée
d'établir un parallèle parfait entre la situation
française et celle suisse. L'école française et
l'école suisse sont transfigurées par la guerre mais n'oublions
surtout pas qu'une nation est en guerre et l'autre non. L'ampleur des
événements n'a aucune commune mesure d'un côté et de
l'autre des Alpes, il faut toujours avoir cette distinction cruciale en
tête. Même dans les moments où elles paraissent le plus
proche - comme dans cette sous-partie - les politiques scolaires divergent
fortement : l'école suisse se tourne entièrement vers la nation
oui, mais celle-ci n'est pas sous le feu des canons. L'école
française, elle, s'implique entièrement à enseigner le
patriotisme et à consolider le sentiment national, mais se surajoute une
culture de guerre, une expérience du deuil, sans équivalence en
Suisse, plutôt favorable à la paix - de plus en plus au fil de
l'avancée du conflit.
Toutefois, il ne faut pas non plus oublier que les situations
ne sont pas homogènes au sein même des nations. Là encore,
la dimension spatiale et la notion de frontière jouent un rôle
important dans l'analyse. Frontières nationales bien sûr, mais
aussi frontières internes : les territoires français de l'avant
ne sont pas impactés de la même manière que ceux de
l'arrière. La Haute-Savoie occupe d'ailleurs une place
particulière - dû autant à des imbroglios administratifs
qu'à la position géographique du département - que nous
tenterons d'éclaircir. Il faut ici pratiquer des jeux d'échelle :
à la question principale de cette partie « les Alpes
protègent-elles de la guerre ? » plusieurs réponses sont
possibles. On serait tenté de répondre par la négative car
les écoles alpines françaises ont été
impliquées dans l'événement guerrier, on peut aussi arguer
que les écoles valaisannes ont pâti du conflit, celui-ci a
modifié les manières de faire école outre-Alpes. Nous
devons pourtant nuancer ce constat en montrant que
516 ADHS, 1 T 294, Mémoire de l'institutrice Thurin
à l'occasion de la conférence pédagogique d'Automne
1915.
517 Phrase prononcée par Stéphane AUDOIN-ROUZEAU
lors du séminaire « La guerre transmise »,
co-organisé avec Emmanuel SAINT-FUSCIEN à l'EHESS, 22 Octobre
2021.
147
d'une certaine manière, les territoires alpins se sont
trouvés à l'écart d'une confrontation trop directe avec
l'appareil militaire.
148
149
CHAPITRE 10. Les territoires alpins dans la guerre
Les situations locales sont difficiles à
appréhender dans le moment de la guerre. Nous avons été
pris malgré nous dans l'événement guerrier, sa force de
mobilisation, son omniprésence dans les archives
raréfiées, nous éloignent involontairement d'une approche
du vécu local de l'école en milieu de montagne. Bien
évidemment, ce vécu quotidien est lui-même en grande part
animé par l'expérience guerrière, que ce soit à
l'école, dans les familles, dans la plus grande partie de l'espace
public et privé - surtout en France : partout la nation en guerre,
partout un frère, un père, un oncle sous les drapeaux. Notons
toutefois que la puissance de l'émulsion nationale, la dévotion
pour la patrie en guerre, tendent à gommer la complexité des
expériences sociales : celles-ci divergent selon les lieux.
De la même manière que les parents
d'élèves mobilisaient un discours stéréotypé
afin d'obtenir l'autorisation du contournement de certaines normes scolaires,
l'école adopte un discours de guerre de circonstance, non moins
empreints de stéréotypes valorisés par la conjoncture. Il
n'est pas ici question d'affirmer que les acteurs scolaires dissimulent
éhontément, sous un vernis patriotique, une indifférence
totale aux événements présents ; Non ! Mais les sentiments
co-existent sans s'annuler : l'angoisse peut côtoyer la lassitude, la
frustration accompagne la tristesse. Il est maintenant temps de revenir
à une analyse plus spécifique des territoires alpins en guerre.
Les situations sont plus originales que la mobilisation soutenue de la
société civile pour la nation peut le laisser penser.
L'école de l'avant n'est pas impactée de la même
manière que l'école de l'arrière et, en replaçant
ici la notion d'environnement alpin - et les représentations qui lui
donnent corps : l'école de plaine n'est pas non plus impactée de
la même manière que l'école de montagne. Plus encore, la
guerre ferme des frontières, elle en ouvre d'autres : tandis que les
limites étatiques s'affirment de toutes leurs forces, d'autres
s'étendent ou se rétractent. Par les jeux d'alliance, de
solidarité, la situation de guerre institue des espaces de jonctions
ponctuels, de nouvelles échelles d'identification, parfois plus larges
et plus visibles qu'en temps de paix.
A] La Haute-Savoie, un territoire éloigné
du front
Le front est lointain pour les habitants de la Haute-Savoie,
ses soldats combattent à la frontière pour défendre la
nation, mais ce département qui partage ses frontières avec d'un
côté
518 .
150
la Suisse, de l'autre l'Italie, n'est pas directement
menacé par l'avancée du front, du moins à partir du moment
où le conflit devient guerre de position, où l'avancée
ennemie jusque dans les montagnes reculées des Alpes semble improbable.
De même, en Valais, une fois les premières frayeurs dues à
l'invasion de la Belgique passées, le canton se sait hors de danger, sa
frontière avec la France n'est pas menacée - mais cependant bien
gardée. En France, la différence d'expérience vécue
entre les territoires de l'avant et ceux de l'arrière est très
marquée, elle se traduit dans la manière de faire école.
Certes, l'école se tourne vers la guerre, mais elle n'est pas
matériellement en guerre. C'est-à-dire, que ses locaux sont en
général plus épargnés au moment des
réquisitions par l'armée : la scolarisation poursuit son cours,
dans des conditions changées mais dans des lieux qui restent stables.
Emmanuel Saint-Fuscien écrit qu'en Octobre 1914, 2031 écoles sont
déjà réquisitionnées, ce qui impose aux «
écoles vacantes » de s'installer dans des lieux parfois insolites,
souvent inconfortables : salles de mairies, cafés...
L'occupation des locaux scolaires semble être une
constante des guerres modernes: ces bâtiments administratifs sont utiles
pour servir de quartier général aux forces armées et les
vastes salles de classe sont propices à l'installation des
blessés - Marc Bloch en rendra plus tard compte pour un autre
conflit519. Qu'ils soient réquisitionnés pour servir
de QG, d'hôpitaux, ou détruits dans les bombardements, les
bâtiments scolaires de l'avant souffrent de la guerre et avec eux les
populations d'élèves, d'enseignants, ou d'habitants en
général - déplacés au fil de l'avancée du
conflit, replacés dans des locaux précaires. Toutefois, Hugues
Marquis montre - en prenant la Charente comme terrain d'étude -
qu'à l'arrière aussi les bâtiments scolaires peuvent
être réquisitionnés, entraînant également une
relocalisation des enseignements scolaires pas toujours
aisée520.
Et pourtant en Haute-Savoie, aucune réquisition
d'école n'a lieu, c'est du moins ce qu'affirme l'inspecteur
d'académie dans son rapport annuel sur l'année
1915-1916521. Pourquoi cela quand l'on sait que la frontière
savoyarde est traversée par le flux des internés de guerre
soignés en Suisse lors de leur retour en France ? La réponse est
étonnante et demande de revenir
518 Emmanuel SAINT-FUSCIEN, « Ce que la guerre... »
op.cit, p. 11.
519 March BLOCH, L'étrange défaite,
Paris, Gallimard/Folio, 1990 [1946]. On pense ici aussi au film de Claude
BERRI sur un village au moment de la libération suite à la
Seconde Guerre mondiale : Gérard Depardieu joue dans le rôle de
Léopold, le tenant d'auberge du village, ravi d'accueillir la classe
d'école dont les locaux ont été bombardés :
Uranus, France, 1990 (Adaptation du roman du même nom de Marcel
Aymé [1948]).
520 Hugues MARQUIS, « L'École primaire de la
Charente dans la Grande Guerre. Un aspect de l'effort de guerre par la
mobilisation patriotique », dans Jean-François CONDETTE
(dir), Les écoles dans la guerre...op.cit, p. 137158, § 13
[en ligne] <
http://books.openedition.org/septentrion/7199>.
521 ADHS, PA 68 4, 4601, Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie, n°9-10, Septembre/Octobre 1916, p.
175.
151
un siècle plus tôt. Le congrès de Vienne,
signé en 1815 après les défaites napoléoniennes,
rendait les territoires de la Savoie au Royaume de Sardaigne - après
leur brèves parenthèse française - tout en instaurant la
fameuse zone franche dont nous avons déjà parlé entre le
canton suisse de Genève et une grande part du territoire savoyard. Il
prévoyait également la neutralisation militaire de la zone en cas
de conflit armé entre les voisins de la Suisse et même la
possibilité pour cette dernière d'occuper militairement la Savoie
du Nord522. Lors du passage de la Savoie - divisée ensuite en
deux départements - à la France, en 1860, les clauses du
congrès ne sont pas abolies. Ainsi un flou persiste sur cette zone qui
recouvre presque 90 % du territoire haut-savoyard. Évidemment, un
siècle plus tard, il est impensable que la Confédération
Suisse envoie son armée occuper la Savoie française, même
en cas de conflit. Toutefois, les clauses de neutralisation sont restées
dans les esprits, si bien qu'au déclenchement de la guerre, seuls 157
soldats blessés sont envoyés dans le département pour
recevoir des soins puis, en raison du statut du territoire, sont
internés sans possibilité de réintégrer
l'armée avant 1915523. Justement, cette même
année, la Suisse profère finalement son accord pour que des
hôpitaux militaires soient installés dans la zone, sauf
qu'à ce moment-là, la plupart des organisations de secours sont
déjà installés hors-zone, principalement dans le
département de la Savoie où elles resteront jusque-là fin
de la guerre - à l'exception de la ville de Thonon524. En
résumé, pour des raisons administativo-politiques qui n'ont aucun
rapport avec l'environnement alpin, le département de la Haute-Savoie
est protégé d'une confrontation trop directe avec l'appareil
guerrier : sur son sol, pas de réquisition de locaux scolaires, pas de
soldats blessés ; le paysage alpin n'est finalement pas un paysage en
guerre, ou alors, les conséquences en sont moins présentes
qu'ailleurs.
Insérons maintenant quelques nuances au sein même
du département. Certes, ni bombardements, ni pilonnages, ni
réquisitions et transformations de locaux scolaires n'ont lieu sur le
territoire haut-savoyard525, mais dans le même temps les
réfugiés belges et français des régions
dévastées affluent vers les lieux épargnés par la
guerre, 13 500 seront accueillis entre 1914 et 1918526. Les
réfugiés ramènent la guerre dans les Alpes, leurs
récits sur les horreurs du
522 Hans Rudolf FUHRER, Mauro CERUTTI, Marc PERRENOUD, Markus
BÜRGI, « Guerre mondiale, Première », dans
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) [en ligne] Guerre mondiale,
Première (
hls-dhs-dss.ch).
523 Sébastien CHATILLON, « Le régime des
zones franches franco-suisses en 1914 : objet de tensions diplomatiques »
dans Frédéric TURPIN (dir), Les Pays de Savoie...
op.cit, p. 70-72.
524 Ibidem.
525 Ce qui donne au département une situation à
part au sein même des territoires de l'arrière.
526 Frédéric TURPIN (dir), Les Pays de
Savoie... op.cit, p. 11.
152
front, la narration de leur exil permettent - à
l'instar des permissionnaires - de tisser un fil qui rattache la nation
combattante et celle de l'arrière. Toutefois, en y regardant de plus
près, les réfugiés sont accueillis dans les
vallées, souvent dans les villes les plus importantes du
département - comme Annecy, Thonon, Bonneville, La Roche ou Cluses.
Françoise Breuillaud-Sottas, en étudiant l'accueil des
réfugiés dans l'arrondissement de Thonon remarque que les cantons
de montagne ne reçoivent pas, ou très peu de
réfugiés. Pour exemple, en Septembre 1915, les cantons montagneux
n'en ont reçu aucun alors que le département en a
déjà accueilli plus de 4000527. Effectivement, en
regardant de plus près les archives, on se rend compte que lorsque le
conseil municipal des Houches vote chaque année une subvention aux
réfugiés, celle-ci est toujours adressée à
l'association pour les réfugiés qui se situe à
Bonneville528, dans la ville de plaine, jamais à la montagne.
D'ailleurs, dans les inspections des instituteurs de la commune de Chamonix
pendant la guerre, il n'est jamais fait mention de la présence de
réfugiés dans les classes, ni d'une surpopulation des locaux
scolaires liée à un fort afflux de personnes. Pourquoi les
réfugiés sont-ils absents de ces lieux ? Les raisons
invoquées sont liées à la géographie physique,
justifiées par les difficultés de transport inhérentes aux
communes de montagne. Certes, nous l'avons montré, l'hiver n'est pas
tendre avec les territoires alpins, surtout lorsque la guerre a retiré
les bras utiles au déblayage des routes et chemins. Toutefois, certains
bourgs - pas les hameaux - ayant profité de la manne touristique pour
développer leurs infrastructures de transport et leurs capacités
d'accueil semblent tout indiqués pour accueillir ces populations.
Souvenons-nous que les lieux de villégiature se vident : Chamonix qui
possède une voie ferrée529 et reçoit plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs chaque année dans ses spacieux
hôtels, possède une capacité d'accueil des centaines de
fois supérieures à son nombre d'habitants. Et pourtant, les
réfugiés n'y sont pas dirigés. Les raisons sont
sûrement complexes mais, il est à notre sens utile
d'évoquer la représentation que l'on se fait de la montagne comme
moteur de ce choix. Même les lieux les plus visités, les plus
renommés souffrent de l'image persistante de la montagne comme
territoire de l'isolement - ce qu'elle est parfois, surtout en hiver et dans
les hameaux. Objectivement, ceux-ci disposent des ressources nécessaires
pour faire face à l'exode des populations de l'avant, mais, en suivant
George Bertrand, les sociétés
527 Françoise BREUILLAUD-SOTTAS «
Réfugiés, évacués, et internés. L'accueil
des populations civiles dans le Nord de la Haute-Savoie au début de la
Grande Guerre. (Août 1914-Février 1915) », dans
Frédéric TURPIN (dir), Les Pays de Savoie... op.cit,
p. 236 et 240 ;
528 Ainsi 50 francs sont alloués en 1915 puis 70
l'année suivante etc. Voir ADHS, 8 R 140, Réponse de
l'instituteur des Houches à l'enquête du ministère de
l'instruction publique.
529 D'ailleurs utilisée pour le transport de bêtes
à destination de l'armée.
153
« ne sont pas directement influencées par leur
environnement agroécologique du moment, mais par la projection sur ce
dernier de tout l'héritage écologique, de tous les fantasmes et
de toutes les cosmogonies façonnées au cours des siècles
»530. Ici, pas de déterminisme géographique
strict, mais un état de fait justifié par les
représentations des autorités vis-à-vis des lieux de
montagne. En bref, cela a pour effet d'introduire à nouveau des
différences dans le vécu de la guerre par les populations des
plaines et celles des montagnes : différences qui influent sur les
manières de faire école, sur la plus ou moins grande
proximité d'avec le conflit selon les lieux.
Manon Pignot insiste elle aussi sur la sensation de distance
qu'entretiennent les populations de l'arrière - au premier chef les
enfants - par rapport à la guerre. Tout en ayant donné le plus
d'hommes à la nation, les campagnes semblent plus distanciées
avec l'événement, les moyens d'informations circulent
moins531, les discours de guerre ne semblent pas toujours
acquérir un fort écho. Cela se traduit dans les travaux des
enfants qui, eux aussi, savent ce que l'institution scolaire attend d'eux dans
cette conjoncture particulière : la fougue patriotique attendue fait
place à un discours normé qui n'en garde que la forme. Même
les jeux de guerre, très présents au début du conflit,
s'effacent au profit des jeux « normaux », ceux d'avant les
hostilités532. La guerre rend las, les enfants ont du mal
à s'identifier aux réalités quotidiennes d'autres
personnes, d'autres enfants qu'ils ne voient pas, qu'ils ne fréquentent
pas et ce, malgré les sollicitations continuelles de l'institution
scolaire pour exalter leur sentiment d'appartenance nationale.
« Pour lui qui n'a jamais quitté son village,
qui n'a rien vu au-delà du coin de terre dans lequel il vit, il est
déjà difficile de comprendre que ce coin de terre qui lui
paraît immense, n'est qu'un point imperceptible dans ce grand pays qui
est le sien et qu'on appelle la France »533. Cette phrase
aux accents misérabilistes qu'on trouve dans l'introduction de
l'abrégé d'histoire de Savoie a peut-être plus de sens
lorsqu'on l'applique aux enfants. Voilà l'impossible communion
nationale, les limites de l'extension scalaire que propose la pédagogie
des petites patries - plus encore dans un pays relativement
protégé des affres du conflit. Stéphane Audoin-Rouzeau
termine d'ailleurs son ouvrage sur l'enfance en guerre en écrivant que
les enfants font
530 Georges BERTRAND, « Pour une histoire
écologique de la France rurale, l'impossible tableau géographique
», Dans George DUBY Armand WALLON (dir.), Histoire de la
France rurale, t. I, Paris, Le Seuil, p. 8-118, p. 109, cité par
Nicolas ELLISON, Semé sans compter, Paris, Éditions de
la Maison de l'Homme, 2013, p. 110.
531 Manon PIGNOT, Allons enfants... op.cit, p.
204-206.
532 Ibidem, p. 334-338.
533 F. CHRISTIN, F. VERMALE, Abrégé...op.cit,
p. V-VI.
154
finalement souvent preuve d'indifférence face à
la guerre534. Au-delà même des enfants, les sentiments
et les pensées de l'ensemble des membres de l'institution scolaire ne
tournent pas en permanence autour de celle-ci, c'est ce qu'on remarque dans les
rares dossiers d'inspection conservés sur la période. Il n'est
presque jamais fait mention de la guerre : l'inspecteur primaire visite Madame
Perrin, institutrice à Chamonix le 30 Mars 1917, il félicite
l'enseignante pour son bon travail auprès des élèves,
allant même jusqu'à écrire que, dans sa classe on
« est habitué à la discipline au travail régulier
et joyeux » 535 - adjectif qui ne nous viendrait pas naturellement
à l'esprit en considération des événements.
Manon Pignot écrit quant à elle : « Il
y a sûrement plus de points communs entre une jeune française et
une jeune allemande vivant chacune en situation d'occupation - allemande ou
russe - qu'entre une Auvergnate et une Sedanaise, fussent-elles du même
âge »536. Cette phrase insiste sur la puissance de
l'expérience de l'occupation, elle perce audacieusement une
brèche dans le cadre de référence nationale souvent choisi
dans l'historiographie de la Grande Guerre : en posant apriori
l'homogénéité d'une culture nationale, on en oublie de
considérer la complexité des expériences
vécues537. En reprenant la proposition et en l'inversant,
nous nous demandons à notre tour s'il n'y a pas plus de points communs
entre un écolier haut-savoyard habitant une commune de montagne et son
voisin valaisan qu'entre ce premier écolier et son concitoyen des
territoires de l'avant ?
Poser une certaine similarité dans le vécu des
habitants de montagne indépendamment de leur nationalité ne doit
pas non plus faire oublier que les frontières physiques entre les deux
territoires de l'étude n'ont jamais été aussi
étanches.
B] La fermeture des frontières
Avec l'entrée en guerre, les frontières
étatiques prennent toute leur force de rupture. Nous l'avons
évoqué, le cadre spatial de référence est plus que
jamais incarné par la nation, reléguant d'autres formes de
territorialités à l'arrière-plan. Lorsque la guerre est
déclarée, les frontières se ferment. Celle entre la
vallée de Chamonix et la vallée du Trient, dont la
traversée venait tout
534 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, La guerre des enfants...
op.cit, p. 248-249.
535 ADHS 1 T 737, Dossier individuel de l'institutrice Pauline
Perrin, rapport d'inspection du 30 Mars 1917.
536 Manon PIGNOT, Allons enfants... op.cit, p. 338.
537 C'est peu ou prou l'idée principale contre laquelle se
dresse Nicolas MARIOT dans son ouvrage : Tous unis dans la tranchée
? Paris, Seuil, 2013.
155
juste d'être facilitée par l'ouverture de la
ligne de chemin de fer Chamonix/Martigny - celle-là même qui a
causé tant de soucis aux autorités scolaires en raison des
populations ouvrières italiennes - est brutalement close. De tentative
d'en faire un espace de jonction, la frontière alpine s'affirme comme
espace de disjonction. Dès le premier Août, l'instituteur des
Houches en rend compte : « 9h du soir : Délivrance de
sauf-conduits pour la frontière du Valais de trois allemandes, dont
l'une, Madame Grégory, femmes d'un officier allemand de Leipzig
»538. Les villégiateurs allemands sont autant de
potentiels ennemis, les conduire en Suisse, à quelques kilomètres
de là, est la priorité des autorités locales dès le
déclenchement de la guerre. Neuf jours plus tard, la commune met en
place des corps de gardes civils, armés par les fusils de la
société de tir que dirige l'instituteur, un corps est
dépêché à la frontière du Châtelard -
celle avec le Valais - afin de surveiller les étrangers sur les voies de
communication539. Le territoire se nationalise : les
étrangers, auparavant bien reçus car si importants pour
l'économie locale deviennent suspects.
La frontière qui n'existait presque pas pour
l'économie du voyage marque maintenant une nette séparation. Les
cours d'allemand organisés dans bien des localités touristiques
cessent : Monsieur Schütt, qui donnait depuis 1908 des conférences
gratuites pour les enfants de guides de Chamonix est lui aussi reconduit. Si
quelques années plus tôt l'inspecteur primaire regardait d'un bon
oeil cet enseignement, « répondant à une
nécessité locale »540 - et se disait curieux
d'y assister - le discours change, les nécessités locales se
diluent dans celles nationales. Ainsi, lors des conférences
pédagogiques à l'Automne 1915 dans les cantons de Thonon et
d'Abondance, les conclusions de la circulaire ministérielle du 10
Septembre 1915 sur la répercussion des événements de la
guerre à l'école primaire sont reprises par les inspecteurs et
instituteurs haut-savoyards. Au sujet de la continuité ou l'arrêt
de l'enseignement de langue allemande dans les écoles, la consigne est
la suivante : « Les langues nous révèlent le secret des
incompatibilités entre les civilisations » 541 avec ses
variables plus concises et violentes « Incompatibilités des
mentalités françaises et boches » 542 . Qu'ils soient
volontairement renvoyés hors du territoire français - comme dans
le cas des Allemands - ou qu'ils partent en raison des circonstances - c'est le
cas des villégiateurs - les éléments étrangers sont
épurés du
538 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur des Houches
à l'enquête du ministère de l'instruction publique,
événements du 1 Août 1914.
539 Ibidem, Événements du 10 Août
1914.
540 ADHS, 1 T 418, Lettre de l'inspecteur primaire à
l'inspecteur d'académie, 31 Octobre 1908.
541 ADHS 1 T 294, Conférence du canton de Thonon, 15
Novembre 1915.
542 Ibidem, Conférence du canton d'Abondance, 6
Novembre 1915.
156
territoire haut-savoyard. La frontière avec le Valais
endosse alors une nouvelle fonction, elle devient une limite d'exclusion et ce,
même pour les populations touristiques. C'est pourtant celle entre
département et le canton de Genève qui entraîne les plus
lourdes conséquences. Nous avons évoqué dans le chapitre 4
la forte dépendance économique des deux territoires, en grande
partie due à l'existence de la zone franche. Les conséquences de
sa fermeture sont lourdes. Justinien Raymond évoque les chiffres des
exportations qui passent de 25,4 millions de francs en 1909 à 5,4 en
1918543. Paul Guichonnet et Claude Raffestin écrivent que
cette frontière - qui n'en avait que le nom avant 1914 - devient presque
hermétiquement close pendant le conflit544. Pour donner un
exemple de la force de cette rupture, le conseil départemental de
l'instruction publique prononce, en 1917, une peine disciplinaire contre
Mademoiselle Dalmaz, institutrice d'école privée à
Megève en raison du fait qu'elle « a essayé, le 4
août 1916, d'exporter à Genève (Suisse) une somme de 60
francs composée de 12 pièces de 5 francs en argent
dissimulée dans ses vêtements et dans un sac à main
». L'institutrice est accusée « d'inconduite et
d'immoralité » ainsi que d'avoir manifesté «
des sentiments peu patriotiques ». Elle sera finalement
condamnée à l'interdiction d'enseigner dans la commune de
Megève, le Conseil considérant « qu'elle n'a plus
l'autorité morale nécessaire »545. La peine
est somme toute assez lourde au vu des faits, indice à nouveau de
l'importance renouvelée que prend le patriotisme guerrier et la
sémiotisation de l'espace qu'il opère. Les conséquences de
la fermeture frontalière sont certes économiques, mais aussi
sociales. La métropole la plus proche du département est
Genève. Avant-guerre, on avait l'habitude d'y vivre, d'y travailler, d'y
commercer mais également de s'y faire soigner. L'instituteur de Morzine
note que le service médical est bouleversé et que « les
maladies sont de plus en plus nombreuses ». Il en impute la cause
à l'opacité sans précédent qui entoure les limites
du département : d'habitude, les soins se font pour grande part à
Genève « mais les passeports causent des retards bien
pénibles pour les malades. Les médecins sont très rares
à Thonon et surchargés, il est très rare de pouvoir
obtenir qu'ils viennent à domicile vu la distance. Si les
communications entre les deux territoires étaient auparavant fluides, la
guerre bouleverse largement les habitudes de vie de ces populations, modifiant
nécessairement leur manière d'appréhender leur espace.
Elle impacte directement la territorialité des acteurs historiques, elle
insère des espaces de rupture là où il n'en existait
pas,
543 Justinien RAYMOND, La Haute-Savoie sous la
IIIe République... op.cit, p. 38-70.
544 Paul GUICHONNET, Claude RAFFESTIN, Géographie des
frontières, op.cit, p. 184.
545 ADHS, 1 T 1276, Réunion du Conseil
départemental du département de la Haute-Savoie, Séance du
2 Avril 1917.
157
elle nationalise l'espace et donne au tracé
immatériel des frontières, une consistance réelle.
Sébastien Chatillon introduit une nuance en écrivant que la
frontière n'est pas totalement fermée : le canton du Saint-Julien
continue d'approvisionner Genève en produits maraîchers et chaque
zonien est autorisé à passer la frontière avec 10 kilos de
beurre et 5 douzaines d'oeufs546. Reste que cela est
dérisoire en comparaison des flux d'échanges avant-guerre.
La fermeture d'une frontière en suppose parfois
l'ouverture d'une autre. Évidemment pas sous les mêmes formes,
celles-ci sont plus idéologiques que pratiques, ce qui n'enlève
rien à leur réalité.
C] Nouvelles frontières ?
En Suisse, la position de neutralité officielle de
l'État fédéral n'autorise en théorie pas de prise
de position trop tranchée en faveur de l'un ou de l'autre des
belligérants. Nous avons vu que dans les faits, cette règle est
largement transgressée, apportant son lot de tensions au sein même
du pays. Toutefois, il faut donner les atours d'une impartialité feinte
à de nombreux actes qui, en réalité, traduisent bien de
solidarités envers les nations en guerre. En Valais, la presse
pédagogique, incarnée par L'école primaire,
adopte un positionnement ambigu face à l'événement
guerrier qui tente de concilier les différentes caractéristiques
culturelles du canton. Si la condamnation des Allemands n'est jamais
explicitement évoquée dans les publications, on remarque que dans
quasiment chaque numéro, des articles - parfois reproduits de journaux
français - content sur un ton compassionnel, les expériences de
guerre des alliés - surtout celles des soldats français. Le fait
que ces articles n'aient pas d'équivalent sur la situation allemande
informe déjà du parti pris au sein du canton. Dans le
numéro du 15 Novembre 1914, un article intitulé « La
leçon d'histoire » raconte la bravoure d'un instituteur
français au temps de la guerre franco-prussienne, faisant sa
leçon sur les victoires de Napoléon face à
Frédéric-Guillaume avant de mourir d'une balle prusse au milieu
de sa classe547. Le texte est directement suivi par un autre
comptant les victoires de Napoléon ! Les références ne
sont pas directes, il n'empêche que dans le contexte du début de
guerre, elles ne sont évidemment pas le fruit du hasard. La
partialité du journal devient de plus en plus explicite, dans le
numéro du 15 Janvier
546 Sébastien CHATILLON, « Le régime des zones
franches franco-suisses en 1914 : objet de tensions diplomatiques »
dans Frédéric TURPIN (dir), Les Pays de Savoie...
op.cit, p. 76.
547 R. LAMOTTE, « La leçon d'histoire »,
L'école primaire, n°10, supplément, 15 Novembre
1914, p. 105-108.
158
1916, ce ne sont pas moins de trois articles qui reproduisent
des récits des expériences de guerres par des français -
« La permission », « La tarte », « Les blessés
» 548 . Toutefois, l'originalité des publications valaisannes est
de privilégier - à l'instar des emprunts d'articles
pédagogiques - des textes qui font mention de la religion
chrétienne, de Dieu. On trouve ainsi, le 15 Février 1917,
« simple médiation des poilus » papier
rédigé par P. Bottinelli, brancardier français, dans
lequel il s'adresse directement au Seigneur pour conter les horreurs de la
guerre et les espoirs de victoire549. Même chose quelques mois
plus tard, en Novembre, lorsque paraît l'article « Fleurs de la
guerre » dans lequel les campagnes françaises sont comparées
aux campagnes suisses pour leur qualités morales et leur
dévotion, l'article conclut ainsi : « Voilà la France.
Laborieuse, active, simple, idéale, imprégnée
malgré tout de croyance religieuse, de sain mysticisme et de divine
charité. Cette France-là ne saurait périr : ne porte-elle
pas en elle-même des germes d'immortalité ?
»550.
Il est évident qu'une grande part des récits de
guerre français ne comporte pas de mention explicite de Dieu : la
sélection du journal relève d'un choix conscient. Insister sur la
dimension chrétienne de la nation française sert à
favoriser l'identification du canton, profondément empreint de la foi
catholique, à son voisin d'outre-Alpes. Nous avions déjà
évoqué que malgré un référentiel culturel
commun, les principales divergences pédagogiques et idéologiques
entre les deux territoires portaient sur la place de l'Église catholique
dans la société. En montrant la pieuté des soldats
français, le journal ne peut que renforcer la compassion ressentie pour
le peuple ami dont les valaisans partagent la langue. Paradoxalement, les
références catholiques ont ici pour conséquence
d'intégrer un peu plus le canton suisse à la guerre, du moins au
niveau idéologique : elles ouvrent un espace de solidarité
élargi à l'extérieur des frontières suisses.
Pourtant, ces mentions fréquentes de la religion
servent dans le même temps à prôner la paix.
Déchirée entre deux positions et tributaire de sa
neutralité, la Suisse ne peut que raisonnablement se tourner vers la
paix. L'ordre de priorité est inversé : dans le cas du soutien
aux alliés, c'est d'abord la nationalité du « héros
» qui compte, puis la religion prend un rôle de renforçateur
; ici c'est l'appartenance commune de tous les belligérants à la
communauté chrétienne qui l'emporte551. Rita
Hofstetter, dans un article sur l'histoire de l'enseignement
548 L'école primaire, n°1,
supplément, 15 Janvier 1916.
549 P. BOTTINELLI, « Simple médiation des poilus
», L'école primaire, n°2, supplément, 15
Février 1917, p. 36-37.
550 « Les fleurs de la guerre », L'école
primaire, n°9, supplément, 15 Septembre 1917, p. 186-187.
551 Un discours ne remplace pas l'autre, les deux coexistent
même si numériquement, c'est les articles en faveur de la paix qui
l'emportent.
159
suisse écrit que « les catholiques ont
longtemps pour première référence la communauté
internationale catholique »552. Dès septembre 1914,
le ton est donné, Monseigneur Bovet vante « l'Église,
mère des patries », et conclut « [qu']il est des
nations qui oublient trop ce qu'elles doivent à l'Église, leur
mère », celle-ci ne doit pas désespérer car elle
conserve malgré tout « l'inépuisable vertu de
guérir et de sauver les nations comme les individus
»553. C'est sur le même ton quelques mois plus tard
qu'un autre texte insiste sur la nécessité de rappeler «
que la société chrétienne des âmes dépasse
les frontières des peuples et les limites du temps » rappelant
sobrement « Dieu [est] le père et le législateur
suprême des sociétés, pour lesquelles il n'est de vraie
civilisation qu'à condition de régler leurs lois et leurs
aspirations sur les destinées éternelles de l'humanité
»554. Enfin, dernier exemple, un article de
Décembre 1915 invite les hommes à réfléchir
à leurs actions, à reconnaître la guerre qui s'abat sur
l'Europe comme une expiation des péchés : la morale est la
suivante « Seule, ne l'oublions jamais, la sanctification des peuples
par la vérité, par la pénitence et par la prière
pourra assurer au monde une paix durable »555. Nous
pourrions multiplier les citations tant leur récurrence est
fréquente tout au long de la guerre. Ces messages portés au nom
de Dieu visent pour une grande part à promouvoir la paix et la communion
des peuples sous l'égide de l'Église. Ces quelques exemples sont
de minces indices, ils ne permettent pas de donner une idée
précise des représentations des habitants du Valais pendant la
période de guerre. Toutefois, ils rendent possible d'identifier la
coexistence de deux tendances générales qui, en se
référant à la chrétienté, tendent à
déborder les frontières suisses pour inclure des espaces
d'identification et de solidarité plus larges face à
l'événement guerrier. Bien sûr, l'Église valaisanne
a toujours défendu l'existence d'une communauté chrétienne
internationale, mais c'est précisément au moment où les
nations obstruent les possibilités d'existence d'autres formes de
territorialités que le contre-discours de la communauté humaine
élargie est martelé en Valais avec le plus de force.
En France, l'Église a apparemment reçu un regain
de fréquentation si l'on en croit l'instituteur de Morzine : «
Vie spirituelle : Sensiblement plus intense, les messes pour les
552 Rita HOFSTETTER, « La suisse et l'enseignement... »
op.cit, p. 75.
553 Monseigneur Bovet, « L'Église, Mère des
patries », L'école primaire, n°9, supplément,
15 Septembre 1914, p. 86.
554 « Les citoyens et l'État »,
L'école primaire, n°4, supplément, Avril 1915, p.
27-29.
555 « Après une année de guerre »,
L'école primaire, n°9, supplément, 15
Décembre 1915.
160
hommes sur le front, les prières publiques
journalières [...] sont très suivies
»556. Néanmoins dans la configuration de la nation
en guerre, la pieuté s'apparente plus à une inquiétude
aiguë pour les parents mobilisés au front, plutôt qu'à
l'idée d'une communion chrétienne internationale : la France a un
ennemi qui menace son territoire, avec lequel l'entente semble difficilement
possible et ni même souhaitable. Dans le cas français,
l'élargissement d'un espace d'appartenance qui transcende la nation se
trouve plus dans les sentiments de solidarité avec les pays
alliés. C'est le cas lors des collectes scolaires en solidarité
avec le peuple serbe ou avec les réfugiés belges
déjà évoquées. C'est aussi le cas lors de
l'entrée en guerre de nouveaux alliés. Ainsi à Vallorcine,
commune de montagne la plus proche de la frontière valaisanne, à
l'extrême marge de la nation, les bâtiments publics sont
pavoisés du drapeau italien au moment de l'entrée en guerre du
pays aux côtés des alliés le 21 Mars 1915. Une année
et demie plus tard, le 2 Septembre 1916, mairie et écoles arborent le
drapeau roumain pour les mêmes raisons557 : dans quelles
autres circonstances que celles de la guerre serait-il possible de rencontrer
le drapeau roumain sur les bâtiments publics français aux confins
de la Haute-Savoie ? Bien sûr, ces mesures sont essentiellement
symboliques et n'ont pas grand impact sur le vécu des individus.
Toutefois, la Haute-Savoie, territoire éloigné du front, peu
confronté à l'appareil militaire, isolé parmi les
crêtes alpines, et dont les frontières avec les pays voisins ont
été fermées, se retrouve tout de même drapé
du pavillon roumain, nation éloignée de plusieurs milliers de
kilomètres - et l'instituteur trouve le fait assez important pour le
rapporter dans son court récit. C'est évidemment parce que ces
faits ont trait à la guerre et offrent de plus grandes chances de
victoire pour la nation française qu'ils revêtent un tel
intérêt. De plus, rappelons que les sources utilisées dans
ce sous-chapitre permettent mal d'appréhender les expériences de
guerre des habitants des territoires alpins. Nous devons donc nous limiter
à des remarques prospectives sur ce qu'aurait été les
échelles d'identifications des acteurs historiques. Elles servent
surtout à montrer qu'au-delà des réalités
matérielles, les sociétés - et les écoles - alpines
sont au moins intégrées du fait de la situation de guerre dans
des territorialités qui débordent leurs frontières.
La guerre donc, ouvre des frontières à mesure
qu'elle en ferme. Encore une fois, les Alpes ne protègent pas de
certaines incidences liées au conflit : elles sont bien sûr moins
visibles dans le paysage que dans la circulation immatérielle des
représentations et des solidarités.
556 ADHS, 8 R 140, Réponse de l'instituteur de Morzine
à l'enquête du ministère de l'instruction publique, 16 Mai
1916.
557 Ibidem, Vallorcine, 21 Mars 1915 et 2 Septembre
1916.
161
CONCLUSION : L'école des Alpes, quel bilan ?
Nous voilà arrivés au terme de ce travail, il
s'agit maintenant de conclure. Se défaire d'une historiographie trop
classique n'a pas toujours été simple, malgré les nombreux
travaux de qualité ayant ponctué la recherche en histoire de
l'éducation ces dernières décennies, le champ n'est pas le
plus dynamique des sciences sociales, les débats y sont rares. Pour
proposer une approche originale il est donc nécessaire d'insuffler
à l'objet des préoccupations plus actuelles de la recherche
historique. C'est pourquoi, l'idée d'étudier l'école dans
l'espace où elle se déploie a composé un souci constant du
présent mémoire. La dimension spatiale de la scolarisation permet
de rompre avec le cadre de prédilection des études du champ,
c'est-à-dire celui de la nation. Bien sûr, en étudiant la
mise en place des systèmes scolaires européens au cours de «
La Belle Époque », il ne s'agit à aucun moment de minimiser
l'intérêt heuristique que comporte le cadre national :
l'école est avant tout celle de la citoyenneté, comme
l'écrit Damiano Matasci elle « devient un moyen de « fixer
» la nation : elle contribue à sa matérialité,
à son invention, voire à sa pérennité
»558. Néanmoins, aussi efficient que ce cadre
d'analyse puisse être, réduire l'école à la nation
impose une vision totalisante qui tend à nier les différences de
vécu dans les expériences scolaires des acteurs historiques. Or,
comme nous espérons l'avoir montré, l'école n'est pas que
l'imposition au niveau local d'un pouvoir national, elle est aussi
négociations à différentes échelles - entre
mairies, communes, instituteurs, inspecteurs... - qui permettent de placer au
centre de l'étude l'approche micro-historique. Certains, par leur
volonté d'autonomiser les deux échelles sont tombés dans
le travers inverse, essayant de faire valoir l'idée - déjà
très vieille - d'une lutte des cultures : l'école de la nation
viserait à l'homogénéisation violente des populations par
la pure et simple destruction des terroirs559. Si ces affirmations
ont largement été infirmées depuis, il ne faut pas non
plus leur dénier tout intérêt. Elles permettent de pointer
du doigt l'oubli des réalités locales dans la feinte
homogénéité des expériences nationales. Une fois
cela posé, le risque est pour nous de jouer sur un registre de simples
ressemblances/différences entre les textes officiels et les faits
glanés ici et là, venant contredire la norme. Toutefois, cette
méthode est d'un bien maigre intérêt
558 Damiano MATASCI, L'école républicaine...
op.cit, p.8.
559 Sur ce point voir les ouvrages d'Eugen WEBER, Peasants
into frenchmen... op.cit et de Suzanne CITRON, Le Mythe National,
op.cit, qui malgré leur date de publication déjà
ancienne, connaissent une étonnante postérité.
162
heuristique et n'est que peu propice à la
généralisation560 . En puisant dans les ressources
qu'offre l'histoire des échelles d'observation561
complété par les analyses fondatrices de la sociologie
pragmatique 562 , il est alors possible de penser la coexistence
d'espaces d'identification qui, entrent conjointement dans les
schèmes de justification des acteurs563. Nous avons vu d'une
part, que les acteurs locaux disposent d'une agentivité, d'une
capacité d'action sur l'institution scolaire - c'est le cas lorsque les
parents demandent une dérogation d'âge, lorsqu'ils font une
pétition ou encore lorsque les instituteurs arguent pour leur mutation -
mais aussi que l'institution scolaire s'adapte aux contraintes locales - le
personnage intéressant de l'inspecteur primaire joue bien ce lien entre
réalité locale et politique nationale.
Dans des territoires que l'on pense isolés - et qui le
sont pour partie - on a alors observé les manières - parfois les
échecs comme dans le cas des cheminées effondrées - dont
l'école populaire s'installe au hameau. Étudier des
sociétés traversées par le tourisme, permet de pousser
à son paroxysme l'interpénétration des échelles
tout en pointant leur non-conflictualité - parfois même leur
complémentarité. Enfin, choisir l'étude du milieu - ou de
l'environnement - rend possible d'informer sur la manière dont les
expériences scolaires des acteurs divergent parfois des normes
nationales et surtout de quelle manière l'environnement alpin est
mobilisé pour justifier ces manquements aux règles. Cela permet
d'appréhender à la fois les représentations des acteurs de
l'école - parents, enseignants, parents, inspecteurs - ainsi que les
manières dont ceux-ci perçoivent l'environnement alpin. Ce n'est
d'ailleurs pas le seul avantage que constitue la dimension environnementale de
l'étude : elle permet également d'élargir l'analyse par
une perspective d'histoire comparée des systèmes scolaires
suisses et français. En partant du paradoxe apparent de deux
systèmes scolaires différents dans un environnement similaire,
nous portons un regard qui dépasse les limites de la nation. Parfois,
les stratégies et les pratiques scolaires donnent lieu à des
expériences que l'on peut rapprocher, d'autres fois, il a fallu conclure
à la différence dans les moyens employés et les
perceptions engendrées. Nous
560 Les archives de la Haute-Savoie conservent pour exemple
plusieurs mémoires des années 1980 qui, en étudiant
l'école dans le département se bornent à reprendre la
grille de lecture proposé par les Ozouf.
561 Entamée par la microstoria italienne puis largement
travaillée ensuite, notamment dans Jacques REVEL (dir), Jeux
d'échelles. La micro-analyse à l'expérience,
op.cit.
562 Voir Luc BOLTANSKY et Laurent THEVENOT, De la
justification...op.cit. Leurs idées sont par la suite reprises en
histoire, voir Simona CERUTTI, « Histoire pragmatique... »,
op.cit.
563 C'est-à-dire que le « macro » ne s'oppose
pas au « micro » : les acteurs utilisent des catégories
générales pour justifier leurs actions sans que le «
général » s'autonomise en dehors. Voir notamment Yannick
BARTHE, Damien DE BLIC, Jean-Philippe HEURTIN et al., «
Sociologie pragmatique : mode d'emploi », Politix, n° 103,
2013/3, p. 175-204.
163
164
observons ainsi que les manières de considérer
l'école et les Alpes - ou l'école dans les Alpes - divergent. De
ce constat, trois conclusions. La première, s'il est encore besoin,
relègue définitivement l'idée d'un déterminisme
géographique stricte aux oubliettes pour considérer
l'environnement dans une relation dynamique d'espace vécu et de
représentations/pratiques de ce même espace - le chapitre
comparant le paysage de l'école et celui du tourisme en montre
également un bon exemple. La deuxième permet de
réintroduire avec force les frontières nationales comme vecteur
important de représentations et d'identification à un espace.
Cette ouverture sur la question des frontières constitue une part
importante du travail, qu'elles soient inter-étatiques ou, lorsqu'on les
prend dans une acceptation plus large, qu'elles fassent fi des nations,
permettant de trouver à diverses échelles d'analyse des limites
strictes et d'autres plus floues entre les deux territoires. Les
frontières prennent toute leur force au moment d'étudier
l'école dans la Première Guerre mondiale, d'où notre
dernier constat.
Ici, la guerre sémiotise le territoire national avec
une force inédite, mais en jouant sur la richesse du concept de
frontière, il apparaît qu'à certaines échelles,
moins physiques qu'idéologiques, la guerre traverse les Alpes,
créant, des espaces qui transgressent à nouveau les limites des
États. Ces analyses ne permettent de répondre aux questions de
différences/ressemblances entre les deux systèmes scolaires
qu'à demi-mots - d'ailleurs poser la comparaison dans ces termes ne
présente qu'un faible intérêt. Les questions
dépendent de l'échelle : on peut à la fois écrire
que les deux écoles sont prises dans un mouvement de scolarisation
européen qui les rapproche car elles partagent les mêmes fins - en
résumé l'éducation populaire, civique et nationale. On
peut aussi dire qu'elles divergent sensiblement - par les moyens de parvenir
à leurs fins, par la place de l'Église sur les bancs scolaires,
par les modèles étatiques - centralisé ou
fédéral - également. En considérant
spécifiquement les écoles alpines cette fois, on peut trouver des
ressemblances non-négligeables qui peuvent les placer à part des
autres lieux compris au sein de leurs nations respectives. Comparer le cas
suisse et le cas français à l'aune du conflit parait absurde.
Pourtant, et de manière tout à fait contrintuitive, l'ampleur de
la mobilisation suisse - surtout entre 1914 et 1916 - couplé à la
relative « protection » du territoire haut-savoyard face aux affres
de la guerre - pas de réquisitions de locaux scolaires, pas
d'hôpitaux de blessés - permettent de rapprocher les deux
expériences de guerre des écoles alpines.
Enfin, on entend une critique légitime qui limite les
apports de ce travail mais en compose à la fois une ouverture pour une
thèse doctorale. Il serait intéressant d'ajouter à notre
propos l'Italie du Nord, qui partage ses limites étatiques avec les deux
territoires de l'étude. D'autant
plus qu'une partie du pays à la botte, celle la plus
proche du Mont-Blanc, comme dans le Val d'Aoste parlait - et parle parfois
encore - la langue française. N'oublions pas que jusqu'en 1860, date de
la réunion des territoires de Savoie - auparavant sardes - à la
France, le Val d'Aoste et ce qui deviendra les départements
français de la Savoie et de la Haute-Savoie communiaient sous le
même drapeau. François Walter recense d'ailleurs des
revendications éparses à partir de la fin du XIXe
siècle pour faire reconnaître l'existence d'une «
région arpitanienne » 564 qui réunirait autour du
Mont-Blanc la Haute-Savoie, le Val d'Aoste et le Valais. Étudier les
écoles alpines de manière exhaustive ne peut donc se
réduire à une comparaison franco-suisse. Une histoire scolaire
des Alpes serait par ailleurs très intéressante à
étudier à l'épreuve de la guerre. En prenant de la
hauteur, on peut aisément élargir l'analyse aux Alpes
autrichiennes ou allemandes ce qui permettrait de renforcer et d'élargir
la comparaison, en étudiant les systèmes scolaires de diverses
nations ainsi que les représentations différenciées des
Alpes dans ces pays. L'école des Alpes ne peut-elle pas s'élargir
à d'autres aires culturelles pour devenir l'école de montagne ?
Bernard Debarbieux a sur ce point des réflexions très
intéressantes, il montre qu'à partir du XVIIIe
siècle les typologies des montagnes, généralisées
par les savants, s'appuient toutes sur le modèle alpin565,
créant décalages et incompréhensions quant aux
manières des différents peuples d'habiter leur environnement
montagneux. Bien évidemment, tout cela n'est que prospectif, il n'en est
pas moins vrai que l'alliage d'histoire de l'éducation et d'histoire de
l'environnement peut s'avérer productif.
564 François WALTER, Les figures
paysagères...op.cit, p. 360.
565 Bernard DEBARBIEUX, Gilles RUDAZ, Les faiseurs de
montagne,op.cit, p. 40-42 et Bernard DEBARBIEUX, « Construits
identitaires... », op.cit.
165
Annexes
Concernant les photos prises par nos soins, il faut ici
excuser nos piètres talents de photographe...

Carte de Chamonix dessinée par l'instituteur dans sa
monographie à l'occasion de l'exposition universelle de 1890. On voit
bien l'éparpillement des hameaux ainsi que la frontière avec la
Suisse voisine.
ADHS, 1 T 236, Monographies rédigées par les
instituteurs - Chamonix. 1888-1892. Photographie de l'auteur.

166
École normale d'instituteurs de Bonneville dont la
construction s'est achevée en 1887. Avant cette date, les
élèves-maîtres du département étaient
obligés de se rendre à Albertville en Savoie pour y recevoir leur
formation. Bien que l'école se situe en plaine, ses canalisations ont
entièrement gelées en 1897 : cela laisse imaginer la situation
des écoles de montagne. C'est dans les archives concernant cette
école que nous avons pioché les informations concernant la
formation des enseignants, dont leurs excursions dans les lieux pittoresques du
département, et leur pratique de l'alpinisme notamment.
ADHS, 57 Fi 2253 - 1777. L'école normale/ Auguste et
Ernest Pittier. 1899-1922.
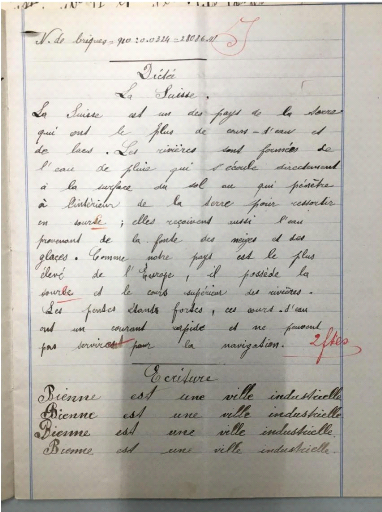
Dictée sur la Suisse et travail d'écriture de
l'élève valaisan Jules Métral en 1913. Il est
intéressant de voir la différence entre la dictée qui
décrit l'environnement naturel de la Suisse et le travail
d'écriture qui insiste sur le caractère industriel de Bienne.
167
CH AEV 24 - Vincent Pitteloud, instituteur. 1886-1931.
Photographie de l'auteur.

168
Plan de l'école mixte du hameau des Frasserands
(Chamonix) bâtie entre 1882 et 1889. Cette école n'était
toujours pas reliée à l'eau courante en 1897 - malgré la
loi en vigueur. La classe mesure 7 mètres 80 centimètres de long
sur 6 mètres de large, c'est de loin la plus grande école de
hameau de la commune. On peut néanmoins se demander jusqu'à quel
point les mesures de séparation des élèves des deux sexes
étaient efficaces.
ADHS, 1 T 169 - Créations d'écoles et d'emplois
- Chamonix. Vers 1882. Photographie de l'auteur.
Etat des sources
Archives Départementales de la
Haute-Savoie.
1 T : Enseignement général -
1849-2009.
1 T 45-51 Affaires générales par commune-
1884-1912.
- On trouve ici les listes des déplacements des
instituteurs par commune. Parfois les motifs sont également inscrits. Y
sont également conservées des correspondances et des tableaux qui
communiquent des informations quantitatives sur l'évolution du nombre
d'écoles.
1 T 54-55 Plaintes contre des instituteurs ou
réclamations des instituteurs. 1861-1918.
- Sous cette côte, on trouve de nombreuses lettres
échangées entre les parents d'élèves, l'inspecteur
primaire, l'inspecteur d'académie et les instituteurs. Ces documents
nous ont été particulièrement utiles pour mesurer la
surveillance morale que l'institution - mais aussi à un niveau plus
local les habitants - opérait sur les pratiques des instituteurs,
permettant ainsi de rendre compte du rôle social dont ils étaient
investis.
1 T 87 Frais de location des maisons d'école
dans les communes : instructions, correspondance (1890-1893). Écoles
mixtes : enquêtes concernant la direction (1907-1922). - Sont
conservés des délibérations communales mais aussi des
correspondances entre les membres de l'institution scolaire ainsi que quelques
tableaux. Utile pour mesurer le phénomène des écoles
mixtes en montagne.
1 T 169 - Créations d'écoles et
d'emplois - 1862-1930 De Cercier à Cruseilles. - 1862-1930. -
Correspondances nombreuses entre les communes et les autorités scolaire.
Informe sur le phénomène des écoles temporaires et les
constructions d'écoles de hameaux pour leur remplacement.
169
1 T 236 Monographies rédigées par les
instituteurs 1888-1892.
170
- Carton très riche qui conserve les monographies
d'instituteurs faites à l'occasion de l'exposition universelle de 1890.
Très pratique pour appréhender l'école au niveau communal
- bien que le plan de l'écrit soit stéréotypé pour
répondre aux attentes de l'institution.
1 T 294 - Conférences pédagogiques
cantonales. Conférences de l'automne 1915 sur la Première Guerre
mondiale - 1915.
- Peu de documents mais des comptes-rendus de
conférences pédagogiques pendant la guerre ainsi que quelques
mémoires d'enseignants rédigés pour l'occasion.
Très utile pour mesurer l'investissement patriotique des instituteurs
avant que l'institution ne reprenne la main sur les pratiques
d'enseignement.
1 T 418 Suivi des écoles. Chamonix.
1860-1938.
- Une des côtes les plus précieuses pour ce
mémoire. On y trouve les correspondances entre tous les acteurs locaux
concernant l'école. Nous avons largement mobilisé ce fond pour
mesurer les revendications des parents liées au climat alpin ainsi que
l'investissement de la commune dans l'amélioration de l'offre
scolaire.
1 T 474-880 Dossiers individuels des instituteurs et
institutrices. 1850-1977.
- Les dossiers individuels suivent la carrière des
instituteurs et contiennent entres autres les rapports d'inspections, et
diverses correspondances avec l'institution scolaire. Leur consultation permet
d'appréhender au plus proche les salles de classes et les parcours de
vie des enseignants.
1 T 1235-1236 Administration générale Ecole
normale de Bonneville. 1887-1927.
- Nous nous sommes particulièrement servi des «
rapports sur la situation matérielle et morale » -
rédigés chaque année par le directeur - qui font
état des événements principaux de la vie de l'école
- dont les sorties et les activités effectuées par les
élèves-maîtres.
1 T 1276 : Conseil départemental de
l'enseignement primaire de la Haute-Savoie. Procès-verbaux de
réunion. 1906-1923.
- Surtout mobilisé pour la période de guerre.
Ces documents permettent d'approcher les conséquences de la guerre sur
l'école - fermetures et fusions de classes, nomination
d'intérimaires et d'instructrices - mais aussi les instituteurs
cités à l'ordre du jour pour leurs faits d'armes.
171
2 O : Dossiers d'administration communale -
1773-1947.
2 O 2174- 2175 - Personnel communal - 1859-1941. Vie
scolaire 1862-1940. Archives de la préfecture concernant
l'administration communale de Chamonix-Mont-Blanc. 1859-1941. - Faute
d'accès aux archives communales, ces côtes se sont
révélées particulièrement intéressantes pour
mesurer l'investissement de la commune dans sa politique scolaire. On y trouve
des informations sur l'état matériel des écoles - manque
de cours empierrées, d'accès à l'eau, de jardins
scolaires...- ou sur les aménagements liés au climat - commandes
d'anthracite, de calorifères, épidémies.
8 R - Occupation de la France par les armées
ennemies en 1870-1871 et 19141918 - 1870-1937.
8 R 140 -Enquête lancée par le
ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts concernant la
prise de notes communales sur les événements de la guerre
1914-1918 par les instituteurs : circulaire, réponses communales.
1914-1917.
- Les réponses des instituteurs - très
inégales selon les communes - sont archivées sous cette
côte. Leur consultation nous a permis d'approcher la vie locale des
communes alpines au moment de la guerre : témoignages précieux
qui compensent en partie le manque d'archives sur la période.
PA - Presse administrative -
1868-1933.
PA 68 3- 68 4 -Bulletin de l'instruction primaire du
département de la Haute-Savoie. 19021929.
- Ces imprimés mêlent circulaires et
recommandations nationales aux événements locaux qui viennent
ponctuer la vie scolaire du département. Leur consultation nous a
informé sur les initiatives locales prises pour l'enseignement mais nous
a également fourni des statistiques intéressantes sur
l'état scolaire de la Haute-Savoie.
172
Archives de L'Etat du Valais.
DIP Département de l'instruction publique -
1756-1976.
1 DIP 21 - Personnel enseignant. 1889-1900.
- Liste des personnels enseignants par commune avec leur
traitement et leurs avantages en nature. Utile pour rendre compte des
différences entre les communes ainsi que le genre et la langue
parlée.
1 DIP 29 - Rapports du Département de
l'instruction publique ; imprimés. 1876-1911. - Cahiers
imprimés annuellement où l'on trouve diverses informations qui
renseignent sur la vie scolaire du canton, dont la place à l'examen des
recrues, le maillage scolaire, et, pendant la guerre, le nombre d'instituteurs
mobilisés, la manière de pourvoir à leur
remplacement...
1DIP 30-98 - Rapports des inspecteurs de Martigny
Entremont, Saint-Maurice et Monthey. 1890-1903.
- Rapports d'inspections par commune qui renseignent sur la
manière de faire classe en Valais, sur l'état matériel des
écoles. Nous avons largement mobilisé ce fond pour rendre compte
du flou des programmes et de la diversité des conditions
d'enseignement.
1DIP 102bis - Cahier sur les examens de recrues par le
Chanoine de Cocatrix. 1886-1906. - Archive très utile qui
relate l'évolution de la politique scolaire du canton avec des
statistiques très détaillées tout en éclairant les
difficultés inhérentes - selon son auteur - à la
géographie alpine.
1DIP 145bis - Correspondance. 1913 - 1915.
- Correspondances diverses entre les membres de l'institution
scolaire, particulièrement utile pour éclairer la vie scolaire
pendant la période de guerre.
2 DIP 21 - Conférence intercantonale romande
(inventaire) : Rapports, convocations, procès-verbaux, correspondances.
1886 - 1920.
173
- Retranscription écrite des séances de la
commission intercantonale. Nous avons largement mobilisé cette
côte pour rendre compte de la coopération de plus en plus
étroite du canton avec l'ensemble de la Suisse romande, contre
l'idée d'un isolement quasi-total porté par les quelques travaux
sur l'éducation valaisanne.
3 DIP 188 - Protocole de la Commission cantonale de
l'enseignement primaire. 1908-1927. - Cahiers qui relatent le
déroulé des séances de la commission cantonale. Ces
archives informent des méthodes pédagogiques en vigueur ou
voulues par les autorités. Il y est question des buts que se fixe
l'enseignement, des manuels à utiliser ou encore du fonctionnement des
écoles.
3 DIP 190 - Correspondance du conseil de l'enseignement
primaire. 1900-1910.
- Sous cette côte sont conservés les circulaires
et décrets liés à l'instruction publique, ce qui donne une
assez bonne idée de l'évolution des normes scolaires.
CH AEV - Imprimés valaisans.
CH AEV 640 - Ordonnance concernant le remplacement des
instituteurs en service militaire.
- Une seule archive est conservée sous cette côte
mais elle donne un aperçu des stratégies mises en place par le
canton pour pourvoir au remplacement des instituteurs mobilisés :
fusions et fermetures de classe, appel de régents retraités,
d'intérimaires...
CH AEV - Fond privé Vincent Pitteloud. 1557-
20e siècle.
CH AEV 24 - Vincent Pitteloud, instituteur.
1886-1931.
- Seules sources « de l'intime » concernant
l'instruction primaire conservées aux archives cantonales. Nous y avons
trouvé plusieurs correspondances entre l'instituteur et les
autorités scolaires, des travaux d'élèves dont un
très beau cahier de l'élève Jules Métral ainsi que
des lettres de meilleurs voeux envoyées par ses élèves.
Ces documents permettent d'approcher au plus près une classe valaisanne
d'une commune de montagne.
174
Archives du Musée national de
l'éducation.
MUNAE 1994.00985.75 - Enquête Ozouf.
1962.
- Les questionnaires de l'enquête de Jacques Ozouf
menée auprès de 20 000 instituteurs retraités ayant
exercé avant 1914 sont conservés ici. Nous avons
récupéré les réponses concernant les instituteurs
haut-savoyards qui s'élèvent au nombre de 26. Leur consultation,
au-delà des réponses normées du questionnaires donnent
parfois lieu à de véritables récits de vie qui constituent
un matériel ethnographique très riche.
Autres Sources imprimées.
Archives de L'école primaire, journal
pédagogique valaisan. Disponible en ligne Résonances
(
resonances-vs.ch).
. La consultation des numéros du journal concernant
notre période s'est avérée très fructueuse pour
appréhender le fonctionnement de l'école valaisanne. Les faits
concernant la politique scolaire du canton y sont rapportés ainsi qu'une
multitude d'articles pédagogiques. Plus généralement, les
textes des suppléments à la fin de chaque numéro informent
sur la société valaisanne au-delà de l'école.
Abrégé d'histoire de la Savoie en 10
leçons - 1913. Disponible en ligne Abrégé d'histoire de
la Savoie en 10 leçons : avec 20 gravures et 3 cartes dans le texte / F.
Christin ... et François Vermale,... ; préface de M. Ch. Faubert
... | Gallica (
bnf.fr).
. Ce manuel d'histoire à visée locale informe
sur la manière dont la pédagogie des petites patries se
déployait effectivement dans le département. Sa lecture nous a
également fourni quelques données statistiques notamment sur
l'ampleur du phénomène touristique.
175
Bibliographie Générale
Nous présentons ici en quelques lignes les ouvrages qui
nous sont apparus décisifs dans cette recherche.
Société française et
société suisse XIXe-XXe siècles
Généralités
ASSIMA George, « L'exception culturelle suisse ou
l'émergence d'une confédération multiculturelle dans sa
relation historique avec la France », Migration et
Société, n°15, 2003, p. 169-174.
AGULHON Maurice, Histoire Vagabonde, t.3 : La
politique en France d'hier à aujourd'hui, Paris, Gallimard,
1996.
AGULHON Maurice, La République au Village,
Paris, Pion, 1970.
ALTERMATT Urs, Le Catholicisme au défi de la
modernité. L'histoire sociale des catholiques suisses aux
XIXe et XXe siècles, Lausanne, Editions
Payot, 1994.
CHANET Jean-François, « Terroirs et pays : mort et
transfiguration ? », Vingtième Siècle. Revue
d'Histoire, n°69, 2001, p. 61-81.
CHARRIER Landry, « La neutralité suisse à
l'épreuve de la Première Guerre mondiale. L'Internationale
Rundschau, une entreprise de médiation internationale »,
Histoire@Politique, n°13, 2011/1, p. 146-160.
DUBY George, WALLON Armand (dir), Histoire de la France
rurale, t.3. De 1789 à 1914, Paris, Le Seuil, 1976.
FARGE Arlette, La vie fragile : violence, pouvoirs et
solidarités à Paris au XVIIIe, Paris, Hachette,
1986.
FAVEZ Jean-Claude (dir.), Nouvelle histoire de la Suisse
et des Suisses, 3t., Lausanne, Payot, 1981-1981.
FROIDEVAUX Didier, « Construction de la nation et
pluralisme suisses : idéologie et pratiques », Swiss Political
Science Review, 1997, n°3/4, p. 1-58.
HOUTE Arnaud- Dominique, Le Triomphe de la
République (1871-1914), Paris, Le Seuil, 2014. LEJEUNE
Dominique, La France de la Belle Époque. 1896-1914, Paris,
A.Colin, 1991.
LEDUC Jean, L'enracinement de la République
(1879-1918) [1991], Paris, Hachette, 2014. MARIOT Nicolas, Tous unis
dans la tranchée ? Paris, Seuil, 2013.
176
THIESSE Anne-Marie, Le roman du quotidien. Lecteurs et
lectures populaires à la Belle Époque, Paris, Le Chemin
vert, 1984.
THIESSE Anne-Marie, « L'invention du régionalisme
à la Belle Époque », Le Mouvement Social,
n°160, 1992/3, p.11-32.
WEBER Eugen, Peasants into Frenchmen, the modernization of
rural France, 1870-1914, Stanford University Press, 1976.
WALTER François, Une histoire de la Suisse,
Neufchâtel, PUS, 2016. WINOCK Michel, La Belle Epoque, Paris,
Perrin, 2002.
Identités nationales
GELLNER Ernest, Nations and nationalism, Ithaca,
Cornell University Press, 1983. HOBSBAWM Eric, Nation et nationalismes
depuis 1780 [1992], Paris, Gallimard, 2001.
NOIRIEL Gérard, Population, immigration et
identité nationale en France. XIXe-XXe
siècles, Paris, Hachette, 1993.
NORA Pierre (dir.), Les Lieux de Mémoire. T. II, La
Nation, Paris, Gallimard, 1997.
THIESSE Anne-Marie, La création des
identités nationales, Europe XVIIIe-XXe
siècles, Paris, Le Seuil, 1999.
THIESSE Anne-Marie, « La Fabrication culturelle des
nations européennes », Sciences Humaines, n°110,
2000.
Haute-Savoie et Valais
ARLETTAZ Gérald, JORIS Gérard, PAPILLOUD
Jean-Henry, REY Michel, TSCHOPP Maria-Pia (dir), Société et
culture du Valais contemporain, Sion, Groupe Valaisan de Sciences
Humaines, 1974.
ARLETTAZ Gérald, PAPILLOUD Jean-Henry, EVEQUOZ-DAYEN
Myriam, TSCHOPP Maria-Pia, (dir), Le Valais et les étrangers,
XIXe-XXe siècles, Sion, Groupe Valaisan de
Sciences Humaines, 1992.
ARLETTAZ Gérald, PAPILLOUD Jean-Henry, REY Michel, ROUX
Elizabeth, FRASS Patrice, ANDREY Georges (dir), Histoire de la
démocratie en Valais (1798-1914), Sion, Groupe Valaisan de Sciences
Humaines, 1999.
(DU) BOIS Pierre, « Le mal suisse pendant la
Première Guerre mondiale : Fragments d'un discours sur les relations
entre alémaniques, romands et tessinois au début du
vingtième siècle », Revue européenne des sciences
sociales, n° 53, 1980, p. 43-66.
177
DEBARBIEUX Bernard, Chamonix-Mont-Blanc, 1860-2000, les
coulisses de l'aménagement, Grenoble, Editmontagne, 2001.
DERIOZ Pierre, BACHIMON Philippe, LOIREAU Maud, « Mise en
scène du paysage montagnard et valorisation sélective des
patrimoines dans une vallée pyrénéenne en reconversion
économique Vicdessos, Ariège », Projets de paysage,
n°11, 2014.
GUICHONNET Paul, « La géographie et le
tempérament politique dans les montagnes de la Haute-Savoie »,
Revue de Géographie alpine, n°22, 1943, p. 39-85.
GUICHONNET Paul, « Politique et émigration
savoyarde à l'époque des nationalités (18481860) »,
Hommes et Migrations, n°1166, 1993, p. 18-22.
JULLIARD Jean-Yves, L'instruction primaire en Savoie du
Nord de 1848 à 1875, Mémoire de maîtrise,
Université Lyon III, 1981.
MIEGE Jean, « La vie touristique en Savoie »,
Revue de Géographie Alpine, n°21, 1933, p. 749817.
RAYMOND Justinien, La Haute-Savoie sous la IIIe
République : histoire économique, sociale et politique
(1875-1940), Lille, Atelier National de Reproduction des
Thèses, 1983.
TURPIN Frédéric, VARASCHIN Denis,
Haute-Savoie. 1914-1918. Archives et Histoire, centenaire de la
Première Guerre mondiale, ADHS, 2014.
TURPIN Frédéric (dir), Les Pays de Savoie
entrent en Grande Guerre, Chambéry, Université Savoie Mont
Blanc, 2014.
WALLE Marianne, « Les prisonniers de guerre
français internés en Suisse », Guerres mondiales et
conflits contemporains, n°253, 2014, p. 57-72.
Histoire de l'éducation En
France
AGULHON Maurice, Marianne au pouvoir. L'Imagerie et la
symbolique républicaines de 1880 à 1914, Paris, Flammarion,
1989.
AMALVI Christian, De l'art de la manière
d'accommoder les héros de l'histoire de France: essais de mythologie
nationale, Paris, Albin Michel, 1988.
CABANEL Patrick, La République du certificat
d'études: histoire et anthropologie d'un examen,
XIXe-XXe siècle, Paris, Belin, 2002.
CHANET Jean-François, « Pour la Patrie, par
l'École ou par l'Épée ? L'école face au tournant
nationaliste », Mil neuf cents. Revue d'histoire intellectuelle,
n°19, 2001, p. 127-144.
178
CHANET Jean-François, L'école
républicaine et les petites patries, Paris, Aubier, 1996.
Comment parler d'histoire de l'éducation
française sans avoir recours à l'oeuvre de Jean-François
Chanet ? Par une recherche archivistique d'une extrême rigueur dans la
quasi-totalité des archives départementales, l'auteur dresse un
tableau de la scolarisation républicaine allant à l'encontre des
critiques classiquement adressées à l'institution. Le contexte de
résurgence des régionalismes à partir des années
1970 avait remis au goût du jour l'accusation de « génocide
culturel » opéré par l'école Ferry contre la
diversité culturelle des terroirs de France. Chanet montre au contraire
que les décisions ne sont pas toutes prises par en haut, il
réhabilite le rôle des communes, dont la marge de manoeuvre
était plus large qu'on avait jusqu'alors pu le penser. Plus encore, il
montre que la pédagogie des « petites patries » (partir du
concret vers l'abstrait) offrait une possibilité d'existence aux
cultures locales au sein même de l'école. L'instituteur n'est pas
« un agent de la ville », il est un enfant du pays où il
enseigne et au fur et à mesure des décennies, il est de plus en
plus encouragé à s'intéresser au folklore local et
entraîne les élèves dans son sillon. L'intérêt
principal de l'ouvrage est de montrer que l'école est plurielle, les
échelles d'identification qu'elle promeut également, il n'y a pas
de contradiction ontologique entre la volonté d'enseigner une culture
nationale et celle de s'adapter à la diversité des
réalités locales. Bien qu'il faille reconnaître des
tensions et des ambiguïtés dans les discours et textes normatifs.
L'auteur va plus loin en prenant le parti d'affirmer qu'on ne peut pas calquer
le contenu des textes sur les pratiques scolaires : le monde social est
complexe et ne peut pas se réduire à une déduction logique
de l'un par rapport à l'autre.
Cette réflexion a été primordiale dans
notre étude. Une partie du premier chapitre consacré au
contournement des normes scolaires par les populations alpines est redevable
à Chanet. Dans le droit fil de ses travaux, nous avons montré le
rôle que les communes prennent dans la scolarisation républicaine
: la décision de Chamonix de construire 8 nouvelles écoles de
hameaux est prise par le conseil communal. Bien sûr, l'institution
encourage les communes - notamment par des subventions - mais celles-ci
disposent d'un pouvoir de négociation non négligeable, selon les
priorités, elles peuvent choisir de s'investir massivement dans
l'amélioration de l'offre scolaire - au-delà même de ce qui
est attendu d'elles - ou s'en tenir au minimum qui leur est imposé.
D'autre part, nous avons largement mobilisé son travail lorsqu'il s'est
agi de montrer une certaine connivence entre le discours sur le local
déployé par l'institution scolaire et le discours porté
sur la nature par les villégiateurs. En effet, l'auteur montre bien que
pendant leur formation et plus tard dans leurs pratiques, les instituteurs sont
portés à avoir sur les choses « un regard d'apprenti
folkloriste épris de pittoresque », une « disposition
de voyageur dont la curiosité est toujours en éveil »
(p. 199). Sur ce dernier point, nous sommes également largement
redevables aux travaux d'Anne-Marie Thiesse, Ils apprenaient la France :
L'exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris,
Éditions De la Maison de l'Homme, 1997.
(DE) COCK Laurence, PICARD Emmanuelle, La fabrique
scolaire de l'histoire, illusions et désillusions du roman
national, Marseille, Agone, 2009.
CRUBELLIER Maurice, L'école républicaine
1870-1940. Esquisse d'une histoire culturelle, Paris, Éditions
Christian, 1993.
179
FURET François, OZOUF Jacques, Lire et écrire
: L'alphabétisation des Français de Calvin à
Jules Ferry, Paris, Ed. Minuit, 1977.
LUC Jean-Noël, La Statistique de l'enseignement primaire
aux XIXe et XXe siècles, politique et mode
d'emploi, Paris, INRP-Economica, 1985.
MAINGUENEAU Dominique, Les livres d'école de la
République (1870- 1914), Paris, Le Sycomore, 1979.
MAYEUR Françoise, Histoire générale de
l'enseignement et de l'éducation en France (tome III, De la
Révolution à l'École républicaine, 1789-1930),
Paris, Perrin, 2004.
OGNIER Pierre, Une école sans dieu ? L'invention d'une
morale laïque sous la IIIe République 1880-1895,
Toulouse, Le Mirail, 2008.
OZOUF Mona, L'École, l'Église et la
République 1871-1914, Paris, Ed. Cana/Jean Offredo, 1982 [1963].
OZOUF Jacques et Mona, « Le thème du patriotisme
dans les manuels scolaires », Le Mouvement social, n°49,
1964, p. 5-31.
PROST Antoine, Histoire de l'enseignement en France,
1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968.
THABAULT Roger, L'ascension d'un peuple. Mon
village. Ses hommes, ses routes, son école, Paris, Presses de
Science Po, 1982 [1938].
THIVEND Marianne, L'école républicaine en ville
: Lyon, 1870-1914, Paris, Belin, 2006.
Il peut être surprenant de prime abord de trouver cet
ouvrage au sein de cette brève liste : son sujet est l'école en
ville, bien éloigné donc de l'école de montagne, mais
c'est justement tout l'intérêt qu'a composé sa lecture.
Marianne Thivend est la seule historienne de l'éducation - à
notre connaissance - à avoir mis au centre de son travail l'étude
de l'école dans son espace. En revendiquant une approche « par en
bas » de la scolarisation républicaine, elle met à jour les
stratégies scolaires des pouvoirs centraux, communaux et celles des
acteurs locaux de l'institution scolaire. La taille des écoles
lyonnaises qui structurent l'aménagement urbain, leur niveau
supposé qui influe des choix des familles - déménagement
pour suivre un enseignant, pour être plus proches des meilleurs
établissements - ainsi que les trajectoires de carrière des
enseignants - souvent en banlieue puis de plus en plus proche des centres -
informent sur les inégalités spatiales en termes de scolarisation
au sein même de la ville. Ce contraste énorme avec les
écoles de notre étude permet de faire un contre-point en montrant
que les expériences scolaires des élèves dépendent
largement de leur lieu de vie. En effet les écoles de hameaux s'imposent
par leur proximité, leur faible attractivité pousse les pouvoirs
communaux à placer à leur tête des instituteurs
débutants, ces postes sont d'ailleurs vécus par les enseignants
comme une « punition » ou un passage obligé en début de
carrière : il s'agit de terminer sa carrière en plaine si faire
se peut - à l'instar des instituteurs citadins qui commencent leur
carrière en banlieue. Donc, au-delà même des
différences entre maillage scolaire urbain et maillage scolaire rural,
la lecture de cet ouvrage nous a permis d'insister sur les choix,
stratégies et représentations de l'école que ses acteurs
pouvent déployer : renforçant ici encore l'idée de
frontières plurielles. Disons-le à nouveau, la notion
d'inégalité spatiale introduit la possibilité de
relativiser l'idée d'homogénéité de la
scolarisation
180
républicaine : les postes ne se valent pas, les
écoles non plus, d'aucune n'offrent des possibilités similaires
pour les acteurs scolaires.
THIESSE Anne-Marie, Ils apprenaient la France : L'exaltation
des régions dans le discours patriotique, Paris, Éditons De
la Maison de l'Homme, 1997.
YOUENN Michel, « Des petites patries au « patrimoines
culturels » : un siècle de discours scolaire sur les
identités régionales (1880-1980) », Carrefours de
l'Éducation, n°38, 2014, p. 15-31.
En Suisse
CZAKA Véronique, Histoire sociale et genrée
de l'éducation physique en suisse romande (milieu
XIXe-début du XXe siècle),
Neufchâtel, PUS, 2021.
FARQUET Maxence, L'École valaisanne de 1830
à 1910 : histoire et organisation, Sion, Fiona et Pellet, 1949.
HAMELINE Daniel, L'éducation dans le miroir du
temps, Lausanne, LEP, 2002.
HEIMBERG Charles, « Les allers-retours de la
mémoire Suisse », Revue française de Pédagogie,
n°165, 2008, p. 55-63.
HOFSTETTER Rita, MAGNIN Charles, CRIBLEZ Lucien, JENZER Carlo
(dir.), Une école pour la démocratie. Naissance et
développement de l'école primaire en Suisse au XIXe
siècle, Berne, P. Lang, 1999.
HOFSTETTER Rita « La suisse et l'enseignement aux
XIXe-XXe siècles. Le prototype d'une
«fédération d'enseignants» ? », Histoire de
l'éducation, n°134, 2012, p. 59-80.
GUNTERN Josef, L'école valaisanne au XXe
siècle : de l'école de six mois aux hautes écoles
spécialisées et universitaires, Sion, Vallesia, Archives de
l'État du Valais, 2006.
PERISSET-BAGNOUD Danièle, Vocation : régent,
institutrice : jeux et enjeux autour des Écoles normales du Valais
romand, (1846-1994), Thèse de doctorat en Sciences de
l'Éducation, sous la direction de PERRENOUD Philippe, Université
de Genève, 2000.
Les instituteurs
BARUCH Marc-Olivier, DUCLERT Vincent, Les Serviteurs de
l'État, Paris, La Découverte, 2000.
CASPARD Pierre, CASPARD-KARYDIS Pénélope, La
Presse d'éducation et d'enseignement, 18ème siècle- 1940,
4 vol. 1981-1991, Paris, CNRS.
CHANET Jean-François, « Maîtres
d'école et régionalisme en France sous la IIIe
République », Ethnologie française, n°18,
1988, p. 244-256.
181
CONDETTE Jean-François, ROUET Gilles Rouet (dir.),
Un siècle de formation des maîtres en Champagne-Ardenne,
Écoles normales, normaliens, normaliennes, et écoles primaires de
1880 à 1980, Reims, CRDP de Champagne-Ardenne, 2008.
CONDETTE Jean-François (dir.), Éducation,
religion, laïcité (XVIe-XXe s.).
Continuités, tensions et ruptures dans la formation des
élèves et des enseignants, Lille, CEGES, 2010.
DELSAUT Yvette, La Place du maître : Une chronique
des écoles normales d'instituteurs, Paris, l'Harmattan, 1992.
GIRAULT Jacques, Instituteurs, professeurs, une culture
syndicale dans la société française (fin
XIXe-XXe siècle), Paris, Publications de la
Sorbonne, 1996.
LAPREVOTE Gilles, Splendeurs et Misère de la
formation des maîtres. Les écoles normales primaires en France,
1879-1979, Lyon, PUL, 1984.
LEJEUNE Philippe, « Les instituteurs du
XIXe siècle racontent leur vie », Histoire
de l'éducation, n°25, 1985, p. 53-82.
LUSSI-BORER Valérie, Histoire des formations
à l'enseignement en Suisse romande, Berne, Peter Lang, 2017.
MUEL-DREYFUS Francine, « les instituteurs, les paysans et
l'ordre républicain », Actes de la recherche en sciences
sociales, n°17-18, 1977, p. 37-61.
MUEL-DREYFUS Francine, Le métier
d'éducateur, Paris, Les Éditions de Minuit 1983. OZOUF
Jacques, Nous les maîtres d'école, Paris, Julliard,
1967.
OZOUF Jacques et Mona, La République des
instituteurs, Paris, Seuil, 1992.
PERISSET-BAGNOUD Danièle, « Formations à
l'enseignement à l'école primaire et plans d'études : Une
relation sociale étroite. Le cas du Valais », Revue des
Hep, n°13, 2011, p. 225235.
L'école et la guerre
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, La guerre des enfants,
1914-1918, Paris, Armand Colin, 1992.
Cet ouvrage proposant d'étudier la place des enfants
dans les sociétés en guerre, nous a été
particulièrement utile pour la dernière partie de ce
mémoire. Le processus d'héroïsation et de mise à
contribution de l'enfance pendant le Premier conflit mondial fait
résonance avec les archives que nous avons consultées. En effet,
les enfants, dans le cadre scolaire - mais pas que - sont sans cesse mis
à contribution pour participer à l'effort de guerre : que ce soit
au niveau des nombreuses collectes scolaires, de la confection d'objet pour les
enfants au front, ou encore dans les cours d'agriculture censés pallier
la crise agricole sévissant. Toutes les observations de Stéphane
Audoin-Rouzeau croisées avec nos propres sources nous ont permis de
parler d'école transfigurée dans ses pratiques. L'idée
182
d'une pédagogie de guerre « par le bas » dans
les deux premières années du conflit - également
présente chez Emmanuel Saint-Fuscien - nous a poussé à
insister sur le paradoxe apparent de la nationalisation guerrière des
contenus de guerre au moment où l'institution - nationale donc - est le
plus absente. Nous avons ainsi pu parler d'imbrication d'échelles, dans
le sens ou toutes les initiatives locales qui répondaient pour partie
à des intérêts locaux avant-guerre - notamment autour des
sociétés savantes - ne prennent plus de sens que dans le soutien
de la nation en armes. Enfin, la conclusion de l'auteur à propos de la
relative indifférence de l'enfant face à la guerre a
été une clef de lecture très riche pour penser le
quotidien des enfants de l'arrière - dans ce cas précis, des
enfants des Alpes, relativement à l'abri du conflit. Ceci nous a permis
de réintroduire des différences dans l'expérience
vécue des élèves hauts-savoyards par rapport à ceux
de l'avant, permettant par-là d'insister à nouveau sur les
questions de frontières : autant entre États qu'au sein
même de ceux-ci.
BURGENER Louis « Les cadets en Suisse », Revue
Militaire Suisse, n°131, 1986, p. 574-581. CHANET Jean
François, « La férule et le galon. Réflexion sur
l'autorité du premier degré en France de 1830 à la guerre
de 1914-1918 », dans Le Mouvement Social, n° 224, 2008, p.
105-
122.
CONDETTE Jean-François (dir), Les écoles dans
la guerre, Lille, Septentrion, 2014.
DEHAY Valérie, L'école primaire publique en
France pendant la guerre de 1914-1918, Thèse de doctorat en
histoire, sous la direction de AUDOIN-ROUZEAU Stéphane,
Université de Picardie, 2000.
PIGNOT Manon, « Les enfants », dans
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Jean-Jacques BECKER (dir),
Encyclopédie de la Grande Guerre, Paris, Bayard, 2004.
PIGNOT, Manon Allons enfants de la patrie.
Génération Grande Guerre, Paris, Le Seuil, 2012.
En étudiant l'enfance lors de la Première Guerre
mondiale, l'historienne Manon Pignot propose une étude originale qui
remet le point de vue des enfants au centre de l'étude et non pas celui
que les adultes ont de l'enfance. Pour des raisons de sources, il n'a pas
été possible d'adopter une démarche similaire dans ce
mémoire - peut-être d'ailleurs que l'enfance est paradoxalement la
grande oubliée de l'histoire de l'éducation ! Néanmoins,
les réflexions de Pignot se sont avérées
particulièrement utiles pour amener une approche spatialiste à
l'événement guerrier. Même problème - mais peut
être plus accentué - que le champ de l'éducation,
l'historiographie de la guerre ne met que très peu la dimension spatiale
des expériences vécues par les acteurs historiques en avant.
Effectivement, et comme nous l'avons-nous même modestement
constaté, lorsque les nations belligérantes entrent en guerre,
tout l'appareil social se tourne vers la patrie, qui devient, à
l'école comme ailleurs, le cadre spatial omnipotent. Ce fait est
largement repérable dans les archives, d'autant plus que leur
raréfaction en période de guerre accentue le
phénomène. Dans un souci affiché d'analyser les
expériences sensibles quotidiennes, micro-localisées des enfants,
l'historienne conclut à un différentiel très large entre
les enfants du front et ceux de l'arrière. Elle montre la lassitude et
la sensation de distance vis-à-vis de l'événement qui
prennent place chez les enfants habitants l'arrière. Sans avoir eu
l'occasion de prolonger ces réflexions, nous avons toutefois largement
réutilisé
183
cette idée pour à nouveau introduire des
frontières dans les expériences scolaires des enfants en temps de
guerre. Pignot émet l'hypothèse d'une plus grande
proximité entre des enfants du front français et allemands
vis-à-vis de leurs compatriotes respectifs. En inversant la proposition,
nous nous sommes demandé si les expériences de guerre des enfants
haut-savoyards - territoire assez préservé de la confrontation
avec l'appareil guerrier - et celles des voisins alpins valaisans,
n'était pas plus proches que celles des hauts-savoyards avec leurs
compatriotes de l'avant. Cette allégation, bien que prospective, permet
de réintroduire une distinction assez nette dans l'expérience
vécue à l'école, contre leur uniformisation dans l'effort
de guerre que l'on retrouve également dans les archives.
SAINT-FUSCIEN Emmanuel, Célestin Freinet. Un
pédagogue en guerres, 1914-1945, Paris, Perrin, 2017.
SAINT-FUSCIEN Emmanuel, « Ce que la guerre fait à
l'institution : l'école primaire en France autour du premier conflit
mondial », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2020,
n°278, p. 5-22.
Perspectives comparées
ASSIMA George, La France et la Suisse. Une histoire en
partage, deux patries en héritage, Paris, L'Harmattan, 2012.
CABANEL Patrick (dir.), Le tour de la nation par des
enfants. Romans scolaires et espaces nationaux, Paris, Belin, 2007.
CASPARD Pierre, Guide international de la recherche en
éducation, Paris, INRP, 1990.
CHANET Jean-François, « Instruction publique,
éducation nationale et liberté d'enseignement en Europe
occidentale au XIXe siècle », Paedagogica
historica, n°1-2, 2005, p. 9-29.
COMPERE Marie Madeleine, L'histoire de l'éducation
en Europe : Essai comparatif sur la façon dont elle s'écrit,
Paris-Berne, INRP, 1995.
COMPERE Marie-Madeleine, SAVOIE Philippe, « L'histoire de
l'école et de ce que l'on y apprend », Revue française
de pédagogie, n°152, 2005, p. 107-146.
FALAIZE Benoît, HEIMBERG Charles, LOUBES Olivier (dir.),
L'école et la Nation, Lyon, ENS, 2013.
FONTAINE Alexandre, Transferts culturels et
déclinaisons de la pédagogie européenne : le cas
franco-romand au travers de l'itinéraire d'Alexandre Daguet
(1816-1894), Thèse de langues, littérature et études
germaniques, sous la direction de ESPAGNE Michel et REINHARDT Volker,
Université Paris 8-Université de Fribourg, 2013.
GROUX Dominique (dir), Dictionnaire d'éducation
comparée, Paris, l'Harmattan, 2002. MATASCI Damiano,
L'école républicaine et l'étranger, Paris, ENS,
2015.
184
Publié à partir de sa thèse, l'ouvrage de
Damiano Matasci a beaucoup compté pour construire notre
réflexion, notamment par son objectif affiché de proposer une
histoire connectée de la scolarisation européenne qui
dépasse le cadre des nations. L'auteur adopte une démarche de
comparaison « par le haut » afin de montrer que les histoires
scolaires qui se pensent souvent par pays sont en réalité
imbriquées dans une multitude d'échanges en termes de pratiques
pédagogiques et de lois scolaires. Il analyse ainsi les emprunts et les
imitations qui sont monnaie courante à partir de la fin du
XIXe siècle au sein des nations européennes pour
construire leurs systèmes scolaires, allant jusqu'à parler d'une
« internationalisation » des savoirs scolaires,
particulièrement après la Première Guerre mondiale. Il
analyse ainsi les voyages d'étude, les missions pédagogiques, les
congrès internationaux ou encore les expositions universelles comme
autant d'événements qui participent à des échanges
globaux à propos de la scolarisation populaire. La démarche
adoptée par Matasci nous a été d'une grande utilité
lorsqu'il s'est agi de montrer que malgré la relative fermeture physique
des frontières nationales, les savoirs scolaires circulaient
au-delà, au travers de frontières et d'espaces moins saisissables
mais bien réels. Ainsi, les élèves-maîtres de
Haute-Savoie étaient régulièrement emmenés à
Genève, la revue pédagogique valaisanne empruntait
énormément aux revues française et les efforts de
coopération du canton - présenté comme quasi-totalement
isolé par l'historiographie - se tournaient vers les cantons romands ou
même vers la France : permettant ainsi à notre analyse
d'identifier un référentiel culturel commun entre les deux
territoires de l'étude. Ces observations ont permis de dynamiser et
d'étendre l'analyse en allant chercher au-delà de
l'opacité des frontières, les éléments communs aux
systèmes scolaires suisses et français.
OGNIER Pierre, L'école républicaine
française et ses miroirs. L'idéologie scolaire française
et sa vision de l'école en Suisse et en Belgique à travers La
revue pédagogique, 1878-1900, Berne, 1988.
Au plus proche des acteurs
BERTRAND Romain, CALAFAT Romain, « La microhistoire
globale : affaire(s) à suivre », Annales. Histoire, Sciences
Sociales, 73e année, n°1, 2018, p. 1 -18.
CERUTTI Simona, « Histoire pragmatique, ou la rencontre
entre histoire sociale et histoire culturelle », Tracés. Revue
de Sciences humaines, n°15, 2008, p. 147-168, p. 161.
CORBIN Alain, Les cloches de la terre. Paysage sonore et
culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle, Paris, Albin
Michel, 1994.
CORBIN Alain, Le Monde retrouvé de
Louis-François Pinagot : sur les traces d'un inconnu (1798-1976),
Paris, Flammarion, 1998.
GINZBURG Carlo, Le fromage et les vers. L'univers d'un
meunier du XVIe siècle, Paris, Flammarion, 1980
[1976].
GINZBURG Carlo, PONI Carlo, « La micro-histoire »,
Le Débat, n°17, 1981, p. 133-136.
185
LÜDTKE Alf, « La domination au quotidien. «
Sens de soi » et individualité des travailleurs en Allemagne avant
et après 1933 », Politix, n°13, 1991, p. 68-78.
LÜDTKE Alf, Histoire du quotidien, Paris,
Éditions de la Maison de l'Homme, 1994.
REMY Jean, VOYE Lilian, SERVAIS Émile, Produire ou
reproduire ? Une sociologie de la vie quotidienne, Bruxelles,
Éditions Vie Ouvrière, 1978.
REVEL Jacques (dir.), Jeux d'échelle : la
micro-analyse à l'expérience, Paris, EHESS, 1996. THOMPSON
Edward Palmer, The making of the english working class, London,
Gollancz, 1963.
THOMPSON Edward Palmer, « History from Below »,
Times Literary Supplement, n° 33, 1966, p. 279-280.
Autour de l'espace et de
l'environnement
ALAVOINE-MULLER Soizic, « Les Alpes d'Elisée
Reclus », Revue de géographie alpine, t. 89, n°4,
2001, p. 27-42.
BACKOUCHE Isabelle, RIPOLL Fabrice, TISSOT Sylvie et
VESCHAMBRE Vincent (dir), Dimension spatiale des
inégalités, PUR, 2011.
BOURDIN Alain, « De la production de l'espace aux lieux :
un itinéraire entre espaces et sociétés »,
Espaces et sociétés, n° 180-181, 2020, p. 79-96.
DEBARBIEUX Bernard, « Le lieu, le territoire et trois
figures de rhétorique », L'Espace géographique,
°24-2, 1995, p. 97-112.
DEBARBIEUX Bernard, « La (M)montagne comme figure de la
frontière : réflexions à partir de quelques cas »,
Le Globe. Revue genevoise de géographie, n°137, 1997 p.
145-166
DEBARBIEUX Bernard, « Identités, frontières
et projet de territoire. Une recherche sur les identités dans la
région genevoise [compte-rendu] », Le Globe. Revue genevoise de
géographie, n°150, 2010, p. 136-139.
DEBARBIEUX Bernard, RUDAZ Gilles, Les faiseurs de montagne,
Paris, CNRS, 2013.
Cet ouvrage des géographes Bernard Debarbieux et Gilles
Rudaz a été une véritable pierre d'angle dans la
construction de notre objet de recherche. En effet, nous éprouvions
jusqu'alors un sentiment de gêne dans la manière
d'appréhender la montagne alpine : Comment considérer ce qui
ressemblait à des déterminations du milieu physique sur les
pratiques des acteurs historiques sans pour autant tomber dans un naturalisme
suranné ? Les deux auteurs y répondent en privilégiant une
perspective constructiviste de la montagne. Dès lors, la montagne n'est
plus un objet en soi, elle se construit par l'interaction des
sociétés avec leur environnement et les représentations
qu'elles s'en font. En reprenant à l'histoire urbaine ses concepts
(Roncayolo et Topalov), Debarbieux et Rudaz proposent de considérer la
montagne comme une catégorie géographique de l'action collective
et des politiques
186
publiques. Depuis lors, quelques lectures en anthropologie de
la nature ont affiné nos analyses, mais cet ouvrage nous a permis de
considérer la montagne comme un cadre spatial dynamique, dans une
historiographie qui privilégie largement l'analyse de l'espace urbain et
quasiment jamais celles des espaces ruraux. Les deux auteurs montrent donc que
la montagne n'est pas un objet naturel mais qu'on lui a apposé une
lecture naturaliste dominante depuis le XVIIIe siècle. C'est
ainsi que stéréotypes tenaces ont été
affiliés aux Alpes et utilisés par les savants pour
édifier une typologie des montagnes largement ethnocentrée. Si
simple que soit ce constat, il nous a poussé à garder en
tête la distinction stricte entre la manière d'étudier
l'objet montagne et les représentations que s'en font les acteurs de
l'école au tournant des XIXe et XXe
siècles. Il nous a aussi été d'une grande utilité
dans les chapitres qui traitent des représentations du milieu alpin par
les institutions scolaires suisses et françaises - parents, instituteurs
- ainsi que pour analyser le regard que portent les villégiateurs sur
les Alpes. Enfin, cet ouvrage nous a donné quelques clefs pour analyser
la porosité des frontières dans les représentations
collectives que les acteurs se font de la montagne : le modèle du berger
suisse déborde les crêtes alpines et prend ensuite corps en
France.
En règle générale, nous avons largement
sollicité les travaux de Bernard Debarbieux, toujours très fins
et pertinents, particulièrement pour le sujet de notre
mémoire.
BERQUE Augustin, La mésologie, pourquoi et pour quoi
faire ? Nanterre, Presses Universitaires de Paris-Nanterre, 2014.
BERTRAND George, « Le paysage entre la Nature et la
Société », Revue géographique des
Pyrénées et du Sud-Ouest. Sud-Ouest Européen,
n°49, 1978, p. 239-258.
BROC Numa, Les montagnes vues par les géographes et
les naturalistes de langue française au XVIIIe
siècle, Paris, CTHS, 1969.
BROC Numa, « Le milieu montagnard : naissance d'un concept
», Revue de Géographie Alpine, t.72, n°2-4, 1984 p.
127-139.
CHARTIER Denis, RODARY Estienne, Manifeste pour une
géographie environnementale, Paris, Sciences Po, 2016.
CLEMENT Vincent, « Contribution
épistémologique à l'étude du paysage »,
Mélanges de la Casa de Velázquez, n°30, 1994, p.
221-237.
CRONON William, Nature et récit, essai d'histoire
environnementale, Éditions Dehors, Paris, 2016.
DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture,
Paris, Gallimard, 2005.
DION Roger, Essai sur la formation du paysage rural
français,Tours, Arrault, 1934.
FERRETTI Federico, « À l'origine de l'idée
de » frontières mobiles »: limites politiques et migrations
dans les géographies de Friedrich Ratzel et d'Élisée
Reclus », BRIT 2011 - Les frontières mobiles, Septembre
2011, France [en ligne] ffhal-00981037.
FREMONT Armand, La région, espace vécu,
Paris, Flammarion, 1999 [1976].
187
GUICHONNET Paul, RAFFESTIN Claude, Géographie des
frontières, Paris, PUF, 1974.
Certes, cet ouvrage est daté. Cependant, les
réflexions des deux géographes gardent une actualité
surprenante. Surtout, elles nous ont permis de réfléchir à
l'objet de frontière, qui nous semblait jusqu'alors difficile à
appréhender. Leur travail a pour mérite d'ouvrir la notion de
frontière à des acceptations dépassant sa seule
réalité matérielle. Acceptant que la frontière est
un phénomène social au sens large, les auteurs amènent
l'idée qu'elle n'est jamais totalement ouverte ni totalement
fermée, car elle se pense à plusieurs échelles. Cette
idée a été fructueuse pour notre travail, lorsqu'il
s'agissait de montrer que les territoires de l'étude étaient
très proches mais pourtant assez étanches l'un par rapport
à l'autre ; jouer sur le registre de frontières
immatérielles nous a aidé à affiner la réflexion.
Car en effet, même si les frontières étatiques sont peu
traversées, les idées et les savoirs pédagogiques
continuent de circuler. À l'inverse, en montrant que les
décalages de deux systèmes juxtaposés le long d'une ligne,
même imaginaire, induisent des décalages dans le paysage, les deux
auteurs réaffirment la puissance de sémiotisation de l'espace
qu'ont les États-nations. Ici encore, cette idée a infusé
dans notre propre travail de manière à comprendre les
différences dans l'appréhension de l'environnement alpin au sein
deux territoires ainsi que les moyens mis en place pour son aménagement.
D'autant plus que Paul Guichonnet est un spécialiste de la Savoie. Son
chapitre sur la frontière franco-genevoise durant « La Belle
Époque » rend bien compte de sa quasi-inexistence tant les
échanges sont importants - c'est le cas de la zone franche. Cela a pour
effet de créer des espaces d'identification, de vivre-ensemble, capables
- dans une certaine mesure - de transgresser les frontières nationales -
ses statistiques intéressantes sur la baisse des importations durant la
guerre ont montré que le territoire de référence reste
bien ici le territoire national. Ainsi, l'analyse très complète
de la frontière comme espace de jonction, de disjonction, comme
réalité plurielle a fortement influencé notre
manière d'appréhender l'objet.
INGOLD Tim, « Culture, nature et environnement »,
Tracés. Revue de Sciences humaines, n°22, 2012, p.
169-187.
NORDMAN Daniel, Frontières de France. De l'espace
au territoires, XVIe-XIXe siècle, Paris,
Gallimard, 1998.
OZOUF MARIGNIER Marie-Vic, La formation des
départements. La représentation du territoire français
à la fin du 18e siècle, Paris, EHESS, 1992.
PARTOUNE Christine, « La dynamique du concept de paysage
», Revue Éducation Formation, n° 275, 2004.
PITTE Jean-Robert, Histoire du paysage français,
Paris, Tallandier, 1983.
PIVETEAU Jean-Luc, « Le territoire est-il un lieu de
mémoire ? », L'espace géographique, n°24/2,
1995, p.113-123, p. 114.
RAMBAUD Placide, Sociétés rurales et
urbanisation, Paris, Le Seuil, 1973 [1969].
188
RIBEIRO Guillaume, « Question régionale,
identité nationale et émergence du monde urbain-industriel. La
modernité dans l'oeuvre de Paul Vidal de la Blache », Annales
de géographie, n° 699, 2014/5, p. 1215-1238.
ROBIC Marie-Claire (dir), Du milieu à
l'environnement : pratiques et représentations du rapport homme/nature
depuis la Renaissance, Paris, Economica, 1992.
WALTER François, « La montagne suisse. Invention
et usage d'une représentation paysagère
(XVIIIe-XXe siècle) », Études
rurales, n°121-124, 1991, p. 91-107
WALTER François, Les figures paysagères de
la nation territoires et paysages en Europe (16-20e siècle),
Paris, EHESS, 2004.
Historien suisse, François Walter choisit très
souvent, dans cet ouvrage, des exemples issus des figures paysagères
helvétiques. C'est particulièrement cet aspect qui a
compté pour notre travail. Grâce à cette lecture, nous
avons appréhendé la force du paysage montagnard dans
l'identité nationale suisse. Étant donné que nous
comparons deux territoires alpins, cette différence dans la
manière d'appréhender les Alpes - côté
français, espace aux marges de la nation et côté suisse,
élément central de l'hélvéticité - est d'une
grande utilité lorsqu'il s'est agi de comparer la place des Alpes dans
les romans nationaux - et donc au sein des écoles. Ainsi, la montagne,
espace de disjonction en France devient espace de communion en Suisse, ce qui
n'est pas sans incidence sur les manières de se représenter les
Alpes et ses habitants. Walter montre par ailleurs très bien de quelle
manière est forgée - principalement par les naturalistes du
XVIIIe siècle - les ethnotypes propres aux montagnards. Cela
les distingue pleinement des gens de la plaine, plus encore, de deux de la
ville : stéréotypes qui infusent encore grandement dans
l'école valaisanne un siècle plus tard. Au-delà même
de la figure du montagnard en Suisse, cet ouvrage constitue une base
théorique importante du mémoire. La notion de
territorialité entendue comme pratique de l'identité spatiale
permet de se défaire de concepts un peu trop lourds et difficiles
à manier comme celui de paysage. En empruntant à Augustin Berque
et même à une partie de l'anthropologie de la nature, l'auteur
donne une définition dynamique et phénoménologique de la
territorialité récusant l'opposition classique
paysage/société ou plutôt nature/culture. Partant du
vécu des acteurs, en privilégiant l'étude de leurs mots
pour dire leur relation au territoire, Walter entend montrer que le rapport au
monde est un perpétuel processus de négociations, que la
dimension territoriale entre en ligne de compte dans les représentations
et les pratiques socio-culturelles.
WALTER François, « La montagne alpine : un
dispositif esthétique et idéologique à l'échelle de
l'Europe », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°
52, 2005, p. 64-87.
Penser la comparaison
BLOCH Marc, « Pour une histoire comparée des
sociétés européennes », Revue de synthèse
historique, n°20, 1928, p. 15-50.
DETIENNE Marcel, Comparer l'incomparable, Paris, Le
Seuil, 2009.
ESPAGNE Michel, « Sur les limites du comparatisme en
histoire culturelle », Sciences Sociales et Histoire, n°17,
1994, p. 112-121.
ESPAGNE Michel, « La notion de transfert culturel »,
Revue Science/Lettres, [En ligne], 1 | 2013, mis en ligne le 01 mai
2012. URL :
http://journals.openedition.org/rsl/219.
JULIEN Élise, « Le comparatisme en histoire.
Rappels historiographiques et approche méthodologique »,
Hypothèses, n°8, p. 191-201.
189
PHILLIPS David, OCHS Kimberley, Educational Policy Borrowing
: historical perspectives, Oxford, Symposium Book, 2004.
RETAILLE Denis, Les lieux de la mondialisation,
Paris, Le Cavalier Bleu, 2012.
SIMIAND François, « Méthode historique et
science sociale », Annales, n°15, 1960 [1903], p. 83-119.
STANZIANI Alessandro, Les entrelacements du monde,
Paris, CNRS, 2018.
WERNER Michel, ZIMMERMANN Bénédicte, «
Penser l'histoire croisée : entre empirie et réflexivité
», Annales. Histoire. Sciences Sociales, 58e
année, n°1, 2003, p. 7-36.
Épistémologie
Étienne ANHEIM, « L'historien au pays des
merveilles ? », Revue française d'anthropologie,
n°203, 2012, p. 399-427.
BARTHE Yannick, DE BLIC Damien, HEURTIN Jean-Philippe et
al., « Sociologie pragmatique : mode d'emploi »,
Politix, n° 103, 2013/3, p. 175-204.
BOCQUET Denis, « les études multi-situées,
entre pragmatisme et construction scientifique d'une posture »,
Espaces et Sociétés, n°178, 2019/3, p. 175-182.
BOURDIEU Pierre, Réponses. Pour une anthropologie
réflexive, Paris, Minuit, 1992.
BOURDIEU Pierre, « Sur les rapports entre sociologie et
histoire en Allemagne et en France », Actes de la recherche en
sciences sociales, n°106-107, 1995, p. 108-122.
(DE) CERTEAU Michel, L'écriture de l'histoire,
Paris, Gallimard, 1975.
CHARTIER Roger, Au bord de la falaise. L'histoire entre
certitudes et inquiétudes, Paris, Albin Michel, 1998.
DELACROIX Christian, DOSSE François, GARCIA Patrick,
OFFENSTADT Nicolas (dir), Historiographie, concepts et débats,
Paris, Gallimard, 2010.
FARGE Arlette, Le goût de l'archive, Paris, Le
Seuil, 1981.
GINZBURG Carlo, « Signes, traces, pistes. Racines d'un
paradigme de l'indice », Le débat, n°6, 1980, p.
3-44.
HOBSBAWM Eric, RANGER Terence, L'invention de la tradition
[1983], Paris, Ed. Amsterdam, 2006.
PAUKETAT Timothy, Agency in Archaeology,
London-New-York, Routledge, 2000.
PASSERON JEAN-CLAUDE, Le raisonnement sociologique. L'espace
non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, l'Harmattan, 1991.
190
PROST Antoine, Douze leçons sur l'histoire,
Paris, Le Seuil, 1996. RICOEUR Paul, La Mémoire, l'Histoire et
l'Oubli, Paris, Le Seuil, 2000.
191
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS 3
Introduction générale 7
PREMIÈRE PARTIE. Le lieu scolaire :
matérialité, pratiques et représentations 19
CHAPITRE 1. L'aménagement des lieux 21
A] Rôle de l'État, Rôle de la commune 21
B] Une multitude d'école aux faibles effectifs 25
C] La fonction spatiale du lieu 27
CHAPITRE 2. Quand l'école se heurte au climat 31
A] L'isolement hivernal 31
B] Des bâtiments inadaptés 35
C] Lutter contre le froid 38
CHAPITRE 3. Pratiquer l'école dans les Alpes suisses et
françaises 43
A] Des écoles valaisannes à temporalité
variable 44
B] De la mixité scolaire 47
C] La gymnastique, une oubliée de l'école
montagnarde ? 51
D] De vieux élèves 52
DEUXIÈME PARTIE. Jeux de frontières et trajectoires
de vies. 57
CHAPITRE 4. Pour vivre heureux, vivons cachés 59
A] Haute-Savoie, Valais : contigus et pourtant fermés
59
B] Genève, frontière poreuse 62
C] Le Valais, aux prises entre isolement et collaboration 65
CHAPITRE 5. Frontières de l'enseignement. 69
A] La place des Alpes dans les romans nationaux français
et suisses 69
B] Une meilleure moralité, un meilleur niveau scolaire ?
71
C] L'église, pierre d'angle de l'enseignement valaisan
75
D]
192
Des échanges « par en haut » 79
CHAPITRE 6. Le tourisme, sauveur des petites patries ? 85
A] Les petites patries et le tourisme 87
B] Un enseignement international 93
C] Nouveaux horizons d'emplois, Guides ou hôteliers 97
CHAPITRE 7. Le maître, la maîtresse et l'enfant.
103
A] Instituteurs haut-savoyards, instituteurs valaisans 103
B] Enseigner dans les Alpes 108
C] Quitter la montagne pour poursuivre ses études ?
112
D] Enfants étrangers, entre rejet et acceptation 115
TROISIÈME PARTIE. Les Alpes protègent-elles de la
guerre ? 119
CHAPITRE 8. Des systèmes scolaires ébranlés.
121
A] L'appel et la mobilisation des corps enseignants 121
B] Faire fonctionner l'école en temps de guerre 125
C] L'école subit les conséquences de la guerre
128
CHAPITRE 9. L'école transfigurée 133
A] L'école, usine du front, terreau nourricier de la
nation 133
B] L'école solidaire 138
C] L'école nationale et patriotique 142
CHAPITRE 10. Les territoires alpins dans la guerre 149
A] La Haute-Savoie, un territoire éloigné du front
149
B] La fermeture des frontières 154
C] Nouvelles frontières ? 157
CONCLUSION : L'école des Alpes, quel bilan ? 161
Annexes 165
Etat des sources 169
Bibliographie Générale 175
193
|
|



