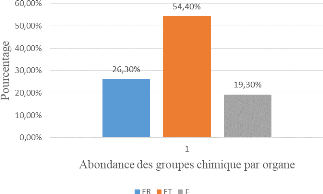REP UBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

Faculté Les Sciences Pharmaceutiques
B.P.1825
LUBUMBASHI

Novembre 2021
ETUDE DIFFERENTIELLE DES NOMS VERNACULAIRES
DE
PILIOSTIGMA RETICULATUM ET PILIOSTIGMA
THONNINGII UTILISEES EN MEDICINE
TRADITIONELLE
DANS LE HAUT-KATANGA
MWENEBATU ECIBA BENEDICT
Travail Le fin Le cycle présenté en vue Le
l'obtention Lu GraLe Le graLué en Sciences Pharmaceutiques

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
|
Faculté des Sciences Pharmaceutiques
B.P.1825
LUBUMBASHI
|
|
ETUDE DIFFERENTIELLE DES NOMS VERNACULAIRES
DE
PILIOSTIGMA RETICULATUM ET PILIOSTIGMA
THONNINGII UTILISEES EN MEDICINE
TRADITIONELLE
DANS LE HAUT-KATANGA
MWENEBATU BENEDICT ECIBA
Travail de fin de cycle présenté en vue de l'
obtention du Grade de gradué en S ciences P harmaceutiques
Directeur : Dr Phn KAHUMBA BYANGA
Professeur Ordinaire
ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021
I
IN MEMORIAM
A mon feu Papa Révérend Pasteur ECIBA
MBOKO Lutho (Buffle),
toi qui t'es battu corps et âme au péril de
ta vie enfin que ton fils étudie. Après tout le sacrifice, tu es
parti si tôt Papa. Mon grand regret est que tu es parti sans tirer gain
de ton investissement en moi.
Être ton fils est une fierté immense !
II
AVANT-PROPOS
Ce travail est le résultat d'un ensemble des
connaissances scientifiques acquises et conjuguées par un effort, un
apport matériel et moral d'un certain nombre d'intervenants dont chacun
à mis sa pierre pour parfaire sa construction.
De prime à bord, nos remerciements s'adressent au
Professeur KAHUMBA BYANGA pour avoir accepté de diriger ce travail ;
veuillez recevoir cher Professeur toute ma reconnaissance et mes
sincères remerciements pour vos conseils scientifiques sans lesquels ce
travail ne serait arrivé à son terme.
Nous remercions également le Chef de Travaux
Pharmacien NTABAZA NDAGE pour son encadrement. Qu'il accepte notre
témoignage de gratitude.
Nous remercions l'assistant Pharmacien MOKE MUINDU pour
toutes les activités relatives à ce travail.
Nous disons également merci aux autorités de
la faculté des Sciences Pharmaceutiques, le corps scientifique et
académique pour leur apport dans notre formation de futur
pharmacien.
Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui nous
ont aidés dans la récolte des données sur terrain,
particulièrement à tous les tradithérapeutes.
Nos sincères remerciements à IBUNGU ECIBA
Léoncy et ISAMBECO LY'ECIBA Jérôme qui ont
été pour nous un exemple de courage, de
persévérance et d'honnêteté mais surtout pour leur
soutien dans la réalisation de ce travail et à tous mes
frères et soeurs.
Nous ne pouvons oublier nos ami(e)s, collègues et
compagnons de lutte à la quête du savoir avec qui nous avons
partagé d'immenses plaisirs et durs moments de notre vie
académique, nous citons : MUYA KANYINDA Pascal, MUKABA NGOY Caleb,
MPUNGU FATAKI Guy. Que chacune et chacun trouvent l'expression de nos
sentiments de franches collaborations.
Notre gratitude à toutes les personnes qui ont
contribuées de près ou de loin à la réalisation de
ce travail, veuillez trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.
III
RESUME
Les plantes médicinales sont une source importante
de recettes efficaces dans le traitement de diverses affections. Près de
80 % de la population Africaine recourt à la médecine
traditionnelle pour leur soin de santé primaire. La médecine
traditionnelle offre un arsenal thérapeutique à des maladies via
plusieurs substances naturelles dont les plantes qui pour la plupart ne sont
pas suffisamment étudiées et ayant des noms vernaculaires sujets
de confusions et causes d'intoxications. L'étude phytochimique de ces
plantes médicinales peut donc contribuer à la connaissance
scientifique de l'usage traditionnel de ces dernières. L'objectif de
cette étude est de réaliser une étude
différentielle des noms vernaculaires de Piliostigma reticulata et
Piliostigma thonningii utilisées en médicine traditionnelle dans
le Haut-Katanga
Une enquête ethnobotanique a été
menée à Lubumbashi dans un rayon de 30 Km2 des
environs auprès de 120 tradipraticiens de 10 différentes tribus
sur la pratique de la médecine traditionnelle et la connaissance de la
signification des noms vernaculaires. Il s'en ai suivi d'une récolte et
identification au laboratoire de la faculté des Sciences agronomiques et
d'un criblage phytochimique par des réactions en solution.
Les tradipraticiens de sexe masculin représentaient
67,5 % tandis que ceux de sexe féminin 32,5 %. Seuls les tradipraticiens
Bemba et Lamba ont su donner la signification des noms vernaculaires des
plantes sous études. Quant au criblage phytochimique, sur l'ensemble des
tests positifs obtenus après les analyses sur les différents
organes étudiés, les tanins et les flavonoïdes sont les
composés trouvés dans toutes les parties des plantes
analysées soit (100%) de tests positifs, les anthocyanes sont
retrouvés à 83,3%, suivis des stéroïdes et saponines
à 50%, coumarines 33,3%, alcaloïdes et terpénoïde
16,7%. Les quinones et les hétérosides cyanogènes ont
été absent (0%) dans tous les organes pour toutes les plantes
étudiées. Quant aux espèces végétales,
Bauhinia reticulata donne 9 tests positifs sur les 11 recherchés soit
81,8% et 7 tests positif pour le Piliostigma thonningii soit 63,6%.
Ces résultats montrent que ces plantes sont riches
en métabolites secondaires et sont différentes l'une de l'autre.
Ainsi une confusion entre les deux ne serait pas sans
conséquence.
Mots clés : confusion des plantes médicinales,
Piliostigma thonningii, Bauhinia reticulata, phytochimie.
IV
ABSRAT
Herbal remedies are an important source of effective
recipes in the treatment of various ailments. Almost 80% of the African
population uses traditional medicine for their primary health care. Traditional
medicine offers a therapeutic arsenal to diseases via several natural
substances including plants which for the most part are not sufficiently
studied and having vernacular names subject to confusion and causes of
intoxication. The phytochemical study of these medicinal plants can therefore
contribute to the scientific knowledge of the traditional use of the latter.
The objective of this study is to carry out a differential study of the
vernacular names of Piliostigma reticulata and Piliostigma thonningii used in
traditional medicine in Haut-Katanga
An ethnobotanical survey was carried out in Lubumbashi
within a radius of 30 km2 of the surroundings with 120 traditional healers from
10 different tribes on the practice of traditional medicine and the knowledge
of the meaning of vernacular names. This was followed by a harvest and
identification in the laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences and a
phytochemical screening.
Male traditional healers accounted for 67.5% while female
32.5%. Only the traditional healers Bemba and Lamba were able to give the
meaning of the vernacular names of the plants under study. As for the
phytochemical screening, on all the positive tests obtained after the analyzes
on the various organs studied, the tannins and the flavonoids are the compounds
found in all the parts of the plants analyzed, i.e. (100%) of positive tests,
the anthocyanins are found at 83.3%, followed by steroids and saponins at 50%,
coumarins 33.3%, alkaloids and terpenoid 16.7%. Quinones and cyanogenic
heterosides were absent (0%) in all organs for all plants studied. As for plant
species, Bauhinia reticulata gives 9 positive tests out of the 11 sought, i.e.
81.8% and 7 positive tests for Piliostigma thonningii, i.e. 63.6 %.
These results show that these plants are rich in secondary
metabolites and are different from each other. Thus a confusion between the two
would not be without consequence.
Key words: medicinal plant
confusion, Piliostigma thonningii, Bauhinia reticulata, phytochemistry.
V
LISTE DES ABREVIATIONS
: Absence
: Présence
Alc : Alcaloïdes
Anth : Anthocyanes
ER : Ecorses de racines
ET : Ecorses de tiges
F : Feuilles
Flav : Flavonoïdes
HCN : Hétérosides cyanogènes
PL : Plante
PU : Partie utilisée
Quin : Quinones
RDC : République Démocratique du Congo
Rés + : Résultats positifs
Sap : Saponines
Ster : Stéroïdes
Tanc : Tanins catéchiques
Tang : Tanins galliques
Terp : Terpénoïde
VI
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM I
AVANT-PROPOS II
RESUME II
ABSRAT IV
LISTE DES ABREVIATIONS V
TABLE DES MATIERES VI
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX VII
INTRODUCTION 1
I. GENERALITES SUR LES PLANTES MEDICINALES 2
I.1. DEFINITION 2
I.2 METHODES D'IDENTIFICATION DES PLANTES MEDICINALES 2
I.3. CONNAISSANCES BIBLIOGRAPHIQUES DES PLANTES SOUS ETUDE 7
I.4. INTOXICATION DUE AUX CONFUSION DE NOMS VERNACULAIRES 11
II. DESCRIPTION DU CADRE DE RECHERCHE 12
II.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 12
III. PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 19
III. 1. PRESENTATION DES RESULTATS 19
CONCLUSION 27
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 28
VII
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX
|
Figure 1 : Bauhinia reticulata (DC) :
|
7
|
|
Figure 2 : Piliostigma thonningii
|
8
|
|
Figure 3 : Abondance en composés chimiques dans l'ensemble
des plantes.
|
24
|
|
Figure 4 : abondance des groupes chimiques par organe
utilisé
|
26
|
|
Tableau 1 : revue bibliographique du criblage phytochimique des
deux espèces sous étude
|
..10
|
|
Tableau 2. Profils socio-démographiques des personnes
ressources
|
..19
|
|
Tableau 3. Présentation des données sur les
connaissances ethnopharmacologiques
|
21
|
|
Tableau 4 : Résultats globaux du criblage chimique
|
23
|
1
INTRODUCTION
L'utilisation des plantes, à des fins
thérapeutiques, est rapportée dans les littératures
antiques arabes, chinoises, égyptiennes, hindous, grecques, romaine. En
Afrique, le pouvoir thérapeutique des plantes était connu par nos
ancêtres et nos parents de façon empirique. Ces plantes
étaient utilisées quand bien même la composition
n'était pas connue. A ceci s'ajoute l'impact du brassage des cultures et
la déformation des mots qui apporte une grande confusion même dans
l'usage des plantes médicinales. Pour parvenir à une
amélioration de cette médecine africaine, plusieurs
investigations phytochimiques ont été faites, afin d'apporter une
justification scientifique quant à l'utilisation traditionnelle des
plantes médicinales Zirihi (2006) et en plus de l'aspect inventaire
botanique, Neuwinger (2004) a consacré une partie de ses travaux
à l'étude chimique et toxicologique de 305 espèces de
plantes, en provenance de divers pays d'Afrique. Les travaux de Nacoulma
(1996), repris par Neuwinger (2004) ont porté sur l'inventaire et la
composition chimique des différents organes de 391 espèces de
plantes. Cependant l'ambigüité sur les noms vernaculaires autour
des certaines plantes demeure.
Dans cette étude il est question de réaliser une
comparaison des profils phytochimiques de deux espèces
végétales : Bauhinia reticulata (Piliostigma reticulatum) et
Piliostigma thonningii, lesquelles partagent un même nom
vernaculaire en langue Bemba et Lamba (Kifumbe).
Un questionnaire semi-structuré a été
utilisé pour la récolte des donnés auprès des
tradipraticiens. Un consentement éclairé a été
obtenu par chaque tradipraticien avant l'enquête et une somme d'argent
était proposé aux tradipraticiens afin d'augmenter le taux de
participation et solliciter une décente sur terrain pour la
récolte d'un herbier (Marpsat & Razafindratsima, 2010). Un rayon de
30 Km des environs de Lubumbashi a été considéré
comme zone d'étude pour l'enquête ethnobotanique durant une
période de sept mois soit de janvier au juillet 2021
Ainsi, cette étude est présentée en deux
grandes parties, la première sera consacrée aux données
bibliographiques sur ces espèces, la seconde sur les protocoles
expérimentaux, les résultats obtenus et la discussion y
afférente.
Première partie :
Données bibliographiques
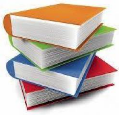
2
I. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
I.1.GENERALITES SUR LES
PLANTES MEDICINALES
Cette partie du travail relative aux données
bibliographiques portera sur les généralités sur les
plantes médicinales, la description botanique et l'intoxication due aux
confusions de noms vernaculaires.
I.1.1. DEFINITION
Selon l'OMS, une plante médicinale fait
référence à toute plante qui contient une ou plusieurs
substances pouvant être utilisées à des fins
thérapeutiques ou qui sont des précurseurs dans la
synthèse de drogues utiles. Ces plantes médicinales peuvent
également avoir des usages alimentaires, condimentaires ou
hygiénique (Hammiche & Maiza 2006).
Les plantes sont des pharmacies naturelles pour guérir
nos maladies, voir les prévenir. Jusqu'à nos jours, et
malgré le développement technologique considérable, les
plantes médicinales n'ont jamais perdu leur charme et importance. La
guérison des maladies fréquentes par ces cures naturelles
représente un intérêt croissant pour le monde entier,
d'où l'importance à mieux les connaître et à les
utiliser pour se soigner efficacement et sans risques inattendus (Hammiche
& Maiza 2006).
Plusieurs raisons sont la cause pour laquelle les populations
font recours aux remèdes naturels. Non seulement, du fait que cette
culture traditionnelle est héritée de nos ancêtres, mais
parce qu'elle a aussi prouvé son efficacité et sa
sécurité au fil du temps. Donc, c'est l'expérience et pas
le hasard d'un côté et pour d'autres raisons liées à
l'utilisation des médicaments conventionnels telles que
l'inaccessibilité à cause du coût élevé, d'un
autre côté.
I.1.2 METHODES D'IDENTIFICATION DES PLANTES
MEDICINALES
Les plantes sont indispensables à l'homme. Elles
n'entrent pas seulement dans sa nourriture, mais aussi bien dans ses plaisirs
et sa santé car les effets curatifs des plantes médicinales sont
connus depuis les temps les plus reculés. En réalité
toutes les plantes qui entretiennent notre corps ou font maintenir
l'équilibre de notre santé peuvent être
considérées comme plantes médicinales, Il est fort
possible que les premières découvertes des
propriétés
3
curatives des végétaux fussent fortuites car en
voulant se nourrir, l'homme primitif trouva leur faculté
médicinale, et il fut certainement aidé dans cela par
l'observation des animaux, qui instinctivement savaient s'en servir.
L'utilisation de ces plantes était également connue des
civilisations de l'antiquité pour des usages religieux,
cosmétiques mais aussi thérapeutiques. Ils citaient le ricin,
l'anis, le blé, le lotus, et ils faisaient appel à quelques 400
drogues dont la majorité était d'origine végétale
(Hammiche & Maiza, 2006).
Depuis l'antiquité l'homme a employé des
remèdes traditionnels à base de plantes sans savoir à quoi
étaient dues leurs actions bénéfiques, il reste difficile
de définir les molécules responsables de l'action bien que
certains effets pharmaceutiques prouvés sur l'animal ont
été attribués à des composés tels que les
alcaloïdes, les terpènes, les stéroïdes et les
composés poly phénoliques (Hammiche & Maiza, 2006).
Les recherches modernes ne font que redécouvrir ce
savoir acquis au cours des siècles. En effet, de nombreux travaux
notoires ont pu démontrés l'activité biologique et les
modes d'action thérapeutiques des métabolites extraites à
partir des plantes. Ces dernières permettent d'aborder les traitements
de façon globale et moins agressive en éliminant la plupart des
effets secondaires connus chez certains médicaments dits moderne.
L'étude de ces connaissances ancestrales par les sciences modernes,
révèle progressivement quelques secrets de la nature qui
permettent à l'homme de poursuivre son évolution. Les plantes
médicinales sont classées en fonction sur les
caractéristiques internes et externes (Hammiche & Maiza, 2006).
Les caractéristiques externes des plantes sont utiles
à leur identification. Selon les plantes taxonomie, on trouve une
classification des plantes basée sur les formes de leurs feuilles et
leurs fleurs. Mais la classification des plantes basée sur la couleur
histogramme, direction du bord, l'histogramme du bord n'est pas tenté
par des êtres humains.
Dans ce cadre, une étude bibliographique est pour
trouver l'état de l'art. Certains chercheurs ont étudié le
processus de classification basé sur les méthodes
hiérarchiques et autres. Les plantes médicinales ont une
classification basée sur les parties, les feuilles, les fleurs et les
tiges, etc. montré des résultats significatifs. Nous trouvons le
segmentation et génération d'histogrammes à l'aide de la
couleur HSV l'espace et une analyse basée sur la perception visuelle de
la variation dans les valeurs de teinte, de saturation et d'intensité
d'un pixel d'image dans récupération d'images. Classification
couleur-texture avec couleur l'histogramme et le
4
modèle binaire local sont utilisés pour fournir
des données robustes informations relatives au modèle.
Les histogrammes de couleur contiennent très
informations de couleur discriminantes .Il est proposé que la couleur
les histogrammes ont des caractéristiques identifiables qui se
rapportent à une manière mathématique aux
propriétés de la scène (Anami, 2010).
Les résultats expérimentaux montrent que les
arbres sont assez classés en utilisant la méthodologie
proposée comme caractéristiques de bord et de couleur car les
arbres se distinguent clairement des herbes et des arbustes. La classification
basée sur la fonction d'histogramme des couleurs donne une
précision, puisque la majorité des plantes ont une couleur verte
(Anami, 2010).
De plus, les nuances changent selon les saisons, provoquant
une caractéristique de couleur fiabilité faible. Par
conséquent, les bons résultats sont obtenus par la combinaison de
caractéristiques de couleur et de texture (bord). On constate que la
précision de la classification est meilleure avec le classificateur SVM
que neuronale classificateur de réseau. La méthodologie n'a pas
donné de bons résultats pour les images d'herbes et d'arbustes
(Anami, 2010).
Ceci est attribué au manque de bord informations sur la
portion de tige. Le travail aide les êtres humains à
classification des plantes médicinales dans le monde réel et
considérée comme une tâche essentielle dans l'industrie
pharmaceutique, l'Ayurved praticiens et botanistes (Anami, 2010)
I.2.1. Médecine traditionnelle
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que
80% de la population des pays en développement sont tributaires de la
médecine traditionnelle, en recourant principalement aux extraits des
plantes pour satisfaire leurs besoins. Cette situation peut s'expliquer par la
pauvreté des populations, leurs habitudes socioculturelles,
l'enclavement des zones rurales, l'absence des infrastructures sanitaires ou
rudimentaires, le cout élevé des préparations
pharmaceutiques (Thring & Weitz 2006)
5
Les plantes médicinales constituent des ressources
inestimables pour l'industrie pharmaceutique et leur meilleure exploitation
passe par des enquêtes ethnobotaniques qui permettent de jour en jour de
dresser une liste non exhaustive d'espèces végétales
utilisées en médecine traditionnelle par les populations (Thring
& Weitz 2006).
I.2.2. Phytothérapie
Le terme « Phytothérapie », provient du grec
« phyton » qui signifie « plante » et « therapein
» qui signifie « soigner ». La phytothérapie
désigne la médecine basée sur les extraits de plantes et
les principes actifs naturels.
On peut la distinguer en trois (3) types de pratiques :
(i) une pratique traditionnelle, parfois très ancienne
basée sur l'utilisation des plantes selon les vertus découvertes
empiriquement, (ii) une pratique basée sur les avancées
et les preuves scientifiques, qui recherchent des principes actifs extraits des
plantes et (iii) une pratique de prophylaxie, déjà
utilisée dans l'antiquité. Nous sommes tous
phytothérapeutes sans le savoir : c'est notamment le cas dans la
cuisine, avec l'usage d'Ail, du thym, du Gingembre ou simplement du Thé
vert ... Une alimentation équilibrée et contenant certains
éléments actifs étant une phytothérapie
prophylactique (Zerbo et al., 2010).
I.2.2.1. Bienfaits de la phytothérapie
Malgré les énormes progrès
réalisés par la médecine moderne, la phytothérapie
offre de multiples avantages. N'oublions pas que de tout temps, à
l'exception de ces cent dernières années, les hommes n'ont eu que
les plantes pour se soigner, qu'il s'agisse de maladies bénignes
(toux...) ou plus sérieuses, telles que la tuberculose ou la malaria.
Aujourd'hui, les traitements à base de plantes reviennent au premier
plan, car l'efficacité des médicaments tels que les antibiotiques
(considérés comme la solution quasi universelle aux infections
graves), décroit : les bactéries et les virus se sont peu
à peu adaptés aux médicaments et leur résistent de
plus en plus (Zerbo et al., 2010).
Encore, Les plantes médicinales sont en mesure de
soigner des maladies simples comme le rhume, ou d'en prévenir de plus
importantes comme l'ulcère, la migraine, l'infarctus, certaines
allergies ou affections. Aussi, la phytothérapie qui repose sur des
remèdes naturels est bien acceptée par l'organisme avec moins
d'effets secondaires reconnus que beaucoup de médicaments de
synthèse.
6
Par ailleurs, la phytothérapie est moins chère
que la médecine orthodoxe. Le coût de cette dernière est
augmenté par la technologie de santé moderne, qui dans beaucoup
de cas est inappropriée, inapplicable aux besoins immédiats des
habitants des pays en voie de développement.
D'autre part, elle est plus accessible à la
majorité de la population du Tiers Monde ; ainsi qu'elle jouisse d'une
large susceptibilité parmi ses habitants des pays en voie de
développement, ce qui n'est pas le cas de la médecine moderne
(Zerbo et al., 2010).
I.2.3. Ethnobotanique
L'Ethnobotanique est synonyme de l'étude des plantes
utilisées par des populations primitives. L'ethnobotanique englobe les
recherches suivantes : L'identification : Recherche des noms vernaculaires des
plantes, de leur nomenclature populaire, leur aspect et leur utilité ;
l'origine de la plante ; la disponibilité, l'habitat et
l'écologie ; la saison de cueillette ou de récolte des plantes ;
les parties utilisées et les motifs d'utilisation des
végétaux ; la façon d'utiliser, de cultiver et de traiter
la plante ; L'importance de chaque plante dans l'économie du groupe
humain ; L'impact des activités humaines sur les plantes et sur
l'environnement végétal.(V et al., 2018)
Donc l'ethnobotanique se définie comme l'ensemble des
interrelations des hommes avec leur environnement végétal. Elle
repose principalement sur les résultats d'enquêtes sur
terrain ainsi que le recueil des données
bibliographiques.
Ainsi, l'ethnobotanique et l'ethnopharmacologie sont
essentielles pour conserver une trace écrite au sein des
pharmacopées des médecines traditionnelles (Zerbo et al.,
2010).
7
I.2. CONNAISSANCES BIBLIOGRAPHIQUES DES PLANTES
SOUS ETUDE
I.2.1. Bauhinia reticulata (DC)

Figure 1. Bauhinia reticulata (DC)
Famille : Ceasalpiniaceae
Synonymes : Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst,
Bauhinia benzoin Kotschy. Noms vernaculaires : Kifumbe
Description : P. reticulatum
(DC.) Hochst (Ceasalpiniaceae) est un arbre ou un arbuste qui est
généralement de 1 à 10 m et se présente souvent
sous forme de buissons. Cette plante soudano-sahélienne est
traditionnellement utilisée dans le traitement de nombreuses maladies
telles que la dysenterie, diarrhée, inflammation, infections,
névralgie, variole, paludisme, rhumatismes. De plus, les feuilles et les
écorces de P. reticulatum sont utilisés dans les
aliments pour la préparation de produits locaux pâte alimentaire.
Les écorces sont stimulant la digestion.(Zerbo et al., 2010).
L'analyse phytochimique des extraits de P. reticulatum a
été réalisée en utilisant des méthodes
qualitatives standard pour la détermination de différents groupes
chimiques : tanins et phénoliques composés, flavonoïdes,
saponines, triterpénoïdes, stéroïdes, coumarines,
alcaloïdes, anthocyanes.
Les références chimiques utilisées sont :
galangine, chrysine, acacétine, genestein, apigénine,
lutéaline, quercitrine, acide cinnamique, quercétine, rutine,
acide férulique, acide gallique, acide hydrocinnamique, acide
caféique et acide vanillique (Zerbo et al., 2010).
8
L'utilisation d'écorces de P. reticulatum
peuvent aider pour prévenir les dommages oxydatifs et les
infections telles que diarrhée et dysenterie dans le corps humain et
peuvent contribuer à la conservation des aliments. Ces résultats
montrent que l'écorce de P. reticulatum pourrait être
utilisée comme antioxydant naturel et agent antibactérien (Zerbo
et al., 2010).
Les écorces de Piliostigma reticulatum sont
très riches en polyphénols composé majoritairement de
tanins condensés. Ce dernier serait responsable pour leur forte
activité antioxydante. Il serait donc intéressant
d'évaluer l'activité biologique des écorces de la plante
comme anti-inflammatoire, activités antimicrobiennes. Il serait
également important d'étudier la nature de tanins pour une
meilleure utilisation thérapeutique pour la fabrication de
médicaments améliorés (TMI) (Ibra et al., 2020).
Le criblage phytochimique qualitatif préliminaire des
extraits a été effectué pour déterminer la
présence de saponines, de flavonoïdes, alcaloïdes,
phénols, tanins, huiles volatiles, glycoside et
stéroïdes.
I.2.2. Piliostigma thonningii (Schumach)

Figure 2. Piliostigma thonningii
Synonyme : Bauhinia thonningii Schumach. Locellaria
bauhinioides Welw, Gigasiphon bauhinioides.
Famille Salpiniaceae
Noms vernaculaires : Kifumbe
Description : Arbre caducifolié,
dioïque, atteignant 10(-40) m de haut, parfois arbustif ; fût
dépourvu de branches sur 2-3 m de hauteur, tordu, atteignant 30(-35) cm
de diamètre ; écorce externe rugueuse, fissurée
longitudinalement, brun foncé à grise ou noire,
9
écorce interne fibreuse, rose à rouge-brun
foncé à la coupe ; cime étalée ; branches
recouvertes d'un tomentum brun rouille, plus ou moins glabrescentes par la
suite. Feuilles alternes, distinctement bilobées sur un huitième
jusqu'à un tiers de la longueur ; stipules de 3-6 mm de long, caduques ;
pétiole de 2-5(-7) cm de long, pubescent ; limbe atteignant 17 cm X 21
cm, base habituellement fortement cordée, apex des lobes arrondi
à aigu, coriace, face supérieure glabre, face inférieure
à poils cassants brun rouille et à nervures
réticulées bien visibles, palmatinervé à 11-15
nervures basales. Inflorescence : panicule, habituellement - de façon
alternée - opposée aux feuilles et axillaire le long des
branches, inflorescence mâle très étroitement pyramidale,
atteignant 25 cm X 5,5 cm ; inflorescence femelle atteignant 7 cm de long, ne
contenant que quelques fleurs ; axes brun-tomentelleux. Fleurs
unisexuées, parfumées ; calice en coupe, de 1-2,5 cm de long,
5-lobé, brun-tomentelleux ; pétales 5, obovales, de 1- 2,5 cm de
long, ridés, à bord fortement ondulé, blancs à
lilas ou roses ; étamines 10(-11), atteignant à peine la gorge de
la fleur, réduites à des staminodes chez les fleurs femelles ;
ovaire brun-tomenteux, rudimentaire chez les fleurs mâles ; style
très court ou absent ; stigmate capité. Fruit : gousse oblongue
à linéaire-oblongue de 12-30(-37) cm X 3-7 cm, ligneuse,
brun-pubescent à l'état jeune mais glabrescente par la suite,
persistante sur l'arbre mais finissant par pourrir au sol, contenant de
nombreuses graines. Graines obovoïdes à ellipsoïdes, de 4-9 mm
X 2-7 mm X 3-4 mm, brun foncé à noirâtres,
comprimées. Plantule à germination épigée (Afolayan
et al. 2018).
10
I.2.3. DONNEES DU CRIBLAGE PHYTOCHIMIQUE
Les études photochimiques réalisées sur
Bauhinia reticulata et Piliostigma thonningii
Tableau 1 : revue bibliographique du criblage phytochimique des
deux espèces sous étude
Organes Alc Flav Anth Quin Coum Sap Tanc Tang Terp Ster HCN
Références
|
Bauhinia reticulata ER
ET F
Piliostigma thonningii ER
ET F
|
|
(Mustapha et al., 2016; Dluya & Dahiru, 2018)
(Omoregie &
Oluyemisi, 2010;
(Afolayan et al. 2018)
|
Quoique les plantes étudiées
appartiennent à une même famille, on observe des
différences des profils chimiques entre Bauhinia reticulata
et Piliostigma thonningi telle
que présentée par le tableau ci-
dessus.
11
I.3. INTOXICATION DUE AUX CONFUSION DE
NOMS
VERNACULAIRES
En sciences de la nature, un nom vernaculaire ou nom commun
est un nom indigène, usuel ou désuet, en langue locale ou
nationale, donné à une ou plusieurs espèces animales,
fongiques ou végétales dans son pays ou sa région
d'origine. Les intoxications peuvent être consécutives à
une ingestion accidentelle chez les enfants ou à une confusion avec des
baies comestibles chez les adultes. Elles surviennent plus rarement dans un
contexte suicidaire ou addictif (Flesch, 2012).
Il semble qu'il existe plusieurs risques liés à
la multitude de langues vernaculaires attribuées à une
espèce donnée ainsi qu'à l'attribution d'un même nom
vernaculaire à différentes espèces ayant des profils
phytochimiques, des vertus et des utilisations différentes (Flesch,
2012).
Les conséquences de la confusion sont graves, surtout
lorsque l'intérêt pour l'herboristerie ou la pratique de la
phytothérapie pour certaines personnes n'est justifié que par un
pur besoin matériel sans se soucier de la santé des populations.
Cependant, il convient de noter que notre objectif n'est ni de discuter de
l'efficacité des plantes ni de prononcer leur innocuité. Nous
visons essentiellement à attirer l'attention sur le fait que le secteur
des plantes médicinales doit être réglementé et que
les acteurs de l'herboristerie et de la phytothérapie traditionnelle
doivent être compétente et très vigilante pour
éviter toute confusion entre les plantes et les risques de
toxicité inhérents. Dans tous les cas, que le but soit culinaire,
cosmétique, médicinale ou autre, la maîtrise de
l'identification des plantes est une étape clé de sa
réussite. Aussi une charte réglementant la collecte et les
médicaments l'utilisation des plantes est impérative pour
éviter tout risque d'intoxication (Martínez & Luján,
2011).
Deuxième partie :
Données expérimentales

12
II.DONNEES EXPERMENTALES
Dans cette partie du travail seront décrits tout
d'abord le cadre qui a servi pour la recherche ainsi que les protocoles
expérimentaux qui ont conduits à l'obtention des résultats
avant d'achever avec la présentation des résultats et leurs
discussions.
II.1. DESCRIPTION DU CADRE DE RECHERCHE
Ce travail a été réalisé au
laboratoire de pharmacognosie de la faculté des sciences pharmaceutiques
de l'Université de Lubumbashi ; situé au N° 27 de l'avenue
Kato dans le quartier Industriel de la commune Kampemba. Ce laboratoire a servi
de cadre pour les différentes analyses.
II.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
Le protocole expérimental regorge l'essentiel de
matériel et moyens par lesquels les résultats sont obtenus.
II.2.1. Matériel
Sont repartis en deux grands groupes selon leur usage lors de
l'expérimentation :
II.2.1.1. Matériel végétal
Le matériel utilisé est constitué des
feuilles, les écorces de la tige ainsi que des écorces de racines
de trois plantes récoltées lors des enquêtes
ethnobotaniques sous le guide des tradipraticiens des Azadirachta indica A.
Juss , Strychnos stuhlmannii Gilg et Pericopsis angolensis (Baker)
Meeuwen.
L'identification de ces trios espèces a
été réalisés à l'herbarium de la
faculté des sciences agronomiques ; les herbiers ont été
constitués pour chaque plante et comparés avec les herbiers de
référence de l'herbarium de la faculté des sciences
agronomiques pour se rassurer de leur originalité.
Les résultats sont présentés sous forme
d'une analyse statistique descriptive (Manya et al., 2020).
13
II.2.1.2. Petit matériel et appareillage de
laboratoire
Un certain nombre de matériel et appareils de
laboratoire ont permis de réaliser ce travail c'est notamment : les
papiers filtrés, les tubes à essai, le portoir à tubes,
les étiquettes, les pipettes graduées, les béchers, les
lames, les pieds gradués, la spatule, le mortier et le pilon en bois,
bain marie. Et comme appareils utilisés, on peut citer le broyeur
Moulinex, la balance analytique (RADWAG modèle AS 220/C/2), et
l'étuve Memmert.
II.2.1.3. Réactifs et solvants
Parmi les réactifs utilisés on peut citer :
Chlorure d'aluminium 10%, l'acide chloridrique concentré, l'Ammoniaque,
les copeaux de magnésium, l'acide sulfurique, Dichromate de potassium,
Anhydre acétique, Chlorure ferrique 1%, Acétate de sodium,
Hydroxyde de potassium, Nitrite de sodium 5%.
Et comme solvants, on cite : Méthanol, Chloroforme, Eau
distillée, Ethanol 97% et Ether de pétrole.
II.2.2. METHODES
Sont présentés dans ce point, les
différentes méthodes utilisées pour réaliser cette
expérimentation.
II.2.2.1. Enquête
Un questionnaire semi-structuré a été
utilisé pour la récolte des donnés auprès des
tradipraticiens. Un consentement éclairé a été
obtenu par chaque tradipraticien avant l'enquête et une somme d'argent
était proposé aux tradipraticiens afin d'augmenter le taux de
participation et solliciter une décente sur terrain pour la
récolte d'un herbier (Marpsat & Razafindratsima, 2010).
Un rayon de 30 Km de Lubumbashi et ses environs ont
été considéré comme zone d'étude pour
l'enquête ethnobotanique durant une période de sept mois soit de
Janvier au Juillet 2021 (Amuri et al., 2017).
14
II.2.2.2. Criblage phytochimique
Le criblage phytochimique a consisté à
rechercher des groupes chimiques notamment les alcaloïdes, les coumarines,
les flavonoïdes, les quinones, les saponines, les stéroïdes,
les tannins et les terpénoïde. Par ailleurs, les
anthocyanes ont été recherchés pour leur pouvoir anti
radicalaire alors que la recherche des hétérosides
cyanogènes renseignait sur une éventuelle toxicité due au
cyanure libéré par hydrolyse thermique ou enzymatique. Le
criblage phytochimique a porté sur les réactions en solution. Les
réactions en solution utilisées sont basées sur la
coloration, la précipitation ou la formation des mousses. Elles sont
décrites par Abisch & Reichstein (1960) et Harborne (1998).
a. Recherche des alcaloïdes
Deux méthodes seront utilisées : la
méthode des réactions en solution et la chromatographie sur
couche mince
Méthodes à 6 réactifs de
précipitation
Principe : La mise en
évidence des alcaloïdes consiste à les précipiter
à l'aide de six réactifs de précipitation (Abisch &
Reichstein, 1960).
Mode opératoire : 1g de
poudre de matière végétale sèche est mise à
macérer dans 10 mL de méthanol à température
ambiante pendant 24 heures. La solution obtenue est filtrée, puis le
marc lavé avec de portions de méthanol chaud. Le filtrat et
évaporé à sec à l'étuve à
50°C.
Le résidu est recueilli deux fois par 2 mL de solution
chaude d'acide chlorhydrique 1 % et est ensuite filtré. La solution
acide obtenue est alcalinisée par l'ammoniaque concentrée dans
une ampoule à décanter. Ajouter 15 mL de chloroforme dans
l'ampoule à décanter. Deux phases se forment. Agiter puis reposer
pour séparer les phases puis les séparer. Répéter
trois fois cette opération. La phase organique est
évaporée à sec à l'air libre et le résidu
est repris par le méthanol pour la CCM et laisser encore évaporer
le méthanol. Le résidu sec est repris par 0,5 mL de chloroforme,
est transféré dans un tube à hémolyse. Ajouter dans
ce tube 0,5 mL de HCl 1 % et agiter. Les alcaloïdes ayant
été protonés sont supposés se trouver dans la phase
aqueuse. Celle-ci, qui est au- dessus, est prélevée à
l'aide d'une pipette pasteur.
15
Six gouttes en sont déposées sur une lame
porte-objet. Chacune de ces gouttes est traitée par l'un des six
réactifs de précipitations décrits en annexe (Abisch &
Reischtein, 1960).
La présence d'alcaloïdes n'est
considérée comme certaine que si chacun des six réactifs
donne un précipité. La méthode permet de détecter
jusqu'à des teneurs d'alcaloïdes inférieures à 0,01 %
sur une prise d'échantillon de 1g (Abisch & Reschtein, 1960)
b. Recherche des coumarines
Principe : En présence de
NaOH 10%, l'apparition d'une couleur jaune, indique la présence des
coumarines
Mode opératoire : Les
coumarines sont révélées à partir de 2 ml de
l'infusé à 5% placé dans un tube dans lequel sont
ajoutés 3 ml de NaOH (10%). Après agitation de la solution,
l'apparition d'une couleur jaune indique la présence de coumarines
(Diallo, 2000).
c. Recherche des flavonoïdes et anthocyanes
Principe : L'extrait aqueux
flavonoïque donne, en présence de l'acide chlorhydrique
concentré et de copeaux de magnésium, une coloration rose-rouge
et rouge violacée dans la couche surnageant d'alcool iso amylique.
Après chauffage au bain-marie, sans ajouter le magnésium,
1'apparition d'une coloration rouge indique la présence de leuco
anthocyanes (Bruneton, 2016)
Mode opératoire : 5 g de
matériel végétal placés dans un erlenmeyer sont
infusés dans 50 mL d'eau distillée pendant 30 minutes.
Après filtration, 5 mL de filtrat sont traités par le
réactif de SHINODA (l'alcool éthylique à 97 %, puis on y
ajoute successivement 5 mL d'eau distillée, 5 mL de HCl
concentré, quelques gouttes d'alcool iso-amylique) et 0,5g de copeaux de
magnésium. La coloration rouge-orangé (flavone), rouge ou rouge
violet (flavonones), rouge cerise (flavonol) apparaît dans la couche
surnageant (phase alcoolique) si la solution contient les flavonoïdes
(Harbone, 1998).
De même, la réaction effectuée pendant
deux minutes au bain-marie en l'absence de copeaux de magnésium permet
la caractérisation des anthocyanes lorsqu'apparaît une coloration
rouge (Harbone, 1998).
16
d. Recherche des hétérosides cyanogènes
Principe : En présence
d'acide cyanhydrique, le papier picrosodé de couleur jaune vire à
l'orange ou au rouge suivant la concentration de HCN (Harbone, 1998).
Mode opératoire : 5 g de
poudre végétale sont placés dans un erlenmeyer avec 10 mL
d'eau distillée. Fermer l'erlenmeyer avec un bouchon auquel est
fixée une bandelette de papier picrosodé légèrement
humectée d'eau. Chauffer légèrement la solution. Le papier
picrosodé jaune vire à l'orange ou au rouge si l'extrait
végétal libère de l'acide cyanhydrique (Harbone, 1998).
e. Recherche des quinones
Principe : (Réaction de
Bornträger) En présence d'une base forte (NaOH ou KOH à 1 %)
les quinones donnent une coloration caractéristique allant de rouge
orange au violet pourpre (Bruneton, 2016)
Mode opératoire : 5g de
matériel végétal en poudre sont macérés
pendant une heure dans le toluène ou pendant 24 heures dans
l'éther de pétrole. Après filtration, 10 mL de filtrat au
toluène ou éthéré sont traités par 5 mL de
NaOH 1 %. L'apparition d'une coloration rouge violacée dans la phase
aqueuse indique la présence de quinones libres et celle jaune ou orange
les quinone liées (Bruneton, 2016; Harbone, 1998).
f. Recherche des saponines
Principe : La détection de
saponines est basée sur leur pouvoir moussant. Pour une mousse non
persistante, le filtrat en milieu acide en présence de dichromate de
potassium donne une coloration vert-sale ou violette virant au rouge (Bruneton,
2016)
Mode opératoire : Dans un
erlenmeyer contenant 10 g de matériel végétal broyé
grossièrement, on ajoute 100 mL d'eau distillée pour
réaliser une décoction pendant 30 minutes. Filtrer la solution
après refroidissement. 15mL de décoctés sont introduits
dans un tube à essai de 16 mm de diamètre et 160 mm de hauteur.
Le contenu du tube est agité hermétiquement pendant une minute.
Après agitation, on laisse reposer la solution pendant 10 minutes et
mesurer la hauteur de la mousse.
17
En cas d'obtention d'une mousse de moins de 10 mm, tester la
présence des saponines à l'aide des réactifs
(Mélange d'acide sulfurique 1N et de dichromate de potassium10 %).
L'apparition d'une coloration violette virant au rouge ou au vert indique la
présence des saponines (Harbone, 1998).
g. Recherche des stéroïdes et
terpénoïdes
Principe : En présence de
l'acide acétique anhydre et de l'acide sulfurique concentré,
l'extrait organique éthéré ou au toluène contenant
les stéroïdes donne des colorations mauves et vertes.
L'identification des terpénoïdes suit le même schéma
en plus de l'ajout du réactif de Hirschson (acide
trichloroacétique). La couleur jaune virant au rouge indique la
présence de terpénoïd
Mode opératoire : 5 g de
matériel végétal sont mis à macérer pendant
24 heures dans l'éther de pétrole ou dans le toluène.
Après filtration, le solvant est évaporé à sec.
Dans le résidu obtenu, on ajoute successivement et en agitant, 2 mL de
chloroforme, 0,5 mL d'anhydride acétique et trois gouttes d'acide
sulfurique concentré. L'apparition de colorations mauves ou vertes
indique la présence de stéroïdes (Bruneton, 2016; Harbone,
1998)
L'identification des terpénoïdes suit le
même schéma que celle des stéroïdes. En plus du test
utilisé pour la recherche des stéroïdes, quelques gouttes de
réactif de Hirschson sont ajoutées à 4 ou 5 mL de la
solution acidifiée. La coloration jaune virant au rouge indique la
présence de terpénoïdes (Bruneton, 2016; Harbone, 1998)
h. Recherche des tannins
h.i. Tannins catéchiques
Principe : En présence de
chlorure ferrique 1 %, les extraits aqueux taoïques donnent des
colorations bleu-vert, bleu sombre et verte ou des précipités.
Mode opératoire : 5 g de
matériel végétal sont infusés dans 50 mL d'eau
contenue dans un erlenmeyer pendant 30 minutes. 5 mL de l'infusé sont
prélevés et additionnés des 1 mL de chlorure ferrique 1 %.
Le test est positif lorsqu' un précipité ou une coloration
(bleu-vert, bleu sombre ou vert) apparaît. 15 mL de réactif de
Stiasny sont ajoutés à 30 mL de l'infusé, le
mélange est porté au bain marie à 90°C. L'apparition
d'un précipité indique la présence de tannins
catéchiques (Amuri et al., 2017).
18
h.ii. Tannins galliques
a. Principe : En présence de
chlorure ferrique 1 %, les extraits aqueux taoïques donnent des
colorations bleu-vert, bleu sombre et verte ou des précipités.
b. Mode opératoire : 5 g de
matériel végétal sont infusés dans 50 mL d'eau
contenue dans un erlenmeyer pendant 30 minutes. 5 mL de l'infusé sont
prélevés et additionnés des 1 mL de chlorure ferrique 1 %.
Le test est positif lorsqu' un précipité ou une coloration
(bleu-vert, bleu sombre ou vert) apparaît. 15 mL de réactif de
Stiasny sont ajoutés à 30 mL de l'infusé, le
mélange est porté au bain marie à 90°C. La solution
est ensuite filtrée, le filtrat est saturé d'acétate de
sodium avant d'y ajouter quelques gouttes de chlorure ferrique. La formation
d'un précipité dans ce cas, révèle la
présence de tannins galliques (Amuri et al., 2017).
19
II.3. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS
II.3.1. PRESENTATION DES RESULTATS
Sont présentés dans ce point, les
résultats de l'enquête sur la confusion de nom vernaculaire ainsi
que ceux du criblage phytochimique.
II.3.1.1. Résultat d'enquête
L'enquête a été réalisé sur
120 personnes ressources dont les données socio-démographiques
sont présentées dans le tableau II ci-après.
|
a. Profils socio-démographiques
Tableau 2. Profils socio-démographiques des
personnes ressources
|
|
|
Sexe
|
Homme
|
81
|
67,5 %
|
|
Femme
|
39
|
32,5 %
|
|
Originaire
|
Bemba
|
12
|
10 %
|
|
Hemba
|
12
|
10 %
|
|
Lala
|
12
|
10 %
|
|
Lamba
|
12
|
10 %
|
|
Luba-Katanga
|
12
|
10 %
|
|
Rund
|
12
|
10 %
|
|
Sangwa
|
12
|
10 %
|
|
Tabwa
|
12
|
10 %
|
|
Luba-Kasaï
|
12
|
10 %
|
|
Zela
|
12
|
10 %
|
|
Statut marital
|
Célibataire
|
7
|
5,8 %
|
|
Marié
|
104
|
86,7 %
|
|
Veuf
|
9
|
7,5 %
|
|
Brevet de formation
|
1
|
0,83 %
|
|
Diplôme d'état
|
36
|
30 %
|
|
Niveau d'étude
|
Gradué
|
15
|
12,5 %
|
|
Licencié
|
7
|
5,84 %
|
|
Primaire
|
10
|
8,33 %
|
|
Secondaire
|
37
|
30,8 %
|
20
|
Rituel avant la récolte Autres activités
|
Aucun niveau d'étude
Oui
Non
Agent de la fonction publique
|
14
18
102
7
|
11,7 % 15 % 85 % 5,83 %
|
|
Commerçant
|
10
|
8,33 %
|
|
Secouriste
|
1
|
0,83 %
|
|
Cultivateur
|
35
|
29,1 %
|
|
Couturière
|
1
|
0,83 %
|
|
Enseignant
|
5
|
4,17 %
|
|
Garde
|
4
|
3,33 %
|
|
Aucune
|
57
|
47,5 %
|
|
Acquisition des compétences
|
Etudes
|
8
|
6,67 %
|
|
Incarnation d'un esprit des ancêtres
|
1
|
0,83 %
|
|
Initiation
|
18
|
15 %
|
|
Inspiration divine
|
2
|
1,7 %
|
|
Héritage familial
|
79
|
65,8 %
|
|
Rêve
|
12
|
10 %
|
|
Expérience (année)
|
[2,5-9,5[
|
9
|
7,5 %
|
|
[9,5-16,5[
|
16
|
13,3 %
|
|
[16,5-23,5[
|
44
|
36,7 %
|
|
[23,5-30,5[
|
22
|
18,3 %
|
|
[30,5-37,5[
|
14
|
11,7 %
|
|
[37,5-44,5[
|
9
|
7,5 %
|
|
[44,5-51,5[
|
3
|
2,5 %
|
|
[51,5-58,5]
|
3
|
2,5 %
|
|
Age
|
[26,7-32,5[
|
15
|
12,5 %
|
|
[32,5-38,5[
|
19
|
15,8 %
|
|
[38,5-44,5[
|
17
|
14,2 %
|
|
[44,5-50,5[
|
23
|
19,2 %
|
|
[50,5-56,5[
|
21
|
17,5 %
|
|
[56,5-62,5[
|
9
|
7,5 %
|
|
[62,5-68,5[
|
7
|
5,83 %
|
|
[68,5-74,5]
|
9
|
7,5 %
|
21
Au cours de cette étude, 120 tradipraticiens
répartis dans 10 différentes tribus ont été
interviewés. Les hommes représentés 81 tradipraticiens
soit (67,5 %) contre 39 de sexe féminin soit (32,5 %). Ces
résultats corroborent avec ceux de Bakari et al (2018) qui lors
de leurs enquêtes, les femmes représentaient 32,65 % contre 67,34
% pour les hommes. Ceci serait étroitement lié à la
culture Africaine qui réserve certaines activités principalement
aux hommes. 18 tradipraticiens étaient des spiritueux soit (15 %) contre
102 herboristes (85 %). Les mariés représentaient 86,7 % soit
(104 tradipraticiens) contre 7,5 % des célibataires soit (9
tradipraticiens). Ceci s'expliquerait par le nombre élevé des
tradipraticiens (36,7 %) dont l'âge variait entre [16,5-23,5[, ce qui est
considéré comme étant l'âge nubile en Afrique. 79
tradipraticiens soit (65,8 %) ont acquis les connaissances de la pratique de la
médecine traditionnelle par héritage comme l'a aussi
rapporté Manya et al, (2020).
b. Connaissances ethnopharmacologiques
Ci-dessous les résultats sur les connaissances
ethnopharmacologiques des
tradipraticiens consultés.
Tableau 3. Présentation des données sur les
connaissances ethnopharmacologiques
|
Nom
vernaculaire
proposé
|
Nom
vernaculaire
standardisé
|
Utilisé pour
soigner quelle(s)
pathologie(s)
?
Préparation &
posologie
|
Quelle est la
signification de
ce nom
vernaculaire
?
|
Espèce identique
récoltée
|
Tribu
|
|
Kifumbe
|
Kifumbe (12/12), TPNPC (0/12)
|
Boisson du décocté des feuilles ou racine : toux
(12/12), diarrhée et malaria (1/12),
|
Sert à régler ou faire disparaitre les
problème (10/12), TPNPC (2/12)
|
Piliostigma thonningii (Schumach.) (12/12)
|
Bemba
|
|
Kifumbe
|
Kifumbe (12/12), TPNPC (0/12)
|
Boisson du décocté des feuilles ou racine : toux
persistante (12/12), boisson du décocté des écorces :
anémie (1/12)
|
Sert à régler ou faire disparaitre les
problème (12/12), TPNPC (0/12)
|
Lamba
|
TPNPC : nombre de tradipraticiens ayant donnés la
même information sur les 12 consultés par tribu.
Il ressort de cette enquête que seuls les
tradiptaticiens des tribus Bemba et Lamba consultés connaissez la
signification anthropologique des noms vernaculaires (Bemba et Lamba) des
plantes ainsi que leurs usages contrairement aux tradipraticiens des autres
tribus qui non seulement ne reconnaissez plus la signification anthropologique
des noms vernaculaires dans leurs langues respectives, mais aussi n'ont pas
tous récolté une même espèce. Ceci serait due
à deux phénomènes, primo l'origine de la plante,
en effet les connaissances
22
ethnopharmacologiques sont étroitement liées
à la culture de chaque peuple, donc il existerait des
spécialités en fonction de telle ou telle autre tribu.
Secundo, la proximité des tradipraticiens avec leurs milieux
d'origines, en effet, plus le tradipraticien serait dans son milieu d'origine
et parlant sa langue maternelle, plus il conservera les connaissances
traditionnelles.
Tota Res+ sur 6
Pourcentage (%)
23
II.3.1.2. Résultats phytochimques
Les résultats du criblage chimique réalisé
sont condensés dans le tableau II ci-après : Tableau 4
: Résultats globaux du criblage chimique
Espèces Organes Alc Flav Anth Quin Coum Sap Tanc Tang Terp
Ster HCN Rés /Org %
|
Bauhinia reticulata
|
ER
ET
F
|
|
6/11 54.5
6/11 54.5
5/11 45.5
|
|
Piliostigma thonningii
|
ER
ET
F
|
4/11 36.4
4/11 36.4
5/11 45.5
|
|
1
|
6
|
5
|
0
|
2
|
3
|
6
|
3
|
1
|
3
|
0
|
|
16.7
|
100
|
83.3
|
0
|
33.3
|
50
|
100
|
50
|
16.7
|
50
|
0
|
F : Feuilles ; ET : Ecorses - tiges ; ER : Ecorses - racines ; PU
: Partie utilisée ; Rés + : Résultats positifs ; Org :
Organe ; PL : Plante, Alc : Alcaloïdes ; Flav : Flavonoïdes ; Anth :
Anthocyanes ; Quin : Quinones ; Sap : Saponines ; Tanc : Tanins
catéchiques ; Tang : Tanins galliques ;
Terp : Terpenoïdes ; Ster : Steroïdes ; HCN :
Hétérosides cyanogènes ; : Présence ; : Absence
24
Après examen minutieux du tableau ci-dessus, il
s'observe que 66 tests ont été effectués pour le criblage
phytochimique, parmi lesquels 30 tests ont été positifs.
L'analyse des résultats globaux peut être examinée sous
trois aspects : la répartition des groupes bioactifs par organe, par
espèce végétale et leur prévalence dans l'ensemble
des plantes.
a. Prévalence des groupes bioactifs dans l'ensemble des
plantes
L'observation montre que les tanins catéchiques et les
flavonoïdes sont les composés trouvés dans les
différentes parties des plantes analysées soit (100%) de tests
positifs, les anthocyanes sont en deuxième position avec 83.3%, suivis
des stéroïdes et saponines avec 50% chacun, coumarines 33,3%, 16,7%
pour les alcaloïdes et terpénoïdes. Les quinones et les
hétérosides cyanogènes ont été absent (0%)
dans tous les organes pour toutes les plantes étudiées.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Alc Flav Anth Quin Coum Sap Tanc Tang Terp Ster HCN
Série 1 Série 2 Série 3
Figure 3 : Abondance en composés chimiques dans l'ensemble
des plantes
25
La présence en majorité des polyphénols
(Tanins, Anthocyanes, flavonoïdes), des saponines et des
stéroïdes dans nos espèces pourrait se justifier par le fait
que ces groupes sont ubiquistes. Quant aux alcaloïdes,
terpénoïdes et hétérosides cyanogènes, leur
présence est souvent marquée à des familles
spécifiques telles que les Lauraceae, Loganaceae, Solanaceae etc.
(Alcaloïdes); et chez les Euphorbiaceae précisement dans
l'espèce Manihot esculenta (hétérosides
cyanogènes).
En se réferant aux résultats ci-haut, nous
disons que l'absence de certains groupes chimiques tels que les alcaloïdes
est justifiée du fait que parmi les familles spécifiques
précitées les familles des espèces à l'étude
n'y figurent pas et c'est la même chose pour la famille d'Euphorbiaceae
du fait que la présence des hétérosides cyanogènes
est révélée précisement dans l'espèce
Manihot esculenta.
Il est aussi à noter que les résultats
phytochimiques peuvent variés d'une étude à l'autre car
plusieurs facteurs peuvent influencés la composition chimique d'une
plante, entre autres la période de récolte, les
différentes techniques lors de récolte (l'heure, l'état
des organes récoltés jeunes ou vieux), le sol, le climat
(Kahumba, 2000).
26
b. Répartition des groupes bioactifs par organe
utilisé
De tous les organes utilisés, les tiges ont
donné 54,4% de tests positifs suivis des racines 26,3% et 19,3% de tests
positifs pour les feuilles.
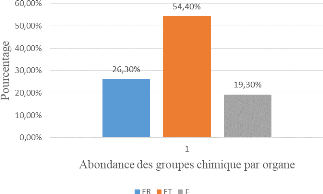
Figure 4 : abondance des groupes chimiques par organe
utilisé
L'abondance de groupes chimiques dans les tiges et racines
serait justifiée par le fait que ces organes sont le lieu de stockage
dans les végétaux (Mangambu et al., 2008).
La présence en grand nombre de ces composés
bioactifs chez une espèce comme le cas de Piliostigma thonningii
et les autres expliquerait leur large utilisation en médecine
traditionnelle contre différents maux (maladies) tel que prouvé
dans les travaux de certains chercheurs.
En effet, l'abondance de tanins, saponines et
stéroïdes dans nos espèces pourrait expliquée l'usage
de ces plantes en médecine traditionnelle congolaise (Makumbelo et
al., 2008).
Par ailleurs, cette étude a confirmée certains
résultats de Mustapha et al., (2016), C'est notamment la présence
de saponines et stéroïdes dans les feuilles et tiges de
Piliostigma reticulatum, de flavonoïdes (Feuilles), anthocyanes
(Tiges), et l'absence de quinones dans les feuilles et tiges, de
terpénoïdes dans les feuilles et des anthocyanes dans les feuilles
et les tiges de la même espèce.
27
CONCLUSION
Il était question dans ce travail de montrer les
similitudes de noms vernaculaires des plantes médicinales
utilisées en médicine traditionnelle dans le Haut-Katanga
d'établir les profils phytochimique des deux plantes sujet aux
confusions et utilisées en médecine traditionnelle Congolaise :
Bauhinia reticulata et Piliostigma thonningii, toute deux
appelées Kifumbe en langue Bemba et Lamba.
Les résultats de l'enquête ethnobotanique ne nous
ont pas permis de différencier, du point de vu des noms vernaculaires
ces deux espèces car toute deux sont appelées Kifumbe
par des tradipraticiens Bemba et Lamba. Cependant, ces deux
espèces ont présenté des profils phytochimiques
différents l'un de l'autre. Les tanins et les flavonoïdes ont
été les composés trouvés dans toutes les parties
des plantes analysées soit (100%) de tests positifs, les anthocyanes
sont retrouvés à 83,3%, suivis des stéroïdes et
saponines à 50%, coumarines 33,3%, alcaloïdes et
terpénoïdes 16,7%. Les quinones et les hétérosides
cyanogènes ont été absent (0%) dans tous les organes pour
toutes les plantes étudiées.
Les feuilles de Bauhinia reticulata renfermaient des
alcaloïdes contrairement à celles de Piliostigma thonningii.
Les écorces tiges de Bauhinia reticulata renfermaient des
saponosides contrairement à celles de Piliostigma thonningii.
Les écorces de racines de Bauhinia reticulata renfermaient
les tannins galliques et terpénoïdes.
Ces différences sur les profils de ces plantes auraient
t-elles d'impact sur l'expression pharmacologique de ce différentes
plantes ? c'est l'une de questions qui peuvent être dégagée
à l'issu de ce travail.
Ainsi, eu égard aux résultats obtenus au cours
de cette étude sur ces plantes, il est utile d'être très
vigilant lors de l'utilisation de l'une de ces plantes afin d'échapper
à tout risque de confusion. Mais aussi des études plus
poussées sur la détermination d'éléments de
différenciation pouvant contribuer à la discrimination facile de
ces deux espèces sont souhaitées.
28
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Abisch, E, and T Reichstein. 1960. «Orientierende Chemische
Untersuchung Einiger Apocynaceen.» HELVETICA CHIMICA ACTA 153 (6):
224-25.
Afolayan, Michael, Radhakrishnan Srivedavyasasri, Olayinka T.
Asekun, Oluwole B. Familoni, Abayomi Orishadipe, Fazila Zulfiqar, Mohamed A.
Ibrahim, and Samir A. Ross. 2018. «Phytochemical Study of Piliostigma
Thonningii, a Medicinal Plant Grown in Nigeria.» Medicinal Chemistry
Research 27 (10): 2325-30.
https://doi.org/10.1007/s00044-018-2238-1.
Amuri, Bakari, Mwamba Maseho, Lumbu Simbi, Philippe Okusa,
Pierre Duez, and Kahumba Byanga. 2017. «Hypoglycemic and Antihyperglycemic
Activities of Nine Medicinal Herbs Used as Antidiabetic in the Region of
Lubumbashi (DR Congo).» Phytotherapy Research 31 (7): 1029-33.
https://doi.org/10.1002/ptr.5814.
Amuri, Bakari, Mwamba Maseho, Lumbu Simbi, Pierre Duez, and
Kahumba Byanga. 2018. «Ethnobotanical Survey of Herbs Used in the
Management of Diabetes Mellitus in Southern Katanga Area/DR Congo.» Pan
African Medical Journal 30.
https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.218.11718.
Anami, B. S. (2010). A Combined Color, Texture and Edge
Features Based Approach for Identification and Classification of Indian
Medicinal Plants. 6(12).
Bahmani, M., Karamati, S. A., Hassanzadazar, H., Forouzan, S.,
Rafieian-kopaei, M., Kazemi-ghoshchi, B., Asadzadeh, J., Kheiri, A., &
Bahmani, E. (2014). E thnobotanic study of medicinal plants in U rmia city:
identification and traditional using of antiparasites plants. Asian Pacific
Journal of Tropical Disease, 4(Suppl 2), S906-S910.
https://doi.org/10.1016/S2222-1808(14)60756-8
Bruneton, J. 2016. «Pharmacognosie : Phytochimie Plantes
Médicinales.» In , Lavoisier:, 287- 1425. Paris.
Dluya, T., & Dahiru, D. (2018). Antibacterial Activity of
Piliostigma Thonningii Methanol Stem Bark Extract Collection of Plant Material.
5(1), 15-20.
Flesch, F. (2012). Plantes toxiques : les dangers du retour
à la nature Toxic plants : the dangers of going back to nature. 525-532.
https://doi.org/10.1007/s13546-012-0494-5
Hammiche, Victoria, and Khadra Maiza. 2006. «Traditional
Medicine in Central Sahara: Pharmacopoeia of Tassili N'ajjer.» Journal of
Ethnopharmacology 105 (3): 358-67.
https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.11.028.
Harbone, J. 1998. Phytochemical Methods : A Guide to Modern
Techniques of Plant Analysis. Thomson Science. Vol. Third edit.
Ibra, S., Dieng, M., Mathieu, C., Sarr, A., Diatta-badji, K.,
& Fall, A. D. (2020). Condensed Tannins Content and their Influence on the
Antioxidant Activity of Bark Hydroethanol
Extract of Piliostigma reticulatum ( Dc ) Hochst and its
Fractions. 12(2), 361-368.
Koffi, N'GUESSAN, KADJA Beugré, ZIRIHI Guédé
N., TRAORÉ Dossahoua, and AKÉ-
ASSI Laurent. 2009. «Screening Phytochimique de Quelques
Plantes Médicinales
29
Ivoiriennes Utilisées En Pays Krobou (Agboville,
Côte-d'Ivoire) Koffi.» Sciences & Nature 6: 1-15.
Manayi, Azadeh, Mahnaz Khanavi, Soodabeh Saiednia, Ebrahim
Azizi, Mohammad Reza Mahmoodpour, Fatemeh Vafi, Maryam Malmir, Farideh
Siavashi, and Abbas Hadjiakhoondi. 2013. «Biological Activity and
Microscopic Characterization of Lythrum Salicaria L.» DARU, Journal of
Pharmaceutical Sciences 21 (1): 1-7.
https://doi.org/10.1186/2008-2231-21-61.
Manya, Mboni Henry, Flore Keymeulen, Jérémie
Ngezahayo, Amuri Salvius Bakari, Mutombo Emery Kalonda, Byanga Joh Kahumba,
Pierre Duez, Caroline Stévigny, and Simbi Jean Baptiste Lumbu. 2020.
«Antimalarial Herbal Remedies of Bukavu and Uvira Areas in DR Congo: An
Ethnobotanical Survey.» Journal of Ethnopharmacology 249: 112422.
https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112422.
Marpsat, Maryse, and Nicolas Razafindratsima. 2010.
«Survey Methods for Hard-to-Reach Populations: Introduction to the Special
Issue.» Methodological Innovations Online 5 (2): 3.1-16.
https://doi.org/10.4256/mio.2010.0014.
Martínez, G. J., & Luján, M. C. (2011).
Medicinal plants used for traditional veterinary in the Sierras de
Córdoba (Argentina): An ethnobotanical comparison with human medicinal
uses. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 7(August).
https://doi.org/10.1186/1746-4269-7-23
Mustapha, B., Kubmarawa, D., Shagal, M., & Ardo, B.
(2016). Preliminary Phytochemical Screening of Medicinal Plants Found in the
Vicinity of Quarry Site in Demsa, Adamawa State, Nigeria. American Chemical
Science Journal, 11(2), 1-7.
https://doi.org/10.9734/acsj/2016/21519
Neuwinger, H. D. 2004. «Plants Used for Poison Fishing in
Tropical Africa.» Toxicon 44 (4): 417-30.
https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2004.05.014.
Pimple, B. P., A. N. Patel, P. V. Kadam, and M. J. Patil.
2012. «Microscopic Evaluation and Physicochemical Analysis of Origanum
Majorana Linn Leaves.» Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2
(SUPPL2): S897-903.
https://doi.org/10.1016/S2222-1808(12)60288-6.
Song, Jun Ho, Sungyu Yang, and Goya Choi. 2020.
«Taxonomic Implications of Leaf Micromorphology Using Microscopic
Analysis: A Tool for Identification and Authentication of Korean
Piperales.» Plants 9 (5).
https://doi.org/10.3390/plants9050566.
Thring, T S A, and F M Weitz. 2006. «Medicinal Plant Use
in the Bredasdorp / Elim Region of the Southern Overberg in the Western Cape
Province of South Africa.» Journal of Ethnopharmacology 103: 261-75.
https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.08.013.
Wagner, Hildebert, Rudolf Bauer, Dieter Melchart Pei-Gen Xiao,
and Anton Staudinger. 2011. Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal
Medicines: Thin-Layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese
Drugs. Edited by H. Wagner, R. Bauer, D. Melchart, Xiao Pei-Gen, and A.
Stauding. Springer.
30
Zerbo, A., Koudou, J., Ouédraogo, N., Ouédraogo,
R., & Guissou, I. P. (2010). Antioxidant and antibacterial activities of
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst extracts. African Journal of
Biotechnology, 9(33), 5407-5411.
https://doi.org/10.4314/ajb.v9i33.
ANNEXES
31
VALIDATION DES PLANTES MEDICINALES UTILISEES A
LUBUMBASHI/Tribu LAMBA
Objectif : Validation des noms vernaculaires ;
récoltes des espèces et informations anthropologiques
1) Informations générales sur
l'informateur
De quelle tribu êtes-vous originaire ? :
Sexe M F âge : Congolaise Oui Non
Coordonnées GPRS du lieu de consultation de l'informateur
:
Niveau d'étude :
Autres activités :
Acquisition des connaissances
Rêve : Parents : Connaissances : Initiation :
Autres : ...
2) Connaissances anthropologiques et informations sur le(s)
espèce(e)
|
Nom vernaculaire
|
Connaissez-vous ?
|
Utilisé pour soigner quelle(s) pathologie(s) ?
|
Préparation &
posologie
|
Quelle est la signification de ce nom
vernaculaire ?
|
|
OUI
|
NON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|