|

REPUBLIQUE DU BENIN
*****
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)
*****
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)
*****
INSTITUT DE GEOGRAPHIE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT (IGATE)
*****
MASTER INTEGRATION REGIONALE ET DEVELOPPEMENT (MIRD)
*****
Option : GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES
RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX LIES
A
L'UTILISATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS
CHIMIQUES DANS LA CULTURE DES
LEGUMES DANS
LA COMMUNE DE SEME-PODJI
Réalisé par :
DEGUENON G. Marie Ange
Sous la direction de :
Docteur VISSIN Expédit W. Docteur
HOUEDENOU Florentine A.
Professeur Titulaire des Maître Assistant des
Universités du
Universités du CAMES CAMES
Membres du jury
Président : Prof Expédit W. VISSIN
Rapporteur : Dr Thierry AZONHE Examinateur :
Dr Florentine A. HOUEDENOU Mention : Bien
Note : 15,25
Soutenu le 04 / 05 / 2019
2
SOMMAIRE
|
Dédicace
|
.3
|
|
Sigles et Acronymes
|
..4
|
|
Liste des figures
|
.5
|
|
Liste des tableaux
|
6
|
|
Liste des planches et photos
|
7
|
|
Remerciements
|
..8
|
|
RESUME / ABSTRACT
|
10
|
|
INTRODUCTION
|
11
|
|
CHAPITRE I : ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU SUJET,
|
13
|
HYPOTHESES, OBJECTIFS, CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DEMARCHE
METHODOLOGIQUE
CHAPITRE II : FONDEMENTS BIOPHYSIQUE ET HUMAIN FAVORABLES A 24
L'UTILISATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE
DES LEGUMES DANS LA COMMUNE DE SEME-KPODJI
CHAPITRE III : RESULTATS, DISCUSSIONS, SUGGESTIONS ET
PERSPECTIVES 38
CONCLUSION 68
Références Bibliographiques 70
Annexes 79
Table des Matières 91
3
DEDICACE A
tous ceux qui par leur sincère amour me donnent sans
cesse la force de continuer à aller de l'avant.
4
SIGLES ET ACRONYMES
|
AMAP
|
Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne
|
|
|
|
ARFD
|
Dose de Référence Aigüe
|
|
|
|
AOEL
|
Niveau d'Exposition Acceptable de l'Opérateur
|
|
|
|
BIO
|
Biologique
|
|
|
|
DDT
|
DichloroDiphénylTrichloroéthane
|
|
|
|
DJA
|
Dose Journalière Admise
|
|
|
|
DLso
|
Dose Létale tuant la moitié de la population
|
|
|
|
IGATE
|
Institut de Géographie de l'Aménagement du
Territoire
l'Environnement
|
et
|
de
|
|
INRA
|
Institut National pour la Recherche Agricole
|
|
|
|
INSAE
|
Institut National de la Statistique et d'Analyses
économiques
|
|
|
|
IRE
|
Indice de risque pour l'environnement
|
|
|
|
IRS
|
Indice de risque pour la santé
|
|
|
|
MA
|
Matière Active
|
|
|
|
MAEP
|
Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la
Pêche
|
|
|
|
MCVDD
|
Ministère du Cadre de Vie et du Développement
Durable
|
|
|
|
MIRD
|
Master Intégration Régionale et
Développement
|
|
|
|
MSP
|
Ministère de la Santé Publique
|
|
|
|
NPK
|
Nitrates, Phosphates et Potassium
|
|
|
|
OBePAB
|
Organisation Béninoise pour la Promotion de l'Agriculture
Biologique
|
|
|
|
OCs
|
Organochlorés
|
|
|
|
Ops
|
Organophosphorés
|
|
|
|
OMS
|
Organisation Mondiale de la Santé
|
|
|
|
ONG
|
Organisation Non Gouvernementale
|
|
|
|
PADAP
|
Programme d'Appui au Développement Agricole
Périurbain
|
|
|
|
PNUD
|
Programme des Nations Unies pour le Développement
|
|
|
|
%
|
Pourcentage
|
|
|
|
RGPH
|
Recensement Général de la Population et de
l'Habitat
|
|
|
|
Ughl
|
Microgramme par Litre
|
|
|
|
VIMAS
|
Village Maraîcher de Sèmè-Podji
|
|
|
5
LISTE DES FIGURES
|
Figure 1
|
Risques environnementaux
|
17
|
|
Figure 2
|
Localisation de la zone d'étude
|
24
|
|
Figure 3
|
Répartition de la population d'étude selon
l'âge
|
28
|
|
Figure 4
|
Répartition de la population d'étude selon le
niveau d'instruction en français
|
29
|
|
Figure 5
|
Répartition de la population d'étude selon le lien
avec la main d'oeuvre
|
31
|
|
Figure 6
|
Répartition de la main d'oeuvre selon l'âge
|
32
|
|
Figure 7
|
Répartition des ravageurs des cultures cités par
les maraîchers
|
32
|
|
Figure 8
|
Répartition de la population d'étude selon le
nombre de traitement insecticide effectué par mois
|
34
|
|
Figure 9
|
Répartition de la population d'étude selon le
délai de carence
|
35
|
|
Figure 10
|
Répartition de la population d'étude selon le
mode de stockage des pesticides
|
36
|
|
Figure 11
|
Différentes techniques de lutte contre les ravageurs
|
53
|
|
Figure 12
|
Mécanismes d'exposition de la population
générale
|
91
|
6
LISTE DES TABLEAUX
|
Tableau 1
|
Répartition de la Commune de Sèmè-Podji
selon les arrondissements
|
27
|
|
Tableau 2
|
Répartition de la population d'étude selon le
sexe
|
27
|
|
Tableau 3
|
Répartition de la population d'étude selon la
situation matrimoniale
|
29
|
|
Tableau 4
|
Légumes cultivés par les maraîchers et le
nombre de fois cité
|
30
|
|
Tableau 5
|
Prix de vente de certains légumes
|
30
|
|
Tableau 6
|
Répartition de la main d'oeuvre selon le sexe
|
31
|
|
Tableau 7
|
Répartition de la population d'étude selon les
moyens de protection adoptés
|
35
|
|
Tableau 8
|
Répartition de la population d'étude selon les
moyens de prophylaxie utilisés
|
36
|
|
Tableau 9
|
Répartition de la population d'étude selon la
gestion des emballages
|
37
|
|
Tableau 10
|
Types de pesticides chimiques utilisés dans la
production des légumes et le prix moyen
|
38
|
|
Tableau 11
|
Distribution des matières actives de pesticides, leur
classification selon l'OMS ainsi que leurs valeurs toxicologiques de
références selon pesticides properties data base
|
40
|
|
Tableau 12
|
Types de pesticides organiques utilisés dans la culture
des légumes
|
45
|
|
Tableau 13
|
Différents types d'engrais chimiques utilisés par
les maraîchers
|
46
|
|
Tableau 14
|
Différents types d'engrais organiques utilisés par
les maraîchers
|
46
|
|
Tableau 15
|
volume de pesticides utilisés lors de la production de
certaines cultures
|
49
|
|
Tableau 16
|
Fréquences des applications de pesticide
|
49
|
|
Tableau 17
|
Malaises provoqués par l'utilisation des pesticides
|
55
|
|
Tableau 18
|
Synthèse des impacts négatifs potentiels de
l'utilisation des pesticides
|
56
|
7
LISTE DES PLANCHES
|
Planche 1
|
Chenilles (Helicoverpa armigera) de Aboudou AMADOU reprise par
Marie Ange DEGUENON janvier 2019
|
33
|
|
Planche 2
|
Mouches blanches et pucerons noirs Chenilles (Helicoverpa
armigera) de Aboudou AMADOU reprise par Marie Ange DEGUENON janvier 2019
|
33
|
|
Planche 3
|
Flacons de pesticides Lambda, Tihan Duel, Alphacal
|
39
|
|
Planche 4
|
Préparation d'un mélange de suncozeb et d'acarius
à VIMAS
|
47
|
|
Planche 5
|
Pulvérisation de pesticides dans un champ de poivron
à VIMAS
|
48
|
|
Planche 6
|
Urée dans la main d'un garçon et NPK aux pieds des
plantes de tomates
|
52
|
|
Planche 7
|
Une boutique de vente d'intrants agricoles et des sacs de fientes
de volailles à VIMAS
|
54
|
|
Planche 8
|
Résidents permanents et formulation de pesticides à
VIMAS
|
57
|
LISTE DES PHOTOS
|
Photo 1
|
Village Maraîcher de Sèmè-Podji
|
18
|
|
Photo 2
|
Prise de vue de Daleb reprise par DEGUENON
|
48
|
|
Photo 3
|
Fientes de volaille étalées aux pieds des plantes
de chou
|
52
|
8
REMERCIEMENTS
Au terme de la réalisation de ce mémoire
j'adresse mes sincères remerciements à :
Mon Maître de mémoire Docteur
Expédit W. VISSIN, qui a accepté de diriger ce
travail malgré ses multiples occupations. C'est la preuve de votre
disponibilité envers vos étudiants.
Mon co-Maître de mémoire, Docteur
Florentine A. HOUEDENOU, qui a accepté
spontanément de diriger ce mémoire malgré ses multiples
occupations. Votre sens de recherche et vos qualités humaines valent
l'admiration.
Madame Carole MADAHUEN, Coordonnatrice du
réseau de vente des produits bio de AMAP Bénin pour m'avoir
accepté en stage. Vos qualités humaines forcent l'admiration.
Votre apport à ce travail est inestimable.
Membres du Jury, pour l'honneur que vous nous
avez fait en acceptant d'apprécier ce travail. Votre affection pour tous
les étudiants vaut l'admiration qu'ils portent tous à votre
personnalité.
Monsieur Jules DAGA Directeur de la
Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche à l'INSAE,
tes bienfaits m'ont aidé à concrétiser ce travail.
Ma mère Hélène GNANGLI
FAGNON, tu as veillé durant mon enfance et mon adolescence pour
je parvienne à bon port. Puisse Dieu te bénisse et t'accorder
longue vie.
Mon feu père Gaudens Avahoundjè
DEGUENON, qui m'a donné dans l'épreuve et la souffrance
la force et l'appui. Que la lumière de Dieu règne sur vous.
Mes feus grands parents Thierry GNANGLI et Marie
marguerite HOUNLÈDODJI GNANGLI, trouvez à travers ce
mémoire le témoignage de vos nombreuses
bénédictions.
Mon frère Simplice AHOUANDJINOU, qui
m'a permis de suivre cette formation. Ton apport n'a pas été
vain.
Mes enfants Elpydio, Astrid et Gérarda
ZEHOUNKPE, trouvez ici le fruit de mes nombreuses absences à
divers moments. Que Dieu vous bénisse et vous protège
Mon ami SOHOTO Noël qui n'a
ménagé aucun effort pour la phase enquête de mes
recherches, ce travail témoigne de ton soutien.
9
Tous les maraîchers qui ont bien voulu, partagé avec
moi les informations sur les thématiques abordées lors des
entretiens. Que ce travail contribue à amoindrir vos difficultés
et améliorer la qualité des légumes produits.
Madame T. Ingred Maguy WANKPO ta contribution
à ce travail n'est pas négligeable.
Tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué
à l'élaboration de ce travail, retrouvez ici le fruit de votre
esprit d'ouverture et d'humanisme au service de ceux qui en ont le plus
besoin.
10
RESUME / ABSTRACT
Ce travail a eu l'objectif d'étudier les risques
liés à l'utilisation des pesticides et engrais chimiques par les
maraîchers de VIMAS, dont 56 (hommes et femmes)
sélectionnés au hasard ont été soumis à un
questionnaire. Les spéculations les plus cultivées sont grande
morelle, amaranthe, laitue, carotte et tomate qui sont traitées par
différents pesticides dont les plus utilisés contiennent le
Cyperméthrine, le Chlopyriphos éthyl, l'Abamectine, et Emamectine
benzoate, des matières actives pyréthrinoïdes et des
organophosphorés suivi des Acaridae et des Avermectines. Les
insecticides sont systématiquement appliqués par 100% des
maraîchers contre 82,73 % qui utilisent les fongicides, seulement 14 %
d'eux respectent le délai de carence de 2 semaines. Aucun des
maraîchers enquêtés ne dispose d'un équipement
complet de protection individuelle. 94,64 % prennent un bain après
traitement et 26,78 % passent de l'huile rouge sur le corps. 75 % des
maraîchers stockent les pesticides dans leurs chambres. 62,5 % des
maraîchers abandonnent les emballages vides des pesticides et engrais
chimiques dans la brousse. 96,98 % souffrent d'une toxicité aigüe
contre 3,2 % de toxicité chronique. La majorité des
maraîchers sont relativement jeunes (74,99 %), l'âge moyen des
enquêtés est de 37,4 ans.»
Mots clés : risque, risques sanitaires,
risques environnementaux.
ABSTRACT
This work aimed to study the risks associated with the use of
pesticides and chemical fertilizers by market gardeners of VIMAS, whose 56
market gardeners (men and women) selected at random was submitted to a question
sheet. The most cultivated specimens are large nightshade, amaranth, lettuce,
carrot and tomato who are treated by various pesticides, the most used of which
contain Cypermethrin, Chlopyriphos ethyl, Abamectin, and Emamectin benzoate, of
the pyrethroid and organophosphorus active ingredients followed by Acaridae and
Avermectins. Insecticides are systematically applied by 100 % of market
gardeners against 82.73 % who use the fungicides, only 14 % respect the 2 weeks
delay. None of the gardeners surveyed has complete personal protection
equipment. 94.64 % take a bath after treatment and 26.78 % spend red oil on the
body 75 % of market gardeners store pesticides in their rooms 62.5 % of
gardeners abandon the empty packaging of pesticides and chemical fertilizers in
the bush. 96.98 % suffer from acute toxicity compared to 3.2% of chronic
toxicity. The majority of market gardeners are relatively young (74.99 %), the
average age of respondents is 37.4 years.
Keywords : risk, healthrisks,
environmentalrisks.
11
INTRODUCTION
La pollution agresse l'homme et son environnement et est
source de graves infections et nuisances liées à l'utilisation
des pesticides et engrais chimiques dans la culture des légumes
(Charbonnier E, Ronceux A, Carpentier A-S, Soubelet H, Barriuso E, coord.,
2015). Le Bénin est un pays en développement dont
l'agriculture est la première source de richesse. (MAEP,2015).
Elle comprend plusieurs filières, dont le maraîchage en plein
essor, qui en est une, permet la production des fruits et légumes,
ceux-ci sont riches en nutriments et permettent aux consommateurs d'être
en bonne santé par la prévention de certaines maladies comme les
maladies cardiovasculaires (Tchiégang, 2004 et Atchibri, 2012).
Du point de vue économique, le maraîchage est une excellente
source de revenus pour les habitants des milieux urbains et
péri-urbains (Kahane, 2005). Grâce à cette
filière, les maraîchers ont une situation économique qui
leur permet de couvrir leurs besoins fondamentaux (Ntow, 2006). Les
cultures maraîchères sont produites dans toutes les régions
du Bénin, mais surtout au Sud. Cependant le développement du
secteur agricole est confronté de jours en jours à des organismes
nuisibles qui ont amené l'agriculture en général et le
maraîchage en particulier à faire intervenir des produits
chimiques (Gbénonchi M, 2008 et Ahouangninou, 2008).
Par ailleurs, le souci d'une productivité
élevée a conduit de nos jours à une agriculture
conventionnelle qui utilise les engrais chimiques (Toé A, 2007).
Pour les cultures, sols et eaux souterraines sont exposés à
des dosages massifs d'engrais chimiques qui modifient leur milieu et rendent
l'eau non potable (Mottes C., 2013). Ces pratiques culturales ont des
conséquences sur les agriculteurs, les cultures, et les
écosystèmes (Aubertot, 2005 et Charbonnier E et al ,2015)
et les exposent à de nombreux risques. (Ahouangninou,
2012). Des teneurs de résidus dépassant 0,5ug/g pour les
organochlorés (DDT, Endrine, Heptachlore) ont été
décelé dans les légumes au sud du Bénin par
Assogba k., (2007). Les recherches de (Sousa-passos, 2006)
suggèrent l'exposition humaine aux pesticides : un facteur de risques
pour le suicide au Brésil. Une dizaine de différents types de
cancer ont été découverts par (Samborn, 2004). En
effet, quelques études sur l'utilisation de pesticides en
maraîchage au Bénin (Agbohessi, 2014 ; Ahouangninou, 2011 ;
Francoise k., 2007) ; (Soclo, H.H., 2004) ;Singbo et al, 2004) ;
(Vodouhe, S.D., 2000). (Sanny, S.M., 2002) (Tokannou, R.
Quenum, R., 2007) (Prudence Agnandji1 , Boris Fresnel Cachon2 ,
Ménonvè Atindehou1, et al, 2018) ont été
réalisées, mais la particularité de cette recherche est
qu'elle donne des informations précises sur les matières actives
de pesticides (prohibés ou sous surveillance (voir annexe 4)
utilisées en maraîchage et
12
les comportements à risques des maraîchers
vis-à-vis des pesticides dans la zone péri - urbaine
(Sèmè-Podji : VIMAS) au Sud Bénin. L'intérêt
de cette étude est de ressortir les maladies que nous causent ces
produits chimiques afin de nous en à protéger.
Le premier chapitre de cette étude s'attache à
décrire l'état des connaissances et la justification du sujet,
les hypothèses, les objectifs, la clarification des concepts, et la
démarche méthodologique ; le second chapitre porte sur les
fondements biophysiques et aspects humains de l'utilisation des pesticides et
engrais chimiques dans la culture de légumes à VIMAS; Le
troisième chapitre présentera les résultats obtenus, la
discussion, et les perspectives pour les études futures.
13
CHAPITRE I :
ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU SUJET,
HYPOTHESES, OBJECTIFS, CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DEMARCHE
METHODOLOGIQUE
1.1. ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU
SUJET
Une utilisation des pesticides élevée mais
très mal connue (INRA, 2005) en agriculture pose de nombreux
problèmes de santé publique et d' écologie. Les plus
importants sont la toxicité vis-à-vis de l' homme, l' atteinte
à la biodiversité et le développement de la
résistance des insectes (D. Alfa, 2014). Les pesticides sont
des substances ou préparations utilisées pour la
prévention, le contrôle ou l'élimination d'organismes
jugés indésirables (plantes, animaux, champignons ou
bactéries). L'utilisation croissante de ces outils chimiques a permis
d'augmenter considérablement la productivité agricole durant ces
40 dernières années et de lutter contre les vecteurs de certaines
pathologies mais ne sont pas dénués d'effets sur la santé
humaine (A. Vigouroux-Villard,2005).
Or l'essor prodigieux de l'industrie chimique au 20ème
siècle a profondément et irréversiblement modifié
les modes de production dictée à la fois par la pression
démographique et les nécessités économiques tant
dans les régions technologiquement et économiquement
avancées que dans les régions moins nanties de la planète
(A. Toé, 2007). Plus particulièrement, la production
massive et l'usage généralisé des produits chimiques en
agriculture notamment les engrais minéraux et les produits
phytosanitaires ont rendu possible l'intensification de l'agriculture avec un
accroissement spectaculaire des rendements des cultures (Gbénonchi
M, 2008). Ainsi les expositions chez les agriculteurs via les troubles de
la vision suite à une dégénérescence de la
rétine ont été mis en relation avec l'exposition à
certains pesticides (Liliana j. 2007.
Cependant l'agriculture urbaine et périurbaine
constitue l'une des préoccupations majeures en Afrique subsaharienne,
mais elle n'est ni contrôlée par l'Etat ni encadrée par une
structure ce qui fait qu'une partie des pesticides et engrais chimiques
destinés au coton est revendue pour être utilisée dans la
production des cultures maraîchères même si la distribution
et l'utilisation de ces produits destinés au coton sont
contrôlées par l'Etat affirment (Ahouangninou, 2008). Or
chacun de ces pesticides chimiques produit des métabolites ou
résidus au sein des
14
organismes vivants, qui sont plus ou moins dégradables
et susceptibles de se retrouver comme polluants de l'environnement ou
contaminants de la nourriture ou de la boisson (Charbonnier E, Ronceux A,
Carpentier A-S, Soubelet H, Barriuso E, coord., 2015) et nous exposent aux
maladies de Parkinson, diabète, cancer de la prostate, du testicule,
tumeurs cérébrales et mélanomes, l'infertilité,
malformations congénitales, cardiaques, perte de vue, la
leucémie, Alzheimer, sclérose latérale amyothrophique,
lymphomes non hodgkinien, myélomes multiples (Inserm, 2013). Même
si des statistiques n'existent pas encore sur la question, puisqu'il est
difficile de mettre derrière une pollution de l'environnement, une
maladie, et la mort un chiffre en matière de risque selon (Jousse,
2004), le risque existe affirme Ahouangninou, 2012 sur l'indice de
risque sanitaire à Sèmè-Podji qui s'élève
à 24429,44 et nous expose à l'intoxication et à la
pollution. Nous sommes interpellés à éduquer, former et
communiquer autour des pesticides pour un changement de comportements vitaux
bien que l'utilisation des pesticides et engrais chimiques en maraîchage
de nos jours est une nécessité pour optimiser les rendements des
cultures maraîchères à cause des conséquences que
ces pesticides ont sur notre santé et l'environnement (Pazou,
2006). Akogbéto (2005) estime que 30% des maraîchers
de Houéyiho au Bénin appliquent des doses fantaisistes de
pesticides. Aubertot, (2005) affirme que lors des traitements
phytosanitaires en pulvérisation sur feuillage, les pourcentages de
pertes sont de 10 à 70% vers le sol et 30 à 50% dans l'air et que
lors d'une fumigation du sol, 20 à 30% de pertes dans l'air peuvent se
produire selon le bon respect ou non des normes d'application. Les pertes en
direction des compartiments de l'environnement varient suivant l'état de
développement des cultures, le réglage du pulvérisateur,
la composition de la bouillie et les conditions météorologiques.
Les pesticides déposés sur le sol peuvent subir des transferts
à travers le sol et atteindre la nappe phréatique ou par
ruissellement contaminer les eaux de surface (Liliana, 2007).
Au Sénégal dans la zone périurbaine de
Niayes où les pesticides sont utilisés dans le maraîchage;
(Cissé, 2003) a trouvé dans la nappe phréatique
des concentrations de résidus de pesticides dépassant les normes
de potabilité de l'eau. En Côte d'Ivoire, (Traoré,
2006) a décelé une contamination de l'eau souterraine par
les pesticides organophosphorés et organochlorés dans les
régions agricoles où les pesticides sont utilisés dans les
cultures de cacao, café, hévéas, banane et
maraîchage. Assogba k., (2007) a décelé des
teneurs de résidus dépassant 0,5ug/g pour les
organochlorés (DDT, Endrine, Heptachlore) dans les légumes au sud
du Bénin. Les recherches de (Sousa-passos, 2006)
suggèrent que l'exposition aux pesticides peut causer toute une
série de dysfonctionnements neurologiques et de désordres
15
neuropsychiatriques. Une dizaine de différents types de
cancer ont été découverts par (Samborn,2004).
Cependant les utilisateurs de pesticides souvent mal formés, mal
informés et mal encadrés ignorent la composition, la
toxicité, le dosage, la fréquence d'utilisation et le mode
d'emploi (Afrique agriculture, 2000). Or même utilisés
avec précaution, leur persistance et leur dissémination, peuvent
aggraver leurs effets toxiques et avoir des incidences néfastes sur la
santé et l'environnement (Gbénonchi M, 2008). Les
organophosphorés et les pyréthrinoïdes constituent environ
65% des matières actives des différentes
spécialités en circulation (Toé A, 2010).
En effet, quelques études sur l'utilisation de
pesticides en maraîchage au Bénin (Agbohessi, et al 2014 ;
Ahouangninou, et al 2011 ; Francoise, et al 2007...etc) ont
été réalisées.
L'intérêt de cette étude est de ressortir
les risques d'exposition probables et essayer de les éviter au
maximum.
1.2. HYPOTHESES DU TRAVAIL
1- les règles de bonnes pratiques agricoles
liées à l'utilisation des pesticides et engrais chimiques ne sont
pas respectées à Sèmè-Podji.
2- l'usage des pesticides et engrais chimiques affecte
l'état de santé des consommateurs et dégrade notre cadre
de vie
3- les maraîchers et les autorités de tutelle
sont capables de développer des stratégies face à la
pollution planétaire de l'agriculture conventionnelle.
1.3. OBJECTIFS DE RECHERCHE
L'objectif général est de contribuer à la
réduction de l'utilisation des pesticides et engrais chimiques dans la
culture de légumes dans la Commune de Sèmè-Podji.
Spécifiquement, il s'agit de :
1- faire le point des pesticides et engrais
chimiques utilisés dans la culture des légumes dans la Commune de
Sèmè-Podji ;
2 - analyser les risques liés à
l'utilisation des pesticides et engrais chimiques dans la culture des
légumes dans la Commune de Sèmè-Podji ;
16
3 - proposer des stratégies pour
réduire l'utilisation des pesticides et engrais chimiques dans la
culture des légumes dans la Commune de Sèmè-Podji afin de
pallier aux catastrophes sur le plan sanitaire.
1.4. CLARIFICATION DES CONCEPTS
y' Risque : Selon le dictionnaire Universel
(2008) le risque est le danger que l'on peut plus ou moins
prévoir Dans le cadre de cette étude, le risque est la
probabilité de survenance d'une maladie par utilisation des pesticides
et engrais chimiques sur les légumes consommés au quotidien.
Ainsi nous avons les risques tels que :
y' Risques sanitaires : Selon le
dictionnaire-environnement un risque sanitaire désigne un risque,
immédiat ou à long terme, plus ou moins probable auquel la
santé publique est exposée. Dans le cadre de cette étude
les risques sanitaires sont des maladies à court ou à long terme
mal connues que nous développons par la consommation des légumes
contaminés par les pesticides et engrais chimiques quotidiennement. Les
effets des pesticides peuvent durer plusieurs jours. Pour gagner rapidement,
certains agriculteurs proposent aux consommateurs, des légumes qui ont
encore sur eux les effets des produits chimiques. C'est l'effet de
rémanence. D'autre part les pesticides laissent les résidus dans
les plantes cultivées. C'est l'effet de permanence.
y' Risques environnementaux : Selon
DEWAILLY E. et al, 2000 risques environnementaux signifie dispersion
des résidus industriels chimiques et des pesticides transportés
sur des milliers de kilomètres via le cycle de l'eau et les masses
d'air. Cependant un sol est pollué lorsqu'il contient une concentration
anormale de composés chimiques potentiellement dangereux pour la
santé, des plantes ou des animaux. L'épandage des produits
phytosanitaires et des engrais chimiques, des exploitations agricoles sont
également à l'origine de nombreuses pollutions des sols
(notamment par l'azote et les phosphates), qui vont à leur tour amener
la contamination des eaux de ruissellement, et par la suite les cours d'eaux.
La contamination se fait alors soit par voie digestive (consommation d'eau
polluée par exemple), ou par voie respiratoire (poussières des
sols pollués dans l'atmosphère CORFEC Yves, 2003) confère
figure 1 ci-dessous. Dans le cadre de cette étude risques
environnementaux est la probabilité de pollution de
l'écosystème (sol, eau et air...) par
l'utilisation des pesticides et engrais chimiques. En effet, lors de la
pulvérisation sur les cultures, on estime que 25 à 75%,voire
plus, des quantités se dispersent dans l'atmosphère.
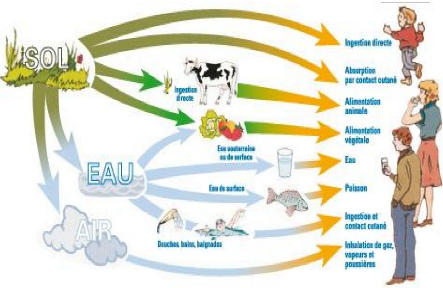
17
Figure 1 : risques environnementaux
Source : CORFEC Yves, 2003
La figure 1 nous montre que toutes les voies de contamination
finissent sur l'homme et démontre sa vulnérabilité face
à la pollution planétaire.
1.5. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
L'approche méthodologique utilisée dans le cadre
de cette étude est fondée sur l'enquête de terrain, la
collecte, le traitement et l'analyse des données sur les
activités menées dans VIMAS et leurs impacts sur les
spéculations cultivées et l'écosystème.
1.5.1. Présentation de la Commune de
Sèmè Podji
La Commune de Sèmè Podji est
une ville du sud est du Bénin, chef lieu de la commune du même nom
et préfecture du département de l'Ouémé. Elle
compte 222.207 habitants en 2013 soit un taux annuel d'accroissement
intercensitaire de 6,24 % avec une densité de 897 hab./km2
sur une superficie de 250 km2 soit environ 0,19% de la superficie de
la République du Bénin et comprise entre 6°22' et 6°28'
latitude nord d'une part et 2°28 et 2°43 longitude nord d'autre part.
Limitée au sud par l'océan atlantique, à l'est par la
république fédérale du Nigéria, à l'ouest
par la commune de Cotonou et au nord par la commune de porto-novo et les
aguégués. Située dans la zone intertropicale, la Commune
de Sèmè-Podji a 4 saisons dont 2
18
sèches et 2 pluvieuses, 1288mm d'eau coule sur la
commune. La température moyenne est de 27° et une humidité
relative élevée (web de la mairie).
Dans le cadre de cette étude la Commune de
Sèmè-Podji est située à seize kilomètres de
Cotonou, la capitale du Bénin, la commune de Sèmè-Podji
s'illustre par de denses activités maraîchères. Un domaine
d'environ 80 hectares, octroyé par le gouvernement, encadré par
la voie internationale Cotonou-Kraké et la mer, abrite, depuis plus de
dix ans, le Village Maraîcher de Sèmè-Podji (VIMAS). Cette
cité grouille d'activités. 240 personnes - 180 hommes et 60
femmes - s'activent à plein-temps pour tirer leur pitance d'un sol
sablonneux, peu riche en matières organiques. Plusieurs
spéculations sont identifiables. D'une part, des cultures
traditionnelles de plein champ : tomates, piments, oignons, gombos,
légumes feuilles... ; d'autre part, des cultures exotiques : carotte,
chou, laitue, concombre, betterave, plantes aromatiques ou haricot vert. Chaque
actif occupe un espace allant de 1/8 à 2 ha en fonction de ses
capacités. « Pour s'installer, il suffit de payer un droit
d'adhésion de 25 000 F Cfa (38 €) à l'association du village
», explique Benoît Amoussou, le trésorier (G. Roko,2016).

Photo 1 : Le Village Maraîcher de
Sèmè-Podji (VIMAS) Source : DEGUENON, novembre
2018
19
La prise de vue 1 témoigne de l'aspect sableux du sol
marin très pauvre en fertilisants que travaillent les maraîchers
pour produire les légumes.
1.5.2. La recherche documentaire
Elle a permis de consulter les ouvrages, les articles
publiés, et l'internet, pour des recherches
avancées. Elle consiste à rassembler des
connaissances théoriques précises sur le sujet de recherche afin
de mieux élaborer les différentes parties de notre recherche.
Elle consiste en l'exploitation d'ouvrages généraux sur le
thème pour mieux définir les concepts à utiliser et le
contenu à leur donner mais aussi en une synthèse des
résultats des recherches antérieures sur la problématique
afin de dégager les questions qui demeurent et les besoins de recherche.
Elle permet de définir la perspective théorique qui servira
à l'interprétation des données et enfin de définir
une ligne de conduite et les instruments pour les différentes mesures.
Elle couvre toutes les phases de la recherche.
1.5.3. Outils et techniques de collecte de
données
Les outils et techniques utilisés pour collecter les
quantités de pesticides et d'engrais
chimiques utilisées par superficie emblavée et
autres sont le questionnaire : le principal outil de collecte de
données, le carnet de note, a servi d'aide-mémoire et de
repère, un appareil photo Samsung et un portable Android pour les
enregistrements.
1.5.4. La phase exploratoire
Cette phase consiste à découvrir le milieu
d'étude à travers des discussions avec les
personnes ressources, les paysans à l'aide d'un guide
d'entretien, en des observations directes (façon discrète
informelle de recenser certaines informations sans questionner les acteurs y
compris des dysfonctionnements constatés). Il s' agit de collecter des
informations générales sur le milieu d'étude, les
contraintes majeures qui influencent la production maraîchère et
les activités. Elle renforce la précision et la reformulation des
objectifs de recherche, les hypothèses, et la méthodologie.
Aussi, la phase exploratoire nous instruira dans notre échantillonnage.
Les informations collectées vont servir à l'élaboration
d'une question d'enquête qui sera utilisé lors de la phase
enquête. A l'issue de cette phase le village maraîcher de
Sèmè-Podji ayant une superficie emblavée d'au moins 80 ha
a été sélectionné.
1.5.5. L'échantillonnage
Le principe de l'échantillonnage est aléatoire. Au
total, cinquante six (56) exploitations
maraîchères sur 240 ont été
visitées et quelques revendeuses de légumes frais
rencontrées et choisies au hasard en vue de recueillir leurs
appréciations sur les légumes bio et
20
conventionnels. Enfin, des données ont
été collectées auprès de quelques boutiques
d'approvisionnement en intrants (semences, engrais, pesticides) afin de
vérifier certaines informations fournies par les maraîchers telles
que les prix d'achat des intrants et les noms de certains produits
phytosanitaires.
1.5.6. La phase enquête :
Les enquêtes ont été
réalisées sur la base des questionnaires (voir annexe 1 du
mémoire). C'est des visites de terrain qui permettent de collecter des
données nécessaires pour le test des hypothèses. Elle est
conduite au sein des échantillons constitués à l'issue de
la phase exploratoire. Les données sont collectées par des
entretiens (interviews : communication bilatérale avec le
maraîcher. D'une durée moyenne d'une heure, ces entretiens se sont
déroulés essentiellement en langue fon) à l'aide d'un
questionnaire adressé aux producteurs utilisateurs et non utilisateurs
des pesticides et engrais chimiques et d'autres acteurs intervenant dans le
domaine.
Les informations collectées sont relatives aux : -
caractéristiques socio-économiques et culturelles des
maraîchers (sexe, âge, taille de ménage, nombre d'actifs
agricoles, niveau d'instruction, ethnie, nombre d'années
d'expériences); -différentes variétés de
légumes cultivées, superficies allouées, etc... ; -
à l'estimation des recettes brutes issues de la vente des produits
maraîchers ; -aux différentes substances chimiques de
synthèse (engrais chimiques et pesticides) utilisées dans la zone
d'étude ;-à l'estimation des coûts des intrants agricoles
(engrais minéraux : urée, NPK ; engrais organique : bouse de
vache, fécès de mouton ; pesticides) ;-à la
quantité de chaque intrant spécifiée par unité de
surface, les prix relatifs aux intrants ont également été
collectés ; -à la qualité et aux conditions d'utilisation
des pesticides ;-au niveau de prise de conscience des populations et des autres
acteurs des dangers et/ou dommages liés à l'utilisation des
engrais chimiques et des pesticides dans l'environnement ;-aux facteurs
à risques liés à l'utilisation des pesticides ; -aux
problèmes de santé et de l'environnement; -aux stratégies
développées par les acteurs pour la durabilité de la
production maraîchère.
Cette phase va nous conduire au traitement des données
collectées, puis à l'analyse des résultats obtenus
utilisés pour la rédaction de ce mémoire.
1.5.7. Traitement et analyse des données
Les données ont été
dépouillées, saisies et analysées par la statistique
descriptive à l'aide des logiciels Word et Excel. Les calculs des
quantités des pesticides ont été faits par
nous-même.
21
1.6. LES INDICATEURS DE RISQUES
1.6.1. La lutte chimique et la quantité de
pesticides à l'hectare par cycle de production d'un légume
feuille
Elle consiste à utiliser des pesticides chimiques
(herbicides, insecticides, fongicides, nématicides, etc.) pour combattre
les maladies et ravageurs des cultures.
Cette quantité est l'un des indicateurs qui
reflète le risque potentiel d'une matière active contenue dans
une formulation commerciale donnée. Elle prend en compte la classe de
danger et les valeurs toxicologiques de référence des pesticides
selon l'OMS Source d'information sur les paramètres chimiques,
toxicologiques et éco toxicologiques dans Pesticides Properties Data
Base, 2018 (annexe 2).
Les données statistiques du calcul de cette
quantité figurent en annexe 2 (ATDA, 2018).
Selon ATDA 2018 pour le mois de décembre 1062 l de
pesticides ( herbicides 20 l + insecticides 1042 l) ont traité 17
légumes sur 70,3 ha.
Ø Dose létale : est la dose
à laquelle un pourcentage donné d'une population donnée
décède. Elle est unité de masse de substance par masse
corporelle (g/kg) puisque la résistance est variable d'un individu
à l'autre (
fr.wikipédia.org),
l'indicateur le plus utilisé est la dose létale 50 ou (DL50).
Pour exemple de doses létales de quelques produits
Doses létales de produits pouvant entraîner la mort
d'un homme de 70 kg :
. alcool 90° : 500g
. sel de table : 225g
. ibuprofène 600 : 30g
. pesticides : non déterminé
. engrais : non déterminé
Il n'y pas une firme spécialisée dans la mise
en forme spéciale pour les pesticides dans le maraîchage. Ce qui
fait que les maraîchers utilisent les produits du coton qui ne sont pas
du tout conseillés pour les légumineuses. Beaucoup utilisent le
Pacha, un insecticide utilisé dans la culture du niébé
mais que les maraîchers utilisent souvent dans les cultures
maraîchères.
22
Par ailleurs, en termes de fréquence, les insecticides
arrivent nettement en tête dans les préférences 100 % des
maraîchers interrogés les placent en première position.
1.6.2. La fertilisation et la quantité d'engrais
à l'hectare par cycle de production d'un légume feuille
On distingue plusieurs types d'engrais minéraux :
V' Les engrais azotés qui contiennent de l'azote
;
V' Les engrais phosphatés qui contiennent du
phosphore ; V' Les engrais potassiques qui contiennent du
potassium.
Les principaux engrais les plus utilisés en
maraîchage au Bénin sont : NPK, l'Urée (46% d'azote),
Sulfate de potassium (45% de potassium).
Selon l'ATDA pour le mois de décembre 9000 kg d'NPK et
d'Urée ont traités 17 légumes sur 70,3 ha, ce qui revient
à 128,02 kg d'NPK et d'Urée à l'hectare. Or la
quantité recommandée devrait être inférieure
à 50 kg, donc les 78,02 kg sont en excès et constituent un indice
de risques sanitaires et environnementaux.
1.7. LIMITES DE LA RECHERCHE
Par rapport aux pesticides (dégâts et impacts sur
les consommateurs), la réticence de certains maraîchers à
fournir les informations sur les produits chimiques prohibés qu'ils
utilisent, nous a amené à procéder à des
estimations. Les déclarations collectées au niveau de plusieurs
maraîchers sur le même site permettent de rendre ces estimations
réalistes. Les informations collectées ont été
obtenues par jeu de question-réponses qui font appel à la
mémoire des producteurs. Enfin, La recherche s'est limitée
à une étude de perception sur les effets environnementaux et
sanitaires des pesticides et engrais chimiques. Elle n'a pas pu prendre en
compte les analyses microbiologiques et la propreté des eaux et des
légumes. Enfin, la nature des données recueillies n'a pas permis
d'estimer la régression afin de déterminer les facteurs
susceptibles de réduire le risque de contracter une maladie suite
à l'utilisation des pesticides. En lieu et place nous nous sommes
contentés d'une étude de perception. Nous pouvons dire que les
données recueillies sont crédibles et reflètent la
situation de la production maraîchère dans la ville de
Sèmè-Podji malgré les insuffisances mentionnées.
23
Conclusion partielle
Les visites de terrain et divers entretiens ont par ailleurs
révélé l'accroissement à tout prix de l'
activité insecticide des formulations chimiques et l'utilisation par les
maraîchers de pesticides prohibés tels que le Duel, l'Alphacal,
Cypercal etc..., l'une des raisons évoquées par les agriculteurs
pour justifier l'utilisation incontrôlée de pesticides
était de sauver les cultures et rentabiliser leurs activités pour
leur survie. L'utilisation des organochlorés, c'est l'efficacité
manifeste de ces derniers sur les insectes ravageurs par rapport à ceux
homologués par l'Etat qui, à l'exception de l'endosulfan, sont
constitués par des pesticides organophosphorés. Ceci a permis
d'avoir une idée sur les fondements biophysiques et les aspects humains
favorisant la contamination des légumes et la pollution de
l'écosystème du site.
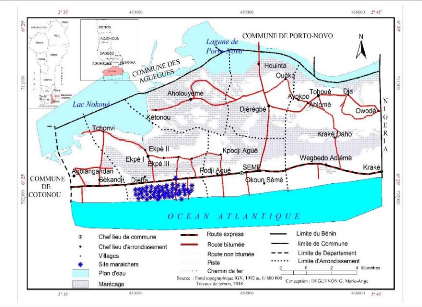
24
CHAPITRE II :
FONDEMENTS BIOPHYSIQUES ET HUMAINS FAVORABLES A
L'UTILISATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES
LEGUMES
2.1. FONDEMENTS BIOPHYSIQUES DE L'UTILISATION DES
PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES LEGUMES
2.1.1. localisation du cadre d'étude
Le périmètre maraîcher prospecté au
cours de nos investigations est situé dans la zone du
cordon littoral encore appelé zone côtière
dans Djeffa à Ekpè peuplé de 75.313 habitants à
forte activité maraîchère comme nous l'indique la figure 2
ci-dessous.
Figure 2 : localisation de la zone
d'étude
Source : DEGUENON, janvier 2019
La figure 2 nous renseigne sur le site maraîcher
matérialisé en astéries bleus situé entre la voie
inter-Etats Bénin-Négéria et l'océan atlantique au
village Djeffa dans l'arrondissement d'Ekpè dans la Commune de
Sèmè-Podji.
25
2.1.2. Relief
Sèmè-Podji est une plaine côtière
encastrée dans un complexe de plans d'eau (océan
Atlantique, lagune de Porto-Novo, fleuve Ouémé
et lac Nokoué). Le relief très bas varie par endroit entre 0 et 6
m environ d'altitude. Il est majoritairement composé de
marécages, de sables fins inaptes aux activités agricoles et de
plans d'eau (INSAE/PDC, 2005).
2.1.3. Climat
La commune de Sèmè-Podji baigne dans un climat
soudano guinéen caractérisé par deux
saisons sèches (décembre à
février et août à septembre) et deux saisons pluvieuses
(avril à juillet et octobre à novembre). La température
moyenne fait environ 27°C avec une humidité relative
élevée. L'influence du vent côtier sur le climat
crée souvent des perturbations cycliques qui font de la commune de
Sèmè-Podji, une des zones les plus arrosées du Sud
Bénin avec une moyenne pluviométrique dépassant
annuellement 1100 mm (INSAE/PDC, 2005). Une zone plus arrosée est une
zone fortement humide, où il y a assez d'eau, l'eau qui est
l'élément fondamental du maraîchage. Donc ce climat est
favorable aux activités maraîchères. Une zone trop
arrosée, peut entraîner une augmentation de traitements, qui
implique une utilisation abondante des pesticides et engrais chimiques. Les
deux différentes saisons des pluies observées au Sud-Bénin
déterminent les périodes de fortes productions
maraîchères grâce à la disponibilité de
l'eau.
2.1.4. Hydrographie
Coincé entre le complexe mer, lac et lagune,
Sèmè-Podji bénéficie d'un réseau
hydrographique favorable aux activités de pêche.
Il s'agit de la lagune de Cotonou qui en s'élargissant forme le lac
Nokoué (14 000 ha). Elle communique par le canal de Toché avec la
lagune de Porto-Novo qui se prolonge à l'Est jusqu'à Lagos au
Nigeria créant ainsi une forme de réservoir d'eau douce ou
salée selon la période de l'année (INSAE/PDC, 2005). Cette
hydrographie est favorable à la culture de légumes même en
temps de contre saison par l'irrigation. VIMAS se retrouve dans cette zone
2.1.5. Végétation
La zone de Sèmè-Podji appartient au secteur
phytogéographique guinéen côtier à
végétation rase, clairsemée,
formée essentiellement d'halophytes. La végétation
naturelle, constituée d'arbustes et d'arbrisseaux denses à
dominance de Zanthoxylum zanthoxyloïdes, Chrysobalanus icaco et Dialium
guineense ne subsiste plus actuellement que très sporadiquement ou sous
forme de touffes éparses, du fait de l'action de l'homme (installation
des cultures, recherche de bois de chauffe et de construction etc...). Elle
reste
26
aujourd'hui dominée par un tapis herbacé
faiblement enraciné dans la zone sableuse. (INSAE/PDC, 2005).
2.1.6. Faune
Elle est très peu diversifiée aujourd'hui dans la
commune et se réduit à quelques
mammifères tels les aulacodes, les singes, le
sitatunga (Tragelaphus spekei), le guib harnaché ope (Tragelaplus
scriptus), les lapins, les lièvres, les rats, les écureuils et
civettes d `Afrique. La grande faune quant à elle, a pratiquement
disparu à cause de la destruction quasi totale de son habitat au profit
des installations humaines (habitat, champs, etc.) et de la chasse (INSAE/PDC,
2005).
2.1.7. Sols
Du fait de sa position topographique (voir relief) la commune de
Sèmè-Podji ne dispose que
de sols résultant essentiellement du lessivage ou de
la sédimentation. Ils sont pour la plupart hydromorphes et très
pauvres en éléments nutritifs et en matériaux organiques,
notamment en base, azote et phosphore, mais riches en dioxyde de silicium avec
quelques éléments de sols ferrugineux de type tropical. De ce
fait, très peu de sols sont favorables ou marginalement aptes à
la production vivrière. Par contre, ils sont apparemment favorables aux
palmiers à huile, cocotiers et canne à sucre qui s'y
développent bien (INSAE/PDC, 2005). Ce fondement physique inapte
à l'agriculture est favorable à l'utilisation des intrants
chimiques pour cultiver les légumes dans VIMAS.
2.2. FONDEMENTS HUMAINS DE L'UTILISATION DES
PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES LEGUMES
2.2.1. Peuplement de la Commune
A l'instar des autres communes du département de
l'Ouémé, le peuplement de Sèmè-Podji a
été réalisé par différents
courants migratoires. Le plus important est celui des Alladanou qui a permis le
peuplement de tout le plateau du Sud-est de l'Ouémé.
(INSAE/PDC,2005).
Sur le plan administratif, la Commune de
Sèmè-Podji a six (06) arrondissements. Il s'agit de
l'Arrondissement : d'Agblangandan, d'Ekpè, d'Aholouyèmè,
de Djèrègbé, de Tohouè et de
Sèmè-Podji. La population est inégalement répartie
dans ces six arrondissements comme l'indique le tableau ci-dessous
27
Tableau1 : Répartition de la Commune de
Sèmè-Podji selon les arrondissements
Arrondissement
|
Population
|
Agblangandan
|
57762
|
Ahlouyèmè
|
13218
|
Djèrègbé
|
20462
|
Ekpè
|
75313
|
Tohouè
|
32310
|
Sèmè-Kpodji
|
23636
|
Total
|
222701
|
|
Source : RGPH4, 2013
Le tableau 1 nous renseigne que la zone d'étude VIMAS
se trouve dans Ekpè un arrondissement représentatif parce qu'il
est le plus peuplé des arrondissements donc favorable à une
demande plus accrue de produits maraîchers incluant une utilisation
massive des pesticides et engrais chimiques à cause de ses sols inaptes
à l'agriculture.
2.2.2. Le sexe
La population d'étude est constituée de 49 hommes
et de 7 femmes soit respectivement 87,5%
et 12,5% de la population enquêtée (tableau 2).
Tableau 2 : Répartition de la population
d'étude selon le sexe
Sexe
|
Fréquence absolue
|
Pourcentage (%)
|
Masculin
|
49
|
87,5
|
Féminin
|
7
|
12,5
|
Total
|
56
|
100
|
|
Source : DEGUENON, novembre 2018
2.2.3. L'âge
L'âge de la population varie de 15ans à 62 ans.
Plus de 74,99% de la population enquêtée a
entre 15 et 45 ans (figure 3). L'âge moyen des
enquêtés de 37,4 ans.
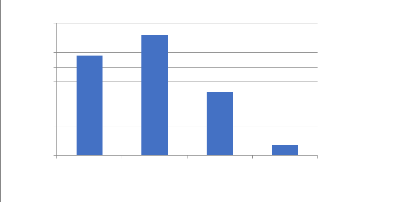
45
40
35
30
25
20
15
10
nombre de maraîchers
5
0
[15-30[ [30-45[ [45-60[ [60-62+[
tranche d'âge
28
Figure 3 : Répartition de la population
d'étude selon l'âge Source : DEGUENON, novembre 2018
La figure 3 montre que la tranche d'âge de 15 à
45 ans est la plus élevée. Ceci confirme également les
résultats de Hounkpotodé et de Tossou (2001) indiquant que la
production maraîchère est principalement l'occupation des jeunes
diplômés sans emploi et autres fonctionnaires à bas salaire
pour qui l'activité constitue un appoint non négligeable pour le
revenu et l'alimentation.
2.2.4. Le niveau d'instruction en français
Près de la moitié des maraîchers n'ont pas
fréquenté l'école. Le taux n'analphabétisme est
de
48,21%. Parmi les maraîchers qui ont été
à l'école (51,78%), seuls 28,57% ont atteint le niveau secondaire
et 23,21% ont atteint le niveau primaire. Aucun d'eux n'a fait d'études
supérieures (figure4).

nombre de maraîchers
60
50
40
30
20
10
0
primaire secondaire non instruit
Niveau d'instruction
29
Figure 4: Répartition de la population
d'étude selon le niveau d'instruction en français Source :
DEGUENON, novembre 2018
2.2.5. La situation matrimoniale
La population d'étude est constituée en
majorité d'hommes mariés soit 78,57% et de 21,43%
de célibataires.
Tableau 3 : Répartition de la population
d'étude selon la situation matrimoniale
Situation matrimoniale
|
Fréquence absolue
|
Pourcentage (%)
|
Marié
|
44
|
78,57
|
Célibataire
|
12
|
21,43
|
Total
|
56
|
100
|
|
Source : DEGUENON, novembre 2018
2.2.6. Activités économiques
Les activités économiques de la population
d'étude se composent essentiellement de la culture
des différentes sortes de légumes à
savoir les légumes feuilles, les légumes racines et les
légumes fruits. Les principaux légumes cultivés à
VIMAS sont : la grande morelle (Solanum macrocarpum), le grand basilic (Ocimum
basilicum), le chou pommé (Brassica oleracea var. capitata), la laitue
(Lactuca savita), la tomate (Lycopersicon esculentum), l'amarante (Amaranthus
hydritus), l'aubergine (Solanum melongena), la carotte (Daucus carota ) les
plantes aromatiques comme la menthe (Menthaspicata), etc... Plus de 20
spéculations ont été citées par les
maraîchers.
30
Tableau 4 : Légumes cultivés par
les maraîchers et le nombre de fois cité.
Cultures
|
Noms scientifiques
|
Nombre
de fois
cité
|
Durée du cycle
|
Grande Morelle
(gboma)
|
Solanum macrocarpum
|
42
|
60 à 90 jours
|
Vernonia
|
Vernonia amygdalina
|
38
|
60 jours
|
Amarante
|
Amaranthus cruentus
|
55
|
21 jours
|
Tomate
|
Lycopersicon esculentum Mil.
|
56
|
45 à 60 jours
|
Carotte
|
Daucus carota
|
45
|
90 jours
|
Piment
|
Capsicums
|
33
|
60
|
Chou cabus
|
Brassica oleracea
|
22
|
60 à 90 jours
|
Aubergine
|
Solanum melongena
|
26
|
60 jours
|
Concombre
|
Cucumis savitus
|
16
|
45 jours
|
Grande Basilique
|
Ocimum basilicum
|
20
|
40 jours
|
Betterave
|
Beta vulgaris
|
6
|
90 jours
|
Laitue
|
Lactuca sativa
|
48
|
60 jours
|
Navet
|
Brassica rapa
|
1
|
70 à 90 jours
|
|
Source : DEGUENON, novembre 2018
Il est à remarquer que les deux types de légumes
(cycles long et court) sont cultivés par tous les maraîchers et
aucun d'eux ne fait exclusivement l' un ou l' autre. Cette attitude fait partir
des moyens mis en oeuvre pour minimiser les risques.
2.2.7. Prix de vente de quelques légumes
Les prix de vente des légumes varient au gré de la
période de production et de la montée ou de la baisse du «
naéra »
Tableau 5 : Prix de vente de certains
légumes
Légumes
|
Période de montée et de baisse
|
Prix / planche
|
|
Offre >
demmande
|
Minimum
|
Maximum
|
Gboma
|
Novembre, décembre
|
Avril, mai, juin,
octobre
|
600
|
1500
|
Oignon vert
|
Décembre, janvier
|
Mai, juin, juillet
|
1000
|
1500
|
Betterave
|
mars et octobre
|
janvier, février,
novembre et
décembre
|
3000
|
6000
|
Laitue
|
avril et juillet
|
mai et juin
|
500
|
4000
|
Vernonia
|
novembre, décembre
|
Mars, avril, juin
juillet
|
500
|
1000
|
Chiayo
|
Plein temps
|
Plein temps
|
500
|
1500
|
Amaranthe
|
Mars, avril, juin
juillet
|
Janvier, mars,
novembre
|
300
|
800
|
Carotte
|
janvier, avril,
septembre, octobre
|
mai, juin et juillet
|
4000
|
7000
|
Concombre
|
Mai
|
juin et juillet
|
1500
|
3000
|
|
31
Chou
mars et octobre
|
janvier, février,
novembre, décembre
|
250 / unité
|
300 / unité
|
Piment
|
Novembre - mai
|
Juin - octobre
|
6000/sac de 50kg
|
15000/sac de 50kg
|
Tomate
|
Janvier -avril
|
Mai - décembre
|
2000/panier
|
7000/panier
|
Persil
|
Avril
|
Janvier
|
1500
|
2500
|
|
Source : DEGUENON, décembre 2018
Le tableau 5 présente quelques légumes et leurs
prix de vente. Les maraîchers estiment qu'un investissement de 150000 fca
peut générer une recette de 360000fca de récolte sans
oublier la main d'oeuvre payante : ouvriers 25000 les 2 premiers mois et 30000
à 35000fca les mois suivants. Les horaires de travail sont 7 à 13
heures et 16 à 18 heures 30 minutes.
2.2.8. La main d'oeuvre utilisée
Parmi les maraîchers 89,28% sont assistés par la
main d'oeuvre. La majorité (80,35%)
utilisent les employés tandis que 19, 65% utilisent
les membres de leurs familles (figure 5). La main d'oeuvre est majoritairement
composée d'hommes (94,87%) contre 5,13% de femmes (tableau 6). Elle est
en général composée de jeunes gens de moins de 30 ans
(figure 6)
employés épouses enfants
nature du lien
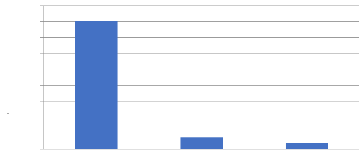
nombre de maraîchers
40
70
90
80
60
50
30
20
10
0
Figure 5 : Répartition de la population
d'étude selon le lien avec la main d'oeuvre. Source : DEGUENON,
novembre 2018
Tableau 6 : Répartition de la main
d'oeuvre selon le sexe
Sexe
|
Fréquence absolue
|
Pourcentage
|
Masculin
|
37
|
94,87
|
Féminin
|
2
|
5,13
|
Total
|
39
|
100
|
|
32
Source : DEGUENON, novembre 2018
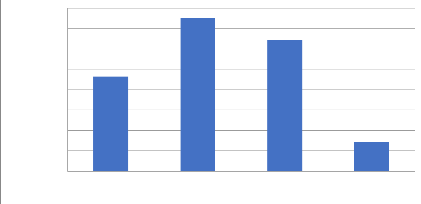
Nombre de maraîchers
35
30
25
20
15
10
40
5
0
[10-15[ [15-20[ [20-25[ [25 et plus[ Tranche
d'âge
Figure 6 : Répartition de la main
d'oeuvre selon l'âge Source : DEGUENON, novembre 2018
2.2.9. Les ennemis de la culture
Les maraîchers signalent l'existence de six ravageurs qui
attaquent les cultures maraîchères. Il
s'agit principalement de vers (chenilles), de pucerons et de
criquets, beaucoup plus rarement de papillons, de cochenilles et de mouches
(figure 7)

nombre de foi cités
40
80
70
60
50
30
20
10
0
criquets papillons vers mouches cochenilles puces
ennemis des cultures
Figure 7 : répartition des ravageurs des
cultures cités par les maraîchers Source : DEGUENON, novembre
2018

33
Planche 1 : Chenilles (Helicoverpa armigera)
de Aboudou AMADOU reprise par Marie Ange DEGUENON, janvier 2019.
Les 3 photos montrent les dégâts causés
par Helicoverpa armigera appelé la noctuelle de la tomate c'est insecte
polyphage, qui s'attaque à plusieurs espèces de plantes
avec une préférence pour le cotonnier et les solanacées
(tomate, poivron, piment, etc.) détruit les bouquets floraux, chute les
jeunes fruits attaqués; déprécie les fruits
commercialisés et pourrit les fruits lorsque des germes
pathogènes les infestent en pénétrant par les trous qu'il
creuse.

Planche 2 : Mouches blanches et pucerons
noirs Chenilles (Helicoverpa armigera) de Aboudou AMADOU reprise par Marie Ange
DEGUENON, janvier 2019
La photo 1 et 2 montrent les mouches
blanches qui sont de petits insectes blanchâtres qui sont des
piqueurs-suceurs que l'on trouve généralement à la face
inférieure des feuilles. Les mouches blanches sont dangereuses par les
virus qu'elles peuvent transmettre aux cultures (tomate, piment,....) et les
pucerons noirs qui sont de petits insectes piqueurs-suceurs qui vivent en
colonie sur les jeunes parties (feuilles, boutons floraux, ...) de plusieurs
cultures, déforment la plante; provoquent un arrêt de croissance;
secrètent des substances sucrées; transmettent aussi des maladies
virales
2.2.10. Nombre de traitement par mois
La majorité des maraîchers font 4 (23,21%)
à 5 (48,21%) traitements insecticides par mois, soit environ 1
traitement par semaine (figure 8). Aussi 14,92% et 6,5% des maraîchers
font 6 à 7 traitements par mois tandis que 2,4% et 6,6% des
maraîchers ne font que 2 à 3 traitements
34
par mois. Bien souvent les maraîchers, lorsqu'ils
décident d'un traitement insecticide, ils traitent la totalité de
leur périmètre toutes cultures confondues.
nombre de traitements par mois
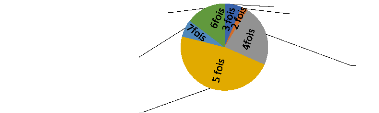
nombre de maraîchers
14,92
6,6
2,4
6,5
23,21
48,21
Figure 8 : Répartition de la
population d'étude selon le nombre de traitement insecticide
effectué par mois
Source : DEGUENON, novembre 2018
Les traitements des cultures sont réalisés
à titre préventif et à titre curatif.
Généralement pour la prévention, les traitements sont
réalisés tous les 5 à 8 jours ; et à titre curatif
tous les 2 à 3 jours selon le niveau d'attaque de la culture.
Un autre facteur déclenche également les
traitements chez une dizaine des maraichers enquêtés. Quand mon
voisin traite ses cultures, il faut que je le fasse aussi sinon mes cultures
seront contaminées disent-ils. Cette perception résulte du fait
que ces maraichers pensent que certains ravageurs ne meurent pas après
traitement mais se déplaceraient. Les acariens et les criquets ne
meurent pas facilement, quand tu mets le produit, ils sont
dérangés et ils se déplacent pour aller chez celui qui est
à côté... etc.
2.2.11. Délai de carence
La grande majorité des maraîchers (80%) n'applique
qu'un délai de 3 à 5 jours entre la dernière application
de pesticides et la récolte et 6% appliquent le délai de 2 jours
seulement (figure 9). Seuls 14% des maraîchers respectent un délai
de carence de 2 semaines
Délai de carence

Nombre demaraîchers
40
20
30
10
0
35
Figure 9 : Répartition de la population
d'étude selon le délai de carence Source : DEGUENON, novembre
2018
2.2.12. Les moyens de protection personnelle
Tous les maraîchers sont près que pieds nus, seuls
17,85% portent de chaussures fermées,
plus de la moitié des maraîchers n'utilise aucun
moyen de protection personnelle lors de la préparation et de
l'application des pesticides (tableau) ils portent seulement une culotte
(60,71%). Environ 51,78% ne portent généralement qu'un pantalon.
Seuls 3,57% utilisent de masque, 1,78% utilisent de gants et 17,85% utilisent
de chemise manche longue.
Tableau 7 : Répartition de la population
d'étude selon les moyens de protection adoptés
Moyens de protection
|
Nombre de fois cité
|
Pourcentage (%)
|
Aucune protection (culotte)
|
34
|
60,71
|
Port de pantalon seul
|
28
|
51,78
|
Port de masque
|
2
|
3,57
|
Port de gants
|
1
|
1,78
|
Port de chaussures fermées
|
10
|
17,85
|
Protection complète
|
00
|
00
|
|
Source : DEGUENON, novembre 2018
2.2.13. Mesures de prophylaxie après utilisation
des pesticides
La majorité des maraîchers prennent un bain
après l'utilisation des pesticides (tableau 7). Pour
les autres, 19,64% lavent automatiquement leurs mains
après la pulvérisation , 12,5% lavent leurs habits, 26,78%
passent de l'huile rouge de palme sur le corps. A leur compréhension,
ces pratiques ont des effets antagonistes avec les pesticides, 14,28% prennent
du lait non sucré et 42,85% prennent des médicaments.
36
Tableau 8 : Répartition de la
population d'étude selon les moyens de prophylaxie utilisés
Mesure de prophylaxie
|
Nombre de fois cité
|
Pourcentage (%)
|
Prendre un bain
|
53
|
94,64
|
Se laver les mains
|
11
|
19'64
|
Laver les habits
|
7
|
12,5
|
Passer de l'huile rouge sur le corps
|
15
|
26,78
|
Prendre du lait non sucré
|
8
|
14,28
|
Prendre de médicaments
|
24
|
42,85
|
|
Source : DEGUENON, novembre 2018
2.2.14. Stockage des pesticides
Le tiers (75%) des maraîchers garde leurs pesticides
dans leurs chambres, 8,92%, et 10,71%
les cachent dans les bananeraies et brousses. Par contre 5,25
les enterrent (figure 10).

lieu de stockage des pesticides

Figure 10 : Répartition de la population
d'étude selon le mode de stockage des pesticides Source : DEGUENON,
novembre 2018
2.2.15. La gestion des emballages des pesticides
Plus de la moitié (62,6%) des maraîchers
abandonnent les emballages des pesticides dans la
brousse (tableau 9), cependant 21,42% les enterrent et 16,07%
les réutilisent pour acheter de l'essence ou à nouveau de
pesticides chez les détaillants.
37
Tableau 9 : Répartition de la population
d'étude selon la gestion des emballages
Gestion des emballages
|
Fréquence
|
Pourcentage (%)
|
Abandonner dans la brousse
|
35
|
62,5
|
Enterrer dans le champ
|
12
|
21,42
|
Réutiliser pour acheter de l'essence
|
9
|
16,07
|
Total
|
56
|
100
|
|
Source DEGUENON novembre 2018 Conclusion
partielle
Le peuplement de Sèmè-Kpodji a
été réalisé par différents courants
migratoires, répartis inégalement en six arrondissements dont
Ekpè où se situe notre zone d'étude est le plus
peuplé, à dominance d'activités économiques
maraîchères favorable à une demande plus accrue de produits
maraîchers incluant une utilisation massive des pesticides et engrais
chimiques à cause de ses sols inaptes à l'agriculture. Selon
Zossou (2004), l' adoption de la méthode de lutte des extraits naturels
connaît des problèmes à cause de l' exigence en temps et en
travail proportion non négligeable de maraîchers confirment l'
efficacité de ces extraits botaniques notamment ceux à base de
graines de neem dans la lutte phytosanitaire.
Les maraîchers utilisent l' un et ou l' autre de ces
produits phytosanitaires en fonction de leur disponibilité, de leur
efficacité, du type de culture, de la grandeur des superficies
cultivées et de l' ampleur des dégâts causés par les
insectes. Certains maraîchers s' emploient à combiner les extraits
botaniques avec des insecticides chimiques. Donc les intrants chimiques sont
utilisés de façon incontrôlée, aucun des
maraîchers n'est bien protégé, un peu petit nombre respecte
le délai de carence et les emballages vides sont très mal
gérés.
Tout ceci nous conduit à aborder le troisième
chapitre
38
CHAPITRE III : RESULTATS, DISCUSSIONS,
ET
PERSPECTIVES
3.1. Résultats
3.1.1. Types de pesticides chimiques utilisés dans
la production des légumes
Tableau 10 : Types de pesticides chimiques
utilisés dans la production des légumes et le prix
moyen
Pesticide utilisé
|
Matière active
|
Famille
|
Prix moyen du pesticide (fcfa)
|
Tihan 1760-
TEQ
|
Flubendiamide+ Spirotetramate
|
Kétoénoles
|
6000
|
Lamdacal P212 EC
|
Lambdacyhalothrine+ profenofos 200
|
Pyréthrinoïde+Organophosphoré
|
3000
|
Acarius 18
EC
|
Abamectine
|
Acaridae
|
7500
|
Emacot Fort
|
Emamectine Benzoate
|
Avermectines
|
3000
|
Pacha 25 EC
|
Acetamipride+ Lambdacyhalothrine
|
Néonicotinoide+Pyréthrinoide
|
3000
|
Laser 480 SC
|
Spinosad
|
Néonicotinoide
|
1200
|
Cypercal P
330 EC
|
Cyperméthrine
|
Pyréthrinoïde
|
4000
|
Coga 80 WP
|
Carbendazim
|
Benzimidazole
|
800
|
Dursban B-
200/18 EC
|
Cyfluthrine+ Chlorpyriphosethyl
|
Pyréthrinoide+Organophosphoré
|
5500
|
Alphacal p318 EC
|
Alphacyperméthrine+ Profénofos
|
Pyréthrinoide
|
6000
|
Capt 88 EC
|
Acétamipride+ Cyperméthrine
|
Néonicotinoide+Pyréthrinoïde
|
5500
|
Cotofan 350
EC
|
Endosulfan
|
Cyclodiène
|
4000
|
Calfos 500
EC
|
Profénofos
|
Organophosphorés
|
6000
|
Sunpyrifos 48 EC
|
Chorpyrifos-Ethyl
|
Organophosphorés
|
6500
|
Duel 336 EC
|
Profénofos+cypermét
hine
|
Organophosphorés+ Pyréthrinoide
|
7000
|
Polytrine 186 EC
|
Cyperméthrine+ profénofos
|
Pyréthrinoide+ Organophosphorés
|
7500
|
Conpyrifos 48 EC
|
Chlorpyrifos
|
Organophosphorés
|
6000
|
Dimex 400
EC
|
Diméthoate
|
Pyréthrinoïde
|
5500
|
Cyper-d
|
Cyperméthrine
|
Pyréthrinoide
|
4000
|
Decis 15 EC
|
Deltaméthrine
|
Pyréthrinoïde
|
3500
|
|
39
Sunhalothrin 25 EC
Lambda-cyhalothrin
|
Pyréthrinoide
|
3000
|
Clear 25 EC
|
Lambda-cyhalothrin
|
Pyréthrinoide
|
3000
|
Lambda finer 25 EC
|
Lambda-cyhalothrin
|
Pyréthrinoide
|
3000
|
Thunder 145 o - teq
|
Betacyfluthrine+ Imidacioprid
|
Pyréthrinoide+ Néonicotinoide
|
4500
|
Cypadem 43.6 EC
|
Dimethoate+ cypermethrin
|
ND
|
3000
|
Kinikini
|
Cyfluthrine+ malathion
|
Pyréthrinoide+Organophosphorés
|
7000
|
Celphos
|
Phosphure d'aluminium
|
ND
|
6000
|
Cydim c 50
|
Cyperméthrine
|
Pyréthrinoïde
|
5000
|
Cypalm50 EC
|
Cyperméthrine
|
Pyréthrinoïde
|
1000
|
Topsin-M
|
Méthylthiophanate
|
Benzimidazole
|
3000
|
|
Source : DEGUENON, décembre 2018
Le tableau 10 présente les différents pesticides
chimiques utilisés par les maraîchers enquêtés pour
combattre les bio-agresseurs et leur prix moyen et la liste n'est pas
exhaustive.

Planche 3 : Flacons de pesticides Lambda,
Tihan, Duel, Alphacal .... Source : DEGUENON, décembre 2018
Les matières actives des pesticides utilisés par
les maraîchers appartiennent aux classes II et III de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) (Pesticides Properties Data Base).
40
Ces matières actives ont été
complétées par leurs valeurs toxicologiques de
référence comme la Dose Journalière Admise (DJA), la Dose
de Référence Aigüe (ARfD) et le Niveau d'Exposition
Acceptable de l'Opérateur (AOELA).
Tableau 11 : Distribution des
matières actives de pesticides, leur classification selon l'OMS ainsi
que leurs valeurs toxicologiques de références selon Pesticides
Properties Data base
Pesticides
|
Pourcentage Valeurs toxicologiques de références
de pesticides
|
|
Global
|
Classe de Danger OMS
|
DJA(mg/ kg/pc/j)
|
ARfD( mg/kg/ pc/j)
|
AOEL(mg/ kg/pc/j)
|
Abamectine (Av)
|
2,2
|
3,8
|
II
|
0,0025
|
0,0025
|
-
|
Mancozèbe (Carb)
|
4,4
|
3,3
|
II
|
0,05
|
0,6
|
0,035
|
Emamectine benzoate ( Av)
|
1,1
|
1,1
|
II
|
-
|
-
|
-
|
Cyperméthrine (Pyr)
|
1,1
|
3,8
|
II
|
0,05
|
0,2
|
0,06
|
Spinosad (Spi)
|
23,3
|
16,9
|
II
|
0,024
|
0,1
|
0,013
|
Profénofos (Op)
|
12,2
|
10,9
|
II
|
0,03
|
1
|
-
|
Lambdacyhalothrine (Pyr)
|
23,3
|
31,7
|
II
|
0,0025
|
0,005
|
0,00063
|
Acétamipride (Néo)
|
16,7
|
14,2
|
II
|
0,025
|
0,025
|
0,07
|
Spirotétramate (Két)
|
4,4
|
3,3
|
III
|
0,05
|
1
|
0,05
|
Flubendiamide (Dia)
|
4,4
|
3,3
|
III
|
0,017
|
0,1
|
0,006
|
Chlorpyrifoséthyl (Op)
|
3,3
|
3,8
|
II
|
0,001
|
0,005
|
0,001
|
Cyfluthrine (Pyr)
|
3,3
|
3,8
|
III
|
0,003
|
0,02
|
0,02
|
|
Source : OMS : Organisation Mondiale de la Santé - DJA :
Dose Journalière Admise - ArfD : Dose de Référence
Aigüe - AOEL : Niveau d'Exposition Acceptable de l'Opérateur.
3.1.2. Quantité de pesticides à l'hectare
pour décembre 2018 à Sèmè-Podji
Cette quantité est l'un des indicateurs qui
reflète le risque potentiel d'une matière active
contenue dans une formulation commerciale donnée.
Les données statistiques de calcul de cette
quantité figurent en annexe (ATDA, 2018).
Selon ATDA 2018 pour le mois de décembre 1062 l de
pesticides (herbicides 20 l + insecticides 1042 l) ont traité 17
légumes sur 70,3 ha.
Soit Qpd la quantité de pesticide utilisée pour le
mois de décembre
Qpd = 1 l x 1062 / 70,3 = 15,1066l
Par an Qpd = 1l x 15,1066 x 12 =181,2792 l
Pour 15 ans Qpd = 1 l x 181,2792 x 15 = 2719,188 l
Pour les 80 ha en 15 ans Qpd = 1 l x 2719,188 x 80 = 217535,04
l
41
De façon objective, nous pouvons dire que toute cette
quantité de pesticides se retrouve dans notre sang par diverses voies
telles que : les aliments, l'eau aux multiples usages, et l'air. Aucun de ces
pesticides n'est sans effet sous toutes les conditions d'exposition.
Comme le mentionnait Paracelsus, il y a plus de 400 ans
Ø « toutes les substances sont toxiques, il n'y a
aucune qui n'est pas toxique. C'est la dose qui fait la différence entre
une substance toxique et un remède». Or aucune dose n'est
respectée par les maraîchers, c'est le résultat qui compte
pour eux quelque soit le conseil. Ce qui fait que les légumes au lieu
d'être des vitamines sont devenus toxiques pour notre santé.
Puisque la dose létale est sous forme huileuse et se
cumule petitement à un seuil qui tue sans préalable. Donc deux
facteurs sont essentiels pour définir l'impact potentiel d'une
exposition à une substance chimique :
Réponse (effet) = concentration x temps
Ø Dose létale : est la dose
à laquelle un pourcentage donné d'une population donnée
décède. Elle est unité de masse de substance par masse
corporelle (g/kg) puisque la résistance est variable d'un individu
à l'autre (
fr.wikipédia.org),
l'indicateur le plus utilisé est la dose létale 50 ou (DL50).
Pour exemple voilà des doses létales de quelques
produits
Doses létales de produits pouvant entraîner la mort
d'un homme de 70 kg :
. alcool 90° : 500g
. sel de table : 225g
. ibuprofène 600 : 30g
. pesticides : non déterminé
. engrais : non déterminé
3.1.3. Quantité de pesticides à l'hectare
par cycle de production d'un légume feuille Prenons le cas d'un
légume de cycle de production de un mois
Soit Qp la quantité de pesticides, pl la planche et T le
traitement 1 ha = 1000 planches, 1 pulvérisateur = 16 litres d'eau
42
Premier traitement (T1) de la première semaine : 30 ml
pour 40 planches Quantité de pesticide par planche
Qp1 = 1 ml x 30/40 = 0,75 ml
Deuxième traitement (T2) de la deuxième semaine :
30 ml pour 40 planches
Qp2 = 1 ml x 30/40 = 0,75 ml
Troisième traitement (T3) de la troisième semaine
: 50 ml pour 40 planches
Qp3 = 1 ml x 50/40 = 1,25 ml
Quatrième traitement (T4) de la quatrième semaine
: 50 ml pour 40 planches
Qp4 = 1 ml x 50/40 = 1,25 ml
Qp = Qp1 + Qp2 + Qp3 + Qp4 = 1 ml x (0,75 + 0,75 + 1,25 + 1, 25)
= 4 ml
Qp = 4 ml / mois /planche
Quantité de pesticide par hectare par mois
Qha = 1 ml x 4 x 1000 = 4000 ml = 4 l
Qha = 4 l / mois / planche / légume / hectare
VIMAS fait 80 hectares
Qha = 1l x 4 x 80 = 320 l
Qha = 320 l / mois / 80 hectares
Quantité de pesticide par hectare par an
Qha = 1l x 320 x 12 = 3840 l
Qha = 3840 l / an / hectare
VIMAS a été créé en 2004, donc Qha =
1l x 3840 x 15 = 57600 l
Qha = 57600 l / 15 ans / hectare
Pour les 80 hectares pour 15 ans on aura:
Qha = 1l x 57600 x 80 = 4 608 000 l
43
Qha = 4 608 000 l / 15 ans / 80 hectares / cycle de
production d'un légume Pour 1a culture de 10
différents légumes nous aurons :
Qha = 1l x 57600 x 80 x 10 = 46 080 000 l
Qha = 46 080 000 l / 15 ans / 80 hectares / cycle de
production de 10 légumes
VIMAS a environ 240 maraîchers, si un maraîcher
cultive au moins dix (10 ) de légumes par mois, nous aurons :
Qha = 1l x 57600 x 80 x 10 x 240 = 1,1059200E10
Qha = 1,1059200E10 l / 15 ans / 80 hectares / cycle
de production de 10 légumes / 240 maraîchers
3.1.4. Quantité de pesticides par planche par cycle
de production du chou cabus Soit Qp la quantité de pesticides, pl la
planche et T le traitement
Tihan = 0,02 l / pl
Biobite = 0,00125 l / pl
Pacha = 0,005 l / pl
Lambda = 0,005 l / pl
Super gros = 0,005 l / pl
Pour le 1er mois de traitement nous aurons : 0,01208
l pl / T.
Pour le 2ème mois de traitement nous aurons :
0,03625 l /pl / T
Pour le 3ème mois de traitement nous aurons :
0,021 l / pl / T
Le traitement est fait tous les 3 jours, par mois il fait 10
traitements, donc nous aurons :
1er mois de traitement Qp = 0,1208 l pl / T.
2ème mois de traitement Qp = 0,3625 l /pl / T
3ème mois de traitement Qp = 0,21 l / pl / T
Qp = 0,6943 l / pl / T / cycle de production
Qp = 2,7772 l / pl / T / an
44
Qp = 41,658 l / pl /T / 15 ans
Qp = 694,3 l / hectare / cycle de production
Qp = 55544 l / 80 hectares
Qp = 833160 l / 80 hectares / 15 ans
Si un maraîcher cultive une planche de chou cabus par
cycle de production on aura :
Qp = 240 x 0, 6943 l = 166,632 l / pl / T / cycle de
production
Qp = 166632 l / pl / T / cycle de production du chou /
hectare
Soit N le nombre de planches de chou cultivés par un
maraîcher pour le cycle de production
Qp = 166,632 l / pl x N / T / cycle de production / chou
/ maraîcher
Qp = 666,528 l / pl / T / an
Qp = 666528 l / hectare / cycle de production
En récapitulatif les indicateurs de risques sont :
Qp = 166632 l / pl / T / cycle de production du chou /
hectare
Qha = 4 l / mois / planche / légume /
hectare
3.1.5. Quantité de pesticides par pied du chou
cabus par cycle de production Une planche de chou contient 40 pieds de chou
Soit pd le pied du chou et xc la quantité de pesticide
utilisée par le pied du chou xc = 0,6943 l / 40 = 0,017 l
xc = 0,017l / pd
3.1.6. Quantité de pesticides par consommateur par
mois par pied du chou cabus soit 1pd / consommateur /mois
Qp = 0,017 l
3.1.7. Quantité de pesticides par consommateur par
an du chou cabus Qp = 0,208 l
3.1.8. Quantité de pesticides par consommateur du
chou cabus en 15 ans Qp = 3,12 l
45
3.1.9. Quantité de pesticides par consommateur du
chou cabus en 50 ans Qp = 10,4 l
3.1.10. Quantité de pesticides par pied d'amaranthe
par cycle de production 4 ml pour 125 pieds, xml pour un pied
x ml = 1 ml x 4 / 125 x ml = 0,032 ml
Soit Qa cette quantité Qa = 0,032 ml
/pied
3.1.11. Quantité de pesticides par consommateur par
pied d'amaranthe en un mois Si un consommateur consomme un pied d'amaranthe par
semaine
Qa = 1 ml x 0,032 x 4
Qa = 0,128 ml /consommateur / mois
3.1.12. Quantité de pesticides par consommateur
par pied d'amaranthe en un an Qa = 1,66 4 ml
3.1.13. Quantité de pesticides par consommateur
par pied d'amaranthe en 15 ans Qa = 24,96 ml
3.1.14. Quantité de pesticides par consommateur
par pied d'amaranthe en 50 ans Qa = 83,2 ml
Il n'y pas une firme spécialisée dans la mise
en forme spécialisée pour les pesticides dans le
maraîchage. Ce qui fait que les maraîchers utilisent les produits
du coton qui ne sont pas du tout conseillés pour les
légumineuses. Beaucoup utilisent le Pacha, un insecticide utilisé
dans la culture du niébé mais que les maraîchers utilisent
souvent dans les cultures maraîchères.
Par ailleurs, en termes de fréquence, les insecticides
arrivent nettement en tête dans les préférences 100 % des
maraîchers interrogés les placent en première position.
3.1.15. Types de pesticides organiques utilisés
dans la culture des légumes Tableau 12 : Types de pesticides
organiques utilisés dans la culture des légumes
Pesticides
|
Matière active
|
Famille
|
Prix moyen
|
Huile de neem
|
Extrait de neem
|
Nd
|
3500
|
|
Source : DEGUENON, décembre 2018
46
Le tableau 12 présente le pesticide organique et le prix
moyen utilisé par les maraîchers enquêtés pour
combattre les bio-agresseurs.
Le pesticide organique huile de neem utilisé par les
maraîchers enquêtés pour combattre les bio-agresseurs laisse
un goût amère dans le légume lorsque c'est ce seul
insecticide qui a traité le légume durant son cycle de
production. Ceci repousse les maraîchers à son utilisation.
D'où la forte utilisation systématique des pesticides
chimiques
3.1.16. Différents types d'engrais chimiques
utilisés par les maraîchers
Le NPK est utilisé par 100% des maraîchers contre
89,28% qui utilisent l'urée. Par contre
3,57% utilisent fertiplus et 1,78% utilisent callifert (tableau
13).
Tableau 13 : Différents types d'engrais
chimiques utilisés par les maraîchers
Engrais utilisés
|
Nombre de fois cité
|
Pourcentage (%)
|
Le prix moyen/sac
50kg
|
NPK
|
56
|
100
|
18000
|
Urée
|
50
|
89,28
|
12000
|
Fertiplus
|
2
|
3,57
|
6000
|
Callifert
|
1
|
1,78
|
8000
|
|
Source : DEGUENON, décembre 2018
3.1.17. Différents types d'engrais organique
utilisés par les maraîchers
100% des maraîchers utilisent la fiente de volaille, bouse
de vache (3,57%), fècès de moutons
(10,71% ) et compost (1,78% ) (tableau 14).
Tableau 14 : Différents types d'engrais
organique utilisés par les maraîchers.
Engrais utilisés
|
Nombre de fois cité
|
Pourcentage(%)
|
Le prix moyen
|
Fiente de volaille
|
56
|
100
|
1500
|
Bouse de vache
|
2
|
3,57
|
500
|
Fècès de moutons
|
6
|
10,71
|
-
|
Compost
|
1
|
1,78
|
1500
|
Tourteau de neem
|
0
|
0,0
|
1500
|
|
Source : DEGUENON, décembre 2018
Le principal moyen de lutte contre les ravageurs est
l'utilisation de pesticides chimiques. La majorité des maraichers ne
semblent pas avoir une grande connaissance des matières actives et des
doses à utiliser en fonction des superficies à traiter à
cause de leur faible niveau d'instruction et d'un manque d'encadrement
adéquat. Les maraîchers estiment ces produits très
coûteux mais affirment qu'ils sont efficaces. Le recours aux produits
destinés à traiter le coton notamment l'endosulfan (produit
très toxique de la famille des organochlorés) est effectué
dans ce cas, puisqu'ils sont moins onéreux. Cependant, les produits
47
homologués pour les cultures maraichères ne sont
pas toujours disponibles dans les centres de promotion agricole. Les maraichers
ne bénéficiant d'aucune subvention font de leur mieux pour avoir
de belles récoltes afin de les commercialiser.
La plupart des maraichers, environ 50 sur les 56
interrogés, affirment ne plus avoir une connaissance sur le mode
d'action précis des produits qu'ils utilisent. Ils
prétendent ne plus rien maîtriser, parce que les produits ne sont
plus efficaces comme avant, alors là ils ne savent plus quoi faire
exactement. Et donc, ce qui est recherché, c' est le résultat ;
peu importe le type d'emballage, la couleur et l'aspect du produit. Alors nous
devons communiquer et former ces maraîchers à choisir le bon
produit pour amoindrir les dégâts dans un monde de contrefaits.
L'équation la plus difficile à résoudre
concernant l' usage des pesticides a été de trancher sur comment
les mélanges de pesticides se font. C' est une question
compliquée, ils ne peuvent pas dire exactement comment ils
mélangent les produits. Ils le font selon le niveau d'attaque des
plants, de la quantité de produit dont ils disposent, des produits qui
existent en ce moment sur le marché, de leur capacité
financière etc... Aucun des maraichers interrogés sur cet aspect
n'a pu fournir d'informations précises. L' observation nous a permis de
constater que, le même maraicher pour la même culture, en face du
même ravageur, peut soit utiliser les mêmes produits à des
doses différentes, soit utiliser carrément d'autres produits,
soit faire d'ajout aux précédents. Néanmoins, même
si on ne peut pas statuer sur les mélanges de produits, il y a les
produits tels que « LAMBDA FINER® 25 EC », « PACHA® 25
EC », « LASER® 480 SC » « EMACOT FORT » qu'on
retrouve systématiquement dans tous les mélanges faits par la
majorité des maraichers enquêtés.

Planche 4 : Préparation d'un
mélange de Suncozèbe et d'Acarius à VIMAS Source :
DEGUENON, décembre 2018

48
Photo 2 : prise de vue de Daleb reprise
par DEGUENON, décembre 2018
Selon les maraîchers, pour renforcer l'efficacité
du produit, il doit être utilisé en mélange. Cette pratique
évite de faire plusieurs passages d'épandage et de ce fait permet
de gagner en temps.

Planche 5 : Pulvérisation de pesticides
dans un champ de poivron à VIMAS Source : DEGUENON, décembre
2018
Le principal mode d'utilisation des pesticides est
l'épandage par le pulvérisateur. L'arrosoir est utilisé
rarement par certains. L'épandage est fait souvent très tôt
le matin ou le soir. La raison évoquée est que l'action du soleil
ambiant associé au produit pourrait griller la plante.
Les pertes occasionnées par les ravageurs sont parfois
extrêmement importantes, de sorte qu'il est courant, pour les
éviter, de traiter les cultures au moyen de pesticides sans guère
se préoccuper des quantités utilisées. En pareil cas, la
teneur en pesticides peut être élevée, quand on
procède à des traitements peu avant la récolte. Alors que
ces légumes sont directement mis sur le marché après
traitement, après un simple lavage.
3.1.18. Quantité de pesticides nécessaire
à la production de certaines cultures
Le classement des cultures a été
complété par la quantité de pesticides que
nécessite la production de chacune des cultures afin d'avoir une
idée plus ou moins claire des
49
doses de pesticides utilisés par les maraîchers.
Pour ce fait, il a été procédé au calcul des
volumes
Tableau 15 : Volumes de pesticides
utilisés lors de la production de certaines cultures
Cultures
|
Durée de cycle (semaine)
|
Nombre moyen d'application
|
Volume solution concentrée (1/ha)
|
Chou
|
12
|
15
|
45
|
Carotte
|
10
|
2
|
15
|
Laitue
|
4
|
3
|
28
|
Grande morelle
|
10
|
9
|
35
|
Amaranthe
|
12
|
5
|
15
|
Vernonia
|
11
|
2
|
8
|
|
Houéyissan, 2006
De l'analyse de ce tableau, nous retenons que le chou, la
grande morelle, la laitue, la carotte, l'amarante et le vernonia et surtout les
deux premières cultures nécessitent une importante
quantité de pesticides pour leurs productions. Par ailleurs ces
résultats sont proches de ceux obtenus par Adisso (2005) James, B. et al
(2005). En effet, les travaux de James, B et al (2005) portent sur les
fréquences et les volumes de pesticides appliqués au cours de la
production maraîchère en zone urbaine et périurbaine au
Sud-Bénin et les résultats sont les suivants
Tableau 16 : Fréquences des applications
de pesticide
Spéculation
|
Période de culture avant récolte (semaine)
|
Nombre d'application avant la récolte
|
Total nombre d'application
|
|
|
Décis
|
Talstar
|
Manèbe
|
Furadan
|
|
Chou
|
12
|
7
|
-
|
-
|
12
|
19
|
Gboma
|
10
|
5
|
2
|
2
|
3
|
12
|
Laitue
|
4
|
-
|
2
|
2
|
-
|
4
|
Carotte
|
10
|
1
|
-
|
-
|
2
|
3
|
Amarante
|
12
|
1
|
1
|
-
|
-
|
2
|
Concombre
|
8
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Source: James B. et al, 2005
Il ressort de cette étude que les maraîchers
utilisent 45,8 litres de concentrés de pesticide en 19 applications pour
un hectare de chou en trois (3) mois de culture : 12 applications de Talstar et
7 de Decis par planche de chou pour lutter prioritairement contre les larves de
Plutella Xylostella L. (Lépidoptère: Yponomeutidae) et Hellula
undalis L. (Lépidoptère: Pyralidae). Le gboma quant à lui,
reçoit 41,8 litres de pesticide par hectare
50
de culture en 12 applications en trois (3) semaines de culture
avant la récolte. La laitue, la carotte, l'amarante et le concombre
reçoivent respectivement 26,9 1; 17,41; 10,51 et 71 de concentré
de pesticide. Les résultats de cette étude prouvent effectivement
que le chou et le gboma sont les principales cultures dont les productions
nécessitent une importante utilisation de pesticide. Des études
ont montré qu'en maraîchage, les doses de pesticides
utilisés sont de 2 à 3 fois supérieures aux doses
recommandées ( Dossa et al, 2000 ; Tallaki, 2001 cités par
Adisso, 2005).
En général tout ce qui est chimique est
destiné aux produits de transformation tels que le coton par exemple.
Normalement les produits chimiques ne sont pas destinés au
maraîchage parce que les produits maraîchers ne doivent pas aller
au feu, ils sont directement à croquer tels que la carotte, le
concombre, la laitue...par exemple. Pour le cas de maïs consommé
frais tous les produits chimiques sont dedans et rentrent dans le sang pour
donner du cancer, mais séché une bonne partie des produits
chimiques est détruite par les rayons solaires. Par ailleurs les
produits chimiques même après cueillette continuent de travailler,
c'est ce qui fait pourrir les légumes. Le légume conventionnel se
développe rapidement (2 mois contre 3 mois) et pourrit aussi très
vite 3jours contre 5 jours.
3.1.19. Engrais minéraux
On distingue plusieurs types d'engrais minéraux :
V' Les engrais azotés qui contiennent de l'azote
;
V' Les engrais phosphatés qui contiennent du
phosphore ; V' Les engrais potassiques qui contiennent du
potassium.
Les principaux engrais les plus utilisés en
maraîchage au Bénin sont : NPK, Urée (46% d'azote), Sulfate
de potassium (45% de potassium).
3.1.20. Quantité d'engrais minéral
à l'hectare par cycle de production d'un légume
feuille
Y2 kg d'NPK + Y2 kg d'urée pour 10 planches
0,1 kg pour 1 planche 0,0008 kg pour un pied
Pour 1000 planches, soit Qe cette quantité
Qe = 1 kg x 0,1 x1000 = 100 kg / ha
D'après les données statistiques du rapport
d'activités de la Cellule Communale de Sèmè-Podji (ATDA,
12/2018).
51
Qe = 1 tonne x 3,5 +5,5 = 9 tonnes = 9000 kg
Soit cs le cumul de superficie emblavée pour le mois de
décembre Cs = 70,3 ha
Qe = 128,02 kg / NPK + UREE / ha / décembre 2018
Cette quantité montre qu'il y a un excédent
d'engrais à la normale et prouve l'utilisation massive des fertilisants
minéraux dans le maraîchage à Sèmè-Podji.
Ceci est un indice de risque sanitaire parce que tout produit chimique
même à une faible dose est toxique et nuisible. En outre le
produit reste dans la sève de la plante et migre vers les fruits et le
résidus se retrouve dans l'aliment. Par conséquent la dose
létale par rapport au poids corporel des individus est sous forme
huileux (liquide) et l'élimination est difficile, ces graisses bouchent
les artères et le sang ne peut pas circuler, cela peut être source
d'une tension artérielle ou d'un infarctus (crise cardiaque).
Ceci est aussi un indice de risque environnemental car les
engrais chimiques détruisent l'humus du sol, dégradent la terre
au point de la rendre compacte, incapable d'absorber l'eau de pluie, ce qui est
une catastrophe, cela conduit à des inondations même en saison
sèche (claude Bourguignon, 2013)
Ø 150 - 200 kg / ha de NPK est recommandé en
fumure de fond 2 semaines après la levée et l'Urée 50 kg /
ha appliqué généralement 40 jours après la
levée pour les cultures vivrières exemple le maïs. Mais ces
engrais en fumure de fond avant le semis en demi dose 50 kg au lieu de 100 kg
pour les légumineuses comme l'haricot pour des sites très faibles
est déconseillé mais très pratiqué par les
maraîchers à cause du sol très faible, si non les haricots
verts captent l'azote de l'engrais du sol.
Ø les engrais potassiques contiennent le sulfate de
potassium (45 %), c'est comme l'urée 50 kg / ha.
Selon l'ATDA pour le mois de décembre 9000 kg d'NPK et
d'Urée ont traités 17 légumes sur 70,3 ha, ce qui revient
à 128,02 kg d'NPK et d'Urée à l'hectare. Or la
quantité recommandée devrait être inférieure
à 50 kg, donc les 78,02 kg sont en excès et constituent un indice
de risques sanitaires et environnemental.
3.1.21. Mode d'utilisation des engrais chimiques
utilisés dans la production des légumes
Le principal mode d'utilisation des engrais chimiques est
l'enfouissement du produit au pied de la plante lors de la floraison et
à une semaine de la maturité.

52
Planche 6 : Urée dans la main d'un
garçon et NPK enfouis aux pieds des plantes de tomates par un
maraîcher à VIMAS.
Source : DEGUENON, décembre 2018
3.1.22. Mode d'utilisation des engrais organiques
utilisés dans la production des légumes Le principal
mode d'utilisation des engrais organiques est le mélange du sable avec
la bouse
de vache pour retenir l'eau (fumure de fond) et fiente de
volaille à déposer aux pieds des plantes (fumure d'entretien),
comme l'indique la photo 3 ci-dessus.

Photo 3 : Fientes de volaille
étalées aux pieds des plantes de chou Source : DEGUENON,
décembre 2018
53
3.1.23. Répartition des maraîchers en fonction
des méthodes de lutte utilisées
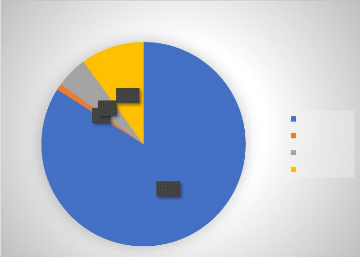
1%
5%
techniques de lutte
10%
84%
conventionnel bio
intégrée intégrée
Figure 11 : Différentes techniques de
lutte contre les ravageurs Source : DEGUENON, décembre 2018
La figure 11 montre que 84% font du conventionnel, 1% fait du
bio, 5% et 10% font les deux (agriculture intégrée). Et cela
s'explique par :
|
Nombre de traitement illimité, autant d'attaque autant de
traitement, car même avec les pesticides les nématodes
résistent et les carottes sont détruites. Encore que même
dans les kiosques, les périmés sont vendus.
A VIMAS tu es obligé de faire du conventionnel parce que
la majorité faire du
conventionnel et si tu es le seul à faire le bio entre
de nombreux conventionnels, tous les ravageurs se ruent sur ton champ et tu
travailles à perte ; d'où il est contraint avec aussi la vision
et le prix des acheteurs. Et aussi c'est 4m ou une haie de citronnelle
seulement qui sépare un champ bio d'un champ conventionnel, entre 2 bio
ou 2 conventionnels il n'y a pas d'espace. Alors Faire le bio c'est sur
commande, laisser le terrain au moins un an en jachère.
|
3.1.24. Sources d'approvisionnement des pesticides
chimiques
Les circuits d'approvisionnement au niveau local sont multiples
et échappent le plus souvent
au contrôle des autorités chargées de la
règlementation. On en distingue trois : le marché
local, le circuit de producteur à producteur et le
marché international
(l'approvisionnement dans les pays voisins).
54
« Accueil Paysan » est la seule boutique de
fourniture d'intrants (semences et produits phytosanitaires) à
Sèmè-Podji. Ce lieu commercial ne fournissant pas des produits
coton, les maraichers de VIMAS se rabattent sur les fournisseurs de Cotonou et
les vendeurs ambulants pour s'approvisionner. En effet, la responsable de cette
boutique est ingénieur agronome et donc consciente du danger de
l'utilisation de ces produits en maraichage. Les autres vendeurs de ces
produits affirment s'approvisionner surtout au Nigéria, en
Côte-d'Ivoire, au Ghana et au Togo. L'enquête a permis de constater
qu'il y a un détournement de l'utilisation des pesticides. En effet, des
pesticides comme l'endosulfan, massivement utilisé dans la production
cotonnière au Bénin, ont été retrouvés
auprès de plusieurs maraîchers. Et puisque ces produits sont
subventionnés par l'Etat, ils ne coûtent plus chers sur le
marché informel. Ce qui explique en partie la présence de ces
produits avec les maraichers. En outre, plusieurs pesticides utilisés
n'ont pu être identifiés, en raison du fait que ces pesticides
sont mis dans des emballages non étiquetés. Même les
maraîchers interrogés n'ont pas été en mesure de
préciser la nature de ces pesticides, se limitant à dire qu'ils
les ont achetés auprès des vendeurs ambulants venant du Ghana et
où du Togo.

Planche 7 : Une boutique de vente d'intrants
agricoles et des sacs de fientes de volailles à VIMAS
Source : DEGUENON, décembre 2018
3.1.25. Risques liés à l'utilisation des
pesticides et engrais chimiques dans la production des légumes
55
Les pesticides chimiques sont très dangereux à
cause de leur toxicité. Sossou, 2004 a identifié deux
sortes de toxicité :
La toxicité aigüe :
désigne un pesticide provoquant des problèmes de
santé peu après l'exposition. Elle peut se produire par la peau,
le nez, les yeux et les lèvres. Nous pouvons citer : les dermites,
aliments contaminés, troubles respiratoires, troubles de vision,
etc...
La toxicité chronique : désigne
un pesticide entraînant ou augmentant le risque de problèmes de
santé graves après une exposition prolongée ou
répétée. Les effets chroniques les plus
étudiés peuvent être classés en quatre grandes
catégories : les cancers, la réduction de la visibilité,
l'infertilité, le suicide, etc...(Raldi et al., 1998 ; CPP,
2002).
La toxicité chronique est exprimée par la DJA
(Dose Journalière Acceptable). Elle est la quantité de produit
qui peut être consommée chaque jour et durant une vie
entière par un individu sans que cela n'affecte en aucune manière
sa santé. Cependant quelques malaises ont été cités
par les maraîchers (tableau17).
Tableau 17 : Malaises provoqués par
l'utilisation des pesticides
|
Malaises
|
Nombre de fois cité
|
|
Brûlure
|
20
|
|
Démangeaison
|
17
|
|
Toux
|
10
|
|
Faible vision
|
7
|
|
Diarrhée
|
5
|
|
Faiblesse sexuelle
|
4
|
|
Dermatoses
|
8
|
|
Nausée
|
12
|
|
Vomissement
|
17
|
|
Fatigue
|
14
|
|
Rhume
|
10
|
|
Trouble respiratoires
|
9
|
|
Maux d'yeux
|
4
|
|
Diarrhée
|
3
|
|
Vertiges
|
4
|
Source : DEGUENON, décembre 2018.
Il ressort de l'analyse du tableau que les affections
cutanées (peau, yeux, lèvres...) et les troubles gastriques
(nausées, toux, diarrhée, vomissement...) sont les plus
fréquentes malaises cités par les producteurs après usage
des pesticides.
En dehors des affections suscitées les maraîchers
courent encore d'autres risques tels que:
56
Exposition accidentelle : les principales
victimes d'expositions accidentelles aigües aux pesticides sont les
enfants de moins de 5 ans. Exposition professionnelle : les
groupes professionnels susceptibles d'être exposés sont les
agriculteurs et les membres de leur famille qui les aident dans leurs travaux.
Exposition délibérée : l'exposition
volontaire, lors d'une tentative de suicide. Exposition
prolongée dans l'environnement général : Les
principales voies d'exposition de la population générale sont,
par ordre d'importance: l'ingestion (avec les aliments ou l'eau de boisson),
l'inhalation (avec l'air ou les poussières), la résorption
cutanée (par contact direct ou par l'intermédiaire des
vêtements).
En particulier, il est difficile de mettre en évidence
et d'évaluer quantitativement les effets d'un apport régulier de
résidus de pesticides par la voie alimentaire. Il faut voir que, pour la
plupart des pesticides, il n'a pas été possible d'établir
une relation dose-effet (Houeyissan, 2006). Il est remarquable de constater
à quel point on manque de données provenant d'études sur
l'homme.
Ainsi donc, si la contamination des légumes par les
résidus de pesticides à travers les matières actives et
leurs mauvaises applications est à redouter, la consommation de ces
légumes ne semble t-il pas constituer à présent une menace
pour la santé des consommateurs?
Globalement aucune couche de la population
générale n'est à l'abri d'une exposition et de troubles
éventuellement graves, mais les maraîchers constituent une
population à haut risque.
Tableau 18 : Synthèse des impacts
négatifs potentiels de l'utilisation des pesticides
|
Composantes
|
Nature de l'impact
|
|
Sol
|
Baisse de la Fertilité ; Acidification ;
Pollutions (P ; K+ ; Pb ++ ; Zn++ ; Mn++, Métaux lourds)
;
|
|
Eau
|
Pollutions par Nitrates ; Ammonium NH4+ ; Métaux lourds
(Pb, Zn, Mn,) et autres composés toxiques ; pH Eutrophisation ;
|
|
Couvert végétal
|
Déforestation
|
|
Biodiversité
|
Chimiorésistance des ravageurs ; Intoxication de la faune
et de la flore aquatique ; Perte de Biodiversité ;
|
|
Santé humaine
|
Intoxication aigue ; Empoisonnement ; Décès Baisse
du taux de cholinestérase ; Baisse de la fécondité ;
Perturbation du cycle endocrinien.
|
Source : DEGUENON, décembre 2018
57
Pour compenser les carences dues à la nature chimique
et géologique du sol et l'appauvrissement de celui-ci dû à
la surexploitation, à l'érosion hydrique et aux ruissellements,
l' agriculteur a recours à la fertilisation chimique par des apports d'
engrais chimiques aux sols. Ces derniers apportent aux plantes les
éléments nutritifs dont elles ont besoin sous forme d' ions
nitrate NO3-, nitrite NO2-, phosphate PO43- et potassique K+ pour ne citer que
ceux-ci. Ils sont retenus dans le sol par le complexe argilo-humique (CAH),
à l' exception des ions nitrates qui sont très solubles dans
l'eau ; ils se retrouvent facilement dans les eaux superficielles ou
souterraines qu'ils polluent par une élévation de leur
concentration en substances toxiques (Djibril, 2002)
Aussi les engrais ne sont pas chimiquement purs et contiennent
des métaux et métalloïdes toxiques tels que le plomb,
l'arsénic, le cadnium qui peu mobiles contaminent le sol. Les engrais
diminuent la biomasse de la micro faune et la micro flore du sol et donc la
productivité du sol (Edorh A. P., 2016)
3.1.26. Cas recensés en milieu d'étude
Dans le secteur agricole, les groupes professionnels
susceptibles d'être exposés sont les agriculteurs et les membres
de leur famille qui les aident dans leurs travaux (environ 7080%). Il est en
effet courant que la famille tout entière, y compris les enfants et les
personnes âgées, participent aux travaux agricoles.
Le risque d'exposition aux pesticides est encore plus
élevé lors que les maraîchers et leurs familles vivent sur
leur lieu de travail, alors les maraîchers constituent une population
à haut risque (planche 8).

Planche 8 : Résidents permanents et
formulation de pesticides à VIMAS Source : DEGUENON, décembre
2018
58
La planche 8 présente une première photo
où le nourrisson est entrain de sucer ses doigts et aussitôt rampe
(photo 2) et dans la troisième photo le chef de ménage nous
montre des flacons de formulation de pesticides qu'il utilise.
- La cohabitation permanente de ces résidents en
occurrence les enfants encore très fragiles les expose à des
contaminations inévitables qui vulnérabilisent leur santé
et dégradent l'environnement.
- Une maraîchère dont je taire le nom
exposée aux pesticides dans le but de maximiser le rendement de sa
culture en tomate qui lui a rapporté plus de 500.000fcfa à la
récolte. Mais à la fin de la récolte elle est
tombée malade et dépense plus de 600.000fcfa, ce qui l'a fait
reconvertir en agriculture biologique.
3.2. DISCUSSION
3.2.1. Fondements physiques et humains de l'utilisation des
pesticides et engrais chimiques pour la culture des légumes
De sables fins inaptes aux activités agricoles favorisent
l'utilisation des intrants chimiques
pour la culture des légumes. La majorité des
maraîchers enquêtés sont âgés de 15 à 45
ans, ceci montre le rôle important que joue la jeunesse dans la
production maraîchère. La promiscuité des unités de
production peut faciliter la contamination des légumes par les
traitements des champs voisins et être une source de maladies fongiques
et d'infestations de nématodes nécessitant une augmentation des
protections phytosanitaires. Ceci pourrait entraîner un appauvrissement
des sols par excès de fertilisants chimiques. Le maraîchage dans
la Commune de Sèmè-Podji mobilise des hommes que de femmes. Cette
prédominance pourrait être liée aux efforts et contraintes
que nécessitent cette filière à savoir préparation
du sol, achat des intrants et traitements de pesticides. Ce constat corrobore
les résultats des travaux menés par Daleb Alfa (2014) au
Bénin et Toé, M.A., 2007 au Burkina Faso. Les maraîchers
sont en majorité analphabètes, ceci pourrait constituer un
obstacle à la bonne connaissance des conditions d'utilisation des
pesticides et engrais chimiques d'autant que les étiquettes sont
écrites en langues étrangères (français, anglais et
allemand). Les travaux de Wade (2003) recensent un taux d'analphabétisme
de 65% parmi les maraîchers de Mboro, et 55% des maraîchers de
Thiès au Sénégal. Toé A. (2007) rapportent dans ces
études au Burkina Faso que l'analphabétisme des agriculteurs ne
leur permet pas de comprendre la signification des pictogrammes et des
informations inscrites sur les étiquettes des flacons des produits
phytosanitaires.
59
3.2.2. Utilisation des pesticides
Les matières actives de pesticides citées par
les maraîchers correspondent aux matières actives de pesticides
autorisés en maraîchage par le Comité Sahélien des
Pesticides. Néanmoins, leur utilisation non maîtrisée peut
être source de nuisances pour la santé et l'environnement
(Hallenbeck, 1985 ; Cohen, 2007). Agbohessi et al. (2014) ont rapporté
la contamination des bassins situés à proximité des champs
de coton au nord du Bénin par des résidus de pesticides comme le
DDT, l'endosulfan, le lindane et l'heptachore. Ces derniers avaient des effets
toxiques sur les poissons qui vivaient dans ce bassin. Des études
réalisées sur les agriculteurs de la Thaïlande
exposés de façon chronique à des mélanges de
pesticides ont révélé des effets toxiques sur leurs
systèmes hématologique, immunitaire et nerveux (Aroonvilairat et
al., 2015 ; Worapitpong et al., 2017). La dose de pesticides à utiliser
pour une superficie de champ est indiquée sur la notice de chaque
produit. Le fait de surdoser les pesticides lors du traitement, peut entrainer
la contamination des légumes ainsi que les compartiments de
l'environnement (sols, nappe phréatique, air, etc.) (Agnandji et al.,
2018)
Les maraîchers interrogés déclarent
traiter leurs cultures le plus souvent à titre préventif, ce qui
protège les plantes contre les nuisibles et leur permet de croître
normalement. La majorité des exploitants ont affirmé traiter
leurs cultures chaque semaine et le plus souvent deux fois par semaine. Les
maraîchers qui traitent les plantes à cette fréquence
seraient plus exposés aux pesticides que ceux qui font des traitements
à titre préventif ou une fois par quinzaine et en cas d'attaque.
La pulvérisation est la seule méthode d'application de pesticides
chez les maraîchers enquêtés. C'est la méthode qui
est aussi utilisée par la majorité des maraîchers du Togo
(Kanda et al., 2013). Le pulvérisateur n'est pas un outil à la
portée de tous les maraîchers africains. C'est ainsi que certains
maraîchers utilisent des rameaux réunis sous forme de balais ou
des arrosoirs pour réaliser la pulvérisation (Sougnabé et
al., 2010).
On a noté une diversité culturale dans le
maraîchage à Sèmè-Kpodji, la production est
destinée à la commercialisation et l'exportation vers les
marchés de Cotonou et du Nigéria. Ceci justifie la
prédominance des cultures commerciales génératrices de
revenus telles que le concombre ( Ecballium elaterium), la tomate (lycopersicon
esculentum), le poivron (Capsicum annum) et l'haricot vert (Phaseolus
vulgaris). L'enjeu commercial explique le fait que les maraîchers
procèdent à une protection intensive des cultures pour lutter
contre les ravageurs et accroître leur productivité. Les
insecticides sont systématiquement utilisés par les
maraîchers, les fongicides sont souvent utilisés en cas d'attaque
des champions. En effet on a recensé trente préparations
commerciales, quarante matières actives et trente-six familles de
60
pesticides. Les pyréthrinoïdes, les
organophosphorés suivi des Acaridae et des Avermectines
représentés respectivement par le Cyperméthrine, le
Chlopyriphos éthyl, l'Abamectine, et Emamectine benzoate sont largement
utilisés en cultures maraîchères. Le grand problème
des pesticides réside dans leur libre commercialisation.
Malgré les règlementations en vigueur sur la
commercialisation des pesticides au Bénin, on assiste à un
désordre dans l'application des textes et ça se traduit par une
multiplication des commerçants vendant divers produits souvent
inadaptés, interdits d'usage ou périmés. Certains
pesticides à base d'endosulfan et l'alphacal dont l'usage est
réservé à la culture du coton sont fréquemment
utilisés dans le maraîchage à Sèmè-Kpodji.
Les organochlorés autres que l'endosulfan n'ont pas été
recensés. Le manque de contrôle dans la commercialisation se
traduit également par diverses reformulations chez les utilisateurs.
Aussi les quantités de pesticides et d'engrais utilisées ne sont
pas souvent respectées. Ceci peut se traduit par la présence de
résidus dans les compartiments de l'environnement. Liliana, 2007 affirme
que les cultures sols et eaux souterraines sont exposés à des
dosages massifs d'engrais chimiques qui modifient leur milieu et rendent l'eau
non potable. Pazou, et al (2006a) ont décelé des teneurs de
résidus d'organochlorés dépassant les limites maximales de
résidus dans les sédiments prélevés le long du
fleuve Ouémé au Bénin.
L'usage des pesticides requiert des moyens de protection pour
assurer la sécurité des utilisateurs. A ce niveau on remarque que
très peu de maraîchers observent les règles
d'hygiène après les traitements phytosanitaires et qu'aucun des
maraîchers ne dispose d'un équipement complet de protection
(tableau 6). Ceci corrobore les résultats des travaux de Wade (2003).
Aussi le manque de matériels de protection augmente les risques
d'intoxication et les expose à divers malaises susceptibles d'être
induits par les pesticides comme des troubles dermatologiques, neurologiques,
immunologiques, respiratoires, digestifs, de cécité et des
cancers....etc (Samborn et al., 2004; Sousa passos, 2006)(tableau 17). La prise
de lait par certains selon Assogba k., (2007) qui a
décelé des teneurs de résidus dépassant 0,5ug/g
pour les organochlorés (DDT, Endrine, Heptachlore) dans les
légumes au sud du Bénin maraîchers pourrait être
dangereuse en cas d'intoxication car la plupart des pesticides sont
liposolubles et le lait pourrait accélérer leur absorption et
occasionner l'apparition précoce d'effets toxiques.
Le non-respect des doses utilisées et les délais
de carence constituent des facteurs de risque pour le consommateur, les
considérations sur l'utilisation des pesticides doivent être
prises au
61
sérieux pour prévenir les intoxications
alimentaires relatives aux pesticides et engrais chimiques.
3.2.3. Stockage des pesticides et gestion des
emballages
Normalement, les emballages vides de pesticides doivent
être récupérés, recyclés si possible et
utilisés par les industries pour de nouvelles productions de pesticides.
Les maraîchers stockent généralement les pesticides dans
leur chambre ou dans la brousse dans leur unité de production. Le
stockage des pesticides dans les chambres pourrait être dangereux pour
les enfants qui sont très vulnérables et qui peuvent les
manipuler. Le stockage des pesticides et engrais chimiques en chambre est
surtout lié aux mesures de précaution contre les tentatives de
vol en l'absence de pièce pouvant servir de magasin. Beaucoup de
maraîchers réutilisent les flacons vides pour se procurer à
nouveau de petites quantités de pesticides puisqu'ils n'ont pas les
moyens de se procurer des flacons d'un litre, c'est ce qui justifie aussi la
présence de vendeurs détaillants qui vendent (1/8, 1/4, 1/2) du
litre. D'autres abandonnent les emballages vides dans les limites des
périmètres maraîchers, ce qui peut être dangereux
pour les enfants qui peuvent les manipuler parce que certains maraîchers
ont des enfants trop petits. Une minorité enterre les emballages vides,
cette pratique est une menace pour les vers de terre et termites et aussi pour
la nappe phréatique. D. Alfa, (2014), affirme que les plus importants
sont la toxicité vis-à-vis de l'homme, l'atteinte à la
biodiversité et le développement de la résistance des
insectes. Ces comportements des maraîchers doivent être
corrigés afin de protéger nos écosystèmes et notre
état de santé.
Les pesticides stockés dans les magasins peuvent
être à l'origine des cas d'intoxications accidentels. Selon
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y a chaque année
dans le monde un million d'empoisonnements graves par les pesticides, à
l'origine d'environ 220.000 décès par an (Ouammi et al., 2009 ;
Cherin et al., 2012).
3.2.4. les risques sanitaires et environnementaux des
pesticides
Le souci d'une productivité élevée qui a
conduit de nos jours à une agriculture conventionnelle qui utilise les
engrais chimiques (Toé A, 2007) est lié aux
quantités de pesticides utilisés par hectare et au nombre de
traitements effectués élevés. Les volumes de solution de
pesticides par hectare par traitement des cultures exotiques, le chou par
exemple qui est de 45l/ha en 15 applications pendant 12 semaines est plus fort
que celui de l'amaranthe qui est de 15l/ha en 5 applications pendant 12
semaines aussi (Houeyissan, 2006). Les travaux de Liliana, 2007
révèlent que pour les cultures sols et eaux souterraines sont
exposés à des dosages massifs d'engrais chimiques qui modifient
leur milieu et rendent l'eau non potable.
62
D'après (Charbonnier E et al ,2015) ces
pratiques culturales ont des conséquences sur les agriculteurs, les
cultures, et les écosystèmes et les exposent à de nombreux
risques. D'après les calculs des indices de risque pour la santé
et l'environnement selon Ahouangninou, (2012) l'indice de risque
sanitaire à Sèmè-kpodji s'élève à
24429,44 et nous expose à l'intoxication et à la
pollution). Assogba k., (2007) a décelé des
teneurs de résidus dépassant 0,5ug/g pour les
organochlorés (DDT, Endrine, Heptachlore) dans les légumes au sud
du Bénin. Les recherches de (Sousa-passos, 2006)
suggèrent l'exposition humaine aux pesticides : un facteur de risques
pour le suicide au Brésil. Une dizaine de différents types de
cancer ont été découverts par (Samborn, 2004).
Selon le professeur Jean-François Narbonne (2005), comment des produits
faits pour tuer des organismes pourraient-ils être inoffensifs pour un
autre organisme (l'homme)? Les études effectuées chez l'homme sur
de nombreuses populations montrent un effet significatif des pesticides sur la
santé : le système nerveux central, les maladies cognitives
(mémoire, attention), les maladies dégénératives
(parkinson, alzheimer), le cancer, la reproduction (stérilité,
malformation). Les professionnels utilisateurs de pesticides sont 5 fois plus
atteints par le parkinson et 2,4 fois par l'alzheimer. Effets significatifs
aussi sur l'environnement, sur les opérateurs, sur les consommateurs.
Un exemple observé sur les légumes est
l'association des formulations Acarius + Suncozeb, il se trouve que dans notre
étude les pesticides ayant des risques sanitaires et environnementaux
particulièrement élevés ont été
utilisés sur les légumes le Cotofan (endosulfan), le Duel,
l'Alphacal..., largement utilisé à Sèmè-Kpodji sont
des produits destinés au coton mais qui se retrouvent sur le
maraîchage. Ceux présentant les risques environnementaux les plus
faibles sont les fongicides utilisés qu'en maraîchage. Ainsi nous
devons beaucoup communiquer sur cela pour prévenir les risques.
En général, les différents indices
sanitaires et environnementaux classent certains pesticides tels que le Tihan
et l'endosulfan comme les plus dangereux pour la santé et
l'environnement.
Exposition de la population
générale
Bien que les exploitants maraîchers soient conscients de
la toxicité des produits phytosanitaires, plusieurs d'entre eux ne
prennent aucune mesure de protection avant de traiter les cultures. Ce
comportement peut être à l'origine d'une exposition directe aux
pesticides soit par les yeux, le nez ou même la peau. Il a
été montré que le manque de matériel de protection
corporelle accroît les risques d'intoxication qui, mineurs au
début, peuvent
63
devenir graves par bioaccumulation (De Jaeger et al., 2012).
Des cas d'intoxications et maladies en milieux maraîchers ont
été observés par Cissé (2003) au
Sénégal et Derkaoui et al. (2011) au Maroc. Le fait de consommer
l'eau des forages peut être aussi une source d'exposition indirecte aux
résidus de pesticides (Bellec et Godard, 2002 ; Mottes, 2013). En effet,
suite à la contamination des sols par les résidus de pesticides,
ceux-ci peuvent s'infiltrer à travers le sol et contaminer les nappes
d'eau souterraines.
Des traces de résidus d'insecticides ont
été décelées dans les échantillons de
feuilles de concombre, de célosie, de l'amaranthe, chou et
aubergine...juste avant la récolte. Elles constituent un risque pour les
consommateurs. Même si les analyses n'ont pas été sur des
plantes déjà récoltées, les maraîchers
pourraient au cas où viendrait un client, vendre ces légumes
contaminés par des pesticides. Des teneurs résiduelles
importantes décelées dans la grande morelle (4,75mg
d'équivalent deltaméthrine /kg de feuille) ne fait qu'aggraver le
risque d'intoxication alimentaire des pesticides (Ahouangninou, 2012).
Martin (2008) a décelé des traces de
résidus d'insecticides dans les échantillons de feuilles de chou
jeunes et avancés avec respectivement 0,05 et 0,67 équivalent
deltaméthrine /kg de feuille dans deux périmètres
maraîchers d' Agbanzinkpota au sud Bénin.
En particulier, il est difficile de mettre en évidence
et d'évaluer quantitativement les effets d'un apport régulier de
résidus de pesticides par la voie alimentaire. Il faut voir que, pour la
plupart des pesticides, il n'a pas été possible d'établir
une relation dose-effet (Houéyissan, 2006), il est remarquable de
constater à quel point on manque de données provenant
d'études sur l'homme.
En somme, cette recherche amène à formuler
quelques suggestions allant dans le sens de la réduction de l'exposition
aux pesticides, de la protection de l'environnement et de la
préservation de la santé publique.
64
3.3. PERSPECTIVES
Pour réduire les risques une série d'actions
mérite d'être menées par les divers acteurs du sous-
secteur maraîcher pour amoindrir les effets des
pesticides et combattre efficacement les ravageurs.
3.3.1. A l' endroit des maraîchers
Pour renforcer les capacités des maraîchers nous
devons les aider à :
- s'informer sur l'origine des pesticides et n'utiliser que les
pesticides recommandés ;
- prioriser l'ensemble de mesures qui peuvent diminuer de
façon significative la nuisance des pesticides chimiques ( culture
raisonnée, utilisation plus efficace des pesticides, production mieux
répartie géographiquement, réhabilitation des
prédateurs biologiques, etc.) ;
- éviter le sous dosage qui favorise l'apparition de
ravageurs résistants;
- éviter le surdosage qui en dehors des pertes
économiques peut entraîner la présence de résidus
sur les végétaux et aliments de consommation;
- utiliser les pesticides spécifiques ayant peu d'impact
sur la faune et la flore;
- adopter un délai de carence un peu plus long afin
d'éviter la présence de résidus dans les plantes
destinées à la consommation.
3.3.2. A l' endroit du Ministère de l'Agriculture,
de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) Pour remédier à la
gestion catastrophique des pesticides et engrais chimiques, il
s'avère
indispensable de :
- Promouvoir l' agriculture biologique dans VIMAS par l'
utilisation de fertilisants organiques (engrais vert, compost, fumier, ordures
ménagères, boues de vidange et cultures en couloirs ou cultures
intercalaires : technique qui vise à intercaler les cultures annuelles
et les arbres sur une même parcelle afin d'assurer la fertilité
des sols sans passer par la jachère ( Louis Robert, 2015).
- mettre en place un programme d'IEC en faveur des
maraîchers de VIMAS sur l'utilisation des pesticides adaptés et le
respect des dosages recommandés;
- fournir aux maraîchers l'équipement complet de
protection, les informer sur les méthodes de protection et conduites
à tenir en cas d'intoxication accidentelle.
65
- Renforcer les capacités nationales en matière
de contrôle de la qualité chimique des pesticides officiellement
et/ou frauduleusement utilisés dans le VIMAS ; dans ce cadre, aider les
laboratoires spécialisés dans l'analyse des pesticides et engrais
chimiques à l'acquisition d'équipements pour le dosage et le
suivi des pesticides dangereux dans les écosystèmes de faune et
de flore ;
- étiqueter les légumes pour mieux les
sécuriser;
3.3.3. A l' endroit du Ministère du Cadre de vie et
du Développement Durable
Pour prévenir l'environnement contre toutes formes de
dégradations et de contaminations, il faut :
- assurer un respect strict de la règlementation en
vigueur sur les produits phytosanitaires.
- informer les maraîchers sur les dangers liés
à l'utilisation des pesticides, les règles d'utilisation et les
mesures de protection.
- financer les études de suivi des effets des
pesticides sur l'environnement afin d'assurer la protection de la
santé.
- Développer une coopération inter-Etats de
lutte contre l'utilisation des pesticides et engrais chimiques dans le
maraîchage.
3.3.4. A l' endroit du Ministère de la Santé
Publique (MSP)
Pour mettre à l'abri des problèmes
environnementaux et sanitaires la population générale, il faut
:
- Interdire la résidence permanente des
maraîchers sur le site pour amoindrir leur
vulnérabilité;
- former et recycler les agents de santé des zones
à fortes utilisations des pesticides et engrais chimiques afin de les
aguerrir à une prise en charge efficace qualitative pour des cas
d'intoxications aux pesticides;
- doter les centres de santé des médicaments et
matériaux nécessaires pour assurer les premiers soins en cas
d'intoxication aux pesticides.
- procéder à un suivi médical
régulier des maraîchers afin de déceler les
éventuelles expositions.
- orienter les programmes de recherches sur les effets à
long terme des pesticides.
66
- mettre en place un laboratoire moderne bien
équipé aux normes internationales pour la biosurveillance
environnement et santé.
- former une équipe de surveillance de la pollution
chimique au niveau de chaque maraîcher, et ce par un laboratoire ou un
centre de formation qualifiée;
- l'équiper en matériel de terrain pour le suivi
continu des mesures physico-chimiques classiques (T°C, pH,
conductivité, turbidité, sels azotés et
phosphatés,...);
- Effectuer par trimestre des campagnes de mesures sur le
terrain (par l' équipe de surveillance) ; - Organiser des campagnes
d'échantillonnages d'eau, sol, végétaux et de tissus
d'animaux pour les études éco toxicologiques (deux fois par an) ;
- Organiser chaque année un atelier de restitution des résultats
des études éco toxicologiques
3.3.5. A l'endroit des ONG, Leaders d'opinion et
Autorités locales
Pour améliorer la qualité des produits
maraîchers, tous les acteurs concernés doivent :
-S'impliquer davantage dans la sensibilisation des
maraîchers sur l'utilisation des pesticides et engrais chimiques pour
ainsi préserver l'environnement et assurer la santé de la
population.
-Former et évaluer les maraîchers pour
l'efficacité de leur travail
-Porter à l'endroit des consommateurs des messages
radiodiffusés, télévisés, des interviews directes
sur les pesticides et engrais chimiques et surtout sur leurs résidus
dans les aliments
-Elaborer des manuels d'éducation sur la dose
létale en langues locales afin d'atteindre la grande masse
-Introduire une stratégie nouvelle (étiquetage)
des légumes bio pour faciliter leur reconnaissance parmi les
conventionnels.
-Promouvoir les légumes bio
-Offrir aux maraîchers des mesures d'accompagnement
capables d'accroître non seulement leurs rendements mais surtout mettre
en valeur leur autonomie financière pour les sortir de la
pauvreté et les aider à quitter le conventionnel sans leur
créer de préjudices.
- Aller à leur école pour les valoriser.
67
Conclusion partielle
Pour mieux apprécier l'impact de l'utilisation des
pesticides et engrais chimiques sur les cultures légumières de
VIMAS, une étude plus approfondie s'avère nécessaire
à travers une bio-surveillance. (un outil qui permet de surveiller la
présence, dans l'organisme, des substances chimiques de notre corps, de
notre environnement ou de leurs produits de dégradation). Elle peut
aussi consister à surveiller certains effets précoces des
substances chimiques sur l'organisme. Les dosages peuvent être faits dans
le sang, l'urine, les cheveux, le lait maternel... les substances ainsi
dosées sont appelées biomarqueurs des pesticides ou autres
indicateurs, établir une liste exhaustive des pesticides les plus
utilisés et évaluer leur toxicité vis-à-vis des
espèces biologiques (végétales, animales et humaines) les
plus menacées dans les productions maraîchères par des
travaux de terrain et des expériences de laboratoire.
Au terme de ce chapitre, Les pesticides les utilisés
sont le Lambdacal P 630, le Cypercal p330 EC, le Pacha et l'Emacot. Le
traitement des cultures à une fréquence bihebdomadaire est la
plus utilisée par les maraîchers de Sèmè-Podji. Les
maraîchers enquêtés n'utilisent pas une mesure
complète de protection avant de traiter les légumes. Certains
maraîchers consomment l'eau des forages utilisée pour l'arrosage
des cultures maraîchères et s'exposent indirectement aux
pesticides. Cette étude est basée sur les déclarations des
maraîchers qui peuvent ne pas corréler avec les analyses au
laboratoire. Une étude sur l'impact des pesticides sur la santé
des maraîchers devrait être envisagée. La sensibilisation
des maraîchers sur les bonnes pratiques d'utilisation de pesticides et
sur les méthodes alternatives aux produits phytosanitaires de
synthèse afin de protéger la santé des exploitants
maraîchers et celle des consommateurs de légumes contre les effets
néfastes provoqués par les résidus de pesticides est d'une
importance capitale pour la durabilité de cette activité. Il
serait aussi intéressant de poursuivre cette étude par la
quantification des résidus de pesticides dans les légumes, les
eaux souterraines et les sols.
68
CONCLUSION
La présente étude constitue une mise au point
sur les risques liés à l'utilisation des pesticides et engrais
chimiques dans la culture des légumes à Sèmè-Podji.
Malgré le caractère prohibitif des intrants agricoles de
synthèse, malgré que les différents acteurs soient
informés sur les conséquences de l'utilisation des pesticides et
engrais chimiques, ils continuent de manipuler frauduleusement les pesticides
sur les légumes et avec peu de soins car ils estiment avoir très
peu d'alternatives. La prise de décision du maraicher de
Sèmè-Podji en matière de choix et d'usage de pesticides
s'inscrit dans un contexte social et économique. Les facteurs
impliqués dans les prises de décisions sont multiples et
hétérogènes et ne sont pas tous mobilisés de la
même manière. Ils sont mobilisés en fonction de la
structure cognitive du maraicher, de sa situation économique, de son
réseau d'informations et surtout de la confiance accordée aux
vendeurs de pesticides.
Il ressort de notre étude que les pesticides
utilisés en maraichage sont en grande partie inadaptés
(pesticides du coton), non recommandés, non homologués voire
même interdits. Les modalités d'usages des pesticides sont la
plupart du temps en dehors des normes et des recommandations, que ce soit en
termes d' indications, de mélanges de produits, de dosages, de respect
des précautions d'usages pour l'épandage, de respect du temps de
rémanence, etc. Par ailleurs, les ruptures de stocks, les changements de
nom commercial pour un même produit, la différence de dosages
d'une spéculation à une autre ne facilitent pas un usage
rationnel des pesticides par les maraichers. Les différents groupes
humains du site de VIMAS ont principalement révélé que les
usages de pesticides par les maraîchers sont étroitement
imbriqués avec le reste des activités qu'ils mènent et
qu'aucune innovation ne peut être envisagée dans ce domaine sans
prendre en compte la globalité du travail quotidien des maraichers et
leurs préoccupations. L'une des conclusions importantes qui se
dégage de cette étude est que pour induire un quelconque
changement en termes de pratiques, c'est sur le facteur temps qu'il faut
concentrer les efforts. Autrement dit, c'est en diminuant les charges de
travail sur des activités autres que la lutte contre les ravageurs
(arrosage, désherbage etc.) que l'on pourrait introduire des techniques
innovantes (biopesticides, filets anti-insectes) dans ce domaine. En effet, ces
techniques innovantes bien que moins toxiques, respectueuses de l'environnement
et ne favorisant pas de résistances, sont pour les maraichers
astreignantes et nécessitent beaucoup de temps.
Par ailleurs, les vendeurs de pesticides très peu
étudiés dans ce travail sont très
hétérogènes et mériteraient une étude
anthropologique spécifique pour comprendre à la fois la
circulation des
69
produits au niveau des différents circuits commerciaux
mais aussi comment les savoirs de ces vendeurs se sont construits. En effet,
les circuits d'approvisionnement en pesticides sont multiples. Les boutiques
n'ont pas toutes ni la même politique de vente en termes de choix des
produits, ni les mêmes fournisseurs. Un changement de pratiques en
matière d'usage de pesticides passe nécessairement par une prise
en compte des vendeurs et un véritable plan d'encadrement et de
formations de ce secteur économique.
La conclusion en est que des efforts importants s'imposent si
l'on veut diminuer le nombre de cas d'intoxication par des pesticides et
engrais chimique. Pour y parvenir, il faut une collaboration entre les pouvoirs
publics, l'agriculture la santé, l'environnement, les
collectivités, les organisations non gouvernementales et les
établissements de recherche qui devront réunir les données
de référence indispensables, adopter une législation
appropriée, assurer aux travailleurs agricoles une formation et un
encadrement convenables pour tourner définitivement la page des
pesticides et engrais chimiques au profit des pesticides et engrais biologiques
pour un développement durable et le respect du droit des
générations futures à un environnement sain.
70
Références bibliographiques
Agbohessi PT., Toko II., Ouédraogo A., Jauniaux
T., Mandiki SNM. & Kestemont P., 2014. Assessment of the health
status of wild fish inhabiting a cotton basin heavily impacted by pesticides in
Benin (West Africa). Sci. Tot. Environ., 506-507 (2015) 567-584.
Adisso, A. M., 2000 : Analyser l'effet de
l'utilisation des pesticides sur la rentabilité financière du
chou (Brassica oleracea) et du Gboma (Solanum macrocarpon) dans Cotonou et ses
environs. Thèse pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur
agronome, FSA/UAC, 99p. 4
Agnandji P., Ayi-Fanou L., Gbaguidi MAN., Cachon BF.,
Hounha M., Dikpo Tchibozo M., Cazier F. & Sanni A., 2018.
Distribution of organochlorine pesticides residues in Solanum macrocarpum and
Lactuca sativa cultivated in South of Benin (Cotonou and Seme-Kpodji). AJFST,
6(1) 19-25.
Ahouangninou C, Martin T, Fayomi BE. 2012,
Usage des produits phytosanitaires en maraîchage au sud-Bénin :
Evaluation des risques sanitaires et environnementaux. MiniSymposium de
Santé au travail et Environnement, Association Africaine de Santé
au Travail, Université d'Abomey-calavi, Université libre de
Bruxelles, 3-4 Février 2012.
Ahouangninou C. (2011), Etude du risque de
contamination des choux par des résidus de pesticides dans le Mono et le
Couffo au Sud-Bénin (Culture sous filet vs culture traditionnelle),
Rapport FAFA/CTB/CeRPA Mono-Couffo, Juin 2011, 28p
Ahouangninou, C.,(2008. Etude des pratiques
phytosanitaires maraîchères et évaluation de leur risque
sur la santé et l'environnement dans la commune de Tori-Bossito au
sud-Bénin. Mémoire recherche de DESS Sciences de l'environnement
et développement durable/CIFRED/UAC, Cotonou, 142 p.
Ahouangninou, C., B.E. Fayomi et T. Martin,
2011, Évaluation des risques sanitaires et environnementaux des
pratiques phytosanitaires des producteurs maraîchers dans la commune
rurale de Tori-Bossito (Sud-Bénin),Cahiers Agricultures, 20, pp.
216-22.
Akogbéto, M., Djouaka, R., Noukpo, N., 2005.
Utilisation des insecticides agricoles au Bénin. Bulletin de la
Société de Pathologie Exotique, 98 : 400-405.
Amadou A., 2018
Présentation du Bénin sur la situation de la production
maraîchère Caire, le 07 mars 2018 MAEP, 27 diapositives.
71
Aroonvilairat S., Kespichayawattana W., Sornprachum
T., Chaisuriya P., Siwadune T. &
Ratanabanangkoon K., 2015. Effect of
pesticide exposure on immunological, hematological and biochemical parameters
in Thai Orchid farmers. Int. J. Environ. Res. Public Health, 12(6),
5846-5861.
Assogba-Komlan, F., P. Anihouvi, E. Achigan, R.
Sikirou, A. Boko, C. Adje, V. Ahle, R. I
Vodouhe, A. Assa, 2007: Pratiques culturales
et teneur en éléments anti nutritionnels (nitrates et pesticides)
du Solanum macrocarpum au sud du Bénin. In African Journal of Food
Agriculture Nutrition and Development, Vol. 7 N°4 2007. 21 p.
Atchibri AOA., Soro LC., Kouame C., Agbo EA. &
Kouadio KKA., 2012. Valeur nutritionnelle des légumes feuilles
consommés en Côte d'Ivoire. Int. J. Biol. Chem. Sci., 6(1),
128-135.
Aubertot, J.N. ; Barbier, J. M., Carpentier, A., Gril,
J.J., Guichard, L., Lucas, P., Savary, S., Voltz, M., Savini, I. 2005,
Pesticide, agriculture et Environnement. Réduire l'utilisation des
pesticides et en limiter les impacts environnementaux. Synthèse de
rapport d'expertise scientifique collective INRA-cemagref , Paris, 64P .
Bellec S. & Godard E., 2002.
Contamination par les produits phytosanitaires organochlorés en
Martinique ; caractérisation de l'exposition des populations.
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Direction de la
Santé et du Développement Social de la Martinique, 38 p.
C. S. J. Padonou, 2008 Analyse
comparée du revenu et de sa distribution entre les producteurs de tomate
utilisant les biopesticides et les pesticides chimiques en zone
périurbaine du Sud Bénin Université de Parakou -
Diplôme d'ingénieur agronome 2008.
Charbonnier E, Ronceux A, Carpentier A-S, Soubelet H,
Barriuso E, coord.(2015) Pesticides ; Des impacts aux changements de
pratiques (Synthèse de 15 années de recherche sur
l'évaluation et la réduction des risques environnementaux
liés à l'utilisation des pesticides en agriculture) ; Ed Quae,
400 pages, ISBN.
Cherin P., Voronska E., Fraoucene N. & De Jaeger
C., 2012. Toxicité aiguë des pesticides chez l'homme. Med.
& Long., 4(2), 68-74.
72
CPP, 2002 Risques sanitaires liés
à l'utilisation des produits phytosanitaires, p 47. Comité de la
Prévention et de la Précaution, Ministère de l'Ecologie et
du Développement Durable, Paris.
Cissé I., Tandia AA. & Fall ST.,
2003. Usage incontrôlé des pesticides en agriculture.
périurbaine : cas de la zone des Niayes au
Sénégal. Cah.Agr., 12(3), 181-186.
Cissé, I., Tandia, A. A., Fall, S. T., Diop,
E.H.S., 2003. Usage incontrôlé des Pesticides en
Agriculture Périurbaine : cas de la zone de Niayes au
Sénégal, Cahiers d'études et de recherche
francophones/Agriculture Mai Juin ; 12 (3) : 181-6.
Cohen M., 2007. Environmental toxins and
health: the health impact of pesticides. Austr.Fam. Phys., 36(12), 1002.
Copplestone, J.F., 1985 Pesticide exposure
and health in developing countries. In: Turnbull, G.J., ed. Occupation al
hazards of pesticide use. Londres, Taylor and Francis.
CPP, 2002 Risques sanitaires liés
à l'utilisation des produits phytosanitaires Comité de la
Prévention et de la Précaution Pièce 5423 20 avenue de
Segur 75007 Paris
genevieve.baumont@environnement.gouv.fr.
Daleb Abdoulaye Alfa, 2014 Construction sociale
des processus décisionnels en matière d'usage des pesticides par
les maraichers de Sèmè-Podji Université d'Abomey-Calavi -
DEA.
De Jaeger C., Voronska E., Fraoucene N. & Cherin P.,
2012. Exposition chronique aux pesticides, santé et
longévité. Rôle de notre alimentation. Med. & Long.,
4(2), 75-92.
Derkaoui A., Elbouazzaoui A., Elhouari N., Achour S.,
Labib S., Sbai H., Harrandou M., Khatouf M. & Kanjaa N., 2011.
Severe acute poisoning by organophosphorus pesticides: report of 28 cases. Afr.
Medical. J., 8, 16.
Dewailly et al. 2000, the immunotoxic potential of
some organochlorine compounds (Ocs) unité de recherche en
santé.
Djibril, B. R., 2002. Contribution à
l' étude d' impacts de l' utilisation des engrais chimiques et des
pesticides sur la qualité des eaux de surface dans la réserve de
biosphère de la Pendjari.- Mémoire de fin de formation d'
Ingénieur des Travaux en Techniques d' Aménagement et Protection
de l' Environnement, APE/CPU.
Edorth A.P., 2016 Pollution de l'environnement et santé
publique UAC /MIRD Cours p11
73
Francoise AK., Prudent A., Enoch A., Rachidatou S.,
Adrien B., Charlotte A., Victoire A., Raymond V. & Ayémou A.,
2007. Pratiques culturales et teneur en éléments anti
nutritionnels (nitrates et pesticides) du Solanum macrocarpum au sud du
Bénin. Afr. J. Food.Agr.Nutr.Pevelop., 7(4), 1-21.
G. Jousse, 2004, le risque cet inconnu, Imestra
édition, 2004.
Gbénonchi M 2008. Bilan
environnemental de l'utilisation des pesticides organochlorés dans les
cultures de coton, café et cacao au Togo et recherche d'alternatives par
l'évaluation du pouvoir insecticide d'extraits de plantes locales contre
le scolyte du café.
Hallenbeck WH. & Cunningham-Burns KM., 1985.
Pesticides and human health.Springer-Verlag, (NewYork), 166 p.
Hounkpodoté, M. et R.C., Tossou 2001.
Profil des interactions entre la problématique foncière et le
développement de l'agriculture urbaine dans la ville de Cotonou et
environs, Réseau national pour l'agriculture urbaine, 6lp.
INRA, 2005 Pesticides, agriculture et
environnement Réduire l'utilisation des pesticides et en limiter les
impacts environnementaux Expertise scientifique collective Synthèse du
rapport d'expertise à la demande du Ministère de l'agriculture et
de la Pêche (MAEP) et du Ministère de l'écologie et du
développement durable (MEDD).
INSAE, 2013. Quatrième recensement
général de la population et de l'habitat, mai 2013 : Principaux
indicateurs sociodémographiques, Direction des études
démographiques, Cotonou, James B., Atcha C., Godonou I. et
Baimey H., 2005. Healphy vegetables through participatory IP M in
peri-urban areas of Bénin : Summary of activities and achievements,
2003-2005. Peri-urban vegetable IPM project : technical report 2005. 51 p.
Inserm, 2013. Pesticides : Effets sur la
santé.
Kahane, R., L. Temple, P. Brat, H. De Bon, 2005:
Les légumes feuilles des pays tropicaux: diversité,
richesse économique et valeur santé dans un contexte très
fragile, 11 p.
Kanda M., Djaneye-Boundjou G., Wala K., Gnandi K.,
Batawila K., Sanni A. & Akpagana K., 2013. Application des
pesticides en agriculture maraichère au Togo. La revue
électronique en sciences de l'environnement, 13(1).
74
Liliana juc., 2007 Etude des risques lies a
l'utilisation des pesticides organochlorés et impact sur l'environnement
et la santé humaine. Sciences de la terre. Université claude
bernard - lyon i, 2007. français. <tel-00330431> 228p
Thèse.
Louis Robert, 2015 Les cultures intercalaires,
quand on veut que ça marche 6p.
MAEP, 2015 Ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt - Politiques agricoles à
travers le monde - Fiche pays - Bénin, 2015.
Mottes C., 2013. Evaluation des effets des
systèmes de culture sur l'exposition aux pesticides des eaux à
l'exutoire d'un bassin versant. Proposition d'une méthodologie d'analyse
appliquée au cas de l'horticulture en Martinique. Thèse de
doctorat : Sciences agronomiques, AgroParis Tech, Paris (France), 265 p.
Ntow WJ., Gijzen HJ., Kelderman P. & Drechsel P.,
2006. Farmer perceptions and pesticide use practices in vegetable
production in Ghana. Pest. Man. Sci., 62(4), 356-365.
OMS, 2011. Principes directeurs pour la
gestion des pesticides utilisés en santé publique dans la
région africaine de l'OMS. 2011. p. 62.
OMS, Genève 1991 L'utilisation des
pesticides en agriculture et ses conséquences pour la sante publique
1pesticides - effets indésirables 2. Pesticides - intoxication ISBN 92 4
256139 8 (Classification NLM WA 240).
Ouammi L., Rhalem N., Aghandous R., Semlali I., Badri
M., Jalal G., Benlarabi S., Mokhtari A., Soulaymani A. &
Soulaymani-Bencheikh R., 2009. Profil épidémiologique
des intoxications au Maroc de 1980 à 2007. Toxicologie, 1, 11.
Pan UK, 2003: Effects of pesticides on the
health of cotton-growing families in West Africa, Comic Relief Mid-te1m
report.
PAPA (Programme Analyse de la Politique Agricole),
2006: Les perceptions des consommateurs sur l'utilisation des
biopesticides dans la production de légume : cas des communes de Cotonou
et de Porto-Novo. Rapport technique, CRA-Agonkanmey/INRAB/MAEP/Bénin, 26
p.
Pazou, E.Y., Laleye, P., Boko, M., van Gestel, C.A.,
Ahissou, H., Akpona, S., van Hattum,B., Swart, K., van Straalen, N.M., 2006
Contamination of fish by organochlorine pesticideresidues in the Oueme
River catchment in the Republic of Benin. Environ Int. 2006b; 32
(5):594-599.
75
Pesticide Action Network TOGO, 2005 Etude
d'impact socio-économique, Sanitaire et environnemental de l'utilisation
des polluants organiques persistants (pops) a Davie au nord de Lomé
(région maritime) Togo, Projet International pour l'Elimination des POPs
(IPEP) Togo. Série de Publication N° 06/F Septembre 2005.
Pesticides Properties Data Base - University of
Hertfordshire.
http://sitem.herts.ac.uk/aeru
(03/07/2018).
Prudence Agnandji1, Boris Fresnel Cachon2,
Ménonvè Atindehou1, Ingrid Sonya Mawussi Adjovi3, Ambaliou
Sanni1, Lucie Ayi-Fanou1. Analyse des pratiques phytosanitaires en
maraîchage dans les zones intra urbaines (Cotonou) et
péri-urbaines (Sèmè-kpodji) au Sud-Bénin Revue
Africaine d'Environnement et d'Agriculture 2018; 1(1), 2-11
Samborn et al., 2004. Pesticides literature
Review. Ontario College of family physicians 2004; 186p.
Sanny, S.M., 2002: Contribution à
l'amélioration des rendements et de la qualité des cultures
marîchères (détection de bio- contaminants et agents
toxiques) : Cas du périmètre maraîcher de Houeyiho à
Cotonou. Mémoire d'Ingénieur des Travaux. CPU/UNB, Bénin.
2002. 102 p.
Singbo, A., Nouhoheflin, T. & L. Idrissou,
2004. Etude des perceptions sur les ravageurs des légumes dans
les zones urbaines et périurbaines du sud Bénin, Projet
Légumes de qualité, Rapport d'activités,
IITA-INRAB-OBEPAB, 22p.
Singbo, G. A., Nouhoheflin, T., Idrissou, L,
2004, Etude des perceptions sur les ravageurs des légumes dans
les zones urbaines et périurbaines du sud Bénin. Projet
Légumes de qualité, Rapport d'activités,
IITA-INRAB-OBEPAB, 21 p 284
Soclo, H.H. , 2004, Résultats
d'analyses chimiques et Toxico chimiques sur des échantillons de
produits maraîchers (Légumes et fruits) et d'aliments vendus et
/ou consommés dans la ville de cotonou. Projet d'appui à
la mise en place d'une stratégie Nationale de réduction de
l'impact de la pollution Urbaine sur la sécurité alimentaire
(projet conjoint FAO-MEHU TCP / BEN / 2904 A) BENIN, 31p.
Sougnabé SP., Yandia A., Acheleke J., Brevault
T., Vaissayre M. & Ngartoubam LT., 2010. Pratiques phytosanitaires
paysannes dans les savanes d'Afrique centrale. Garoua, Cameroun. Cirad, 13p
76
Sousa Passos, C. J., 2006. Exposition humaine
aux pesticides : un facteur de risques pour le suicide au Brésil ?
VertigO- La revue en sciences de l'environnement, 17 (1) : 18p.
Tchiégang C. & Aissatou K., 2004 Données
ethnonutritionnelles et caractéristiques physicochimiques des
légumes-feuilles consommés dans la savane de l'Adamaoua
(Cameroun).Tropicultura, 22(1),11-18.
Toé A 2010. Etude pilote des
intoxications dues aux pesticides agricoles au Burkina Faso
Toé, M.A., 2007, Utilisation des
pesticides chimiques en cultures maraîchères et cotonnières
dans la région Est du Burkina Faso, Campagne 2005-2006 et 2006-2007,
Rapport d'étude, IRSS, Bobo Dioulasso, Burkina Faso.
Ton, P., Tovigan, S., Vodouhe, S.D., 2000. Tokannou,
R., Quenum, R., 2007. Etude sur le sous-secteur maraîchage au
sud Bénin, Rapport final, AD consult, PAIMAF, 122p.
Traore, S.K., Mamadou, K., Dembele, A., Lafrance, P.,
Mazelliert, P., Houenou, P. (2006). Contamination de l'eau souterraine
par les pesticides en régions agricoles en Côte-d'Ivoire (centre,
Sud et Sud-Ouest). Journal Africain des Sciences de l'environnement, (1) 19.
Vigouroux-Villard, A. 2015. Niveau
d'imprégnation de la population générale aux pesticides:
selection à mesurer en priorité. Master professionnel Evaluation
et gestion des risques sanitaires liés à l'environnement,
Université Paris 5 et Université Paris-sud 11.
Vodouhe, G. (2007) : Genre et production
durable des légumes sains en zone urbaine et péri urbaine au
Sud-Bénin. Thèse d'ingénieur agronome UAC / FSA,
Bénin. 146 p.
Vodouhè S. D. et Aboubacary I. L. 2003.
Réglementation des pesticides
Worapitpong S., Maruo SJ., Neelapaichit N.,
Sirivarasai J. & Piaseu N., 2017. Effects of an insecticide
exposure prevention program on exposure and blood cholinesterase levels in Thai
farmers. Bangkok. Medic. J., 13(2), 22870237 (2017), 2287-9674.
Zossou, E., 2004 : Analyse des
déterminants socio-économiques des pratiques phytosanitaires :
Cas des cultures maraîchères à Cotonou (Département
du Littoral, Bénin).Thèse d'ingénieur agronome,
FSA/UNB/Bénin. 104 p.
REVUE
Revue Africaine d'Environnement et d'Agriculture 2018 ; 1(1),
2-11
77
La revue en sciences de l'environnement, 20 17 (1) : 18p.
Revue Afrique agriculture Guy Christian Roko., 2016
Bulletin de Pesticide Action Network Africa, 2000 Intoxications
et Morts au Bénin par
l'Endosulfan. In: Pesticides & Alternatives. de Pesticide
Action Network Africa.
Rapport final, AD consult, PAIMAF, Ton, P., Tovigan, S., Vodouhe,
S.D., 2000). (Tokannou, R., Quenum, R., 2007 Etude sur le sous secteur
maraîchage au sud Bénin, 122p
Ouvrage : Le CORFEC Yves (édition Dunod) - Sites et sols
pollués : Gestion des passifs environnementaux
SITES WEB
https://www.dictionnaire-environnement.com/risque
sanitaire
http://www.futura-sciences.pollution-engrais-pollution-agricole-dangereuse
http://www.rafea-congo.com
Dépôt légal: JL 3.01807-57259
https://pdfs.semanticscholar.org
http://www.insae.bj.org
www.invs.santepubliquefrance.fr,2016).)
www.utz.org
78
Annexes Annexe1
Exemplaire de fiche d' enquête relative à l'
utilisation des engrais chimiques et des pesticides dans le Village
Maraîcher de Sèmè-podji.
Formulaire de questionnaire à l' endroit des
maraîchers
1- Utilisez-vous des pesticides dans la lutte contre les
insectes nuisibles dans vos champs ?
OUI NON
2- A quelle période de la saison des cultures les
utilisez-vous ?
3- Pour quels types de cultures les utilisez-vous ? Amaranthe?
grande morelle? chou? carotte? laitue ? Autres
4- Qui sont vos principaux fournisseurs agréés par
l' Etat?
5- Comment trouvez-vous les prix de vente des pesticides par les
fournisseurs agréés?
6- Ces prix de cession des pesticides ne semblent-ils pas trop
chers ?
7- S' il vous est demandé de fixer les prix
vous-même, à combien les mettriez-vous pour que cela soit
supportable pour vous?
8- S' il vous est proposé d' autres marchés en
dehors du circuit officiel, mais moins chers,
accepteriez-vous l' offre ? OUI NON
9- Les mêmes produits peuvent être achetés
beaucoup moins chers à partir des pays voisins, comme le Nigeria par
exemple des gens seraient prêts à vous en fournir ; est-ce qu' un
tel marché ne vous intéresserait pas ? OUI NON
10- Connaissez-vous déjà d' autres producteurs qui
s' approvisionnent en pesticides dans les pays voisins ? Combien sont-ils dans
le village ?
11- Quelle quantité chacun de vous achète-t-il
à chaque cycle de production d'un légume ?
auprès des fournisseurs agréés . litres ?
à partir des pays voisins . litres
12- Quel volume à l' hectare utilisez-vous ?
13- Les utilisez-vous à l' état brut ou
dilués dans l' eau ? ? Brut ? Dilué
14- Quelles quantités de ces emballages utilisez-vous par
culture de légume ?
15-
79
Que faites-vous de ces emballages, une fois les pesticides
utilisés? Les utilisez-vous pour
conserver : ? l' eau de boisson ? l' huile de cuisine ? les
boissons ?
16- Ne ressentez-vous pas de malaises pendant ou après
les opérations de pulvérisation des
cultures aux pesticides ? OUI NON
Impacts de l'utilisation des engrais chimiques et des
pesticides sur les écosystèmes de faune et de flore de VIMAS
Si oui, lesquels malaises ?
17- Avez-vous déjà connu des cas d'
intoxication ou d' épidémies dans le village ? Combien de fois ?
et combien de personnes sont affectées ?
18- Est-ce que quelqu'un vous a dit une fois que les
pesticides peuvent être dangereux pour la santé de l' homme ?
Est-ce que cela peut être vrai ?
19- Pourriez-vous donner quelques noms de ces pesticides que
vous utilisez ? Endosulfan
DDT Heptachlore Lindane Dieldrine autres
20- Connaissez-vous les risques liés à la
manipulation des pesticides? OUI NON
21- Si oui comment les avez-vous su ?
22- Est-ce que vous avez eu de malaises une fois après
avoir bu l' eau de votre forage ou de puit qui se trouvent dans ou dans les
environs de vos unités de production ? OUI? NON ? si oui, quels types de
malaises ?
23- Au cours de vos déplacements dans le village, vous
est-il déjà arrivé une fois de trouver des animaux morts
ou malades ( rat, perdrix ...), sans en savoir réellement les causes
?
24- Quelles seraient selon vous certaines causes de
mortalité ou de maladies chez certaines espèces animales ?
25- Savez-vous que l' utilisation des pesticides peut causer
des problèmes chez les animaux et
chez l' homme ? OUI NON
26- Que pensez-vous de l' utilisation des pesticides ?
Seriez-vous prêts à abandonner l' utilisation des pesticides
importés si l' on vous proposait d' autres produits moins dangereux pour
les animaux et pour l' homme ?
27-
80
Utilisez-vous des engrais chimiques pour vos cultures
? OUI
NON
28- SI oui, quelle quantité à l' hectare
utilisez-vous ?
29- Quelles quantités utilisez-vous à chaque cycle
de production ?
30- Pour quelles cultures ?
31- Pourquoi les utilisez-vous ?
32- A quelle période de la saison des cultures les
utilisez-vous ?
33- De quelle manière appliquez-vous pour leur
utilisation ?
34- Quels sont les types d' engrais chimiques que vous utilisez
?
35- Qui sont vos principaux fournisseurs ?
36- Utilisez -vos d'autres types d'engrais en dehors de ceux
importés ? OUI NON
Impact de l' utilisation des engrais chimiques et des pesticides
sur les écosystèmes de faune et de flore de VIMAS
37- Si oui lesquels et pourquoi les utilisez-vous
38- De quel côté du village se trouve votre
unité de production ?
39- Pourquoi ?
40- Que faites-vous des déchets post-récolte et
des déchets ménagers ?
41- Lesquels et pourquoi ?
42- Est-ce que vous saviez qu' il est possible de les utiliser
comme amendements des sols et
augmenter la production agricole ? ? OUI NON
43- Entretenez-vous des commerces d' intrants agricoles avec des
pays voisins ?
IDENTIFICATION
- Nom et prénoms :
- Ethnie :
- Age :
- Sexe :
81
- Religion :
- Niveau scolaire : Scolarisé : Oui Non
Si oui, niveau d'étude : Primaire
Secondaire1
Secondaire2
Universitaire
Si non, Alphabétisé ? Oui Non
- Activités professionnelles (autres que le
maraîchage) :
- Situation matrimoniale : Célibataire Oui Non
Marié Oui Non
Si marié, mariage civil Mariage coutumier Mariage
religieux
Veuf/Veuve Divorcé(e) Répudiation
- Nombre d'enfants
De moins de 5 ans De 5 à 18 ans : De 18 ans et plus
:
- Nombre de personnes à charge
(financièrement)
Dans le ménage :
Enfants jusqu'à 17 ans :
Autres personnes :
Situation financière
*Revenu mensuel : Salaire ou gain mensuel :
*Autres revenus -Bail
-Contribution du conjoint :
- Charges financières
*Crédits en cours
82
Formulaire de questionnaire à l' endroit des
agents du CARDER
1. Les producteurs utilisent-ils des pesticides dans la lutte
contre les insectes nuisibles dans
les unités de production ? OUI NON
2. A quelle période de la saison des cultures en
utilisent-ils ?
3. Pour quels types de cultures en utilisent-ils ? Amaranthe
grande morelle carotte chou laitue Autres
4. Qui sont leurs principaux fournisseurs agréés
par l' Etat?
5. Comment trouvent-ils les prix de vente des pesticides par les
fournisseurs agréés?
6. Ces prix de cession des pesticides, selon eux, ne
semblent-ils pas trop chers ?
7. Existe-t-il, selon vous, d' autres marchés en dehors
du circuit officiel, où les producteurs
vont s' approvisionner en pesticides ? OUI NON Si
oui,
lesquels ?
12- Quel volume à l' hectare utilisent-ils ?
13- Les utilisez-vous à l' état brut ou
dilués dans l' eau ? Brut Dilué
14- Quelles quantités de pesticides sont utilisées
dans votre secteur par cycle de production?
15. Quels types de pesticides et quelles quantités de
chaque sont utilisés dans le secteur ? des
organophosphorés de l' endosulfan des
organochlorés Autres
16. Que font les maraîchers ou les habitants de la
localité des emballages, une fois les
pesticides utilisés? Les utilisent-ils pour conserver : ?
l' eau de boisson ? l' huile de
cuisine ? les boissons ?
17. Ne ressentent-ils pas de malaises pendant ou après
les opérations de pulvérisation des
cultures aux pesticides ? OUI NON Si oui, lesquels
malaises
?
17. Avez-vous déjà connu des cas d' intoxication ou
d' épidémies dans le village ? Combien de fois ? et combien de
personnes sont affectées ?
Impact de l' utilisation des engrais chimiques et des pesticides
sur les écosystèmes de faune et de flore de VIMAS
18.
83
Est-ce que les pesticides peuvent être dangereux pour la
santé de l'homme ? OUI
NON
19. Pourriez-vous donner quelques noms des pesticides qui
sont fournis aux producteurs? Endosulfan DDTs Heptachlore Lindane Dieldrine
autres
20. Quelles peuvent être les risques liés
à la manipulation des pesticides ?
21. Vous est-il déjà arrivé de
sensibiliser les producteurs sur les risques liés à l'utilisation
des pesticides?
22. Au cours de vos déplacements dans VIMAS, vous
est-il déjà arrivé une fois de trouver des animaux morts
ou malades (rat perdrix.....), sans en savoir réellement les causes ?
23. Quelles seraient selon vous certaines causes de
mortalité ou de maladies chez certaines espèces animales ?
24. Savez-vous que l'utilisation des pesticides peut causer
des problèmes chez les animaux et
chez l'homme ? OUI NON
25. Que pensez-vous de l'utilisation des pesticides ?
Seriez-vous prêts à proposer l'utilisation des produits naturels
en remplacement des pesticides importés, parce que ceux-ci sont
dangereux pour l'environnement et pour la santé de l'homme et des
animaux ?
26. en savez-vous quelques types à nous proposer ?
27. Quelles stratégies pourrait-on, selon vous, mettre
en oeuvre pour éviter la pollution des aires de
Sèmè-Kpodji par les résidus de pesticides et d'engrais
chimiques ?
Annexe2
|
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
REPUBLIQUE DU B E N I N
|
03 B P 2900 Cotonou -Bénin
Tél. + 2 2 9 21 30 10 87/21 30 04 10 Site Web :
www.agriculture.gouv.bj
Agence Territoriale de Développement Agricole
(ATDA)
OUEME-ATLANTIQUE-LITTORAL-MONO
01 BP : 648 Cotonou Tel : 21361798/99 Fax : 21361796
Email :
atda.oam@yahoo.com
RAPPORT D'ACTIVITES DE LA CELLULE COMMUNALE DE
SEME-PODJI
84
DECEMBRE 2018
1.3.2. Quelques données statistiques

Cumul
v Piment 437 182,35 2 184,35
v Tomate 983 328,45 4 332,45
v Laitue 62 81,9 14 95,9
v Gombo 0 11,75 0,3 12,05
v Gboma (Grande morelle) 77 121,31 8 129,31
v Choux 26 18,89 0,9 19,79
v Crincrin 24 23,75 0,2 23,95
v Amarante 36 57,7 4 61,7
v Basilic africain 53,9 47,4 3 50,4
v Citronnelle 3 4,3 0,4 4,7
v Pastèque 45 71,86 6 77,86
v Carotte 181 223,05 9 232,05
v Concombre 317 253,8 15 268,8
v Haricot vert 21 18,2 0,2 18,4
v Oignon 8,4 23,6 3 26,6
v Poivron 306 255,3 2 257,3
v Betterave 76,5 63,6 0,3 63,9
Désignation
Herbicides (litres)
Engrais (Tonnes)
Insecticide
(litres)
Superficies (ha)
Semences (kg)
v Piment 62,7 26,207 0,35 26,56
v Tomate 140,4 49,014 0,8 49,81
v Laitue 15 35,02 6,2 41,22
v Gombo 0 24,82 0,5 25,32
v Gboma (Grande morelle) 24,6 36,997 4,2 41,2
v Choux 5 4,84 0,1 4,94
v Crincrin 8 5,34 0,06 5,4
v Amarante 10,8 17,3 1,2 18,5
v Basilic africain 16 14,2 0,9 15,1
v Citronnelle 0 0 0 0
v Pastèque 29,4 43,203 11,2 54,4
v Carotte 114,5 149,31 11,2 160,51
v Concombre 344,2 309,438 37,5 346,94
v Haricot vert 315 273 3 276
v Oignon 10,5 9,4 3,75 13,15
v Poivron 61,2 51,06 0,4 51,1
v Betterave 3,5 3,03 0,01 3,04
v Totaux 631,6 94 4 98
v Spécifiques 0 74 16 90
v NPK 79 60,77 3,5 64,27
v UREE 59,5 61,53 5,5 67,03
v Binaires 10318 9390 280 9670
v Fongicides 9987 6109,5 230 6339,5
v Nématicides 9987 1825,5 140 1965,5
Prévisio n annuell e
Réalisées/Mise place
Cumul antérieur e
Pour le mois de
Décembre
85
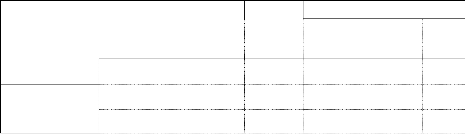
392 10173,
v Acaricides 9987 9781,5 5
v Fongicides pour 141,7 84 5 89
traitement
semences
Réalisées/Mise place
Désignation
Cumul
Pour le mois de
Décembre
Cumul antérieur e
Prévisio n annuell e
Produits de conservation
(Kilogrammes)
v Insecticides 1,8 0 0 0
86
Annexe 3
|
Liste des pesticides prohibés (par ingrédient
actif)
|
|
N°
|
Ingrédient actif
|
Convention s
Internationa les
|
Toxici té
aigüe
|
Toxicité chronique
|
|
Cancérogè ne
|
Mutagè ne
|
Toxique
pour la
reproducti on
|
Perturbat
eur du
système endocrini en
|
|
1
|
Acéphate
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Acroléine
|
|
x
|
|
|
|
|
|
3
|
Alachlore
|
X
|
|
|
|
|
x
|
|
4
|
Aldicarbe
|
X
|
x
|
|
|
|
x
|
|
5
|
Alpha-BHC, alpha-HCH
|
X
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Alpha-
chlorhydrine
|
|
x
|
|
|
|
|
|
7
|
Amitraze
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Huile
d'anthracène
|
|
|
X
|
|
|
|
|
9
|
Arsenic et
ses composés
|
|
|
X
|
|
|
|
|
10
|
Atrazine
|
|
|
|
|
|
x
|
|
11
|
Azafenidin
|
|
|
|
|
x
|
|
|
12
|
Azinphos- éthyl
|
|
x
|
|
|
|
|
|
13
|
Azinphos-
|
X
|
x
|
|
|
|
|
87
|
méthyl
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Bénomyl
|
X
|
|
|
x
|
x
|
|
|
15
|
Bêta-
cyfluthrine, cyfluthrine
|
|
x
|
|
|
|
|
|
16
|
Bêta-HCH, bêta-BCH
|
X
|
|
|
|
|
x
|
|
17
|
Blasticidine S
|
|
x
|
|
|
|
|
|
18
|
Borax, tétraborate de disodium décahydraté
(uniquement
si utilisé
comme pesticide
|
|
|
|
|
x
|
|
|
19
|
Acide borique (uniquement
si utilisé
comme pesticide)
|
|
|
|
|
x
|
x
|
|
20
|
Brodifacoum
|
|
x
|
|
|
|
|
|
21
|
Bromadiolon e
|
|
x
|
|
|
|
|
|
22
|
Brométhalin e
|
|
x
|
|
|
|
|
|
23
|
Bromoxynil butyrate
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Butoxycarbo xime
|
|
x
|
|
|
|
|
|
25
|
Cadusafos
|
|
x
|
|
|
|
|
|
26
|
Captafol
|
X
|
x
|
X
|
|
|
|
|
27
|
Carbaryl
|
|
|
|
|
|
x
|
|
28
|
Carbofuran
|
X
|
x
|
|
|
|
|
|
29
|
Carbosulfan
|
|
x
|
|
|
|
|
88
30
|
Chlordane
|
X
|
|
|
|
|
x
|
|
31
|
Chlorethoxy phos
|
|
x
|
|
|
|
|
|
32
|
Chlorfénapyr
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
Chlorfenvinp hos
|
|
x
|
|
|
|
|
|
34
|
Chlorméphos
|
|
x
|
|
|
|
|
|
35
|
Chlorophaci none
|
|
x
|
|
|
|
|
|
36
|
Chlorotoluro n
|
|
|
|
|
|
x
|
|
37
|
Chlozolinate
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
Coumaphos
|
|
x
|
|
|
|
|
|
39
|
Coumatétral yl
|
|
x
|
|
|
|
|
|
40
|
Créosote
|
|
|
X
|
|
|
|
|
41
|
Cyhalothrine
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
Daminozide
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
DDT
|
X
|
|
|
|
|
x
|
|
44
|
Déméton-S- méthyl
|
|
x
|
|
|
|
|
|
45
|
Dichlorvos, DDVP
|
|
x
|
|
|
|
|
|
46
|
Dicofol
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
Dicrotophos
|
|
x
|
|
|
|
|
|
48
|
Difenacoum
|
|
x
|
|
|
|
|
|
49
|
Diféthialone
|
|
x
|
|
|
|
|
|
50
|
Diméthénam ide
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
Dimoxystrob ine
|
|
|
|
|
|
x
|
|
52
|
Dinocap
|
|
|
|
|
x
|
|
|
53
|
Dinoterbe
|
|
x
|
|
|
x
|
|
89
54
|
Diphacinone
|
|
x
|
|
|
|
|
|
55
|
Disulfoton
|
|
x
|
|
|
|
|
|
56
|
2-méthyl- 4,6-dinitrophénol et ses sels
|
X
|
x
|
|
|
|
|
|
57
|
Édifenphos
|
|
x
|
|
|
|
|
|
58
|
Endosulfan
|
X
|
x
|
|
|
|
|
|
69
|
Fenthion
|
|
|
|
|
|
|
Source :
www.utz.org
90
Annexe 4

Figure 12 : Mécanismes d'exposition de la
population générale Source : www.expositionde la
population générale
91
Table Des Matières
SOMMAIRE 2
DEDICACE 3
SIGLES ET ACRONYMES 4
LISTE DES FIGURES 5
LISTE DES TABLEAUX 6
LISTE DES PLANCHES 7
LISTE DES PHOTOS 7
REMERCIEMENTS 8
RESUME / ABSTRACT 10
INTRODUCTION 11
CHAPITRE I : 13
ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU SUJET, HYPOTHESES,
OBJECTIFS,
CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 13
1.1. ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU SUJET 13
1.2. HYPOTHESES DU TRAVAIL 15
1.3. OBJECTIFS DE RECHERCHE 15
1.4. CLARIFICATION DES CONCEPTS 16
1.5. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 17
1.5.1. Présentation de la Commune de Sèmè
Podji 17
1.5.2. La recherche documentaire 19
1.5.3. Outils et techniques de collecte de données
19
1.5.4. La phase exploratoire 19
1.5.5. L'échantillonnage 19
1.5.6. La phase enquête : 20
1.5.7. Traitement et analyse des données 20
1.6. LES INDICATEURS DE RISQUES 21
1.6.1. La lutte chimique et la quantité de
pesticides à l'hectare par cycle de production d'un légume
feuille 21
1.6.2. La fertilisation et la quantité d'engrais
à l'hectare par cycle de production d'un légume feuille
22
1.7. LIMITES DE LA RECHERCHE 22
CHAPITRE II : 24
FONDEMENTS BIOPHYSIQUES ET HUMAINS FAVORABLES A L'UTILISATION
DES
PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES LEGUMES
24
2.1. FONDEMENTS BIOPHYSIQUES DE L'UTILISATION DES
PESTICIDES ET ENGRAIS
CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES LEGUMES 24
92
2.1.1. localisation du cadre d'étude 24
2.1.2. Relief 25
2.1.3. Climat 25
2.1.4. Hydrographie 25
2.1.5. Végétation 25
2.1.6. Faune 26
2.1.7. Sols 26
2.2. FONDEMENTS HUMAINS DE L'UTILISATION DES PESTICIDES ET
ENGRAIS
CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES LEGUMES 26
2.2.1. Peuplement de la Commune 26
2.2.2. Le sexe 27
2.2.3. L'âge 27
2.2.4. Le niveau d'instruction en français 28
2.2.5. La situation matrimoniale 29
2.2.6. Activités économiques 29
2.2.7. Prix de vente de quelques légumes 30
2.2.8. La main d'oeuvre utilisée 31
2.2.9. Les ennemis de la culture 32
2.2.10. Nombre de traitement par mois 33
2.2.11. Délai de carence 34
2.2.12. Les moyens de protection personnelle 35
2.2.13. Mesures de prophylaxie après utilisation des
pesticides 35
2.2.14. Stockage des pesticides 36
2.2.15. La gestion des emballages des pesticides 36
CHAPITRE III : RESULTATS, DISCUSSIONS, ET PERSPECTIVES 38
3.1. Résultats 38
3.1.1. Types de pesticides chimiques utilisés dans la
production des légumes 38
3.1.2. Quantité de pesticides à l'hectare pour
décembre 2018 à Sèmè-Podji 40
3.1.3. Quantité de pesticides à l'hectare par
cycle de production d'un légume feuille 41
3.1.4. Quantité de pesticides par planche par cycle de
production du chou cabus 43
3.1.5. Quantité de pesticides par pied du chou cabus
par cycle de production 44
3.1.6. Quantité de pesticides par consommateur par mois
par pied du chou cabus 44
3.1.7. Quantité de pesticides par consommateur par an
du chou cabus 44
3.1.8. Quantité de pesticides par consommateur du chou
cabus en 15 ans 44
3.1.9. Quantité de pesticides par consommateur du chou
cabus en 50 ans 45
3.1.10. Quantité de pesticides par pied d'amaranthe par
cycle de production 45
93
3.1.11. Quantité de pesticides par consommateur par
pied d'amaranthe en un mois 45
3.1.12. Quantité de pesticides par consommateur par
pied d'amaranthe en un an 45
3.1.13. Quantité de pesticides par consommateur par
pied d'amaranthe en 15 ans 45
3.1.14. Quantité de pesticides par consommateur par
pied d'amaranthe en 50 ans 45
3.1.15. Types de pesticides organiques utilisés dans la
culture des légumes 45
3.1.16. Différents types d'engrais chimiques
utilisés par les maraîchers 46
3.1.17. Différents types d'engrais organique
utilisés par les maraîchers 46
3.1.18. Quantité de pesticides nécessaire
à la production de certaines cultures 48
3.1.19. Engrais minéraux 50
3.1.20. Quantité d'engrais minéral à
l'hectare par cycle de production d'un légume feuille 50
3.1.21. Mode d'utilisation des engrais chimiques
utilisés dans la production des légumes 51
3.1.22. Mode d'utilisation des engrais organiques
utilisés dans la production des légumes 52
3.1.23. Répartition des maraîchers en fonction
des méthodes de lutte utilisées 53
3.1.24. Sources d'approvisionnement des pesticides chimiques
53
3.1.25. Risques liés à l'utilisation des
pesticides et engrais chimiques dans la production des
légumes 54
3.1.26. Cas recensés en milieu d'étude 57
3.2. DISCUSSION 58
3.2.1. Fondements physiques et humains de l'utilisation des
pesticides et engrais chimiques pour la
culture des légumes 58
3.2.2. Utilisation des pesticides 59
3.2.3. Stockage des pesticides et gestion des emballages 61
3.2.4. les risques sanitaires et environnementaux des
pesticides 61
3.3. PERSPECTIVES 64
3.3.1. A l' endroit des maraîchers 64
3.3.2. A l' endroit du Ministère de l'Agriculture, de
l'Elevage et de la Pêche (MAEP) 64
3.3.3. A l' endroit du Ministère du Cadre de vie et du
Développement Durable 65
3.3.4. A l' endroit du Ministère de la Santé
Publique (MSP) 65
3.3.5. A l'endroit des ONG, Leaders d'opinion et
Autorités locales 66
CONCLUSION 68
Références bibliographiques 70
Annexes 77
Table des matières 91
| 


