|

UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI
(UAC)
*******
FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENSES
HUMAINES
(FLASH)
**********
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
(DGAT)
************
OPTION : GEOGRAPHIE PHYSIQUE
MEMOIRE DE MAITRISE
FONDEMENTS BIOPHYSIQUES DE LA PRODUCTION
PISCICOLE DANS LA COMMUNE DE SÔ-AVA
Réalisé par :
Domiho Honoré OKPOUE
Sous la direction de :
Prof. Euloge OGOUWALE
Professeur Titulaire au
DGAT/FLASH/UAC
Soutenu, le 30/12/2016
2
Sommaire
Dédicace 3
Sigles et acronymes 4
Remerciements 5
Résumé 6
Abstract 6
Introduction 7
CHAPITRE I: ETAT DES CONNAISSANCES, PROBLEMATIQUE, CLARIFICATION
DES CONCEPTS ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE
10
1.1- Etat des connaissances 10
1.2- Clarification des concepts 13
1.3-Problématique 15
1.4- Démarche méthodologique 18
CHAPITRE II: FACTEURS BIOPHISIQUES DU DEVELOPPEMENT DE
LA
PISCICULTURE 26
2.2 Différentes formes de la pisciculture 28
2.3 Facteurs biophysiques de la production piscicole dans la
Commune de Sô-
Ava 29
2.4 Exigences écologiques des espèces
élevées 38
CHAPITRE III: CONTRAINTES ET STRATEGIES DE RENFORCEMENT POUR UNE
MEILLEURE CROISSANCE DE LA PRODUCTION
PISCICOLE DANS LA COMMUNE DE SÔ-AVA 49
3.1 Contraintes de la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava 49
3.2 Stratégies de renforcement pour une meilleure
croissance de la production
piscicole dans la Commune de Sô-Ava 61
Conclusion 73
Bibliographie 75
Liste des tableaux 84
Liste des figures 84
Liste des photos 85
Liste des planches 85
ANNEXES 86
Table des matières 95
3
Dédicace
A :
V' mon père Victorin OKPOUE et ma mère
Rosaline AKPADEGNON pour avoir fait de moi un homme instruit ; recevez ici le
fruit de vos sacrifices quotidiens
V' toutes personnes et organisations qui oeuvrent
pour un développement durable, la lutte contre la pauvreté et la
crise alimentaire ; soyez fier de vos engagements.
4
Sigles et acronymes
ASECNA : Agence pour la Sécurité
de la Navigation Aérienne en Afrique
et au Madagascar
BIDOC : Bibliothèque et Centre de
Documentation
CARDER : Centre Agricoles Régionaux pour
le Développement Rural
CDI : Centre pour le Développement
Industriel
COMHAFAT : Conférence
Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats
Africains Riverains et l'Océan Atlantique
DP : Direction des Pêches
AIMARA : Association de spécialistes
oeuvrant pour le développement et
l'application des connaissances sur les poissons et les relations
Homme-Nature
FAO : Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et
l'Agriculture
FPEIR : Forces-Pressions- Etat- Impacts-
Réponses
FSA : Faculté des Sciences
Agronomiques
INSAE : Institut National de la Statistique et
d'Analyse Economique
MAEP : Ministère de l'Agriculture, de
l'Elevage et de la Pêche
MARP : Méthode Active de Recherche
Participative
MFCD : Ministère Français de la
Coopération et du Développement
DGAT : Département de Géographie
et Aménagement du Territoire
PDC : Plan de Développement Communal
PROVAC : Projet de la Vulgarisation de
l'Aquaculture Continentale
RGPH : Recensement Général de la
Population et de l'Habitation
SCDA : Secteur Communal pour le
Développement Agricole
PADPPA : Programme d'Appui au
Développement Participatif de la Pêche
Artisanale
PANA : Programme d'Action National d'Adaptation
aux changements
climatiques
LAMS : Lycée Agricole Médji de
Sékou
CTOP : Coordination Togolaise des Organisations
Paysannes et
de Producteurs Agricoles
5
Remerciements
La réalisation de ce mémoire aurait
été impossible sans l'aide de nombreuses personnes que je tiens
à remercier. Tout d'abord, je témoigne ma profonde gratitude
à mon Maître de mémoire, Professeur Euloge OGOUWALE,
Professeur titulaire au Département de Géographie et
Aménagement du Territoire (DGAT) à l'Université
d'Abomey-Calavi, qui a accepté diriger ce mémoire malgré
ses multiples occupations. Je remercie tout le corps professoral du DGAT pour
avoir assuré ma formation et tous les collaborateurs du Professeur
Euloge OGOUWALE pour leurs multiples conseils et formations. Je remercie tous
les membres du Jury de soutenance qui ont accepté d'examiner les
résultats de mes travaux de recherche.
Je dis mes sincères remerciements aux Doctorants
Félix H. ZOUNDJE et Louis SOHE; Monsieur Jean Djissou et à mon
directeur de stage Monsieur Loth ZOSSOU pour leurs
générosités, leurs bienveillances, leurs multiples
orientations et conseils. J'adresse aussi mes sincères remerciements
à mes frères Fidèl OKPOUE, Philippe DE MONTIGNY, ma grande
soeur Stéphanie PAGEAU, mes soeurs Marie LORANGER, Noëline,
Pascaline, Agolétine et Benoîte OKPOUE pour leur soutien moral et
leur amour fraternel ; recevez ici le témoignage de mon très
profond attachement.
Je dis merci à mon tuteur Monsieur NOUDEWATO
Djètonda Valentin, son épouse et ses enfants pour m'avoir
accepté chez eux durant toute ma formation. De même, je remercie
Monsieur Abel KOUYONOU, son épouse et ses enfants pour m'avoir offert
l'hospitalité lors de mon stage à Ganvié. Mes
sincères remerciement à la famille ZODJI en occurrence à
Madame Murielle ZODJI épouse DJAMAGNAN Arnaud et à mon fieul
Nauriel DJAMAGNAN pour leurs encouragements et gestes d'amour. Je n'oublie pas
Elizabeth BERGERON pour sa contribution. Enfin, je présente ma gratitude
à mon oncle Isaac OKPOE, et à tous mes amis pour leur soutien
combien inestimable.
6
Résumé
La présente étude vise à
appréhender une meilleure connaissance des fondements biophysiques de la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.
L'approche méthodologique utilisée est
fondée sur la recherche documentaire, les observations et les
enquêtes socio-anthropologiques. Les entretiens ont été
réalisés avec les pisciculteurs, les personnes ressources et
autres acteurs oeuvrant pour le développement de la pisciculture. Le
modèle FPEIR a été utilisé pour analyser les
résultats.
L'analyse des données recueillies montre que la Commune
de Sô-Ava dispose d'important atout et potentialité biophysique
pour le développement de la pisciculture. De même, l'analyse des
données climatologiques, des paramètres physico-chimiques des
espèces et du milieu d'étude montrent que le milieu est encore
favorable à l'élevage de Clanias ganiepinus et du
Tilapia Oneochnomis niloticus. La température maximale et
minimale du milieu d'étude varie entre 23.5°C et 31.9°C or
celle de la croissance pour le Tilapia Oneochnomis niloticus oscille
entre 16°C à 38°C et de 26° à 30°C pour le
Clanias ganiepinus.
Malgré ces atouts et potentialités, la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava demeure embryonnaire
à cause des contraintes d'ordres climatiques, techniques,
socioéconomiques et du choix des infrastructures piscicoles selon les
réalités de chaque arrondissement. Face à ces contraintes
les pisciculteurs développent des techniques d'adaptation
endogène qui sont peu efficaces. Ainsi, les stratégies ont
été proposées pour une meilleure croissance de la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.
Mots clés : Sô-Ava, fondements
biophysiques, production piscicole, enquête socio-anthropologiques,
contraintes.
Abstract
The present study aims at apprehending a better knowledge of
the bases biophysics of the piscicultural production in the Commune of
Sô-Ava.
The methodological approach used is founded on the information
retrieval, the socio-anthropological observations and investigations. The talks
were carried out with the pisciculturists, the people resources and other
actors working for the development of pisciculture. Model FPEIR was used to
analyze the results.
The analysis of the data collected shows that the Commune of
Sô-Ava has significant asset and potentiality biophysics for development
of pisciculture. In the same way, the analysis of the climatological data, the
physicochemical parameters of the species and the medium of study show that the
medium is still favorable to the breeding of Clanias ganiepinus and of
Tilapia Oneochnomis niloticus. The maximum and minimal temperature of
the medium of study varies between 23.5C and 31.9C but that of the growth for
Tilapia Oneochnomis niloticus oscillates between 16C with 38C and of
26 with 30C for Clanias ganiepinus.
In spite of these assets and potentialities, the piscicultural
production in the Commune of Sô-Ava remains embryonic because of
constraints of the climatic, technical, socio-economic natures and of the
choice of the piscicultural infrastructures according to realities' of each
district. Face to face these constraints the pisciculturists develop techniques
of endogenous adaptation which are not very effective.Thus, the strategies were
proposed for a better growth of the piscicultural production in the Commune of
Sô-Ava.
Key words: Sô-Ava, bases biophysics,
piscicultural production, investigation socio-anthropological, constraints.
7
Introduction
Depuis 1970, l'Afrique de l'Ouest connaît une baisse des
précipitations qui a eu des répercussions sur les ressources en
eau superficielle et les écosystèmes (Olivry, 1983). Au
Bénin, la pêche continentale, principale source de la production
nationale halieutique (80%), fait l'objet d'utilisation d'engins et pratiques
de pêche destructrices des ressources. A cela, s'ajoutent des contraintes
environnementales : ensablement du chenal, pollution, changements climatiques
(COMHAFAT, 2014). Ainsi, la dégradation de l'environnement évolue
au gré des conditions bioclimatiques et de l'action anthropique. Elle
est d'autant plus inquiétante qu'elle ne laisse indifférents ni
acteurs de développement, ni chercheurs (Boko, 2000) cité par
(Wanou, 2013).
Pour leurs importances socioéconomiques, la pêche
et l'aquaculture contribuent à la sécurité alimentaire de
façon directe et indirecte par la provision d'un aliment de très
haute qualité nutritionnelle, l'auto-emploi et la
génération de revenus. La pêche a été une
source majeure de revenus au Bénin pour les communautés
vulnérables de pêcheurs à travers les
générations et une source de protéines animales, parfois
la seule accessible à des couches de populations pauvres vivant
près de plans d'eau et des communautés isolées en milieu
rural (Rurangwa et al., 2014).
Or, actuellement, avec le nombre d'usagers, le
perfectionnement des méthodes et des pratiques de pêche conduisent
non plus à une simple cueillette, mais à des
prélèvements plus ou moins anarchiques et importants dans un
milieu aquatique de plus en plus sollicité pour d'autres usages et de
plus en plus dégradé par les nuisances multivariées
(Arrignon, 1998). Dans ce contexte, la production de la pêche
continentale au Bénin est surexploitée au-delà de ses 18
000 tonnes par an représentant le Maximum Sustainable Yield (MSY)
(PADPPA, 2011). De même, il faut ajouter que les changements intervenus
au niveau des caractéristiques physico-chimiques du lac Nokoué
couplés aux techniques de pêche ont entrainé la
rareté et le risque de disparition de certaines espèces
8
halieutiques du lac (Clédjo et Ogouwalé, 2009).
Cependant, cette multitude de facteurs, combinés à la
surpêche et au changement climatique, accélèrent la
surexploitation des stocks halieutiques. Cela risque à longs termes
d'engendrer une situation de dégradation irréversible de
l'écosystème béninois.
Ces phénomènes ont entraîné la
baisse de la production halieutique qui a engendré des effets
socio-économiques sur les populations riveraines (Djissou, 2013). A cela
s'ajoute l'expansion démographique qui entraine une grave
détérioration des conditions d'approvisionnement des populations
en poissons. Cette détérioration se traduit également par
un appauvrissement des populations de pêcheurs et nécessite le
développement de la pisciculture (Sohou et al., 2009).
Aujourd'hui, la pisciculture n'a pas encore atteint une
dimension économique viable en Afrique subsaharienne, que ce soit en
termes de volume ou en termes de place de cette activité dans les
systèmes de production (MFCD, 1991).
Malgré l'existence de systèmes traditionnels de
production du poisson et une industrie aquacole qui peine à
démarrer, la contribution de la pisciculture (<1%) à la
production halieutique nationale est très marginale (156 à 386
tonnes par an selon les sources) et peu diversifiée essentiellement
composée de Clarias (51%) et de tilapia (47%) (MAEP, 2011). Or, le pays
dispose en revanche des potentialités de développement du secteur
des pêches et de l'aquaculture. Dès lors, la pisciculture
constitue un secteur d'avenir dans ce pays, car il dispose d'atouts
considérables liés aux facteurs naturels (réseau
hydrographique) et à l'existence de marchés pour sa production de
clarias et de tilapia (COMHAFAT, 2014).
Au regard de ces contraintes que connait la pêche, la
présente étude se veut de contribuer à une meilleure
connaissance des facteurs biophysiques de la production piscicole dans la
Commune de Sô-Ava afin de résoudre toute les
9
préoccupations d'ordres socioéconomiques,
écologiques et environnementales liées à la production de
poisson.
Ce travail s'articule autour de trois (03) chapitres :
Le premier présente les fondements théoriques et
la démarche méthodologique de recherche adopté. Le
deuxième chapitre est consacré aux fondements biophysiques du
développement de la pisciculture dans la Commune de Sô-Ava. Et
enfin le troisième chapitre met l'accent sur les contraintes et les
mesures de renforcement pour un meilleur développement de la production
piscicole dans la Commune de Sô-Ava,
10
CHAPITRE I
ETAT DES CONNAISSANCES, PROBLEMATIQUE,
CLARIFICATION
DES CONCEPTS ET DEMARCHE
METHODOLOGIQUE
Ce chapitre présente l'état des connaissances, la
problématique et la démarche
méthodologique adoptée pour appréhender
les fondements biophysiques de la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava.
1.1- Etat des connaissances
De nombreux auteurs ont parlé de l'influence des
facteurs biologiques et physiques (facteurs climatiques et physico-chimiques)
sur les écosystèmes aquatiques, de la baisse de la production
halieutique et de la question du développement de la pisciculture.
Selon Hegbé (2012), la pêche constitue avec
l'agriculture les activités principales des habitants lacustres.
D'après les travaux de Wanou (2013), il est montré qu'entre 1995
et 2006, le taux de pêcheurs a chuté de 10,88 % à
Sô-Ava. Cette chute remarquée serait liée aux faibles
revenus des pêcheurs. Pour Hounkponou (2015), les plans d'eau
exploitables constituent la principale ressource naturelle de la Commune. Les
populations disposent des techniques et des équipements variés
pour leur exploitation. La pêche y est pratiquée sous toutes ses
formes avec à la clé la pêche à acadja. Des trous
à poissons ainsi que l'utilisation des filets sont entre autres les
techniques de pêches couramment utilisées par les
communautés des pêcheurs. Cependant, l'activité de
pêche reste confrontée à la baisse de la
productivité à cause de l'encombrement du lac par les acadja (6
000 ha) et les jacinthes d'eau, l'utilisation des engins de pêche
prohibés et la défaillance de l'encadrement technique. MAEP
(2009) ajoute que les besoins en poissons des populations sont de plus en plus
accrus alors que les prises ont chuté d'environ 15 %.
Selon Boko (1988), les fluctuations climatiques et les `'chocs
climatiques» qui ébranlent le système économique et
tout le tissu social seraient la cause cette
11
baisse. De même Sircoulon (1990) et Afouda (1990)
rapportent aussi que la dynamique du climat associée aux facteurs
sociotechniques entraine des bouleversements écologiques et
génère une fragilisation des modes d'existence. Gboni (1995) a
expliqué que le climat intervient aussi bien dans la vie biologique des
espèces que dans les activités de pêche. De même,
Moss et al.(2005) soulignent que le climat influence la
productivité des lacs en agissant sur l'apport annuel d'eau et
d'énergie, sur l'hydrologie du bassin versant et sur le taux de
renouvèlement de l'eau, ainsi que sur l'apport des nutriments vers le
plan d'eau.
Houadégla (1991) a exposé que la variation de la
température induit inévitablement la variation de l'eau, qui est
un paramètre de confort pour les espèces aquatique/halieutique.
De même, Ogouwalé (2007) stipule que les tendances
pluvio-thermométriques, associées à la dynamique
bathymétrique, ont entrainé des variations des
caractéristiques biologiques, hydrologiques et physico-chimiques du lac.
L'analyse des données montre une diminution de plus de 50 % de la
richesse spécifique du lac Nokoué entre 1950 et 2001.
Akognongbé (2011) a montré que les
variabilités pluviométriques ont entrainés la
détérioration des conditions écologiques du milieu et leur
diminution est l'une des causes des mutations des écosystèmes
dans le lac Nokoué. Pour Djissou (2013), la production halieutique sur
le lac Nokoué a connu une baisse de 2,88% de 1987 à 2000. Il a
montré que cette baisse de la production halieutique trouve ses
fondements dans l'augmentation de la température de l'eau, de
l'irrégularité des hauteurs de pluies, de l'étroitesse de
l'embouchure de Cotonou, de la multiplication des parcs acadja, de
l'utilisation des techniques prohibées et de la pollution des eaux.
Quant à Sohè (2011), l'envahissement du lac Nokoué par la
jacinthe d'eau entraine une baisse de la productivité halieutique.
Houedanou (2013), faire ressortir que les débordements de l'eau de la
rivière Sô rendent la pêche difficile aux pêcheurs.
Or, la pêche est l'activité principale des populations de la
Commune de Sô-Ava.
12
Cependant, INSAE (2010 et MAEP-DP 2013) font ressortir dans
leur rapport que la production halieutique est presque stagnante avec une
demande croissante en produits halieutiques et que le déficit est
comblé par des importations sans cesse croissantes de poissons
congelés, qui sont passées de l'ordre de 20 000 tonnes en 2000,
à plus de 78.000 tonnes en 2008 et 80000 tonnes en 2011.
Par ailleurs, Tchéoubi (2006) dans ses travaux,
relève que le pays dispose d'un réseau hydrographique riche en
cours d'eau parmi lesquels se trouvent les fleuves Ouémé, Mono et
Couffo, les lacs Nokoué et Ahémé, la lagune
côtière et celle de Porto-Novo. La capacité de production
de ces cours et plans d'eau pourrait satisfaire les besoins halieutiques de la
population béninoise. De même, pour Igué (1975), la Commune
de Sô-Ava se trouvant dans la basse vallée de
l'Ouémé, qui fait partie des zones humides du Sud-Bénin,
regorge d'énormes potentialités. Dans cette optique, Pirot et
al.(1994) cité par Wanou(2013) confirment que les zones humides
sont des zones à écosystèmes extrêmement productifs
qui procurent toutes sortes d'avantages. Dans ce contexte, Okou et al.
(2007) soulignent que dans le souci du développement tant au niveau
local que national voire continental et même mondial, la mise en valeur
des ressources naturelles après l'étude approfondie d'impacts
environnementaux reste une option indiquée. L'exploitation de ces
ressources se fait d'une manière libre et incontrôlée, ce
qui entraine la dégradation du milieu naturel.
Mais jusqu'ici, peu d'études à l'échelle
locale ont abordé de façon spécifique la
problématique des facteurs biophysiques de la production piscicole dans
la Commune de Sô-Ava. Les données disponibles sont très
générales et ne permettent pas de cerner les fondements
biophysiques de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava afin
d'atténuer l'ampleur des effets socio-économiques de la baisse de
la production halieutique sur les populations riveraines mais aussi d'offrir
à la population une protéine animale (poisson) de qualité
et en plein temps. C'est pour cette raison et pour combler cette
13
discontinuité dans la connaissance scientifique que
résident la spécificité et l'originalité du
présent sujet.
1.2- Clarification des concepts
Pour faciliter la compréhension de ce travail, il est
nécessaire de clarifier les concepts clés employés.
Pêche : Selon Arrignon (1998), la
pêche constitue un prélèvement, dans le milieu aquatique,
d'animaux aquatiques comestibles. Elle doit être en harmonie avec la
capacité de production de ce milieu. Dans l'esprit des cadres
intellectuels du développement rural (Direction des pêches) et aux
termes de l'arrêtés n° 069/ MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 et
en son article2, on entend par pêche, la capture de tout poisson
crustacé ou mollusque ; son champ d'application ne s'étend pas
à la capture des mammifères aquatiques. Qu'ils s'agissent de
capture dans les eaux marines ou dans les eaux continentales, cette conception
du mot pêche ne verra donc pas son champ d'application s'étendre
ni aux dauphins ni aux hippopotames. Dans le cadre de cette étude, la
pêche désigne la capture des poissons sur les plans et cours d'eau
continentale.
Production halieutique : selon le «
dictionnaire universel » (2008), il s'agit des produits issus de la
pêche. D'après FAO, c'est l'exploitation des ressources vivantes
aquatique. Elle regroupe les différents modes d'exploitation et de
gestion (pêche aquaculture) des espèces vivantes
(végétales ou animales) exercées dans tous les milieux
aquatiques. Mais la production halieutique dans cette étude
s'intéresse à l'exploitation et à la gestion des
ressources issues de la pêche continentale.
Fondements biophysiques : selon le
dictionnaire Petit Larousse (2010), les fondements biophysiques sont les bases
d'étude des phénomènes biologiques, en particulier les
processus de transformation d'énergie, par les méthodes de la
physique. Wikipédia (2015) pour sa part définit la biophysique
dans le domaine de l'environnement comme la « représentation locale
ou globale des composants
14
de l'environnement biologique et physique de la
biosphère ». Dans le cadre de cette étude ils
désignent les facteurs biologiques, physiques (naturel), voir
physico-chimiques qui participent au développement de la pisciculture et
dont l'extrême l'influence.
Production piscicole : encore appelé
la pisciculture selon Arrignon (1998), elle est l'élevage,
l'élaboration d'un produit appelé poisson. Comme tout
élevage, elle est tributaire d'un certain nombre impératifs se
rapportant au degré de rusticité de l'espèce
élevé. D'après Djissou (2013), la pisciculture est la
technique d'élevage de poissons dans leur milieu naturel ou artificiel.
Elle peut se fait en étang, en bassin ou en cours d'eau (cage
flottante). Dans le cadre de ce travaille la production piscicole est
défini comme l'élevage du poisson chat africain Clarias
gariepinus et du Tilapia Oreochromis niloticus dans les eaux
continentaux en cage flottante, bassin, enclos, bac-hors sol ou
étangs.
Aquaculture : selon le dictionnaire universel
(2002), l'aquaculture est l'ensemble des techniques d'élevage des
êtres vivants aquatiques (animaux et végétaux). Et pour FAO
(2004), l'aquaculture est la culture d'organismes aquatiques, elle comprend
celle des Poissons, des Mollusques, des Crustacés et des
végétaux aquatiques. Cette culture implique diverses formes
d'intervention dans le processus d'élevage pour augmenter la production,
par exemple l'alimentation des animaux en élevage, la protection contre
les prédateurs, etc. La culture implique également la
propriété individuelle ou juridique du stock cultivé.
Etang sur nappe phréatique : Selon le
centre de métiers de Covè (2010), un étang sur nappe
phréatique est une infrastructure dont les digues et assiettes sont
aménagées à la manière d'un étang
vidangéable mais qui est alimenté par la nappe
phréatique.
15
1.3-Problématique
La problématique prend en compte la justification du
sujet, les hypothèses de travail et les objectifs de recherche.
1.3.1- Justification du sujet
Au Bénin, les écosystèmes du lac
Nokoué ont été, au cours des trois dernières
décennies, marqués par une dégradation du fait de la forte
variabilité climatique associée à une plus grande
fréquence des phénomènes extrêmes et à une
augmentation des températures (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 et
Ogouwalé, 2007). Dans ce contexte, l'environnement du lac Nokoué
a connu une baisse des précipitations et une augmentation des
températures qui ont entrainé des modifications au niveau des
composantes environnementales. Ces modifications ont engendré des
perturbations biologiques et écologiques des espèces rendant
défavorable la production (baisse de la production). Cette baisse de la
production halieutique engendre des effets socio-économiques sur les
populations riveraines (Djissou, 2013).
Malgré le rôle primordial du poisson dans
l'alimentation, le Bénin accuse un déficit halieutique dans la
région avec un très faible apport du poisson par individu par an
(9.4 kg) et une faible contribution de l'apport protéique du poisson
(28.5%) par rapport aux autres sources protéiques animales
(Béné et Heck, 2005). Or, les normes de la FAO recommandent 15
à 18 kg de poisson/habitant/an (FAO, 2012). A cet effet, plus de la
moitié des produits halieutiques consommés en République
du Bénin proviennent de l'étranger d'après le rapport sur
l'état de l'économie béninoise de 1997. De même le
rapport de (MAEP, 2008) sur l'état de la production halieutique
consommé au Bénin souligne que la production halieutique actuelle
ne permet de couvrir que 44 % des besoins nationaux en poissons estimés
à 90.000 tonnes/an. Le déficit est comblé par des
importations croissantes de poissons congelés, qui sont passées
de l'ordre de 20.000 tonnes en 2001, à plus de 78.000 tonnes en 2008,
y
16
compris la part de réexportation vers le Nigeria. Ainsi
la pêche continentale est en déclin (Sohou et al., 2009).
Or, la pêche et l'aquaculture contribuent à la
sécurité alimentaire essentiellement de trois manières :
augmenter les disponibilités alimentaires, fournir des protéines
animales hautement nutritives et d'importants oligo-éléments,
offrir des emplois et des revenus que les gens utilisent pour acheter d'autres
produits alimentaires.
Cependant, un peu plus de 100 millions de tonnes de poissons
sont consommées dans le monde chaqueannée, et assurent à
2,5 milliards d'êtres humains au moins 20 % de leurs apports moyens par
habitant en protéines animales. Cela peut aller à plus de 50 %
dans les pays endéveloppement. Dans certaines des zones les plus
touchées par l'insécurité alimentaire en Asie et en
Afrique, par exemple les protéines de poisson sont indispensables car,
elles garantissent unebonne partie du niveau déjà bas d'apport en
protéines animales (Fermon / Imara, 2008).
Dans ce contexte, il apparait impérieux de promouvoir
la pisciculture qui se fera grâce à l'intensification des
espèces locales (Fiogbé etal., 2002). De même,
pour réduire la pression sur la pêche et la menace
d'insécurité alimentaire liée au manque récurrent
de poissons, la pisciculture se présente comme une activité
alternative incontournable à promouvoir pour laisser les stocks de
poissons de pêche se régénérer (Rurangwa et
al.,2014).
Par conséquent, avec le développement de la
pisciculture, la production nationale de poissons augmentera (20000 tonnes),
l'importation de poissons congelés sera réduite (9000 tonnes),
des économies en devises seront réalisées, les revenus des
pêcheurs auront augmenté, l'effort de pêche sera
réduite et la productivité des plans d'eau
améliorée (MAEP, 2011).
C'est ainsi que le développement de la pisciculture
dans la Commune de Sô-Ava qui est une Commune lacustre où la seule
source de protéine animale dont la population à accès est
le poisson s'avère indispensable. Dès lors, l'implantation
17
des infrastructures piscicole se fait dans les zones où
la topographie de terrain présente une pente douce, le sol est
imperméable et il y a la disponibilité de l'eau de bonne
qualité de façon permanente et naturelle (Djissou, 2013).
Des constats énumérés plus haut, il se
dégage les questions suivantes :
- quels sont les facteurs biophysiques de la production
piscicole dans la Commune de Sô-Ava ?
- quelles sont les contraintes de la production piscicole dans
la Commune de Sô-Ava ?
- quelles sont les mesures pouvant permettre d'accroître
la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava ?
C'est dans le but de répondre à ces questions
que le sujet intitulé « Fondements biophysiques de la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava » a
été choisi dans le cadre de la réalisation d'un
mémoire de maîtrise en géographie. Pour répondre
à ces interrogations des hypothèses sont émises.
1.3.2- Hypothèses de travail
Les hypothèses qui sous-tendent cette recherche sont les
suivantes :
? plusieurs facteurs biophysiques favorisent la production
piscicole dans la Commune de Sô-Ava ;
? plusieurs contraintes sont liées à la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava ;
? il existe plusieurs mesures permettant d'accroitre la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.
1.3.3-Objectifs de recherche
L'objectif global de cette recherche est d'étudier les
fondements biophysiques de la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava.
De façon spécifique il s'agit de :
? identifier les facteurs biophysiques du développement
de la pisciculture dans la Commune de Sô-Ava ;
18
+ analyser les contraintes liées à la production
piscicole dans la Commune de Sô-Ava ;
+ proposer les stratégies de renforcement pour une
meilleure croissance de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava
et un projet d'insertion professionnelle.
1.4- Démarche méthodologique
La démarche méthodologique adoptée comprend
essentiellement les étapes
suivantes :
> données utilisées ;
> collecte des données ;
> traitement des données et analyse des
résultats obtenus.
1.4.1- Données utilisées
Les données utilisées dans le cadre de cette
étude sont pour essentiel :
y' les données climatologiques (précipitations,
températures, humidités) de la série de 1986-2015 sont
extraites de la base des données de l'Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA), des relevés des stations de Cotonou ;
y' les statistiques de production piscicole de la série
de 2008-2014 ont été colletés au CARDER
Atlantique/Littoral;
y' Les données pédologiques et hydrologiques de
la Commune de Sô-Ava sont recueillies à travers les recherches
documentaires ;
y' les statistiques démographiques de la Commune de
Sô-Ava du Récensement Général de la Population et de
l'Habitation de RGPH3 et 4 ont été recueillies à
l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) afin
d'apprécier la dynamique de la population de la Commune de Sô-Ava
;
y' les données sur l'oxygène dissous, la
salinité et le pH du réseau hydrographique de la Commune de
Sô-Ava sont recueillies à travers des recherches documentaires
;
19
w' les données relatives aux deux espèces
d'intérêt aquacole de la Commune de Sô-Ava (Clarias
gariepinus et Tilapia Oreochromis niloticus) sont recueillies
à travers des recherches documentaires ;
w' les informations qualitatives qui sont obtenues à
partir des questionnaires adressés aux pisciculteurs/pêcheurs et
autres riverains du Lac ont complété les données
recueillies.
1.4.2- Collecte des données
Cette étape comprend la recherche documentaire et les
enquêtes de terrain.
? Recherche documentaire
Les ouvrages et travaux ayant rapport à la
présente étude ont été consultés dans
différentes institutions et centres de documentation (tableau I).
20
Tableau I:Structures/centres de documentation
visités et informations recueillies
|
Institutions/centres de documentation
|
Nature des documents
|
Types d'information recueillie
|
|
FLASH
|
Mémoires et thèses
|
-Information sur la méthodologie de recherche
-Informations générales sur
les
écosystèmes du lac Nokoué, de la rivière
Sô et des cours d'eau de la Commune de Sô-Ava
|
|
Bibliothèque centrale
de l'UAC
|
-Livres, thèses, articles et rapport
|
-Information générales sur le lac
Nokoué et la Commune de Sô-Ava
|
|
FSA (BIDOC)
|
Thèses, Livres, mémoires, articles, rapports
|
-Information sur la production
piscicole au sud du Bénin en générale et
dans la Commune de Sô-Ava en
particulier et données physico-
chimiques des cours
et plans d'eau de la Commune de Sô-Ava
|
|
Bibliothèque de
l'EPAC
|
Livres, mémoires de
Master, articles
|
Informations sur la production
piscicole au sud du Bénin.
|
|
Archives communales
|
Livres, articles, PDC,
SDAC
|
- Informations générale sur la
pisciculture, données pédologiques et
hydrologiques de la Commune de Sô-Ava
|
|
ASECNA
|
|
Données climatologiques
|
|
Direction des
pêches/CARDER Atlantique/littoral
|
Rapports, livres, articles
|
Données sur les productions piscicoles de la Commune de
Sô-Ava
|
|
MAEP
|
Livres, rapports
|
Information générale sur la pêche et
l'aquaculture au Bénin
|
|
INSAE
|
Rapports et livres
|
Données démographiques
|
|
SCDA Sô-Ava
|
Rapports, livres et articles
|
Informations générales sur la
production Piscicole dans la Commune de Sô-Ava
|
Source : Travaux de terrain,
novembre 2015
La recherche documentaire a permis de mieux appréhender
les articulations ainsi que les contours du sujet. Elle a été
complétée par des informations recueillies lors des travaux de
terrain.
? Enquêtes de terrain
Les travaux de terrain ont permis de compléter et
d'actualiser les informations documentaires. Ils ont permis d'apprécier
les facteurs biophysique de la
21
production piscicole, les contraintes liées à
cette production, la perception de l'évolution de cette production dans
la Commune de Sô-Ava par la population et sa rentabilité afin de
proposer des mesures pouvant permettre à une bonne croissance de cette
activité dans la Commune de Sô-Ava. Ils ont été
possibles grâce à l'utilisation d'un choix raisonné.
? Echantillonnage
L'échantillon a été constitué
à deux niveaux, d'abord pour identifier les arrondissements où se
sont déroulées les enquêtes, ensuite pour identifier la
population cible.
Les critères de choix des arrondissements se
définissent comme suit :
- villages ou arrondissements au bord du lac Nokoué ou
traversé par la rivière Sô où la plupart des
habitants exercent comme activité principale la pisciculture, la
pêche et autres ;
- villages ou arrondissements dans lesquels les
problèmes écologiques et des débordements des hautes eaux
(envahissement de la jacinthe d'eau, pollution de l'eau, inondation etc.) sont
les plus perceptibles.
Quant aux critères de choix de la population cible, il a
été retenu :
- les personnes ressources (chefs de villages, chefs
d'arrondissement, personnels d'encadrement rural (CARDER), les chefs
traditionnels, les intellectuels communautaires), compte tenu de l'importance
des informations qu'elles détiennent en raison de leur ancienneté
dans le milieu, de leurs savoirs endogènes de la gestion et sur
l'état de la pêche sur les plans d'eau continentaux, de leurs
connaissances dans le domaine piscicole ;
- les pisciculteurs, les pêcheurs, les mareyeuses, les
maraîchères, les artisans, les commerçant(e)s, les
consommateurs et autres.
La formule utilisée pour déterminer la taille de
l'échantillon est la suivante : N= t2 X
pXq/e2 (Schwartz, 2002) Avec :
N : la taille de l'échantillon requise
;
22
t : le niveau de confiance à 95 % (valeur
type de 1,96) ;
p : le degré
d'homogénéité de la population ;
q : le degré de non
homogénéité de la population (pour cette étude p=
q= 0,5
puisque la prévalence estimative n'est pas connu d'avance)
;
e : la marge d'erreur à 5 % (valeur type
de 0,05) qui donne la précision
recherchée ou l'intervalle de confiance.
En se basant sur cette formule 384 personnes ont
été enquêtées pour la
réalisation de cette étude.
Pour que l'échantillon soit représentatif du fait
que les arrondissements n'ont
pas la même taille, la formule des quotas a permis de
déterminer le nombre de
personnes interrogées dans chaque village ou
arrondissement. Cette formule est
la suivante :
n = Xi ×Z / X avec :
n = Nombre d'individus à questionner par village ou
arrondissement ;
Xi = Population par village ou par arrondissement ;
Z = Nombre total d'individus à questionner ;
X = Nombre total d'individus dans les villages ou arrondissements
retenus.
Tableau II : Liste des différentes
localités retenues et le nombre de personnes enquêtées par
arrondissement
|
Commune de
Sô-Ava
|
Arrondissement
|
Population
|
Nombre de personnes
enquêté
|
|
Ahomey-Lokpo
|
11026
|
47
|
|
Ganvié 1
|
19155
|
81
|
|
Ganvié2
|
18017
|
76
|
|
Sô-ava
|
13347
|
56
|
|
Vekky
|
29476
|
124
|
|
Total
|
91021
|
384
|
Source : INSAE 2013 et calculs,
avril 2016
23
A base de ces résultats du tableau II, 384 personnes
ont été interrogées dans cinq(5) arrondissements sur les
sept que compte la Commune de Sô-Ava. La réalisation des
enquêtes de terrains a nécessité l'utilisation des
différentes techniques et outils de collecte de données.
? Outils de collecte des données
Les outils utilisés pour la collecte des données
sont le questionnaire et les guides d'entretien et d'observation. Ces outils
ont permis de consigner les données nécessaires pour une bonne
compréhension des facteurs biophysiques de la production piscicole dans
la Commune de Sô-Ava.
Un appareil photographique numérique est utilisé
pour prendre des vues directes et instantanées des sites de production
piscicole et autres éléments de l'environnement concernés
par cette étude.
? Techniques
Dans le cadre de ce travail, la Méthode Active de
Recherche Participative (MARP) est utilisée pour collecter les
informations auprès des pisciculteurs, des intellectuels communautaires
(ayant une connaissance des facteurs biophysiques de la pisciculture), du
personnel d'encadrement rural, etc. à l'aide des questionnaires. Elle
part de l'hypothèse que les populations ont élaboré un
savoir au fil du temps et qu'il faut nécessairement le respecter pour
mener des enquêtes, notamment dans le domaine des pêcheries
(Ogouwalé, 2007).
En outre, des interviews directes sont réalisées
dans les localités visitées afin d'obtenir des populations leurs
perceptions sur la baisse de la production halieutique du lac Nokoué et
l'importance du retour à la pisciculture.
1.4.3-Traitement des données
Les différentes données collectées ont
fait l'objet d'un traitement selon leur nature. Le traitement des
données a consisté au dépouillement manuel des
questionnaires. Les paramètres statistiques tels que la moyenne
arithmétique et
24
la fréquence ont été utilisés. Par
ailleurs le logiciel ArcView est utilisé pour la réalisation de
la carte administre, topographique et pédologique du milieu
d'étude.
? Moyenne arithmétique
Elle est le paramètre fondamental de tendance central qui
est utilisé pour
caractériser l'état climatique moyen. Elle
s'exprime de la façon suivante :
??
??=? ????
?? ??=??
??
X: Moyenne ; n : Effectif total des
modalités et xi : Modalités du
caractèreétudié.
? Fréquence
Elle est le paramètre qui est utilisé pour
déterminer la proportion de la population interrogée sur un fait
(Djissou, 2013). Elle s'exprime de la façon suivante :
??
F= ?? × ??????
F : Fréquence ; n : Effectif de la
population interrogée sur un fait et N : Effectif total de la
population.
1.4.4- Analyse des résultats
Après le traitement des données, il a
été procédé à une analyse des
résultats. L'analyse des résultats est faite à l'aide du
modèle FPEIR (Forces-Pressions-Etat- Impacts- Réponses). Ce qui a
permis d'évaluer les forces (facteurs naturels favorables) que dispose
la Commune de Sô-Ava pour la production piscicole, les pressions que
connait cette production (pollution des eaux, cherté de l'aliment
poisson et le dynamique du climat), son état embryonnaire et des impacts
sur les composantes sociales (revenu, alimentation, santé) et les
réponses apportées par les populations pour réduire leur
vulnérabilité. Cette analyse a permis d'appréhender
l'évolution des facteurs biophysiques de la production piscicole dans la
comme de Sô-Ava.
25
Le chapitre suivant décrire les différents
facteurs biophysiques de la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava ainsi les exigences écologiques des espèces
élevées.
26
CHAPITRE II
FACTEURS BIOPHISIQUES DU DEVELOPPEMENT DE
LA
PISCICULTURE
Ce chapitre présente la situation géographique,
administrative, les différentes formes de pisciculture, les facteurs
biophysiques de la production piscicole et les exigences écologiques des
espèces élevées.
2.1 Situation géographique et administrative de la
Commune de Sô-Ava
La Commune de Sô-Ava est située dans la
région méridionale du Bénin, dans la basse vallée
de l'Ouémé et comprise entre 6°24' et
6° 38' de latitude nord et entre 2° 21' et
2° 31' de longitude est. La Commune de Sô-Ava est
limitée au nord par les Communes de Zè, de Dangbo et d'Adjohoun,
au sud par la Commune de Cotonou, à l'est par la Commune lacustre des
Aguégués et à l'ouest par la Commune d'Abomey-Calavi
(figure1).

436000
432'000
I.E DEPARTEMENT DE
L'ATLANTIQUE
DANS LE BENIN
N
LA COMMUNE DE SO-AVA
DANS LE DEPARTEMENT
DE
L'ATLANTIQUE
432000
2°20'55.I"
o
b
436000
o Ague
440000
444000 2°30'42.I"
oô
w W
Â
COMMUNE DE ABOMEY-CALAVI
ekky Dogbodj
Vekky Daho
i
·
· to kpakpa
gomey i
me Lokpol. entre
'Ahome=Heun{ne
AHOME1 OKPO
_1
` homey f ibekpâ
hômeyGinn-1w'
Gbessm4
H6UEDO-AGÛEKON Assa e,,,«
Q`Sokomer Akpafe D
Ganvidcomey
DEPARTEMENT DE L'OUEME
DEKAN
1_
N
00
ô
2°20'55.1"
DEPARTEMENT DU LITTORAL
440000
444000
0
2°3042.1"-
N
o o
r-
N
° VEKKY \`\ /
Lc& Nokoué D. ARTEMENT
/ DE L'OUEME
\ /
2 0 2 Km
° GANVIE
LEGENDE
§ Chef lieu de Commune Chef lieu d'Arrondissement
· Village
|
·
|
Cours d'eau temporaire
|
|
Limite d'Arrondissement Limite de Commune Limite de
Département
|
|
Piste communale locale Piste communale principale
Plan d'eau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source: Fond topographique IGN au 1/600000, 1992 Reproduction:
OKPOUE Domiho Honoré, octobre 2016
Travaux de terrain, 2013
inancomey
Agonm
Lokpodji
27
Figure 1 : Situation géographique de la
Commune de Sô-Ava
28
D'une superficie de 218 km2 (INSAE, 2002), elle
compte 118547 habitants et est subdivisée en soixante-neuf (69) villages
répartis dans 7 arrondissements (INSAE, 2013). Il s'agit des
arrondissements de Sô-Ava, Vekky, Houédo-Aguékon,
Dékanmey, Ganvié I, Ganvié II et Ahomey-Lokpo.
La Commune de Sô-Ava est traversée par la
rivière Sô ayant une longueur de 84,4 km et est
caractérisée par sa richesse en plans d'eau (82 %) du territoire
d'où son statut de Commune lacustre (Toffon, 2013).
2.2 Différentes formes de la pisciculture
La pisciculture est l'élevage, l'élaboration
d'un produit appelé poisson. Elle peut se faire dans les retenues d'eau
aménagées, les étangs, les cages etc. En fonction des
intrants utilisés, du niveau d'investissement et du degré
d'implication de l'homme, (Mikolasek et al., 1999) distingue trois
formes de pisciculture qui sont: intensive, semi-intensive et extensive.
La pisciculture intensive consiste à produire dans un
minimum d'eau de grandes quantités de poissons à partir
d'aliments artificiels. Elle est caractérisée par l'utilisation
d'aliments exogènes riche en protéine et d'équipements
adéquats. Celle semi-intensive est caractérisée par une
forte intégration du système agricole et sa capacité
à recycler et à valoriser des nombreux déchets et
effluents agroindustriels. Elle est la plus répandue à cause de
sa souplesse et assure l'essentiel de la production mondiale. Quant à
celle extensive qui est la mise en valeur piscicole de certains plans d'eau
naturels et des retenues d`eau créées à des fins
variées. L'empoissonnement peut aussi se faire à partir du
peuplement naturel de la rivière. En termes de durabilité, elle
détruit peu l'environnement.
Cette dernière forme de pisciculture, encore peu
explorée par les chercheurs (Mikolasek et al., 1999) regroupe
plusieurs modèles de pisciculture reposés sur les dynamiques et
le savoir-faire paysan tel que l'empoissonnement et l'exploitation des mares
semi-permanentes en zones sahéliennes. Cependant, 98
29
% des personnes enquêtées affirme que la forme de
la pisciculture la plus pratiqué dans la Commune de Sô-Ava est la
pisciculture intensive.
2.3 Facteurs biophysiques de la production piscicole dans
la Commune de Sô-Ava
Les fondements biophysiques de la production piscicole mettent
l'accent sur les conditions d'implantation des infrastructures piscicoles. En
effet, d'après Djissou (2013) l'implantation des infrastructures
piscicole se fait dans les zones où :
? il y a disponibilité de l'eau de bonne qualité
de façon permanente, naturelle, facile à obtenir ou à
moindre coût ;
? la topographie du terrain présente une pente douce (2
à 3%) ;
? le sol est imperméable (argileux, silencieux,
argilo-sableux, etc.) ;
? il y a disponibilité d'aliments poissons ou de
sous-produits d'origine agricole ou animale (issues de céréales,
de soja, d'arachide, de palmiste, d'abattoirs, des produits de pêche,
etc.) et pouvant être utilisés pour la fabrication d'aliments
poissons de qualité à moindre coût.
2.3.1 Disponibilité de l'eau piscicole dans la
Commune de Sô-Ava
La survie de tout être vivant dépend de son
milieu de vie. L'eau est le facteur le plus important pour la mise en place des
étangs et d'autres infrastructures piscicoles adéquates. Elle
conditionne la croissance des poissons à travers ses
propriétés physiques et chimique (Balfour et al, 1981).
La présence d'un cours d'eau en permanence ayant les
propriétés physico-chimiques appropriées est donc
essentielle pour le choix d'un site.
Le milieu d'étude, la Commune de Sô-Ava dispose
d'un réseau hydrographique relativement dense, 82 % de son territoire
(Toffon, 2013). Elle est traversée par la rivière Sô qui
est constitué par deux axes parallèles, l'Ouémé
à l'est et le Sô à l'ouest. Ils sont reliés entre
eux par des plaines d'inondation et des marigots, jouant un rôle
tantôt d'affluents, tantôt défluents : Zounga,
l'Agbadé, l'Ouovi et
30
la Zounvi. Ils se trouvent bordés par de vastes zones
inondables (Le barbé et al.,1993) cité par
(Houédanou, 2013).
La rivière Sô (photo 1), longue de 84,4 km est
une petite rivière côtière alimentée par les lacs
Néwis et Tossanhoué et le sous affluent Ouovi qui prend sa source
dans le petit lac sacré « Hlan » (Amoussou, 2005).

Photo 1 : Vue partielle de la rivière
Sô à Ahomey-lokpo Prise de vue :
Okpoué, avril 2016
La photo 1 montre la rivière Sô dans
l'arrondissement d'Ahomey-lokpo situé à l'ouest du fleuve
Ouémé. Cette rivière Sô traverse les arrondissements
d'Ahomey-lokpo, de Sô-Ava, de Vekky et de Ganvié 1 et 2.
La rivière Sô se jette dans le lac Nokoué
qui communique avec la lagune de Cotonou et ce dernier avec la mer ce qui
explique la salinité de la rivière Sô et des plans d'eau de
la Commune par saison. La rivière Sô parcourt la Commune sur toute
sa longueur alors que le lac Nokoué occupe toute sa partie sud. Cette
situation permet à la Commune d'avoir trois types d'eau favorable pour
sa production piscicole : l'eau douce, saumâtre et salée. Le choix
d'un de ces types d'eau en pisciculture détermine le choix de
l'espèce a élevé. Ainsi, le Clarias gariepinus
préfère que de l'eau douce pour sa bonne croissance. Le
Tilapia Oreochromis niloticus par contre supporte les trois types
d'eau précitée mais dans le domaine piscicole on n'empoisonne pas
les alevins du Tilapia dans de
31
l'eau salée pour éviter d'enregistrer des pertes
par leur taux élevé de mortalité d'après 98,5 % des
pisciculteurs. Ces différents types d'eau apparaissent suivant les
saisons pluvieuses et sèches et les périodes de hautes eaux et de
basses eaux.
En raison de la position géographique de chaque
arrondissement par rapport au lac Nokoué, les périodes
d'apparition de ces types d'eau diffèrent et de façon progressive
allant du Sud au Nord de la Commune. D'après 52,5 % des personnes
interrogées, les eaux salées font leurs apparitions de
février à mai. De même, 75 % de ces personnes
enquêtées ont affirmé la présence des eaux douces de
septembre à novembre, quant aux eaux saumâtres qui sont la
transition entre l'eau douce et l'eau salée ou l'inverse elles sont
perçues de juin-juillet (transition d'eau salée à l'eau
douce) et décembre-janvier (transition d'eau douce à l'eau
salée) d'après 67,5 % des personnes enquêtés. C'est
trois types d'eau sont indispensables à la production piscicole.
Cependant, cette variation d'eau à des effets sur la
production piscicole en cage flottante et en enclos car elle agit sur les
paramètres physicochimiques des espèces élevées
puisque ces espèces (Clarias gariepinus et Tilapia
Oreochromis niloticus) n'ont pas les mêmes caractéristiques
écologiques. Mais cette richesse en ressource d'eau de la Commune ainsi
que sa disponibilité en plein temps et son accès facile et
gratuite constituent un facteur très favorable pour la production
piscicole selon 98 % des personnes interrogées.
2.3.2 Topographie du secteur d'étude
Le littoral béninois résulte du processus
classique paléo morphologique des milieux lagunaires, qui est
caractérisé par des phases de transgression et de
régression marines (Clédjo, 1999). Ces phases sont
accompagnées successivement de dépôts des couches de roche
dure et de roche tendre. Ceci a finalement conduit à la formation d'un
système lagunaire dont le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo
sont les témoins actuels (Pélissier, 1963). La structure
étant tabulaire, la topographie de la Commune de Sô-Ava est
caractérisée par un
32
relief très peu accidenté avec des talus faible.
Elle présente plusieurs formes élémentaires de relief
notamment des zones marécageuses, des terrasses fluviales et des plaines
d'inondation (figure 2).

Figure 2 : Topographie de la Commune de
Sô-Ava
De l'analyse de la figure 2, il ressort que la Commune de
Sô-Ava est constitué de dépôts alluvionnaires, de
plaine côtière et de plan d'eau. Dès lors, le relief de la
Commune de Sô-Ava est relativement plat d'une pente douce allant de 2
à 3
33
% avec un dénivelé d'environ 20 mètres
entre les rives du lac Nokoué et le point le plus élevé
(Wanou, 2013). Cette topographie permet l'implantation des infrastructures
piscicole dans la Commune de Sô-Ava.
Par ailleurs, les données topographiques permettent de
déterminer le type d'étangs à mettre en place et aussi de
délimiter la surface utile pour la construction des étangs. Pour
les étangs conventionnels, la pente adoptée ainsi que la
dénivelée entre l'entré et la sortie d'eau doivent
permettre une réduction de coût de construction des étangs
et un écoulement d'eau par simple gravité. Cependant pour les
étangs sur nappe phréatique seuls les bas-fonds hydromorphes sont
pris en considération pour la construction.
2.3.3 Pédologie du milieu d'étude
Les différentes formations pédologiques sont
représentées dans la figure 3.

34
Figure 3 : Formations pédologiques de la
Commune de Sô-Ava
La Commune de Sô-Ava se situe dans le bassin
sédimentaire du bas Bénin plus spécifiquement sur les
formations récentes. Ces formations sont constituées d'une part,
de sable d'origine marine avec en profondeur de l'argile vaseuse, et d'autre
part, des alluvions qui proviennent de la vallée de
l'Ouémé (PDC Sô-Ava, 2010). Sur le plan pédologique,
environ 47 % du territoire de la Commune de Sô-Ava est constitué
de sols hydromorphes, c'est-à-dire engorgés d'eau de
35
façon temporaire ou permanente (Oyédé
1991) cité par (Wanou 2013). Cet état de chose permet
l'implantation des étangs sur nappe phréatique utilisé par
plus de la moitié des pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava et
l'implantation d'autres infrastructures piscicoles, d'après 85 % des
personnes interrogées.
Par ailleurs, six types de sols hydromorphes sont
formés : sols hydromorphes sur matériau alluvial lagunaire et
alluvio-colluvial fluviatile, sols hydromorphes à gley sur
matériau alluvial argileux, sols hydromorphes sur matériau
alluvial deltaïque, sols à sesquioxydes de fer et de
manganèse lessivé sur sable quaternaire, sols hydromorphes
à pseudo-gley sur matériau alluvial sablo-limoneux à
limono-argileux et sols hydromorphes à pseudo-gley sur sable sur argile.
Ces différents types de sols sont favorables à l'implantation des
différentes infrastructures piscicoles dans la Commune de
Sô-Ava.
Cependant, un sol destiné à la construction d'un
étang doit avoir une texture argilo-sableuse. Ce qui permet une bonne
étanchéité de l'assiette de l'étang. Pouomogne
(1998) compare un pareil sol à celui destiné à la
fabrication des parpaings des briques de terre. Ce type de sol est
observé dans la Commune de Sô-Ava, 90 % des personnes
enquêté l'affirment.
Dans la production piscicole la disponibilité du
facteur aliment surtout local permet une production à moindre.
2.3.4 Disponibilité d'aliment poisson dans la
Commune de Sô-Ava
Dans une pisciculture commerciale, le facteur aliment est le
poste de dépense le plus important. Il correspond au minimum à 50
% du coût de production global et atteint souvent 60 à 70 % (CID,
1998).Ainsi les pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava n'échappent
à cette réalité d'après 85 % des personnes
interrogées.
La Commune de Sô-Ava dont la production piscicole est
essentiellement commerciale, dispose quelques engrais organiques comme :
? bouse de vache ;
36
? fientes de volaille ;
? déchets des cultures ;
? son de maïs ;
? etc.
Ces engrais organiques sont utilisés pour la
fertilisation des étangs afin de produire de nourriture naturelle pour
les poissons élevés. Mais l'utilisation de ces engrais organique
n'est pas assez riche en protéine pour permettre la croissance des
poissons élevés en leur cycle normale (trois mois pour le
Clarias gariepinus et six mois pour le Tilapia Oreochromis
niloticus). Par contre ces engrais organiques constituent un aliment
secondaire pour les pisciculteurs car
seul et même à moindre coût n'assurent pas
un bon rendement de la
production.
Pour assurer une bonne croissance des espèces
élevées, « Multi-Feed » (photo 2) est la provende par
excellence à laquelle font recourir 99 % des pisciculteurs à
cause de sa richesse en protéine (45 %).

Photo 2:Sac de provende de Multi-Feed dans une
ferme piscicole à Ganvié
Prise de vue : Okpoué,
avril 2016
La photo 2 montre les sacs de provende Multi-Feed dans une
ferme piscicole à Ganvié. Cette provende est d'origine
Israélienne (fabriquer en Israël) et le taux de protéine
varie selon les granulés. Ainsi, les granulés de 2 ou 3 mm ont
un
37
taux de protéine de 45 % tandis que les granulés
de 4 ou de 6 mm ont un taux de protéine de 42 % ; donc plus la taille
des graines de provende augmentent plus le taux en protéine dimunie. Un
sac de cette provende contient 15 kg et coute 113,33 FCFA le kilogramme
à raison de 16700 FCFA le sac. Pour 98 % des pisciculteurs cet aliment
poisson est très cher et cet état de chose ne rend pas la
production aisée.
Par ailleurs, la disponibilité des aliments locaux et
d'engrais organiques (planche 1) dans le milieu d'étude pourrait
permettre d'avoir un aliment deux fois plus riche que « Multi-fied »
en protéine et à très moindre coût d'après 95
% des pisciculteurs. Cet aliment est la fabrication des asticots (Petit ver
blanc, larve de la mouche à viande, qui se développe dans la
viande gâtée et sert d'appât pour la pêche) par un
mélange de bouse de vache (matière organique) et de son de
maïs avec l'ajout ou non d'autres déchets organiques donne des
asticots après avoir exposé le mélange au soleil du matin
au soir et le conserver dans un endroit où la température est
plus élevée pendant 3 à 5 jours. C'est un aliment
très riche en protéine, très apprécié pour
les espèces élevées surtout pour les espèces
carnivores telle que le Clarias gariepinus.

3.1
3.2
Planche 1 : Bouse de vache et son de maïs
à Vekky
Prise de vues : Okpoué,
août 2016
Les photos 3.1 et 3.2 de la planche 1 montrent respectivement
des bouses de
vache et son de maïs dans une bassine dans
l'arrondissement de Vekky. Ces
38
bouses de vache sont ramassées par les pisciculteurs et
avec l'achat des bassines de son de maïs pour la fabrication des
asticots.
Cependant, d'après 75 % des personnes
enquêtées, cette technique de fabrication d'aliment poisson avec
des produits locaux pourtant riche en protéine et moins couteux n'est
pas utilisée à cause des problèmes environnementaux et
sanitaires qu'engendre cette dernière par la pollution
atmosphérique entrainée par l'audeur puantes de ces asticots qui
à la longue peut être source d'une épidémie ou un
problème sanitaire pour le pisciculteur et pour la population
environnante du site de production piscicole.
2.4 Exigences écologiques des espèces
élevées
Les exigences écologiques font recourent au climat
(pluie, température et humidité) et aux paramètres
physico-chimiques (le pH, le O2, la salinité).
2.4.1 Tendances climatiques dans la Commune de
Sô-Ava
Le climat est un facteur important : la température
moyenne, les extrêmes, le rayonnement et la durée de la bonne
saison. Pour une espèce donnée, plus la température de
l'eau approche de la température optima de croissance et plus la
durée de cette température optima est longue, plus la production
annuelle sera grande, tous les autres facteurs restant constants (Timmermans,
1962). Ainsi, les variations climatiques, qu'elles soient d'origine naturelle
ou humaine, ont un impact sur de nombreux aspects de notre environnement, et en
particulier sur les espèces en pisciculture.
2.4.1.1 Evolution des précipitations dans la Commune
de Sô-Ava
La pluie est un des paramètres climatiques qui
participe à l'alimentation des nappes d'eau phréatique qui sert
à la production piscicole d'étang sur nappe phréatique
dans la Commune de Sô-Ava mais elle contribue aussi à la baisse de
la température qui induit immédiatement une augmentation de
l'humidité. Pour
39
95 % des personnes interrogées cet état de chose
s'observe en saison pluvieuse et en mois d'août.
La figure 4 présente le régime
pluviométrique de la station de Cotonou (station couvrant le milieu
d'étude) sur la série de 1986-2015.
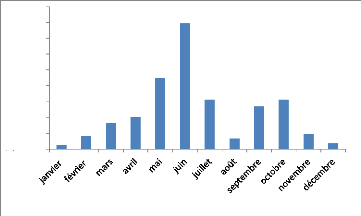
450
Hauteurs de pluies en (mm)
0
Mois
400
350
300
250
200
150
100
50
Figure 4 : Régime pluviométrique
de la station synoptique de Cotonou sur la
période (1986-2015)
Source : ASECNA, 2016
L'analyse de la figure 4montre que le milieu d'étude
couvrit par la station synoptique de Cotonou est marquée par deux optima
pluviométriques centrés sur les mois de juin (grande saison des
pluies) et septembre ou octobre (petite saison des pluies). Sur la série
1986-2015, le mois de Juin demeure le plus pluvieux. Les deux minima sont
centrés sur les mois de décembre-janvier (grande saison
sèche) et d'août (petite saison sèche). Ceci étant,
les saisons pluvieuses sont les périodes dans lesquelles la production
est plus aisée en raison d'une quantité suffisante d'eau dans les
étangs sur nappe phréatiques. D'après 72 % des personnes
enquêtées, cette évolution pluviométrique est
très favorable à la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava.
2.4.1.2 Evolution des températures dans la Commune
de Sô-Ava
La température des poissons est étroitement
liée à celle du milieu où ils vivent. Elle a une influence
sur la consommation d'aliments, sur l'efficacité de transformation
énergétique, ainsi que la croissance des poissons.
La figure 5 montre l'évolution intermensuelle des
températures maximales et minimales de la station synoptique de Cotonou
sur la série 1986-2015. (Tmax et Tmini).
Mois
Températures
maximales en °C
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre Octobre Novembre Décembre

34
32
30
28
26
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre Octobre Novembre Décembre

|
Températures minimales en °C
|
28 27 26 25 24 23 22
|
Mois
40
5.a 5.b
Figure 5:Températures Maximales et
minimales de la station synoptique de
Cotonou (1986-2015)
Source : ASECNA, 2015
L'examen de la figure 5 montre que la température
maximale varie entre27,7 °C (août) et 31,9 °C (mars) et que la
température minimale oxille entre 23,5°C (août) et 26,1
°C (mars). Dès lors, il ressort que les mois de février
(31,7°C), mars (31,9 °C) et avril (31,7 °C) sont les mois les
plus chauds de l'année. Par contre, les mois de juillet (23,8 °C),
août (23,5 °C) et septembre (23,8 °C) qui sont les mois de la
saison pluvieuse ou les mois les plus frais de l'année. Il faut noter
que le mois le plus chaud est celui de mars (31,9 °C) et le mois le plus
frais est celui d'août (23,5°C).
Cependant, La température doit se situer entre
24°C et 33°C pour les poissons d'élevage (Clarias
gariepinus et Tilapia Oreochromis niloticus) pour qu'ils
réalisent leurs meilleures performances de croissance car ces derniers
présentent un stress de croissance au-delà des
températures extrêmes (Coche et al., 1999).
41
Selon 75 % des personnes enquêtées,
l'évolution de la température de la Commune de Sô-Ava est
favorable à une bonne croissance de la production piscicole.
2.4.1.3 Evolution de l'humidité dans la Commune de
Sô-Ava
L'humidité relative est déterminée par
l'évolution de la température. Ainsi plus la température
est élevée plus l'humidité diminue et plus la
température est basse plus l'humidité augmente (figure 6).
|
Températures maximales en °C
|
33
|
|
95
|
|
|
|
32 31 30 29 28 27 26
|
94 93 92 91 90 89 88 87 86 85
|
Humidités maximales
|
|
|
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre Octobre Novembre Décembre
|
|
|
Température Humidité
|
Mois
Figure 6 : Relation entre température
et humidité (1986-2015)
Source : ASECNA, 2015
L'analyse de cette figure 6 montre que quand la
température est élevée l'humidité diminue (janvier,
février, mars, avril et mai). Et quand la température baisse
l'humidité augmente (mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,
et novembre). En effet, la température de l'eau dans les infrastructures
piscicoles augmente lorsque la température de l'air est
élevé et le niveau de cette eau baisse dans les étangs sur
nappe phréatiques et demande un apport d'eau. Cependant, 90 % des
personnes interrogées déclarent qu'une humidité moyenne ou
élevées est nécessaire pour une bonne croissance des
espèces élevés. Ainsi, l'humidité de la Commune de
Sô-Ava est favorable à la production piscicole de
(Clarias gariepinus et Tilapia Oreochromis
niloticus). La figure 7 présente la variabilité
intermensuelle de l'humidité.

Mois
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre Octobre Novembre Décembre
96
Humidités maximales
94
92
90
88
86
84

Humidités minimales
40
80
60
20
0
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septembre Octobre Novembre Décembre
Mois
42
7.a 7.b
Figure 7 : Humidités Maximales et
minimales de la station synoptique de
Cotonou (1986-2015)
Source : ASECNA, 2015
L'analyse de la figure7 montre que l'humidité maximale
varie entre 88,5 H (mars) et 94,2 H (juin) et que l'humidité minimale
oxille entre 50,5 H (janvier) et 70 H (juin). Dès lors, il ressort que
les mois de juin (94,2 H), septembre (92,5 H) et octobre (93,7) sont les mois
les plus humides de l'année. Par contre, les mois de décembre (50
H), janvier 50,6 H) et mars (60,5) sont les mois les moins humides de
l'année en raison de l'absence de pluie. Il faut noter que le mois le
plus humide est celui de juin (94,2 H) et le mois le moins humide est celui
décembre (50 H).
Il ressort de toute ses analyses que la Commune de
Sô-Ava jouit d'un climat encore favorable pour la production piscicole de
Clarias gariepinus et Tilapia Oreochromis niloticus.
2.4.2 Paramètres Physico-chimiques des
espèces élevées
Il s'agit, de la présentation biophysique des
espèces élevées, préferendum écologique (la
température, l'oxygène dissous, le pH, et la salinité) et
de la tolérance écologique des espèces
élevées.
43
2.4.2.1 Présentation biologique des espèces
élevées
La Commune de Sô-Ava dispose deux espèces
d'intérêt aquacole qui sont : Clarias gariepinus et
tilapia Oreochromis niloticus.
? Clarias gariepinus
? Appellation
Ce poisson communément appelé silure, Clarias ou
poisson-chat africain, Clarias gariepinus est une espèce
reconnue sous d'autres appellations telles que Clarias lazera
(Valenciennes, 1840), Clarias garontis (Günther, 1864),
Clarias xenodon (Günther, 1864), Silurus (Heterobranchus)
gariepinus (Burchell, 1822), (Paugyet al., 2003) cité par
(Adouvi, 2013).
? Position systématique
Le tableau III présente la position systémique de
Clarias gariepinus.
Tableau III : Position systématique de
Clarias gariepinus
|
Règne
|
Animale
|
|
Embranchement
|
Vertébrés
|
|
Super classe
|
Ostéichtyens
|
|
Classe
|
Poissons
|
|
Ordre
|
Siluriformes
|
|
Famille
|
Clariidae
|
Source : Adouvi, 2013
Du règne animal, le Clarias gariepinus est une
espèce de poisson appartenant à la famille des Clariidae,
à l'ordre des Siluriformes. En Afrique de l'ouest la famille comporte
trois genres dont le genre Clarias dans lequel se trouve une des
espèces élevé dans le milieu d'étude Clarias
gariepinus.

Photo 3 : Spécimen de Clarias
gariepinus
Source : Adouvi, 2013
44
Clarias gariepinus est caractérisé par
la présence d'une seule nageoire dorsale. Il présente une peau
sans écaille et couverte de mucus. On distingue 8 babillons autour de sa
bouche qui lui servent de tentacules. C'est un poisson rustique en raison de
son double système de respiration constitué de branchies et
d'organes arborescents capables d'utiliser directement de l'air
atmosphérique, ce qui rend facile sa manutention (Ewoukem, 2011).
? Biogéographie
La répartition de Clarias gariepinus est
presque panafricaine. Dans l'Afrique de l'Ouest, l'espèce est Commune
dans le bassin de l'Ouémé, bassin du Mono, dans les bassins du
Chari et du Logone, de la Bénoué, du Niger, de l'Oshun, de
l'Ogun, de la Volta, du Bandama, de la haute Comoé et du
Sénégal., de Sierra Leone, du Liberia et de Côte d'Ivoire
(à l'ouest du bassin du Bandama) (Paugy et al., 2003)
cité par(Adouvi 2013).
? Tilapia Oreochromis niloticus
? Appellation
Ce poisson est communément appelé Tilapia du Nil
appartient à la famille des Cichlidés. Le groupe des Tilapias
occupe le deuxième rang mondial des poissons d'élevage
après les carpes (Ewoukem, 2011).
? Position systématique
Le tableau IV présente la position systémique du
Tilapia Oreochromis niloticus.
Tableau IV : Position systématique du
Tilapia Oreochromis niloticus
|
Règne
|
Animale
|
|
Embranchement
|
Chordata
|
|
Sous embranchement
|
Vertebrata
|
|
Super classe
|
Osteichthyes
|
|
Sous-classe
|
Neopterygii
|
|
Super-ordre
|
Acanthopterygii
|
|
Ordre
|
Perciformes
|
|
Sous-ordre
|
Labroidei
|
|
Famille
|
Cichlidae
|
|
Genre
|
Oreochromis
|
Source : Linnaeus (1758)
45
Son nom binominal estOreochromis niloticus. Aussi du
règne animal, les tilapias au sens large appartiennent à l'ordre
des Perciformes, au sous-ordre des Labroidei et à la famille des
Cichlidae. Ils comprennent les genres Tilapia au sens strict, Sarotherodon
et Oreochromis dont Oreochromis niloticus qui est la
deuxième espèce élevée dans le milieu
d'étude.

Photo 4 : Spécimen du Tilapia
Oreochromis niloticus
Source :
Wikipedia.org, 2016
Oreochromis niloticus se reconnait à ses
rayures verticales sur la nageoire
Caudale ; une coloration grisâtre sur la même
nageoire avec poitrine et flancs rosâtres ; un corps, de forme variable
mais jamais très allongé, plus ou moins comprimé et
recouvert d'écailles cycloïdes ; la nageoire dorsale longue,
à partie antérieure épineuse (17-18 épines) et
à partie postérieure molle (12-14 rayons). La ligne
latérale supérieure compte 21 à 24 écailles ; la
latérale inférieure 14 à 18. Le dimorphisme sexuel, chez
cette espèce, est très marqué. A l'état adulte, la
papille génitale des mâles est protubérante en forme de
cône et porte un pore urogénital à
l'extrémité, alors que chez les femelles, elle est courte et
présente une fente transversale en son milieu : c'est l'oviducte
situé entre l'anus et l'orifice urétral. Le mâle se
distingue en plus d'un liseré noir en bordure des nageoires dorsale et
caudale (Adjanké, 2011).
46
? Biogéographie
Oreochromis niloticus présente une
répartition originelle strictement africaine couvrant les bassins du
Nil, du Tchad, du Niger, des Volta, du Sénégal et du Jourdain
ainsi que les lacs du graben est-africain jusqu'au lac Tanganyika. Cette
espèce a été largement répandue hors de sa zone
d'origine pour compléter le peuplement des lacs naturels ou de barrages
déficients ou pauvres en espèces plancton phages ainsi que pour
développer la pisciculture. Elle est également cultivée
dans les lacs, les fleuves et les piscicultures en Amérique, en Asie et
en Europe (Adjanké, 2011).
2.4.2 Référendum écologique
La vie biologique des espèces aquatiques est
influencée par la variabilité des paramètres
physico-chimiques du milieu. Ainsi, pour chaque espèce aquatique, un
seuil de tolérance écologique est sollicité.
Au-delà de ce seuil, la vie biologique de l'espèce est
défavorable (Djissou, 2013).
Le tableau V présente la synthèse des
caractéristiques écologiques et biophysiques des espèces
d'intérêt aquacole (Clarias gariepinus et Tilapia
Oreochromis niloticus) de la Commune de Sô-Ava.
47
Tableau V : Synthèse des
caractéristiques écologiques et biophysiques des espèces
d'intérêt aquacole (Clarias gariepinus et Tilapia
Oreochromis niloticus) de la Commune de Sô-Ava
|
Espèces
|
Températ
ure
tolérée
pour une
bonne
croissance
|
Valeurs
extrêmes
de survie
|
Température
de l'air du
milieu
|
Température
de l'eau du
milieu
|
p11
toléré
|
p11 du
milieu
|
O2
toléré
|
O2 du
milieu
|
Salinité
toléré
|
Salinité du
milieu
|
Observations
|
|
26°C
|
8°C
|
23,5°C
|
26,2°C
|
6,5
|
5,6
|
3g/mol
|
2,4
|
15
|
0 g/mol
|
Favorable
|
|
Clarias
|
à
|
à
|
à
|
à
|
à
|
à
|
|
g/mol
|
g/mol
|
à
|
|
|
gariepinus
|
30°C
|
32°C
|
31,9°C
|
27,5°C
|
9
|
7
|
|
à 10,9
g/mol
|
|
7 g/mol
|
|
|
26°C
|
6,7°C
|
23,5°C
|
26,2°C
|
5
|
5,6
|
5,5
|
2,4
|
0,015 à
|
0 g/mol
|
Très favorable
|
|
Tilapia
|
à
|
à
|
à
|
à
|
à
|
à
|
à
|
à 10,9
|
30
|
à
|
|
|
Oreochromis
niloticus
|
32°C
|
42°C
|
31,9°C
|
27,5°C
|
11
|
7
|
8,5
g/mol
|
g/mol
|
g/mol
|
7 g/mol
|
|
Source : Recherches
documentaires, juin 2016
48
Il ressort de l'analyse du tableau V que les conditions
écologiques sont favorables ou très favorables pour les
espèces considérées Clarias gariepinus et
Tilapia Oreochromis niloticus.
Le seuil de tolérance écologique étant
dans les normes, il en résulte que la vie biologique des espèces
est favorable par rapport aux paramètres physico-chimiques du milieu.
Cette situation s'explique par la tendance climatique et les paramètres
physico-chimiques du milieu d'étude.
Par ailleurs, les paramètres physico-chimiques
n'étant toujours pas stables, ils peuvent variés à tout
moment. En somme, la Commune de Sô-Ava dispose d'importante atout
biophysique avec une tendance climatique encore favorable pour le
développement de la production piscicole. Mais la disponibilité
de ces atouts et potentialités de la Commune de Sô-Ava en
matière de la production piscicole n'épargne pas des contraintes
auxquelles sont confrontées les pisciculteurs.
Dans le chapitre suivant il est question d'analyser les
différentes contraintes liées à la production piscicole et
de proposer des stratégies de renforcement pour une meilleure croissance
de cette production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.
49
CHAPITRE III
CONTRAINTES ET STRATEGIES DE
RENFORCEMENT POUR UNE
MEILLEURE CROISSANCE DE LA PRODUCTION PISCICOLE
DANS
LA COMMUNE DE SÔ-AVA
Ce chapitre met l'accent sur les contraintes liées
à la production piscicole, et les stratégies de renforcement pour
une meilleure croissance de la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava.
3.1 Contraintes de la production piscicole dans la Commune
de Sô-Ava
La pisciculture qui se présente comme une solution
à la crise de pêche afin de compléter ses apports mais
aussi de réduire l'effort de pêche et améliorée la
productivité des plan d'eau tout en maintenant le niveau de consommation
actuel, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale (MAEP, 2011),
se retrouve face aux différentes contraintes qui constituent un
véritable obstacle pour son développement. Cependant, les
contraintes que rencontre les pisciculteurs dans la Commune de Sô-Ava
sont généralement les mêmes avec quelques
spécificités allant d'un arrondissement à un autre. Ainsi,
quatre catégories de contraintes sont enregistrées au cours des
travaux de recherche de terrain, qui sont : les contraintes de choix de type
d'infrastructure piscicole, les contraintes d'ordres climatiques, techniques et
socioéconomiques.
3.1.1 Contraintes de choix de type d'infrastructure
piscicole
La production piscicole, elle se fait avec plusieurs
infrastructures adéquates. Dans la Commune de Sô-Ava, les
étangs sur nappe phréatique, les bassins, les cages flottantes,
les bacs-hors sol et parfois les enclos sont utilisées pour
l'élevage des poissons. Mais toutes ces infrastructures ne sont pas
adéquates pour la production piscicole durant toutes les saisons ou
périodes de l'année dans cette Commune en occurrence les
périodes de hautes eaux allant de juillet à octobre. De
même, les réalités naturelles de chaque arrondissement de
la Commune de Sô-Ava imposent un choix de type d'infrastructure
adéquate à utiliser.
50
Le tableau VI présente les infrastructures piscicoles
utilisés dans la Commune de Sô-Ava ainsi que leurs avantages et
contraintes.
51
Tableau VI: Tableau synthétique des
infrastructures piscicoles utilisés dans la Commune de Sô-Ava :
Avantages et contraintes
|
Types d'infrastructure
|
Caractéristiques
|
Avantages
|
Contraintes
|
|
Etang sur nappe phréatique
|
Etang sur nappe phréatique
|
Offre de grande superficie : 200m2 (20m/10m) plus
largeur des digues 3m. Alimentation en eau par nappe phréatique et moins
cher.
|
-Baisse du niveau d'eau dans l'étang en saison
sèche ; -Encombrement de l'étang par les digues entrainé
par les fortes pluies
-Etang submergé par les hautes eaux (inondations)
périodiques entrainant ainsi l'arrêt de la production pendant 03
mois (Septembre à novembre)
|
|
Bac hors sol
|
Dimensions variables,
infrastructures dont les
parois et l'assiette sont en
matériaux divers.
L'alimentation en eau est faible à partir d'une source
et/ou manuelle
|
Pratique de la pisciculture par tout et en toutes saisons.
Pisciculture pour
autoconsommation
|
Couteux, renouvèlement fréquent de l'eau
nécessitant un forage, de la main d'oeuvre et une charge
financière
|
|
Bassin
|
Dimensions variables dont les parois de l'assiette sont en
ciment.
L'alimentation en eau est faible à partir d'une source
et/ou manuelle.
|
Pratique de la pisciculture par tout et en toutes saisons.
Gestion de l'eau facile,
manipulation facile.
|
Couteux, renouvèlement fréquent de l'eau
nécessitant un forage, de la main d'oeuvre et une charge
financière
|
|
Cage flottante/ Enclos
|
Dimensions variables,
matériaux de construction : planche, tuyaux, vivier en
filet synthétique (filet pour
enclos), pointes, vis,
écrous, fil, bidons etc.
|
Installation sur plan d'eau et
en toute période.
|
Couteux, la pollution des plans d'eau, Forte teneur des plans
d'eau en sel pendant la saison sèche, les transitions entre l'eau
salée et l'eau douce et l'eau douce et salée agissent sur les
paramètres physico-chimiques de l'eau et de l'espèce rendant
ainsi le milieu défavorable aux espèces élevées.
|
Source : LAMS, 2014 et
enquête de terrain, juillet 2016
52
De l'analyse du tableau VI, il ressort que cinq (05)
différentes infrastructures sont utilisées dans la Commune de
Sô-Ava en production piscicole. Elles présentent toutes des
contraintes auxquelles est lié le développement de cette
activité. Mais parmi ces infrastructures, certaines sont ou peuvent
être utilisés en toutes saisons ou périodes de
l'année il s'agit : des Bassins et Bac hors sol (planche 2).

4.1
4.2
Planche 2 : Bassin et Bac hors-sol piscicole
à Ganvié
Prise de vues :
Okpoué, avril 2016
La planche 2 montre respectivement Bassin et Bac hors sol sur
un remblai de terre à Ganvié. Ces infrastructures sont les plus
utilisées dans les arrondissements de Ganvié à cause de la
présence permanence de l'eau et de son statut du village lacustre ; y
sont souvent élevés du poisson chat africain Clarias
gariepinus en bassin ou en bac hors-sol et le tilapia du Nil
Orechromis niloticus en enclos.
L'utilisation d'autres infrastructures piscicoles sont
conditionnées par le choix d'espèce à élever ainsi
que la saison ou la période d'élevage. C'est le cas de la cage
flottante ou enclos (planche 3).

5.1
5.2
53
Planche 3 : Cage flottante implantée dans
la rivière Sô, dans les arrondissements de Sô-Ava et
d'Ahomey-lokpo en saison de basses eaux Prise de vues
: Okpoué, avril 2016
La planche 3 montre des cages flottantes qui sont souvent
utilisées dans les arrondissements de Sô-Ava et d'Ahomey-lokpo
pour l'élevage du tilapia du Nil (Oreochromis niloticus). Elles
peuvent être installées en période des basses eaux (saison
sèche) ou des hautes eaux (crue) mais en période de hautes eaux
le débit d'écoulement de la rivière Sô est
élevé de 204m3/s dans ces arrondissements avec un
courant d'eau très fort (Mama, 2010 cité par Houédanou,
2013). Cela rend tout le système de production difficile en raison de la
préférence des eaux calme du tilapia. Tandis qu'en période
des basses eaux le débit d'écoulement de la rivière
Sô dans ces arrondissements est de 36m3/s (Mama, 2010
cité par Houédanou, 2013): c'est la saison sèche où
le scénario contraire se passe.
Pour les étangs sur les nappes phréatiques
(planche 4) ils sont uniquement utilisés en période de basses
eaux (saison sèche) où le débit d'écoulement de la
rivière Sô est faible allant de 12m3/s à
36m3/s ce qui n'engendre pas un débordement d'eau dans les
étangs mais nécessite d'apport d'eau en cas de sècheresse
accrue par moment en cette période de décembre à mai.

6.2
6.1
54
Planche 4 : Etangs sur nappe phréatique
dans les arrondissements de Sô-Ava et
de Vekky en saison de basses
eaux (décrue)
Prise de vues : Okpoué,
avril 2016
La planche 4 montre les étangs sur nappe
phréatique utilisés pour la production piscicole dans la Commune
de Sô-Ava. Dans ces étangs y sont élevés le
Clarias gariepinus. Par ailleurs, la figure 8 présente les
différentes infrastructures piscicoles utiliser par % dans la Commune de
Sô-Ava.

15%
17,50%
9%
6,50%
52%
Etangs sur nappe phréatique
Bac hors sol
Bassin
Cage flotantte
Enclos
Figure 8: Différentes infrastructures
piscicoles utilisées dans la Commune de
Sô-Ava
Source des données :
Enquête de terrain, avril 2016
De l'analyse de la figure8, il ressort que plus de la
moitié des pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava
c'est-à-dire 52 % utilisent les étangs sur nappe
phréatique dont la production marque un arrêt systématique
à la monté des hautes eaux qui
55
dure de juillet à octobre ou parfois d'août
à octobre. Cette pourcentage est suivie de celle de bac hors sol et de
bassin 17,5 % et 15 % et enfin 9 % et 6,5 % représentent les
pisciculteurs qui utilisent les cages ou enclos pour leur élevage.
Cependant, le choix d'utilisation de ces infrastructures
piscicoles varie d'un milieu à un autre ou d'un arrondissement à
un autre selon les réalités de ces derniers. Ainsi, les
arrondissements de Ganvié sont dominés par les Bassin, les Bac
hors-sol et des enclos en raison de leur statut du village lacustre. Ceux de
Vekky, Sô-Ava et de Ahomey-lokpo sont prédominés par les
étangs sur nappe phréatiques et les cages flottantes en raison de
la disponibilité des terres, 96 % des personnes interrogés ont
constaté cet état de chose.
3-1-2 Contraintes climatiques et accès à
l'eau de qualité sur la production piscicole de la Commune de
Sô-Ava
Le climat est un facteur important pour la production
piscicole mais son instabilité par les saisons rend l'activité de
la pisciculture plus contraignante. La Commune de Sô-Ava qui jouit d'un
climat subéquatorial avec deux saisons sèches et deux saisons
pluvieuses pourtant favorable à la production piscicole se trouve faire
face aux risques climatiques majeurs liés aux changements climatiques
dans les zones de pêcheries (zone agro écologique 8) zone à
laquelle fait partir la Commune de Sô-Ava (PANA, 2014).
Cependant, les saisons pluvieuses font monter
l'humidité, baissent considérablement la température qui
tourne en moyenne autour de 25,7°C ce qui permet une très meilleure
croissance des espèces espèce élevées. Mais, les
fortes pluies des saisons pluvieuses entrainent l'encombrement des
étangs par les digues, drainent les eaux souillées et puantes des
champs (terre exondée destinée au maraichage) dans la
rivière Sô en plus de la turbidité de l'eau qu'elles
engendrent, agissent et changent brutalement les paramètres
physico-chimiques de l'eau de façon défavorable pour les
espèces élevées et affecte ainsi la vie biologique de ces
espèces surtout en cage flottante dans la rivière Sô
causant
56
ainsi leurs morts. En 2015, ce phénomène a
été observé dans l'arrondissement
ho 3
de Ahomey-lokpo situé au Nord de la Commune de
Sô-Ava et a fait enregistrer aux pisciculteurs dudit arrondissement une
perte estimé à plus de 5.000.000 de FCFA du Tilapia du Nil
(Oreochromis niloticus). De même, ces risques climatiques
provoquent essentiellement les hautes eaux précoces et
particulièrement longues allant de juillet à octobre avec un
débit d'écoulement qui varie entre 68m3/s et
204m3/s (Mama, 2010) cité par (Houédanou, 2013). Cette
situation submerge les étangs mais aussi d'autres infrastructures
implantées sur des terres fermes entrainant ainsi l'arrêt
systématique de 85 % des pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava
selon les personnes enquêtées. Mais la présence d'eau douce
en cette période est un facteur très favorable pour
l'élevage de Clarias gariepinus en enclos sur les plans d'eau
dans les endroits où le courant d'eau est faible.
En période de basses eaux et en raison de l'utilisation
des nappes d'eau phréatique comme sources d'eau de production dans les
étangs sur nappe phréatique, la monté de la
température engendre l'évaporation de cette eau en plus
salé qui baisse considérablement dans ces étangs par
moment demandant ainsi un apport d'eau douce (eau de pompe/forage)
régulier pour une bonne croissance des espèces
élevées notamment le Clarias gariepinus qui ne supporte
pas la salinité mais par contre le Tilapia Oreochromis niloticus
en tolère parce qu'il vive dans toute les eaux continentales
(salée, saumâtre, douce).
Cependant, les sites de production étant
dépourvue d'eau de forage pour mener à bien leur production, 52 %
des pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava se contentent des sources d'eau
de nappe phréatique. Cette situation rend aussi la production piscicole
difficile. Ces conditions entrainent une faible croissance des poissons
allongeant ainsi les cycles d'élevage (6 à 8 mois). Ce qui
contraint le pisciculteur à un seul cycle de production par an et une
récolte précoce où les poissons n'atteignent pas la taille
prisée par les consommateurs et le retard de
57
croissance des alevins en pisciculture (PANA, 2014). Ces
contraintes climatiques sont observées par 88 % des personnes
enquêtées.
Par ailleurs, la décomposition des feuilles mortes de
la jacinthe d'eau rend le milieu anoxique privant d'oxygène les
espèces du milieu conduisant, ainsi à l'eutrophisation du plan
d'eau (Kpondjo, 2008). Cet état de chose altère la qualité
physico-chimique et organoleptique de l'eau d'après 65 % des personnes
enquêtées. A cela s'ajoute la pollution des plans d'eau de la
Commune de Sô-Ava par les déchets ménagers ainsi que la
turbidité de l'eau engendré par les fortes pluies ce qui affecte
la production piscicole en générale et celle en étang, en
cage flottante et en enclos en particulier. La population interrogée a
eu une perception de cette altération de la qualité
physico-chimique des eaux par tous ces éléments
précédemment cités mais cela à des degrés
différents. Ainsi, les mois où les eaux de la Commune sont plus
polluées et altère la qualité physico-chimique de l'eau
sont les mois de janvier-février-mars, confirmé par 55% des
personnes interrogées. Dès lors, la présence de la
qualité de l'eau ne s'observe pas durant toute une année
d'après 74 % des personnes enquêtées.
3.1.3 Contraintes techniques
Les contraintes techniques de la production piscicole dans la
Commune de Sô-Ava ne sont rien d'autres que les mauvaises connaissances
de la pisciculture due au manque de formation de recyclage en faveur des
pisciculteurs. Même si ces derniers reçoivent la visite des agents
du CARDER Atlantique/Littoral et SCDA/Sô-Ava pour un contrôle
aléatoire cela reste insuffisant pour avoir une meilleure connaissance
en pisciculture selon 70 % des pisciculteurs. Pour l'association des
pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava, cette situation affecte plus les
nouveaux entreprenants dans le domaine piscicole en raison à leurs
manques d'expériences dans le domaine. Ce qui les contraints souvent
à abandonner à cause des pertes qu'ils enregistrent.
58
3.1.4 Contraintes socioéconomiques
L'agriculture occupe une place très importante dans
l'économie béninoise. Bien que de nombreuses études
biotechniques aient été conduites (Blé et al.,
2009 ; Toko et al., 2007), la prise en compte de la dimension
socioéconomique et environnementale est encore insuffisante aux
différentes échelles. Les productions halieutiques (pêche
et aquaculture) occupent 15% de la population active totale, 25% de la
population active du secteur agricole et contribuent en moyenne pour 3% au PIB
national (programmes cadre Bénin, FAO, 2012-2015).
La Commune de Sô-Ava, majoritairement pêcheurs,
agriculteurs et commerçants respectivement du Sud, au Nord ; la
pisciculture n'est qu'une activité de second plan avec 70 % des
pisciculteurs qui pratiquent la pisciculture comme une activité
secondaire et seulement 30 % comme une activité de plein temps. Or, vue
l'importance socioéconomique de la pêche continentale pour la
population lacustre de Sô-Ava et la crise qui s'observe au niveau de
cette pêche continentale, la pisciculture devrait être une
activité de premier plan. De même 45 % des pisciculteurs ont
commencé cette activité en moins de ces cinq (05)
dernières années et 55 % depuis plus de 5 ans.
La figure 9 présente les différents secteurs
d'activité (%) qui s'intéressent à la pisciculture dans la
Commune de Sô-Ava.
59
Représentation des secteurs d'activités
piscicultures
|
qui s'intéressent à la
en %
|
35,00%
30,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,00%
10,00%
5,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secteurs d'activiés
|
|
|
|
Figure 9 : Différents secteurs
d'activité (%) qui s'intéressent à la
pisciculture
Source des données :
Enquête de terrain, mai 2016
L'analyse de cette figure 9, montre que à part les 30 %
des personnes qui pratiquent la pisciculture en plein temps, les 70 % qui
pratiquent aussi cette activité viennent d'autres secteurs
d'activité comme la pêche qui représente 22,5 % suivie
d'agriculture (maraîchage) et du commerce respectivement de 20 % et 15 %,
l'artisanat et professionnel des soins sanitaires 5% et enfin l'enseignement
qui vient en dernière position avec 3 %. Cet état de chose
s'explique surtout par la cherté des infrastructures piscicoles
adéquates, de l'aliment poisson, de l'accès difficile et couteux
à un site piscicole et du soutien financier.
Cependant, 50 % des pisciculteurs ont procédés
à l'achat d'un site piscicole, 30 % à l'héritage et 20 %
à l'emprunt. Mais pour éviter tous problèmes d'ordre
social, l'achat d'un site piscicole est la meilleure option afin de ne pas
assister à la perte de son investissement à plein essor de
croissance de sa production d'après 97 % des personnes
enquêtées.
Malgré toutes ces contraintes, la pisciculture est une
activité lucrative d'après 99 % des personnes interrogées
mais pour cette même source les retombés de cette activité
seule ne permettent pas une entière prise en charge financière
des foyers
60
des pisciculteurs cela à cause des
précarités et des contraintes auxquelles sont confrontées
cette activité (production piscicole).
Par ailleurs, les retombées issues de cette
activité sont destinées à la satisfaction des besoins
vitaux, à la scolarisation des enfants et aux réinvestissements
dans l'activité piscicole (figure 10).
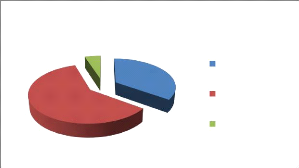
60%
5%
35%
Scolarisation des enfants
Besoins vitaux
Réinvestissement
Figure 10 : Destination des
gains
Source des données :
Enquête de terrain, avril 2016
De l'analyse de la figure 10, il ressort que 60 % des gains
issues de la production piscicole sont destinées à la
satisfaction des besoins vitaux, 35 % sont utilisés pour la
scolarisation des enfants et seulement 5 % sont utilisés pour le
réinvestissement dans l'activité piscicole.
Remédier à toutes ces contraintes d'une
façon efficace pourrait faire décoller le développement de
la production piscicole voir une révolution de cette activité (la
pisciculture) dans la Commune de Sô-Ava et entrainera une croissance
économique considérable avec la création des emplois pour
la Commune de Sô-Ava en particulier et pour le Bénin en
générale selon 90 % des personnes interrogées.
61
3.2 Stratégies de renforcement pour une meilleure
croissance de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava
Il s'agit ici d'exposer la perception des populations sur le
développement embryonnaire de la pisciculture, les techniques
développées par les pisciculteurs pour faire face aux contraintes
rencontrées, proposer des stratégies de renforcement pour une
meilleure croissance de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava
et projet d'insertion professionnelle.
3.2.1 Perception des populations sur le
développement embryonnaire de la pisciculture dans la Commune de
Sô-Ava
Au Bénin, malgré l'existence de systèmes
traditionnels de production du poisson et une industrie aquacole qui peine
à démarrer, la production piscicole demeure toujours embryonnaire
car sa contribution à la production nationale halieutique du
Bénin est très marginale (<1%) et très peu
diversifiée composée essentiellement du Tilapia Oreochromis
niloticus et du Clarias gariepinus (MAEP, 2011).
La Commune de Sô-Ava n'échappe pas à cette
situation embryonnaire de la production piscicole. En effet, sur les 118 547
habitants (RGPH, 2013) que compte la Commune de Sô-Ava, le nombre totale
des pisciculteurs n'atteigne pas 200 selon les personne enquêtées
et d'après (SCDA /Sô-Ava) on y retrouve seulement 192
pisciculteurs dans la Commune de Sô-Ava soit 0,16 % de la population
totale de ladite Commune ce qui confirme les dires des populations. Le nombre
de producteur étant très faible voir insignifiant, 0,16 % par
rapport à la population totale qui est en manque accru de
protéine animale dû à la crise de pêche, la
production piscicole de Sô-Ava peine sérieusement à
décoller avec une moyenne de production piscicole de 15,68 tonnes/an sur
une série de sept (07) ans de 2008-2014 (CARDER/Atlantique - Littoral,
2016) et très peu diversifié avec essentiellement
l'élevage du Clarias gariepinus et du Tilapia Oreochromis
niloticus en monoculture. Ainsi, cette offre ne permet pas de
répondre à la demande de plus en plus grandissante de la
population et cela malgré les atouts,
62
potentialités naturelles et une ressource humaine dont
dispose la Commune de Sô-Ava. Selon cette perception de la production
piscicole des populations et des agents de l'état sur le terrain, ce
développement embryonnaire de la pisciculture est dû au :
cherté de l'aliment poisson (provende) qui prend plus de 50 % du
coût de la production, aux extrêmes climatiques qui entrainent
souvent l'instabilité des paramètres physico-chimique du milieu
de vie des espèces élevées, au débordement des
hautes eaux, à l'absence de centre d'écloserie dans la Commune
qui entraine le retard d'arriver des alevins, au manque de formation de
recyclages et de suivi des pisciculteurs, à la faible promotion de la
filière aquacole, au cherté et manque d'infrastructure piscicole
adéquate pour faire face aux différentes saisons de
l'année en matière de production piscicole, à la non
disponibilité d'une eau de qualité en toute saison, au manque
d'accès aux microcrédits et à l'absence d'énergie
électrique sur les sites de production.
Face à ces contraintes les pisciculteurs
développent quelques techniques pour mieux mener leur production.
3.2.2 Techniques développées par les
pisciculteurs pour faire face aux
contraintes rencontrées
Face aux contraintes, les pisciculteurs développent des
techniques et stratégies afin de faire survivre leurs activités.
Dans ce contexte, plusieurs techniques sont développées par les
pisciculteurs, nous avons : le prolongement des cycles de production par les
déchets d'abattoir comme aliment poisson pour maximiser le rendement ,
échanges d'expériences entre pisciculteurs pour une meilleure
production, recherche d'un bon marché d'écoulement des produits
piscicoles, vente des produits piscicole sur le marché Nigérian,
investissement propres des pisciculteurs, réservation d'alevins à
l'approche du fin de cycle de la production en cours pour éviter les
retards de production, l'utilisation des bac hors-sol ou bassin avec apport
d'eau douce par les pisciculteurs afin de produire même en période
de hautes eaux et couverture de certaines infrastructures piscicoles
comme : les bacs hors-sol ou les bassins contre les
intempéries. Couverture d'un bac hors-sol contre les intempéries
(photo 5).

Photo 5 : Bac hors-sol couvert contre les
intempéries à Ganvié
Prive de vue
.
· Okpoué, avril 2016
La photo 5 montre un Bac hors sol couvert de branche de
palmier pour protéger des espèces élevées contre la
chaleur qui sévit afin d'éviter un probable changement de la
température de l'eau qui pourrait avoir des répercussions sur les
espèces présentent dans l'infrastructure.
De même étant donné que les
paramètres physico-chimiques ne sont pas toujours stables, les
techniques sont aussi développées par les pisciculteurs pour en
faire aussi face. Nous avons :

? Observation de la couleur de l'eau dans
l'infrastructure piscicole utilisé Elle consiste à voir
si l'eau change de couleur au fil des jours. Si cette couleur d'eau
dévient verdâtre et qu'elle est aussi trouble alors elle est acide
ou basique (photo6).
63
Photo 6 : Eau verdâtre dans un bassin
piscicole à Ganvié
Prise de vue
.
· Okpoué, avril 2016
64
La photo 6 montre de l'eau verdâtre sur Clarias
gariepinus dans un bassin piscicole à Ganvié. Selon
l'expérience des pisciculteurs une eau de cette couleur dans une
infrastructure piscicole a un pH acide ou basique et doit être
vidangé au plus vite possible afin de permettre une bonne croissance des
espèces qui y sont élevées .Par conséquent, les
pisciculteurs procèdent à la vidange de cette eau.
Cependant, l'eau dans l'infrastructure piscicole peut
être claire, propre et être acide ou basique, dans ce cas il faut
observer la réaction des poissons.
? Observation de la réaction des poissons dans
l'infrastructure piscicole
Si par un mouvement de bruit auprès de l'infrastructure
piscicole les poissons qui s'y trouvent ne réagissent pas et refusent de
manger ou commencent par lever la tête au même moment dans
l'infrastructure où ils sont élevés alors la
qualité de l'eau n'est pas bonne (elle est acide ou basique). Ainsi,
elle doit être vidangé et remplacer dès l'instant
d'observation de ces signes ou de l'un de ces signes.
3.2.3 Proposition des stratégies de renforcement
pour une meilleure croissance de la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava
Le poisson représente plus de 30 à 40% des
protéines d'origine animale (FAO, 2010). Il est constitué de
protéine de haute valeur biologique et des acides aminés
essentiels (Gohoungo, 1998) cité par (Adouvi, 2013). Qu'il soit frais,
fumé ou séché, le poisson joue un rôle très
important dans la lutte contre la malnutrition et constitue une source
importante de protéines animales dans l'alimentation humaine. De
même vu l'importance de l'élevage de poisson (pisciculture)
à cause de son intérêt pour :
Sa chair qui est une source de protéine animale
très appréciée et nourrissante surtout pour les enfants et
les personnes âgées ; sa farine utilisée dans
l'alimentation humaine et dans la provende animale ; sa diversification des
65
sources de protéines animales ; tirer profit de son
association à l'élevage de poulets, de porcs, de canard, etc.
pour un meilleur rendement ; la mise en valeur des zones peu favorable à
l'agriculture ; et la diversification des sources de revenus, il parait
impérieux de proposer des stratégies de renforcement pour une
meilleure croissance de cette activité dans la Commune de Sô-Ava.
Dès lors, il conviendrait de :
? adopter un système de production piscicole
intégré et durable : Cela consiste a développé un
système de production agricole viable et peu coûteux basé
sur l'agrobiologie en intégrant l'agriculture, l'élevage et la
pisciculture tout en valorisant les sous-produits agricoles d'origine animale,
végétale et piscicole.
? développer un système de production piscicole
en coopérative/entreprenariat commun :
C'est un système dans lequel un groupe de personnes
physiques et morales s'entendre pour se mettre ensemble afin d'investir leurs
capitaux dans la production piscicole intégré ou non. Elles
seront propriétaires d'un même site piscicoles et pourront avoir
la capacité d'avoir des infrastructures piscicoles adéquates, un
forage pour avoir une eau de qualité et permanente en toute
période de l'année afin de produire en toute saison.
? construire un centre d'écloserie moderne :
Elle consiste à construire un centre d'écloserie
des espèces élevées (Clarias gariepinus et
Tilapia Oreochromis niloticus) ainsi que de potentielle espèces
d'intérêt aquacole afin de satisfaire la demande des pisciculteurs
en alevins de qualité. Ceci permettrait de faire des reproductions
artificielles.
? former les pisciculteurs
Une formation de recyclage à l'endroit des
pisciculteurs et toute personne qui désire entreprendre dans le domaine
piscicole est primordiale afin de leur
66
permettre d'avoir une connaissance en production piscicole qui
leur sera utile dans leur activité ;
? développer une technique de fabrication d'aliment
poisson avec des sous-produits locaux riche en protéine et accessible
à moindre coût ; Mettre en place une institution de soutien
financier (prêt/micro crédit) et de suivi pour l'entreprenariat
agricole surtout pour les jeunes afin de leur permettre d'auto-employer;
équiper les sites de production de systèmes solaire ; encourager
les innovations et l'entreprenariat des jeunes dans le domaine piscicole ou
agricole ; intensifier des recherches sur d'autres poissons
d'intérêt aquacole en vue d'une meilleure diversité des
espèces à élevées ; sensibiliser les populations
sur les questions de changement climatique.
? insertion d'un projet professionnel :
Le projet consiste à mettre en place une ferme
piscicole dans le village Sô-Tchanhoué (arrondissement de Vekky,
Commune de Sô-Ava). Ce projet à pour objectif de contribuer
à l'essor de filière piscicole dans la Commune de
Sô-Ava.
En somme, les résultats obtenus se résument dans le
modèle suivant (figure 11) :
67
|
|
Forte densité de ressources en eau permanente, sol
adapté à la mise en place d'infrastructure piscicole et climat
favorable
|
|
FORCES
|
|
|
|
|
PRESSIONS
|
|
Pollution de l'eau, cherté de la provende,
présence des hautes eaux et les extrêmes des paramètres
climatiques
|
|
|
|
Développement embryonnaire de la pisciculture et manque de
connaissance dans le domaine piscicole.
|
|
ETAT
|
|
|
IMPACTS
|
|
Faible production piscicole avec des pertes
enregistrées
|
|
|
|
|
|
|
|
REPONSES
|
|
Pisciculture intégré, formations de recyclage,
encadrement technique, suivie et appuie financier, projet d'insertion
professionnel etc.
|
Figure 11 : Analyse à l'aide du
modèle FPEIR des facteurs biophysiques de la
production piscicole
dans la Commune de Sô-Ava
68
Les forces, ce sont les atouts et potentialités
physiques que disposent la Commune de Sô-Ava (richesse en plan d'eau
permanente, sol adapté pour l'implantation d'infrastructures piscicole
et climat favorable). La pression, est la pollution qui altère la
qualité des eaux, la cherté de l'aliment poisson, les facteurs
climatiques (précipitations, températures, humidité) qui
dans leur variabilité entrainent l'instabilité des
paramètres physico-chimiques du milieu et cause la mort des
espèces élevées et les hautes eaux qui marquent
l'arrêt de la production pendant trois à quatre mois.
L'état est caractérisé par le développement
embryonnaire de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.
L'impact, c'est l'ensemble des effets socio-économiques causés
par la faible production piscicole, conditions d'accès en
protéine animal (poisson) dégradé et des pertes du
à une mauvaise connaissance de la pisciculture. Les réponses sont
les stratégies a développées pour une meilleure croissance
de la production piscicole.
69
3-2-4 Projet d'insertion professionnelle
o Identification du projet
Titre du projet
|
Implantation d'une ferme piscicole dans le village de
Sô-Tchanhoué (Commune de Sô-Ava)
|
Type de projet
|
Projet d'élevage
|
Chargé de l'exécution
du
projet
|
Domiho Honoré OKPOUE
|
Champ géographique du
projet
|
Commune de Sô-Ava
|
Secteur d'activité
|
Secteur primaire
|
Périodicité du projet
|
Toute l'année
|
|
o Description du projet Contexte et Justification du
projet
L'élevage est l'une des filières agricoles
faisant partie du secteur primaire non négligeable dans le
développement économique du Bénin. Il joue un rôle
considérable dans la vie économique des éleveurs par les
revenus qu'il génère et permet à ces derniers de
satisfaire leurs besoins vitaux et d'assurer la scolarisation de leurs enfants.
Il revêt aussi bien une importance particulière sur le plan social
en participant à la réduction du taux de chômage des
jeunes.
Le poisson représente plus de 30 à 40% des
protéines d'origine animale. Il est constitué de protéine
de haute valeur biologique et des acides aminés essentiels. Qu'il soit
frais, fumé ou séché, le poisson joue un rôle
très important dans la lutte contre la malnutrition et constitue une
source importante de protéines animales dans l'alimentation humaine.
Cependant, au Bénin, les captures sur les plans d'eau
intérieurs décroissent de façon drastique et ne suffisent
plus aux populations qui en font l'exploitation. La taille des espèces
cibles pêchées devient inquiétante puisque les prises sont
constituées à plus de 98% de juvéniles qui n'ont pas
encore fait une première
70
ponte, c'est-à-dire des individus immatures à
cause de la pression démographique et les techniques de pêche
rétrograde combinée aux phénomènes de changement
climatique. Dès lors la pêche naturelle sur les différents
plans d'eau n'arrive plus à permettre aux pêcheurs de satisfaire
la demande en poisson des populations. De même le rapport sur
l'état de la production halieutique consommé au Bénin
souligne que la production halieutique actuelle ne permet de couvrir que 44 %
des besoins nationaux en poissons estimés à 90.000 tonnes/an. La
pêche continentale est ainsi en déclin.
Pour combler ce déficit, le Bénin importe chaque
année plus de 45.000 tonnes de poissons congelés. Cette
dépendance vis-à-vis des importations en produits halieutiques
constitue une grande menace pour la sécurité alimentaire du pays.
Face à ce constat, il est important de penser à une autre forme
d'exploitation des plans d'eau (pisciculture) pour satisfaire la demande en
protéines d'origine halieutique. C'est dans le but de combler ce vide
accru en matière de protéine animal poisson que le présent
projet a été initié. Il consiste à produire et
à commercialiser du clarias gariepinus et du Tilapia
Oreochromis niloticus dans la Commune de Sô-Ava.
L'objectif global du projet
Production et commercialisation du clarias gariepinus
et du Tilapia
Oreochromis niloticus dans la Commune de
Sô-Ava.
De façon spécifique, il s'agit de :
V' réduire les difficultés d'approvisionnement en
protéine animal poisson ;
V' produire en plein temps afin de permettre à la
population d'avoir accès à
leur seul source de protéine animal poisson ;
V' créer des emplois.
Activités du projet
V' production des alevins ;
V' élevage des alevins jusqu'au poids moyen de vente ;
71
w' commercialisations des produits piscicoles
Résultats attendus
w' produire 4 tonnes de clarias et 2 tonnes de Tilapia par an ;
w' satisfaire la demande en protéine animale poisson des populations ;
w' faciliter les mises en relations commerciales.
Activités prévues :
w' Mobilisation des ressources financières ;
w' Achat du site de production ;
w' Achat des alevins et d'aliment poisson ;
w' Achat et construction des infrastructures adéquates de
production ;
w' Construction d'un magasin et d'un forage ;
w' Recrutement de main d'oeuvre.
Bénéficiaire du projet
Population de la Commune de Sô-Ava et les Communes
limitrophes.
Date : illimité
Date de démarrage : Février
2017
Date de fin prévue : illimité
Coût global du projet : 4.560.700 FCFA
Financement déjà acquis : 250.000
FCFA
Financement sollicité : 4.310.700 FCFA
Quant aux matériels de travail, un fond d'amortissement
sera mise en place pour
faciliter le renouvèlement du matériel.
72
Budget du projet
|
DESIGNATION
|
QUANTITES
|
P.U (FCFA)
|
MONTANT
(FCFA)
|
|
Parcelle
|
01
|
500000
|
500000
|
|
Construction
magasin et logement
|
01
|
1000000
|
1000000
|
|
Construction de
bassin de 12m2
|
01
|
500000
|
500000
|
|
Alevin de Clarias
|
2400
|
100
|
240000
|
|
Individus de Tilapias
|
108
|
150
|
16200
|
|
Château
d'eau/Forage
|
01
|
800000
|
800000
|
|
Constructions
d'étangs de 200m2
|
02
|
100000
|
200000
|
|
Provendes clarias
|
22 sacs
|
15000
|
330000
|
|
Provendes Tilapias
|
50 sacs
|
16000
|
800000
|
|
Epuisette
|
05
|
2000
|
10000
|
|
Balance
|
01
|
13000
|
13000
|
|
Brouette
|
01
|
15000
|
15000
|
|
Table de tri
|
01
|
10000
|
10000
|
|
Bassine
|
03
|
7000
|
21000
|
|
Seau
|
05
|
2000
|
10000
|
|
Paire de botte
|
02
|
6000
|
12000
|
|
Fourche
|
01
|
3000
|
3000
|
|
Coupe-coupe
|
01
|
2500
|
2500
|
|
houe
|
01
|
2500
|
2500
|
|
Table- chaises
|
01
|
|
65000
|
|
Cahiers manifold
|
01
|
10000
|
10000
|
|
Bic
|
05
|
100
|
500
|
|
TOTAL
|
-
|
|
4.560.700F CFA
|
73
Conclusion
L'étude des fondements biophysique de la production
piscicole dans la Commune de Sô-Ava a été possible
grâce à l'utilisation des données climatologiques des
stations pluviométriques et thermométriques de l'environnement
immédiat de la Commune de Sô-Ava (station synoptique de Cotonou)
puisque le secteur d'étude ne dispose pas de stations climatologiques.
Pour ce qui concerne les données des paramètres physico-chimiques
de la Commune de Sô-Ava, on ne dispose pas encore d'une longue
série devant permettre des analyses affinées.
Les données utilisées sont celles
collectées par les auteurs ayant effectué des travaux
récents sur les paramètres physico-chimique du milieu
d'étude.
De même, les données sur la production piscicole
de la Commune souffrent de disponibilité sur une longue période.
Cependant, les méthodes de traitement et d'analyse ont permis d'obtenir
des résultats évocateurs qui témoignent la
disponibilité des fondements biophysiques de la production piscicole
dans la Commune de Sô-Ava.
Au terme de cette étude, il est à retenir que le
secteur d'étude, jouit d'un climat favorable à la production
piscicole de Clarias gariepinus et du Tilapia Oreochromis
niloticus avec une température moyenne qui oxille entre un maximum
de 31,9°C (en mars) et un minimum de 23,5°C dans le mois
d'août. La disponibilité de l'eau, du sol et même que de la
topographie du milieu constituent des facteurs favorables au
développement de la pisciculture. Cependant, quelques contraintes
d'ordre technique, naturel, économique et climatique freinent le
développement de ce sous-secteur.
Face à ces situations, les populations
développent des stratégies d'adaptation pour leur mode
d'existence comme le prolongement des cycles de production, l'utilisation des
bacs hors sol, des bassins, etc.
74
Des stratégies complémentaires sont
proposées comme le développement de la pisciculture
intégré, la construction de centre d'écloserie moderne,
l'utilisation de différentes infrastructures adéquates, la
fabrication d'aliment poisson à base des produits locaux etc. Afin
d'assurer une meilleure croissance de la production piscicole dans la Commune
de Sô-Ava et une disponibilité en plein temps de la
protéine animale poisson pour les populations de cette Commune et celles
qui lui sont limitrophes.
75
Bibliographie
Adjanke A. (2011) : Formation en pisciculture : Production
d'alevins et gestion
de ferme piscicole. C.T.O.P, 39p.
Adouvi E.C. (2013) : Effets de la substitution de la farine de
poisson par la farine des graines de Néré (Parkia
biglobosa) et de la farine du tourteau de soja (Glycine maxima)
sur la croissance et la survie des juvéniles de Clarias gariepinus
(Burchell, 1822). Mémoire de licence, UAC/ENSTA-KETOU,
32p
Afouda F. (1990) : L'eau et les cultures dans le Bénin
central et septentrional : Etude de la variabilité des bilans de l'eau
dans leurs relations avec le milieu rural de la savane africaine. Thèse
de Doctorat nouveau régime, Université, Paris IV (Sorbonne),
Institut de Géographie, 428p.
Akitikpa (2001) : Essaie de mise au point de formules
alimentaires à Base d'AZOLA et de sous-produits locaux pour la
pisciculture rurale. Mémoire d'ingénieur des travaux, UAC/CPU/PA,
89p.
Akognongbe J. (2011) : Variabilité pluvio-hydrologique
et mutations des écosystèmes dans le lac Nokoué.
Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 86p.
Amoussou S. (2005) : Morpho-dynamique du delta de la Sô.
Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 108p
Arrignon J. (1998) : Aménagement piscicole des eaux
douces. Paris : BORDAS.
AssiahV.E., Ton V.S. et Aldin H. (1996) : Pisciculture en eau
douce à petite échelle. (Trad. E. Codazzi),Wageningen :
Agromisa.-III.-Agrodok, 15p.
Azontonde H.A. (1991) : Propriétés physiques et
hydrauliques des sols au Bénin. IAHS, publi.n°199,
249-258p.
Balfour H. et Pruginin Y. (1981): Commercial fish farming with
special reference to fish. A wiley-interscience publication, New York, 361p.
76
Béné C. et Heck S. (2005): Fish and Food
Security in Africa. In: Fish for All; a turning point for aquaculture and
fisheries in Africa. World Fish Centre Quarterly 28 [2 and 3], 8-13p.
Boko M. (1988) : Climats et communautés rurales du
Bénin : Rythmes climatiques et rythmes de développement.
Thèse de Doctorat d'Etat Lettres et Sciences Humaines. CRC, URA 909 du
CNRS, Uni, de Bourgogne, Dijon, 2volumes, 601p.
Boko M. et Ogouwale E. (2007) : Eléments d'approche
méthodologique en géographie et sciences de l'environnement et
structure de rédaction des travaux d'étude et de recherche.
UAC/FLASH/DGAT/LECREDE, 104p.
Cakpokiossa C. (2012), Biodiversité et exploitation de
quelques espèces de poissons de la rivière Sô au
Bénin. Mémoire de Master (MFH2), Université Polytechnique
de Bobo-Dioulasso, 113p.
CDI [Centre pour le Développement Industriel] (1998) :
Guide d'élevage du Tilapia. 1ère édition,
Bruxelles, 45p.
Clauzel C. (2008) : Dynamiques et enjeux de l'agriculture en
milieu lacustre : comparaison du lac Inlé (Birmani) et des Chinampas de
Mexico (Mexique), Revue Vertigo, vol 8, n°3, 1-9p.
Clédjo F. (1999) : La gestion locale de l'environnement
dans les cités du lac Nokoué (région urbaine du littoral
au Sud-Bénin), Mémoire de DEA : Gestion de l'environnement, DGAT,
FLASH, 56p.
Cledjo F. et Ogouwale E. (2009) : Climat, pression
anthropique, impacts environnementaux et dynamique des ressources biologiques
du lac Nokoué. Annales de la FLASH/UAC (Bénin) n°15
pp132-149.
77
Coche, A.G. et Muir, J.F. (1999) : Pisciculture continentale.
La gestion 2 la ferme et ses stocks. Manuel de la série FAO collection :
Formation, volume 21341p.
COMHAFAT [Conférence Ministérielle sur la
coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains et
l'Océan Atlantique] (2014) : Synthèse de l'Etude sur les
industries des pêches et de l'aquaculture au Bénin, 33p.
Dakpogan A. (2005) : Contribution à la restauration
écologique du lac Nokoué. Mémoire de maîtrise de
Géographie, UAC/FLASH.DGAT, 101p.
Direction des Pêches (1996) : Plan de gestion des plans
d'eau continentaux du Bénin. Projet Pêche Lagunaire-GTZ, 48p+
Annexes.
Djissou J. (2013) : Tendances climatiques et production
halieutique du lac Nokoué. Mémoire de maîtrise,
UAC/FLASH/DGAT, 73p.
Dovonou F.E. (2008) : Pollution des plans d'eau du
sud-Bénin et risques écotoxicologues : Cas du lac Nokoué.
Mémoire de DEAT, en Environnement Santé et Développement,
CIFRED, UAC, 68p.
Ewoukem E.T. (2011) : Optimisation biotechnique de la
pisciculture en étang dans le cadre du développement durable des
Exploitations Familiales Agricoles
au Cameroun. Thèse doctorat, Université
Européenne de Bretagne, 164p. FAO (2012) : cadre de programmation
pays-Bénin (2012-2015), 61p.
Fermon Y. (2008) : Pisciculture de subsistance en
étangs en Afrique : Manuel technique, AIMARA, 294p.
Fiogbe E et al (2002) : projet de diversification de
la pisciculture dans les zones humides du sud-Bénin : reproduction
artificielle et élevage larvaire de clarias gariepinus et
Héterotis niloticus. FLASH/UNB, Abomey-Calavi, 114p.
Floquet A., Vodouhe G., Houedokoho F., Mongbo R. et Triomphe
B. (2013) : Le whedo dans les systèmes agro-piscicoles de la
vallée inondable de l'Ouémé
78
au Bénin. Rapport d'étude approfondie. Programme
JOLISAA, UAC/Benin, Cotonou, Bénin, 40p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),
2004b: Capture-based aquaculture. The fattening of eels, groupers, tunas and
yellowtails.
Gboni M. (1995) : Rythmes climatiques et productions
halieutiques au Bénin : cas de la lagune côtière.
Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 124p + Annexes.
Guedenon P. (2010) : Pollution des écosystèmes
par les métaux lourds (Cd, Pd, Cu) : cas de du fleuve
Ouémé et du lac Nokoué. Mémoire de DEAT, Option :
Environnement Santé et Développement, EPD, UAC, 95p.
Hegbe B. (2013) : Techniques d'élevage bovin en milieu
lacustre : Cas de l'arrondissement d'Ahomey-Lokpo (Commune de Sô-ava).
Mémoire de maîtrise en géographie, UAC/FLASH/DGAT, 79p.
Houadegla A. (1991) : Rythmes climatiques et production
halieutique au Bénin : Cas du lac Nokoué. Mémoire de
maîtrise en géographie FLASH/UNB, 126p.
Houedanou C. (2013) : Stratégie d'adaptation des
populations de la Commune de Sô-Ava aux débordements des eaux de
la rivière Sô. Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT,
67p.
Hounkpatin A. (2010) : Pollution des écosystèmes
aquatiques par les métaux toxiques (Pd et Cd) : cas de la cité
lacustre de Ganvié. Mémoire de DESS Science de l'environnement et
développement durable, CIFRED, UAC, 72p.
Igue M. (1975) : Un exemple d'innovation agricole dans la
basse vallée de l'Ouémé : la riziculture. Mémoire
de titularisation, Centre de recherche Appliqué au Bénin,
Porto-Novo, 31p.
79
Lalèye P. (1995) : Ecologie comparée de deux
espèces de Chrysichthys : poisson siluriformes (claroteidae) du complexe
lagunaire Lac Nokoué - Lagune de Porto-Novo au Bénin.
Thèse de doctorat en science (zoologie), université de
liège (Labo de DPA) 199p.
Lazard J. et Legendre M. (1994) : La pisciculture africaine :
enjeux et problèmes de recherche. Cahiers d'études et de
recherches francophones en Agriculture. vol. III n°2, 71-138p.
Maar A., Mortimer., M.A.E.And Van Der Lingen, I. (1966): Fish
culture in central East Africa. FAO. Rome. 156p.
MAEP (2008) : Rapport de performance cité dans cadre de
programmation pays Bénin, 61p.
MAEP (2011) : Plan Stratégique de Relance du Secteur
Agricole (AIMAEP) ,108p + Annexes.
Mbouombouo D. M. (2007) : Caractérisation des
étangs d'inondation de la plaine des Mbô et analyse des facteurs
influençant leur production piscicole. Mémoire pour l'obtention
du diplôme d'Ingénieur. Université de
dschang/FASA-Cameroun, 77p.
Meho-Loko(2010) : Parasitotaune de CHRYSICHTHYS
NIGRODIGITATUS, poisson-chat d'intérêt piscicole des eaux
continentales du sud-Bénin : systématiques et effets
pathogènes. Mémoire de master professionnel, UAC/EPAC/PSA,
48p.
MFCDP [Ministère Français de la
Coopération et du Développement] (1991) : pisciculture en Afrique
subsaharienne, 156p.
Mikolasek O. et LazardJ. (1999) : Pisciculture continentale en
milieu tropical. In séminaire « Journée Aquacole de
l'Océan Indien. 1er édition » du 31 mai au 3
juin. Ile de la Réunion.
80
Niyonkuru C., Montchowui E. et Laleye P. (2007) : Effets de la
densité des géniteurs d'Oreochromis niloticus
stockés en bassins et nourris aux sous-produits locaux sur la
production d'alevins. Actes du 1er colloque de l'UAC des Sciences,
Cultures et Technologie, Zoologie, 147-156p.
Ogouwalé E. (2007) : Evaluation des impacts des
changements climatiques sur les écosystèmes du lac Nokoué.
In ENDA TM, 88p.
Okou C., Dakpo P. C., Ahonnon A. et Houngan M. C.
(2007):Impact socio-environnemental de l'exploitation du sable marin sur le
Développement Humain Durable, Actes du 1er Colloque de l'UAC,
83 à 90p.
Olivry O. (1983) : Le point en 1982 sur l'évolution de
la sècheresse en Sénégambie et aux Îles du cap vert.
Examen de quelques séries de longue durée (débits et
précipitations). Cah. ORSTOM, Sér. Hydrol., vol. XX n°1,
47-69p.
PADPPA (2011) : Programme d'Appui au Développement
Participatif de la Pêche Artisanale (PADPPA).
Paugy D., Leveque C. et Teugels G.G. (2003) : Les poissons des
eaux douces et saumâtres de l'Afrique de l'Ouest. Editions IRD.
Publication scientifiques de Museum. MRAC, 2004.
PDC (2010) : Plan de Développement Communal, Commune de
Sô-Ava, 20102014, Version finale, Oxfam Québec, 142 p.
Pelissier P. (1963) : Les pays du bas Ouémé, une
région témoin du Dahomey méridional, faculté des
lettres et sciences humaines de Dakar, travaux du département de
géographie, N°11, 173 p.
PNUD [Programme des Nations Unies pour Le
Développement] (2001) : Etudes sur les conditions de vie des
ménages ruraux (EVCR2), 170p.
81
Pouomogne V. (1998) : Pisciculture en milieu tropical
Africain: Comment produire du poisson à coût modéré.
Coopération française, Centre d'excellence pour la production,
l'innovation et le développement. Presse universitaire d'Afrique,
236p.
PROVAC (2013) : Production d'Alevins du poisson-chat Africain
(Clarias gariepinus) au Bénin. Préparé et
publié à la Direction de la Production Halieutique par la Projet
de la Vulgarisation de l'Aquaculture Continentale République du
Bénin, JICA/MAEP, Cotonou, 29p.
PROVAC (2013) : Production d'Alevins du poisson-chat Africain
(Oreochromis niloticus) au Bénin. Préparé et
publié à la Direction de la Production Halieutique par la Projet
de la Vulgarisation de l'Aquaculture Continentale République du
Bénin, JICA/MAEP, Cotonou, 29p.
Rischl M. (1992) : Faune des poissons d'eau douce et
saumâtre de l'Afrique de l'Ouest Vol 2 collection faune tropicale XXVIII,
Orstom, Paris Musée royal de l'Afrique de Centrale.
Rurangwa E.,Van Den Berg J., Laleye P.A., Van Duijn A.P. et
Rothuis A. (2014): Mission exploratoire Pêche, Pisciculture et
Aquaculture au Bénin : Un quick scan du secteur pour des
possibilités d'interventions, 70p.
Schwartz D. (2002) : Méthodes statistiques à
l'usage des médecins et biologistes. Collections statistiques en
biologie et en statistique, 4ème édition, Flammarion
médecine science, Paris, 391p.
Sohè L. (2011) : Prolifération de la jacinthe
d'eau (Eichhornia crassipes) sur le lac Nokoué : facteurs
climatiques, perceptions et stratégies endogènes de lutte.
Mémoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 73p.
Sohou Z., Houedjissin R. C. et Ahoyo N. R. A. (2009): La
pisciculture au Bénin : de la tradition à la modernisation. Brab,
2009, 66, 48-59p.
82
Sossou-Agbo L. (1998) : Système foncier et gestion des
plans d'eaux dans l'écosystème de la lagune côtière
du bénin. Mémoire de maîtrise de géographie,
FLASH/UNB, Abomey-Calavi, 114p.
Stanley B., Allsopp W.H., et Davy F.B. (1979) : Les fermes de la
mer : description du programme de recherche aquicoles subventionné par
le centre de recherches pour le développement international. Ottawa,
Ont., CRDI, 40p.
Tcheoubi H. (2006) : Etude de la dynamique
hydro-sédimentaire et écologique du lac Salé (Commune de
Ouinhi). Memoire de maîtrise, UAC/FLASH/DGAT, 99p.
Teugels G.G. (1986): A systematic revision of the African
species of the genus Clarias (Pisces; Clariidae). Ann. Mus. R. Afr. Centr.,
147(8), 1-193p.
Texier H. (1980) : Le lac Nokoué, environnement du
domaine margino-littoral sud béninois : Bathymétrie
lithofaciès, salinité, mollusque et peuplement
végétaux. Bulletin IGGA, Bordeaux n°28, 115-142p.
Timmermans J. A. (1962): Influence de la température
sur la production piscicole en étang. Groenendaal, publi Mai 1962,
67-71p.
Toffon E. (2013) : Elevage de bovin dans la Commune de
Sô-Ava : organisation, impacts socio-économiques et
environnementaux. Mémoire de Maîtrise de Géographie, DGAT,
UAC, 70p.
Toko I. (2007) : Amélioration de la production
halieutique des trous traditionnels à poisson (whédo) du delta de
l'Ouémé (sud-Bénin) par la promotion de l'élevage
des poissons-chats Clarias gariepinus et Hétoro branchus
longifilus : Thèse de doctorat. UAC, 280p.
Vissin E. (2001) : Contribuer à l'étude de la
variabilité des précipitations et des écoulements dans le
bassin béninois du fleuve Niger. Mémoire de DEA,
Université de Bourgogne, CNRS, 56p.
83
Wanou D. (2013) : Impacts socio-économiques et
environnementaux de l'exploitation du sable lagunaire dans la Commune de
Sô-Ava. Mémoire de maîtrise en géographie,
UAC/FLASH/DGAT, 88p.
Wouinsou C.T. (2011) : Gestion des ressources en eau et leurs
impacts sur les activités humaines dans la Commune de Sô-ava.
Mémoire de maîtrise en géographie, UAC/FLASH/DGAT, 87p.
Site consulté
www.googlescholar.com,
www.google
.com, consulté le 16/05/16 à
22h 35mn www.memoire
Online.com,
consulté le 01/ 07/ 16 à 21 h
45mn.
www.fao.org/docrep/013/i1820f/i1820f00.pdf.le 14 / 07/ 23 à 00 h
15mn.
84
Liste des tableaux
Tableau I : Structures/centres de documentation
visiter et information recueillir
20
Tableau II : Liste des différentes
localités retenues et le nombre de personne
enquêtées par arrondissement 22
Tableau III : Position systématique de
Clarias gariepinus 43
Tableau IV : Position systématique du
Tilapia Oreochromis niloticus 44
Tableau V : Synthèse des
caractéristiques écologiques et biophysiques des espèces
d'intérêt aquacole (Clarias gariepinus et Tilapia
Oreochromis niloticus)
de la Commune de Sô-Ava 47
Tableau VI : Tableau synthétique des
infrastructures piscicoles utilisés dans la
Commune de Sô-Ava : Avantages et contraintes 51
Liste des figures
Figure 1 : Situation géographique de la
Commune de Sô-Ava 27
Figure 2 : Topographie de la Commune de
Sô-Ava 32
Figure 3 : Formations pédologiques de la
Commune de Sô-Ava 34
Figure 4 : Régime pluviométrique
de la station synoptique de Cotonou
sur la période (1986-2015) 39
Figure 5: Températures Maximales et
minimales de la station synoptique de
Cotonou (1986-2015) 40
Figure 6 : Relation entre température et
humidité (1986-2015) 41
Figure 7 : Humidité Minimale et minimale
de la station synoptique de Cotonou
(1986-2015) 42
Figure 8 : Différentes infrastructures
piscicoles utilisées dans la Commune de
Sô-Ava 54
Figure 9 : Différents secteurs
d'activité (%) qui s'intéressent à la pisciculture 59
Figure 10 : Destination des gains 60
Figure 11 : Analyse à l'aide du
modèle FPEIR des facteurs biophysiques de la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava 67
85
Liste des photos
Photo 1 : Vue partielle de la rivière
Sô à Ahomey-lokpo 30
Photo 2 : Sac de provende de Multi-Feed dans
une ferme piscicole à Ganvié 36
Photo 3 : Spécimen de Clarias
gariepinus 43
Photo 4 : Spécimen du Tilapia
Oreochromis niloticus 45
Photo 5 : Bac hors-sol couvert contre les
intempéries à Ganvié 63
Photo 6 :L'eau verdâtre dans un bassin
piscicole à Ganvié. 63
Liste des planches
Planche 1 : Bouse de vache et son de
maïs à Vekky 37
Planche 2 : Bassin et Bac hors-sol piscicole
à Ganvié. 52
Planche 3 : Cage flottante
implantée dans la rivière Sô, dans les
arrondissements de Sô-ava et d'Ahomey-lokpo en saison de
basses eaux 53
Planche 4 : Etangs sur nappe
phréatique dans les arrondissements de Sô-Ava et
de Vekky en saison de basses eaux (décrue) 54
86
ANNEXES
QUESTIONNAIRE
Dans le cadre de la réalisation de notre mémoire de
Maîtrise, nous vous prions de répondre à ce questionnaire
afin de nous permettre d'étudier les facteurs biophysiques favorable
à la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.
Objectif spécifique 1 : identifier les facteurs
biophysiques du développement de la pisciculture dans la Commune de
Sô-Ava
1- La pisciculture est-elle pour vous une activité ? 1-de
plein temps [ ]? 2- secondaire [ ]? 3- autre [ ]?
2- Depuis quand pratiquez-vous la pisciculture ?
1-moins de 5 ans [ ]? 2-depuis l'enfance [ ]? 3- autres[ ]?
3- Quels sont selon vous les facteurs physiques/naturels qui
favorisent le développement de la pisciculture ?
1- existence de réseau hydrographique [ ]? 2-
disponibilité de l'eau [ ]? 3-existence de bas-fond adapté
à la pisciculture [ ] ? 4- nature du sol : sol hydromorphes [ ] ?
argileux [ ] ? limoneux [ ]? Sableux [ ]? Autre [ ]?
5- pente douce du terrain [ ] ? 6- vent [ ]? 7- humidité
relative [ ] ? 8-température [ ] ? 9- hauteurs de pluies [ ] ?
4- En quoi est ce que ces facteurs vous sont favorable ?
Facteurs physiques Favorables
En quoi sont-ils favorables/
Utilités
5- 82
quelles sont les exigences écologiques des espèces
que vous élevez ?
1- Eau salé [ ] ? 2- Eau saumâtre [ ] ? 3- Eau
douce [ ]? 4- Température : Faible [ ] ? Moyenne [ ] ? Elevé [ ]
? 5- Humidité : Faible [ ] ? Moyenne [ ] ? Elevé [ ] ? 6- Autre [
] ?
6- Quels sont les types d'eau disponible pour la pisciculture
dans la Commune de Sô-ava ?
1- Eau salé [ ] ? 2- Eau saumâtre [ ]? 3- Eau douce
[ ] ? 4- Autre [ ] ?
7- Quelle(s) sont les/la source(s) d'eau(x) qu'utilisez-vous
pour votre production ?
88
1- eaux de surfaces [ ] ? 2- eaux de la nappe
phréatique [ ] ? 3- eaux de pompe/forage [ ] ? 4- autre [ ] ?
Et pourquoi ce/ces
choix ?
|
Sources d'eau
|
Impacts
|
|
Salées
|
|
|
Saumâtres
|
|
|
Douces
|
|
8- Quelles sont les espèces qui supportent une forte
teneur des eaux salées, une eau saumâtre, ou douce ?
|
Types d'eaux Espèces
|
Eau salé
|
Eau saumâtre
|
Eau douce
|
|
Tilapia: Owè
|
|
|
|
|
Clarias G : Oson
|
|
|
|
|
Héterotis : Ohoua
|
|
|
|
|
Chrysichthys :zavoun
|
|
|
|
|
Autres
|
|
|
|
9- A quelle période de l'année apparait-on ces
différents types d'eau ?
Types d'eaux
|
Période de l'année
|
Eau salé
|
|
Eau saumâtre
|
|
Eau douce
|
|
|
10- Comment est-ce que votre production a évolué
ces dernières années ?
Evolution de production
Progression Stabilité Régression
|
|
|
|
11- Quelles sont les causes de cette évolution ?
|
Causes d'évolution de la production
|
|
Facteurs physiques
|
|
|
Facteurs Humaines et économiques
|
|
|
Facteurs Sociaux
|
|
Objectif spécifiques 2 : Analyser les contraintes
à la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava
1- Avez-vous connaissance des années où votre
région a connu des sécheresses ? oui [ ] non [ ]
Si oui lesquelles ?
Sécheresse
Année de manifestation
2- Quelles ont été les conséquences de cette
sécheresse sur votre production piscicole ?
Conséquence sur la production
piscicole
3- Avez-vous connu des inondations ? Oui [ ] Non [ ]
4- Quelles sont les effets de crue et de décrue sur votre
production ?
Effets sur la production piscicole
5- 89
Quelles sont les modifications qu'a subies les plans d'eau, cours
d'eau, rivière et le lac Nokoué ces dernières
années ?
a)-Comblement/ensablement [ ] ; oui=1 ; non=0 b)-Augmentation de
la salinité [ ] ; oui=1 ; non=0 c)-Diminution de la salinité [ ]
; oui=1 ; non=0
d)-Augmentation du niveau de l'eau [ I ; oui=1 ;non=0
e)-Diminution du niveau de l'eau [ I ; oui=1 ; non=0 f)-Autres [ ] ; oui=1 ;
non=0
Si oui préciser
6- Quelles sont les conséquences des types d'eau sur les
poissons élevés ?
|
Eaux plus salées
|
Eaux moins salées
|
Périodes
|
|
|
Conséquences
|
|
|
|
7- Quelles sont les périodes de l'année où
les eaux de la Commune sont polluées ?
90
Eaux polluées
Périodes de l'année
8- Quelles sont les conséquences de cette situation sur
les poissons élevés?
Conséquences sur la production
piscicole
Eaux polluées
9- Est-ce que les phénomènes naturels ont des
impacts sur votre activité ?
|
Phénomènes naturels
|
Impacts
|
|
La pluie
|
|
|
Insolation
|
|
|
Le vent
|
|
|
La température
|
|
|
Prolifération de plante aquatique
|
|
|
Nature du sol
|
|
|
Qualité de l'eau
|
|
|
Saisons sèche
|
|
|
Saisons pluvieuse
|
|
10- L'accès à un domaine piscicole est-il facile ?
Oui [ ] ou Non [ ] Si oui comment ? si Non pourquoi ?
Accès au domaine piscicole
Facile/Comment
Difficile/Pourquoi
11- Bénéficiez-vous d'encadrement technique ? Oui [
] Non [ ]
Encadrement technique
Oui
Non et pourquoi ?
12- 91
Quelle(s) structure (s) vous Avez-vous assure (nt) l'encadrement
? 1-CARDER/SCDA [ ] ? 2- Spécialiste [ ] ? 3- ONG [ ] ? 4-
Autre [ ] ?
13- Existe-t-il selon vous une ou des périodes de
l'année où la production est plus facile/difficile oui [ ] [ ]
non
Si oui situez les dans l'année ?
|
Périodes de l'année
|
|
La production est facile
|
|
La production est difficile
|
|
|
|
Objectifs spécifiques 3 : Examiner la
rentabilité et la destination des gains de la production piscicole dans
la Commune de Sô-Ava
1- Quelles techniques de pisciculture pratiquez-vous :
1-étang [ ] 2-whédo [ ] 3-bassin [ ] 4-cage
flottante [ ] 5-bac hors sol [ ]
Et pourquoi ?
Techniques de pisciculture
Pourquoi
2- Quelles sont les espèces que vous élevez :
1- Tilapia
(OreochromisniloticusetSorotherodonmelanotheran):Owè___?
2-Clarias (Clarias gariepinus):Oson [ ]?
3-Héterotis (Héterotisniloticus):Ohoua [
]?
4-Chrysichthys (Chrysichthysnigrodigitatus) : Zavoun [
] ?
5-Autre [ ] ?
Et pourquoi ?
3- Que constatez-vous quant au rendement en produits piscicole :
1-Augmenté [ ] ? 2-Diminués [ ] ? 3-Inchangés [ ] ?
4-Autre [ ] ?
4- Quelles sont les raisons de la baisse éventuelle de la
production piscicole : 1-Variabilité climatique [ ] ? 2-Cherté de
la provende [ ] ? 3-Mauvaise techniques piscicole [ ] ? 4-Mauvaise connaissance
de production piscicole [ ] ? 5- Manque de marché d'écoulement [
] 6- Autre [ ] ?
5- Comment avez-vous acquis votre domaine de production
piscicole : 1-Achat [ ] ? 2-Don [ ]? 3-Location [ ]? 4- Autre [ ] ?
6- A combien s'élèvent approximativement vos
revenus après récolte ?
1- En période de production abondante [ ] ? 2- En
période de pénurie
[ ] ?
7- A quelle fin utilisez-vous vos revenues ?
Revenues
Usages
8- Parmi les espèces élevées la/ lesquelles
(s) présente(nt) un meilleur rendement ?
|
Espèces élevés
|
Niveau de rendements
|
|
Tilapia
|
|
|
Clarias
|
|
|
Héterotis
|
|
|
Chrysichthys
|
|
|
Autres
|
|
9- Etes-vous organisés en association ? Oui ou Non ?
10- Si oui quel est son nom et mode de fonctionnement ?
Nom : Mode de fonctionnement :
Objectif spécifique 4 : Proposer les
stratégies de renforcement de la pisciculture dans la Commune de
Sô-Ava
1- Quelles sont les pratiques/méthode que vous
développées pour s'adapter à la baisse de la production
piscicole ?
Pratiques/Méthodes
Explications

92
2- Avez-vous d'autres activités en dehors de la
pisciculture ?
oui [ ] non [ ]
Si oui lesquelles ?
93
3- Prenez-vous des précautions pour vous adapter aux
régimes climatiques ? Oui [ ] ? ou Non [ ] ?
Si oui les quelles ?
Précautions d'adaptation aux régimes
climatiques
4- Cette activité vous permet-elle de répondre
à vos besoins ? Oui [ ] ou Non [ ]
5- Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans
votre activité ?
Difficultés rencontrées
6- Quelles sont vos suggestions pour améliorer votre
activité ?
7- Quelles stratégies souhaiterez-vous adopter pour mieux
réussir dans votre activé ?
Propositions de stratégies
? Guide d'entretien
Aux agents de structures
spécialisées
1- Depuis quand intervenez-vous comme encadreur dans la
production
piscicole ?
2- Quelles sont les périodes où vous intervenez
dans la production
piscicole ?
3- Quelles sont les types d'encadrements donnés aux
pisciculteurs ?
4- Quelles sont les modes d'accès aux domaines piscicoles
?
5- 94
Quelles sont les normes que vous prévoyez pour la mise en
charge des
espèces?
6- Donnez-vous aux pisciculteurs les moyens d'assumer une
exploitation
croissante ?
7- Les techniques de production piscicole que vous recommandez
sont-ils favorables en milieu lacustre (Sô-Ava) ?
8- Quelles sont les difficultés rencontrez dans votre
activité ?
9- Quelles sont vos suggestions pour améliorer la
production piscicole d'eau douce/saumâtre Dans la Commune de Sô-Ava
?
10- Est-ce que la Commune de Sô-Ava dispose des
potentialités Physiques et humaines pour faire l'exploitation de la
production piscicole ?
? Grille d'observation
|
Eléments
|
Etat/Observation
|
|
Les Facteurs physiques et biologiques sur le
cadre
|
|
L'hydrologie
|
|
|
Le climat
|
|
|
Le couvert végétal
|
|
|
La géologie et la pédologie
|
|
|
La topographie
|
|
|
Les caractères physico-chimiques
|
|
|
Autres
|
|
|
Système de production piscicole
|
|
Les techniques de production piscicole
|
|
|
Les infrastructures et outils piscicoles
|
|
|
Le mode de fonctionnement
|
|
|
Les produits piscicoles
|
|
Les poissons
|
|
|
Les crustacés
|
|
|
Les mollusques
|
|
95
Table des matières
Sommaire 2
Dédicace 3
Sigles et acronymes 4
Remerciements 5
Résumé 6
Abstract 6
Introduction 7
CHAPITRE I: ETAT DES CONNAISSANCES, PROBLEMATIQUE, CLARIFICATION
DES CONCEPTS ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE
10
1.1- Etat des connaissances 10
1.2- Clarification des concepts 13
1.3-Problématique 15
1.3.1- Justification du sujet 15
1.3.2- Hypothèses de travail 17
1.3.3-Objectifs de recherche 17
1.4- Démarche méthodologique 18
1.4.1- Données utilisées 18
1.4.2- Collecte des données 19
1.4.3-Traitement des données 23
1.4.4- Analyse des résultats 24
CHAPITRE II: FACTEURS BIOPHISIQUES DU DEVELOPPEMENT DE LA
PISCICULTURE 26
2.2 Différentes formes de la pisciculture 28
2.3 Facteurs biophysiques de la production piscicole dans
la Commune de Sô-
Ava 29
2.3.1 Disponibilité de l'eau piscicole dans la Commune de
Sô-Ava 29
96
2.3.2 Topographie du secteur d'étude 31
2.3.3 Pédologie du milieu d'étude 33
2.3.4 Disponibilité d'aliment poisson dans la Commune
de Sô-Ava 35
2.4 Exigences écologiques des espèces
élevées 38
2.4.1 Tendances climatiques dans la Commune de Sô-Ava
38
2.4.2 Paramètres Physico-chimiques des espèces
élevées 42
2.4.2 Référendum écologique 46
CHAPITRE III: CONTRAINTES ET STRATEGIES DE RENFORCEMENT POUR
UNE MEILLEURE CROISSANCE DE LA PRODUCTION
PISCICOLE DANS LA COMMUNE DE SÔ-AVA 49
3.1 Contraintes de la production piscicole dans la Commune de
Sô-Ava 49
3.1.1 Contraintes de choix de type d'infrastructure piscicole
49
3-1-2 Contraintes climatiques et accès à l'eau
de qualité sur la production
piscicole de la Commune de Sô-Ava 55
3.1.3 Contraintes techniques 57
3.1.4 Contraintes socioéconomiques 58
3.2 Stratégies de renforcement pour une meilleure
croissance de la production
piscicole dans la Commune de Sô-Ava 61
3.2.1
Perception des populations sur le développement embryonnaire de la
pisciculture dans la Commune de Sô-Ava 61
3.2.2
Techniques développées par les pisciculteurs pour faire face
aux
contraintes rencontrées 62
3.2.3 Proposition des
stratégies de renforcement pour une meilleure croissance
de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava
64
Figure 11 : Analyse à l'aide du modèle FPEIR des facteurs
biophysiques de la
production piscicole dans la Commune de Sô-Ava 67
3-2-4 Projet d'insertion professionnelle 69
Conclusion 73
97
Bibliographie 75
Liste des tableaux 84
Liste des figures 84
Liste des photos 85
Liste des planches 85
ANNEXES 86
Table des matières 95
| 


