2.2.2. Implication de la CTDs à la production
décentralisée de l'électricité
Parfois, les solutions décentralisées sont plus
rentables que (Figure 2.10 ) les solutions
centralisées . C'est le cas par exemple lorsque la distance du site
rural au réseau national est importante ou encore lorsque l'Etat
favorise ce type d'installation, en instaurant des mesures favorables aux
bénéficiaires (populations concernées et communes
rurales).

Connexion au réseau d'autant moins rentable que
les usagers sont dispersés et pauvres - Cout de raccordement
- Cout d'exploitation : pertes en ligne, frais d'entretien et de
gestion élevées pour de faibles
consommations
Solutions rurales
décentralisées
Moyens disponibles concentrés sur les
villes
- Exode rural
- Nombreuses zones rurales éloignées sans
réseau électrique
Solidarité plus forte à l'échelle
locale
Financements à l'échelle nationale
limités
Figure 2.10 : Synoptique vers les choix
des réseaux électriques
décentralisés
Dans un contexte de décentralisation, il importe de
définir une stratégie d'implantation de la solution
envisagée pour une responsabilisation des activités par toutes
les parties prenantes en faisant une distinction entre l'entité qui
offre le service énergétique et celle propriétaire des
moyens et infrastructures. Si l'on prend comme critère de distinction,
la propriété des infrastructures, nous pouvons envisager quatre
cas possibles :
1) Le service électrique est assuré par une
entreprise publique : c'est la forme de propriété la plus
courante, où l'Etat doit rendre compte de sa gestion dans le cadre de
contrats-plan ou de contrats-gestion.
2) L'Etat est propriétaire, mais l'exploitation est
sous-traitée au secteur privé : ce dernier est souvent
chargé de l'entretien et de l'exploitation de l'équipement, voire
dans certains cas de la construction de l'infrastructure (gestion
déléguée de type concession).
3) Le service privé est propriétaire des
infrastructures mais son activité est réglementée.
4) Le service qui est assuré par la communauté
et l'usager qui sont propriétaires ou pas des équipements. Cette
solution est privilégiée lorsque les services publics ne
permettent pas la satisfaction de tels besoins.
Bien sûr, ces quatre situations ne sont pas exhaustives
mais permettent de dresser les cas les plus courants. La capacité de
mobiliser des financements adéquats pour le développement de
services apparaît à chaque fois indispensable.
Plus que jamais, la nature du développement de
l'électrification rurale décentralisée dans les pays
d'Afrique passe par le soutien de l'Etat, ses partenaires au
développement et des ONG. L'Etat oeuvre pour assurer la cohérence
des schémas d'électrification, leur programmation, et surtout
leur concrétisation en renforçant la législation et la
réglementation. Celui-ci intègre la dimension économique
par la mobilisation des forces économiques, sociales et administratives
de la nation pour résoudre les problèmes qui se posent. Avec
l'accroissement de la défaillance de l'Etat dans des
domaines dont il avait traditionnellement la responsabilité, les ONG,
les acteurs privés et les organismes multilatéraux se sont
spécialisées dans leur soutien aux « petits projets
énergétiques participatifs », se démarquant ainsi de
l'approche technicienne et productiviste des grands projets de
coopération publique. « Le petit projet » est conçu
comme un outil de promotion de solutions énergétiques
décentralisées, outil initié par les acteurs de base
(bottom up decisionmaking).
L'accès à l'électrification rurale
demande à effectuer des choix technologiques appropriés. Les
critères de sélection de ceux-ci sont les suivants :
> Gamme de puissance souhaitée
> Ressource disponible
> Gestion des intermittences
> Impact environnemental
> Difficulté de mise en oeuvre, modèle de
gestion
> Cout d'investissement et d'opération
> Conflits d'usage
L'accès sans discrimination à
l'électricité est un des objectifs de la coopération
internationale. Pour y parvenir, de nombreuses options techniques et
organisationnelles maîtrisées parfaitement existent :
i. La localisation des populations concernées par rapport
au réseau national Basse Tension (BT) et ou Moyenne Tension (MT)
ii. Le pouvoir d'achat des populations concernées, qui
déterminent le choix des solutions techniques les mieux
adaptées.
Pour une meilleure compréhension des options techniques
envisageable en fonction de la localisation des populations il importe
d'effectuer un choix judicieux (Fig 2.11). Le guide
de sélection des techniques d'électrification rurale
approprié à un contexte donné proposé ici n'a pas
l'ambition d'être exhaustif et chaque solution regroupe plutôt une
famille d'interventions, qui se distinguent par l'organisation du service ou de
la délégation, le choix de la source d'énergie localement
la plus adéquate, le pouvoir d'achat des populations... etc.

Fig 2.11: Le guide de sélection des
techniques d'électrification rurale approprié. Source René
Massé dans «Promoting Rural Decentralized Electrification in Africa
: Best Pratices Paper» ESMAP publication, 2000.
Population Périurbaine
Solutions spécifiques - Connexion au
réseau - Systèmes de prépaiement -
Délégation gestion client - Compteur collectif
- Rétrocession d'électricité
- Recharge
de batteries
Oui
Et /ou encore
La population réside sous le réseau BT ou
à
proximité (<5km)
Solutions décentralisées
a) Solution individuelles :
- Achat d'un générateur PV,
thermique, éolien...etc. - Recharge de batteries au
réseau le plus proche
b) Solutions collectives :
- Fournisseur de « services électriques
»à une clientèle regroupée (village, quartier)
- Concessionnaire villageois
ou pour une région
Extension de réseau - Réseau
conventionnel - Réseau à faible coûts
Ou
Non
Et /ou encore
La population réside sous le réseau MT, HT ou
à proximité (<10km)
Solutions spécifiques
- Raccordement conventionnel et/ou extension du réseau
- Raccordement privé et délégation de la
gestion clientèle du réseau local compteur collectif
- Poste de recharge de batteries
Non
Oui
Population Rurale
67
68
Parmi le large éventail de solutions techniques, on
distingue les systèmes individuels d'électrification (SIE) et les
systèmes collectifs (SEC).
? Les systèmes individuels
d'électrification(SIE), comme les installations photovoltaïques,
les groupes électrogènes individuels...etc. n'ont de perspectives
durables que lorsque l'installation d'un réseau électrique local
est impossible, en particulier lorsque l'habitat est très
dispersé. Un système d'électrification collectif (SEC)
distribuant l'électricité à travers un réseau
électrique local leur est alors le plus souvent
préférable.
? Un réseau électrique local n'a, lui
d'intérêt que lorsque le raccordement au réseau
électrique
national est impossible, en raison en particulier de la distance
de l'agglomération au réseau
On a pris l'habitude ces dernières années
à cause des développements technologiques dans le domaine des
énergies renouvelables de distinguer, parmi les options d'ER, les
solutions dites «décentralisées». L'Electrification
Rurale Décentralisée (ERD) ne se réfère pas
seulement à des choix technologiques (réseau ou hors
réseau) ou géographiques (urbain ou rural). Cette nouvelle
conception de l'ER se réfère le plus souvent à la
production locale de l'électricité mais aussi surtout à la
décentralisation de la décision d'entreprendre et de
générer un schéma d'électrification, qu'il soit
raccordé au réseau ou non, en zone rurale ou
périurbaine.
Des facteurs critiques doivent être pris en compte dans
le montage durable des projets d'électrification rurale
décentralisée : choix de technologie ; garantie de
l'accessibilité ; considérations sociales et environnementales ;
opportunités d'activités productives ... Aussi, des principes
doivent être suivis à cet effet. (Confère Banque Mondiale,
Novembre 2008) [27].
Une fois la décentralisation envisagée
implantée dans la collectivité territoriale grâce à
l'essor de l'électrification rurale décentralisée, les
populations déjà certaines que le développement local
passe par leur capacité de regroupement et de bénéficier
des moyens mises à leur disposition demanderont une reconstitution
(Tab 2.2) de leur collectivité territoriale en
commune par exemple afin d'avoir une identité institutionnelle.
Tableau 2.2: Scénario pour améliorer le
taux d'accès à l'électricité dans les zones rurales
et urbaines en Afrique pour la période 2007-
2050 [28]

Ils sont nombreux les problèmes qui freinent la mise de
l'électrification rurale décentralisée au service d'un
vrai développement durable au Cameroun. On a notamment :
69
- Documentation et disponibilité des informations, surtout
la cartographie, la cartographie,
Difficulté pour avoir à disposition des experts
pour des installations,
Taxation douanière exorbitante,
Méconnaissance de nombreuses initiatives locales
isolées à orienter,
Manque de coordination entre tous les acteurs, surtout absence
d'une ligne directrice à suivre par les
acteurs privés.
2.2.2.1. Contraintes liées à la mise en
place d'un projet d'ERD
Avant d'entamer une étude de projet d'ER, il importe
ici que nous recensons tout d'abord les différents centres de production
pouvant être utilisés dans le cadre de l'ERD.
Tableau 2.3 : différents types de centre de
production pour l'ERD
|
1
|
Le système de production est constitué par deux
sources complémentaires ; une source principale (éolienne, Moteur
Synchrone avec un redresseur intégré dans la machine) et une
source secondaire (groupe diesel). En complément, nous pouvons noter la
présence d'une batterie pour le stockage et pour réaliser un
tampon entre l'éolien et la charge.
|
|
2
|
Le système de production est constitué par un
ensemble de panneaux photovoltaïques (PV) associés à un
système de stockage par batterie. La batterie peut être
chargée par un groupe électrogène. Ce système
permet d'arriver à une meilleure fiabilité qu'un système
PV sans groupe électrogène. Le diesel réduit la taille du
PV et le PV réduit le temps de fonctionnement du diesel, la consommation
en fuel, la maintenance et les coûts de remplacement.
|
|
3
|
Le système de production est constitué par une
éolienne associée à un système de stockage par
batterie. La non utilisation d'un groupe de secours oblige ici d'avoir un
système de stockage de taille importante (environ cinq jours
d'autonomie).
|
|
4
|
Le système de production est constitué par une
éolienne et des panneaux PV associé à un système de
stockage. Ce système n'utilise pas de groupe diesel.
|
|
5
|
Le système de production est constitué par un
ensemble éolien + panneaux PV associé à des batteries. Un
groupe électrogène est utilisé uniquement lorsque
l'ensemble ne peut plus rien fournir. On utilise également une charge
ballaste (dump load) dans le cas où l'ensemble du système
à base d'EnR ne peut plus fournir l'énergie électrique
nécessaire.
|
|
6
|
Le système de production est constitué par un
ensemble de groupes électrogènes associés à un parc
éolien et des panneaux PV (avec stockage) ; le tout alimentant
l'île grecque de Kythnos. La présence des énergies
renouvelables est là pour réduire la consommation en fuel des
groupes électrogènes.
|
|
7
|
Le système de production est constitué par un
ensemble de groupes électrogènes associés à un parc
éolien et des panneaux PV (avec stockage) et une charge ballaste.
|
|
8
|
Le système de production est constitué par un
groupe diesel associé à des panneaux PV et des batteries. Le
groupe électrogène est éteint aux heures creuses lorsque
les batteries peuvent fournir l'énergie électrique.
|
Le Tableau 2.3 fait
apparaître deux types de centres de production ; les centres utilisant
principalement les énergies renouvelables (de [1] à [5]) et les
centres utilisant principalement l'énergie fossile comme source de
production (de [6] à [8]). Les différents exemples
présentés dans le Tableau 2.4 montrent
qu'il existe un nombre très important de configurations de centres de
production, que ce soit pour les systèmes basés sur les GE ou les
systèmes basés sur les EnR. Pour mieux cerner la
problématique portant sur les projets d'électrification en zone
rurale, il importe de définir les différentes parties prenantes.
Les acteurs intervenant dans l'électrification d'une zone sont ainsi
cartographiés en figure 2.12. Pour chacun de
ces acteurs, nous avons défini les différentes
fonctionnalités qui peuvent être attendues du réseau de
distribution. Le tableau 2.4 regroupe les principales
fonctions attendues par chacun de ces acteurs.
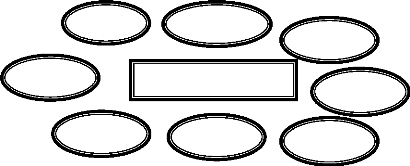
Financiers
Gestionnaire clients
Clients Exploitant du
réseau Autorités
politiques
ELECTRIFICATION RURALE D'UNE ZONE
Gestionnaire de l'énergie
Producteur d'énergie
Maître
d'ouvrage
70
Figure 2.12: Cartographie des objets et des acteurs
intervenant dans l'électrification rurale d'une zone
[34]
Tableau 2.4 : Fonctions attendues par chacun des
acteurs intervenant dans l'électrification rurale des Pays En
Développement [34]
|
Acteurs intervenant dans
l'électrification
|
Fonctions attendues par cet acteur
|
|
Clients
|
- Recevoir un service électrique à un certain
coût en fonction de besoins prédéfinis - Développer
une activité économique rentable (clients tertiaires et
industriels)
|
|
Autorités politiques
|
- Electrifier le plus vite possible le plus de monde possible
afin de satisfaire la population
- Pouvoir bénéficier d'aides internationales pour
le projet d'électrification
- Permettre un développement durable du pays
- Minimiser le coût d'acquisition du système
- Tenir compte des influences historiques (réseau HTA de
type Nord Américain ou
Européen)
|
|
Maître d'ouvrage
|
- Planifier le réseau en fonction d'architectures
standardisées - Utiliser du matériel standardisé en gamme
normalisée
|
|
Exploitant du réseau
|
- Gérer un réseau « facilement »
exploitable - Assurer la sécurité des personnes et des biens -
Faciliter le raccordement de nouveaux clients - Etre informé de
l'état du réseau
- Assurer la maintenance du réseau
- Réduire le nombre de pièces nécessaires
|
|
Producteur d'énergie
|
- Produire de l'énergie électrique à moindre
coût - Etre alimenté facilement en énergie primaire
|
|
Gestionnaire de l'énergie
|
- Gérer l'équilibre entre l'offre et la demande
- Gérer la qualité de l'énergie
électrique
- Veiller au respect des normes
- Privilégier éventuellement les sources
d'énergie renouvelables
- Acheter l'énergie électrique à bas
coût
|
|
Gestionnaire clients
|
- Adapter le type de paiement au type de clients
- Vérifier la bonne utilisation de l'énergie en
fonction de ce qui a été prévu - Former les clients
à la sécurité de leur installation
- Vérifier le bon respect des règles de paiement
définies
|
|
Financiers
|
- Financer des projets rentables en ayant un bon rendement des
capitaux (banque commerciale)
- Intervenir dans le développement durable (banque
mondiale)
|
La figure 2.13 résume les
caractéristiques principales de dimensionnement de deux types de centres
Production d'Electrification Rurale Décentralisée (PERD) qui
obeissent à une démarche méthodologique qui sera
définie par la suite.
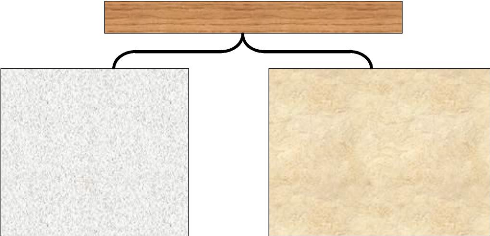
Caractéristiques :
- utilisation des EnR en complément pour gagner sur la
consommation en fuel,
- utilisation de batteries pour gagner sur la durée de
vie du GE aux heures creuses,
- utilisation d'un GE de puissance plus faible pour gagner en
consommation et sur la durée de vie du GE,
- etc
Système basé principalement sur l'Energie
Fossile
Centre de production pour l'Electrification Rurale
Décentralisée
Caractéristiques :
- utilisation d'un système de stockage pour assurer
une certaine fiabilité de fonctionnement au système,
- utilisation d'un GE pour réduire la taille du
stockage ; différents types de fonctionnement (chargeur de batteries et
donc de faible puissance, ou utilisation de celui-ci en secours et donc
dimensionné pour passer la pointe),
- etc
Système basé principalement sur les
Energies Renouvelables
71
Figure 2.13 : Caractéristiques des deux
types de centre de production envisagés pour
l'ERD[34]
r Méthodologie de dimensionnement
La méthode de dimensionnement utilisée est la
méthode dite « d'essai et d'erreur » ; il s'agit de tester un
certain nombre de solutions potentielles jusqu'à l'obtention d'une
solution adéquate. Pour cela, il est nécessaire de choisir les
variables du problème (variation des paramètres), l'espace de
recherche (limites de variation de ces paramètres), et la fonction
objective (objectifs à atteindre) Figure
2.14.
|
1) Analyse
|
|
Définition du
problème
Contraintes
Objectifs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Synthèse
|
|
Formulation des solutions potentielles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluation des solutions
potentielles
|
|
|
|
3) Evaluation
|
|
|
|
|
|
|
|
Solution
Figure 2.14 : Descriptif d'un processus de
dimensionnement par la méthode d'essai et
d'erreur[34]
Pour dimensionner au mieux un centre de production pour l'ERD,
Il est alors nécessaire de déterminer la combinaison des
différents éléments de production (variables) minimisant
son bilan actualisé (fonction objectif) sur la durée de
l'étude (Figure 2.15).
Cette méthode choisie est adaptée pour
dimensionner au mieux un centre de production pour l'Electrification Rurale
Décentralisée. Il est alors nécessaire de
déterminer la combinaison des différents éléments
de production (variables) minimisant son bilan actualisé (fonction
objectif) sur la durée de l'étude (D = 20 ans). Celui-ci
est constitué par :
? les coûts d'investissement,
? les coûts de fonctionnement
(maintenance, consommation en fuel, etc),
? les coûts de renouvellement.
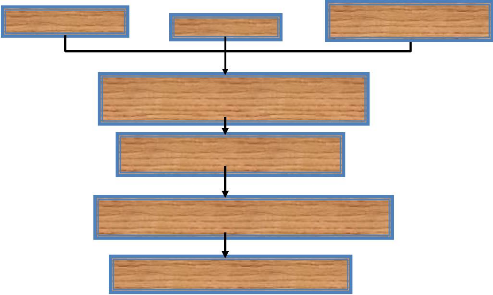
Courbe de charge
Configuration du système de production
72
Gamme de matériel
Estimation préliminaire des combinaisons de
gamme de
matériels de production permettant d'assurer
l'équilibre
production - consommation
Programmation du fonctionnement horaire
du
système considéré
Calcul du bilan actualisé pour chaque combinaison
de matériel
Choix de la combinaison de matériels
minimisant
le bilan actualisé
Figure 2.15: Méthode de dimensionnement pour
choisir l'équipement à installer pour une configuration
prédéfinie de système ERD [34]
Pour déterminer les coûts horaires de fonctionnement
de chacun des systèmes, nous effectuons une analyse
temporelle du fonctionnement en discrétisant le temps
(créneau d'une heure). L'équation de base
représentant l'évolution du système est le
bilan de puissance :
P Ch arg e ( )
h = ? P Générateur (
)
VhE DEtude
V Générateur
h
Générateur
Dans ce cas, PCharge représente la
charge vue depuis le centre de production (charge des clients plus les pertes
dans le réseau de distribution BT). La détermination des
différents vecteurs PGénérateur
( PGE , PEolien
et PBatterie ) s'effectue grâce à la
programmation du fonctionnement envisagé. On peut ainsi
déterminer les différents coûts horaires de fonctionnement
des éléments de production puis enfin en déduire les
coûts actualisés du système.
? Choix du créneau horaire de
dimensionnement
La taille de ces vecteurs (20 ans * 365 jours * 24 heures =
175 200 heures) est trop importante pour un calcul rapide ; il est donc
nécessaire de le réduire. Pour cela nous devons faire des
hypothèses sur une taille suffisamment représentative de ces
paramètres. Pour la donnée d'entrée « charge »,
nous utilisons la courbe de charge moyenne, ainsi une évaluation sur 24
heures de la courbe de charge moyenne est suffisante.
Pour les éléments de production, la puissance
fournie par les groupes électrogènes (PGE)
sera une donnée de «sortie » à calculer du bilan de
puissance. Par contre, pour les sources de production renouvelables, la
puissance ( PEolien) est calculée implicitement
grâce à la vitesse de vent disponible (donnée
«d'entrée »). Il est cependant nécessaire de
réaliser une hypothèse sur cette donnée d'entrée
aléatoire. Trois niveaux d'hypothèses ont été
considérés.
| 


