Epigraphe
Mais voici ce que dit l'Eternel: Dès que
soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai
de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en
vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés
sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance.
« Jérémie
29 :10-11 »
Dédicace
A mon Dieu pour le souffle de vie, l'intelligence et la
sagesse ;
A ma maman chérie que j'aime beaucoup Tuzolana
Makwiza Marie ;
A mon papa bien aimé Jean Rolly
Matota ;
A mes oncles et tantes particulièrement à
Nsimba mumposa ;
A mes frères et soeurs Nancy Nsansi et Joslin
Ngetadidi ;
A mes cousines et cousins Sandrine, irene, Indrick,
Teji, Shekinah, Ester, Naguel, Deo, Anifa, Vanessa, Gopphin, Guy, Angeline,
Jean Robert, Guyguy, Tresor, Nene, Lydie ; etc.
A mes nièces et neveux Magnificence, Eclat ,
Yver, Soraya, Daniela, Davina, Chris ;
A tous mes amis et grands frères Dr Furher, Dr
Goëthe, Dr Richard, Dr Bumba, Ir Ben, Ir Bill Wanet, Ya Blaise
Bokea ;
A celle qui sera la mère de mes
enfants ;
A mes prochains enfants Faveurdi, Fleurdi, Favoridi et
Fabegrace ;
A mon Pasteur ;
A tout ce monde qui ne cesse de prier pour
moi ;
Je vous dédie tous ce travail en guise de
reconnaissance.
Remerciement
Nous tenons à remercier en premier lieu Dieu le tout
puissant pour qui tout ce travail lui revient entièrement, à nos
parents pour tous les sacrifices et efforts consentis pour notre encadrement et
formation.
Nous remercions notre Directeur Prof Jeampy MBIKAYI qui
malgré ses multiples occupations a bien voulu nous encadrer.
Nous remercions tous les corps professoraux de l'ISS-Kin
notamment Ass. Willy MPWATE, Ass. Charmant SOTO, Ass. KALOMBO, CT Eric KATANGA,
CT Jeannot FATAKI, CT ZINGA, CT OKITO, Prof KASORO, Prof DJUNGU, Prof MABELA,
Prof Pierre KASENGEDIA notre maître.
Nous tenons à remercier tous les collègues avec
qui nous avons combattus ensemble Ir Olivier TUSAMBA, Ir Christian MAYALA, Ir
Hénoch BETU, Ir MIMIE, Ir NAOMIE, Ir Moutard MBENGA, Ir Jadis MALAMBA,
Ir Ben NYAMABO, Ir Mick LOLEKA, Ir Sacha, Ir Tonton MBUIDI, Ir John MONGONDA,
Ir Arnold FUKIAU, Séraphin HUALA et tous les autres dont les noms ne se
figurent pas ici qu'ils trouvent ici l'expression de mes remerciements.
Nous tenons à remercier tous les amis qui nous ont
toujours soutenu particulièrement à Berdo NGYEKI reçoit
l'expression de mes remerciements mon frère, Rosette SHAKO ma
chérie, Yanick TSHABOLA, Fa BASUNGA, Couple KALONJI Tous, Nelly MBOMBO,
Guelda LANDU, Carol.
Nous remercions également Bénédicte
MBIMBA, Merveille ETALE, Eder KABUIKU, Hervé MAYAMBU, Chico SUNGU, Julio
SADI, Nida KINZUNGA, Chico DIMBUMBA, Max LUWAU, Blathy TUNGU pour leurs apports
qui nous avaient été très bénéfiques, et
autres.
AVANT PROPOS
Nous voici au terme de notre périple pour
décrocher le diplôme de licence en ingénierie réseau
informatique pour lequel nous avons consenti beaucoup d'efforts ; pour
construire une maison, il faut certes poser la fondation et ce travail a
bénéficié de l'apport de plusieurs personnes de
près ou de loin que nous tenons à rendre hommage
mérité, nous ne pouvons terminer sans dire un mot à notre
Père céleste Dieu des armées. Nous tenons à dire
merci à nos enseignants depuis primaire, secondaire et
université qui ont contribué chacun à niveau à
une étape de notre formation ; il nous sera ingrat de ne pas dire un mot
à nos parents pour les efforts consentis et à notre Directeur qui
a bien voulu nous encadrer.
Dans ce monde en constante mutation, l'informatique n'est pas
restée en marge, elle prend même en grande vitesse encore ce monde
des défis immenses, comme les hommes cohabitent les
matériels ont aussi la possibilité de cohabiter entre eux.
D'où, le réseau informatique qui permet à mettre ensemble
les ressources matérielles informatiques en vue de partager certaines
ressources tant matérielles que logicielles.
Notre mémoire, nous abordons sur la mise en place et la
sécurisation d'un système de messagerie électronique,
c'est pour cela il fallait d'abord proposer la mise en place d'un réseau
local et l'interconnexion de différents réseaux locaux,
l'installation d'un système d'exploitation réseau, l'installation
d'un serveur de messagerie et un client de messagerie lourd ou léger.
INTRODUCTION GENERALE
Le service de messagerie électronique dans un intranet
même à l'internet représente près de 90% des
échanges d'informations entre les humains, les entreprises ou
organisations, entre les nations d'où, la nécessité de sa
compréhension, sa mise en place et sa sécurisation.
C'est le service le plus populaire et le plus utilisé
dans un réseau informatique ; d'une vérité
indubitable, nous vivons dans un monde en constante évolution et l'un de
nos désirs primaires est d'améliorer nos conditions de vie.
D'où, il faut chercher de nouvelles informations dans n'importe quel
domaine enfin de rendre cette vie encore mieux. « Un pays ne peut se
développer s'il n'est pas riche en information » dit-on.
Dans ce siècle de l'information et de la communication,
des progrès immenses ont été réalisés dans
plusieurs domaines pour la prise de décisions rapide et efficace.
D'où, on ne peut plus faire de longues distantes pour passer une
information à quelqu'un ou encore passer dans une Agence de transfert
des courriers pour envoyer un courrier. A l'heure actuelle, on peut être
dans sa maison ou dans son bureau et transférer tout ce qu'on veut en
moindre coût et en temps réel. Le courrier électronique ou
courriel par concaténation est un service de transmission des messages
électroniques via un réseau informatique existant dans la
boîte aux lettres électroniques d'un destinataire choisi par
l'émetteur ; il prend de plus en plus une place
prépondérante par rapport aux autres moyens de communication
traditionnels, bien qu'il puisse incorporer des graphiques, des fichiers
sonores et visuels, il sert principalement à l'envoi de textes avec ou
sans documents annexés.1(*)
Ex. : avec les réseaux sociaux comme Facebook,
Twitter, ...
Ce service nous offre plusieurs avantages, mais est
confronté aussi à plusieurs menaces notamment :
- Des virus ;
- Des spams ;
- Des hackers
- Des usurpations des adresses ;
- Des attaques de déni de service,...
D'où, sa mise en place doit exiger certains niveaux de
sécurité et certaines connaissances sur :
- Des antivirus ;
- Des protocoles d'envoi, de réception et de
sécurisation de la messagerie électronique ;
- Des serveurs sécurisés de messagerie
électronique ;
- Des clients de messagerie électronique ;
- Des autres moyens de sécurité et le
réseau informatique sécurisé.
1. L'intérêt du sujet
La messagerie électronique appelée aussi
« Electronic-mail » ou « E-mail » ou
« courrier électronique » ou encore
« courriel » est l'outil le plus populaire et le plus
répandu sur l'internet pour les entreprises ou les particuliers ;
c'est un service gratuit et de base pour la communication sur le net entre les
personnes ou les entreprises distantes ; quoi qu'il paraisse pratique et
efficace, le service de messagerie électronique n'est forcément
pas aussi simple et anodin qu'il peut y paraître au premier regard.
En effet, l'intérêt de ce mémoire est de
proposer la solution sur la messagerie électronique à la
Société Nationale d'Electricité SNEL en sigle dans son
Département de régions de Distribution de Kinshasa DDK en sigle
en vue, de lui doter d'un système autonome d'échange des mails en
intranet ou même à partir de l'Internet. Cette solution
résoudra beaucoup de problèmes liés aux échanges
des messages et des documents car le nouveau pourra faire toutes ces
tâches avec des mails simples et des mails dotés de pièces
jointes.
Aussi, le principe est similaire à celui du courrier
postal traditionnel où pour envoyer un courrier on doit se rendre dans
l'entreprise chargée à expédier de courriers (serveur
d'expédition) et si le destinataire a une boîte postale ou une
adresse physique (compte dans le serveur 2 ex : compte Yahoo) et
delà l'entreprise chargée d'envoi, l'envoie à son
homologue correspondante (serveur de destination) et dans la boîte
postale de destination, c'est maintenant à la personne destinataire
d'aller récupérer dans sa boîte ou encore l'entreprise de
destination d'aller le lui déposer à partir de son adresse
physique.
Avec la messagerie, il suffit de disposer d'une adresse
électronique auprès d'un serveur de messagerie, on peut
déjà s'échanger des mails avec d'autres correspondants
possédant aussi des adresses électroniques.
2. Problématique et hypothèse
2.1 Problématique
2.1.1 Définition de la problématique
Vu le problème de l'évolution d'informations
simples en multimédias qui préoccupe nos entreprises, avec la
démocratisation d'Internet, le boom de l'ADSL (Asymetric Digital
Subscriver Line ou Ligne Asymétrique Numérique c'est une
technologie qui permet de faire transiter à haut débit de
très importantes quantités de données numériques
sur le réseau téléphonique classique en louant une ligne
spéciale), le nomadisme, la messagerie électronique est devenue
le frontal de communication « standard » le plus couramment
utilisé dans les échanges d'informations et intègre un
contenu très divers donc multimédia. La tâche des
responsables des systèmes informatiques et de
télécommunications et surtout du système de messagerie en
devient de plus en plus compliquée. L'E-mail est aujourd'hui une
solution universelle utilisée par tous. Chacun peut insérer
quasiment n'importe quel contenu numérique (la seule limite est
aujourd'hui la taille) et l'envoyer à n'importe quel destinataire, qui
peut décider de le supprimer, le conserver, y répondre en
ajoutant/retranchant des destinataires, le faire suivre. Son
développement est donc anarchique et incontrôlable. Pourtant, il
est de plus en plus un élément d'infrastructure essentiel des
systèmes d'informations. Dans les entreprises, les bases de
données prenant en charge les applications critiques des systèmes
de messagerie (courrier électronique, planification et gestion des
calendriers) augmentent en taille et prennent une importance croissante. Or,
l'indisponibilité des fonctions de messagerie peut interrompre ou
ralentir l'activité des entreprises qui sont confrontées à
plusieurs défis ; On peut dire que la gestion des E-mails demeure
donc une problématique très importante et un défi pour les
années à venir alors que les échanges électroniques
vont continuer à augmenter, sous cette forme ou sous la forme nouvelle
de messagerie instantanée avec tous ces réseaux sociaux qui
naissent en occurrence Facebook, Twitter ainsi que d'autres.
Pour notre travail, nous voulons proposer ce projet à
l'entreprise SNEL qui est confrontée à ce problème, elle
veut mettre en place son propre système de messagerie entre ses
différentes succursales, ses différents services et même
ses agents, pour éviter certaines dépenses relatives à la
télécommunication, au transport, aux dépenses de
carburant, à certaines impressions sur papier et à certaines
missions pour les agents d'aller déposer un document ou une circulaire
c'est pour cela, elle s'est décidée de mettre ce service en
place. D'où, ce projet devait commencer expérimentalement dans
son Département de Régions de Distribution de Kinshasa et ses
différentes représentations au niveau des districts de Kinshasa
avant d'être déployer dans toute l'entreprise.
2.2. Hypothèse
2.2.1 Définition de l'hypothèse
Cette étape nous permet de proposer des solutions aux
questions posées dans la problématique ; Par rapport
à la question de la messagerie électronique, Quelles
hypothèses pouvons-nous formuler ?
· La mise en place et la sécurisation d'un
système de messagerie électronique doivent améliorer
considérablement le travail ;
· Du point de vue technique, la messagerie
électronique présentera les caractéristiques les mieux
adaptées à la bonne utilisation des services Internet ou
même Intranet ;
· Du point de vue scientifique cela constituera un
document de référence pour tout étudiant qui voudra
emprunter encore ce chemin.
3. Délimitation du sujet
Notre mémoire se limite en espace sur le bâtiment
régional de la SNEL donc le DDK avant d'être proposé pour
ces différentes succursales éparpillées à travers
tous les districts de Kinshasa où il y a des Directions et des CVS. Et
par rapport à la période notre étude couvre une
période allant de 2010 à nos jours, en plus la période de
réalisation du projet part du mois d'Octobre jusqu'au mois de Janvier.
4. Méthodes et techniques utilisées
4.1 Méthodes
Un travail scientifique est une étude approfondie d'une
question soulevée qui nécessite une explication ou une solution
au moyen d'apport personnel ou originaire. D'où, les qualités
sont exigées au chercheur, la rigueur et la précision, l'esprit
scientifique, la largeur de vue, etc. et aussi le chercheur doit avoir des
méthodes et techniques pour bien analyser et apporter un meilleur
remède aux problèmes qui se posent. Une méthode est un
ensemble d'opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit les
démontre et les vérifie.2(*)
Dans ce travail, nous avons utilisé plusieurs
méthodes pour mettre en place ce projet notamment :
- Méthode PERT : qui est une méthode
d'optimisation de temps de la mise en place d'un projet, elle se déroule
en plusieurs étapes ;
- Méthode historique : permet d'analyser le
passé d'une entreprise en vue de bien aborder et bien comprendre le
présent en vue d'améliorer l'avenir ;
- Méthode structuro fonctionnelle : permet
à étudier la structure ou l'organigramme de l'entreprise et la
fonction de chaque poste.
4.2. Techniques
Une technique est un ensemble des procédés
exploités par un chercheur dans la phase de collecte des données
pour réaliser un travail(2) ; parmi les techniques
utilisées il y a :
a. Interview
C'est la technique qui permet le dialogue entre
l'enquêteur (chercheur) et les enquêtés (les agents de
l'entreprise en question) ; Enfin, des séries d'entretiens avec des
Administrateurs Web (Webmaster) et Administrateurs système dans des
entreprises ont achevé notre interview.
b. Analyse documentaire
La recherche documentaire va nous spécifier
l'état des connaissances relatives à notre thème. Dans le
cadre de cette étude, nous avons eu recours, à des
mémoires de fin d'études des anciens étudiants, des
publications de certains auteurs, des syllabus, des notes de cours.
c. Consultation web
Aussi, faut-il ajouter le concours de l'Internet avec son
service web, qui nous a fourni beaucoup d'informations car aujourd'hui c'est la
bibliothèque ouverte pour tout le monde.
5. Difficultés rencontrées
Pendant la réalisation de ce mémoire, nous avons
rencontré beaucoup de problèmes de nature même de nous
obliger à changer le sujet mais nous avons tenu bon pour arriver
jusqu'au bout ; parmi les difficultés rencontrées, nous
pouvons citer :
· Le problème lié au transport, car on
devait se déplacer chaque jour pour aller récolter les
informations et ces déplacements nous ont coûté
énormément chers ;
· Le problème lié à la
récolte des informations car ces agents n'étaient pas
toujours disposés pour recevoir les étudiants et surtout non
coopératifs ;
· Le problème lié à la
compréhension de notre demande chez certains agents n'était aussi
aisé d'où, la perte de temps ;
· Le problème lié à la documentation
même sur le net, il n'était pas toujours aisé d'avoir des
informations précises par rapport à celles que nous cherchons.
I ère PARTIE : ETUDE D'OPPORTUNITE
CHAPITRE I. PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE
I.1. Historique de l'entreprise
La Société Nationale d'Electricité
« SNEL » en sigle, est un consortium de droit public
à caractère industriel et commercial créé par
l'ordonnance n° 73/033 du 16 mai 1970. A l'origine, l'entreprise avait
reçu de l'Etat, en tant que maître d'ouvrage, le mandat de
maître d'oeuvre pour les travaux de première étape de
l'aménagement du site hydroélectrique d'Inga.
En effet, dans le souci de répondre aux besoins
énergétiques du pays, les pouvoirs publics, par ordonnance
présidentielle n° 67-391 du 23 septembre 1967, instituaient le
comité de contrôle Technique et Financier pour les travaux d'Inga
qui sera remplacé, en 1970 par la SNEL.
A la suite de la mise en service de la centrale d'Inga I le 24
novembre 1972, la SNEL devenait effectivement productrice, transporteuse et
distributrice d'énergie électrique à l'instar d'une autre
société d'Etat, la Régie de Distribution d'Eau, REGIDESO,
et des six sociétés commerciales privées existantes, ayant
le même objet social.3(*)
Il s'agit de :
1. COMECTRICK
2. FORCES DE L'EST
3. FORCES DU BAS CONGO
4. SOGEFOR
5. SOGELEC
6. COGELIN
Au cours de la même année, le Gouvernement mit en
marche le processus d'absorption progressive de ces sociétés
privées par la SNEL. A l'issue de ce processus se traduira par
l'instauration d'une situation de monopole au profit de la SNEL soutenue par la
suite par la loi n°74-012 du 14 juillet 1974 portant reprise, par la SNEL,
des droits, obligations et activités des anciennes
sociétés privées d'électricité.
Toutefois, la reprise totale, par la SNEL, des
activités électriques de la REGIDESO ainsi que ses centrales
n'interviendra qu'en 1979. A travers cette loi, l'Etat avait traduit sa
volonté de s'assurer le contrôle direct de la production, du
transport et de la distribution de l'énergie électrique,
ressource stratégique en matière de développement
économique et social du pays.
Dès lors, la SNEL contrôle en
réalité toutes les grandes centrales hydroélectriques et
thermiques du pays. Seuls quelques micros et minis centraux
hydroélectriques du secteur minier et petites centrales thermiques
intégrées aux installations d'entreprises isolées
continuent à révéler du secteur privé.
En 1994, le sous-secteur de l'électricité a
été ouvert aux privées pour la construction et
l'exploitation des centrales hydroélectriques et des réseaux
associés à des fins commerciales. L'année 2003 est
marquée par le début du processus de reforme institutionnelle
dans tous les secteurs d'activités publiques dont celui de
l'énergie.
A ce jour, le service public de l'électricité
est confié à la SNEL érigée sous forme de la
société d'Etat, régie par la loi-cadre sur les entreprises
publiques et l'ordonnance n°78/196 du 5 mai 1978 approuvant ses statuts,
sous la tutelle technique du Ministère ayant l'énergie dans ses
attributions : la tutelle administrative et financière étant
assurée par le Ministère du Portefeuille.
I.2. Présentation géographique de
l'entreprise
La SNEL est située sur le coin du croisement des
avenues de justice et de batetela, mais en ce qui nous concerne, c'est le
Département de Régions de Distribution de Kinshasa DDK en sigle
qui est situé sur l'avenue du commerce vers l'Institut National des Arts
« INA » en sigle dans la commune de la Gombe, au centre
ville de Kinshasa la capitale de la République Démocratique du
Congo.
I.3. Objets et vision de l'entreprise
Après sa création au plan administratif et la
définition de ses statuts par les pouvoirs publics, il incombait
à la nouvelle société de s'assumer en matérialisant
ses structures fonctionnelles et ses activités sur le terrain. Pour ce
faire, partant des anciennes sociétés productrices et
distributrices d'énergie électrique ayant des structures et des
cultures différentes, il a fallu :
· Traduire dans les faits une véritable
société d'électricité à l'échelon
national et international ;
· Définir son développement à court,
moyen et long terme en rapport avec les objectifs généraux lui
assignés par l'Etat : produire, transporter et distribuer
l'électricité au moindre coût. Accomplissement au mieux ces
deux objectifs, la SNEL poursuivit sa mission de maître d'oeuvre pour les
travaux d'aménagement du site d'Inga dont la première phase, Inga
I (351 MW), officiellement démarrée le 1 er janvier 1968, fut
inaugurée le 24 novembre 1972. La deuxième phase, Inga II (1424
MW), a vu ses installations entrées en service en 1982. Cette
période des grands travaux a été couronnée par la
construction de la ligne plus ou moins de 500 KV CC Inga-Kolwezi (1774 Km), la
plus longue du monde. Entrée en service industriel en 1983, cette ligne
était initialement destinée à l'approvisionnement en
énergie électrique des mines et usines du Katanga, au sud du
pays. Aujourd'hui, elle permet la desserte de quelques pays d'Afrique Australe
(Zambie, Zimbabwe et Afrique du Sud).
En 1980, la SNEL a amorcé une étude de
développement de la société. Dans l'entre-temps, la
nécessité de mener parallèlement des actions de sauvegarde
a conduit à la mise en place du programme intérimaire 1981-1983,
suivi aussitôt après du programme 1984-1986.
A l'issue du second programme intérimaire,
parallèlement aux actions, se poursuivit l'élaboration de
l'étude d'un plan de développement qui devait prendre en compte
tous les problèmes de l'entreprise et ceux des acquits qui concourent
aux mêmes objectifs. Ainsi, est né le « Plan Directeur
national de développement du secteur de l'électricité
à l'horizon 2005 » dont la publication date de 1988.
Aujourd'hui, ce plan est actualisé jusqu'à l'horizon 2015.
Le plan Directeur s'articulait autour des objectifs
stratégiques suivants :
Ø Rentabilisation des infrastructures de production et
de transport existantes ;
Ø Satisfaction de la demande à moindre
coût ;
Ø Amélioration de la
productivité ;
Ø Recherche de l'équilibre financier.
Ce plan a permis d'arrêter deux programmes
d'investissement prioritaires (PIP 1988-1990 et 1991-1993), premières
tranches d'exécution du Plan Directeur.
Le Plan Directeur à l'horizon 2015 met, quant à
lui, l'accent sur la nécessité de mettre l'énergie
électrique à la portée de tous les congolais pour leur
épanouissement, singulièrement ceux habitant les milieux
ruraux.
I.4. Organisation et structure de la SNEL
La SNEL est organisée structurellement de la
manière suivante :
I.4.1. Tutelle
La société d'Etat SNEL est sous la tutelle du
Ministère de l'énergie d'une part, en tant qu'entreprise
technique, et du Ministère du Portefeuille d'autre part, en tant
qu'entreprise du porte feuille de l'Etat Congolais, suivant l'ordonnance
n° 78/196 du 1978.
I.4.2. Le conseil d'Administration
Ce conseil est composé de neuf membres, à sa
tête, se trouve un Président. Le Conseil d'Administration prend
toutes les décisions relatives à la gestion de l'entreprise.
I.4.3. Le comité de Gestion
Le comité de Gestion est composé de
l'Administrateur Délégué Général, de
l'Administrateur Délégué Général Adjoint, de
l'Administrateur Directeur Technique, de l'Administrateur Directeur Financier
et du Président de la Délégation Syndicale nationale pour
la bonne marche et l'application complète des décisions technico
économico financières de l'entreprise.
La Direction Générale de la SNEL est
composée de neuf Départements, à savoir :
1. Département de l'Organisation et Contrôle
(DOC) ;
2. Département des Ressources Humaines (DRH) ;
3. Département de Production et Transport
(DPT) ;
4. Département de Distribution (DDI) ;
5. Département Financier (DFI) ;
6. Département de Développement et Recherche
(DDV) ;
7. Département des Approvisionnements et Marchés
(DAM) ;
8. Département du secrétariat
Général (DSG) ;
9. Département de Régions de Distribution de
Kinshasa (DDK) dont il est question pour notre travail.
Le Département de régions de Distribution de
Kinshasa fait l'objet de notre travail, est dirigé par un Chef de
Département suivi par des Directeurs pour chaque Direction. La structure
est décrite dans l'organigramme ci-dessous.
I.5. Organigramme de DDK/SNEL
I.6. Description des postes de l'organigramme
I.6.1. DDK = Département de Distribution de
Kinshasa, dirigé par un chef de Département ;
· Direction des Etudes Opérationnelles et
Travaux : Direction attachée au DDK, dirigé par un
Directeur ;
· Division Inspection Commerciale : c'est une
division qui aide dans l'inspection commerciale le DDK ;
· Service Juridique : c'est l'organe juridique du
DDK
· Secrétariat : c'est l'organe
rattaché au DDK gérant tout ce qui a trait à
l'administration ;
I.6.1.1. DCK = Direction Commerciale de Kinshasa :
c'est la Direction qui gère la commercialisation de l'énergie
à Kinshasa, elle gère la moyenne et la basse tensions ;
- Moyenne Tension de Kinshasa : c'est l'organe
chargé à la gestion de la moyenne tension ;
- Basse Tension de Kinshasa : c'est l'organe
chargé à la gestion de la basse tension ;
- Coordination Commerciale : c'est l'organe qui coordonne
la commercialisation de l'énergie à Kinshasa ;
- Informatique de Kinshasa (IKX) : c'est l'organe qui
s'occupe de l'informatique dans l'installation, la maintenance et la gestion du
parc informatique de DDK.
I.6.1.2. DAF = Direction Administrative et
Financière : c'est la Direction qui s'occupe de l'administration et
des finances du Département de Kinshasa ;
· Division Administrative : c'est la Division qui
`occupe des dossiers administratifs du personnel ;
· Division Financière : c'est la Division qui
s'occupe de la gestion financière du Département ;
I.6.1.3. DEM = Direction d'Exploitation et
Maintenance : c`est la Direction qui s'occupe de l'exploitation et la
maintenance des matériels de transport de l'énergie ;
- Gestion Matériels : c'est l'organe qui se charge
de la gestion des matériels ;
- Maintenance et Travaux : c'est l'organe qui se charge
de la maintenance et des travaux des lignes de transport de
l'énergie ;
- Inspection Technique : c'est l'organe qui se charge
d'inspecter les matériels et lignes de transport de
l'énergie ;
- Comptage, Mes et Protect : c'est l'organe s'occupant de
la gestion des flux électriques sur des lignes et de sa
protection ;
- Exploitation moyenne tension : c'est l'organe qui
s'occupe de l'exploitation de la ligne de la moyenne tension.
En plus de tout ça, il y a les différentes
Directions au niveau de chaque district stratégique où sont
attachés des CVS
DKE = Direction Régionale de Kinshasa Est DKN =
Direction Régionale de Kinshasa Nord
DKO = Direction Régionale de Kinshasa Ouest DKS =
Direction Régionale de Kinshasa Sud
DKC = Direction Régionale de Kinshasa Centre
Et puis, dans chaque Direction il y a :
- Division Gestion Réseaux
- Gestion Clientèle
- Secrétariat Administratif
- Centre de Vente et Service
CHAPITRE II. ANALYSE DE L'EXISTANT
II.1. Etude des moyens
II.1.1. Moyens humains
La SNEL dans son Département de Régions de
Distribution de Kinshasa, a un personnel qualifié dans tous ses services
et particulièrement dans son service informatique surtout avec la
nouvelle vague des jeunes diplômés qu'elle vient de recruter. Le
DDK a son propre réseau autonome reliant son quartier
général avec quelques unes de ses différentes succursales
éparpillées sur Kinshasa, qui ne dépend pas de la
Direction Générale et puis elle a sa propre connexion Internet.
Le personnel technique du service informatique de Kinshasa est composé
de :
· Ingénieurs Informaticiens (Concepteurs,
Système, Réseau)
· Techniciens Supérieurs en Maintenance
Informatique
· Simples utilisateurs de la bureautique
Il est à signaler que le DDK travaille avec quelques
partenaires informatiques, qui lui viennent en aide chaque fois qu'il est dans
le besoin.
II.1.2. Moyens matériels
La SNEL dispose de grands moyens matériels surtout
informatiques, le DDK particulièrement dispose d'un petit service
informatique de Kinshasa qui s'occupe de la mise en place des applications de
gestion pour ses activités, de la maintenance et entretien du
réseau et des matériels, et aussi pour l'édition des
factures.
Parmi les matériels et logiciels du parc informatique,
nous pouvons citer :
· Les ordinateurs fixes complets Pentium 4 et Pentium M
avec de bonnes caractéristiques ;
· Les ordinateurs portables Pentium M ;
· Les équipements réseaux comme le Switch,
le Modem, le Hub, les connecteurs RJ 45, le routeur ;
· Les imprimantes même réseaux ;
· Les serveurs (Web) ;
· Les systèmes d'exploitation comme XP, Vista,
Seven, ... ;
· Les matériels de transmission comme le VSAT,
Téléphones et autres.
II.1.3. Moyens financiers
Eu égard, aux donations et aux subventions de l'Etat,
ses principales recettes proviennent de ses abonnés qui sont
catégorisés en deux dont ceux de la basse tension concernant les
ménages et ceux de la moyenne tension concernant les entreprises,
organisations et autres.
Malgré tout ce qu'on a cité ci-haut, une
amélioration est importante pour un meilleur rendement, on doit
améliorer le niveau du personnel, ajouter les autres matériels
par rapport aux nouvelles réalités comme la messagerie
électronique, en vue de réaliser encore de grands
bénéfices.
III. Critique des moyens et Proposition de solution
III.1. Critique des moyens
En effet, les moyens que possède la SNEL dans son
Département de Kinshasa sont déjà bons mais qu'il faudra
améliorer, ajouter et mettre à jour. Pour ajouter c'est surtout
avec les équipements d'interconnexion pour permettre de relier le
siège du Département de Kinshasa avec les différentes
Directions au niveau de chaque district et les Centres de Vente et Service CVS
en sigle éparpillés dans toutes les communes de Kinshasa, car
dans ce projet nous voulons permettre les échanges des mails entre tous
les agents de toutes les Directions et tous les CVS. Et puis il faut recycler
les agents par rapport au nouveau système.
III.2. Proposition de solution
Dans ce projet, nous proposons comme solution « la
mise en place et la sécurisation d'un système de messagerie
électronique » d'où, il faut le respect de certain
préalable pour la société en occurrence :
- Acquisition des matériels adaptés au nouveau
système ;
- Acquisition des logiciels adaptés ;
- Formation des agents par rapport à ce nouveau
système ;
- Mise en place d'un réseau informatique
intégré ;
- Interconnexion de ses différents réseaux
locaux.
Conclusion partielle :
Dans cette partie, nous avons développé sur la
présentation de l'entreprise en question dans son historique, sa
localisation géographique, son objectif, sa vision, son organisation et
sa structure.
En plus, de la présentation de l'entreprise nous avons
procédé par l'analyse et la critique des moyens et aussi proposer
des solutions pour l'amélioration.
II ème PARTIE : CONCEPTION THEORIQUE DU
RESEAU, CADRAGE PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROJET ET PRESENTATION DU CAHIER
DE CHARGE
CHAPITRE I. PRESENTATION DU PROJET
Un projet c'est ce qu'on a l'intention de faire, pour notre
cas, c'est la mise en place d'un serveur de messagerie et sa
sécurisation. D'où, on doit tenir compte du triangle pour la
réalisation d'un projet, nous aurons besoin de :
- Objectifs
- Moyens (humains, financiers et matériels)
- Objectifs
Durée (délai)
Durée
Moyens
I.1. Objectifs
L'objectif primordial de ce projet est la mise en place d'un
système de messagerie et sa sécurisation pour faciliter aux
agents l'échange d'informations à l'intranet d'abord et
même à l'extranet ou à l'internet en tenant compte des
moyens que l'entreprise dispose.
I.2. Durée (délai)
Ce projet s'étend sur une durée bien
précise pour sa réalisation qui est estimée en jour, la
durée s'évalue à 100 jours ouvrables en excluant les jours
fériés et les dimanches.
I.3. Moyens
La réalisation dudit projet exige des moyens
conséquents d'où on doit partir d'abord aux moyens qui existent
dans l'entreprise et puis proposer une amélioration s'il y a lieu, par
le recyclage, la formation, l'ajout, le financement et autre afin d'atteindre
les objectifs poursuivis car il faut ajouter les matériels, les
logiciels, faire la formation et le recyclage des agents, l'aménagement
des locaux, solliciter une main d'oeuvre extérieure et avoir la
connexion auprès d'un provider.
La gestion rapide et sécurisée de l'information
est un facteur très important pour mener à bien les
activités d'une entreprise.
A cet effet, la SNEL dans son Département de
Régions de Distribution de Kinshasa veut se doter d'un système de
transmission ou d'échange des mails (messages) avec un parc informatique
composé du serveur de messagerie, d'ordinateurs clients complets,
d'ordinateurs portables, de cartes réseaux, de modems, de routeurs, etc.
Un réseau informatique couvrant tous les bureaux et
annexes. Avec l'avènement de la technologie et surtout la vulgarisation
de l'Internet, il devient donc urgent à l'entreprise de se doter d'un
système de communication robuste, moderne et basé sur les
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), dont la
messagerie est une pièce essentielle.
L'envoi des courriers est devenu une fonction importante pour
beaucoup de sites Web ainsi que pour les utilisateurs de PC personnels. Qu'il
informe les clients des nouveaux produits ou qu'il envoie simplement un message
à un groupe d'amis, l'envoi du courrier offre un moyen facile et rapide
de communiquer.
En fait, le fonctionnement de l'envoi repose sur l'existence
d'ordinateurs spécialisés qui recueillent le courrier, le
distribuent et le tiennent à la disposition des utilisateurs de
logiciels de messagerie ou du courrier électronique.
Il existe des systèmes d'envoi d'e-mails simples,
flexibles et souples destinés à envoyer un ou quelques e-mails et
il existe aussi d'autres systèmes destinés à l'envoi
d'e-mail en masse. Les nouveaux systèmes d'envoi d'e-mail font partie
des besoins actuels des entreprises. Plusieurs systèmes sont en cours de
développement et d'amélioration.
Dans le cadre du projet de fin d'étude, une application
d'envoi du courrier a été développée et
adaptée aux nouveaux besoins des entreprises. Les infrastructures et les
normes qui permettent d'échanger aussi facilement et rapidement des
messages à travers le monde sont nombreuses.
On distingue le serveur Web, le serveur de messagerie et les
protocoles de communication. On tend, de nos jours, vers une solution Web,
c'est-à-dire, une solution qui permet à partir d'un logiciel
d'envoyer un courrier électronique en temps réel et quelque soit
l'endroit où ce logiciel se trouverait.
CHAPITRE II. CONCEPTION THEORIQUE DU RESEAU
La communication entre ordinateurs ne peut pas être
distinguée de celle des humains, si au départ l'ordinateur n'est
qu'un gros jouet aux mains de scientifiques, celui-ci a créé une
véritable révolution technologique qui devient le support de base
de la communication entre les humains. L'informatique est entrée
partout, dans la téléphonie, dans l'industrie, dans le commerce,
dans les échanges commerciaux, dans la médecine, dans
l'économie, etc.
Le réseau informatique est composé des
ordinateurs, des Routeurs, des Switches, des câbles de liaison, des
réseaux locaux qui permettent aux ordinateurs de se communiquer
rapidement sur de courtes distances entre eux sur un site donné (un
bâtiment, une agence, un bureau bref dans une organisation).4(*)
II.1. Définition de quelques concepts
Ø Réseau informatique : c'est la mise
ensemble des ressources informatiques tant matérielles que logicielles
en vue d'un partage ;
Ø Internet : c'est la concaténation de deux
mots INTERconnected NETworks ou INTERconnection of NETworks donc réseaux
interconnectés, c'est donc un immense réseau reliant une
multitude d'ordinateurs entre eux via des câbles, des liaisons
satellitaires ou hertziennes offrant des services et des informations
très variés ;
Ø Protocole : ensemble des conventions
nécessaires pour faire coopérer des entités
généralement distantes, en particulier pour établir et
entretenir des échanges d'informations entre ces entités qui
peuvent être des éléments réels ou virtuels,
matériels ou logiciels, d'un réseau de
télécommunication ou d'un ensemble de traitement de
l'information.5(*)
II.2. Analogie entre Modèle OSI et TCP/IP
Un modèle est une norme adoptée par plusieurs
constructeurs en vue de se communiquer avec les protocoles adoptés dans
l'ensemble ; Modèle OSI est fondé sur une recommandation
d'ISO (International Standards Organisation ou Modèle de
référence pour l'interconnexion de systèmes ouverts), un
système ouvert est un système qui permet l'interconnexion avec
d'autres systèmes ouverts afin de faciliter la communication et
l'interopérabilité, son architecture en couches permet de bien
gérer la complexité.6(*)
Modèle OSI(Open Systems Interconnection) est un
modèle à 7 couches conçu comme modèle
référence avec le principe de « diviser pour mieux
gérer » notamment couche physique, couche de liaison,
couche réseau, couche de transport, couche session, couche de
présentation et couche d'application où chacune joue son
rôle à son niveau ; c'est la nécessité
d'identifier des fonctions élémentaires distinctes, mais
participant au processus de communication, a conduit à étudier un
modèle structuré en couches. La définition des
différentes couches descriptives du modèle respecte les principes
suivants :
- Ne pas créer plus de couches que nécessaire,
pour que le travail de description et d'intégration reste simple, ce qui
conduit à regrouper les fonctions similaires dans une même
couche ;
- Créer une couche chaque fois qu'une nouvelle fonction
peut être identifiée par un traitement ou une technologie
particulière mise en jeu ;
- Créer une couche là où un besoin
d'abstraction de manipulation de données doit être
distingué.
Il existe une frontière entre chaque couche, et puis
chaque couche (N) fournit les services (N) aux entités (N+1) de la
couche (N+1) en plus chaque couche échange des unités de
données avec la couche correspondante sur l'entité distante ou
homologue à l'aide d'un ensemble de règles appelé
Protocole en utilisant pour cela les services de la couche
inférieure.(3)
Suite aux nombreux problèmes notamment : la
lenteur des travaux de normalisation, la complexité des solutions
adoptées et la non-conformité aux exigences de nouvelles
applications,...
Ce modèle de référence n'a jamais fait
l'objet de véritables implémentations complètes.
Cependant, il décrit tous les concepts et les mécanismes
nécessaires au développement d'une architecture de communication
car il a structuré les fonctions. D'où, on est arrivé
à un modèle fédéral TCP/IP qui combine deux
protocoles TCP et IP.7(*)
II.2.1. Description des couches du modèle OSI
Parmi les couches nous avons :
a. Couche physique
C'est la première couche du modèle OSI qui
permet la transmission des signaux sous forme électrique, lumineuse,
d'onde et s'occupe de :
- La transmission de bits sur un canal de
communication ;
- L'initialisation de la connexion et relâchement
à la fin de la communication entre émetteur et le
récepteur ;
- L'interface mécanique, électrique et
fonctionnel comme support physique de transmission de
données ;
- Résolution de possibilité de transmission
physique dans les deux sens (Half et Full duplex)
b. Couche de liaison de données
C'est une couche qui s'occupe principalement pour la liaison
de données et de :
- Constituer des trames à partir de bits soit en
tant que émetteur ou récepteur ;
- De corriger des erreurs de contrôle de flux.
En plus, elle est constituée de deux sous couches LLC
(Link Layer Control) et MAC (Media Access Control), au niveau de cette couche
transmet les trames.
c. Couche réseau
La couche réseau permet de gérer le
sous-réseau, la façon dont les paquets sont acheminés de
la source à la destination. Elle s'occupe de routage,
c'est-à-dire la route que prendront les paquets pour arriver à
destination à un temps relativement bref.
d. Couche transport
Elle s'occupe de la communication fiable de bout en bout,
entre l'émetteur et le récepteur qui agissent comme des machines
d'extrémité, elle s'occupe de la gestion de la connexion,
multiplexage, démultiplexage des connexions réseaux, elle
transfère les segments.
e. Couche session
Elle permet aux utilisateurs travaillant sur
différentes machines, d'établir entre eux un type de connexion
appelé « session » et de la gestion du dialogue.
f. Couche présentation
A la différence des couches inférieures, qui
sont seulement concernées par la transmission fiable des bits d'un point
à un autre, cette couche s'intéresse à la syntaxe et la
sémantique de l'information transmise.
g. Couche application
Cette couche comporte de nombreux protocoles utilisés
tels que : terminal virtuel (ex : Telnet) ; courrier
électronique ; exécution des travaux à
distance ; consultation base de données. On peut ajouter encore
plusieurs autres protocoles comme : HTTP, SNMP, FTP, DNS, TFTP, DHCP et
autres.
Tandis que le Modèle TCP/IP qui est le modèle
fédérateur est un modèle à quatre couches
notamment :
v Couche physique ou d'accès
réseau (Network access ou interface réseau) joue le
même rôle que la couche physique du modèle OSI ;
v Couche Internet Protocol qui joue le
même rôle que la couche de liaison ;
v Couche transport (qui a deux sous
protocoles TCP et UDP) fonctionne comme la couche réseau soit en mode
connecté avec TCP ou en mode non connecté avec UDP ;
v Couche application ; cette couche
regroupe certaines couches du modèle OSI en une seule couche, suite
à ces qualités telles que : la capacité de
fonctionnement sur toutes les tailles de réseau, son efficacité
et son évolution ont séduit les entreprises pour interconnecter
leurs réseaux à l'internet avec surtout des applications comme
messagerie et web.8(*)
II.2.2. Protocoles de messagerie
Chaque utilisateur de messagerie doit posséder une
boîte aux lettres identifiée par une adresse électronique
de format
« identifiantpersonnel@sous-domaine.domaine » ;
l'acheminement des mails passe par plusieurs étapes de l'émission
jusqu'à la réception, facilité par les protocoles au
niveau des couches réseaux et de transport (TCP/IP)
évoqués ci haut.
a. SMTP (Simple Mail Transfert Protocol)
: est un protocole qui permet de transmettre les messages envoyés par
les postes clients. C'est un protocole standard qui permet de transmettre soit
d'un client à un serveur ou d'un serveur à un autre en connexion
point à point. Il fonctionne en mode commuté, encapsulé
dans les trames TCP/IP, grâce à des commandes textuelles
(chaîne des caractères ASCII terminée par des
caractères gestion d'erreurs). Il existe une version
améliorée de SMTP qui est le ESMTP, c'est un protocole simple de
transfert des mails ou courriers électroniques vers le serveur, il
utilise le port 25.
b. POP (Post Office Protocol) :
c'est un protocole de récupération des messages dans un serveur
de messagerie électronique, nécessite une connexion à un
réseau, utilise le port 110, se présente sous plusieurs versions
par rapport à la sécurité et aux
générations. D'où, il existe POP3, POP3S, POP4 ainsi de
suite, permet le dialogue à partir de postes clients afin d'assurer
l'interrogation des BAL et le rapatriement des messages du serveur au poste
client. Ce protocole permet aussi de récupérer des mails dans des
serveurs pour des postes clients, ne fonctionne qu'en mode connecté. Son
avantage est qu'il permet à enregistrer les mails dans un poste client
pour les consulter partout où on peut se retrouver mais dans le
même poste même hors connexion.
c. IMAP (Internet Message Access
Protocol) : c'est aussi un protocole de récupération de mail
dans le serveur pour le mettre à la disposition d'un utilisateur au
niveau de MUA de destination, il présente plus d'avantages que POP car
il permet la conservation ou l'archivage des messages au poste clients pour
qu'ils soient utilisés en local. Il utile le port 143, pour la
sécurité on combine IMAP avec SSL pour donner IMAPS enfin de
permettre un accès sécurisé au serveur. Joue le même
rôle que le protocole POP, il fonctionne aussi en mode connecté,
il présente les avantages par rapport au
précédent.9(*)
Parmi lesquels il y a :
§ Possibilités de stocker les mails sur le serveur
de manière structurée qu'on peut lire partout où on peut
se retrouver ;
§ Gestion de plusieurs BAL ;
§ Permet l'accès direct à des parties de
messages ;
§ Supporte des accès concurrents et des BAL
partagées ;
§ Les utilisateurs peuvent accéder à leurs
messages à partir de plusieurs machines.
Un service IMAP est un système de fichiers, dont les
répertoires sont des classeurs. Chaque classeur contient des messages et
éventuellement d'autres classeurs. A chaque message sont
associées des informations (en plus du corps et de l'en-tête des
messages) telles que :
§ Un numéro unique ;
§ Un numéro de séquence dans son
classeur ;
§ Une série de drapeaux (message lu,
réponse envoyée, message à effacer,
brouillon,...) ;
§ Une date de réception des messages.
II.2.3. Les différents services ou
éléments de la messagerie
La messagerie est un système d'échange de
mails dans un réseau soit à l'intra ou à
l'extranet(Internet) avec des protocoles et/ou services bien précis.
Elle comporte un ou plusieurs serveurs de messagerie et des postes clients qui
sont utilisateurs ;
Ø E-mail : en français
courrier électronique « courriel » : c'est
l'un des outils d'internet les plus utilisés, est un service à
connexion différée qui permet l'échange d'informations
entre les personnes en possédant une BAL ou boîte e-mail dans un
domaine ou serveur bien déterminé,
Son format est :
nom-utilisateur@nom-du-serveur(sous-domaine).domaine
Par exemple :
lfmumposa@yahoo.fr
§ nom utilisateur : lfmumposa qui est
généralement le pseudonyme de l'utilisateur ;
§ @ (arobase) : qui sépare l'utilisateur avec
sous domaine et domaine ;
§ sous domaine : c'est le serveur où est
logée la BAL `Yahoo' ;
§ domaine : c'est le type de domaine utilisé
`fr'.
Ø MTA : signifie Mail Transfer
Agent ou Agent de Transfert de Courriers `ATC' est un serveur
ou programme qui sert à transférer des messages
électroniques à un autre serveur « MTA »
ou entre les ordinateurs qui utilisent le protocole SMTP. Il est composé
de deux agents :
· Un agent de routage des messages ;
· Un agent de transport des messages.
Donc, c'est un agent de transfert des mails dans un
réseau informatique qui travaille avec le protocole SMTP ;
Ø MDA : signifie Mail Delivery
Agent ou Agent de Distribution de Courriers `ADC' C'est un
programme utilisé par l'Agent de Transfert de Courriers ATC pour
acheminer le courrier vers la boite aux lettres du destinataire
spécifié. Il distribue le courrier dans les boîtes aux
lettres des utilisateurs spécifiés ;
Ø MUA : signifie Mail User Agent
ou Agent de Gestion du Courrier `AGC' est un programme qui
permet à un client de LIRE, ECRIRE un message électronique et de
l'envoyer à l'Agent de routage qui va l'injecter dans le système
de messagerie via les protocoles et les agents de transfert et de
distribution jusqu'à atteindre l'autre destination
spécifiée.10(*)

II.2.4. Fonctionnement du système de messagerie
électronique
Fig n°1 Fonctionnement du système de messagerie
électronique
Fig n°2 Fonctionnement du système de messagerie
électronique

Ce système pour son administration et coordination, il
faut un administrateur qui aura pour rôle de :
· Créer, détruire des comptes utilisateurs
(boîtes aux lettres) ;
· Créer, modifier des listes de diffusion
(ensembles de destinataires réunis sous une même
dénomination) ;
· Démarrer / Stopper un Service (Service SMTP ou
POP) ;
· Créer un annuaire regroupant tous les
utilisateurs de ce système.
Tandis que l'utilisateur aura pour rôle de :
· Permettre à l'utilisateur de rédiger,
expédier et consulter les messages ;
· Classer les messages dans des dossiers ;
· Répondre à un message sans avoir à
retaper l'entête ;
· Utiliser des fonctions de recherche (retrouver les
messages répondant à des critères spécifiques, tel
que : la date, le nom de l'expéditeur, le sujet).11(*)
II.3. Le service Internet
L'Internet, c'est le nouveau monde avec son plus
célèbre service qui est le web (WWW), il permet l'interconnexion
de plusieurs ordinateurs pour un éventuel partage des ressources mises
en réseau. Mais, il est important de signaler une différence
capitale existant entre internet et Internet, les deux sont acronymes
signifiant inter = interconnexion et net = network = réseau donc, c'est
l'interconnexion des réseaux.
internet : c'est un réseau privé
d'organisation exploitant ou non les technologies, services et/ou applications
Internet ;
Internet : c'est un réseau intercontinental qui
met ensemble plus de centaines de milliers de réseaux
interconnectés entre eux, appartenant aux cinq continents, utilisant les
technologies TCP/IP et auquel peuvent accéder des centaines des millions
d'utilisateurs pour exploiter des services divers tels que :
- La messagerie ;
- La navigation web ;
- Le transfert des fichiers, etc.12(*)
III. Mise en place d'un réseau LAN
L'évolution générale des systèmes
d'information et des moyens d'y accéder ont engendré une
modification significative des méthodes de travail. Aujourd'hui, le
travail est devenu collectif car les besoins d'information et de communication
dans le groupe de travail ont été décuplés. On ne
peut parler du réseau informatique sans partage des ressources tant
matérielles que logicielles.
Un réseau informatique est composé :
- D'un serveur qui a pour rôle de servir les autres
postes, il met ses ressources en leur faveur, il peut être
matériel ou logiciel ;
- Des postes appelés clients qui sont des
matériels bénéficiaires des ressources ou des services du
serveur ;
- Des autres équipements du réseau comme
Routeur, Switch, câble, connecteurs RJ 45, Modem,
Répéteur, etc.
Il existe deux types de réseaux poste à poste ou
peer to peer et client-serveur :
1. Réseau poste à poste ou peer to
peer
C'est un réseau sans serveur dédicacé,
chaque poste est autonome par rapport à lui-même, il n'a pas une
administration centralisée donc pas d'administrateur, il est moins
coûteux car ne nécessitant d'un poste puissant ni encore d'un
mécanisme de sécurité avancé,
généralement c'est un petit réseau de plus ou moins 10
postes.
2. Réseau à serveur
dédicacé ou client-serveur
Un serveur est une machine qui met ses ressources au service
des autres machines, il peut être matériel ou logiciel. Il est
plus coûteux car il faut un poste puissant qui offre ses services
à d'autres postes, optimisé pour répondre aux besoins des
postes clients, il faut de grandes mesures de sécurité des
différentes ressources. Ce réseau c'est lorsqu'il y a plus de 10
postes ; plus un réseau croît en taille plus il est important
de mettre en place un ou plusieurs serveurs.13(*)
Tels que :
- Serveur de messagerie ;
- Serveur de fichiers ;
- Serveur d'impression ;
- Serveur web ;
- Serveur de fax ;
- Serveur de bases de données, etc.

Fig n°3 Exemple d'un serveur
Avantages
- Administration et sécurité
centralisées ;
- Procédure de back up centralisée ;
- Tolérance à la faute ou panne ;
- Accès d'un nombre élevé d'utilisateurs
au serveur.

Fig. n° 4 Déploiement d'un réseau local
3. Connexion des médias de
transmission
3.1. Présentation de connexion des
médias de transmission
Eu égard, à l'installation physique des
médias de connexion, il est nécessaire de connecter des
ordinateurs entre eux c'est pour cela on doit utiliser des interfaces et des
périphériques appelés Matériels de connexion qui
représentent deux groupes :
- Réseau ;
- Inter réseau.
3.1.1. Matériels de connexion d'un
réseau LAN
Pour mettre en place un réseau informatique, on doit
disposer d'un certain nombre des périphériques matériels
afin de connecter chaque ordinateur à un segment de média parmi
lesquels il y a :
- Connecteurs de média de transmission ;

251648000
Fig n°5 Connecteur RJ 45
- Interface réseau ou carte réseau ;

251642880
Fig n°6 Interface réseau
- Modem.

251646976
Fig n°7 MODEM
En plus, pour avoir un grand réseau ayant un nombre
important des ordinateurs, il faut certains matériels qui doivent
élargir la connexion parmi lesquels :
- Répéteur ou Repeater ;

251644928
Fig n°8 Répéteur
- Pont ou Bridge ;
- Hub ou concentrateur ;

251641856
Fig n°9 Hub ou concentrateur
- Switch ou Commutateur.

251645952
Fig n°10 Switch ou Commutateur
3.1.2. Matériels d'interconnexion
Contrairement à tout ce qui est évoqué ci
haut, pour connecter plusieurs ordinateurs appartenant dans des réseaux
différents, il faut des équipements appropriés pour faire
l'interconnexion parmi lesquels :
- Routeur ;

251643904
Fig n°11 Routeur
- Pont-routeur.
3.2. Topologie des réseaux locaux
Par rapport à la topologie, il y a deux points à
développer :
3.2.1. Topologie logique
C'est la manière dont les informations ou les signaux
circulent dans un réseau local appelée aussi méthode
d'accès au canal ou au réseau ;
3.2.2. Topologie physique
C'est la manière dont les équipements sont
disposés ou interconnectées dans un réseau local
d'où on parlera de :
- Topologie ou architecture de réseau en
bus : utilisée dans le réseau Ethernet ;
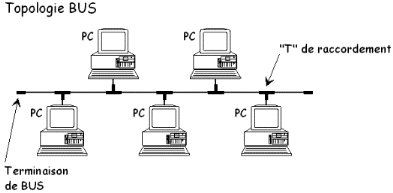
251649024
Fig n°12 Topologie ou architecture de réseau en
bus
- Topologie ou architecture de réseau en
étoile :
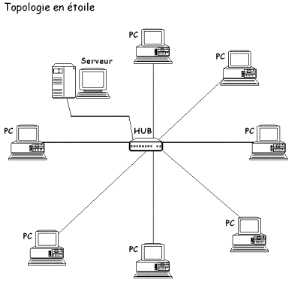
251650048
Fig n°13 Topologie ou architecture de réseau en
étoile
- Topologie ou architecture de réseau en anneau
ou en boucle : utilisée dans un réseau Token
ring ;
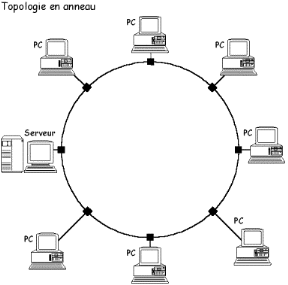
251651072
Fig n°14 Topologie ou architecture de réseau en
anneau ou boucle
- Topologie ou architecture
maillée : c'est la combinaison de plusieurs topologies.
Dans un réseau local, il y a des ordinateurs, des
câbles plus de connecteurs, des hubs, des Switches, des Routeurs,
etc.14(*)
CHAPITRE III. PLANNING PREVISIONNEL POUR LA REALISATION
DU PROJET
La réalisation d'un projet nécessite une
succession des tâches auxquelles s'attachent certaines contraintes
notamment :
- De temps : c'est le délai à respecter
pour l'exécution des tâches ;
- D'antériorité : certaines tâches
doivent être exécutées avant d'autres ;
- De simultanéité : certaines tâches
se réalisent ou s'exécutent au même moment ;
- De production : temps d'occupation des matériels
ou des hommes qui les utilisent.
Pour mettre un ordre dans la succession de ces tâches,
il faut faire « l'ordonnancement ». On utilise plusieurs
méthodes entre autre P.E.R.T (Program Evolution Reseach Task) qui
consiste à mettre en ordre sous forme d'un graphe plusieurs
tâches. Cette méthode a été conçue vers 1957
par US Navy pour le développement de programme de lancement des
fusées Polaris et permet de calculer le meilleur temps de
réalisation en établissant le planning correspondant.15(*)
III.1. Identification des tâches du projet
Consiste à :
- Donner la liste exhaustive des tâches à
exécuter ;
- Evaluer le temps ou durée pour chaque tâche
à s'exécuter en déterminant les ressources
nécessaires à utiliser ;
- Codifier les tâches pour faciliter la construction du
réseau (A, B, C, D, etc.).
Pendant cette opération, on a recensé plusieurs
tâches à exécuter comme Etude et Analyse de l'existant,
Aménagement des locaux, acquisition des matériels et logiciels,
Critique de l'existant, Proposition de solution, Appel d'offre, Test,
Elaboration des manuels, Conception du cahier de charge, Formation des agents
d'exécution et de coordination, etc.16(*)
III.2. Ordonnancement
Parmi les tâches retenues, nous avons :
- Recueillir de l'existant (Analyse et Etude) ;
- Critique de l'existant ;
- Proposition de solution ;
- Conception du réseau ;
- Appel d'offre (collecte des factures pro format) ;
- Conception du cahier de charge ;
- Aménagement des locaux ;
- Passation de commande ;
- Acquisition des matériels et logiciels ;
- Installation et configuration ;
- Test ;
- Elaboration des manuels ;
- Formation des agents (utilisateurs et
administrateurs) ;
- Lancement du projet.
III.3. Calcul des niveaux de graphe
|
Tâches
|
Activités
|
Activités antérieures
|
Durées
|
|
d.
|
Début
|
-
|
0
|
|
A
|
Recueillir l'existant (Analyse et étude)
|
d
|
20
|
|
B
|
Critique de l'existant
|
A
|
5
|
|
C
|
Proposition de solution
|
B
|
2
|
|
D
|
Conception du réseau
|
C
|
5
|
|
E
|
Appel d'offre (collecte des factures pro format)
|
C, D
|
5
|
|
F
|
Conception du cahier de charge
|
E
|
10
|
|
G
|
Aménagement des locaux
|
F
|
20
|
|
H
|
Passation de commande
|
F
|
3
|
|
I
|
Acquisition des matériels et logiciels
|
G,H
|
5
|
|
J
|
Installation et configuration
|
I
|
5
|
|
K
|
Test
|
J
|
2
|
|
L
|
Elaboration des manuels
|
K
|
7
|
|
M
|
Formation des agents (User et Administrateur)
|
K
|
10
|
|
N
|
Lancement du projet
|
L,M
|
1
|
|
F
|
Fin du projet
|
N
|
0
|
N1=d ; N2=A ;
N3=B ; N4=C ; N5=C,D ;
N6=E ; N7=F; N8=F; N9=G,H;
N10=I; N11=J; N12=K; N13=K;
N14=K; N15=L,M; N16=f
III. 4. Cadrage du projet avec Méthode PERT
III.5. Chemin critique
Le chemin critique passe par d, A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, M,
N et f
III.6. Marge libre
ML = minDTAx - DTOx - d(i)
MlA = 20 - 0 - 20 = 0
MlB = 25 - 20 - 5 = 0
MlC = 27 - 25 - 2 = 0
MlD = 32 - 32 - 0 = 0 et 32 - 27 - 0 = 5
MlE = 37 - 32 - 5 = 0
MlF = 47 - 37 - 10 = 0
MlG = 67 - 47 - 20 = 0
MlH = 67 - 47 - 3 = 17 et 67 - 67 - 0 = 0
MlI = 72 - 67 - 5 = 0
MlJ = 77 - 72 - 5 = 0
MlK = 79 - 77 - 2 = 0
MlL = 89 - 79 - 7 = 3 et 89 - 89 - 0 = 0
MlM = 89 - 79 - 10 = 0
MlN = 90 - 89 - 1 = 0
III.7. Marge totale des tâches
C'est la plage de temps maximum dans laquelle peut se
déplacer la tâche sans modifier la date de terminaison du
projet.
MT = DTA(x) - DTO(x)
|
Tâches
|
Durées
|
Prédécesseurs
|
Successeurs
|
T'(x)
|
T''(x)
|
T''(x)-T'(x)
|
|
d.
|
0
|
-
|
A
|
0
|
0
|
0
|
|
A
|
20
|
d.
|
B
|
20
|
20
|
0
|
|
B
|
5
|
A
|
C
|
25
|
25
|
0
|
|
C
|
2
|
B
|
D
|
27
|
27
|
0
|
|
C
|
2
|
B
|
E
|
27
|
27
|
0
|
|
D
|
5
|
C
|
F
|
32
|
32
|
0
|
|
E
|
5
|
C
|
F
|
32
|
32
|
0
|
|
F
|
10
|
D
|
G
|
42
|
42
|
0
|
|
F
|
10
|
E
|
H
|
42
|
42
|
0
|
|
G
|
20
|
F
|
I
|
62
|
62
|
0
|
|
H
|
3
|
F
|
I
|
62
|
62
|
0
|
|
I
|
5
|
G
|
J
|
67
|
67
|
0
|
|
I
|
5
|
H
|
J
|
67
|
67
|
0
|
|
J
|
5
|
I
|
K
|
72
|
72
|
0
|
|
K
|
2
|
J
|
L
|
74
|
74
|
0
|
|
K
|
2
|
J
|
M
|
74
|
74
|
0
|
|
L
|
7
|
K
|
N
|
81
|
84
|
3
|
|
M
|
10
|
K
|
N
|
84
|
84
|
0
|
|
N
|
1
|
L
|
f.
|
85
|
85
|
0
|
|
N
|
1
|
M
|
f.
|
85
|
85
|
0
|
III.8. Elaboration du calendrier
Nous voulons démarrer le projet en date du 10
septembre 2012 en sachant qu'il y a des jours fériés et des
dimanches.
|
Période
|
Tâches à réaliser
|
|
Du 10 Septembre au 02 Octobre 2012
|
Recueillir l'existant (Analyse et étude)
|
|
Du 03 Octobre au 08 Octobre 2012
|
Critique de l'existant
|
|
Du 09 Octobre au 10 Octobre 2012
|
Proposition de solution
|
|
Du 11 Octobre au 16 Octobre 2012
|
Conception du réseau
|
|
Du 17 Octobre au 22 Octobre 2012
|
Appel d'offre (collecte des factures pro format)
|
|
Du 23 Octobre au 02 Novembre 2012
|
Conception du cahier de charge
|
|
Du 03 Nov au 26 Novembre 2012
|
Aménagement des locaux
|
|
Du 27 Nov au 29 Novembre 2012
|
Passation de commande
|
|
Du 30 Nov au 05 Décembre 2012
|
Acquisition des matériels et logiciels
|
|
Du 06 Déc au 11 Décembre 2012
|
Installation et configuration
|
|
Du 12 Déc au 13 Décembre 2012
|
Test
|
|
Du 14 Déc au 21 Décembre 2012
|
Elaboration des manuels
|
|
Du 22 Déc au 03 Janvier 2013
|
Formation des agents (User et administrateur)
|
|
05 Janvier 2013
|
Lancement du projet
|
Conclusion partie
Dans cette partie, nous présentons le projet qui va
nous aider à définir les objectifs, la durée et les moyens
à utiliser pour atteindre cet objectif. La conception théorique
du réseau en définissant quelques concepts de base, faire
l'analogie entre Modèle OSI et TCP/IP en définissant les
différentes couches pour chaque Modèle, les différents
protocoles de messagerie électronique et les différents services
de la messagerie, du fonctionnement du système de messagerie
électronique, le service Internet et surtout la mise en place d'un
réseau LAN.
Aussi, nous avons abordé sur les médias de
transmission dans un réseau LAN même ceux d'interconnexion.
En plus, pour finir ce projet, nous avons défini les
différentes topologies des réseaux locaux, et enfin le planning
prévisionnel pour la réalisation du projet en invoquant les
différentes méthodes utilisées et élaboration du
calendrier.
IIIème PARTIE : MISE EN PLACE DE LA
SOLUTION « MISE EN PLACE ET SECURISATION D'UN SYSTEME DE MESSAGERIE
ELECTRONIQUE »
CHAPITRE I. PHASE PROBATOIRE
Cette phase consiste à déterminer
l'environnement et toutes les mesures de sécurité de locaux
où seront placés les matériels informatiques car ces
derniers exigent les conditions climatiques et les normes d'architecture
spécifiques.
I.1. Choix des locaux
La conception des salles et centres informatiques où
seront placés les matériels et équipements informatiques
exige beaucoup de rigueur et de savoir faire car ces salles ou centres sont des
environnements multi techniques où il faut réserver des endroits
pour l'électricité, la climatisation, les matériels
d'anti-incendie, les services de contrôle d'accès en mettant des
badges pour les travailleurs qui devraient avoir accès, les gardes de
sécurité ou les portes de sécurité avec le lecteur
des cartes à puce, report d'alarmes, asservissement et
procédures) c'est pour cela un soin très particulier doit
être réservé ou porté dans sa mise en place
(cohérence et homogénéité) et sa synthèse
(inter asservissement, remontée des informations). Les locaux doivent
respecter les conditions d'aération et doivent avoir des
possibilités pour placer des prises murales et des câbles
réseaux.
I.2. Condition de l'environnement
Eu égard, de tous ceux qu'on a
énumérés ci haut, il faut faire en sorte que les
conditions de l'environnement soient rassurantes tant au niveau interne
qu'externe.
- Electricité : il faut prévoir au
préalable les voies par lesquelles passeront les câbles
électriques pour éviter l'improvisation et d'abîmer
l'esthétique du bâtiment ou des salles en cassant le mur et puis
se rassurer de la tension, de l'ampérage et de l'intensité du
courant qui doit être mis pour prendre en charge tous les
matériels qui seront utilisés ;
- Climatisation : il faut prévoir des endroits
où seront placés les climatiseurs car les salles de
matériels informatiques exigent une certaine échelle de
températures qui va de 10 à 30°C ;
- Anti-incendie : il faut prévoir dans ces
différents locaux des mesures d'anti-incendie en mettant en place des
systèmes d'alarmes qui doivent signaler tout risque qui survient et des
extincteurs17(*) ;
- Service de contrôle d'accès : le flux
d'accès dans la salle informatique doit rigoureusement être
très réglementé ou contrôlé en mettant des
portes à carte à puce ou avec code d'accès, des gardiens
de surveillance ou port obligatoire des badges et des caméras de
surveillance ;
- Procédure : il faut mettre une procédure
à suivre en cas d'un danger (incendie, fumée, feu, inondation),
ce document SLA (Service Layer Agreement) décrit de manière
très claire des actions à mener.
C'est pour cela, vu l'importance de cette partie, les
entreprises recourent aux sous-traitants spécialisés en la
matière en vue d'une meilleure expertise car cette matière est
tellement cruciale qu'aucun bricolage ne peut être
accepté.18(*)
CHAPITRE II. EVALUATION DE LA SOLUTION
II.1. Coût de réalisation du projet
Un projet a un coût, d'où sa mise en oeuvre demande
une étude minutieuse enfin de donner à l'entreprise ce qu'elle a
réellement besoin pour éviter une dépense inutile, en
respectant aussi la suite d'exécution des tâches décrites
par le graphe de P.E.R.T par son chemin critique où on a pu
bénéficier de 10 jours donc au lieu de 100 jours on ne doit que
faire 90 jours.
- Acquisition du serveur non rackable
Serveur DELL (non rackable)
Processeur: 1X Xeon E5630 (1,53 GHz)
Disque : 2X 150 Gb
Mémoire RAM : 10 Gb (6X4)
Système d'exploitation : Windows serveur 2003
Standard Edition (PREINSTALLE)
Coût : 4520 $ US avec un service pré -
vente
- Acquisition du logiciel serveur de messagerie 1200 $ US
Coût total de réalisation : 5720 $
US
CHAPITRE III. INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR
DE MESSAGERIE
Ce serveur de messagerie doit se trouver dans un environnement
système. D'où, il faut au préalable avoir un
système d'exploitation installé dans une machine, il y en a
plusieurs qui existent aujourd'hui dans les deux grandes familles des
systèmes :
- IBM et Compatible : où nous avons les
systèmes comme Dos dans toutes ses versions, Windows dans toutes ses
versions, etc.
- Apple : où il ya Macintosh avec Unix qui a
quatre familles Linux dans toutes ses distributions, BSD, Posix et System V.
Nous avons porté notre choix sur l'environnement
Windows 2003 Server parce qu'il est très convivial, facile et
présente encore beaucoup plus d'avantages par rapport à nos
réalités, nous permet à créer un annuaire ou
répertoire des utilisateurs avec Active Directory, un nom de domaine
(DNS) avec une adresse IP lors de l'installation, ainsi que les autres services
comme DHCP, SMTP, POP ou IMAP et en plus permet de faire un déploiement
automatique ou dynamique.19(*)
Et pour les serveurs de messagerie, ils sont aussi nombreux
sur le marché des logiciels tant pour ceux qui tournent sur
l'environnement Unix que pour ceux qui tournent sur l'environnement Windows.
Parmi les quels on peut citer : MS Exchange, Hmail,
Postfix, Sendmail, etc.
En plus, des systèmes d'exploitation et des serveurs de
messagerie, il existe encore des clients de messagerie qui sont des interfaces
entre les utilisateurs et les serveurs, ils permettent aux utilisateurs de
lire, d'écrire, d'expédier, de supprimer des mails
électroniques. Il existe des clients lourds et légers parmi
lesquels : Thunderbird, Outlook, Web mail, Zimbra, etc. Et notre choix
pour le client de messagerie s'est fait sur Outlook car on est dans un
environnement Windows.
Enfin, pour accéder dans cette application, il faut un
navigateur web car Les fonctions de messagerie, de gestion des contacts, de
calendrier partagé, d'informations composites et de création de
documents sont accessibles à partir d'un navigateur Web standard comme
Internet explorer et Mozilla de Microsoft ou même Netscape.
III.1. Dialogue entre client/serveur de messagerie
Le dialogue qui s'installe entre les machines pour acheminer
des pages hypertexte n'est pas le même dans le cas de la transmission de
courriers électroniques. Dans le premier cas, il est nécessaire
d'avoir une réponse immédiate, un vrai dialogue, le plus possible
en temps réel. Dans le second, c'est une communication asynchrone entre
deux individus. Le destinataire du message le lira quand il en aura envie. Le
protocole mis en jeu dans l'échange des courriers tient bien sûr
compte de ce principe.
III.2. Comparaison de quelques serveurs de
messagerie
III.2.1. Sendmail
C'est un serveur de messagerie dont le code source est
ouvert. Il se charge de la livraison des messages électroniques et
possède les atouts suivants :
III.2.1.1. Avantages
Sendmail est très puissant et résiste beaucoup
à la grande charge donc il peut supporter beaucoup d'utilisateurs.
§ Une très bonne sécurité ;
§ Code source libre ;
§ Il tourne sur la plate forme UNIX dans plusieurs de ces
familles (MAC OS, GNU/LINUX).
III.2.1.2. Inconvénients
Sendmail est très difficile à configurer car son
architecture est vieille, en plus il est :
§ Très lent ;
§ Très complexe avec une maintenance difficile.
III.2.2. Postfix
III.2.2.1. Avantages
§ Il est adapté pour des gros besoins ;
§ Facile à installer et à
configurer ;
§ Maintenance aisée ;
§ Sécurisé avec anti Spam ;
§ Codes sources libres et gratuits;
§ Il tourne sur la plate forme UNIX dans plusieurs de ses
familles (MAC OS, GNU/LINUX) ;
§ Accessible en mobilité.
III.2.2.2. Inconvénients
Il n'a pas d'inconvénients majeurs.
III.2.3. Microsoft Exchange
Microsoft Exchange est un logiciel serveur de messagerie qui
permet de gérer les mails, les calendriers et les contacts ; il est
de la gamme Windows Server System. En plus d'être un serveur de
messagerie puissant, vienne se greffer à Exchange 2003 une multitude de
composants, comme la gestion de contacts, intégration à Active
Directory, calendriers partagés, tâches, composants Web, etc.
Ce serveur de travail collaboratif (groupware) regroupe tous
les outils et composants nécessaires pour l'échange
d'informations entre différents collaborateurs et cela sur
différentes plates-formes. (Client MAPI, client Web, Smartphone ou
autres...). L'ajout de ces composants fait d'Exchange serveur 2003 un groupware
performant.
Groupware: application permettant le travail
collaboratif, la centralisation de ressources et de documents
partagés.
Microsoft Exchange Serveur utilise toute la puissance d'Active
Directory 2003, une multitude de fonctionnalités optimise et facilite
l'administration de notre système d'informations de messagerie via AD et
ses divers composants.20(*)
III.2.3.1. Avantages
§ Accès en mobilité, c'est-à-dire
vous avez accès à vos mails, vos calendriers ou vos contacts via
votre ordinateur portable ou votre téléphone portable et à
n'importe quel endroit où vous êtes connecté à
l'Internet ;
§ Une bonne sécurité antispam qui
sauvegarde et archive vos données critiques, la sécurité
renforcée: Anti-virus, Anti-spam, règles de messages ;
§ Une bonne efficacité permettant de partager
votre agenda et contact professionnel avec vos collègues ou
collaborateurs ;
§ La simplicité de migration et d'installation
grâce aux nouveaux utilitaires ;
§ L'augmentation de la productivité avec Outlook
2003, Outlook Web Access 2003, le support des périphériques
mobiles ;
§ La gestion de la bande passante ;
§ La gestion optimale de l'infrastructure des
sites ;
§ L'imbrication avec les technologies Windows 2003
serveur pour de plus grandes performances, IIS 6.0,
clustering, gestion de la mémoire.
III.2.3.2. Inconvénients
§ Les codes sources ne sont pas libres ;
§ Il n'est pas gratuit ;
§ Uni plate-forme donc il tourne que sur l'environnement
Windows.
III.3. Comparaison de quelques clients de
messagerie
En effet, il y a plusieurs clients de messagerie sur le
marché, aujourd'hui tant pour ceux qui tournent sur l'environnement
Windows que pour ceux qui tournent sur l'environnement Unix, ils sont des
interfaces entre les utilisateurs de service de messagerie et leurs serveurs.
Il existe des clients lourds et légers parmi lesquels on peut
citer :
III.3.1. Clients lourds
III3.1.1. Thunderbird
Il a les caractéristiques suivantes :
§ Très léger et rapide ;
§ Multi plate-forme donc il peut tourner dans tous les
environnements (Windows, Mac OS, Linux) ;
§ Extensible (peut recevoir de nouvelles
fonctionnalités) ;
§ Les codes sources sont libres d'accès et
gratuits;
§ Installation et configuration simples ;
§ Transfert de messages avec pièces jointes
III.3.1.2. Zimbra Desktop
Il se caractérise par :
Multi plate-forme (Windows, Mac OS, Linux).
Il est gratuit
§ Codes sources sont libres ;
§ Regroupe tous les comptes dans un seul
répertoire ;
§ Installation et configuration rapides et
faciles ;
§ Transfert les messages avec pièces
jointes ;
§ Extensible ;
§ Il ne tourne que sur l'environnement Unix.
III.3.2. Les clients légers ou Web mail
Un client de messagerie de type léger est un logiciel
qui est installé sur un poste client, permet de se connecter au serveur
de messagerie via un navigateur web (Internet explorer, Firefox ou Mozilla). Il
fonctionne uniquement en mode connecté et ne copie pas en local les
messages stockés sur le serveur. Ainsi, en mode hors connexion nous
n'avons plus accès à nos courriers.
III.3.2.1. MS Outlook Web Access
Outlook Web Access est une interface Web
mail permettant aux utilisateurs d'accéder à leur messagerie via
une enveloppe web. Il se caractérise par :
§ Installation rapide et facile ;
§ Très léger ;
§ Codes sources ne sont pas libres ;
§ Il n'est pas gratuit ;
§ Uni plate-forme (MS Windows).
II.3.2.2. Web mail de Zimbra
L'interface web mail de Zimbra a la
particularité suivante :
§ Installation automatique à la première
connexion au serveur via un navigateur web ;
§ Multi plate-forme (MS Windows, Mac OS, Linux,
etc.) ;
§ Codes sources libres et gratuits;
§ Autorise le glisser/déposer de
messages ;
§ Autorise le clic droit de la souris ;
§ Transfère les messages avec pièces
jointes ;
§ Permet les messages instantanés.
III.4. Elaboration de la
solution
Pour réaliser ce projet comme il a été
dit ci-haut, il fallait réunir tous les moyens nécessaires tant
matériels, financiers qu'humains en se fixant un objectif et un
délai, et puis pour mettre en oeuvre cette solution, il faut certains
préalables notamment :
Un système d'exploitation serveur : Windows
serveur 2003 car il nous faudra un serveur qui nous permettra de centraliser
l'administration d'où à l'installation, nous devons configurer en
même temps l'Active directory (annuaire) qui nous permettra de
créer un groupe des utilisateurs et le contrôleur de domaine enfin
d'avoir un domaine dans lequel nous allons appartenir ; tout en
précisant aussi l'adresse IP du domaine.
Fig n°15 interface d'installation de Windows server 2003
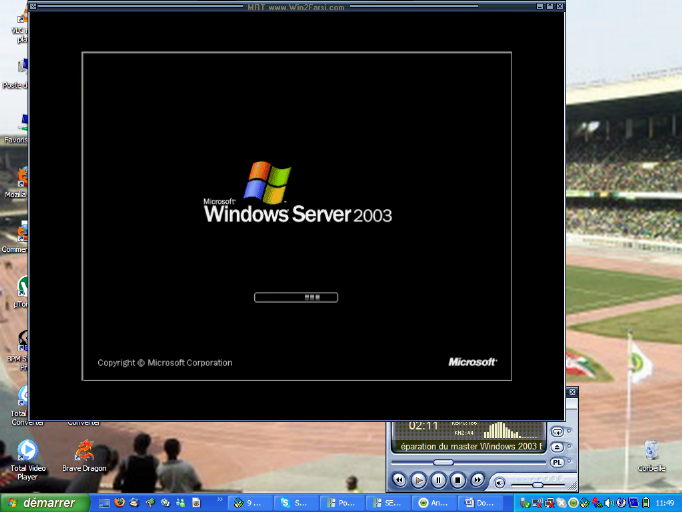
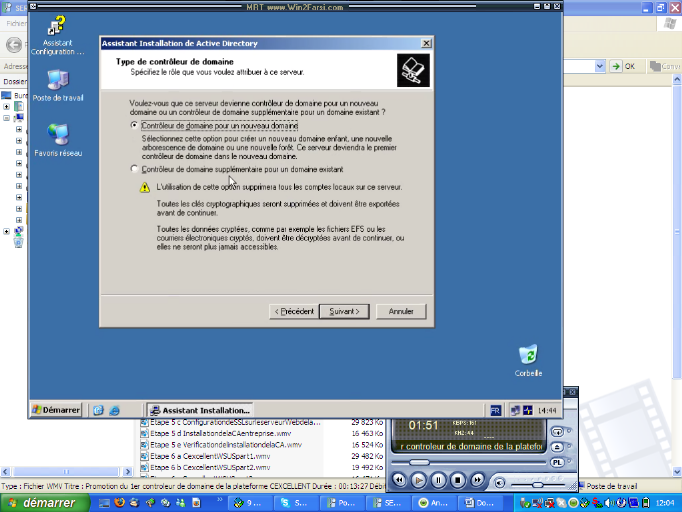
Fig n°16 interface de configuration du service DNS
Fig n°17 interface de configuration d'adressage
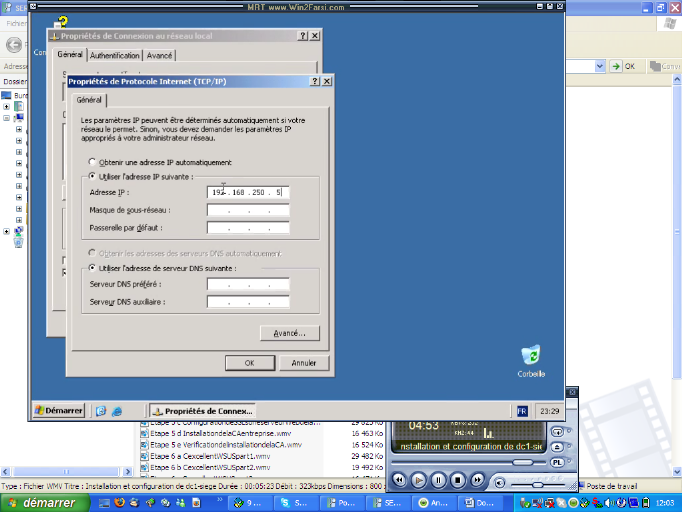
Fig n°18 interface de configuration du nom de domaine

Avant d'installer le serveur de messagerie, il faut au
préalable bien configurer les paramètres d'adressage du
réseau local pour que chaque client ait accès au serveur, et en
plus, nous devons configurer aussi :
- Nom pour chaque machine : ex. pc1 ;
- Adresse IP pour chaque utilisateur : ex.
193.75.10.100 ;
- Masque sous réseau pour chaque machine :
ex. 255.255.255.0 ;
- Nom du domaine avec DNS : snel.ddk.cd ;
- Adresse mail : ex.
lfmumposa@snel.ddk.cd ;
- Mot de passe pour chaque utilisateur.
Un serveur de messagerie : MS Exchange qui est un serveur
de messagerie tournant dans l'environnement Windows.
Fig n°19 interface d'installation de Microsoft Exchange
2003

Procédure d'installation d'Exchange Server 2003
Après avoir planifié et préparé votre
organisation Exchange, vous pouvez procéder à l'exécution
du programme d'installation d'Exchange 2003. Cette rubrique explique la
procédure d'exécution du programme d'installation d'Exchange pour
installer Exchange Server 2003.
|
Pour installer le premier serveur Exchange 2003 dans la
forêt, vous devez utiliser un compte qui dispose d'autorisations
Administrateur intégral Exchange au niveau de l'organisation et qui est
administrateur local sur l'ordinateur. Vous pouvez notamment utiliser le compte
que vous avez désigné au cours de l'exécution de
ForestPrep ou un compte appartenant au groupe que vous avez
désigné.
|
|
Lorsque vous déployez des serveurs Exchange 2003
dans plusieurs domaines pour la première fois, vérifiez que les
informations d'installation du premier serveur que vous installez ont
été répliquées dans tous les domaines avant
d'installer le serveur suivant. Si les informations d'installation du premier
serveur n'ont pas été répliquées dans tous les
domaines, des incidents liés à des collisions de
réplication se produiront et le serveur concerné perdra les
autorisations sur l'objet d'organisation dans Active Directory.
|
 Pour installer Exchange Server 2003
Pour installer Exchange Server 2003
1. Connectez-vous au serveur sur lequel vous voulez installer
Exchange. Insérez le CD-ROM d'Exchange Server 2003 dans le lecteur
correspondant ;
2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter,
puis tapez E:\setup\i386\setup, où E correspond
à votre lecteur de CD-ROM ;
3. Sur la page d'accueil de l'Assistant Installation de
Microsoft Exchange, cliquez sur Suivant ;
4. Sur la page Contrat de licence, lisez le contrat. Si vous
acceptez les termes du contrat, cliquez sur J'accepte, puis sur
Suivant ;
5. Sur la page Identification du produit, entrez votre
clé du produit à 25 caractères, puis cliquez sur
Suivant ;
6. Sur la page Sélection des composants, dans la
colonne Action, utilisez les flèches de la liste déroulante pour
spécifier l'action appropriée pour chaque composant, puis cliquez
sur Suivant ;

Fig n°20 Assistant d'installation des composants de
Microsoft Exchange 2003
7. Sur la page Type d'installation, cliquez sur
Créer une nouvelle organisation Exchange, puis sur
Suivant ;
Fig n°21 interface de spécification de type
d'organisation Microsoft Exchange 2003
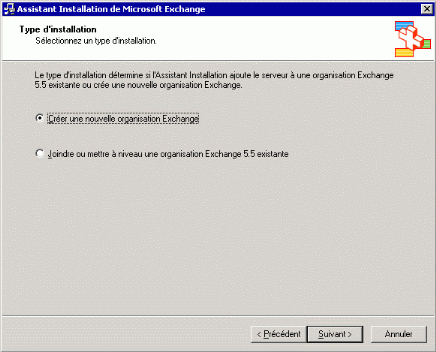
8. Sur la page Organisation, dans la zone Organisation, tapez
le nom de votre nouvelle organisation Exchange puis cliquez sur Suivant ;
|
|
Le nom doit avoir une longueur comprise entre 1 et 64
caractères. Vous avez la possibilité d'utiliser les
caractères suivants dans le nom de votre nouvelle organisation
Exchange 2003 :
|
Ø A à Z
Ø a à z
Ø 0 à 9
Ø Espace
Ø Trait d'union ou tiret

Fig n°22 interface de création d'une nouvelle
organisation Microsoft Exchange 2003
9. Sur la page Contrat de licence, lisez le contrat. Si vous
acceptez les termes du contrat, cliquez sur J'accepte : j'ai lu et je
serai lié par les accords de licence de ce produit, puis sur
Suivant ;
10. Sur la page Sélection des composants, dans la
colonne Action, utilisez les flèches de la liste déroulante pour
spécifier l'action appropriée pour chaque composant, puis cliquez
sur Suivant ;
11. Sur la page Résumé de l'installation,
vérifiez que les sélections effectuées pour l'installation
d'Exchange sont correctes, puis cliquez sur Suivant.
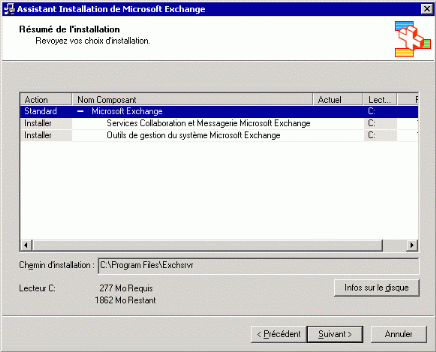
Fig n°23 interface de fin d'installation Microsoft Exchange
2003
12. Sur la page Fin de l'Assistant Installation de Microsoft
Exchange, cliquez sur Terminer.
Un client de messagerie lourd : Outlook qui va
fonctionner dans le serveur MS Exchange comme un client lourd de messagerie.
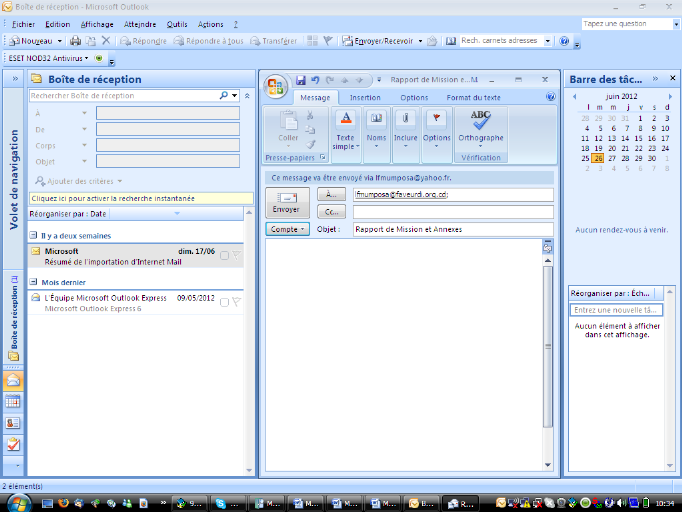
Fig n°24 Interface du client lourd de messagerie
Et en fin un client léger de messagerie : Web mail
qui permet à accéder dans l'interface mail à partir d'un
navigateur web en utilisant une adresse IP dans la barre d'adresses.

Fig n°25 Interface de moyen d'accès au serveur de
messagerie
Pour accéder dans le système de messagerie
électronique à partir de son client de messagerie il existe deux
possibilités soit lorsqu'il y a connexion Internet ou sans connexion
Internet à partir de l'Intranet de l'entreprise.
Les deux possibilités sont :
a. Avec connexion Internet
Il suffit de mettre au niveau de la barre d'adresses,
l'adresse IP du serveur de messagerie et après il faut s'identifier avec
le nom d'utilisateur et s'authentifier avec le mot de passe pour avoir
accès au serveur. Tout ça c'est à partir des clients web
de messagerie comme At mail, Web mail, Outlook mail, etc.
b. Sans connexion Internet
Lorsque nous avons un Intranet qui utilise les services
Internet, Il faut seulement bien configurer les protocoles de messagerie SMTP
pour les mails sortants et POP3 ou IMAP pour les mails entrants et c'est
à partir de l'interface du client de messagerie qu'on peut envoyer,
recevoir, consulter ou supprimer des mails. Tout ça c'est à
partir des clients simples de messagerie comme Outlook, Thunderbird, etc.
III.5. Technologies d'interconnexion des
réseaux
III.5.1. Généralités
Pour permettre à ce que ce nouveau système de
rendre effectivement son service, il faut d'abord s'assurer du bon
fonctionnement des différents réseaux locaux de chaque site et
celui de l'interconnexion de ces derniers, pour que tous les agents de
n'importe quel site puissent avoir accès au serveur de messagerie et la
possibilité de consulter et d'écrire le mail.
Ainsi, pour mettre en place un réseau local, nous avons
parlé de différents équipements qu'il faudra utiliser et
les différentes topologies que nous pouvons déployer ; pour
l'interconnexion aussi.
Il existe plusieurs technologies d'interconnexion
notamment :
- Faisceaux hertziens ;
- Boucle locale radio avec VSAT ;
- Boucle locale radio avec WIMAX, etc.
III.5.2. Technologie WIMAX
WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwaves Access) c'est
une technologie normalisée par IEEE sous IEEE 802.16, pour
déployer un réseau data sans fil au niveau métropolitain
en reliant les différents sites clients ou différents
réseaux locaux. C'est une technologie adaptée aux
réalités des pays en voie de développement comme le
nôtre, elle est le meilleur mode d'accès à l'Internet aussi
compte tenu de l'inexistence d'une infrastructure câblée ou d'un
opérateur national outillé tant pour la téléphonie
que pour la transmission de données, la boucle locale radio fait partie
des technologies de transmission de données sans fil. Mais cette
technologie est encore à l'étape expérimentale dans notre
pays.
Ces technologies sans fil de transmission de données
peuvent être classifiées par :
- PAN avec Infrarouge et Bluetooth ;
- LAN avec Hyper LAN et WIFI ;
- MAN avec Hyper MAN et WIMAX ;
- WAN avec GSM, GPRS, EDGE, etc.21(*)
III.5.3. Les caractéristiques de WIMAX
Parmi ces caractéristiques nous pouvons citer:
- Portée maximale de 40 km ;
- Fait le déploiement du réseau
métropolitain ;
- Niveau QoS très élevé ;
- Fonctionne en mode NLOS donc même sans
visibilité directe entre les stations de base grâce à la
méthode d'accès OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) ;
- Fait la connectivité point à multipoint avec
un débit binaire de 70 Mbps.
Son architecture s'appuie sur des stations de base (BS) qui
constituent de points d'accès au réseau, peuvent
s'interconnectent entre elles au niveau métropolitain via
l'infrastructure de télécommunication afin de constituer un
Backbone métropolitain ou à partir d'une station de base qui
gère les points d'accès éloignés sans même
passer par un opérateur téléphonique.
Dans ce projet, nous devons relier les différents sites
de DDK d'où, nous avons adopté pour WIMAX pour l'interconnexion.
Nous ne pouvons faire un réseau distant sans Routeur d'où dans
chaque site nous devons avoir un Routeur qui va interconnecter le réseau
local avec le réseau public auquel nous sommes connectés et dans
ce Routeur on doit configurer le NAT pour la translation de l'adresse IP du
réseau public à l'adresse IP du réseau privé et
configurer le Firewall pour la sécurité et le filtrage des
paquets.
En effet, avec les adresses IP V4 on s'acheminait vers la
pénurie des adresses routables, pour résoudre ce problème
les grandes firmes ont mis en place le NAT et puis proposer les adresses IP V6.
Le principe du NAT consiste à utiliser à partir d'une adresse IP
routable ou publique pour connecter un ensemble des machines possédant
des adresses IP privées ou non routables à l'Internet. Il fait la
passerelle ou la translation ou encore la traduction entre les adresses
internes non routables de la machine voulant aller à l'Internet à
partir d'une adresse IP routable qui constitue la passerelle, permet aussi la
sécurité des réseaux locaux car c'est seulement une
adresse qui sort vers l'Internet.
III.5.4. Domaine d'application
Comme dit ci haut le WIMAX est une technologie qui permet de
déployer un réseau métropolitain à partir ou non
d'un réseau de télécommunication pour la couverture des
zones reculées ou rurales à l'Internet ou à l'Intranet.
Parmi les domaines il ya :
- Réseaux urbains ;
- Connecter à l'Internet les quartiers
périphériques ou des banlieues ;
- Réseaux publics inter sites pour les entreprises.
Pour mieux sécuriser cette connexion par WIMAX, si on
est sur l'Internet en passant par un fournisseur d'accès Internet ou un
opérateur de téléphonie qui donne accès à
l'Internet, il faut faire un VPN (Virtual Private Network) qui est une voie
privée, sécurisée et sûre eu égard, à
la sécurité obtenue par le firewall et des Antivirus ou
autres.
Pour déployer cette technologie nous devons soit passer
par un opérateur de la téléphonie en utilisant ses
infrastructures ou soit en plaçant nous même nos
équipements dans différents hauts lieux de la ville. Donc il y
aura deux propositions de solutions pour DDK car il a plusieurs sites
éparpillés sur l'étendue de la ville, et pour relier ces
sites il faut cibler les endroits hauts ou les pilonnes des opérateurs
téléphoniques pour placer les équipements WIMAX. Dans
notre cas pour mieux quadriller Kinshasa, nous avons ciblé six endroits
différents où nous pouvons placer nos équipements de point
d'accès entre autre immeuble SOZACOM où sera placée la
station de base, place Echangeur, immeuble RTNC, bâtiment UNIKIN,
bâtiment UPN, bâtiment de l'aéroport de N'djili.
III.6. Les équipements d'interconnexion
Pour interconnecter les différents sites se trouvant
dans des segments différents comme a été dit ci haut, il
faut des équipements d'interconnexion pour relier ces segments.
- Le routeur :
Effectue le routage des adresses, il permet d'interconnecter
deux ou plusieurs réseaux. Possédant les mêmes composants
de base qu'un ordinateur, le routeur sélectionne le chemin
approprié (au travers de la table de routage) pour diriger les messages
vers leurs destinations. Cet équipement est qualifié de fiable
car il permet de choisir une autre route en cas de défaillance d'un lien
ou d'un routeur sur le trajet qu'empreinte un paquet. Il existe de routeur
WIMAX qui doit permettre à faire communiquer deux segments
différents l'un interne et l'autre externe, et puis de dans nous pouvons
configurer le NAT si nous aurons une connexion Internet, le firewall pour le
filtrage des paquets qui arrivent, de configurer certains ports pour certains
services soit pour autoriser, bloquer ou limiter les accès.
- Passerelle :
La passerelle relie des réseaux
hétérogènes, elle dispose des fonctions d'adaptation et de
conversion de protocoles à travers plusieurs couches de communication
jusqu'à la couche application. On distingue les passerelles de transport
qui mettent en relation les flux de données d'un protocole de couche
transport ; les passerelles d'application qui quant à elles
réalisent l'interconnexion entre applications de couches
supérieures. Malgré le fait que la passerelle est incontournable
dans les grandes organisations, elle nécessite souvent une gestion
importante.22(*)
Fig n°27 Déploiement d'un réseau MAN dans une
ville avec WIMAX

Fig n°28 Connexion à l'Internet à partir de
WIMAX
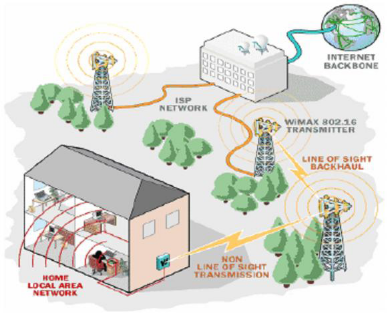
CHAPITRE IV. SECURITE DU SERVICE DE MESSAGERIE
Aujourd'hui environ 75% des e-mails seraient des spam et 90%
des infections par des vers où des vers sont véhiculés par
la messagerie électronique. Cependant, le courrier électronique
est le plus populaire des services sur l'internet d'où, sa
sécurisation dans sa mise en place doit être de rigueur. Au niveau
de l'utilisateur, il présente toutes les caractéristiques du
courrier classique : envoi par dépôt au poste client, centre
de tri, acheminement, boîte aux lettres, distribution.
En plus, la messagerie est de plus en plus utilisée et
est devenue une application Internet ou Intranet indispensable comme la VoIP,
parce que la messagerie est un vecteur de communication, de productivité
et de production, sa sécurité et sa disponibilité sont des
préoccupations légitimes des entreprises.
Toutefois, le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
lors de sa conception n'a pas tenu compte des préoccupations de
sécurité actuelles. C'est ce qui explique la prolifération
des menaces techniques qui pèsent aujourd'hui sur la messagerie :
virus, haox, attaque déni de service, usurpation d'adresses, piratage
d'adresses et du contenu du mail, etc.
De plus, parce que c'est un outil simple, rapide et expansif,
des dérives comportementales et légales peuvent en
résulter et doivent être contrôlées dans le monde des
entreprises : fuite d'informations, manque de confidentialité,
contenus illicites et saturation des ressources informatiques. Le Directeur
informatique ou Manager trouvera sans doute des éléments à
prendre en compte pour la sécurisation de la messagerie
électronique. Les menaces sont en perpétuelle évolution
alors que la messagerie est l'application la plus utilisée dans nos
entreprises d'où, sa sécurisation doit être au centre des
préoccupations de ces dernières, la politique de sa conception
doit être cohérente et intégrée.23(*)
IV.1. Menaces de la messagerie électronique
En effet, il existe plusieurs types de menaces et risques que
nous pouvons segmenter par rapport à leur niveau potentiel en trois
problématiques :
- La sécurisation des messages autorisés au sein
de l'entreprise ;
- La sécurisation de l'infrastructure sur laquelle
repose le système d'échange ;
- La définition des règles d'utilisation du
système de messagerie de l'entreprise.
IV.1.1. Les atteintes aux flux identifiés par
l'entreprise comme légitimes/autorisés
Elles sont nombreuses mais qu'on ne peut citer que quelques
unes parmi lesquelles :
- Perte d'un e-mail :
Il y a deux scénarii :
· La perte d'un e-mail au cours de sa transmission, due
à plusieurs éléments qui créent le problème
du serveur, suppression par oubli ou à tort par un anti spam ;
· La disparition d'un ou de tous les messages
reçus, c'est surtout lorsqu'on stocke les e-mails dans son propre
ordinateur.
- Perte de confidentialité :
Elle peut être due à plusieurs
événements :
· Une divulgation accidentelle ;
· Une divulgation par négligence ou
méconnaissance des règles ;
· Une divulgation volontaire ;
· Un espionnage des messages lors de la transmission sur
un réseau local à partir d'un logiciel spécialisé
« SNIFFER ».
- Perte d'intégrité :
Un message peut être altéré
accidentellement (par dysfonctionnement d'équipements, modification de
format) ou par malveillance pendant sa transmission ou son stockage dans un
serveur de messagerie ou sur le poste destinataire, cette perte peut
également provenir de modifications, de suppressions ou d'ajouts
volontaires effectués au niveau du serveur.
- Usurpation de l'identité de
l'émetteur :
Dans un système de messagerie, l'adresse e-mail est un
élément vulnérable car elle est diffusée à
tous les destinataires et est stockée dans des milliers de carnets
d'adresses ; des gens ou organisations malveillants exploitent des failles
de sécurité via des vers ou des virus pour
récupérer ces adresses en accédant aux données
personnelles de l'utilisateur et dans son carnet d'adresse lors de divulgation
sur le web.
- Répudiation :
C'est le risque de reniement de l'envoi ou de la
réception d'un message, c'est qu'on n'a pas de garantie sur
l'émission ou la réception d'un message.
IV.1.2. Les atteintes à l'infrastructure et au
système d'information
- Programmes malveillants :
La messagerie permet d'introduire les fichiers dans un
ordinateur donc c'est un bon vecteur de diffusion des programmes malveillants
(Virus, Cheval de Troie, Spyware, etc.) on a trois types d'attaque :
· L'introduction d'un virus par le biais d'une
pièce jointe, en contenant des instructions exécutables avec
extension (.exe, .dll, .bat, .vbs, ...) ;
· L'introduction d'un code malicieux dans le corps du
message, lorsque celui-ci est dans un format de page web incluant des
scripts ;
· L'introduction des faux virus (hoax) qui propagent de
fausses informations ou qui font perdre inutilement le temps de lecture aux
destinataires.
- Spam :
Le spam est l'opération qui consiste à inonder
les boîtes aux lettres (BAL) de courriers indésirables et non
sollicités, leur but est soit la publicité pour les sites
marchands plus ou moins recommandables, soit simplement de nuire aux
systèmes de messagerie par saturation des réseaux et des BAL
(mail bombing).
- L'interruption de service :
C'est l'indisponibilité du service de messagerie alors
qu'elle fait partie intégrante du processus de l'entreprise, elle peut
être accidentelle ou malveillante (panne, destruction de locaux,
déni de service), elle peut provenir d'une inscription en Black-list
suite à des attaques opérées à partir des serveurs
de l'entreprise.24(*)
IV.1.3. Les atteintes à l'organisation
- Accomplissement d'actes frauduleux par la
messagerie : c'est l'utilisation de la messagerie à des
fins d'extorsion, de racket ou de chantage entraînant des
préjudices pour l'entreprise (pertes financières, atteinte
à l'image de l'entreprise, divulgation d'information confidentielles,
etc.)
- Phishing ou Hameçonnage : c'est
une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements
personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité, il
consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à
un tiers de confiance, banque, administrateur, etc. enfin de lui soutirer des
renseignements personnels notamment à partir de mot de passe,
numéro de carte bancaire, date de naissance, etc. c'est une forme
d'attaque informatique reposant sur l'ingénierie sociale.25(*)
IV.2. Solution de sécurité
Des solutions sont nombreuses par rapport aux menaces et
risques présentés ci-haut, elles sont parfois
complémentaires ou contradictoires, mais se présentent sous
plusieurs formes :
IV.2.1. Sécurisation des flux légitimes
IV.2.1.1. Chiffrement et signature
électroniques de messages
La cryptographie apporte des solutions efficaces aux
problèmes des flux légitimes, elle permet :
- La confidentialité des messages ;
- L'authentification de l'émetteur ;
- L'intégrité des messages et de garantir la
non-répudiation.
a. Principe et outils de cryptographie
Il existe deux catégories des algorithmes
utilisés pour faire le chiffrement
· Les algorithmes symétriques (AES, DES, Triple
DES, IDEA, ...) ;
· Les algorithmes asymétriques (RSA, Courbes
elliptiques, ...).
Les deux utilisent la clé de chiffrement ou de
déchiffrement, les premiers la même clé utilisée
pour le chiffrement, c'est seulement celle là qui est utilisée
pour le déchiffrement des messages, la clé est donc
partagée pour l'émetteur et le destinataire tandis que les
derniers utilisent deux clés différentes associées
(bi-clé : avec une clé privée et une clé
publique ) qui sont liées par des relations mathématiques
complexes et sont telles que tout message chiffré à
l'émission par l'une soit déchiffré à la
réception par l'autre.
Les algorithmes asymétriques sont robustes, très
puissants et gourmands en ressources de la mémoire que les algorithmes
symétriques, c'est à partir d'eux qu'on a la base des outils de
chiffrement et de signature des systèmes de messagerie. Les premiers
algorithmes leurs avantages sont plus sur la rapidité d'exécution
et pour les derniers, sont la facilité de gestion des
clés.26(*)
b. Chiffrement des messages
Le chiffrement des messages est réalisé par
l'émetteur en utilisant la clé publique du destinataire, par un
algorithme symétrique beaucoup plus rapide. La clé publique du
destinataire est utilisée pour chiffrer la clé secrète de
chiffrement du message. Dans ce cas seul le destinataire peut
récupérer la clé secrète, mais celle-ci est connue
de l'émetteur du message. Un grand nombre de systèmes de
chiffrement ont été inventés, qui consistaient à
faire subir à un texte clair une transformation plus ou moins complexe
pour en déduire un texte inintelligible, dit chiffré. La
transformation repose sur deux éléments : une fonction
mathématique (au sens large) et une clé secrète. Seule une
personne connaissant la fonction et possédant la clé peut
effectuer la transformation inverse, qui transforme le texte chiffré en
texte clair.27(*)
c. Signature électronique des
messages
Est un dispositif qui permet de garantir l'authenticité
de l'émetteur et l'intégrité du message
d. Certificat et tiers de confiance
En effet, les mécanismes de chiffrement de clé
publique sont très intéressants mais ils ne permettent pas la
confidentialité du secret entre émetteur et récepteur et
puis, autre difficulté c'est la diffusion de la clé.
Et c'est alors pour remédier à ce
problème qu'on a fait recours au tiers de confiance reconnu à la
fois par l'émetteur et le destinataire, il vérifie
l'identité du propriétaire de la clé publique
(autorité d'enregistrement) puis scelle cette clé, les
informations d'identification associées ainsi que celles de gestion
liées à l'utilisation de la clé publique, à l'aide
de sa clé privée (autorité de certification), le
résultat est un certificat. Cette organisation et les techniques
associées constituent une infrastructure de gestion de clé
publique « PKI : Public Key Infrastructure » ; la
gestion des certificats est en général intégrée aux
clients de messagerie et inclut un standard une liste d'autorités de
confiance prédéfinie, qui sera limitée aux
autorités reconnues par l'entreprise.28(*)
IV.2.2. La sécurisation des protocoles
Elle permet de sécuriser les communications entre les
MTA et entre les Serveurs et clients de messagerie.
IV.2.2.1. Protocole SSL/TLS
SSL (Secure Socket Layer) développé par Netscape
et TLS (Transport Layer Security protocol) repris et normalisé à
partir du précédent par l'IETF ; Ce protocole permet
d'assurer l'authentification, la confidentialité et
l'intégrité des données échangées, il
s'intercale entre le protocole de transport (TCP) et les protocoles applicatifs
tels que ceux utilisés dans l'application de la messagerie (SMTP, POP,
IMAP, http). Il utilise un sous-protocole appelé handshake et un moyen
de cryptographie reconnu, l'algorithme à clé publique RSA (des
noms de concepteurs : Rivest, Shamir et Adleman).
La sécurisation de connexion à l'aide de ce
protocole assure :
- La confidentialité de données transmises
- L'intégrité des données transmises
- L'authenticité des correspondants
- La fiabilité.
En définitif, pour terminer nous devons mettre en place
un logiciel libre Firewall pour renforcer la sécurité au niveau
du serveur en fin d'éviter les intrusions malveillantes.29(*)
Conclusion partielle
Dans cette partie nous avons abordé sur la phase
probatoire qui nous permettra de faire choix des locaux et les conditions de
l'environnement. Aussi, l'évaluation de la solution par rapport au
coût de réalisation de ce projet.
Aussi, nous avons fait la comparaison de quelques serveurs de
messagerie et la comparaison de quelques clients de messagerie après
nous avons fait le choix et présenté les différentes
étapes pour l'installation et la configuration du serveur de messagerie
et du client de messagerie.
En plus, nous avons proposé la solution avec la
technologie WIMAX pour interconnecter les réseaux locaux de
différents sites.
A la fin, nous avons abordé sur les menaces de la
messagerie électronique et la proposition de solution de
sécurité de ce service de messagerie soit avec les protocoles de
sécurité ou avec la méthode de cryptage
CONCLUSION GENERALE
Au cours de l'élaboration de notre mémoire qui
aborde la question de la mise en place et la sécurisation d'un
système de messagerie, qui permettra aux agents de la SNEL dans son
Département de Kinshasa de s'échanger des mails ayant même
des pièces jointes entre eux en vue de :
- Faciliter le travail ;
- Réduire les dépenses dues au
déplacement, à la communication, à l'impression ;
- Interconnecter les différents sites ;
- Mettre en place un réseau
intégré ;
- Sécuriser le trafic des messages ;
- Former les agents sur la nouvelle technologie.
Ce mémoire compte trois parties qui chacune qu'elles
subdivisée par des chapitres notamment :
- La première partie : « Etude
d'opportunité » qui nous a permis de présenter
l'entreprise, de faire d'analyse de l'existant et de le critiquer ;
- La deuxième partie : « Conception
théorique du réseau, cadrage prévisionnel de
réalisation du projet et présentation du cahier de
charge » où nous avons abord sur l'Etude du projet, la
conception et mise en place du réseau local, l'étude comparative
entre le Modèle OSI et le Modèle TCP/IP, la description des
couches, les protocoles de messagerie, fonctionnement du système de
messagerie et puis les différents matériels et topologies
réseaux.
- Troisième partie : « Mise en
place et sécurisation d'un système de messagerie » qui
nous a permis de faire le choix et de définir les conditions de
l'environnement, installer et configurer le serveur de messagerie et du client
de messagerie.
Au terme de ce mémoire pour la réalisation de ce
projet, nous avons pu exploiter nos connaissances théoriques et
pratiques pour avoir des interfaces graphiques et les différents
protocoles utilisés pour l'envoi et la réception des messages
électroniques. Il s'agit d'un complément précieux à
notre formation estudiantine et des générations futures.
La mise en place et la sécurisation du système
de messagerie électronique interne ou externe, devient de plus en plus
la solution de communication et d'échanges de données au sein des
grandes entreprises, des grandes institutions cela est valable aussi pour la
SNEL, d'où il faut une documentation pour aider ceux qui vont manipuler
ce système.
Néanmoins, une phase de démonstration pratique a
été possible grâce à notre ordinateur personnel
configuré comme serveur de messagerie dans le réseau local.
A travers cette étude, il serait vivement
recommandé qu'un accent soit mis sur la formation et la sensibilisation
de tout le personnel pour lui montrer les avantages de la messagerie
électronique et aussi lui faire comprendre sur les notions
élémentaires d'un système informatique en
général.
En définitif, cette solution ne peut atteindre son but
que si on arrivait à interconnecter les différents sites du
Département de Kinshasa de la SNEL, c'est pour cela nous avons
proposé la solution WMAX pour permettre l'interconnexion de ces
sites.
Bibliographie
I. Références
bibliographiques
1. Prof Osokonda, Notes de cours d'Initiation à la
Recherche Scientifique, Année académique 2007-2008
2. René PINTO et Madeleine GRAWITZ,
« Méthode de recherche scientifique », éd.
Dunod, Paris, 1978.
3. Prof Dominique Lalot, Support : « les
réseaux informatiques », Faculté d'Aix en Provence,
publié en 2000
4. Prof KASENGEDIA MUTUMBE Pierre, Notes de cours Architecture
de systèmes téléinformatiques, Année
académique 2011-2012
5. Prof KASENGEDIA MUTUMBE Pierre, Notes de cours de
Conception des Architectures Réseaux, Année académique
2011-2012
6. Prof Saint Jean DJUNGU, Notes de cours de
Télématique et Réseaux, Année académique
2010-2011
7. Prof Saint Jean DJUNGU, Notes de cours de Systèmes
d'exploitation comparés, Année académique 2011-2012
8. Prof KASORO, Notes de cours de l'intelligence artificielle,
Année académique 2010-2011
9. Prof Jeampy MBIKAYI, Notes du cours de Méthode de
Conduite des Projets, Année académique 2011-2012
10. Prof MABELA, Note du cours de Recherche
opérationnelle, Année académique 2010-2011
11. Ass Charmant SOTO, Note du cours d'Administration
réseau, Année académique 2011-2012
12. Service d'archivage de la SNEL
II. Références
webographiques
1. Bernard JOLIVALT, Internet et courrier
électronique
Lien web:
http://www.twenga.fr/livres/internet-et-courrier-ctronique_26546027.html
2. www.commentcamarche.net
«
Fonctionnement
du courrier électronique (MTA, MDA, MUA »,
2011.
3. www.commentcamarche.net
Forum
Virus
/ Sécurité
4. Forum des administrateurs informatiques
5. Mémoire online

* 1 Bernard JOLIVALT,
« Internet et courrier électronique ».
* 2 Prof. OSSOKONDA OKENDE,
Cours inédit d'Initiation à la recherche scientifique, G2 Info
2006-2007, ISS/Kin.
* 3 Service d'archivage de la
SNEL
* 4 Kanga Kangatchi,
« Mémoire sur la Mise en place d'un système de
messagerie électronique », 2008-2009.
* 5 Prof Dominique Lalot,
Support : « les réseaux informatiques »,
Faculté d'Aix en Provence, publié en 2000.
* 6 Prof Dominique Lalot,
Support : Op. Cit.
* 7 Prof Saint Jean DJUNGU,
Notes de cours de Télématique et Réseaux, Année
académique 2010-2011.
* 8 Prof KASENGEDIA MUTUMBE
Pierre, Notes de cours « Architecture de systèmes
téléinformatiques », 2011-2012.
* 9
www.commentcamarche.net
«
Fonctionnement
du courrier électronique MTA, MDA, MUA », 2011.
* 10 Guillaume SANGUI,
« Mise en place d'un système de messagerie sous
Linux », Avril 2009.
* 11 Kanga Kangatchi,
« Mémoire sur la Mise en place d'un système de
messagerie électronique », Université Check Anta Diop,
2008-2009.
* 12 Prof KASENGEDIA MUTUMBE
Pierre, Notes de cours de Conception des Architectures Réseaux,
Années 2011-2012.
* 13 Ass. Charmant SOTO,
Note du cours d'Administration réseau, Année académique
2011-2012.
* 14 William Saint Clicq,
Publication : « Introduction au réseau local »,
Mars 2002
* 15 Prof Jeampy MBIKAYI,
« Notes du cours de Méthode de Conduite des
Projets », Année académique 2011-2012.
* 16 Prof MABELA,
« Note du cours de Recherche Opérationnelle »,
Année académique 2010-2011.
* 17 Ass. Charmant SOTO,
Explication sur les conditions d'une salle serveur.
* 18 Ir Richard Bill
Wanet : « Sécurité de l'environnement des
matériels informatiques », 2011.
* 19 Ass Charmant SOTO, Note
du cours d'Administration réseau, Année académique
2011-2012.
* 20 Labo SUPINFO de
Microsoft, « Présentation et implémentation du
serveur de messagerie EXCHANGE 2003 »
* 21 Prof KASENGEDIA MUTUMBE
Pierre, Op. Cit.
* 22 Prof Pierre KASENGEDIA
MUTUMBE, Op. Cit.
* 23 Club de la
sécurité des systèmes d'information Français,
« La sécurité de messagerie », éd.
CLUSIF, Septembre 2005
* 24 Club de la
sécurité des systèmes d'information Français, Op.
cit.
* 25 Club de la
sécurité des systèmes d'information Français, Op.
cit.
* 26 Club de la
sécurité des systèmes d'information Français, Op.
cit.
* 27 Club de la
sécurité des systèmes d'information Français, Op.
cit.
* 28 Gildas Avoine, Pascal
Junod, et Philippe Oechslin « Sécurité
informatique - Exercices corrigés » Vuibert, Paris, 2004.
Préface de Robert Longeon
* 29
www.commentcamarche.net
Forum
Virus
/ Sécurité



