CONCLUSION
Les principales idées développées dans ce
mémoire sont la relation entre l'offre et la demande en énergies
au TOGO, et d'autre part sur la substitution énergétique, les
plans d'actions pour la maîtrise de l'énergie.
Une situation de répartition pas obligatoirement
harmonieux solidaire durable au niveau de la population mondiale, une zone de
contrainte en terme de consommation, une offre relativement limitée, de
ce fait une question climatique qui s'accélère, l'énergie
est un point central d'une part pour le mode de développement de notre
société, d'autre part pour l'équilibre.
Le développement harmonieux et d'autant plus dès
lors consommer dans une perspective de Développement Durable qui soit
être soutenable adaptée pour les générations futurs
et aussi pour assurer le bien-être de tous.
Pour définir la maîtrise de la demande en
énergie, il ne peut y avoir qu'une impulsion politique. Les politiques
sont le préambule indispensable à une politique mis en oeuvre
efficace. Cette politique doit s'instrumentaliser d'une part dans le cadre
d'une coopération internationale.
Une fois cette impulsion politique, il y a une richesse de ce
qui peut être créée au niveau d'un territoire, d'un pays
avec à la fois de la formation, des transferts de technologie, à
la fois la mise en oeuvre donc des Energies renouvelables mais aussi de la
maitrise de la demande en énergie alternative avec de
l'efficacité énergétique et de la sobriété
énergétique.
Cette dynamique fait qu'a un moment donné, on a une
organisation territoriale différente tournée vers la performance
et de là, on met en oeuvre ce mixte Energétique Durable qui
permet de répondre aux trois (3) enjeux du Développement Durable
qui à savoir : L'économie, le social et l'Environnement.
ANNEXES
ANNEXE 1
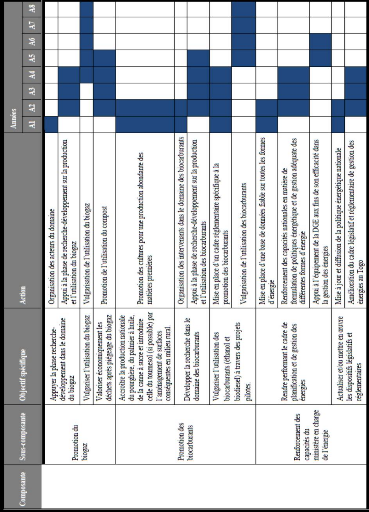

ANNEXE 2
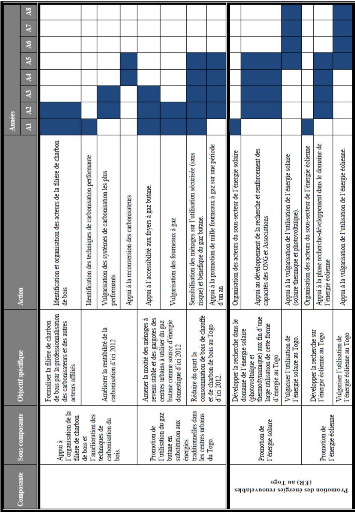

ANNEXE 3
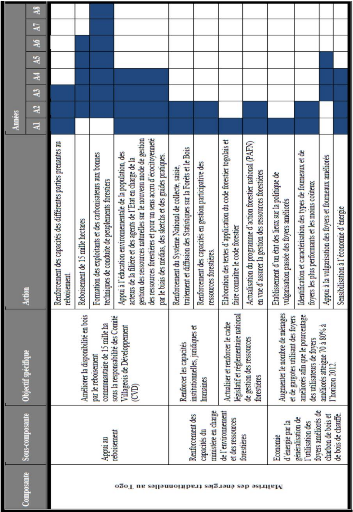

ANNEXE 4
Questionnaire pour les États Membres sur
les
Expériences, Facteurs de Réussite, Risques et
Défis
Par rapport à l'Objectif et aux Thèmes de
la Conférence des Nations-Unies sur
le Développement Durable
(CNUDD)
I. Introduction
1. Ce questionnaire a été préparé
en réponse aux décisions prises lors du Premier Comité
Préparatoire (Prépcom1) tenu du 17 au 19 mai 2010, qui invita les
États Membres à contribuer aux processus de préparation,
notamment, sur les expériences, les facteurs de réussite, les
défis et les risques. Les contributions et informations
récoltées vont permettre la préparation d'un Rapport de
Synthèse qui sera discuté lors de la première Intersession
préparatoire qui est prévu du 10 au 11 Janvier 2011 à
New-York
II. Objectif et Thèmes de la CNUDD
2. La Conférence est organisée, à la
suite de la Résolution A/64/236 de l'Assemblée
Générale des Nations-Unies tenu le 24 Décembre 2009.Elle
aura lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en 2012,
commémorant le 20e anniversaire de la Conférence de Rio de 1992
(CNUED), et le 10e anniversaire du Sommet Mondiale sur le Développement
Durable (WSDD), tenu en 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud.
3. L'objectif de cette Conférence est de
sécuriser le renouvellement des engagements politiques internationaux en
faveur du développement durable, établir un bilan des
progrès accomplis à ce jour et les lacunes à combler dans
la mise en oeuvre des documents finaux des sommets importants tenus sur le
développement durable; mais aussi en adressant les nouveaux défis
émergents.
À cette fin, l'accent sera mis sur deux thèmes:
(a) l'économie verte dans le contexte de l'éradication de la
pauvreté et du développement durable; et (b) le cadre
institutionnel du développement durable.
III. Questionnaires pour fournir des
Contributions
4. Des questionnaires séparés ont été
préparés en rapport à l'objectif et aux deux thèmes
de la Conférence (Voir Annexes A-E).Une liste de ces questionnaires est
fournie ci-dessous.
Document A
Questionnaire :
Susciter un engagement politique renouvelé pour le
développement durable
I
. Introduction
L'objectif de la CNUDD est de renouveler le soutien politique
pour le développement durable, en évaluant les progrès
réalisés à ce jour et les lacunes à combler dans la
mise en oeuvre des documents finaux des grands sommets sur le
développement durable, et en adressant les nouveaux défis
émergents.
La question du renouvellement des engagements politiques sera
adressée dans un contexte plus ou moins à long terme sur comment
l'accord entre les gouvernements et les autres Parties prenantes à la
CNUDD pourrait permettre d'accélérer les progrès,
notamment: (i) l'objectif démographique de stabiliser la population
mondiale; (ii) l'objectif de développement d'étendre les
bénéfices du développement équitablement entre tous
les segments de la société globale; et (iii) l'objectif de
découplage de veiller à ce que l'utilisation de matériaux
et de production de déchets se trouve dans les capacités de
régénération et d'absorption de la planète.
II. Questionnaire
Les États Membres sont invités à fournir
leurs contributions sur leurs expériences, facteurs de succès,
défis et risques liés à l'objectif de la CNUDD
«Renouveler l'engagement politique au Développement Durable»
en réponse aux questions suivantes, développées en se
basant sur les discussions qui ont eu lieu lors du premier PrepCom.
Expériences
1.
Existent-ils des moyens objectifs de mesurer l'engagement
politique? Quels en sont les indicateurs principaux? Selon vous, quels
indicateurs sont les plus utiles? (exemples: Nouvelle Législation,
Politiques publiques, le soutien et l'allocation budgétaire, la
Proéminence des institutions compétentes, le niveau
d'intérêt des medias, etc.)
L'engagement politique de l'Etat en faveur du
développement durable peut être objectivement mesuré
par:
- l'allocation croissante des ressources au profit des
institutions en charge de la promotion du développement durable;
- les investissements publics durables c'est-à-dire les
investissements publics dans des domaines aptes à stimuler le
verdissement des secteurs économiques;
- l'adoption de lois, politiques ou stratégie
spécifique de développement durable.
2. En se basant si possible sur ces indicateurs, comment
évaluerez-vous l'engagement politique du gouvernement national
aujourd'hui sur la question du développement durable comparé
à 1992? Et celui de la communauté internationale?
L'engagement politique du gouvernement togolais peut
être évalué à trois sur une échelle de cinq
(3/5) Le pays dispose d'une stratégie nationale de développement
durable et d'un cadre global de planification (DSRP-C) qui intègre
moyennement les piliers du développement durable. Les investissements
publics dans les secteurs environnement et social sont de plus en plus
significatifs..
L'engagement de la communauté internationale en faveur
du développement durable depuis 1992 si l'on devait l'évaluer,
recevrait une note de deux sur cinq (2/5). D'abord parce que les trois
conventions de Rio et l'Agenda 21 n'ont connu que très peu de mise en
oeuvre depuis près de vingt ans. Très peu de pays ont mis en
place des stratégies nationales de développement durable.
L'allocation des ressources dans le monde s'est faite au
détriment de secteurs porteurs de la croissance verte. Selon le PNUE,
«au cours des deux dernières décennies, des volumes
importants de capitaux ont été investis dans l'immobilier, les
combustibles fossiles et les actifs financiers incorporant des produits
dérivés, mais relativement peu dans les énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports
publics, l'agriculture durable, la protection des écosystèmes et
de la biodiversité et la préservation des sols.»
Les engagements des pays développés en
matière d'aide au développement ne sont pas suivis d'effet.
Depuis 1992 la pauvreté dans le monde n'a pas reculée au
contraire elle s'accentue dans certaines parties du monde sous l'effet
conjugué de nouveaux défis tels que les crises
alimentaires, énergétiques et
financières, la pénurie d'eau potable et de terres productives
sur une toile de fond de changement climatique, d'événements
météorologiques extrêmes et de raréfaction des
ressources naturelles.
Document D Questionnaire sur
L'économie verte dans le contexte de
l'éradication de la pauvreté et du développement
durable
I. Introduction
Le concept de l'économie verte est un des quelques
concepts étroitement liés qui ont émergé ces
dernières années pour renforcer la convergence entre les trois
piliers du développement durable. Bien que l'idée présente
un certain intérêt intrinsèque, des questions ont
été soulevées concernant sa clarté conceptuelle, sa
définition précise, et ses implications pour les objectifs
économiques et sociaux clés.
Une question spécifique se rapporte à la
différence entre le concept idéal «d'économie verte
et les implications à court et moyen termes de la «transition vers
une économie verte».
Dans la littérature, la plupart des textes invoque le
terme dans le but de tracer le contour des éléments et actions
qui seraient normalement décrits comme «écologisation de
l'économie».
II. Questionnaire
Les États Membres sont invités à fournir
des contributions sur leurs expériences, facteurs de succès,
défis et risques pertinents au thème de la CNUDD
«l'économie verte dans le contexte de l'éradication de
la pauvreté et du développement durable» en
réponse aux questions suivantes qui ont été
développées en se basant sur les discussions tenues lors du
premier PrepCom.
Expériences
1. Existe-il un consensus entre les décideurs
politiques de votre pays sur une définition précise du terme
«économie verte dans le contexte de l'éradication de la
pauvreté et du développement durable»? Si oui, comment
est-il défini? (si pertinent, fournir toutes publications officielles ou
études analytiques sur le concept de l'économie verte ou ses
implications opérationnelles et sociales, le tout accompagné d'un
petit résumé).
La notion d'économie verte est encore récente au
Togo et un débat national spécifique sur cette question n'est pas
encore engagée. Toutefois, le Togo en tant que membre de plusieurs
organisation sous-régionale s'aligne sur les positions des pays
africains sur la question. En effet, la troisième Conférence
ministérielle africaine sur le financement du développement (mai
2009), la session de la Conférence ministérielle africaine sur
l'environnement (CMAE) de juin 2010, la première Conférence
panafricaine sur la biodiversité (septembre 2010), le septième
Forum pour le développement de l'Afrique (octobre 2010) et, plus
récemment, la 18e session ordinaire du Conseil exécutif de
l'Union africaine (janvier 2011) ont permis aux etas d'afrique d'avoir une
position commune sur l'économie verte.
Est-ce que la pauvreté et d'autres impacts sociaux
probables sont-ils explicitement considérés dans la conception
des politiques d'économie verte? Si oui, comment?
Pour le moment le pays ne dispose pas de politique
spécifique liée à
l'economie verte.
2. Ces politiques sont-elles mises en oeuvre comme faisant
partie d'une stratégie d'économie verte cohérente ou d'une
croissance verte?
Non
.
. Quels sont les principaux bénéfices à
tirer de la mise en oeuvre d'une stratégie nationale pour
l'économie verte?
Les principaux bénéfices d'une stratégie
nationale d'économie verte sont: le renforcement et
l'amélioration du capital naturel de la terre,
l'optimisation des bénéfices économiques,
la réduction au minimum des inégalités
sociales et du gaspillage des ressources.
.
. Quels secteurs économiques considérez-vous
comme les plus importants pour construire une économie verte dans le
contexte de l'éradication de la pauvreté et du
développement durable?
Les secteurs économiques les plus importants pour
construire une économie verte au Togo sont l'énergie
(énergies renouvelables et efficacité énergétique),
l'agriculture, les ressources en eau, les biens et services environnementaux,
la foresterie, la pêche, les ressources minérales, les industries
manufacturières et la gestion des déchets y compris leur
recyclage.
Comment est-ce que ces politiques ont contribué
à l'éradication de la pauvreté, ou à d'autres
objectifs spécifiques au développement durable?
Ces différentes politiques ne sont pour la plupart
qu'à leur phase de démarrage au Togo et les résultats sur
l'éradication de la pauvreté ne sont pas encore perceptibles.
Selon vous, quelles sont les raisons principales de ce
succès? (disponibilité d'aptitudes institutionnelles et
techniques pertinentes, un fort soutien politique, un vaste engagement de la
société civile et des hommes d'affaires, un soutien
international, autres)
L'économie verte n'est qu'à ces débuts. Elle
ne jouit pas encore d'un soutien fort des politiques, de la
société civile ou du secteur privé.
Quelles mesures et actions ont été
prouvées efficaces dans la construction dans un engagement politique et
populaire pour les mesures liées à l'économie verte?
Aucune
Défis
9. Existent-ils des études dans votre pays qui
identifient les facteurs de succès, défis ou risques
associés aux politiques liées à l'économie verte
soulignées à la Question 1? Pour chacun, fournir un article
original ou un lien internet, accompagné d'un petit
résumé.
Il n'existe pas encore au Togo des études pour identifier
les facteurs de succès, défis ou risques associés aux
politiques liées à l'économie verte.
10. En se basant sur toutes les informations ci-dessus,
quel(s) est (sont), selon vous, le(s) résultat(s)-clé(s) qui vont
émerger de la Conférence des Nations-Unies sur le
Développement Durable en 2012 (Rio+20) par rapport à la question
de «l'économie verte dans le contexte de l'éradication de la
pauvreté et du développement durable»?
Selon moi le résultat clé que la planète
toute entière doit attendre de la conférence de Rio+20 par
rapport à l'économie verte dans un contexte d'éradication
de la pauvreté et du développement durable est un engagement
politique au plus haut niveau de tous les pays du monde en faveur de
l'économie verte et pour une fois le respect par les pays
développés de leurs engagements.
Risques
11. Quelle est la relation entre les politiques
liées à l'économie verte et les autres politiques ou
domaines politiques (pauvreté, croissance, emploi, commerce, etc.)?
S'agit-il de cas de conflits et, si oui, quelles sont les mesures prises pour y
faire face?
Les relations entre les politiques liées à
l'économie verte et les autres politiques ou domaines politiques sont
pour la plupart divergentes dans leurs objectifs et dans leurs
stratégies de mise en oeuvre. La principale mesure prise par le
gouvernement pour y faire face est l'élaboration participative de la
Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) et la mise en
place de la Commission Nationale de Développement Durable pour orienter
les politiques sectorielles vers l'intégration des trois piliers du
développement durable.
Document E
Questionnaire sur le Cadre Institutionnel du
Développement Durable I. Introduction
Le soutien institutionnel pour le développement durable
fonctionne horizontalement à travers différents domaines,
agences, ministères, groupes de fonction, et pays, alors que
l'organisation traditionnelle de l'autorité est verticale,
précisément selon les lignes directives des mêmes agences
et ministères et autres groupes spécialisés. Dans ce
cas-ci, le défi est donc d'identifier les éléments
institutionnels qui vont faciliter l'intégration, sur une base
continuelle, à travers les différentes lignes d'autorité
et les structures de programme, sans les miner ou les déplacer.
Au niveau international, le CNUDD a permis
l'établissement de trois principales structures institutionnelles: la
Commission du Développement Durable (CDD), le Comité Inter-Agence
de Coordination du Développement Durable (IACSD) pour la coordination au
sein du système de l'ONU, et le Conseil Consultatif de Haut Niveau pour
le Développement Durable (HLB) pour l'orientation intellectuelle. Le CDD
reste toutefois la principale institution décisionnelle sur la question
du développement durable au sein du système des Nations-Unies,
les deux autres structures ayant été abandonnées.
Depuis Rio, plusieurs corps des Nations-Unies et des
organisations internationales ont accompli leur travail en se basant sur les
principes du développement durable, qui est mentionné dans le
Document final du Sommet
Mondial de 2005 (Résolution Assemblée
Générale A/RES/06/1) comme «un
élément-clé du cadre général des
activités des Nations-Unies».
Aux niveaux nationaux, les premières innovations
comprennent les conseils nationaux de développement durable (CNDD), et
les stratégies intégrées. L'expérience avec les
CNDD a besoin d'être évaluée pour en identifier les
leçons à tirer, autant au niveau des réussites, qu'au
niveau des échecs. Le processus de développement des
stratégies intégrées a bien pris racine, notamment sous la
forme de stratégies nationales de développement durable (SNDD);
toutefois, il est nécessaire d'examiner cette expérience pour
évaluer quelle est la manière la plus efficace pour atteindre
cette intégration, et particulièrement, si la présence de
plusieurs processus de stratégie en compétition les uns avec les
autres (DSRP, plan de développement, stratégie nationale de
conservation) risque de nuire à l'objectif même de
l'intégration.
Aux niveaux locaux, les Agendas 21 locaux ont
été développés par les institutions locales et les
municipalités urbaines, et ici encore, il est nécessaire de tirer
des leçons de cette expérience.
| 


