|


UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI
(UAC)
+++++&+++++
FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES
HUMAINES
(FLASH)
-=-=-=-=-@-=-=-=-=-
DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE-ANTHROPOLOGIE
(DS-A)
*******0********

LE FESTIVAL DU DANXOME : ENJEUX ET DEFIS POUR LA
COMMUNE D'ABOMEY DANS LE CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION
SUJET
Présenté et soutenu
par : Devant le
Jury composé de
Anicet Nondoté LAO
Présidente : Mme Elisabeth FOURN
Membre : M. D. Hyppolyte AMOUZOUNVI
Rapporteur : M. David Godonou HOUINSA
Note: 16/20
Mention : Très Bien
Date de soutenance : 22 décembre
2008
Année académique
2007-2008
SOMMAIRE
SOMMAIRE................................................................................2
DEDICACE.................................................................................4
REMERCIEMENTS......................................................................5
LISTE DES
SIGLES ET ACRONYMES
.............................................6
RESUME
DU
TRAVAIL.................................................................7
INTRODUCTION.........................................................................8
I-CADRES
THEORIQUE, PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE DE LA
RECHERCHE.......................................................................11
1- Problématique de la
recherche.....................................................12
2- Etat de la
question.....................................................................17
3- Place de la fête dans le
développement.............................................20
4- Clarification
conceptuelle...........................................................22
5-Démarche
méthodologique............................................................33
II-
PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS.........................44
1-Utilité de l'Organisation du Festival de
Danxomè................................45
2- Impacts du festival sur la
commune...............................................48
3-Les limites du
festival..................................................................61
4- Matrice de diagnostic
stratégique...................................................63
5- Les défis et
suggestions...............................................................67
CONCLUSION.............................................................................72
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
75
ANNEXES
79
TABLE DES MATIERES
88
DEDICACE
Je dédie ce mémoire à
· Feu mon père Paul AGOSSOU LAO,
qui de son vivant m'a toujours donné le goût du travail bien
fait ;
· Victorine FANOU, ma mère, qui
jour et nuit ne cesse de penser à mon avenir, reçois ici ma
profonde gratitude ;
· Guillaume FANOU, mon oncle, qui n'a
jamais cessé de m'encourager, merci pour ton soutien moral ;
· Mes frères et soeurs Léonardine,
Fulgence, Pulcherie qui m'ont toujours apporté de
réconfort dans les dures épreuves ;
· Eustache LAO, mon fils et sa
mère Nadine BRAHI ;
· Hubertine HOUNSOU, ma chère
amie, reçois ici ma reconnaissance pour ton soutien ;
REMERCIEMENT
Ce mémoire est le fruit de la combinaison des efforts
de certaines personnes que nous tenons à remercier. Ce soutien tant
moral qu'intellectuel s'est manifesté de diverses manières et
à maintes occasions. Il s'agit de :
· Dr. David Godonou HOUINSA, mon
maître de mémoire qui a suivi ce travail malgré ses
multiples occupations;
· Dr. Albert TINGBE AZALOU, qui à
travers un entretien m'a donné la piste à suivre pour la
réalisation de ce mémoire et tous les professeurs du
Département de Sociologie-Anthropologie qui ont contribué
à ma formation ;
· M. Gabin DJIMASSE, Directeur de
l'Office du Tourisme d'Abomey et Régions, qui n'a ménagé
aucun effort pour mettre les informations à ma disposition ;
· M. Benjamin A. BADOU, chef service
Artisanat, Tourisme et Hôtellerie à la DDCAT/ZOU ;
· M. Bertin A. KPAKPA,
Socio-anthropologue, coordonnateur adjoint du festival pour les documents mis
à ma disposition ;
· Toutes les autorités de la mairie et toute la
population d'Abomey ;
· Tous les membres des familles LAO, FANOU,
YAHOUEDEOU, HOUNSOU et AKPASSONOU;
· M. Roch BAH et sa famille pour leur
soutien ;
· Abel SODOHOUE pour son aide lors de
l'enquête ;
· Tous mes amis, Thierry, Ghaffar, Hervé,
Siméon, Roland, Alain, Raymond, Samson et tous
les autres qui n'ont pas été cités mais que je remercie du
fond du coeur pour leurs soutiens combien multiples et variés.
SIGLES ET ACRONYMES
DDCAT : Direction Départementale
de la Culture de l'Artisanat et du Tourisme
GTZ : Organisme Allemand de la
Coopération Technique
INJEPS : Institut National de la
Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport
INSAE : Institut National de
la Statistique et de l'Analyse Economique
MDS : Matrice de
Diagnostic Stratégique
OMT : Organisation
Mondiale du Tourisme
OSC : Organisation de la
Société Civile
OT : Office du
Tourisme d'Abomey et Région
PADECOM : Programme d'Appui au
Développement des Communes
PDC : Plan de
Développement Communal
PDM :
Partenariat pour le Développement Municipal
UNESCO : Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture
RESUME DU TRAVAIL
La décentralisation fait aujourd'hui obligation aux
Communes de s'ingénier dans des solutions de l'auto-développement
durable de toutes les composantes d'une localité. De ce fait, les
élus locaux, premiers responsables de ce développement sont
astreints de tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif. C'est la raison
d'être du festival du Danxomè initié par l'autorité
communale d'Abomey, capitale historique du Bénin aux atouts culturels et
touristiques indéniables. Et il parait important à nos yeux
d'appréhender l'utilité de ce festival dans la
problématique du développement de cette Commune.
La méthode raisonnée a été d'une
grande utilité dans la conduite de cette étude. Elle nous a
permis d'identifier différentes catégories d'acteurs directs et
indirects du festival. La méthode d'investigation a retenu un guide
d'entretien et un questionnaire, appliqués à un
échantillon de 108 acteurs. Ces outils ont permis de collecter diverses
informations dont les résultats se présentent de la
manière suivante :
- le festival du Danxomè permet la revalorisation et la
réaffirmation de l'identité culturelle fon ;
- le festival permet le développement du secteur
touristique qui est une source substantielle de revenus pour les ménages
et pour la Commune ;
- le festival offre un cadre de retrouvailles et de
rapprochement des filles et fils d'Abomey en leur redonnant le sentiment
d'appartenir à une même sphère culturelle mais n'a
pas encore réussi à conduire à leur union;
- la revalorisation du patrimoine culturel à Abomey
constitue un élément important dans le renforcement de la
coopération décentralisée ;
- plusieurs défis restent à relever pour une
meilleure contribution du festival au développement de la Commune.
Ces résultats révèlent l'utilité
du festival dans la problématique de l'auto- développement de la
commune d'Abomey et les défis à relever pour sa meilleure
contribution à ce développement.
Mots clés :
Décentralisation, Revalorisation du patrimoine culturel,
Tourisme, Auto-développement
INTRODUCTION
Avec l'avènement de la démocratie en 1990 et
toujours dans l'optique de renforcer la gestion du pouvoir par le peuple, le
Bénin gère depuis l'organisation en janvier 1993 des Etats
Généraux de l'administration territoriale, un processus de
décentralisation. Ce processus est entré dans sa phase active par
l'organisation en décembre 2002 et janvier 2003 des premières
élections communales et municipales.
Ainsi, le 21ème siècle consacre la refondation
de l'Etat béninois qui devient un Etat décentralisé,
porteur des élus locaux sur la scène politique nationale.
L'option béninoise est d'opérer une décentralisation
intégrale d'un seul niveau qui a abouti à la création de
77 Communes de plein exercice dont trois (3) à statut particulier.
Dans ce contexte, les élus locaux sont de
véritables pionniers de la promotion de la démocratie à la
base et du développement local. Qu'ils dirigent une Commune "riche ou
pauvre", ils ont la lourde responsabilité de relever le défi de
l'auto-développement de leur localité. Maintes stratégies
sont, à cet effet, mises en oeuvre pour l'accomplissement de cette
tâche. Ainsi, depuis quelques années, on assiste à un
développement important des manifestations culturelles et artistiques
organisées le plus souvent sur l'initiative des élus locaux et
des collectivités locales avec parfois le soutien de l'Etat ou de
donateurs publics ou privés, nationaux ou internationaux.
Ces festivals connaissent beaucoup de succès
auprès des populations locales. Ils sont une occasion exceptionnelle
pour une communauté de se retrouver et de «vivre son
patrimoine » et dans certains cas de fédérer plusieurs
communautés autour d'un patrimoine commun. Ils sont aussi des
catalyseurs d'une fierté retrouvée et permettent de redonner aux
populations une confiance dans leurs valeurs culturelles, fortement
valorisées par la présence d'un public varié
réunissant aussi bien des connaisseurs que des touristes. C'est dans
cette perspective que s'inscrit l'organisation du festival du Danxomè,
une rencontre annuelle des filles et fils du plateau du Danxomè pour
revaloriser et vendre leurs richesses culturelles. L'idée d'une telle
rencontre avait été traduite sous différentes approches
dans les différents programmes de plusieurs candidats à la mairie
d'Abomey. L'autorité communale en a fait une réalité et le
Festival du Danxomè est considéré comme une réponse
positive aux multiples défis de l'auto-développement de la
Commune.
Ce sont donc les véritables enjeux et les
multiples défis de ce festival dans le cadre de la
décentralisation dans cette Commune qui feront l'objet de la
présente étude. En d'autres termes, elle permettra d'inventorier
la contribution de cette manifestation culturelle au développement
d'Abomey en cette ère de décentralisation. La première
partie de ce travail sera consacrée aux cadres théorique,
pratique et méthodologique de la recherche et la seconde partie mettra
en exergue dans les résultats qui y seront analysés.
CADRES THEORIQUE, PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE DE
LA RECHERCHE
1- PROBLÉMATIQUE
1.1- Problème
Après l'indépendance en 1960, les
découpages territoriaux intérieurs ont repris les
délimitations coloniales : cercles, subdivisions, cantons etc.
Jusqu'en 1972, ce système a fonctionné sur la base d'une
déconcentration sur le plan technique qui accompagnait une
centralisation encore présente et pesante avec des services centraux
basés à Cotonou et à Porto-Novo relayés par les
annexes hors de ces deux villes.
Les multiples crises socio-politiques intervenues
après l'indépendance ont conduit le pays, en 1972, à la
révolution. Ainsi, un nouveau découpage territorial fut
réalisé en 1977: la province (ancien département)
dirigé par un préfet, le district (ancienne
sous-préfecture) dirigé par un chef district, la Commune (urbaine
et rurale) dirigée par le maire, le village représenté par
un délégué. Quoi qu'il en soit, on ne pouvait parler de la
décentralisation, au sens propre du terme, dans la mesure où le
vrai pouvoir décisionnel continuait d'appartenir au sommet. Le
délégué et le maire avaient des rôles purement
administratifs sans portée politique. Cette centralisation du pouvoir
dans les mains de l'Etat constituait une entrave au développement du
pays en général et des localités en particulier car le
peuple n'est pas concrètement associé à la gestion de la
chose publique. Ce système ne permettait pas à l'Etat
d'appréhender les profondes aspirations des populations et les
véritables problèmes auxquels elles sont confrontées. Si
des progrès furent accomplis dans les domaines de la santé, de
l'éducation primaire, de l'encadrement et de l'équipement
agricole dès le début des années 80, les performances
économiques furent moins satisfaisantes. La crise économique
galopante devient généralisée. La pression des
revendications et la fragilisation du pouvoir aboutirent à
l'organisation en février 1990, de la Conférence des Forces Vives
de la Nation. Plusieurs décisions ont été prises notamment
l'adoption d'un régime économique libéral et le
multipartisme intégral appelé "le renouveau
démocratique ", mode de gouvernement où le peuple
détient la souveraineté. ABRAHAM Lincoln le définira comme
« le gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple ».
Il fut également décidé d'entamer une
reforme institutionnelle de décentralisation intégrée dans
la nouvelle constitution adoptée par référendum et
promulguée en décembre 1990. Les intérêts et enjeux
de la décentralisation étaient tels qu'une décennie de
travail difficile fut nécessaire aux gouvernements successifs pour
mettre en place cette reforme. Annoncées de multiples fois et
reportées à maintes reprises en raison des stratégies
électorales, les premières élections communales et
municipales eurent enfin lieu le 15 décembre 2002 et 19 janvier 2003
avec un taux de participation se situant entre 70% et 75% (Lalanne, 2004).
La décentralisation, gage de la promotion de la
démocratie à la base et du développement local, devient
alors effective suivie de l'installation des maires. Elle permettra de
responsabiliser les collectivités locales dans la production et le
développement de l'économie locale. Elle est la pierre d'angle
qui astreint l'autorité élue d'une collectivité locale
à ingénier, aux fins de la survie de sa communauté la
conception du développement la plus durable et de la
matérialiser par ses propres moyens. Outre l'aide de l'Etat, chaque
Commune est tenue de réfléchir, de chercher et de
découvrir les voies et moyens pour amorcer son développement
socio-économique réel et durable. Les collectivités
locales mettent à cet effet, toutes leurs richesses, toutes leurs
ressources, qu'elles soient culturelles, historiques, agricoles,
infrastructurelles... au service de l'économie communale.
Dans cette logique, la Commune d'Abomey, capitale historique
du Bénin, qui n'a pas à l'instar d'autres régions du
Bénin, le privilège d'appartenir à un pôle de
concentration industrielle ou commerciale, ni le privilège d'être
une région de concentration des capitaux de l'Etat, ne peut, à
l'orée de la décentralisation, se prévaloir que de ses
richesses historiques, culturelles, artistiques et touristiques comme seules
valeurs économiquement monnayables pour son développement. Vu que
le tourisme occupe aujourd'hui une place importante dans le rang des
activités génératrices de revenus au Bénin. Le
tourisme plus qu'une activité de découverte et de distraction est
devenu une industrie. L'industrie touristique avec son expansion depuis le
siècle dernier a été identifiée comme facteur
susceptible de contribuer à la réduction de la pauvreté au
regard des devises qu'elle génère.
En effet, selon les statistiques de la Direction du
Développement Touristique, le Bénin a connu 111000 touristes en
1994 pour une recette de 13,134 milliards de FCFA. Cette recette a plus que
doublé sur une décennie et les devises touristiques sont
passées à 27 milliards de FCFA en 2004 pour 173500
touristes1(*). Ces chiffres
ont évolué et ont atteint 35 milliards de FCFA comme recette
touristique nationales pour 185000 touristes en 2007. Or, bien que disposant
d'un immense patrimoine historique et touristique constitué de cultes,
rythmes, chants et danses, chorégraphies, palais, musée ... de
même que les institutions du royaume et leurs rituels respectifs, la
Commune d'Abomey a longtemps connu un taux de fréquentation touristique
relativement faible. Cet état de choses, résultat de la
dégradation et de la non conservation des différents sites
touristiques, ne permet pas l'amélioration des conditions de vie des
artisans, artistes, agriculteurs, restaurateurs, etc. et leurs ménages
(soit environ 75% de la population active) ni la création de nouveaux
emplois et participe de ce fait à l'accroissement de la pauvreté
des populations. Il s'en suit qu'à l'ère de la
décentralisation, la réhabilitation du patrimoine culturel et
cultuel d'Abomey par le biais du Festival du Danxomè s'avère
indispensable. Cela permettra la réduction de la pauvreté des
populations dans cette Commune. Aussi, la valorisation du patrimoine culturel
d'une ville ou d'un territoire constitue-t-elle un facteur
d'attractivité vis à vis non seulement des touristes mais aussi
des opérateurs économiques qui, par la mise en place de nouvelles
activités (industries, projets de développement), vont contribuer
au développement local. Elle se présente aussi comme un
élément important dans la coopération et la consolidation
intercommunales.
Loin d'être ce que les industriels pourraient
considérer comme un luxe superflu face aux besoins essentiels des pays
africains, l'action en faveur du patrimoine culturel et naturel peut au
contraire constituer un formidable levier de développement. Les
collectivités locales y ont, à cet effet, un rôle majeur
à jouer, de par leur position au plus près des populations qui en
sont les premiers bénéficiaires. Le Festival du Danxomè,
dont la première édition a eu lieu en décembre 2003, y
trouve alors son compte et peut être considéré comme une
réponse au défi de l'auto-développement dans le cadre de
la décentralisation dans la Commune.
Comme le stipule la théorie de Marcel Mauss, les
réalités sociales ne peuvent être
appréhendées que dans leur totalité d'où sa notion
du "fait social total". Selon l'auteur, le fait social comporte plusieurs
dimensions, économique, religieuse ou juridique et ne peut être
réduit à un seul de ces aspects. Il parvient à la
conclusion que, « le fait social n'est réel
qu'intégré dans un système et c'est là un premier
aspect de la notion du fait social total »2(*). Le développement
étant donc un fait social doit embrasser tous les domaines
(économique, social, culturel, politique...) Dans cette perspective,
le festival du Danxomè, au-delà de la revalorisation des
richesses culturelles devra viser le développement harmonieux de toutes
les composantes de la Commune d'Abomey pour le bien-être des
populations.
Quelle est alors la contribution du Festival du
Danxomè au développement de la Commune d'Abomey?
1. 2- Hypothèses de l'étude
Ø Le festival du Danxomè est une réponse
aux multiples défis de l'auto-développement dans la Commune
d'Abomey ;
Ø la valorisation du patrimoine culturel constitue un
facteur important dans le renforcement des rapports intercommunaux et de la
coopération décentralisée à Abomey.
1. 3- Objectifs de la recherche
1.3-1- Objectif général
Appréhender l'utilité du Festival du
Danxomè dans la problématique de l'auto-développement de
la Commune d'Abomey.
1.3-2 -Objectifs spécifiques
Ø Inventorier l'apport du festival au
développement de la Commune d'Abomey ;
Ø Mettre en évidence l'importance de la
valorisation du patrimoine culturel dans le renforcement des rapports
intercommunaux et de la coopération décentralisée.
2- ETAT DE LA QUESTION
« La recension des écrits constitue
la pierre angulaire de l'organisation d'une recherche. Aucun chercheur
sérieux n'oserait entreprendre une recherche sans avoir
vérifié l'état de la question »3(*). Par ailleurs, comme le souligne
Dumezil (1941) « l'esprit comparatif doit intervenir dès le
début, dès la collecte et l'appréciation des sources,
dès la lecture et le classement des documents »4(*). Faisant nôtre ces deux
considérations, la revue documentaire s'est donc avérée
incontournable. Mais le Festival du Danxomè étant une innovation,
nous n'avons pas bénéficié en la matière d'une
florissante littérature. Mais, animé d'un esprit comparatif, nous
sommes partis d'exemples déjà connus et décrits pour
d'autres communautés sur le développement et ses aspects
socio-culturels et économiques. Nous avons ainsi parcouru des documents
ayant traité des manifestations culturelles telles que la Gani à
Nikki, le Nonvitcha chez les Popo... Cet exercice nous a permis de
définir de façon claire la position du sujet et le
problème qu'il pose.
Pour Jacques Lombart (1965)5(*), au-delà du rôle
sélectif et unificateur de la Gani, elle a un caractère religieux
avec ses implications politiques juridiques et économiques.
Dans la même perspective la sous commission
(Borgou 1985) part du mythe batonu selon lequel « les morts ne sont
pas morts » pour montrer qu'au-delà des implications
politiques, économiques et juridiques, la Gani tire son fondement de ce
mythe qui commémore la cohésion et l'unité des Batombu
chaque année.
Reprenant à son compte les analyses de Jacques
Lombart et des administrateurs coloniaux (Cornevin et Al), OROU Y. R.
(1982)6(*) souligne les
impacts socio-économiques de la Gani sur le groupe socio-culturel
batonu. Pour l'auteur, la Gani enrichit les populations qui s'y rendent car
elle est le carrefour d'un système de croyances, de connaissances, de
sentiments et de littératures. Dans la perspective du
développement, elle est comprise comme la dynamique d'un ensemble
d'idées liées tant à l'histoire du passé
qu'à l'avenir. Elle participe donc du développement social,
politique et économique de cette communauté.
Bio Bigou (1996)7(*) a montré quant à lui, que la Gani est un
jour de dons et d'échanges par excellence. Il aboutit à la
conclusion qu'elle est " un phénomène social total" comparable
au Potlatch chez les Indiens d'Amérique du Nord étudié par
Mauss.
LAFIA F. B. (1997)8(*) a montré que sur le plan socio-culturel, la
Gani assure la cohésion, l'unité du peuple batonu en même
temps que sa stabilité politique. Elle est un fait culturel,
l'expression des mentalités, des sentiments collectifs, des
comportements et attitudes collectifs. Elle mobilise, réunit les Batombu
autour du pouvoir politique Wassangari en même temps qu'elle est une
fête de communion avec les mânes des ancêtres et les
divinités batombu. Elle assure l'équilibre psychologique des
Batombu, symbolise le consensus. Tous ces déterminants sont des
prédispositions d'un développement réel.
L'auteur poursuit en montrant qu'au plan
économique, tout un mois appelé " mois de recherche
financière ? est destiné aux préparatifs de la fête.
Pendant ce temps, les acteurs travaillent intensément pour
accroître leurs revenus ou pour se faire beaucoup d'argent dans l'optique
de bien fêter... Or, le travail est le facteur essentiel du
développement. Mieux, la Gani implique des échanges. C'est le
lieu de consommation et d'ostentation. L'exposition des objets d'arts est un
moment intense d'échanges où touristes et participants viennent
découvrir les objets d'arts des Batombu. Pendant ce temps, hommes
d'affaires, commerçants, petits détaillants, en un mot les
opérateurs économiques voient leurs chiffres d'affaires augmenter
grâce aux marchés qui s'animent de jour comme de nuit.
Soulignant les impacts de certaines manifestations
religieuses sur la vie économique des populations, Charles J.
Dassi9(*) a montré
que le pèlerinage marial de Dassa offre beaucoup d'opportunités
aussi bien aux populations locales qu'aux églises. Durant cette
période, artisans, vendeuses, propriétaires d'hôtels, de
buvettes et restaurants voient leurs chiffres d'affaires augmenter.
A l'instar de ces manifestations, le Festival
du Danxomè est l'expression des mentalités, sentiments et
attitudes collectifs. C'est un moment d'échanges économiques et
en tant que tel, il doit participer au développement économique,
social et politique d'Abomey.
Dans le cadre de ce travail, nous allons nous atteler
à étudier la contribution de ce festival au développement
de la Commune d'Abomey.
3- PLACE DE LA FETE DANS LE DÉVELOPPEMENT
La dynamique du monde moderne
place le développement au centre des préoccupations de
l'humanité. Le développement devient depuis 1960, le centre de
gravité, l'enjeu autour duquel tournent les grands débats
nationaux et internationaux.
La conception classique considère le
développement comme une forme particulière du changement social,
une approche matérialiste et productiviste qui définit le
développement en mettant l'accent sur la croissance économique
sans soucis de ses répercussions sur les dynamiques propres des groupes
cibles, ainsi que sur les réalités socio-culturelles ou sur les
représentations collectives des pays concernés. Le
développement peut contribuer pour une part modeste mais réelle
à améliorer la qualité des services que les institutions
de développement proposent aux populations en permettant une meilleure
prise en compte des dynamiques locales, les fêtes occupent une place
prépondérante dans l'univers culturel africain.
Objets d'étude pour les historiens,
anthropologues et sociologues, les fêtes sont l'un des faits sociaux les
plus répandus dans les sociétés traditionnelles
négro-africaines. Elles sont nécessaires à leur
équilibre et à leur bon fonctionnement. Elles marquent les temps
forts de la vie sociale en mobilisant les forces collectives et en suscitant
l'enthousiasme commun. « Aucune joie ne peut remplacer celle des
fêtes.» OROU Y.R.(1982)10(*). En dehors des fêtes ordinaires comme celles du
1er Mai et du 1er Août, les fêtes religieuses
se déroulent dans une atmosphère imbibée du sacré.
Elles sont le symbole de la dimension sacrée de la vie et d'une
réactualisation rituelle d'un temps originel. « En rapport
avec le mythe et la cosmogonie, la fête n'est pas la commémoration
d'un événement mythique, mais sa
réactualisation »11(*). La réactualisation périodique est le
symbole de la continuité et de la perpétuité dans la
vie des peuples. Il semble d'ailleurs « qu'aucune
société n'aurait pu se perpétuer sans que
périodiquement les individus qui la composent viennent la revivifier par
leur participation à une manifestation collective » Lombard
(1965)12(*). Henri Hubert
et Marcel Mauss (1909) voient dans le sacré « une suite
d'éternités », les fêtes religieuses participent
du domaine du sacré qui draine toute la collectivité, le lignage,
la famille ou tout un peuple.
Dans " les formes élémentaires de
la vie religieuse " Durkheim (1912), fait du rassemblement,
générateur d'exaltation, le trait caractéristique de la
fête dont le corrobori australien semble donner l'exemple le plus
frappant. Il note ainsi la fonction récréative et
libératoire de telle manifestation à travers des chants, des
danses, des cris, des tumultes et l'ivresse qui accompagnent les rites. Ces
différentes caractéristiques de la fête se lisent à
travers le festival du Danxomè et traduisent les richesses culturelles
et cultuelles de ce royaume.
Mais dans "Totem et tabou", Freud (1912)
définit la fête comme « un excès permis, voire
ordonné, une violation solennelle d'une prohibition. La fête
ressortirait ainsi du sacré de transgression. »13(*). Elle manifesterait la
sacralité des normes de la vie sociale courante par leur violation
rituelle. Elle serait nécessairement désordre, renversement des
interdits et des barrières sociales, fusion dans une immense
fraternité par opposition à la vie sociale commune qui classe et
qui sépare.
Jean DUVIGNAUD (1974) dira que la fête
« substitue une fusion délirante »14(*). De fait la joie de se perdre
dans la foule dense et animée, d'admirer les chants et les
vêtements neufs, de boire et de manger, rompt avec la monotonie de la
quotidienneté. La fête qui obéirait alors aux
schèmes bien connus : lente accumulation, brusque explosion,
compétition, simulacre, vertige devient un remède à
l'usure sociale15(*). Les
fêtes plongent ainsi les communautés entières dans le temps
du rêve. Durant les cérémonies totémiques annuelles
du type « intichiuma » les Australiens
« Arunta » reprennent l'itinéraire suivi par
l'ancêtre mythique du clan dans l'époque
« altchéringa » (temps du rêve). Cet aspect
des cérémonies décrites par Durkheim16(*) se lit à des nuances
près dans la célébration du Festival du Danxomè.
4- CLARIFICATION CONCEPTUELLE
Aborder ce travail sans définir les mots
clés que comporte le thème serait une maladresse. En effet, un
mot peut revêtir une structure polysémique. Platon ne disait-il
pas que « la pire des choses qu'on peut exiger d'un ennemi c'est de
lui demander une définition ? ». La difficulté
réside dans la capacité à pouvoir cerner tous les contours
du terme. C'est cette polysémie qui crée en sciences sociales une
confusion et peut conduire à des malentendus entre chercheurs. Il
importe donc de définir d'une manière claire et univoque afin de
rompre avec les évidences naïves du sens commun et les malentendus
qui ruinent toute recherche qui se veut sérieuse. C'est justement ce que
Durkheim nous enseigne lorsqu'il disait « La première
démarche du sociologue doit être de définir les choses dont
il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est
question »17(*).
Quelques mots et expressions retiennent à cet
effet notre attention et nécessitent une clarification. Il s'agit
de :
Le Festival du
Danxomè : C'est la formule trouvée
par le conseil communal d'Abomey pour instaurer une tradition annuelle de
mobilisation et de retrouvailles des filles et fils du plateau d'Abomey afin de
mettre en valeur la culture fon d'Abomey18(*)
Le festival : Tenue
périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre
donné et se déroulant habituellement dans un endroit
précis. Telle est la définition donnée par Larousse
(2002). Mais elle est loin de rendre compte de la diversité et de la
complexité du phénomène des festivals. Le Ministère
de la Culture définit quant à lui le festival comme
« une manifestation où la référence à la
fête, aux réjouissances éphémères,
événementielles et renouvelées s'inscrivant dans la triple
unité de temps, de lieu et d'action. Il est intéressant de
rappeler la définition donnée par Luc Bénito dans son
ouvrage "Les festivals en France : Marchés - enjeux et
alchimie" : « Le festival est une forme de fête unique,
célébration publique d'un genre artistique dans un espace temps
réduit ».
Danxomè :
Le roi AKABA construit son palais sur la sépulture d'un adversaire
appelé Dan (serpent en fon) d'où le nom de Dan-homè qui
signifie « dans le ventre du serpent ». Danxomè a
une longue histoire que nous ne saurions raconter dans son
intégralité. Ce qu'il faut retenir est que « Durant la
période précoloniale, l'actuel territoire du Bénin
était composé de trois grands ensembles de royaumes que l'on va
retrouver dans la phase contemporaine de revitalisation. Dans le sud,
régnaient les grandes monarchies de l'aire adja-fon qui allaient exercer
l'influence la plus importante sur le pays avec ses deux puissants royaumes
d'Abomey et de Porto-Novo. Ces monarchies se sont bâties au cours de deux
vagues migratoires : celle des Houéda (ou xuéda), venus du
plateau adja, qui fondèrent la royauté de Savi et
donnèrent son nom à la ville de Ouidah ; celle de Agassouvi
(les « fils de panthère », venus de Tado selon la
légende) qui, à la suite de querelles entre princes aboutit
à la création des royaumes d'Allada, d'Adjacè (Porto-Novo)
et d'Abomey (Danxomè) ... A la veille de la colonisation, la
moitié sud du pays voyait s'établir la suprématie d'un
royaume économiquement prospère, fortement
hiérarchisé et centralisé : celui du Danxomè,
qui allait absorber Allada, détruire Savi et Kétou, soumettre
Sàbè, et étendre les frontières de sa
suveraineté jusqu'aux franges des Wassangari du Borgou. Le
Danxomè commença véritablement à s'organiser au
17ème siècle sous le règne de Houégbadja
(1645-1685) qui assit son pouvoir sur des chefs locaux (les
Guédévi), institua une administration, un corps de ministre et
formalisa un ensemble de rituels et de cérémonies royales qui
allaient dès lors constituer la « grande tradition »
des souverains d'Abomey... »19(*)
Du fait de son influence et de sa suprématie,
Danxomè a donné son nom au pays. L'actuelle république du
Bénin s'appelait donc République Populaire du Dahomey
après les indépendances avant d'être proclamé
République Populaire du Bénin en 1975 sous le règne de M.
KEREKOU20(*)
Le défi :
C'est un problème, une difficulté que pose une situation
et que l'on doit surmonter (Larousse, 2002). Dans le contexte de la
décentralisation, les défis que doivent relever les Communes
africaines en général et celles béninoises en particulier
se trouvent être ceux de mobilisation des ressources
financières.
Enjeu :
Selon Larousse (2002), le mot enjeu revêt deux sens.
· C'est la somme que l'on mise en jeu et qui revient au
gagnant
· C'est aussi ce que l'on risque de gagner ou de perdre
dans une entreprise, une compétition.
Dans le cadre de notre travail c'est le second sens qui
correspond au mieux à celui que nous lui conférons.
Par ailleurs, un enjeu pour une Commune est de
participer à la construction d'une base économique et spatiale
valable pour son développement. Son rôle est, en effet, de
créer un environnement favorable pour inciter les opérateurs
économiques à faire des investissements. En matière de
ressources financières, l'enjeu pour une Commune est quadruple :
faire fonctionner la Commune en tant qu'administration publique, assurer les
activités récurrentes qu'imposent les nouvelles
compétences, réaliser des investissements et mener ou susciter
des actions de développement.21(*)
Le tourisme :
Depuis 1982, Marc BOYER a perçu la difficulté liée
à une définition type du concept de tourisme. Pour lui,
« le plus difficile pour qui veut écrire sur le tourisme est
de le définir. Il est pourtant indispensable si l'on tient à le
mesurer »22(*)
WAINWRIGHT J.23(*) quant à lui, voit dans le tourisme, le fait de
voyager, de parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où l'on
vit habituellement. L'auteur circonscrit ainsi le tourisme au plaisir
qu'éprouve le visiteur.
Mais élargissant le champ du concept, Francesco
FRANGIALLI24(*),
définit le tourisme comme une forme de loisir dont le contenu
économique est le plus évident puisqu'il implique une
dépense de transport et d'hébergement.
Abondant dans le même sens, l'OMT (1998), le
définit comme « un ensemble d'activités
déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs
séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement
habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas
une année, à des fins de loisirs, pour affaires et
autres ».
Cette dernière définition que nous nous
proposons d'adopter dans le cadre de notre étude, comme
l'écrivait Marc BOYER, essaie de dissocier, la double dimension du
tourisme, qui pour le touriste est une forme de loisirs et pour celui qui le
reçoit, le nourrit, le transporte ou le distrait, une forme de travail,
créateur de richesses et d'emplois.
Au Bénin, quatre principaux types de tourisme peuvent
être pratiqués. Il s'agit du tourisme de congrès ou
d'affaire, l'écotourisme, le tourisme balnéaire et le tourisme
culturel qui vise à promouvoir de façon durable le pluralisme
culturel et préserver la diversité culturelle ainsi que
l'authenticité du patrimoine vivant et monumental. A propos de ce
dernier type de tourisme, Mohamed BERRIANE25(*) souligne qu' « il faut soutenir la
culture pour développer le tourisme, développer le tourisme pour
soutenir la culture ».
La
décentralisation : D'une manière
générale, la décentralisation est un mode d'administration
dans lequel, les collectivités publiques locales se voient
reconnaître la personnalité morale distincte de l'Etat et le
pouvoir de décision propre. Décentralisation signifie donc un
réel transfert de pouvoirs, de compétences et surtout de
ressources au plan local pour permettre aux populations à la base de
participer pleinement à la gestion des affaires de leur localité.
Dans tous les cas, elle est appréhendée comme un concept
politique, un instrument idéologique. Elle prône la
maîtrise, par les populations d'une collectivité, de la gestion
des affaires publiques qui touchent directement à leur vie quotidienne.
Cette maîtrise commence par la désignation endogène des
autorités chargées de représenter la collectivité.
L'élection symbolise, selon Hauriou, (1982)26(*) le transfert de la puissance
publique des citoyens aux autorités de représentation.
La décentralisation selon Sébahara,
(2000)27(*)
« est un mode d'organisation institutionnelle qui consiste à
faire gérer par des groupes délibérants élus les
affaires propres d'une collectivité territoriale ou locale, c'est-
à- dire la reconnaissance d'une personnalité juridique
propre ; des pouvoirs de décisions, justifiés par
l'existence de ces affaires propres, sont reconnus à ces entités
administratives autres que l'Etat et non situés par rapport à lui
dans une relation hiérarchique. Le processus de décentralisation
concerne ainsi les aspects administratifs, financiers et
politiques. »
Ainsi, on distingue :
· La décentralisation administrative entendue
à la fois comme technique juridique d'administration territoriale et
modalité politique de partage de pouvoirs entre les autorités
centrales et les autorités locales d'un pays. Ce disant, elle se
caractérise par la reconnaissance d'une personnalité juridique et
d'une autonomie financière au profit des collectivités
locales ;
· La décentralisation politique qui serait
caractéristique d'un système qui associerait à la
décentralisation administrative, une décentralisation
corrélative des pouvoirs législatif et juridictionnel.
Cette définition présente la Commune au
Bénin comme une entité territoriale décentralisée,
gérée par des organes élus que sont les maires et les
conseillers communaux.
Pour Adjaho, (2002)28(*) « la décentralisation peut se
définir comme la création par l'Etat et en dehors de lui,
d'autres personnes de droit public capables de prendre en charge une partie de
la gestion des affaires de la cité ». De façon
schématique et comparative, l'auteur ajoute que « la
décentralisation peut être comparée au principe de la
subsidiarité cher aujourd'hui à l'Union Européenne et qui
veut qu'un niveau de responsabilité : Etat, région,
département, Commune ne fasse pas ce qu'un autre niveau peut mieux faire
et à moindre coût ».
Selon le guide du maire (2006)29(*) « la décentralisation est un
système d'administration qui consacre le partage du pouvoir, des
compétences, des responsabilités et des moyens entre l'Etat et
les collectivités territoriales. » Les caractéristiques
d'une collectivité territoriale sont :
§ un territoire propre,
§ la personnalité juridique et l'autonomie
financière,
§ l'élection des autorités locales (Maire
et conseillers)
Du côté des autorités et des
bailleurs, l'accent est plutôt mis sur la séparation des pouvoirs,
le bon fonctionnement des structures publiques, notamment des structures
élues et le déroulement transparent du processus
électoral, essentiel pour la légitimité des organes
élus.
Par contre, pour la société civile
béninoise, la tendance est de mettre l'accent sur les pratiques
démocratiques tant des structures associatives que publiques :
informations pour tous, dialogues et débats objectifs et ouverts, droit
à la parole, prise de décisions collectives, clarté dans
les délégations données, compte rendu par les
délégués et responsables, transparences de la gestion et
lutte contre la corruption.30(*)
Notons que la décentralisation se distingue de la
déconcentration qui est le système dans lequel la décision
pour la solution des affaires locales demeurées centralisées, est
remise aux agents du pouvoir central se trouvant sur place que constituent les
préfets.
Selon Sébahara, (2000)31(*) « la déconcentration est une
technique administrative de délocalisation de la gestion consistant
à transférer aux représentants de l'Etat, demeurant soumis
à l'autorité hiérarchique centrale, le pouvoir de prendre
certaines décisions ». La déconcentration facilite le
dialogue avec les autorités locales et situe la pratique de la
décentralisation au niveau décisionnel adéquat.
Au Bénin, la déconcentration est perçue
comme un volet de la réforme de l'administration territoriale qui
consiste à :
· la mise en place de 12 départements en tant que
seules circonscriptions administratives de l'Etat sans personnalité
juridique ni autonomie financière;
· la nomination des préfets comme chefs de
département en conseil des ministres et le renforcement des pouvoirs du
préfet en tant qu'autorité déconcentrée.
Tableau I : Structuration
de l'Etat décentralisé
|
Structures
|
Nombre
|
Statut
|
Autorités
|
Mode de désignation
|
|
Département
|
12
|
Circonscription administrative
|
Préfet
|
Nomination par le conseil des ministres
|
|
Commune (ancienne sous-préfecture)
|
77
|
Collectivité territoriale décentralisée
|
Maire
|
Election parmi les conseillers communaux par ses pairs
|
|
Arrondissement (ancienne Commune)
|
546
|
Unité administrative locale
|
Chef d'arrondissement
|
Election parmi les conseillers communaux par ses pairs
|
|
Village/ quartier de ville
|
3628
|
Unité administrative locale
|
Chef de village ou de quartier
|
Election en 1990 parmi les délégués de
village/quartier par ses pairs
|
Source : Les premiers pas des
Communes au Bénin (2005)
Le développement
local : Le développement local qui se
révèle aujourd'hui comme un enjeu fondamental de la
réforme de l'administration territoriale, est un concept apparu en
milieu rural européen dans les années 1970. Il fait suite aux
différentes volontés de gestion de terroirs en réaction
aux risques de désertification économique, démographique
et sociale des régions défavorisées par les mutations
économiques et le développement des pôles industriels
urbains. Son usage est récent en Afrique.
Lors des Etats Généraux des pays tenus à
Mâcon (France) en juin 1982, le développement local a
été défini comme « un mouvement culturel,
économique, social qui tend à augmenter le bien être d'une
société. Il doit commencer au niveau local et se propager au
niveau supérieur. Il doit valoriser les ressources d'un territoire par
et pour les groupes qui occupent ce territoire »
Selon Guigou, (1984)32(*), le « développement local est
l'expression de la solidarité locale créatrice de nouvelles
relations sociales et manifeste la volonté des habitants d'une
microrégion à valoriser les richesses locales, ce qui est
créateur de développement économique ».
Pour Greffe, (1984)33(*) le développement local est « un
processus de diversification et d'enrichissement des activités
économiques et sociales sur un territoire, à partir de la
mobilisation et de la coordination de ses ressources et de ses énergies.
Il met en cause l'existence d'un projet de développement
intégrant ses composantes économiques ; sociales et
culturelles ».
Selon Pecqueur, (1989)34(*) le développement local est « une
dynamique qui met en évidence l'efficacité des relations non
exclusivement marchandes entre les hommes pour valoriser les richesses dont ils
disposent».
Ce concept a été aussi abordé par les
participants au colloque du Cameroun sur le Développement local et la
gestion des ressources naturelles organisées à Douala. Selon eux,
le développement local peut se définir comme un processus qui
vise à construire un mieux être des populations à
l'intérieur d'un espace donné, avec une approche où
différents acteurs se rencontrent, échangent et édifient
ensemble un projet de société. Ainsi, à travers ces
définitions, nous pouvons identifier deux composantes essentielles du
développement local.
v Une composante économique
Le développement local est une réponse
à la crise structurelle qui affecte en particulier les pays
industrialisés. La crise est alors considérée comme une
décomposition et une recomposition des systèmes productifs.
Le développement local met l'accent sur l'initiative
et la créativité, le rôle des petites et moyennes
entreprises-industries, des sociétés et coopératives de
tout genre. Ces différentes formes d'organisations offrent une meilleure
résistance à la crise grâce à leur grande souplesse
d'adaptation et d'innovation.
Elles peuvent donc s'adapter à la diversité des
marchés et des circuits d'échange. Les entreprises de petites
tailles offrent un milieu favorable aux transformations des modes
d'organisation du travail au sein de la société ; c'est
l'idée de la conquête de l'outil de travail, de la
réappropriation et l'exploitation des richesses locales. La population
locale, menacée d'appauvrissement se met à créer
collectivement.
Ainsi, en faisant jouer un rôle essentiel à la
création et à l'offre plutôt qu'à la demande, le
développement local doit conduire à une transformation profonde
de l'économie appropriée conceptualisée.
v Une composante culturelle
Teisserence, P. (1998), dans Les politiques de
développement, soutient que le développement local d'un
territoire fait appel à d'autres données qu'à des
éléments purement économiques. La dimension culturelle y
est prépondérante, et son influence est énorme. Il s'agit
d'apprécier les besoins des populations pour apporter des
réponses ayant une incidence sur le plan économique.
En effet, le développement local est d'abord social et
culturel : il repose sur diverses formes d'animation, de formation et
d'information afin de susciter la participation et l'imagination des acteurs
locaux. L'objectif est de rendre les groupes sociaux conscients, responsables,
solidaires et agissants. C'est la prise de conscience qui aidera à
suivre ou à mieux suivre, au lieu de tout attendre de l'Etat ou de
l'extérieur. Les réponses les plus adaptées sont à
rechercher dans les ressources et les cultures locales. C'est pourquoi, il est
impérieux que, dans une situation de destruction de tissu social et
économique, des potentialités et des savoir-faires
inexploités apparaissent, de même que les traditions
tombées dans l'oubli.
De toutes ses définitions, nous pouvons retenir que
le développement local met l'accent sur le développement social,
économique et culturel d'un territoire donné. En
considérant les Communes comme cadre de développement local, il
est l'ensemble des actes posés par la population, les élus et les
acteurs extérieurs concourant à la prospérité, au
progrès et à l'épanouissement des citoyens à
travers :
- La satisfaction graduelle des besoins minima par la mise en
place et l'équipement progressif des infrastructures
socio-communautaires en matière de santé, d'éducation, de
production, d'échanges commerciaux et de culture.
- Le développement économique par la promotion
des initiatives entreprenariales, les innovations technologiques et la
valorisation des potentialités existantes dans le sens de gérer
des emplois et des biens économiques.
5- DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
5.1- Cadre de l'étude
Située au centre du Bénin dans le
département du Zou à 130 km des berges de l'Océan
Atlantique et de Cotonou, la ville d'Abomey peut faire rallier le Togo à
l'Ouest, le Nigeria à l'Est, le Niger et le Burkina-Faso au Nord. Elle
est située sur un plateau à 200m environ d'altitude et jouit d'un
climat subéquatorial humide, d'une végétation
constituée de forêts et de savanes. Abomey est limitée au
Nord par la Commune de Djidja, au Sud par Agbangnizoun. A l'Est et à
l'Ouest, elle partage respectivement ses frontières avec Bohicon et
Aplahoué. Elle couvre une superficie de 142km² avec une population
de 78.341 habitants selon le troisième Recensement Général
de la Population et de l'Habitat conduit par l'INSAE en 2002 ; soit une
densité de 552 habitants au km². La population d'Abomey est
constituée en majorité de fon (95%), Adja (2%). En dépit
de la prolifération des religions, celles traditionnelles demeurent les
plus importantes (67% contre 0,9% pour le catholicisme).
Sur le plan administratif, Abomey compte
sept (07) arrondissements, 29 villages et quartiers de ville. Ses
différents arrondissements sont : Djègbé, Hounli,
Vidolé, Agbokpa, Détohou, Sèhoun, Zounzonmè.
Au plan économique, la ville d'Abomey
dispose de sept (07) marchés quotidiens, de deux (02) marchés
périodiques dont un régional.
Les potentialités de la Commune sont essentiellement
agricoles avec une production annuelle de 6.513.000 tonnes. Les ressources
animales (bovins, ovins, caprins, porcins) atteignent 21.144.000 têtes
pour une valeur de 519.080.500FCFA (LARES 2001)
Les autres potentialités concernent les produits
d'exportation (Mais, arachide, coton), les ressources minières telles
que la carrière du sable, gravier et latérite, les eaux
souterraines de Codji-Adjaho, l'argile, le marbre, la filière "afintin"
(moutarde) et le tourisme qui a drainé en 2004 plus de 17.000 touristes
nationaux et étrangers sur le sol d'Abomey (DDCAT/Zou /Colline 2005).
Au plan touristique, le répertoire du
patrimoine culturel et cultuel de la Commune d'Abomey présente une
multitude de curiosités parmi lesquelles nous pouvons citer entre
autres :
· Le site des palais royaux publics qui couvre une
superficie de 44 ha et qui abrite aujourd'hui le Musée historique
d'Abomey classé au Patrimoine culturel mondial par l'UNESCO depuis
1985. On y découvre : la case à étage du Roi
Guézo (Singbo), la cour extérieure (Kpododji), la
case-fétiche du Roi Guézo (Boho), la salle des armes
(Adanjèho), le temple du Roi Glèlè (Glèlè
jèho), le village artisanal, lieu où le visiteur pourra
s'approvisionner en objets d'art de toute qualité ;
· Les sites des palais royaux privés qui sont
environ une dizaine et constituent des lieux où les princes
héritiers apprennent l'exercice du pouvoir avant d'accéder au
trône. Ce sont entre autres Gbindo, Djimè,
Aglingonmè, etc ;
· Les marchés publics : ils sont
environ cinq dans la Commune avec chacun son histoire et sa
spécificité. Parmi ce marchés figure celui de Houndjro
qui est le plus grand et qui a été créé par le
Roi Guézo entre 1830-1832 comme butin d'une guerre de
conquête ;
· La place Goho, lieu de rencontre entre le Roi
Béhanzin et le Général Dodds lors de la déportation
en 1894. C'est également le lieu de la proclamation du Marxisme
Léninisme le 30 Novembre 1974 par le gouvernement militaire
révolutionnaire du Bénin. La place abrite depuis lors la statue
du Roi Béhanzin ;
Photo
n°1 : Place Goho à l'entrée d'Abomey

Source :
Cliché LAO A., 14-12-2007
· La place Ayidjosso, située actuellement
à l'intérieur du Lycée Houffon d'Abomey et qui traduit la
stratégie de peuplement du territoire d'Abomey. Elle aurait
été installée par le Roi Guézo, qui suite à
une de ses victoires en pays Mahi aurait fait ramener avec des captifs des
morceaux de granites ; lesquelles auraient servi à enterrer sous
les pierres, le chef de village vaincu afin que les prisonniers viennent s'y
prosterner et oublier leur origine pour ne plus tenter d'y retourner ;
Photo
n°2 : Emblème du Roi Guézo d'Abomey
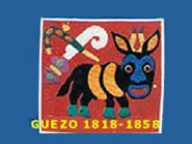
Source :
Cliché LAO A., 14-12-2007
· Le cimetière français qui abrite
la dépouille des soldats français ayant perdu leur vie au front
lors de la guerre de résistance avec l'armée
danhoméenne.
· Les abris souterrains du Didonou qui servaient
de refuge aux citoyens du royaume lors des guerres ;
· Les prisons et lieux de regroupement : ce
sont des places qui reçoivent à la fois des prisonniers de
guerre, les exclaves avant leur départ sur Ouidah ; la maison
Houinato à Hounli est l'une de ses places créées par le
Roi Agadja et réaménagées par Guézo ;
· Ahouangblétinsa
(kpètèkpa- Détohou) : place où Béhanzin
aurait décrété l'arrêt des hostilités
franco-dahoméennes et pris l'historique décision de rencontrer le
président français ;
· La place Ayivèdji à
Agblomè-Leby qui rappelle la dernière escale du Roi
Béhanzin sur la route de la rédition.
A tous ces attraits, nous pouvons ajouter les danses, rythmes
et chansons du Danxomè ainsi que les temples de Vodoun et lieu
sacrés tels que Zomadonou, Kpélu, Tolègba, Aizan
etc. ce sont des lieux d'initiation, de cérémonie rituelles
annuelles et de prières. Ces places sont chacune
spécialisées.
Photo n°
3 : Danse traditionnelle "Houissodji"35(*) à Abomey

Source :
Cliché LAO A., 14-12-2007
Photo n°
4 : L'art chez les Yèmadjè d'Abomey

Source :
Cliché LAO A., 14-12-2007
5. 2- Nature de l'étude
L'entretien, mode particulier de communication ou
échange verbal entre le chercheur et son interlocuteur permet de
recueillir des données, des idées, des attitudes, des
préférences, des sentiments et attentes relatifs à la
question de recherche en vue d'une étude qualitative. Le
développement d'Abomey, devenant de plus en plus préoccupant,
cette étude a été essentiellement basée sur une
approche qualitative à travers des entretiens avec des personnes
ressources. Cette approche a été appuyée par quelques
données de type quantitatif en vue d'une meilleure appréciation
de l'utilité du festival de Danxomè dans la Commune.
5. 3- Durée de l'étude
La présente étude comporte deux grandes
articulations : l'exploration documentaire et le travail de terrain
· L'exploration documentaire
Elle a activement commencé le 5 mai 2007 et s'est
déroulée de façon continue durant toute la
rédaction du mémoire. Elle n'est donc terminée
qu'après ladite rédaction le 10 juin 2008. Les différents
centres de documentation parcourus dans ce cadre sont : le centre de
documentation de la FLASH, ceux de l'Office du Tourisme d'Abomey et
Région du Ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme
(MCAT). La bibliothèque centrale de l'Université d'Abomey-Calavi
ainsi que le Centre Culturel Français ont été
également parcourus. Les différents documents visités dans
ces centres sont ceux relatifs aux manifestations culturelles et leurs impacts
socio-économiques.
· Le travail de terrain
Le travail de terrain a été fait en deux
temps
- La pré-enquête
C'est la phase de l'exploration et des entretiens
préliminaires. Elle s'est déroulée du 14 au 23
décembre 2007, période de l'organisation de la
5ème édition du festival. L'objectif était de
savoir comment s'y prendre pour avoir une certaine qualité de
l'information, comment explorer le terrain pour concevoir la
problématique et de mieux circonscrire le sujet. A cet effet, des
entretiens exploratoires ont eu lieu avec certaines personnes ressources
impliquées dans l'organisation du festival. Ce travail a conduit
à une bonne reformulation de la question de départ et une
définition claire des objectifs et hypothèses.
- L'enquête proprement dite
Elle s'est déroulée au lendemain des
dernières élections municipales et communales et donc du 25 avril
2008 au 10 mai 2008. Cette période a été choisie car elle
se présente comme l'heure du bilan de la première mandature des
conseillers communaux. Plusieurs informations ont été
collectées à cette étape et ont permis d'évaluer et
de mieux apprécier l'impact du festival sur la commune d'Abomey.
5. 4- Groupes cibles et échantillonnage
5.4-1- Groupes cibles
Ne pouvant étendre l'étude de terrain sur toute
la Commune d'Abomey qui compte 7 arrondissements, nous avons choisi de la mener
dans les arrondissements de Vidolé, Djègbé et Agbokpa. Ce
choix s'explique par le fait que ces trois arrondissements abritent la
quasi-totalité des manifestations du festival. La méthode
raisonnée nous a permis d'identifier certaines catégories
d'acteurs dont les cas de figure se présentent comme suit :
- les autorités communales : ce sont elles qui
organisent le festival et maîtrisent au mieux son utilité.
L'entretient avec ces dernières aura comme conséquence une
meilleure compréhension les différents enjeux du festival.
- Les autorités de la Direction départementale
de la culture de l'artisanat et du tourisme (DDCAT Zou/Collines) : la
DDCAT étant le démembrement du Ministère en charge de la
culture et du tourisme, il est normal dans le cadre de cette étude,
qu'on se rapproche de ces autorités pour recueillir leur point de vue
sur la question. L'entretien avec ces autorités renseignera sur
l'utilité du festival et les défis à relever pour sa
meilleure contribution au développement de la commune.
- les autorités coutumières : c'est
l'ensemble constitué de rois, chefs de collectivités, sages et
notables etc. On ne saurait parler de la chose culturelle sans faire recours
à ces gardiens de la tradition. L'entretien avec les autorités
coutumières éclairera sur les multiples richesses à
valoriser en vue d'attirer plus de touristes et l'impact socio-culturel et
économique du festival.
- les populations locales et opérateurs
économiques : c'est l'ensemble constitué de
propriétaires d'hôtels ou de restaurants, artisans,
commerçants, et autres. Cette catégorie d'acteurs se
présente pour nous comme « groupe témoin »
car étant les premiers bénéficiaires pouvant ressentir les
effets du festival. L'entretien avec ces derniers permettra de mieux
apprécier la contribution du festival au développement de la
Commune.
5.4-2- Echantillonnage
Compte tenu de l'importance du sujet et de la
diversité des acteurs, nous n'avons pas d'avance défini la taille
de l'échantillon. L'échantillon s'est constitué par la
technique de « boule de neige ». Cette technique consiste
à constituer l'échantillon en demandant à quelques
informateurs (clés) de départ de fournir des noms d'individus
pouvant faire partie de l'échantillon. Sa taille s'est dons
précisée par saturation des informations recueillies. Ainsi,
l'importance numérique de chacun des acteurs identifiés
diffère selon le nombre et les variables à mesurer. La taille de
l'échantillon varie donc d'un groupe cible à un autre comme
l'indique le tableau ci-après
Tableau II: Répartition des
enquêtés par statut
|
Groupes cibles
|
Nombre
|
|
Autorités communales
|
2
|
|
Autorités de la DDCAT / Zou-Collines
|
1
|
|
Autorités coutumières
|
30
|
|
Opérateurs économiques
|
21
|
|
Populations locales
|
54
|
|
TOTAL
|
108
|
Source : Enquêtes
présente étude (2008)
5. 5- Collecte et analyse des données
5.5-1- Les techniques et outils de collecte
des données
Pour collecter les données nous avons eu recourt
à trois différentes techniques : l'exploration documentaire,
l'enquête par questionnaire, l'entretien
· l'exploration documentaire : elle nous a conduit
dans les bibliothèques, les centres de documentation ;
· l'enquête par questionnaire : un
questionnaire a été conçu et administré aux
populations locales et opérateurs économiques ;
· l'entretien : les autorités locales et
administratives ainsi que les autorités coutumières ont
été soumises à l'entretien. L'entretien utilisé est
l'entretien semi-directif. Cela a permis d'offrir une grande liberté
d'expression à ces différentes autorités et aussi de les
ramener dans le sujet chaque fois qu'elles s'en éloignent. L'outil
utilisé est le guide d'entretien.
Ces différentes techniques ont
permis de recueillir diverses informations inhérentes au festival et son
impact sur la Commune.
5-5-2- Instruments de traitement et d'analyse des
données
Les données collectées ont fait l'objet d'un
dépouillement informatique et ont été traitées
grâce aux logiciels SPSS-Windows et Excel. Ce traitement a
consisté dans un premier temps à une transcription des
données empiriques recueillies sur le terrain et dans un second temps
à faire ressortir par une analyse descriptive les corrélations
et les interactions des différentes variables.
5. 6- Chronogramme
Tableau III : Chronogramme de
la recherche
|
Période
|
Activités
|
|
5 Mai 2007 au 10 Juin 2008
|
Recherche documentaire
|
|
14 au 23 décembre 2007
|
Entretiens préliminaires
|
|
12 au 20 janvier 2008
|
Elaboration et test des outils
|
|
25 avril 2008 au 10 mai 2008
|
Collecte des données
|
|
15 Mai 2008 au 10 Juin 2008
|
Dépouillement, traitement et analyse des
données
|
Source : Présente
étude (2008)
5. 7- Difficultés rencontrées
La première difficulté est relative à la
recherche documentaire. En effet, le festival du Danxomè étant
une innovation, nous n'avons pas bénéficié en la
matière d'une florissante littérature en l'occurrence sur son
apport au développement de la Commune.
La deuxième difficulté concerne
l'indisponibilité des autorités locales et communales. La
collecte des données s'est faite au lendemain des dernières
élections communales et municipales, ce qui a eu comme
conséquence l'indisponibilité des conseillers communaux qui
étaient dans les tractations pour l'élection du maire et des
chefs d'arrondissement. La demande d'audience adressée au Maire et
à son adjoint est restée sans suite jusqu'à la fin de
notre séjour sur le terrain. Cela nous a valu moultes navettes à
la Mairie. Nous nous sommes vu dans l'obligation de nous contenter des
entretiens avec le Chef d'arrondissement de Vidolé et le coordonnateur
adjoint du festival qui est un cadre de la Mairie.
Par ailleurs, la crise qui secoue la famille royale a
été un grand handicap pour la collecte des informations
auprès des autorités coutumières qui nous prenaient pour
des espions envoyés par le camp adverse. Bien que nous ayons une
autorisation de recherche délivrée par le département de
Sociologie-Anthropologie, il nous a fallu plusieurs explications avant de
gagner quelque peu la confiance de certaines autorités
coutumières. D'aucuns se sont refusés de se prononcer sur
certaines de nos questions et nous interdisaient aussi de prendre notes. Ce qui
nous oblige à nous contenter d'une simple synthèse à la
fin de l'entretien.
Les populations et opérateurs économiques,
quant à eux, sont réticents à nous livrer les informations
surtout celles relatives à leurs chiffres d'affaire.
Cependant, toutes ces difficultés ne nous ont nullement
empêché de mener à bien nos enquêtes qui ont
duré du 25 avril au 10 mai 2008.
PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
En nous fondant sur le postulat que le festival du
Danxomè est une réponse aux multiples défis de
l'auto-développement dans la Commune d'Abomey, nous avons entrepris une
recherche. L'objectif était d'appréhender l'utilité dudit
festival dans la problématique du développement de cette Commune.
Pour atteindre cet objectif, nous avons suivi la démarche
méthodologique combinant aussi bien la méthode qualitative
(entretien), celle quantitative (questionnaire) et l'exploration documentaire.
Toutes ces méthodes nous ont permis de cibler plusieurs
catégories d'acteurs directs et indirects du Festival du Danxomè.
L'essentiel des informations recherchées a été obtenu et
les résultats feront l'objet de notre analyse. Elle éclaire
d'abord sur l'utilité du festival, ensuite son impact sur la commune
avant de présenter ses limites qui déboucheront propositions et
suggestions.
1- UTILITÉ DE L'ORGANISATION DU
FESTIVAL DE DANXOMÈ
Les données recueillies sur le terrain
révèlent que la quasi-totalité des personnes
interrogées sont conscientes de la nécessité de la
revalorisation du patrimoine culturel à Abomey comme l'indique la figure
suivante :
Figure 1 :
Répartition des acteurs selon leur opinion sur l'importance du festival
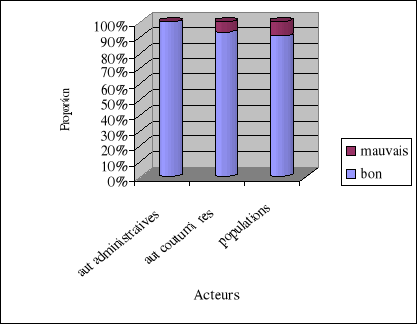
Source :
Résultats enquêtes présente étude (2008)
L'analyse de cette figure indique que toutes les
autorités administratives rencontrées jugent indispensable
l'organisation du festival de Danxomè à Abomey. Cela est
évident puisqu'elles sont les initiatrices de ladite manifestation. A en
croire ces autorités, seule la revalorisation du patrimoine culturel et
cultuel peut sortir cette Commune de son état de pauvreté
avancée. En effet, la Commune d'Abomey, contrairement à la
Commune soeur de Bohicon, ne dispose pas d'usines pouvant lui permettre de
percevoir de taxes sur son territoire. La seule ressource dont elle dispose est
le Musée historique d'Abomey qui est encore déclaré
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO et exclusivement
géré par la DDCAT / Zou-Collines. Par ailleurs, en dépit
de son statut de capitale historique, Abomey n'a pas pu
bénéficié par le passé d'une attention
particulière de l'Etat pour le développement du secteur
touristique à travers la réhabilitation ou l'aménagement
des sites. Sur les 47 hectares qu'occupe le site des palais royaux, seulement 4
hectares ont été aménagés et visités
aujourd'hui par les touristes. De plus, le tissu social est fragilisé,
la famille royale divisée. Il fallait alors une politique culturelle
pour faire venir plus de touristes afin d'augmenter les recettes de la Commune
et celles des populations. Cela offrira aussi un cadre de retrouvailles des
filles et fils d'Abomey pour la reconstitution du tissu social. Ce sont autant
de raisons qui justifient l'organisation du Festival du Danxomè
autorisé lors de la première session du conseil communal du 11
Avril 2003, une idée déjà énoncée dans le
Plan de Développement Communal (PDC) de la Commune d'Abomey
élaboré par le PADECOM en 2002.
Dans le rang des autorités coutumières, la
majorité des personnes interrogées
(93,34 %) trouvent le Festival utile pour le
développement de la Commune en cette période où la culture
constitue le levier du développement. Pour ces dernières,
à travers ce festival, c'est la culture du Danxomè qui est mise
sous les feux de la rampe. Si rien n'était fait dans ce sens, Abomey
courrait le risque de perte de son identité. Cette revalorisation permet
une lecture plus juste et impartiale de l'histoire du Danxomè.
Quant aux populations locales enquêtées
composées de restaurateurs, propriétaires d'hôtels,
artisans et commerçants ..., 90,9 % ont répondu par l'affirmative
à la question relative à la contribution du festival au
développement culturel de la ville d'Abomey.
L'analyse de ces chiffres montre que le festival a reçu
l'assentiment des populations de la Commune d'Abomey, du moins pour son apport
au rayonnement et au développement culturel. Ce qui laisse augurer d'un
lendemain meilleur pour cette manifestation. En effet, la revalorisation du
patrimoine culturel à travers le festival du Danxomè pourrait
constituer une porte de sortie de la pauvreté de la ville d'Abomey. Le
tourisme occupant aujourd'hui une place importante en matière de
rentrée de devises au Bénin, cette manifestation apparaît
comme un instrument privilégié pour la réduction de la
pauvreté dans la localité. Autrement dit, l'apport du tourisme
à la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté
sera d'autant plus efficace que trois conditions pourraient être remplies
à savoir : engendrer des revenus, engendrer un développement
durable, faire parvenir ces ressources aux plus démunis. Une meilleure
politique du développement du secteur touristique s'avère donc
indispensable dans cette Commune aux atouts culturels et touristiques
indéniables.
2- IMPACTS DU FESTIVAL SUR LA
COMMUNE
2.1- Impact économique du festival sur les
populations et la mairie d'Abomey
2.1-1- Sur les populations locales
L'objectif fondamental de l'organisation du festival de
Danxomè est de promouvoir l'image de la ville d'Abomey à travers
son patrimoine culturel et artistique en vue d'attirer plus de touristes. Or,
qui parle de tourisme parle d'arrivée d'étrangers qui vont passer
des nuits dans les hôtels, faire des achats, visiter les sites et donc de
rentrée de devises pour la Commune. Pour les autorités
administratives, la ville d'Abomey accueille pendant la période du
festival qui dure en moyenne dix (10) jours, une variété de
touristes (nationaux et internationaux). Cette période se
présente comme une opportunité où les populations font de
bonnes affaires. Elles affirment par ailleurs, qu'on constate depuis la
première édition du festival une fréquentation plus accrue
des différents sites touristiques. Pour ces autorités (100 %), le
festival a largement contribué à l'amélioration des
recettes des opérateurs économiques et des populations en
général. Ces propos du Chef Service Artisanat, Tourisme et
Hôtellerie de la DDCAT/ Zou-Collines, membre du comité
d'organisation du festival « je me souviens qu'au cours d'un
festival, je m'étais retrouvé à Bohicon où je
n'avais pas trouvé de? lio?36(*) à acheter, notre ?
lio? qui traine au bord des voies, il n'y en avait pas à
Abomey, nous n'en n'avons pas trouvé à Bohicon. Cela veut dire
que les dames ont fait plus d'affaires que par les temps
ordinaires » témoignent de ce que l'organisation de ce
festival profite indubitablement aux populations au moins pour les dix jours
que dure cette manifestation.
Mais quand on se rapproche des populations, on remarque que
les réponses sont divergentes. En effet, près de 80 % des
personnes interrogées dans cette catégorie d'acteurs ont
laissé comprendre qu'elles n'ont pas constaté depuis
l'organisation de ce festival une amélioration proprement dite de leurs
recettes. A en croire certaines personnes (30 %) de ce groupe, seule la
première édition a mobilisé du monde et elles ont pu faire
un peu plus d'affaire. Les autres éditions n'ont pas connu cette
affluence et n'ont pas de ce fait contribué à l'augmentation de
leur chiffre d'affaires. Par contre, les 50% des enquêtés restant
de ce groupe ont affirmé qu'ils remarquent à toutes les
éditions du festival, une légère augmentation de leur
chiffre d'affaires. Seulement cet accroissement n'est pas continu et prend
automatiquement fin à la clôture des manifestations. 20 % de cette
catégorie d'acteurs nous ont confié qu'elles ont remarqué
depuis l'organisation du festival une augmentation de leurs revenus variant
entre 1 et 25%.
De l'analyse de ces chiffres, il ressort que cette
manifestation ne produit pas encore l'effet escompté du point de vue de
sa rentabilité pour les populations, du moins selon leurs avis. Mais
à y voir de près, l'on pourrait comprendre que le festival fait
son petit bonhomme de chemin. En effet, 20% de cette catégorie de
bénéficiaires ont déclaré avoir constaté un
accroissement de leur chiffre d'affaires depuis l'organisation du festival. Ce
taux relativement faible n'est pas négligeable si l'on s'en tient au
fait que le festival est une innovation qui n'est qu'à sa
5ème édition et qui éprouve, à l'instar
de toute entreprise à ses débuts, des difficultés pour
émerger. De plus, la moitié des personnes interrogées
parmi les populations ont néanmoins reconnu que la période des
festivités constitue une opportunité pour faire de bonnes
affaires. Il va donc sans dire que le festival même s'il ne constitue pas
encore le socle du développement économique de cette Commune,
n'en demeure pas moins un facteur essentiel de ce développement.
Il convient aussi de rappeler que l'objectif premier du
festival est de promouvoir le tourisme. Or, le tourisme est une
activité saisonnière ; une activité qui se planifie.
C'est ce qui justifie la présence des touristes dans certaines
périodes que dans d'autres. Ces derniers se déplacent surtout
pendant les vacances, les congés, ou la période des fêtes.
La preuve est que la majorité des personnes interrogées au sein
de la population nous ont confié que leurs recettes augmentent dans les
mois d'Avril (congés de pâques), juillet, août, septembre
(vacances) et en décembre à l'approche des fêtes,
période du festival. La figure 2 fait le point de l'évolution
moyenne de leur chiffre d'affaires des personnes enquêtées. Le but
de tout artisan, de tout commerçant ou de tout opérateur
économique étant de faire quotidiennement de bonnes affaires, on
comprend pourquoi les populations ne sont pas alors totalement satisfaites de
l'organisation de cette manifestation qui selon elles, doit tout le temps
mobiliser les touristes pour que leurs recettes soient à plein temps
améliorées. Aussi les dernières éditions ont
manqué de publicité puisque les deux premières
éditions ont entraîné de lourdes pertes pour la mairie. Il
fallait alors prévoir, pour reprendre les propos du coordonnateur
adjoint du festival un budget réaliste puisque les partenaires et
sponsors n'honorent pas toujours à leur engagement. Il est aussi
important de signaler que les populations ne sont pas toujours sincères
dans leurs déclarations surtout quand il s'agit des informations
relatives à leur chiffre d'affaires. Cette insincérité
pourrait aussi biaiser les chiffres qu'ils nous ont avancés.
Tableau IV :
Statistiques de l'évolution moyenne du chiffre d'affaire des
populations et opérateurs économiques tout au long de
l'année
|
Période
|
Moyenne
(en %)
|
|
Décembre
|
20,83
|
|
Janvier
|
16,54
|
|
Février
|
7,02
|
|
Mars
|
2,14
|
|
Avril
|
9,4
|
|
Mai
|
0,42
|
|
Juin
|
3,33
|
|
Juillet
|
14,4
|
|
Août
|
15,11
|
|
Septembre
|
14,88
|
|
Octobre
|
3,85
|
|
Novembre
|
3,66
|
Source :
Enquêtes présente étude (2008)
Figure 2 : Evolution moyenne du
chiffre d'affaires des populations tout au long de l'année
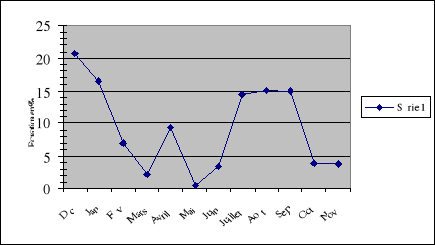
Source : Résultats
enquêtes présente étude (2008)
2.1-2- Sur la mairie
L'impact économique du festival sur la mairie est aussi
positif que négatif. En effet les deux premières éditions
ont respectivement entraîné une perte de 32 millions et 30millions
pour la mairie. Selon les déclarations du coordonnateur adjoint du
festival, la mairie a fait à la première édition une
recette de 12 millions contre une dépense de 44 millions. Cet
état de choses n'est que le résultat de l'élaboration d'un
budget ambitieux, de la non tenue des promesses des partenaires et bailleurs et
de l'inconsistance de l'aide de l'Etat.
Selon les autorités de la mairie d'Abomey, les premiers
bénéficiaires sont les opérateurs économiques et
les populations car l'arrivée des touristes augmente leurs recettes. La
mairie trouve indirectement son compte à travers le paiement des
impôts. Le conseil communal a aussi instauré une taxe de 1000 FCFA
par touriste au musée et cette somme est directement versée
à la recette perception qui se trouve être la banque de la
Commune. Il y a aussi des manifestations telles que les soirées
théâtrales, les concerts, l'élection de la ?Nan? etc. qui
engendrent de revenus à la mairie. De plus, le renforcement de la
coopération décentralisée et les aides des
différents partenaires sont d'une importance capitale dans le
développement de la Commune en général et son essor
économique en particulier. L'analyse de toutes ces données montre
que l'impact économique du festival pour la mairie est certain. Pour
preuve, comme l'indique le tableau V, la moitié des personnes
enquêtées dans le rang des populations pensent que le festival
génère de l'argent à la mairie. Les sources de revenus
pour la mairie selon ces populations sont entre autres : les locations de
stands aux artisans, les théâtres et concerts, les aides des
bailleurs et partenaires etc. Le festival n'est peut-être pas à sa
vitesse de croisière du point de vue de rentabilité, mais cela
n'est qu'une question de temps.
Tableau V :
Répartition des populations selon que le festival est
source ou non de revenus pour la Mairie
|
Opinions
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
|
Oui
|
38
|
50 %
|
|
Non
|
33
|
44 %
|
|
Aucune idée
|
4
|
6 %
|
Source :
Enquêtes présente étude (2008)
Figure 3 :
Répartition des populations selon que le festival engendre ou non des
revenus pour la mairie
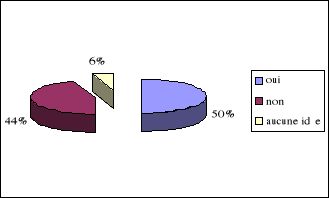
Source : Résultats
enquêtes présente étude (2008)
2. 2- Impact du festival au plan
social
Au plan social, les points de vue des différentes
catégories d'acteurs ciblées sont divergents. En effet, selon les
déclarations des autorités administratives, le festival a
beaucoup apporté au plan social. Pour ces dernières le festival
est un creuset de retrouvailles de filles et fils d'Abomey pour
réfléchir sur l'avenir de la ville. C'est une fête qui
rassemble tous les Agbomè-nou (ressortissants d'Abomey), toutes les
forces politiques de la Commune, au moins à l'ouverture. Cela permet aux
Aboméens, et aux Fons en général de partager le sentiment
d'appartenir à une même sphère culturelle.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler la scission qui
règne au sein de la famille royale depuis un certain moment avec
l'avènement de deux rois. C'est à la première
édition que les deux Rois Houédogni BEHANZIN et Dédjalagni
AGOLI-AGBO se sont retrouvés sur l'esplanade du musée et se sont
embrassés pour la première fois. Ainsi, avec le festival, un
début de dénouement de la crise royale est amorcé. Si la
politique ne s'en était pas mêlée, on parvenait
déjà, selon les autorités communales, à une
solution à la crise qui secoue la cour royale depuis plus d'une
décennie.
Pour les autorités coutumières
enquêtées (100%), le festival, de part sa politisation n'a fait
que fragiliser les relations et aggraver la crise qui secoue la famille royale.
Ces déclarations du roi Houédogni BEHANZIN « le
festival a été initié pour faire la promotion de
Dédjalagni AGOLI-AGBO et l'installer comme roi d'Abomey »
illustrent à plus d'un titre cette dégradation du tissu
social à Abomey. Selon ces autorités, cette politisation a comme
corollaire toutes les tensions observées au plan social. La mise en
quarantaine des partisans des formations politiques n'ayant pas la
majorité au sein du conseil communal de l'organisation, crée
indubitablement de mécontents, entraîne la désunion des
fils d'Abomey provoquant ainsi le déchirement du tissu social.
Quant aux populations prises comme groupe-cible
témoin, 77,3% des personnes interrogées ont affirmé que le
festival a beaucoup apporté au plan social. Les exemples cités
sont entre autres, le rassemblement des fils de la ville, l'accolade des deux
rois, la prise de conscience des filles et fils d'Abomey de leur appartenance
à une même culture et de leurs liens de fraternité. Pour
les 22,7% des populations, le festival est politisé, les fils de la
Commune divisés. Cette proportion de la population pense que le festival
est encore loin de conduire à l'union des fils d'Abomey car les conflits
demeurent. L'accolade des deux rois lors du lancement des éditions du
festival n'est qu'une mise en scène pour tromper l'opinion nationale et
internationale car cette paix n'est jamais profonde. Elle n'est que
circonstancielle et situationnelle.
De l'analyse de toutes ces déclarations, il ressort
que la problématique d'union, de solidarité et de paix sociale
à Abomey reste et demeure un mythe. Cet état de choses tire son
origine du passé du Danxomè. En effet, selon plusieurs
écrits et d'autres sources orales, Béhanzin et Agoli-Agbo sont
tous deux fils du Roi Glèlè ; Béhanzin prit la
succession après le décès de leur père. Mais
pendant sa résistance aux Français, il aurait été
trahi par son frère Agoli-Agbo qui aurait indiqué aux
Français l'endroit où il se cachait ; ce qui a permis
à ces derniers de retrouver Béhanzin pour sa déportation.
Pour récompenser Agoli-Agbo, les Français l'auraient nommé
Roi d'Abomey. Cette nomination a suscité une vive polémique,
laquelle polémique a enfin de compte fini par embraser les descendants
de ces deux anciens Rois. Ce serait cette querelle que traîne la famille
royale jusqu'à présent. De plus, l'ingérence du pouvoir
politique dans la royauté et les effets du pouvoir moderne sont d'autres
sources justificatives de cette querelle. Cette situation n'est que la
conséquence de l'émergence des cadres modernes dans
l'arène politique traditionnelle.
Comme nous pouvons nous en convaincre, les contingences
socio-économiques dues à un univers fortement
monétisé, la montée en flèche de l'individualisme
et la cherté de la vie font que les sujets sont réticents
à nourrir leur Roi. Ce dernier doit se débrouiller pour vivre par
ses propres efforts. En outre, l'organisation des cérémonies
coutumières en mémoire des ancêtres royaux nécessite
désormais de gros moyens financiers et matériels. Et cela
s'impose comme un devoir incontournable auquel ne peut se soustraire celui qui
en a la charge. A ce titre, on ne peut confier cette charge qu'à une
personne fortunée. Il s'est avéré que ce sont les cadres
modernes qui sont relativement les plus nantis dans les familles et
collectivités royales. Par ailleurs, étant détenteur du
savoir moderne, ils sont considérés comme pouvant servir
d'intermédiaires entre la base traditionnelle illettrée et
l'administration bureaucratique moderne. Or, ces cadres ont une place sur la
scène politique ; on comprend alors l'incursion du pouvoir
politique dans l'arène royale. Pour Gilbert DAKPO, « le
pouvoir politique, à commencer par le pouvoir colonial jusqu'aux
pouvoirs postcoloniaux, a une part non moins déterminante dans la crise
actuelle ».37(*)
L'auteur fait le point de la crise depuis la nomination du Roi Agoli-Agbo par
le colon jusqu'à la fin du mandat de Kérékou en 2001 en
montrant l'influence du pouvoir politique moderne sur la royauté
à Abomey. Il parvient à la conclusion que « la crise du
pouvoir royal à Abomey est une crise de
modernité ».38(*) Elle provient de l'émergence de nouveaux
acteurs de la scène politique traditionnelle, les cadres modernes, et
avec eux, tous les effets de la modernité (démocratie moderne
avec son cortège de lois : pouvoir à durée
déterminée, alternance, loi de la majorité), toutes choses
inadaptées à la mentalité des Houégbadjavi
(descendants de Houégbadja).
Comme on peut le constater, être dans l'arène du
pouvoir royal aujourd'hui, offre non seulement un prestige, mais aussi et
surtout des opportunités d'une micro-entreprise de
créativités culturelles rentabilisée par les bailleurs de
fonds internationaux. En effet depuis que l'UNESCO a inscrit les palais royaux
d'Abomey au Patrimoine Mondial de l'Humanité en 1985, nul n'ignore la
valeur économique des investissements et les financements de cette
institution et beaucoup d'autres, à travers les projets de restauration
des palais royaux et d'autres à caractère culturel. Cela justifie
d'une part, l'intérêt que portent ces cadres au pouvoir royal.
D'autre part, le pouvoir royal constitue une machine électorale
potentielle, à travers laquelle les Rois peuvent manipuler les
politiciens en quête de suffrages. Ils constituent une force politique
locale susceptible d'assurer le succès d'un politicien aux
élections ou au contraire, d'entraîner son échec. Ce sont
autant de facteurs explicatifs de la crise qui constitue une gangrène au
développement de la ville d'Abomey. Le festival était
initié comme une réponse à cette crise en se fixant entre
autres comme objectif l'union des filles et fils d'Abomey. Malheureusement
l'interférence du politique et du culturel l'a désorienté
de cet objectif et au lieu d'unir, le festival n'est que source de
désunion, de jalousie et de méfiance.
Au total, si le festival permet pour la circonstance le
rassemblement des fils d'Abomey, il na pas encore réussi à
conduire à leur union. D'aucuns pensent que l'entière
responsabilité revient aux autorités communales. Pour ceux-ci, ce
sont ces autorités majoritairement membres de la Renaissance du
Bénin (RB), qui n'associent pas les autres formations politiques et
leurs partisans à l'organisation ; pour d'autres ce sont ces
formations politiques qui s'en écartent elles-mêmes, prenant le
festival comme la `'chose'' de la RB. Dans les deux cas, les autorités
communales doivent savoir s'y prendre étant donné qu'elles sont
les premières responsables du développement de la Commune. Elles
sont élues pour toute la Commune et doivent pour ce faire transcender
les divergences politiques quand il s'agit de l'avenir de la ville.
2. 3- Impact du festival au plan
politique
Les informations recueillies lors de nos enquêtes font
état de ce que le festival a permis, au plan politique le renforcement
et la consolidation de la solidarité intercommunale au niveau du plateau
d'Abomey avec la mise en place de l'Office du Tourisme d'Abomey et
Région (OT); l'un des objectifs du festival étant
l'intégration harmonieuse des évolutions socio-économiques
du département du Zou dans le processus national du Bénin. A en
croire les autorités administratives, cet office le tout premier au
Bénin, est né du partenariat public privé ; l'Etat
représenté par la Direction Départementale de la Culture
de l'Artisanat et du Tourisme, la mairie, le musée et les privés.
De plus, le festival a permis le rapprochement de la Commune d'Abomey et celle
de Porto-Novo, deux anciens royaumes liés par des relations
conflictuelles par le passé. On ne saurait passer sous silence
l'intérêt accordé par le régime actuel à la
ville d'Abomey, lequel intérêt s'est manifesté à
maintes occasions. Nous pouvons citer entre autres la tentative de
réconciliation des deux Rois, la contribution financière de
l'Etat à l'organisation du centenaire du Roi Béhanzin et aussi et
surtout celle de la 5ème édition du festival du
Danxomè qui s'élève à 35 millions. Par ailleurs, il
faut signaler que par ce biais, la Commune d'Abomey a pu entrer en partenariat
plus intéressant avec la Commune française d'Albi. De même,
les coopérations avec l'Allemagne et le Danemark se sont
fortifiées. Ces coopérations revêtent toute leur importance
quand on sait que ces pays du Nord ont une grande expérience en
matière d'organisation touristique et une bonne connaissance des pays de
provenance des touristes. Toutes ces informations montrent que le festival,
plus qu'une simple revalorisation du patrimoine culturel, est un enjeu majeur
pour la diplomatie et la coopération décentralisée.
2. 4- Impact du festival au plan
touristique
Comme l'on ne peut s'en douter, le festival a
énormement contribué au développement touristique du
plateau d'Abomey en général et de la Commune d'Abomey en
particulier. En effet, la majorité des personnes interrogées ont
reconnu la contribution du festival au développement du tourisme. Les
autorités administratives nous ont confié que c'est grâce
au festival que la place "Ayonoudjo"39(*) a été matérialisée.
Aussi, elles sont à pieds d'oeuvre pour la réhabilitation des
palais privés non habités. De plus, on peut citer la
réhabilitation du marché historique "Houndjro",
l'implantation des panneaux directionnels pour indiquer les sites, ce qui
permet une meilleure lisibilité des sites touristiques et une meilleure
compréhension des réalités culturelles. Le palais public
(Dowomè) de Béhanzin a été réhabilité
en partie (la clôture, le tombeau, le adjlala, une salle d'exposition)
sur financement japonais de même que le palais d'Akaba (son tombeau). La
route du résistant "Béhanzin" a été aussi
retracée. Il est aussi important de souligner que l'Office de Tourisme
d'Abomey et Région est le fruit de ce festival. Les populations (81,8%)
ont aussi déclaré que le festival contribue au
développement du tourisme dans la localité puisqu'elles
constatent un certain entretien et quelques aménagements de sites
touristiques. Les autorités coutumières, de leur
côté, nous ont confié que les autorités communales
essayent d'aller à leur rythme et qu'elles restent optimistes.
Toutes ces données traduisent la contribution du
festival au développement touristique dans cette Commune.
2. 5- Impact du festival sur l'environnement de la
Commune
Les points de vue relatifs à l'impact du festival sur
l'environnement diffèrent d'une catégorie d'acteurs à une
autre. En effet, selon les déclarations des autorités
administratives rencontrées, beaucoup de choses ont changé dans
la Commune. Pour ces dernières, la réhabilitation des palais
engagée a entraîné une transformation des palais en places
de fête. L'état de la Commune n'est plus comparable à celui
d'il y a une décennie. La flore est protégée, la ville
plus assainie.
Les autorités coutumières pensent par contre
que rien n'a changé au plan environnemental. Elles ont
déclaré que c'est seulement à la veille de chaque
édition qu'on assiste à un nettoyage de la ville avec des
machines.
Le tableau suivant renseigne sur les points de vue des
populations, pris comme groupe témoin sur la question relative à
l'impact du festival sur l'environnement :
Tableau VI :
Fréquence de la population selon les opinions sur la
contribution du festival au changement de l'environnement d'Abomey
|
Opinions
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
|
Beaucoup
|
41
|
54,54 %
|
|
Un peu
|
27
|
9,09 %
|
|
Rien
|
7
|
36,36 %
|
Source : Enquêtes
présente étude (2008)
Figure 4 : Répartition de la
population selon les avis sur la contribution du festival au
changement de l'environnement de la Commune 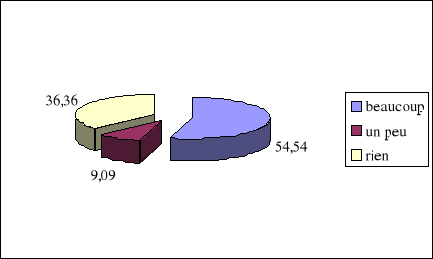
Source : Résultats
enquêtes présente étude (2008)
L'analyse de ces chiffres montre que plus de 50% des
personnes interrogées au sein de la population pensent que depuis
l'organisation du festival, l'environnement d'Abomey devient
progressivement sain. Environ 10% affirment qu'il y a un changement, seulement
elles sont peu satisfaites. Ces chiffres traduisent l'impact positif du
festival sur l'environnement de la ville, seulement ce changement demeure
insuffisant face aux défis à relever par cette Commune. Mais il
convient de reconnaitre que l'assainissement de la ville est un problème
politique que seul le festival ne saurait résoudre. L'aménagement
des différents palais par le biais du festival constitue
déjà un début de solution.
3- LES LIMITES DU FESTIVAL
Les limites sont multiples et multiformes et s'observent sur
plusieurs plans.
3. 1- Au plan organisationnel
Le comité d'organisation étant essentiellement
composé d'autorités communales, on assiste à un grand
retard dans les préparatifs du festival. Cet état de choses,
résultat du cumul des responsabilités de ces autorités, a
une conséquence fâcheuse sur la planification des
activités du festival. L'organisation d'une manifestation de cette
envergure nécessite du temps, ce qui manque à ces
autorités. Par ailleurs, l'organisation de spectacles et autres
activités pouvant générer de l'argent demande beaucoup de
professionnalisme, ce dont ne disposent pas certains membres du comité
d'organisation. Les facteurs temps et professionnalisme sont indispensables
pour le festival ; les occulter aura de sérieuses
répercussions sur cette manifestation.
3. 2- Au plan culturel
Abomey est un gisement de cultures. Selon les
déclarations des autorités coutumières, gardiens de la
tradition, plusieurs valeurs authentiques du Danxomè restent à
répertorier et revaloriser. On pourrait à titre d'exemple citer
l'absence de certaines danses des différents cantons puisque le plateau
du Danxomè est composé de plusieurs cantons et chacun a sa danse.
Le répertoire de ces danses et leur revalorisation permettront aux
jeunes générations de prendre connaissance de ces richesses.
3. 3- Au plan touristique, économique et
environnemental
Malgré que le festival soit à sa
5ème édition, beaucoup de sites restent non
aménagé ; plusieurs voies d'accès aux sites sont
toujours en état de dégradation avancée voire
impraticables. Le non aménagement de certains sites réduit la
durée de la visite du touriste si bien qu'en deux heures, pour reprendre
les propos du coordonnateur adjoint du festival, le touriste a terminé
la visite du géant royaume du Danxomè. Cet état de choses
ne permet pas de retenir les touristes dans la ville alors qu'en
réalité, exceptés les frais d'accès aux sites
aménagés, ce qui profite à la Commune reste les
nuitées. Plus le touriste passe de nuits, plus il dépense. Le
tracé de nouveaux circuits touristiques aura donc comme
conséquence, la retenue des touristes dans la ville, ce qui profitera
aux populations et opérateurs économiques et par ricochet
à la Commune d'Abomey. En outre, le festival n'est pas bien connu
à l'extérieur. Ce qui fait qu'il n'a pas encore réussi
à attirer les opérateurs économiques étrangers qui
par la mise en place de nouvelles activités, pourraient contribuer
à la création de nouveaux emplois et participer ainsi au
développement de la ville.
Par ailleurs la ville d'Abomey ne dispose pas
d'infrastructures d'accueil de luxe. Les quelques unes existantes sont objets
d'une mauvaise répartition spatiale. De plus, les promoteurs
n'investissent pas leur entreprise pour combler l'attente des étrangers
si nous empruntons les termes du Directeur de l'OT. Le manque de confort dans
les hôtels, l'insuffisance du personnel et la faible qualification
professionnelle de ceux existant sont autant de facteurs qui ne sont pas de
nature à favoriser le tourisme dans cette Commune.
L'environnement est très pollué après le
festival, il n'y a pas jusqu'à présent la mise en place d'une
structure qui pourrait nettoyer la ville à la fin du festival. Ce sont
autant de limites que les autorités communales doivent prendre en compte
pour une contribution efficace du festival au développement de la
localité.
3. 4- Au plan social et politique
L'un des objectifs que le festival s'est assigné est
un climat d'union, de paix et de développement social. Paradoxalement
cette manifestation désunit plus qu'elle n'unit. Le festival n'a pas
encore réussi à « rassembler les fils d'Abomey autour
de la jarre trouée du Roi Guézo », devise chère
au royaume du Danxomè. Le festival, à cause de sa politisation
est encore loin de conduire à l'unification des fils d'Abomey. Les
autorités communales n'ont pas encore réussi à transcender
les divergences politiciennes pour associer toutes les couches sociales quelque
soit leur âge, sexe et coloration politique à l'organisation.
Cette situation crée assez de mécontents et constitue une menace
le développement de la Commune. En outre, les rapports intercommunaux au
niveau du plateau du Danxomè demeurent fragiles. Le festival est
dénommé festival du Danxomè, or, le Danxomè ne se
limite pas à la seule ville d'Abomey. Mais les autorités
n'associent pas concrètement les autres Communes à
l'organisation. Cette situation rend les Communes réticentes. Et c'est
justement pour dissiper ces petits problèmes que le festival a
changé de nom à l'édition de 2007 et est devenu
"Fête internationale des cultures du Danxomè". Par ailleurs,
l'Office du Tourisme pose problème. On devrait avoir un Office
Intercommunal du Tourisme dirigé par les délégués
de chaque Commune, c'est l'un des principes de l'intercommunalité.
4- MATRICE DE DIAGNOSTIC
STRATÉGIQUE
En considérant Abomey comme un système dont il
faut comprendre les relations entre les divers éléments, une
approche prospective nous permettra d'appréhender d'avantage la
problématique de développement dans tous les domaines
(économique, social, politique, environnemental, culturel, technologique
et genre) dans cette Commune. Cette approche nous permet de situer cette
problématique dans trois axes temporaires que sont : le
passé, le présent et le futur afin de comprendre les
interrelations entre les différentes variables. L'impact du festival sur
la Commune étant diversement apprécié, la Matrice de
Diagnostic Stratégique, analysant les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces se présente comme suit :
Tableau VII : Matrice de
diagnostic stratégique
|
Domaines
|
Faits porteurs
|
Acteurs
|
Tendances lourdes
|
Incertitudes critiques
|
Stratégies
|
Forces
|
Faiblesses
|
Opportunités
|
Menaces
|
|
Passées
|
Présentes
|
|
Economie
|
Le tourisme
|
-Autorités communales
-opérateurs économiques
- artisans
-commerçants
-conservateurs de site
|
-Mauvaise gestion
-Corruption
-Mauvaise organisation des activités touristiques
-Non paiement des taxes
|
Gouvernance locale
|
Conservation des sites
|
-Organisation du festival du Danxomè
-Aménagement de nouveaux sites
-Réhabilitation des anciens sites
|
-Existence des sites
-Richesses culturelles
-Existence d'infrastructures d'accueil
|
- Non aménagement de plusieurs sites
- Manque d'infrastructures d'accueil de luxe
- faible qualification professionnelle du personnel
|
- Coopération décentralisée
- Partenariat
- Appui au développement local (GTZ, Danemark etc.)
|
- Les subventions
- Les emprunts
|
|
Social
|
- Reconstitution du tissu social
- Retrouvailles et rapprochement des fils d'Abomey
|
- Autorités - communales
- Autorités
-Traditionnelles
- Populations
|
- Passé du Danxomè
- Interférence du politique et du culturel
- Le pouvoir moderne
- La crise au sein de la famille royale
|
- Gouvernance locale
- Ingérence du pouvoir politique
|
|
Organisation du festival du Danxomè
|
-Conscience des populations d'appartenir à une même
culture
- Volonté de reconstruire le tissu social
|
- Fragilisation du tissu social
- Manque de solidarité
- Recherche abusif du pouvoir pour des intérêts
personnels
|
|
|
|
Politique
|
- Gestion locale concertée
- Coopération décentralisée
|
- Autorités administratives
- OSC
- Populations
- Partis politiques
- Les Communes
|
- Querelles et divisions politiques
- Détournement
- Corruption
|
- Ingérence du pouvoir politique
- Coopération
|
Délégation de pouvoir
|
- Démocratie locale
- Gestion participative
- Diplomatie offensive
- Intercommunalité
|
- Capitale historique
- Stabilité politique
- Ressources humaines
|
- Ville longtemps considérée comme ville de
l'opposition
- Insuffisance de ressources humaines
spécialisées
|
- Coopération décentralisée
-Intercommunalité
- Partenariat
|
- Les subventions
|
|
Environnemental
|
- Réhabilitation des palais
- Aménagement des sites
|
- Autorités administratives
- Etat
- Populations
|
- Absence de conscience patriotique
- Détournement
- Déboisement
- Mauvaise gestion
|
Gouvernance locale
|
Conservation des sites
|
- Sensibilisation
- Reboisement
- Aménagement des sites touristiques
- Réfection des voies
|
- Disponibilité des terres
- Statut de capitale historique
- Volonté d'assainir la ville
|
- Dégradation des voies
- Insalubrité
|
-Appui au développement local
- Les subventions
- Les partenariats
|
- Disparition des espèces
- Exportation des bois
-Réchauffement de la planète
|
|
Culturel
|
Revalorisation du patrimoine culturel
|
- Autorités administratives
- Chefs religieux
- Gardiens de la tradition
- Populations
|
- Scission de la famille royale
- Division des fils du Danxomè
|
- Gouvernance locale
- Interférence du politique et du culturel
|
Cérémonies et rituels au sein des familles ou
collectivités
|
- Organisation du festival du Danxomè
- Réapparition des grandes cérémonies
royales et leurs rituels
|
- Richesses culturelles
- Existences de ressources humaines (chefs religieux, gardiens de
la tradition, autorités coutumières)
|
Disparition de certaines valeurs authentiques
|
Brassage culturel
|
Mondialisation
Universalisme
|
|
Technologique
|
Utilisation des NTIC
|
- Opérateurs économiques
- Populations
- Autorités
Administratives
|
Analphabétisme
|
Gestion des infrastructures
|
Promotion des techniques et matériaux locaux
|
- Communication pour stimuler les investissements
- Introduction des NTIC dans l'administration
|
Existence des ressources humaines
|
- Faible capacité d'adaptation
- Insuffisance d'infrastructures technologiques sur le
marché local
- Manque de ressources humaines spécialisées
|
Ouverture sur le monde
|
- Globalisation
- Village planétaire
|
|
Genre
|
Promotion de la femme
|
- Femmes
- Autorités administratives
- OSC
|
- Analphabétisme
- Non scolarisation des filles
- Les conflits d'attribution
|
Formation des cadres
|
|
- Implication des femmes dans les prises de décision
- Eloge des amazones du Danxomè
|
Existence de femmes intellectuelles
|
- Incompétence
-Faible niveau de scolarisation des femmes
|
|
Féminisme
|
Source : Enquêtes
présente étude (2008)
5- LES DÉFIS ET SUGGESTIONS
L'analyse du MDS révèle que plusieurs
défis restent à relever pour que le festival atteigne ses
objectifs et ainsi contribuer efficacement à l'auto-développement
de la Commune d'Abomey. En effet, toutes les personnes interrogées ont
reconnu que le festival est une bonne initiative, seulement beaucoup reste
à faire. Comme l'on pourrait le remarquer dans le tableau suivant,
38,09% des personnes interrogées parmi les populations à la base,
principales bénéficiaires ne sont pas du tout satisfaites de
l'organisation du festival ; 14,28% déclarent qu'elles sont peu
satisfaites de cette organisation.
Tableau VIII : Fréquence
des populations relative à leur
satisfaction ou non de l'organisation du festival
|
Opinions
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
|
Satisfait
|
36
|
47,61
|
|
Peu satisfait
|
28
|
14,28
|
|
Pas satisfait
|
11
|
38,09
|
Source : Enquêtes
présente étude (2008)
Figure 5 :
Répartition des populations selon qu'elles soient satisfaites ou non de
l'organisation du festival
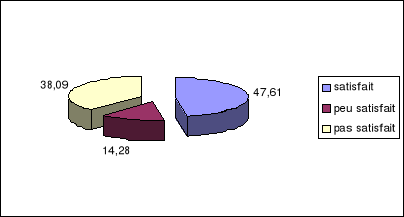
Source :
Résultats enquêtes présente étude (2008)
L'analyse de ces chiffres montre que plus de la moitié
des populations ne sont pas encore totalement satisfaites de l'organisation du
festival. Or, pour être une réussite et ainsi atteindre ses
objectifs, l'organisation doit recevoir l'assentiment total des populations et
connaître leur participation. Les défis que doit relever le
festival s'observent sur plusieurs plans.
5. 1- Sur le plan organisationnel
Le défi majeur au plan organisationnel est de sortir
le festival du carcan politique. Il faudra à tout prix éviter
que la politique "tue" le festival. Il faudra de ce fait, dissocier
l'organisation pratique du festival de la gestion de la mairie et la confier
à des professionnels. Le comité ne jouera qu'un rôle de
parrainage et d'appui conseil.
Par ailleurs, l'installation d'un secrétariat permanent
du festival s'avère indispensable. Seule la mise sur pied de ce
secrétariat pourrait faciliter l'organisation et éviterait les
précipitations observées à la veille du festival. Comme
l'on pourrait le constater, c'est toujours à la veille que le
comité d'organisation est mis sur pieds et les tractations pour la
rédaction du projet commencent. Cette situation a de sérieuses
répercussions sur l'organisation pratique de la manifestation quand on
sait le projet doit suivre un circuit avant d'être autorisé. Les
autorités communales aussi en sont conscientes, seulement elles
s'inquiètent des dépenses que cela induirait.
Enfin, les autorités doivent développer des
stratégies pour faire participer toutes les couches de la population
afin qu'elles puissent s'approprier cette fête car l'implication des
populations dans le processus de développement constitue de nos jours
une nécessité absolue. Autrement dit, pour un
développement urbain et rural plus efficace la participation des
populations est une condition sine qua non. On pourrait par exemple
étendre la fête dans les quartiers pour que les populations se
sentent impliquées.
5. 2- Au plan culturel et
touristique et environnemental
Du point de vue culturel et touristique, le festival a permis
la résurgence de certaines richesses culturelles du Danxomè et un
début du développement du secteur touristique, mais plusieurs
défis restent à relever, maintes valeurs authentiques à
déceler et valoriser.
Il faudra pour ce faire :
· Recenser toutes les potentialités historiques,
culturelles, cultuelles et naturelles de la Commune d'Abomey et les Communes
soeurs avec lesquelles elle constitue le plateau d'Abomey. On pourrait à
titre d'exemple, mettre en valeur les rythmes et tam-tam de chaque palais et
permettre aux jeunes générations et touristes de prendre
connaissance de ces richesses ;
· Créer d'un centre historique où on
pourrait lire l'histoire du Danxomè. Il serait aussi un lieu où
les familles dépositaires de cette histoire pourraient donner des
communications pour une lecture plus juste et impartiale de l'image du
Danxomè, offrant ainsi aux jeunes générations et touristes
l'opportunité de mieux connaître ce royaume ;
· Réhabiliter ou aménager les vestiges
historiques et les places ayant des valeurs porteuses de civilisation en
prenant conseil auprès de ces familles ;
· Créer de nouveaux circuits touristiques pour
retenir les étrangers ;
· Créer des cadres de concertation
réguliers impliquant tous les acteurs locaux du tourisme (Etat,
promoteurs, élus, ONG, institutions etc.), les femmes et les jeunes
notamment, afin de définir les stratégies locales du
tourisme ;
· Adapter les principes et recommandations
stratégiques aux spécificités locales ;
· Développer des actions de sensibilisation
(modification des comportements en faveur d'un tourisme durable) aussi bien
pour les touristes que pour populations hôtes ;
· Elargir dans la mesure du possible la
coopération touristique aux pays émetteurs de touristes ;
· Surveiller dans la mesure du possible les sites
touristiques afin de sauvegarder les patrimoines matériel et
immatériel et assurer au maximum la sécurité des
touristes ;
· Recruter des guides spécialisés et former
ceux existants ;
· Mettre à long terme en place une salle de
fête moderne ;
· Organiser de façon périodique le
nettoyage de la ville et accompagner les structures et ONG impliquées
dans le ramassage des ordures ;
· Sensibiliser les populations sur les notions de bonne
citoyenneté et les conséquences de la pollution de
l'environnement sur leur santé.
5. 3- Au plan social et économique
Pour une paix sociale, source de développement à
Abomey, la responsabilité incombe à toutes les composantes de
cette Commune. Mais dans le cas précis du festival, les conseillers
communaux restent et demeurent les premiers responsables. Ils ont l'obligation
de tout mettre en oeuvre pour reconstruire la ville et cette reconstruction ne
saurait se réaliser dans la division. Les populations doivent aussi
comprendre que le festival est une cause commune et transcender les
ressentiments et multiples querelles qui ébranlent, rongent et ruinent
la devise de solidarité chère au peuple fon. Les hommes
politiques doivent faire montre d'indulgence, de tolérance et de
clairvoyance. Ils doivent accepter la différence et transcender les
divergences politiciennes quand il s'agit de la construction de la Commune. Les
acteurs de la vie politique sont des adversaires et non des ennemis. La
politique n'est en réalité que l'émission de points de vue
différents, de programmes d'action différents et n'est opportune
qu'en période électorale.
De façon spécifique, pour que le festival
contribue efficacement au développement économique et social de
la Commune d'Abomey il faudra :
· Créer un cadre de concertation permanente des
filles et fils de la Commune et du plateau d'Abomey d'une part, et d'autre
part, entre eux et les partenaires intéressés à quelque
aspect que ce soit du royaume du Danxomè, pour une meilleure
compréhension des évolutions sociales, économiques et
culturelles ;
· Sensibiliser les populations sur la
nécessité de leur participation au développement
local ;
· Mettre en place une politique de commercialisation pour
mieux vendre l'image du festival afin de permettre une meilleure
fréquentation des sites touristiques et attirer aussi des
investissements ;
· Alimenter pour ce faire le site Internet pour
permettre aux étrangers de faire leur programme sur le
festival ;
· Mettre en place des circuits de commercialisation du
produit touristique selon les règles du commerce équitable et au
profit des populations les plus vulnérables. Cela passera par la
facilitation à la création d'une micro-entreprise d'accueil (type
gîte, hébergement chez l'habitant) ;
· Répertorier toutes les entreprises de la Commune
afin de mieux orienter les touristes permettant aux opérateurs
d'augmenter leurs recettes ;
· Sensibiliser les opérateurs économiques
sur l'enjeu du festival et que ces derniers acceptent d'accompagner les
organisateurs.
CONCLUSION
La question fondamentale de notre étude portait sur la
contribution du festival du Danxomè au développement de la
Commune d'Abomey. L'objectif était donc d'appréhender
l'utilité de cette manifestation dans la problématique du
développement de cette ville en cette ère de
décentralisation. Pour mener à bien cette étude, nous
sommes partis de deux hypothèses. La première qui se trouve
être la centrale est celle selon laquelle le festival du Danxomè
est une réponse aux multiples défis de
l'auto-développement dans la Commune d'Abomey. La seconde concerne
l'importance de la valorisation du patrimoine culturel dans le renforcement
des rapports intercommunaux et de la coopération
décentralisée. Pour les vérifier, nous avons
utilisé la méthode combinant approche qualitative et
quantitative. Cela nous a conduit vers différents acteurs directs et
indirects du festival.
Soumis à l'épreuve des faits, ces
hypothèses se sont avérées non plausibles (non
vérifiées). En effet, les investigations et l'analyse des
informations recueillies ont révélé que le festival est
une initiative qui a suscité beaucoup d'espoir à ses
débuts. Mais plusieurs facteurs constituent des handicaps pour
l'atteinte de ses objectifs. Si le festival a permis dans une certaine mesure,
l'amélioration des recettes de la Commune, la revalorisation et la
réaffirmation de l'identité culturelle fon ainsi qu'un
début de coopération décentralisée, il n'a pas
encore réussi à conduire les Aboméens à l'union.
Les rapports intercommunaux demeurent fragiles. Or, le développement
étant un fait social total doit embrasser tous les domaines. Nous avons
constaté après diagnostic que la politique politicienne et la
crise de la royauté d'Abomey sont deux principales tendances lourdes qui
sèment la division entre les Huégbadjavi et menacent le
développement de leur localité. Comme l'on peut s'en souvenir,
l'ancien royaume du Danxomè est l'un des plus organisés de
l'Afrique Noire pré-coloniale. L'option guerrière et d'expansion
de même que le génie politique des Danxoméens ont conduit
ce royaume à anticiper sur les structures de l'Etat moderne.
C'était donc un royaume éminemment politique. Ce qui explique
l'importance et l'attachement des fils de ce royaume à la politique et
au pouvoir. Chose qui malheureusement provoque le déchirement du tissu
social. Aucun développement n'est possible dans la division. Pour un
développement réel et durable, la participation de toutes les
couches de la population constitue de nos jours une nécessité
absolue. Cela fait appel à la prise de conscience le toutes les
composantes de la Commune (autorités locales, autorités
traditionnelles, formations politiques, OSC, populations etc.) de ce que le
festival est une opportunité pour le développement de celle
localité. Il faudra pour ce faire transcender les ressentiments, taire
les querelles politiciennes et associer toutes les populations à
l'organisation tout en prenant en compte les propositions et suggestions des
uns et des autres.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1- ADJAHO, R., 2002, Décentralisation au
Bénin en Afrique et ailleurs dans le monde, état sommaire et
enjeux, Cotonou, CODEP, 194p
2- AGUIDI, T.J.M., 1987, approche sociologique du
développement touristique dans la cité lacustre de
Ganvié, mémoire de maîtrise en
Sociologie-Anthropologie, FLASH, UAC, 129p
3- ASSOBGA, T., 2007, Dynamiques et contraintes du
financement des collectivités locales dans le contexte actuel de la
décentralisation : cas de la Commune d'Abomey, mémoire
de fin de 2nd cycle universitaire en Jeunesse et Animation, option
Développement Communautaire, INJEPS, UAC, 73p
4- BANEGAS, R., 2003, la démocratie à pas de
caméléon : transition et imaginaire politique au
Bénin, Paris : Karthala, 491p
5- BEHANZIN, S., 2005, Approche intercommunal et
développement du tourisme dans les Communes d'Abomey, Bohicon et
Zogbodomey, mémoire de fin de 2nd cycle universitaire en
Jeunesse et Animation, option Développement Communautaire, INJEPS, UAC,
84p
6- BENIN 2025 ALAFIA, 2000, Etudes nationales de
perspectives à long termes, Cotonou, Août 2000,
PRCIG/NLTPS/BEN 96/001, 235p
7- BENITO, L., 2001, Les festivals en France :
Marchés - enjeux et alchimi, Paris : Harmattan, 196p
8- BERRIANE, M., 1999, Tourisme, culture et
développement dans la région arabe, UNESCO, 177p
9- BIO, B., 1996, la Gani à Nikki, Cotonou
10- BOYER M., 1982, le tourisme, Paris, Editions du
Seuil, 312p.
11- CHARLES, E., 1984, Cours du droit administratif, ?
les structures de l'administration?, Paris, LGDJ, p288
12- DAKPO, G. R. H., 2001, Sources socio-anthropologiques de
la crise de la royauté d'Abomey, Mémoire de maîtrise
en Sociologie-Anthropologie, FLASH, UAC, 85p
13- DASSI, J.C., 1998, impacts socio-économiques des
pélerinages marials de Dassa-Zoumè, mémoire de
maîtrise en Sociologie-Anthropologie, FLASH, UAC, 91p
14- DOSSOU, C., 1997, Décentralisation,
déconcentration et découpage territoriale : ce qu'il faut
savoir, Cotonou, GTZ, 64p.
15- DUMEZIL, G., 1941, Jupiter, Mars, Quirinus,
Paris : Gallimard, 233 p
16- DURKHEIM, E., 1986, les règles de la
méthode sociologique, 22ème édition, PUF,
254 p
17- DURKHEIM, E. 1912, les formes
élémentaires de la vie religieuse, Paris : PUF, 647
p
18- DUVIGNAUD, J., 1974, Fêtes et
civilisations, Paris : Weber, 143p
19- FREUD, S. 1912, Totem et tabou, Paris:
Gallimard, 240 p
20- GRIGOU, J.L., 1984, le développement
local : Espoir et freins, revue municipale n°246
21- LAFIA, I.F.B., 1997, aspects socio-culturel du
développement dans la Gani, mémoire de maîtrise en
Sociologie-Anthropologie, FLASH, UAC, 119p
22- LOMBART, J., 1965, Structure de type féodal en
Afrique noire (études des relations sociales chez les Bariba du
Dahomey), Paris : Mouton et la Haye, 263p
23- MADELEINE, G., 2001, Méthodes des sciences
sociales, Paris : Dalloz, 11è édition, 860p
24- MAUSS, M. et HUBERT, 1909, les représentations
du temps dans la religion et la magie, pp 190-229
25- MAUSS, M., 1925, Essai sur le don. Formes et raisons
de l'échange dans les sociétés archaïques
3è édition in Marcel MAUSS, Sociologie et Anthropologie,
Paris : PUF (1950) 3è édition, pp143 à 279
26- MIRCEA, E., 1965, le sacré et le profane,
coll.folio essai, Paris : Gallimard, 183p
27- NACK MBACK, C. (2003). Démocratisation et
décentralisation. Genèse et dynamiques comparées des
processus de décentralisation en Afrique subsaharienne. Editions
KARTHALA et PDM, 528 p.
28- OROU-TOKO, O., 2002, la reforme de l'administration
territoriale en République du Bénin, Cotonou, éd
corrigées, 110p
29- OROU, Y.R., 1982, la Gani et ses implications
socio-économiques, mémoire de maîtrise en Sociologie-
Anthropologie, FLASH, UAC, 143p
30- PDM, 2000, Politiques économiques et
développement local durable, Actes de la réunion
scientifique "AFRICITES 2000?, Afrique de l'ouest et du centre, série
séminaires, Windoek, 116 p.
31- PDM, 2003, Gérer l'économie localement
en Afrique : Evaluation et prospective de l'économie locale,
manuel ECOLOC, tome 1, synthèse, club du Sahel, OCDE, 35 p.
32- PDM, 2005, Mieux impliquer les collectivités
locales, la revue africaine des finances locales, pays de l'Afrique de
l'Ouest, n°8, 31 p.
33- PDM, 2005, les premiers pas des Communes au Bénin,
Windoek, 116 p
34- PDM, (Séminaire national tenu à Abomey du 2
au 4 Mars 1994), Autonomie financière et fiscale des Communes,
Décentralisation et démocratisation, document n°7, 133
p.
35- PECQUEUR, B., 1989, le développement
local, Paris : Syros, 357p.
36- QUIVY, R. et CAMPENHOUDT, V., 1988, Manuel de
recherche en sciences sociales, Paris : DUNOD, 288p
37- TEISSERENCE, P. (1998). Les politiques de
développement local. Edition française Inc, 295 p.
38- THOMAS, L.V. et LUNEAU, R., 1975, la terre africaine
et ses religions, Paris, Larousse, 433 p
39- THOMAS, L.V. et LUNEAU, R., 1981, les religions
d'Afrique noire, Paris, Stock plus, Tome I
40- XAVIER, G., 1984, Territoires en France, les enjeux
économiques de la décentralisation, Paris, Economica, 304
p.
ANNEXES
GUIDE D'ENTRETIEN À L'ENDROIT DES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES ET COUTUMIÈRES
I- L'organisation du Festival du Danxomè dans
la Commune d'Abomey
A- Utilité du festival
B- Les priorités du festival à l'ère de
la décentralisation.
II- Impact positif du Festival sur le
développement de la Commune d'Abomey
A- Au plan culturel et touristique
B- Au plan économique et social
C- Au plan environnemental
D- Au plan politique
III- Les limites du festival
A- Au plan culturel et touristique
B- Au plan économique et social
C- Au plan environnemental
D- Au plan politique
IV- Les défis à relever à travers
le festival pour un réel développement de la
Commune
A- Sur le plan organisationnel
B- Au plan politique
C- Au plan touristique
D- Au plan environnemental
V- Suggestions
A- A l'endroit des autorités administratives
B- A l'endroit des opérateurs économiques
C- A l'endroit des populations
QUESTIONNAIRE À L'ENDROIT DES POPULATIONS LOCALES ET
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Identification de
l'enquêté
Nom et Prénoms :
Sexe:
Profession:
Quartier :
Arrondissement :
1- Avez-vous connaissance de l'organisation d'une
manifestation culturelle annuelle dénommée Festival du
Danxomè ?
Oui
Non
2- Quand avez-vous installé votre entreprise ?
Avant ou après la première édition du Festival de
Danxomè ?
Avant Après
3- Si vous êtes installé après la
première édition, à quelle édition avez-vous
assisté ou participé pour la première fois ?
2 3 4
5
3- Si vous êtes installé avant la
première édition, quel était en moyenne votre chiffre
d'affaire mensuel avant cette première édition?
4- Pensez-vous que ce chiffre a augmenté depuis
l'organisation du Festival ?
Oui
Non
5- Si oui, à quelle proportion / hauteur
|
1 à 25 %
|
|
|
26 à 50 %
|
|
|
51 à 75 %
|
|
|
76 à 100 %
|
|
6- Quel est l'accroissement (en %) de votre chiffre d'affaire
dans les autres mois par rapport au mois de décembre ?
|
Déc
|
Jan
|
Fév
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Setp
|
Oct
|
Nov
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7- Pensez-vous que le Festival génère de
l'argent à la Mairie
Oui Non aucune
idée
8- Si oui, quelles sont selon vous les manifestations qui
génèrent de l'argent
9- Pensez- vous que le festival contribue au
développement de la ville d'Abomey ?
Au plan culturel oui non
peu
Pourquoi...................................................................................................................................................................................
Au plan touristique oui non peu
Pourquoi
Au plan économique oui non peu
Pourquoi.......................................................................
Au plan social oui non peu
Pourquoi..................................................................
Au plan environnemental oui non
peu
Pourquoi
Au plan politique oui non
peu
Pourquoi
10- Avez-vous noté des changements comme signe de
développement dans la
Commune depuis l'organisation du Festival ?
Oui Non
peu
Si oui lesquels
a-
......................................................................
b-
......................................................................
c-
.........................................................................
11- Etes-vous satisfait de l'organisation du
festival ?
Bien satisfait peu satisfait
pas satisfait
12- Quels sont selon vous les défis à relever
pour que le Festival contribue efficacement au développement de la
Commune ?
a.
................................................................
b.
................................................................
c.
............................................................
d. ...................................................
Merci pour votre participation
Date de l'enquête :
LISTE DES TABLEAUX
|
Numéros d'ordre
|
|
Titres
|
Pages
|
|
Tableau I
|
:
|
Structuration de l'Etat décentralisé
|
30
|
|
Tableau II
|
:
|
Répartition des enquêtés pas statut
|
40
|
|
Tableau III
|
:
|
Chronogramme de la recherche
|
41
|
|
Tableau IV
|
:
|
Statistiques de l'évolution du chiffre d'affaire des
populations et opérateurs économiques tout au long de
l'année
|
49
|
|
Tableau V
|
:
|
Répartition des populations selon que le festival est
source ou non de revenus pour la Mairie
|
51
|
|
Tableau VI
|
:
|
Fréquence de la population selon les opinions sur la
contribution du festival au changement de l'environnement d'Abomey
|
58
|
|
Tableau VII
|
:
|
Matrice de diagnostic stratégique
|
63
|
|
Tableau VIII
|
:
|
Fréquence des populations relative à leur
satisfaction ou non de l'organisation du festival
|
65
|
LISTE DES FIGURES
|
Numéros d'ordre
|
|
Titres
|
Pages
|
|
Figure N° 1
|
:
|
Répartition des acteurs selon leur opinion sur
l'importance de l'organisation du festival
|
44
|
|
Figure N° 2
|
:
|
Evolution moyenne du chiffre d'affaire des opérateurs
économiques tout au long de l'année
|
50
|
|
Figure N° 3
|
:
|
Répartition des populations selon que le festival
engendre ou non de revenus pour la mairie
|
52
|
|
Figure N° 4
|
:
|
Répartition des populations selon leur avis sur
l'impact du festival sur l'environnement
|
59
|
|
Figure N° 5
|
:
|
répartition des populations selon qu'elles soient
satisfaites ou non de l'organisation du festival
|
65
|
LISTE DES IMAGES
|
Numéros d'ordre
|
|
Titres
|
Pages
|
|
Image N° 1
|
:
|
Statue du Roi Béhanzin à l'entrée de la
ville d'Abomey
|
35
|
|
Image N° 2
|
:
|
Emblème du Roi Guézo
|
36
|
|
Image N° 3
|
:
|
Danse traditionnelle Houissodji à Abomey
|
37
|
|
Image N° 4
|
:
|
L'art chez les Yèmadjè d'Abomey
|
37
|
TABLE DES MATIERES
|
SOMMAIRE.......................................................................................
DEDICACES.......................................................................................
REMERCIEMENTS..............................................................................
LISTE DES SIGLES ET
ACRONYMES.....................................................
RESUME DU
TRAVAIL........................................................................
INTRODUCTION.................................................................................
I- CADRES THEORIQUE, PRATIQUE ET METHODOLOGIQUE DE LA
RECHERCHE...........................................................................
1- Problématique de la
recherche.........................................................
1-1-
Problème..............................................................................
1-2- hypothèses de
recherche..........................................................
1-3- Objectifs de
recherche..............................................................
1-3-1- Objectif
général.........................................................
1-3-2- Objectifs
spécifiques...................................................
2- Etat de la
question........................................................................
3- Place de la fête dans le
développement................................................
4-Clarification
conceptuelle..................................................................
5- Démarche
méthodologique................................................................
5-1- Cadre de
l'étude.....................................................................
5-2- Nature de
l'étude..................................................................
5-3- Durée de
l'étude......................................................................
5-4-Groupes-cibles et
échantillonnage................................................
5-4-1-
Groupes-cibles..........................................................
5-4-2-
Echantillonnage..........................................................
5-5- Collecte et analyse des
données.................................................
5-5-1- Techniques et outils de collectes des
données......................
5-5-2- Instrument de traitement et d'analyse des
données..................
5-6-
Chronogramme......................................................................
5-7- Difficultés
rencontrées..............................................................
II- PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS.................................
1- Utilité de l'organisation du festival du
Danxomè......................................
2- Impact du festival sur la
Commune......................................................
2-1- Impact économique du festival sur les populations
et la mairie
d'Abomey...........................................................................
2-1-1- Sur les populations
locales................................................
2-1-2- Sur la
mairie...................................................................
2-2- Impact du festival au plan
social................................................
2-3- Impact du festival au plan
politique.............................................
2-4- Impact du festival au plan
touristique..........................................
2-5- Impact du festival sur l'environnement de la
Commune.....................
3- Les limites du
festival....................................................................
3-1- Au plan
organisationnel...........................................................
3-2- Au plan
culturel.....................................................................
3-3- Au plan touristique, économique et
environnemental........................
3-4- Au plan social et
politique........................................................
4- Matrice de diagnostic
stratégique.......................................................
5- Les défis et
suggestions...................................................................
5-1- Sur le plan
organisationnel........................................................
5-2- Au plan culturel et touristique et
environnemental............................
5-3- Au plan économique et
social....................................................
CONCLUSION..................................................................................
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES....................................................
ANNEXES.......................................................................................
TABLES DES
MATIERES...................................................................
|
Pages
2
4
5
6
7
8
11
12
12
16
16
16
16
17
20
22
33
33
37
38
39
39
40
41
41
42
42
42
44
45
48
48
48
52
53
57
58
59
61
61
61
62
63
63
67
68
69
70
72
75
79
88
|
* 1 Ministère de la
Culture de l'Artisanat et du Tourisme, Direction du Développement
Touristique, statistique du secteur touristique, 2008
* 2 MAUSS, M., Essai sur le
don. Formes et raison de l'échange dans les sociétés
archaïques (1925) 3è édition in Marcel MAUSS,
Sociologie et Anthropologie, Paris : PUF (1950) 3è édition,
p143.
* 3 QUETELET, 1969, physique
sociale ou essai sur le développement des facultés de l'homme
* 4 DUMEZIL, E., 1941, Jupiter,
Mars, Quirinuis, Paris : Gallimard
* 5 LOMBART, J, 1965, Structure
de type féodal en Afrique noire (Etude des relations sociales chez les
Bariba du Dahomey), Paris : Mouton et la Haye
* 6 OROU, Y.R., 1982, La Gani et
ses implications socio-économiques, FLASH, UNB, p 43
* 7 BIO, B., 1996, LA Gani
à Nikki, Cotonou
* 8 LAFIA I. F.B., 1997,
Aspects socio-culturels du développement dans la Gani : Cas de
Nikki, FLASH, UNB, p 98
* 9 DASSI, J.C., 1998, Impacts
socio-économiques des pèlerinages marials de Dassa-Zounmè,
FLASH, UNB, pp.34-35
* 10 OROU, Y.R., 1982, op.
cit. p 8
* 11 MIRCEA E., 1965, le
sacré et le profane, coll.folio essai, Paris : Gallimard, p78.
* 12 LOMBART, J., 1965,
Structure de type féodal en Afrique noire (études des
relations sociales chez les Bariba du Dahomey), Paris : Mouton et la
Haye, cité par LAFIA I. F.B., 1997, in Aspects socio-culturels du
développement dans la Gani : Cas de Nikki, FLASH, UNB, p 8
* 13 FREUD S., 1912, Totem
et tabou, Paris: Gallimard, 240p cité par LAFIA I. F.B., 1997, in
Aspects socio-culturels du développement dans la Gani : Cas de
Nikki, FLASH, UNB, p 8
* 14 DUVIGNAUD, J., 1974,
Fêtes et civilisations, Paris, Weber, p38
* 15 THOMAS, L.V. et LUNEAU,
R., 1975, la terre africaine et ses religions, Larousse, 433p cité par
LAFIA I. F.B., 1997, in Aspects socio-culturels du développement dans
la Gani : Cas de Nikki, FLASH, UNB, p 9
* 16 DURKHEIM, E., 1912, les
formes élémentaires et la vie religieuse, Paris : PUF
* 17 DURKHEIM, E., 1986, les
règles de la méthode sociologique, 22ème
édition, Paris : PUF
* 18 www.google.com/ Journal
l'@raigné : politique
* 19 BANEGAS, R., 2003, la
démocratie à pas de caméléon : transition et
imaginaire politique au Bénin, Paris : Karthala, pp 316-318
* 20 Le petit Larousse
illustré, 2002
* 21 PDM, 2005, les premiers
pas des Communes au Bénin, Windoek, p 69
* 22 BOYER M., 1982, le
tourisme, Paris, Editions du Seuil, 312p, cité par BEHANZIN S.,2005, in
Approche intercommunale et développement du tourisme dans les Communes
d'Abomey, Bohicon et Zobgodomey, mémoire de fin de 2nd cycle
universitaire en Jeunesse et Animation, p. 14
* 23 WAINWRIGHT J., 1999,
Agenda Info Haïti, Edition CASSAGNOL, p.79
* 24 FRANGIALLI, F., 1999, le
tourisme dans notre monde et pour la France in Tourisme et Loisirs, p.63
* 25 BERRIANE M., 1999,
Tourisme, culture et développement dans la région arabe, UNESCO,
p.17
* 26 Maurice Hauriou,
(1982) cité par Nack Mback, C. (2003). Démocratisation et
décentralisation. Genèse et dynamiques comparés des
processus de décentralisation en Afrique subsaharienne. Editions
KARTHALA et PDM, p. 35
* 27 Sebahara 2000, www.
google. Fr/ recherches avancées sur décentralisation et
développement
* 28 ADJAHO, R. (2002).
Décentralisation au Bénin en Afrique et ailleurs dans le monde,
état sommaire et enjeux. Cotonou, CODEP, p. 23
* 29 Le guide du maire, 2006,
Mission de la décentralisation, p14
* 30 PDM, 2005, les premiers
pas des Communes au Bénin, Windoek, p11
* 31 Sebahara, 2000. Op.
cit.
* 32 GUIGOU, J.L., 1984, le
développement local : Espoir et freins, revue municipale
n°246
* 33 Xavier, G., 1984,
Territoires en France, les économiques enjeux de la
décentralisation, Paris, Economica, 304p
* 34 Pecqueur, B., 1989, le
développement local, Paris : Syros, 357p.
* 35 En confiant le royaume du
Danxome à son successeur, le roi Glèlè comme l'exige la
tradition, a légué les vestiges et les biens à
Béhanzin. Conscient de l'imminence de la guerre, Glèlè
donna des coutelas à son fils, arme de guerre capable de percer les
collines. Telle est l'origine de cette danse qui se fait avec le coutelas.
* 36 Ce mot désigne en
milieu fon une sorte d'akassa en forme de boule généralement plus
dure que l'akassa ordinaire
* 37 DAKPO, G. R. H., 2001,
Sources socio-anthropologiques de la crise de la royauté d'Abomey,
Mémoire de maîtrise en Sociologie-Anthropologie, FLASH, UAC,
p.61
* 38 DAKPO, G. R. H., 2001, op.
cit, p.74
* 39 Lieu de rencontre et de
remise de la tribu annuelle au royaume d'Oyo par le Danxomè. Cette place
se trouve aujourd'hui dans l'enceinte de la gare routière de
Zogbodomey.
|
|



