|
UNIVERSITE DE KISANGANI
B.P. 2012
KISANGANI
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, ADMIISTRATIVES ET
POLITIQUES

Département des Relations Internationales
OPERATION USHUJAA ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME
INTERNATIONAL DANS LES VILLES DE BENI ET DE BUTEMBO
Par
MULULA KIABU Joseph
MEMOIRE
Présenté en vue de l'obtention de Diplôme
de Licence en Relations Internationales.
Directeur : Dr. OYOKO HAMZATI HAMZADA
Encadreur : C.T. Alexis Toussaint KAWAYA
YUMA
Année Académique :
2022-2023
Première Session
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
ADF : Allied Democratic Forces
AFDL : Alliance des Forces Démocratique pour la
Libération du Congo
BCZ : Banque Commerciale Zaïroise
BDP : Banque du Peuple
BENELUX : Belgique, Pays-Bas et LuxembourgCEEAC :
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
DDRRR : programme désarmement,
démobilisation, rapatriement, réinstallation et
réinsertion
DIH : Droit international humanitaire
EI : Etat islamique
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
FARDC : Force Armée de la République
Démocratique du Congo
FBI : Federal Bureau of investigation
FDLR : Forces démocratiques de libération
du Rwanda
FMI : Fond monétaire international
FNL : Forces Nationales pour la Libération du
Burundi
FPR : Front Patriotique Rwandais
GAFI : Groupe d'Action Financière sur le
Blanchiment de Capitaux
GEC : Groupe d'Etude sur le Congo
IRA : Irish République Army
M23 : Mouvement du 23 Mars
MPR : Mouvement Populaire de la Révolution
MONUC : Mission d'Observation des Nations Unies au
Congo
MONUSCO : mission de l'organisation des nations unies pour
la stabilisation en RDC
NALU : National Army for the Liberation of Uganda
RDC : République Démocratique du Congo
ONU : Organisation de Nations Unies
OED : Oxford English Dictionary
OIF : Organisation international de la Francophonie
OZACAF : Office Zaïrois du Café
PNUCID : Programme des Nations Unies pour le
Contrôle international de la Drogue et la Prévention des Crimes
PPRD : parti du peuple pour la reconstruction et la
démocratie
PME : petite et moyenne entreprise
RCD : Rassemblement congolais pour la Démocratie
SADC : Souther African Development community
SMI : Structure militaire d'intégration
UE : Union Européenne
UFFM : Mouvement des combattants ougandais pour la
liberté
UMSC : Conseil supérieur des musulmansougandais
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
UPC : Uganda people's progress
UPDF :Ugandapeople's defence force
USA : United states of America
UZB : Union Zaïroise de Banques
ZES : Zones économiques spéciales
EPIGRAPHE
« Avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mieux
vaut mourir en avançant que mourir en reculant car la mort n'est rien et
vivre vécu sans gloire c'est mourir tous les jours »
Napoléon BONAPARTE
DEDICACE
A nos parents Jean-Jacques KIABU NTAMBUE et Justine
KITENGIE,
A mon oncle Lucien NGONGO, et Tente Charlie BOKI,
A mes frères et soeurs
A chaque fois que le soleil se lève, il y a
toujours un temps pour qu'il se couche. Après tout le temps que nous
nous sommes séparés pour cette formation universitaire, voici
venir le temps de savourer ce fruit mûr.
REMERCIEMENTS
A la fin de la rédaction de notre mémoire de
licence, nous voudrions nous acquitter de noble devoir celui de remercier les
différentes qui ont concouru à la réalisation de ce
mémoire.
De Prime à bord, notre reconnaissance d'adresse
à l'Éternel Dieu tout puissant pour la grâce, la vie et
l'intelligence qu'il nous a donné tout au long de notre parcours
académique lesquelles nous ont permis d'arriver à la fin de notre
formation en toute bonté.
À toutes les autorités de l'Université de
Kisangani en général et en particulier à celle de la
Faculté des Sciences Sociales, Administratives et Politiques pour
l'effort et le souci qu'elles ont fourni pour la formation et l'organisation de
notre parcours.
Du plus profond de nous, nous tenons à remercier le
Directeur de ce mémoire, le Professeur Associé OYOKO HAMZATI
HAMZADA qui, malgré ses multiples occupations, à accepter
d'assurer avec grand dévouement la direction du présent
mémoire.
Par la même occasion qu'il nous soit permit de remercier
le Chef des travaux Alexis Toussaint KAWAYA YUMA, pour sa disponibilité
pendant l'encadrement de ce travail.
Nous remercions nos parents Jean Jacques KIABU NTAMBUE,
Justine KITENGIE KUNDA, Lucien NGONGO, Charly BOKI pour leur éducation
et immenses sacrifices consentis en vue de notre épanouissement, nous
leur disons grand merci.
A nos frères et soeurs : Pascal TSHITE, Justin NGIEFU,
Adolph NGOYI, Ange MUALUKIE, Francine NGOIE, Jures NTAMBWE, Benjamin MUKONKOLE,
Abigaël NGOIE, Gracia MISENGA, Guenael LOFINDI, Joël NZIMBI... qui
nous ont assisté de diverses manières tout au long de notre
parcours universitaire.
A nos amies de lutte : Sam YAGASE, Gratien ASAMBOA,
Stéphanie ANYEKE, Junior EILE, Emmanuel LOMBELE, Isaac MOBOLAMA,
Joël BUAGUO, Jonathan KABASEKE et Moise AMANI... avec qui nous avons tous
Connu les aléas estudiantins tout au long de notre parcours
académique.
Joseph MULULA KIABU
INTRODUCTION
0.1. CONTEXTE DE L'ETUDE
Depuis plus de deux décennies, la République
Démocratique du Congo (RDC, anciennement dénommée
République du Zaïre jusqu'en 1997) est plongée dans une
variété de conflits armés qui connaissent la participation
des forces et groupes armés étrangers. Les forces armées
étrangères incluent celles venues de l'Angola, du Burundi, du
Rwanda, de la Tanzanie, du Tchad, du Zimbabwe et de l'Ouganda sur invitation du
Gouvernement ou des groupes armés locaux.
Pour les groupes armés étrangers, nous noterons
les Forces Nationales pour la Libération du Burundi (FNL), les Forces
Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR), les Forces
Démocratiques alliées (ADF en anglais Allied Democratic Forces)
et l'Armée Nationale de Libération de l'Ouganda (NALU en anglais,
National Army for the Liberation of Uganda). La présence de ces forces
et groupes armés étrangers, opérant sur le territoire
national de la RDC, a constitué une menace à la paix et à
la sécurité régionales et cela reste un obstacle permanent
au rétablissement de l'autorité de l'Etat dans ce dernier
pays.
Au cours de la période susmentionnée, il y a eu
commission des violations massives et systématiques des droits de
l'homme (comme celles visant le droit à la vie et à
l'intégrité physique) et du droit international humanitaire
(comme celles mettant en danger des personnes protégées ou ne
participant pas ou plus au combat ou portant atteinte aux biens
protégés). Ces violations seraient constitutives, de par leur
type, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. La
persistance de cette situation facilite la prolifération, la circulation
et le trafic illicites des armes légères et des petits calibres
que les groupes armés et même la population civile se procurent.
Ce qui constitue une menace à la sécurité humaine et au
développement social et économique de cette partie du pays.
Pour tenter de remédier à cette situation, les
règlements politiques qui se sont succédé aboutirent,
d'une part, à des accords de paix entre les belligérants
congolais et, d'autre part, les accords de retrait des forces armées
étrangères entre la RDC et les pays voisins impliqués. Il
convient toutefois de noter que, par l'absence d'une approche holistique des
règlements politiques, aucune négociation ou table ronde
réunissant, d'une part, les groupes armés rwandais opérant
sur le territoire national de la RDC et le gouvernement rwandais, et, d'autre
part, les groupes armés ougandais opérant sur le territoire
national de la RDC avec le Gouvernement ougandais n'avait été
entreprise. Faute d'une telle approche, ces groupes armés devraient
être neutralisés et désarmés par la force.
Ne voulant pas se rendre afin d'être rapatriés
volontairement, ces groupes armés étrangers se sont
retranchés dans les forêts du Kivu où ils se livrent,
presque impunément, aux pillages des biens de la population civile et
surtout des matières premières : minerais, faunes et flores,
aux viols et à l'esclavage sexuel des jeunes filles et femmes
congolaises, au recrutement forcé d'enfants, aux tueries massives et
systématiques de la population civile, etc. En conséquence,
craignant d'être persécutée, une partie de la population
civile victime de ces exactions n'a d'autre solution que de quitter son milieu
naturel afin de traverser la frontière internationale pour chercher
asile, être à l'abri de telles menaces et ainsi être
éligible au statut de réfugiés dans les pays limitrophes
de la partie orientale de la RDC. Des situations similaires forcent la
population à se déplacer vers une autre zone plus stable.
Certes, les recours à la situation du terrorisme sont
intéressants pour être réguler. Mais le contexte africain
et/ou congolais sur la monté du terrorisme
« islamiste » n'est abordé que par rapport aux
guerres à répétition (en RDC), Rwanda et Ouganda.
Il existe plusieurs études relatives au terrorisme dont
les effets s'expriment par d'abominables tueries, viols, meurtres... que
subissent des populations victimes de Beni et Butembo.
0.2. Etat de la question
Les relations internationales présentent un état
anarchique où presque chaque groupe s'efforce de prendre le dessus, un
avantage sur les autres. C'est pourquoi le monde actuel est un espace de
conflits et d'incertitudes, un monde qui se doute de lui-même et dans la
lutte des intérêts qui pousse les hommes à
s'entredéchirer.
Il sied, dans cette partie, de faire un recensement des
travaux antérieurs en vue d'en dégager ou d'y découvrir
des nouvelles pistes. C'est dans cet esprit que le sujet que nous traitons a pu
être étudié par d'autres chercheurs.
C'est ainsi que nous avons retenu les études de
Fraternel AMURI MISAKO, MAHAMOUD El KHADIR, MBIKAYI NKUANYA,Max WEBER,
Jean-Claude BULOBA KALUMBA,Samuel SOLVIT,TSHIMPANGA MATALA KABANGU et GONZALEZ,
F et quelques articles et rapports en caractère avec cette
thématique.
Fraternel Amuri Misako, dans son article analyse les
contradictions autour du terme terrorisme : un concept abusé1(*), mais décrivant une
menace sociétale contemporaine réelle. Il les applique ensuite au
cas de la République Démocratique du Congo (RDC).
L'hypothèse principale est que l'instrumentalisation du concept
terroriste par les acteurs politiques congolais contribue à
empêcher une meilleure saisie d'un phénomène
représentant pourtant une menace sécuritaire réelle pour
un Etat (congolais) encore au stade de son édification ou affermissement
et qui peine à se consolider. Ce faisant, cette instrumentalisation
empêche la formulation des stratégies adéquates en vue de
la prévention et de l'éradication de ladite menace.
MAHAMOUD EL KHADIR2(*), « dans les causes et remèdes du
terrorisme » se pose la question de savoir quelles les causes de cette
montée en puissance du mouvement terrorisme et les remèdes
à y apporter ?
C'est ainsi qu'en répondant à cette
problématique il démontre que les causes du terrorisme sont
belles et bien la pauvreté, le chômage, la famine, la
mondialisation, l'humiliation, la politique étrangère des Etats-
Unis etc. En effet pour EL KHADIR, la lutte contre le terrorisme est
exigée.
Nécessairement la compréhension de ses causes
profondes d'abord ensuite trouver les remèdes obligatoires à ces
« maladies » car « prévenir vaut mieux que guérir
»
Autrement la lutte contre le terrorisme doit pour être
efficace, se placer sur le terrain de la lutte contre les causes du
terrorisme.
A cet égard, il faut comprendre les souffrances et les
désespoirs de respecter la dignité humaine, la tolérance
et mettre en pratique les principes des conventions. Des droits de l'homme,
notamment et le partage des richesses. Une politique responsable doit faire en
sorte que les richesses produites profitent à tout le monde.
Cela n'a rien avoir avec l'idéologie, c'est une simple
question de justice. Si on n'applique pas ces principes, les choses ne
s'améliorent plus et on aboutira à une paix durable. C'est
pourquoi la réponse juste au terrorisme, est ne pas être dans les
représailles.
MBIKAYI NKUANYA3(*) qui, en abordant la question du terrorisme se pose la
question de savoir, quelles sont les stratégies de lutte contre le
terrorisme international dans le Moyen-Orient adoptées par
l'Administration Barack-Obama.
Pour répondre à cette problématique,
l'auteur montre que les stratégies de lutte contre le terrorisme
international au Moyen-Orient, l'Administration Obama adopte la
stratégie de démocratisation de tous les Etats de la
région car l'existence d'un régime hostile est un danger
vis-à-vis de l'extérieur ainsi que le despotisme à
l'intérieur, les deux sont liés comme dans celui de l'Irak.
Au contraire, un régime ou un Etat démocratique
présente un facteur de la paix où la démocratie se fait
remarquer et rarement on y observe la guerre.
Parmi ces stratégies, l'auteur parle aussi de la
présence militaire américaine dans la région. Ces
installations américaines au Moyen-Orient servent à garder un
oeil sur l'Iran mais leur présence dans la région a
été considérablement élargie de la
coopération internationale dans le cadre de l'ONU pour lutter contre le
terrorisme au Moyen-Orient par Barack-Obama.
Max WEBER4(*) soutient dans la violence légitime et lutte
éternelle des Etats, l'homme est en permanence déchiré
entre des aspirations contradictoires : foi et raison, vécu et
concept... ces antagonismes peuvent dégénérer en conflits,
car cette « guerre des dieux » entre valeurs
opposées sont éternelles.
Selon Weber, chaque structure politique préfère
avoir des voisins faibles plutôt que fort. De plus chaque
communauté de grande importance aspire potentiellement à
augmenter son prestige au prestige et est aussi une menace pour ses voisins.
Seules les grandes puissances comptent dans les relations internationales.
Bien qu'il n'a jamais été partisan d'un
impérialisme raciste, et parlant des allemands, il déclarait que
« ce n'est pas la paix et le bonheur des hommes que nous avons
à procurer à nos descendants mais la lutte éternelle pour
la conservation et l'édification de notre caractère
national ». Pour lui, la puissance n'englobe pas seulement la force
militaire d'un pays mais également le dynamisme de son économie
et le prestige de sa culture : elle est ainsi en lien étroit avec
le régime politique intérieur qui doit combiner justice et
efficacité.
Il sied de signaler que cette dissertation n'est qu'une
continuation de nos recherches amorcées en graduat. Dans ce travail,
nous nous démarquons par le fait les travaux ci-haut cités n'ont
parlé que du terrorisme d'une manière globale. Pour le
présent travail nous parlerons de l'opération Ushujaa et lutte
contre le terrorisme international dans les villes de Beni et de Butembo.
Jean-Claude BULOBA KALUMBA5(*) , fait état de conflits au Kivu, partant d'une
classification qu'il va subdiviser en deux parties :
Dans la première catégorisation, il s'agit des
guerres paysannes, qu'il appellera d'une escalade conflictuelle autour d'enjeux
fonciers et identitaires. Pour cette période, il partira d'une
constatation selon laquelle les cohabitations imposées par les
colonisateurs et les tensions politiques baptisées sous l'appellation
« trajectoire conflictuelle », pour ainsi dire qu'au Nord-Kivu, les
collines fertiles encore boisées et très peuplées au
début de ces siècles, ont attiré des flux importants de
migrants en provenance du Rwanda.
En plus, une autre immigration massive encadrée et
organisée par les autorités coloniales entre 1940-50, va inonder
la province du Nord-Kivu, car la raison fondamentale de cette organisation est
que ces migrants étaient confrontés aux problèmes de
famine et aux affrontements politico-ethniques entre Hutu et Tutsi au Rwanda
voisin
Dans la deuxième catégorisation, le constat fait
par l'auteur est celui de la guerre régionale et acteurs internationaux
autour du Kivu, enjeux politiques en 1995 et 1998. D'après ses analyses,
il constate que le génocide Rwandais est la principale
conséquence, car l'énorme exode qui en découla,
après la victoire du Front Patriotique Rwandais (F.P.R) en Juillet 1994
a représenté incontestablement pour ce qui regarde l'Afrique
centrale, un signal fort d'une mutation historique, profonde en termes de
mouvement et de déplacement de population, ses répercussions ont
même débordé largement, l'Afrique dite des Grands Lacs.
Samuel SOLVIT 6(*) est parti de l'observation selon laquelle les
Relations diplomatiques jouent un rôle dans la résolution des
conflits qui minent la République Démocratique du Congo depuis
tant d'années. Depuis sa création en 1885, ce pays est en proie
à des situations de conflits quasi permanentes. Du caoutchouc dans les
années 1890-1900 au coltan-cassitérite, à l'or ou au
pétrole dans les années 2000 en passant par le cuivre, l'uranium
ou le diamant dans les années 1960, ces ressources sont au coeur des
conflits congolais évoluant avec les besoins, les acteurs et les enjeux
internationaux. Et il a observé la diversité et la
complexité de ce rôle au cours de l'histoire du pays.
A l'époque coloniale, les ressources naturelles ont
joué un double rôle dans la dynamique des conflits du pays. Elles
ont tout d'abord servi à alimenter les conflits, car les ressources
naturelles étaient la finalité principale de l'oppression et de
l'exploitation. Les colons et les entreprises ont ainsi exercé ce
pouvoir pour ces ressources, mais aussi via ces dernières. Et à
plus long terme, elles ont contribué à la création d'une
structure politique, étatique, économique et territoriale du pays
instable, ce qui fut le terreau de conflits à venir.
D'où La guerre et l'économie sont
éternellement liées, pour des raisons évidentes de
financement de l'effort de guerre, et par ailleurs pour les liens plus «
métaphysiques » qui peuvent exister entre le pouvoir, l'argent et
la politique c'est ainsi qu'il est évident de privilégier les
relations diplomatiques.
TSHIMPANGA MATALA KABANGU et GONZALEZ, F.7(*), après avoir
étudié l'essence des conflits dans les pays de la région
des Grands Lacs, notamment au Burundi, en Ouganda, en RD Congo et au Rwanda et
leurs conséquences en Afrique Centrale et Australe, montrent que le
conflit en RDC revêt une dimension régionale.
Les peuples de la région des Grands Lacs sont si
étroitement liés les uns aux autres dans les domaines social,
économique, culturel et linguistique qu'une instabilité
provoquée dans un pays de la même région pour causes
internes, peut se propager rapidement jusqu'à créer une nouvelle
dynamique de conflit dans toute la région, la porosité des
frontières aidant.
Notre travail converge avec ces auteurs dans la mesure
où leurs analyses ont expliqué la prolifération des
groupes armés de faible envergure à l'Est de la RD Congo et
surtout par le fait qu'ils ont cherché à comprendre les
politiques adoptées pour mettre fin à la persistance de ces
groupes armés. Ces analyses ont une raison d'être quant à
ce qui concerne notre étude.
Nous nous démarquons de ces auteurs par le fait notre
étude aborde l'impact de la relation diplomatique entre en
République Démocratique du Congo et l'Ouganda en ce qui concerne
l'éradication de la troupe Rebelle ADF NALU longtemps installer et
émerger dans la partie Est du pays.
0.3. Problématique
Il va sans dire qu'avant de dégager la
problématique de cette recherche, il sied de rappeler avec
SHOMBA8(*) que celle-ci
signifie le problème à résoudre par des
procédés scientifiques. Comme substantif, elle désigne
l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue
d'une recherche des solutions.
En fait, Rocher corrobore cela en soulignant qu'elle est un
ensemble d'interrogations que se posent dans une étude ou que se pose un
chercheur autour d'une problématique donnée en vue de l'apprendre
ou de l'expliquer.
Elle demeure par ailleurs une angoisse qui provoque chez le
chercheur une curiosité, un désir de comprendre, d'expliquer ou
d'interpréter les faits qui se présentent comme un
problème à résoudre.
D'où la problématique d'une étude
signifie répondre à la question « pourquoi et
comment ? » au finish, elle participe à une meilleure
formulation de la question et d'une articulation des axes autours desquels
viendront s'organiser les matériaux.
Ainsi dit, toute bonne problématique part d'un
état de la question et débouche sur les hypothèses.
Il est évident que le terrorisme international est
depuis plus deux décennies une menace permanente dans le monde en
général et en République Démocratique du Congo en
particulier. Les pays comme la France, les Etats-Unis d'Amérique qui
sont les premières cibles pour n'est cité que ceux-là,
constituent de subir les frasques de la sauvagerie des groupuscules de gens
surtout de jeunes adolescents qui se revendiquent pour lutter contre la
domination américaine dans le monde. Ces groupes terroristes puissamment
armés ont généralement pour cible les gouvernements et les
équipes dirigeantes.
Etant donné la précarité de ces
conditions de vie dans cette partie du pays, comment l'Opération Ushujaa
contribue-t-elle à la lutte contre le terrorisme international dans les
villes de Beni et Butembo ? Telle est la question principale de
l'étude.
De cette question principale, nous avons dégagé
une question spécifique ci-après :
Ø Quels sont les résultats concrets de
l'Opération Ushujaa dans la lutte contre le terrorisme international
dans les villes de Beni et Butembo ?
0.4. Hypothèse
D'entrée de jeu, précisons que dans le langage
courant ce terme évoque la présomption que l'on peut construire
autour d'un problème donné estime SHOMBA K. elle est une
proposition de réponse aux questions que l'on se pose à propos de
l'objectif de la recherche formulée en terme tel que l'observation et
l'analyse puissent fournir une réponse.9(*)
Ainsi dit, nous estimons provisoirement accréditer
quelques éléments de réponse au profit des quelques
questions soulevées dans la problématique de cette recherche en
soulignant primordialement que le Monde en général et la
République Démocratique du Congo en particulier fait l'objet
depuis autant de tentatives du terrorisme international.
Eu regard aux questions sus-évoquées, nous
proposons les réponses provisoires que voici :
Ø L'opération Ushujaa contribuerai à la
lutte contre le terrorisme international en RDC en renforçant la
sécurité et la stabilité dans les zones touchées
par les groupes terroristes.
De cette hypothèse générale,
l'hypothèse spécifique qui en découle est la
suivante :
Ø L'Opération Ushujaa contribue également
à la lutte contre le terrorisme international en RDC en
renforçant la coopération régionale et internationale dans
la lutte contre le terrorisme. Les partenaires internationaux soutiennent
cette opération en fournissant une assistance technique et
financière pour renforcer les capacités des forces de
sécurité congolaises et améliorer la coordination entre
les pays de la région dans la lutte contre le terrorisme. La
coopération entre les forces armées congolaises et les forces de
maintien de la paix de l'ONU est essentielle pour neutraliser les groupes
armés menaçant la sécurité des populations civiles
en RDC. Les forces de maintien de la paix de l'ONU peuvent fournir un soutien
logistique et opérationnel aux forces de sécurité
congolaises, telles que des enseignements sur les mouvements des groupes
armés et une aide à la planification des opérations. De
plus, la présence des forces de maintien de la paix de l'ONU peut
dissuader les groupes armés d'attaquer les populations civiles et peut
aider à protéger les civiles lors des opérations
militaires. En outre, la coopération entre les forces armées
congolaises et les forces de maintien de la paix de l'ONU peut contribuer
à améliorer la coordination entre les différents acteurs
impliqués dans la lutte contre le terrorisme en RDC. Cela peut inclure
la coordination avec les forces armées d'autres pays (armée
ougandaise, armée burundaise, armée de la région et avec
les agences internationales telles que l'Union Africaine et l'Organisation
Internationale de police criminelle (INTERPOL). En fin de compte, la
coopération entre les forces armées congolaises et les forces de
maintien de la paix de l'ONU est essentielle pour neutraliser les groupes
armés menaçant la sécurité des populations civiles
en RDC.
0.5. Objectifs
En menant cette étude, nous avons d'une part un
objectif principal, et, d'autre part, un objectif spécifique.
a. Objectif général
Généralement la présente étude
vise à démontrer la contribution de l'opération Ushujaa
dans la lutte contre le terrorisme international dans les villes de Beni et de
Butembo.
b. Objectif spécifique
De cet objectif principal, l'objectif spécifique est de
dégager les résultats de l'Opération Ushujaa dans la lutte
contre le terrorisme international dans les villes de Beni et de Butembo.
0.6. Choix et Intérêt du
sujet
a. Choix du sujet
Le choix de ce sujet n'est pas un acte aléatoire
d'autant plus qu'il est tributaire de pertinence que le sujet porte sur le
Terrorisme international en Afrique Subsaharienne qui suffit des soubresauts
des actes terroristes de plusieurs sectes terroristes existant dans le
monde.
AL QAÏDA, AQMI, AQPA, BOKOHARAM, MNLA, AMSARDINE,
MUJAO... et vit dans une mouvance des guerres asymétriques.
Notons depuis les deux décennies, cette question
devient de plus en plus préoccupante suite à l'ampleur des actes
terroristes à travers le monde. Le terrorisme a été
toujours à la base d'un certain nombre de perturbation.
De nos jours, ces phénomènes viennent de prendre
une ampleur jamais égalée non seulement par ses complications,
mais aussi par les choix de cible visé par cette forme de violence. Nous
ne perdons de vue pour souligner les nombres croissant de leurs victimes qui
est également l'un des incidences de la montée en puissance qui
ne cesse de toucher notre conscience.
Ainsi le choix de notre sujet ci- haut notifie d'une angoisse
existentielle qui s'est installée en nous à partir de
l'observation de ce mouvement terroriste qui a secoué le monde entier en
général, et la République Démocratique du Congo en
particulier pendant ces deux dernières décennies.
b. Intérêt du sujet
Dans les traditions et cursus d'Universités
Contemporaines, la présentation et la défense d'un travail est on
ne peut plus une épreuve requise.
Mais elle se veut être une opportunité offerte
à l'impétrante de faire preuve de la connaissance acquise en tant
qu'acrobatisant intellectuelle dans sa discipline.
De l'autre côté communément
qualifié de récipiendaire, il devra dans le cas
échéant démontré de manière critique le
rapport existant entre son étude avec sa discipline tout en fournissant
de manière claire et objective des explications scientifique.
En effet, ce travail est intéressant pour la discipline
des Relations Internationales dans le sens où il participe au
débat et réflexion sur l'impact de la politique des Etats du
monde avec certaines Organisations Internationales dans la lutte contre le
terrorisme.
· Sur le plan scientifique : cette
étude va être bénéfique à la science car elle
va permettre à d'autres chercheurs voulant aborder la question les
opérations de paix de se servir de ce travail comme
référence.
· Sur le plan social et pratique :
Dévoiler à la face du monde les atrocités commises par les
terroristes des ADF associés aux armées rwandaises et
ougandaises.
0.7. Courant théorique
Les Relations Internationales expliquent le fait social
international comme se fondant sur un certain nombre des théories.
Voilà pourquoi dans cette étude nous avons opté pour la
théorie réaliste. En effet, c'est elle qui explique mieux ce
travail parce que dans toute l'histoire de l'humanité, les Etats se font
la guerre. Celle-ci se propose de considérer l'être humain ou les
faits sociaux internationaux tels qu'ils sont et non tels que l'on voudrait
qu'ils soient.
D'après les réalistes, le monde des Etats est un
monde de l'anarchie ayant pour base la souveraineté de chaque Etat.
Chaque Etat est souverain chez lui à cause du principe de
l'égalité souveraine des Etats. D'où
l'intérêt de chaque Etat est de garantir sa propre
sécurité.
C'est dans cette optique que Thomas HOBBES, dans le « Le
Léviathan » stipule que l'homme dans l'état de nature est un
loup pour l'homme. C'est après des décennies que l'homme à
céder au Léviathan Etat » son droit d'assurer sa propre
sécurité mais aussi celui de se rendre justice. D'où la
suppression de la loi du plus fort. En contrepartie, si l'Etat remplit ses
fonctions, la population dans le pacte politique et social s'engage à
respecter l'Etat et lui rendre son autorité. D'après ce courant,
l'anarchie et la recherche de la sécurité sont à la base
de la règle du plus fort. A ces deux idées il faudra ajouter
l'intérêt général qui est la finalité de
toute politique étrangère et la boussole guidant l'action de
l'Etat parce que les Etats n'agissent qu'à fonction de cet
intérêt.
D'après Hans MORGANTHAU10(*), l'intérêt général est
synonyme de puissance mais cet intérêt n'est pas lié
à la puissance plutôt à la souveraineté parce qu'en
droit chaque Etat est souverain ; tous les Etats sont égaux.
L'intérêt général est lié aussi à la
puissance parce que celle-ci est floue (volonté de se battre,
connaissance du terrain et expertise dans la mesure où la puissance
n'est comptabilisable). D'où la puissance est différente de la
force qui par contre peut être mesurable et comptabilisée.
Quant à Kenneth WALTZ, en distinguant la politique
interne de la politique internationale dans son principe ordonnateur, conclut
l'incompatibilité entre l'espace national ou interne et l'espace
international. Dès lors il considère que l'anarchie
internationale est la variable structurelle du système international.
D'où son postulat « la guerre existe parce que rien ne
l'empêche » c'est-à-dire aucune autorité analogue
à l'Etat ne peut prétendre appliquer.11(*)
Quelques lois en usant de la force pour empêcher qu'un
Etat ne recourt à la guerre comme moyen de la politique
étrangère.
Les intérêts étant diamétralement
opposés comme le jour ct la nuit, les rapports entre les Etats ne
peuvent être que conflictuel. Les richesses étant elles aussi
inéquitablement reparties sur la surface du globe, les rapports entre
les Etats ne peuvent engendre que les conflits.
Comme les Etats n'ont pas d'amis, pas des frères, ils
n'ont que des intérêts à sauvegarder ct à
protéger et que le conflit se trouve dans les espaces, le territoire de
Beni constitue un espace vital pour ces rebelles ADF-NALU qui ne cessent de
piller les ressources et d'endeuiller ce territoire.
Signalons qu'il existe 3 catégories
d'intérêt pour lesquelles les Etats ne négocient pas, ils
se font la guerre, Il s'agit des intérêts politiques liés
à la sécurité, les intérêts
économiques liés à la prospérité et les
intérêts culturels liés à l'identité. Donc
les Etats ne se recroquevillent pas dans leur tour de voir, ils se tournent
résolument vers l'extérieur et pratiquent la politique
extérieure. Les Etats n'ont que des intérêts et ces
intérêts sont vitaux, totaux, globaux et nationaux qu'on ne
transige pas.
0.8. Cadre Méthodologique
Dans la tradition académique de toutes les sciences, il
est toujours recommandé à tout chercheur de faire mention de la
méthodologie qu'il a mobilisée pour accomplir sa recherche. Pour
satisfaire à cette exigence, la présente étude a recouru
essentiellement à la méthode géopolitique appuyée
par technique d'observation et à l'analyse documentaire.
Globalement, la perspective critique consistant à
dégager les contradictions dans les discours et l'agir du gouvernement
congolais face aux séquences de violences connues ces dernières
décennies, a suggéré un examen minutieux de
l'évolution historico-juridique concernant multiples aspects : le
traitement du terrorisme par les instances internationales, les attitudes et
les comportements des puissances frappées par ledit
phénomène et qui sont à l'origine de principales lois,
résolutions et conventions internationales s'y rapportant, l'impact
exercé par la lutte contre le terrorisme international sur la
reconfiguration des stratégies politiques des dirigeants des pays du Sud
confrontés aux pressions populaires sur l'alternance au pouvoir...Autant
de pesanteurs qui ont déterminé notre démarche.
Il s'est agi également de saisir les dynamiques
à la fois internes et externes de la crise en RDC face au
déploiement insidieux du phénomène de terrorisme. La
complexité du terrorisme à l'ère digitale
révèle bien des zones d'incertitude quant à
l'élucidation cohérente du concept « terrorisme » face
à tous les autres phénomènes souvent qualifiés de
terrorisme sous l'effet de la mode (labélisation idéologique et
stratégique).
1. Méthode
Il va sans dire que, les sciences sociales sont
forcément différentes des sciences exactes dans ce sens ou elles
sont fortement influencées par l'opinion et la subjectivité
susceptibles d'alerter les résultats de la recherche.
Afin de réduire l'influence de l'opinion et de la
subjectivité, l'investigation, la collecte des données doivent
être soutenues par un raisonnement conduit rigoureusement à l'aide
de méthode.
Par méthode nous entendrons « une marche
raisonnée que l'on suit pour arriver à la connaissance ou
à la démonstration de la vérité » elle est
selon l'expression de ROUSSELOT P « Le chemin le plus droit, le plus
sûr pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration de la vérité ou la communiquer lorsqu'elle
est découverte »
Elle apparait comme direction donnée à
l'intelligence, la voie suivie naturellement par l'esprit pour acquérir
la science avec facilité et sureté. On peut la définir
comme un ensemble des règles à suivre ou des moyens à
employer premièrement pour découvrir la vérité
quand on l'ignore et deuxièmement pour la démontrer quand on la
possède.
C'est ainsi que dans l'élaboration du présent
travail, nous avons fait recours principalement à la méthode
Géopolitique qui est une approche d'analyse des relations
internationales qui étudie les interactions entre les Etats et les
acteurs internationaux en se basant sur les aspects géographiques,
économiques, politiques et culturels. Cette méthode
s'intéresse notamment à l'étude des territoires, des
frontières, de ressources naturelles, des flux migratoires et des
influences culturelles pour comprendre les enjeux et les dynamiques
géopolitiques à l'échelle mondiale12(*).
Pour Delphine Papin13(*), ce qui caractérise les situations
géopolitiques, c'est le fait que des territoires petits ou grands, sont
l'objet de rivalités de pouvoirs ou d'influences : rivalités
entre des pouvoirs politiques de toutes sortes et pas seulement entre Etats ou
avec des peuples qui n'ont pas encore leur propre Etat, mais aussi entre des
mouvements politiques ou des groupes armés plus ou moins clandestins,
toutes ces rivalités ayant pour buts le contrôle, la
conquête ou la défense de territoires. L'intérêt
porté aujourd'hui aux situations géopolitiques s'explique par
l'inquiétude que suscitent certains conflits dont on craint que par
contrecoups ils puissent menacer l'équilibre d'une région, voir
du monde.
Le modèle construit par abstraction conduit
inexorablement à la mise à l'écart d'un grand nombre de
caractéristiques qui peuvent avoir ensuite une très grande
importance. Les situations géopolitiques sont constituées d'un
enchevêtrement et d'une multiplicité de facteurs tant d'un point
vue spatial que temporel, et non seulement dans le passé mais aussi dans
le présent, ce qui en fait des situations dynamiques qui
évoluent, plus ou moins rapidement, et qui peuvent, parfois brusquement
basculer dans le drame.
Ce qui peut et doit être théorisé avec
rigueur, c'est la démarche géopolitique qui sert à
comprendre des situations compliquées dont il est difficile de percevoir
les tenants et les aboutissants et qui nécessitent donc de mener un
raisonnement diatopique et diachronique, c'est-à-dire s'appuyant
à la fois :
Ø Sur le raisonnement géographique à
différents niveaux d'analyse et sur les intersections des multiples
ensembles spatiaux ;
Ø Sur le raisonnement historique qui intègre les
différents temps de l'histoire et du présent ;
Ø Sur la nécessaire prise en compte des
représentations plus ou moins subjectives que se font les
différents acteurs à propos de chaque territoire, enjeu d'une
rivalité de pouvoirs14(*).
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru
à la méthode géopolitique selon le schéma
donné par Éric Mottet et Frédéric
Lasserre.15(*) La
méthode de l'analyse géopolitique impose de respecter plusieurs
étapes absolument nécessaires à la compréhension
d'un enjeu donné. En voici le schéma ci- dessous :
Ø Identifier et délimiter le ou les
enjeux ; car en géopolitique, l'enjeu est source de tension, de
crise, de conflit, voire de guerre, dont la cause peut être diverse et
multiple.
Ø Identifier l'espace ou le territoire. La connaissance
du territoire traité constitue donc une étape essentielle et
nécessaire.
Ø Identifier les acteurs internes et externes. Les
acteurs sont plus nombreux que dans le passé et ils interfèrent
de multiples manières. Il importe de ne pas oublier que l'État
n'est pas le seul acteur possible en géopolitique.
Ø Identifier les différents niveaux
d'échelles. L'analyse d'enjeux géopolitiques faisant intervenir
des acteurs aux identités multiples et présents à
différentes échelles, il devient impossible d'étudier ce
phénomène en le situant à un seul niveau d'analyse,
à une seule échelle.
Ø Identifier les représentations des acteurs
internes et externes. Prendre en compte les représentations des acteurs
en géopolitique permet de saisir les enjeux que constituent le
territoire et ses ressources pour les différents acteurs en cause, de
rendre compte des argumentations, officielles et inexprimées, et de
souligner les mécanismes cognitifs qui ont conduit à
l'élaboration de prises de position et/ou d'actions pouvant
déboucher sur des tensions, et dans certains cas donné lieu
à des conflits.
La méthode géopolitique permet ainsi de
comprendre les relations de pouvoir entre les Etats, les alliances et les
conflits internationaux, ainsi que les enjeux économiques et
stratégiques qui sous -tendent ces relations. Elle est utilisée
par les analystes politiques, les diplomates, les militaires et les
décideurs politiques pour élaborer des stratégies et des
politiques internationales. Dans le cadre du présent travail, la
méthode géopolitique.
La méthode susmentionnée a été
appliquée dans notre recherche comme suit :
Ainsi dans le cadre du présent travail, l'enjeu majeur
porte sur l'opération Ushujaa et lutte contre le terrorisme
international dans les villes de Beni et de Butembo.
Les territoires de notre analyse ici, c'est la région
du Nord-Kivu, c'est-à-dire la ville de Beni et celle de Butembo.
Dans le cadre de notre analyse, les acteurs Internes sont les
FARDC et les acteurs externes sont les UPDF (armée ougandaise).
Dans notre étude le niveau d'échelle se divise
en deux nouveaux. D'abord au niveau national et en suite au niveau
International.
2. Technique
Contrairement à la méthode qui est une
démarche intellectuelle permettant au chercheur d'atteindre un but, la
technique à son tour se présente comme un outil ou moyen de
collecte des informations liées au but défini.
Dans le cadre du présent travail nous avons opté
pour les deux techniques : d'observation indirecte
désengagée et la technique documentaire.
En effet, si la première technique s'est
focalisée sur l'identification des acteurs incriminés, des faits
et circonstances qualifiés comme des preuves ou manifestations du
terrorisme en RDC (qu'il s'agisse de rébellions ou
contre-rébellions, ou encore d'actes de violence individuels et de
groupes, coordonnés ou isolés) par les observateurs nationaux,
dont le gouvernement congolais, la seconde a prouvé son importance dans
la récolte d'une diversité de documents (y compris ceux offerts
par Internet et divers médias) et leur examen systématique
s'appuyant sur l'analyse de contenu. Grâce à celle-ci, il a
été possible de dégager de documents les orientations et
significations politiques et idéologiques sur le phénomène
de terrorisme contemporain (post-guerre froide).
0.9. Délimitation
Cette étude est délimitée dans le temps
et dans l'espace.
Ø Dans le temps, cette étude couvre la
période allant de 2016 jusqu'en 2022.
Ø Dans l'espace, cette étude couvre l'espace
grand Kivu précisément à Beni, Butembo...
0.10. Difficultés rencontrées
Nous n'avons pas réalisé notre étude sans
difficultés car, sur terre, toute oeuvre est le fruit de la sueur du
front. Ceci étant, tout au long de notre recherche, nous sommes
heurtés aux difficultés ci - après : La
partialité de la plupart des auteurs qui avait écrits sur notre
sujet et le manque des moyens suffisant pour se procurer ses ouvrages relatifs
à notre sujet. Il nous a fallu faire usage de l'esprit de
lucidité, et de critique pour concourir à détourner
certaines difficultés. Nous nous sommes contentées de notre
vieille bibliothèque centrale et l'internet pour nous documenter sur la
situation étudier.
0.11. Subdivision
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail est subdivisé en trois chapitres dont le premier est axé
sur les considérations générales, le deuxième quant
à lui est axé sur l'Opération Ushujaa et lutte contre le
terrorisme dans les villes de Beni et de Butembo et en fin le trois est
basé sur les résultats de l'Opération
Ushujaa.
Chapitre premier: Considérations générales
sur le terrorisme
Le terrorisme n'est pas un concept nouveau dans la
sphère des sciences sociales, mais surtout dans les domaines de
recherche relatifs aux questions sécuritaires. La réalité
qu'il vise à décrire est tout aussi vieille que le concept
lui-même (Hennebel et Lewkowicz, 2009, p. 20). Ce qui paraît
nouveau, c'est la place prépondérante que le terrorisme occupe
désormais dans le discours politique et surtout médiatique,
particulièrement depuis les attaques menées par le groupe
Al-Qaïda, le 11 septembre 2001, contre diverses cibles
aux Etats-Unis d'Amérique (USA) dont les tours jumelles du
WorldTradeCenter à New York.
L'accaparement apparent du concept terroriste par les
pouvoirs publics a eu pour conséquences, entre autres, son
instrumentalisation et son exploitation comme outil permettant de
discréditer, de décrédibiliser, voire de
déshumaniser des adversaires réels ou imaginés. Pourtant,
la réalité que ce concept vise à décrire n'a jamais
été aussi menaçante pour le genre humain. Il convient,
toutefois, de rappeler que l'abus du terme terrorisme par les acteurs
politiques pour leurs intérêts n'est pas un
phénomène nouveau.
En effet, au plus fort moment de sa lutte contre le
régime d'apartheid16(*) en Afrique du Sud, par exemple, Nelson Mandela
fut qualifié de "terroriste" par le pouvoir
ségrégationniste sud-africain et ses alliés
américains et britanniques. Son nom demeura d'ailleurs sur la liste
"terroriste" du gouvernement américain jusqu'au lendemain de son
départ de la présidence sud-africaine en 1999 et ce,
malgré la précipitation de la part de tous les dirigeants
occidentaux, y compris américains, d'apparaître
régulièrement en public à ses côtés.
Cet article (Le Terrorisme : Un Concept Abusé, Une
Menace Réelle. Le Cas De La République Démocratique Du
Congo) analyse les contradictions autour du terme terrorisme : un concept
abusé, mais décrivant une menace sociétale contemporaine
réelle. Il les applique ensuite au cas de la République
Démocratique du Congo (RDC). L'hypothèse principale est que
l'instrumentalisation du concept terroriste par les acteurs politiques
congolais contribue à empêcher une meilleure saisie d'un
phénomène représentant pourtant une menace
sécuritaire réelle pour un Etat (congolais) encore au stade de
son édification ou affermissement et qui peine à se consolider.
Ce faisant, cette instrumentalisation empêche la formulation des
stratégies adéquates en vue de la prévention et de
l'éradication de ladite menace.
1.1. Esquisse définitionnelle et notionnelle
1.1.1. Opération Ushujaa
1.1.2. Opération
Le mot « opération » veut dire l'ensemble
organisé des processus qui concourent à l'effet, à
l'action d'une fonction, etc. Autrement dit, c'est l'ensemble des combats et
des manoeuvres exécutés par des forces militaires dans une
région en vue d'atteindre un objectif précis ; intervention des
forces de police17(*).
Le Dictionnaire Grand Robert18(*), définit l'opération comme l'ensemble
de mouvements, de manoeuvres, de combats qui permet d'atteindre un objectif,
d'assurer la défense d'une position, le succès d'une attaque.
1.1.3. Ushujaa
L'opération Ushujaa est une opération militaire
qui contribue à la lutte contre le terrorisme international en RDC en
renforçant la sécurité et la stabilité dans les
zones touchées par les groupes terroristes.
Cette opération consiste en une coopération
entre les forces armées congolaises et les forces de maintien de la paix
de l'ONU pour mener des opérations conjointes visant à
neutraliser les groupes armés qui menacent la sécurité des
populations civiles.
1.1.4. Lutte
Le dictionnaire universel, définit la lutte comme toute
action contre une force, un phénomène, un évènement
nuisible ou hostile19(*).
Ce qu'il faut retenir est qu'il existe plusieurs formes de lutte parmi
lesquelles l'on peut citer : la lutte contre le cancer, la lutte
antipollution,lutte biologique c'est-à-dire méthode de
destruction des animaux nuisible, lutte chimique, lutte des
éléments, lutte du droit et du devoir.
Ainsi, dans le cadre de cette étude, c'est la
première forme de lutte qui nous intéresse, c'est-à-dire
celle qui consiste à lutter contre une force, un
phénomène, un élément nuisible ou hostile. Car ici,
il s'agit de combattre le terrorisme considéré comme un
phénomène qui préoccupe la communauté
internationale en général et la République
Démocratique du Congo en particulier.
1.1.5. Terrorisme international
a. Terrorisme
Il n'existe pas de définition unanime de la notion de
« terrorisme », car les Etats et les opinions continuent à
diverger au sujet de cette définition. Mais faudrait-il noter que
certains instruments juridiques internationaux donnent une définition de
la notion de « terrorisme », de ce nombre figure la Convention arabe
contre le terrorisme qui prévoit à son article 1er (2)
que :
« le Terrorisme s'entend de tout acte ou menace de
violence, quels que soient ses motifs ou les buts, qui serait l'instrument d'un
projet criminel individuel ou collectif, et viserait à semer la terreur
dans la population, à lui inspirer la peur, en lui portant
préjudice ou en mettant sa vie, sa liberté ou son
indépendance en péril, à causer des dommages à
l'environnement, à une installation ou à un bien, tant public que
privé, à occuper ces installations ou ses biens ou à s'en
emparer, ou à mettre en danger une ressource nationale
»20(*).
Aussi vieux que l'humanité, le terrorisme appartient
à tous les temps, tous les continents et toutes les confessions, les
oubliettes de l'histoire renferment des périodes ou terrorisme et
angoisse se confondirent. Ainsi le 24 juin 1984, un immigré italien
anarchiste Caserio, tue le président français Sadi Canot et cet
attentat marque l'apogée d'une série perpétrée, en France21(*) perpétrée, en France21(*)
En général, le terrorisme n'est pas synonyme de
violence politique. C'est une forme particulière de violence dont le but
est de créer un climat de peur, dans un groupe d'individus
généralement à des fins politiques ou
idéologiques.



Dans la mise en oeuvre de leur action, les terroristes
cherchent à obtenir une publicité massive et immédiate
à la suite d'un attentat ou d'une série d'atrocités,
susciter des adeptes et des sympathisants qui se lanceront dans d'autres actes
de terrorisme ou dans une insurrection, provoquer de la part des
autorités des réactions répressives disproportionné
qu'ils pourront alors exploiter à leur avantage politique.
Le terrorisme est aussi utilisé comme un moyen de
forcer les autorités à faire des concessions, telles que la
libération de terroristes emprisonnés, sur le paiement d'une
rançon, mais également à provoquer des conflits
intercommunautaires en semant la haine ; de détruire la confiance du
public dans le gouvernement et les agences de sécurité, de
contraindre les communautés et les activistes d'obéir directement
aux directives terroristes.
Le terrorisme se caractérise ainsi comme une
méthode de lutte au coût peu élevé à faible
risque, au rendement potentiellement élevé.
Toutefois, parmi les très nombreuses définitions
contemporaines sur le terrorisme, celle présentée par le juge
Gilbert Guillaume attire notre attention. Ce dernier considère que
« le terrorisme implique l'usage de la violence dans des conditions de
nature à porter atteinte à la vie des personnes ou à leur
intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant pour but
de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins
».22(*)
Le droit international humanitaire interdit les actes de
terrorisme contre les personnes civiles et les biens de caractère civil
dans les conflits armés internationaux ou non-internationaux.
Ainsi, l'article 33 de la Convention (IV) de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et
l'article 4 (al 2, d) du Protocole additionnel II relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux
interdisent toute mesure d'intimidation ou les actes de terrorisme à
l'égard des personnes protégées et de leurs biens. En
Afrique, l'article 3 de la Convention sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme interdit tout acte terroriste. A la lumière de
cette disposition, figurent parmi les actes terroristes interdits, ceux qui
sont susceptibles de mettre en danger la vie humaine, de provoquer une
situation de terreur ou d'amener tout Gouvernement à renoncer à
une position particulière de même que toute promotion ou
financement ayant pour but de les commettre.
Etant un recours illégal, le terrorisme vise à
répandre la terreur pour atteindre des objectifs notamment politiques,
religieux ou idéologiques.23(*)
Le blanchiment de capitaux et le terrorisme sont
considérés, à l'échelle planétaire, comme
les pires fléaux hérités du vingtième
siècle, le premier mettant en péril les systèmes
économiques et financiers des Etats, le second menaçant la paix
et la sécurité internationales par la multiplication, dans
diverses régions du monde, des actes terroristes motivés
notamment par l'intolérance et l'extrémisme. Ces deux
fléaux qui faisaient déjà l'objet de préoccupations
de l'ensemble des Etats, sont devenus les points de mire de plusieurs
organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies
(ONU), le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international de
la Drogue et la Prévention des Crimes (PNUCID), le Groupe d'Action
Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI), lesquelles ont
élaboré des instruments juridiques et formulé des
recommandations pour impulser une lutte commune et impérativement
coordonnée face à cette criminalité sans frontière.
Par ailleurs, cette prise de conscience s'est manifestée dans plusieurs
Etats par l'élaboration et la mise en place des cadres juridiques et des
structures appropriées en vue, d'une part, d'éviter l'expansion
de ces phénomènes et, d'autre part, d'aboutir à leur
éradication. La République Démocratique du Congo ne
pouvait demeurer en reste.24(*)
Justement, le législateur congolais (RDC)
s'intéresse beaucoup plus à la question du blanchiment et des
financements du terrorisme. Pour ce législateur, le terme «
terrorisme » désigne les actes en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur, à savoir :
a. Les atteintes volontaires à la vie ou à
l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la
séquestration de la personne ainsi que le détournement
d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport ;
b. Les vols, extorsions, destructions, dégradations et
détériorations ;
c. La fabrication, la détention, le stockage,
l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou
autres armes biologiques, toxiques ou de guerre ;
d. tout autre acte de même nature et but consistant en
l'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans
les eaux de la République, d'une substance de nature à mettre en
péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu
naturel.25(*)
1.
Définition du terrorisme
Partant du fait qu'il n'existe pas une définition
unique et acceptable par tous les acteurs de Relations Internationales du
concept terrorisme, nous essayerons d'en répertorier un certain nombre
qui peuvent nous éclairer dans sa conception.
Ainsi, Raymond Aron décrit le terrorisme comme une
action dont les effets psychologiques sortent hors des propositions avec ses
résultats purement physiques26(*). Nous nous rendons bien compte qu'il met plus
l'accent sur l'aspect physique des attaques terroriste.
Paul Wilkinson donne une définition plus précise
car selon lui, le terrorisme est l'usage systématique de la violence par
de petits groupes conspiration dont le but est d'influencé des positions
plutôt que de défaire maternellement l'ennemi. Pour lui,
l'intention de la violence terroriste est psychologique et symbolique27(*).
Nous pouvons aussi ajouter la définition donné
par Anne Marie la Rose qui définit le terrorisme comme tout acte
illicite de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus,
agissant à titre individuel ou avec l'approbation, l'encouragement, la
tolérance ou le soutien d'un objectif idéologique, et susceptible
de mettre en danger la paix et la sécurité
internationale28(*).

La principale autorité de la langue anglaise, le
vénérable Oxford English Dictionary (OED), donne une
définition assez flou et vague du terrorisme car sa définition
est plus littéraire et historique sa définition est tellement
vague qu'elle peut s'appliquer à toute les actions qui font peur.
Selon l'OED, le terrorisme est un système de terreur ou
un gouvernement fondé sur l'intimidation tel que l'a mis en place et
développé le parti en pouvoir en France pendant la
révolution entre 1789 et 1794 ou encore comme la politique
destinée à frapper de terreur ceux contre qui elle est
employée ; c'est aussi l'emploi de méthode d'intimidation ; le
fait de terroriser ou l'état d'être terrorisé29(*).
La difficulté qui entoure la définition du terme
terrorisme réside dans le fait que cette expression à une
connotation émotionnelle négative. D'une manière
générale, les gens emploient cette expression pour exprimer la
désapprobation d'une variété de phénomène
qui leurs déploient.
Le terrorisme se définit aussi comme une lutte
menée sur la durée pour atteindre des objectifs, qui utilisent
des moyens comme des attentats contre la vie et les biens des gens en
perpétuant tout particulièrement des crimes graves tels que
détailles dans le code pénal (volontaires, utilisation
d'explosifs) ou un moyen d'autres acte de violence qui servent à
préparer de tels actes criminels.
A.
Typologie du terrorisme
Nous pensons que c'est à travers les actions, les
objectifs et les idéologiques que la classification ou la typologie a
été rendue possible. Le terrorisme d'Etat se développe
pendant la guerre froide. Essentiellement mis en oeuvre dans les pays
latino-américains alors soumis à des dictatures mais aussi
à des pays comme la Grèce de 1967 à 1974, ou encore
l'Indonésie et la Corée du sud, le terrorisme d'Etat constitue
l'un de plus important car il consiste en une mobilisation
générale de la société dans une guerre contre
l'ennemi intérieur, la sécurité nationale qui constitue
l'ossature idéologique du terrorisme d'Etat, trouve son origine dans des
doctrines comme celle de Maroc ou de Truman.
Cela débouche une politique de contre insurrection,
dont les mouvements les plus forts sont des coups d'Etats fomentés avec
l'aide d'autres Etats puissants. En guise d'exemple, nous pouvons parler de
l'intervention américaine contre les régimes progressistes
d'Arvenz ou Guatemala (1954), et de Isaac Goulart au Brésil (1964), de
Salvador Allende au Chili (1973 et contre les régimes instables
d'Uruguay (1973) avec guérilla des Tupa Maros) et d'Argentine (1976).
1. Terrorisme religieux
Nouvellement apparu dans l'actualité de cette fin de
siècle, le terrorisme d'inspiration religieuse est en fait l'une de plus
anciennes manifestations du terrorisme. Entre 66 et 77 avant Jésus
Christ, en Palestine, les étoiles combattirent l'occupation romaine avec
des méthodes relevant du terrorisme en employant du poison pour
empoisonner les puits, assassinat et massacrant la population.
Selon les terroristes religieux, la violence est d'abord avant
tout un acte ou un impératif religieux ou théologique. Ici, le
terrorisme comporte une dimension transcendantale, et c'est pourquoi ses
auteurs ne sont pas affectés par des contraintes politiques, morales qui
peuvent atténuer l'aspect aveugle de leur action.
La caractéristique du terrorisme religieux est qu'il
s'inscrit dans une référence non temporelle. Ses objectifs ne se
situent pas au niveau de la société mais plutôt au niveau
des idées, de la morale ou de la spiritualité.
Le terrorisme religieux évolue dans un système
complexe des valeurs d'ordre moral ou spirituel, face auquel la vie humaine n'a
qu'un poids limité. C'est une sorte de croisade contre l'infidèle
qui se veut porteur d'un message religieux, il se rapproche du terrorisme
politique mais n'en distingue par l'intensité des actes. Voilà
pourquoi dans le cadre du présent travail nous considérons les
ADF comme le terrorisme politico-religieux.
2. Terrorisme politique
Il se situe dans un processus révolutionnaire mais
juste en amant d'un conflit ouvert. Il constitue l'outil armé des partis
politiques extrémistes, dont ils exploitent le soutient populaire pour
se légitimer. C'est le cas de l'Irish République Army (IRA).
Le terrorisme nord irlandais en dépit de la violence
entre les communautés catholiques et protestantes n'est pas un
terrorisme d'inspiration religieuse il est le moyen choisi pour changer une
situation politique et sociale issue d'une époque ou appartenant
à l'une ou l'autre communauté30(*).
Le terrorisme politique, même s'il est meurtrier, fait
souvent preuve de retenue car il a pour objectif le plus souvent de
démontrer la capacité à tuer, une capacité de
conserver l'initiative et est ainsi d'avantages une manifestation de la
puissance.
3. Terrorisme individuel
C'est l'image de la terreur promouvoir une activité
criminelle lucrative. Le terrorisme de droit commun ne s'intègre pas
dans un processus révolutionnaire et cherche à mettre la pression
sur l'Etat afin de garantir sa liberté d'action face au pouvoir
politique, son soutien populaire peut être relativement important au
niveau local et c'est le genre de soutien
Accordé aux narcoterroristes qui, de facto, assurent
une certaine prospérité à la région.
Le terrorisme individuel est une pratique qui s'est
développée à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle. Ce terrorisme a été
pratiqué par quelques anarchistes comme Ravachol Vengeant la
Répression de Fourmies en 1891 et sante GERONIMO CASERIO vengeant la
répression exercée sur les assassinant en 1894 le
président Sadi CARNOT. Les Etats-Unis ont connu une vague d'attentats
anarchistes pendant la guerre de 1919-1920. Des attentats d'inspiration
anarchistes ou nihiliste ont été commis dans divers pays (Russie,
Espagne, Italie, etc.).
Les attentats des nihilistes ou des anarchistes visaient des
personnalités de la sphère politique ou proche (le riche, le
militaire, le prêtre, l'homme politique, etc.) ayant participé
à réprimer la population ou l'un de leurs camarades.
L'idée étant qu'une fois supprimes les acteurs de la
sphère politique répressive. Ce terrorisme avait un
caractère spontané et une base sociale.
4. Terrorisme d'Etat
Le terrorisme d'Etat est une notion controversée,
utilisé pour de signe « des actes » terroriste menés
par un Etat, on parle également de terrorisme d'Etat dans le cas
où les actions terroristes ont été commanditées ou
manipulées ou complaisamment ignorées par un Etat. Et les
méthodes employées sont strictement des méthodes de
terrorisme (enlèvement, séquestration, assassinat) mais sous
couvert de la raison d'Etat. Exemple typique du terrorisme d'Etat est « la
guerre sale ». Conduite par des services de l'Etat Espagnol à
l'encontre du groupe armée nationaliste.
L'expression « terroriste d'Etat » est parfois
utilisée pour décrire desagressions ouvertement commises par un
Etat contre un groupe particulier. La terreur a la source du « terrorisme
d'Etat », peut aussi relever du crime contre l'humanité.
Dans le monde contemporain la Turquie est accusée de
terrorisme par des militants Kurde, l'Indonésie par des militants Tamil,
l'Israël par des militants Palestiniens ainsi que les pays qui lui sont
hostiles et en particulier à la suite des opérations militaires
Israéliennes de juillet-août 2014 menées dans la bande de
GAZA et dont les victimes sont en partie des civils.31(*) La Bolivie a classé
Israël comme « Etat terroriste » afin de protester contre cette
guerre.
5. Terrorisme informatique ou cyber
terrorisme
La criminalité informatique est un vaste domaine, dont
les frontières ne sont pas faciles à définir et chaque
pays a une législation différente à ce sujet, le
terrorisme informatique est le fait de détruire ou de corrompre de
systèmes informatiques, dans le but de déstabiliser un pays ou de
faire pression sur un gouvernement. Mais, il est vrai que les attentats
informatiques restent limités car la majorité des
activités reflètent l'occidentalisation de leur pays et par
conséquent, la technologie avec elle.
Pour Mark POLLITT, membre du FBI définit le cyber
terrorisme comme « une attaque préméditée,
politiquement motivée, contre l'information, les systèmes
informatiques et les données contre les cibles non combattantes ou
combattantes par des groupes nationaux ou des agents clandestins.32(*)

Selon Maurice Cuisson33(*), ces différents types de terrorisme
précités sont motivés par quatre éléments
suivants :
v La haine vengeresse (la haine débouche sur la
détermination sur de venger les exactions dont les ennemies seraient
responsables) ;
v La dissuasion (pour que la population terrorisée
fasse pression sur le gouvernement) ;
v La propagande (pour frapper les esprits) et ;
v La provocation (pour pousser un gouvernement à
surgir).
b. International
Qui a lieu, qui se fait de nation à nation, entre
plusieurs nations34(*).
L'international fait référence à
l'ensemble des relations et des échanges entre les différents
pays et les acteurs non-étatique à travers le monde. Cela
comprend les relations diplomatiques, les accords commerciaux, les
organisations internationales, les conflits internationaux, les enjeux
environnementaux et sociaux qui ont une portée mondiale, et bien
d'autres aspects qui transcendent les frontières nationales.
L'international est un domaine d'étude et d'action important pour les
gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales et la
société civile dans son ensemble.
Dans le cadre de ce sujet, le terme international fait
référence au caractère transnational du terrorisme et de
l'Opération Ushujaa, qui implique la collaboration entre
différents pays et organisations internationales pour lutter contre
cette menace dans les zones ciblées c'est-à-dire à
Béni et à Butembo.
1.2. Présentation du milieu
d'étude
1.2.1. Présentation
de la RépubliqueDémocratique du Congo
a. Situation
géographique
La RDC est le plus vaste pays en Afrique au sud du Sahara et
le troisième du continent par sa taille35(*).Au centre de l'Afrique, à cheval sur
l'équateur, elle bénéfice des conditions
géographiques privilégiées qui jouent en sa faveur.
Compris entre 50°20° de latitude de Nord et
130° de latitude de Sud, il s'étend entre 12°15' et
13°15' de longitude Est. La RDC couvre une superficie de 2.345.000
km², environ 33 fois plus grand que le BENELUX (Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg), quatre fois plus grand que la France ou deux fois plus que le
Québec. En Afrique seuls le Soudan et l'Algérie sont plus
étendus que la RDC.
Partageant neuf frontières avec ses voisins, le
Congo-Kinshasa est limité à l'Ouest par le Congo-Brazzaville, au
Nord par la République centrafricaine et le Soudan, l'Est par l'Ouganda,
le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie au Sud par la Zambie et l'Angola.
La disposition de relief accentue la situation continentale du
pays dont les relations extérieures dépendent en partie des pays
voisins.
En réalité la RDC est un pays
semi-enclavé du fait qu'en plus de la faible densité de ses
réseaux de communication, elle ne possède qu'une façade
maritime, sur l'océan Atlantique de 37km. En raison de sa superficie, de
ses richesses et de son importante population, le Congo demeure l'un des
géants de l'Afrique, avec l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
Par ailleurs, signalons aussi bien que la constitution de 2005
de la RDC prescrit un nouveau découpage du pays en 25 provinces, tout en
conservant la ville-province de Kinshasa comme capitale du pays, mais
actuellement le Congo se compose des provinces suivantes : le Bandundu, le
Bas-Congo, le Kasaï occidental et oriental, le Maniema, le nord et sud
Kivu.
Parmi les avantages à faire valoir de sa situation
géographique, la RDC est le premier pays d'Afrique du point de vue de
l'étendue de ses forêts dont la moitié du territoire
Nationale est occupé par la forêt équatoriale au nord et le
plus important pour la préservation de l'environnement mondial. L'Est du
pays est le domaine des montagnes, des collines, des grands lacs mais aussi des
volcans. Le Sud et le Centre en savane arborées, fortement un haut
plateau en minerais divers.
La position de la RDC sur l'équateur a une influence
essentielle sur les données climatiques et lui fait
bénéficier du privilège d'appartenir à une zone
intertropicale. Le climat général du pays est chaud et humide,
mais cette situation varie selon les provinces, ainsi donc le pays comprend
trois types de climat : le climat tropical, le climat tempéré et
le climat équatorial.
L'existence des tels climats produit une
végétation dense et régit les activités Agricoles
de la population Congolaise. Car à l'exception des montagnes, tout le
pays bénéficie des températures moyennes
élevées, assurant le minimum de chaleur indispensable à la
vie végétale.
Il nous faut retenir que la RDC se classe parmi les dix
premiers pays de la méga biodiversité du monde avec plusieurs
espèces diverses ; de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de
reptiles, de batraciens et angiospermes. Elle dispose d'une faune naturelle
exceptionnelle où l'on y trouve tous les grands animaux de l'Afrique et
des espèces rares.
Elle dispose aussi d'abondantes ressources en eau, des lacs
poissonneux notamment le lac Tanganyika (plus grand que le Burundi) le plus
poissonneux du monde36(*).
b. Situation politique
La situation politique de la RDC est restée fortement
mouvementé depuis l'accession du pays à l'indépendance,
par plusieurs événements marquants notamment des guerres de
sécessions, les mutineries, les rebellions, ainsi que des conflits qui
se traduisent d'une part par un processus de militarisation accentuée de
la société congolaise avec la présence accrue des groupes
armés étrangers, le recrutement massif des jeunes et des enfants,
la création des milices d'autodéfense et une augmentation du
trafic illicite d'armes légères.
Constatons-le, ensemble avec le Professeur BANYAKU, qui estime
que l'histoire politique du Congo est faite de moments de soubresaut d'espoir
pour la libération de tout un peuple et de moments de sombrement profond
dans le désastre et le chaos d'un grand Etat en perdition ou en
partition. Cette dynamique contrariante se traduit par des courts moments
d'apaisements et de longs moments de turbulence généralement
violente emportant les grands espoirs de la population pour l'idéal
démocratique ainsi que pour leur bien-être
socio-économique37(*).
La RDC a été plongée dans plusieurs
conflits, certains désormais résolus tandis qui d'autres couvent
encore ; mais en dépit de tous ces événements la RDC voit
aujourd'hui s'offrir une occasion unique. Elle émerge peu à peu
d'un passé difficile : une longue période coloniale suivie d'une
naissance pendant la guerre froide, puis plusieurs décennies
d'instabilité chronique suivies de deux guerres concentrées sur
une période de cinq ans.
En effet c'est après un temps relativement
concentré entre les événements de Léopoldville en
janvier 1959 et les résolutions de la table ronde de Bruxelles en mai
1960, que la RDC va faire une entrée fracassante dans le concert des
nations en accédant à son indépendance au 30 juin 1960.
Cet événement va raviver les espoirs de la population pour la
libre gestion de leurs propres destinés.
Mais cela ne durera pas longtemps pour qu'en juillet 1960 on
assiste aux premières fragmentations de mouvements
sécessionnistes et des mouvements réfractaires ou
révolutionnaires de 1961, aussi tôt le pays sera plongé
dans une crise institutionnelle entre le Premier Ministre Lumumba et le Chef de
l'Etat KASA-VUBU, à la suite de l'éviction du premier Ministre et
sa liquidation en janvier 1961. Ces événements laisseront la
place à une suite de conflit constitutionnel entre le Président
KASA-VUBU et les deux chambres du parlement ; à propos de
l'interprétation de la disposition transitoire de la loi fondamentale
sur l'élaboration de la constitution et sur la formation de la
constituante, se terminera par la suspension du parlement.
Il va s'en suivre d'une suite d'événements
conflictuels mettant en cause le Chef de l'Etat et son premier Ministre
Moïse TSHOMBE avec son parti le CONACO longuement majoritaire au
parlement. Face au refus du président de nommer un premier Ministre issu
de la majorité parlementaire de la CONACO, les institutions de la
République seront paralysées. Face à cette situation, le
front démocratique du Congo, incite le haut commandement militaire
à prendre le pouvoir et place le Lieutenant Général Joseph
Mobutu au pouvoir comme Président de la République en novembre
1965.
Dès son accession au pouvoir, les signes forts
étaient donnés par le nouveau Président à la classe
politique pour l'obliger à se soumettre à son autorité.
Confrontée à la fois à la recherche d'une
légitimité politique interne et à la subvention de la
haute finance, lésée par la première Nationalisation des
Société à charte intervenues pendant les années
66-67. C'est ainsi que sera réprimé un premier complot auquel se
trouveront associés l'ancien Premier Ministre KIMBA et trois autres
parlementaires M.M. Jérôme ANANY, Alexis MAHAMBA et Emmanuel
BAMBA. Ils seront condamnés à mort et exécutés par
la pendaison publique
Une terreur va s'installer, par la création d'un parti
unique dominant, le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR). On
assiste à la suppression du parlement et l'obligation faite à
tous les citoyens de devenir membre du nouveau mouvement de rassemblement
populaire et révolutionnaire.
La conséquence de la Zaïrianisation se manifeste
par les mouvements de déstabilisation et à une grande crise
sociopolitique. L'installation de multiples atteintes aux droits de l'homme est
constatée par des multiples abus de pouvoir avec des relégations
d'opposants, des arrestations arbitraires et des tracasseries dans la
société civile organisée par les services de
sécurité, les brigades de parti-Etat et les milices
paramilitaires.
Les années 90 marquées par la
libéralisation politique, sera inaugurées par les consultations
populaires : sur le plan de l'évolution des institutions du pays, le
chef de l'Etat a présenté les décisions suivantes38(*) :
- L'introduction du multipartisme à trois au
Zaïre, l'abolition de l'institutionnalisation du MPR ;
- La désignation d'un Premier Commissaire d'Etat ou
Premier Ministre suivi de la formation d'un gouvernement de transition ;
- La révision de l'actuelle constitution en vue de
l'adapter à la période de transition qui s'instaure ;
- La mise sur pied d'une commission chargée
d'élaborer la constitution de la troisième république,
constitution qui sera sanctionnée par un référendum
populaire ;
- L'élaboration, enfin, d'un projet de loi devant
régir les partis politiques dans notre pays et organiser leur
financement.
L'ouverture de la CNS (Conférence Nationale Souveraine)
donna lieu au débat National public, mais les nouvelles exigences
sociales d'une population ayant totalement perdu confiance à ses
dirigeants prirent une tournure dramatique avec le désordre social, qui
s'illustra par le pillage instantané du 3 décembre 1990 et les
deux grands pillages de 1991 et 1992.
La RDC, ex-Zaïre à l'époque en 1994 voit
s'aggraver sa situation politique par l'arrivée des
réfugiés Rwandais, fuyant les massacres perpétrés
chez eux.
Une nouvelle opposition politico-militaire, née
à l'Est du pays, l'Alliance des Forces Démocratique pour la
Libération du Congo (AFDL), dirigée par Laurent
Désiré KABILA est appuyée par l'Ouganda et le Rwanda,
déclare la guerre au pouvoir central de Kinshasa. Le Président
Mobutu Sese Seko est renversé le 17 mai 1997. L'AFDL et le
Président Laurent Désiré KABILA prennent le pouvoir.
C'est en voulant limiter l'influence de l'Ouganda et du
Rwanda, par le Président Laurent D. KABILA, que va éclater la
guerre d'agression Rwando- Ougando-Burundaise en RDC. Les belligérants
signent à Lusaka un accord de cessez-le feu, qui conduit les forces
étrangères des pays présents sur le territoire de la RDC
à retirer leurs troupes, le conseil de sécurité
créera la MONUC (Mission d'Observation des Nations Unies au Congo) dans
le but de maintenir une liaison sur le terrain avec toutes les parties à
l'Accord de cessez-le feu.
Alors commandant en chef des forces terrestres, Joseph KABILA
fils du feu le Président Laurent-D. KABILA, succède à la
tête de l'Etat son père, qui est assassiné en janvier
2001.
Durant le conflit, le Rwanda et l'Ouganda ont
créé des groupes ou de milices qui ont provoqué une guerre
civile impliquant trois fonctions principales : le gouvernement de la RDC
(Kabilistes ou PPRD, appuyés par l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe),
le RCD-G (soutenu par le Rwanda) et le MLC (par l'Ouganda).
Ainsi donc, sur le plan de la transition politique et à
l'issue des négociations particulièrement ardues et suite aux
pressions internationales redoublées, le long processus de DIC (dialogue
inter-congolais) va aboutir à la signature le 17 décembre 2002
par les représentants des composantes et entités au DIC, de
l'Accord Global et Inclusif. Le 2 avril 2003, l'Accord de cessez-le feu de
Lusaka est alors complété par « l'Accord Global et Inclusif
» à Sun City (Afrique du Sud), les participants au DIC signent
l'Acte final des négociations politiques, par lequel ils approuvent
formellement l'ensemble des Accords qui constitue un programme global de
restauration de la paix et de la souveraineté Nationale en RDC pendant
une période de deux ans.
Ces accords comprennent l'accord global de décembre
2002, la constitution de la transition, le mémorandum sur les questions
militaires et les questions de sécurité de mars 2003 et les 36
résolutions adoptées par les participants à Sun City en
mars et Avril 2002. La signature de l'Acte final maquera un nouveau chapitre
important dans le processus de reconstruction Nationale et de la paix en
RDC.
Une constitution de transition est promulguée par le
Président Joseph Kabila, le 4avril 2003. Le gouvernement d'union
nationale, ainsi formé, le 30 juin 2003, est chargé de mettre en
oeuvre le processus électoral dont le referendum constitutionnel,
organisé en décembre 2005, constitue la première
étape, suivie par les élections présidentielle et
législatives en juillet et octobre 2006.
Le gouvernement a aussi pour mission de rétablir
l'autorité de l'Etat dans les provinces, autorité bafouée
par les belligérants qui se sont répartis leur contrôle
Administratif et militaire, au gré de leurs alliances et de leurs
intérêts économiques.
Le pouvoir est donc partagé selon la formule « 1+4
» : c'est-à-dire, un Président de la République et
quatre vice-présidents.
On croyait que la transition politique était bien
partie en RDC, les réalités de terrain démentaient les
professions de foi des plus optimistes. Quand ce ne sont pas les
incompatibilités d'humeurs entre Ministres qui gangrènent le bon
fonctionnement de l'équipe gouvernementale, ce sont les provinces
ex-rebelles qui rappellent au gouvernement central que la réunification
physique du pays est très loin de devenir une
réalité39(*).
Le troisième rapport spécial du
secrétaire du conseil de sécurité de l'ONU sur la MONUC ;
rapporte qu'en dépit de la mise en place des institutions de transition,
des freins à l'action du gouvernement de transition ont
été observé. Certains éléments des anciens
belligérants conservaient une mentalité de guerre et cherchaient
activement à faire échouer la transition40(*).
D'une part des freins au rétablissement de
l'autorité de l'Etat sont observés par le fait que le pouvoir de
l'Etat fut déficient ou inexistant dans de nombreuses parties du pays
où l'autorité est exercée par les Administrations
parallèles qui ont été créées par les
groupes armés, y compris d'anciens éléments
belligérants du gouvernement de transition. La réunification des
structures Administratives parallèles au niveau local n'a guère
avancé. De plus, des milices armées, qui cherchent à
conserver leur contrôle illicite sur les ressources naturelles,
continuent de s'opposer aux efforts visant à mettre en place des
Administrations légitimes. D'autre part, des freins au
rétablissement de la sécurité sont observés, or
cette dernière constitue pourtant la pierre angulaire de la
réussite de la transition politique.
L'absence de progrès concernant le désarmement,
la démobilisation et la réinsertion (DDR) des ex-combattants
congolais a constitué un important facteur de déstabilisation.
Malgré le déploiement, durant l'automne de 2003, de commandants
de région militaire chargés d'assurer l'intégration dans
les Forces Armées de la RDC (FARDC), les groupes armés du pays
sont encore loin d'être véritablement intégrés et
les commandants de région militaire n'ont guère de prise sur les
éléments armés qui leur ont été
confiés. De même, la lenteur de l'application du programme
désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation
et réinsertion (DDRRR) des combattants étrangers, avec l'aide de
la MONUC, est resté une préoccupation majeure.
Mais en dépit de tous les événements
fâcheux qu'a traversé la RDC, cette dernière a sût
quand même se ressaisir et accédée enfin à des
institutions politiques démocratiques et cela à travers des actes
forts de la démocratie, que sont les élections libres et
transparentes lui permettant ainsi de tourner une nouvelle page en vue
d'écrire un nouveau chapitre de son histoire.
c. Situation socio-économique
La RDC, qui est l'un des pays parmi les plus vastes et les
plus peuplés du continent Africain, n'a pour autant pas le niveau de vie
qui devrait correspondre à ses immenses ressources naturelles (minerais,
bois précieux, produits agricoles,) et cela par le simple fait que son
système socio-économique a longtemps été
handicapé par une guerre civile lavée et un niveau de corruption
les plus élevés de la planète.
Le classement 2005 de « Transparency International
», sur l'indice de perception de la corruption, classait la RDC
sixième sur 158 pays évalués. Après une
période de relatif dynamique économique, la RDC a subi une
sévère dépression entre le milieu des années 1980
et le milieu des années 2000 liée à une gestion
marquée par la corruption, puis aux guerres civiles qui ont
ravagé le pays.
En 2006 la RDC est l'un des dix pays les plus pauvres du
monde, et les inégalités y sont très marquées. Une
grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
fixé à deux dollars par jour avec une majorité des femmes
et des hommes, qui n'ont aucun revenu, les disparités sont très
fortes, avec un taux de chômage très élevé, des
salaires et des prestations sociales dérisoires dans tout le pays.
Le forum économique et mondial sur l'Afrique rapporte
que l'économie congolaise est une des économies les moins
compétitives d'Afrique.
Cette économie occupe en 2008, selon le rapport de la
Banque mondiale sur le climat d'affaire, la 178ème position,
c'est-à-dire la dernière place sur la liste des pays du monde
considérés d'après leurs capacités d'offrir de
réelles facilités de faire des affaires41(*).
L'histoire économique récente de la RDC est
galonnée de plusieurs tentatives d'assainissement et de redressement de
l'économie bien que confronté aux déséquilibre
financiers, à la montée de l'endettement et à la
stagnation de la production, mais malgré cela les relations commerciales
entre différentes régions du pays dans leur ensemble restent
faibles encore aujourd'hui.
La production minière, qui a commencé plus d'un
siècle, a joué un rôle important dans la gestion
économique. En effet, le sous-sol de la RDC est compté parmi les
plus riches au monde au regard de la géologie et de la
minéralogie. Etant donné cet avantage naturel, la
défaillance de l'économie congolaise est
généralement attribuée à la «
malédiction des ressources naturelles ».
La RDC possède des gisements, contenant une
cinquantaine de minerais, mais seulement une douzaine de ces minerais sont
exploitées. La Gécamines (Générale des
Carrières et des Mines) était la principale entreprise
minière du pays, elle jouait un rôle social et économique
important pour beaucoup de PME (petite et moyenne entreprise) se trouvant dans
sa périphérie. Mais aujourd'hui la réalité n'est
plus la même, la Gécamines a été déchue, la
production minière industrielle s'est aussi effondrée avec elle ;
plusieurs mesures de restriction et de libéralisation du secteur minier
n'ont rien donné, d'autant plus qu'on assiste à l'exploitation
des terres des paysans au profit de nouvelles concessions minières,
à la fraude généralisée et aux contrats
léonins.
Cependant, l'agriculture reste le principal secteur de
l'économie de la vie de la population active. Le secteur secondaire
(industriel) par contre est très peu développé et
caractérisé par une forte présence de l'Etat,
marginalisant ainsi le secteur privé.
L'économie congolaise est aujourd'hui bien plus pauvre
qu'elle ne l'était à l'indépendance. Selon un rapport de
la Conférence Nationale Souveraine, le secteur informel présente
près de 60% des activités économiques. Douze ans
après, il est évident que ce pourcentage représente plus
de 80% des activités42(*)
La part de l'économie informelle dans la
création d'emplois s'est accrue continuellement au point de devenir le
secteur dominant de la RDC. Bien que le volume de production de ce secteur ait
grandement augmenté, le secteur informel congolais ne joue pas un
rôle essentiel dans l'économie nationale fournissant des revenus
minimums à ses employés.
§1. Ville de Beni
Beni est une ville de la république démocratique
du Congo, située à proximité du Parc national des Virunga,
sur le plateau du mont Ruwenzori (5 109 mètres d'altitude), en bordure
de la forêt de l'Ituri, dans la province du Nord-Kivu. Elle se trouve
à 90km de Kasindi, une cité qui fait frontière avec
l'Ouganda. Elle forme une entité distincte au sein du territoire de
Beni. Elle est une ville soeur de Butembo43(*)..
C'est en 1894 que les Belges installent un poste d'État
dans ce qui est le territoire administratif actuel de Beni.
En 1889, l'explorateur Henry Morton Stanley découvrit
le mont Rwenzori dont le sommet était à l'époque couvert
de neige sur 7 km2. Depuis, la fonte de ce glacier africain unique s'est
accentuée par le fait du changement climatique au point qu'il ne reste
plus qu'un petit km² des glaciers.
L'islam imposé par les Arabes et des esclavagistes
arabisés se développe dans la région de Beni à
partir de 1870, ce qui pourrait expliquer en partie l'usage du swahili en tant
que langue véhiculaire de l'époque, sachant que le swahili tire
de la langue arabe une bonne partie de son vocabulaire.
Jusqu'aux années 1900, Beni et Irumu faisaient partie
de la zone administrative du Haut-Ituri. Vers 1902, Beni fut rattaché
à Rutshuru dans le Kivu, marquant ainsi sa séparation
définitive d'avec Irumu.
1. Toponymie
La ville de Beni doit son nom à Mbene, un chef
coutumier très influent qui administra cette agglomération avant
l'« arrivée des Blancs ». Par la tradition orale, il nous est
parvenu l'anecdote suivante : un colon belge s'enquit du nom du village
auprès des autochtones. « Chez Mbene », lui
répondirent-ils. Mais dans ses notes, le Belge retiendra « Beni
» et ce fut dès lors le nom donné à ce village. La
sacralisation de toute parole sortant de la bouche d'un Blanc à
l'époque coloniale pourrait se vérifier dans plusieurs
domaines.
Citons, par exemple, les noms donnés à plusieurs
sites, quartiers et rivières autour de la ville de Beni. Ils
témoigneraient d'une forte influence des colons belges au
Congo-Léopoldville en général et dans l'est du pays en
particulier. « Boïkene », c'est le nom d'un des quartiers
huppés de Beni. Ce quartier doit ce nom à un Belge qui aurait
souhaité un « bon week-end », en fin de semaine, à
l'équipe de cantonniers qu'il dirigeait. Nos cantonniers
analphabètes ont cru entendre le Blanc leur dire que ce lieu
s'appellerait « Bo-ï-Kene » et se mirent à propager la
nouvelle autour d'eux. De Cité Belge (vers Mabolio), un autre Blanc se
serait intéressé à la montagne qui surplombe ce village et
aurait demandé aux badauds : « Qu'y a-t-il là-haut ? »
Depuis, ladite montagne s'appelle « La-o ». Et un autre colon belge,
alors qu'il se trouvait sur la route de Mangina, donna ordre à ses
accompagnateurs : « Passez ici et suivez le chemin de la brousse ! ».
Ces pauvres gens se dirent entre eux, très enthousiasmés : «
Le Blanc dit que ce village s'appelle 'Pa-sse-si' et que de l'autre
côté où son doigt était pointé c'est
'Bou-rou-sse' ». Ainsi seraient nés les noms de Pasisi et de
Burutsu. Enfin, pour ce qui est de l'origine du nom porté par la
rivière Semliki, on raconte qu'un explorateur aurait demandé
à un pêcheur qu'il trouva en train de pêcher de lui
communiquer le nom de cette rivière. Pensant que ce Blanc
s'intéressait à ses modestes prises de la journée, il lui
glissa laconiquement en kinande : « Si-mu-li-ki » ce qui, traduit,
veut dire : « Il n'y a rien dedans ». Mais dans son carnet de
voyages, l'explorateur indiqua qu'un indigène lui a
révélé le vrai nom de cette majestueuse rivière.
a. Sur le plan commercial
L'agglomération de Beni revêtait une importance
capitale, eu égard à sa position stratégique. Les Belges
firent de ce lieu un chef-lieu administratif et un carrefour commercial
tourné vers l'Ouganda et le Kenya par le poste frontalier de Kasindi.
Une communauté grecque rompue dans le commerce s'y implanta en y
érigeant des maisons originales encore visibles de nos jours où
le devant abritait l'échoppe tandis que l'arrière maison servait
de résidence. Les missionnaires catholiques s'établirent sur les
hauteurs de Beni-Païda où ils construisirent une église, des
couvents et l'une des premières écoles de la région sous
l'impulsion d'Henri Pierard, un missionnaire belge.
Dans le milieu des années 1970 jusqu'à la fin
des années 1980, Beni connut son âge d'or grâce à
l'implantation dans cette agglomération de nombreuses usines à
café et de grandes sociétés d'exportations parmi
lesquelles on peut citer UPAK. L'or vert ainsi que la papaïne se vendaient
bien à l'export à telle enseigne que la cité attira
l'attention de plusieurs banques nationales qui y ouvrirent des agences ou
succursales. Ce fut le cas de la Banque Commerciale Zaïroise (BCZ) suivie
plus tard de la Banque de Kinshasa (BK), de la Banque du Peuple (BDP) et de
l'Union Zaïroise de Banques (UZB).
La chute des cours de café dans les années 1990
et le pillage des biens de 1991 et 1993 sous le régime du dictateur
Mobutu mirent à mal les opérateurs économiques. Pourtant,
le marché du café était régulé et sa vente
réglementée par un système assez complexe des timbres OIC
sous l'égide de l'Office Zaïrois du Café (Ozacaf). Les
autorités instaurèrent un autre principe, celui de la
rétention de café afin de créer de la rareté sur le
marché mondial. Mais sans succès. Beaucoup de
sociétés firent alors faillite, les plantations de
caféiers furent laissées à l'abandon. Les usines de
café qui ne fonctionnaient qu'avec de groupes électrogènes
devinrent inexploitables à cause de la flambée des prix de
carburant importé du Kenya, la région n'étant pas
électrifiée. Les paysans revinrent à la production du
café pilonné de piètre qualité car
décortiqué de manière artisanale et sans être
calibré ce qui, sur le marché mondial, contribua à
dégrader l'image du café produit au Zaïre. Les routes de
desserte agricole se dégradèrent inexorablement et
l'évacuation des produits agricoles vers Beni devint un véritable
cauchemar pour les entreprises. Le tronçon routier d'une importance
vitale reliant Beni à Kisangani devint impraticable, celui de
Beni-Kasindi très dangereux car non entretenu et occupé par
endroits par des coupeurs de route, des rebelles « Mumbiri » ou
« Ngilima » venant de Lume, le pied du mont Ruwenzori. La crise qui
s'ensuivit fut douloureuse et plongea Beni dans une situation économique
désastreuse.
Contribuant encore à dégrader la situation, la
trachéomycose fit son apparition dans la région et affecta
surtout le café robusta. Cette maladie, surnommée « le sida
du café », agit sur la dégénérescence du
système vasculaire du caféier. La rumeur se répandit que
la consommation de café victime de trachéomycose pourrait
être nuisible à la santé, voire cancérigène,
ce qui dégrada la confiance des rares acheteurs potentiels et contribua
à la dépréciation du prix du café produit au Kivu.
Les palmeraies supplantèrent les caféiers, mais l'huile de palme
est une production moins rentable que ne l'était le café vert. Le
développement de la culture de cet oléagineux a permis de rendre
la région de Beni autosuffisante et de la voir ainsi se passer de
Kisangani et d'Isiro jusqu'alors grandes pourvoyeuses de cette huile, mais
contrairement au café vert, l'huile de palme n'est pas exportée.
Quelques années plus tard, les agriculteurs de Beni trouvèrent
une alternative en se reconvertissant dans la culture du cacao.
2. Guerres du Congo 1995-1998
Les deux dernières guerres du Congo (1996, 1998) eurent
pour conséquence l'exode rural des populations. Ainsi Beni, à
l'instar de Butembo et des autres villes de l'est du pays, voit la cité
se développer très rapidement, les nouveaux venus étant
essentiellement des déplacés de guerre fuyant leurs villages
à la suite des exactions commises par des éléments
incontrôlés de l'armée régulière ou par des
rebelles. Paradoxalement, lorsque le mouvement rebelle RCD-KML dirigé
par Mbusa Nyamwisi, natif de la région, s'empara de cette partie du
territoire congolais, il s'observa un nouveau dynamisme entrepreneurial
auprès de jeunes commerçants. En fait, ce mouvement rebelle
favorisa les importations des biens et des produits manufacturés en
instaurant, aux frontières qu'il contrôlait, des tarifs
forfaitaires très compétitifs. Ces mesures douanières
incitatives firent oublier que la région était trop dangereuse
pour y investir. Les commerçants saisirent cette opportunité et
dégagèrent en retour des marges importantes au point que la
prospérité de leurs affaires intrigua les autorités de
Kinshasa lorsque le territoire national fut réunifié. En effet,
ces autorités se rendirent compte des progrès économiques
enregistrés et de la montée en puissance d'une classe moyenne
à l'est du pays, territoire qui échappait jusqu'alors à
leur pouvoir
Ayant encore en mémoire le traumatisme causé par
le pillage de leurs biens sous Mobutu (1991, 1993), les habitants de Beni et de
ses environs s'investirent dans l'immobilier en construisant des maisons, des
villas et des immeubles « que personne ne pourra leur dérober la
nuit ». Cette prise de conscience se révéla payante et, du
jour au lendemain, ce que fut une cité sans âme devint une ville
urbanisée, propre et grouillante d'activités. La cité de
Beni fut officiellement élevée au rang de « ville » en
1998 par le Président de la République
Laurent-Désiré Kabila. La majorité de sa population est
composée de personnes issus de l'ethnie Nandé. Beni se veut une
ville hospitalière et ouverte au monde extérieur. Le projet en
cours relatif à la réhabilitation de l'aérodrome de Beni
Mavivi, à côté de Mavivi, va dans le sens de l'ouverture
à l'international de cette région enclavée. En effet, la
quasi-totalité de missions d'affaires vers ou au départ de
Beni-Lubero passent jusqu'à présent par l'aéroport
d'Entebbe, en Ouganda.
Une loi votée en 2014 par le Parlement porte sur la
création en RDC des Zones économiques spéciales (ZES). Ce
sont des espaces industriels spécifiques bénéficiant
d'exonérations fiscales pour les entreprises qui s'y implantent, un
modèle qui a déjà fait ses preuves dans le monde à
l'instar de Shenzhen, Dubaï, Hong Kong, etc. La zone qui abritera la ZES
de Beni-Butembo n'est pas encore délimitée. Toutefois, cette zone
se situera entre les deux villes précitées. La question de
l'électricité se posera alors avec acuité car jusqu'en
2014, la ville de Beni n'était toujours pas électrifiée,
freinant les opérateurs économiques dans l'industrialisation de
la région.
En ville et dans le Beni (territoire), les accrochages ont
été nombreux et meurtriers en 2014 et 2015 (12 mai 2015,
particulièrement). Après un premier semestre 2016 chargé
(une centaine de personnes), un nouveau massacre, de 42 personnes, s'y est
déroulé le samedi 13 août 2016.
Depuis l'élection de Julien Kahongya au poste de
Gouverneur du Nord-Kivu en 2007, Beni était dirigée par Jules
Mungwana Kasereka, jusqu'à sa suspension le lundi 14 avril 2008 par
l'arrêté N° 052 du 12 avril 2008. L'intérim a
été assuré par le chef de bureau de la mairie
jusqu'à l'élection de Masumbuko Nyonyi Bwanakawa, un ancien
joueur du Football Club Beni-Sport, qui a commencé sa carrière
politique au côté de Antipas Mbusa Nyamwisi au sein du RCD/K-ML,
avant de se tourner vers le MLC de Jean-Pierre Bemba et, finalement, de revenir
au PPRD, le parti qui se réclame de Joseph Kabila.
§2. Ville de Butembo
La ville de Butembo est située également dans
l'est de la République Démocratique du Congo, également
dans la province du Nord-Kivu. La ville est un important centre commercial et
économique de la région, avec une forte présence de
l'industrie minière et agricole. Cependant, la ville a également
été touchée par les conflits armés dans la
région et les attaques de groupes armés. Butembo est
également située à proximité du parc national de
Virunga44(*).
Avant l'installation de la minière des grands lacs
(MGL) dans la localité, cette partie du territoire de Lubero
était une brousse parsemée de quelques cafiers et formée
des plusieurs petits villages.
Butembo est connu en ce temps sous le nom de LUSANDO petit
village où résidait l'ancien chef de YORA du groupement
BUYORA.
Le mot « BUTEMBO » ne serait venu qu'après
par altération linguistique de « MUTEMBO » un arbre
géant qui se trouvait dans la cours de la parcelle d'un vieux papa.
C'est de cet arbre que dérive le nom de Butembo qui donnera naissance au
nom de toute l'agglomération indigène.
A l'arrivée de l'homme blanc au Congo, il sera
créé des centres dont le rôle primordial sera la gestion
des terres dites domaniales. Cette stratégie entraînera par voie
de conséquence, non seulement la désagrégation des
unités structurelles, mais aussi l'instauration de deux régimes
fonciers.
D'une part, les terres indigènes gérées
suivant : la coutume d'autre part, les terres vacantes soumises au droit
court.
L'installation, en 1928 de la MGL, actuellement SOMINKI ;
Butembo offrait l'avantage de faciliter l'approvisionnement et la distribution
du matériel dans la partie Ouest du territoire de Lubero et en
territoire de Beni.
Au demeurant, il se constituera un centre administratif et de
négoce à Butembo.
Familiarisés à l'économie du
marché, les ouvriers de la MGL, retraités ou licenciés,
éprouvent de la peine à réintégrer leur milieu
coutumier. Il en va de même des employés des colons et des «
capita-vendeurs » des commerçants grecs. A la suite de la demande
pressante de la population, l'Administrateur du territoire de Lubero autorisera
celle-ci à s'installer sur ce lieu. Il s'en suivra la création de
la cité indigène par l'arrêté du ministère
des colonies du Congo Belge et du Rwanda-Burundi N°21/503 du 23 Septembre
1949. L'ordonnance N° /138 du 15 mai 1956 soumettra ladite cité au
régime de l'urbanisation
Son premier chef est : Romain MATOKEO MUSAVULI dans le but
d'attirer plus des populations et soucieux d'ériger Butembo en une
entité autonome, distribuera gratuitement des parcelles à la
population. Cette pratique attirait la population périphérique
ainsi que les commerçants grecs installés ou chef-lieu du
territoire (45 Km).
En 1958, le centre de Butembo accède au statut de
centre extra coutumier. En 1987, Butembo est reconnue comme cité moderne
parmi les citées créées par les ordonnances
présidentielles N° 87/238 du 29 juin 1987 portant création
de 83 cités en République du Zaïre.
En 1999, la cité de Butembo se voit dotée d'un
statut d'une ville par l'arrêté N°01/001 bis/CAB/GP-MK/99 du
29 septembre 1999 portant création des villes de Beni et de Butembo en
province du Nord-Kivu, par les autorités rebelles du RCD/K-ML qui
avaient choisi Beni comme siège de leur institution politique lors de la
2ème guerre dite de libération qui a éclaté le
2/08/1999 en RDC.
En 2001, le président du RCD/K-ML signe en date du 22
décembre le décret N°2001/038 portant création et
délimitation de la ville de Butembo et ses communes en province du
Nord-Kivu.
En 2003, le président de la République
Démocratique du Congo, le Général major Joseph KABILA
signe le Décret N°042/2003 en date du 28 mars portant
création d'une ville pour hisser Butembo en ville après la
réunification du territoire nationale.
b. Présentation de
l''Ouganda
L'Ouganda, en forme longue la République d'Ouganda ou
la République de l'Ouganda, en anglais Uganda et Republic of Uganda, en
swahili Uganda et Jamhuri ya Uganda, est un pays d'Afrique de l'Est. Il est
aussi considéré comme faisant partie de l'Afrique des grands
lacs.
§1. Situation
géographique
Il est entouré par la République
Démocratique du Congo, le Kenya le Rwanda le Soudan du sud, et la
Tanzanie. Le Sud du pays englobe une vaste partie du lac Victoria.
§2. Subdivisons
administratives
L'Ouganda est divisé 80 districts répartis entre
quatre grandes régions (Nord, Est, Centre et Ouest). Les districts sont
tous nommés d'après leur ville principale respective. Les
districts sont divisés en sous-districts, en comtés, en
sous-comités, en paroisses et en villages.
Parallèlement aux subdivisions administratives, six
royaumes traditionnels bantous ont été préservés
avec une autonomie limitée, essentiellement culturelle. Ce sont le Toro,
l'Ankole, le Busonga, le Bunyoro, le Bouganda et le Rwenzururu.
§3. Cadre
économique
On retrouve sur le territoire de l'Ouganda plusieurs sites de
minerais inexploités, notamment le cuivre et le cobalt qui sont les
principaux.
Un peu d'hydrocarbure dont du pétrole qui provient du
Lac Albert. On y produit à cet emplacement environ près de 10 000
barils par jour. le climat et les terres riches favorisent extrêmement la
culture de plusieurs produits. On retrouve principalement dans ceux-ci le
café dont l'Ouganda est un des principaux exportateurs dans le monde, la
canne à sucre, le coton et la culture de la patate douce. Ces
éléments sont les principales activités économiques
du secteur primaire de l'économie.
§4. Démographie
Évolution de la démographie entre 1961 et 2003
(chiffre de laFAO, 2005). Population en milliers d'habitants. L'Ouganda a l'une
des plus fortes croissances démographiques au monde avec un taux de
fécondité estimé à près de 7 enfants par
femme.
§ 5. Vie politique
Le 9 octobre 1962, à l'indépendance de
l'Ouganda, se pose de manière aiguë le problème des
structures politiques. La solution retenue, exprimée dans la
première Constitution, est de type fédéral - elle associe
les quatre anciens royaumes - mais le bouganda maintient sa
prépondérance jusque dans le nom du nouvel Etat, l'Ouganda, pays
des bagandas. Le kabaka mutesa II en devient le président à vie.
Milton Obote, fondateur en 1960 du Congrès du peuple ougandais (Uganda
people's progress ou UPC), devient Premier ministre.
L'UPC, à l'image de son dirigeant, est le parti des
populations nilotiques du Nord, opposées à la domination
économique et politique du Bouganda et, donc, favorable à la
centralisation. Dès lors, les tensions entre le Nord nilotique et le Sud
bantou s'exacerbent. En mai1966 : Milton Obote, afin d'imposer la
centralisation, envoie l'armée au Bouganda et dépose le roi
Kabaka Mutesa II avec l'appui de son chef d'état-majorité Idi
Amin Dada. Ce dernier appartient à une ethnie musulmane minoritaire du
nord-ouest. Obote fait promulguer, l'année suivante, une nouvelle
constitution abolissant les royaumes, et instituant un régime
présidentiel à parti unique. La résistance des Baganda,
que la politique de nationalisation du commerce entreprise par Obote menace
directement dans leurs intérêts, la dégradation
économique et les accusations de corruption se conjuguent pour
déstabiliser Obote45(*).
Le 25 janvier 1971 Idi Amin Dada prend le pouvoir par un coup
d'État. Au départ soutenu par les pays occidentaux qui
craignaient une orientation trop socialiste du régime
précédent, Amin Dada va être lâché par ces
derniers au fur et à mesure que son régime devient tyrannique et
sanguinaire. En huit ans de pouvoir, le régime va être
accusé de la mort ou de la disparition de près de 300 000
Ougandais. Privé de l'aide occidentale, après l'expulsion du pays
des 50 000 Indo-pakistanais (qui détenaient le commerce et beaucoup
d'entreprises) et l'oppression de l'intelligentsia, l'économie
s'effondre. En1978, avec la chute du cours du café, principale
exportation du pays, l'Ouganda frôle la faillite et le gouvernement
ougandais est aidé financièrement par les États arabes
amis d'Idi Amin Dada. En1979, après des mutineries de l'armée,
Idi Amin Dada, aux abois, déclenche la Guerre Ouganda-Tanzanienne. La
Tanzanie contre-attaque et avec l'aide du mouvement de résistance
ougandais, le renverse en avril 1979. L'ex-dictateur s'exile alors en Libye
puis en Arabie Saoudite où il meurt en2003.
Jusqu'en 2005, l'Ouganda est une république à
parti unique, tous les citoyens ougandais étant membres du parti unique.
Les partis politiques sont de facto autorisés en tant que regroupements
mais les candidats de l'opposition se présentent comme candidats
indépendants aux élections.
Le29 juillet 2005, un référendum populaire
valide la modification constitutionnelle et autorise à nouveau le
multipartisme. Le oui obtient 92,6 % des voix et la participation est seulement
de 47 %. L'opposition qui dans sa grande majorité avait appelé au
boycott dénonce des chiffres de participation fantaisistes.
Les dernières élections législatives et
présidentielle ont eu lieu le 23 février 2006, et ont permis la
réélection de Yoweri Museveni (au pouvoir depuis 1986) avec 59 %
des voix, contre 37% pour son principal adversaire, KizzaBesigye. Le Forum pour
le changement démocratique de M. Besigye dénonce des fraudes.
§6. Education
L'analphabétisme est fréquent en Ouganda,
notamment parmi les femmes dans la période de 2002-2005 les
dépenses publiques pour l'éducation étaient de 5,2 % du
PIB. L'Ouganda a des universités privées et publiques. En 2007,
on comptait plus de 90% de jeunes ougandais qui fréquentaient les
établissements scolaires primaires. En revanche, la même
année, on ne dénombrait qu'environ un adolescent sur trois dans
l'enseignement secondaire. Ce déséquilibre est lié au
coût trop élevé de l'éducation, au manque
d'établissements scolaires et au désintérêt des
étudiants.
§7. Sante
Le SIDA est fréquent en Ouganda. L'espérance de
vie féminine était de 52,4 ans, et l'espérance de vie
masculine était de 51,4 ans en2007. En 2007, l'espérance de vie
en bonne santé était de 44 ans. Les dépenses
gouvernementales pour la santé étaient de 39 $ (parité de
pouvoir d'achat) par habitant en 2007.
§8. Religion
Chrétiens : 85% (catholiques : 45% ; anglicans : 39%);
musulmans : 10% et divers (dont nouvelles Églises protestantes) : 6%.
Beaucoup de convertis continuent cependant à pratiquer les religions
traditionnelles ou certains de leurs rites.
Chapitre deuxième : Opération Ushujaa et
lutte contre le terrorisme dans les villes de Beni et Butembo
2.1. L'Opération Ushujaa face au
terrorisme dans le Grand Nord
Bien avant la signature de l'accord relatif à la
coopération militaire basé sur l'éradication des ADF NALU
qui est un ennemi commun, l'Ouganda avait déjà
déployé, une semaine plutôt, un millier des membres de son
armée en appui à l'armée congolaise pour combattre les ADF
retranchés dans l'Est de la République Démocratique du
Congo depuis 1995.
Ce groupe armé est accusé du meurtre des
milliers des civils dans le territoire de Beni frontalier avec l'Ouganda. Les
provinces de L'ITURI et du Nord-Kivu devenues sanctuaires de l'ADF ont
été placées depuis le mois de Mai de l'année 2021
sous état de siège consacrant le remplacement des
autorités civiles par des officiers de l'armée et de la
police.
Cette mesure exceptionnelle, n'a pas encore permis à
l'armée d'empêcher les massacres. Depuis 2019, les attaques de
l'ADF sont revendiquées par Daech. La coopération militaire
ougando-congolaise concerne aussi le volet infrastructures et
énergie.
En effet, les deux pays indiquent la possibilité de
partage ou vente d'électricité produite sur le Nil par l'Ouganda
(barrage construit par une société chinoise dans le Nord sur le
Nil Blanc) mais aussi le soutien à la construction des routes
d'intérêt mutuel, notamment le tronçon
Bunangana-Rutshuru-Goma-Kasindi-Beni-Butembo, dont les travaux ont
été lancés par les ministres en charge de ces projets
vitaux sur le plan socio-économique, avec impact positif sur les aspects
de défense et de sécurité mutuels.
Rappelons que les forces armées ougandaises et
congolaises ont mené une offensive conjointe mardi 30 novembre dernier
pour mettre fin à l'activisme des groupes terroristes dans l'Est de la
RDC. Le ministre congolais de la Défense et son homologue ougandais ont
signé, jeudi 9 décembre à Bunia (Ituri) un accord
général de défense et de sécurité pour la
conduite des opérations contre les groupes armés en Ituri et au
Nord-Kivu. Dans leur communiqué conjoint, les deux
délégations réaffirment que la mutualisation des forces
vise à traquer tous les groupes armés et les forces
négatives dont les ADF.
C'est un accord général mais un cadre de
mutualisation de nos forces armées qui est en cours, notamment dans la
lutte contre l'ADF. Vous le savez, que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo
que de l'Ouganda il est tout à fait normal que nous puissions le
combattre de manière mutuelle. S'il y a des groupes armés locaux
qui sont à cheval entre le Congo et l'Ouganda c'est accord va
s'étendre.
Pour le gouvernement ougandais, ce qui est très
important dans cet accord, c'est l'union des efforts entre les Forces
Armée de la République Démocratique du Congo et l'UPDF
pour atteindre les objectifs de ces opérations. Pendant deux jours, les
experts congolais et ougandais ont discuté sur des questions de
sécurité et de défense d'intérêt mutuel pour
les deux pays, notamment en ce qui concerne les opérations conjointes
pour l'éradication des rebelles ougandais des ADF et d'autres groupes
armés locaux actifs le long de la frontière commune dans les
provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.
Les deux parties rassurent les populations de la RDC et de
l'Ouganda que ces opérations continueront à être
menées dans le respect strict des droits de l'homme tout en respectant
la souveraineté de ces deux pays.
Dans la conduite des opérations militaires, seuls des
objectifs militaires peuvent être directement attaqués. La
définition des objectifs militaires stipulée au Protocole
additionnel I est généralement considérée comme
reflétant le droit international coutumier. Selon l'article 52 (2) du
Protocole, "les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par
leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent
une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction
totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un
avantage militaire précis"46(*).
Le fait que le Protocole additionnel I contienne une
définition générale plutôt qu'une liste
spécifique d'objectifs militaires exige des parties à un conflit
armé à respecter de manière rigoureuse les conditions
énoncées à l'article 52 à savoir que l'objet de
l'attaque doit contribuer effectivement à l'action militaire de l'ennemi
et que sa destruction, sa capture ou sa neutralisation doit offrir un avantage
militaire précis à la partie adverse dans les circonstances
prévalant en l'occurrence. Par ce biais, les rédacteurs voulaient
exclure les contributions indirectes et les avantages éventuels. Sans
ces restrictions, la limitation des attaques licites aux objectifs "militaires"
pourrait trop facilement être sapée et le principe de la
distinction être vidé de son sens.
La définition des objectifs militaires, lue
conjointement avec le principe de distinction, l'interdiction des attaques
frappant sans discrimination, l'obligation de réduire autant que
possible les pertes civiles, ainsi que le principe de proportionnalité,
réfute manifestement les interprétations avancées
naguère dans les doctrines de la "guerre totale", qui incluaient parmi
les objectifs militaires "tous les objectifs contribuant véritablement
à la destruction des moyens de résistance de l'ennemi et à
l'atténuation de sa détermination à combattre".47(*)
2.1.1. Les origines du terrorisme en RDC
Depuis plus de deux décennies, la République
Démocratique du Congo (RDC, anciennement dénommée
République du Zaïre jusqu'en 1997) est plongée dans une
variété de conflits armés qui connaissent la participation
des forces et groupes armés étrangers. Les forces armées
étrangères incluent celles venues de l'Angola, du Burundi, du
Rwanda, de la Tanzanie, du Tchad, du Zimbabwe et de l'Ouganda sur invitation du
Gouvernement ou des groupes armés locaux. Pour les groupes armés
étrangers, nous noterons les Forces Nationales pour la Libération
du Burundi (FNL), les Forces Démocratiques pour la Libération du
Rwanda (FDLR), les Forces Démocratiques alliées (ADF en anglais
Allied Democratic Forces) et l'Armée Nationale de Libération de
l'Ouganda (NALU en anglais, National Army for the Liberation of Uganda). La
présence de ces forces et groupes armés étrangers,
opérant sur le territoire national de la RDC, a constitué une
menace à la paix et à la sécurité régionales
et cela reste un obstacle permanent au rétablissement de
l'autorité de l'Etat dans ce dernier pays.
Au cours de la période susmentionnée, il y a eu
commission des violations massives et systématiques des droits de
l'homme (comme celles visant le droit à la vie et à
l'intégrité physique) et du droit international humanitaire
(comme celles mettant en danger des personnes protégées ou ne
participant pas ou plus au combat ou portant atteinte aux biens
protégés). Ces violations seraient constitutives, de par leur
type, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.
La persistance de cette situation facilite la
prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes
légères et des petits calibres que les groupes armés et
même la population civile cesexactions perpétrées et droit
à la vérité procurent. Ce qui constitue une menace
à la sécurité humaine et au développement social et
économique de cette partie du pays.
Pour tenter de remédier à cette situation, les
règlements politiques qui se sont succédé aboutirent,
d'une part, à des accords de paix entre les belligérants
congolais et, d'autre part, les accords de retrait des forces armées
étrangères entre la RDC et les pays voisins impliqués.
Il convient toutefois de noter que, par l'absence d'une
approche holistique des règlements politiques, aucune négociation
ou table ronde réunissant, d'une part, les groupes armés rwandais
opérant sur le territoire national de la RDC et le gouvernement
rwandais, et, d'autre part, les groupes armés ougandais opérant
sur le territoire national de la RDC avec le Gouvernement ougandais n'avait
été entreprise.
Faute d'une telle approche, ces groupes armés devraient
être neutralisés et désarmés par la force. Ne
voulant pas se rendre afin d'être rapatriés volontairement, ces
groupes armés étrangers se sont retranchés dans les
forêts du Kivu où ils se livrent, presque impunément, aux
pillages des biens de la population civile, aux viols et à l'esclavage
sexuel des jeunes filles et femmes congolaises, au recrutement forcé
d'enfants, aux tueries massives et systématiques de la population
civile, etc.
En conséquence, craignant d'être
persécutée, une partie de la population civile victime de ces
exactions n'a d'autre solution que de quitter son milieu naturel afin de
traverser la frontière internationale pour chercher asile, être
à l'abri de telles menaces et ainsi être éligible au statut
de réfugiés dans les pays limitrophes de la partie orientale de
la RDC. Des situations similaires forcent la population à se
déplacer vers une autre zone plus stable. Dans cette section il s'agit
de donner l'origine du terrorisme en République Démocratique du
Congo. La présente section est scindée en deux sous-sections dont
la première porte sur les ADF et la dernière porte sur le M23.
a. Les ADF
1. Aperçu historique des ADF
Les premiers membres de la rébellion des ADF ont
d'abord appartenu à la secte Tablish, active en Ouganda depuis au moins
les années 70 et qui a commencé à recevoir des fonds du
Soudan après le renversement d'Idi AMIN DADA.
Cette communauté a vu le jour au début du XXe
siècle dans une Inde sous domination britannique. À sa
création, il s'agissait d'un mouvement conservateur appelé
Tabligh, dont l'objectif était de raviver les valeurs et les pratiques
de l'islam en mettant particulièrement l'accent sur les activités
missionnaires48(*).
Bien que la communauté Tabligh se soit en
général opposée à la brutalité de groupes
djihadistes - elle a même été la cible de militants
islamistes à certains endroits -, ses membres ont parfois rejoint des
groupes violents. En Ouganda, la secte Tabligh est parfois également
associée à un courant salafiste de la communauté musulmane
locale, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. Certains de ses
membres sont partis étudier en Arabie saoudite avec des bourses
d'étude octroyées par des religieux saoudiens. Jamil Mukulu,
devenu le chef des ADF, en est un exemple. Né chrétien, il s'est
converti à l'islam dans sa jeunesse et s'est rendu à Riyad pour y
étudier et en revenir avec une vision militante de l'islam49(*).D'ailleurs, selon un ancien de
ses collègues, « il est revenu d'Arabie saoudite en musulman plus
dévoué et prêt à mourir pour l'islam. Il parlait
constamment de défendre l'islam. »
Les querelles pour le pouvoir et le contrôle des
mosquées locales ont dévasté la communauté
musulmane ougandaise pendant des décennies, en particulier depuis qu'Idi
Amin Dada avait fédéré tous les dirigeants musulmans au
sein du Conseil supérieur des musulmans ougandais (UMSC), en 1971.
En 1991, des membres de la communauté
« Tabligh » se sont unis à l'un des cheikhs qui
convoitait la tête de l'UMSC. Lorsque les tribunaux ont confirmé
l'élection d'une faction rivale, un groupe dirigé par Jamil
Mukulu a pris d'assaut le siège de l'UMSC, situé dans la vieille
mosquée de Kampala, tuant plusieurs policiers. Mukulu et d'autres
individus ont été arrêtés et
transférés à la prison de Luzira, où ils ont
rencontré plusieurs anciens déserteurs de l'armée
ougandaise qui prendraient par la suite le commandement des ADF50(*).
En 1994, Mukulu a été libéré de
prison et a créé le Mouvement des combattants ougandais pour la
liberté (UFFM) à Hoima (Ouest de l'Ouganda) avec le soutien du
gouvernement soudanais. Lorsque l'armée ougandaise a
assiégé leur camp en 1995, Mukulu s'est enfui au Kenya, tandis
qu'un autre dirigeant de l'UFFM, Yusuf Kabanda, guidait les jeunes soldats qui
restaient vers le Congo de l'Est. Là-bas, le gouvernement soudanais a
continué de les soutenir et ils ont conclu une alliance avec
l'Armée nationale pour la libération de l'Ouganda (NALU), un
groupe rebelle laïc ougandais. L'alliance ADF-NALU s'est retrouvée
empêtrée dans les politiques complexes des groupes armés du
territoire de Béni, où elle était basée. À
bien des égards, la NALU a fait figure d'héritière du
Rwenzururu, ancien groupe rebelle ougandais, dont le but était de
restaurer le pouvoir coutumier des communautés Bakonjo et Baamba dans
l'Ouest de l'Ouganda. Ces groupes ethniques sont respectivement
affiliés aux groupes ethniques Nande et Talinga du Congo avec
lesquels ils partagent les langues et les cultures51(*).
Alors que Mobutu Sese Seko soutenait aussi l'alliance ADF-NALU
dans sa guerre par procuration contre Yoweri Museveni, l'armée
ougandaise est intervenue dans le cadre d'une coalition pour le renverser en
1996, et le groupe rebelle a été forcé de fuir des zones
urbaines. À la recherche d'un refuge, une partie du groupe s'est
installée dans les savanes du sud-est de Béni alors qu'une
faction qui lui était liée entamait des relations avec la
communauté minoritaire Cuba dans le groupement Bambuba-Kisika, au nord
de la ville de Béni. De nombreux Cuba ont rejoint les ADF-NALU,
tandis que des chefs rebelles épousaient des femmes Cuba, achetaient des
terres aux chefs Cuba pour établir des camps et collaboraient avec eux
afin de faire du trafic d'or et de bois52(*).
Plus tard, lorsque le mouvement rebelle congolais, le
Rassemblement congolais pour la démocratie/Kisangani Mouvement de
libération (RCD/K-ML) régnait sur la région, les ADF-NALU
ont également collaboré avec eux de manière sporadique. Au
début de la rébellion, les ADF-NALU entretenaient surtout des
relations cordiales avec les communautés Congolaises tout en organisant
des raids et des attaques régulières en Ouganda,
déplaçant plus de 100 000 personnes dans le district de
Bundibugyo et kidnappant des dizaines de jeunes.
Cependant, au début des années 2000, plusieurs
événements simultanés ont secoué le groupe.
L'armée ougandaise a déployé des forces importantes contre
les ADF et coopté des officiers supérieurs de la NALU pour les
enrôler dans leur contre-insurrection. En 2005, les FARDC ont
lancé leur première opération d'envergure contre le groupe
avec le soutien des forces de maintien de la paix de l'ONU. Pendant ce temps,
les processus de paix soudanais et congolais ont commencé à
priver les ADF-NALU d'alliés locaux et de soutien
étranger.53(*)
En 2007, les dirigeants de la NALU se sont
démobilisés à la suite d'un accord avec le gouvernement
ougandais sur la reconnaissance du royaume du Rwenzururu, privant ainsi les ADF
de leur principal allié. Au même moment et peut être en
raison de ces nouveaux défis auxquels ils devaient faire face les
dirigeants du groupe ont commencé à se radicaliser. Un de ses
membres s'explique : « Vers 2003, nous avons commencé à
appliquer la loi de la charia de manière plus stricte, à imposer
la séparation des femmes et des hommes dans les camps, et le rôle
de l'islam au sein des ADF est ainsi devenu plus important. »
Le groupe est devenu plus agressif envers la population
locale, souvent en réaction à des attaques des FARDC, commettant
des enlèvements et des pillages, et tuant des agriculteurs et des
commerçants. Un rapport de l'ONU de janvier 2014 indique que des
formateurs arabophones avaient rendu visite aux ADF et confirme l'application
d'une interprétation stricte du droit islamique dans les camps ADF.
La plupart des compte-rendu sur les ADF qui ont
été faits vers 2013 décrivent un groupe reclus, uni et
retranché dans deux camps principaux : près d'Isale, dans les
contreforts des monts Ruwenzori, et à l'est de la ville d'Eringeti, dans
la vallée de la Semuliki, dans le groupement de Bambuba Kisiki, qui est
lié aux chefs traditionnels cuba.
Deux offensives de l'armée congolaise et de la MONUSCO,
les offensives Ruwenzori (2010-2011) et Radi Strike (2012) avaient
considérablement amenuisé le groupe, réduisant le nombre
de ses combattants à environ 110, sans pour autant vraiment affecter ses
hauts dirigeants.
Presque immédiatement après avoir vaincu la
rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, l'armée congolaise a
lancé les opérations Sokola I contre les ADF en décembre
2013. Cela a déclenché une série d'horribles massacres
contre la population locale à partir d'octobre 2014. Selon une
enquête approfondie menée par le GEC, la dynamique à
l'origine de cette violence était complexe. La décision du
gouvernement congolais de s'en prendre aux ADF, plutôt qu'aux Forces
démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ce que
réclamaient les États-Unis et d'autres pays influents, a
probablement été influencée par le fait que le M23 avait
tenté d'ouvrir une deuxième ligne de front dans la région
de Béni, avec la participation d'anciens réseaux RCD/K-ML de la
zone. Le gouvernement a commencé à arrêter des hommes
d'affaires et beaucoup d'officiers de l'armée liés à cet
ancien groupe rebelle.
Cela permet d'expliquer pourquoi, lorsque les massacres ont
véritablement commencé en octobre 2014, cela concernait un
réseau décentralisé d'acteurs armés, à
savoir d'anciens officiers du RCD/K-ML, des milices locales liées
à la communauté Cuba et même des officiers des FARDC.
Chaque groupe a cherché à utiliser la violence
pour défendre ses propres intérêts. Il semblerait que les
ADF ont eu recours à la brutalité pour pouvoir survivre face
à l'offensive du gouvernement et afin d'exercer des représailles
envers les locaux pour leur collaboration avec celui-ci. Des déserteurs
des ADF déclarent que c'est à ce moment-là qu'ils ont
initié leur « guerre » contre les FARDC. Les enregistrements
de Mukulu parlent ouvertement des combats contre les FARDC et appellent aux
meurtres de « non croyants » parce qu'ils pourraient transmettre des
informations sur les ADF. Entre temps, les réseaux RCD/K-ML cherchaient
aussi à discréditer le gouvernement et ont mis sur pied une
nouvelle rébellion alors que les milices locales étaient
impliquées dans des luttes pour le pouvoir politique et
économique les opposant à des rivaux de la communauté.
Les objectifs des FARDC sont plus difficiles à cerner, mais
d'après des sources proches du général Akâli Mundos,
ce dernier aurait cherché à coopter les réseaux locaux
RCD/K-ML en les faisant travailler pour lui, ce qui aurait contribué
à prolonger la violence. Alors que le gouvernement congolais a
principalement insisté sur le fait que les ADF étaient
responsables des massacres, des équipes indépendantes de
chercheurs de l'ONU ainsi que certains groupes de la société
civile ont aussi déclaré que d'autres groupes étaient
impliqués.54(*)
Entre octobre 2014 et décembre 2016, plus de 500
personnes ont été massacrées dans le territoire de
Béni, en grande partie près de la route menant de Béni
à Eringeti et en périphérie de Béni. Le mode
opératoire des attaques variait considérablement, ce qui renforce
la théorie selon laquelle la responsabilité ne pouvait être
imputée qu'à un seul groupe. Aucune communauté religieuse
ou ethnique n'était particulièrement visée et les
massacres ont eu lieu dans des contextes à la fois urbains et ruraux, la
plupart du temps pendant la nuit. Selon des témoins oculaires, les
assaillants parlaient plusieurs langues, principalement le swahili mais aussi
le kinyarwanda et le lingala, des langues que les ADF ne parlaient
généralement pas pendant leurs opérations. Les massacres
les plus importants se sont déroulés simultanément dans
les trois villages de Tepiomba, Masulukwede et Vemba, le 20 novembre 2014,
faisant 120 morts.
a. Le mouvement du 23 mars (M23)
Le M23 est un groupe politico-militaire mis en place en mai
2012 par d'anciens membres du CNDP (Sadiki, 2014) intégrés au
sein des institutions du pays (principalement l'armée) à la
faveur de l'Accord de Paix de 2009 signé entre le gouvernement et le
leadership du CNDP conduit par le Général Bosco Ntaganda.
Initialement, les animateurs du M23 avaient motivé leur décision
de reprendre la lutte armée par les réticences du gouvernement
à appliquer l'Accord de mars 2009 dans sa totalité.
Il s'agissait en particulier des aspects relatifs aux grades
militaires, à la réconciliation, à la justice ainsi qu'au
retour des réfugiés tutsi congolais vivant au Rwanda (Minani,
2013). Cependant, comme le fait si bien remarquer Jones, la décision
d'anciens commandants militaires et combattants du CNDP de s'engager dans une
mutinerie en avril 2012 était une réponse à la tentative
du Président Kabila de transférer les anciens
éléments du CNDP hors de la région du Kivu dans un effort
de démanteler les anciennes chaînes parallèles de
commandement du CNDP au sein de la région militaire du Kivu et
d'éliminer la "maffia" qui contrôlait l'Est du pays (Jones, 2012).
Au départ, le gouvernement rejeta la demande du M23
pour un dialogue direct. Cependant, après la chute de Goma entre les
mains des rebelles en décembre 2012, le gouvernement révisa sa
position. Mais, dans l'entre-temps, le M23 était considéré
comme « une force négative terroriste » (L'Avenir,
2013). L'empressement et la détermination de la part du gouvernement
à qualifier le M23 de groupe terroriste procédaient de deux
logiques.
D'une part, ils servaient à discréditer et
à décrédibiliser cette organisation (ainsi que ses
parrains rwandais et ougandais) aux yeux de la communauté internationale
qui, depuis la "guerre de libération" entre 1996 et 1997, avait tendance
à sympathiser avec les différents mouvements rebelles s'opposant
militairement au pouvoir établi à Kinshasa. D'autre part, ils
avaient pour finalité de justifier le refus catégorique du
gouvernement de négocier avec le M23, car il est une "maxime"
universellement partagée en matière de terrorisme que « l'on
ne négocie pas avec un groupe terroriste ». Cette
stratégie du gouvernement servait à camoufler l'humiliation subie
par le gouvernement suite à la prise "aisée" de la ville de Goma
par le M23 en décembre 2012. Elle s'appuyait, dans une large mesure, sur
l'impopularité manifeste du M23 aussi bien au sein de la
société civile que dans les cercles politiques congolais.
Ainsi, par exemple, en février 2013, l'Agence
Congolaise de Presse (ACP) décrivait « des factions
disloquées du groupe terroriste M23 [qui] se dispersent et s'affrontent
entre elles au Nord-Kivu » (2013). Cette même ligne d'argumentation,
consistant à qualifier le M23 de groupe terroriste, a également
été utilisée dans les cercles des organisations non
gouvernementales. Par exemple, le défenseur des droits humains Hubert
Tshiswaka suggérait que « [l]a Cour Pénale Internationale
(CPI) devrait suivre les activités terroristes du M23 en RDC »
(http://massdouglas.over
blog.com, 2012).
Toutefois, malgré l'acharnement du gouvernement et
d'autres cercles socio-politiques congolais à présenter le M23
comme un groupe terroriste, la prise de la ville de Goma par ce groupe rebelle
en décembre 2012 finit par obliger les autorités congolaises
à entrer en pourparlers directs avec ce dernier sous la facilitation du
Président ougandais Yoweri Museveni.55(*) En réalité, c'est la Conférence
Internationale sur la Région des Grands-Lacs (CIRGL) qui somma le M23
à se retirer de Goma sans délai tout en intimant l'ordre au
gouvernement congolais de rencontrer les rebelles en vue d'écouter leurs
doléances.
C'est cette logique des négociations directes quoique
sans parvenir à un compromis - qui prévalut jusqu'à la
défaite militaire du M23 aux mains des Forces Armées de la RDC
(FARDC), appuyées par la Brigade d'Intervention de la MONUSCO en fin
2013.
Ø Mode opératoire de M23
Le M23 opère de plus en plus comme une armée
conventionnelle, s'appuyant sur des équipements beaucoup plus
sophistiqués que par le passé.
Bien que cela n'ait pas encore été
vérifié de manière indépendante, le M23 est parmi
des groupes que l'on croit avoir abattu un hélicoptère de la
mission de l'ONU qui s'est écrasé dans leur fief en mars 2022.
Des hélicoptères militaires de la RDC ont également
été pris pour cible dans cette zone en 2017.
Des sources militaires ont laissé entendre que le M23
est actuellement capable d'opérer 24 heures sur 24, grâce à
des dispositifs et équipements de vision nocturne. Il dispose
également d'armes à plus longue portée, comme des mortiers
et des mitrailleuses. Il est probable que ces armes aient été
fournies par une armée bien organisée, raison pour laquelle les
services de sécurité rwandais sont soupçonnés de
soutenir le M23.
Outre l'équipement, le M23 mène une guerre
conventionnelle bien organisée durant laquelle il a pris le dessus sur
l'armée nationale Congolaise. Le M23 a connu de sérieux
problèmes de recrutement dans la population locale. Il a effectué
des recrutements forcés à l'égard des jeunes et commis des
viols et des meurtres. Les ONG des droits de l'homme sont entrées en
sommeil ou se sont retirées par peur des représailles.
À l'instar des autres groupes armés, le M23
mène une stratégie fondée sur une alternance de coups de
force et d'appels à la négociation.
2.1.2. Objectifs de l'opération
Cette opération consiste en une coopération
entre les forces armées congolaises et les forces de maintien de la paix
de l'ONU pour mener des opérations conjointes visant à
neutraliser les groupes armés qui menacent la sécurité des
populations civiles.
En outre, l'opération Ushujaa vise également
à renforcer les capacités des forces de sécurité
congolaises en matière de lutte contre le terrorisme et de maintien de
la paix. Cela permettra aux forces de sécurité congolaises
d'être mieux préparées pour faire face aux menaces
terroristes et de mieux protéger les populations civiles.
L'Opération Ushujaa renforce la sécurité
et la stabilité dans les zones touchées par les groupes
terroristes en RDC en menant des opérations militaires ciblées
contre ces groupes. Les forces de sécurité congolaises, soutenues
par des forces de maintien de la paix de l'ON ; mènent des
patrouilles et des opérations de recherche et de saisie pour neutraliser
les groupes armés et leurs bases. L'Opération vise
également à renforcer les capacités des forces de
sécurité congolaises en matière de lutte contre le
terrorisme, en leur fournissant une formation et un équipement
appropriés. En fin, l'Opération vise à améliorer la
coopération régionale et internationale dans la lutte contre le
terrorisme en RDC.
2.1.3. Les acteurs impliqués dans
l'opération de lutte contre les ADF en RDC
2.1.3.1. Les forces armées de la
République Démocratique du Congo (FARDC)
Les forces armées de la République
Démocratique du Congo (FARDC), sont les forces armées officielles
de la RDC, issues des accords de paix de Sun city de juin 2003.
Elles se constituent en partie sur base d'une tentative de
regroupement et d'intégration au sein d'une structure de commandement
unique des forces militaire tant du gouvernement légal de Kinshasa que
des anciens mouvements de rébellion qui ont divisé le pays. En
particulier depuis la seconde guerre d'Août 200856(*).
II s'agit en particulier des mouvements Maï-Maï, des
troupes du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD Goma), du
mouvement de libération du Congo (MLC) auxquels viennent s'ajouter les
miliciens des groupes armés de l'Ituri et les éléments
militaires sous l'obédience du général déchue,
Laurent NKUNDA.
a. Création de Forces armées de la
République Démocratique du Congo (FARDC)
Après le déclenchement de la seconde guerre du
Congo et l'occupation d'une partie du pays par des troupes du Rwanda, de
l'Ouganda et du Burundi en 1998, le principe de former une « armée
nationale, restructurée et intégrée » a
été pour la première fois évoqué lors de
« l'Accord de cessez-le- feu » signé à Lusaka le 10
juillet 1999 par le chefs d'Etat de la RDC et de cinq autres pays africains
ayant déployé des troupes dans ce pays.
Dans une annexe consacrée aux « modalités
de mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu », il était en outre
prévue que les éléments de cette nouvelle armée
seraient issus des forces gouvernementales, des Forces Armées
Congolaises (FAC) et des deux principaux mouvements rebelles, le Rassemblement
Congolais pour la Démocratie (RCD) et le mouvement pour la
Libération du Congo (MLC)57(*)
L'accord de cessez-le-feu n'a jamais été mis en
oeuvre et il a fallu attendre près de trois ans pour que la question
revienne sur le tapis, lors du dialogue inter-congolais » tenu à
Sun city (Afrique du Sud) de février à Avril 2002. Cependant,
l'accord conclu le 19 avril par les parties belligérantes, l'opposition
politique et les forces vives » (soit, pour simplifier la
société civile) se contente, par son article 5, de confier toutes
les questions relatives aux forces armées à un « Conseil
Supérieur de la Défense » dont la composition et le
fonctionnement seront déterminés par une loi. Cependant dans son
article 13, l'accord prévoit qu'un « mécanisme pour la
formation d'une Armée Nationale restructuré et
intégrée » sera établi conformément
à l'accord de Lusaka et qu'il inclura également des
représentants des forces armées du RCD/Mouvement de Liberation,
RCD/national (RCD/N, deux scissions du RCD, ainsi que des Maï-Maï,
groupes de résistants à l'occupation étrangère
bénéficiant des soutiens du gouvernement.
Quelques mois plus tard, le 16 Décembre 2002 à
Pretoria, alors que les armées Rwandaises et burundaises venaient de
quitter la RDC, était signé « l'Accord global et
inclusif sur la transition en République Démocratique du
Congo ». Il y était d'emblée précisé
qu'un « des objectifs principaux de la transition était la
formation d'une armée nationale, restructurée et
intégrée ». L'article 6, entièrement
consacré à cette armée, institue le
« mécanisme chargé de la formation d'une armée
nationale, restructurée et intégrée »
prévu par l'Accord de Sun city. Il prévoit que le chef
d'état-major général et ses deux adjoints, ainsi que ceux
des trois forces, ne peuvent provenir de la même
« composante » (partie signataire ou, de facto, partie
belligérante).
Comme décidé à Sun city, la nouvelle
armée inclura des éléments des forces gouvernementales,
des Maï-Maï et des quatre mouvements rebelles. Sont également
crées un mécanisme intérimaire pour procéder
à l'identification physique des militaires et un conseil
supérieur de la Défense présidé par le
président de la République, soit JOSEPH KABILA, composé
d'une douzaine de membres, dont les quatre vice-présidents
instituées par le même accord.
En outre, dans un mémorandum annexé «
l'accord global et inclusif » et signé également à
Pretoria le 6 mars 2003, il est convenu que le « mécanisme »
de formation d'une armée nationale sera la « réunion des
états-majors FAC, RCD, MLC, RCD/N, RCD/KML et Maï-Maï. De
plus, chaque dirigeant de la transition choisira 5 à 15 gardes du corps
pour sa sécurité personnelle.
Le premier texte officiel à évoquer les «
Forces armées de la République Démocratique du Congo
» désormais connues sous le sigle « FARDC », est la
constitution de transition adoptée par les deux chambres, le
1er Avril 2003 et promulguée par le chef de l'Etat trois
jours plus tard. Les sections II et III de son chapitre IV traitent
respectivement des forces armées et du Conseil Supérieur de la
Défense. Ce dernier étant notamment chargé de former
« une armée nationale, restructurée et
intégrée », de désarmer les groupes armés et
de superviser le départ des troupes étrangères.
Cette nouvelle constitution, qui demeurera en vigueur jusqu'en
février 2006, jettera les bases pour de nouvelles forces armées
d'un pays en voie de réunification.
Le 18 Décembre 2003, dans le but de désarmer,
démobiliser et de réinsérer dans la vie civile les
combattants excédentaires, un décret présidentiel
crée une commission nationale, de désarmement, de
démobilisation ct de réinsertion (CONADER), chargée en
particulier d'exécuter un programme national de désarmement, de
démobiliser et de réinsertion (PNDDR) dont la mise en oeuvre
débutera en 2004 et s'étalera sur sept années. Grace
à ce programme, financé par la banque mondiale, plus de 105000
adultes et près de 28000 enfants ont été
désarmés et démobilisés, puis
réinsérés dans la vie civile.
Le 28 janvier 2004, une nouvelle étape est franchie par
création, via le décret  présidentiel n° 04/014, de la structure militaire
d'intégration (SMI) chargée de l'identification, de la
sélection, du brassage et du recyclage des éléments
éligibles dans le cadre de la Défense et la CONADER58(*). présidentiel n° 04/014, de la structure militaire
d'intégration (SMI) chargée de l'identification, de la
sélection, du brassage et du recyclage des éléments
éligibles dans le cadre de la Défense et la CONADER58(*).
Le 12 novembre 2004, une loi concernant les FARDC est enfin
promulguée. Il s'agit de la loi organique n° 04/023 portant
organisation générale et fonctionnement de la Défense et
des forces armées. Son article 45 prévoit d'intégrer dans
les FARDC, outre les six forces ou mouvances déterminés pour le
gouvernement. La loi institue également, au sein des FARDC, une «
garde républicaine » ayant pour mission de protéger le
président de la  République et relevant directement de ce dernier. En
définitive, concernant la création, tout commence par la
signature de l'accord global et inclusif ayant pour objectif de mettre fin
à la guerre et de sauvegarder par conséquent la
souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. République et relevant directement de ce dernier. En
définitive, concernant la création, tout commence par la
signature de l'accord global et inclusif ayant pour objectif de mettre fin
à la guerre et de sauvegarder par conséquent la
souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC.
b. Objectifs des FARDC
Pendant la période de transition, l'objectif
était de créer une armée nationale, restructurée et
intégrée.
1. Objectifs globaux
Ø Réaliser les missions constitutionnelles
dévolues aux forces Armées (art 187 de la constitution) ;
Ø Assurer l'instruction et la formation aux
éléments des FARDC  ; ;
Ø Garantir le bien être des
éléments de FARDC et de leurs dépendants ;
Ø Garantir l'acquisition d'équipement et
matériels en comptant sur nos ressources avant tout.
2. Objectifs spécifiques
Ø Restructurer les forces armées en les rendant
professionnelle, moderne et crédible ;
Ø Préparer les unités à assurer la
relève des troupes de la MONUC ;
Ø Rendre opérationnelle ces unités en les
dotant des matériels et équipements indispensables pour
détruire les forces négatives déclarées ;
Ø Renforcer les capacités des FARDC par la
relance de l'instruction de base de l'entrainement des troupes et la formation
des cadres ;
Ø Redéployer les unités
restructurées dans les zones vitales et zones clées ;
Ø Construire des cantonnements en dur dans les sites
d'implantation des unités ;
Ø Retrouver progressivement les militaires en limite
d'âge et procéder au recrutement des nouveaux
éléments pour le rajeunissement de l'armée ;
Ø Moderniser la gestion des ressources humaines du
recrutement jusqu'au départ en retraite en utilisant les moyens
informatiques ;
Ø Assurer une bonne communication entre l'armée
et d'autres composantes de la société.59(*)
Les objectifs ci-haut cités sont des objectifs du forum
du gouvernement de transition de 1+4.
3. Objectifs Militaires
Parmi ces objectifs, on peut citer :
Ø La défense nationale qui est l'ensemble des
moyens militaires et non militaires mis en place par la nation pour assurer sa
défense ;
Ø La défense militaire ;
Ø La doctrine militaire ;
Ø La stratégie de défense ;
Ø La dissuasion ;
Ø La guerre ;
Ø La stratégie militaire, composante de la
stratégie générale ;
Ø L'état de siège ;
Ø La mobilisation générale ;
Ø La sécurité militaire, la
sécurité publique sont autant des moyens mis à leur
disposition. Ces concepts sont définis dans l'article 2 de la loi.
Ici il s'agit des objectifs assignés aux Forces
Armées de la République Démocratique du Congo.
c. Moyens humains, financières et
matériels des FARDC
1) Moyens matériels
En ce qui concerne les moyens matériels, on peut citez,
les chars, les avions de guerre etc. L'insuffisance, le vieillissement du
personnel logistique ; le peu existant souvent mal utilisé. Le manque
(le politique d'acquisition, de gestion ct de maintenance des matériels
ct des équipements. Les matériels d'occasion de type civil, sans
pièces de recharge, non standardisés, entrainant la
réduction de longévité, car pas de document technique. le
manque de fondstechnique pour l'entretien et réparations des
matériels et équipements sont autant des problèmes dans ce
domaine59(*)
2) Moyens humaines
Nous avons les Forces terrestre, navale ct aérienne. Le
recensement biométrique a retenu provisoirement un effectif de 129.395
militaires actifs répartis comme suit :
v Officiers : 32.373
v Sous-officiers : 47.723
v Troupe : 49.399
La pyramide globale d'âge n'est pas mauvaise, la grande
majorité des militaires ont entre 25 et 40 ans.
Dans l'effectif recensé, près de 20.000
militaires ont dépassé l'âge limite de la retraite, auquel
chiffre, il faut ajouter près de 40.000 militaires dits « Macarons
Rouges » qui trouvent présentement au ministère des affaires
sociales attendant la retraite. C'est parmi des militaires âgés
que l'on trouve la grande majorité des spécialistes et dont le
départ précipité, sans mesure d'encadrement risque de
créer un vide.
3)
Moyens financiers
Selon la loi de programmation militaire qui est une loi
financière pluriannuelle, fixe les échéances des
crédits de paiements relatifs aux défenses d'équipement et
de développement des Forces Armées. Elle définit dans le
cadre des lois budgétaires la tranche du budget réservé au
développement et à l'équipement des forces. Elle
détermine les séquences et le rythme des opérations ou des
achats à effectuer pour atteindre les objectifs de développement
des forces armés60(*).
Cependant, il faut noter que les militaires n'ont pas de
salaire, ils se contentent de la ration convertie en argent (RCS) avec comme
conséquences, le mauvais rendement, l'indiscipline et les exactions de
la population, pas de scolarisation des enfants. Le fonds de ménage leur
accordé au taux de 70 homme/mois ne permet pas d'organiser la cuisine
collective au-delà de 10 jours et l'absence de prise en charge
médicale des militaires de leurs indépendants.
2.1.3.2. Mission de l'organisation des
nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO)
A la suite des atrocités qui ont émaillé
la République Démocratique du Congo divisé en partie par
les différends tels que le Rassemblement congolais pour la
Démocratie (RCD) soutenu par le Rwanda, le RCD Kisangani appuyé
par l'Ouganda ; le RCD/KML, le MLC et le Maï-Maï dans les
différents coins de la RDC ; les autorités congolaises se sont
vues dans une difficulté pour en finir avec la guerre. A cet effet,
elles ont saisi le conseil de sécurité qui est l'organe de l'ONU
auquel l'article 24 de la charte confère la responsabilité
principale du maintien de la paix et la sécurité internationale,
et des nations unies a été déployé au Congo en 1999
(MONUSCO) par la résolution du conseil de sécurité (1856)
qui donne mandat à la MONUC de créer les conditions favorables et
les efforts de paix, d'appuyer le gouvernement de la RDC dans la recherche des
solutions pacifiques au conflit, d'étendre l'autorité de l'Etat,
d'améliorer le droit de l'homme et de renforcer les institutions
légitimes.
En date du 23 mars 2009, par la résolution 1906 du
conseil de sécurité des Nations Unies qui avait comme
préoccupation de la protection des civils et conditionne le soutien de
la MONUC aux FARDC au respect du DIH sur base des progrès accomplis par
la MONUC en matière de la protection des civils, de professionnalisation
des FARDC, de rétablissement de l'autorité de l'Etat, le conseil
de sécurité propose un plan envisageant le retrait de la MONUC
suite aux accords du 23 mars 200361(*)
2.1.3.2.1. Création de la MONUSCO
Le conseil de sécurité des Nations Unies a
adopté le 28 mai 2010, la Résolution  1925 installant la « Mission de l'Organisations des Nations Unies
pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo
(MONUSCO), après la Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République Démocratique du Congo (MONUC), mise en place suite
à une guerre qui avait près de 4 millions des victimes, Elle a
accompagné le peuple congolais dans les négociations de
cessez-le-feu et la transition vers les élections avec une mission
d'imposition de paix. En prenant le relais, la MONUSCO a contribué
à la restauration de la paix, dans certaines parties du territoire avec
un mandat évolutif, même si l'on constate, malheureusement la
persistance de conflit armé dans les deux provinces du Kivu. La MONUSCO
est créé à l'issue du prolongement une nouvelle fois du
mandat de la MONUC jusqu'au 30 Juin 2010 dans sa résolution 1925 du 28
mai 2010. 1925 installant la « Mission de l'Organisations des Nations Unies
pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo
(MONUSCO), après la Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République Démocratique du Congo (MONUC), mise en place suite
à une guerre qui avait près de 4 millions des victimes, Elle a
accompagné le peuple congolais dans les négociations de
cessez-le-feu et la transition vers les élections avec une mission
d'imposition de paix. En prenant le relais, la MONUSCO a contribué
à la restauration de la paix, dans certaines parties du territoire avec
un mandat évolutif, même si l'on constate, malheureusement la
persistance de conflit armé dans les deux provinces du Kivu. La MONUSCO
est créé à l'issue du prolongement une nouvelle fois du
mandat de la MONUC jusqu'au 30 Juin 2010 dans sa résolution 1925 du 28
mai 2010.
Cependant, il faut noter que la MONUSCO est une
opération de maintien de paix de dernière
génération chargée des missions de la stabilisation de la
paix et du développement socio-économique. Pour cela, les nations
unies travaillent avec les autorités congolaises, la
société civile et les citoyens congolais.
2.1.3.2. Missions de la MONUSCO
Le conseil de sécurité dans sa résolution
1991 fixe plusieurs missions de la MONUSCO à savoir celui de pacifier le
pays et protéger les populations, assister  les faibles dans l'urgence, renforcer l'Etat pour consolider la paix,
relancer l'économie et initier62(*) le développement les faibles dans l'urgence, renforcer l'Etat pour consolider la paix,
relancer l'économie et initier62(*) le développement 
2.1.3.3. La pacification du pays et la
protection des populations.
Les Nations Unies sont d'abord dans le pays à la
demande du gouvernement pour aider l'Etat à restaurer la paix et
protéger ses citoyens physiquement dans leurs droits à
démanteler les groupes armés, promouvoir et garantir le respect
des droits de l'homme. Dans ce cas, elle collabore au quotidien avec les
autorités souveraines du pays et les autres institutions du
système des Nations Unies, en particulier le Bureau conjoint des droits
de l'homme (BCDH).
Elle appuie le gouvernement pour négocier la fin des
conflits, surtout à l'Est du pays, tout comme elle soutient
l'armée Congolaise dans ces opérations contre les groupes
illégaux ; là où les populations sont plus en danger, elle
a pour tâche de les protéger et d'appuyer la réforme de
l'armée et de la police, renforcer la capacité de la justice
civile et militaire pour mettre en oeuvre la politique de «
tolérance zéro » décrétée par le chef
de l'Etat et fournir un soutien matériel pour restaurer la discipline au
sein des effectifs militaires.
2.1.3.4. L'assistance des faibles dans
l'urgence
Les Nations Unies sont en RDC pour aider les plus faibles,
c'est la mission des qui agences mettent en oeuvre des programmes d'assistance
humanitaire. Il s'agit notamment PAM qui assure les distributions alimentaires
d'urgence, de l'UNICEF qui répond aux besoins essentiels des enfants, de
I' UNFPA et d'autres partenaires qui appuient l'aide aux victimes de violences
sexuelles, enfin d'OCHA qui assure la coordination de toutes
activités.
Ces agences collaborent avec tous les autres acteurs
humanitaires, organisations non gouvernementales, nationales et internationales
en particulier, mais aussi les autorités nationales et locales pour
sauver des vies au quotidien. Les agences aident notamment les
déplacés jusqu'au retour dans leurs communautés
après la fin des violences. Mais les Nations appuient surtout aux
congolais les services sociaux de base dont ils ont besoin. Car l'avenir du
pays imposera de passer de l'assistance humanitaire encore nécessaire
aujourd'hui au renforcement d'un Etat à même.
2.1.3.5. Le renforcement de l'Etat pour la
consolidation de la paix.
La clé de tout progrès pour un pays est le
renforcement de l'autorité légitime de l'Etat. Une fois mis au
terme aux conflits, il faut consolider la paix. Pour cela, les Nations Unies
appuient les efforts du gouvernement congolais pour étendre la
présence de l'Etat partout dans le pays et renforcer la capacité
de ses administrations. Dans les zones reprises aux groupes armés dans
l'Est du pays, les Nations Unies à travers le PNUD en particulier,
appuie la réforme de l'armée, de la police et de la justice parce
que ces institutions sont essentielles pour assurer le retour pérenne de
la paix.
2.1.3.6. La relance de l'économie et
l'initiative au développement.
Les Nations Unies sont en RDC pour accompagner le pays sur la
voie de développement. Les agences alignent leur action sur le
développement. Les agences alignent leur action sur les plans
définis par les autorités nationales pour que les enfants aient
accès à l'éducation que les services de santé
s'améliorent pour faire face à la malaria et au sida, que la
production agricole augmente. La banque mondiale, le FMI et le BAD, les
institutions financières partenaires, travaillent également avec
les instances gouvernementales pour contribuer à la stabilité et
au développement économique du pays ; ils appuient les finances
 publiques et soutiennent notamment des projets d'infrastructures.
L'enjeu est de passer d'une économie de guerre où des profiteurs
pillent ct perpétuent le conflit, à une économie de paix
où les ressources naturelles et le potentiel agricole fournissent des
rêveurs à l'Etat, du travail aux citoyens et des surplus
réinvestis dans l'économie par les entrepreneurs
légitimes. publiques et soutiennent notamment des projets d'infrastructures.
L'enjeu est de passer d'une économie de guerre où des profiteurs
pillent ct perpétuent le conflit, à une économie de paix
où les ressources naturelles et le potentiel agricole fournissent des
rêveurs à l'Etat, du travail aux citoyens et des surplus
réinvestis dans l'économie par les entrepreneurs
légitimes.
2.1.3.7. Actions de la MONUSCO
La RDC a cependant bénéficié de plusieurs
réalisations de la MONUSCO dès la première mission de
l'ONU de 1960 à 1964 pour faire face à la sécession
Katangaise, sous appellation opération des Nations au Congo
(ONUC)63(*)
La MONUSCO, dans son premier mandat devait accompagner la
transition du Congo vers la consolidation de paix. La nouvelle orientation du
mandat de la Mission des Nations dans les pays, consistait à accorder
une importance plus accrue à la consolidation de paix. Pour raffermir ct
faire avancer la stabilisation du pays. C'est ainsi que la MONUSCO 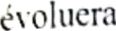 avec deux priorités majeurs ; la protection des civils, ainsi que
la stabilisation et la consolidation de la paix. La protection des populations
civiles comme l'on peut le constater avec deux priorités majeurs ; la protection des civils, ainsi que
la stabilisation et la consolidation de la paix. La protection des populations
civiles comme l'on peut le constater  sera placée au coeur de tous les mandats qui suivent. sera placée au coeur de tous les mandats qui suivent.
La résolution 1991 met surtout l'accent sur la
nécessité d'un partenariat stratégique impliquant tous les
acteurs au plan national, régional et international. La
résolution 2078 du 28 novembre 2012 s'est focalisée sur les
priorités majeures suivantes : de nouveau la protection des civiles, la
fin de l'impunité, l'arrêt du recrutement des enfants soldats et
de toute forme de violations des droits de l'homme.
Avec la résolution 2098, du 28 mars 2013, le conseil de
sécurité prend une décision historique qui va changer la
manière d'intervenir sur terrains en conflit. Il s'agissait de s'adapter
pour faire reculer les forcer négatives, s'adapter pour protéger
les populations touchées par toute la violence qui s'abat sur elles,
s'adapter pour aider à consolider la paix tout simplement. Cette
année-là en effet pour la première fois dans l'histoire
des Missions de Maintien de la paix, il a été
décidé la création d'une brigade d'intervention, à
titre exceptionnel. Cette brigade a pour mission de traquer les groupes
armés, de les neutraliser et de les éradiquer seule avec les
FARDC. Elle est basée à l'Est du pays et reste mobile pour plus
d'efficacité.
Les menaces sur les populations ne faiblissant pas, une fois
le rapport annuel du SGNU présenté au conseil il sera
décidé de proroger le mandat de la Mission, dans la
résolution 2147 du 28 mars 2014. A nouveau la protection des civils
reste la pierre angulaire des interventions assignées aux casques bleus
en terre congolaise. L'un des groupes armés les plus néfastes
(M23) à l'Est du pays défait, en novembre 2013 et il est
demandé à la brigade d'intervention de poursuivre sa tâche
de neutralisation des milices, bandes et groupes armées. Il est
également question de revoir la configuration de la Mission. On parle
alors de reconfiguration » : optimisation des humains et matériels,
souplesse et efficacité pour agir au coeur des zones à
problème.
Enfin, adoptée en 7415 e séance par le conseil
de sécurité, la dernière Résolution 2211 du 26 mars
2015 fait le constant que « l'Est de la RDC continue d'être le
théâtre de conflit récurrents ct de violences persistantes
» ; maintenue toujours à titre exceptionnel. Mais, recommandation
du secrétaire général de Nations Unies de commencer
à réduire la présence militaire de 2000
éléments est prise en compte.
Il faudra en définitive retenir que depuis 1960,
l'histoire politico-sociale de la RDC est émaillée de conflits
sur une ou plusieurs parties du territoire, qui ont appelé l'attention
du conseil de sécurité. La protection de la population
étant le point commun aux missions qui s'y sont
succédé.
2.1.3. UGANDA PEOPLE'S
DEFENCE FORCE (UPDF)64(*)
La Uganda People's defence a
L'armée ougandaise (officiellement la Force de defense
du people ougandais) est l'armée nationale de l'Ouganda. Elle est forte
de 45.000 hommes.
2.1.3.1. Budget
L'armée ougandaise a un budget de 95 millions de
dollars
2.2. Contribution de la coopération militaire
entre la RDC et l'Ouganda dans le développement socio-économique
A. Les axes prioritaires de la diplomatie congolaise
Une coopération au service du développement
socio-économique de la RDC, c'est l'essentiel en analysant les axes
prioritaires de la diplomatie Congolaise ainsi que les partenaires de cette
dernière dans la réalisation.
§1. La Paix
La RDC a connu une série de crises et des conflits
armés au cours des précédentes décennies, ces
derniers ont porté un coup très dur à sa stabilité
tant intérieure qu'extérieure. Le pays reste, aujourd'hui,
confronté à une situation de paix fragile,
d'insécurité et de grande pauvreté. Le Gouvernement
Congolais ayant compris les préalables de la paix sur le
développement, qu'il s'engage à promouvoir la paix parmi les
principaux axes de priorité de sa diplomatie.
C'est dans cette optique que le Gouvernement se concentre dans
l'immédiat sur la première priorité c'est-à-dire
mettre fin à la guerre, restaurer la paix et résoudre le drame
humanitaire de deux millions de déplacés au Nord-Kivu ainsi que
sur toute la partie Est du pays. Le retour à la paix durable à
l'Est du pays passe aussi par le dialogue permanent au sein de la RDC et entre
la RDC et ses pays voisins.
C'est ainsi que le Premier Ministre SAMA LUKONDE, lors de son
discours prononcé devant l'Assemblée Nationale en guise de
présentation de son programme d'action, a relevé cet aspect de
dialogue entre la RDC et ses pays voisins en signifiant par ailleurs que dans
le cadre des pays des grands lacs, il sera mis en oeuvre un entretien de
dialogue permanent et des rapports de bon voisinage, qui passent
également par le dialogue entre Etat, sans chantage ni fourbie, ainsi
que par la relance de la coopération sous régionale.
Il apparaît évident que la coopération
militaire soit perçue comme clé de la stabilité et du
développement de la République Démocratique du Congo. La
politique régionale de la RDC repose sur la mise en oeuvre d'une
politique de bon voisinage avec les pays voisins et la réaffirmation du
rôle intégrateur de la RDC en Afrique centrale65(*).
C'est dans le but de redynamiser cette forme de
coopération, qu'il a été créé au sein du
Gouvernement un Ministère autonome de la coopération
régionale. Ce dernier est chargé de développer la
participation de la RDC aux organisations internationales Africaines. Certes,
il nous faut croire que c'est par réalisme politique et non par
faiblesse ou naïveté, que le Gouvernement Congolais s'est
engagé dans des pourparlers avec toutes parties impliquées dans
les conflits à l'Est du pays, ainsi que toutes les parties signataires
de l'accord de Nairobi et de l'Acte d'engagement de BUNIA.
§2. La
Sécurité
Dans un rapport de Kofi Annan, ancien secrétaire
général de l'ONU, il est d'ailleurs rappelé « qu'il
n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas de
sécurité sans développement... ». Cela signifie
notamment que le mouvement entrepris dès les années 1950 pour
relier paix, sécurité et développement devient une
préoccupation majeure dans le monde. C'est aussi l'élément
central des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
fixés pour 201566.
Suite à ce constat, il est important et opportun pour
la RDC qui a longtemps vécu des périodes
d'insécurité et qui semble aujourd'hui pouvoir entrer dans une
phase de stabilité et de reconstruction post-conflit, de promouvoir
l'axe prioritaire de la Sécurité dans les actions de sa
diplomatie. Car s'il est important que la RDC ait une diplomatie dynamique pour
la défense de ses intérêts, il est plus qu'important de
disposer d'une armée dissuasive pour mettre notre pays à l'abri
de l'insécurité récurrente et des attaques
répétées.
Face aux différents problèmes identifiés
dans le domaine de la sécurité et qui menacent l'unité
nationale, le Gouvernement s'engage à renforcer la stabilité
politique, la sécurité et les institutions en vue de consolider
les acquis des élections, la paix et l'unité Nationale.
Ayant conscience de l'enjeu important que revêt la RDC,
c'est-à-dire celui d'être un pays à vocation de locomotive
en Afrique, le Gouvernement Congolais cherche à accélérer
les réformes des forces armées et développer leurs
capacités défensives et offensives. De plus la situation
d'insécurité qui secoue les régions de l'Est Congolais
constitue une menace pour le progrès de la démocratie et pourrait
entraver les efforts de la communauté internationale dans
l'amélioration des conditions de vie quotidienne des Congolais. C'est
dans cette optique que l'on peut distinguer sur le plan diplomatique, l'apport
des différents partenaires bi et multilatéraux dans la
réalisation du plan de réforme du secteur de
sécurité en RDC.
Il est notamment du cas du programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), qui après les élections a eu comme
tâche principales de soutenir le Gouvernement dans le processus de
réforme de la sécurité et prendre des initiatives pour la
mise en oeuvre du programme de DDR (Désarmement, Démobilisation
et Réinsertion) pour les milices ADF NALU encore présent en Ituri
(Nord-est) avec un budget de 4 millions de dollars us66(*).
Dans ce cadre, la MONUSCO devra contribuer à assurer
une formation de base à court terme, y compris dans le domaine des
droits de l'homme, du droit international humanitaire, de la protection de
l'enfant et de la prévention des violences sexuelles, à divers
membres et à des unités des brigades intégrées des
FARDC.
L'union européenne (UE) participe quant à elle
depuis plusieurs années aux projets de réforme de la police et de
l'armée en RDC, à travers ses missions d'appui et de conseil
européen.
La coopération militaire avec la RDC depuis, envisage
de poursuivre ses efforts dans ce domaine afin de participer de façon
significative au processus en cours de restructuration des FARDC. Il convient
de souligner que ce volet important de la réforme de
sécurité est particulièrement déterminant pour la
stabilité future et par conséquent pour le développement
durable de la RDC.
La RDC sort d'une guerre régionale de près de
vingt ans. L'armée et la police, constituées des
éléments issus de différentes factions
ex-belligérantes, sont en cours de restauration depuis plusieurs
années.
Mettre en place une armée de l'excellence en
privilégiant la qualité dans le recrutement, un contrôle
rigoureux des effectifs à travers un recensement biométrique, la
mise sur pied d'une force de réaction rapide capable d'assurer la
relève de la MONUSCO, de sécuriser l'Est du pays et de
réaliser des missions constitutionnelles dévolues à
l'armée, ainsi qu'une force de couverture pour appuyer la reconstruction
des infrastructures civiles et militaires. C'est ce qui ressort du
condensé des recommandations faites à l'issu des assises de la
table ronde sur la réforme de la sécurité organisée
avec la participation des représentants de la Communauté
internationale notamment de la MONUSCO, de la Belgique et de l'Afrique du sud,
ainsi que plus d'une centaine d'expert de l'état-major
général des FARDC, et de la police Nationale. Cela dans
l'objectif d'avoir d'ici 2024 une armée efficace capable de
défendre à tout moment l'intégrité du territoire
Congolais.
§3. La consolidation de la
démocratie et de la bonne gouvernance
La démocratie et la bonne gouvernance, sont par ici
perçues comme une stratégie globale qui devrait conduire ledit
programme à atteindre une issue favorable, entre autre le
développement socio-économique. Car au stade actuel ni Etat de
droit, ni démocratie ne sont encore véritablement ancrés
dans le pays ; l'un et l'autre a donc impérativement besoin d'être
confortés, afin de promouvoir une bonne gouvernance qui conditionne le
développement.
Promouvoir la participation des populations aux
décisions qui les concernent est un principe fondamental des
stratégies de réduction de la pauvreté. C'est par cette
participation que les populations pauvres peuvent influencer sur la politique
générale, sur les priorités budgétaires. Pour
être durable, la participation doit être institutionnalisée.
En s'appuyant sur le document de la stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté, le Gouvernement congolais initiera une
série de réformes en vue de renforcer et d'améliorer
l'efficience et la performance de l'appareil étatique67(*).
§4. Le Développement
socio-économique
Comme nous l'avons évoqué tout haut, que sans la
paix et la sécurité, il est impossible de mettre en oeuvre le
programme de reconstruction et de redressement économique et social. De
même, le mieux-être social des populations dépend de la
stabilisation et de la relance économique.
En outre, l'amélioration des conditions sociales des
populations est le gage de la pérennité de la paix et de la
sécurité, par la réduction des foyers de tension et des
prédispositions à la délinquance, à la violence et
aux conflits armés. Sans stabilité économique forte et
soutenue, génératrice des richesses et de ressources
financières accrues pour le trésor public, la RDC ne pourra
atteindre le développement économique au vrai sens du terme.
C'est dans ce but que la RDC, notre pays s'engage à
assurer une croissance économique robuste par le maintien d'un cadre et
des politiques macroéconomiques stables et la poursuite des
réformes économiques et structurelles. En termes quantitatifs,
les objectifs se traduisent pour la période étalée comme
suit :
- Une croissance soutenue de la production qui se situera en
moyenne à 7,7% grâce à un afflux de financement
extérieur pour les projets ;
- Un taux d'inflation moyen de 6,5% grâce à des
politiques budgétaires et monétaires prudentes.
La RDC sortait à peine d'un conflit dans la
région des grands lacs dont les pays membres ont été
impliqués (7 pays étrangers) de manière active. Depuis le
retour de la paix et la fin de la transition, l'intégration
régionale est désormais définie comme une priorité
gouvernementale. C'est ainsi que, dans le cadre de la diplomatie, la RDC s'en
sert comme une nécessité en vue de faciliter l'investissement
étranger et la gestion durable des ressources naturelles pour un retour
de la croissance à travers l'influence que peut avoir le RDC en Afrique.
Malheureusement, ces efforts sont sapés par la montée en
puissance des groupes armés et les terroristes des ADF ainsi que ceux
des M23.
2.3. Les difficultés inhérentes
àl'opération Ushujaa
Lorsqu'il a pris les commandes de la République
Démocratique du Congo après les élections, Felix
TSHISEKEDI prône une diplomatie d'ouverture et de bon voisinage dans son
discours d'investiture.
Durant des années, il a été
ressassé les maux qui rongent la diplomatie congolaise, notamment la
complaisance dans l'affectation des diplomates en poste, les difficultés
financières pour le fonctionnement des missions, tout ceci pour savoir
vendre l'image de la République Démocratique du Congo à
travers sa diplomatie.
2.3.1. L'image de la diplomatie
congolaise
Après cinquante ans d'indépendance, la
diplomatie congolaise plutôt que de progresser, a plutôt
régressé et sensiblement. Depuis les années 1992, la
diplomatie congolaise s'est compliquée davantage et à
l'époque de la continuité de la transition avec le gouvernement
de salut public, l'image de la diplomatie congolaise a été
ternie, encore pire pendant la période du gouvernement dit 1+4 que
l'image de cette dernière été totalement abusée car
à ce temps, les affectations tenaient compte du militantisme politique
de sorte que le rendement des ambassades en souffre aujourd'hui.
Le critère du militantisme politique viendra renforcer
l'instabilité de ministre appelé à animer ce
Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération
internationale et Régionale ceci implique le clientélisme dans la
nomination du personnel en poste. Pourrions-nous dire que la troisième
République, a-t-elle- pu faire accéder la République
Démocratique du Congo à ce contexte diplomatique conjoncturel ?
La réalité est que le pays aura connu une activité
diplomatique contrastée entre les capacités de son appareil,
à porter son image sur la place diplomatique internationale et la
visibilité acquise durant cette période au travers les
différents sommets abrités et les rencontres auxquelles ses
officiels ont participé à travers le monde.
A la clé, la République Démocratique du
Congo a pu renforcer sa coopération pour se sortir du dangereux
isolement qui contrastait avec son aspiration au développement. De
l'atteinte du point d'achement PPTE, qui a vu s'annuler plus de 90% de sa dette
extérieure, à la même prouesse auprès du club de
Paris en passant par le réchauffement des rapports bilatéraux et
multilatéraux à l'image du fond monétaire international
(FMI) et de la banque mondiale (BM).
Les présidences tournantes acquises dans
différentes organisations régionales, sous régionales et
même internationales (S.A.D.C, CEEAC et OIF) les accords de
coopération bilatérale passés, notamment avec l'Afrique du
sud, l'Inde, les deux Corées... les relations de bon voisinage
consolidées avec les constituants de la sous-région de grands
lacs (le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda) sont aussi à mettre sur le
compte de cette nouvelle visibilité renforcée.
Les visites d'importantes des personnalités du
monde-effectuées en République Démocratique du Congo
celles des chefs d'Etat et de gouvernement Français, Canadien, Turque...
chefs du parlement chinois, la secrétaire d'Etat américaine, du
secrétaire général des nations unies, du roi des belges
montrent à suffisance que la République Démocratique du
Congo est entrain de regagner sa place dans le concert des nations.
Pour le reste, il est clair que la 3e république n'aura
rien changé à l'image de la diplomatie congolaise des
années précédentes une image de l'insolvabilité de
ses missions diplomatiques vis-à-vis, non seulement des bailleurs de ces
différentes missions toujours locataires et souvent déguerpis,
mais aussi du personnel en poste qui accuse encore plusieurs
arriérés de salaire. Du côté des infrastructures,
là également le pays n'est pas épargné. Certaines
ambassades sont dans un état de délabrement fort avancé,
hors l'ambassade d'un Etat représente l'image de son pays. Ce qui ne
contribue pas toujours à la bonne image du pays.
2.3.2. Les difficultés
financières et matérielles
C'est pendant les trois premières décennies de
l'indépendance de la République Démocratique du Congo que
nous pouvons considérer à juste titre comme l'âge d'or de
la diplomatie congolaise vis-à-vis de la coopération militaire,
les diplomates congolais avaient jouit d'excellentes conditions de vie et de
travail ainsi que de l'environnement physique décent.
Les missions diplomatiques congolaises furent
confrontées à d'énormes difficultés
financières et matérielles suite à l'interruption de
transferts des fonds pour leur fonctionnement et pour les salaires et les
loyers des diplomates68(*).
2.3.2.1.Difficultés
matérielles
L'histoire du patrimoine de la République
Démocratique du Congo à l'étranger remonte à
l'accession de cette dernière à la souveraineté
internationale.
L'ouverture des missions diplomatiques congolaises dans le
monde, des missions de prospection avaient été
dépêchées dans les différentes capitales du monde
dans le but d'acquérir des immeubles pour abriter les chancelleries, les
résidences des chefs de mission et les habitations des diplomates. Ces
derniers ont été acquis soit par achat soit par
réciprocité.
Le patrimoine de la République Démocratique du
Congo à l'étranger comprend les biens immobiliers
(Bâtiments, terrains et les biens mobiliers (voitures...) Tous ces biens
sont aujourd'hui dans un état de délabrement très
avancés, d'autres proches de l'abandon, suite au non transfert des fonds
nécessaires à leur maintenance.
Outre cet état de délabrement, ces immobiliers
sont en général aujourd'hui objets de multiples litiges entre
autres :
- Absence de titres de propriété ;
- Saisie ;
- Procès en justice.
2.3.2.2. Absence des titres de
propriété
La République Démocratique du Congo dispose des
biens immobiliers dans plus de trente pays du monde mais tous ces biens sont
devenus aujourd'hui des objets des conflits soit avec les autorités de
pays accréditaires, soit avec les particuliers de ces dit pays pour
mangue de document justificatif tout cela dû à la mauvaise gestion
de ce patrimoine.
Tous ces manquements conduisent nos ambassades, chancelleries
et résidences des chefs des missions diplomatiques à la
saisie.
Chapitre troisième :
Les résultats de l'opération Ushujaa
Le résultat de l'opération militaire Shujaa,
menée conjointement par l'Ouganda et la RDC, est mitigé. C'est la
conclusion du rapport présenté jeudi 20 octobre à Goma
(Nord-Kivu) par le Groupe d'Etude sur le Congo (GEC) et son partenaire de
recherche Ebuteli.
Intitulé « L'opération conjointe Ushujaa
entre l'Ouganda et la RDC : combattre les ADF ou sécuriser les
intérêts économiques ? », ce rapport de GEC/Ebuteli,
publié en juin dernier, a été présenté
devant une trentaine de personnes dont des scientifiques, des politiques, des
membres de la société civile ainsi que quelques
analystes69(*).
Selon le Coordonnateur des recherches sur la violence à
Ebuteli, Pierre Boisselet, la présentation de ce rapport a pour objectif
de permettre à toutes les parties de faire, à leur tour,
l'évaluation mi-parcours de cette opération conjointe qui est
à sa quatrième phase. Ce, en vue de pousser le politique à
recadrer les tirs là où cette opération n'a pas
donné les résultats aux attentes des populations civiles :
« D'une part, il faut reconnaitre que nous on n'a pas
repéré les exactions de l'armée ougandaise sur les civils
congolais. Jusqu'à maintenant, on constate qu'il y a un bon comportement
de ce point de vue-là. Le problème maintenant, les ADF ont,
certes, été repoussés de certains bastions qu'ils
occupaient précédemment. Mais finalement, ils ont
été plutôt dispersés. Ils ont opéré
par la suite dans d'autres zones où ils étaient beaucoup moins
présents : à Mambasa, Butembo, parce que cette ville n'avait
jamais été touchée par les attaques des ADF», a
indiqué le chercheur Pierre Boisselet.
Tout en saluant le travail de GEC, l'Ambassadeur ougandais en
RDC et le Conseiller du ministre congolais de la défense en charge des
renseignements et sécurité, de leur côté, parlent du
succès qu'ont connu les trois premières phases de ces
opérations conjointes, en dépit de quelques obstacles70(*).
Le conseiller du ministre congolais de la défense en
charge de renseignements et sécurité, le Colonel Didier Mundey se
montre optimiste :
« Les bastions ont été
démantelés, l'ennemi a perdu sa zone de confort. Quelques
commandants importants ont été neutralisés, plusieurs
otages ont été libérés et puis, des combattants ont
été capturés. Globalement, l'Ambassadeur venait de le
dire, la zone était inaccessible, aucun véhicule ne pouvait y
accéder depuis plus de 30 ans ».
Pessimistes, les participants ont recommandé aux
responsables de deux armées de donner d'autres indicateurs précis
comme résultats de cette opération.
3.1. La coopération militaire entre la RDC et
l'Ouganda
La coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda
porte essentiellement sur deux aspects : « mutualiser les
efforts et les moyens entre les deux pays afin d'arriver à neutraliser
les ennemis communs ainsi que la formation des hommes et
l'équipement ou encore logistique »71(*).
La République Démocratique du Congo (RDC) a
signé, le 09 décembre 2021, un accord de coopération
militaire avec l'Ouganda qui a déjà déployé ses
troupes dans l'est du territoire congolais pour traquer les rebelles des Forces
démocratiques alliés (ADF) opposées au régime de
Kampala et accusés de multiples massacres de civils dans l'Est
congolais.
La signature de cet accord de coopération militaire a
eu lieu à Bunia dans la province congolaise de L'ITURI
frontalière avec l'Ouganda.
Le 16 novembre 2021, trois kamikazes explosaient leurs gilets
pare-balles à Kampala, deux près du parlement et un près
du quartier général de la police. Au moins quatre personnes ont
été tuées et 37 blessées dans les explosions.
De la même façon, le porte-parole des FARDC,
Commandant General Kasonga a affirmé le 27 mars 2022, "tous les
sanctuaires ADF, quartiers généraux et forteresses ont
été détruites, et les régions environnantes ont
été pacifiés".72(*)Ce restant quelques "criminels" qui ont réussi
à s'échapper des coups en "cherchant de la nourriture et
médecine pour leur survie." Le 7 mars 2022, le FARDC a annoncé
qu'il avait libéré au moins 72 otages, a capturé 98
combattants, a tué plusieurs autres, et a retrouvé 197
weapons.73(*)
Peu après, le gouvernement ougandais a affirmé
que les assaillants étaient liés aux Forces démocratiques
alliées (ADF), un groupe rebelle apparu dans les années 1990 en
Ouganda et résidant en République démocratique du Congo
(RDC) depuis 200074(*).
Les attentats ont également été
revendiqués par l'État islamique (EI), auquel les ADF ont
prêté allégeance en 2019. Dans les semaines
précédentes, l'IS avait revendiqué des attaques contre un
restaurant de porc et un poste de police également.
À la suite de ces évènements, le
président Yoweri Museveni a déclaré que « les
terroristes nous ont invités et nous venons les chercher ». Le 30
novembre 2021, les armées ougandaise et congolaise ont lancé des
frappes aériennes et d'artillerie conjointes contre les camps des
ADF.
Cette collaboration entre les Forces de défense
populaires de l'Ouganda (UPDF) et les Forces armées de la
République démocratique du Congo (FARDC) a ensuite
été formalisée dans un accord de défense et de
sécurité le 9 décembre.
L'opération militaire conjointe a été
baptisée Opération Ushujaa. Depuis lors, pratiquement aucune
information n'a filtré sur l'opération, les deux armées
restant très discrètes. Le peu qui a transpiré a
été un éloge sans critique. En mars 2022, par exemple, le
président Museveni a qualifié l'opération Ushujaa de
« succès total » et a déclaré que les UPDF
avaient « démoli les terroristes »
3.1.1. Stratégies de la traque des groupes
armés par les FARDC
En tant que gouvernement, ayant pour mission traditionnelle de
protéger la population de son territoire, certaines actions militaires
ont été engagées pour mettre fin à l'activisme de
groupes armés nationaux au Nord-Kivu. Les FARDC avaient
réalisé plusieurs opérations militaires pour venir
à bout des groupes armés dans les territoires de Masisi, Walikale
et tenter de restaurer l'autorité de l'Etat dans les zones où
opèrent les forces dites négatives.
Dans ses tentatives de traitement des conflits au Nord-Kivu
occasionné par l'activisme des groupes armés nationaux, le
gouvernement congolais adopte souvent la stratégie de la confrontation.
Pour le gouvernement congolais, ces groupes armés constituent une force
négative et ne méritent pas de s'assoir autour d'une table de
négociation avec lui. Mais dans la plupart de cas, c'est la
confrontation qui caractérise le dialogue entre gouvernement congolais
et différents groupes armés opérant au Nord-Kivu.
A chaque tentative, les FARDC sont toujours en
difficulté et perdent souvent le terrain devant les groupes armés
composés de moins d'hommes en comparaison avec les soldats loyalistes.
Pour tout combat, il s'observe que les FARDC sont moins efficaces et incapables
de résister ou de progresser devant l'ennemi, en particulier lorsqu'il
s'agit du groupe constitué par les militaires dissidents tutsi (CNDP,
M23,)
Les efforts officiels déployés par le
gouvernement congolais avec d'une part les pays de la région (Rwanda et
Ouganda) et d'autre part avec la Monusco n'ont pas donné des
résultats escomptés et ce, pour des raisons ci-haut
mentionnées. Comme déjà évoqué dans les
écrits de Philippe Braud, les acteurs politiques disposent de plusieurs
stratégies pour trouver solutions aux problèmes qu'ils
rencontrent dans la gestion de la chose publique. Les plus importantes restent
la négociation et la confrontation dont la priorisation est fonction de
calculs politiques, des enjeux en présence et succession des
événements sur le terrain. Pour éviter d'énormes
dépenses en ressources que nécessite la confrontation, plusieurs
acteurs mobilisent en priorité la négociation avant la
confrontation. La négociation intervient également après
la confrontation lorsque celle-ci n'arrive pas, à elle seule, d'obtenir
la décision ou d'atteindre les buts visés. Ainsi au regard des
efforts militaires consentis par le gouvernement congolais pour venir à
bout des groupes armés nationaux et étrangers sur son sol sans y
parvenir véritablement, ou alors sans le vouloir effectivement, la
négociation a souvent été mobilisée par les acteurs
nationaux et étrangers dans la recherche des solutions à la crise
à l'Est de la RDC75(*).
3.2. Les défis de l'opération Ushujaa
Malgré ces avancées significatives, il est
important de souligner que le travail pour éradiquer complètement
les ADF n'est pas encore terminé. Le Général Major Kasongo
Maloba reconnaît la lourdeur de la tâche qui attend les forces
armées.
Pour réussir, il est essentiel que les FARDC et l'UPDF
continuent de collaborer et de parler «un même langage» sur la
ligne de front. Cette coordination étroite permettra de maximiser les
chances de réussite et d'accélérer l'éradication
des ADF de la région.
Dans présente section, nous allons aborder les
défis de l'opération conjointes FARDC- UPDF sur les
différents plans entre autres, sur le plan politique, sur le plan
militaire, sur le plan sécuritaire et en fin sur le plan
économique.
3.2.1. Sur le plan politique
Les chefs d'états-majors d'armée congolaise et
ougandaise parlent des résultats satisfaisants à propos des
opérations conjointes FARDC-UPDF dénommées
« Shuja », visant essentiellement les rebelles ougandais de
l'ADF, forces démocratiques alliées dans la région de
Beni-Ituri, en République Démocratique du Congo.
Lieutenant-Général Tshiwewe Songesa Christian et
Général d'Armée MBADI MBASU Wilson l'ont fait savoir jeudi
dernier à l'issue de la réunion d'évaluation desdites
opérations tenue pendant deux jours dans la ville de Beni, au Nord-Kivu,
en présence du Gouverneur, Lieutenant-Général Constant
Ndima, et de nombreux officiers militaires de deux pays.
Les opérations conjointes menées par les forces
armées congolaises (FARDC) et l'armée ougandaise (UPDF) dans le
cadre de la lutte contre les forces négatives à l'est de la
République démocratique du Congo (RDC) sont en train de porter
leurs fruits. Sous la coordination du général major Kasongo
Maloba, commandant des opérations «Sokola 1 Grand Nord», les
deux armées travaillent de concert pour éradiquer les ADF (Allied
Democratic Forces) et rétablir la sécurité dans la
région.
« La destruction de plusieurs bastions, la neutralisation
des quelques leaders ADF/MTN, démantèlement des réseaux de
ravitaillement, y compris l'arrestation des poseurs des bombes de Kasindi
», sont des points illustrant le bilan non chiffré, a-t-on lu dans
le compte-rendu final.
Dans le même document, les deux Généraux
ont soulevé des défis majeurs auxquels font face les militaires
au front. Ils énumèrent : « la poursuite des terroristes qui
évitent la confrontation directe avec les Forces de la coalition
».
Malgré ces opérations, des civils ne cessent de
périr dans plusieurs agglomérations au Nord-Kivu et en Ituri.
Lundi dernier, au moins 30 personnes ont été tuées par
l'ADF dans la province de l'Ituri. Les deux officiers supérieurs tentent
d'en donner la raison76(*).
« Les rebelles se disséminent en petits groupes et
mènent des actions de représailles sur la population civile dans
des coins isolés », affirment-ils. Les deux autorités
militaires ont réaffirmé la nécessité de poursuivre
les opérations conjointes pour empêcher l'ADF, actuellement
affilé à l'état islamique de constituer des nouveaux
bastions.
Depuis novembre 2021, la RDC et l'Ouganda ont signé un
accord de coopération militaire en vue de traquer conjointement l'ADF
dans la région de Beni. Outre ses grandes exactions dans les provinces
du Nord-Kivu et de l'Ituri, cette milice reste une menace au régime de
Museveni. `'Ces terroristes'' qualifiés ainsi par les services
sécuritaires sont accusés d'avoir mené, il y a près
de deux ans des attentats à Kampala, capitale de l'Ouganda.
3.2.2. Sur le plan militaire
Rappelons ici l'arrivé des militaires, Kenyans,
burundais, et ougandais sur le sol congolais dans le bu de traquer les ADF,
M23...
L'association avec les forces ougandaises était loin
d'être une évidence. Personne en RDC n'a oublié
l'occupation par l'Ouganda de larges territoires du Nord-Kivu et de l'Ituri
à la fin des années 1990 et au début des années
2000. La Cour internationale de justice a d'ailleurs ordonné à
l'Ouganda, le 9 février, de verser 325 millions de dollars à la
RDC pour les divers dommages causés à cette époque. Mais
le président congolais Felix Tshisekedi ayant fait de
l'insécurité dans l'est du pays une de ses priorités, il a
tendu la main à ses voisins dans le but d'apporter une réponse
militaire robuste et rapide dans cette région77(*). Cet accord est
considéré comme un pacte avec le diable.
Les ADF sont un groupe hétéroclite. Les ADF ne
sont ni islamistes, ni ougandais, ni même terroristes islamistes au vrai
sens du terme. Actuellement, ils sont purement congolais. Les ADF constituent
une organisation armée et mafieuse qui bénéficie de
plusieurs complicités locales, nationales et transnationales dans un
contexte d'impuissance publique en RDC, mais une organisation qui n'a pas la
capacité de conquérir un pays et de reverser un régime et
qui, pour survivre, doit recourir aux méthodes terroristes, aux crimes
massifs et aux rapines et aux pillages exercées sur des populations
vulnérables et innocentes.
En RDC, le mode de fonctionnement représente une lutte
vie et mort pour l'accès aux ressources. Naturellement, l'accès
aux ressources signifie l'argent pour financement du groupe. Il est
évident que les tuniques des musulmans aident la diversion qui tend
à masquer la face commerciale de la crise pour faire avancer la
thèse islamiste qui n'a jamais réussi à convaincre aucun
congolais. La traque des ADF a permis au gouvernementcongolaisd'arrêter
ses opposants supposés collaborer avec les rebelles et de muselerles
médias censés faire leur propagande. Toutefois, le terrorisme
reste une menace réelle pour l'est de la RDC, c'est pourquoi il est
nécessaire quel'armée se mobilise afin de produire de
stratégies nouvelles, qui soient moins prévisibles pour n'importe
quel ennemi.
Au moins 108 civils ont été tués par des
présumés rebelles ADF en l'espace d'un mois dans la chefferie de
Walese Vonkutu, dans le sud du territoire d'Irumu (Ituri), indiquent des
activistes de défense des droits humains de cette région dans un
communiqué publié, lundi 28 août.
Les victimes sont en majorité d'anciens otages,
capturés dans leurs champs puis exécutés par leurs
ravisseurs, selon ces activistes.
Ils indiquent également que cette entité
coutumière reste l'épicentre de cette rébellion, dont les
membres se livrent allègrement à des massacres contre les
populations78(*).
3.2.3. Sur le plan sécuritaire
Nobili et Kamango figurent parmi les villages de la chefferie
des Watalinga situées à l'extrême nord-est du Territoire de
Beni qui regorgent d'un nombre important des déplacés à
cause des attaques des ADF et opérations militaires menées
conjointement par les militaires des FARDC et UPDF contre ces rebelles en
Territoire de Beni79(*).
Alors que cette partie du Territoire venait de connaître
une accalmie en 2020 grâce à laquelle environ 80 000 personnes
pour 16000 ménages déplacés étaient
retournées progressivement dans leurs villages d'origine en janvier
2021, un revirement a été observé sept mois plus tard avec
l'attaque des civils par les ADF en date du 06 aout 2021 dans le village de
Kikingi, situé au sud-est de Nobili en zone de santé de Kamango.
Consécutivement à cette attaque, la situation a
dégénéré en janvier 2022 avec l'incursion des ADF
dans le village de Luanoli au cours de laquelle le centre de santé de
référence portant le même nom fut incendié. Le mois
suivant, d'autres incursions étaient signalées dans les villages
de Kikura, Nobili et Kamango.
En février 2022, le centre de Nobili
considéré comme la plus grande localité d'accueil des
déplacés a été la cible des présumés
ADF-NALU. Environ 15.000 ménages se sont déplacés de
Nobili vers l'Ouganda, tandis que d'autres estimés à 2000 sont
partis de Kamango et ses environs pour se réfugier à Mbau, Oicha
et Mavivi, au nord de la ville de Beni, sur l'axe Beni-Eringeti. Dans les
mêmes circonstances, des vagues des déplacés
concentrées le long de la frontière du Congo avec l'Ouganda ainsi
que d'autres qui continuent à faire des mouvements pendulaires tous les
jours entre les deux pays étaient et sont toujours signalés.
En plus de ces attaques, les assaillants ont multiplié
leurs exactions contre les populations civiles dans les villages de Ndiva,
Bukohwa et Kayenze, situés au sud-ouest de Nobili, sur la route
Mbau-Kamango-Nobili.
Cette situation a occasionné la suspension des
activités de 5 ONG Internationales ainsi que la relocalisation de leurs
staffs en Ouganda, à Beni et à Butembo. Pendant cette
période, l'ONG AOF (Action of Future) est la seule organisation qui
intervenait à Nobili en clinique mobile santé à partir de
l'Ouganda.
C'est dans ce contexte que cette mission humanitaire conjointe
a été réalisée dans la chefferie des Watalinga avec
comme objectif principal de procéder à l'identification rapide
des besoins humanitaires et de protection qui requièrent une
réponse urgente ainsi que l'analyse d'accès humanitaire.
Rappelons qu'une mission conduite par OCHA a eu lieu du 09 au
11 mars 2022 dans cette zone, juste un mois après l'incursion des ADF
à Nobili et avait relevé la nécessité de
créer un comité de liaison réunissant autour d'une table
des discussions les autorités et les humanitaires pour traiter les
questions d'accès humanitaire et de protection ainsi que la
nécessité d'apporter en toute urgence une assistance
multisectorielle aux déplacés eu regard de leur
vulnérabilité80(*).
3.2.4. Sur le plan économique
Comme nous l'avons évoqué tout haut, que sans la
paix et la sécurité, il est impossible de mettre en oeuvre le
programme de reconstruction et de redressement économique et social. De
même, le mieux-être social des populations dépend de la
stabilisation et de la relance économique.
En outre, l'amélioration des conditions sociales des
populations est le gage de la pérennité de la paix et de la
sécurité, par la réduction des foyers de tension et des
prédispositions à la délinquance, à la violence et
aux conflits armés. Sans stabilité économique forte et
soutenue, génératrice des richesses et de ressources
financières accrues pour le trésor public, la RDC ne pourra
atteindre le développement économique au vrai sens du terme.
Le résultat de l'opération militaire Shujaa,
menée conjointement par l'Ouganda et la RDC, est mitigé. C'est la
conclusion du rapport présenté jeudi 20 octobre à Goma
(Nord-Kivu) par le Groupe d'Etude sur le Congo (GEC) et son partenaire de
recherche Ebuteli.
Intitulé « L'opération conjointe Shujaa
entre l'Ouganda et la RDC : combattre les ADF ou sécuriser les
intérêts économiques ? », ce rapport de GEC/Ebuteli,
publié en juin dernier, a été présenté
devant une trentaine de personnes dont des scientifiques, des politiques, des
membres de la société civile ainsi que quelques analystes.
Selon le Coordonnateur des recherches sur la violence à
Ebuteli, Pierre Boisselet, la présentation de ce rapport a pour objectif
de permettre à toutes les parties de faire, à leur tour,
l'évaluation mi-parcours de cette opération conjointe qui est
à sa quatrième phase. Ce, en vue de pousser le politique à
recadrer les tirs là où cette opération n'a pas
donné les résultats aux attentes des populations civiles :
« D'une part, il faut reconnaitre que nous on n'a pas
repéré les exactions de l'armée ougandaise sur les civils
congolais. Jusqu'à maintenant, on constate qu'il y a un bon comportement
de ce point de vue-là. Le problème maintenant, les ADF ont,
certes, été repoussés de certains bastions qu'ils
occupaient précédemment. Mais finalement, ils ont
été plutôt dispersés. Ils ont opéré
par la suite dans d'autres zones où ils étaient beaucoup moins
présents : à Mambasa, Butembo, parce que cette ville n'avait
jamais été touchée par les attaques des ADF», a
indiqué le chercheur Pierre Boisselet.
Tout en saluant le travail de GEC, l'Ambassadeur ougandais en
RDC et le Conseiller du ministre congolais de la défense en charge des
renseignements et sécurité, de leur côté, parlent du
succès qu'ont connu les trois premières phases de ces
opérations conjointes, en dépit de quelques obstacles.
Le conseiller du ministre congolais de la défense en
charge de renseignements et sécurité, le Colonel Didier Mundey se
montre optimiste :
« Les bastions ont été
démantelés, l'ennemi a perdu sa zone de confort. Quelques
commandants importants ont été neutralisés, plusieurs
otages ont été libérés et puis, des combattants ont
été capturés. Globalement, l'Ambassadeur venait de le
dire, la zone était inaccessible, aucun véhicule ne pouvait y
accéder depuis plus de 30 ans ».
Pessimistes, les participants ont recommandé aux
responsables de deux armées de donner d'autres indicateurs précis
comme résultats de cette opération.
Le commandement des opérations conjointes FARDC-UPDF
interdit aux militaires engagés dans les opérations contre les
groupes armés dans la région de Beni toute autorisation
d'accès des civils à leurs positions.
Cette mesure a été prise après avoir
enregistré un cas de décès d'une femme civile, dans une
position militaire des FARDC dans le secteur de Ruwenzori lors d'une attaque
ennemie. La décision intervient à la suite de la rencontre entre
les généraux major Camille Bombele et Kayanja Muhanga,
respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint des opérations
« Shujaa »81(*).
« Cette mesure est motivée par le fait que tout le
monde a été surpris de compter parmi les victimes de l'attaque de
la banlieue de Bulongo, une dame civile à six heures du matin. C'est
ce qui a poussé les autorités militaires, à savoir le
coordonnateur des opérations conjointes et le commandant secteur et
évidemment avec le général Kayanja qui est le commandant
du contingent de l'UPDF de prendre la mesure d'interdire l'accès aux
civils des camps militaires », a expliqué le lieutenant-colonel Mak
Hazukay, porte-parole des opérations conjointes.
Il rappelle que les positions militaires sont des lieux
stratégiques :
« Ce sont des tranchées et des trous de
fusillés. Il n'est pas normal qu'on amène des civils, des enfants
surtout dans des positions comme celles-là. Voilà pourquoi cette
mesure a été prise pour que nos militaires surtout les FARDC qui
combattent avec leurs homologues de l'UPDF ne puissent pas occasionner
encore des pareils incidents. On ne peut pas empêcher quelqu'un de
recevoir la visite de ses proches, mais ça doit se faire la
journée et en dehors des positions militaires ». L'ONG Centre
d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits
de l'Homme (CEPADHO), a appelé, mardi 23 août, la coalition
FARDC-UPDF d'intensifier la pression militaire sur les ADF ainsi que les
Maï-Maï, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu).
Le coordonnateur de cette structure, Omar Kavota a
réagi ainsi au lendemain de l'attaque des miliciens contre une position
des FARDC, au village Masambo, dans le secteur de Ruwenzori.
« Nous en appelons au commandement des opérations
FARDC et UPDF de poursuivre les offensives contre l'ennemi, comme par le
passé. D'aucuns croient qu'il y a une certaine léthargie
aujourd'hui qui s'observe actuellement sur le terrain. On dirait que ces
opérations sont au point mort, alors que notre espoir repose sur ces
opérations. Nous pensons que si les forces de la coalition FARDC-UPDF
maintenaient leur pression sur l'ennemi, l'ADF sera totalement
éradiqué », a-t-il estimé.
Pour Omar Kavota, c'est inadmissible que des compatriotes
s'attaquent aux FARDC tout en étant dans les opérations de traque
des ADF dans la région.
Sept personnes, dont deux femmes, sont mortes et deux autres
blessées par machette et des chèvres emportées, lors d'une
incursion des rebelles ADF, dans la nuit de lundi dernier au village Irangyo
dans le territoire de Beni82(*).
Beni : les ripostes de l'armée doivent être
accentuées contre les groupes armés (CEPADHO). L'ONG de
défense des droits de l'homme CEPADHO recommande, dans une interview
jeudi 4 aout à Radio Okapi, que les ripostes de l'armée soient
accentuées pour mettre fin à toute tentative d'attaque des
groupes armés dont les ADF et les M23.
Selon cette structure de défense des droits de l'homme,
le souhait de la population est de voir l'armée contenir toutes ces
menaces qui visent l'occupation des territoires congolais.
Faisant allusion à l'attaque de mardi 2 août
2023, de la localité Samboko-Chanichani où les FARDC ont
infligé une perte lourde dans le camp des terroristes ADF, CEPADHO
encourage autant l'armée à défaire le M23 qui occupe le
territoire de Rutshuru.
« Nous encourageons les forces armées à
s'employer pour riposter à toute tentative du M23 à occuper
d'autres zones en territoire de Rutshuru. Nous avons appris que ces terroristes
également cherchent à tout prix contrôler Rumangabo et cela
à travers des attaques dirigées çà et là
contre les positions des FARDC. Nous souhaitons que notre armée inflige
des revers à ces terroristes comme cela vient d'être fait dans le
territoire de Beni, où les FARDC ont effectivement donné une
leçon aux terroristes ADF-MTM », a expliqué Omar Kavotha,
coordonnateur de CEPADHO83(*).
Pour sa part, le porte-parole de l'armée dans la
région de Beni, capitaine Anthony Mualushayi, rassure que toutes les
dispositions sont déjà prises afin de contenir toutes les menaces
des terroristes dans la région.
Il demande à la population de se ranger derrière
son armée et « que les brebis égarées quittent la
brousse et optent pour le processus de la paix ».
La société civile de Mamove dans le territoire
de Beni se dit satisfaite de la prolongation mercredi dernier par les
armées congolaises et ougandaises des opérations conjointes
dénommées « Shujaa », lancées depuis six mois
contre les rebelles ougandais des ADF au Nord-Kivu et en Ituri. Dans une
déclaration faite samedi 4 juin à Radio Okapi, cette structure
citoyenne invite aussi la population à collaborer avec les services de
sécurité pour dénoncer tous les collaborateurs des milices
dans la région84(*).
« La société civile félicite le
gouvernement congolais pour avoir prolongé la mutualisation des forces
entre les FARDC et l'UPDF. Néanmoins, si nous évaluons les six
derniers mois, il n'y a pas de changement par rapport à la protection
des populations civiles dans le territoire de Beni et en Ituri », a
déploré le président de la société civile de
Mamove, Kinos Katuo.
Il a recommandé le lancement des opérations
militaires de grande envergure pour sécuriser la population contre les
attaques des ADF dans la région.
Les armées ougandaise et congolaise ont
décidé, mercredi 1er juin, de prolonger de deux mois leur
opération conjointe de traque des ADF au Nord-Kivu et en Ituri. Les deux
armées ont levé cette option à la suite de
l'évaluation de leurs opérations, dans la ville ougandaise de
Fort Portal, dans le district de Kabore85(*).
Les acteurs de la société civile du territoire
d'Irumu (Ituri) ont appelé, ce mercredi 1er juin, à
l'intensification des opérations conjointes FARDC-UPDF.
Ces opérations militaires consistent à traquer
les rebelles des ADF au Nord-Kivu et en Ituri. Ils reconnaissent
l'amélioration de la situation sécuritaire dans les chefferies de
Boga et de Walesse Vonkutu, en territoire d'Irumu, depuis le lancement de ces
opérations. Certains déplacés ont regagné leurs
villages, situés le long de la route nationale numéro 4 sur le
tronçon Komanda-Luna, affirment-ils.
Même du côté de Boga, un retour timide de
la population s'observe dans la zone. Cependant, plusieurs localités
dans les groupements Bandavilenga et Badibongo, sont encore sous contrôle
des rebelles ADF, affirme le président de la société
civile de Walesse Vonkutu.
Dieudonné Malanga demande aux armées ougandaise
et congolaise de faire plus d'efforts pour sécuriser la population de ce
coin de l'Ituri. De son côté, la société civile de
Boga, elle aussi, signale la présence des ADF vers Malibongo et d'autres
localités environnantes.
Le président de cette organisation citoyenne, Albert
Baseke, regrette que la population n'accède pas aux champs à plus
de 5 kilomètres au risque de croiser les groupes armés.86(*)
La milice Front patriotique et intégrationniste du
Congo (FPIC), actif dans le territoire d'Irumu, met officiellement fin aux ses
activités sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Les
leaders de ce mouvement l'ont fait savoir au gouverneur de l'Ituri lundi 30
mai.
Dans l'acte d'engagement unilatéral remis au gouverneur
Johnny Luboya, le FPIC déclare :
« Nous sommes conscients de la nécessité
d'offrir une opportunité au développement au niveau tant local
que national. Nous venons ces jours exprimer notre engagement ferme de cesser
les hostilités ».
Cette position est saluée par le gouverneur de l'Ituri.
Le général Johnny Luboya invite d'autres groupes armés
à emboiter les pas afin d'adhérer au processus de paix
initié par le Président de la République.
« L'engagement unilatéral que vous avez pris,
c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple !
Pour ça, je vous en félicite », a-t-il renchéri.
Cette décision du groupe armé FPIC est
l'aboutissement d'un long processus initié par le gouvernement de la
RDC, avec l'appui de la MONUSCO. Elle est aussi le résultat de nombreux
dialogues intercommunautaires initiés par la MONUSCO et les notables de
la communauté Bira afin de pacifier la province de l'Ituri.
« On a organisé les consultations communautaires.
C'est à travers ces différentes consultations que nous avons
débouché à ce forum. C'est une approche de transformation
des conflits à travers les groupes armés. Nous osons croire que
la prochaine étape pourra nous aider à plus de perfections
», a précisé Debon Mwisa, officier à la Section des
affaires civiles de la MONUSCO.
La Mission onusienne a organisé plusieurs rencontres,
dont la dernière remonte au 11 avril dernier à Nyakunde à
45 kilomètres de Bunia. Ces assises ont regroupé les leaders Bira
des cinq chefferies et ceux du groupe armé FPIC qui se sont
engagés à déposer les armes87(*).
Les forces armées conjointes FARDC-UPDF annoncent le
rapatriement des 11 civils de nationalité congolaise le mercredi 05
juillet 2023, ils sont entrés en RDC via le poste frontalier de Kasindi
après avoir passés 3 mois en Ouganda.
Selon le lieutenant-colonel Mak Hazukay porte-parole des
opérations conjointes FARDC-UPDF en cours dans les provinces du
Nord-Kivu et Ituri, ces ex-otages leurs âges varient entre 13 et 57 ans
et sont originaires de Kasenyi en Ituri et des Lume, Kasindi en territoire de
Beni, de Masisi, Rutshuru et Beni ville.
7 parmi les 11 ex-otages ont été remis au
fonctionnaire délégué du gouverneur affecté
à Kasindi frontalier avec l'Ouganda Kambale Barthélémy
sivavughirwa.
Cette source fait savoir que, ceux d'autres localités
lointaines sont encore pris en charge et suivront la procédure
administrative habituelle pour rejoindre leurs familles.
Ces 11 civils ( dont 2 femmes et la majorité
constituée des enfants ), ont été libérés
lors des opérations menées par des unités de la coalition
FARDC-UPDF dans leurs secteurs opérationnels88(*).
Cent quinze otages retenus par des rebelles ADF ont
été libérés, vendredi 15 septembre, des mains de
leurs ravisseurs à Ndalia, un village situé 50 à
kilomètres du centre commercial de Komanda sur la route nationale
numéro 4, au territoire d'Irumu (Ituri).
Cette libération a été rendue possible
grâce aux opérations lancées conjointement, vendredi dans
la matinée, par les forces armées congolaises (FARDC) et
ougandaises (UPDF) contre les bastions de ces rebelles dans la chefferie de
Walese Vonkutu.
D'après l'ONG Convention pour le respect des droits de
l'homme (CRDH), active dans le territoire d'Irumu, les deux armées ont
lancé des offensives en profondeur dans la forêt de Ndalia dans la
matinée de vendredi. Ces opérations visent à
déloger les rebelles qui massacrent des civils et commettent
régulièrement des exactions sur des populations.
Ils incendient souvent des véhicules principalement sur
l'axe Komanda-Luna. Parmi les 115 otages libérés, figurent 29
femmes et 16 enfants, confie la même source qui précise qu'un
second groupe de 21 ex-otages est arrivé tôt ce samedi matin
à Ndalia.
Ces otages sont tous encadrés par les militaires des
FARDC qui procèdent ensuite à leur identification. Ce n'est
qu'après cette étape qu'ils pourront être remis à
leurs familles, précise Christophe Munyaderu, le coordonnateur de cette
ONG dans le territoire d'Irumu.
Il rappelle que ces anciens otages sont pour la plupart des
passagers qui sont tombés dans des embuscades des ADF sur le
tronçon Komanda-Luna. Les personnes libérées ont
passé entre quatre et six mois en captivité.
Le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF,
le Colonel Mak Hazukai, confirme cette liberation et parle de bilan encore
provisoire.
Le Colonel Mak Hazukai qui promet de se prononcer à ce
sujet dans les prochains jours précise cependant que des combats se
poursuivent dans la zone pour déloger ces rebelles de leurs
bases89(*).
3.3.
Mécanismes pour éradiquer les terrorismes en RDC
A Beni, depuis plus de quatre ans, de pauvres paysans voient
déferler sur eux des barbares munis de machettes, gourdins, fusils de
guerre et autres armes pour les massacrer. Ce cycle infernal a
déjà ôté la vie à plusieurs personnes et fait
de nombreux blessés. Le bilan est donc alarmant et la terreur est
vécue. Il est fait état des attaques indistinctes contre les
populations civiles : nouveau-nés, jeunes, vieillards et autres adultes
; ce qui crée un traumatisme inestimable. La violence est à son
comble dans ce territoire jadis paisible de l'Est de la République
Démocratique du Congo, en Province du Nord-Kivu. En plus de ces
massacres, il y a également des enlèvements de plusieurs
personnes, des destructions massives des infrastructures d'utilité
publique et des objectifs civils. En début de l'année 2020, 24
corps sans vie ont été retrouvés en quatre endroits
près d'Oicha.90(*)
Soulignons que ce bilan s'alourdit davantage à ce jour.
Au regard de la Résolution 1373 du 28 Septembre 2001 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, n'importe quel acte de
terrorisme international constitue une menace contre la paix et la
sécurité internationales. Cette résolution exige que tous
les Etats prennent certaines dispositions en ce qui concerne la lutte contre le
terrorisme et établissent un comité pour suivre la mise en place
de ses dispositions.91(*)
Ceci dit, le carnage et les exactions de Beni nécessitent le soutien
unanime de la communauté internationale afin que le territoire et la
ville de Beni soient de nouveau vivables, de peur que cette situation ne
devienne une menace contre la paix de toute la région des grands lacs
africains.
Puisqu'il est irréaliste de déclarer la guerre
contre le terrorisme, cette main invisible, la prévention contre ce
fléau parait rationnelle et réaliste pour une prise en charge
efficace. Compte tenu des enjeux majeurs qui sous-tendent la recrudescence du
terrorisme en Afrique, il est évident que la refondation de l'Etat dans
toutes ses dimensions reste le remède idéal pour prévenir
le terrorisme en Afrique. Cet impératif s'impose à la
République démocratique du Congo, qui aux yeux des observateurs
avisés, est loin d'être un Etat stable, qui exerce son
autorité sur l'ensemble du territoire national.
La prévention du terrorisme passe à travers des
initiatives étatiques plurisectorielles. Le développement
économique et socio-culturel, militaire, la bonne gouvernance,
l'amélioration des conditions sécuritaires, voire même
juridique sont notamment les secteurs sur lesquels l'Etat peut s'appuie pour
prévenir la radicalisation des masses, et ainsi détruire
l'économie de guerre sur laquelle le terrorisme se fonde pour mobiliser
les recrutements, le financement et les bases-arrières de protection. En
République démocratique du Congo, certaines initiatives
s'inscrivent dans cette optique, mais cette étude s'intéresse
à la loi n °04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme92(*) et des institutions
spécialisées mises en place par le Gouvernement pour la lutte
contre ce fléau.
Pour éradiquer les présumés ADF et mettre
fin aux massacres de Beni et de Butembo, jepropose les éléments
suivants à observer en guise de perspectives :
ï Une présence significative des nouvelles
unités militaires et des forces de défense et de
sécurité à Beni-Lubero et dans d'autres parties sous
occupation des groupes armés afin de restaurer l'autorité de
l'Etat ;
ï La collaboration de la population avec les forces de
l'ordre et le cas échéants, dénoncer toute
passivité desdites forces ou la défaillance de l'Etat dans sa
responsabilité de sécuriser la population et ses biens ;
ï Sur base de l'article 23 al. 2 du Pacte de la CIRGL, la
RDC peut demander la convocation d'un sommet extraordinaire de la CIRGL sur la
présence des groupes armés étrangers opérant sur
une partie du territoire national de la RDC aux fins d'une table ronde avec les
dirigeants de leurs pays respectifs pour une solution régionale et
holistique ;
ï Il est indispensable de réfléchir sur la
mise en application effective des instruments internationaux relatifs à
la prévention et à la lutte contre le terrorisme aux niveaux de
l'Union Africaine, des communautés économiques régionales
et des Etats membres et de formuler un projet de programme d'action, indiquant
notamment les priorités et les domaines d'assistance possibles ;
ï Le renforcement des services de renseignement et
d'échange d'informations entre les Etats de la sous-région serait
d'une importance on ne peut plus capitale ;
ï La réforme du système éducatif
afin que le passé conflictuel soit enseigné à
l'école (éducation sensible à la justice) et ainsi
prévenir la répétition, etc.
Comme c'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre,
c'est dans l'esprit des hommes que nous devons ériger les remparts de la
paix.93(*) Voilà
l'une des voies de sortie de ce goulot d'étranglement meurtrier. Ainsi,
la mise en oeuvre d'un programme de la culture de la paix dans les institutions
d'enseignement publiques et privées ainsi que dans les académies
militaires se révèle très indispensable.
Il importe de noter que la promotion et la protection des
droits de l'homme doivent occuper une place centrale dans une stratégie
effective contre le terrorisme. Deux dimensions importantes et liées
entre elles s'attachent à cette déclaration. Premièrement,
le besoin de s'assurer que les mesures prises pour combattre le terrorisme ne
limitent pas injustement les droits de l'homme et les libertés
fondamentales et, deuxièmement, le fait de reconnaître que le
terrorisme menace la pleine jouissance des libertés civiles et les
droits de l'homme. Le besoin d'assurer que la lutte contre le terrorisme reste
vigilante quant à la protection des droits humains les plus
inaliénables suscite un débat. De même, le lien entre le
terrorisme et la promotion des droits de l'homme a reçu une attention
grandissante. Il n'y a probablement aucun droit humain qui soit à l'abri
de l'impact du terrorisme.94(*)
En vue de lutter de façon coordonnée et efficace
contre la menace terroriste, il faut prévenir par tous les moyens : la
préparation, le financement, la commission d'actes terroristes ou
l'implantation d'organisations reconnues comme terroristes par les Nations
Unies ; interdire sur le territoire, toutes formes de propagande ou d'apologie
du crime en général et du terrorisme en particulier et de soutien
aux organisations terroristes.95(*)
La Résolution de la 23ème
Assemblée régionale Afrique de l'APF sur le terrorisme en Afrique
condamne fermement tout financement du terrorisme et appelle aussi bien les
gouvernements que les parlements africains à prendre les mesures et
à adopter des législations requises afin d'empêcher ces
financements et de sanctionner leurs auteurs.96(*)
Tous ces préjudices nécessitent une
réparation au travers d'une justice équitable qui établira
la responsabilité de toute personne coupable voir même celle de
l'Etat congolais car la responsabilité de l'État est tirée
de la défaillance dans la mission de sécuriser la population et
ses biens. Cette approche a été essentiellement mise en avant par
la Cour militaire de Bukavu dans l'arrêt Kibibi et consorts,
l'une des premières décisions à l'avoir invoquée.
Dans cet arrêt, la Cour militaire a notamment
observé que « la sécurité des individus est la raison
même de la vie juridique des peuples et de l'organisation des
sociétés et que l'État doit y veiller constamment
».97(*) Dans
l'affaire Maniraguha et Sibomana, qui concernait les activités
d'un groupe des FDLR (Rasta), le TMG de Bukavu a retenu la
responsabilité de l'État congolais dans les crimes commis par un
des groupes armés étrangers opérant sur le territoire
congolais, à savoir les FDLR (Rasta), traqué depuis plusieurs
années par l'État congolais, avec parfois le soutien de la
communauté internationale. Pour retenir cette responsabilité, aux
termes de l'article 52 de la Constitution de la RDC, le tribunal a
rappelé le devoir de l'État de protéger la population en
disant qu'« il est du devoir constitutionnel de l'État d'assurer la
paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national,
à son peuple et à leurs biens tant sur le plan national que sur
le plan international ; et d'éradiquer tout acte de nature
insurrectionnelle».98(*)
CONCLUSION
Nous voici à la phase finale de notre Mémoire de
fin d'étude qui a porté sur l'opération Ushujaa et lutte
contre le terrorisme international dans les villes de Béni et de
Butembo.
Depuis près de cinq ans, les différentes
attaques des présumés ADF se caractérisent par la
mobilité, la surprise dans les lieux et moments imprévisibles,
les embuscades et le rapide désengagement pour se confondre à la
population ou se replier dans la forêt pour ne pas alerter les forces de
sécurité.
C'est pourquoi jusque-là les présumés ADF
n'ont fait aucune déclaration contre le pouvoir en RDC et ne peuvent
agir pour modifier l'ordre constitutionnel en RDC par les armes. A ce jour,
l'objet de leur lutte armée sur le territoire de la RDC reste de
répandre un sentiment de terreur à des fins économiques.
Les attentats contre la population civile et les biens de caractère
civil nécessitent une solidarité internationale afin de lutter
contre ces terroristes et les neutraliser pour que règne la paix dans le
territoire et la ville de Beni de même que toute la région des
pays des grands lacs africains.
De ce constat nous nous sommes interrogés de la
manière suivante :
Ø Comment l'Opération Ushujaa contribue-t-elle
à la lutte contre le terrorisme international dans les villes de Beni et
Butembo ? Telle est la question principale de l'étude.
De cette question principale découle une question
spécifique à savoir :
Ø Quels sont les résultats concrets de
l'Opération Ushujaa dans la lutte contre le terrorisme international
dans les villes de Beni et Butembo ?
Partant de ceux deux interrogations, ces réponses
provisions ont été formulées
Ø L'opération Ushujaa contribuerai à la
lutte contre le terrorisme international en RDC en renforçant la
sécurité et la stabilité dans les zones touchées
par les groupes terroristes.
De cette hypothèse générale,
l'hypothèse spécifique qui en découle est la
suivante :
Ø L'Opération Ushujaa contribue également
à la lutte contre le terrorisme international en RDC en
renforçant la coopération régionale et internationale dans
la lutte contre le terrorisme. Les partenaires internationaux soutiennent
cette opération en fournissant une assistance technique et
financière pour renforcer les capacités des forces de
sécurité congolaises et améliorer la coordination entre
les pays de la région dans la lutte contre le terrorisme. La
coopération entre les forces armées congolaises et les forces de
maintien de la paix de l'ONU est essentielle pour neutraliser les groupes
armés menaçant la sécurité des populations civiles
en RDC. Les forces de maintien de la paix de l'ONU peuvent fournir un soutien
logistique et opérationnel aux forces de sécurité
congolaises, telles que des enseignements sur les mouvements des groupes
armés et une aide à la planification des opérations. De
plus, la présence des forces de maintien de la paix de l'ONU peut
dissuader les groupes armés d'attaquer les populations civiles et peut
aider à protéger les civiles lors des opérations
militaires. En outre, la coopération entre les forces armées
congolaises et les forces de maintien de la paix de l'ONU peut contribuer
à améliorer la coordination entre les différents acteurs
impliqués dans la lutte contre le terrorisme en RDC. Cela peut inclure
la coordination avec les forces armées d'autres pays (armée
ougandaise, armée burundaise, armée de la région et avec
les agences internationales telles que l'Union Africaine et l'Organisation
Internationale de police criminelle (INTERPOL). En fin de compte, la
coopération entre les forces armées congolaises et les forces de
maintien de la paix de l'ONU est essentielle pour neutraliser les groupes
armés menaçant la sécurité des populations civiles
en RDC.
L'étude s'est par conséquent assignée
deux objectifs : démontrer la contribution de l'opération
Ushujaa dans la lutte contre le terrorisme international dans les villes de
Beni et de Butembo et en fin dégager les résultats de
l'Opération Ushujaa dans la lutte contre le terrorisme international
dans les villes de Beni et de Butembo.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru
à la méthode géopolitique selon le schéma
donné par Éric Mottet et Frédéric Lasserre.
Pour le récolte des données nous avons
opté pour deux techniques : d'observation indirecte
désengagée et la technique documentaire.
En effet, si la première technique s'est
focalisée sur l'identification des acteurs incriminés, des faits
et circonstances qualifiés comme des preuves ou manifestations du
terrorisme en RDC (qu'il s'agisse de rébellions ou
contre-rébellions, ou encore d'actes de violence individuels et de
groupes, coordonnés ou isolés) par les observateurs nationaux,
dont le gouvernement congolais, la seconde a prouvé son importance dans
la récolte d'une diversité de documents (y compris ceux offerts
par Internet et divers médias) et leur examen systématique
s'appuyant sur l'analyse de contenu. Grâce à celle-ci, il a
été possible de dégager de documents les orientations et
significations politiques et idéologiques sur le phénomène
de terrorisme contemporain (post-guerre froide).
Hormis l'introduction et la conclusion, trois chapitres qui
présentent la quintessence dudit travail. Le premier chapitre est
consacré aux généralités sur le terrorisme, le
deuxième quant à lui porte sur l'opération Ushujaa et
lutte contre le terrorisme international dans les villes de Beni et de Butembo
et en fin le troisième qui est le dernier est axé sur les
résultats de l'opération Ushujaa.
Le choix de notre sujet se justifie par l'ensemble
d'intérêt que nous portons sur les règles juridiques
essentiellement Décortiquer l'impact de la relation diplomatique entre
la RDC et l'Ouganda sur l'éradication des ADF NALU. Déterminer
l'effectivité de la Relation diplomatique entre la RDC et l'Ouganda sur
l'éradication des ADF NALU. Décrire les conséquences du
non respects de cet accord diplomatique basé sur l'éradication
des ADF NALU. La République Démocratique du Congo (RDC) a
signé, le 09 décembre 2021, un accord de coopération
militaire avec l'Ouganda qui a déjà déployé ses
troupes dans l'est du territoire congolais pour traquer les rebelles des Forces
démocratiques alliés (ADF) opposées au régime de
Kampala et accusés de multiples massacres de civils dans l'Est
congolais.
A l'issue de notre recherche, nous avons
débouché sur les résultats suivants :
Les opérations conjointes FARDC-UPDF ont
déjà eu des résultats tangibles sur le terrain. En plus de
la libération de centaines d'otages, la sécurité a
été rétablie dans de nombreuses zones du secteur de
Ruwenzori, contribuant ainsi au retour du calme et à la
réconciliation communautaire. Cette stabilité est essentielle
pour le développement de la région et pour le bien-être des
populations locales, qui pourront désormais vaquer à leurs
occupations quotidiennes sans crainte.
Ainsi, il incombe à l'Etat congolais de veiller
constamment à la sécurité de la population civile dans le
territoire et ville de Beni et mettre fin aux agissements criminels commis par
les présumés ADF. La justice devra exercer la plénitude de
l'action publique afin que les atrocités commises ne restent impunies.
L'effectivité de la Relation diplomatique entre la RDC
et Ouganda serait remarquable lorsqu'une suppression totale et la paix
durablement installer sera observer dans la partie Est du pays occupée
par des ADF NALU.
La non observance des dispositions telles que reconnues dans
l'accord diplomatique entre la RDC et Ouganda basé sur
l'éradication des troupes rebelles ADF violerait le principe
« pacta sum servanda » et plongerait effectivement le pays
dans un cas d'insécurité approfondit d'autant plus que cette
troupe rebelle trouve sa genèse de l'Ouganda.
La signature de cet accord de coopération militaire a
eu lieu à Bunia dans la province congolaise de L'ITURI
frontalière avec l'Ouganda.
Depuis le lancement des opérations conjointes
FARDC-UPDF, plusieurs objectifs ont été atteints avec
succès. La récupération du Kambi ya Jua et la
sécurisation de la RN4 de Beni-Kasindi sont parmi les principaux
succès remportés par les forces armées.
Ces victoires ont permis de rétablir la circulation des
populations et de leurs biens en toute sécurité, mettant fin aux
embuscades et aux attaques perpétrées par les Adf. Ces
résultats encourageants témoignent de l'efficacité de la
coopération entre les deux armées et de leur engagement commun
dans la lutte contre les forces négatives.
Les deux pays, la République Démocratique du
Congo et l'Ouganda étaient représentés par leurs ministres
de la Défense respectifs. Cette coopération vise, entre
autres : à mutualiser les efforts et les moyens entre
les deux pays afin d'arriver à neutraliser les « ennemis communs
», « Ayant des ennemis communs (ADF/MTM, résidus
LRA, Ex-M23 résiduels),
- Il importe aux deux pays signataires de cet accord de
coopération militaire de travailler ensemble pour mutualiser les
efforts, ainsi que leurs moyens, en vue de neutraliser tous ces ennemis d'une
part,
- Et de promouvoir le développement économique
et le bien-être des populations congolaises et ougandaises d'autre part
».
- L'accord vise également à « examiner,
amender et signer l'accord général de coopération en
matière de défense, afin d'assumer le passif et de progresser
vers une coopération intégrale de défense entre la
République démocratique du Congo et l'Ouganda »,
Dans le même cadre, les deux pays indiquent la
possibilité de partage ou vente d'électricité produite sur
le Nil par l'Ouganda (barrage construit par une société chinoise
dans le Nord sur le Nil Blanc), mais aussi le soutien à la construction
des routes d'intérêt mutuel.
Bien avant la signature de cet accord relatif à la
coopération militaire basé sur l'éradication des ADF NALU
qui est un ennemis commun, l'Ouganda avait déjà
déployé, une semaine plutôt, un millier des membres de son
armée en appui à l'armée congolaise pour combattre les ADF
retranchés dans l'Est de la République Démocratique du
Congo depuis 1995.
Les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF
à l'est de la RDC représentent une véritable
avancée dans la lutte contre les forces négatives qui menacent la
stabilité de la région depuis plusieurs années.
Grâce à une coopération étroite et à un
engagement commun, les deux armées ont réussi à obtenir
des résultats significatifs, contribuant ainsi à rétablir
la sécurité et à restaurer la confiance au sein des
communautés touchées. Il reste encore beaucoup de travail
à faire pour éradiquer complètement les ADF, mais cette
collaboration constitue un pas important dans la bonne direction. La poursuite
de ces opérations conjointes est un signe positif pour l'avenir de la
RDC et de la région dans son ensemble.
Ce groupe armé est accusé du meurtre des
milliers des civils dans le territoire de Beni frontalier avec l'Ouganda. Les
provinces de L'ITURI et du Nord-Kivu devenues sanctuaires de l'ADF ont
été placées depuis le mois de mai de l'année 2021
sous état de siège consacrant le remplacement des
autorités civiles par des officiers de l'armée et de la
police.
Cette mesure exceptionnelle, n'a pas encore permis à
l'armée d'empêcher les massacres. Depuis 2019, les attaques de
l'ADF sont revendiquées par Daech. La coopération militaire
ougando-congolaise concerne aussi le volet infrastructures et
énergie.
En effet, les deux pays indiquent la possibilité de
partage ou vente d'électricité produite sur le Nil par l'Ouganda
(barrage construit par une société chinoise dans le Nord sur le
Nil Blanc) mais aussi le soutien à la construction des routes
d'intérêt mutuel, notamment le tronçon
Bunangana-Rutshuru-Goma-Kasindi-Beni Butembo, dont les travaux ont
été lancés par les ministres en charge de ces projets
vitaux sur le plan socio-économique, avec impact positif sur les aspects
de défense et de sécurité mutuels.
Rappelons que les forces armées ougandaises et
congolaises ont mené une offensive conjointe mardi 30 novembre 2021
dernier pour mettre fin à l'activisme des groupes terroristes dans l'Est
de la RDC. Le ministre congolais de la Défense et son homologue
ougandais ont signé, jeudi 9 décembre à Bunia (Ituri) un
accord général de défense et de sécurité
pour la conduite des opérations contre les groupes armés en Ituri
et au Nord-Kivu. Dans leur communiqué conjoint, les deux
délégations réaffirment que la mutualisation des forces
vise à traquer tous les groupes armés et les forces
négatives dont les ADF.
Nous avons laissé la latitude aux autres chercheurs de
continuer cette étude tout en s'appuyant sur l'impact des relations
diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda face à l'éradication des
ADF : Enjeux, défis et perspectives.
RECOMMANDATIONS
Ø Au gouvernement congolais
- Imposer des sanctions efficaces aux réseaux qui les
soutiennent, notamment aux politiciens et aux commandants de l'armée qui
en sont souvent des acteurs clés. Le gouvernement devrait aussi tenter
d'affaiblir les bases de ressources des groupes armés en
améliorant la formalisation et la réglementation du commerce et
du secteur des ressources naturelles. Les partenaires internationaux devront
ici apporter leur assistance. Au-delà des frontières orientales
de la RDC, il existe une réelle opportunité de transformer la
rivalité violente des élites des pays voisins en une
collaboration économique régionale.
- Créer des écoles spécifiques pour
former les futurs dirigeants du pays ;
- Créer une armée spécialisée pour
traquer les groupes terroristes ;
- Ø Aux partenaires humanitaires
- De prévoir une assistance médicale
adéquate pour toutes les victimes de viol, notamment une assistance
psychologique pour les victimes et leurs familles, et des tests de
dépistage des maladies sexuellement transmissibles ;
- D'apporter une assistance humanitaire aux victimes qui ont
entièrement été dépouillées de leurs
biens.
Ø A la communauté
internationale
- D'apporter l'appui nécessaire aux autorités
congolaises afin qu'elles interpellent et poursuivent les responsables des
groupes armés impliqués dans ces violations graves des droits de
l'homme :
- D'apporter aux autorités congolaises l'appui
nécessaire pour réglementer l'exploitation illégale des
ressources naturelles, ainsi que de lutter contre la militarisation des
carrières minières et l'affairisme de certaines autorités
qui ont un impact négatif sur les efforts conjoints de la MONUSCO et des
FARDC pour la protection des civils.
Ø A la population du Nord-Kivu
- Seule une conscience collective d'un peuple qui veut prendre en
main son destin pourra sauver le Nord-Kivu en général, et le
territoire de Beni et de Butembo en particulier.
Ø Aux autorités de la RDC
- De déployer immédiatement les forces
gouvernementales de défense et de sécurité bien
entrainées et disciplinées sur ledit axe afin de protéger
la population civile étant donné la persistance des menaces et
les rumeurs d'une nouvelle attaque par des groupes armés dans la zone
;
- D'enquêter sur les agissements des FARDC qui n'ont pas
assuré la sécurisation de la région affectée
probablement en raison de leur affairisme autour des sites miniers et de leur
collaboration éventuelle avec les bandes armées qui y sont
présentes contrairement aux ordres donnés par la
hiérarchie militaire FARDC ;
- De désenclaver la zone en y améliorant les
moyens de communication, tels que le réseau téléphonique,
les routes et en y favorisant l'installation de radios communautaires ;
- De faciliter l'accès des partenaires humanitaires
dans les zones affectées par les rebelles afin de pouvoir accéder
aux victimes et leur apporter des soins d'urgence.
BIBLIOGRAPHIE
2. TEXTES JURIDIQUES
a. TEXTES NATIONAUX
- La Constitution du 18 Février 2006 telle que
modifiée par la loi n°011/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision des certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo.
- Exposé des motifs de la loi n° 04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme en République Démocratique du Congo. Disponible sur
http://www.droit
-
afrique.com/upload
/doc/rdc/RDC
-
Loi
-
2004
-
16
-
lutte
-
blanchiment.pdf
,
consulté le 24/05/2023.
- Art 3 Alinéa 8 de loi n° 04/016 du 19 juillet
2004.
- Loi Organique sur les FARDC-1 PDF.
- Loi-portant-statut-du-militaire-des
FARDC-promulguée-le 15/01/2013 PDF.
- La loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en RDC.
b. TEXTES INTERNATIONAUX
- Accord de siège de l'O.N. Uavec les Etats -
Unis
- Accord signé entre la RDC et l'OUGANDA.
- Na-2014-09-FR-G-BERGHEZAN
- Préambule de la Constitution de l'UNESCO. Disponible
sur
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution/,
consulté le 24/04/2023.
- Compte rendu soumis par le Rapporteur Spécial sur le
Terrorisme et les Droits de l'Homme U.N. Doc E/C N.4/Sub.2/2001/31 para 102.
- Art 3 al. 1 et 2, Règlement N°
08/05-UEAC-057-CM-13 portant adoption de la Convention relative à la
lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale, disponible sur
http://www.droit
-
afrique.com/upload/doc/
cemac/ CEM AC
-
Reglement
-
2005
-
08
lutte
-
terrorisme.pdf
,
consulté le 11 /05/2023
- Résolution de la 23e Assemblée
régionale Afrique de l'APF sur le terrorisme en Afrique, disponible sur
https://infokiosques.net/IMG/pdf/Terrorisme
-
A5
-
12p
couleur
-
cahier.pdf
,
consulté le 11/04/2023.
3. OUVRAGES
- BANYAKU, l'histoire politique du Congo, Presse
universitaire de Grenoble, Paris, 2007
- BIAOU F, M., Le terrorisme en question, Paris, Presses de
Sciences Po, 2004, p.23
- CASTELLA, M., Lutte diplomatique et du pouvoir,
Maspero, Paris, 1975
- FATAKI, Citadins et villageois dans les villes
congolaises, Presse universitaire de Grenoble, Paris, 1974.
- Définition de l'Air Marshall Trenchard datant de
1928, citée dans C. Webster et N. Frankland, The Strategic Air Offensive
Against Germany 1939-1945, Londres, 1961, p. 96.
- Delphine Papin, les 50 fiches pour comprendre la
géopolitique, p 2
- FREUD ; J ; les immunités et
l'égalité de tous devant la loi, paris, PUF, 1965
- G. GUILLAUME, « Terrorisme et droit international
», RCADI, Tome 215, 1989-II,
- GUIDERE, Méthodologie de la recherche. Guide du
jeune chercheur en Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales.
Eclipse Marketing, Paris 2003.
- Hans MORGENTHAU, la synthèse du réalisme
classique, p165.
- Henri KISSINGER, droit diplomatique tome II,
P54,Dalloz, paris 2011
- J.B. MBOKANI, La jurisprudence congolaise en
matière de crimes de droit international : une analyse des
décisions des juridictions militaires congolaises en application du
Statut de Rome, African Minds, New York, 2016, p. 390.
- J.C BULOBA KALUMBA ; Conflits et guerres au Kivu et
dans la région des Grands Lacs, Paris, Ed. L'Harmattan, 1999.
- FATAKI, Citadins et villageois dans les villes
congolaises, Presse universitaire de Grenoble, Paris, 1974. P.27
- Kenneth Waltz, le néo-réalisme, p225
- KOLOMONI KATETULA ; L'histoire d'un peuple
ad. Université ; Paris, 2000
- LASSERE F., et al, Manuel de Géopolitique :
enjeux de pouvoir sur des territoires, 2e édition, ARMAN
COLIN, Paris, 2016, p.60
- LEBRIS, E. L'appropriation de la terre en Afrique
Noire, Karthala, Paris, 1991.
- LUKUSA KANGELA, un jour une histoireMaspero, Paris,
1975, p.52.
- MASSABA, les relations diplomatiques, SOGEDEC,
Kinshasa, 2012,
- Max WEBER, la violence légitime et lutte
éternelle des Etats, p 159-160.
- MORCE DORDOIN ; Guide d'élaboration d'un
projet de recherche, ad. Université ; Paris, 2000
- MORCE DORDOIN, Le forum économique et mondial sur
l'Afrique,ad. Université ; Paris, 2000,
- MULUMA, Le guide des économies africaines,
SOGEDES, Kinshasa, 2003
- MULUMA, Le guide du chercheur en sciences sociales et
humaines, SOGEDES, Kinshasa, 2003
- MORCE DORDOIN, Le forum économique et mondial sur
l'Afrique, ad. Université ; Paris, 2000, pp 36-37.
- Paul RETEUR, diplomatie française, Dalloz,
Paris 2015.
- PINTO et GRAWITS, Méthode de science
sociale, Dalloz, Paris, 1979
- QUIVY, R., et VAN CAMPENHOUDT, L., Méthodes de
recherche en Sciences Sociales, Paris, Ed. Dunod, 2006
- SOLVIT, S., RDC : REVE OU ILLUSION. Conflits et ressources
naturelles en République démocratique du Congo, Paris,
L'Harmattan, 2012.
- RAYMOND A., Juger le terrorisme dans l'Etat de droit,
Bruxelles, Bruylant, Collection Magna Carta, 2009, p.18.
- TSHIMPANGA MATALA KABANGU., et GONZALEZ F., La
conférence Internationale sur la paix, la sécurité, la
démocratie et le développement dans la Région des Grands
Lacs, Madrid, Los éditions, 2004.
- Van Der Essen, les rapports diplomatiques, Grenoble, Paris,
1993.
- p. 306, cité par V. SILVY, Le recours à la
légitime défense contre le terrorisme international, Paris,
Connaissances et Savoirs, 2013, p. 38.
- WILKINSON « Le problème de la
définition du terrorisme », dans HENNEBEL L. et LEWKOCZ, p.
25
- GLASSER S., « Le terrorismes international et ses
divers aspects », Revue internationale de droit comparé,
Vol.25 n°4, 1973, p. 825
- ARIANE L., "Terrorisme et sécurité national.
Au mépris des droits humains" in le monde diplomatique, Août 2003,
p. 4
- « Pour un terrorisme défensif, ciblé et
polyvalent » revue française de criminologie et de droit
pénal, vol 6, avril 2016, Page 36.
4. ARTICLES ET AUTRES
- Fraternel AMURI MISAKO, Le Terrorisme : Un Concept
Abusé, Une Menace Réelle. Le Cas De La République
Démocratique Du Congo. Article, 2017, édition vol 13.
N°17. P20
- Caution needed with casualty figure, Antony Reuben, BBC
News, 11 Août 2014.
5. ARTICLES ET AUTRES
- Le terme est de l'afrikans et désigne
littéralement «développement séparé»
c'est-à-dire un système prônant la
ségrégation et la discrimination raciales. Ce système a
longtemps marqué la vie politique, économique, sociale et
culturelle de l'Afrique du Sud.
- Art. 1er (2), Convention arabe relative à
la répression du terrorisme, Caire, le 22 avril 1998. En vigueur depuis
le 7 mai 1999. Consulté le 03/06/2023 à 23h20.
- Mark POLLITT, the future of Cyberterrorism: where the
physical and virtual Worlds converge 11th annual international
symposium on criminal justice issues, Barry C. Collin, institute for security
and intelligence. Available online at :
http://afgen.com/terrorisml.html
- Le Kivu Security Tracker, un projet géré par
le Groupe d'Étude sur le Congo et Human Rights Watch, a recensé
l'homicide de 1 229 personnes dans le Nord et Sud Kivu depuis mai 2017. Les ADF
sont responsables d'au moins 105 de ces massacres.
- Le CEC a interrogé directement quatre anciens
combattants ou personnes à charge des ADF à Kampala et à
Béni, et a obtenu des notes d'entretien, des transcriptions ou des
enregistrements sonores de douze autres entretiens. Parmi les
déserteurs se trouvaient neuf anciens membres des ADF qui avaient
abandonné le groupe au cours des quatre dernières
années.
- International Criss Group, « L'Est du Congo : la
rebellion perdue des ADF-Nalu », Briefing Afrique, n° 93, 2012.
- World Almanach of Islamism, «Tabligh Jamaat,»
American Foreign Policy Council, le 14 juillet 2011;
- Fred Burton and Scott Stewart, «Tablighi Jama'at: An
Indirect Line to Terrorism,» Strator Worldview Report, 2009; Alexiev,
Alex, «Tablighi Jamaat: Jihad's Stealthy Legions», Middle East
Quarterly. 12 (1): 3-11
- Kapferer, Bruce, and Bjørn Enge Bertelsen, eds.
Crisis of the State: War and Social Upheaval. Berghahn Books, 2009, p. 104;
Risdel Kasasira, «Who is ADF's Jamil Mukulu?» Daily Monitor, le
7août 2015; Mike Ssegawa, «The aftermath of the attack on Uganda
Muslim Supreme Council,» Daily Monitor, le 4 août 2015.
- Riddle Kasasira, «Who is ADF's Jamil Mukulu?»
Daily Monitor, le 7 août 2015.
- « L'Est du Congo : la rébellion perdue des
ADF-Nalu », op. Cit., p 19
- MBULU EHAMBE, Mémoire de DES, FSSAP, UNIKIS,
2011-2012, p.28
- Echos de la MONUSCO NO 45-Mai 2015.
- GEC EBUTELI, rapport sur les conflits à l'Est de la
RDC, publié 20 juin 2022, Consulté le 19/07/2023 à
16H15.
- GEC EBUTELI, consulté le 19/07/2023 à 18H50.
- Radio OKAPI, publié le 16 novembre 2021/
modifié le 17/11/
- RADIO OKAPI, publié le Publié le ven,
21/10/2022 - 12 :24 | Modifié le ven, 21/10/2022 - 12 :24
- Rapport GEC/EBUTELI publié le 20/10/2022 à
18 :25. Consulté le 22/06/2023 à 22 :30.
- Radio okapi, le bilan des opérations FARDC-UPDF
contre les ADF est encourageant, publié le jeudi, 30/03/2023 à
17 :07.
- RADIO OKAPI, Publié le dimanche, 05/06/2022 - 12 :33
| Modifié le dim, 05/06/2022 - 12 :33
- RADIO OKAPI, Publié le jeu, 02/06/2022 - 17 : 00 |
Modifié le jeu, 02/06/2022 - 17:14
- RADIO OKAPI, Publié le mardi, 31/05/2022 - 12 :57 |
Modifié le mardi, 31/05/2022 - 13 : 02
- RADIO OKAPI, Publié le 05/07/2023, consulté le
19/07/2023.
- RDC: une vingtaine de morts dans de nouvelles tueries
attribuées au groupe armé ADF disponible sur
https://www.lefigaro.fr/flash
-
actu/rdc
-
une
-
vingtaine
-
de
-
morts
-
dans
de
-
nouvelles
-
tueries
-
attribuees
-
au
-
groupe
-
arme
-
adf
-
20200130
,
consulté le 04 Juin 2020. Voir aussi BCNUDHO, Analyse de la situation
des droits de l'homme au mois de juin 2019, disponible sur
https://drcongo.un.org/fr/36042
-
note
-
du
-
bcnudh
-
sur
-
les
principales
-
tendances
-
des
-
violations
-
des
-
droits
-
de
-
lhomme
-
en
-
janvier
,
consulté le 04 Juin 2020.
- S/RES/1373 du 28 Septembre 2001. Disponible sur
https://www.un.org/press/
en/2001/sc7158.doc.htm
,
consulté le 18/5/2023.
6. DICTIONNAIRES
- Dictionnaire le Grand-Robert édition 2010.
- Le dictionnaire universel, disponible sur
https://www.dictionnaire-universel.org//lutte-définitions.org,
consulté le 03 mai 2023 à 21h.
7. THESE, DES, TFC, MEMOIRES ET COURS
- Mahamoude, El KHADIR, Le terrorisme, les causes et
remèdes, mémoire, R.I, Université Mohamed,
2004-2005.
- Mwahila Tshiyembe, Cours de Géopolitique 2022,
Unikis, inédit.
- MBIKAYI NKUANYA, La problématique de la lutte contre
le terrorisme international au Moyen-Orient par l'administration barack-Obama,
TFC, R.I, UOM, 2013-2014.
- SHOMBA.K, Méthodes de recherche
scientifique, Kinshasa, éd.mes, 1995, p 42.
- MOUSSA S, conflits diplomatique face à la
réalité contemporaine, Mémoire de Licence en Droit
Privé et Judiciaire, FD, UNIKIS, 2001-2002, (inédit).
- IDI MALIKI, la responsabilité civile de la Monusco
sur le crash survenu à Kinshasa le 04 Avril 2011 en RDC, Mémoire,
FO, DES, 2011-2012, p.15-18
8. WEBOGRAPHIE
-
https://www.wikipedia-opération-définition.org
- www.wikipédia.fr.
-
https://7sur7.cd/2023/04/07/guerre-contre-ladf-les-fardc-et-lupdf-notent-un-bilan-prometteur-et-reaffirment-la
-
https://www.politico.cd/encontinu/2023/05/01/operations-conjointes-fardc-updf-retour-progressif-des-habitants-des-entites-du-sud-dirumu.html/132427.
-
https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/ressources/Small-Survey-2006-chapter-11-FR-pdf.
Table des matières
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
..............................................................i
EPIGRAPHE
iii
DEDICACE
iv
REMERCIEMENTS
v
0. INTRODUCTION
1
0.1. CONTEXTE DE L'ETUDE
1
0.2. Etat de la question
2
0.3. Problématique
7
0.4. Hypothèse
8
0.5. Objectifs
9
a. Objectif général
9
b. Objectif spécifique
9
0.6. Choix et Intérêt du
sujet
9
a. Choix du sujet
9
b. Intérêt du sujet
10
0.7. Courant théorique
11
0.8. Cadre Méthodologique
12
1. Méthode
13
2. Technique
16
0.9. Délimitation
16
0.11. Subdivision
17
Chapitre un : Considérations
générales sur le terrorisme
18
Section 1 : Esquisse définitionnelle et
notionnelle
19
1.1. Opération Ushujaa
19
1.1.1. Opération
19
1.1.2. Ushujaa
19
1.2. Lutte
19
1.3. Terrorisme international
20
1.3.1. Terrorisme
20
1. Définition du terrorisme
22
a. Typologie du terrorisme
24
1. Terrorisme religieux
24
2. Terrorisme politique
25
3. Terrorisme individuel
25
4. Terrorisme d'Etat
26
5. Terrorisme informatique ou cyber
terrorisme
26
1.4. International
27
Section 2 : Présentation du milieu
d'étude
28
a. Présentation de la
République Démocratique du Congo
28
§1. Situation géographique
28
§2. Situation politique
29
§3. Situation socio-économique
34
§1. Ville de Beni
36
1. Toponymie
37
a. Sur le plan commercial
38
2. Guerres du Congo 1995-1998
39
§2. Ville de Butembo
40
b. Présentation de l''Ouganda
42
§1. Situation géographique
42
§2. Subdivisons administratives
42
§3. Cadre économique
43
§4. Démographie
43
§ 5. Vie politique
43
§6. Education
45
§7. Sante
45
§8. Religion
45
Chapitre deuxième : Opération
Ushujaa et lutte contre le terrorisme dans les villes de Beni et Butembo
46
Section 1 : L'Opération Ushujaa face au
terrorisme dans le grand Kivu
46
2.1.1. Les origines du terrorisme en RDC
48
a. Les ADF
48
2.1.2. Objectifs de l'opération
54
2.1.3. Les acteurs impliqués dans
l'opération
54
2.1.3.1. Les forces armées de la
République Démocratique du Congo (FARDC)
54
a. Création de Forces armées
de la République Démocratique du Congo (FARDC)
55
b. Objectifs des FARDC
57
1. Objectifs globaux
57
3. Objectifs Militaires
58
c. Moyens humains, financières et
matériels des FARDC
58
1) Moyens matériels
58
2) Moyens humaines
59
3. Moyens financiers
59
2.1.3.2. Mission de l'organisation des
nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO)
60
2.1.3.2.1. Création de la MONUSCO
60
2.1.3.2. Missions de la MONUSCO
61
2.1.3.3. La pacification du pays et la
protection des populations.
61
2.1.3.4. L'assistance des faibles dans
l'urgence
61
2.1.3.5. Le renforcement de l'Etat pour la
consolidation de la paix.
62
2.1.3.6. La relance de l'économie et
l'initiative au développement.
62
2.1.3.7. Actions de la MONUSCO
63
²
64
Section 2 : contribution de la coopération
militaire entre la RDC et l'Ouganda dans le développement
socio-économique de la RDC
64
A. Les axes prioritaires de la diplomatie
congolaise
64
§1. La Paix
64
§2. La Sécurité
65
§3. La consolidation de la démocratie
et de la bonne gouvernance
67
§4. Le Développement
socio-économique
67
Section 3 : les difficultés
inhérentes a l'opération Ushujaa
68
3.1. L'image de la diplomatie congolaise
69
3.2. Les difficultés financières et
matérielles
70
3.2.1. Difficultés matérielles
70
3.2.2. Absence des titres de
propriété
71
Chapitre troisième : Les
résultats de l'opération Ushujaa
72
Section 1 : La coopération militaire
entre la RDC et l'Ouganda
73
Section2 : les défis de l'opération
Ushujaa
74
1. Sur le plan politique
74
2. Sur le plan militaire
76
3. Sur le plan securitaire
76
4. Sur le plan économique
77
Section 3 : perspectives d'avenir pour
éradiquer les terrorismes en RDC
84
CONCLUSION
89
* 1 Fraternel AMURI MISAKO,.
Le Terrorisme : Un Concept Abusé, Une Menace Réelle. Le Cas
De La République Démocratique Du Congo. Article, 2017,
édition vol 13. N°17. P20
* 2 Mahamoude, El KHADIR, Le
terrorisme, les causes et remèdes, mémoire, R.I,
Université Mohamed, 2004-2005.
* 3 MBIKAYI NKUANYA,. La
problématique de la lutte contre le terrorisme international au
Moyen-Orient par l'administration barack-Obama, TFC, R.I, UOM, 2013-2014.
* 4 Max WEBER, la violence
légitime et lutte éternelle des Etats, p 159-160.
* 5 J.C BULOBA KALUMBA,
Conflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands Lacs, Paris,
Ed. L'Harmattan, 1999.
* 6 SOLVIT, S., RDC : REVE OU
ILLUSION, Conflits et ressources naturelles en République
démocratique du Congo, Paris, L'Harmattan, 2012, p.2
* 7 TSHIMPANGA MATALA
KABANGU., et GONZALEZ F., La conférence Internationale sur la paix, la
sécurité, la démocratie et le développement dans la
Région des Grands Lacs, Madrid, Los éditions, 2004.
* 8 SHOMBA.K.,
Méthodes de recherche scientifique, Kinshasa, éd.mes,
1995, p 42.
* 9 SHOMBA.K, op cit, p42.
* 10 Hans MORGENTHAU, les
grands théoriciens des Relations Internationales, p165.
* 11 Kenneth Waltz, les grands
théoriciens des relations Internationales, p225
* 12 Mwahila Tshiyembe, Cours
de Géopolitique 2022, Unikis, inédit.
* 13 Délphine Papin, les
50 fiches pour comprendre la géopolitique, p 2
* 14 Op cit, p 3.
* 15 LASSERE F., et al, Manuel
de Géopolitique : enjeux de pouvoir sur des territoires,
2e édition, ARMAN COLIN, Paris, 2016, p.60
* 16 Le terme est de
l'afrikans et désigne littéralement «développement
séparé» c'est-à-dire un système prônant
la ségrégation et la discrimination raciales. Ce système a
longtemps marqué la vie politique, économique, sociale et
culturelle de l'Afrique du Sud.
* 17
https://www.wikipedia-opération-définition.org,
consulté le 02 mai 2023 à 11h
* 18 Dictionnaire le
Grand-Robert
* 19 Le dictionnaire universel,
disponible sur
https://www.dictionnaire-universel.org//lutte-définitions.org,
consulté le 03 mai 2023 à 21h.
* 20 Art. 1er (2),
Convention arabe relative à la répression du terrorisme, Caire,
le 22 avril 1998. En vigueur depuis le 7 mai 1999. Consulté le
03/06/2023 à 23h20.
* 21 BIAOU F, M., Le terrorisme
en question, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p.23
* 22 G. GUILLAUME, «
Terrorisme et droit international », RCADI, Tome 215, 1989-II,
p. 306, cité par V. SILVY, Le recours à la
légitime défense contre le terrorisme international, Paris,
Connaissances et Savoirs, 2013, p. 38.
* 23 J. CILLIERS et K.,
STURMAN, Op. Cit.,p. 5.
* 24 Exposé des
motifs de la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République
Démocratique du Congo. Disponible sur
http://www.droit
-
afrique.com/upload
/doc/rdc/RDC
-
Loi
-
2004
-
16
-
lutte
-
blanchiment.pdf
,
consulté le 24/11/2017.
* 25 Art 3 Alinéa 8 de
loi n° 04/016 du 19 juillet 2004.
* 26 RAYMOND A., Juger le
terrorisme dans l'Etat de droit, Bruxelles, Bruylant, Collection Magna Carta,
2009, p.18.
* 27 WILKINSON « Le
problème de la définition du terrorisme », dans
HENNEBEL L. et LEWKOCZ, p. 25
* 28 Idem, p.26
* 29 GLASSER S., « Le
terrorismes international et ses divers aspects », Revue
internationale de droit comparé, Vol.25 n°4, 1973, p. 825
* 30 ARIANE L., "Terrorisme et
sécurité national. Au mépris des droits humains" in le
monde diplomatique, Août 2003, p. 4
* 31 Caution needed with
casualty figure, Antony Reuben, BBC News, 11 Août 2014.
* 32 Mark POLLITT, the future
of Cyberterrorism: where the physical and virtual Worlds converge
11th annual international symposium on criminal justice issues,
Barry C. Collin, institute for security and intelligence. Available online at :
http://afgen.com/terrorisml.html
* 33« Pour un terrorisme
défensif, ciblé et polyvalent » revue française de
criminologie et de droit pénal, vol 6, avril 2016, Page 36.
* 34 Dictionnaire le Grand
Robert
* 35MOUSSA, S,
conflits diplomatique face à la réalité
contemporaine, Mémoire de Licence en Droit Privé et
Judiciaire, FD, UNIKIS, 2001-2002, (inédit).
* 36FATAKI, Citadins et
villageois dans les villes congolaises, Presse universitaire de Grenoble,
Paris, 1974. P.27
* 37 BANYAKU, l'histoire
politique du Congo, Presse universitaire de Grenoble, Paris, 2007.
P.157.
* 38KOLOMONI
KATETULA ; L'histoire d'un peuple ad. Université ;
Paris, 2000, pp 36-37.
* 39 KOLOMONI KATETULA, op
cit . p.155.
* 40Rapport
spécial du secrétaire du conseil de sécurité de
l'ONU sur la MONUC, journal des nations unis pour la RD Congo, P 129.
* 41 MORCE DORDOIN, Le
forum économique et mondial sur l'Afrique,
ad. Université ; Paris, 2000, p 36-37.
* 42 MULUMA, Le guide
des économies africaines, SOGEDES, Kinshasa, 2003, p.85.
* 43
www.wikipédia.fr
* 44
www.wikipédia.fr
* 45 http//www.google.com,
consulté le 21 octobre 2022.
* 46 Les protocoles
additionnels aux conventions de Genève du 12 Août 1949, p 42
disponible sur
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc-001-0321pdf
* 47 Définition de l'Air
Marshall Trenchard datant de 1928, citée dans C. Webster et N.
Frankland, The Strategic Air Offensive Against Germany 1939-1945 , Londres,
1961, p. 96.
* 48 Le Kivu Security Tracker,
un projet géré par le Groupe d'Étude sur le Congo et Human
Rights Watch, a recensé l'homicide de 1 229 personnes dans le Nord et
Sud Kivu depuis mai 2017. Les ADF sont responsables d'au moins 105 de ces
massacres.
* 49 Le GEC a interrogé
directement quatre anciens combattants ou personnes en charge des ADF à
Kampala et à Béni, et a obtenu des notes d'entretien, des
transcriptions ou des enregistrements sonores de douze autres entretiens.
Parmi les déserteurs se trouvaient neuf anciens membres des ADF qui
avaient abandonné le groupe au cours des quatre dernières
années.
* 50 International Criss Group,
« L'Est du Congo : la rébellion perdue des ADF-Nalu »,
Briefing Afrique, n° 93, 2012.
* 51 World Almanach of
Islamism, «Tabligh Jamaat,» American Foreign Policy Council, le 14
juillet 2011;
Fred Burton and Scott Stewart, «Tablighi Jama'at: An
Indirect Line to Terrorism,» Strator Worldview Report, 2009; Alexiev,
Alex, «Tablighi Jamaat: Jihad's Stealthy Legions», Middle East
Quarterly. 12 (1): 3-11
* 52 Kapferer, Bruce, and
Bjørn Enge Bertelsen, eds. Crisis of the State: War and Social Upheaval.
Berghahn Books, 2009, p. 104; Risdel Kasasira, «Who is ADF's Jamil
Mukulu?» Daily Monitor, le 7août 2015; Mike Ssegawa, «The
aftermath of the attack on Uganda Muslim Supreme Council,» Daily Monitor,
le 4 août 2015.
* 53 Riddle Kasasira, «Who
is ADF's Jamil Mukulu?» Daily Monitor, le 7 août 2015.
Consulté le 23 juillet 2023 à 15h30. Disponible sur
https://www.monitor.co.ug/lifestyle/reviews-profiles/who-is-adf-s-jamil-mukulu-1620396
* 54 « L'Est du Congo : la
rébellion perdue des ADF-Nalu », op. Cit., p 19. Briefing Afrique
de Crisis Group N° 93, 19 décembre 2012. Disponible sur
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/I%E2%80%99est-du-congo-la-r%C3%Abellion-perdue-des-adf-nalu
* 55 En effet, il est
important de noter que c'est le gouvernement congolais qui sollicita
l'intervention du Président Museveni comme médiateur dans la
crise derrière la rébellion du M23. Cette sollicitation
était d'autant plus surprenante qu'un rapport des experts de l'ONU cita
l'Ouganda comme pays, en plus du Rwanda, apportant des soutiens de divers
ordres au M23.
* 56 MBULU EHAMBE,
Mémoire de DES, FSSAP, UNIKIS, 2011-2012, p.28
* 57 THAMBA THAMBA, R., Finance
des groups armés et gouvernance démocratique en République
Démocratique du Congo, Article, Afrique et développement, Volume
XLIV, n°. 2, 2019, pp 77-97.
* 58 Loi Organique sur les
FARDC du 11 août 2011, disponible sur
https://www.droitcongolais.info/files/412.08.11-Loi-du-11-août-2011.pdf
consulté le 15 août 2023 à 23h45.
* 57 Idem disponible sur
https://www.droitcongolais.info/files/412.08.11-Loi-du-11-août-2011.pdf
consulté le 15 août 2023 à 23h45.
* 59
Loi-portant-statut-du-militaire-des FARDC-promulguée-le 15/01/2013.
Disponible sur
https://www.droitcongolais.info/files/4123.01.13-Loi-du-15-janvier-2013-statut-du-militaire-Forces-armées.pdf
consulté le 17 août 2023 à 18h20.
* 60 Loi de programmation
militaire du 04/023 du 12 Novembre 2004. Disponible sur
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ministeres/defense/loi.04.023.12.11.2004.pdf.
Consulté le 16 septembre 2023 à 01h26.
* 61 IDI MALIKI, la
responsabilité civile de la Monusco sur le crash survenu à
Kinshasa le 04 Avril 2011 en RDC, Mémoire, FD, DES, 2011-2012,
p.15-18
* 62 Idem, pp 20-23
* 63 Echos de la MONUSCO
NO 45-Mai 2015. Disponible sur
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc-001-0321.pdf
consulté le 17 août 2023 à 19h45.
* 64 UGANDA PEOPLE'S DEFENCE
FORCE UPDF disponible sur
https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/ressources/Small-Survey-2006-chapter-11-FR-pdf.
Consulté le 16 septembre 2023 à 01h32.
* 65 LUKUSA KANGELA, un
jour une histoireMaspero, Paris, 1975, p.52.
* 66Idem, Paris, 1975,
p.5
* 67Idem, Paris, 1975,
p.57
* 68Idem, Paris, 1975,
p.12
* 69 GEC EBUTELI, rapport sur
les conflits à l'Est de la RDC, disponible sur
https://www.radiookapi.net/2022/10/20/actualité/sécurité/opération-militaire-ushujaa-menée-conjointement-par-louganda-et-la-rdc.
Consulté le 19/07/2023 à 16H15.
* 70 GEC EBUTELI, disponible
sur
https://www.radiookapi.net/2022/10/21/actualite/securite/loperation-militaire-shujaa-menee-conjointement-par-louganda-et-la-rdc.
Consulté le 19/07/2023 à 18H50.
* 72Général
major Kasonga : " Tous les sanctuaires, tous les quartiers
généraux, toutes les places fortes des ADF ont été
détruits," Radio Okapi, publié le 28 Mars 2022,
https://www.radiookapi.net/2022/03/28/emissions/linvite-du-jour/general-major-kasonga-tous-les-sanctuaires-tous-les-quartiers
.
Consulté le 16 septembre 2023 à 02h16.
* 73Richard Muteta,
«RDC: Au moins 72 otages des ADF libérés en trois mois
à Beni dans les opérations conjointes FARDC-UPDF,» MCNTV
CONGO, publié le 7 Mars 2022
https://mnctvcongo.net/rdc-au-moins-72-otages-des-adf-liberes-en-trois-mois-a-beni-dans-les-operations-conjointes-fardc-updf/.
Consulté le 16 septembre 2023 à 02h20.
* 74 Radio OKAPI, disponible
sur
https://www.radiookapi.net/2022/10/20/actualité/sécurité/opération-militaire-ushujaa-menée-conjointement-par-louganda-et-la-rdc.
Consulté le 18/01/2023 à 19H30.
* 75LISSENDJA BAHAMA, T.,
Dybnamique des groupes armés en Nord-Kivu, Thèse de
Doctorat en SPA, FSSAP, UNIKIS, 2016-2017.p.306.
* 76 Rapport GEC/EBUTELI,
massacre de plus de 30 morts dans des nouvelles violences kwamouth, disponible
sur
https://actualité.cd/2022/09/13/rdc-plus-de-30-morts-dans-des-nouvelles-violences-kwamouth-pres-de-70-personnes-tuées
* 78 Au moins 108 civils ont
été tués par des présumés rebelles ADF en
l'espace d'un mois dans la chefferie de Walese Vonkutu. Disponible sur
https://www.radiookapi.net/2023/08/29/actualite/securite/ituri-pres-de-110-personnes-tuees-dans-un-mois-par-des-presumes.
Consulté le 17 septembre 2023 à 06h20.
* 79 Rapport consolidé
de la mission conjointe à Nobili du 06 au 11 mai 2022. Disponible sur
https://www.radiookapi.net/2022/02/22/actualite/societe/nord-kivu-retour-progressif-des-deplaces-de-nobili-et-kamango.
Consulté le 15 août 2023 à 23h10.
* 80 Rapport consolidé
de la mission conjointe à Nobili du 06 au 11 mai 2022. Disponible sur
https://www.radiookapi.net/2022/02/22/actualite/societe/nord-kivu-retour-progressif-des-deplaces-de-nobili-et-kamango.
Consulté le 15 août 2023 à 23h10.
* 81 Radio okapi, bilan des
opérations militaires FARDC-UPDF. Disponible sur d
https://www.radiookapi.net/2023/03/30/actualite/securite/beni-le-bilan-des-operations-fardc-udpf-contre-les-adf-est
publié le 20/10/2022 à 18 :25. Consulté le 22/06/2023
à 22 :30.
* 82
https://www.radiookapi.net/2022/08/24/actualite/securite/beni-le-cepadho-appelle-lintensification-des-operations-contre-les-adf
* 83 Radio okapi, le bilan des
opérations FARDC-UPDF contre les ADF est encourageant, publié le
jeudi, 30/03/2023 à 17 :07. Disponible sur
https://www.radiookapi.net/2023/03/30/actualite/securite/beni-le-bilan-des-operations-fardc-udpf-contre-les-adf-est
. consulté le 05/08/2023 à 20H08.
* 84 RADIO OKAPI, La
société civile de Mamove dans le territoire de Beni se dit
satisfaite de la prolongation des opérations militaires FARDC-UPDF.
Disponible sur
* 85
https://www.radiookapi.net/2022/06/05/actualite/securite/beni-la-societe-civile-satisfaite-de-la-prolongation-des-operations
. consulté le 05/06/2023 à 12:33
* 86
https://www.radiookapi.net/2022/03/28/emissions/linvite-du-jour/general-major-kasonga-tous-les-sanctuaires-tous-les-quartiers
* 87
https://www.politico.cd/encontinu/2023/05/01/operations-conjointes-fardc-updf-retour-progressif-des-habitants-des-entites-du-sud-dirumu.html/132427.
Consulté le 12 mai 2023 à 12h20.
* 88
https://7sur7.cd/2023/04/07/guerre-contre-ladf-les-fardc-et-lupdf-notent-un-bilan-prometteur-et-reaffirment-la
consulté le 23 mai 2023 à 15h16.
* 89 RADIO OKAPI, Cent quinze
otages retenus par des rebelles ADF ont été
libérés, vendredi 15 septembre, des mains de leurs ravisseurs
à Ndalia, un village situé 50 à kilomètres du
centre commercial de Komanda sur la route nationale numéro 4, au
territoire d'Irumu (Ituri) Disponible sur
https://www.radiookapi.net/2023/09/16/actualite/securite/ituri-la-force-conjointe-fardc-updf-libere-115-otages-des-mains-des.
Consulté le 17 septembre 2023 à 8h51.
* 90 RDC: une vingtaine de
morts dans de nouvelles tueries attribuées au groupe armé ADF
disponible sur
https://www.lefigaro.fr/flash
-
actu/rdc
-
une
-
vingtaine
-
de
-
morts
-
dans
de
-
nouvelles
-
tueries
-
attribuees
-
au
-
groupe
-
arme
-
adf
-
20200130
,
consulté le 04 Juin 2023. Voir aussi BCNUDHO, Analyse de la situation
des droits de l'homme au mois de juin 2019, disponible sur
https://drcongo.un.org/fr/36042
-
note
-
du
-
bcnudh
-
sur
-
les
principales
-
tendances
-
des
-
violations
-
des
-
droits
-
de
-
lhomme
-
en
-
janvier
,
consulté le 04 Juillet 2023.
* 91 Résolution du
conseil de sécurité N°1373 du 28 Septembre 2001. Disponible
sur
https://www.un.org/press/
en/2001/sc7158.doc.htm
,
consulté le 18/08/2023 à 21h10.
* 92 La loi n°04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme en RDC. Disponible sur
* 93 Préambule de la
Constitution de l'UNESCO. Disponible sur
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution/,
consulté le 24/08/2023 à 21h36.
* 94 Compte rendu soumis par
le Rapporteur Spécial sur le Terrorisme et les Droits de l'Homme U.N.
Doc E/C N.4/Sub.2/2001/31 para 102.
* 95 Art 3 al. 1 et 2,
Règlement N° 08/05-UEAC-057-CM-13 portant adoption de la Convention
relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale, disponible
sur
http://www.droit
-
afrique.com/upload/doc/
cemac/ CEM AC
-
Reglement
-
2005
-
08
lutte
-
terrorisme.pdf
,
consulté le 11 /9/2023 à 23h20.
* 96 Résolution de la
23e Assemblée régionale Afrique de l'APF sur le
terrorisme en Afrique, disponible sur
https://infokiosques.net/IMG/pdf/Terrorisme
-
A5
-
12p
couleur
-
cahier.pdf
,
consulté le 11/9/2023.
* 97 Arrêt Balumisa et
consorts, pp. 32-33 Voir J. B MBOKANI., La jurisprudence congolaise en
matière de crimes de droit international : une analyse des
décisions des juridictions militaires congolaises en application du
Statut de Rome, African Minds, New York, 2016, p. 386.
* 98 J. B. MBOKANI, La
jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international :
une analyse des décisions des juridictions militaires congolaises en
application du Statut de Rome, African Minds, New York, 2016, p. 390.
| 


