IX.2.
CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE
En géographie la théorie est un ensemble
cohérent d'énoncés, ayant pour objectif de rendre compte
d'une réalité géographique. Elle se compose de postulat et
d'hypothèses ayant subi avec succès l'épreuve des faits,
d'hypothèses moins souvent testées et aussi d'hypothèses
nouvelles qui attendent la confrontation avec l'observation, le projet de la
théorie est d'expliquer. Ainsi pour vérifier nos
hypothèses dans le cadre de notre travail, nous avons jugé bon
d'utiliser certaines théories.
IX.2.1.
La théorie de la Centralité galactiquede René Joly ASSAKA
ASSAKO
Cette théorie est encore appelée « la
centralité diffuse ou multimodale » a été
élaborée parRené Joly ASSAKA ASSAKO en2020. D'après
ce dernier dans son ouvrage la géographie transcendante, le principe de
centralité ne se limite pas uniquement sur la polarisation à
travers l'existence d'un simple réseau urbain, mais d'une organisation
en nuage de point qui émousse les contrastes
« centre-périphérie » et pose les
prémices d'un continuum socio-spatial sur fond d'administration et de
production économique.Cette théorie peut
êtreimplémentée dans notre étude dans la mesure ou
tout d'abord le développement de l'agriculture dans l'arrondissement de
Melong est influencé par un paradigme social dans la mesure ou de
nouveaux systèmes sont introduits par le faite de brassage de plusieurs
ethnies. En fin du fait que le développement agricole dans les villages
environnant Melong, la politique agricole est impulsée par
l'administration centrale en charge de l'agriculture qui est le MINADER
situé au centre-ville et qui polarise la périphérie de
Melong à travers sa politique agricole.Elle nous permet d'expliquer non
seulement la relation que la ville de Melongentretient avec ses
localités environnant, mais aussi son influence dans l'exploitation
agricole avec sa proche campagne.
IX.2.2.
La théorie de l'offre et de la demande d'Adam Smith
Adam Smith dans son model, définit l'offre d'un bien
comme étant la quantité de produit offert à la vente par
les vendeurs pour un prix donné. Tandis que la demande est comprise
comme la quantité d'un certain produit demandé par les acheteurs
pour un prix donné. Quant au prix d'un objet, c'est une quantité
dépendant de l'offre et de la demande. Il s'agit d'un
résumé autour une loi appelée Loi du marché. C'est
une loi qui régit un marché, avec ou sans l'intervention de
l'Etat.
Ici l'offre et la demande sont indépendantes et le
comportement de l'une ou l'autre est relatif à la situation des prix du
marché. On parle alors de l'équilibre partiel dont la figure est
le suivant.
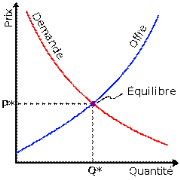
Figure 3 : Confrontation de l'offre et demande
Selon cette figure, dans les marches où on a une
situation d'équilibre, on aura les effets suivants :
v Lorsque le prix monte :
L'offre ici a tendance à augmenter car les producteurs
sont incités plus de bien, de nouveaux producteurs sont incités
à s'installer sur le marché. Ainsi la demande a tendance à
baisse, car plus les prix sont élevés, moins les acheteurs sont
disposés à acheter.
v Lorsque le prix baisse :
Dans cette situation contraire que la première l'offre
à tendance a tendance à baisser. Ainsi les producteurs sont
découragés à produire car l'activité ou le
marché n'est pas bon car personne ne peut accepter produire pour perdre.
C'est une situation vécue généralement en période
de crise ou les prix des produits chutent sur le marché. Cependant la
demande a tendance à augmenter. Car moins les prix sont
élevés, plus les acheteurs sont disposés à acheter.
Afin de résoudre ce problème de
déséquilibre entre le demandeur et l'offreur, il faut donc
trouver une situation ou un point d'intersection qui maximise le nombre
d'échanges. Un prix un peu au-dessus laissera des vendeurs voulant bien
vendre sans acheteurs. Par contre un prix un peu en dessous laissera des
acheteurs voulant bien acheter sans vendeur.
Dans les deux cas, le nombre d'échanges sera aussi plus
petit qu'au point d'intersection. Il y aura de toute façon des acheteurs
et des vendeurs qui ne seront pas satisfaits, mais ce sera à cause du
prix mais pas parce qu'ils n'ont trouvé personne en face.
Une courbe d'offre et de demande correspond à un nombre
donné d'offreurs et de demandeurs. Une augmentation ou diminution du
nombre d'offreurs ou de demandeurs provoque un déplacement vers la
droite ou vers la gauche, et donc une modification de l'équilibre. Smith
envisage ainsi une confrontation de l'offre et de la demande :
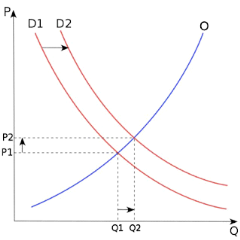
Figure 4 :Confrontation des prix
Le prix P d'un objet est déterminé par
l'équilibre entre les deux courbes de demande D ainsi que de l'offre O.
le graphique montre l'effet d'une augmentation de la courbe de demande D1
à D2 : le prix P et la quantité totale Q
vendue augmentent tous les deux.
Les principaux déterminants de l'offre sont le prix du
marché et les couts de production. Ceux de la demande sont le prix des
objets, le revenu, les gouts, mais aussi l'offre et la demande des biens des
objets. En construisant les deux courbes (offre et demande), on se trouve en
face d'une nouvelle situation de marché. La rencontre entre la courbe de
la demande et celle de l'offre, on obtient un point d'équilibre. Tant
que ce point n'est pas atteint, l'excédent d'offre provoque la baisse du
prix ou bien la forte demande provoque automatiquement sa montée. C'est
donc par tâtonnement censé être atteint ce prix dans la
réalité. Ainsi, la demande et l'offre connaissent des
évolutions :
v Evolution de la demande : lorsque d'avantage de
personnes désirent un bien, la quantité qui en est
demandée pour un prix donné tend à augmenter. Cette hausse
de la demande peut dériver d'une évolution des gouts, quand les
consommateurs accroissent le désir qu'ils aient d'un bien donné.
La conséquence de ce changement est la hausse du prix d'équilibre
qui passe de P1 à P2, tandis que s'accroit
également la quantité d'équilibre qui passe de
Q1 à Q2. Inversement, lorsque la demande diminue,
les phénomènes inverses se produisent. La quantité
échangée décroit ainsi que le prix.
v Evolution de l'offre : lorsque les couts de production
de l'offreur sont modifiés, la courbe de l'offre se déplace en
conséquence. Si, par exemple quelqu'un découvre une nouvelle
manière de faire pousser le rotin, les producteurs tenteront d'accroitre
les quantités vendues, si bien que la courbe O0 se
déplace vers la droite et deviendra O1.
Cet accroissement de l'offre provoque une diminution du prix
d'équilibre qui passe de P1 à P2. Quant
à la quantité d'équilibre, elle augmente de Q1
à Q2 car la quantité demandée est accrue par la
baisse du prix. Cette évolution n'a d'effet que sur l'offre, la courbe
de la demande reste identique.
Cette théorie présente clairement son rôle
dans notre travail car elle nous permet de comprendre le comportement des
différents acteurs de l'agriculture dans l'arrondissement de Melong.
Cette théorie nous permettra également de comprendre ce qui
motive les agriculteurs de pratiquer de plus en plus ou de moins en moins de
nouvelles techniques. Cependant on peut aussi à partir de cette
théorie comprendre l'organisation du marché. L'agriculture
faisant partie d'une activité économique où l'offre et la
demande constituent les éléments essentiels dans le jeu du
prix.
| 


