
 |
Déforestation et dégradation de l'environnement au Cameroun 1960-2010.par Marcel Koviel Songo Université de Youndé I - Master en histoire 2012 |
Source : H. Bikié, J. G. Collumb et al, Aperçu de la situation de l'exploitation forestière au Cameroun, rapport de l'observatoire mondial des forêts, Washington, DC, World Resources Institue, 2000, p. 16. A travers ce tableau, nous constatons que la diversité des essences forestières camerounaises offre au pays une grande variété de bois de grande valeur. Toujours sur ce tableau, nous pouvons évaluer la multitude d'applications qui résulte de la transformation de ce bois. Ainsi, sur le plan floristique, les forêts camerounaises présentent une très grande multitude d'espèces d'arbres. Ce qui est corroboré par le rapport de l'observatoire mondial 23 24 des forêts qui stipule que le pays a le nombre le plus élevé de plantes par unité de surface de la région0. La liste des essences forestières proposée par l'annexe I est une preuve de cet argument0. En dehors du bois, les forêts camerounaises renferment plusieurs produits non ligneux. Parmi ces produits nous avons les feuilles et les écorces qui sont utiles à la pharmacopée, les tubercules, les graines, les résines, les fruits, le miel, les champignons et les produits à base d'animaux qui constituent de véritables aliments de nutrition0. A part cette richesse floristique, on dénombre aussi une faune importante. 2-Les richesses fauniques des forêts camerounaisesLes forêts camerounaises abritent une forte variété d'espèces animales. D'après Filip Verbelen, les forêts de la chaine montagneuse du Cameroun et du Nigeria, les forêts des plaines ouest et les forêts équatoriales du Cameroun abritent pas moins de seize espèces de singes, dont deux primates : le chimpanzé et le gorille des plaines0. La faune forestière typique du Cameroun compte également l'éléphant de forêt, le léopard, le chat doré, le bongo, le buffle des forêts, l'antilope de forêt le pangolin géant, et le porc-épic0. Dans la forêt équatoriale vivent également des centaines d'espèces d'oiseaux. Selon Birdlife International, le Cameroun abrite deux zones d'oiseaux endémiques notamment les montagnes camerounaises qui ont plus de vingt et neuf espèces à territoire peu étendu, et les plaines du Cameroun et du Gabon, une zone de forêts de plaine qui s'étend du sud-ouest du Nigeria au Gabon. Ce secteur comprend six espèces à territoire peu étendu0. Cette diversité d'espèces fauniques place le Cameroun en deuxième position dans la région après la Guinée équatoriale0. Au vue de ces espèces fauniques, on peut dire que le pays dispose d'une grande richesse. Alors, parlant des richesses forestières, nous pouvons dire que le grand Sud-camerounais dispose des richesses forestières d'une très grande importance. Ces richesses sont tant floristiques que fauniques. Le pays se distingue ainsi des autres Etats de la région par son importance en biodiversité. C'est grâce à ce milieu favorable par son relief, hydrographique et la forêt que le milieu a attiré de nombreuses populations. Celles-ci ont immédiatement lié des rapports vitaux avec cette forêt. Ainsi, il serait intéressant de savoir quelle a-été la place de celle-ci dans la vie de ces populations ? 0 Bikié, Collumb, Aperçu de la situation de l'exploitation, 2000, p. 16. 0 Confère Annexe I de la page 142. 0 Ibid. 0 Ibid. p. 7. 0 Ibid. 0Ibid.. 0 Ibid. p. 15. 25 II - LA PLACE DE LA FORET DANS L'UNIVERS DES POPULATIONS CAMEROUNAISESL'étude de la place de la forêt dans l'univers des populations camerounaises répond à l'examen des forêts camerounaises comme sources de biens, des services d'une part et d'autre part comme patrimoine culturel des populations. A-LES FORETS : SOURCE DE BIENS POUR LES POPULATIONSLes forêts sont une source de biens depuis les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale. 1 - La place des biens forestiers dans la vie des populations précolonialesLes peuples qui habitent les zones forestières au Cameroun aujourd'hui sont constitués des Bantous, des Pygmées, des Baka et des Bagyélis. Ces différentes populations sont localisées dans les régions du Sud-Ouest, du Littoral, du Centre, du Sud et de l'Est Cameroun0. Ils seraient immigrés là entre le XVIII è et le XIX è siècles, venant de tous les horizons d'Afrique. Leur adaptation à ce milieu ne fut pas une chose facile. Mais plus tard leur vie devint liée à la forêt0. Avant l'avènement de la colonisation, ces populations tiraient de la forêt l'essentiel du nécessaire vitale Les Bantou et leurs voisins Pygmées, Baka et Bagyéli vivaient du ramassage, de la chasse et de la cueillette0. Ils s'alimentaient avec des denrées tirées de la forêt, notamment les ignames sauvages, la viande de brousse, les escargots, les chenilles, les champignons, les fruits sauvages (corossols, fruits noirs, mangues, ndjansang, noix du moabi...), feuilles sauvages etc. L'approvisionnement en ces produits par ces populations se faisait à travers la chasse, la cueillette et le ramassage. Ainsi, pour avoir les ignames sauvages (Mbial en langue Konabembé0), `'les hommes recherchaient les lianes à ignames dans la forêt, après la découverte de celles-ci, leurs tiges 0 J-F., Gerber, `'Resistances contre deux géants industriels en forêt tropicale. Populations locales versus plantations commerciales d'hévéa et palmiers à huile dans le Sud Cameroun», 2008, p. 13. 0 Ibid. p. 14. 0 Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, p. 254. 0 Le Konabembé est une langue parlée par une tranche de populations bantou agriculteurs vivant dans le sud de l'arrondissement de Yokadouma, leur canton regroupe près d'une cinquantaine de villages en bordure de l'axe principale reliant la ville de Yokadouma à Moloundou et toute la région de la Boumba jusqu'aux limites avec le département du Haut-nyong. Leur communauté serait la plus importante de l'arrondissement de Yokadouma. 26 étaient arrachées pour permettre à ces hommes de creuser les racines pour parvenir aux tubercules», nous confiait Touoba du village Madjoué0. La viande de brousse était le produit de la chasse. On y chassait le lièvre, l'antilope, le sanglier, le buffle, le porc-épic, le buffle, l'éléphant, le pangolin géant, le gorille ; etc. `'Nos grands parents chassaient avec des arcs et à travers les pièges»0 nous confiait Méloa à Madjoué. En effet, Pour se procurer le poisson, les hommes et les femmes barraient une rivière poissonneuse avec le bois mort tiré de la forêt, les mottes d'argile et les feuilles, et ils évacuaient toute l'eau à l'aide des paniers en rotin, le lit de la rivière vidé, ils attrapaient tout le poisson présent, en dehors de pêcher comme ça, on pouvait piéger les poissons de grandes rivières en construisant de grands pièges en gros troncs de bois sous la forme de pont0. L'importance de la forêt se justifie ici par le rôle que jouent les arbres qui bordent les rivières et les fleuves dans la nutrition et la protection de certains poissons et dans les moyens qu'utilisent les populations pour leur avoir. L'approvisionnement en fruits sauvages était une chose simple, puisqu'il suffisait de se rendre aux pieds de certains arbres. C'était le ramassage. Parmi ces fruits, les noix de moabi, et les mangues sauvages étaient les plus appréciés. Car en dehors du jus sucré que ces deux produits procuraient, ils permettaient aussi à la fabrication de l'huile végétale pour les amandes de moabi (huile de karité) et de la patte et le beurre de mangue sauvage0. Ainsi, comme les fruits, les escargots, les chenilles et les champignons faisaient partie des produits provenant du ramassage. C'est cet ensemble de produits qui constituaient l'alimentation des peuples de la forêt du grand Sud Cameroun0. Cette façon de s'alimenter est restée en grande partie aujourd'hui celle des Pygmées du département de la Boumba et Ngoko, les Baka de la région de Lomié, les Bagyeli ou les Bakola du département de l'Océan0. La richesse alimentaire issue de la forêt garantissait la survie des peuples anciens (avant la période coloniale) au point de ne rien envier à la vie d'aujourd'hui. La forêt était 0 Entretien avec Joseph Touoba, environ 90 ans, ancient planteur de Cacao, Madjoué, 26 octobre 2010. 0Entretien avec André Méloa, environ 40 ans, braconnier, Madjoué, 2 novembre 2010. 0 Entretien avec Yvonne Ebiaboua, environ 75 ans, cultivatrice et pêcheur, Ngatto ancien, 7 novembre 2010. 0G. Deravin, `'projet Coeur de forêt : 2008-2010 : sauver le Moabi, arbre sacré chez les Pygmées-baka du Cameroun», rapport de coeur de forêt, www.coeurdeforêt.com, 2010, P. 8, consulté le 15 novembre 2010. 0Entretien avec Delphin Mouamie, environ 60 ans, chasseur, Massea, 11 novembre 2010. 0 G. Deravin, `'projet coeur de Forêt», 2010, p.8 27 ouverte à tous ces habitants et on pouvait se servir à sa guise. Dans ce sens les maux tels que les famines ne devraient pas être connus. Ce qui est corroboré par Zondjel du village Medoum, qui affirmait que : `'La vie était facile en ce temps, la forêt était notre bienfaitrice. C'est pourquoi on vénérait certains de ces éléments''0. Dans cette étendue de forêt, les Bantous étaient sédentaires, les Pygmée, les Baka et les Bagyeli étaient semi-nomades, car ils pouvaient quitter le campement pour les raisons de deuil, l'évitement d'un conflit et le désengorgement du premier campement0. En dehors des produits alimentaires, beaucoup d'autres produits étaient issus de la forêt. En effet, il s'agit des matériaux qui étaient essentiels pour le tissage des vêtements. Ces matériaux étaient parfois les lianes, parfois les écorces d'arbres. Les fils issus des lianes traitées étaient soigneusement tissés pour confectionner les habits et en ce qui concerne les écorces d'arbres, on les battait à l'état frais longuement pour donner une forme de tissu0. De cette étoffe était confectionné un vêtement0. Par exemple, depuis le XIV è siècle, voire avant, les habitants de l'Afrique équatoriale battaient les écorces de ficus afin de les assoupir pour tailler des vêtements dans ce `'tissus'' ; elles tissaient et teintaient de superbes pagnes en raphia0. La conclusion à laquelle nous pouvons aboutir, est que la forêt en dehors d'alimenter les populations, habillait aussi celles-ci. Tous les produits de tissage étaient disponibles dans la forêt. Et ces haillons issus des produits forestiers avaient des noms. Cela dépendait de la région où on était. Par exemple les Konabembé l'appelaient Apkaka . Au-delà d'habiller les hommes, la forêt était aussi une source des médicaments. Pour résoudre leurs problèmes de santé, les ancêtres s'approvisionnaient en forêt en produits médicinaux. On y trouvait presque tout remède à toute maladie. Le tableau ci-dessous est plus illustratif de la richesse en pharmacopée des forêts camerounaises. 0 Entretien avec Louis Zondjel, environ 65 ans, cultivateur, Medoum, 10 octobre 2010. 0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels'', 2008, p. 15. 0 Entretien avec Marie Mbot, environ 65, cultivatrice, Madjoué, 8 août 1999. 0Ibid. 0 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette Edicef, 4 è édition, 2002, p. 27. 28 Tableau n°2 : Liste des plantes médicinales et les maux qu'elles traitent
Source : O. Ndoye, M. Ruise-Perz. Et al, `'Les effets de la crise économique et de la dévaluation sur l'utilisation des plantes médicinales au Cameroun. Implication pour la gestion durable des forêts», séminaire FORAFRI de Libreville (enquête CIFOR 1998), p. 4. Cette liste non exhaustive des plantes médicinales ressortant les maladies qu'elles soignaient, démontre que la forêt camerounaise offrait largement aux peuples anciens de quoi se soigner. Ces plantes étaient en abondance dans cette forêt. Ceci atteste la valeur médicinale de la forêt. Par ailleurs, cette même forêt offrait l'emplacement et des matériaux de construction. Pour certains Bantous qui auraient vécu en pleine forêt originelle, pour se protéger contre les intempéries et les attaques de tout part, ils construisaient des habitats traditionnels. Pour la construction d'un habitat, le choix de l'emplacement était primordial, car la fragilité des matériaux (piquets, lianes et feuilles) faisait en sorte que ces maisons positionnées en pleine air soient détruits par les intempéries. Dès lors, les pieds des grands arbres étaient des 29 meilleurs emplacements, car ces pieds et les branches pouvaient protéger la maison des forces naturelles0. C'est avec le temps qu'ils auraient adopté les techniques de maisons en poteaux, murs en écorces d'arbres et le toit en raphia0. Chez les Pygmées de l'Est Cameroun, ces constructions ont gardé leur forme authentique jusqu'à ce jour. Elles étaient en huttes entièrement constituées des produits forestiers. La forêt était donc ainsi la source des matériaux de construction à l'époque précoloniale. Alors, au vu de sa valeur alimentaire et médicinale, considérée comme source des vêtements et de matériaux de construction, nul ne peut douter de la valeur des forêts camerounaises comme sources de biens pour nos ancêtres. Contrairement aux générations actuelles, nos aïeux s'en servaient amplement pour tous leurs besoins. La forêt était donc l'essence vitale. 2 - La dépendance des populations coloniales et postcoloniales des biens forestiersL'arrivée des Européens à partir du XIXe siècle eut un impact sur la vie des populations camerounaises. Car ceux-ci apportaient avec eux des nouvelles habitudes de vie. Ainsi, ils introduisirent des nouveaux produits (cultures, médicaments et matériaux de construction). Ce qui fait affirmer Kelodjoué que l'agriculture est un lègue colonial. L'introduction par les colons des cultures modernes telles que les produits alimentaires (manioc, banane-plantain, macabo, arachide, haricot, patates, igname, palmier à huile, canne à sucre et tous les fruits qu'on connait ; etc.), la médecine moderne pratiquée dans les hôpitaux et les médicaments occidentaux, les matériaux de construction (tôle, pointe, briquette, ciment, acier...), les vêtements éloignait déjà peu à peu des populations locales de certains produits forestiers sans pour autant les séparer totalement de ceux-ci. Sur le plan alimentaire, certaines des habitudes d'aujourd'hui sont restées attachées au passé. Parmi ces produits alimentaires forestiers consommés dans le passé, certains seraient disparus, mais d'autres sont encore très prisés et on les rencontre dans nos marchés. Il s'agit entre autres des espèces utilisées comme vivrier, des fruitiers, des cultures de rente, les 0 Entretien avec Louis Zondjel, environ 65 ans, cultivateur, Medoum, 10 octobre 2010. 0 Entretien avec Jean Elidong, environ 70 ans, Braconnier, Song ancien, 15 novembre 2010. 30 chenilles, les escargots et la viande de brousse ; etc.0 Comme vivrier, on distingue trois espèces de riz sauvage (oryza sp.), trois ou quatre espèces de haricot sauvage (niébé). Les racines et les tubercules sont aussi présents. Dans leur registre, on rencontre les ignames sauvages. On dénombre huit ou neuf espèces. Ces tubercules et racines sont toujours consommés. De nos jours ils sont un peu rares, pas connus de toute la jeune génération. Pourtant, dans certaines régions du Cameroun, certaines populations continueraient à les consommer. C'est le cas des Pygmées dans la Boumba et Ngoko, des Baka dans le Haut-Nyong, les Bagyeli dans l'Ocean0. Pour ce qui est des fruits sauvages, environ deux cent cinq espèces d'après Fon Dou et Foteu sont recensées. Elles sont consommées sur plusieurs formes : Pulpes comestibles (18 espèces) ; Amandes comestibles (5 espèces) ; Fruits et amandes non utilisés en cuisine (3 espèces) ; Fruits et amandes subissant des transformations (3 à 5 espèces) ; Amandes transformés en bouillie (5espèces) ; Huile alimentaire ou industrielle (5 à 7 espèces)0. Beaucoup d'entre eux qui, hier faisaient partie de l'alimentation des populations, continuent toujours à alimenter les paniers de certaines ménagères. On peut citer les noix de moabi, la mangue sauvage, le corossol sauvage ; etc. On trouve tous ces fruits dans les marchés actuellement0. Les chenilles et les escargots sont toujours les denrées très prisées par certaines populations camerounaises. Comme les fruits, on les rencontre aussi dans les marchés. Que ce soit les fruits ou les escargots et les chenilles, on les consomme aujourd'hui, au rythme des saisons, car ce sont des produits saisonniers. Par ailleurs, certains de ces produits sont classés dans la liste des produits forestiers non ligneux (PFNL) que beaucoup d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) tentent de valoriser0. Ce nom est attribué aux produits forestiers qui sont en dehors du bois et dont l'exploitation par les populations riveraines peut leur apporter une amélioration au niveau de leurs conditions de vie0. Certains de ces produits 0 S. C. Tagne Kemmegne, `'Gestion durable des ressources naturelles en Afrique centrale : cas des produits forestiers non ligneux au Cameroun et au Gabon», mémoire de master en droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, 2008, p. 50. 0 Deravin, `'Projet coeur de forêt», 2010, p. 8. 0 Fomete Nembot, Tchanou, La gestion des écosystèmes forestiers, 1998, pp. 58-59. 0 Tagne Kemmegne, `'Gestion durable des ressources », 2008, p. 50. 0 Tagne Kommegne, `'Gestion durable des ressources», 2008, p. 43. 0 Ibid. 31 d'origine végétale sont le gnetum africana, la mangue sauvage, le ndjansang, les noix de moabis, les produits médicinaux etc. Pour les feuilles, on connait les légumes comme le Ndolé (Vermonia sp) et l'Okok (Gnetum africana) qui sont les plus en vues et consommées. Ces deux légumes étaient déjà consommés à l'époque. De nos jours, le Ndolé est un plat prestigieux. Il est consommé dans tous les grands banquets. Sur son cas, Endele Béatrice disait : `' Le Ndolé reste le plat que mes clients commandent le plus quand ils arrivent ici». Quant à la salade sauvage, elle est connue sous le nom de l'Okok en Beti. Son nom scientifique est le Gnetum africana. Cette feuille très prisée est utilisée pour plusieurs fins0. Jusque là, elle servait à l'alimentation pour des populations des zones forestières. Mais aujourd'hui, elle est entrée dans l'alimentation des populations urbaines. Ainsi, chaque région avait un met spécial à base de cette feuille. A l'Est c'est le plat de Koko qu'on vous sert avec du bon couscous, dans le Centre et le Sud, on vous la sert sous la forme du Kok avec du manioc, alors que dans le Nord-Ouest et le Sud-ouest, elle est mangée sous le nom de Ero avec du Water foufou. En dehors de cet usage du Gnetum aficana s'ajoute encore d'autres. Cette même plante sauvage servirait à la fabrication de l'alcool et de certains produits médicinaux0. C'est pourquoi elle est commercialisée aujourd'hui tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Les chargements du Gnetum africana qui partent des brousses du Sud-ouest, du Littoral et du centre alimentent les grands marchés du pays0. La mangue sauvage au même pied d'égalité que les autres fruits forestiers connait aussi plusieurs usages. Son fruit est d'abord sucé pour son jus et les amandes qui en sortent servent à la fabrication d'une patte grise qui alimente les sauces. Cette patte est appelée ndo'o en Beti et Ndiek en Konabembé. Elle est comparable à la patte d'arachide ou de pistache, mais très appréciée par les vieux pour son taux de lipides développé et à cause de sa facile digestion0. Pourtant elle est commercialisée aussi à l'extérieur du pays. Pendant la saison, les commerçants nigériens se déversent au Cameroun pour s'en approvisionner. La cuvette de mangue sauvage coute 25 000 FCFA dans les marchés de Yokadouma0. 0O. Ndoye, M. Ruise-Perez. et al `'Les effets de la crise économique et de la dévaluation sur l'utilisation des plantes médicinales au Cameroun. Implications pour la gestion durable des forêts», Séminaire FORAFRI de Libreville, 1998, p. 9. 0 Ibid. 0 Tagne Kommegne, `'Gestion durable des ressources», 2008, p. 44. 0 Entretien avec Irène Medjara, environs 35 ans, vendeuse au marché de Yokadouma, Yokadouma, 10 août 2010. 0 Ibid. Le ndjansang est aussi cette espèce de graines qu'on a toujours prélevées dans la forêt. Sa patte sert à concocter certaines sauces. Par exemple les femmes au Cameroun adoraient le préparer avec du poisson. Et le sac de Ndjansang coûterait extrêmement cher dans les marchés au Cameroun0. Quant aux noix de moabi, ils n'ont pas perdu leur valeur datant. Comme dans le passé, ses fruits sont sucés comme la mangue sauvage, ses amandes servent à extraire une bonne huile végétale. Cette huile est très appréciée par les populations forestières et est vendue dans les marchés camerounais0. Cette huile végétale est très importante dans l'alimentation de certaines populations des zones forestières. Petit à petit, elle commence à être commercialisée dans les marchés intérieurs du pays. Les images suivantes montrent la place que cette huile a toujours occupée dans la vie des populations. 32 0 Entretien avec Annie Etsal, environs 35 ans, cultivatrice, Madjoué, 02 août 2010,. 0 Deravin, `'projet coeur de forêt », 2010, p. 7. 33 Photo n°1 et 2 : Une famille Baka concassant les noix de moabi et une femme bantou en train de charger son huile dans un bidon à l'Est Cameroun.
Source : G. Deravin, `'Projet coeur de forêt» 2010. Quant à la viande de brousse, principale source de protéines dans le passé, est l'un des produits forestiers les plus consommés actuellement par presque toutes les couches sociales au Cameroun, et presque dans tous les villes et les villages du pays. De Douala à Yokadouma, de Loupessa à Akom II, cette viande est la plus prisée0. Malheureusement, tellement elle est consommée qu'un cri d'alarme est lancé dans tout le pays pour que tous les animaux de la forêt ne soient pas décimés0. On peut néanmoins constater que l'alimentation est toujours liée aux produits forestiers. Sur le plan médical, une bonne partie de la population comme celle d'avant se sert encore aujourd'hui des produits forestiers pour se soigner. Malgré le développement de la médecine moderne, la santé de plusieurs Camerounais est tributaire de la pharmacopée forestière. Ce qui explique cet attachement aux produits forestiers est parfois la pauvreté ambiante dans la majorité des foyers camerounais, l'isolement sanitaire et l'attachement aux traditions. Ce qui n'était pas le cas dans le passé ou c'était plutôt un problème d'habitude des populations camerounaises à accorder leur choix aux produits locaux qui leur inspiraient la confiance par apport aux produits importés. Ainsi beaucoup d'études attestent que les plantes médicinales sont très utilisées dans la médecine traditionnelle et même moderne. Ainsi, selon l'article de `'coeur de Forêt», 80% de la population camerounaise se traitent à la médecine traditionnelle0. Ce qui est la preuve de l'importance des PFNL. Sur ce point, Tagne 0 Ibid. p. 47. 0 Bulletin WWF Jengi...n°11 2008, p. 7. 0 Ibid. 34 Kommegne affirme dans son étude menée en 2008 que `', vingt cinq des marchés des zones forestières humides du Cameroun vendent les PFNL d'origine végétale, pour un chiffre d'affaire de vente semestriel estimé à 1,9 million de dollars US».0 Le même auteur qui cite Flore NNanga estime que sur les trente marchés choisis comme échantillon dont vingt huit dans la ville de Douala et deux dans la ville d'Edéa, il ressort que chaque marché a eu en moyenne 51,61 espèces présents sur son site et au moins 79 espèces sont vendues de plus. Les prix de PFNL vendus sur les marchés étudiés donnent à peu près ceci. Tableau n°3: quelques prix d'espèces de PFNL trouvés dans les marchés de Douala
Source : Tagne Kommegne `' Gestion durable des ressources», 2008, p. 47. En cette période de modernité, l'habitat est passé de traditionnel à celui de moderne. Mais sans pour autant se passer totalement des matériaux forestiers. Pendant la période coloniale la majorité des maisons étaient construites à 80% des matières forestières. Des poteaux aux nattes de raphia en passant par les lianes, étaient des matériaux récoltés dans les forêts. La construction des cases dans beaucoup de villages du grand Sud Cameroun dépend jusqu'à ce jour des produits forestiers. Alors dans les villages, en dehors de ceux qui construisent des maisons en dur, la majorité des paysans le font à base des matériaux que la nature leur offre. Ainsi, si les maisons ne sont pas en poto-poto, elles sont en « calabotes ». Ces différentes compositions des maisons prennent abondamment les produits ligneux. C'est ainsi que pour avoir une maison en « calabotes », il faut les poteaux ou les chevrons, les planches et les lattes. Pourtant la construction d'une maison en poto-poto nécessite, les poteaux, les lianes, les planches et les lattes. Ainsi donc, on localise les maisons en poto-poto 0 Tagne Kommegne, `'Gestion durable des ressources», 2008, p. 47. 35 dans les villages des régions du Centre, du Sud, et de l'Est. Alors que les maisons en « calobotes » sont localisées dans les régions du Littoral et du Sud-ouest. L'avènement des cultures pendant la période coloniale au Cameroun a diminué la pression alimentaire que les populations exerçaient sur les forêts. Ce qui ne les a pas rendues indépendantes de celle-ci, car nous savons que le développement de toutes ces cultures agricoles se fait par l'exploitation des terres. L'agriculture nécessite le défrichement de plusieurs hectares de forêts. On a l'agriculture traditionnelle et l'agro-industrielle. Ces deux classifications classiques tiennent compte des techniques de culture, du matériel de travail, des moyens financiers et de l'importance des parcelles cultivées. En effet, l'agriculture traditionnelle (itinérante sur brulis) est celle pratiquée par les petits paysans dans les villages du grand Sud Cameroun0. Elle est une agriculture de subsistance. Sa particularité est qu'elle utilise des outils rudimentaires (houes et machettes), des petites surfaces (0,3 à 1,5 hectares) et a des techniques dérisoires notamment les incendies des parcelles défrichées, la technique de jachère0. C'est cette forme d'agriculture qui est développée dans les villages du Cameroun. Ainsi, pour la pratiquer, les populations défrichent des parcelles de forêt pour faire des champs de cultures vivrières. A l'Est, au Centre, au Sud, au Littoral et dans le Sud-ouest on y cultive la banane-plantain, le manioc, le macabo, la patate, les ignames, les arachides, les pistaches, le gombo, le maïs, etc.0. Ce sont les parcelles qui ont servies de plantations de cultures vivrières qui deviennent souvent plus tard les plantations des produits de rente tels le Cacao, le Café. Dans la région de la Boumba et Ngoko, c'est précisément ce qui se passe. L'image ci-dessous illustre la modeste qualité de plantation qu'on trouve dans les villages. 0 P. Bigombe Logo `'exploitation forestière et développement local: sortir de l'Etat forestier», Arbres, forêts et communautés rurales, vog-ADA Bulletin FTPP n°15 et 16 Décembre 1998 spécial Cameroun, p. 2. 0 Entretien avec George Akwah Neba, 46 ans environ, Project officer, Pro-poor Redd project, Yokadouma, 10 Octobre 2010. 0Entretien avec Jeannette Nala, 48 ans environs, commerçante des produits de consommation, Douala, 22 décembre 2010. 36 Photo n°3: petite plantation de banane-plantain paysanne dans le village de Massea
Source : Songo Eric, Massea le21 janvier 2007 Ce champs paysan présente toutes les caractéristiques de l'agriculture traditionnelle. On peut remarquer le minuscule espace de terrain qu'il occupe, l'état touffu de la parcelle cultivée et la triste santé de la culture (banane-plantain) qui est développée. Ce qui signifie qu'il appartient à un seul paysan, qui a eu des moyens limités pour le créer. Le plus souvent, les forêts sont parsemées de plusieurs champs comme celui-ci. On peut donc constater que cette agriculture consomme énormément la forêt, car l'absence d'engrais conduit les cultivateurs à observer des périodes de jachère qui vont de 3 à 10 ans0. Pendant ce temps, ils déboisent des nouvelles portions de forêt. Puisque c'est dans les forêts vierges où les sols sont encore fertiles qu'ils créent des nouveaux champs. Ce qui par 0 Ibid. 37 conséquence met cette forme d'agriculture sous la dépendance de la forêt. On parle alors de l'agriculture itinérante sur brulis, contrairement à celle moderne que pratiquent les agro-industriels0. Dans la zone forestière camerounaise, l'agriculture moderne est pratiquée depuis la période coloniale allemande. Quelques années après son indépendance, les autorités camerounaises ont créé des plantations agricoles qui sont venus s'ajouter à celles héritées de la colonisation. Elles sont localisées dans les régions du Sud-ouest, du Littoral et du Sud. Ce sont les sociétés agro-industrielles (HEVECAM, SOCAPALM, SOSUCAM, SAFACAM, CDC etc.) qui pratiquent cette forme d'agriculture0. La particularité de celle-ci est la pratique de la monoculture, l'importance des parcelles cultivées, l'usage des engrais chimiques pour enrichir les sols, la mécanisation, une main-d'oeuvre importante, avec des gros capitaux. Les deux sociétés à savoir HEVECAM et SOCAPALM, qui font partie de notre étude, ont respectivement été créées en 1975 et 19780. Le gouvernement face aux plans d'ajustement structurels, leur a cédé aux capitaux privés en 1996 pour la société d'Hévéa et 2000 pour celle de l'huile de palme0. La Société camerounaise de palmerais (SOCAPALM) et la société d'hévéa du Cameroun (HEVECAM), occupent à elles seules une parcelle de 61 339 hectares0. Pourtant Kelodjoué évalue ce chiffre à 98 000 hectares en 19770. Ces deux géants de l'agro-industrie pratiquent la monoculture, l'une la culture du palmier à huile, l'autre l'hévéa et ont des usines de transformation. La main d'oeuvre de ces deux sociétés est évaluée en centaines de personnes0. Elles ont des productions annuelles évaluées en tonnes, 26 500 pour HEVECAM et 26 000 pour SOCAPALM0. La photo suivante renseigne sur ce qui est de ces plantations. 0 Entretien avec Dr Gordon N. Ajonina, 48 ans environs, ingénieur forestier/Aménagiste des écosystèmes de mangrove et de zones humides, Yokadouma, 10 Otobre 2010. 0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels», 2008, p. 8 0 Ibid. p. 26. 0 Ibid. 0 Ibid. p. 14. 0 Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation forestière», 1985, p. 257. 0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels», 2008, p. 14. 0 Ibid. pp. 19-20. 38 Photos n°4 et 5 : Une plantation de palmier à huile et une plantation d'hévéa
39 Source : Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels», pp. 22-23. Dès lors, l'analyse qu'on peut faire au vue de cette superficie élevée qu'occupent les agro-industriels, est que par rapport aux champs paysans, elles occupent de grandes parcelles dans la forêt. Et pour leur extension, elles exigent de plus en plus de nouveaux espaces de forêt. Ce qui les met en dépendance des forêts au même pied d'égalité que les champs paysans. A tous ces biens que la forêt procure aux populations actuelles, on peut ajouter le bois mort qui sert de bois de feu et de charbon de bois. L'usage de ces deux produits énergétiques est récurrent de nos jours. Le bois de chauffage est une énergie utilisée pour la cuisson et la conservation des aliments. Ces aliments peuvent être conservés soit par le réchauffage, soit par le fumage. Les fumées émanant du bois de chauffage servent souvent à l'extermination des insectes dans la maison. Son usage date depuis la période précoloniale. Il a conservé sa place qu'il avait auprès des ménages jusqu'à ce jour. De nos jours, il est très observé dans les zones rurales au Cameroun, ce qui n'exclut pas néanmoins le secours qu'il apporte à certains citadins. A côté de lui, on trouve le charbon à bois. Sur ce point, le rapport de la direction des eaux et forêts indique en 1981 que près des grands centres urbains, il existe des gens spécialisées pour le 40 bois de chauffage. Ces personnes abattent les petits arbres dans les forêts environnantes, les fendent ou les carbonisent pour la vente. Ainsi, il estime à 70 le nombre de personnes qui faisaient ce travail autour de la ville de Yaoundé dans les années 19800. Le charbon à bois est une énergie faite à base du bois brulé. Il a toujours été une source d'énergie incontournable pour certains ménages urbains. Ainsi, il est plus consommateur du bois que le feu de bois. De nos jours, dans les banlieues des grandes métropoles camerounaises (Douala et Yaoundé), de nombreux jeunes se sont lancés à la transformation des gros et longs troncs de bois frais en charbon de bois à travers les fours en forêt0. Cette nouvelle intervention de la forêt dans la procuration de l'énergie vient compléter ce qu'elle a toujours apporté aux populations camerounaises. A1ors, la conclusion qu'on peut tirer de là est que depuis leur arrivée dans la zone forestière, les Bantou du Cameroun ont appris à s'alimenter grâce à celle-ci. D'autres biens qui se sont ajoutés à ceux-là sont: les matériaux de construction, l'habillement, les médicaments et l'énergie. Mais au fil du temps et grâce à la colonisation, certains de ces biens forestiers ont été remplacés par ceux dits domestiques. Cette réalité n'a pourtant pas affranchi l'homme de sa dépendance de la forêt. Ce que confirme les Pygmées, les Bakas et les Bagyélis ; eux qui sont les seules communautés des forêts camerounaises qui ont gardé les mêmes habitudes forestières qu'elles avaient avant la période coloniale0. Arrivé au terme de notre examen sur les biens que la forêt offrait et continue d'offrir aux populations camerounaises, non seulement les forêts sont d'excellentes sources de produits domestiques, mais elles fournissent aussi de précieux services à l'environnement des populations locales et contribuent à leur bien être. B-LES FORETS CAMEROUNAISES COMME SOURCES DE SERVICESLes forêts, en dehors d'être une source de biens, sont aussi de véritables sources de services. A cet effet, depuis la période précoloniale jusqu'à ce jour, les services que les forêts ont rendu et rendent toujours aux populations sont les mêmes. Ces services paraissent très 0 `'Relance du secteur forestier» Direction des eaux et forêts, 1981. 0 Etretien avec Mbala Metouk, 30 ans environ spécialiste de charbon de bois, Mengueme, 24 Septembre 2011. 0 Gerber, `'Resistances contre deux géants industriels», 2008, p. 13. 41 nombreux. Dans ce travail, on les regroupe en services environnementaux et services écologiques. 1 - Les services environnementaux de la forêtLes services environnementaux que rend la forêt aux Camerounais sont de plusieurs dimensions. Elles sont entre autres : la conservation des sols, la séquestration du carbone, l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau, la maîtrise des inondations et la régulation du climat0. La conservation des sols par des forêts tropicales humides passe par la protection des sols fragiles et l'atténuation de la violence des précipitations tropicales en interceptant les gouttes de pluie avant qu'elles n'atteignent la surface du sol0. A cet effet, ce rôle de la forêt entraine la réduction de l'érosion et la protection des ressources locales en terre et en eau. Par conséquent, les sols de certaines zones forestières n'ont pas connu jusque là l'érosion, les coulées de boues, les glissements de terrain. La séquestration du carbone par les forêts est un grand service environnemental que celle-ci rend aux populations. Dans son exposé de juillet 2008, Elvis Ngole Ngole, ministre de la forêt et de la faune au Cameroun estimait que les forêts agissent comme réservoir de 46% du carbone terrestre et absorbent le dioxyde de carbone qui nourrit l'effet de serre. Ainsi, les écosystèmes forestiers abritent 80% du carbone de la végétation terrestre et 40% du carbone des sols0. En outre, soulignons que cette séquestration du carbone se fait à travers la photosynthèse0. Ce rôle semble être essentiel, car la forêt absorbe une grande partie du CO2 atmosphérique. Au Cameroun, les forêts stockent au moins 1,3 et peut être jusqu'à 6,6 gigatonnes de carbone. En débarrassant l'atmosphère du carbone, les forêts rendent l'air atmosphérique sain pour les hommes. Puisque à travers la photosynthèse, la végétation libère l'oxygène dans l'air0. C'est pourquoi, beaucoup de gens pensent que les Africains en général 0 Koffi Annan, `'Les forêts et le changement climatique», Forum des Nations Unies sur les forêts, Rapport du Secrétaire Général, huitième session, New-York, 2009, p. 5. 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 2. 0 Elvis Ngole Ngole, `'Les forêts : enjeu international du 21ème siècle», Exposé du ministre des forêts et de la faune, Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC), Yaoundé le 18 juillet 2008. 0 R. Nguessi, `'Application de l'article 40 des résolutions du sommet de Rio, cas de l'ANAFOR», Rapport de stage professionnel, 2005/2006, P.5. 0 Bikié, Collumb. Et al (eds), Aperçu de la situation de l'exploitation forestière, 2000, p. 18. 42 et les Camerounais en particulier respirent un air pur. Cet avantage leur est du grâce à la présence des forêts dans leur territoire. Parmi ces services de la forêt camerounaise, on souligne aussi l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau. Comme nous pouvons le constater, la forêt joue un double rôle dans le domaine de l'eau. Elle est à l'origine de certaines précipitations et rend l'eau de bonne qualité0. Les forêts ont une action importante sur le cycle de l'eau, notamment avec l'évapotranspiration (quantité de vapeur d'eau qu'évapore un sol et que transpire la végétation qu'il porte)0. Les arbres contribuent plus que la flore au phénomène d'évapotranspiration et ce qui influence la pluviosité. Ils créent une hygrométrie locale importante en zone tropicale. Leurs racines vont chercher l'eau jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur ou de distance0. Les forêts humides tropicales dont celles du Cameroun sont à l'origine des précipitations qui tombent dans les régions sous le vent0. Lors de ces précipitations, les forêts retiennent la majorité de l'eau qu'elles interceptent ou l'infiltrent en rechargeant la nappe phréatique. Cette eau filtrée par les forêts alluviales est épurée. Ainsi, 30 mètres de forêt riveraine retiennent la quasi-totalité des nitrates agricoles0. Les forêts de collines et de montagnes sont d'une importance particulière pour la captation des eaux dans les zones de précipitations abondantes. Elles permettent de réguler les écoulements des fleuves dont dépendent de nombreuses populations en aval, de protéger les têtes de sources. Ce rôle de la forêt dans le cycle de l'eau donne un grand avantage en ce qui concerne la pluviométrie au grand Sud du Cameroun par apport aux régions du grand Nord. Le constat est très visible, il pleut beaucoup dans les zones forestières que dans les zones sahéliennes ou de savane. D'après Jean Pierre Amou'ou Jam, ces pluies diminuent de la zone forestière vers la savane. Ainsi, une ville comme Yaoundé dans le Sud forestier reçoit une pluviométrie de 1597 mm, alors que Maroua dans le Nord connait seulement 815 mm de pluviométrie0. 0`'Déforestation» http: // fr.wikipedia, consulté le 22 novembre 2010. 0 Dictionnaire Universel, Paris Hachette, 2002, p. 455. 0 Ibid. 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 3. 0 http: // fr.wikipedia 0 Amou'ou Jam et al, `'Géographie le Cameroun», 1985, p. 9. 43 Pour ce qui est de la qualité de l'eau, on peut dire qu'elle est claire dans les forêts. C'est pourquoi dans les villages forestiers, les hommes s'approvisionnaient dans les sources avant l'avènement des forages et des pompes à eau. Et le plus souvent, ils n'avaient pas de problèmes des verres intestinaux. A tous ces services environnementaux s'ajoutent la maîtrise des inondations et la régulation du climat. La forêt maîtrise des inondations en aspirant l'eau des pluies à travers le travail d'infiltration des eaux que font les racines des arbres jusqu'à la nappe souterraine au lieu de ruisseler à la surface.0 En outre, le couvert végétal offre un microclimat, plus favorable à la croissance végétale et à la vie animale, puisqu'il abaisse la température en absorbant la lumière, là où le sol nu renvoie l'énergie du soleil vers l'atmosphère, réduit l'évaporation et freine le vent0. Si les zones forestières ne connaissent pas assez d'inondations au Cameroun, c'est aussi à cause du couvert forestier. Malgré les pluies abondantes qui tombent dans ces régions, tout se passe un peu bien. Et pour ce qui est du climat, il est très doux, car le couvert forestier offre un ombrage et rend le milieu moins chaud et moins humide. C'est cet ensemble d'éléments qui constitue les services environnementaux qu'offre la forêt aux populations. A côté de ceux-ci, on a les services écologiques de la forêt. 2 - Les services écologiquesLes services écologiques que rendent les forêts aux populations tournent autour de la conservation de la biodiversité0qui comprend plusieurs volets. A savoir la protection de la faune, de la flore, des espèces aquatiques et des autres espèces forestiers et l'alimentation de ces dites espèces. Ce qui rend les choses simples à l'homme qui pourrait se servir des produits de ceux-ci sans se soucier de leur situation. Pour protéger les espèces fauniques, floristiques, aquatiques et autres, les forêts leur offrent d'abord un habitat0. C'est pourquoi les bêtes sauvages vivent dans les forêts avec une assurance sans faille. D'aucuns vivent dans les trous, certains sur les arbres, d'autres sous les racines de ces arbres, et les derniers sous certains grands arbres. Ainsi, Ismael Sergeldin pense que les forêts tropicales humides servent d'habitat à une très grande partie des espèces 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 3. 0 Ibid. 0 Koffi Annan, `'Les forêts et le changement climatique», 2009, p. 5. 0 Ibid. 44 qu'abrite notre planète0. On retrouve plus de la moitié de toutes les espèces vivant dans les forêts tropicales humides, qui n'occupent pourtant que 7% de la surface des terres0. La forêt camerounaise en fait partie. C'est dans ce sens que Filip verbelen nous apprend que les forêts de la chaine montagneuse du Cameroun et du Nigeria et la forêt équatoriale des plaines du Cameroun abritent des espèces qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans le monde0. On compte parmi ces animaux pas moins de 16 espèces de singes, dont deux primates : le chimpanzé (Pan troglodytes) et le gorille des plaines (Gorilla)0. La faune forestière typique du Cameroun compte également l'éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis), le léopard (Pantera pardus), le chat doré (Profelis aurata), le bongo (Tragelaphus euruceros, Antilope farouche), l'antilope de forêt (cepholophus spp), le buffle de forêt (Syncercus nanus), pangolin géant (smutsia gigantea) et le porc-épic (Atherurus africanus)0. Dans la forêt équatoriale camerounaise, vivent également des centaines d'espèces d'oiseaux, comme le Calao, le Martin-pêcheur, l'Aigle et le Perroquet gris à queue rouge du Gabon0. En effet, il est clair que de nombreuses espèces animales et végétales de la forêt équatoriales ne peuvent survivre que dans des forêts tranquilles comportant de grands arbres âgés dont le feuillage est intact. Certaines espèces (oiseaux, insectes) dépendent d'arbres bien précis pour leur nid, bref leur habitat0. Alors suite à cette longue liste des animaux sauvages qui dépendent de la forêt du Cameroun pour leurs habitats, le constat est clair que la forêt est un abri pour les animaux comme elle est aussi leur source d'alimentation. En ce qui est de l'alimentation, comme les hommes, les animaux aussi dépendent de la forêt. Quant à eux, leur dépendance est quasi-absolue. Les forêts nourrissent les animaux et les poissons. Les animaux des forêts se nourrissent des fruits sauvages (la mangue, la noix de moabi, le corossol, les fruits noirs et rouges), les feuilles, les écorces d'arbre, le nectar des fleurs ; etc. Ainsi pour leur alimentation les éléphants et les sangliers de la forêt du Sud-Est Cameroun se nourrissent des noix de moabi0, les gorilles mangent les fruits rouges, les 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 3. 0 Ibid. 0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 7. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. p. 8. 0 Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010, p. 8. 45 antilopes et autres herbivores se servent de certaines feuilles, quant aux abeilles et autres insectes volants, eux ils se contentent du nectar des fleurs, certains oiseaux se nourrissent des petits fruits alors que d'autres sont des carnivores (Aigle, Corbeau, Charognard...). Les forêts nourrissent les espèces aquatiques. Ainsi, les palétuviers fournissent une abondance d'éléments nutritifs durant leur cycle vitaux à de nombreuses espèces rencontrées dans les estuaires et les mers, en particulier les crevettes et les mollusques. Les forêts riveraines apportent aux pêches d'eau douce des avantages analogues sous forme de substance nutritives que d'importantes espèces de poissons utilisent à divers stades de leur cycle vital0. A base de ce que nous venons d'apprendre, nous pouvons conclure que la forêt joue un rôle déterminant dans la survie des espèces animales terrestres et aquatiques. Car, elle est leur seule source d'approvisionnement en aliments. Pourtant en dehors de ce rôle nutritif s'ajoute celui de source de traitement des maladies des animaux. Certains observateurs, des primatologues ont montré que les gorilles et les chimpanzés parviennent à se soigner en absorbant les plantes précises dans la forêt0. Cette hypothèse sur la valeur médicale des forêts vis-à-vis des animaux pourrait être crédible. Car si les êtres humains sont victimes des maladies de toute sorte, des blessures et par conséquent ont besoin de traitement pour la survie dont certains éléments de celui-ci viennent des forêts, les animaux sauvages ne font pas l'exception. Ainsi donc, parvenu au terme de l'examen des services écologiques que rend la forêt aux populations camerounaises, force est de constater que c'est à travers l'habitat, l'alimentation et les médicaments qu'elle offre aux animaux sauvage que ce service est accompli. Nous tirons donc la conclusion que les forêts protègent, nourrissent et soignent les animaux dont la viande sert à l'alimentation des hommes. En dehors d'être une source de biens et de service, les forêts sont aussi un patrimoine culturel. C - LES FORETS CAMEROUNAISES : UN PATRIMOINE CULTURELAu Cameroun, les forêts représentent toujours beaucoup de choses dans la vie des populations. En dehors d'être leur source de biens et de services, ces mêmes forêts sont pour elles un patrimoine culturel. Les forêts et tous ces éléments ont longtemps étaient la source 0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 6. 0 `'Déforestation», http : // fr. wikipedia. 46 culturelle des populations bantou et un milieu de vie pour les peuples pygmées, appelés peuples des forêts. 1 - La forêt comme patrimoine culturel des peuples bantouDepuis l'installation de l'homme dans la forêt comme nous avons dit plus haut, il a noué une relation vitale avec son milieu. Parmi les domaines qui nourrissent ce lien, il existe le rapport culturel. A l'époque précoloniale le rapport culturel était étroit, l'avènement du christianisme a fragilisé ce lien. A cet effet, elles trouvaient les éléments manifestes de leur religion dans la forêt. Il y avait parmi ces éléments, certains grands arbres, certains grands animaux, certains fleuves. Ces éléments de la forêt alimentaient la spiritualité chez les peuples précoloniaux. Ainsi, quand ils n'étaient pas la représentation matérielle de leur dieu, ils étaient l'intermédiaire avec celui-ci. C'est pourquoi à l'arrivée des premiers Européens, ils vont déclarer que les peuples africains sont les animistes0. Après l'introduction du christianisme au Cameroun au 19ème siècle, les peuples de forêt reconvertis en majorité à celui-ci abandonnent peu à peu cet attachement spirituel aux esprits de la forêt. Pourtant, jusqu'à ce jour, certains liens n'ont pas été coupés. Ainsi, dans les rites mystiques actuels, on utilise certains arbres. Cela dépend de la région, du pays où on se trouve. A titre illustratif, dans la neutralisation de la sorcellerie et l'initiation à la profession de guérisseur voyant, les Konabembé, les von-von et les Mbimo0 du departement de la Boumba et Ngoko utilisent un arbre forestier appelé en langue konabembé `'Essouom»0. Chez les peuples bamiléké, ils ont ce qu'ils appellent la `'forêt sacrée»0 qui est réservée aux rites 0 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette Edicef, 2002, P. 58. 0 Les Von-Von sont une ethnie de l'arrondissement de Yokadouma. D'après l'histoire orale, elle serait une ethnie soeur des Konabembé, car leurs ancêtres étaient frères. Les Von-Von, troisième ethnie en importance occupent deux tronçons de route dans l'arrondissement. Elles sont installées à entre la ville de Yokadouma et Gieu (Est de l'arrondissement) et sur le tronçon Yokadouma Moloundou (Sud de l'arrondissement).Elles compte à peu près une vingtaine de villages. Quant aux Mbimo, elles sont aussi du même arrondissement. Deuxième population la plus importante de l'arrondissement après les konabembé. Comme les Von-Von, elles occupent aussi deux tronçons de route dans cet arrondissement. Le premier tronçon va de la ville de Yokadouma à Gribi 27 kilomètres (Nord de l'arrondissement). Le deuxième part de la ville jusqu'à Mboye, village frontière entre le Cameroun et la République Centrafricaine (Sud -est de l'arrondissement). Elles seraient venues de la Centrafrique. Le nombre de leur village est évalué à environ trente. 0 Entretien avec Elarion Epopodengue, 60 ans environ, guérisseur-voyant, Yokadouma 5 novembre 2010. 0Entretien avec Joseph Nguedia, 60 ans environ, policier retraité, Yaoundé l8 mars 2011. Et même le totémisme dans les cultures des sociétés camerounaises, on utilise de bêtes féroces et dangereuses de la forêt telles que la panthère, le gorille, le serpent l'aigle, etc. Et parfois certains arbres. Dans la production artistique, le bois est la matière qui domine. Le Dictionnaire Universel situe l'usage du bois comme le support artistique à partir du VIII è siècle en Afrique0. Ainsi, les masques et les statuettes sont reproduits en bois, on les rencontre dans les grandes chefferies telles que le sultanat de Foumban et les chefferies de Bafoussam, Bafang, Bangangté, etc. Aujourd'hui, ces masques et statuettes sont une source culture dans cette région car ils sont l'héritage que ces peuples ont eu de leurs ancêtres et sont parfois les représentations de la société ancienne. Les fauteuils du musée d'art de Foumban et les tabourets des chefferies Bamileké sont autant d'exemples. A coté du bois, on trouve les lianes qui servent au tissage des paniers, les corbeilles, les sacs à mains, les pots de fleurs ; etc Dans les villages des régions du Sud et de l'Est, le Bubinga et le Moabi sont des arbres culturels. Hauts de 60 mètres et ayant des diamètres de 4 mètres, ils sont des points de repère de référence dans la forêt et jouent le rôle social d'arbre à palabre sous lesquels les réponses à plusieurs problèmes sociaux étaient trouvées, voire la résolution des conflits0. Et même à l'époque précoloniale, chez les peuples Konabembé et Bulu, le moabi incarnait l'esprit des ancêtres, c'est sous les pieds des grands moabi qu'on enterrait les grands patriarches, qu'on laissait les blessés qui guérissaient mystérieusement. La même essence fait l'objet de plusieurs contes et de chansons dans les villages0. Nous pouvons constater cette grande importance que revêt cet arbre à travers la photo ci-après. 47 0 Ibid. p. 27. 0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p.29. 0Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010. 48 Photo n°6 : Un moabi dans le village de Nomedjoh (Est Cameroun)
Source : Deravin, `'projet coeur de forêt Cameroun», 2010, p. 7. Cette image d'un grand arbre par le volume de son tronc, de sa hauteur et par son large feuillage, ne laisserait personne indiscrète. Aussi grand comme il est, le moabi attirait déjà la curiosité des populations qui l'ont immédiatement adopté comme leur arbre de choix. La plupart des instruments musicaux rencontrés au Cameroun sont en bois (tambours, guitares traditionnelles, balafons ; etc). Ainsi, de la religion aux instruments musicaux en passant par les oeuvres artistiques, notre constat est clair, les populations forestières au Cameroun tirent leur patrimoine culturel des forêts. La preuve que la forêt reste l'élément essentiel dans la vie des populations riveraines. Par ailleurs, il ya des populations dont la culture est forestière. 2 - La forêt comme milieu culturel des peuples indigènes (Pygmées, Bakas et Bakola)Les Pygmées sont les populations nomades africaines vivant principalement dans la forêt équatoriales de la chasse et de la cueillette0. Au Cameroun, ils seraient les premiers habitants. Ainsi, on rencontre plusieurs groupes, les Pygmées dans la Boumba et Ngoko, les Baka dans le Haut-Nyong et les Bagyeli dans l'Océan, ils sont évalués à 43 400 dans les années quatre-vingt0. Toutes ces populations n'ont pas connu un grand changement dans leur culture jusqu'à nos jours. 0 Dictionnaire Universel, Paris, Hachette Edicef, 2002, p. 991. 0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 29. 49 Les Pygmées-Baka de l'Est Cameroun utilisent les grands arbres dont le moabi pour les rites traditionnels. Parmi ces rites, on cite la danse du `' Jengi'', qui est au coeur de la vie culturelle des Pygmées-Baka. En plus ces populations douées de grands chasseurs utilisent le moabi0. Sur cette photo, nous pouvons observer une petite communauté Baka de Nomedjoh. Photo n°7 : Petite communauté Baka de Nomedjoh.
Source : Deravin, `'projet Coeur de forêt cameroun», 2010, p. 8. Il existe une alliance naturelle et mystique entre le moabi et l'éléphant. Les éléphants consomment les noix de moabi et pour les peuples pygmées, cette interaction apporte une dimension sacrée à l'arbre. Pour ces populations l'esprit Jengi n'apparait qu'à la mort d'un éléphant et guide les chasseurs en forêt sur les traces des gibiers0. A peu près comme les Bantou, toutes leurs oeuvres culturelles leur viennent de la forêt. Et malgré les changements des temps, ces Pygmées pratiquent leurs rites dans la forêt. Alors, la forêt comme nous l'avons souligné reste la source culturelle des peuples riverains. Ainsi, comme dans le passé, les populations bantou et pygmées vivent en symbiose avec les éléments de la forêt. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que la place de la forêt dans l'univers des populations camerounaises est triple, car la forêt en même temps qu'elle procure les biens, rend aussi les services et est aussi le patrimoine culturel. Les rapports qu'avaient les peuples 0 Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010, p. 8. 0 Ibid. p. 10. 50 précoloniaux étaient plus étroits que ceux avec les populations actuelles. Pourtant, les Pygmées sont restés étroitement liés à celle-ci, malgré d'innombrables menaces qu'elle subit actuellement, entrainant ainsi sa dévalorisation. En revenant sur la préoccupation de ce chapitre qui était celle de savoir la place qu'occupe toujours la forêt dans l'univers des populations, il faut dire que celle-ci est un milieu de vie très complet et favorable à la vie humaine. Pourtant, au fil du temps, elle continue à subir une destruction qui la dévalorise de plus en plus. 51 CHAPITRE II : LA DEPRECIATION DE LA FORET ET
DE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53
Sources
|
Qualité de forêts |
OMF 1992- 1993 à partir de données |
Mayaux et al. 1992- 1993 |
Laporte et al. 1992- 1993 |
Superficie forestière historique WRI |
FAO 1980 |
FAO 1990 |
FAO 1995 |
|
Montagnard e et sous |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1767 |
-- |
|
Mangrove |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Autres forêts denses |
17915 |
17378 |
17385 |
-- |
-- |
18499 |
-- |
|
Forêt très sèche |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
86 |
-- |
|
Forêt dégradée |
4879 |
-- |
6477 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Forêt indéterminée |
-- |
-- |
-- |
37400 |
21573 |
-- |
1958 2 |
|
Total |
22794 |
17378 |
23862 |
37400 |
21573 |
20352 |
1958 2 |
|
Total moins forêt sèche |
22794 |
-- |
23862 |
-- |
-- |
20266 |
1958 2 |
Source : Bikié, Collumb, Aperçu de la situation de l'exploitation,2000 , p. 41.
Ces chiffres sont les résultats des estimations de 1992 à 1995. Ils ont permis à Bikié et Collumb dans leur rapport d'estimer l'étendue de forêt restante en 2000. Ce qui montre que les estimations depuis 2000 jusqu'en 2010 aujourd'hui ne peuvent plus être les mêmes. Car depuis cette date jusqu'à ce jour, beaucoup d'hectares de forêts se sont volatisés. Par ailleurs, en termes absolus, les estimations de la déforestation annuelle varient entre 80 000 et 200 000 hectares0. Cet état de déforestation rapide qui a réduit les forêts camerounaises à des petites superficies en peu de temps, nous révélant les estimations chiffrées alarmantes soulignées plus haut n'est pas ex-nilo. C'est le résultat de la conjugaison de plusieurs facteurs.
0 Ibid.
54
Les facteurs de la déforestation sont multiples au Cameroun. Ils sont tous anthropiques contrairement à ceux qui affectent les forêts dans les autres régions du monde (Europe, Asie et Amérique), à savoir les catastrophes naturelles, les causes biotiques. Au Cameroun, il ne serait pas le cas. Ils existent certes, mais avec une force destructrice très minime. Ces causes liées à l'activité humaine, sont subdivisées en causes à vocation agricole et liées à l'exploitation industrielle, les défaillances de l'Etat et ses partenaires et la mauvaise gestion des forêts communautaires et le rôle négatif de certains Camerounais.
L'intensification de l'agriculture et l'exploitation industrielle du bois sont responsables en partie de la déforestation et la dégradation de l'environnement.
L'agriculture qui est définie comme la culture du sol, est une activité très pratiquée dans les pays sous-développés. Le Cameroun faisant partie de cet ensemble d'Etats qui voient ses sols depuis plusieurs décennies remués, car la majeure partie de sa population est paysanne et tributaire de la terre. On l'estime à 80%. Ce sont les forêts qui payent le prix fort, puisqu'elles sont dévastées pour céder la place aux sols nus, fertiles et cultivables. Sur ce point, Hugue pensait que : `'Lhomme ne détruit pas la forêt ou les arbres par plaisir, mais par nécessité''0.
A titre de rappel, il faut souligner que l'agriculture est un legs colonial. Puisque avant cette période, les hommes vivaient du ramassage et de la cueillette. La forêt ne connaissait pas une forte pression, mais l'introduction des nouvelles cultures industrielles par les occidentaux, l'instauration du système des impôts et le développement des cultures urbaines sont autant de facteurs qui ont développé l'agriculture au Cameroun0. La triple colonisation qu'a connue le Cameroun a donc été responsable de l'introduction de l'agriculture industrielle dans le pays.
Ce développement de l'agriculture s'est fait d'abord pendant la période allemande. Le Cameroun étant une colonie d'exploitation, avait vu se développer l'agro-industrie dans son territoire. Au départ, l'administration coloniale allemande cède des dizaines de millions d'hectares de forêts aux sociétés agro-industrielles et forestières européennes0. Ainsi, en 1896, une concession de 7 200 000 hectares est obtenue par la Gesellschaft Süd-Kamerun, puis la
0 Elong, `'L'impact d'une exploitation forestière'', 1984, p. 274. 0Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle'', 1985, p. 254.
0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels'', 2008, pp. 12-13.
55
Gesellschaft Nord-West-Kamerun obtient 4 450 000 hectares. Ces deux concessions occupent un cinquième de la colonie. Dans ces concessions, elles exploitent le caoutchouc, naturel, les fruits de palmier à huile, l'ivoire, les minéraux et les bois précieux0. N'ayant pas donné des résultats escomptés, l'Etat se tourne alors vers le système de grandes plantations. Il opte pour la monoculture. Ainsi dont, les plantations de caoutchouc, de cacao et d'hévéa sont créées entre 1885 et 1906. Pour y parvenir, il fallait dévaster des grandes étendues de forêt dans les régions du Sud-ouest, du Littoral, particulièrement dans la vallée inférieure de la Sanaga (Dizangué), et le Mungo0. Ces produits étaient destinés à la métropole0. Ceci a fait subir à la forêt camerounaise ses premières grandes pertes.
Après les Allemands, les Français et les Anglais ont hérité de ces immenses plantations pendant les périodes de mandat et de tutelle. Et aujourd'hui ces plantations coloniales sont regroupées au sein de la Cameroon Development Corporation(CDC)0.
L'installation d'une agro-industrie exige : le rasage systématique des grandes étendues de forêts, et que la superficie défrichée soit supérieure à celle effectivement cultivée. En plus, les agro-industrielles coloniales pratiquaient la monoculture0. A travers cette action agricole coloniale, le Cameroun devenait ainsi un pays à vocation agricole.
Après l'indépendance de la partie sous tutelle française en 1960, l'agro-industrielle n'a fait que se développer. C'est dans ce contexte que très vite naissent des nouvelles sociétés agro-industrielles, à savoir la Société Camerounaise de Palmerais (SOCAPALM) initiée en 1963 par le programme gouvernemental et la Société d'Hévéa du Cameroun (HEVECAM) fondée en 1975. Ces nouvelles industries agricoles ont continué à déboiser les énormes terres pour leurs cultures. A titre illustratif, la création d'HEVECAM conditionnait l'abatage de 2250 hectares de forêt pour la surface à cultiver, par ailleurs, 1750 hectares ont été défrichés pour les bordures de routes pour la société d'hévéa. Ainsi comme nous le constatons, 5000 hectares de forêts ont été détruits pour cultiver sur seulement 2250 hectares, preuve que les agroindustriels sont des grands destructeurs des forêts0.
La culture du tabac ne nécessite pas l'usage des engrais. Ainsi, chaque année il faut des nouvelles terres pour sa culture. Les anciennes sont délaissées aux femmes qui en font
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, P. 258.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Ibid.
56
leur usage0. C'est ainsi qu'on estimait en 1977 à 98 000 hectares la superficie occupée par les seules agro-industries dans les forêts camerounaises0. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puisque ces deux agro-industrielles ont fait des extensions ces dernières années. On peut apprendre par Gerber que la SOCAPALM de Kienki et ses autres plantations ont une superficie de 31 000, alors qu'HEVECAM possède une vaste étendue de 41 339 hectares de forêt0. Soient des augmentations respectivement de plus de 30 000 pour SOCAPALPM et de 36 339 pour HEVECAM. Ce qui a normalement changé les anciennes données chiffrées sur l'estimation des surfaces dévastées de forêt pour l'agriculture. Si on s'amuse à faire des calculs, avec les superficies actuelles des deux géants de l'agro-industriel, sachant que dans les années passées, elles deux occupaient à peine une superficie de 6000 hectares de forêt. En soustrayant ce nombre des 61 339 d'hectares des deux entreprises, on se retrouve avec 55 339 hectares. Ajoutant donc aux 98 000 hectares, on se retrouve avec 153 339 hectares qu'occupent seulement ces deux entreprises.
Ce chiffre représente seulement ce qu'occupaient et occupent les agro-industries sans tenir compte des plantations paysannes. Pourtant, il est connu de tous que beaucoup de cultures tant vivrières que de rente avaient été mises à la disposition des populations paysannes. C'étaient les cultures du cacao, du café, du coton, de l'ananas, des arachides, de la banane plantain, du manioc, etc.
C'est avec ces cultures que la majorité des populations paysannes au Cameroun s'étaient lancées dans l'agriculture pour subvenir à leurs besoins alimentaires et pécuniaires. Alors, au lendemain de l'indépendance, on a assisté au Cameroun au développement des cultures de rente. Dans les régions de l'Ouest, la culture du café était préférée, au Centre-Sud et Est c'était le cacao, au Littoral les deux et au Nord, le coton fut introduit.
En effet, la culture de ces produits exigeait la conversion définitive des étendues de terre. Sur ce point, François Tatala affirmait que `'la culture du cacao passe par la récupération des terres abandonnées par les femmes après leur récolte''0.
A côté de ces cultures citées haut, s'est ajoutée la culture du palmier à huile par les paysans dans les régions de l'Ouest et du littoral. Avec une pression démographique très accentuée, conjuguée de la domination de l'activité agricole comme activité économique, la
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Gerber, `'Resistance contre deux géants industriels'', 2008, p. 20.
0 Entretien avec François Tatala, 52 ans environ, planteur de cacao, Ngouonepoum nouveau, 06 novembre 2010
57
forêt paye un prix fort. Car, `'la pression agricole est fille de la pression démographique'' comme affirmait Kelodjoué0. Cette population qui était de 8, 6 millions est passée en 1998 à 14,3 millions. Elle est essentiellement agricole. En 1994, cette population agricole était estimée à 74% de la population totale, de nos jours, elle s'évalue à 88,5%0. Ces chiffres qui croient rapidement nous renseignent sur la pression qu'une population de cette envergure peut faire subir aux forêts du pays. Surtout, depuis que les réserves pétrolières se sont épuisées, les forêts sont devenues comme `'des vaches laitières à traire''0.
Toujours sur ce plan, l'agriculture itinérante est très consommatrice de forêt. Elle qui consiste à défricher et brûler des nouvelles forêts chaque année est à l'origine en majorité à la destruction des forêts. A cause de la pauvreté des sols, chaque année des nouvelles terres sont exploitées pour assurer une bonne récolte. Sydonie Tapio disait par exemple sur ce sujet que `'la culture de l'arachide avait besoin des sols vierges pour espérer une récolte signifiante et la parcelle défrichée doit être brulée pour que la cendre issue de cette carbonisation fertilise le sol''0.
Il faut souligner que de nombreuses primes accordées par le gouvernement aux agriculteurs dans les années 1970 et l'augmentation soutenue des prix des différents produits agricoles étaient autant de facteurs qui avaient accéléré l'extension de l'agriculture0. Ces différentes motivations avaient encouragé l'agriculteur camerounais à créer de plus en plus des grandes plantations afin de se faire de l'argent. Et par conséquent les terres étaient déboisées chaque année à un rythme très fulgurant. Ce qui a emmené la majorité des experts à s'accorder par le fait que l'agriculture est la principale cause de la déforestation.
Ainsi, une étude de la FAO, PNUD et SODECAO sur la surface défrichée pour l'agriculture en 1972 estime à 80 000 hectares de forêts qui sont détruites chaque année, sous toutes les différentes formes que nous venons de décrire et sans tenir compte de la zone forestière de l'Ouest0. En tenant compte de la croissance démographique rapide au Cameroun, on peut dire qu'en cette année 2010, ce chiffre a dû évoluer. Car en 1972, avec une population de moins de 8,6 millions d'habitants, l'impact de l'agriculture était important
0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle'', 1985, p. 254.
0 P. T. Mbous, `'l'exploitation forestière et le développement des forêts communautaires au Cameroun. Une
action collective pour la protection e la biodiversité'', mémoire en vue d'obtention du diplôme d'étude
approfondie, Institut universitaire d'étude de développement, Université de Génève, 2002/2003, p. 5.
0 M. Ghattas et L. Doumia, `'biodiversité africaine'', p. 48.
0 Sydonie Tapio, 50 ans environ, cultivatrice, Madjoué, 24 octobre 2010
0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle'', 1985, p. 255.
0 Ibid. p. 266.
58
dans l'environnement. Avec l'augmentation de cette population qui est passée à 19 millions d'habitants aujourd'hui, il est certain que celui-ci a aussi augmenté.
Ce que nous venons d'examiner sur le rôle que joue l'agriculture sur des forêts permet de penser que l'agriculture est et reste la plus grande menace pour les forêts camerounaises. Car l'agriculture de subsistance est à 63% responsable du déboisement, alors que l'agriculture permanente l'est à 17%. C'est dans ce sens que S. Kelodjoué affirmait dans son étude que `'l'agriculture est sans doute le principal ennemis de la forêt dense camerounaise''0. Pourtant, elle n'est pas le seul facteur.
Les industries du secteur bois ont aussi une grande partie de responsabilité dans la déforestation au Cameroun. Beaucoup d'études indiquent que l'exploitation forestière afflige d'énormes dégâts aux forêts. L'exploitation forestière qui serait une ancienne activité économique comme l'agriculture, affectait dangereusement les forêts du pays dès leurs premières heures. Elle est dévastatrice depuis l'implantation de la société d'exploitation des essences forestières.
L'installation d'une société forestière dans une forêt d'exploitation exige l'aménagement d'un site destiné à l'habitat, d'une scierie si c'est une société de pointe, et plusieurs parcs à bois. Ces nombreux espaces exigent de la réquisition de plusieurs hectares de forêts vierges.
Le site d'habitat est l'endroit où sont implantés le ou les différents camps où doivent habiter les ouvriers et les cadres.
Dans son étude sur `'les techniques d'exploitation à faible impact en forêt dense humide camerounaise'', Luc Durrieu de Madron pose le problème de l'impact environnemental de l'implantation du site ou ce qu'il appelle campement d'une société dans une forêt. Il s'appuie sur l'implantation de la base de la société forestière et industrielle de Dimako (SFID) dans la forêt de Dimako. Il dit dont que pour cette implantation, il a fallu raser 117 hectares pour le campement et le site industriel. Le projet API au Cameroun concernant les implantations des sociétés partenaires de la SFID sont du même ordre0.
0 Ibid.
0 L. D. De Madron, E. Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible impact en forêt dense humide camerounaise, Campus international de Baillargnet, 1998, p. 4.
59
A la SFID de Mbang, 25 hectares de forêt ont été détruits pour l'exploitation d'un massif de 60 000 hectares. Au Cameroun, Lumet cite un chiffre de 0,03 à 0,1% du couvert forestier défriché pour la base vie0. Par exemple, voilà une minime partie du site d'habitat des ouvriers de la société SFIL de Deng.
Photo n°9 : Le site d'habitat des ouvriers de la SFIL

Source : Photo prise par Marcel Songo, le 21 janvier 2007.
La grandeur de ce genre de camp varie selon l'importance de la société. Autant une société est grande, autant elle a un ou plusieurs sites plus grands que celui-ci.
Par ailleurs, le site d'une scierie est l'endroit où se trouvent les machines qui servent au sciage du bois et parfois les structures bureautiques0. Comme le site d'habitat, son importance dépend aussi de la grandeur de l'entreprise. La photo suivante illustre mieux cet endroit.
0 Ibid.
0 De Madron, Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible, 1998, p. 5.
60
Photo n°10 : La Scierie de la SFIL de Deng

Source : Photo prise par Marcel Songo le 21 janvier 2007
Contrairement à l'espace réservé pour l'habitat, l'endroit où est installée la scierie n'est pas souvent aussi grand en tant que tel. Il est constitué d'un grand hangar à l'intérieur du quel se trouvent plusieurs machines servant à scier le bois0. Ce même hangar sert souvent de dépôt du bois scié. Et dans les alentours, on trouve les bâtiments de bureaux.
0 Ibid.
61
Les parcs à bois sont des espaces rasés à l'intérieur des forêts qui servent à parquer le bois rond. Il existe les parcs destinés au chargement des grumiers et les parcs à bois destinés à la scierie. Une seule société peut avoir plusieurs parcs. La création de ceux-ci entraine toujours le déboisement d'un espace où les billes sont toujours stockées avant leur transport0. Ils auraient une superficie moyenne de 1000 m3. Selon une étude menée en forêt semi-décidue du Sud-Est du Cameroun, ces parcs représentent 0,3% de la surface exploitée0.
Lumet pense qu'au Cameroun, 2,5 à 5 m2 de parcs par m3 de bois exploité, soit en moyenne 30 hectares pour un chantier produisant 100 000 m3 de bois0. Quant à Steve, il cite le chiffre 2000 m2 de surface pour 100 hectares exploités pour les parcs principaux destinés au chargement des grumiers0. Ces espaces sont les plus grandes clairières créées par la société en pleine forêt. Pourtant à côté d'elles, il y a les routes, et les pistes de débardage.
Les routes sont des embranchements qui relient les parcs à la scierie et la société elle-même à la route publique. Dans la forêt d'exploitation, la société utilise souvent des centaines de kilomètres de routes pour relier ses différents sites. Par exemple lors de notre entretien avec Bernard Ndoumba, celui-ci nous confiait qu'en ce qui concerne la Transformation Tropicale du Sud (TTS), `'le tronçon qui relie le premier village des riverains le plus proche à la société est de 15 kilomètres, celui partant du camp des travailleurs à la scierie mesure 7 kilomètres et la dernière qui part de la scierie à la forêt s'étend sur 22 kilomètres''0.
Dans les études menées toujours par le projet API en forêt semi-décidue passant en deuxième ou troisième exploitation, riche en bois blanc, la largeur moyenne des pistes principales est de 16,7 mètres, la largeur en moyenne des pistes secondaires est de 8 mètres, 1,7% de la surface est occupée par les pistes principales d'après une étude de Mbolo en 19940.
Alors les routes principales et secondaires représentent en général 1 à 2% de surface perturbée. Il faut entre 5 et 10 mètres de route par hectare. Dans ce sens, Laurent et Maître en 1992 déclarent une largeur de 30 à 45 mètres défrichée0. L'image suivante présente un tronçon de cette route.
0 Ibid. p. 6.
0 Ibid. p. 9.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Entretien avec Bernard Ndoumba, 35 ans environs, opérateur radio à TTS, Masséa, 06 novembre 2010.
0 De Madron, Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible, 1998, p. 5.
0 Ibid.
62
Photo n° 11: Le tronçon de route reliant la scierie de TTS à la route publique (22 km)

Source : Photo prise par Marcel Songo le 18 janvier 2010.
La forêt est parsemée des tronçons de route de ce genre qui jouent un grand rôle dans le déboisemen. Kelodjoué affirme que l'ouverture d'une route nécessite le déboisement le long de celle-ci de deux bandes de forêt larges d'environ 50 mètres de part et d'autre de la route. Ainsi, la création d'un kilomètre de route forestière entraine le déboisement de 10 hectares de forêt0. L'auteur indique que cette estimation est celle de la route de Ngona-Ngossé construite par la SABM dont il a personnellement été témoin0. Un autre exemple vient des études menées par le projet API (Aménagement pilote intégré) de Dimako en forêt semi-
0 Kelodjoué, `'l'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, p. 268. 0 Ibid.
63
décidue passant en deuxième exploitation, riche en bois blanc (exploitation de 0,77% d'arbres à l'hectare soit 10,8m3/hectare), la largeur moyenne des pistes secondaires est de 8 mètres, 1,7% de la surface est occupée par les pistes principales. En forêt dense sempervirente et semi-décidue, pour une première exploitation ayant prélevé 0,35 arbres par hectare, on observe que 1,3% de la surface est occupé par les pistes0.
Les pistes de débardages sont les ouvertures à l'intérieur de l'assiette de coupe qui servent à évacuer la bille abattue par les ouvriers. L'aménagement des routes (layons, piste de débardage, routes qui relient les parcs aux scieries) est responsable à 2% de la destruction de la forêt0. Dans les études menées par le même projet API, 0,5 et 1 tige à l'hectare (5 à 15 m3/ha), 3% de la surface au sol est couvert par les pistes de débardage, soit la moitié des dégâts causés par l'exploitation0.
Hormis l'installation de la société, d'autres actes de la société pendant l'exploitation contribuent aussi à la déforestation. Au nombre de ceux-ci, l'on peut citer l'exploitation anarchique des essences, le gaspillage du bois abattu.
L'exploitation anarchique est l'expression qui désigne l'abattage des bois en marge de la réglementation. Elle peut se faire dans les limites d'exploitation ou hors de cette zone. Pour mieux comprendre le terme limite, il faut d'abord le définir dans son contexte.
Ainsi, Roger Tene parle de limite spatiale et limite temporelle. Les limites spatiales sont les espaces prévus pour l'exploitation, clairement définis pendant l'octroi du titre d'exploitation. Quant à la limite temporelle, elle est le nombre d'années de validité du titre d'exploitation0.
Dans l'exploitation anarchique à l'intérieur des limites, il s'agit des fraudes à l'intérieur de la zone cédée pour l'abattage des bois et dans les délais prévus dans le contrat d'exploitation. Elles sont quantitatives et qualitative. Pour ce qui est des fraudes au niveau de la quantité et la qualité de bois à exploiter, certaines entreprises abattent les bois au-delà des nombres et les espèces exigés. Pourtant, dans les années 1970, le nombre d'essences à abattre était précisé dans le permis. On avait par exemple le permis ordinaire et le permis spécial. Le permis ordinaire était délivré pour l'exploitation de 10 essences au maximum0.
0 Ibid.
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 17.
0 De Madron, Forni et al, Les techniques d'exploitation à faible, 1996, p. 9.
0 Tene, `' aspect juridique de la gestion», 1978, p. 72.
0 Ibid. p.73.
64
Cette fraude n'a pas disparu dans le secteur forestier, car de nos jours, certaines sociétés continuent d'utiliser ces méthodes destructrices de la forêt. L'exemple nous vient du Sud-Ouest du pays où les Malaisiens font une exploitation intensive et anarchique0. Ainsi, d'après le guide de Ben N'diaye : `'Les Malaisiens travaillent 24/24 heures, sans se fatiguer. Ils coupaient tout, même les petits arbres»0. Le cas de la SABM est identique, car selon Ekomi Amoka, cette société abattait dans la décennie 1980 les arbres qui ont un sous diamètre d'abattage0.
Cette fraude est très pratiquée par les sociétés. Pour ce faire, celles-ci surestiment pendant l'inventaire le nombre d'essences présentes à l'intérieur de l'UFA 0. C'est le cas des sociétés Malaisiennes dans le Sud-ouest. Une autre fraude de même nature est l'entrée du bois destinés au sciage à l'intérieur de l'usine sans subir de contrôle. Amoka rapporte que c'étaient les jours fériés, aux heures de repos ou les jours de dimanche quand le garde forestier était absent, que les camions de la société choisissaient d'entrer avec le bois dans l'usine0.
L'exploitation abusive hors des limites est celle qui va au delà de la zone d'exploitation. Cette pratique est prisée par les exploitants de bois. A titre illustratif, la Camerounaise du bois (CAMBOIS) exploitant à Campo a étendu ses activités hors des limites de son assiette de coupe plusieurs fois0. Il s'agit là des fraudes en dehors de limites spatiales. Le tableau suivant apporte des informations intéressantes sur des infractions en dehors et à l'intérieur des limites de concession.
Tableau n°5 : Nombre d'infractions relatives à l'exploitation illégale du bois dans les provinces de l'Est et du Centre du Cameroun entre 1995 et 1998
|
Type d'infractions |
Province de l'Est |
Province du Centre |
|
En dehors des limites de concession |
9 infractions |
34 infractions |
|
A l'intérieur des limites de concession 24 infractions 24 infractions |
||
|
Total |
33 |
58 |
Source : Bikié, Collomb. Et al (eds), Aperçu de la situation de l'exploitation, 2000, p. 46.
0 B. N'diaye, `'Le mirage asiatique», le magazine de l'écologie et du développement durable, `'filière bois à
l'aube d'un grand sinistre écologique ?», n° 17, octobre-décembre 1998, p. 5.
0 Ibid.
0 Ekomi Amoka , `' Exploitation et production du bois », 2004, p. 95.
0 Ibid. p. 73.
0 Ibid.
0Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt : exploitation, 2002, p. 27.
En ce qui concerne les infractions hors des limites temporelles, il semble qu'entre 1997 et 1998, certaines licences étaient exploitées hors délais0.
Le constat est clair, l'exploitation illégale est une pratique exercée par la majorité des exploitants forestiers. A côté d'elle, on rencontre le gaspillage du bois. Cette pratique s'observe à travers l'abandon des billes de bois et l'importance des rebuts lors du sciage par les sociétés. Ce gaspillage cause préjudice à la survie de la forêt au Cameroun.
Dans les activités forestières, certaines sociétés abandonnent des billes pour plusieurs raisons. Ceci arrive souvent dès qu'elles constatent que le tronc est en partie pourri, d'autres abandonnent les troncs qui tombent dans les terrains accidentés et pour beaucoup plus pour des raisons qu'on ignore.
Samuel Wafo nous fait constater dans ce sens que toutes les sociétés concernées par l'exploitation forestière dans le Sud ne transportent pas la totalité du bois abattu. Il insiste en présentant un cas d'espèce. Ainsi, il dit que dans le département de la Mvilla, la SOFAC a abattu en 1997 5970,556 m3 et n'a transporté que 373,267 m30. Voici ce que Samuel Essono nous présente sur cet aspect des choses. Il illustre par les images les billes de bois abandonnés par la SFID de Mbang lors de l'exploitation. Cette pratique s'accompagne de rebuts importants de bois.
Photo n° 12: Les billes de bois abandonnées dans la concession de la SFID de Mbang

65
Sourc e : E. M. S. Essono, `'Etat des rebuts d'exploitation et de transformation du bois de la SFID de Mbang : enjeux économiques et impacts sur le processus de certification», mémoire de DEES en sciences forestières, Université de Yaoundé I, 2011, p. 27.
0 Ibid. p. 54.
0 S. Wafo, `'La clairière au détour du sentier», le magazine de l'écologie et du développement durable, n° 17, octobre-décembre 1998, p. 5.
L'importance des rebuts pendant le sciage reste une très grande perte dans l'exploitation durable des forêts. Pourtant plusieurs sociétés au Cameroun sont championnes dans cette pratique pour des raisons capitalistes qui ne riment pas avec le développement durable. La photo ci-après tirée du le travail de Samuel Essono est assez illustrative. Elle présente un tas de rebuts de bois de sciage de la même société.
Photo n° 13 : Tas de rebuts provenant du sciage de la SFID de Mbang

Source : Essono, `'Etat des rebuts d'exploitation», 2011, p. 27.
A travers cette image, nous pouvons comprendre l'importance des rebuts de bois de la SFID et rapprocher cela avec le cas des autres sociétés. Quand on se penche sur le cas de la SFID, on se rend compte que les pertes sont énormes. Ce que le tableau suivant nous révèle.
Tableau n°6 : Evaluation des rebuts de transformation de la SFID entre 2007 et 2009
66
Années 2007 2008 2009
67
Volumes grumes
|
133 060 m3 |
135 889 m3 |
1250249 m3 |
|
|
Volumes débités |
43 057 m3 |
40 660 m3 |
37 168 m3 |
|
Volumes rebuts |
90 003 m3 |
95 229 m3 |
88 082 m3 |
|
Rendement matière |
32,24% |
29,92% |
29,68% |
Source : Essono, `' Etat des rebuts d'exploitation'', 2011, p. 27.
Nous constatons donc qu'à travers l'abandon des billes et le prélèvement d'une infime partie du bois pendant le sciage, les sociétés forestières gaspillent assez de produits ligneux qui peuvent profiter aux autres fins. Alors quand on ajoute à ce dégât celui causé par l'implantation de la société, on se rend compte que les industries forestières sont en partie à l'origine de la déforestation. Ces mêmes sociétés portent la responsabilité de la déforestation issue des activités agricoles des villageois ou des ouvriers en bordure des routes forestières. A cette responsabilité des sociétés forestières dans la déforestation s'ajoute celle de l'Etat et de ses partenaires.
La situation de la déforestation serait en partie la responsabilité des autorités camerounaises. Plusieurs éléments semblent confirmer cette hypothèse. Il s'agit de la corruption au sein du ministère chargé des forêts, la complaisance des autorités, la carence en logistique et personnel, et l'absence des contrôles et de surveillances.
La corruption est un véritable casse-tête dans les efforts du gouvernement de rendre le secteur forestier transparent et bénéfique. Pour des raisons liées à la pauvreté, d'une prise en charge insuffisante par l'Etat, les agents du ministère en charge des forêts se laissent corrompre sur le terrain. `'Que peut-on faire avec un salaire minable de 40 000 francs CFA, quand on travaille dans les conditions difficiles. En plus la tentation de prendre les pots de vins est facile, puisque le secteur des forêts est fructueux, et que nous avons des familles nombreuses à nourrir''0. Cette position de cet agent d'Etat montre le malaise qu'il y a chez les gardes forestiers pour ce qui concerne leurs conditions de vie.
Et cette posture du personnel du ministère en charge des forêts est en partie à l'origine des pratiques forestières illégales telles que les coupes illégales, les fausses déclarations
0 Entretien avec Ladoum Mbiabot, 36 ans environs, agent technique des eaux et forêts, Ngatto, 13 Août 2011
68
comme le souligne Filip Verbelen0. Ce qui est corroboré par une autre source qui mentionne que pendant les appels d'offres de 2000, la société Thanry a été attributaire de 230 000 hectares de forêt, ajoutant ainsi à ses anciennes concessions, elle se retrouvait désormais avec 850 000 hectares, quatre fois le maximum légal0. Dans le cas de Thanry, l'illégalité était flagrante, car la loi de 1994 était claire dans son article 49(2) : `'Toute prise de participation majoritaire ou création d'une société d'exploitation par un exploitant forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue par lui au-delà de 200 000 hectares est interdite''0. Cette attribution de nouvelles concessions dans l'illégalité avait été facilitée par un certain Baloulo, député de la Boumba et Ngoko. Ce service était conséquent aux 4000 FCFA par m3 de bois que percevait l'intéressé depuis 1998 de la CFC. Car il siégeait à la commission interministérielle d'attribution0.
Ce cas n'est pas isolé, puisque la même année, le ministre en charge des forêts recevait un don de deux véhicules 4x4 flambants neufs d'un certain Pascal Khoury. Un don que Labrousse et Verschaves pensent qu'il serait en échange des faveurs du MINEF vis-à-vis de la société pascal Khoury sciage transport forêt (BK-STF)0. Ce qui semble être vrai, car celui-ci venait à point nommé. En septembre 2000, un appel d'offres avait été lancé pour l'exploitation de la réserve de So'o Lala. La société de Khoury était soumissionnaire0. En plus quatre jours avant la remise de ce don, les agents du MINEF (brigade du Sud) avaient dressé un procès verbal contre PK-STF pour « prise de participation sans accord préalable de l'administration forestière » et « exploitation forestière au- delà des limites de son permis». Le 3 janvier, la dite société malgré ses antécédents est déclarée attributaire de So'o Lala0.
Ces deux cas de corruption sont une goutte d'eau dans l'océan si on tient compte de tous les actes de ce genre commis par les agents et les responsables du MINEF devenu MINFOF. Ce fléau est un grand obstacle à l'application rigoureuse des lois forestières garant de la lutte contre la déforestation. Il revient à l'Etat de rendre saine la gestion des affaires de ce ministère, c'est pourquoi la responsabilité lui est incombée. Ce qui pourrait empêcher d'autres tares qu'on lui reproche.
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts'', 1999, p. 52. 0
0 Ossama, le cadre juridique des forêts, 2007, p. 10.
0Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 65. 0 Ibid. p. 90.
0 Ibid. 0 Ibid.
69
Plusieurs observateurs Camerounais (journalistes, consultants, philosophe polytechnicien, économistes, historien, enseignant d'université) remarquent qu'il y a beaucoup de complaisance du ministère dans la gestion des affaires forestières. Cela s'observe à travers l'attribution de licences et des concessions aux personnes sans compétence ni moyens matériels et financiers. Il s'agit des opérateurs des filières bois qualifiés de nationaux à qui on attribue des concessions forestières à tort et à travers. Sur ce sujet, Samuel Wafo disait qu' `'Il suffit d'être originaire d'une région de la forêt, ministre ou ancien ministre, haut fonctionnaire en retraite ou non, député du parti au pouvoir, frère ou ami du prince''0. Les exemples sont nombreux. On peut citer entre autres les cas du Général Asso, propriétaire de l'UFA n°10-029 dans le Sud, de l'Ex-Secrétaire d'Etat à la gendarmerie Jean Marie Aléokol, propritaire de l'UFA 10-041 dans la région de Lomié0. Cette pratique s'est développée depuis la levée de l'interdiction de la sous-traitance jadis interdite. Ce qui a entrainé l'intérêt de nombreux Camerounais qui trouvent en elle une source d'enrichissement.
Ce phénomène nuit à l'exploitation durable des forêts, car les nationaux sans capacité savent que la sous-traitance, jadis interdite, est aujourd'hui permise. Ainsi, telle compagnie forestière peut racheter ou louer la licence de telle autre0. CAMBOIS par exemple utilisait la licence de Medou Djemba, TTS utilisait la licence de la SFCS de M Botiba, Pallisco celle de Assene Nkou0. Ce système d'affermage a de lourdes conséquences sur la forêt. Car la loi forestière n'est pas rigoureuse envers les nationaux et cela profite à leurs partenaires qui peuvent abusivement exploiter la forêt.
Certains partenaires comme TTS qui, par ce canal, explosent dans l'exploitation anarchique de l'UFA n° 10-023 comme nous révélait le virgile de la société propriétaire de la concession0. A ce cas, on peut ajouter celui de la Cameroon Timber Company (CTC), une exploitation forestière basée à Kokum, à une quarantaine de kilomètres de Kumba. `'Elle appartient officiellement à M. N., détenteur d'une licence sur une concession de 22 000 hectares délivrée en 19800. C'est un certain Aloysius Ejagham, le maître des lieux, qui est en
0 Wafo, `'La clairière au détour du sentier'', 1998, p. 5.
0 `'Audit économique et financier '', MINEFI, sept 2006, p. 34.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Pendant cet entretien le 6 novembre 2010, ledit virgile nous confiait que TTS ne pratique pas l'aménagement,
ne paie pas bien et à temps ses ouvriers, ne paie pas bien les taxes, bref cette société ne respecte aucune des
dispositions de la loi forestière. Pour cause, elle dit que la forêt ne lui appartient pas. Alors si l'Etat la
sanctionne, c'est le concessionnaire qui va payer les peaux cassées.
0 N'diaye, `'Le mirage asiatique'', 1998, p. 5.
70
fait un sous-traitant qui, à son tour, est partenaire des Malaisiens''0. Ce foisonnement d'opérateurs accordé par l'Etat limite les contrôles. Le tableau du circuit des opérateurs forestiers proposé à l'annexe II est plus illustratif de ce phénomène0. La preuve est l'exploitation abusive que ces Malaisiens font subir aux forêts de cette localité. Et ils évacuent les produits par le port de Limbé pour continuer à se déjouer de la vigilance des autorités0. Face à cette situation, on peut penser que les nationaux sont complices de cette situation. Chaque fois que l'on croit avoir repéré un forestier Camerounais libre de tout patronage exotique, surgit de derrière l'arbre un blanc, tout sourire, avec sa valise0.
A tout ce qui a été cité, s'ajoutent les moyens logistiques et humains insuffisants que l'Etat met à la disposition de son personnel. Sur ce point voici un tableau révélateur.
Tableau n°7 : Résume des capacités logistiques et humaines de la direction des forêts en 1970
|
Provinces |
Est |
Sud |
Centre |
Littoral |
Sud-ouest |
|
Nombre d'agents |
116 |
115 |
232 |
167 |
163 |
|
Nombre de véhicules 4x4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Nombre de moto |
4 |
4 |
10 |
4 |
6 |
|
Superficie de concession par agent |
20859 |
6608 |
2762 |
306 |
31 |
Source : Bikié, Collumb, Aperçu de la situation de l'exploitation, 2000, p. 29.
En nous appuyant sur les chiffres qui sont dans ce tableau, nous pouvons dire que les moyens logistiques et humains dont disposait la direction des forêts en 1970 étaient minimes, vus les défis auxquels elle faisait face. Si on se base sur le nombre d'agents, de motos et de véhicules dont disposaient les deux régions où se trouve le plus grand nombre de concessions en activité (Est et Sud), on se rend compte qu'ils ne permettaient pas l'atteinte des objectifs qui étaient de lutter contre l'exploitation illégale et anarchique des forêts. Cette situation a évolué dans les années 1990 avec la dotation desdites régions en motos, véhicules supplémentaires et par la formation et l'affectation d'un nombre important de nouveaux agents. Mais Ces moyens ne sont pas toujours proportionnels aux résultats escomptés. Ce qui
0 Ibid.
0 Confère Annexe II page 143.
0 Ibid.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt , 2002, p. 79.
71
pose toujours le problème d'insuffisance logistique et humain. Cette situation entraine directement l'absence de contrôles et de surveillance.
L'absence de contrôles et de surveillance comme nous l'avons présentée en haut est la conséquence en partie des moyens logistiques et humains insuffisants. A cet effet, les agents sans moyens de déplacement exercent difficilement leur fonction sur le terrain. Ainsi, on se retrouve avec plusieurs cas de pratiques illégales dans les forêts dont les auteurs sont les sociétés profitant de la circonstance. C'est la situation que dénonce Samuel Wafo, lorsqu'il affirme que dans le département de l'Océan, les contrôles sont inexistants0. Conséquence, un puissant forestier échappe quasiment au paiement des taxes et des frais portuaires en balançant les billes de bois directement dans la partie mer qui mouille l'embouchure de Campo0. Ce problème se pose presque partout sur l'étendue du territoire. Et elle permet aux opérateurs de piller les forêts du pays sans être inquiétés. Ce facteur semble être le plus important dans la destruction des écosystèmes forestiers. Il y en a cependant d'autres telles que la mauvaise gestion.
Les problèmes de déforestation et de dégradation de l'environnement sont dus à la mauvaise gestion des forêts communautaires et le mauvais rôle de certains Camerounais.
La forêt communautaire est considérée comme l'ensemble des processus dynamiques de responsabilisation des communautés rurales dans la gestion des ressources forestières, pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et promouvoir le développement local0.
La mauvaise gestion des forêts communautaires entraine d'énormes dégâts dans les forêts camerounaises. Leur responsabilité est à deux dimensions. La première est l'ensemble des coupes illégales effectuées dans l'exploitation des bois dans ces forêts et la deuxième est du au fait de l'usage frauduleux des avantages de ces forêts par les autres opérateurs.
0 Wafo, `'La clairière au détour du sentier», 1998, p. 6.
0 Ibid.
0P. Bigombe Logo, `'Foresterie communautaire et réduction de la pauvreté rurale au Cameroun :Bilan et tendances de la première décennie», http://www.wrm.org.uy/index.html, consulté le 12 décembre 2011.
72
Les forêts communautaires sont parfois responsables des coupes illégales de bois. Il y a coupe illégale du bois dans les forêts communautaires lorsque l'exploitation ne respecte ni les limites ni les volumes de bois0. Ce non respect des limites est du au choix des arbres à exploiter qui est lié à la commande du partenaire, à la proximité des arbres et par apport à la piste existante, et l'accessibilité à la zone concernée.
Quant au non respect des volumes, il s'explique toujours par l'exigence des clients qui veulent des espèces précis. Associées à la tendance à l'acrémage, ces pratiques mettent la pression sur des forêts0.
L'usage frauduleux par certains opérateurs des produits et des papiers officiels appartenant aux forêts communautaires, s'explique du fait de l'exemption sur certaines taxes (paiement des redevances forestières, taxe à l'abattage) dont bénéficient les forêts communautaires. Ainsi, On apprend par cet audit que certaines sociétés se sont spécialisées dans l'achat des bois issus des forêts communautaires0. Par ailleurs, le rapport trimestriel n°5 de juillet 2006 de l'observatoire indépendant (O. I.) indique que plusieurs sociétés utiliseraient des lettres de voiture0 des forêts communautaires. Ceci les permet de transporter du bois coupés illégalement, de blanchir du bois coupés au-delà des quantités autorisées et d'échapper à la fiscalité0.
L'activité forestière tant bien que dominée par les étrangers au Cameroun, connait une forte implication des nationaux. Ceux-ci seraient dans la majorité des hommes du sérail ou proches du sérail0. Par manque de moyens pourtant propriétaires des concessions, certains signent des partenariats forestiers néfastes avec des sociétés étrangères, d'autres jouent simplement le rôle d'écran pour certaines entreprises contribuant à cet effet à la destruction de leur propre forêt.
0 `'Audit économique et financier», MINEFI, 2006, p. 94.
0 Ibid.
0 Ibid. p. 90.
0 Une lettre de voiture est un document que l'administration des forêts délivre contre un paiement à tous les transporteurs des produits forestiers (grumes, débités, bois de sciages, charbon de bois, gnetum africana) au début de chaque année. Ce certificat définit la nature et la quantité du produit transporté. Ici, il s'agit du transport des grumes et du bois de sciages des forêts communautaires. Ministère de l'économie et des finances, `'l'Audit économique et financier», sept 2006, p. 35
0 `'Audi économique et financier», MINEFI, 2006, pp. 35-36.
0Ibid.
73
Beaucoup de cadres d'Etat et d'homme d'affaires camerounais dans le but de s'enrichir très vite malgré leur inaptitude dans la profession forestière due à leur manque de moyens financiers et techniques se sont lancés dans l'activité forestière0.
Certains de ces hommes sont en partenariat avec les sociétés étrangères. C'est-à-dire, ils ont les forêts mais ce sont les sociétés étrangères qui exploitent ces forêts. Il y a plusieurs risques d'exploitation illégale ici. L'exemple de ce cas d'étude nous vient de l'UFA 10-023 de la société forestière de commerce et de services (SFCS) de Mne Batibo, exploitée par son partenaire TTS0. D'après notre informateur Abdoulaye, `'depuis 2007 jusqu'aujourd'hui, TTS ne respecte aucune réglementation dans l'exploitation de sa parcelle de forêt. Elle n'applique aucune politique d'aménagement car d'après sa direction, elle ne serait pas concernée par les sanctions''0. Ce cas n'est qu'un échantillon de ce genre de choses. Parfois ces nationaux protègent leurs partenaires étrangers.
A côté des partenariats de pillage, il y a la stratégie d'écran adoptée par les entreprises étrangères. Elles nomment tout simplement au sein de leur conseil d'administration un homme influent dans le gouvernement. C'est une pratique qui daterait de très longtemps. Ces nationaux sélectionnés parfois dans les cimes du pouvoir sont de véritables soutien et boucliers anti sanctions pour les sociétés hors la loi.
Sur ce point, Verschaves stipule que dans les années 2000, les grumes destinées aux scies de Patrice Bois0avaient la fâcheuse habitude de sortir de la forêt sans le moindre marquage, rendant les pistes fiscales assez fangeuses. Ceci était dû au fait que l'administration de cette société forestière dont la scierie se trouvait à Yaoundé avait pour président du conseil d'administration un certain tout puissant honorable, délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé, président du groupe des parlementaires francophone le feu Nicolas Amougou Noma0.
Le cas de Patrice bois est un échantillon pour ce genre de pratiques. Conscientes de cette nature de soutiens, ces sociétés violent librement toutes les dispositions juridiques, entrainant la déforestation sans être inquiétées. Car elles savent que grâce à l'intervention de leurs
0Wafo, `'La clairière au détour du sentier'', 1998, p. 4.
0 Entretien avec Ndoumba Bernard, 37 ans environ, chargé de la communication et du suivi des activités d'exploitation et de la transformation à la TTS, Masséa, 6 novembre 2010.
0 Entretien avec Abdoulaye, 33 ans environ, virgile de la SFCS, Masséa, 6 novembre 2010.
0 Patrice Bois est une société forestière italienne appartenant aux familles Giancarlo Fuzer et Patrizio Deitos. Elle est la plus grande société forestière dont la scierie se trouve à Yaoundé. Pendant les appels d'offres de 2001, elle s'accaparait de quatre UFA pour un total de 250 000 hectares, ceci grâce à ses soutiens.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 77.
74
partenaires ou leurs complices nationaux, certaines de leurs sanctions ou procès judiciaires sont abandonnés et leur société blanchie. Entre 1995 et 1998, 13 procès en justice d'infractions contre certaines sociétés pour un pourcentage de 21% ont été abandonnés suite aux interventions de certaines personnes influentes du pays0.
Cette situation facilite la destruction des forêts au Cameroun par les sociétés étrangères. Elle serait nourrie par la corruption, puisque ces personnes qui jouent le rôle d'écran bénéficieraient des fortes sommes d'argent.
Alors, à la somme de tous ces facteurs, on ajoute les effets de dévaluation du franc CFA, l'urbanisation, le développement des infrastructures énergétiques et routières, le secteur informel, le bois de construction et le bois de feu. C'est donc cet ensemble de causes qui sont responsables de la déforestation. Ceci entraine des graves conséquences.
Les conséquences qu'entraine la déforestation sont multiples et leur impact est local et international. Elles sont économiques, socioculturelles et environnementales.
Les conséquences économiques de la déforestation sont entre autres ; les pertes dues à l'exploitation illégale, des pertes liées à la coupe des essences qui peuvent contribuer à l'économie du pays.
Les pertes liées à l'exploitation illégale sont les plus importantes dans le secteur forestier. C'est presque la totalité des sociétés forestières en activité au Cameroun qui fraudent dans leurs activités. Cette situation est due au fait que les opérateurs économiques qui dominent le secteur sont en majorité des étrangers0. Ce sont les entreprises capitalistes. Ainsi, quand elles arrivent au Cameroun, elles ont déjà peaufiné des stratégies et des tactiques de fraudes.
0 Bikié, collumb et all, Aperçu de la situation, 2000, p. 48. 0 Verbelen, `' Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 21.
75
Ces dommages économiques sont parfois chiffrés. Ainsi, certaines études avancent que l'exploitation frauduleuse de 2000 hectares de forêt par la société WIJMA0 a fait perdre 1,4 milliard de FCFA à l'Etat. Et les opérations illégales de la société forestière Hazim (SFH) dans l'UFA 10-030 ont causé à l'Etat camerounais un manque à gagner d'environ 25 million de francs CFA0. Et les dommages et intérêts de l'exploitation illégale de CAMBOIS en dehors de leur assiette de coupe ont été évalués à 247 millions de francs CFA0. Les manques à gagner sont aussi constatés dans la foresterie communautaire, le secteur informel et l'application de la loi.
Toutes les mauvaises pratiques constatées dans l'exploitation des forêts communautaires entrainent de lourdes conséquences sur l'économie camerounaise. Pour ce qui est du secteur informel, les chiffres ne sont pas négligeables. Ainsi, selon les statistiques des douanes, 120 000 m3 des débités environ, représentant un chiffre d'affaires de 40 milliards de francs CFA ont été exportés en 2005 par des transformateurs sans titre ou travaillant en partenariat avec les forêts communautaires0.
Pour Greenpeace, les effets économiques de l'abattage illégal entre 1992 et 1995 ont fait perdre à l'Etat camerounais environ 6 milliards de FCFA des revenus des impôts, presque la moitié de ce qu'il devrait gagner si l'activité forestière était saine0. Si ce volet concerne les effets liés à l'exploitation illégale. Il convient de signaler qu'il y a aussi la perte des espèces très riches.
Beaucoup d'experts s'accordent à dire que le potentiel économique des produits forestiers non ligneux camerounais n'a pas été évalué, sinon l'Etat pourrait se rendre compte du manque à gagner qu'il subit à cause de la coupe des essences précieux par les industries0. L'exemple vient du moabi, dont le tronc peut rapporter plus de revenus que quand on le vend sur pied. En effet, un pied de moabi débout produit autant d'huile, de produits médicinaux, qui font plus d'entrées financières que quand on le coupe pour la vente. Les photos ci-après illustrent les étapes que traversent les fruits de moabi pour arriver à l'huile.
0 WIJMA est le nom du fondateur de cette société
0 J. C. Noundou, `'L'application du droit international de l'environnement par les sanctions : cas du Cameroun»,
mémoire de Master en droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, août 2005,
pp. 33-38.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt , 2002, p. 27.
0 `'Audit économique et financier », MINEFI, 2006, p. 90.
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 25.
0 Ibid. p. 26.
76
Photo n° 14 : Les étapes que parcourent les noix de moabi pour arriver à l'huile
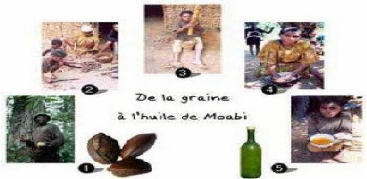
Source : Deravin, `' Projet Coeur de forêt», 2010.
Ces photos présentent les cinq étapes que connait la fabrication de l'huile de karité. Sur les photos 1, c'est le ramassage des fruits de moabi. La deuxième image montre le retrait des amandes des coques. Pour la photo 3, il s'agit de piler ces amandes pour se retrouver avec la patte. Quant aux photos 4 et 5, elles présentent une femme entrain de presser la patte pour extraire l'huile qui s'affiche à la photo 5. Ce qui révèle l'importance qu'a le moabi.
Dans ce sens, M. Schneider, spécialiste de moabi, affirmait en 1993 que sachant qu'un moabi peut fructifier de manière forte 150 litres d'huiles tous les trois ans, à raison 1500 F le litre, en 25 ans ce moabi pourrait fructifier 1200 à 1600 litres d'huile d'une valeur de 1 800000 francs CFA. Arrivé à la fin de son cycle de vie, ce moabi pourrait être enfin vendu. Ce qui apporte un autre bénéfice0.
Alors, en faisant le rapport avec le nombre de troncs de cet arbre que les industriels coupent chaque jour, on se rend compte que l'Etat camerounais est perdant. Au-delà de ces pertes, on ajoute celles des produits forestiers pouvant rapporter d'énormes revenus si leur potentiel médical était exploité. Alors tous ces chiffres non exhaustifs nous permettent quand même d'estimer les conséquences chiffrées de la déforestation au Cameroun.
0 Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010, p. 10.
77
Ces effets de la déforestation sur le plan socioculturel touchent aujourd'hui certaines populations de l'Est et de la région de l'Océan.
En ce jour, ces communautés sont en train de perdre leur source de biens et de services. Les grands arbres de leur forêt sont abattus tous les jours. Et dans les villages, on ressent déjà petit à petit cet impact. Il se traduit par la rareté des fruits sauvages, les chenilles, les escargots ; etc. Ce qui porte un coup dure à la ressource alimentaire forestière au Cameroun. La forêt commence même à manquer pour l'agriculture de subsistance. La preuve est qu'aujourd'hui, les populations de Madjoué font des longues distances avant de trouver des parcelles cultivables0. Les espaces forestiers disparaissent à un rythme plus rapide sans tenir compte des générations futures. Phénomène qui est à l'origine des conflits sociaux. Par exemple, le principe de délimitation des zones agricoles et de chasse engagée par le WWF et mise en application par le Ministère des forêts et de la faune camerounais avait suscité en 2008 à Zoulabot-ancien, Maléa-ancien et Ngatto-ancien, une vive contestation de la part des habitants de ces villages. En effet, ces populations reprochaient au gouvernement et au WWF d'avoir délimiter la forêt pour protéger les parcs nationaux de Boumba-Bek et de Nki, sans tenir compte de leur forêt d'exploitation agricole0. Les industries forestières d'une part et les populations autochtones d'autre part se battent comme elles peuvent pour survivre et faire entendre leur voix. Dans le village de Nomedjoh, les exploitants sont même venus en 2000 couper des vieux moabi, pourtant situés dans les champs et les cacaoyers des villageois. En 2002, environ 300 moabis ont été coupés à moins de deux kilomètres du village de Bapilé0. Ceci entrave la bonne exécution de la médecine traditionnelle et met en danger la survie des populations concernées.
Pour Filip Verbelen, sur le plan social, l'installation d'une société d'exploitation forestière n'entraine pas forcement un développement durable dans la région. Elle est plutôt
0 Entretien avec Pkama théophile, 60 ans environ, paysan, Madjoué, 14 novembre 2010.
0 Louis Defo and Olivier Njounan Tegomo, `'Ingenous people's participation in mapping of traditional forest resources for sustainable livelihoods and great ape conservation», rapport d'exécution du projet WWF jengi south East forest programme, September, 2008, p.7.
0 Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun», 2010, p.10.
78
un facteur de problèmes sociaux0. Les exploitants forestiers ne respectent pas les valeurs traditionnelles que les populations locales accordent à certaines essences. Par exemple le moabi et le bubinga sont très utiles pour les populations riveraines. Soit pour les rites traditionnels, soit pour le prélèvement des médicaments ou encore pour l'alimentation0.
Aujourd'hui dans la région de l'Est, la forêt est répartie entre plusieurs acteurs, les exploitants forestiers ont la part du lion et interdisent aux populations qui n'ont qu'une minime partie de s'approvisionner dans leur zone d'exploitation. Cette situation ne plait pas aux riverains qui engagent souvent des conflits avec ces sociétés0. L'exemple est celui du village de Masséa dans la Boumba et Ngoko où en 2003, les dirigeants de la CFE de la place ont subi des atrocités venant des populations de ce village, sur un litige forestier0.
Des exemples comme celui là, on les rencontre partout où il y a des entreprises qui exploitent le bois. En plus, les sociétés forestières sont à l'origine des autres problèmes sociaux liés à leur installation0. Dans son étude, Filip Verbelen montre qu'elles sont à l'origine des problèmes de santé, de famine, d'alcoolisme, de la prostitution et du grand banditisme. S'agissant des problèmes de santé, les médecins en fonction dans l'Est Cameroun ont établi en 1999 un lien très net entre l'expansion de l'industrie du bois et le développement de la prostitution, ainsi que l'accroissement du taux de prévalence du SIDA0. L'exploitation industrielle des forêts affecte la tradition des populations locales ; elle les sèvre de leurs grands arbres, qui étaient hier, leur source culturelle.
La plus frappante de ces conséquences sociales est la destruction du milieu de vie des peuples pygmées. Ceux-ci assistent impuissants à la destruction de leur précieux environnement0. Ils représentent les couches les plus vulnérables au Cameroun.
Pour les Pygmées-Bakas (population estimée à 25 000 et 40 000 hts)0 de l'Est Cameroun, l'exploitation industrielle des forêts est venue désarticuler leur mode de vie. Les forêts que l'Etat attribue aux sociétés sont des forêts permanentes et sont celles dans lesquelles vivent les Pygmées. Que deviennent ces populations qui d'ici peu se retrouveront
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 28.
0 Ibid.
0 Entretien avec André Kallo, 45ans environ, chef du village Masséa, Masséa 8 novembre 2010.
0 Entretien avec Dieudonné Etom, 35 ans environs, Planteur originaire de Masséa, Masséa, le 8 novembre 2010.
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 29.
0 Ibid.
0 Ibid. P. 30.
0 A K Barume, Etude sur le cadre légal pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux au
Cameroun, Génève, Organisation Internationale du Travail, 2005, p. 24.
79
sans leur biotope ? Inquiet de cette situation, un Pygmée de Nomedjoh disait que : `'L'huile de moabi, c'est notre seule richesse. Nous n'avons plus de moabi. Même les arbres de moins de un mètre de diamètre sont abattus et rien n'est fait pour la régénération''0. Pour ces populations, `'Abattre un moabi en Afrique, c'est comme dévaliser une banque et détruire une pharmacie''0.
En 1993, dans le district de Mbang (région de l'Est), un tiers des moabi protégés par les Pygmées depuis plusieurs siècles a été exploité par la SFIL0. C'est semblablement ce que vivent les populations de l'Océan.
2- Les Bulu et les Bagyeli face à la menace des agro-industries
Dans le département de l'Océan, ce sont plutôt les agro-industries qui déboisent. L'impact de cette déforestation entraine les conflits sociaux avec les riverains. Les communautés de ce département (les Bulu et le Bagyeli) sont en conflit depuis plusieurs décennies aujourd'hui avec la SOCAPALM et HEVECAM. Elles prétendent qu'elles ont été chassées de leurs terres en 1939 par les Français0. Ces derniers ont brûlé leurs maisons, leurs biens et les tombes des ancêtres ont été abandonnées, les chefs et les notables ont été jetés en prison pendant trois semaines0. Il s'agissait des chefs des tribus Bulu d'Assakotan du village Afan-oveng et des Yemon de Zingui et de Bifa0. Et en 1973, lors de la création de ces deux agro-industries par l'Etat, elles se sont vues à nouveau déguerpir. Ces populations revendiquent haut et fort ces terres où se trouvent les anciennes tombes, leurs traces0. Dans les villages de Nko'olong, afa-oveng, Mitzen, Bidou III au bord de la route Kribi-Adjap où vivent les tribus Assakotan et Yemon toutes Bulu, la contestation est forte0. En décembre 2005, les villageois d'Afa-oveng écrivent une lettre au directeur d'HEVECAM pour faire respecter leurs droits sur toutes les terres de Niété que la société exploite. En aout 2006, constatant qu'elle est restée sans réponse, ils écrivent une autre qu'ils adressent au Ministre de l'économie0.
0 Deravin, `'Projet Coeur de Forêt Cameroun'', 2010, p. 8.
0 Ibid.
0Ibid. p. 10.
0Gerber, `'Résistance contre deux géants industriels'', 2008, p. 26.
0Ibid. p. 27.
0 Ibid.
0 Ibid. p. 28.
0Ibid.
0 Ibid.p. 27.
80
A Mitzen, les villageois ont été invités de partir. Ils disent qu'en 2003, le chef de district de Niété et le Directeur de la société d'hévéa leur ont demandés de déguerpir en avançant que le gouvernement avait cédé cette parcelle inclus leur village à la société d'hévéa pour son extension. Restées indifférentes, ces populations ont vu le 20 décembre 2006, certains de leurs maisons et leurs champs détruits par les bulldozers de la société d'hévéa0. Ce qui a suscité une réaction qui s'est soldé par un affrontement entre les conducteurs d'engins et ces populations0.
A Bidou III en janvier 2003, un affrontement a opposé les gens de ce village aux gardes de la SOCAPALM. Le bilan était lourd. Les blessés graves du coté des gardes et les arrestations chez les villageois0. Les Bantou ont les droits de revendiquer leurs terres. Pourtant, ce n'est pas le cas des Bagyeli (population indigène estimée à 3500 et 40000)0 qui sont les peuples qui habitaient depuis les siècles la zone où se trouve HEVECAM et d'autres zones adjacentes0. Leur statu de peuples indigènes ne leur permet pas d'être mis au même enseigne que les Bantou0. Donc, cette situation marginale ne leur donne pas les droits de revendication. Ce peuple déclare avoir été victime d'une injustice historique grave, celle d'avoir été dépossédé des droits et libertés sur des terres qu'il considère avoir hérité des ancêtres0. Pourtant on peut lire dans la constitution de 1996 du Cameroun que : `'L'etat assure la protection des minorités et preserve les droits des populations autochtones conformement à la loi''0. Ces populations se retrouvent prises en sandwiche entre les agro-industries et la réserve de campo-ma'an.
Le campement Nyamabandé est un exemple de cette situation. En effet, ce campement bagyeli se retrouve coincé entre la réserve campo-ma'an et HEVECAM. Cette situation ne leur permet pas de vivre dans les conditions normales. Ils n'ont aucun espace pour faire la chasse et la cueillette. Interdits depuis 19950 d'extraire les produits dans la réserve, ils ont aussi la prohibition de le faire dans la plantation d'HEVECAM0. En outre, grâce à
0 Ibid. p. 28.
0Ibid. P. 30.
0 Ibid.
0 Barume, Etude sur le cadre légal pour la protection, 2005, p. 24
0 Ibid.
0 Ibid. p. 38.
0 Barume, Etude sur le cadre légal pour la protection, 2005, p. 24
0 AAN, `'Constitution camerounaise de 1996'', Titre I.
0 En 1995, les décrets n°-95/531 et 95/466 du Ministre de forêts et de la faune ont institué l'interdiction
d'extraction de quoi que ce soit dans les zones protégées.
0 Ibid. p. 38.
81
l'intervention des ONG qui travaillent sur le terrain, certains compromis ont été faits, malgré qu'ils n'apportent rien0.
Un autre cas d'espèce est le village de Kilombo I aujourd'hui coincé entre la SOCAPALM et HEVECAM. La situation des habitants est difficile due à leur isolement et la destruction de leur forêt. En 2006 selon certains témoignages, la société de palmiers à huile leur a demandé de quitter leur lieu de vie forestier contre un dédommagement pour la destruction de leurs tombes et la construction des maisons modernes pour céder la place à l'extension de la plantation0. Chose que les intéressés ont fait, mais les promesses n'ont pas suivi0. Aujourd'hui, ils vivent dans une zone marécageuse inondable où pullulent moustiques et maladies. Ils ont les problèmes de santé dûs à la mauvaise alimentation, à l'eau contaminée et à l'insalubrité du site dans lequel ils vivent, qui s'aggrave à cause de la perte de leur pharmacopée traditionnelle. Le constat est ainsi fait.
Les Bagyeli vivaient bien avant sur leur territoire qui comprenait ce qui est aujourd'hui d'HEVECAM ainsi que d'autres zones adjacentes. La forêt n'existe plus et ils sont perçus comme les intrus sur leur propre territoire, aujourd'hui sous le contrôle de l'entreprise (...) il en résulte aujourd'hui que c'est un groupe humain démoralisé, appauvri, mal nourri, exploité et opprimé, acculé par la plantation et sans avoir nulle part où aller0.
R. Carrere en 2007 estimait que les Bagyeli ont été les principales victimes de la venue d'HEVECAM0. Alors à travers ces deux communautés, nous avons la preuve concrète que les plantations d'Hévéa et de palmiers à huile posent d'innombrables problèmes dans la vie de celles-ci. Nous pensons que les principaux problèmes que posent les plantations découlent de la disparition d'une grande étendue de forêt sur laquelle ils vivaient et dont leur mode de vie dépend entièrement. Leur cas est le plus inquiétant, car en dehors des forêts elles n'ont plus un autre milieu de vie favorable à leur épanouissement. Ainsi, un adulte pygmée de Bipindi révélait que : `' La forêt est tout ce que nous avons. Nous sommes incapables de survivre en dehors d'elle''0. En conclusion, la déforestation est une menace pour les populations riveraines ou autochtones. La disparition des forêts tropicales touche les populations
0 Cette situation a connu un changement en 2007, grâce à l'intervention du centre pour l'environnement et le
développement (CED), qui a convaincu les responsables de campo-ma'an et du WWF d'accorder un droit
d'usage aux Bagyeli. Du côté d'HEVECAM, les adultes ont droit d'aller chercher les escargots, mais parc celui
de chasser. Les enfants y sont interdits.
0 Gerber, `'Résistance contre deux géants'', p. 39.
0Ibid.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Barume, Etude sur le cadre légal pour la protection, 2005, p. 24
82
riveraines qui sont entre autres les plus pauvres et tributaires de leur environnement naturel0. Ainsi, pour Ismail Serageldin :
Jusqu'à une date récente, ce sont les populations vivant dans des airs géographiquement relativement circonscrits qui ont subi la plupart des conséquences de la dégradation de l'environnement. La baisse de la fertilité des sols à la suite de l'érosion ou du surpâturage, et la pollution des eaux d'un fleuve ou d'un lac ne touchait que des populations humaines qui en étaient directement tributaires pour leur subsistance0.
Au Cameroun, ces populations sont les Bantous (Konabembé, Maka, Bulu, Eton, Douala, BAkweri ; etc.) et Pygmées (Baka, Bakola, Bagiyeli) des régions de l'Est, du Sud, du Centre, du Littoral et du Sud-Ouest qui dépendent plus des faveurs de la forêt que les autres communautés0. A ces conséquences socioculturelles de la déforestation s'ajoutent celles qui sont environnementales.
Les conséquences environnementales dues à la déforestation sont diverses. Elles sont écologiques et environnementales.
Le déboisement que subissent les étendues de forêts camerounaises affecte sa biodiversité dont plusieurs éléments sont menacés d'extinction, en l'occurrence, certaines espèces floristiques, fauniques et même les airs protégés.
Les grands arbres sont les espèces floristiques les plus menacées au Cameroun. L'exploitation sélective à laquelle font face certaines forêts menace d'extinction les essences les plus valeureuses des forêts denses humides du pays. Ce qui est démontré dans l'étude de Greenpeace Belgique0 où, on apprend que le World Conservation Monitoring Centre (WCMC) cataloguait en 1998 les essences de bois camerounais les plus commercialisés comme `'vulnérables» et menacés0. Les essences sont dits vulnérables quand ils courent un risque élevé d'extinction sous forme sauvage à moyen terme, alors qu'ils sont dits menacés quand ils courent un très grand risque de disparaitre sous forme sauvage à court terme.
0 Serageldin, La protection des forêts tropicales, 1993, p. 1.
0 Ibid.
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 28.
0 Wafo, `'La clairière au détour du sentier», 1998, p. 6.. 9.
0 Les essences en question sont l'acajou, l'afzela (doussie), l'azobé, le bubinga, le dibétou, le kosipo, le moabi,
le niangon, le sapelli, le sipo, l'afromosia (assamela), l'ébène, le makoré (douka), le mansonia et le wenge.
83
En outre, l'agriculture, l'exploitation abusive des forêts entrainent le recul de celles-ci. L'agriculture parfois combinée de l'élevage ne laissent aucune reforestation secondaire. C'est une pratique qu'on rencontre dans les régions montagneuses et les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun. Les champs abandonnés sont transformés en pâturage0. Cette pratique est à l'origine de l'avancée du désert.
L'exploitation anarchique et plusieurs fois des forêts laissent des clairières à l'intérieur des forêts. Ce que pense samuel Wafo qui dit que les zones de Mvagan, Bipindi, Méngon, Biwon-bane, ngulemakon,Meyocentre sont devenues de vastes clairières0.
Les animaux de la forêt ne sont pas épargnés par cette menace ainsi selon le rapport de filip Verbelen, il existe un lien direct entre le développement de l'exploitation forestière et celui du braconnage pour le `'bushmeat trade» le commerce de viande. Les experts prévoient que certains mammifères du Cameroun vont disparaitre à brève échéance si aucun terme n'est mis à ce braconnage0.
Le chimpanzé et le gorille des plaines sont deux espèces de primates qui vivent dans la forêt équatoriale camerounaise. Une étude menée à l'Est du pays en 1995 a estimé que quelques 800 gorilles sont chassés chaque année par zone de 10 000km20.
D'après le docteur Jane Goodall, expert de primates d'Afrique, dans 50 ans il n'y aura plus de population viable de primates dans le bassin du Congo. Une situation qui risque faire disparaitre une sous-espèce du chimpanzé du Cameroun qui porterait le virus du SIDA sans être malade dont la médecine a besoin pour la recherche0.
A ces primates s'ajoutent l'éléphant de forêt, le léopard et le pangolin géant qui sont fortement menacés aussi par le braconnage0. Cette menace subie par la biodiversité se répand jusqu'aux airs protégés.
Les airs protégés au Cameroun ne sont pas épargnés par la déforestation. L'exploitation illégale effectuée par les industries forestières menace de raser ce qu'on appelle air protégé bien entendu les espaces de diversité biologique mis en conservation. La réserve de Campo-ma'an est pillée par la Foresterie de Campo (HFC)0.
Dans le Sud, c'est la réserve du Dja qui paie les frais. En effet, depuis plusieurs décennies aujourd'hui, cette réserve subie la pression de plusieurs sociétés d'exploitation. Et
0 UICN, `'Rapport préliminaire sur l'état de l'environnement en Afrique centrale, 2010, p. 78.
0 Wafo, `'La clairière au détour du sentier», 1998, p. 6.
0 Ibid. p. 7.
0Ibid. p. 8.
0 Ibid
0 Ibid.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 69.
au rythme ou vont les choses, elle pourrait se retrouver dévastée. Car encerclée par plusieurs entreprises dont Pallisco0. Cette hypothèse est possible.
La pollution environnementale n'est pas en reste, si les industries de bois seraient les moins pollueurs de l'environnement au Cameroun, ce n'est pas le cas des agro-industries. Les industries que sont HEVECAM et SOCAPALM sont entrain de polluer l'environnement dans la région de l'Océan0. HEVECAM déverse ses déchets en pleine nature, ce qui affecte dangereusement la flore et la faune des environs. L'image suivant est plus explicite.
Photo n° 15: Rigole de latex (mélange avec les autres produits)

Source : Labrousse, Verschaves, les pillards de la forêt, 2002, p.69.
Le ruisseau de l'huile nauséabond sortant de l'usine de SOCAPALM-Kienké se déverse dans certains cours d'eaux de la région. La photo suivante est un exemple parlant.
84
0 Ibid. p. 84. 0Ibid. p. 21.
85
Photo n° 16 : Vue du cours d'eau pollué (un affluent de la Lobé) dans lequel se deverse le ruisseau d'huile vers Bidou II.

Source : Labrousse, Veschaves, les pillards de la forêt, 2002, p. 69.
Ces deux cas de sociétés qui polluent l'environnement au Cameroun ne sont que l'échantillon. Mais si nous nous servions d'elles c'est par ce qu'elles sont avant tout des déforesteurs.
Sur le plan des surfaces forestières, il faut dire que la déforestation a emporté 18 millions d'hectares de forêts originelles du Cameroun0. Le taux de déforestation a beaucoup évolué jusqu'à se situer à 1,2% aujourd'hui. Le taux d'émission de gaz à effet est estimé à 0,14%, plaçant le pays devant tous les pays du bassin du Congo0.
En dehors de ces effets que nous on a pu constater, d'autres sont encore à découvrir. Qui sait si les glissements de terrain, les inondations et d'autres catastrophes naturelles que le pays connait tout ces derniers temps sont liées à cette déforestation.
Nous pouvons conclure que la déforestation s'est effectuée en plusieurs étapes au Cameroun. De la période coloniale jusqu'à nos jours, la forêt a été surexploitée. Les estimations faites par plusieurs études montrent qu'elle a fortement diminuée. Ceci a été possible grâce à la conjugaison d'une agriculture intensive et d'une exploitation forestière anarchique, accompagnée par les défaillances de l'Etat dans son rôle de gestionnaire des forêts. Ce phénomène a entrainé de lourdes conséquences économiques, sociales et environnementales. Alors pour mieux savoir la responsabilité qu'a eu l'Etat dans ces dégâts
0 Bikié, Collomb. Et al (eds), Aperçu de la situation de l'exploitation, 2000, p. 11. 0 UICN, `'Rapport préliminaire sur l'état de l'environnement en Afrique centrale», 2010, p. 72.
86
environnementaux, il faut faire une analyse de l'évolution de la législation forestière du pays, avec ses enjeux depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.
87
L'indépendance du Cameroun a été marquée en 1960 par une autonomie politique, économique et sociale ; et la prise en main de tous ces domaines. Ainsi, pour lutter contre la déforestation et la dégradation de l'environnement, les autorités camerounaises ont entrepris la mise sur pied d'une politique forestière appropriée à la situation du pays. C'est dans les années 90 que les problèmes environnementaux ont commencé à se poser. Averti par les écologistes sur les causes de ces problèmes dont la déforestation en est l'une, conscient du danger que cette situation représente pour le pays et le monde, l'Etat camerounais se voyait dans l'obligation d'encadrer toutes les activités liées à l'environnement par un cadre juridique quelques années plus tard. Alors cinquante ans plus tard, que pouvons nous dire de l'évolution de cette politique ? Ce chapitre traite la dynamique des normes forestières et environnementales, les mutations qu'ont connues les institutions en charge de ces questions et la dynamique des enjeux de la lutte contre la déforestation entre 1960 et 2010.
La mise sur pied des premières lois forestières au Cameroun n'était pas une chose aisée au vue de l'immaturité du jeune Etat à définir une politique forestière adéquate. Plusieurs défis l'attendaient, dont la réglementation de l'exploitation des forêts et la protection et la conservation de celles-ci. C'est ce qui explique un lent décollage entre 1960 et 1994. Ce processus s'était fait en deux étapes : de 1960 à 1981 et de 1981 à 1994.
Après l'indépendance du Cameroun sous tutelle britannique et la réunification avec la République du Cameroun en 1961, la politique forestière de chaque Etat fédéré était restée distinctes de l'autre jusqu'en 19730. C'est au lendemain de l'unification de 1972 que ces différentes politiques se sont vues harmonisées pour devenir une seule.
0 `'Politique forestière du Cameroun, document de politique générale», MINEF, Yaoundé, juin 1995, p. 10
88
Au Cameroun oriental, les différentes lois y afférentes étaient calquées sur le modèle de la gestion des forets de l'AEF0. L'exploitation forestière en 1964 n'était pas régie par des régimes spécifiques à cette période. Aucune loi n'avait été établie pendant ce temps au Cameroun jusqu'en 1968. De 1964 à 1968, l'exploitation forestière était subordonnée aux régimes forestiers ultérieurement abrogés au Cameroun oriental avant et après l'indépendance de 1960, notamment la loi forestière n°58/24 du 26 mars 1958, l'ordonnance n°61/OF/14 du 16 novembre 1961 et le décret n°62/2 du 9 janvier 19630. Ces lois visaient à régulariser l'activité forestière et lui donner un caractère légal. Ainsi les articles 33 et 37 de l'ordonnance de 1961 mettaient en exergue le reboisement des forêts et la conservation des sols. Il fallait replanter les essences comme l'ébène qui ne pouvait se régénérer seul. En outre, cette ordonnance intégrait les populations locales0. Celles-ci pouvaient bénéficier des réalisations sociales (écoles, hôpitaux ; etc.) des sociétés exploitantes.
Manifestement, d'autres études montrent qu'après l'indépendance, le régime forestier du Cameroun oriental a continué à être régi par le texte français de 1946, car il faut préciser que le texte de 1959 ne fixait que le régime de propriété de la forêt. Il faudra attendre 1961 pour qu'une ordonnance, celle n° 61/OF/14 du16 novembre 19610, abrogeant le décret du 3 mai 1946, fixât le régime forestier sur le territoire du Cameroun oriental.0 Cependant, cette ordonnance n'était qu'une édition modifiée du décret français.0 Pendant cette période, l'exploitation forestière était conditionnée par l'obtention d'une licence. Celle-ci avait une durée de cinq ans. Et une licence donnait accès à une pluralité de permis de coupe. La SFID présente à Dimako dans la région de l'Est depuis 1946, avait obtenu des autorités camerounaises de 1955 à 1983, neuf licences d'exploitation0. Et cette société n'était pas la seule en activité en ce moment. Il y avait d'autres à l'instar de HFC créée en 1960 et agissant dans la forêt de Campo0.
En se basant sur ces informations, il n'y a aucun doute que le Cameroun oriental, jusqu'en 1968, s'était appuyé sur les lois forestières de la période coloniale française. Ceci
0 Ebela, `'L'exploitation forestière et le développement», 2007/2008, p.10.
0 Ibid. pp. 10-11.
0 Ibid.
0 AAN. Décret n°64/34/COR du 04 mars 1964 accordant un permis d'exploitation.
0 Après l'unification, la gestion des forêts a été laissée dans les affaires relevant des Etats fédérés.
0 R. Tene, `' L'aspect juridique de la gestion», 1977-1978, Université de Yaoundé, p. 10.
0 Elong, `'L'impact d'une exploitation forestière», 1984, p. 254.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 69.
89
peut s'expliquer par l'état de jeunesse du nouvel Etat, qui faisait immédiatement face à plusieurs réalités au point où il fallait partir des lois laissées par les colons pour établir ses propres règles sur la gestion du patrimoine forestier. On peut aussi signaler la situation politico-géographique du Cameroun. Le pays était divisé en deux Etats fédérés, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, avec chacun un héritage colonial différent de l'autre qui rendait difficile la mise en place d'une politique forestière unique et fiable pour le jeune Etat. En plus, les nouveaux dirigeants du pays ne s'étaient pas encore bien imprégnés de tous les problèmes des forêts.
Soulignons quand même que la loi de 1961, dans ses articles 33 et 37, a insisté sur le reboisement et la conservation des sols ; ce qui n'était pas le cas des régimes de 1958 qui n'étaient pas stricts en matière de protection de la forêt0.
L'inertie observée allait s'étendre jusqu'en 19680. Il convient de retenir qu'en 1964, l'exploitation forestière était toujours conditionnée par l'obtention d'un titre d'exploitation. Il permettait de déterminer la superficie de forêt dont devait bénéficier l'exploitant et surtout lui signifiait à travers un cahier de charges, ses devoirs envers les populations locales0. Parmi ces titres, on observe le permis de coupe ordinaire, le permis de chantier, le permis de coupe d'ébène et la licence0.
C'est dans cette ambiance qu'a été signé le décret n°68/1 du 11 juillet 1968 rendu applicable par celui n°68/179 du 8 novembre 1968. Cette loi reposait sur la définition de la notion de forêt. L'Etat camerounais s'était rendu compte que les régimes forestiers précédents n'avaient pas mis l'accent sur la définition de la forêt, pourtant c'était sa priorité. Pour lui, la définition de la forêt permettait de mieux cerner ses problèmes.0Il était donc qualifié de forêt, les terrains recouverts d'une formation végétale, soit capable de produire du bois ou des produits ne constituant pas des denrées agricoles, soit exerçant sur le sol, le climat et le régime des eaux, un effet indirect0. Cette loi insistait aussi sur la réglementation forestière et les conditions de la régénération de la forêt. Ce premier point était nécessaire car le secteur
0 Ebela, `' L'exploitation forestière», 12007/2008, p. 12.
0 Ibid. p. 11.
0 Ibid. p. 12.
0 Les différents titres d'exploitation de cette législation de 1964 étaient repartis par apport à la superficie et à la période d'exploitation. Ainsi, le permis de coupe ordinaire était délivré pour une période de 5 ans sur une superficie de 2 500 hectares, pour les permis de chantier, il s'agissait des superficies de moins de 100 hectares dans une période d'un an, quant aux permis de coupe d'ébène ils disposaient de l'exploitation de dix tonnes de bois pour un an, et en ce qui concerne les licences, elles étaient accordées pour une période de cinq ans pour une superficie supérieure à 250 000 hectares.
0Ebela, `' L'exploitation forestière», 2007/2008, p. 13.
0 Ibid.
90
des forêts faisait face à une certaine anarchie. Celle-ci se traduisait parfois par le non respect des devoirs des exploitants. Quant à l'appel à la régénération, il encourageait le reboisement afin de remplacer ces énormes forêts détruites pendant l'exploitation forestière0.
Dans l'étude de Tene, la loi n°68/1/COR du 11 juillet 1968 modifiée par la loi n°71/4/COR du 21 juillet 1971 fixant le régime forestier de l'Etat Fédéré du Cameroun Oriental accordait déjà une grande importance à la conservation des ressources forestières en stipulant que certaines zones étaient fermées à l'exploitation0. Les principales dispositions de cette loi reposaient sur la définition de la notion de forêt. En effet, le gouvernement camerounais s'était aperçu qu'avec le premier régime forestier de 1921, l'accent n'avait pas été mis sur cette définition0. Elle insistait sur la régénération afin de remplacer ces énormes forêts détruites pendant leur exploitation. Cette mesure liée à l'exploitation intense de la forêt a donné lieu à la constitution de superficies relativement importantes de forêts fermées à l'exploitation, dont la forêt de Yokadouma de 2.000.000 ha0.
Ce qu'il faut dire est que la loi de 1968 apportait une certaine précision sur la notion de forêt, facilitant ainsi la conservation des produits issus de celle-ci. Mais comme dans les lois précédentes, il fallait avoir une licence pour obtenir une concession forestière. La SEFAC voit le jour en 1968 en même temps que cette loi. Et elle obtenait une licence cette même année pour l'exploitation d'une zone forestière située dans la région du Sud-Est et plus précisément sur le rivage camerounais du fleuve Sangha dont la localité s'appelle aujourd'hui Libongo0. Malgré ses lacunes, l'anarchie et le non respect des devoirs des exploitants, cette norme forestière marquait le début d'un long processus de réformes dans le secteur des forêts du pays.
Pourtant la situation était différente au Cameroun occidental qui, avant son indépendance, formait une union administrative avec le Nigeria et était gouverné comme une partie de ce pays0. Les lois du Nigeria s'étendaient donc à l'ensemble de cette union. Il faut rappeler qu'en matière des forêts, c'est l'ordonnance de 1938 sur la préservation et le contrôle des forêts qui va rester en vigueur même après l'indépendance0. Elle est remplacée plus tard
0 Ibid.
0 Tene, `' L'aspect juridique», 1977/1978, p. 11.
0 Ebela, `'L'exploitation forestière», 2007/2008, p. 13.
0 Ibid.
0`'Groupe sefac», htt:// www. Groupesefac. Com. Consulté le 15 Octobre 2010.
0 V. T. Le Vine, Le Cameroun, volume II, Berkey et Los Angeles, University of California press, 1964, pp. 118-
119.
0 Ibid.
91
par la loi n°69/LW/12 du 2 septembre 1969 qui tend déjà à s'harmoniser avec les textes du Cameroun oriental ; elle a certainement été inspirée par la loi n° 68/1/COR du 11 Juillet 19680.
En effet, cette situation de bivalence dans la politique de gestion des forêts au Cameroun était un obstacle dans une politique qui se voulait unique et dynamique. Il fallait donc réagir face à ce problème.
Après l'unification du pays en 1972, il fallait remédier à ce problème de dualité des politiques forestières et élaborer un régime unique. C'est l'ordonnance n° 73/18 du 22 mai 1973 qui a institué cette harmonisation0. Elle venait modifier tous les anciens régimes de deux Etats fédérés et avait mis par la même occasion une loi qui devait s'étendre sur tout le territoire camerounais. Celle-ci avait été rendue applicable par le décret n°74/357 de 19740. Par conséquent, les forêts domaniales devraient représenter 20% de la surface nationale, soit environ 9 500 000 hectares0.
Aussi les surfaces concédées à un même exploitant ne pouvaient dépasser 250 000 hectares. A partir de 10 000, il y avait lieu d'installer une industrie de transformation. La société Pallisco (SARL) qui était créée en 1972 pour répondre à cette condition, avait installé une scierie pour la transformation dans le village d'Eboumetoum à l'Est Cameroun0. Les permis de 10 000 hectares étaient attribués aux nationaux. L'accent était aussi mis sur la transformation du bois. Et le seuil de transformation est porté à 60%0. L'exploitation et la transformation du bois ne se faisaient pas sans concessions. L'exploitation devait se conformer au cahier des charges selon la loi en vigueur dans le territoire camerounais0.
Concernant le cahier des charges, cette ordonnance venait le modifier. Le cahier de charges renferme les devoirs des exploitants et dans ses clauses particulières, met l'accent sur ceux envers les populations et les communes locales0. L'ancien système de cahier de charges stipulait que c'est l'exploitant lui-même qui devait réaliser des infrastructures socio-
0 Ibid.
0 `'Politique forestière du Cameroun», brochure du MINEF', 1995, p. 10.
0 Ebela, `' L'exploitation forestière», 2007/2008, p. 13.
0 Ibid.
0`'Pallisco-cifm historique des entréprises pallisco» http://www. Pallisco-cifm. Com.consulté le 15 octobre 2010
0 Ibid.
0 Ibid. pp. 13-14.
0 Ibid.
92
économiques au bénéfice des populations locales. Or la loi de 1973 annulait cette clause. Désormais, les exploitants devaient payer des taxes de contribution socio-économique à verser aux communes locales0. Celles-ci se chargeaient désormais de ces réalisations. L'inconvénient de cette nouvelle loi était le fait que les communes locales n'étaient pas parfois à la hauteur des la réalisation de ces infrastructures. L'exemple nous vient de la commune de Yokadouma qui a perçu plusieurs milliards des sociétés forestières exploitant surplace depuis 1975, mais qui n'a pas pu construire des infrastructures conséquentes0. Donc, face à cette triste situation, qui est d'ailleurs responsable aujourd'hui à 60% du retard infrastructurel que connait la ville.
D'autre part, Kelodjoué constate que cette ordonnance et son décret d'application visaient une gestion rationnelle des ressources forestières afin de tirer le profit maximum, tout en préservant le patrimoine forestier0. En effet, il en résulte que la législation élaborée en 1973 et appliquée en 1974 avait pour souci d'harmoniser les textes applicables en matière des forêts dans les anciens Etats fédérés et donner au Cameroun un régime juridique unique en ces matières0. Les principales articulations de ce texte étaient les suivantes :
* La procédure de classement et le déclassement des forêts domaniales tenant compte de la vocation des terres et des intérêts des populations locales ; le principe est posé par l'article 14 de cette ordonnance où les forêts domaniales font partie du domaine privé de l'Etat et doivent atteindre au moins 20% de la superficie totale du territoire, soit près de 9 500 000 ha ;
* l'exploitation d'une forêt classée ne peut se faire que sur la base d'un plan d'aménagement ;
Les domaines des licences d'exploitation forestière son constitués des commissions techniques, nationales et provinciales ;
* toute personne morale ou physique désireuse d'exploiter une forêt doit être agrée ; les critères d'octroi de cet agrément sont la garantie de financement de l'activité à entreprendre, la connaissance technique de l'exploitation forestière et une bonne moralité ;
* les licences d'exploitation forestière sont accordées pour une période de 5 ans renouvelables après avis d'une commission technique ; les superficies totales accordées à un même exploitant ne peuvent excéder 250 000 ha ; les licences de superficie inferieure à 10 000 ha sont réservées aux Camerounais ou aux sociétés nationales camerounaises ;
* aussi, toute licence d'exploitation est assortie d'un cahier de charges
* en vue d'accroitre les taux de transformation industrielle de bois, la qualité d'installation industrielle à mettre en place et le pourcentage minimum du volume devant être transformé localement0.
L'avènement de cette ordonnance était la bienvenue dans la politique forestière du pays. D'une part elle venait harmoniser les deux textes qui régissaient les secteurs forestiers dans
0 Ibid.
0 Entretien avec Armand Souobot, 66 ans environ, employer à la mairie de Yokadouma depuis trente ans,
Yokadouma, 12 octobre 2010.
0 Kelodjoué, `' L'évolution de l'exploitation industrielle », 1985, p. 27.
0 Ibid. p. 29.
0 Ibid. pp. 27-28.
93
ces deux Etats fédérés pour en faire un. Quant on sait qu'un an auparavant, c'est-à-dire le 20 mai 1972, l'Etat unitaire du Cameroun naissait entrainant ainsi l'unicité des institutions du pays, on peut donc constater que cette harmonisation des textes forestiers était la conséquence de cette réunification.
Par apport aux précédents textes, celui-ci apportait beaucoup d'innovations dans la réglementation forestière. C'est dans ce sens que Tene dans son étude, affirmait que `'Cette législation est à l'heure actuelle l'une des plus élaborées d'Afrique au Sud du Sahara. Elle permet d'assurer une gestion plus rationnelle de nos ressources forestières»0. Elle était novatrice à cause de la définition plus complète des différentes procédures de gestion ; par la définition des principes d'exploitation rationnelle de la forêt par assiette de coupe et la concordance établie entre la superficie totale à exploiter, la quantité des installations industrielle à mettre en service et le pourcentage minimum de volume de bois à être transformé localement ; par le système méthodique de contrôle et du recouvrement des recettes0.
Pourtant quelques années plus tard cette ordonnance présente très vite les insuffisances. Les règles de 1973 ne prévoyaient pas d'inventaire préalable des ressources forestières avant toute ouverture à l'exploitation. Cette loi n'a pas atteint ses objectifs sur le plan de la conservation. Le nombre de 9 500 000 hectares de forêt classés qui avait été fixé n'a pas été atteint. En 1978 on comptait seulement 3 500 000 d'hectares, faisant du pays l'un des rares en Afrique où la superficie des forêts appartenant au domaine privé de l'Etat était faible0. Le système de taxation de l'exploitation forestière n'était pas proportionnel à l'importance de ces activités0. Les mesures d'encouragement des nationaux à se lancer dans la profession d'exploitant étaient insuffisantes. Le contrôle de l'abattage des essences forestières laissait à désirer0. Par conséquent, il était indispensable de modifier et de compléter ce texte par un autre plus adéquat et plus adapté aux nouveaux défis.
Ce qui précède présente la législation forestière au Cameroun de 1961 jusqu'en 1981. Il ressort de cette analyse que les années 60 ont été marquées par deux régimes forestiers parallèles dans les deux Etats fédérés du pays. C'est à partir de 1973 qu'on assiste à une
0 Tene, `' L'aspect juridique», 1977/1978, p. 11.
0 Ibid. pp. 11-12.
0 Ibid. p. 28.
0 Kelodjoué, `' L'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, p. 29.
0 Ibid. p. 30.
94
uniformité de la loi forestière dans tout le territoire camerounais. C'est cette facette qu'avait la législation forestière au Cameroun à l'aube de la signature du régime forestier de 1981.
La réglementation qui a régi les forêts entre 1981 et 1992 au Cameroun était constituée de lois, décrets et instructions ministérielles.
La loi forestière de 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche semble la mieux élaborée du pays après les indépendances. En effet, suite au recours aux différentes lois régissant l'exploitation des forêts pendant la colonisation et à l'aube des indépendances, le Cameroun mettait pour la première fois sur pied son régime forestier0. Celui-ci apportait de nouvelles réformes dans le secteur de forêts. Et ceci devait se poursuivre jusqu'en 1992.
A partir de 1982, l'exploitation des forêts est régie par la loi n° 81-13 du 27 novembre 1981, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche0. Dans son article premier, elle prévoyait `'assurer la conservation, l'exploitation et la mise en valeur des ressources forestières, fauniques et halieutiques des domaines forestier, fluvial et maritime''0. Cette loi redéfinissait les domaines forestiers du pays. Ainsi on avait :
Les forêts domaniales ;
les forêts des collectivités publiques ;
les forêts des particuliers ;
les forêts du domaine national ;
la faune sauvage ;
les ressources halieutiques du domaine public fluvial et ou du domaine maritime0.
Cette loi venait réformer l'activité forestière au Cameroun et lui donner des règles solides et précises. Aussi il faut constater qu'avec elle, il était désormais question de s'occuper de la forêt et ses éléments composants. Ce qui signifie qu'on ne parlait plus seulement de la forêt, mais aussi de la faune. Car la destruction de la forêt entraine celle de la
0 Ebela, `' L'exploitation forestière'', 2007/2008, p. 15. 0 J.O R.U.C, n°22 du 1er Décembre 1981, p. 2639 0 Ibid.
0 Ibid. pp. 2639-2640.
95
faune. Les précédentes lois avaient contribué à une chasse massive et anarchique dans les forêts camerounaises. L'exemple nous vient de Kika0. En effet, jusqu'au début des années 1980, cette zone forestière exploitée depuis plusieurs décennies par la SIBAF subissait une chasse anarchique encouragée par les dirigeants de cette société. Sur ce point, Labrousse et Verschaves nous apprennent que :
La direction de la SIBAF, aujourd'hui horrifiée par le moindre soupçon de mort d'animal chez elle, a toujours favorisé la chasse jusqu'à la fin des années 1980, au moins. Les écologistes ne devraient pas ignorer la biographie-brûlot du chasseur Roger Fabre. Enfin, après avoir accompli à Yaoundé les manoeuvres d'usage, Fabre en arrivait à la conclusion qu'aucune amodiation ne pouvait être envisagée, tous les espaces étant déjà attribués aux compagnies forestières. Il obtint cependant un conseil. S'entendre avec l'une d'elles, la SIBAF, installée à Kika, dans le district de Moloundou, région très giboyeuse. S'étant rendu sans délai à Douala, Roger Fabre fut reçu par le directeur français de cette société, M. Billet, ne voyant aucun inconvénient qu'un professionnel de chasse vînt s'installer sur le territoire de l'exploitation. Se vantant du grand nombre d'éléphants de forêt et de gorilles dans sa
concession0.
Ainsi donc, cette loi était la bien venu. Car la faune à l'intérieur des concessions d'exploitation n'était plus confondue avec les arbres à exploiter. C'est-à-dire elle n'appartenait pas comme les arbres à la société qui détenait cette zone.
Pour ce qui concerne l'exploitation, l'article 23 stipule que `' L'exploitation de toute zone de forêt est subordonnée à un inventaire préalable de celle-ci `'0. Ce qui veut dire qu'avant toute activité d'exploitation dans une parcelle forestière, celle-ci devait subir un inventaire, question de faire un sondage permettant d'apprécier la richesse de la forêt en arbres de diamètre supérieur à 20 cm.
La loi forestière de 1981 venait faire la précision sur les titres d'exploitation accordés au Cameroun. Ainsi, on comptait trois types de titres. A savoir :
Les licences ;
les ventes de coupe ;
les permis ou autorisations de coupe0.
Les licences étaient accordées pour une période de cinq ans renouvelables. Leur renouvellement était soumis à une procédure fixée par décret0. Toute licence de superficie inférieure ou égale à 25 000 ha ne pouvait être attribuée qu'aux nationaux pris
0 Kika est la localité où sont installés le site d'exploitation et la scierie de SIBAF, située aujourd'hui dans
l'arrondissement de Moloundou, département de la Boumba et Ngoko, région de l'Est.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 68.
0 O G.U R C, 1st december 1981, loi n°81-12 du 27 novembre 1981, p. 2642.
0 Ibid. p. 2645.
0 Ibid. p. 2643.
96
individuellement ou regroupés en société0. Toutefois, l'exploitant étranger pouvait être autorisé à soumissionner en vue d'étendre son exploitation sur une superficie contigüe inferieure ou égale à 25 000 ha0.
L'obtention d'une licence imposait l'installation d'une industrie forestière ou la mise en valeur de celle existante0.
Nous constatons ici que le régime de 1981 insistait sur la protection et la mise en valeur des forêts comme les lois précédentes. Mais dans le souci d'améliorer certaines dispositions forestières, certains de ses articles ont été modifiés.
Entre 1983 et 1994, le régime forestier précédent a été aménagé par les décrets et l'instruction ministérielle.
Le 12 Avril 1983 était signé le décret n°83-169 fixant le régime des forêts0. Celui-ci dans ses articles 1 et 2 insistait sur la régénération des forêts, les définitions et droits d'usage0.
Selon la disposition de l'article 1 `' La régénération des forêts a pour but d'assurer la pérennité du patrimoine forestier national `'0. Cette disposition souligne la volonté de l'Etat camerounais de faire de la régénération l'une des solutions importantes pour pérenniser les forêts. A travers cette politique, les surfaces de forêts détruites par l'exploitation devaient être reconstituées soit par le reboisement soit par la régénération naturelle.
Le décret définissait les forêts en réserve naturelle intégrale, forêt de production, forêt de protection, forêt récréative, périmètre de reboisement et jardin botanique selon leurs droits d'usages0. Dorénavant, les forêts étaient bien réparties selon leurs usages, le gouvernement camerounais attendait que ceux-ci soient respectés. Par exemple, une forêt de production était un périmètre destiné à la production des bois d'oeuvre et de service ou de tout autre produit forestier, tandis qu'une forêt de protection était un périmètre dont l'objet principal fut la protection du sol, du régime des eaux ou de certains écosystèmes présentant un intérêt scientifique0 .
0 Ibid
0 J.O R.U.C, n°22 du 1er Décembre 1981, p.
0 Ibid
0 J.O R.U.C, du 15 Mai 1983, p. 1227.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Ibid.
97
L'exploitation des forêts du domaine national était subordonnée à un dossier complet qui devait être soumis à une commission technique0. Et le métier des forêts n'était plus réservé à tout le monde comme auparavant. Ainsi les articles 27, 28, 29 régissaient l'agrément à la profession forestière0.
Un agrément à la profession forestière, considéré comme une attestation professionnelle à cette activité, conditionnait déjà l'obtention d'une parcelle de forêt pour l'exploitation. Mais en 1983, il fallait le redéfinir et mieux le spécifier0. Dorénavant, toute personne physique ou morale voulant exploiter la forêt devait au préalable avoir été reconnue capable d'exercer cette profession0. Cet agrément à la profession était sanctionné par arrêté du Président de la République sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes :
- une demande timbrée précisant le nom, prénom, nationalité profession et résidence ;
- un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au moins ;
- d'un curriculum vitae. Lorsqu'il s'agissait d'un particulier0.
Et lorsqu'il s'agissait d'une société, il fallait :
- Une demande timbrée précisant la raison sociale et le siège de la société ;
- Les statuts ; l'extrait du casier judiciaire du directeur ou du gérant datant de moins de
trois mois ;
- Le curriculum vitae du directeur ou du gérant0.
Le dossier doit comporter en outre des pièces justificatives suivantes :
- Des connaissances techniques du responsable de l'exploitation forestière ;
- Des investissements réalisés ou les garanties de ceux prévus ;
- D'un capital qui doit être équivalent à au moins 20% des investissements prévus,
conformément aux comptes d'exploitation prévisionnels0.
0 La commission technique était un organe qui donnait son avis à l'administration chargée des forêts avant toute instruction sur une demande d'agrément à la profession forestière, les demandes d'octroi de licence d'exploitation forestière, de renouvellement, de transfert ou d'abandon de ces titres...etc. cette commission était composée du ministre chargé des forêts ou de son représentant, du représentant de l'assemblée nationale, du représentant du ministre de l'administration territoriale, du représentant du ministre des finances, du représentant du ministre de l'économie et du plan, du représentant du ministre de l'urbanisme et de l'habitat, du représentant du ministre des mines et de l'énergie...etc.
0 JO.RUC ; 1983, p. 1234
0 Ebela, `' L'exploitation forestière», 2007/2008, p. 17.
0 Ibid.
0 JO.RUC ; 1983, p. 1234
0 Ibid.
0Ibid.
98
Il est visible que le régime de 1983 avait pour but de réformer l'activité forestière en la rendant rentable et en s'attardant sur la protection des forêts à travers une définition précise de leurs usages. Ce décret est complété par l'instruction ministérielle de 1984.
L'instruction ministérielle n°1272 du 31 Aout 1984 complétait les dispositions de la loi 81-13 du 27 novembre 1981 et du décret 83-169 du 12 avril 1983, réorganisant l'exploitation forestière au sein des populations locales0. En effet, celle-ci donnait le pouvoir aux conservateurs de décerner des autorisations de coupe d'arbres à usage personnel aux populations éloignées des usines de transformation, pour pouvoir bénéficier de ce produit0. Ainsi, cela les permettaient de subvenir à leurs besoins de construction et d'ameublement de leurs cases0.
Pour obtenir ces autorisations il fallait introduire un dossier auprès du chef de poste ou du chef de section du département concerné. Le demandeur devait néanmoins payer 15 % de la valeur mercuriale de l'essence brute sollicitée0.Par exemple il fallait débourser 975 francs en cas de sollicitation de l'Iroko dont le prix FOB était évalué à 7500 francs. Il lui était donné un délai pour l'exploitation de son arbre. Ce délai dépendait de l'éloignement du bénéficiaire par apport à l'arbre sollicité et les moyens qu'il dispose0.
Ainsi, les autorités voulaient impliquer les populations locales dans l'exploitation de leur forêt, ceci dans le respect des normes établies par le législateur.
Après cette instruction de 1984, nous avons dénombré d'autres décrets dont celui du 20 février 1990 et celui du 9 avril 1992. Seulement ceux-ci venaient restructurer l'administration forestière au Cameroun0.
Il faut retenir ici que depuis l'ordonnance de 1961 jusqu'au décret de 1992, la législation forestière au Cameroun avait fait une évolution progressive. Car nous sommes parties des lois calquées sur les régimes coloniaux pour arriver aux régimes forestiers solides et efficaces pour réglementer l'activité forestière au Cameroun. Il faut dire que ça n'avait pas été facile vue l'immaturité que accusait le pays après les indépendances. Ceci fut possible grâce à la volonté de l'Etat camerounais qui cherchait à parfaire les lois forestières au
0 Ebela, `'L'exploitation forestière», 2007/2008, p. 18. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 Ibid.
99
Cameroun pour une exploitation durable en protégeant en même temps certaines zones forestières pour d'autres usages et en encourageant la régénération.
Pourtant les pressions qu'exerce la Banque mondiale pour les réformes forestières sur les pays d'Afrique centrale dont fait partie le Cameroun et les problèmes environnementaux mondiaux vont très vite déceler plusieurs insuffisances dans la législation forestière camerounaise. D'où la grande réforme forestière de 1994.
L'analyse de la législation forestière et environnementale entre 1994 et 2010 passera par la loi forestière de 1994, la loi cadre de l'environnement de 1996, leurs aménagements et les résultats obtenus sur leur application.
Cette fameuse loi s'avérait être complète, ceci à travers les règles à observer et les sanctions prévues en cas de violation de ces dernière. C'était une grande révolution dans la politique forestière du Cameroun depuis 1961. Certains iront jusqu'à dire qu'elle était la plus meilleure en Afrique centrale0. Comme aucune oeuvre humaine n'est parfaite, quelques une de ses dispositions ont été modifiées dès son application en 1995.
La législation forestière de 1994 visait quatre objectifs. A savoir :
- Une meilleure protection du patrimoine forestier national ;
- La protection de l'environnement et de la biodiversité ;
- L'amélioration du niveau de vie de la population rurale à travers une meilleure
intégration de la foresterie dans le développement rural ;
- L'augmentation de la part du secteur de la foresterie dans le PIB0
La première grande innovation de cette loi était l'association des autres ayant droits de propriété des forêts en dehors de l'Etat. C'est dans l'article 7 de celle-ci qu'on pouvait lire `' L'Etat, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur
0 UICN, `'Promouvoir l'efficacité en Afrique centrale et occidentale», rapport annuel 2008, p. 8.
0 Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts de la faune et de la pêche», Centre d'Etude Fiscale et d'Appui à la Gestion (CAFAG : le Partenaire Fiscal), Première édition Mars 2000, pp. 14-25.
100
leurs forêts et leurs établissements aquacoles, tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par les législations foncière et domaniale et par la présente loi `'0. Elle est qualifiée de nouvelle par ce qu'avant 1994, seul l'Etat était propriétaire des forêts. Les autres pouvaient seulement avoir les droits d'usage tels que l'usage des parcelles forestières pour des fins agricoles par les paysans.
Dans de ce régime forestier, on parle de forêts communales (article.30), communautaires (article.37), et forêts des particuliers (article.39)0. Les fruits de cette innovation sont très vite perceptibles chez les communautés riveraines. Les chiffres communiqués par la cellule de foresterie communautaire en 2002 indiquent que 35 forêts communautaires ont été attribuées par le MINEF0. Il s'agit entre autres de celles de Bengbis, Bimboué, Bosquet, Ngola, Kongo, Koungoulou, Eschiambor ; etc.0
Pour la protection de la nature et de la biodiversité, cette loi interdit la provocation des feux de brousse sans autorisation préalable, de déverser dans le domaine forestier national, ainsi que dans les domaines public, fluvial, lacustre et maritime un produit toxique ou déchet industriel sensible de détruire ou de modifier la faune et la flore0. Cette disposition sur l'interdiction de provoquer les feux de brousse est respectée par certaines sociétés à l'instar de TTS. En effet, lors de notre visite là bas, nous avons constaté que la société ne brulait plus les déchets de bois comme dans les années précédentes. Ce qui est un pas à saluer pour cette loi.
L'article 16 de la loi de1994 initie une étude préalable d'impact sur l'environnement avant toute mise en oeuvre de tout projet de développement susceptible d'entrainer des perturbations en milieu forestier ou aquatique0.
Cet ensemble de dispositions visaient à protéger la nature et la biodiversité du Cameroun dans le sens de les préserver pour la pérennité. Et encourager les reboisements à travers les prises de mesures incitatives.
0Ibid. p. 14. Et confère Annexe III page 144.
0 Ibid. pp. 17-19. Et confère Annexe III page 144.
0 Bigombe Logo, `'Foresterie communautaire et réduction », 2008.
0 Ibid.
0 Ibid. p. 15.
0 Ibid.
101
Comme les précédents régimes, le domaine forestier national était constitué des forêts permanentes et des forêts non permanentes. Chaque forêt permanente doit faire l'objet d'un plan d'aménagement0. Elle peut être divisée en unités forestières d'aménagement (UFA)0.
A partir de cette loi, nous constatons que la forêt plus que jamais est mise dans un cadre de lois qui la protège de tous les dangers, menaces, et de l'exploitation anarchique. L'aménagement de celle-ci devient une condition préalable pour son exploitation. Ceci montre les intentions des autorités camerounaises de rendre les activités forestières saines et durables. C'est pourquoi l'inventaire des ressources forestières devient une prérogative de l'Etat.
L'exploitation forestière entre dans une autre optique qui tend vers le développement durable. Par apport aux régimes antérieurs cette loi voudrait que l'exploitation des forêts soit pour une fois transparente et arrimée aux normes internationales. Ainsi au début de chaque année, l'administration chargée des forêts détermine la possibilité annuelle de coupe de l'ensemble des forêts domaniales de production ouverte à l'exploitation0.
Dorénavant, l'exploitation d'une forêt domaniale de production se fait, soit par vente de coupe, soit par convention d'exploitation. Une vente de coupe dans une forêt domaniale de production est une autorisation d'exploiter pendant une période limitée un volume de bois vendu sur un pied et ne pouvant dépasser la possibilité annuelle de coupe. Elles sont attribuées aux nationaux par exception pour le cas prévu par l'article 77(2)0.
Pour ce qui est de la vente de coupe dans une forêt du domaine national, le ministère attribue une autorisation d'exploiter une superficie ne pouvant dépasser 2 500 hectares, un volume précis de bois vendu sur pied. Dans les forêts du domaine national, les ventes de coupes sont concédées après avis d'une commission compétente pour une période de 3 ans non renouvelables0. Elles sont attribuées par le Ministre chargé des forêts pour une période d'un an non renouvelable.
0 L'aménagement d'une forêt permanente se définit comme étant la mise en oeuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêté au préalable, d'un certains nombre d'activités et d'investissements, en vue de la production soutenue des produits forestiers et des services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effet indésirables sur l'environnement physique et social. (Loi n°94 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, p.16).
0 Ibid. p. 17.
0 Ibid. p. 20.
0 A l'expiration des anciens titres d'exploitation localisés dans le domaine forestier permanent, leurs titulaires peuvent bénéficier exceptionnellement de vente de coupe dans la zone concernée pendant une période maximale de trois ans, à condition qu'ils soient détenteur d'une unité de transformation du bois et conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application (Loi de 1994, p.25)
0 Ibid.
102
Quant à la convention d'exploitation, elle confère au bénéficiaire le droit d'obtenir un volume de bois donné provenant d'une concession forestière, pour approvisionner à long terme son ou ses industrie(s) de transformation du bois. La convention d'exploitation est assortie d'un cahier de charges et définit les droits et obligations de l'Etat et du bénéficiaire. Le volume attribué ne peut en aucun cas dépasser la possibilité annuelle de coupe de chaque unité d'aménagement concernée. La convention d'exploitation forestière est conclue pour une durée de quinze ans0. La superficie totale pouvant être accordée à un même concessionnaire est fonction du potentiel de la concession forestière calculé sur la base d'un rendement soutenu et durable de la capacité des industries de transformation existantes ou à mettre en place. Elle ne peut en aucun cas excéder 200 000 hectares0. En 1999 Assene Nkou obtient une convention pour l'obtention de l'UFA 10 044 dans le secteur d'Abong-bang0.
Une autre disposition qui marque cette loi est la transformation à hauteur de 70% par essence de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de 5 ans à compter de la date de promulgation. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par l'industrie locale0.
Avec cette loi, les titres sont attribués sur appel d'offres lancé par le ministère. Après
l'obtention d'une concession, l'exploitation se fait en combinaison avec l'aménagement qui
comprend :
- les inventaires ;
- les reboisements ;
- la régénération naturelle ou artificielle ;
- l'exploitation forestière soutenue ;
- la réalisation des infrastructures0.
La loi forestière de 1994 a révolutionné la législation dans ce domaine au Cameroun.
Beaucoup de choses ont changé comme nous pouvons le constater dans ses dispositions.
Ce régime confère au pays une politique forestière répondant aux conditions du
développement durable. L'association des collectivités à la gestion des forêts à travers les
forêts communales et communautaires est saluée par toute la communauté nationale et
0 Ibid. p. 21.
0 Ibid.
0 `'Audit économique et financier', MINEFI, 2006, p. 68.
0 Loi n°94 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
0 Ibid. p. 22.
103
internationale. Ce que le délégué de la commission européenne faisait remarquer aux autorités camerounaises en novembre 1996 en ces termes :
La nouvelle législation mise en place par le gouvernement du Cameroun, le Plan d'Action National Forestier ainsi que le Plan National de Gestion de l'Environnement qui devront être mis en oeuvre à court terme et moyen terme présentent des stratégies de gestion durable des ressources naturelles similaires à
celles définies dans la convention de Lomé0.
En plus de cet avantage social, s'ajoutent les retombées économiques. Les nouvelles dispositions financières et fiscales conduisent une bonne rentabilité financière par rapport au passé. Par exemple les recettes forestières sont passées entre 1992 à 2010 de quatre milliards à quarante milliards de franc CFA0. Nous pouvons observer dans ce volet que pour les ventes de coupe et les conventions d'exploitation forestière, les charges financières prévues à l'article 66 alinéa (3) sont constituées outre la patente prévue par le code général des impôts, par :
- La redevance forestière annuelle assise sur la surface et dont le taux est fixé par la loi
des finances ;
- La taxe d'abattage des produits forestiers,
c'est-à-dire la valeur par espèce, par
volume, poids ou
longueur, estimée selon des modalités fixées par
décret ;
- La surtaxe progressive à l'exportation des produits forestiers non transformés ;
- La contribution à la réalisation des oeuvres sociales ;
- La réalisation de l'inventaire forestier ;
- La participation aux travaux d'aménagement0. En 1995 est signé le décret
d'application de cette loi.
Le décret n°95/531/PM du 23 Aout 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts0 est la première parmi ces lois qui viennent compléter la loi de 1994.
Ce décret définit le processus d'attribution des concessions. Ainsi, dans son article 64 nous découvrons que les concessions forestières sont attribuées après avis d'une commission interministérielle et à la procédure d'appel d'offres public prévue à l'article 63. Pour ce qui est du processus, après le dépôt des offres par les soumissionnaires, la commission interministérielle présélectionne et classe les soumissionnaires les mieux disant sur la base des
0`'Table ronde internationale des donateurs sur l'environnement au Cameroun», MINEF, rapport général, Yaoundé 08 novembre 1996, p. 24.
0 `'Ministère de la forêt et de la faune au Cameroun», http://cameroon 50, 2010, consulté le 15 novembre 2010. 0 Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts », 2000, p. 23. Et confère Annexe III page 144.
0 Décret n°95/531/PM du 23 Aout 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts
104
critères suivants, en tenant compte des seuils minima arrêtés au préalable par le ministre chargé des forêts dans l'avis d'appel d'offres :
- Les investissements programmés ;
- Les capacités financières y compris les garanties de bonne exécution ;
- Les capacités techniques et professionnelles ;
- Le respect des engagements ultérieurement pris dans les mêmes domaines0 ;
De la liste des soumissionnaires établie, la commission sélectionne le soumissionnaires offrant le montant le plus élevé de la redevance forestière assise sur la surface, dont le taux plancher est fixé par la loi des finances0. Pendant les premiers appels d'offres de 2000, Thanry avec la CFE sa filiale récupère 230 000 hectares de forêt0.
Dans le cas ou deux ou plusieurs soumissionnaires présentent des offres d'un montant identique, la concession provisoire est attribuée sur la base des coefficients de pondération affectés par le ministre chargé des forêts aux critères énumérés.
En effet, ce règlement encadre l'exploitation forestière au Cameroun. Et tous les acteurs du secteur forestier sont invités à l'observer sous peine de sanctions. Ces sanctions sont prévues dans la loi de l'environnement.
La loi n°96/12 du 5 Aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement stipule dans son article 1 que `'La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun''0. Ainsi, la gestion de la forêt en tant qu'une partie intégrante de l'environnement devait répondre aux dispositions de la loi de celui-ci.
Dans son article 9, la loi de 1996 indique les sources aux quelles s'inspirent la gestion de l'environnement et des ressources naturelles dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Ces sources sont des principes. Ils sont entre autres le principe de précaution, le principe d'action préventive et de correction, le principe de responsabilité, le principe de participation, le principe pollueur-payeur et le principe de subsidiarité0.
0 Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts '', 2000, p. 59.
0 Ibid.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 64.
0 Ossama, Le cadre juridique des forêts et de l'environnement, 2007, p. 205.
0 Loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
105
Les articles 13 et 14 disposent que le gouvernement est tenu d'élaborer un plan national de gestion de l'environnement qui est révisé tous les cinq ans et l'administration chargée de cet environnement veille à l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques énergétiques, fonciers et autres0. En février 1996, le MINEF avec la collaboration du PNUD et le co-financement de la banque mondiale met sur pied ce plan0. Avant tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation une étude d'impact doit être faite par le maître d'oeuvre. Sa charge revient au promoteur stipule l'article 170.
La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes et la conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction sont d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel0.
Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. L'utilisation durable de la diversité biologique du Cameroun se fait notamment à travers :
- un inventaire des espèces existantes, en particulier celles menacées d'extinction, - des plans de gestion des espèces et de préservation de leur habitat,
- un système de contrôle d'accès aux ressources génétiques0.
La conservation de la diversité biologique à travers la protection de la faune et de la flore, la création et la gestion des ressources naturelles et des parcs nationaux sont régies par la législation et la réglementation en vigueur0.
L'exploitation scientifique et l'exploitation des ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec des institutions nationales de recherche, les communautés locales et de manière
0 Confère Annexe IV de la page p. 156.
0 `'Plan national de gestion de l'environnement», MINEF, volume II, Yaoundé, février 1996.
0 Ossama, Le cadre juridique des forêts et de l'environnement, 2007, pp. 213-214.
0 Ibid. p. 228.
0 Ibid.
0 Ibid. p. 229.
106
profitable au Cameroun dans les conditions prévues par les conventions internationales en matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique0. Celle-ci à ce propos indique que :
Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :
a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources
biologiques dans le processus décisionnel national ;b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer
les effets défavorables sur la diversité biologiques ;c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux
pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec des impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable ;d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones
dégradées où la diversité biologique a été appauvrie ;e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des
méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques0.
La loi sur l'environnement englobe tous les domaines de la vie publique et privée. Elle interpelle toutes les forces, quelles soient des personnes morales ou physiques. Elle invite tout le monde à protéger la nature et à conserver les écosystèmes à travers l'observation simple de ses dispositions. Sinon, elle prévoit aussi des sanctions en cas de transgression de ces dispositions.
En ce qui concerne les sanctions encourues en cas de non respect des dispositions définies, la loi forestière de 1994 et la loi n°96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ont réservé une bonne partie de leurs dispositions à celles-ci. Dans ce sens, il existe des sanctions administratives et des sanctions pécuniaires. Les sanctions administratives sont prévues par la loi de 1994. Elles vont de la saisie des objets illicitement obtenus au retrait des titres d'exploitation0. La saisie intervient lorsqu'on interpelle le délinquant en possession des ressources illicitement prélevées (grumes ou produit forestier). Le bois est saisi et frappé de sceau `'saisie» au marteau forestier et un procès verbal conformément à l'article 142 de la loi forestière est établi. Les objets saisis sont vendus aux enchères ou au gré-à-gré0. En dehors de la saisie il y a la confiscation.
La confiscation est la privatisation du contrevenant des objets ayant permis la commission de l'infraction. Ils peuvent être les engins. Si c'est un délinquant primaire, c'est-
0 Ibid.
0 A AN, Convention sur la diversité biologique, juin 1992
0 Loi n°94 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, p. 398. 0 Noundou, `'L'application du droit international», 2005, p. 13.
107
à-dire impliqué pour la première fois, les produits confisqués lui sont restitués sous condition de l'exécution définitive de la transaction, s'il est récidiviste, ils sont vendus aux enchères0.
La suspension et le retrait du titre d'exploitation sont les recours que les autorités forestières utilisent en situation de récidivité. La suspension est prononcée par le ministre chargé des forêts. La récidive est passible d'une amande au moins ou égal à 3 000 000 FCFA et est sanctionnée par la suspension0.
Quant au retrait du titre de l'exploitation forestière, il est le plus souvent décidé par la même autorité. Ceci survient quand l'exploitant poursuit ses activités pendant la suspension. Les sanctions administratives sont parfois accompagnées des sanctions pécuniaires.
Les sanctions pécuniaires sont constituées essentiellement des amandes dont le montant est fonction de la gravité de l'infraction. Par exemple en décembre 2000, CAMBOIS s'est vue sanctionnée pour une première infraction commise en avril de la même année, mais pour deux autres commises dans le Dja et Lobo. Elle est dont frappée d'une amande de huit millions de francs CFA, plus de 71,9 millions de francs CFA de dommages et intérêt0.
Les infractions contre la forêt sont multiples et leur degré de dévastation important, raison fondamentale pour laquelle leurs sanctions sont lourdes0. Et il incombe aux autorités compétentes de constater des infractions et d'infliger les sanctions. Par exemple, pour sa responsabilité dans le pillage de la réserve de Campo ma'an, la HFC s'est vue dressée contre elle deux procès verbaux entre 2000 et 20010.
Sur le plan institutionnel, la réglementation camerounaise remet à titre principal la protection de l'environnement au MINEP. Cependant d'autres autorités administratives dont les activités ont une incidence sur le milieu naturel se voient également reconnaitre des prérogatives pour la préservation des ressources naturelles0.
C'est le secrétariat permanent à l'environnement à travers la brigade des inspections environnementales qui assume ce rôle.
0 Ibid.
0 Ibid. p.15.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, pp. 27-28.
0 Noundou, `'L'application du droit international», 2005, p. 13.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 69.
0 Noundou, `'L'application du droit international», 2005, p. 13
108
Au terme de la loi de 1994 les autres services en charge de la protection de l'environnement sont entre autres la brigade provinciale de contrôle forestier, le service de la faune, le service des pêches, de l'élevage et des industries animales0.
La brigade régionale forestière est chargée d'assurer sur le terrain les différents contrôles et vérification liés à l'exploitation normale des forêts. Toutefois afin de renforcer le contrôle, il est créé en 2000 au MINFOF une unité centrale de contrôle (UCC). Elle est chargée d'exécuter des missions spéciales sur le terrain, sur l'instruction du ministre, de proposer les sanctions, à infliger aux auteurs et co-auteurs d'infractions forestières. Cette structure qui possède une compétence nationale a pour fonction de veiller à la bonne application des règlements relatifs à l'exploitation forestière, la découverte et la poursuite en justice des exploitants frauduleux0. Cet ensemble de sanctions complète ainsi le cadre législatif des forêts. Dans l'optique de solidifier et de rendre efficaces ces deux lois, les aménagements vont se faire plus tard.
Le décret n°95/466/Pm du 18 décembre 1995 instituant un cadre indicatif d'utilisation des terres en zone forestière méridionale s'ajoute à la loi de 19940. Ce décret vient rendre exécutoire le plan d'affectation des terres du Cameroun méridional (plan de zonage) couvrant 14 011 065 hectares dans la zone forestière( les régions de l'Est, Sud, Centre, Littoral et Sud-Ouest, Ouest) élaboré sur la base des résultats d'un inventaire forestier national0. De ce fait la loi de 1994 divise le domaine forestier national en deux :
- le domaine forestier permanent avec 12 millions d'hectares dans la zone forestière affectés à la production du bois d'oeuvre et à la conservation.
- le domaine forestier non permanent ou domaine à vocations multiples pour environ 8,5 millions d'hectares de toute l'étendue forestière. C'est le domaine où se développent toutes les activités de production agropastorales en milieu rural0. La conséquence de ce décret
0 Ibid.
0 Ibid. p. 19.
0 Ngole Ngole, `' Foresterie, les potentialités et opportunités d'investissement dans le secteur forestier», exposé
lors du Cameroon Investment Forum de Yaoundé, 2009.
0 Ibid. p. 3.
0 Ibid.
109
est la limitation des surfaces que doivent occuper les paysans pour leurs activités agricoles et pastorales. Ce qui semble très difficile pour ceux-ci.
L'ordonnance n°99/001 du 31 Aout 1999 complétant certaines dispositions de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche apporte certaines dispositions complétant celles de l'article 71 (1) de la loi de 1994. Ainsi dans son unique article, elle stipule que :
Les grumes sont transformées à hauteur de 70% de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par les industries locales. Toutefois, sous réserve du paiement d'une surtaxe, l'exportation des grumes pourra se poursuivre dans le cadre de la promotion de certaines essences0.
Cette ordonnance du chef de l'Etat vient assouplir les dispositions de cet article 71 qui militaient pour un arrêt total des exportations des grumes cinq ans plus tard. Elle vient mettre l'exception à cette loi quand il s'agit des essences de promotion.
Son décret d'application est celui n° 99/781/Pm du 1er octobre 1999, celui-ci précise que l'exportation sous forme de grumes des essences dont la liste se trouve dans l'annexe du dit décret est interdite0. Alors que celle sous forme de grumes des essences de promotion dont la liste figure à la même annexe est autorisée, sous réserve du paiement des droits de sortie et d'une surtaxe à l'exportation0.
Cette ordonnance du premier ministère se termine par l'article 4 qui rapporte que compte tenu de la nécessité d'assurer une gestion nationale et durable des ressources forestières, le ministre chargé des forêts peut, lorsque le comportement de certaines essences sur le marché et/ou leur degré de transformation locale l'exige, modifier par arrêté la classification prévue aux annexes V et VI du présent décret0.
Cette ordonnance vient rendre très complexe cette loi sur l'interdiction des grumes, car à partir d'elle, le pouvoir revient au Ministre chargé des forêts de décider sur quelles essences exportées ou lesquelles interdire l'exportation. Ce qui complique la compréhension et même l'objectif orignal de cette loi.
0 Ordonnance n°99/001 du 31 août 1999 complétant certaines dispositions de la loi de 1994.
0 Confère Annexe V de la page
0 Décret n°99/781/PM du 1er octobre 1999 fixant les modalités d'application de l'article 71 (1) ( nouveau) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche. Et confère Annexe VI de la page
0 Confère Annexe V et VI pages pp. 166-1667.
110
L'arrêté n°0293/MINEF/ du 21 mars 2000 fixant les critères de sélection et les procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière0 définit clairement les critères de sélection. Ces critères sont : les investissements réalisés et/ou programmés, les capacités financières et aux garanties de bonne exécution, les capacités techniques et professionnelles, le respect des engagements antérieurement pris et des lois et règlements concernant la protection de l'environnement0. Alors pour les ventes de coupe, le soumissionnaire doit être propriétaire ou locataire d'un matériel prévu par cette réglementation ; fournir une caution bancaire ou une ligne de crédit d'un montant minimum de soixante millions pour le critère financier ; pour le critère technique, le soumissionnaire au vente de coupe doit être préalablement agréé à la profession forestière et justifier pour les personnes physiques d'une formation technique de base appropriée ou d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'exploitation forestière ; les seuils minima en matière de respect des engagements antérieurement pris tiennent compte des clauses générales0 et des clauses particulières0 du cahier de charges.
Pour les concessions à la place de ces critères, le soumissionnaire doit être propriétaire du matériel visé haut, il doit aussi posséder une unité de transformation ayant une capacité annuelle égale au moins à 50% de la possibilité annuelle de coupe de la concession, produire une caution bancaire ou une ligne de crédit garantissant le financement de 100% de l'acquisition et de la mise en place d'une telle unité de transformation0. Cette ordonnance s'applique à travers les appels d'offres de juillet 2000. Celui-ci mettait en compétition les firmes Rougier, Bolloré, Pallisco, Wijma, Thanry ; etc0.
Le décret n° 2000/092/Pm du 27 Mars 2000 modifie le décret n°95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts. Ce décret qui n'est pas d'une grande portée par apport à ceux précédemment décrétés fait une modification sur le dossier à déposer auprès du ministère chargé des forêts par les soumissionnaires en vue
0 Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts », 2000, p. 169.
0 Ibid.
0 Les clauses générales sont : l'exploitation illégale, sans titre ; exploitation en dehors des limites du titre ; toute autre infraction répétée aux réglementations de l'exploitation forestière ; toute exploitation répétée aux lois relatives à la protection de l'environnement (Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts », Mars 2000, pp.170-171)
0 Les clauses particulières sont pour les ventes de coupe et les concessions forestières, le paiement intégral de toutes les charges fiscales ; pour les concessions forestières, la mise en place effective de l'unité de transformation de bois prévue lors de l'octroi d'une concession forestière précédente
0 Dieudonné Njokou, `' Régime des forêts », 2000, p. 169. .
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, pp. 2002, 57-61.
111
d'obtenir une concession forestière0. Le nouveau décret supprimait la disposition de cet article qui exigeait à fournir dans le dossier `'Un contrat de partenariat industriel et/ou financier avec un exploitant de nationalité camerounaise, titulaire d'une concession forestière pris individuellement ou regroupé en société où les personnes de nationalité camerounaise détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote''0. Ce décret venait ainsi affranchir les entreprises étrangères de la dépendance des nationaux. On a pu remarquer qu'aux appels d'offres de juillet 2000, on a eu une bonne franche de sociétés étrangères qui n'avaient pas de partenaires camerounais telles que Thanry, Cambois ; etc0.
L'arrêté n°0222/A MINEF/25 mai 2002 portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre des plans d'aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent0. Cet arrêté organise et définit la politique des plans d'aménagement. Son article 11 est celui qui semble résumer toutes les dispositions de cet arrêté. Ainsi il stipule que : «Le plan d'aménagement précise comment seront satisfaits les obligations du cahier des charges relatives à la protection de l'environnement et quelles seront les mesures qu'il mettra en oeuvre en matière d'infrastructure d'exploitation à faible impact et de protection de la faune en plus les normes d'interventions en milieu forestier''0. Les normes d'interventions en un lieu forestier s'appliquent à toute exploitation forestière. Elles font partie de la réglementation forestière et complétant le cahier des charges en vue de minimiser les impacts de l'exploitation sur l'environnement. Les différents articles de ces normes sont regroupés sous les chapitres suivants :
- la protection des rives et plan d'eau ;
- la protection de la qualité d'eau ;
- la protection de la faune ;
- le tracé, la construction et l'amélioration des routes forestières ;
- l'implantation des parcs à grumes ;
- l'exploitation (abattage) et le débardage0.
Cet arrêté entre en droite ligne avec la volonté des autorités camerounaises à compléter et préciser les différentes dispositions du décret de 1995. Il concerne le volet de
0 Article 65 du décret n°95/531/PM du 23 Août fixant les modalités d'application du régime des forêts.
0 Njokou, `'Regime des forêts de la faune'', 2000, p. 59.
0 `'Audit économique et financier'', MINEFI, sept 2006, pp. 33-34.
0Ossama, Le cadre juridique des forêts , 2007, p.160
0 Ibid.
0 Ibid. p. 162.
112
l'aménagement invoqué dans le dit décret. Par conséquent, son application traduit le souci du Cameroun à protéger l'environnement. Quelques mois plus tard, Pallisco réalise les inventaires d'aménagement forestier, les études socio-économiques et les études fauniques en relation avec des organismes nationaux spécialisés et agrées, une pépinière (environ 30 000 plants) est également implantée. A la fin du mois de novembre 2004, les deux plans d'aménagement sont validés par le ministère en charge des forêts0. Beaucoup d'autres décrets vont suivre dont celui de 2007.
Le décret n°2007/342/PM du 07 mars modifie et complète certaines dispositions du décret de 1995. Ces changements touchent les articles 86 et 940. On constate que les permis d'exploitation pour le bois de chauffage, les perches ou bois d'oeuvre en vue de la transformation artisanale, sont réservés exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise ou aux sociétés où ces personnes ont la totalité du capital social ou du droit de vote0.
On remarque que les permis d'exploitation pour certains produits spéciaux, la récolte des produits forestiers à des fins scientifiques, du bois d'oeuvre en vue de la transformation artisanale sont attribués par le ministre chargé des forêts après avis d'un comité technique interministériel.
L'article 94 stipule que pour satisfaire leurs besoins domestiques, les personnes titulaires d'autorisation personnelle de coupe de nationalité camerounaise peuvent abattre un nombre limité de bois dans les forêts du domaine national. Sauf pour les riverains qui conservent leurs droits d'usage0.
En ce qui concerne les aménagements de la loi cadre de 1996, le décret du premier du 23 février 2005 et l'arrêté ministériel du 08 mars 2005 constituent l'essentiel.
Le décret de février 2005 fixait les modalités de réalisation des études d'impact environnemental0. Par exemple l'article définit le contenu d'une étude d'impact environnemental sommaire. Il comprend :
- La description de l'environnement du site et de la région ;
- La description du projet ;
- Le rapport de la descente sur le terrain ;
0`'Pallisco-cifm historique des entréprises pallisco», http://www.pallisco-cifm.com consulté le 15 octobre 2010. 0 Décret n°2007/342/PM du 07 mars 2207 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts, p. 1.
0 Ibid.
0Ibid. p. 2.
0 Art 1 du décret n°2005/ 0577/ PM du 23 février 2005 sur les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.
113
- L'inventaire et la description des impacts de projet sur l'environnement et les mesures d'atténuation envisagées ;
- Les termes de référence de l'étude ;
- Les références bibliographiques0.
L'initiation de la procédure d'étude d'impact environnemental passe par le dépôt d'un dossier du promoteur auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce dossier comporte une demande de réalisation de l'étude d'impact environnemental, les termes de référence de l'étude, l'accent sur la préservation de l'environnement, une quittance de versement des frais du dossier0.
L'article 11 stipule que la réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet0.
Quant à l'arrêté ministériel du 8 mars 2005, il fixe les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental.
Dans cet arrêté, on constate les aménagements au niveau de l'article 2. Il stipule que l'étude d'impact environnemental peut être sommaire ou détaillée et s'applique à l'ensemble du projet. Toutefois en cas de réalisation échelonnée ou d'extension du projet, chaque phase peut faire l'objet d'une étude d'impact environnemental0.
L'article 4 de cet arrêté liste les opérations ou les activités qui sont soumises à une étude d'impact environnemental détaillée. A l'article 5 on peut lire que les opérations ou activités visées aux articles 3 et 4 ci-dessus et qui sont en fonctionnement ou en exploitation sont soumises à un audit environnemental0.
Ce décret et cet arrêté viennent compléter et renforcer le droit environnemental du Cameroun. Car ce droit a notre humble avis semble être la loi maitresse de toutes les règles sur la réalisation de tous les projets.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Arrêté n° C 69/ MINEP du 08 mars 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est
soumise à une étude d'impact d'impact environnemental.
0 Ibid.
114
L'aménagement des forêts, la réduction des titres d'exploitation à deux, l'attribution des concessions par appel d'offres après étude d'une commission sont autant d'innovations qui ont rendues l'activité forestière rentable et bénéfique pour l'économie du pays et certaines collectivités locales. L'interdiction d'exploiter certaines essences d'arbres allait développer la transformation locale en créant plusieurs emplois dans l'avenir dans le secteur des forêts.
En effet, les résultats de la loi de 1994 ne se sont pas fait attendre. En dehors de l'augmentation de la contribution du secteur forestier au PIB, la lutte contre la pauvreté à travers la rétrocession d'une partie des recettes fiscales aux collectivités, la création d'emplois et la mise en place des forêts communautaires et communales.
Après les réformes forestières de 1994, on a remarqué une profonde augmentation de la contribution des revenus au PIB. Ainsi, cette contribution est passée de 1, 53 milliards en 1992 à 258 milliards en 20040. Dans son objectif de lutter contre la pauvreté, le gouvernement camerounais a réservé 40% de recettes fiscales au communes et 10% aux populations riveraines0. Pour ce qui est des emplois régénérés par le secteur forestier, on a aussi constaté une augmentation des chiffres. Les chiffres que le rapport 2006 du MINEFI estime à 13270 emplois0. L'autre aspect positif des résultats de ces réformes est la création des forêts communautaires et communales. En 2009, le nombre des forêts communautaires est estimé à 35 alors que les forêts communales sont estimées à 180. D'autres aspects positifs de ces résultats sont à noter. Il s'agit de l'élaboration d'un plan de zonage, le seul dans la sous région, le passage progressif à la certification forestière, l'adoption d'un mécanisme d'adjudication des titres et l'introduction des trois niveaux d'observateurs indépendants pour la gestion transparente du secteur0.
Beaucoup d'observateurs saluent la politique d'appel d'offres. Pour eux, cette politique emmène la compétitivité dans les offres des soumissionnaires, en plus à travers les critères de sélection, la commission élimine des sociétés irresponsables. L'un de ces observateurs est Giuseppe Topa0, il affirmait à Jeune Afrique Intelligence en juin 2000 que : `' Avec le système d'appel d'offres, le Cameroun a mis en place un système d'attribution des concessions, de contrôle de l'exploitation et de protection de la nature qui pourra devenir à
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 25.
0 Bigombé Logo, `'Foresterie communautaire et réduction».
0 `'Audi économique et financier», MINEFI, 2006, p. 50.
0 Bigombé Logo, `'Foresterie communautaire et réduction», 2008.
0 `'Ministère des forêts et de la faune», http. //Cameroun50, 2010.
0Giuseppe Topa, expert forestier principal de la Banque mondial pour la région Afrique.
115
long terme l'un des plus performants dans le monde''0. D'une manière générale, les travaux des commissions ont permis de donner un signal fort dans la lutte contre l'exploitation illégale par l'élimination des soumissionnaires fortement impliqués dans l'exploitation frauduleuse. C'est ce qui est arrivé à la SIM en 2000. Elle s'est vue exclue des appels d'offres de concessions de l'année 2000 pour faute lourde0. Le relèvement des critères a permis d'écarter bon nombre d'aventuriers et à rendre le secteur plus difficile d'accès, l'attribution des titres à des opérateurs qui ont investis durablement0.
Mais, beaucoup reste encore à faire, car certaines de ces dispositions n'ont pas été appliquées ou sont mal adaptées au contexte camerounais. Par exemple celles qui prévoyaient la transformation à 70% de l'essence localement et l'interdiction d'exportation des grumes cinq ans après l'application de la dite loi. On peut dire que la loi de 1994 n'a pas encore atteint les objectifs escomptés. Car nous avons constaté qu'elle a plusieurs failles. Ses manquements sont son manque de respect et son application subjective par les autorités compétentes. Cette loi semble complexe et floue dans certaines de ses dispositions. On note une diversité des sources favorables à des interprétations fluctuantes. Par exemple la liste des pièces demandées pour la confection du dossier d'appel d'offre. Ces pièces varient selon que l'on se réfère aux pièces demandées par l'article 65 du décret 095-531, aux pièces demandées par l'administration des forêts pour ces offres d'appel, aux pièces à fournir par les soumissionnaires prévues par l'article 23 du code des marchés0. Cette diversité des sources permet d'écarter ou de conserver en lice tel ou tel dossier. Le nombre de pièces demandées par l'administration des forêts est le plus complet, mais sans doute également superflu. Est-il nécessaire de demander le bilan de cinq années comparées, le plan d'investissement et les réalisations sociales pour que soit déclaré recevable le soumissionnaire ? Tout se passe comme si l'objectif de l'administration était d'écarter le plus possible de soumissionnaires sur des critères non financiers, dans les conditions parfois douteuse vu les conflits d'intérêt qui concerne certains membres de la commission0. Prenons le cas de Bonaventure Takam. L'attribution en 2001 d'une concession de presque 100 000 hectares à sa SCTB était paradoxale. Car l'offre de Takam était la plus basse de l'adjudication, plus basse même que les offres perdantes0. A ces lacunes s'ajoutent encore l'attribution à des non professionnels, la
0 Ibid. p. 58.
0 Ibid. p. 27.
0`'Audit économique et financier '', MINEF, 2006, p.50
0 Ibid. p. 50.
0 Ibid. p. 52.
0 Labrousse, Verschaves, Les pillards de la forêt, 2002, p. 72.
116
pratique de la fermage, la concurrence entre les filiales soeurs d'une même entreprise. S'agissant de ce genre de cas de concurrence truquée, dans les adjudications de 2000, deux filiales de Rougier, à savoir la CAMBOIS et la SFID étaient concurrentes pour une concession remportée par la première. Ainsi, quelle sorcellerie deux filiales du même groupe en concurrence ne sauraient au courant ni du nom ni de l'existence de leur compétiteurs éventuels ? Pourtant en se référant à la jurisprudence française qui est la plus exigeante en la matière, on peut constater que sont interdites :
Toute pratique tendant à permettre ou faciliter la coordination des offres des entreprises soumissionnaires, ainsi que les échanges d'informations entre elles antérieurement à la date ou le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut être que ces échanges portent sur l'existence des compétiteurs, leurs noms, leur importance, leur disponibilité en personnel et en matériel, leur intérêt ou leur absence d'intérêt pour le marché considéré ou le prix auquel ils se proposent de soumissionner0.
Pourtant dans la liste des soumissionnaires de juin 2000, un bon nombre de soumissionnaires qui se battaient pour une même concession étaient des sociétés associées. Conséquence, le rapport de l'observateur indépendant révèle paradoxalement que les soumissionnaires qui étaient seuls en compétition pour une UFA ont soumissionné quasiment au prix plancher. Ce qui peut laisser croire qu'ils ont eu connaissance qu'ils étaient seuls en compétition0.
Le non respect de certaines dispositions forestières par les autorités compétentes est une véritable entorse dans l'atteinte des objectifs fixés. En octobre 2000, Guisepe Topa disait que : `'Dans le cadre de sa stratégie de planification, le MINEF a accompli un travail de mise en ordre et de transparence dans la gestion des titres qui vient enfin limiter les opportunités autrefois rependues de masquer des exploitations illicites. Le MINEF a confirmé récemment que toutes les autorisations de récupération sont expirées. Toute activité menée sur un tel titre est donc désormais illégale''0. Pourtant, entre le 30 juillet 1999 date officielle de leur suppression en octobre 2000, quand la Banque mondiale félicite le MINEF, pas moins de 49 récupérations ont été octroyées0.
En dehors de ce manque de respect s'ajoutent une vérification non pertinente de certains critères tels que la possession des engins, les garanties de financement, les investissements programmés. A titre illustratif, cet extrait du rapport de l'OI en témoigne que
0 Ibid. p. 58. 0 Ibid. p. 94. 0 Ibid.
0 Ibid.
la commission a encore manqué de rigueur en acceptant un dossier qui n'a pas justifié dix jours après la caution bancaire qu'on lui exigeait. Ce qui a été pris comme une injustice par certains membres de la commission, car les cas ne sont pas jugés de la même façon0.
Les versements des redevances forestières par les sociétés forestières aux communes et aux populations riveraines qui étaient considérées comme une solution viable pour la lutte contre la pauvreté montrent plutôt un autre visage aujourd'hui. Leur multiplication ne traduit pas toujours une meilleure implication des populations locales, ou des retombées effectives sur le développement local0. De nombreuses études ont montré qu'il s'agit dans beaucoup des cas d'une instrumentalisation du dispositif légal et l'ignorance des masses paysannes, par des gens mieux organisés et nantis (élites intérieures et extérieures). Ainsi les réalisations sociales provenant des revenus de l'exploitation des ces forêts sont souvent imperceptibles. Les photos ci-dessous illustrent suffisamment quelques abus notoires et autres investissements dont la pertinence peut être questionnée.
117
0 Ibid. p. 53.
0 `'Audi économique et financier», MINEFI, 2006, pp. 92-93.
Les photos n°17 - 24 : les réalisations issues des redevances forestières des communes de la région de l'Est.

Figure 49 : Ce hangar a coûté plusieurs millions !

Figure 50 : Idem

Figure 50: Ce comptoir commercial a été facturé 10 millions par une commune rurale


Figure 53 : Foyer communautaire construit avec les fonds RFA (les 10%) : Quelle importance pour les populations
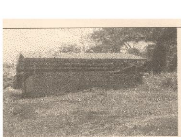
Figure 52: Comme ces deux là (10 millions chacun)
Figure 54 : Exemple de surfacturation , édifice à 8 millions de FCFA ?

118
Figure 55 : Ce puit a été facturé à 5 millions de FCFA
Figure 56 : Matériel coûteux ayant très peut servi et
abandonné faute de maintenance
Source : `'Audit économique et Financier», MINEFI, 2006, p. 95.
119
Au terme de l'analyse de l'évolution de la législation forestière et environnementale au Cameroun, ce qui saute à l'oeil c'est que, ce changement s'est fait de manière crescendo, parfois affecté par les facteurs internes du pays et souvent suite aux réalités internationales. Les différentes métamorphoses subis par la législation forestière aboutissent aux grandes réformes forestières et environnementales des années 90. Ce sont ces réformes qui viennent parfaire et adapter le régime forestier et environnemental camerounais aux normes internationales. Pourtant les résultats de ce changement ont été parfois entachés d'insuffisances. Alors que pour l'application de ces différents régimes et la réalisation des projets dans le secteur des forêts et environnemental, il fallait des institutions et des structures d'accompagnement, qui comme ces lois ont connu aussi une franche évolution.
120
C'est dans le but de mieux contrôler ses ressources forestières et de mieux gérer son environnement que le Cameroun a mis sur pied les services administratifs et techniques0. En effet, si les pouvoirs publics ont toujours renouvelé les institutions forestières, c'est par apport à l'importance des enjeux avenirs autour des forêts. Elles ont pourtant eu une évolution lente comparée celle des lois.
Pour faciliter l'analyse de l'évolution de ces institutions, trois étapes sont essentielles à prendre en compte. Les organes administratifs et techniques de 1961 à 1972, les organes administratifs et les structures techniques entre 1972 et 1992 et les grandes réformes institutionnelles de 1992 à 2010.
Il faut d'abord signaler que comme pour la législation forestière, les institutions qui les gèrent sont aussi distinctes dans les deux parties du pays entre 1961 et 1972. Ainsi au Cameroun oriental, c'est le secrétariat d'Etat au développement rural qui gère les forêts. Alors que dans le Cameroun occidental c'est le secrétariat d'Etat aux ressources naturelles. Pour des problèmes de manque d'informations sur le Cameroun occidental signalé haut, nous avons opté de parler plutôt du Cameroun oriental. Pour ce qui est de cette partie du pays, il faut dire que le service forestier au sein du secrétariat d'Etat au développement rural s'occupait des forêts. Et jusqu'en 1971, il n'y a que deux structures techniques chargées des forêts. L'une privée le CTFT et l'autre publique à savoir le FSFP0.
0 Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation», 1985, p. 37. 0 Ibid. pp. 37-43.
121
De 1960 à 1961, date de la réunification, c'est le ministère de l'agriculture qui s'occupait des forêts dans le Cameroun oriental. De la réunification jusqu'en 1972, c'est le secrétariat d'Etat au développement rural qui gère les questions forestières au Cameroun oriental0.
Les informations sur l'organisation et le fonctionnement du secrétariat d'Etat au développement rural jusqu'en 1972 ne sont pas connues des sources que nous avons eu à notre possession. Pour ce, Kelodjoué dans son étude, souligne qu'après l'indépendance du pays, la gestion des forêts était assurée par le service forestier. Il faut aussi souligner que le pays doit à ce service l'élaboration de l'ordonnance de 1961 et la loi de 19680. Et qu'il faut attendre 1964 pour que l'administration des forêts obtienne deux structures dont l'une révèle de l'Etat (FSFP) et l'autre du CTFT0.
Il faut dire qu'après l'indépendance, le service forestier au Cameroun a subi la pression des anciens officiers d'outre-mer qui formaient le personnel d'une société privée appelée CTFT dont le siège se trouve encore à Nogent-Sur-Marne en France. Cette société s'était alors organisée pour vendre ses services au pays africains en arrachant aux administrations locales les sections de recherche forestière, empêchant ainsi de leur livrer au chômage0. Cette structure privée a servi d'organe technique pendant une bonne période au Cameroun. A son actif, il y a la réalisation de plusieurs projets dont celui de l'inventaire d'exploitation à Edéa (Sanaga maritime) dans le projet papétier0.
0 Ibid.
0 Ibid. pp. 10-11.
0 Le centre technique forestier tropical en abrégé CTFT est une société privée. Cette société donc le personnel était formé par les officiers français d'Outre-mer s'est organisée pour vendre ses services aux Pays africains en arrachant aux administrations locales les sections de recherches forestières, empêchant ainsi la formation des cadres locaux qui risquaient de concurrencer ceux du CTFT et de les livrer au chômage (S. Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, p. 38).
0 Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation industrielle», 1985, p. 38.
0 Tene, `'L'aspect juridique», 1977/1978, p. 42.
122
Jusqu'en 1971, date du passage du FSFP au FNFP, le FSFP jouait le rôle d'office national de la régénération des forêts0. En raison de ses problèmes de subvention0, celui-ci connait un changement très fulgurant et par la loi n°71/2/COR du 11 juillet 1971 complétée par l'ordonnance n°72/18/ du 22 mai 1973, il devient le Fonds National Forestier et Piscicole0. Ce dernier fut chargé de la régénération forestière, du développement et de l'enrichissement de la forêt dans les zones abusivement exploitées0. Ce fonds a régénéré dans les provinces de l'Ouest, du Nord, Nord-ouest, Centre-sud entre 1973 et 1977 un total de 5288 hectares de forêt0. Il a aussi fait le classement des forêts dans les provinces du centre-Sud, du Littoral, de l'Est, du Sud-Ouest, du Nord, de l'Ouest et du Nord-Ouest en 1976. Ce classement a permis de connaitre les superficies forestières en hectares et les catégories de forêts dans ces différentes provinces0.
Ce que nous pouvons retenir est que le service forestier au sein du ministère de l'agriculture assurait l'administration des forêts et que le CTFT et le FSFP étaient les seuls organismes techniques des forêts entre 1961 et 1971. Après cette date, le FNFP a pris le relais. En outre, il faut signaler qu'à partir de 1972 les deux parties du Cameroun ont une unité sur des organes administratifs et techniques.
L'année 1972 marque la reforme du ministère de l'agriculture. Des années après, les organes techniques qui accompagnent ce ministère ont connu des réaménagements.
Après l'unification, il n'était plus question de maintenir deux systèmes parallèles au sein d'une République unie. Le 1er septembre 1972, le décret n°72/438 porte organisation du ministère de l'agriculture. Les deux secrétariats d'Etat ont fusionné pour donner naissance au
0 Ibid. p. 39.
0 Il faut dire ici que le FSFP a vu l'amenuisement au fil des années de son aide accordée par le Fonds Européen
de Développement et des subventions du Fonds d'Aide et de Coopération. C'est ainsi qu'il fut dans un premier
temps doté d'une personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est alors alimenté en partie par
les taxes forestières : Taxes de reforestation, 35% de la taxe de production (Ibid. p.40)
0 Ibid.
0 Ibid.
0 `'rapport d'exécution», FNFP, 1977.
0 Tene, `'L'aspect juridique», 1977/1978, pp. 30-35.
123
ministère d'agriculture0. Il fut organisé par le décret n°74/54 du 26 janvier 1974 et réorganisé par un autre décret n°76/256 du 1er juillet 19760.
Ce ministère de l'agriculture comprend 8 directions dont la direction des forêts et des chasses. Cette direction était chargée de :
- De la gestion et la protection des forêts domaniales, du domaine national et éventuellement de celles appartenant aux collectivités publiques ou faisant partie du patrimoine collectif national ;
- du contrôle de la gestion des forêts des particuliers;
- de la mise au point et du contrôle de l'exécution des programmes de régénération, de reboisement, d'inventaire et d'aménagement;
- du contrôle de l'exploitation forestière;
- de la liaison avec des organismes professionnels du secteur forestier et avec ceux chargés des problèmes de recherche en matière écologique;
- des études économiques relatives au secteur forestier ;
- du contrôle des chantiers d'exploitation et des industries forestières, notamment en ce qui concerne le respect de la réglementation ;
- de toutes investigations à la demande du ministre chargé des forêts0.
Ce réaménagement du ministère renforce et diversifie les interventions de la direction des eaux et forêts. Ce ministère est l'organe qui a élaboré la loi de 1981, les décrets de 1983 et l'instruction ministérielle de 1984. Avec cette importance que vient de prendre le secteur forestier, ce qui s'en suit est la création du Centre National de Développement des Forêts (CENADEFOR) à travers un décret du 9 juin 19810.
forêts
0 Ibid. pp. 20-21
0 Ibid.
0 OG.URC, 1 March 1983, p. 433. La direction de l'administration générale, la direction de l'agriculture, la direction des études et projets, la direction de la coopération et de la mutualité, la direction du génie rural et de l'hydraulique agricole, la direction du développement communautaire et la direction de l'enseignement agricole. 0 Kelodjoué, `'L'évolution de l'exploitation», 1985, p. 43.
124
Cette première structure a pour objectif la mise en valeur des forêts et la promotion de bois camerounais tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ainsi, il est chargé :
- d'établir un mécanisme de coopération entre le gouvernement, l'exploitation, la transformation ; etc.
- d'assurer le perfectionnement technique des nationaux dans le domaine du travail et de l'industrie du bois ;
- enfin de réaliser une reconnaissance forestière générale0. Pour renforcer le travail du CENADEFOR, l'Office national de régénération (ONAREF) est créée en 1982 par le décret n°82-636 du 8 décembre 19820. Il a pour objectif la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de régénération des forêts, de reboisement, de conservation et de restauration des sols0. A ce titre, il est notamment chargé de :
- la régénération des forêts domaniales en vue de l'accroissement de leur productivité, dans le cadre des plans d'aménagement approuvés par le ministre de tutelle ;
- l'exécution des projets de reboisement, de protection et de restauration des sols, de lutte contre les effets de sécheresse ;
- l'étude et de l'exécution, sur leur demande et leur financement, des projets de reboisement des particuliers et des collectivités ;
- la réalisation de toutes les opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières se rattachant à son objet0. Parmi ses réalisations, on compte l'enrichissement de la réserve de Makak en 1982 de 2222 Samba et Ayous0.
Le décret n°90/397 du 02 février 1990 crée l'Office national de développement des forêts (ONADEF). Il se substitue au CANADEFOR et à l'ONAREF dont il reprend en améliorant les activités0. En résumé, l'ONADEF réalise des inventaires forestiers de toute nature, se charge d'aménagements forestiers, développe la production forestière, s'occupe de la protection de l'environnement forestier et appuie le secteur de l'industrie du bois0. Cette
0 Ibid. p. 43.
0 JO.RUC, du 15 décembre 1982, p. 3292.
0 Ibid.
0 Ibid. p. 3293.
0 `'Rapport d'activités», ONAREF, 1982.
0 ONADEF, `'Progrès réalises sur la voie de l'objectif an 2000 décision 10 (XXVI) et 5(XVII)», Rapport
national, p. 4.
0 Ibid.
125
dernière structure a fait plusieurs réalisations. Les plus marquantes sont : la réalisation des projets d'aménagement des forêts et les propositions de contrôle des activités forestières. Nous avons comme exemple la réalisation du projet pilote d'aménagement durable de la forêt de So'o Lala (Cameroun) sur une superficie de 39728 hectares et l'élaboration d'un plan d'aménagement intégré démarré en 1992 et achevé en19990. En janvier 2001, il fait des propositions pour l'organisation du contrôle des aménagements forestiers au Cameroun, en vue de la gestion durable des forêts (contrôle technique et administratif)0.
Cette évolution des structures centrales et des agences d'exécution du secteur forestier marque la recherche acharnée des autorités camerounaises d'un cadre plus performant et plus efficace dans l'exécution de la politique forestière du pays. C'est cet acharnement accompagné de l'aide international qui conduit aux grandes réformes institutionnelles de 1992.
Jusqu'en 1992, les forêts étaient gérées par le ministère de l'agriculture et la faune par le ministère du tourisme. L'ingérence de la Banque mondiale dans la politique forestière du Cameroun entraine une série de réformes institutionnelles qui partent de la création du ministère de l'environnement et des forêts en 1992, du passage de l'ONADEF à l' ANAFOR en 2002 et de l'éclatement du MINEF en 2004 qui devient ministère de l'environnement et de la protection de la nature d'une part et ministère des forêts et de la faune d'autre part0.
L'année 1992 marque un grand changement institutionnel au Cameroun. Ce saut permet au pays de s'arrimer avec les nouveaux défis environnementaux. Le ministère de l'environnement et des forêts semble être adapté pour cela. Il comprend deux directions ; celle de l'environnement et celle des forêts0. Ainsi, Céline kemmogne pense que d'après Stéphanie Doumbe Bile, pour ce qui concerne les mesures institutionnelles encadrant la gestion des forêts en Afrique :
0 Ibid. p. 8.
0`'Propositions de l'ONADEF pour l'organisation du contrôle des aménagements forestiers au Cameroun, en
vue de la gestion, durable des forêts», ONADEF, janvier 2011, p. 3.
0 http:/www.fao, consulté le 30 décembre 2010.
0 Ibid.
126
L'exemple du Cameroun doit être noté à travers le décret n°98-345 du 21 décembre 1998 portant organisation du ministère de l'environnement et des forêts qui régit l'administration forestière au Cameroun. Il s'agit d'une organisation très classique d'un département ministériel avec une administration centrale et des services extérieurs, avec une inspection générale chargée des missions
d'évaluation et de contrôle ainsi que d'information directe du ministère et du secrétariat général0.
Les compétences forestières sont partagées entre un secrétariat permanent et la direction des forêts. Alors que le secrétariat permanent est compétent pour élaborer les stratégies de gestion durable des ressources naturelles disposant à cet égard d'une cellule de la protection et de la conservation de la biodiversité, la direction des forêts rattachée à l'administration centrale est chargée quant à elle des fonctions traditionnelles, notamment l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique forestière, la planification, la gestion et l'aménagement des forêts , l'octroi d'agréments et des titres d'exploitation forestière0.
Toutefois, bien qu'elle fût censée assurer la direction de tous les produits forestiers d'origine végétale, y compris les PFNL, il n'empêche que dans la pratique, elle ne s'occupait quasi-exclusivement que du bois d'oeuvre. A la suite du décret de 1998 dont fait mention Doumbe bile, est créé, `' une direction de la promotion et de la transformation des produits forestiers (DPT) dotée entre autres structures d'une sous direction de la promotion et de la transformation des produits non ligneux. Comme son nom l'indique, cette sous direction ne se voit pas confier le monopole de la gestion des PFNL qui est une fonction transversale et des fonctions relevant de l'aval de la filière à savoir la transformation et la commercialisation''0.
Pour accompagner cette direction, un plan d'action d'urgence (PAU) a été élaboré en 1999 sur la base du plan d'action forestier national (PAFN). Ce PAU retrace les grands thèmes entrepris et à entreprendre par le MINEF à savoir :
- Conservation de la biodiversité ;
-gestion rationnelle des produits forestiers non ligneux ;
- classement des UFA
-assainissement des titres et données d'exploitation forestière 0;
L'avènement du ministère de l'environnement et des forêts a était une solution viable pour les questions liées à la forêt et l'environnement au Cameroun. D'une part, il innovait en réservant une direction de l'environnement à ce ministère, chose qui n'existait pas avant 1992 au Cameroun et qui devait désormais encadrer les problèmes liés à l'environnement. D'autre
0 Tagne Kemmogne, `'Gestion durable des ressources'', 2008, p. 36. 0 Ibid. 0 Ibid. 0 http:/www.fao. consulté le 30 decembre 2010.
127
part, il apportait une bouffée d'oxygène à la direction des forêts en la soustrayant du ministère d'agriculture où elle ne bénéficierait pas d'un très grand intérêt de la part des autorités camerounaises. A l'intérieur de ce nouveau ministère, le secteur forestier bénéficiait d'un secrétariat permanent et une direction.
Sur le plan législatif, ce ministère a eu à oeuvrer pour l'élaboration d'une nouvelle politique forestière mieux adaptée au pays. La politique qui est à la base de la loi forestière de 1994 avec les décrets et les ordonnances la modifiant et la complétant parfois. Et un autre constat est le fait d'avoir mis ensemble les forêts et l'environnement ensemble, quant on sait que l'une est l'élément de l'autre. Ce ministère en dehors de la politique forestière, a aussi élaboré celle de l'environnement avec sa loi-cadre de 19960 dont certaines de ses dispositions s'intéressent à l'exploitation du bois0.
En effet toujours dans cet élan de réforme institutionnelle, le décret n°2002/155 du 18 juin 2002 a officiellement transformé l'ONADEF en Agence nationale de développement forestier (ANAFOR)0. L'ANAFOR est donc l'aboutissement de cette vision arrêtée par le gouvernement du Cameroun avec le consentement compréhensif des bailleurs de fonds0.
Les missions de l'ANAFOR sont :
- La réalisation des études
Il s'agit de toute étude pouvant se rapporter au développement et à la mise en oeuvre de plantations forestières privées et communautaires.
- La coordination
Afin de permettre à l'Etat du Cameroun de s'assurer du déroulement harmonieux des activités de reboisement à travers le pays, l'ANAFOR coordonne l'action des différents intervenants sur le terrain (bailleurs de fonds, ONG, organismes internationaux, opérateurs privés) en matière de foresterie communautaire et privée.
- L'information
0 La loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
0 Les dispositions de la loi de l'environnement qui s'étendent aux forêts sont dans l'article 4 qui stipule que : `'les opérations ou activités ci-après cités sont soumises à une étude d'impact environnemental détaillée. Et précise dans sa partie B réservée à la foresterie les détails qui concernent cette dernière à savoir l'aménagement des aires protégées, aménagement et exploitation des unités forestières d'aménagement (UFA), l'exploitation de vente de coupe (VP) et l'agroforesterie de superficie égale ou supérieure à 50 ha.»
0 Nguessi, `'Application de l'article 40 », p. 3.
0 Ibid.
128
L'ANAFOR recherche et met à la disposition du public, des opérateurs privés et communautaires, toute information pouvant induire à la réalisation des plantations forestières Communautaires et privées.
- La promotion
Il s'agit de la promotion de tout objectif pouvant justifier la mise en place de tout boisement de quelque intérêt qu'il soit0.
Il faut souligner ici que l'ANAFOR contrairement à l'ONADEF perd les missions de régénération forestière, d'aménagement des forêts, du développement de la production forestière, de l'inventaire forestier et a juste un rôle d'assistance au programme de reboisement forestier. Ainsi, elle a déployé ses employés dans certaines sociétés forestières depuis 2005, pour leur assister dans la mise en oeuvre des plans de régénération. On peut citer entre autres Coron, TTS dans l'arrondissement de Yokadouma. Cependant, la modestie de ses missions diminue l'impact qu'elle pouvait avoir dans la mise en oeuvre de la politique forestière du pays.
En 2004, on assiste à l'éclatement du ministère de l'environnement et des forêts en deux départements ministériels distincts à savoir, le ministère de l'environnement et la protection de la nature d'une part et le ministère des forêts et de la faune d'autre part0. Désormais le ministère de l'environnement et la protection de la nature (MINEP) s'occupe des questions environnementales dont celles des forêts et de la faune. Cette protection de l'environnement concerne la préservation des espèces animales et végétales et leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, la conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction0.
Le ministère des forêts et de la faune (MINFOF) continue avec l'oeuvre de l'ancien ministère0. Car les bases de la politique forestières avaient déjà été jetées en 1994 par cet ancien département ministériel0. Ce qui explique ce qui semblerait être une absence jusque là
0 Ibid. pp. 11-12.
0 `' Ministère de l'environnement et des forêts», http:/WWW.fao, consulté le 30 décembre 2010.
0 Ossama, Le cadre juridique des forêts et de l'environnement, pp. 213-214.
0 `'Le ministère des forêts et de la faune au Cameroun», http://cameroon50, 2010, consulté le 12 novembre
2011.
0 Ossama, Le cadre juridique des forêts et de l'environnement, 2007, p. 15.
129
des innovations dans le secteur forestier. Cependant il faut dire ici que ce nouveau ministère est divisé en deux directions. La direction chargée des forêts et celle chargée de la faune.
Dans cette création du MINFOF, on voit le souci du gouvernement camerounais de doter chaque domaine de l'Etat de son département ministériel pour rendre la gouvernance fluide et efficace. Ainsi ce renforcement des lois et des institutions forestières à travers plusieurs changements montrent les enjeux avenirs que revêtent ces forêts aujourd'hui.
Les enjeux de la lutte contre la déforestation et la dégradation de l'environnement sont multiples et diversifiés. Ils sont tant nationaux qu'internationaux.
Sur le plan national, ces enjeux tournent autour de l'économie, la biodiversité et la société.
La lutte contre la déforestation revêt un intérêt important sur l'économie nationale. Car de l'exploitation forestière à la commercialisation des produits forestiers non ligneux en passant par la commercialisation des plantes médicinales, ces secteurs d'activité contribuent à l'économie nationale.
L'exploitation forestière est un secteur économique au même pied d'égalité que le pétrole et les produits agricoles. Il est aujourd'hui le troisième contributeur au PIB après l'agriculture et le pétrole0.
La forêt camerounaise est exploitée depuis le début du XX è siècle. L'exploitation industrielle commence dans les années 19600. Les revenus de cette exploitation ne représentaient pas beaucoup dans l'économie du pays. Mais en 1986, suite à la chute des matières premières (cacao, café, coton) dans le marché mondiale et à la crise économique qui
0 `' Le ministère des forêts et de la faune au Cameroun», http. // Cameroon 50, 2010 0 `'Audit économique et financier», MINEFI, septembre 2006, p. 18.
130
a mis le pays au bord de la faillite après 1988, les autorités camerounaises s'appuient sur les exportations des bois tropicaux pour relever son économie0.
Cette période marque le début de l'importance des revenus de l'exploitation forestière à l'économie nationale. Malgré une exploitation abusive, les revenus issus de ce secteur parviennent à satisfaire les autorités du pays. Mais les pertes dues à l'abattage illégal sont énormes. Le tableau suivant illustre ce constat.
Tableau n°8: L'estimation des revenus et les pertes de l'exploitation du bois entre 1992 et 1996
|
Année |
Total revenus des impôts |
Pertes de revenus estimées |
|
92-93 |
1,53 |
1,8 |
|
93-94 |
2,49 |
2,4 |
|
94-95 |
2,6 |
2,6 |
|
95-96 |
4,11 |
? |
Source : Verbelen, «Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 25.
Selon F. Verbelen, si des contrôles sur le terrain, plus réguliers et plus efficaces avaient été réalisés, les revenus de l'industrie du bois pour l'Etat auraient été, d'après les estimations, de deux à trois fois plus élevés. Un effort particulier de service juridique du MINEF a permis l'encaissement entre 1994 et 1995 de 162 millions de FCFA d'amande (pour infraction à la législation forestière) par rapport à 25 million de FCFA l'année précédente0.
Beaucoup d'efforts restent à faire par les pouvoirs publics pour assainir le secteur des forêts afin que celui-ci donne des rendements financiers qu'on attend de lui. La preuve est que plus ce secteur connait une évolution sur le plan des contrôles et la surveillance, les revenus qu'il génère font un bon en avant et sa contribution au PIB devient importante. Ce n'est pas le tableau suivant qui va démentir.
Tableau n°9 : Evolution de la contribution du secteur forestier à la formation du PIB entre
2000 et 2004.
|
En milliards de F CFA courant Produit intérieur brut |
Valeur apportée du secteur forestier |
Pourcentage du PIB |
Valeur ajoutée du secteur forestier informel inclus |
Pourcentage du PIB |
|
2000/1 6909,8 |
174 |
2,5% |
273,3 |
3,95% |
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts», 1999, p. 6. 0 Ibid.
131
2004
|
8311,4 |
258 |
3,1% |
380,9 |
4,6% |
Source : `'Audit économique et financier», MINEFI, Septembre 2006, p. 43
Si nous nous referons aux chiffres de ce tableau, nous pouvons remarquer que plus l'évolution du temps apporte des améliorations dans la gestion du secteur forestier, sa contribution à l'économie du pays s'augmente. C'est pourquoi nous pensons que dans l'avenir, ce secteur pourrait être plus prometteur si on le débarrasse des mauvaises pratiques que nous avons eu à énumérer plus haut. En plus il contribue à créer de l'emploi pour les Camerounais.
D'après le ministre des forêts et de la faune, l'exploitation forestière génère 45 000 d'emplois, dont 22000 sont enregistrés officiellement et les autres de manière informelle. Ces chiffres sur l'emploi grimpent aussi avec l'amélioration des méthodes de gestion de ce secteur. Nous pouvons constater que de 2000 à 2004, ces chiffres ont connu une augmentation, ceci est dû à la rigueur qui semble s'installer dans la gestion de ce secteur. Le tableau suivant est un exemple qui illustre mieux cette évolution.
Tableau n°10 : Evolution de l'emploi dans le secteur formel selon les données de l'INS entre 2000 et 2004.
|
Année |
2000/2004 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2004 |
|
Exploitation |
5272 |
5933 |
6432 |
4497 |
|
Transformation |
8494 |
8924 |
5383 |
5820 |
|
Transport |
2249 |
2283 |
2895 |
2954 |
|
Total |
16015 |
17140 |
14710 |
13270 |
Source : « Audit économique et financier», MINEFI, 2006, p.43
A travers l'évolution des chiffres d'emploi dans ce secteur, nous pouvons tirer la conclusion selon laque1le dans l'avenir, il pourra employer plus de Camerounais s'il y a plus de sérieux. Toutes ces données montrent l'important rôle que jouent les forêts dans la création des revenus et des emplois. Mais pour beaucoup d'experts, ils ne représentent pas grande chose par rapport à ce qu'ils devraient être si l'exploitation du bois était durable. C'est pourquoi la lutte contre la déforestation semble être une solution pour que le secteur forestier arrive à créer des revenus et des emplois égaux à ses capacités. En dehors des revenus et des emplois issus de l'exploitation du bois, d'autres produits restent à valoriser.
Il s'agit des produits forestiers non ligneux. La déforestation est une grande menace pour la survie de ces richesses. C'est pourquoi la protection des forêts assurerait l'existence de ceux-ci. Aujourd'hui, leur importance dans l'économie du pays est sous évaluée. Pourtant beaucoup de personnes semblent d'accord que si ce secteur était exploité normalement, il
132
rapporterait plusieurs millions de dollars USA à l'Etat. Nous avons l'exemple de ce tableau qui montre la faiblesse que connait encore la commercialisation de ces PFNL.
Tableau n°11 : Exportation des produits forestiers secondaires
|
Produits |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
||||
|
Tonnage |
Valeur x 1000 FCFA |
|||||||
|
Feuilles |
146 |
14,491 |
314 |
21,896 |
531 |
29,365 |
||
|
Noix de cola |
1,336 |
21,614 |
3,302 |
53,510 |
1,127 |
11,152 |
2,875 |
25,365 |
|
Yohimbe |
2,025 |
80,702 |
1,608 |
87,566 |
881 |
48,073 |
1,054 |
54,882 |
|
Strophantus |
273 |
35,472 |
1,520 |
152,080 |
372 |
37,836 |
5 |
1,326 |
|
Bambous |
24 |
707 |
16 |
937 |
5 |
479 |
||
|
Rotin |
11,913 |
849,824 |
||||||
|
Autres écorces |
10,189 |
2,045 |
3,085 |
518,807 |
5,104 |
523,500 |
||
|
Autres plantes |
59 |
6,534 |
774,949 |
|||||
Source : Foumete Nembot, Tchanou, La gestion des écosystèmes, 1998, p.62.
D'ailleurs même mal exploité les exportations de ndjansang, du gnetum africana, mangues sauvages et les plantes médicinales contribuent à l'économie du pays. Alors, vue l'importance que revêtent tous ces produits forestiers, il est sans doute certain que la lutte contre la déforestation développera la valorisation et la commercialisation de ces produits secondaires pour que à long terme ce secteur devienne rentable. Ce que corrobore Maurice Kamto qui pense que :
L'exploitation durable consiste à ne prélever des ressources renouvelables en quantité qui n'affecte pas leur aptitude à se renouveler, mais aussi à utiliser rationnellement les ressources non renouvelables et affecter les bénéfices tirés de leur utilisation à la recherche des matériaux de remplacement, ainsi que des techniques de réutilisation et de recyclage des ressources0.
Le Cameroun possède une forêt diversifiée au plan biologique. En effet, la diversité des biotopes qu'il comporte fait de lui l'un des pays d'Afrique les plus riches en biodiversité. Dans certaines forêts côtières du Cameroun, plus de 200 espèces ligneuses poussent sur 0,1 hectare. Au total, il compte 8 000 espèces de plantes supérieures. Il détient le nombre le plus
0 Tagne Kemmogne, `'Gestion durable des ressources», 2008, pp. 9-10.
133
élevé de plantes par unité de surface en Afrique centrale0. Les forêts au Cameroun abritent quelques 409 espèces de mammifères, 183 espèces de reptiles, 849 espèces d'oiseaux, 190 espèces d'amphibiens et plus de 1000 espèces de papillons0. La majeure partie de ces espèces vit dans les forêts tropicales du sud du pays.
Ces espèces sont des atouts inexplorés de la forêt au Cameroun, mais se retrouvent déjà menacés. La création et la protection des parcs nationaux biens gérés, offrant aux touristes la possibilité d'observer des espèces animales impressionnantes comme les gorilles, des plaines et les éléphants pourraient constituer une importante source de revenus pour les populations locales. Déjà le pays compte un bon nombre d'aires protégés. Le tableau ci-après livre de manière détaillée, le nombre de types d'aires protégés au Cameroun.
Tableau n°12 : Nombre détaillé des types d'aires protégés au Cameroun en 2010
|
Types d'aires protégés |
Nombre |
Superficie (Km2) |
|
Parcs nationaux |
07 |
10 309 |
|
Réserves de faune |
07 |
10 039 |
|
Zone cynégétique |
26 |
22 000 |
|
Jardin zoologique |
03 |
14 |
|
Total |
43 |
42,342 |
Source : Foumete Nembot, Tchanou, La gestion des écosystèmes, 1998, p.89.
Comme le pensent Nembot et Tchanou, `'Il faut seulement que certaines conditions soient remplies pour que l'écotourisme rapporte au pays d'ici peu. Il faut que les inventaires et les aménagements doivent être effectués en tenant compte de l'aspect touristique ; la sécurité des
touristes doit être assurée, il faudra construire les routes et les structures d'accueil». Ajouté à ces conditions la définition et l'augmentation des droits de visite. Aujourd'hui, ils semblent minimes. Par exemple l'ancienne grille des droits établis depuis 1987 nous livre de chiffres suivants : 5000 F CFA pour les non résidents, 3000 pour les résidents et 2000 pour les nationaux.
En moyenne, les éco touristes consacrent à leurs vacances des budgets considérablement plus élevés que les touristes ordinaires. Ainsi, la lutte contre la déforestation qui passe en même temps par la protection de ces aires pourrait devenir une source importante de devises.
0 P. T. Mbous, `'l'exploitation forestière et le développement des forêts communautaires au Cameroun. Une action collective pour la protection de la biodiversité», mémoire en vue d'obtention du diplôme d'étude approfondie, Institut universitaire d'étude de développement, Université de Genève, 2002/2003, p.45.
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts`', 1999, p . 7.
134
La forêt et la vie des populations riveraines sont liées. La lutte contre la déforestation permet d'adopter les pratiques durables de l'exploitation des forêts. L'une d'elle est la certification de l'exploitation forestière au Cameroun. C'est dans ce sens que les organisations écologiques interprètent la notion de gestion durable dans un sens plus large0. La gestion forestière n'est pas seulement axée sur une récolte durable du bois, mais elle accorde aussi de l'importance aux critères sociaux (condition de travail, respect des populations indigènes)0.
La gestion saine et équitable des forêts camerounaises permettra à stabiliser la situation des populations qui sont menacées par la disparition de celles-ci. On fait allusion aux bantous et aux pygmées. Ces communautés ont été désarticulées par l'exploitation anarchique des forêts par les industries de bois et les agro-industries. La coupe de certaines espèces comme le moabi pourrait à moyen terme fragiliser la vie des pygmées. Car l'importance que revêt cet arbre dans le quotidien de ces communautés sur le plan économique, médicinale et culturel n'est plus à démontrer. Par exemple voici ce que avance un Pygmée de Nkamouna : « La forêt est pour chacun de nous comme un père et une mère, elle nous donne ce dont on a besoin : nourriture, abri, vêtement, chaleur et affection »0. Sur ce point, il n'ya pas que ces seules pygmées qui bénéficient des biens faits du moabi. Même les populations bantous tirent aussi profit de cet essence. Les activités de ces entreprises ne tiennent pas compte de l'existence des populations autochtones. Ce qui a causé de nombreux conflits sociaux dans toute la zone forestière du pays. Alors, ce danger que courent ces communautés devrait être pris au sérieux. Sinon, il est probable qu'elles disparaissent ensemble de leur forêt d'ici peu de temps.
Il faut donc revoir cette gestion afin d'apporter à nouveau la sérénité à ces populations. Ceci passe par le zonage équitable et objectif des forêts. C'est-à-dire ternir compte de ce qui doit revenir aux populations locales.
0 Ibid.
0 Ibid.
0 Deravin, `'Projet coeur de forêt», 2010.
135
La communauté internationale s'est impliquée dans la lutte contre la déforestation au Cameroun pour plusieurs raisons. Ces raisons sont environnementales, économiques et sociales.
Ce que les pays développés gagneraient à s'impliquer dans la lutte contre la déforestation réside sur le service climatique et écologique que peuvent jouer les forêts camerounaises dans le monde.
En effet, en 1972 des environnementalistes mondiaux font un rapport sur les changements climatiques et la destruction de la nature à travers la pollution et la déforestation0. Ceux-ci trouvaient en la déforestation une véritable calamité pour l'humanité0. Suite à cela, une prise de conscience s'imposait. Les dernières réserves des forêts tropicales de l'Amazonie et du Bassin du Congo dont fait partie le Cameroun devaient être protégées.
Ainsi dont le premier souci est de financer une exploitation rationnelle des forêts, car celle-ci réduirait d'abord le taux de déforestation qui est de 1,2%, constituant le taux le plus élevé dans le bassin du Congo. La conséquence de cette réduction affecterait celle d'émission de gaze à effet de serre dont est responsable la déforestation au Cameroun, qui dans un autre cas pourrait réduire à 0,14% des 25% du gaz à effet de serre émis par la déforestation des forêts tropicales dans le monde0.
En plus sur le plan de stockage de carbone dans l'atmosphère, les forêts du pays ont un rôle déterminant à jouer. On estime à 1,3 et peut être jusqu'à 6,6 gigatonnes de carbone stocké dans leur végétation. Classant le pays parmi les 15 pays tropicaux les plus importants au monde pour le captage et le stockage du carbone0. Cette force d'emprisonnement de carbone
0 `'Convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel `', Paris, 23 novembre 1972. 0 Ibid.
0 UICN, `'Rapport préliminaire sur l'état de l'environnement en Afrique centrale», 2010, p. 72. 0 Bikié, Collumb et al., Aperçu de la situation de l'observatoire, 2000, p. 18.
contribue à la stabilisation du climat. La carte suivante illustre mieux les capacités de séquestration de carbone des forêts camerounaises.
136
Carte n°3 : Figure représentant la séquestration du carbone au sein des forêts Camerounaises
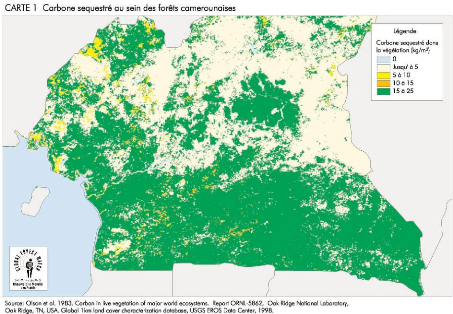
Source : Bikié, Collumb, Aperçu de la situation de l'observatoire, 2000, p. 19.
Nou
s pouvons donc dire ici que les Etats développés ont vraiment intérêt à s'impliquer dans la lutte contre la déforestation au Cameroun s'ils espèrent réduire comme ils prétendent les
émissions du gaz à effet de serre et maintenir la stabilité du climat mondial d'ici quelques années.
En outre, les écosystèmes camerounais abritent les derniers parents de l'homme qui sont les gorilles et les chimpanzés qu'on rencontre aujourd'hui dans les forêts frontières de l'Est, du Sud, et du Sud-Ouest. La protection de ces primates qui sur le plan génétique sont respectivement identiques à 98,4% et 97,7% à l'homme est considérée par les scientifiques comme une priorité absolue pour des raisons écologiques scientifiques et éthiques.
D'ailleurs, il a été démontré récemment qu'une sous-espèce du chimpanzé du Cameroun peut être porteuse du virus du SIDA mais sans être malade. L'étude du chimpanzé du Cameroun revêt une importance vitale pour la lutte contre le virus du SIDA0.
Beaucoup d'experts s'accordent sur le fait que les `'forêts frontières» sont les dernières réserves de la biodiversité dans le monde. Les forêts frontières de la Boumba et Ngoko, du Haut-Nyong, le parc Korup dans le Sud-Ouest frontalier au Nigeria et la réserve du Dja dans le Sud assurent la survie de la diversité biologique0. Et même, c'est dans le parc national de Korup qu'une nouvelle espèce de plante grimpante (Ancistrocladus korupensis) vient ainsi d'être découverte. Les scientifiques pensent qu'elle pourra servir de médicament contre le SIDA. Cette plante ne vit pour autant qu'on le sache que dans ce parc0. Et le Cameroun rassemble plusieurs sites critiques. On entend par les sites critiques des aires d'une importance particulière en terme de diversité biologique, pour la conservation d'espèces menacées de disparition ou pour la protection des systèmes biologiques servant de base au développement de la vie. Ces sites critiques représentent un grand intérêt mondial comme les aires protégées pour la conservation et la protection de la diversité biologique. Et le tableau suivant illustre leur importance en nombre, valeur et menaces au Cameroun.
137
0 Verbelen, `'Exploitation abusive des forêts des forêts`', 1999, p. 8. 0 Ibid.
0 Ibid.
138
Tableau n° 13 : Classement des sites critiques du Cameroun en 1998
|
Numéros |
Sites |
Valeurs |
Menaces |
Total |
|
1 |
Mont Cameroun |
18 |
12 |
30 |
|
2 |
Dla-Edéa |
10 |
18 |
28 |
|
3 |
Oku |
10 |
16 |
26 |
|
4 |
Campo Ma'an |
14 |
10 |
24 |
|
5 |
Koupé |
12 |
12 |
24 |
|
6 |
Yaoundé |
6 |
18 |
24 |
|
7 |
Korup |
16 |
6 |
22 |
|
8 |
Bakossi |
12 |
10 |
22 |
|
9 |
Dja |
12 |
10 |
22 |
|
10 |
Lokoundje-Nyo |
10 |
12 |
22 |
|
11 |
Nlonako |
10 |
12 |
22 |
|
12 |
Tchabal Mbabo |
8 |
14 |
22 |
|
13 |
Banyang Mbo |
8 |
14 |
22 |
|
14 |
Manengouba |
4 |
16 |
20 |
|
15 |
Mwne |
4 |
16 |
20 |
|
16 |
Boumba-Bek-N |
12 |
6 |
18 |
|
17 |
Ayos |
8 |
10 |
18 |
|
18 |
Mbam et Ndjere |
8 |
10 |
18 |
|
19 |
Rumpi |
8 |
10 |
18 |
|
20 |
Takananda |
8 |
10 |
18 |
|
21 |
Lobeké |
10 |
6 |
16 |
|
22 |
Nta Ali |
6 |
8 |
14 |
Source : Nembot, Tchouna, La gestion des écosystèmes, 1998, p.94.
La réserve de la Dja avait été classée par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et en dehors d'elle le Cameroun a plusieurs aires protégés qui sont élevés à un intérêt universel. Ces airs protégés seront exploités pour l'éco-tourisme dans un future proche et pourraient recueillir les touristes venant de partout dans le monde.
Les pays développés ont intérêt de s'investir dans la lutte contre la déforestation au Cameroun par ce que le pays est leur fournisseur de bois d'oeuvre. L'activité forestière est dominée au Cameroun par les entreprises étrangères. Ainsi, en 1996, on dénombrait 220 entreprises forestières au pays dont la majorité est constituée par les entreprises étrangères0.
0 Ibid. p. 21.
139
Ces entreprises exportent leur bois vers les marchés européens, asiatiques et américains. Ce qui indique que le Cameroun contribue au commerce global des produits du bois qui s'élèverait à 130 milliards de dollars USA et créant par conséquent 47 millions d'emplois dans le monde0. Plusieurs pays développés figurent dans le circuit commercial du bois camerounais et leur économie en dépend en partie0.
Au delà des produits ligneux, le Cameroun contribue au commerce mondial des produits forestiers non ligneux que nous avons pris le temps de montrer dans le chapitre précédent. Un cas d'espèce est la production du Prunus africana, une plante médicinale qui est commercialisée sur le marché mondial. Cette plante est utilisée pour le traitement de troubles de prostate. Sa commercialisation générait 150 millions de dollars USA par an dans le monde0.
Sur le plan social, les Etats développés se soucient des populations pauvres. Car selon certaines estimations 90% de la population pauvre, soit 1,5 milliards de personnes dépendent totalement ou partiellement des forêts pour vivre0. Une bonne partie de ces populations vit au Cameroun. Parmi elle, certaines sont dites vulnérables. C'est le cas des groupes Pygmées au Cameroun. Et pour les raisons humanitaires, la communauté internationale cherche des solutions pour les problèmes de pauvreté, dont l'une d'elles est la conservation des forêts.
Ainsi, les pays développés gagneraient à venir en aide aux pays sous-développés exportateurs de bois. Leur intervention aurait des effets positifs sur la gestion durable des ressources naturelles locales garantes de la survie des populations riveraines.
Alors, fort de ce qui précède, il faut constater que dans la volonté d'appliquer les lois forestières, de contrôler, de surveiller des forêts et réaliser les projets dans le secteur forestier, l'Etat camerounais a créé des institutions. Celles-ci ont connu une évolution liée aux circonstances internes et aux réalités internationales. Et parfois elles ont suivi la dynamique des lois forestières qui à leur tour devaient rendre l'exploitation des forêts durable, pour éviter la déforestation. Car la question de lutte contre la déforestation au Cameroun revêt un enjeu tant national qu'international, il faut dont que les structures qui accompagnent ces lois soient fortes.
0 Ngole Ngole, `'Foresterie, les potentialités et opportunités», 2008.
0 Confère Annexe VII page 168.
0 Ndoye, Ruiz-Perez et al., `' Les effets de la crise économique», 1998, p. 3.
0 UICN, `'Rapport préliminaire sur l'état de l'environnement en Afrique centrale», 2010, p 22.
140
141
La question sur l'histoire de la protection des forêts au Cameroun de 1960 à 2010 nous a donné l'occasion d'évaluer l'importance de celles-ci dans l'univers des populations, leur dépréciation, l'évolution de leur législation et leurs institutions.
Il ressort de notre étude que depuis les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale, les populations ont toujours tiré leur substance vitale de la forêt. D'abord une source de biens, puis une source de services et enfin un patrimoine culturel des peuples autochtones, elle a été et reste un milieu de vie complet et favorable à l'existence humaine. Pourtant, depuis la colonisation jusqu'à ce jour, elle continue de subir une destruction qui la dévalorise de plus en plus. Les facteurs de cette destruction ne sont entre autres que les activités agricoles, l'exploitation forestière et les défaillances de l'Etat dans son rôle de gestionnaire des forêts. En effet, cette situation catastrophique n'est pas restée sans effets. Les conséquences entrainées par ce phénomène environnemental s'étalent sur plusieurs dimensions.
A savoir économique, environnementale et sociale.
Dès son indépendance, le pays s'est doté des lois qui devaient protéger ces forêts. Celles-ci ont connu une évolution de manière crescendo. Parfois affectées par les facteurs internes et souvent suite aux réalités internationales. Les différentes métamorphoses subies par les différents régimes forestiers qu'a connus le pays ont abouti aux grandes réformes forestières et environnementales de 1994. Ce sont ces réformes qui ont posé les bases d'une exploitation durable adaptées aux normes internationales. L'espoir demeure qu'un jour elles arrivent à leur finalité, qui est celle de créer un cadre sain dans le secteur forestier.
A cet effet, pour l'application de ces lois, le contrôle, la surveillance et la réalisation des projets dans ce secteur, l'Etat a mis sur pied des institutions et des structures techniques. Celles-ci, comme les lois, ont connu une certaine évolution qui a souvent été liée non seulement à celle des différentes législations forestières, mais aussi à des pressions des bailleurs de fonds.
La question de la politique la lutte contre la déforestation revêt aussi un enjeu tant national qu'international. Si les lois qui régissent les activités forestières au Cameroun et les
142
hommes qui incarnent ces institutions atteignent les objectifs fixés, on pourra s'attendre à des retombées positives énormes. Pour y arriver, les pays développés en général et le Cameroun en particulier se doivent de s'impliquer dans ce combat, car l'avenir climatique du monde dépend en partie de la sauvegarde des forêts.
De la diminution du gaz à effet de serre, ou alors de la protection des communautés vulnérables à la protection de la biodiversité, ces questions tant soulevées au Cameroun qu'à l'étranger doivent bénéficier de l'attention des organismes et des ONG internationaux. Il faudrait que les projets REDD dont les ONG environnementales internationales se vantent ne soient pas un leurre. Ainsi donc le développement durable auquel aspirent les Camerounais et le monde entier passera par l'exploitation durable des forêts.
143
ANNEXE I : LISTE DES ESSENCES FORESTIERES DES FORETS DU GRAND-SUD CAMEROUN
Acajou de Bassam Faro Abale/Abing
Afromosia/Assamela Fromager/Ceila Okan/Odoum
Aniegre Gombe/Ekop Osanga/Sikon
Ayous Itandza/Evouvous Ozigo
Azobe Ilomba Tsanya/Akela
Agba/Tola Iroko Moabi
Aiele/Abel Kanda Pao Rosa
Ako/Aloa Kapokier/Bombax Wenge
Amvout/Ekong Kondroti/Ovonga Koto
Andoung Kum/Ekoa Movingui
Angueuk Landa Bodioa
Asila/Kioro Lati/Edjil Alumbi
Avodir Limba/Frake
Able/Abing Limbali
Abura Lotofa/Nkanang
Bête/Mansonia Mambode/Amouk
Bosse Moambe
Bubinga Mukulungu
Bilinga Mutundo
Bodia Naga/Ekop
Coussie blanc Olong/Bongo
Cordial/Ebe Ouochi/Albizia
Dibetou/Bibolo Tali
Doussie blanc Longhi/Abam
Dambala Ovengnkol
Dabema/Atui Sapeli
Diana/Celtis Zingana/amuk
Ebiara Teck
Ekaba Ang/Kokrodua
Essouom Bibelo
Ekoume Miama
Emien/Ekouk Oboto/Abodzok
Esak Onzabili/Angongui
Eseng/Lo Ovog/Angale
Essessang Tchitola
Esson Makore/Douka
Evene/Ekop Evene Padouk
Eveuss/Ngon Sipo
Evoula/Vitex Kotibe
Eyeck Tiama
Framir Eben
Source : Dieudonné Njankou, `'Regime des forêts de la faune et de la pêche», Mars 2000, p. 45. 46.
144
|
Titulaire du ttre |
Titres d'exploitaton |
Partenaires : |
Acheteurs |
Observatons |
|
1 - Appui technique et financiers ou exploitaton directe |
||||
|
WFC |
2 ventes de coupe |
SIM |
||
|
EYIA |
1 ventes de coupe |
SIM |
||
|
GAU |
2 ARB |
PATRICE BOIS |
||
|
2 - Ventes directes de grumes |
||||
|
CUF |
2 concessions |
WUMA |
Absence d'usine |
|
|
KIEFFER |
1 concession 1 vente de coupe |
SEEF, TTS |
Absence d'usine |
|
|
MARELIS PANAGIOTIS |
1 concession |
SEEF |
Capacité de transformaton encore limitée |
|
|
Groupe KHOURY |
3 concessions |
SEEF |
Capacité de transformaton = 34 potentel producton |
|
|
STBK |
1 concession |
ALPICAM |
||
|
APRODE |
1 vente de coupe |
|||
|
SCIEB |
1 concession |
|||
|
SFEES |
1 vente de coupe |
|||
|
EFTD |
1 vente de coupe |
|||
|
TAGNE |
2 ventes de coupe |
|||
|
3 - Partenariats durables sur les concessions assimilables à des productons en propre |
||||
|
LOREMA |
1 concession |
SFID |
||
|
SOCIB |
1 concession |
SFID |
||
|
SFCS |
1 concession |
TTS |
||
|
SFDB |
1 concession |
SIM |
||
|
SCTCB |
1 concession |
SIM |
||
|
SEPFCO |
1 concession |
TRC |
||
|
SFB |
1 concession |
PATRICE BOIS |
||
Source : `'Audit économique et financier du secteur forestier au Cameroun», MINEFI, rapport final, septembre 2006, p. 56.
145
subordonné à une autorisation administrative préalable délivrée dans des conditions fixées par des textes particuliers.
Article 19. - Des mesures incitatives peuvent, en tant que de besoin, être prises en vue d'encourager les reboisements, l'élevage des animaux sauvages, des algues et des animaux aquatiques par des particuliers.
TITRE III
DES FORETS
Article 20. - (1) Le domaine forestier national est constitué des domaines forestiers permanent ou non permanent.
(2) Le domaine forestier permanent est constitué de terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune.
(3) Le domaine forestier non permanent est constitué de terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières.
DES FORETS PERMANENTES
Article 21. - (1) Les forêts permanentes ou forêts classées sont celles assises sur le domaine forestier permanent.
(2) Sont considérées comme des forêts permanentes :
- les forêts domaniales ; - les forêts communales.
Article 22. - Les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du territoire national et représenter la diversité écologique du pays. Chaque forêt permanente doit faire l'objet d'un plan d'aménagement arrêté par l'administration compétente.
Article 23. -Au sens de la présente loi, l'aménagement d'une forêt permanente se définit comme étant la mise en oeuvre sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, d'un certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la protection soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social.
146
Des forêts domaniales
Article 24. - (1) Sont considérées au sens de la présente loi comme forêts domaniales : - les aires protégées pour la faune telles que :
· les parcs nationaux ;
· les réserves de faune ;
· les zones d'intérêt cynégétique ;
· les game-ranches appartenant à l'Etat ;
· les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;
· les sanctuaires de faune ;
· les zones tampons.
- les réserves forestières telles que :
· les réserves écologiques intégrales ;
· les forêts de production ;
· les forêts de protection ;
· les forêts de récréation ;
· les forêts d'enseignement et de recherche ;
· les sanctuaires de flore ;
· les jardins botaniques ;
· les périmètres de reboisement.
(2) La définition ainsi que les règles et les modalités d'utilisation des différents types de forêts domaniales, sont fixées par décret.
Article 25. - (1) Les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l'Etat.
(2) Elles sont classées par un acte réglementaire qui fixe leurs limites géographiques et leurs objectifs qui sont notamment de production, de recréation, de protection, ou à buts multiples englobant la production, la protection de l'environnement et la conservation de la diversité du patrimoine biologique national. Cet acte ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de l'Etat.
(3) Le classement des forêts domaniales tient compte du plan d'affectation des terres de la zone écologique concernée, lorsqu'il en existe un.
(4) Les forêts soumises au classement ou classées selon la réglementation antérieure demeurent dans le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le plan d'affectation des terres dûment approuvé de la zone concernée en dispose autrement.
(5) La procédure de classement des forêts domaniales est fixée par décret.
Article 26. - (1) L'acte de classement d'une forêt domaniale tient compte de l'environnement social des populations autochtones qui gardent leurs droits normaux d'usage. Toutefois ces droits peuvent être limités s'ils sont contraires aux objectifs assignés à ladite forêt. Dans ce dernier cas, les populations autochtones bénéficient d'une compensation selon des modalités fixées par décret.
(2) L'accès du public dans les forêts domaniales peut être réglementé ou interdit.
147
Article 27. - Le classement d'une forêt ne peut intervenir qu'après dédommagement des personnes ayant réalisé des investissements sur le terrain, avant le démarrage de la procédure administrative de classement.
Article 28. - (1) Une forêt domaniale peut faire l'objet d'une procédure de classement suivant des modalités fixées par décret.
(2) Le classement total ou partiel d'une forêt ne peut intervenir qu'après classement d'une forêt de même catégorie et d'une superficie équivalente dans la même zone écologique.
Article 29. - (1) Les forêts domaniales dont dotées d'un plan d'aménagement définissant, dans les conditions fixées par décret, les objectifs et règles de gestion de cette forêt, les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs, ainsi que les conditions d'exercice des droits d'usage par les populations locales, conformément aux indications de son acte de classement.
(2) Le plan d'aménagement, dont la durée est fonction des objectifs poursuivis, est révisé périodiquement ou en cas de besoin.
(3) Toute activité dans une forêt domaniale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan d'aménagement.
(4) Les forêts domaniales peuvent être subdivisées par l'administration chargée des forêts en unités forestières d'aménagement. Dans ce cas, cette administration arrête pour chacune de ces unités un plan d'aménagement.
(5) Les modalités de mise en oeuvre du plan d'aménagement sont fixées par décret.
Des forêts communales
Article 30. - (1) Est considéré, au sens de la présente loi, comme forêt communale, toute forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par celle-ci.
(2) L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de ladite forêt qui peuvent être les mêmes que ceux d'une forêt domaniale, ainsi que l'exercice du droit d'usage des populations autochtones. Il ouvre droit à l'établissement d'un titre foncier au nom de la commune concernée.
(3) Les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée.
(4) La procédure de classement des forêts communales est fixée par décret.
Article 31. - (1) les forêts communales sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par l'administration chargée des forêts. Ce plan d'aménagement est établi à la diligence des responsables des communes, conformément aux prescriptions de l'Article 30 ci-après.
148
(2) Toute activité dans une forêt communale doit, dans tous les cas, se conformer à son plan d'aménagement.
Article 32. - (1) L'exécution du plan d'aménagement d'une forêt communale relève de la commune concernée, sous le contrôle de l'administration chargée des forêts qui peut, sans préjudice des dispositions de la loi portant organisation communale, suspendre l'exécution des actes contraires aux indications du plan d'aménagement.
(2) En cas de défaillance ou de négligence de la commune, l'administration chargée des forêts peut se substituer à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite commune, certaines opérations prévues au plan d'aménagement.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communales appartiennent exclusivement à la commune concernée.
Article 33. - Les communes urbaines sont tenues de respecter, dans les villes, un taux de boisement au moins égale à 800 m2 d'espaces boisés pour 1 000 habitants. Ces boisements peuvent être d'un ou de plusieurs tenants.
DES FORETS NON PERMANENTES
Article 34. - Les forêts non permanentes, ou non classées, sont celles assises sur le domaine
forestier non permanent. Sont considérées comme forêts non permanentes :
- les forêts du domaine national ;
- les forêts communautaires ;
- les forêts des particuliers.
Des forêts du domaine national
Article 35. - (1) Les forêts du domaine national sont celles qui n'entrent dans aucune des catégories prévues par les Articles 24 (1), 30 (1) et 39 de la présente loi. Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni les aménagements pastoraux ou agrosylvicoles.
Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les anciennes jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de propriété, peuvent être considérées à nouveau comme forêts du domaine national et gérées comme telles.
(2) Les produits forestiers de toute nature se trouvant dans les forêts du domaine national sont gérés de façon conservatoire, selon le cas, par les administrations chargées des forêts et de la faune. Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une convention de gestion prévue à l'Article 37 ci-dessous.
Article 36. - Dans les forêts du domaine national, les droits d'usage sont reconnus aux populations riveraines dans les conditions fixées par décret. Toutefois, pour des besoins de protections ou de conservation, des restrictions relatives à l'exercice de ces droits, notamment les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et la mutilation des essences protégées, ainsi que la liste de ces essences, peuvent être fixées par arrêté du Ministre chargé des forêts.
149
Des Forêts Communautaires
Article 37. - (1) L'administration chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la gestion des ressources forestières par les communautés villageoises qui en manifestent l'intérêt, leur accorder une assistance. Une convention est alors signée entre les deux parties. L'assistance technique ainsi apportée aux communautés villageoises doit être gratuite.
(2) Les forêts communautaires sont dotées d'un plan simple de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. Ce plan est établi à la diligence des intéressés selon les modalités fixées par décret. Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation des forêts communautaires appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées.
(4) Les communautés villageoises jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris dans leurs forêts.
Article 38. - (1) Les conventions de gestion prévues à l'Article 37 ci-dessus prévoient notamment la désignation des bénéficiaires, les limites de la forêt qui leur est affectée et les prescriptions particulières d'aménagement des peuplements forestiers et/ou de la faune élaborées à la diligence desdites communautés.
(2) La mise en application des conventions de gestion des forêts communautaires relève des communautés concernées, sous le contrôle technique des administrations chargées des forêts et, selon le cas, de la faune. En cas de violation de la présente loi ou des clauses particulières de ces conventions, les administrations précitées peuvent exécuter d'office, aux frais de la communauté concernée, les travaux nécessaires ou résilier la convention sans que ceci touche au droit d'usage des
populations.
Des Forêts Particuliers
Article 39. - (1) Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par des personnes physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les propriétaires de ces forêts sont tenus d'élaborer un plan simple de gestion avec l'aide de l'administration chargée des forêts, en vue d'un rendement soutenu et durable.
(2) Toute nouvelle affectation des terrains concernés est soumise au respect des dispositions de l'alinéa (3) de l'Article 16 ci-dessus.
(3) La mise en oeuvre du plan simple de gestion d'une forêt de particulier relève de celui-ci, sous le contrôle technique de l'administration chargée des forêts.
(4)
150
Les produits forestiers tels que définis à l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les formations forestières naturelles assises sur le terrain d'un particulier appartiennent à l'Etat, sauf en cas d'acquisition desdits produits par le particulier concerné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(5) Les particuliers jouissent d'un droit de préemption en cas d'aliénation de tout produit naturel compris dans leurs forêts.
DE L'INVENTAIRE, DE L'EXPLOITATION
ET DE
L'AMENAGEMENT DES FORETS
De l'inventaire des Forêts
Article 40. - (1) L'inventaire des ressources forestières est une prérogative de l'Etat.
(2) Les résultats qui en découlent sont utilisés dans la prévision des recettes et dans la planification de l'aménagement.
(3) A ce titre, l'exploitation de toute forêt est subordonnée à un inventaire préalable de celle-ci selon les normes fixées par les Ministres chargés des forêts et de la faune.
De l'exploitation Forestière
Article 41. - (1) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière doit être agréée suivant des modalités fixées par décret.
(2) Les titres d'exploitation forestière ne peuvent être accordés qu'aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la composition du capital social est connue de l'administration chargée des forêts.
Article 42. - (1) Les bénéficiaires des titres nominatifs d'exploitation peuvent sous-traiter certaines de leurs activités, sous réserve de l'accord préalable de l'administration chargée des forêts. Ils restent, dans tous les cas, responsables devant celle-ci de la bonne exécution de leurs obligations.
(2) Les titres prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont individuels et incessibles.
(3)Toute nouvelle prise de participation ou cession de parts sociales dans une société bénéficiaire d'un titre d'exploitation est soumise à l'approbation préalable du Ministre chargé des forêts.
Article 43. - L'administration chargée des forêts peut marquer en réserve tout arbre qu'elle juge utile de l'être, pour des besoins de conservation et de régénération, sur une superficie concédée en exploitation.
Article 44. - (1) L'exploitation d'une forêt domaniale de production se fait, soit par vente de coupe, soit par convention d'exploitation. Toutefois l'exploitation en régie peut intervenir
151
lorsque s'impose la récupération des produits forestiers concernés, ou dans le cas d'un projet expérimental et selon des modalités fixées par décret. Elle peut se faire dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, conformément au plan d'aménagement de ladite forêt.
(2) Au début de chaque année, l'administration chargée des forêts détermine la possibilité annuelle de coupe de l'ensemble des forêts domaniales de production ouvertes à l'exploitation.
(3) L'exploitation des produits forestiers de toute forêt domaniale se fait conformément à son plan d'aménagement.
(4) Dans les forêts domaniales autres que de production, les prélèvements de certains produits forestiers sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à l'amélioration du biotope. Ces prélèvements se font en régie conformément au plan d'aménagement desdites forêts.
Article 45. - (1) Une vente de coupe dans une forêt domaniale de production est une autorisation d'exploiter, pendant une période limitée, un volume précis de bois vendu sur pied et ne pouvant dépasser la possibilité annuelle de coupe.
(2) Dans les forêts domaniales de production, les ventes de coupe ne peuvent être attribuées qu'à des personnes de nationalité camerounaise, sauf pour le cas prévu à l'Article 77 (2) ci-dessous.
(3) Les ventes de coupe sont attribuées par le Ministre chargé des forêts après avis d'une commission compétente, pour une période maximum d'un an non renouvelable.
Article 46. - (1) La convention d'exploitation confère au bénéficiaire le droit d'obtenir un volume de bois donné provenant d'une concession forestière, pour approvisionner à long terme son ou ses industrie (s) de transformation du bois.
La convention d'exploitation est assortie d'un cahier de charges et définit les droits et obligations de l'Etat et du bénéficiaire. Le volume attribué ne peut, en aucun cas, dépasser la possibilité annuelle de coupe de chaque unité d'aménagement concernée.
(2) La convention d'exploitation forestière est conclue pour une durée de quinze (15) ans renouvelable. Elle est évaluée tous les trois (3) ans.
Article 47. - (1) La concession forestière est le territoire sur lequel s'exerce la convention d'exploitation forestière. Elle peut être constituée d'une ou plusieurs unités d'exploitation.
(2) La concession forestière est attribuée après avis d'une commission compétente suivant les modalités fixées par décret.
(3) La concession forestière prévue à l'alinéa (1) ci-dessus peut être transférée suivant les modalités fixées par décret.
Article 48. - Certaines concessions doivent être réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en sociétés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 49. - (1) La superficie totale pouvant être accordée à un même concessionnaire est fonction du potentiel de la concession forestière calculé sur la base d'un rendement soutenu et
152
durable et de la capacité des industries de transformation existantes ou à mettre en place. Elle ne peut, en aucun cas excéder deux cent mille (200 000) hectares.
(2) Toute prise de participation majoritaire ou création d'une société d'exploitation par un exploitant forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue par lui au-delà de deux cent mille (200 000) hectares est interdite.
Article 50. - (1) Le bénéficiaire d'une concession forestière est tenu de conclure avec l'administration chargée des forêts une convention provisoire d'exploitation préalablement à la signature de la convention définitive.
(2) La convention provisoire a une durée maximale de trois (3) ans au cours de laquelle le concessionnaire est tenu de réaliser certains travaux notamment la mise en place d'unité (s) industrielle (s) de transformation des bois. L'industrie de transformation des bois et le siège social de l'entreprise seront situés dans la région d'exploitation. Pendant cette période, la zone de forêt concernée est réservée au profit de l'intéressé.
Les conditions d'établissement des conventions provisoires ainsi que le cahier de charges y afférent sont définies par décret.
Article 51. - (1) Un contrat de sous-traitance est une convention définissant les activités d'exploitation et d'aménagement forestier qu'un promoteur est appelé à exécuter dans le cadre de l'aménagement ou de l'exploitation d'une forêt. Il ne confère au sous-traitant aucun droit de propriété sur les produits forestiers exploités.
(2) L'exploitation en régie d'une unité forestière d'aménagement dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ne peut se faire qu'avec le concours exclusif d'un promoteur de nationalité camerounaise.
Article 52. - L'exploitation d'une forêt se fait pour le compte de la commune, en régie, par vente de coupe, par permis, ou par autorisation personnelle de coupe, conformément aux prescriptions d'aménagement approuvées par l'administration chargée des forêts.
Article 53. - (1) L'exploitation des forêts du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis ou par autorisation personnelle de coupe.
(2) L'administration chargée des forêts fixe annuellement par zone écologique, les superficies des forêts du domaine national ouvertes à l'exploitation forestière, en tenant compte des prescriptions du plan d'affectation des terres de ladite zone dûment approuvé et selon les modalités fixées par décret.
Article 54. - L'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts.
Article 55. - (1) Une vente de coupe dans une forêt du domaine national est au sens de la présente loi, une autorisation d'exploiter une superficie ne pouvant dépasser deux mille cinq cents (2 500) hectares, un volume précis de bois vendu sur pied.
(2) Dans les forêts du domaine national, les ventes de coupe sont attribuées après avis d'une commission compétente pour une période de trois (3) ans non renouvelable.
153
Article 56. - (1) Un permis d'exploitation est, au sens de la présente loi, une autorisation d'exploiter ou de récolter des quantités bien définies de produits forestiers dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des produits spéciaux tels que définis à l'alinéa (2) de l'Article 9 ci-dessus, du bois d'oeuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 mètres cubes bruts, du bois de chauffage et de perches à but lucratif.
(2) Les permis d'exploitation pour le bois d'oeuvre et certains produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l'administration chargée des forêts, sont accordés après avis d'une commission compétente pour une période maximum d'un (1) an non renouvelable.
(3) Pour les autres produits forestiers spéciaux, le bois de chauffage et les perches, les permis d'exploitation sont attribués de gré à gré par le Ministre chargé es forêts.
Article 57. - (1) Une autorisation personnelle de coupe est, au sens de la présente loi, une autorisation délivrée à une personne physique, pour prélever des quantité de bois ne pouvant dépasser trente (30) mètres cubes bruts, pour une utilisation personnelle non lucrative. Cette disposition ne s'applique pas aux riverains qui conservent leur droit d'usage.
(2) Les autorisations personnelles de coupe sont accordées de gré à gré, pour une période de trois (3) mois non renouvelable.
Article 58. - Les permis d'exploitation et les autorisations personnelles de coupe ne peuvent être attribués qu'à des personnes de nationalité camerounaise auxquelles les facilités de toute nature peuvent être accordées par l'interprofession, en vue de favoriser leur accès à l'exploitation forestière.
Article 59. - Dans les forêts du domaine national, certaines ventes de coupe peuvent être réservées à des personnes de nationalité camerounaise prises individuellement ou regroupées en société, suivant un quota fixé annuellement par l'administration chargée des forêts et selon des modalités fixées par décret.
Article 60. - Le transfert des ventes de coupe, des permis d'exploitation et des autorisations personnelles de coupe est interdit.
Article 61. - (1) Toute exploitation à but non lucratif de produit forestier est assortie d'un cahier de charges comportant des clauses générales et particulières.
(2) Les clauses particulières concernent les prescriptions techniques relatives à l'exploitation des produits concernés et, dans le cas des forêts domaniales, les prescriptions d'aménagement que doit respecter le bénéficiaire.
(3) Les clauses particulières concernent les charges financières, ainsi que celles en matière d'installations industrielles et de réalisations sociales telles que les routes, les ponts, les centres de santé, les écoles, au profit des populations riveraines.
(4) Les modalités de mise en place des installations industrielles, de réalisation des oeuvres sociales, ainsi que les conditions de renégociation desdites charges sont fixées par décret.
154
Article 62. - La convention d'exploitation forestière, la vente de coupe, le permis d'exploitation et l'autorisation personnelle de coupe confèrent à leur détenteur, sur la surface concédée, le droit de récolter exclusivement, pendant une période déterminée, les produits désignés dans le titre d'exploitation, mais ne créent aucun droit de propriété sur le terrain y afférent. En outre, le bénéficiaire ne peut faire obstacle à l'exploitation des produits non mentionnés dans son titre d'exploitation.
De l'aménagement des Forêts
Article 63. - L'aménagement prévu à l'Article 23 comprend notamment les opérations ci-après
- les inventaires ;
- les reboisements ;
- la régénération naturelle ou artificielle ;
- l'exploitation forestière soutenue ;
- la réalisation des infrastructures.
Article 64. - (1) L'aménagement forestier relève du Ministère chargé des forêts qui le réalise par l'intermédiaire d'un organisme public. Il peut sous-traiter certaines activités d'aménagement à des structures privées ou communautaires.
(2) Le financement des activités d'aménagement est assuré par un Fonds Spécial de Développement Forestier géré par un Comité. La composition ainsi que les modalités de fonctionnement du Comité et du Fonds Spécial de Développement sont fixées par décrets.
(3) Le plan d'aménagement forestier est un élément obligatoire du cahier de charges confectionné pendant l'exécution de la convention provisoire prévue à l'Article 50 ci-dessus.
(4) Le cahier de charges précise le coût financier des opérations d'aménagement.
(5) Les sommes correspondantes sont réservées directement dans le Fonds Spécial de Développement Forestier. Ces sommes ne peuvent recevoir aucune affectation.
Article 65. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et notamment la violation des prescriptions d'un plan d'aménagement d'une forêt permanente ou communautaire, ou la violation des obligations en matière d'installations industrielles, ou des réalisations des clauses des cahiers de charges entraîne soit la suspension, soit en cas de récidive, le retrait du titre d'exploitation ou le cas échéant, de l'agrément dans des conditions fixées par décret.
DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 66. - (1) Pour les ventes de coupe et les conventions d'exploitation forestière, les charges financières prévues à l'Article 61 alinéa (3) ci-dessus sont constituées, outre la patente prévue par le Code Général des Impôts, par :
155
- la redevance forestière annuelle assise sur la superficie et dont le taux est fixé par la Loi de
Finances ;
- la taxe d'abattage des produits forestiers, c'est-à-dire la valeur par espèce, par volume, poids
ou longueur, estimée selon des modalités fixées par décret ;
- la surtaxe progressive à l'exportation des produits forestiers non transformés ;
- la contribution à la réalisation des oeuvres sociales ;
- la réalisation de l'inventaire forestier ;
- la participation aux travaux d'aménagement.
(2) L'exploitation par permis d'exploitation et par autorisation personnelle de coupe donne lieu uniquement à la perception du prix de vente des produits forestiers.
(3) Les services produits par les forêts domaniales et visés à l'Article 44 (4) ci-dessus donnent lieu à la perception des droits correspondants.
(4) Les charges financières prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont fixées annuellement par la Loi de Finances, à l'exception des coûts d'inventaires et des travaux d'aménagement.
Article 67. - (1) Les bénéficiaires des ventes de coupe et des concessions, quel que soit le régime fiscal dont ils bénéficient, ne peuvent être exonérés du paiement des taxes d'abattage des produits forestiers, ni du versement de toute taxe forestière relative à leur titre d'exploitation.
(2) Au titre de l'exploitation de leurs forêts, les communes perçoivent notamment le prix de vente des produits forestiers et la redevance annuelle assise sur la superficie. Les communautés villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires.
(3) Aucun exportateur des produits non transformés ne peut être exonéré du paiement de la surtaxe progressive à l'exportation.
Article 68. - (1) Les sommes résultant du recouvrement des taxes, des redevances ainsi que les recettes de vente prévues aux Articles 6, 67 (3) et 70 de la présente loi, à l'exception de la contribution à la réalisation des oeuvres sociales et des taxes provenant de l'exploitation des forêts communales, communautaires et des particuliers, sont réservées pour partie à un fonds spécial de développement forestier suivant des modalités fixées par décret.
(2) En vue du développement des communautés villageoises riveraines de certaines forêts du domaine national mises sous exploitation, une partie des revenus tirés de la vente des produits forestiers doit être reversée au profit desdites communautés selon les modalités fixées par décret.
(3) La contribution à la réalisation des oeuvres sociales est réservée en totalité aux communes concernées. Elle ne peut recevoir aucune autre affectation.
Article 69. - L'attribution d'une vente de coupe ou d'une concession forestière est subordonnée à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par la loi de finances. Ce cautionnement est constitué par un versement au Trésor Public.
156
Article 70. - Le transfert d'une concession forestière donne lieu à la perception d'une taxe de transfert dont le montant est fixé par la loi de finances.
DE LA PROMOTION ET DE LA COMMERCIALISATION
DU BOIS
ET DES PRODUITS FORESTIERS
Article 71. - (1) Les grumes sont transformées par essence à hauteur de 70 % de leur production par l'industrie locale pendant une période transitoire de cinq (5) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi. Passé ce délai, l'exportation des grumes est interdite et la totalité de la production nationale est transformée par l'industrie locale.
(2) L'exportation des produits forestiers spéciaux non transformés est, suivant des modalités fixées par décret, soumise à une autorisation annuelle préalable délivrée par l'administration chargée des forêts et au paiement de la surtaxe progressive fixée en fonction du volume exporté.
(3) Un Office National de Bois dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par décret assure l'exportation et la commercialisation.
(4) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'administration chargée des forêts procède à l'évaluation de l'exploitation aux fins de vérifier que, conformément au plan d'investissement dûment approuvé par cette administration les dispositions requises sont prises par l'exploitant en vue de transformer la totalité de la production de grumes issue de sa concession. Tout défaillance grave entraîne la suspension ou
le retrait définitif de la concession.
Article 72. - Sauf dérogation spéciale du Ministre chargé des forêts, les produits forestiers bruts ou transformés destinés à la commercialisation sont soumis aux normes définies par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et du commerce.
Article 73. - (1) En cas de réalisation d'un projet de développement susceptible de causer la destruction d'une partie du domaine forestier national, ou en cas de désastre naturel aux conséquences semblables, l'administration chargée des forêts procède à une coupe des bois concernés suivant des modalités fixées par décret.
(2) Les billes sans marque apparente locale échouées sur la côte atlantique ou abandonnées le long des routes peuvent être récupérées par toute personne physique ou morale selon des modalités définies par décret, moyennant paiement d'un prix de vente dont le montant est fixé par la loi de finances.
Article 74. - Des mesures spécifiques peuvent être prises notamment
SOURCE : OSSAMA F., Le cadre juridique des forêts et de l'environnement au Cameroun, Yaoundé Espace-imprim, 2007, pp. 36 - 53
157
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESDENT DE LA REPU BLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1°'- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue on République du Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu'ils comprennent.
ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui t'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense d l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tondant a assurer la conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes d'application, on entend par:
(a) l'ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général;
(b) « audit environnemental » : l'évaluation systématique, documentée et objective de l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources;
(c) « déchet » : tout résidu d'un processus do production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon;
(d) «développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs eaux souterraines.
158
ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants:
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant a prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable
b) le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, on utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur:
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets ;
e) le principe de participation selon lequel
- chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses;
- chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer â la protection de celui-ci
- les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mômes exigences
- les décisions concernant l'environnement doivent être prises après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles ont une portée générale
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence d'une règle de droit écrit, générale ou spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme coutumière identifiée d'un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection do l'environnement s'applique.
TITIREII
DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET
DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il
- établit les normes de qualité pour l'air, l'eau, le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement;
- établit des rapports sur la pollution l'état de conservation do la diversité biologique et sur l'état de l'environnement on général ;
159
- initie des recherches sur la qualité de l'environnement et les matières connexes
· prépare une révision du Plan National de Gestion de l'Environnement, selon la périodicité prévue à l'article 14 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences nouvelles dans ce domaine;
- initie et coordonne les actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave pour l'environnement
- publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de l'environnement - prend toutes autres mesures nécessaires à la mise on oeuvre de la présente loi,
(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration de coordination,
d'exécution et de contrôle des politiques de l'environnement et une Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions, organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d'application de la présente loi.
ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compté spécial d'affectation du Trésor, dénommé « Fonds National de Environnement et du Développement durable et ci-après désigné le Fonds, qui a pour objet:
- de contribuer au financement de l'audit environnemental; - d'appuyer les projets de développement durable;
- d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales
· appuyer les programmes de promotion des technologies propres;
- d'encourager les initiatives locales en matière de protection do l'environnement, et de développement durable;
- d'appuyer les associations agréées dans la protection de l'environnement qui mènent dis actions significatives dans ce domaine;
- d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds ont fixés par un décret du Président de la République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent - des dotations de I'Etat;
· des contributions des donateurs internationaux - des contributions volontaires ;
· du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi; - des dons et legs;
- des sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites;
- de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées à d'autres fins que celles ne correspondant qu'à l'objet du Fonds.
160
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 13. Le gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de Gestion de l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans.
ARITCLE 14.-- (1) L'Administration chargée de I' environnement veille à l'intégration des considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation et la politique nationale en la matière.
ARTICLE 15.-- L'Administration chargée de l'environnement est tenue de réaliser la planification et de veiller à la gestion rationnelle de l'environnement de mettre en place un système d'information environnementale comportant une base de données sur différents aspects de l'environnement, au niveau national et international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tient un recueil à jour de la législation et réglérnentation nationales et des instruments juridiques internationaux en matière d'environnement auxquels le Cameroun est partie.
ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée de l'environnement établit un rapport bi-annuel sur l'état de l'environnement au Camoroun et le soumet à l'approbation du Comité Interministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une études d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de ta défense ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité nationale assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.
161
(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret d'application de la présente loi,
ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19.- (I) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes - l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement;
- les raisons du choix du site
· l'évaluation dos conséquences prévisibles de la mise on oeuvre du projet sur la site et son environnement naturel et humain
- l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes
- la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.
ARTICLE 20. (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de
l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cotte décision.
la décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de notification de l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact non respectée en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi.
DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION I
DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
ARTICLE 21.- Il est interdit
de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens - d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes
d'application de la présente loi ou, selon le ca., par des textes particuliers;
- d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.
162
ARTICLE 22.- (1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national en une aire écologiquement protégée. Une telle aire fait l'objet ci un plan de gestion environnemental.
ARTICLE 65.- (1) L'exploitation scientifique et l'exploitation des ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent être laites dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les institutions nationales do recherche, les communautés locales et de manière profitable au Cameroun dans les conditions prévues par les conventions internationales en la matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de Rion de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente loi détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites constituant une beauté panoramique particulière et organise leur protection et les conditions de leur gestion.
ARTICLE 67.- (1) L'exploration et l'exploitation des ressources minières et des carrières doivent se faire d'une façon écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations environnementales.
DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE
DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
ARTICLE 72.- La participation des populations à la gestion de l'environnement doit être encouragée, notamment à travers:
- le libre accès à l'information environnementale, sous réserve des impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat;
- des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport des populations - la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière d'environnement;
- la production de l'information environnementale;
- la sensibilisation, la formation, la recherche, l'éducation environnementale.
ARTICLE 73.- L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements d'enseignement supérieur.
ARTICLE 74.- Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans la société ainsi que la sensibilisation et la participation des populations aux questions environnementales, les Administrations chargées de l'environnement, de la communication et les autres Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes d'information et de sensibilisation à travers les média et tous autres moyens de communication.
163
A cet égard, ils mettent à contribution les moyens traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement.
DES MESURES INCITATIVES
ARTICLE 75.- Toute opération contribuant à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par la présente loi.
ARTICLE 76.- (1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le chloro-fluoro-carbone, ou de réduire toute forme de pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminés, on tant que de besoins, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi des Finances.
DE LA RESPONSABILITE ET DE SANCTIONS
DE LA RESPONSABILITE
ARTICLE 77.- (1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des activités susmentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé à l'alinéa (1) du présent article est partagée lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.
ARTICLE 78.- Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites.
DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 79.- Est punie d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement do six (6) mois à deux (2) ans ou de
164
l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant:
- réalisé, sans élude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact
-- réalisé un projet non conforme aux critères normes et mesures énoncés pour l'étude d'impact;
- empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi et/ou par ses textes d'application.
ARTICLE 80.- Est punie d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500 000.000) do FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.
ARTICLE 81.- (1) Est punie dune amende do dix (10) millions à cinquante (50) millions (10 FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
ARTICLE 82.- (1) Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5,000.000) de FCFA et dune peine d'emprisonnement de six (6). mois à un (1) an ou de l'une de ces doux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade os sols et soussols, altère la qualité de l'air ou des eaux, on infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, te montant maximal des peines est doublé.
ARTICLE 83.- (1) Est puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.00000 de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine do navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses testes d'application ou des conventions internationales relatives à la prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un navire-citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents (400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa précédent du présent article sont réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un million (1.000.000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
(4) Les pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navire, ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire sans qu'une faute ne puisse être établie à l'encontre de son capitaine ou de son équipage.
ARTICLE 84.- (1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à doux millions (2.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (G) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui lait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.
165
(2) En cas do récidive, le montant maximal des peines est doublé.
ARTICLE 85.- Les sanctions prévues par la présente loi sont complétés par celles contenues dans le Code pénal ainsi que dans différentes législations particulières applicables à la protection de l'environnement.
·
ARTICLE 86.- La sanction est doublée lorsque les infractions suscitées sont commises par un agent relevant des Administrations chargées de la gestion de l'environneront, ou avec sa complicité.
ARTICLE 87.- Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux circonstances atténuantes rie sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi.
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 88.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'Administration chargée de l'environnement ou des autres Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de marine marchande, des mimes, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites on répression dos Infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'Administration Intéressée, suivant dos modalités par un décret d'application de ta présente loi.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
ARTICLE 89.- Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par doux (2) agents qui co-signent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à l'inscription en faux.
ARTICLE 90.- (1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction doit être transmis immédiatement à l'Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l'alinéa (1) du présent article, la réclamation est examinée par l'Administration compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d'arbitrage définitif, l'Administration compétente procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.
DE LA TRANSACTION ET DE LA FILTRAGE
ARTICLE 91.- (1) Les Administrations chargées de la gestion de l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l'auteur de l'in traction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l'amende pénale correspondante,
(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la présente loi.
ARTICLE 92.- Les parties à un différend relatif à l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie d'arbitrage.
166
Source : AAN, `'Loi n°96 /12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement».
167
LE CADRE JURIDIQUE DES FORETS ET DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN
ANNEXE I DU DECRET N° 99/781/PM
DU 13 OCTOBRE
1999 FIXANT LES MODALITES
D'APPLICATION DE L'ARTICLE 71 (1) (NOUVEAU)
De
la loi n° 94/01 DU 20 JANVIER 1994 PORTANT
REGIME DES FORETS, DE LA
FAUNE ET DE LA PECHE
ESSENCES DE PROMOTION DONT L'EXPORTATION EST INTERDITE SOUS FORME DE GRUMES
ACCAJOU DE BASSAM/NGOLLON
AFFRORMOSIA/ASSAMELA
ANIEGRE/ANINGRE
BETE/MANSONIA
BIBOLO//DIBETOU
BOSSE
BUBINGA
DOUKA/MAKORE
DOUSSIE BLANC/PACHYLOBA/APA
DOUSSIE/BIPINDENSIS
FROMAGER/CEIBA
ILOMBA
IRIKO
LONGHI/ABAM
MOABI
MOVINGUI
EVENGKOL
PADOUK
PAO ROSA
SAPELLI
SIPO
WENGE
ZINGANA/AMUK
Source : Ossama F, Le cadre juridique des forêts et de l'environnement au Cameroun, Yaoundé, Espace-Imprim, 2007, p. 55.
168
LE CADRE JURIDIQUE DES FORETS ET DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN
ANNEXE II DU DECRET N° 99/781/PM
DU 13 OCTOBRE 1999 FIXANT LES MODALITES DU REGIME DES FORETS, DE LA FAUNE ET DE
LA PECHE
ESSENCES DE PROMOTION DONT L'EXPORTATION EST AUTORISEE SOUS FORME DE GRUMES
ESSENCES DE PROMOTION DE PREMIERE CATEGORIE
AYOUS/OBECHE AZOBE/BONGOSSI BILINGA FRAMIRE KOSSIPO/KOSIPO KOTIBE KOTO LIMBA/FRAKE OKOUME TALI
TECK
TIAMA
ESSENCES DE PROMOTION DE DEUXIEME CATEGORIE
ABALE/ABING/ESSIA
ABURA/BAHIA
AGBA/TOLA AIELE/ABEL AKO/ALOE ALUMBI
AMVOUT/EKONG
ANDOUNG
ASILA/KIORO/OMANG
AVDIRE
BODIOA
CORDIA/EBE
Source : Ossama F, Le cadre juridique des forêts et de l'environnement au Cameroun, Yaoundé, Espace-Imprim, 2007, p, 96.
169
Chine Italie
Inde
Turquie Espagne France Belgique
Irlande Pays-Bas
Tchad Sénégal Soudan Libye Allemagne
Malaisie
Liban
Source : Filip verbelen, `'Exploitation abusive des forêts équatoriales au Cameroun», rapport Greenpeace Belgique, 1999, p. 38.
|
SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES |
170
OUVRAGES
1- Amo' ou Jam J P., Melingui A. et al.( eds), Géographie le Cameroun, Paris, armand colin, 1985.
2- Barume k Albert, Etude sur le cadre légal pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux au Cameroun, Genève, OIT, 2005.
3- Bikié H., Collomb J G. et al.(eds), Aperçu de la situation de l'exploitation forestière au Cameroun, Washington, DC., World resources institue, 2000.
4- De Madron D L., Fomi E. et al.(eds), Les techniques d'exploitation à faible impact en forêt dense humide camerounaise, Cirad-Forêt, Baillargnet, Campus universitaire, 1998.
5- Ismail Sérageldin, La protection des forêts tropicales ombrophiles de l'Afrique, Washington, DC., la bibliothèque du congrès des Etats-Unis, 1993.
6- Fomete Nembot T., Tchouna Z, La gestion des écosystèmes forestiers du Cameroun à l'aube de l'An 2000, volume I, Yaoundé, UICN, 1998.
7- Labrouuse A., Verschaves F-X, Les pillards de la forêt : exploitations criminelles en Afrique, Marseille, Agone, 2002.
8- Levine TV, Le Cameroun, Volume II, Berkey et Los-Angeles, University of California Press, 1964.
9- Méthot P., Mertens B, Atlas forestier interactif du Cameroun, rapport de Global Forest Watch, Washington, Dc., Papyrus Design Group, 2005.
10- Ossama. F, Le cadre juridique des forêts et de l'environnement au Cameroun,
Yaoundé, Espace-Imprim, 2007.
ARTICLES DE REVUE
1-
171
Bigombé Logo Patrice, `'Exploitation forestier et développement local, sortir de l'Etat forestier», Arbres, forêts et communautés rurales, Vog-Ada Bulletin FTPP n°- 15 et 16 Décembre 1998, Spécial Cameroun.
2- Bigombe Logo Patrice, `'Foresterie communautaire et réduction de la pauvréte rurale au Cameroun. Bilan et tendances de la première décennie», http://www.wrn.org.ny/index.html/bigombe.Html.
3- Cyrie Sendashoua, `'La déforestation évitée est une formule « Gagnant-gagnant », WWW fern.Org. 08 mai 2008.
4- Gerber F J, `'Résistance contre deux géants industriels en forêt tropicale. Populations locales versu plantations commerciales d'hévéa et de palmiers à huile dans le Sud Cameroun», http://www.wrn.org.uy-2008.
5- Ndiaye b, `'Le mirage asiatique», le magazine de l'écologie et du développement rurale, Filière bois à l'aube d'un grand sinistre écologique ? 15 pages n°17 octobre-décembre 1998.
6- Ngoufo R., Tsafack M, `'Logiques d'acteurs et échelles de risques dans l'exploitation forestière au Cameroun», les cahiers d'Outre-Mer, Paris, janvier-mars 2006.
7- Wafo S, `'La clairière au détour du sentier», le magazine de l'écologie et du développement durable, Filière bois à l'aube d'un grand sinistre écologique ? 15 pages n°17, octobre-décembre 1998.
THESES, MEMOIRES, DOCUMENTS DIVERS
THESES
1- Elong. G. J, `'L'impact d'une exploitation forestière et d'une industrie de bois sur le milieu rural», thèse de doctorat de 3ème cycle en géographie tropicale, Université de Bordeaux III, 1984.
2-Kelodjoué. S, `'L'évolution de l'exploitation industrielle du bois dans la forêt dense camerounaise», thèse de doctorat de 3ème cycle en géographie, Université de Yaoundé, 1985.
MEMOIRES
1- Ebela. A, `'L'exploitation forestière et le développement socio-économique du Cameroun : le cas du département du Ntem de 1964 à 1992», mémoire de maîtrise en histoire, Université de Yaoundé I, 2008.
2-
172
Ekomi Amoka. A, `'Exploitation et production du bois dans le Mbam. Etude historique à partir de la société africaine de bois du Mbam (SABM) 1961-1994»mémoire de maîtrise en histoire, Université de Yaoundé I, 2004.
3- Essono. S.M. E, `'Etat des rebuts d'exploitation et de transformation du bois à la SFID de Mbang : enjeux économiques et impact sur le processus de certification», mémoire de DEES en sciences forestières, Université de Yaoundé I, 2011
4- Mbous T P, `'L'exploitation forestière et le développement des forêts communautaires au Cameroun. Une action collective pour la protection de la biodiversité», mémoire en vue d'obtention du diplôme d'étude approfondie, Institut d'étude de développement, Université de Genève, 2002.
5- Ndjock Nyobe P I, `'Préservation et conservation de la faune et de la flore au Cameroun sous administration française. 1916-1960, approche historique», mémoire de maîtrise en histoire, Université de Yaoundé I, 2005.
6- . Noundou C J, `'L'application du droit international de l'environnement par les sanctions : cas du Cameroun», mémoire de master 2 en droit international et comparé de l'environnement, université de Limoges, 2005.
7- Tagne Kommegne. S. C, `'gestion durable des ressources naturelles en afrique centrale : cas des produits forestiers non ligneux au Cameroun et au Gabon», mémoire de master en droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, 2008.
8- Tene R, `'Aspect juridique de la gestion des forêts au Cameroun», mémoire de licence de droit, université de Yaoundé, 1977/1978.
RAPPORTS LIES
1- Defo Louis and Njounan Tegomo Oliver, `'Ingenous people's participation in mapping of traditional forest resources for sustainable live hoods and great ape conservation», rapport d'exécution du projet, WWF, jengi south east forest program, September 2008.
2- FAO-2001, `'Evaluation des ressources forestières mondiales», FRA 2000-rapport principal Rome
3- FNFP, Rapport d'exécution, 1997.
4-
173
Geremi Deravin, rapport Coeur de forêt, `'Projet coeur de forêt : 2008-2010. Sauver le moabi, arbre sacré chez les Pygmées-Baka du Cameroun», www.coeurdeforêt.com, 2010.
5- Koffi Annan, `'Les forêts et le changement climatique», Rapport du secrétaire général des Nations unies, forum des Nations unies sur les forêts, huitième session, New-York, 2009.
6- MINEFI, `'Audit économique et financière du secteur forestier au Cameroun», rapport final, septembre 2006.
7- MINEFI, `'Table ronde internationale des donateurs sur l'environnement au Cameroun», rapport général, Yaoundé, 08 novembre 1996.
8- Nguessi. R, `' Application de l'article 40 des résolutions du sommet de RIO, cas d'ANAFOR», Rapport de stage professionnel, 2000/20006.
9- ONADEF, `'Progrès réalisés sur la voie de l'objectif An 2000 décision 10 (XXVI) et 15 (XVII)», rapport national.
10-ONADEF, Rapport d'activités, 1992
11-Rapport du séminaire régional sur `'La planification du développement et l'exploitation des ressources forestières dans les régions de forêts tropicales en Afrique», Yaoundé, novembre et décembre 1985.
12-UICN, `'Rapport préliminaire sur l'état de l'environnement en Afrique centrale», 2010.
13-UICN, `'Promouvoir l'efficacité en Afrique central et occidentale», rapport annuel 2008.
14- Verbelen Filip, `' L'exploitation abusive des forêts équatoriales au Cameroun», rapport de Green peace Belgique, 1999.
DOCUMENTS DIVERS
1- Bigombe Logo Patrice, `'Etude d'impact environnemental du projet GEOVIC à Nkamouna», Raimbow environment consult, Yaoundé, 2004.
2- Etude de la FAO entre 1992-1999
3- Convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel, Paris, 23 novembre 1972.
4- AA N, `'Constitution camerounaise de 1996».
5- MINEF, `'La politique forestière du Cameroun, document de poliatique générale», Yaoundé, juin 1995.
6- MINEF, `'Plan national de gestion de l'environnement», volume II, Yaoundé, février 1996.
7- Ngole Ngole Elvis, `'Les forêts : enjeu international du 21ème siècle», exposé à l'IRIC, Yaoundé, 18 juillet 2008.
8- Ngole Ngole Elvis, `'Foresterie, les potentialités et opportunités d'investissement dans le secteur forestier», exposé lors du Cameroon Investissment Forum, Yaoudé, 2009.
9- Njokou Dieudonné, `'Régime des forêts, de la faune et de la pêche», centre d'étude fiscale et d'appui à la gestion, Yaoundé, première édition, mars 2000.
10- Ndoye O., Ruise-Perez. et al. (eds), `'Les effets de la crise économique et de la
dévaluation sur l'utilisation des plantes médicinales au Cameroun. Implication pour la gestion durable des forêts», séminaire FORAFRI de Libreville, 1998.11- ONADEF, `'Proposition de l'ONADEF pour l'organisation du contrôle des
aménagements forestiers au Cameroun, en vu de la gestion durable des forêts», 2001.
LOIS, DECRETS ET ARRETES
1- Arrêté n°c69/ MINEF du 08 mars 2005 fixant les différentes catégories d'opération dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental.
2- Article 1 du décret n°2005/0577/ PM du 23 janvier 2005 sur les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.
3- Décret n° 95/ 531/ PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.
4- Décret n° 99/781/PM du 1ér octobre 1999 fixant les modalités d'application de l'article 71 (1) (nouveau) de la loi de 1994.
5- Loi forestière de 1994
SOURCES
174
SOURCES ELECTREONIQUES
1-
175
http://lebiogeographe centerblog. Net/definition-environnement/ww.centerblog.net.
2- www.globalforeshwawatch.org, 2002
3- http://fr.wikipedia.org/wiki/
4- http://www.Groupesefac.com.oct 2010
5- http://www.pallisco.cifm.com
6- http://cameroon.50, info/newsletter.Html
SOURCES D'ARCHIVES
1- A. AN Décret n°64-150/COR du 31 août 1961 transférant deux permis d'exploitation.
2- A. AN Décret n°64/34/COR du 4 mars 1964 accordant un permis d'exploitation.
3- J O R. U. C, 15 mai 1983, décret n°83-169 du 15 mars 1983.
4- Loi n°69/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
5- O.G U.R.C, 1st December 1981, loi n°81-12 du 27 novembre 1981
6- O G U. R. C 1 march 1983
SOURCES ORALES
|
Noms Prenoms |
Ages/ans |
Ethnies |
Métiers |
Dates et de l'interview |
|
Abdoulaye |
33 ans |
Toupouri |
virgile |
06 nov 2010 à Masséa |
|
Akwa Neba Géorge |
45 |
Projet officer poor Redd project |
Oct 2010 Yokadouma |
|
|
Ajonia N Gordon |
48 |
ingénieur forestier/Aménagiste |
Oct 2010 Yokadouma |
|
|
Ebiaboua Yvonne |
75 |
Konabembe |
cultivatrice |
07 nov 2010 Ngatto an |
|
Elindong Panphil |
70 |
Konabembe |
braconnier |
Jan 2009 Ngatto an |
|
Epopodengu Elarion e |
60 |
Bakwele |
Guerisseur-voyant |
05 nov Yokadouma |
|
Etom Didier |
35 |
Konabembe |
planteur |
08 nov 2010 Masséa |
|
Etsal Annie |
35 |
Konabembe |
cultivatrice |
Août 2010 Madjoué |
|
Foang |
50 |
Ingénieur des eaux et forêts |
15 oct 2010 Yaoundé |
|
|
Ladoum M |
36 |
Konabembe |
Agent technique des eaux et forêt |
13 août 2010 Ngatto |
|
Kallo Andre |
45 |
Konabembe |
Chef de village |
08 nov 2009 Masséa |
|
Kpama Théophi l |
60 |
Konabembe |
Instituteur retraité |
Nov 2010 Madjoué |
|
Mballa M |
30 |
Ewondo |
Producteur de charbon de bois |
Sep 2011 Mengueme |
|
Mbot Marie |
65 |
Konabembe |
cultivatrice |
Août 1999 Madjoué |
|
Medjara Irène |
35 |
Konabembe |
Vendeuse au marché de Yoka |
Août 2010Yokadouma |
176
Mouamie
|
60 |
Konabembé |
chasseur |
11 nov 2010 Masséa |
|
|
Méloa |
40 |
Konabembe |
braconnier |
02 nov 2010 Madjoué |
|
Nala |
48 |
Bakweri |
Commerçante au marché de Dla |
22 déc 2010 Douala |
|
Ndoumba Bernard |
35 |
Von-von |
Opérateur radio à TTS |
08 nov 2010 Masséa |
|
Nguedia Joseph |
60 |
Baleven |
Policier retraité |
08 mar 2011 Yaoundé |
|
Souobot Armand |
66 |
Konabembe |
Employé retraité de la mairie |
12oct2010Yokadouma |
|
Tapio Sydonie |
50 |
Konabembe |
cultivatrice |
24 oct 2010 Madjoué |
|
Tatala Françis |
52 |
Konabembe |
planteur |
06 nov 2010 Ngonepoum an |
DICTIONNAIRES
1- Dictionnaire universel, Paris, hachette édicef, 4ème édition, 2002
2- Dictionnaire Petit Larousse, Paris, ISBN, 2001.

