|
République Algérienne Démocratique et
Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Université d'Oran2
Faculté des Sciences de la Terre et de
l'Univers
Département de Géologie

Mémoire pour l'obtention du grade de Master
II en Hydrogéologie
Option :
Hydrogéologie et
Environnement
Thème :
Étude Piézométrique et Hydro
chimique de la nappe des calcaires du
Murdjadjo à l'échelle du
bassin de Ras el Aïn (Oran, Algérie)

Présenté par :
Amouziane Fatima Zohra Hadjal Nadia
Devant le jury :
Mansour Hamidi : Professeur
à l'Université d'Oran 2 Président
Foukrache Mohamed :
Maitre-assistant à l'Université d'Oran 2 Rapporteur
Borsali Toufik : Maitre-Assistant
à l'Université d'Oran 2 Examinateur
Session
2018-2019
Dédicaces
Je dédie ce modeste travail à
:
La mémoire de mon cher et défunt
père
La mémoire de ma chère
grand-mère,
Ma chère Mère,
Mes chers Ahmed-Salim et Yousra,
Mes chers frères,
Mon Amie, soeur et binôme Fatima
-Zohra,
Ma chère Yasmina,
A toute personne ayant contribué de
près ou de loin à la réalisation de ce
Mémoire.
Nadia
Je dédie le fruit de mon travail à
:
Mon cher et défunt
père,
Ma chère mère,
Ma chère soeur Yasmina,
Mes chers Frères,
Ma chère Amie, soeur et binôme
Nadia,
Mon cher Ami, Chikh Boubakeur
Abderahmane,
Mon Ami, Freh-Brahim Abdel Baki,
Mon Ami, Amadou Mounkaïla
Boukhari,
A toute ma famille.
A toute personne ayant contribué de
près ou de loin à la réalisation de ce
Mémoire.
Fatima Zohra
Remerciements
Je remercie Dieu tout puissant pour la volonté, la
santé et la patience qu'il Nous a données durant nos
études.
Au terme de ce travail, il nous est agréable de
remercier tous ceux qui ont contribué à sa réalisation et
en particulier :
Mr. Foukrache, pour avoir accepté de nous encadrer
dans cette étude. Nous le remercions pour son soutien, son implication
et ses encouragements.
Mr. Borsali, qui a eu la bienveillance d'accepter de juger
ce travail et d'être membre du jury à notre soutenance.
Nous remercions également, Mr. Hamidi, pour
présider au jury.
Mr. Benabid, d'avoir accepté de nous fournir les
données, nécessaires à notre travail et de nous avoir
accompagnées, tout au long de ce cursus.
Nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance Mr.
Hayanne pour son soutien, sa disponibilité et son aide permanente. Ses
qualités humaines nous ont beaucoup touchées.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers
notre professeure, Mme Ablaoui pour ses conseils, suggestions et sa
disponibilité permanente.
Nous remercions également Mohammed, du
département de Géographie de l'Université d'Oran2.
Nous adressons notre reconnaissance à Monsieur
Kebdani et Madame Latifa, et à l'ensemble du personnel de L'ANRH de la
Wilaya de d'Oran.
Merci à Saliha Hadjal pour ses conseils et ses
orientations.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos anciens
encadreurs, Monsieur Dakkiche et Monsieur Azri pour leur
disponibilité.
Nos remerciements vont également aux enseignants du
département de Géologie de l'Université de Belgaïd
:
Mr. Hassani, Mme Dakkiche, Mme Belkheir, et Mme
Mabrouk.
Mots clés : Source de Ras el
Aïn, Bassin de Ras el Aïn, Djebel Murdjadjo, agglomération
oranaise, eau souterraine, hydrochimie, faciès chimique, qualité
des eaux, vulnérabilité, pollution.
Résumé :
Le XXIème siècle s'annonce
hélas sous le signe de « la pénurie d'eau », un stress
hydrique touche l'ensemble du bassin de Ras el Aïn de
l'agglomération Oranaise.
Situés à la proximité immédiate de
l'agglomération oranaise, les calcaires récifaux du
Miocène supérieur, appelés le plus souvent «
calcaires du Murdjadjo » constituent le principal réservoir d'eau
souterraine de la région. Cet aquifère karstique est
drainé, entre autres, par la source de Ras el Aïn Il est
sollicité pour nombre d'usages agricoles, domestiques et industriels.
La présence de cette ressource hydrique dans un
contexte urbain, à croissance parfois mal maîtrisée,
augmente sa vulnérabilité aux pollutions multiformes
habituellement générées par ce milieu (fosses perdues,
fuites du réseau d'assainissement, effluents industriels, lessivage des
chaussées, etc.).
La présente étude a permis d'avancer dans
l'état de la connaissance hydrogéologique de l'évolution
de cet Aquifère dans le temps, d'estimer son état d'affectation
par la pollution et plus généralement d'apprécier le
degré de vulnérabilité des eaux souterraines face aux
pollutions urbaines.
Après une étude exhaustive du cadre physique de
la région d'étude rendant compte du contexte
hydrogéologique du système aquifère étudié,
l'étude hydro chimique des eaux de la nappe s'est basée sur
l'interprétation des résultats d'analyses effectuées sur
neuf échantillons d'eau prélevés au niveau de
différents points d'eau (puits, Forages et la source de Ras el
Aïn), lors d'une campagne d'échantillonnages réalisée
entre la période de 2007 et 2018.
L'état de la qualité des eaux a
été apprécié à travers l'étude des
paramètres indicateurs de pollution des eaux prélevées,
ainsi que l'état bactériologique des eaux au niveau de la source
de Ras el Aïn, située dans la partie Méridional du Murdjadjo
et constituant l'exutoire principal de la nappe à l'échelle du
Bassin de Ras el Aïn.
La source de Ras el Aïn se trouve affectée depuis
une dizaine d'années par une pollution aux hydrocarbures qui interdit
toute utilisation de cette eau (près de 6000 m3/j), L'enjeu après
cet accident était de mettre en sécurité la zone,
d'éviter l'extension de la pollution et de dépolluer, traiter les
milieux impactés.
La dernière partie a été consacrée
à la procédure mise en place en 2007 de périmètres
de protection pour protéger les points d'eau du Bassin de Ras el
Aïn.
Les paramètres hydrodynamiques exploités,
confirment la stabilité du caractère dynamique de la nappe
à l'échelle du bassin de Ras el Aïn.
Abstract:
The twenty-first century is characterised by "water scarcity",
water stress affects the entire Ras el Ain Basin of the Oran agglomeration.
Located in the immediate proximity of the Oran agglomeration,
the Upper Miocene reef limestones often called "Murdjadjo limestones", is the
main underground water reservoir of the region. This karstic aquifer is drained
by the source of Ras el Aïn. It is used for agricultural, domestic and
industrial purposes.
This water resource is in an urban area, which growth is
sometimes uncontrolled. It increases its vulnerability to multiform pollution
usually generated by this environment (lost pits, leakage from the sewerage
network, industrial effluents, leaching of pavements, etc.).
The present study has made it possible to improve the
hydrogeological knowledge of the evolution of this aquifer over time, to
estimate its state of use by pollution and more generally to assess the degree
of vulnerability of the underground water facing urban pollution.
After an exhaustive study of the physical setting of the study
area, taking into account the hydrogeological context of the studied aquifer
system, the hydrochemical study of the groundwater was based on the
interpretation of results of analyses carried out on nine water samples
collected at different points (wells, boreholes and the source of Ras el
Aïn), during a sampling campaign carried out between the period of 2007
and 2018.
The water quality was assessed through the study of the
indicators on pollution of the water withdrawn, as well as the bacteriological
state of the water at the source of Ras el Aïn, located in the southern
part of Murdjadjo. The latter is the main outlet of the aquifer at the Ras el
Ain Basin scale.
The source of Ras el Ain has been affected for ten years by
hydrocarbon pollution that prohibits any use of this water (nearly 6000 m3 /
d). After this accident, the main goals were to secure the area, to avoid the
extension of the pollution and to treat the impacted environments.
The last part of this work was dedicated to the procedure set
up in 2007 to protect the water points of the Ras el Aïn Basin.
The hydrodynamic parameters exploited confirm the stability of
the dynamic nature of the aquifer at the scale of the Ras el Aïn basin.
Key words: Ras el AÏn Bassin,
Jebel Murdjadjo, Oran agglomeration, Ground water, hydrochimestry, chemical
facies, water quality, vulnerability, pollution
SOMMAIRE
Introduction générale
1
Chapitre I
Cadre Physique de la région
d'étude
|
I/ - Généralités
|
4
|
|
II/ - Cadre Géographique
|
..4
|
|
III/ - Cadre Géologique et Structural
|
5
|
|
IV/ - Morphologique du Secteur d'étude
|
6
|
|
V/ - Les Sols et la Végétation
|
7
|
|
VI/ -Cadre Litho-Stratigraphique
|
9
|
|
VII/ - Les Faciès de Substratum
|
11
|
|
VII/-1 Jurassique
|
11
|
|
VII/-2 Crétacé
|
11
|
|
VIII/ - Les Faciès de Couverture
|
14
|
|
IX/ -Structure
|
15
|
|
IX/-1 La Déformation dans le Substratum
|
.16
|
|
IX/-2 La Déformation dans la Couverture
|
..16
|
|
X/- Conclusion
|
16
|
Chapitre II
Hydro climatologie de la région
d'étude
I/ - Description générale du climat de la
région 19
II/ - Etude des facteurs climatiques de la station de
Ras-el-Ain 20
II/-1 Température 20
II/-2 Estimation de l'évapotranspiration 21
|
II/-3 Estimation de l'évapotranspiration réelle
(ETR)
|
21
|
|
III/- Précipitations
|
24
|
|
IV/- Régime climatiques
|
26
|
|
IV/-1 Indice xérothermique
|
27
|
|
IV/-2 Diagramme ombrothermique
|
27
|
|
IV/-3 Indice de Martone
|
27
|
|
IV/-4 Bilan hydrologique par la méthode de
Thornthwaithe
|
..28
|
|
V/ - Discussion des résultats
|
31
|
|
VI/ -Conclusion
|
32
|
Chapitre III
Contexte Hydrogéologique de la
région d'étude
I/-Introduction 34
II/-Hydrogéologie 37
III/- Description des principaux Aquifères du
secteur d'étude 39
|
II/-1 l'aquifère des calcaires récifaux du
Djebel Murdjadjo
|
39
|
|
III/1-1 La nappe perchée des crêtes
|
41
|
|
III/1-2 Une nappe captive
|
42
|
|
III/1-3 Une nappe librintermédiaire
|
42
|
|
III/-2 L'Aquifère du calabrien
|
43
|
|
III/-3 L'aquifère des alluvions plio-quaternaires
|
44
|
|
IV/- Fluctuations du débit de la source de Ras el
Ain
. ....45
|
|
|
V/- Piézométrie du secteur d'étude
|
46
|
|
V/-1 Caractère piézométrique de la zone
d'étude
|
50
|
|
VI/- Les paramètres Hydrodynamiques
|
50
|
|
VI/-1 La porosité
|
...51
|
|
VI/-2 Le coefficient de perméabilité
|
51
|
|
VI/-3 La transmissivité
|
........52
|
|
VII/- Conclusion
|
53
|
Chapitre IV
Contexte Hydro chimique
I/-Historique 58
II/-Introduction 59
III/- Zone de prélèvement ......59
IV/- Méthode et matériels 61
IV/-1 Méthodologie de l'étude
hydrogéochimique 61
IV/-2 Méthode de traitement des données
62
IV/-2-1 Diagramme de PIPER 63
IV/-2-2 Diagramme de SCHOELLER-BERKALOFF .63
IV/-2-3 Diagramme de Wilcox 64
V/- Résultats et Discussions
64
V/-1 Balance ionique 65
V/-1-1 Station du bassin de Ras-el-Aïn pour la chronique
2007 65
V/-1-2 La source de Ras-el-Aïn pour la période
2010-2018 66
V/-2 Les paramètres Physiques 66
V/-2-1 La température 66
V/-2-2 Le Potentiel d'Hydrogène 67
V/-2-3 La conductivité électrique 68
V/-3 Les Paramètres chimiques 69
V/-3-1 Les chlorures 69
V/-3-2 Le Titre Hydrotimétrique TH 70
V/-3-3 Le Titre alcalimétrique complet (TAC)
73
V/-4 Principaux éléments présents dans
l'eau ...73
V/-4-1 Le Calcium et le magnésium 73
V/-4-2 Les Sulfate 75
V/-5 Les substances indésirables. 76
V/-5-1 Les Nitrates 76
V/-6 Détermination des principaux faciès hydro
chimiques 78
V/-6-1 Le Diagramme de PIPER ....78
V/-6-2 Le Diagramme de SCHOLLER-BERKALOFF 82
V/-6-2-a Source de Ras-el-Aïn 82
V/-6-2-b Bassin de Ras-el-Aïn 83
V/-6-3 Diagramme de Wilcox ...84
V/-6-3-a Source de Ras-el-Aïn 84
V/-6-3-b Bassin de Ras-el-Aïn 85
VI/-Pollution des nappes souterraines du bassin de
Ras-el-Aïn 86
VI/-1 Les pollutions bactériologiques .....86
VI/-2 La pollution de la source de Ras-el-Aïn par
Hydrocarbures 88
VI/-2-1 Les polluants insolubles plus légers que l'eau
88
VI/-2-2 Les polluants insolubles et plus denses que l'eau
88
VI/-3 Les périmètres de protection 89
VI/-3-1 Le périmètre de protection
immédiate 89
VI/-3-2 Le périmètre de protection
rapprochée ...89
VI/-3-3 Le périmètre de protection
éloignée 91
VII/-Conclusion 93
Conclusion générale
95
Références bibliographiques
Annexe
Liste des figures
Figure n°1 : Situation Géographique du secteur de
Ras-el-Aïn Échelle : 1/15000.00 5
Figure n°2 : Coupe Géologique du versant Sud-Est
du Djebel Murdjadjo ...6
Figure n°3 : Carte des principaux sols de la
région Echelle : 1/1500.00 8
Figure n°4 : Coupe Litho Stratigraphique du versant Sud
du Djebel Murdjadjo .10
Figure n°5 : Les écailles du Djebel Murdjadjo,
d'après B.Fenet.1975 12
Figure n°6 : La Structure
Géologique des environs d'Oran (A.Dagorne, B.Fenet : Oran,
métropole de
l'Ouest Algérien d'hier à aujourd'hui)
13
Figure n°7 : Carte des structures Géologiques de
l'Oranie ..14
Figure n°8 : Description générale du
Climat de la région ..19
Figure n°9 : Température mensuelles de la station
de Ras-el-Aïn, 1990-2005 ....20
Figure n°10 : Variation des Températures moyennes
Période : 1990-2002 21
Figure n°11 : Variation de l'Evapotranspiration,
Précipitations et Températures Moyennes Annuelles
1990-2005 23
Figure n°12 : Précipitations moyennes annuelles
1986-2016 25
Figure n° 13 : Précipitations moyennes mensuelles
1986-2016 25
Figure n°14 : Diagramme Ombrothermique : 1990-2005
27
Figure n°15 : Variation des différents thermes du
bilan Hydrique 1990-2005 ...30
Figure n° 16 : Bilan Hydrique de la station de
Ras-el-Aïn 1995-2005 31
Figure n°17 : Le site d'Oran représenté
(Robert Thinthoin 1956) (Mise en forme par F.Kettaf
(2013) 35
Figure n°18 : Carte du système Aquifère de
la région d'étude 36
Figure n°19 : Principaux Aquifères du secteur
d'étude (d'après A.Joseph) 37
Figure n°20 : Log Hydrogéologique de la
région d'Oran (Hassani.M.!., 1987) 38
Figure n°21 : Carte de localisation des sources et de la
fracturation des calcaires messéniens
(Hassani.1987) ..40
Figure n°22 : Coupe hydrogéologique
schématique du Djebel Murdjadjo (M.!. Hassani,
(1987) 41
Figure n°23 : Fluctuation des débits de la source
de Ras-el-Aïn (1700-2019) 45
Figure n°24 : Carte de localisation des
piézomètres du bassin de Ras-el-Aïn (2007-2018)
Échelle :
1/25000 49
Figure n°25 : Carte piézométrique de
Ras-el-Aïn 2000 Équidistance des courbes 5m 53
Figure n°26 : Agrandissement de la carte
piézométrique 2007 54
Figure n°27 : Carte piézométrique de
Ras-el-Aïn 2018 Équidistance des
courbes:10 ...55
Figure n°28 : Agrandissement de la carte
piézométrique 2018 56
Figure n°29 : Carte de la localisation des points
d'eau du bassin de Ras-el-Aïn Échelle :
1/25000 60
Figure n°30 : Variation des températures de la
source de Ras-el-Aïn 2007-
2018 67
Figure n°31 : Variation du PH des échantillons
d'eau de la source de Ras-el-Aïn 2007-
2018 68
Figure n°32 : Evolution de la conductivité
électrique de la source de Ras-el-Aïn 2007-
2018 ...69
Figure n°33 : Evolution de la concentration en
chlorures de la source de Ras-el-Aïn 2007-
2018 70
Figure n°34 : Evolution du titre hydrométrique
de la station de Ras-el-Aïn2007-
2018 71
Figure n°35 : Evolution du titre
alcalimétrique du bassin de Ras-el-Aïn 2007-
2018 ...73
Figure n°36 : Evolution de Ca2+ et
Mg2+ du bassin de Ras-el-Aïn 2007-
2018 ...73
Figure n°37 : Evolution des sulfates dans le bassin
de Ras-el-Aïn 2007-
2018 ...75
Figure n°38 : Evolution des Nitrates dans le bassin
de Ras -el-Aïn 2007-
2018 76
Figure n°39 : Diagramme de PIPER- (Source de Ras el
Aïn
(2007-2018) 77
Figure n°40 : Diagramme de PIPER-Bassin de
Ras-el-Aïn
2007 78
Figure n°41 : Diagramme de SCHOLLER-BERKALOFF-Source
de Ras-el-Aïn 2007-
2018 82
Figure n°42 : Diagramme de SCHOLLER-BERKALOFF-Bassin
de Ras-el-Aïn
2007 83
Figure n°43 : Diagramme de WILCOX-Source de
Ras-el-Aïn 2007-
2018 84
Figure n°44 : Diagramme de WILCOX-Bassin de
Ras-el-Aïn 2007-
2018 85
Figure n°45 : Évolution bactériologique
de la source de Ras el Aïn 2010-
2011 87
Figure n°46 : Pollution par un produit plus
léger que l'eau et qui atteint la
nappe 88
Tableau n°19 : Tableau descriptif du
périmètre de protection intermédiaire (Zone!!!)
(S.Benabid
ANRH-2007) 91
Figure n°47 : Pollution de la nappe par un produit
plus lourd que
l'eau 88
Figure n°48 : Cartes de délimitations des
périmètres de protections (S.Benabid ANRH-2007) (Zone !!
et Zone !!!) Echelle 1/50000 92
Liste des tableaux
Tableau n°1 : Température mensuelles de la
station de Ras-el-Aïn 21
Tableau n°2 : Evapotranspiration moyenne mensuelle
1990-2005 .22
Tableau n°3 : Précipitations annuelles
1986-2016 24
Tableau n°4 : Classification de Martonne de Climat
27
Tableau n°5 : Calcul de l'ETR par la méthode
de comparaison de Thornthwaite 29
Tableau n°6 : La valeur moyenne de l'ETR 1990-2005
30
Tableau n°7 : Calcul Totaux des principaux
paramètres hydriques 1990-2005 30
Tableau n°8 : Les débits enregistrés
à la source de Ras-el-Aïn (1700-2019) 45
Tableau n°9 : Niveau piézométrique
mensuels du bassin de Ras-el-Aïn ..48
Tableau n°10 : Quelques ordres de grandeurs des
valeurs de Porosités totale et
efficace 50
Tableau n°11 : Quelques ordres de grandeurs de
coefficients de perméabilité 51
Tableau n°12 : Transmissivité des
Aquifères du bassin de Ras-el-Aïn 2001 52
Tableau n°13 : Données hydro chimiques du
bassin de Ras-el-Aïn 2007 62
Tableau n°14 : Données hydro chimiques de la
Source de Ras-el-Aïn 2007-2018 62
Tableau n°15 : Les pourcentages d'erreurs des
échantillons d'eau prélevés dans le bassin de
Ras-el-
Aïn ....65
Tableau n°16 : Echelle de concentration des ions
Ca2+ et Mg2+ 74
Tableau n°17 : Relevés bactériologiques de
la Source de Ras-el-Aïn 2010-2011 87
Tableaun°18 : Tableau descriptif du
périmètre de protection intermédiaire (Zone !!) (S.Benabid
ANRH-
2007) ....90
Liste des abréviations
ANRH: Agence Nationale des
Ressources Hydriques
SEOR: Société de
l'Eau et l'Assainissement d'Oran
GPS: Prise des
Coordonnées géographiques
ETP: Évapotranspiration
potentielle (mm)
ETR : Éstimation de
l'Evapotranspiration Réelle
P: Précipitation moyenne
mensuelle (°C)
I: Indice thermique
annuel
L: Pouvoir
évaporant
T: Moyenne interannuelle des
températures du moi en °C
RFU: Réserve en eau
facilement Utilisable
TAC: Titre Alcalimétrique
Complet
TH: Titre
Hydrométrique
AEP: Alimentation en Eau
Potable
AEB: Alimentation en Eau du
Bétail
AHP: Automne, Hivers,
Printemp

1
I/- Introduction générale
L'histoire d'Oran est étroitement liée à
deux éléments majeurs : la présence de ressources d'eau
douce, élément de première importance pour une ville, et
la présence de la remarquable rade de Mers-el-Kébir, un abri
naturel contre tous les vents situé à quelques kilomètres
d'Oran), qui ont fait d'elle une place forte.
La ville d'Oran est située au nord-ouest de
l'Algérie, elle est construite sur les flancs abrupts du Mont Murdjadjo,
sur les rives de l'Oued Rehhi (l'Oued des Moulins) où coulait une eau
abondante qui avait attiré de tout temps des conquérants.
La principale ressource en eau potable de l'Oranie est la
nappe libre de l'aquifère des calcaires récifaux du Djebel du
Murdjadjo, issue de sources et d'écoulements pluviaux du Murdjadjo.
Cette ressource est abondante et généralement de bonne
qualité comme le montre la présente étude, du fait d'une
alimentation par des eaux issues du « Horst Murdjadjo » garantissant
un débit élevé, elle est drainée par un nombre
important de bassins, parmi les quels, celui de Ras el Aïn (sujet de notre
étude), situé sur son Flanc Sud.
Cependant, le développement des activités
industrielles, de l'urbanisation, des réseaux routiers et autoroutiers
sont autant de menaces pour la pérennité de la qualité de
cette ressource. D'autre part, le bassin versant de notre secteur
d'étude se situe dans une région sous influence
méditerranéenne le classant sous un régime semi aride avec
des valeurs de l'ETP supérieures à la lame d'eau
précipitée.
Notre travail est consacré à l'inventaire et
l'actualisation des données sur les ressources en eaux souterraines du
bassin de Ras el Aïn.
Cette étude est basée sur la collecte
d'informations importantes, pour but principal, l'évaluation des
ressources exploitables en eaux destinées pour les usages domestiques,
agricoles et industriels.
Pour plus de clarté dans la présentation de ce
mémoire, nous l'avons scindé en quatre chapitres :

2
Le premier chapitre présente une vue
générale sur la zone d'étude est consacré à
l'étude du contexte géologique et structural de la
région.
Le deuxième chapitre a pour but
d'évaluer à l'aide d'une étude hydro climatologique les
différents termes du bilan hydrique, en s'appuyant essentiellement sur
les relevés pluviométriques et de températures.
Le troisième chapitre est
consacré à l'hydrogéologie. A partir de données
dont nous avons pu disposer, nous avons essayé de délimiter les
aquifères à l'aides de cartes piézométriques, de
déterminer le sens d'écoulement des nappes et d'en déduire
leurs évolutions spatiotemporelles.
Le quatrième chapitre est
consacré à l'évaluation qualitative des ressources en eau
à partir de l'interprétation des résultats d'analyses
chimiques, pour une meilleure identification des faciès chimiques et une
meilleure vision de la qualité des eaux souterraines.
Enfin, Ce travail sera achevé par une conclusion
générale et une série de recommandations proposées
à la lumière de l'étude réalisée ainsi
qu'aux problèmes rencontrés.
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
- 3 -
CHAPITRE I
Cadre physique de la région
d'étude
- 4 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
Chapitre I
Cadre physique de la région d'étude I/-
Généralités :
La source Ras-el-Ain a été utilisée
depuis l'époque Carthaginoise (Archives APC d'Oran) en passant par
l'occupation espagnole et la période Ottomane.
Aucun élément ne permet de fixer l'époque
à laquelle fut creusée la galerie qui a permis le captage du
griffon de la source.
En 1850, cette galerie a été prolongée et
partiellement revêtue et en 1942, reliée à un canal de
dérivation qui conduit l'eau dans un puisard où elle est
pompée vers un château d'eau.
Les premières données concernant la source ont
été publiées en 1852 et l'étude sera reprise plus
tard en 1939 par Monsieur Dalloni.
A plusieurs périodes l'observation du débit de
la source a été suspendue, et ce n'est que vers 1976 que l'on
commença à s'intéresser à ce point d'eau.
L'observation ne reprend sérieusement qu'en 1992 avec
l'équipement de la source d'un limnigraphe à pression et des
mesures de débits mensuelles, exécutés par l'Agence
Nationale des Ressources hydrauliques, pour le compte du Service des Etudes et
d'Inventaire (Section Surveillance des nappes).
II/- Cadre Géographique :
Notre secteur d'étude, qui correspond à la
partie orientale du Djebel Murdjadjo qui a fait l'objet de nombreuses
recherches sur les quelles nous nous sommes basés pour réaliser
une synthèse locale. Le secteur de Ras-el-Aïn appartient au Tell
septentrional et englobe la carte d'Oran au 1/50000eme (Figure
n°1).
Les limites naturelles sont constituées au nord, par la
mer Méditerranée, au sud par la grande Sebkha d'Oran, à
l'Ouest, par la plaine des Andalouses et à l'Est par le DJbel Khar.
- 5 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
La Source de Ras-el-Aïn représentant l'exutoire
principal de l'aquifère est située à
l'extrémité Sud-Est du djebel Murdjadjo. Lequel, constitue la
plus orientale des chaines côtières Alpines de l'Oranie de
direction moyenne Sud-Ouest-Nord Est au point de coordonnées Lambert
suivantes :
? X = 196.130
? Y = 271.250
? Altitude du sol (z) = 75.489
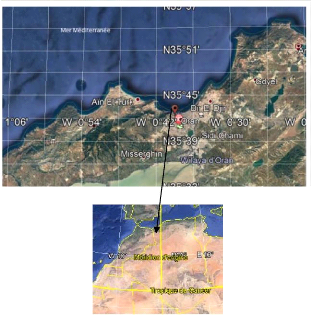
Figure n°1 ? Situation Géographique du
secteur de Ras-el-Aïn-
Échelle :
1/15000
III/- Cadre Géologique et Structural :
La description géologique du bassin de Ras-el-Aïn
est basée sur les informations exploitées à partir des
observations effectuées sur le terrain, essentiellement au niveau du
massif du Murdjadjo.
- 6 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
Le littoral oranais est une zone assez élevée
très abrupte entourée de plaines basses subsidentes
Constituées de petits Bassins dont le bassin de Ras-el-Aïn. Ce
littoral est constitué de plateaux aux bords escarpés, souvent
vers le Sud. Le caractère fondamental de ces reliefs est leurs
jeunesses. Oran est une grande région reposant sur le Quaternaire
Continental dont la partie côtière est formée de terrains
du Plio-quaternaire continental et du Miocène supérieur.
Nous distinguons 02 ensembles :
- Un substratum Anté-synchro-nappe affleurant dans la zone
haute. - Un remplissage Néogène au centre du bassin.
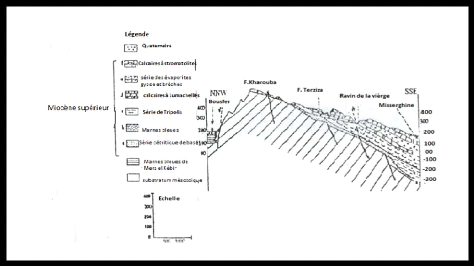
Figure n°2 - Coupe Géologique du versant
Sud-Est du Djebel Murdjadjo
IV/- Morphologie du Secteur d'étude :
Le Sahel d'Oran constitue naturellement le coeur de l'Oranie,
la ville d'Oran est située au fond Sud-Ouest de la baie, à cheval
sur le ravin de Ras-el-Aïn qui sépare la plaine sublittoral
dominant la mer par une falaise haute de 100 mètres constituant le
Plateau d'Oran et à l'Ouest, le massif du Murdjadjo.
- 7 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
Le flanc Sud du Murdjadjo et le Plateau d'Oran constituent un
ensemble comprenant les dépressions dont la grande sebkha d'Oran, la
basse Plaine, les piémonts et le flanc du monoclinal.
Sa disposition recoupe le littoral, orienté dans
l'ensemble Sud - Ouest / Nord - Est, les altitudes passent de 80 mètres
au niveau de la Sebkha à 500 mètres sur le sommet de la
montagne.
L'ensemble est divisé en sous-bassins
endoréiques se déversant d'une manière
générale dans l'exutoire principal qu'est la sebkha à
l'exception du sous bassin de la fameuse source Ras-el-Aïn qui fut
à l'origine de la fondation de la ville d'Oran et dont les eaux se
jettent dans la mer.
Les composants qui forment le grand bassin endoréique du
flanc Sud du Murdjadjo
sont :
- Le sous-bassin de Brédéah.
- Le sous-bassin de Misserghin.
- Le sous-bassin d'Ain El Beida.
Et enfin le plateau d'Oran qui constitue naturellement le
coeur de la ville d'Oran et borde le Murdjadjo dans sa partie Sud-Est avec vue
sur le ravin de Ras-el-Aïn qui sépare la plaine sublittoral
dominant la mer par une falaise haute de 100 mètres. Il s'étend
au Sud jusqu'aux premiers affleurements de calcaires d'Ain Beida et se poursuit
à l'Est par le Plateau de Saint Louis (Hassi) sa superficie avoisine
quelque 150 à 180 km2.
V/-Les Sols et la Végétation :
La répartition des sols et de la
végétation dans cette région ne peut être
évoquée sans certain schématisme.
En effet les sols constituent des mosaïques
compliquées où se mêlent paléosols et sols
récents et où les conditions locales (roche mère,
topographie) permettent l'introduction de nombreuses variantes.
La couverture pédologique quasi homogène est
caractérisée par la présence de trois classes de sol
(Figure n°3):
-Sols peu évolués : alluvions d'oueds (galets,
graviers, argile).
-Sols calci -magnésiques : piedmonts des massifs
avoisinants (sols rouges).
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
-Verti -sols : sols gris sombre localisés au niveau des
dépressions, moins étendus.
Les versants sont couverts par une végétation
constituée par la brousse à jujubier, arbustes épineux,
pins d'Alep et par les conifères.
Les cultures maraîchères ou fruitières
très limitées dans l'espace, sont localisées surtout
autour des points d'eau.

Figure n°3 - Carte des principaux sols de la
région Échelle : 1/1500.000
- 8 -
- 9 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
VI/- Cadre Litho-Stratigraphique :
Reposant sur un substratum Mésozoïque, les
formations que l'on rencontre sont souvent rattachées au Miocène
et plio-quaternaire (Figure n°4)
Sur le plan stratigraphique, le Versant Sud
du Djebel Murdjadjo est caractérisé par la présence de
trois ensembles bien distincts :
? Le substratum formant l'ossature ? Les terrains du
Miocène supérieur
? La couverture et le remplissage alluvionnaire Polio
-quaternaire de la Sebkha.
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude

- 10 -
Figure n°4 - Coupe Litho stratigraphique du
versant sud du Djebel Murdjadjo
- 11 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
VII/- Les Faciès de Substratum :
Le Jurassique et le crétacé inférieur
constituent les formations des mésozoïques les mieux
représentées sur le Murdjadjo.
VII/-1 Le Jurassique représenté par :
-Le Lias : Il s'agit d'une formation
carbonatée formée de lentilles dolomitiques massives
accompagnées de calcaires schisteux et marmoréens. Elle a
été attribuée au Lias par M.Doumergue (1912) et correspond
à l'allochtone carbonaté de B.Fenet (1975).
-Le Dogger (Jurassique moyen) : qui surmonte
les formations liasiques. Les schistes calcaires ardoisiers passent à
des schistes rougeâtres et affleurent au sommet du Djebel Murdjadjo.
-Le Malm : (Kimméridjien et Thioniques
inférieur) : Il est représenté par des petits bancs de
calcaires alternés de niveau d'argile d'une centaine de mètres
d'épaisseur.
VII/-2 Crétacé représenté par
:
-Le crétacé inférieur : Il est
représenté essentiellement par des formations schisteuses qui
occupent la partie nord du secteur étudié. Ils sont visibles tout
le long de la ligne de crête du Murdjadjo. Ces schistes forment la
majeure partie de l'ossature du Murdjadjo (500 m).
- Le Néocomien est représenté par des
schistes massifs argileux à bancs de quartzites blancs.
- Le Barrémien est représenté par des
schistes- calcaires jaunes, compacts contenant des ammonites pyriteuses.
-Le Crétacé supérieur : Il est absent de
la feuille d'Oran soit par ablation, soit par non dépôt, on le
retrouve plus à l'Est sur la feuille d'Arzew.
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
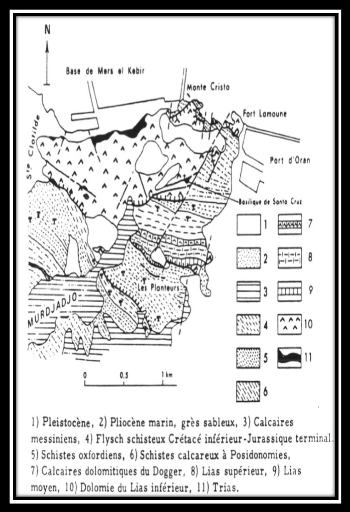
- 12 -
Figure n° 5 ? Les écailles du Djebel
Murdjadjo, d'après B.Fenet, 1975
- 13 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
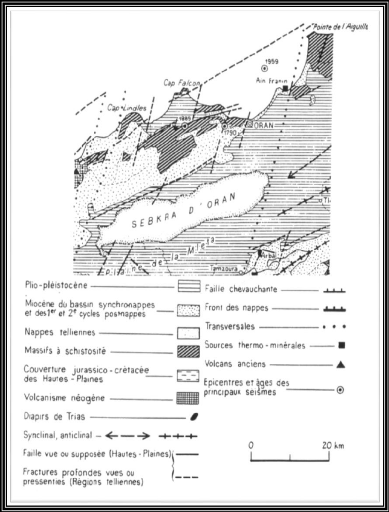
Figure n° 6 ? La Structure Géologique des
environs d'Oran (A. Dagorne, B. Fenet : (Oran, métropole de l'ouest
algérien d'hier à aujourd'hui.)
- 14 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude

Figure n°7 ? Carte des structures géologiques
de l'Oranie
VIII/- Les Faciès de Couverture :
Le Miocène est formé en grande partie par des
marnes bleues jouant parfois le Rôle de mur d'aquifère (Guardia,
1975). Il est constitué de formations transgressives. Y.Gourinard (1958)
avait déjà esquissé les grandes lignes de la
sédimentation néogène et a fourni une cartographie
détaillée de cette région, mis en évidence le
rôle de la Tectonique durant la sédimentation.
(Delfaut et Al.1973) ont proposé la succession
verticale du Miocène terminal du Djebel Murdjadjo dont les
différentes unités sont de bas en haut : (Figure n°4 et
Figure n°5)
- La série de base : Qui correspond
à des grès à Clypéastres issus des niveaux
transgressifs. Ce sont des grès sableux parfois à ciment calcaire
à nombreux éléments empruntés au substratum. Cette
série est représentée sur le versant Sud-Est du Djebel
Murdjadjo.
- 15 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
- Les marnes bleues : (Formations
médianes) qui reposent en biseau (Figure n°3) dans le versant sud
du Djebel Murdjadjo. Elles affleurent localement au fond des carrières
des Planteurs.
-Tripolis et gypse : (Formations terminales)
: Les marno- calcaires blancs à tripolis affleurent largement dans le
Djebel Murdjadjo et dans sa bordure sud (falaise d'Oran, Ravin Blanc, Eckhmul,
Ras el Aïn et Oued Misserghine). Il a été constaté,
aussi la présence de bancs de grés par endroits intercalés
à des Tripolis ainsi que des rognons de silex noirâtre au niveau
de Ras-el-Aïn.
- Les récifs coralliens : Ils marquent
la dernière transgression de la mer Miocène. En amont du Horst
Murdjadjo, les calcaires reposent sur des marnes à Tripolis, dont le
dépôt correspond au maximum de l'extension de la mer
miocène et au début de régression.
Les calcaires récifaux qui affleurent le Murdjadjo se
noient sous les alluvions
plio- quaternaires, leur plongement s'accentue à la faveur
de failles bordières N60°.
-Les alluvions anciennes : Les niveaux marins
du Pléistocènes de l'Oranie sont rares. Ces alluvions
résultent de l'érosion rapide des formations situées en
amont de la plaine. Le long du littoral Oranais actuel, les dépôts
du Pleistocène supérieur sont bien représentés,
dans la zone des piémonts du Djebel Murdjadjo. Ils se présentent
sous forme de terrasse et glacis d'accumulations formés de limons
sableux ou argileux rubéfiés (Thomas, 1985).
IX/- Structure :
La région a été affectée par des
tectoniques successives cassantes et disloquantes ayant entraîné
à des âges différents la formation de Horsts (la montagne
des Lions (Djebel Khar), Cap Lindlès (surrection primaire) ainsi que le
Murdjadjo. Ce dernier, constitue un Horst dissymétrique dont l'axe est
orienté suivant une direction Sud-Ouest - Nord- Est, selon (A. Perrodon
.1957), ce Horst de terrains mésozoïques a permis des mouvements
verticaux localisés qui ont joué récemment en surrection.
Le relèvement dissymétrique avec basculement vers le sud a permis
à des séries plus récentes de se déposer sur le
flanc sud.
- 16 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
IX/-1 La déformation dans le substratum :
Les terrains schisteux du substratum forment une série
complexe fortement plissée et légèrement
métamorphisée. On distingue dans cet ensemble deux phases de
schistosité (B.Fenet, 1974)
-La première phase est à avec des plis
couchés à schistes verts affleurant le long des accidents majeurs
de direction Nord - Sud.
- La deuxième phase est à schistosité de
fracture de direction N130°.
Ces contacts anormaux se pendent vers le Nord - Nord Est et
contiennent des roches éruptives.
La deuxième phase de schistosité fait que les
parties supérieures du Djebel Khar ont tendance à se
déplacer d'où le chevauchement des écaillages de la
première phase par les dolomies de Santa -Cruz.
IX/-2 La déformation dans la couverture :
Les Terrains Miocènes forment l'essentiel de la
couverture du Murdjadjo. Cette formation est discordante sur les terrains
antérieurs. Le littoral Oranais a subi une distension qui a donné
naissance à des Grabbens et des Horsts selon trois familles d'accidents
verticaux.
- Une des conséquences les plus importantes est
l'installation du bassin néogène (Sebkha-Chellif) limité
par des accidents N60°.
-La deuxième phase détermine des structures
souples à grands rayons de courbures. C'est l'accident de Bousfer, celui
qui sépare le Murdjadjo de Santa Cruz à l'Ouest du plateau
d'Oran. Cette deuxième phase est de direction N20°.
- La Troisième famille d'accident est orienté N
80°. Ces accidents sont plus importants, car ils limitent de
véritables fossés d'effondrement (grabben de Mers el
Kébir), ou s'accumulent d'épaisses formations plio-
quaternaires.
X/- Conclusion
La région Oranaise est très diversifiée,
ses strates appartiennent aux quatre ères Géologiques. La
région d'étude s'intègre dans la terminaison occidentale
de la chaine Alpine Tellienne ou (Atlas Tellien).
- 17 -
CHAPITRE I : Cadre physique de la région
d'étude
Les formations géologiques de cette région
s'étendent depuis l'âge primaire jusqu'au Quaternaire.
Des Schistes d'âge secondaire forment ce qu'on appelle les
massifs schisteux côtiers de l'Oranie, à l'Ouest d'Oran ville, ils
forment la Montagne des Lions et surplombent la partie septentrionale du
Murdjadjo.
Les calcaires d'âge secondaire sont assez bien
représentés dans l'Oranie. Ils forment, le plus souvent des
reliefs assez escarpés. Ces Calcaires forment la partie
méridionale du Murdjadjo dont fait partie notre secteur
d'étude.
Ainsi, le bassin de Ras el Aïn se trouve focalisé sur
une assise carbonatée (calcaires du Murdjadjo). Cette formation est
parsemée de figures de dissolution : lapiez, dolines, avens, etc...
Toutes ces formes du modèle karstique confèrent
à ces calcaires une forte perméabilité qui est à
l'origine de l'existence de l'aquifère représentant cette
région.
L'exutoire principal de cette nappe étant
représenté par la source de Ras el Aïn. Cependant,
l'aquifère des calcaires au niveau du bassin de Ras el Aïn, ne
constitue qu'une partie de tout le système hydrogéologique du
Murdjadjo dont les autres parties se prolongent vers les bassins de
Misserghine, Brédéah et Bouyakour.
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
- 18 -
CHAPITRE II
HYDRO -CLIMATOLOGIE
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
Chapitre II
HYDRO CLIMATOLOGIE
I/- Description générale du climat de la
région :
Le climat est parmi les ressources naturelles, il constitue un
patrimoine dont la
Connaissance est primordiale tant par son côté
positif, c'est-à-dire comme source de richesse renouvelable (eau -
production agricole- énergie solaire - etc....) que par les contraintes
qu'il impose (variabilité - phénomènes dangereux -
transport de polluants).
L'Algérie est un pays de la zone subtropicale du
Nord-africain. Son climat est très différent entre les
régions. Il est de type méditerranéen sur toute la frange
nord qui englobe le littoral et l'atlas tellien (étés chauds et
secs, hivers humides et frais), semi-aride sur les hauts plateaux au centre du
pays, et désertique dès que l'on franchit la chaine de l'Atlas
saharien
En Algérie les précipitations sont
caractérisées par une variabilité Spatio-temporelle
très marquante.
La wilaya d'Oran se situe en grande partie dans le domaine
climatique méditerranéen semi-aride, elle reçoit en
moyenne entre 300 à 400 mm de précipitations annuelles. La
température moyenne annuelle est de 18.1 °C à Oran. L'eau y
est donc rare, irrégulière et inégalement répartie
dans l'espace. Les facteurs limitatifs sont d'ordres climatique, morphologique,
lithologique, structural et géomorphologique comme le montre la figure
n°8
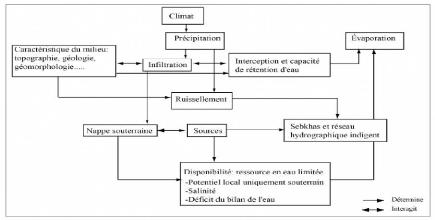
Figure n° 8 ? Description générale
du climat de la région
- 19 -
- 20 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
II/- Étude des facteurs climatiques de la station de
Ras-el-Aïn :
II/-1Températures :
La température est un élément fondamental
du climat. Elle est liée à la radiation solaire. Sa variation
influe sur la transformation des eaux en vapeur, que ce soit à la
surface ou dans le sous-sol.
De ce fait, elle influe sur le degré
d'évapotranspiration et par conséquent elle agit sur le taux de
salinité des eaux. Toutefois, la température a un rôle
important dans la variation des composantes du bilan hydrologique. Nous avons
rassemblé dans le Tableau n°1, ci-dessous les
temppératures moyennes mensuelles enregistrées au niveau du
bassin de Ras el AÏn, couvrant la période d'observation allant de
1990 à 2005.
|
Ras el Aïn
|
Jan
|
Fév.
|
Mars
|
Avr.
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sept
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc
|
|
T max
|
20,03
|
21,6
|
24,19
|
25,21
|
27,75
|
29,59
|
34,47
|
35,5
|
32,79
|
29,17
|
25,16
|
20,17
|
|
T min
|
3,7
|
5,49
|
4,99
|
7,34
|
9,75
|
14,26
|
18,42
|
18,04
|
14,57
|
11,44
|
5,75
|
3,52
|
|
T moy
|
12,11
|
12,85
|
14,33
|
15,54
|
18,24
|
20,99
|
23,61
|
25,28
|
25,72
|
18,54
|
15,04
|
12,12
|
Tableau n°1 ? Températures mensuelles de la
station de Ras-el-Aïn (1990-2005)

Figure n°9 ? Températures mensuelles du
bassin de Ras-el-Aïn Période - 1990-2005
- 21 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
D'après la Figure n°9, nous
constatons que les mois les plus chauds sont les mois de juillet et août
avec une température moyenne 25°C.
Le mois le plus froid est le mois de janvier avec une
Température moyenne de 11°C, A l'échelle mensuelle, la
variation de la température ne présente pas de grandes
fluctuations, les températures minimales, maximales et moyennes sont
concordantes. Cependant, nous remarquons une irrégularité des
Températures moyennes annuelles à l'échelle mensuelle
(Figure n°10).

25
20
15
10
0
5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002
19,12 20,15
16,55 15,28
Tmoy(°c)
21,86
Tmoy(°c)
19,25 17,89 19,12
14,06 15,43
8,26
Figure n°10 ? Variation des Températures
moyennes
Période - 1990- 2002
II/-2 Estimation de l'évapotranspiration :
Le phénomène d'évaporation constitue une
étape importante dans le cycle hydrologique dès l'arrivée
des premières gouttes de pluies à la surface du sol. Ce processus
peut se produire à la surface des plans d'eau, des sols humides ou bien
à la surface d'un couvert végétal, ce dernier cas est
appelé transpiration ; ces deux termes ont été
regroupés sous le nom d'évapotranspiration.
On distingue :
Évapotranspiration potentielle ETP :
L'estimation de ce paramètre a été
établie à l'aide de la formule de G.W.Thornthwaite.
- 22 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
L'agronome américain G.W. Thornthwaite proposa en 1948 une
expression pour l'estimation de l'évapotranspiration potentielle en
tenant compte seulement de la température mensuelle.
Le développement de cette expression donne la formule
suivante :

? ETP(m) : l'évapotranspiration moyenne du mois m (m = 1
à 12) en mm,
? T : moyenne interannuelle des températures du mois en
°C
a : 0.016 * I + 0.5
?
? I : indice thermique annuel

Selon ces considérations, nous avons
résumé dans le Tableau n°2, ci-dessous les résultats
obtenus de l'évapotranspiration moyenne mensuelle pour la série
d'observations ainsi considérée.
|
Ras el Aïn
1990-2005
|
sept
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
Jan
|
Fév.
|
Mars
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
|
T° Moy
|
25,72
|
18,54
|
15,4
|
12,12
|
12,1
|
12,9
|
14,33
|
15,54
|
18,24
|
20,99
|
23,61
|
25,28
|
|
ETP
|
120
|
61
|
44
|
31
|
30
|
34
|
41
|
47
|
60
|
80
|
95
|
110
|
|
I(°c)
|
11,94
|
7,27
|
5,29
|
3,82
|
3,81
|
4,2
|
5,56
|
7,09
|
8,77
|
10,48
|
11,63
|
11,94
|
Tableau n°2- Evapotranspiration moyenne
mensuelle
1990-2005
- 23 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie

Figure n°11 - Variations de
L'Évapotranspiration potentielle et Températures
Moyennes
mensuelles
1990-2005
Les valeurs de l'ETP calculées par la formule de
Thornthwaite à l'échelle mensuelle sont en
générale supérieure à la lame d'eau
précipitée (Figure n°11).
II/- 3 Estimation de l'évapotranspiration
réelle (ETR) :
Elle peut se faire à l'aide de plusieurs formules parmi
lesquelles, nous avons pris en considération la méthode de
Turc :
L'ETR est calculée par l'expression suivante :

Avec :
P : précipitation moyenne annuelle (mm) ; P=338.3
mm
T : température moyenne annuelle (C°) ; T=
17.86 °C
L : pouvoir évaporant, L = 300 + 25T +
0,05T3
ETR : évapotranspiration réelle (mm).
ETR = 355 mm
ETR représente 105 % des
précipitations.
- 24 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
III/- Les précipitations :
La connaissance des Données des précipitations
pour la période d'observations de 1986 à 2016 fournies par
l'ANRH, (Tableau n°3) permet en particulier de calculer la lame d'eau
tombée sur la région de Ras el Aïn. Cette opération
qui reste relativement délicate, nécessite la combinaison de
différentes méthodes afin de prendre en considération les
contraintes géographiques existantes telles l'altitude, topographie et
l'exposition.
-La répartition des précipitations annuelles sur
la période 1986- 2016 manifeste une irrégularité
interannuelle très marquée (Figure n°12).
-Quant à la distribution des précipitations
à l'échelle mensuelle (Figure n°13), elle accuse, un indice
saisonnier de type AHPE (Automne, Hiver, Printemps,
Été)
|
Année
|
P (mm)
|
Années
|
P(mm)
|
|
1986
|
276,6
|
2002
|
360,3
|
|
1987
|
329,2
|
2003
|
335,6
|
|
1988
|
274,5
|
2004
|
353,9
|
|
1989
|
401,9
|
2005
|
370,1
|
|
1990
|
453,1
|
2006
|
383,7
|
|
1991
|
409,7
|
2007
|
414,6
|
|
1992
|
249,4
|
2008
|
534,9
|
|
1993
|
284,9
|
2009
|
510,8
|
|
1994
|
310,4
|
2010
|
285,8
|
|
1995
|
386,5
|
2011
|
429,9
|
|
1996
|
226,8
|
2012
|
624,4
|
|
1997
|
249,3
|
2013
|
406,0
|
|
1998
|
307,2
|
2014
|
368,2
|
|
1999
|
328,8
|
2015
|
282,3
|
|
2000
|
402,0
|
2016
|
364,5
|
|
2001
|
385,2
|
|
Tableau n°3 ? Précipitations
Annuelles
Bassin de Ras el Aïn
- 25 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
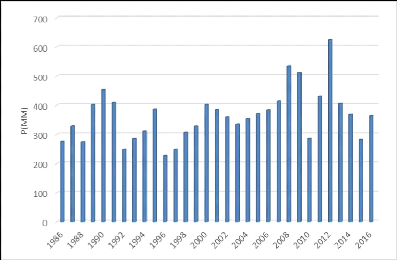
Figure n° 12 - Précipitations moyennes
Annuelles
Bassin de Ras el Aïn
1986-2016
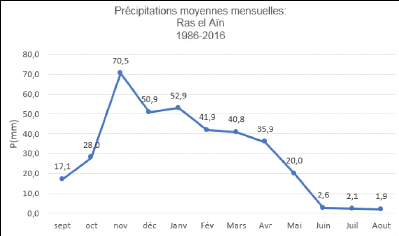
Figure n°13 ? Précipitations moyennes
mensuelles
1986-2016
- 26 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
IV/- Régime Climatique :
Le climat dans une région peut être estimé
à travers certains paramètres qui mettent en Relation la
température et les précipitations caractérisant cette
région.
IV/-1 Indice xérothermique :
Cet indice xérothermique appelé aussi diagramme
ombrothermique de Gaussen, il définit le Mois sec par la comparaison
entre le total des précipitations de ce mois en mm et le double de sa
température.
P= 2T
P : Précipitation mensuelle (mm).
T : Température moyenne mensuelle (°c).
D'après la formule, un mois sec est celui ou le total
de précipitations est égal ou inférieur au double de la
température moyenne mensuelle exprimée en degrés Celsius.
Quand la courbe de température est au-dessus de celle des
précipitations, la zone délimitée représente la
zone sèche.
IV/- 2 Diagramme Ombrothermique :
Le diagramme Ombrothermique (Figure n°14) permet de
déterminer la période sèche et la période humide de
l'année. Il définit la période humide comme étant
celle ou les précipitations mensuelles dépassent le double de la
température mensuelle, tandis que la période sèche est
celle ou le double des températures mensuelles dépasse les
précipitations mensuelles.
Sur ce diagramme (voir figuren°14 ci- dessous), nous
constatons que du mois d'avril au mois d'octobre ce milieu connait une
période de sécheresse.
Les températures sont assez élevées
à plus de 25°C l'été, alors que les
précipitations sont quasi inexistantes avec un minimum atteint au mois
de juillet.
- 27 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
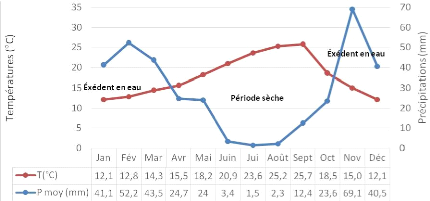
Figure n°14 - Diagramme Ombrothermique
1990-2005
IV/- 3 Indice de Martonne :
Cet indice est fonction des températures et des
précipitations ; il est calculé par la relation suivante :

P : Précipitations moyenne annuelle (mm).
T : Température moyenne annuelle (°C).
Suivant les valeurs de I, De Martonne a établi la
classification suivante :

Tableau n°4 - Classification de Martonne de
Climat
Pour la période de 1990 à 2005 : P moy =
338.3 mm
T moy= 17.86 °c
I =12.14 Le climat de Ras-el-Aïn est de type
semi-arid
- 28 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
IV/- 4 Bilan hydrologique par la méthode de
Thornthwaithe
L'utilisation des différents paramètres
hydro-climatiques calculés, auparavant, permet de fournir une base de
données nécessaire pour le calcul de l'ETR par la méthode
de Thornthwaite.
Cette méthode est basée sur la notion RFU qui
est défini comme étant la réserve en eau facilement
utilisable et qui dépend de la saturation du sol et des
précipitations.
La quantité d'eau stockée dans la RFU est
bornée par 0 (la RFU vide) et RFU max (capacité maximale de la
RFU qui est de l'ordre de 0 à 200mm suivant les sols et sous-sols
considérés, en effet dans les zones arides à semi-arides,
le sol est considéré saturé quand il absorbe une lame
d'eau équivalente à des précipitations de 50mm
(Archambault et al, 1975).
Pour établir ce bilan, après avoir donné la
RFU maximale (RFU max=50mm), il faut Connaître l'état de la RFU
à la fin du mois antérieur au début de
l'établissement du bilan. On tient alors l'un des deux raisonnements
suivants :
? Si la RFU doit être pleine un jour, ce sera à
la fin de la période durant laquelle on a pu la remplir,
c'est-à-dire à la fin du dernier mois ou P)
ETP.
? Si la RFU doit être vide un jour, ce
sera à la fin de la période durant laquelle on a pu la vider,
c'est-à-dire à la fin du dernier mois ou P <
ETP.
On admet que la satisfaction de l'ETP a
priorité sur l'écoulement, c'est-à-dire qu'avant qu'il n'y
ait d'écoulement, il faut avoir satisfait le pouvoir évaporant
(ETP=ETR).
Par ailleurs, la complétion de la RFU est
également prioritaire sur l'écoulement.
On établit ainsi un bilan à l'échelle
mensuelle, à partir de la pluie du mois P, de
l'ETP et de la RFU :
? Si P )ETP ETR=ETP
:
Si (P-ETP) +RFU i-1 RFU max alors RFUi = (P-ETR) + RFU
i-1 et Exc=0.
Si (P-ETR) +RFU i-1 RFU max alors
RFU i =RFU max et Exc.= (P-ETR) +RFUi - RFU
max
- 29 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
Dans ce cas, le surplus des précipitations alimentera
l'infiltration et/ou le ruissellement.
? Si P< ETP :
On évapore toute la pluie et on prend à la
RFU (jusqu'à la vider) l'eau nécessaire pour
satisfaire l'ETR soit :
SiRFU i-1 = ETP-P alors ETR = ETP, RFUi =RFUi-1+(P-ETR)
SiRFU i-1 ETP-P alors ETR= P+RFU i-1, RFUi =0
Si malgré l'apport de la RFU, l'ETR reste toujours
inférieure à l'ETP : il y aura déficit agricole
(DA) tel que :
DA = ETPi - (Pi + RFU i-1)
(i est le mois en cours et i-1 représente le mois
précédent).
Les résultats de l'ETR sont représentés sur
le Tableau n°5 suivants :
|
Ras el Ain
1990-2005
|
sept
|
oct
|
nov
|
déc
|
jan
|
fév
|
mar
|
avr
|
mai
|
jui
|
juil
|
aout
|
|
(T°C)
|
25,7
|
18,5
|
15
|
12,11
|
12,1
|
12,84
|
14,33
|
15,5
|
18,24
|
21
|
23,6
|
25,3
|
|
P (mm)
|
12,4
|
23,6
|
69,1
|
40,5
|
41,1
|
52,2
|
43,5
|
24,7
|
24
|
3,4
|
1,5
|
2,3
|
|
ETP (mm)
|
120
|
61
|
44
|
31
|
30
|
34
|
41
|
47
|
60
|
80
|
95
|
110
|
|
ETR (mm)
|
12,4
|
23,6
|
44
|
31
|
30
|
34
|
41
|
24,7
|
24
|
3,4
|
1,5
|
2,3
|
|
Excédent (mm)
|
0
|
0
|
25,1
|
9,5
|
11,1
|
18,2
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Déficit Agricole (mm)
|
108
|
37,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
36
|
76,6
|
93,5
|
108
|
Tableau n° 5 - Calcul de l'ETR par la
méthode de comparaison de Thornthwaite
1990-2005
- 30 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
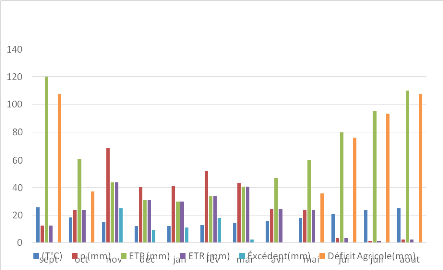
Figure n°15 - Variation des différents
termes du bilan Hydrique
1990-2005
|
Méthode
|
Thornthwaithe
(page 30)
|
Turc
(page24)
|
Moyenne
|
|
ETR (mm)
|
272
|
355 mm
|
313 mm
|
Tableau n°6 ? la Valeur moyenne de
l'ETR
1990-2005
|
Termes
|
P
|
ETP
|
ETR
|
EXCEDENT
|
|
Valeurs (mm)
|
338.3
|
753
|
272
|
66.3
|
|
Taux%
|
100
|
222.6
|
80.4
|
19.6
|
Tableau n°7 - Calcul Totaux des principaux
paramètres Hydriques
1990-2005
- 31 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
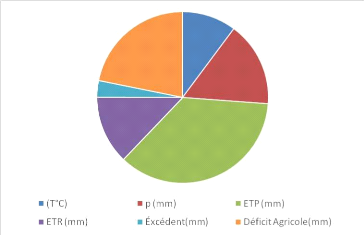
Figure n°16 - Bilan Hydrique de la station de
Ras-el-Aïn
1995-2005
V/- Discussion des résultats :
De l'examen l'analyse de ce bilan, nous retenons les points
suivants :
? De Avril jusqu' à Octobre : Les
précipitations (P) sont inférieures à
l'ETP, la réserve du sol est nulle.
L'ETR est égale à P.
P - ETP donne des valeurs négatives,
qui correspondent au déficit hydrique du mois.
? De Novembre jusqu' à Janvier : Les
précipitations sont supérieures à l'ETP, l'ETR
est égale à l'ETP, la
différence
P - ETP sert à la reconstitution des
réserves du sol.
? De Février jusqu'à Mars : Les
précipitations sont supérieures à l'ETP, l'ETR
est égale à l'ETP, la réserve
utile est portée à son maximum (50 mm). La quantité de
l'excédent dépassant lesréserves cumulées, elles
constituent un surplus disponible au ruissellement et à
l'infiltration.
- 32 -
CHAPITRE II : Hydro- Climatologie
VI/- Conclusion :
En se basant sur les données climatiques concernant la
station de Ras-el-Aïn fournies par L'agence Nationale des recherches
hydrauliques d'Oran.
A partir des différents calculs des formules
appliquées, le calcul du bilan, on conclut que le Bassin de
Ras-el-Aïn appartient à l'étage bioclimatique semi-aride
avec une moyenne pluviométrique annuelle de 300 mm,
caractérisée par deux principales saisons :
Une saison sèche allant du mois de Mai jusqu'au mois de
Septembre où l'irrigation est indispensable aux cultures.
Une saison humide allant du mois de Novembre au mois de
d'Avril, les températures sont modérément chaudes dont,
les mois les plus chauds sont les mois de Juillet et Août.
L'Évapotranspiration représente une grande
partie des précipitations allant jusqu'à 222% de cette
dernière.
On peut dire que le bassin de Ras-el-Aïn est une zone
à potentiel hydrique relativement important, qui permet de
développer l'arboriculture fruitière et les cultures
maraichères. Le Bassin de Ras-el-Aïn est centré sur des
formations calcaires douées d'une forte perméabilité, de
fissures atteignant parfois le stade de karstification.
Cette assise carbonatée constitue l'essentiel de
l'impluvium du bassin recevant les apports par les précipitations nettes
et occultes.
Toutes ces conditions concourent à une meilleure
réalimentation de l'Aquifère des calcaires de Ras-el-Aïn.
En effet, le débit important à l'exutoire de la
nappe (Source de Ras-el-Aïn) enregistre 70 à 80 L/s.
CHAPITRE III : Hydrogéologie
- 33 -
CHAPITRE III
HYDROGÉOLOGIE
- 34 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
Chapitre III
HYDROGEOLOGIE
I/- INTRODUCTION :
L'étude Hydrogéologique nous a permis de
déterminer les principaux aquifères de la région et leurs
caractéristiques hydrogéologiques.
Nous nous sommes intéressées au système
aquifère centré sur le bassin Hydrogéologique de Ras el
Ain et la dynamique de la nappe depuis le massif du Murdjadjo vers l'exutoire
principal représenté par la source.
L'étude des nappes d'eau souterraine de Ras el Ain
concerne les bassins versants des écoulements provenant des reliefs qui
culminent à l'Ouest de la ville d'Oran.
Le Djebel Murdjadjo fait partie de ces Massifs Littoraux
Oranais. Il enserre la partie occidentale de l'agglomération (secteur
d'El Hassi-Ain Beida).
Il est caractérisé par son profil
dissymétrique, son étagement en gradins, ses ruptures de pente,
et aplanissements, son hydrologie et surtout sa karstification. Il domine le
Plateau d'Oran, selon un dénivelé de prés de 500 m. Le
sommet du djébel culmine à 589 m.
Au Djebel Murdjadjo, la formation messinienne dont
l'épaisseur peut dépasser une centaine de mètres constitue
un excellent aquifère du fait de ses caractéristiques physiques
de milieu (fissuré et karstique) et de sa position topographique
sommitale dans le paysage. Naguère, c'était vraisemblablement le
château d'eau de la proche région d'Oran. Les calcaires sont
alimentés directement par leur impluvium et par le ruissellement issu
des formations schisteuses du substratum. Les eaux s'y infiltrent rapidement
à la faveur des fissures. Ces calcaires sont aussi karstiques et les
eaux de ruissellement s'engouffrent dans les cavités le long du lit des
cours d'eau.
La source de Ras el Aïn est située à la
base des calcaires miocènes bordant l'ancienne route d'Oran à
Misserghine, probablement à la suite d'un passage latérale vers
l'Est des calcaires à Algues à des grés fins avec marnes
jaunes.
- 35 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
Elle émerge au contact des calcaires marneux à
tripolis et des marnes jaunes à silex. Elle représente le point
le plus bas de la formation Miocène, elle constitue l'exutoire de la
nappe centré sur le bassin Hydrogéologique de Ras el Aïn.
Elle constitue l'exutoire de la nappe centrée sur le
bassin hydrogéologique de Ras el Ain .Cette source est captée par
une grande galerie drainante qui alimente les quartiers côtiers.
Figure n°17- Le site d'Oran
représenté (Robert Thinthoin 1956)
(Mise en forme par F.
Kettaf 2013)
C.N : Château Neuf
Q.I : Quartier Juif
Q.M : Principal quartier musulman
CHAPITRE III : Hydrogéologie

Figure n°18 - Carte du système
Aquifère de la région d'étude
Échelle :
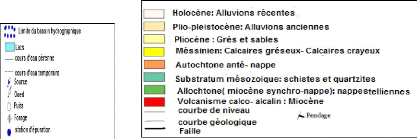
- 36 -
- 37 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
II/- HYDROGÉOLOGIE :
L'hydrogéologie du secteur d'étude est bien
définie en raison de sa situation géographique,
géomorphologique. La nappe la plus importante est contenue dans les
calcaires fissurés du Miocène Terminal (Messinien). Un second
aquifère (les alluvions du Plio-quaternaires) de qualité chimique
médiocre de plus en plus épais vers le Sud repose sur les
calcaires.
Les aspects litho stratigraphiques et structuraux des
formations géologiques de la zone d'étude font ressortir les
principaux aquifères présents (Figure n°19, Figure
n°20)
? Les formations carbonatées miocènes du Djebel
Murdjadjo.
? Les colluvions et alluvions récentes et anciennes du
Pleisto-Holocène. ? Les grès et sables Calabriens du plateau
d'Oran (Plio-Pleistocène).
Ces formations constituent le principal réservoir
aquifère de la région d'Oran.
Ils s'étendent de Ras-el-Aïn à Oran
jusqu'à Brédea à l'Ouest, leur impluvium est de l'ordre de
135km2.

Figure n°19 - Principaux Aquifères du
secteur d'étude (d'après A. Joseph)
- 38 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
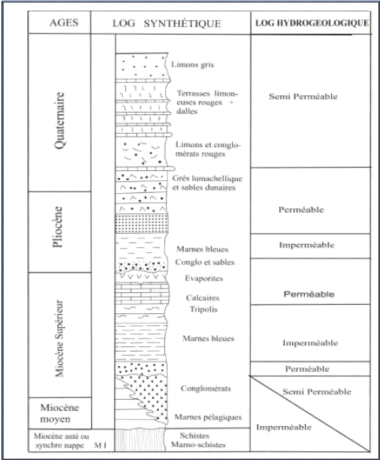
Figure n°20 - Log Hydrogéologique de la
région d'Oran (Hassani.M.I., 1987)
- 39 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
III/ Description des principaux aquifères du
secteur d'étude : Sur le secteur d'étude, on distingue
:
III/-1L'Aquifère des calcaires récifaux du
Djebel Murdjadjo :
Les calcaires récifaux du Miocène
supérieur, appelés également "calcaires du Murdjadjo"
constituent le principal réservoir d'eau souterraine de la
région. Cet aquifère, de type karstique, s'étend de Ras el
Aïn, à l'Est, jusqu'à Boutlelis, à l'Ouest.
Il constitue un impluvium de 135 km2 pour une
épaisseur moyenne atteignant environ 100m.Toutes les eaux de
précipitation s'y infiltrent rapidement à la faveur des diaclases
et parfois au niveau des pertes, ceci explique la relative aridité de la
surface du karst (Hassani MI, 1987).
La fracturation et les phénomènes karstiques
majeurs sont peu s spectaculaires dans le Djebel Murdjadjo. Ceci est dû
à l'âge relativement récent des calcaires méssiniens
qui n'ont été affectés que par les phases tectoniques
post-nappes.
Cette tectonique s'exprime selon les directions principales
N10-20 E, N50-70 E et NW-SE (Hassani M.I, 1987). (Fig. n° 21).
- 40 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie

Figure n°21 - Carte de localisation des sources et
de la fracturation des calcaires messéniens
(Hassani.1987)
- 41 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
Les joints et les diaclases des niveaux calcaires ont
été largement ouverts par dissolution.
L'écoulement des eaux souterraines au sein des massifs
calcaires se fait selon les plans de fractures et à leur
intersection.
La détermination des directions
préférentielles de la fracturation conditionne le drainage
hydraulique de ces formations.
L'étanchéité des calcaires du Murdjadjo est
assurée à la base par le substratum marneux et schisteux ou par
les niveaux les moins perméables des marnes à tripoli.
Trois nappes peuvent être distinguées au sein de ce
système aquifère:(Figure. n°22)
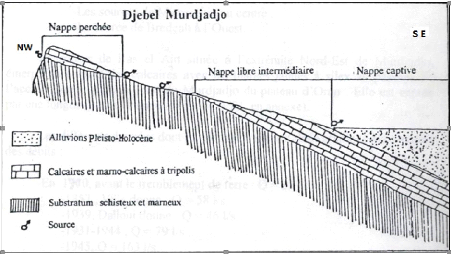
Figure n°22- Coupe Hydrogéologique
Schématique du Djebel Murdjadjo
(M.I. Hassani, 1987)
III/-1-1 Une nappe perchée des Crêtes :
Longeant une partie de la crête du Djebel. Elle repose
directement sur un substratum schisteux. Cette nappe est drainée par
deux lignes de sources orientées NE-SW.
- 42 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
Une série de sources se déverse vers le nord en
direction de la plaine de Bousfer, alors que la deuxième série se
déverse vers le sud en direction de la plaine bordière de la
grande Sebkha.
Les débits d'écoulement de ces sources sont
faibles du fait de la faible extension de leur bassin d'alimentation.
III/-1-2 Une nappe captive :
En aval, à la ligne de rupture de pente du Djebel
Murdjadjo, les calcaires passent sous les colluvions et alluvions
plio-quaternaires beaucoup moins perméables.
L'aquifère devient de ce fait semi-captif à
captif. Les forages indiquent que les calcaires restent fissurés sur une
assez grande profondeur et la perméabilité de fissures reste
prépondérante.
L'alimentation de cette nappe se fait par apports
latéraux à partir des affleurements et partiellement par
drainance à partir des eaux relativement minéralisées de
la nappe polio-quaternaire sus-jacente.
III/-1-3 Une nappe libre intermédiaire :
Cette nappe est contenue dans l'aquifère calcaire qui
repose, au nord, directement sur les Schistes du Jurassique et du
Crétacé et plus en aval, par l'intermédiaire des
marno-calcaires, à tripoli, sur des marnes jaunes puis les marnes bleues
du Miocène.
Son alimentation se fait par les précipitations
directes et par l'infiltration d'une partie de l'écoulement de surface
amont. La nappe est drainée par plusieurs exutoires situés
à la base des calcaires au contact des marnes à tripoli, parmi
les plus importants :
-Les anciennes sources de Bérédeah
à l'extrémité occidentale de
l'aquifère.
-les sources de l'Oued Misserghine
localisées en amont de l'agglomération de même
nom.
-La source de Ras-el-Aïn(X= 196.13, Y= 271.23)
: Elle est située à l'extrémité orientale
du Murdjadjo. Elle émerge au contact des calcaires, des marno-calcaires
et des marnes jaunes au passage de l'accident qui sépare le horst du
- 43 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
Djebel Murdjadjo du plateau d'Oran Elle est capté par
une galerie drainante. Son débit actuel est estimé à 6000
m3/j.
L'observation de la fracturation du Djebel Murdjadjo permet
d'expliquer l'importance relative du débit de la source de
Ras-el-Aïn par rapport à son bassin versant, ce dernier fait partie
d'un ensemble comprenant plusieurs autres sous-bassins juxtaposés et
constituant le massif du Murdjadjo.
Ces sous-bassins renferment chacun une nappe aquifère
formant une entité à part avec son impluvium et son exutoire.
L'exutoire du bassin est représenté par la
source Ras-el-Aïn, le débit de cette source a toujours varié
dans le temps. Toute une série d'accidents orientés globalement
SW-NE, convergent vers la zone de la source (Hassani.M.I, 1987).
La source de Ras-el-Aïn, par sa situation au sein de
l'agglomération urbaine, est Très vulnérable à la
pollution organique et autres pollutions. Les calcaires à la
perméabilité fissures et de chenaux n'assurent aucune filtration
des éléments polluants. Cette source alimente les quartiers
côtiers :
- Quartier le planteur.
- Une partie de la corniche Oranaise. - Saint Clotilde.
N.B : La source de Ras-el-Aïn n'est pas en
utilisation actuellement, parce que ces eaux sont impropres à la
consommation, suite à une pollution généralisée de
la nappe par les Hydrocarbures.
III/-2 L'Aquifère du Calabrien :
Cet aquifère s'étend en profondeur sous
l'agglomération oranaise essentiellement à la partie nord-Est de
notre secteur. Il s'étend jusqu'à la zone piémont du
Djebel Khar (secteur de Belgaid).
Il est constitué par un complexe dunaire
consolidé de porosité d'interstices reposant sur le substratum
imperméable des marnes à tripolis du Miocène
supérieur.
Il présente une épaisseur qui atteint les 45 m
au niveau des falaises côtières et au ravin blanc. Il renferme une
nappe libre alimentée au nord par son impluvium et
- 44 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
drainée vers le nord par la ligne de sources qui
émergent au contact des marnes à tripolis tout le long des
falaises côtières.
La source de Cueva d'El Agua qui se déverse vers la mer
est la plus importante de ces sources Vers le sud, l'écoulement
souterrain se fait sous les formations alluvionnaires, en direction de la Daya
Morsly. La nappe devient légèrement semi-captive sous ce
recouvrement argileux : puits des Abattoirs, INESMO, etc...
III/-3 L'Aquifère des alluvions plio-quaternaires
:
L'Aquifère du remplissage plio-quaternaire
s'étend au sud et au sud-ouest des affleurements Calabriens.
Dans les zones piémont du Sud-Est du Djebel Murdjadjo
(zone d'El Hassi), il est Constitué d'alluvions rouges à galets
calcaires et nodules de schistes, plus anciennes, caractérisées
par une pente relativement légère, suffisamment
perméables.
Dans les zones plus basses du plateau, il est constitué
d'Alluvions récentes, essentiellement argilo limoneuses, provenant de
dépôts fluviaux et éoliens. Elles sont
caractérisées par un pendage relativement faible.
L'Aquifère Plio-quaternaire renferme une nappe d'eau
peu profonde. Son alimentation se fait essentiellement par :
? Son impluvium.
? Les eaux provenant par drainance latérale des calcaires
du Djebel Murdjadjo ou des formations du complexe dunaire Calabrien.
? L'infiltration du ruissellement de surface dévalant
en période de crue du Djebel Murdjadjo.
- 45 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
IV/- Fluctuations du débit de la source de
Ras-el-Aïn :
|
Années
|
Débits L/S
|
|
1700
|
213
|
|
1852
|
58
|
|
1939
|
46
|
|
1982
|
80
|
|
1997
|
71
|
|
1998
|
61
|
|
2005
|
45
|
|
2006
|
41
|
|
2018
|
62
|
|
2019
|
63
|
Tableau n°8- Les Débits Enregistrés
à la Source Ras-el-Aïn (1700-2019)
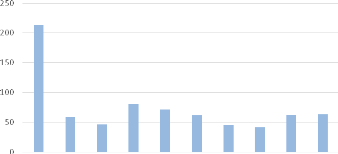
Figure n°23- Fluctuations des débits de la
source Ras-el-Aïn
1700-2019
- 46 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
V/- Piézométrie du secteur d'étude
:
V/-1 Caractère piézométrique de la
zone d'étude :
Afin d'étudier le comportement des eaux souterraines,
nous disposons d'un grand fichier piézométrique mensuel couvrant
pratiquement tout le bassin de Ras-el-Aïn
Après une analyse critique du réseau en
matière de données exploitables, il a été retenu
trente- deux points de mesure qui nous ont servi aux différents
traitements de données (Figure n°24).
Deux cartes piézométriques ont été
élaborées afin de suivre la dynamique de l'Aquifère,
représentée par la cartographie de l'écoulement souterrain
de la nappe. Il s'agit des cartes piézométriques établies
à partir des séries de mesures des périodes d'observation
de mai 2007 et Avril 2018.
Ainsi, à partir d'un fichier mensuel des niveaux
piézométriques, nous avons dressé deux cartes en courbes
hydro-isohypses (Figure n°25 et n°27).
Ainsi, l'aspect d'écoulement est nettement apparent
dans les deux cartes, représenté par deux axes principaux
prédominants orientés du Sud-Ouest du Djebel Murdjadjo vers les
exutoires du bassin.
Ceci et d'autant plus logique que l'alimentation de la nappe
s'effectue par infiltration, longeant le réseau hydrographique
guidée par la perméabilité de fissures des Calcaires du
Murdjadjo, cette hypothèse est également valable si on se
réfère à la structure lithologique du bassin marno-
calcaire du Miocène à travers lequel émerge la source de
Ras-el-Aïn.
Les axes secondaires activent au Nord comme au Sud dont le
sens d'alimentation rejoint celui des axes principaux.
Cette structure piézométrique est compatible
avec la plate-forme géologique, justifiant le réseau
d'infiltration. Dans ce sens, il est à noter certaines remarques et
observations utiles expliquant localement le comportement de la nappe :
En effet, au niveau de la source de Ras-el-Aïn et au du
pont Albin, nous constatons l'existence de deux courbes fermées avec des
lignes de courant convergentes. Il semblerait qu'il s'agisse de deux
dépressions indiquant des zones favorables à l'implantation des
captages.
A ce niveau une sur exploitation de la nappe nous parait
évidente.
- 47 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
En 2018, ces dépressions sont représentées
par les courbes 190 m au Sud -Ouest du Murdjadjo et par la courbe 85 m dans la
partie méridionale au niveau de la source de Ras-el-Aïn en des
noyaux de drains, localisés près des exutoires.
En 2007 ces courbes dépressionnaires commençaient
à peine à se mettre en place.
Il est à noter également que les courbes hydro
Isohypses tendent vers les limites du bassin, ce qui pourrait provoquer un
abaissement du niveau piézométrique.
Dans l'ensemble, il s'avère que la morphologie de la nappe
reste inchangée au cours des deux campagnes piézométriques
(2007 et 2018).
- 48 -
|
Nature
|
Coordonnées Lambert
CHAPITRE III : Hydrogéologie
|
Z sol (m)
|
|
|
|
Point d'eau
|
|
X
|
Y
|
N-P Avril 2018
|
N-P Mai 2007
|
|
20
|
PUITS
|
192,450
|
268,000
|
218,222
|
173,542
|
175,762
|
|
24
|
PUITS
|
192,440
|
267,240
|
184,463
|
145,923
|
146,713
|
|
40
|
PUITS
|
194,225
|
269,100
|
161,578
|
109,578
|
110,268
|
|
52
|
PUITS
|
194,180
|
269,650
|
171,121
|
108,791
|
109,271
|
|
53
|
PUITS
|
194,350
|
269,550
|
177,036
|
109,786
|
110,626
|
|
56
|
PUITS
|
193,050
|
267,550
|
182,085
|
136,085
|
138,735
|
|
60
|
PUITS
|
194,650
|
269,300
|
147,357
|
104,097
|
105,177
|
|
63
|
PUITS
|
195,600
|
270,920
|
117,99
|
90,100
|
91,79
|
|
67
|
PUITS
|
195,675
|
271,100
|
100,889
|
89,349
|
90,989
|
|
69
|
PUITS
|
195,850
|
271,150
|
88,096
|
65,596
|
10,196
|
|
71
|
PUITS
|
195,400
|
270,740
|
121,641
|
92,651
|
92,751
|
|
80
|
PUITS
|
194,800
|
269,780
|
144,17
|
102,120
|
103,99
|
|
82
|
PUITS
|
194,100
|
268,700
|
161,809
|
137,157
|
139,606
|
|
94
|
SOURCE
|
196,130
|
271,250
|
75,489
|
|
75,489
|
|
95
|
PUITS
|
195,900
|
270,050
|
132,506
|
100,666
|
103,826
|
|
96
|
PUITS
|
196,100
|
270,600
|
130,175
|
99,845
|
102,785
|
|
97
|
PUITS
|
194,950
|
266,450
|
151,45
|
111,020
|
115,550
|
|
98
|
PUITS
|
195,400
|
267,760
|
134,702
|
99,522
|
100,562
|
|
99
|
FORAGE
|
195,260
|
266,060
|
166,186
|
108,196
|
110,556
|
|
100
|
PUITS
|
195,400
|
270,500
|
145,892
|
91,522
|
92,942
|
|
101
|
FORAGE
|
195,000
|
270,575
|
150,777
|
93,729
|
94,317
|
|
102
|
FORAGE
|
193,400
|
267,875
|
170,818
|
132,548
|
134,668
|
|
103
|
PUITS
|
193,900
|
267,900
|
165,133
|
118,993
|
120,743
|
|
104
|
PUITS
|
195,260
|
269,200
|
131,967
|
103,317
|
105,427
|
|
105
|
PUITS
|
195,120
|
267,300
|
146,544
|
105,294
|
106,704
|
|
106
|
PUITS
|
196,600
|
270,800
|
126,537
|
95,789
|
97,397
|
|
107
|
PUITS
|
194,700
|
267,500
|
149,192
|
108,192
|
108,292
|
|
108
|
PUITS
|
195,240
|
269,920
|
141,404
|
104,764
|
106,774
|
|
109
|
PUITS
|
196,560
|
269,620
|
118,936
|
89,286
|
93,536
|
|
110
|
PUITS
|
193,300
|
269,100
|
269,100
|
240,210
|
160,626
|
|
114
|
PUITS
|
196,240
|
268,300
|
123,700
|
89,700
|
89,800
|
|
121
|
PUITS
|
196,8
|
269,35
|
107,12
|
78,570
|
78,520
|
Tableau n°9 - Niveaux
piézométriques mensuels du Bassin de
Ras-el-Aïn
- 49 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie

Figure n°24 - Carte de Localisation des
Piézomètres du Bassin de Ras-el-Aïn (2007-2018)
Échelle : 1/25000
- 50 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
VI/- Les Paramètres Hydrodynamiques :
Il s'agit de paramètres physiques définissant
quantitativement le comportement d'un milieu ou d'un corps conducteur
vis-à-vis d'un fluide, c'est-à-dire son aptitude à le
contenir, à permettre son écoulement et à régir les
propagations d'influence.
Les principaux paramètres régissant
l'écoulement des eaux souterraines sont :
La transmissivité, la perméabilité, le
coefficient d'emmagasinement et
la porosité efficace.
Certains paramètres sont indispensables pour
connaître les débits exploitables par un forage. Ils peuvent
être déterminés au laboratoire ou sur le terrain, notamment
lors de test de pompages dans un puits.
VI/-1 La porosité :
Elle s'exprime par le rapport du volume des vides au volume
total du milieu (ex : 0,3 ou 30%).
La porosité totale ne dépend pas de la taille des
grains mais diminue avec : L'hétérogénéité
des grains
La porosité efficace représente le volume d'eau
mobilisable par gravité, soit l'« eau libre » (non liée
aux grains de la roche par capillarité) et circulant dans les pores
« ouverts ».
D'une manière générale, les roches
meubles sont poreuses « en petit » (porosité d'interstice) et
les roches compactes poreuses « en grand » (porosité de
fissures et de karst).
Porosité totale porosité efficace
|
sables
|
20% à 40%
|
10% à 25%
|
|
craie
|
10% à 40%
|
1% à 5%
|
|
Calcaires massifs fissurés
|
1% à10%
|
1%à 5%
|
|
Argile
|
40%à 50%
|
1%à2%
|
Tableau n°10
Quelques ordres de grandeurs des valeurs de
porosités totale et efficace
La nappe des calcaires du Murdjadjo est drainée par la
source de Ras-el-Aïn à l'Est, cette source émerge des
calcaires marno-calcaires et des marnes jaunes à silex qui sépare
le Horst Murdjadjo du plateau d'Oran. Cet Aquifère a sans nul doute
une
- 51 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
Porosité qui varie entre 1% à 5%, il lui
associé une porosité en grand, du fait de son importante
Karstification.
VI/-2 Le coefficient de perméabilité :
Darcy propose une loi expérimentale à la suite
d'observations d'écoulements d'eau sous pression dans une conduite
verticale remplie de sable.
La vitesse apparente v d'écoulement de
l'eau (débit par unité de surface) est proportionnelle à
la perte de charge et inversement proportionnelle à la hauteur de la
conduite.

k coefficient de perméabilité du sol en
[m/s]
La perméabilité (conduction
hydraulique) représente la vitesse avec laquelle l'eau traverse
une unité de section perpendiculaire par rapport au sens du courant d'un
milieu poreux sous un gradient hydraulique unité à 20°C.
En m3/sec
Q : débit d'écoulement
v : vitesse d'écoulement en m/s ;
S : section traversée par l'écoulement en
m2 ;
k : perméabilité de Darcy m3/sec ;
i : gradient hydraulique.
La loi de Darcy est valable sous 4 conditions :
continuité, isotropie et homogénéité, du
réservoir, et écoulement laminaire
|
Roches
|
Coefficient de perméabilité
|
|
Gravier
|
10-2 m/s
|
|
Sable
|
10-2 à10-5 m/s
|
|
Craie
|
10-3à10-5m/s
|
|
Argile
|
10-9à10-13m/s
|
Tableau n° 11 - Quelques ordres de grandeurs de
coefficients de perméabilité
- 52 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
Concernant les roches compactes et fissurées,
représentatives du Bassin de Ras el Aïn (perméabilité
en grand), les valeurs perméabilité sont extrêmement
variables.
VI/-3 La Transmissivité :
C'est le volume d'eau qui traverse une tranche verticale de 1
m de large sur toute la hauteur de l'aquifère sous un gradient
hydraulique unitaire pendant 1 seconde à 20°C.
Pour l'utilisation d'un forage, l'aquifère devra
satisfaire au moins 12 m3/jour pour une utilisation domestique et
125 m3/jour pour une utilisation industrielle, municipale ou pour
l'irrigation.
m2/sec
k : perméabilité
e : épaisseur de l'aquifère.
Concernant notre secteur d'étude, nous avons repris les
données de Transmissivité enregistrées en 1986 (tableau
-5), pour les régions situées au voisinage de la source
de Ras el Aïn. Nous n'avions pas des données
réactualisées.
L'aquifère profond, semblerait être situé au
niveau de Aïn el Beïda, les drains sont
largement transmissifs avec une porosité en grand,
caractérisant, ainsi un Aquifère Kastique.(Tableau n°12)
|
Région
|
Transmissivité(m2/s)
|
Aquifère capté
|
|
Ain el Beida
|
2,5 10-1
|
calcaire très
fissuré
|
|
Pont Albin
|
2,1 10-3
|
calcaire
gréseux
|
|
Les
Amandiers
|
7 10-4
|
calcaire
marneux
|
Tableau n° 12 - Transmissivité des
Aquifères du bassin de Ras-el-Aïn 2001
- 53 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
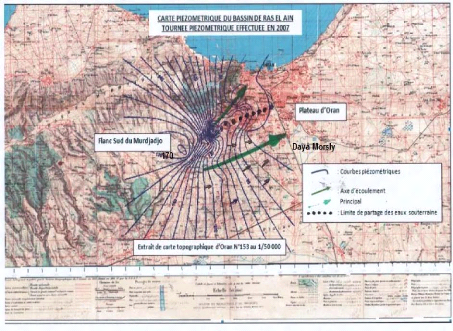
Figure n°25- Carte piézométrique de
Ras-el-Aïn
2007
Équidistance des courbes : 5m
- 54 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie

Figure n°27- Carte piézométrique de
Ras-el-Aïn
2018
Équidistance des courbes : 10 m
- 55 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
VII/- Conclusion :
La comparaison des cartes, nous a monté que
l'évolution piézométrique devient légèrement
plus sollicitée (augmentation de dépressions), ceci dépend
de la forte implantation des ouvrages sur toute la surface du flanc Sud du
Murdjadjo et la surexploitation des nappes.
L'extension du bassin d'alimentation vers Daya Morsly en
direction du plateau d'Oran, vers l'Est est bien évidente,
caractérisée par un axe de drainage principal bien
prononcé.
L'homogénéité de l'Aquifère des
calcaires, accusée par une dynamique sensiblement stable à
l'échelle spatio- temporelle semble ainsi bien confirmée, au vu
des cartes piézométriques actualisées (carte 2018).
Cependant, il est à noter que l'allure des courbes
hydrohypses pour la période 2018, manifeste un nodule d'espacement de
plus en plus serré, marqué par un dôme
piézométrique enregistrant un côté atteignant 230 m
.En revanche, la période 2007, montre une altitude
piézométrique maximum de l'ordre de 170 m.
Cette situation peut être l'apport d'eau des
précipitations qui est très élevé en 2016
(Jusqu'à 600 mm) comparé à celui enregistré en 2007
(300mm).
Les paramètres hydrodynamiques exploités
ultérieurement, confirment la stabilité du caractère
dynamique de la nappe à l'échelle du bassin de Ras el
AÏn.
- 56 -
CHAPITRE III : Hydrogéologie
CHAPITRE IV : Hydrochimie
- 57 -
CHAPITRE IV
HYDRO -CHIMIE
- 58 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
CHAPITRE IV
HYDROCHIMIE
I/- Historique :
? Au mois d'août 1847 (M Jule) :
L'eau de la source de Ras-el-Aïn est la plus pure de
toutes les eaux tertiaires de la province d'Oran. Elle est fraîche,
limpide et d'un goût agréable.
Cette source constitue l'affleurement naturel de la nappe
à la faveur d'une fissuration intense affectant cette formation. Les
eaux de pluie qui tombent sur le revers méridional de ce massif
s'infiltrent à travers les couches du terrain tertiaire, suivant les
plans de stratification, se réunissent en un cours d'eau souterrain
suivant le thalweg du ravin de Ras-el-Aïn, et débouchent au jour
à 72 mètres environ de hauteur au-dessus du niveau de la mer et
à 2,000 mètres environ du rivage ; elles forment un cours d'eau
volumineux, qui fournit en été 5,000 m3 d'eau par
vingt-quatre heure. Le ravin de Ras-el-Aïn traverse la ville d'Oran et la
divise en quelque deux parties égales. Il est
très-encaissé dans la partie inférieure de son cours,
près de son embouchure dans la mer, à cause de
l'empiétement des constructions.
? La SEOR (Société de l'Eau et de
l'assainissement d'Oran) Précise ce qu'il en est en 2012 :
«Située au fond du ravin d'Oued Errhi,
elle constitue la plus ancienne des ressources de la ville. Bien plus, la
présence de cette source n'a été un facteur
déterminant dans la fondation même de la ville d'Oran en ce lieu.
La source de Ras-el-Aïn a fait l'objet de plusieurs aménagements le
long des siècles.
L'eau provient de l'écoulement souterrain des eaux
d'infiltration dans le calcaire fissuré du massif du Murdjadjo. Son
débit journalier est de 5.000 m3. Elle dessert actuellement
le quartier des Planteurs et le port, y compris la centrale thermique. Les eaux
de cette source ne subissent aucun traitement spécial, à
l'exception d'une désinfection finale, avant
distribution.»
Ce qui reste dangereux aujourd'hui pour la santé de la
population, c'est que cette source de Ras-el-Aïn est gravement
polluée. Car, si à l'origine, le site au-dessus de la nappe
était vierge de toute construction, il n'en est pas le cas
aujourd'hui.
Devant l'exode rural et les besoins immenses en logements, une
agglomération d'habitations s'est constituée progressivement
au-dessus de la source, sans qu'il y'ait d'égout collecteur. Ces
innombrables refuges de fortune disposent de fosses septiques, lesquelles, par
infiltration, versent leurs eaux usées dans la nappe.
- 59 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
D'où l'impérieuse nécessité de
procéder à un contrôle quotidien de l'eau de
Ras-el-Aïn.
II/- Introduction :
L'étude de la chimie des eaux souterraines apporte
à l'hydrogéologie une somme considérable de renseignements
utiles à la compréhension des phénomènes se
produisant dans les systèmes aquifères. C'est-à-dire dans
les échanges possibles entre l'eau et la roche, sachant que la
minéralisation des eaux souterraines peut provenir de l'acquisition des
éléments chimiques par la dissolution et l'altération des
minéraux du réservoir.
Les caractéristiques physiques et chimiques des eaux
dépendent d'un certain nombre de facteurs tels que la composition
chimique et minéralogique des terrains traversés. Une
éventuelle pollution peut modifier les caractéristiques
naturelles de l'eau. C'est dans ce contexte que le présent chapitre est
abordé. Il propose ainsi d'étudier l'évolution temporelle
et spatiale de la qualité physico-chimique de l'eau du bassin de
Ras-el-Aïn.
La détermination de ces caractéristiques s'est
basée sur des analyses et des mesures, sur des échantillons d'eau
qui reflètent notamment, le mieux que possible, la composition de l'eau
dans l'aquifère.
III/- Zone de prélèvement :
Nous avons procédé à la sélection
de quelques points d'eau qui sont uniformément répartis à
travers la région de Ras-el-Aïn sur des échantillons d'eau
prélevés sur des puits et forages tels que inventoriés sur
le secteur étudié (Figure n°29).
- 60 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie

Figure n°29 - Carte de la localisation des points
d'eau du bassin de Ras-el-Aïn Échelle : 1/25000
- 61 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
IV/- Méthodes et matériels :
IV/-1 Méthodologie de l'étude
hydrogéochimique :
L'échantillonnage des eaux a été
étalé sur plusieurs périodes du 30 Octobre 2007 jusqu'au
18 Avril 2018.Il a porté sur les paramètres tels que la
température (T), le potentiel d'Hydrogène (pH) et la
conductivité électrique (CE) qui ont été
mesurés in situ.
Le matériel utilisé pour la réalisation
de la campagne hydro chimique est composé d'un pH-mètre pour la
mesure du pH d'un conductimètre pour la mesure de CE et de T et d'un GPS
pour la prise des coordonnées géographiques ou UTM des points
d'échantillonnages.
Les bouteilles d'échantillonnage de 500 ml et de 1
litre en plastique ont également été utilisées pour
l'échantillonnage sur le terrain. Chaque bouteille est rincée
trois fois avec l'eau à prélever, puis remplie à refus et
fermée hermétiquement avant d'être transporté
à froid (4°C) dans une glacière jusqu'au laboratoire.
Les points d'échantillonnages ont été
choisis en fonction du niveau d'utilisation du point d'eau par les populations
et en fonction de la densité des points d'eau de la zone
d`étude.
Il est important de prendre en considération que
l'étendue des chroniques que nous avons à notre disposition varie
énormément, certaines débutent en 2007 et concernent les
puits ainsi que les forages du bassin de Ras-el-Aïn (Tableau
n°13).
Alors que d'autres analyses sont établies uniquement
depuis 2010 et s'étendent jusqu'en 2018 et ne concernent que la source
de Ras-el-Aïn (Tableau n°14).
Il a donc fallu prendre tous ces paramètres en
considération. Nous avons mis à jour des tableaux
récapitulatifs d'analyses du secteur concerné grâce
à la base de données de L'ANRH et la SEOR (voir Annexe).
Ainsi, sur cette base, 8 points d'eau ont été
sélectionnés. Il s'agit de cinq (05) puits, de deux (02) forage,
d'une (01) source d'eau.
Les éléments à doser sont : Ca2+,
Mg2+ Na+, K+, NH4 +, pour les cations et SO4
2-, HCO3 -, NO3 - pour les anions.
62
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Les analyses chimiques ont été
réalisées dans les laboratoires de L'ANRH
à Oran ainsi que la SEOR de la ville Oran.
|
Bassin de Ras el
Ain (2007)
|
Ca2+
|
Mg2+
|
Na+
|
K+
|
Cl
|
SO42
|
HCO3
|
NO3
|
Minéral
|
Rs
|
PH
|
5
|
Co3
|
|
F2
|
79
|
72
|
104
|
7
|
175
|
96
|
301
|
46
|
707
|
860
|
7,2
|
1140
|
0
|
|
P53
|
90
|
33
|
55
|
2
|
119
|
57
|
278
|
7
|
493
|
500
|
8,1
|
795
|
0
|
|
P66
|
225
|
82
|
483
|
24
|
912
|
378
|
337
|
118
|
2344
|
2660
|
8,2
|
3780
|
0
|
|
P76
|
399
|
180
|
863
|
7
|
1699
|
672
|
439
|
62
|
3856
|
4640
|
7,1
|
6220
|
0
|
|
P98
|
190
|
118
|
589
|
7
|
988
|
443
|
337
|
64
|
2406
|
2800
|
7,4
|
3880
|
0
|
|
F109
|
105
|
103
|
430
|
17
|
639
|
384
|
412
|
126
|
1848
|
2060
|
7,8
|
2980
|
0
|
|
F114
|
217
|
58
|
350
|
4
|
818
|
198
|
355
|
33
|
2368
|
2400
|
7,14
|
3120
|
0
|
|
Source
|
100
|
57
|
253
|
11
|
307
|
226
|
342
|
75
|
1397
|
110
|
7,17
|
1840
|
0
|
Tableau n°13 - Données Hydro-Chimiques du
Bassin de Ras-el-Aïn
2007
|
Source de Ras el
Ain
|
PH
|
T°C
|
5°C
|
NO3
|
SO42
|
Ca2+
|
Mg2+
|
Cl
|
|
2007
|
7,17
|
25
|
1840
|
75
|
226
|
100
|
57
|
307
|
|
2010
|
7,76
|
21,9
|
1624
|
44,61
|
93,5
|
84,96
|
48,01
|
283,6
|
|
2011
|
7,4
|
18,6
|
1606
|
34,08
|
159,6
|
81,76
|
47,52
|
283,6
|
|
2018
|
7,74
|
20
|
1434
|
35
|
166
|
114
|
65
|
394
|
Tableau n°14 - Données Hydro -Chimiques de
la source de Ras-el-Aïn
2007-2018
IV/-2 Méthodes de traitement des données
:
Un certain nombre d'histogrammes à l'aide du logiciel
Excel a été élaboré, ils serviront de base pour
l'interprétation des résultats des analyses physico-
chimiques.
Les données collectées ont été
traitées en utilisant une méthode hydro chimique qui adopte les
diagrammes de Piper et Schoeller- Berkaloff pour la classification hydro
chimique des eaux, le diagramme de WILCOX nous a servi à suivre
l'évolution du degré de salinisation des sols.
Ces diagrammes sont très couramment utilisés
dans le domaine de l'hydrochimie des eaux, avec de très bons
résultats.
- 63 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
La réalisation de ces diagrammes a été
faite en utilisant le logiciel Diagrammes Version : 5.1.1.
IV/-2-1Le Diagramme de PIPER :
Le Diagramme de Piper est l'une des représentations les
plus classiques pour comparer les compositions chimiques des eaux
naturelles.
Il permet une représentation des cations et anions sur
deux triangles spécifiques dont les côtés témoignent
des teneurs relatives de chacun des ions majeurs par rapport au total des ions.
La position relative d'un résultat analytique sur chacun de ces
triangles permet de préciser en premier lieu la dominance cationique et
anionique.
A ces deux triangles, est associé un losange sur lequel
est reportée l'intersection des deux lignes issues des points
identifiés sur chaque triangle. Ce point d'intersection
représente l'analyse globale de l'échantillon. Cette position
permet de préciser le faciès de l'eau naturelle concernée.
Le diagramme de Piper permet également :
-D'illustrer l'évolution chimique d'une eau dans un
aquifère ainsi que les mélanges d'eaux de minéralisations
différentes
- D'avoir une idée sur la lithologie à partir des
analyses chimiques,
-D'avoir une relation entre le chimisme de l'eau et la nature
lithologique de l'encaissant, la projection de plusieurs échantillons en
même temps :
? Pour suivre leurs évolutions dans le temps et dans
l'espace
? Pour les comparer
? Pour avoir une idée sur la notion de mélange, de
suivre les propriétés physico-chimiques au cours de leur
évolution spatiotemporelle.
IV/-2-2 Diagramme de SCHOELLER - BERKALOFF :
Le diagramme de SCHOËLLER-BERKALOFF
permet de représenter le faciès chimique de plusieurs
échantillons d'eaux. Chaque échantillon est
représenté par une ligne brisée.
- 64 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
La concentration de chaque élément chimique est
figurée par une ligne verticale en échelle logarithmique.
La ligne brisée est formée en reliant tous les
points qui représentent les différents éléments
chimiques.
Un groupe d'eau de minéralisation variable mais dont
les proportions sont les mêmes pour les éléments dissous,
donnera une famille de lignes brisées parallèles entre elles.
Lorsque les lignes se croisent, un changement de faciès chimique est mis
en évidence.
IV/-2-3 Diagramme de Wilcox :
Il est utilisé pour évaluer le risque de
salinisation des sols. Il prend en ligne de compte, la conductivité
électrique ou la charge totale dissoute, toutes deux relatives à
la salinité de l'eau, et l'indice d'absorption du sodium aussi
appelée « pouvoir salinisant »
V/- Résultats et Discussions :
Présentation et interprétation des
résultats : V/-1 Balance ionique :
Avant de traiter et d'interpréter les analyses des eaux
prélevées au niveau des différentes stations), il faut
analyser la fiabilité des résultats de ces analyses.
La méthode utilisée est la Balance Ionique (BI).
Il faut rappeler qu'en théorie, une eau naturelle est
électriquement neutre. De ce fait, la somme (en équivalents
chimiques) des cations devrait être égale à celle des
anions (en équivalents chimiques). En réalité, cette
égalité est rarement obtenue. De façon
générale, la différence est attribuée aux
incertitudes, à la présence de certains ions non dosés ou
à d'éventuelles erreurs d'analyse. Ainsi, une certaine marge de
déséquilibre entre anions et cations est admise. Elle est
exprimée sous forme d'un écart relatif par la formule :
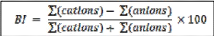
Le calcul de la balance ionique permet
généralement de vérifier la fiabilité des
résultats des analyses chimiques. Cependant, les incertitudes sur les
résultats, variables selon les techniques d'analyse, peuvent expliquer
les erreurs parfois
- 65 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
élevées sur les balances ioniques, à
cause de la présence éventuelle d'anions organiques non pris en
compte dans les calculs. D'une manière générale, des
analyses chimiques sont considérées :
Excellentes lorsque BI < 5 %
Acceptable lorsque
5%= BI < 10%,
Douteuse lorsque BI = 10%
Le contrôle de la qualité des analyses par la
balance ionique a été systématiquement appliqué
à toutes les analyses :
V/-1-1 Stations du bassin de Ras el Aïn pour la
chronique 2007 :
En ce qui concerne les données des points d'eau
traitées dans le cadre de cette étude, on a effectué le
traitement pour 10 points
60% des analyses sont de bonne qualité (BI < 5 %),
20% ont une qualité acceptable (5%= BI < 10%),
20% sont douteuses (BI=10).
Toutes les analyses présentant des BI dont les valeurs =
10 % ont été systématiquement éliminées de
cette étude, seules les analyses dont la BI < 10 % ont
été retenues.
La balance ionique présente un maximum de
déséquilibre (BI>10) dans la station 113 située en
amont du bassin où 20% des analyses ont une qualité douteuse. Les
valeurs du pourcentage d'erreur pour chaque échantillon d'eau
prélevé sont portées sur le tableau suivant :
|
Points d'eau
|
BI
|
cations
|
anions
|
BI
|
Analyse
|
|
F2
|
7,25
|
14,57
|
12,6
|
7,25
|
Acceptable
|
|
P53
|
2,37
|
9,65
|
9,2
|
2,37
|
Excellente
|
|
P66
|
1,71
|
39,61
|
40,99
|
1,71
|
Excellente
|
|
P76
|
1,69
|
72,46
|
70,05
|
1,69
|
Excellente
|
|
P98
|
1,56
|
45
|
43,61
|
1,56
|
Excellente
|
|
P113
|
40
|
24,51
|
57,68
|
40
|
Douteuse
|
|
F114
|
3,99
|
30,94
|
33,51
|
3,99
|
Excellente
|
|
P104
|
12,14
|
31,23
|
39,87
|
12,14
|
Douteuse
|
|
P109
|
2,84
|
32,85
|
34,78
|
2,84
|
Acceptable
|
|
Source Ras el Ain
|
1,94
|
20,97
|
20,17
|
1,94
|
Excellente
|
Tableau n° 15- les Pourcentages d'erreurs des
échantillons d'eau prélevés dans le bassin de
Ras-el-Aïn
- 66 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
V/-1-2 La source de Ras-el-Aïn pour la période
2010-2018 :
Nous n'avions pas des résultats probants pour la source de
Ras-el-Aïn pour la période 2010-2018, Toutes les analyses
présentaient des BI dont les valeurs = 10 %. Dans notre cas,
les problèmes relatifs à la qualité des analyses sont dus
aux défaillances d'analyses des éléments suivants :
HCO3-, Na+, en effet compte tenu de la
situation désastreuse actuelle de la source de Ras el Ain, L'ANRH comme
les laboratoires SEOR privilégient les analyses les plus importantes
(voir en Annexe les analyses chimiques de la (SEOR ET L'ANRH)
V/-2 Les paramètres Physiques : V/-2-1 La
température :
En rapport avec les normes de potabilité de l'eau
fixée par l'OMS (2006) ; la qualité de l'eau est passable. Les
résultats des analyses des échantillons d'eau montrent une
température qui varie entre 18.7°c et 25°c. Nous estimons que
cette variation de la température est en relation directe avec la
température ambiante, au moment de la mesure.

- 67 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Figure n°30 - Variation des Températures de
la source de Ras-el-Aïn
2007-2018
V/-2-2 Le Potentiel d'Hydrogène :
Le pH indique le caractère acide ou basique de l'eau.
Il est lié à la nature des terrains traversés. D'une
façon générale, les eaux très calcaires ont un pH
élevé et celles provenant de terrains pauvres en calcaires ou
siliceux ont un pH voisine de 7 et quelquefois un peu inférieur (environ
6).
La station d'étude présente des eaux basiques en
2010 et 2018, leur pH étant compris entre 7,74 et 7,76 pouvant
être expliquée par la nature géologique (calcaires du
Tripolis) du bassin versant et leur teneur en bicarbonates.
Quant aux valeurs peu élevées du pH
enregistrées 2007, elles peuvent être expliquées par une
contamination de la source par des produits chimiques.
- 68 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
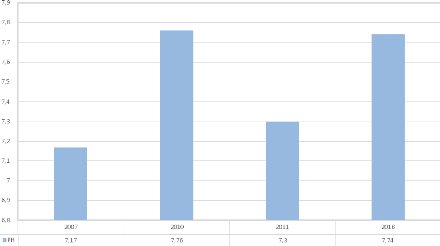
Figure n°31 ?Variation du pH des
échantillons d'eau de la source de Ras-el-Aïn
2007-2018
V/-2-3 La conductivité électrique :
A l'Inverse de la résistivité, elle permet
d'évaluer rapidement mais approximativement la minéralisation
globale de I `eau et d'en suivre l'évolution.
La variation de la conductivité électrique
fluctue entre 1434 ìs /cm en 2018et 1840 ìs /cm en 2007
Nous remarquons une légère évolution
décroissante 2007 à 2018 qui peut être expliquée par
les quantités importantes d'eaux usées qui se sont
déverses dans le cours d'eau sans aucun traitement à cette en
2007.
A notre avis c'est plutôt l'apport d'eau par les
précipitations qui est à l'origine d'une dilution importante des
eaux souterraines et superficielles, contribuant ainsi à une diminution
de la concentration en sels dissous. Ceci a pour conséquence une
décroissance de la conductivité.

- 69 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Figure n°32 -Évolution de la
Conductivité électrique de la source de
Ras-el-Aïn
2007-2018
V/-3 Les Paramètres chimiques : V/-3-1 Les
Chlorures
L'ion chlorure possède des caractéristiques
différentes de celles des autres éléments, il n'est pas
absorbé par les formations géologiques, ne se combine pas
facilement avec les éléments chimiques et reste très
mobile.
Il constitue un bon indicateur de la pollution. Les teneurs
enregistrées pendant toutes les périodes d'observation montrent
des valeurs qui ne dépassent pas la norme de potabilité. La
valeur la plus importante a été enregistrée en 2018 avec
une valeur de 394 mg/l. Les chlorures peuvent avoir plusieurs origines.
- Les argiles sableuses gypsifères qui couvrent la partie
amont du bassin.
- Les dépôts évaporitiques.
- Le déversement des eaux usées.
- Les marnes formant le substratum.
- 70 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Le schéma qui suit illustre comment varie les chlorures au
niveau de la source de Ras-el-Aïn, le principal exutoire de la nappe
à l'échelle du Bassin Hydrogéologique. On peut remarquer
une concentration excessive des chlorures en 2018 qui serait probablement
liée aux eaux des fortes averses ayant lessivés les couches
superficielles riches en chlorures.

Figure n°33 - Évolution de la Concentration
en chlorures de la source de Ras-el-Aïn
2007-2018
V/-3-2 Le Titre Hydrotimétrique TH :
Le TH est une autre manière d'estimer la
minéralisation d'une eau notamment en carbonates de calcium et de
magnésium et en anhydride carbonique libre. Cette mesure est la plus
usitée est couramment appelée dureté, Le principe de
l'hydrotimétrie consiste à étudier l'action de l'eau sur
le savon. Elle est exprimée en degré français (1
degré français correspond à 4 mg/l de calcium).
- 71 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
- 0 à 7° : eau très
douce
-7à14° : douce
- 14 à 20° : moyennement dure
- 20 à 30° : assez dure
- 30 à 50° : dure
- plus de 50° : très dure (limite de
potabilité).
Les eaux provenant de terrains calcaires et surtout de terrais
gypseux peuvent avoir des duretés très élevées
susceptibles d'atteindre 1 g/L de CaCO3 cependant les eaux en provenance de
terrains cristallins, métamorphiques ou schisteux auront des
duretés très faibles.
La nappe Karstique du Murdjadjo draine des terrains
carbonatés. Les eaux sont dures pour la source de Ras-el-Aïn. On
enregistre une teneur 55°F en 2018 qui renseigne d'une eau très
dure qui dépasse la limite de la potabilité.
Au sommet du massif du Murdjadjo, on observe des amas et
lentilles de gypse inter stratifiés dans les couches calcaires.
Celles-ci, au contact des eaux des précipitations infiltrées
contribuent à une augmentation de la dureté des eaux
souterraines.
- 72 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
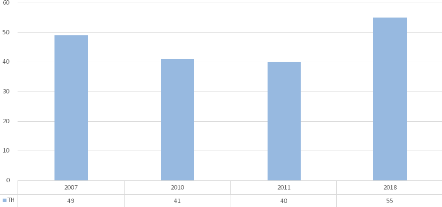
Figure n°34 - Évolution du titre
hydrotimétrique de la station de Ras-el-Aïn
2007-2018
V/-3-3 Le Titre alcalimétrique complet (TAC) :
C'est une mesure globale évaluant en bloc les
carbonates et bicarbonates alcalins et alcalino-terreux et
éventuellement les borates, silicates et phosphates alcalins. D'une
manière plus restrictive, il correspond à la somme des
carbonates, des hydrogénocarbonates et des silicates. Cette mesure de
L'alcalinité confrontée aux carbonates libres permet
d'évaluer l'agressivité d'une eau.
Le TAC enregistré dans la source de Ras-el-Aïn est
important mais irrégulier. Il varie entre 20°F et 28°F, cette
forte alcalinité est en relation avec l'augmentation de la
minéralisation par suite des apports des eaux riches en cations et en
anions ; mais aussi, accessoirement, par la pluviométrie de plus en plus
élevée durant la période d'observation entre 2007 et
2018.
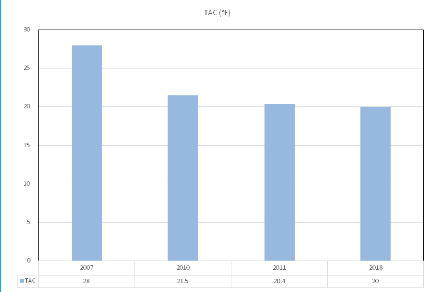
- 73 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Figure n°35 - Évolution du titre
alcalimétrique du bassin de Ras-el-Aïn
2007-2018
V/- 4 Principaux éléments présents
dans l'eau :
La minéralisation de la plupart des eaux est
dominée par 8 ions, appelés couramment les majeurs.
On distingue :
Les cations : Calcium, Magnésium, Sodium
et Potassium. Les anions : Chlorure, Sulfate, Nitrate, et
bicarbonate.
Les indications présentées dans ce paragraphe sont
utiles pour interpréter les résultats d'analyses courantes.
V/-4-1 Le Calcium et le magnésium :
Le calcium (Ca2+) et le magnésium
(Mg2+) sont présents dans les roches cristallines et les
roches sédimentaires. Ils sont très solubles et sont donc
largement représentés
- 74 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
dans la plupart des eaux. L'altération des roches
cristallines libère du calcium et du magnésium, mais en
quantité moindre que certaines roches sédimentaires
carbonatées, dont les principales sont la calcite (CaCO3), la dolomie
(CaMgCO3), la magnésie (MgCO3), le gypse (CaSO4).
|
Contexte
|
Mg2+ (mg/l)
|
Ca2+(mg/l)
|
|
Eaux souterraines Terrains calcaires
|
70<C<120
|
3<C<25
|
|
Eaux souterraines Terrains cristallins
|
2<C<10
|
<2C<6
|
|
Eau de mer
|
1400
|
1200
|
Tableau n°16 - Echelle de concentration des ions
Ca2+ et Mg2+
Les valeurs maximum enregistrées des teneurs en
ca2+ de 114 mg/l sont observées en 2018.
Les valeurs les plus faibles avec un minimum de 84.96 mg/l sont
observées en2010.
Nous constatons qu'il n'y a pas une grande variation des
teneurs, ceci pourrait justifier une même dissolution de formations
carbonatées des roches calcaires du Tertiaire du Murdjadjo.
Les ions (Mg2+) proviennent, comme
les ions calcium, de la dissolution des formations carbonatées riches en
magnésium (Dolomite).
La moyenne enregistrée pendant la campagne de 2018
(65mg/l) est supérieure à celle enregistrée durant 2011
(46.06 mg/l), ceci montre l'importance de la dilution par rapport à la
concentration pour l'acquisition de cet élément. Les variations
de concentration sont très faibles.
Dans l'ensemble, on peut constater, sensiblement une
légère stabilité des teneurs en ions Ca et Mg. Cependant,
cette concentration peut légèrement augmenter suite à de
fortes précipitations.
L'évolution du magnésium et du calcium est
représentée par la (Figure n°36) ci-dessous.
- 75 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
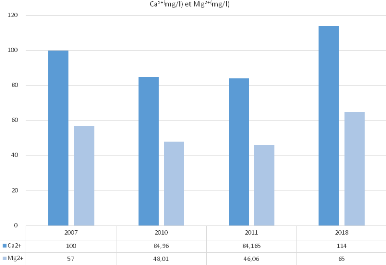
Figure n°36 - Évolution de Ca2+
et Mg 2+ du bassin de Ras-el-Aïn
2007-2018
V/-4-2 Les Sulfates :
Les origines des sulfates dans les eaux sont variées. Les
origines naturelles sont l'eau de pluie (Evaporation d'eau de mer) 1 < C
< 20 mg/l) et la mise en solution de roches sédimentaires
évaporitiques, notamment le gypse (CaSO4).
Au contact du gypse, fréquent dans les terrains
tertiaires, l'eau se charge en sulfate de calcium et devient dure
(séléniteuse) et impropre à la consommation.
D'une façon générale, la présence de
sulfate dans des eaux naturelles "non polluées" invoque la
présence de gypse ou de pyrite.
Pour l'eau destinée à la consommation humaine, en
raison de problèmes particuliers susceptibles d'introduire une
gêne pour le consommateur (goût, corrosion), l'OMS recommande comme
valeur limite 250 mg/L.

- 76 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
La fluctuation des concentrations en sulfates dans le bassin
de Ras-el-Aïn est très hétérogène, ces
dernières, ne dépassent pas pour autant les concentrations
maximales recommandées (150 mg/L)
Les teneurs élevées en sulfates peuvent
être rattachées à l'activité Agricole très
développée sur les terrains superficiels, mais n'a pas
cessé de se limiter avec l'accroissement de l'urbanisme au sommet du
massif et même sur les versants du bassin de Ras-el-Aïn.
Figure n°37 - Évolution des Sulfates dans
le bassin de Ras-el-Aïn
2007-2018
V/-5 Les substances indésirables :
V/-5-1 Les Nitrates :
Les nitrates sont naturellement présents dans les eaux
souterraines à de faibles
concentrations. Toutefois des teneurs
importantes témoignent de la contamination
- 77 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
des eaux souterraines par des apports azotés provenant des
activités humaines (excédents d'engrais agricoles de sols
cultivés, ruissellement d'eaux usées, etc.). Les teneurs moyennes
en nitrates varient entre 35 et 75 mg/l sur la période de 2007 à
2018.
Le seuil limite de potabilité de 50 mg/l a
été dépassé en 2007 en atteignant 75 mg/l. En ce
qui concerne les autres échantillons, malgré des
améliorations constatées, notamment en 2018 avec une
concentration en nitrates de 35 mg/l.
La présence des Nitrates est liée à des
engrais utilisés par les agricultures et aux rejets urbains, qui se
déversent dans le bassin sans subir de traitement préalable, qui
sont chargés de matières organiques et produisent des
nitrates.7
Le schéma qui suit, représente la variation des
teneurs en nitrates dans le bassin de Ras-el-Aïn.

Figure n°38 - Évolution des Nitrates dans
le bassin de Ras-el-Aïn
2007-2018
- 78 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
V/-6 Détermination des principaux faciès
hydro chimiques
V/-6-1 Le Diagramme de PIPER : Il est
particulièrement adapté à l'étude de
l'évolution des faciès des eaux lorsque la minéralisation
augmente, ou bien pour comparer des groupes d'échantillons entre eux et
indiquer les types de cations et anions dominants L'interprétation des
résultats d'analyses hydro chimiques pour les deux périodes
d'observation a permis d'avoir une idée sur les faciès chimiques
des eaux du bassin de Ras-el-Ain en 2007 et de la source de Ras-el-Aïn sur
la période de 2007-2018.
Les deux schémas ci-dessous (Figure n°39 et
n°40) montrent la représentation des échantillons d'eau
souterraine sur le diagramme de PIPER.
- 79 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
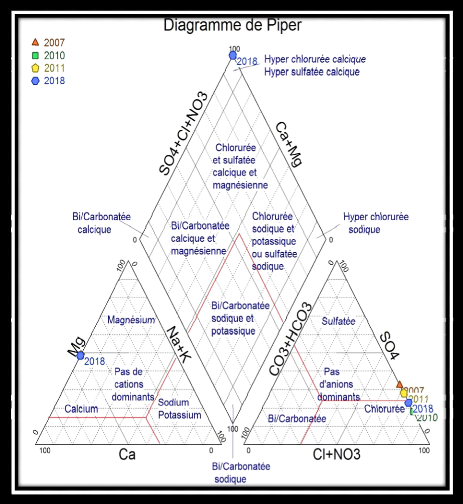
Figure n° 39 - Diagramme de PIPER Source de
Ras-el-Aïn 2007-2018
Ces résultats portés sur le diagramme de
PIPER (Figure n° 39) permettent de déterminer les
tendances chimiques des eaux de la source de Ras-el-Aïn à travers
le temps.
L'ensemble des nuages de points présente une dominance de
faciès Hyper chloruré calcique.
- 80 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie

Figure n°40-Diagramme de PIPER
Bassin de
Ras-el-Aïn 2007
- 81 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
- D'après le diagramme de Piper (Figure n°4), que les
eaux appartiennent principalement aux deux familles des eaux :
? Chlorurée sodique (75%).
? Chloruré et magnésienne (25%)
-Ce diagramme de Piper met en évidence les faciès
des trois grandes catégories d'eau de l'étude :
1. Les eaux de puits
2. Les eaux de Forages
3. Les eaux de la source Ras-el-Aïn
-On observe que les eaux de forages sont principalement de
faciès chlorurés magnésiens. Les eaux de puits
présentent globalement un faciès de type chloruré sodique,
les eaux de la source de Ras-el-Aïn quant à elles sont
chlorurés sodiques.
- 82 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
V/-6-2 Diagramme de SCHOELLER - BERKALOFF :
Une autre manière de déterminer les faciès
chimiques de chaque échantillon est le diagramme de
SCHOELLER-BERKALOF
Les résultats des analyses chimiques des eaux souterraines
ont été reportés sur le diagramme de
SCHOELLER-BERKALOFF (Figure n°41 et n°42)
IV/-6-2-a Source de Ras-el-Aïn

Figure 41 -Diagramme de SCHOELLER-BERKALOFF
Source
de Ras-el-Aïn 2007-2018
- 83 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Le faciès Chloruré-calcique caractérise
la plupart des Années de prélèvement, il est à
l'origine de la situation de la source à l'aval du Mont de Murdjadjo qui
influe sur la chimie des eaux de la source de Ras-el-Aïn et du bassin en
général en les chargeant d'eaux riches en calcaires. A
l'échelle du massif, l'allure identique des droites d'ajustement des
points représentatifs des ions dissous des eaux de la source,
dénote d'une homogénéité chimique durant toute la
période d'observations.
V/-6-2-b Bassin de Ras-el-Aïn

Figure n°42- Diagramme de
SCHOELLER-BERKALOFF
Bassin de Ras-el-Aïn 2007

- 84 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Les données chimiques des eaux de surface,
représentées sur le diagramme de SCHÖLLER BERKALOFF,
(Figure n°42) indiquent un faciès
Bicarbonaté-calcique dans la majorité des points, mais montre
également un faciès Sulfaté-calcique au niveau du point
P76 situé au sud du bassin de Ras-el-Aïn.
Ceci est en parfaite concordance avec le Faciès
lithologique des calcaires, parfois interstratifiés de Gypse, formant
l'ossature du massif au niveau du bassin de Ras-el - Aïn.
V/-6-3 Diagramme de WILCOX : V/-6-3-a Source de
Ras-el-Aïn
Figure n°43-Diagramme de WILCOX
Source de
Ras-el-Aïn 2007-2018
- 85 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Faute de données de sodium de la source de Ras el
Aïn, à cette période, nous n'avons pas pu faire une
interprétation crédible du diagramme (Figure n°43)
V/-6-3-b Bassin de Ras-el-Aïn
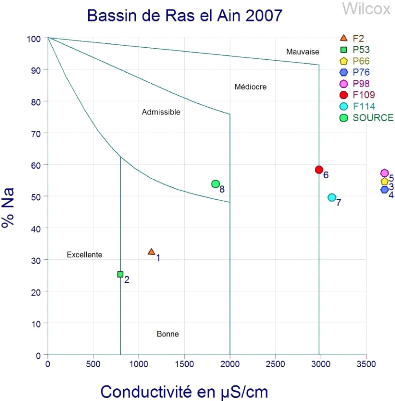
Figure n°44 ?Diagramme de WILCOX
Bassin de
Ras-el-Aïn 2007-2018
Le diagramme de Wilcox (Figure n°44)
tracé en fonction du % Na et de la CE, montre que 25% des
échantillons des eaux souterraines tombent dans le domaine des eaux
excellentes à bonnes pour l'irrigation, 12.5% des eaux sont bonnes, 62%
tombent dans le domaine mauvais.
- 86 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
D'après WILCOX (figure n°16) qui
classe les eaux à partir de leur proportion en sodium en fonction de la
conductivité électrique, on constate que les eaux du bassin de
Ras el Aïn ont un taux en sodium qui varie entre 25% et 60%.
Par conséquent, on remarque que ces eaux ainsi que le
sol du Bassin versant de Ras-el-Aïn présente un grand risque
à la salinisation, mis à part le forage F2 et le puits P53
situées dans la partie Sud-Ouest du flanc sud du Murdjadjo de part et
d'autre de la route Nationale n°2 , reliant le pont Albin et Bou
Yakour.
Ces eaux du bassin de Ras el Aïn sont bonnes par rapport
à d'autres points du Bassin. Leur pH étant
légèrement basique, ils ont une faible capacité de
dissoudre les alcalins (calcium, potassium, magnésium, sodium).
VI/ Pollution d'eau de la nappe du bassin de
Ras-el-Aïn
VI-1/ Les pollutions Bactériologiques :
Les bactéries, virus et autres agents pathogènes
rencontrés dans les eaux souterraines proviennent de fosses septiques,
des décharges, des épandages d'eaux usées, de
l'élevage, de matières fermentées, de cimetières,
du rejet d'eaux superficielles. Ces pollutions peuvent être aussi dues
à des fuites de canalisations et d'égouts ou à
l'infiltration d'eaux superficielles.
La grande majorité de ces microorganismes nocifs,
susceptibles d'engendrer des infections humaines redoutables, diffuse dans
l'environnement hydrique par l'intermédiaire de souillures
fécales humaines ou animales.
Les pollutions microbiologiques se rencontrent surtout dans
les aquifères à perméabilité de fissure (craie,
massifs calcaires), dans lesquels la fonction épuratrice du sous-sol ne
peut s'exercer et dans lesquels la matière organique est
dégradée partiellement. Les émergences de type karstique
avec des circulations souterraines rapides sont par conséquence
très vulnérables à cette pollution, c'est le cas de notre
secteur d'étude qui semblerait rassembler toutes les conditions à
la prolifération des Bactéries et d'éléments
pathogènes.
La surveillance microbiologique des eaux de distribution
concerne les paramètres suivants: coliformes thermo tolérants
(Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Salmonella, Yersinia
enterocolitica, ...), streptocoques fécaux (genres
Enterococcus
CHAPITRE IV : Hydrochimie
et Streptococcus) et bactéries aérobies
revivifiables à 22°C (germes saprophytes) et à 37°C
(germes pathogènes ou plutôt hébergés par l'homme et
par les animaux à sang chaud).
D'après L'Étude bactériologique
réalisée par la SEOR. À partir des données des
années de 2010 et de 2011(Annexe), la situation de la source de
Ras-el-Aïn est très inquiétante (Tableau n°17).
Les coliformes totaux sont omniprésents dans la nature
et sont associés à la matière organique en
décomposition (pelouse, foin, bois, matières fécales,
etc...).
Pour qu'une eau soit considérée potable, le
résultat doit être de moins de 10 ufc (Unité Formant
Colonie) par 100 ml. L'eau des puits et forages de la source de
Ras-el-Aïn, avec une concentration de 21 ufc est considérée
impropre à la consommation et un nettoyage des puits et des forages doit
être effectué.
|
Source de Ras el Aïn
|
2010
|
2011
|
NA
|
|
Germes aérobiques à 37°C
(u.f.c/ml)
|
35
|
150
|
10
|
|
Coliformes totaux à 37°C
(u.f.c/100ml)
|
21
|
240
|
<10
|
|
Entérocoques (u.f.c/100ml)
|
0
|
21
|
0
|
|
Escheichia-Coli à 44°C
(u.f.c/100ml)
|
2
|
0
|
0
|
Tableau n°17 - Relevés
Bactériologique de la source de Ras-el-Aïn
2010-2011
n°45 - Évolution Bactériologique de la
Source de Ras-el-Aïn 2010-2011
- 87-
- 88 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
VI/-2 La pollution de la source de Ras-el-Aïn par
Hydrocarbures :
VI/-2-1Les polluants insolubles plus légers que
l'eau : comme le Fuel, par exemple, plus légers que l'eau
restent à la surface de la nappe où ils s'étalent. C'est
principalement le cas des hydrocarbures, même si quelques-uns sont
légèrement solubles (phénols, aromatiques). Pour circuler
dans le sol et rejoindre la nappe, les hydrocarbures doivent être en
quantité suffisante pour former une phase continue. S'ils sont
présents sous forme discontinue (gouttelettes piégées dans
les pores), la pollution sera plus lente.

Figure n°46- Pollution par un produit plus
léger que l'eau et qui atteint la nappe.
VI/-2-2 Les polluants insolubles et plus denses que
l'eau : comme les organochlorés (boues ou les bitumes)migrent
jusqu'à la nappe sans laisser de traces derrière eux. Une fois
arrivés à la nappe, ils continuent à descendre
jusqu'à la base, puis migrent dans le sens du pendage. Peu ou pas
biodégradables, ils polluent la nappe pour des durées très
longues. Ils sont très difficiles à localiser et à
éliminer.
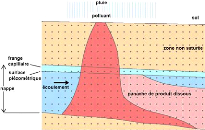
Figure n°47- Pollution de la nappe par un produit
plus lourd que l'eau.
- 89 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
VI/-3 Les périmètres de protection :
Les périmètres de protection d'un captage sont
définis après une étude hydrogéologique; ils sont
prescrits par une déclaration d'utilité publique. Leur but est de
protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage et
d'interdire ou réglementer les activités qui pourraient
dégrader la qualité des eaux captées. Pour un captage ou
un champ captant, trois zones concentriques sont définies dans
lesquelles des contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour
éviter la dégradation de la ressource.
Les limites méridionales et orientales ont
été déterminées grâce à l'apport de la
carte piézométrique (S.Benabidi 2007, Figure n°48)qui a
permis de mettre en évidence des lignes de partages des eaux
souterraines faisant office de limites du bassin hydrogéologique.
Ceci n'a été possible que par la densité
des points mesurés et entrant dans le réseau
piézométrique que nous avons conçu.
Les limites Nord et Nord-Ouest correspondent à la ligne
de crête où affleure le substratum constitué des schistes
imperméables.
VI/-3-1 Le périmètre de protection
immédiate :
Ce premier périmètre contient le captage
lui-même. Sa surface est limitée à quelques centaines de
mètres carrés (environ 30 mètres sur 30). La
collectivité locale est propriétaire du terrain qu'elle doit
clôturer, sauf en cas d'impossibilité. Toutes les activités
y sont interdites, sauf celles consacrées à l'exploitation et
l'entretien des équipements .Son rôle est d'empêcher la
dégradation des ouvrages ou l'introduction directe de substances
polluantes dans l'eau.
VI/-3-2 Le périmètre de protection
rapprochée :
Le périmètre de protection rapproché doit
protéger le captage de la migration de substances polluantes. Sa surface
dépend des caractéristiques locales; elle varie entre 1 et 10
hectares. Toutes les activités, installations et dépôts
susceptibles de nuire directement ou indirectement à la qualité
des eaux sont interdits ou réglementés.
De prime abord, il faut garder à l'esprit que la
raideur des versants, surtout la partie occidentale de Ras-el-Ain, intensifie
avant tout l'activité des divers processus de transport (c'est aussi les
lieux où les eaux courantes exercent au maximum leurs
- 90 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
activités de transport, d'ablation latérale et
d'accumulation), en raison de l'amoindrissement des forces d'inertie
opposées à l'action de la gravité.
(Tableau n°18), récapitulatif des puits et forages du
Bassin de Ras-el-Aïn délimités dans la zone II de protection
rapprochée.

|
Point
|
X Lambert
|
Y Lambert
|
Description
|
|
A
|
196.130
|
271.250
|
Source Ras-el-Aïn
|
|
B
|
196.852
|
270.920
|
Réservoir d'Eckmühl
|
|
C
|
196.000
|
270.270
|
Camp des Tirailleurs (point de
rencontre avec la limite
hydrogéologique)
|
|
D
|
194.800
|
269.780
|
Stade Bouakel
|
|
E
|
193.250
|
270.200
|
Point de côté 308 m
|
|
F
|
191.500
|
270.750
|
Point de côté 365 m
|
|
G
|
189.825
|
273.000
|
Le point de côté 510 (ligne de
crête) au Nord du Douar Krerza,
|
|
H
|
190.950
|
273.450
|
Point géodésique de 3ème ordre
(509 m) situé au Nord-Est
de la Ferme Combe.
|
|
I
|
191.550
|
273.000
|
Point de côté 479m a l'Est de la ferme
Ste Marie.
|
|
J
|
192.650
|
272.000
|
Point de côté 410m ( limite des
crêtes ).
|
|
K
|
194.350
|
272.100
|
Point de côté 367m.
|
|
L
|
195.650
|
271.800
|
Au Sud-Ouest du village Etienne
et dans la chaaba qui longe le
coté Nord du cimetière Moul el
Douma.
|
Tableau n°18- Tableau descriptif du
périmètre de protection intermédiaire (Zone
II)
(S.Benabid ANRH-2007)
- 91 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
VI/-3-3 Le périmètre de protection
éloignée :
Le dernier périmètre (Figure n° 19) n'est
pas obligatoire. Il renforce le précédent. Sa surface est
très variable. Sont réglementés les activités,
dépôts ou installations qui présentent un danger de
pollution pour les eaux prélevées, par la nature et la
quantité de produits polluants mis en jeu ou par l'étendue des
surfaces qu'ils affectent.
|
Point
|
X Lambert
|
Y Lambert
|
Description
|
|
A
|
196.130
|
271.250
|
Source Ras-El-Aïn
|
|
B
|
196.852
|
270.920
|
Réservoir d'Eckmuhl
|
|
C
|
195.500
|
268.000
|
Ferme Saint Marie
|
|
D
|
193.150
|
267.825
|
Ferme Thoreu
|
|
E
|
192.825
|
268.300
|
Point de côté 226m
|
|
F
|
192.000
|
268.250
|
Point de côté 268m
|
|
G
|
189.650
|
272.250
|
Douar Krerza
|
|
H
|
190.250
|
273.050
|
Ferme Combier
|
|
I
|
191.000
|
273.550
|
Point géodésique de 3ème ordre
(509 m) situé au Nord de la Ferme Saint Marie.
|
|
J
|
192.650
|
272.000
|
Point de côté 410m .
|
|
K
|
194.910
|
272.590
|
Point de côté 423m(Sud-Ouest de Sidi AEK .Morsli)
|
|
L
|
195.325
|
272.850
|
Koubba de Sidi Abdelkader Morsli
|
Tableau n°19- Tableau descriptif du
périmètre de protection intermédiaire (Zone III)
(S.Benabid
(ANRH-2007)
- 92 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
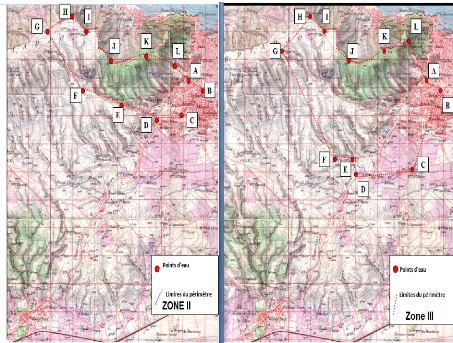
Figure n°48 : Cartes de délimitation des
périmètres de protection (S.Benabid ANRH-2007) (Zone II et Zone
III)
- 93 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
VII/- Conclusion :
La qualité naturelle des eaux souterraines peut
être altérée par l'activité humaine. La
détérioration de la qualité de l'eau est
appréciée par mesures des paramètres physico-chimiques et
bactériologiques.
Dans le cas d'une détérioration jugée
importante, l'eau ne sera plus considérée comme potable pour la
consommation humaine. Elle pourra être telle quelle utilisée
à d'autres fins (irrigation...) ou devra subir un traitement
approprié pour retrouver sa potabilité.L'eau des nappes n'est
donc pas à l'abri de la pollution et l'autoépuration naturelle
n'est pas complète dans toutes les nappes et vis-à-vis de
certaines substances.
Dans les réservoirs calcaires du Murdjadjo les eaux
sont dures, moyennement à fortement minéralisées en sels
de calcium et magnésium, C'est le cas des eaux du bassin de
Ras-el-Aïn. Dans les réseaux karstiques, l'eau peut se charger de
particules argileuses en suspension au cours des fortes pluies.
L'eau du bassin de Ras-el-Aïn à une qualité
qui dépend de celle de la nappe qui l'approvisionne, en l'occurrence,
celle du Mont Murdjadjo.
Généralement deux types d'eaux ont
été identifiés :
-Les eaux des calcaires : Ces eaux sont soit
Calci-magnésiques, soit chlorurées sodiques.
-Les eaux des grès sont moyennement chargées en
sels solubles. Leur faciès est chloruré sodique.
Les résultats des nombreuses analyses effectuées
au niveau de la source de Ras-el-Aïn, le point le plus bas de tout le
massif perméable en grand, indiquent une eau de faible
minéralisation avec un léger apport extérieur (les pluies
par exemple).
Il est à noter une diminution du taux de nitrates des eaux
de la source :
De 2007 à 2018, la concentration en nitrates est
passée de 75mg/l à 35mg/l. Néanmoins une
dégradation de la qualité physico-chimique des eaux est bien
présente (voir analyses de le SEOR en annexe), elle ne peut s'expliquer
que par la
- 94 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
surexploitation de la nappe due à la prolifération
des ouvrages, des germes de contamination fécale ont été
détectés localement au niveau de la source de Ras-el-Aïn.
Cela nous semble vraisemblablement lié aux fosses septiques des
habitations très développés sur les versements du bassin
de Ras-el-Aïn
Les hydrocarbures qui polluent la source de Ras-el-Aïn,
suite à une fuite dans les réservoirs de la caserne militaire
d'Oran, située à proximité de notre zone d'étude
ont modifié le comportement de la source.
Ces modifications organoleptiques de l'eau persistent depuis
1998.Comme ces produits sont pour la plupart faiblement oxydables et encore
perceptibles à des dilutions de 1 partie par milliard, les nappes d'eau
polluées du Bassin de Ras-el-Aïn sont devenues inutilisables et ce
pendant de très longues années.
- 95 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
Conclusion Générale
Le premier objectif de cette étude était de
rassembler les éléments de compréhension au fonctionnement
générale de l'aquifère des calcaires à
l'échelle du bassin de Ras el Aïn. Ceci permettra dans le futur
à une meilleure représentation sous forme de modèle
Hydrogéologique.
Le deuxième objectif était d'interpréter
les données disponibles afin de cerner les problématiques
actuelles et futures, et proposer des mesures complémentaires utiles
à la modélisation du système Aquifère.
Cette étude s'articule principalement sur des
informations lithologiques, piézométriques, hydro climatologiques
et hydro chimiques.
Grâce aux coupes lithologiques et les sondages, nous
avons pu préciser les variations dans l'espace et en profondeur des
différents niveaux aquifères.
Les calcaires récifaux, très faillés
renferment un aquifère en réseaux de fissures et de chenaux.
La morphologie structurale de ces carbonates aurait permis
ainsi un emmagasinement fort appréciable dans tout le bassin
hydrographique du flanc sud du massif du Murdjadjo.
Le principal exutoire de cet Aquifère karstique est la
source de Ras el Aïn ainsi que de nombreuses autres sources qui
émergent faisant partie de tout un système Hydrogéologique
regroupant Misserghin, Berédah et le bassin de Ras el Aïn.
Dans le cadre de ce travail, l'étude hydro
climatologique de la région étudiée nous a permis de
définir les différents paramètres du bilan hydrologique.
Ainsi l'exposition à la mer et en particulier le relief (le massif de
Murdjadjo) jouent le rôle d'obstacle aux facteurs dominants du climat
semi-aride de la région favorable aux apports occultes (brouillard).
Les variations piézométriques indiquent un
rôle important des irrigations qui permettent le maintien du niveau d'eau
pendant la période d'étiage durant tout l'été, cela
permet de limiter le risque de manque d'eau et d'éventuelles
restrictions. Par ailleurs, suivant le sens de l'écoulement principal
(NW-SE), on constate que la morphologie de l'Aquifère calcaire de la
nappe est restée inchangée pendant la
- 96 -
CHAPITRE IV : Hydrochimie
période d'observation des fluctuations des niveaux
piézométriques de la nappe (2007-2018).
La réactualisation des cartes
piézométriques nous a apporté un élément
nouveau d'une importance capitale insoupçonnée, jusqu'à
aujourd'hui. En effet, la cartographie de l'écoulement souterrain au
niveau du bassin du massif du Murdjadjo s'est avéré alimenter en
plus du grand bassin de Ras el Aïn situé à son
piémont, le bassin de Daya Morsly communément appelé,
« Petit lac », en effet les axes principaux s'étendent dans la
direction SW-SE, vers le plateau d'Oran.
Nous pourrons envisager dans le futur de soulager le bassin du
Murdjado par l'implantation de nouveaux points d'eau et contribuer, ainsi
à alimenter une grande partie du plateau d'Oran.
Du point de vue hydro chimique, les eaux du bassin de Ras el
Aïn appartiennent principalement aux deux familles d'eau :
Chlorurée-sodique (75%) des points d'eau
Chloruré - Magnésienne pour le reste des points
eau.
Il est à noter une diminution du taux de nitrates des eaux
de la source :
De 2007 à 2018, la concentration en nitrates est
passée de 75mg/l à 35mg/l. Néanmoins une
dégradation de la qualité physico-chimique des eaux est bien
présente (voir analyses de le SEOR en annexe), elle ne peut s'expliquer
que par la sur exploitation de la nappe due à la prolifération
des ouvrages.
L'urbanisation de plus en plus développée au
sommet du massif et sur les versants, dépourvue de tout réseau
d'assainissement véhiculent les eaux usées. Des germes de
contamination fécale ont été détectés
localement au niveau de la source de Ras-el - Aïn.
Des périmètres de protection peuvent être
prescrits par une déclaration d'utilité publique, suite à
la contamination de la source de Ras el Aïn.
Nous n'avons pas pu étudier l'évolution des
Hydrocarbures dans notre secteur d'étude, les résultats des
analyses actuels nous n'ayant pas étés communiqués.
Références bibliographiques
-Belhaloui B, 1999 :
Méthodologie d'évaluation de la vulnérabilité des
nappes libres à la pollution à partir des SIG application
à la région d'Oran carte au (1/50000) D'Oran
Mémoire d'Ingéniorat Université
d'Oran.
-Adda et Bouchenouk, 2007 : Etude
Hydrochimique et Bactériologique des Eaux Souterraine de la partie
occidentale de l'agglomération oranaise
Mémoire d'ingéniorat Université d'Oran
Institut des Sciences de la Terre
-Abdelkrim Zidouri, 1986
Contribution à l'Étude Hydrogéologique du Bassin
d'Alimentation de Ras-El-Ain(Oran)
Mémoire pour l'Obtention du Titre d'Ingéniorat
d'État-Option : Hydrogéologie
Institut des sciences de la Terre Département de
Géologie Appliquée.
-Benabid salim, 2008 : Le
Périmètre de Protection de la Source Ras -El- Ain Mémoire
pour l'Obtention du Titre d'Ingéniorat d'Etat-Option :
Hydrogéologie Université d'Oran Institut des Sciences de la
Terre.
-Boudoura et Bourzag, 1999 :
Structure et Fonctionnement du Système Karstique de la Source de
Ras-El-Ain à Oran
Mémoire pour l'Obtention du Titre d'Ingéniorat
d'Etat-Option : Hydrogéologie
Université d'Oran Institut des Sciences de la
Terre.
- Dalloni et Fennet
(Étude géologique de l'Oranie )
-Thomas Géodynamique des
Bassins sédimentaires
- Gevin 1949,
Périmètre de Protection de Ras eL Ain.
-Sourisseau 1975, Étude
Hydrogéologique du Massif du Murdjadjo.
- F.Bouchama , 2001 :
Synthèse d'établissement des
périmètres de protection) ANRH
- Mostefa Djelloul-H.Belhadj
Jaugeages de la source de Ras El Ain
ANRH
- A.Belkhodadi, 1994)Choix du
réseau de surveillance qualitative du Flan sud du Murdjadjo,ANRH
1
- Mostefa Djelloul, Annuaires
Piézométrique du Flan Sud du Murdjadjo)
-Castani 1998, Hydrogéologie
principes et méthodes.
-MelleKherzi Sabrina,
2011 : Etude hydrochimique des eaux de l'Oued Djemâa Wilaya de
Bejaïa. Mémoire pour l'Obtention de Magistère en
hydraulique-Option : Hydraulique générale.
-Moussa Haidar Chaden, 2014 :
Evaluation de la qualité de l'eau du bassin supérieur de la
rivière du Litani, Liban, Approche hydrogéochimique.
Mémoire, Thèse en Géosciences
Université de Lorraine Ecole Doctorale RP2E (Science
et Ingénierie Ressources Procèdes Produit Environnement.
-Boudia Abdelkrim et Bouameur Asmaa,
2016/2017 : Caractérisation hydrochimique et
qualité des eaux souterraines de la nappe Karstique de Saida.
Mémoire pour l'Obtention du diplôme de Master en
Hydraulique-Option : Ressources en eau Université Dr.Moulay Tahar de
Saida, Faculté des sciences et de la technologie, Département de
Génie Civil & d'hydraulique.
-Fahd Fatima Ezzahra, El Rhaffouli
Oumayma, 2016 : Etude Climatologique de la région de
Fes. Mémoire pour l'Obtention de Licence Science et Techniques-Option :
Géoressources et Environnement
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Faculté
des Sciences et Techniques Maroc.
-M. Foukrache Mohammed 2001
Hydrogéologie des massifs côtiers Oranais (Arzew- Bénisaf)
Thèse de Magistèr Université Essénia Oran Foukrache
Mohamed 2001
- Fadila Kettaf ,2013, La fabrique d'espaces
publics : Conceptions, formes et usages des places d'Oran
(Algérie)
Thèse de Doctorat Université de Paul -
Valéry Montpellier Fadila Kettaf
- Adda Mawloud ,2013 Caractérisation
Hydrochimique et pollution des eaux souterraines en contexte urbain ,2013: Cas
de l'agglomération oranaise (Algérie) Thèse de Magister
Adda Mawloud
Sites Web
https://journals.openedition.org/insaniyat/11858
file:///F:/BIBLIOGRAPHIE%20RAS%20EL%20AIN/Climatologie%20globale%20à%20Oran%20P
ort%20-%20Infoclimat.html
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2017/oran-port/valeurs/60461.html
https://www.persee.fr/doc/camed0395-93171995num5111152
https://www.memoireonline.com/10/12/6341/Caracterisation-et-etat-de-connaissance-du-bassin-de-la-grande-Sebkha-d-Oran.html
-
| 


