|
0. INTRODUCTION
0.1. Contexte du
stage
En vue de concilier les théories apprises dans
l'auditoire aux pratiques sur terrain, le Ministère de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire prévoit à la fin de chaque
cycle de formation supérieure et universitaire un stage de
professionnalisation.
Ainsi, pour ne pas faire une exception à cette
instruction universitaire nationale, l'Université Shalom de Bunia nous a
recommandé de passer ce stage au sein de la Réserve de Faune
à Okapis, qui est une des Aires Protégées parmi d'autres
en République Démocratique du Congo pour une durée allant
du 13 septembre au 17 octobre 2010.
0.2. Objectifs
Dans le souci d'atteindre ce but de concilier la
théorie à la pratique, nous nous sommes assignés comme
objectifs :
Ø Avoir des connaissances générales sur
la RFO ;
Ø Approfondir les connaissances pratiques par
l'acquisition de l'expérience en matière de développement
et de gestion d'une aire protégée ;
Ø Asseoir des connaissances sur les différentes
méthodologies de recherche scientifique ;
Ø Comprendre l'orientation de la politique de
conservation et les principes de gestion de la Réserve.
0.3.
Méthodologie
La methode participative nous a servi de chemin pour mener nos
recherches. Cependant, pour parcourir ce chemin, nous avons utilisé les
techniques suivantes :
Ø De documentation à la bibliothèque de
la WCS pour la rédaction du stage surtout la partie de
généralités sur la RFO ;
Ø D'interview ou entretien suivi des questions
explicatives avec les différents encadreurs pour s'informer du
fonctionnement de la RFO/ICCN et ses partenaires (WCS et GIC) ;
Ø D'observation participante aux activités
organisées au sein de deux partenaires de la RFO, ainsi que des
visites sur terrain.
0.4. Difficultés
rencontrées
Durant notre période de stage, nous nous sommes
butés à des problèmes qui suivent :
Ø Le manque d'un protocole de recherche de
l'Université Shalom de Bunia pour l'orientation des étudiants
stagiaires aux recherches précises ;
Ø Le manque des matériels de terrain tels que le
GPS, Boussole, ...
0.5. Subdivision
Comme tout travail scientifique, hormis l'introduction et la
conclusion, ce présent rapport de stage se subdivise en deux petites
parties dont :
Ø La première parle des
généralités sur la Réserve de Faune à Okapis
(RFO/Epulu) et ;
Ø La seconde axée sur le déroulement du
stage est subdivisée à des chapitres.
PREMIERE
PARTIE :
GENERALITES SUR LA RESERVE DE FAUNE A OKAPIS/
EPULU
I.1. CADRE JURIDIQUE DE LA RFO
La RFO est une Aire Protégée (AP)
gérée pour des fins d'utilisation durable des
écosystèmes naturels. Elle a été
créée par l'Arrêté Ministériel N°
045/CM/ECNT/92 du 02 mai 1992, inscrite parmi les cinq sites du
patrimoine mondial de l'UNESCO en RDC depuis le 15 décembre 1996. Elle
est gérée aux fins d'assurer la protection et le maintien
à long terme de la diversité biologique tout en garantissant la
durabilité des fonctions et produits naturels nécessaires au bien
être de la communauté locale.
I.2. LOCALISATION DE LA RFO
La Réserve de Faune à Okapis est située
au Nord-Est de la R.D.Congo, dans la province Orientale, District de l'Ituri et
en grande partie au territoire de Mambasa. Elle se situe entre 1° et 2°29' de
la latitude Nord, 28o et 29o4' de longitude Est, à
une altitude comprise entre 700 m et 1000 m. Elle couvre une superficie de
13.726 km2 soit 90% de son étendue située dans le
territoire de Mambasa, 7% dans le territoire de Wamba et 3% dans le territoire
de Watsa.
I.3.
CLIMAT
La forêt de l'Ituri est classée dans la
catégorie des forêts humides sempervirentes telle que
définies par White en 1983. Elle présente un climat chaud et
guinéen (humide). La moyenne des températures journalières
se situe entre 20o et 27o C avec des variations de la
durée du jour inférieure à une heure sur toute
l'année1(*).
La température moyenne annuelle est toujours
supérieure à 24o C avec une amplitude thermique
très faible. La pression atmosphérique est très faible et
constante. Les précipitations annuelles se situent autour de 1600
à 1800 mm2(*). En
général, la région de l'Ituri connaît une saison
sèche allant de mi-décembre à février, le reste de
l'année est entièrement pluvieux avec des pics irréguliers
de précipitations.
I.4.
BIODIVERSITE
I.4.1. Flore
Quatre principaux types d'habitat ont été
identifiés dans la forêt de l'Ituri3(*) , à savoir :
v Les forêts mixtes : C'est
l'habitat le plus divers de l'Ituri du point de vue de la flore. Dans la plus
grande partie de la RFO, elles sont dominées par Julbernadia
seretii, et Cynometra alexandrii (Caesalpiniaceae) qui sont parmi
les espèces les plus abondantes de la canopée.4(*)
v Les forêts mono dominantes :
Elles sont caractérisées par la dominance de Gilbertiodendron
dewevrei (Caesalpiniaceae) qui peut représenter plus de 90% des
arbres de la canopée sur des vastes étendues.
v Les forêts marécageuses :
ou riveraines se trouvant au bord des rivières où sur le sol
continuellement inondé. Les espèces dominantes de cette
végétation sont : Hallea stipulosa et Mitragyna
stipulosa (Rubiaceae), Macaranga schweinfurthil, et Uapaca
guineensis (Euphorbiaceae)
v Les forêts secondaires : Elles
sont les plus abondantes le long des routes et dans les zones à forte
densité de la population. La composition d'espèce est
variable : Trema guinesis (Ulmaceae), Musanga
cecrospioides, Albizia guimmifere (Cercrospiaceae, Fabaceae et
mimosoideae).
v Dans le secteur Nord de la Réserve, de grands
affleurements rocheux granitiques (Inselbergs) dominent la canopée de la
forêt et supportent des formations végétales tout à
fait particulières dont certaines sont endémiques.5(*)
I.4.2.
Faune
La Forêt de l'Ituri est l'un des sites de la RDC les
plus riches en faune en raison de son statut de refuge forestier du
pléistocène à partir de laquelle se sont dispersées
par la suite de nombreuses espèces vertébrées de l'Afrique
centrale et Orientale.6(*)
La plupart des données zoologiques disponibles portent sur les
mammifères et les oiseaux. Les invertébrés sont
très mal connus dans cette région.
L'Okapi, Okapia johnstoni est une Girafe
(Giraffidé) forestière endémique à la RDC. Sa
densité de population est relativement élevée dans la
forêt de l'Ituri et sa présence est l'une des principales raisons
ayant motivé la création de la RFO. Cependant, d'autres
mammifères revêtent également une importance majeure du
point de vue de la conservation7(*). La Réserve offre un habitat pour des
populations appréciables d'éléphants de forêt
(Loxondota africana cyclotis). Elle abrite 13 espèces de
primates dont six espèces de cercopithèques, trois de colobes,
deux de cercocèbes et deux de grands primates (babouin et
chimpanzé) anthropoïdes diurnes ou la grande diversité
connue en Afrique sur un seul site8(*). Trois espèces de ses primates sont
considérées comme vulnérables. Il s'agit du
Cercopithèque à tête de hiboux (Cercopithecus
hamlyni), du Cercopithèque de
l'hoesti (Cercopithecus hoesti) et du
Chimpanzé (Pan troglodytes)9(*). Les divers carnivores de la RFO sont : le chat
doré (félis aurata) et deux viverridés rares tels
que la genette aquatique (Osbornictis piscivora) et la genette
géante (Genetta victoriae).
I.5. OBJECTIFS DE LA RFO
I.5.1. Objectif global
Conserver la faune, la flore (la biodiversité) et
assurer la continuation à perpétuité des activités
économiques alternatives par les communautés vivant à
l'intérieur de la RFO.
I.5.2. Objectifs
spécifiques
Spécifiquement, la RFO vise :
v La protection des espèces phares, menacées,
plus particulièrement les Okapis, Eléphants, les plantes
médecinales, sans oublier les premiers habitants du Congo
(Pygmées dans la Réserve) ;
v L'implication de la population locale dans la
conservation ;
v La promotion du développement durable en milieu
rural ;
v La création des microprojets compatibles avec la
conservation de la nature.
I.6. FONCTIONNEMENT DE LA RFO
Dans son fonctionnement, la RFO bénéficie des
soutiens internationaux dont les principaux partenaires sont : Wildlife
Conservation Society (WCS) et Gilman International Conservation (GIC), sans
oublier l'appui de l'USAID, UNESCO, .... Ces deux premiers partenaires sont
implantés en R.D.Congo dans le secteur de la conservation de la nature
en collaboration avec l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
précisément à la RFO/Epulu, il y a plus de vingt ans.
1.6.1. Wildlife Conservation
Society (WCS)
C'est une Organisation Non Gouvernementale ayant son
siège principal à New York intervenant en RDC dans ce même
domaine. Elle s'occupe de la recherche scientifique, la connaissance de la
biodiversité et la formation des agents de l'ICCN et autres cadres
nationaux dans la recherche en écologie forestière. Elle apporte
un appui varié dans les infrastructures et la gestion de la
Réserve. Il existe trois volets organisés au sein de la WCS pour
un progrès harmonieux de la Réserve à savoir :
· Le Volet Botanique (VB) : comprend les
activités de recherches qui sont la phénologie, la
météorologie et la dynamique forestière.
· Le Volet de Conservation Communautaire (VCC) :
celui-ci est pour apporter solutions et remèdes éventuels aux
différends qui se posaient entre la RFO et les CLs.
· Le Volet de Recensement de Grands
Mammifères : ce volet se charge des inventaires des grands
mammifères et le monitoring biologique.
I.6.2. Gilman International
Conservation (GIC)
C'est aussi une ONG de conservation qui a pour but de
contribuer à la sauvegarde de la faune et flore de la RFO et de soutenir
l'ICCN à la gestion de la Réserve. Pour atteindre ce but, le GIC,
partenaire de l'ICCN a pour objectifs de promouvoir l'écotourisme et
l'éducation environnementale, tout en mettant en place les
infrastructures touristiques appropriées. Cette ONG a plusieurs
programmes dans son sein tels que l'Agroforesterie, l'éducation
environnementale, le programme de Zoo, ...
I.7. APPROCHE DE GESTION DE LA
RFO
Après une rivalité élastique entre la RFO
et la Communauté Locale causée par le système
répressif des agents de surveillance aux communautés, que la RFO
a songé à créer, depuis 2000, une nouvelle
stratégie de gestion de la Réserve qui est « La
conservation communautaire participative ». Cette
dernière permet d'associer et de faire participer les CLs dans la
gestion de la Réserve en leur montrant le bien fondé de la
Réserve. Les communautés locales bénéficient des
retombées ou revenus de la conservation de la nature. Cette nouvelle
stratégie suscite la collaboration entre ces deux parties (CLs et
RFO/ICCN). Ce système accorde une importance à l'homme car
« la conservation de la Réserve doit se faire par les hommes,
avec les hommes et pour les hommes ». Ce système montre que
l'homme est au centre de la conservation pour réaliser une conservation
durable.
DEUXIEME
PARTIE :
DEROULEMENT DE STAGE
Dans cette partie, il est question de présenter les
différentes activités réalisées pendant notre
période de stage d'un mois allant du 13 septembre au 17 octobre 2010.
Notre stage s'est déroulé aux trois composantes de la
Réserve de Faune à Okapis dont le calendrier est
élaboré de la manière suivante :
1. Du 13 au 23 septembre 2010 : Prise de connaissance sur
le plan d'utilisation des terres et la promotion des activités
économiques alternatives ainsi que les différentes recherches
botaniques.
2. Du 24 septembre au 5 octobre 2010 : Prise de
connaissance sur le système de contrôle de séjour et de
passage dans la RFO, les différentes réglementations et la
stratégie de protection de la RFO.
3. Du 6 au 10 octobre 2010 : Prise de connaissance sur
l'agroforesterie et l'éducation environnementale.
4. Du 11 au 17 octobre : Rédaction et
présentation du rapport de stage au Comité Scientifique Local
(CSL).
CHAPITRE PREMIER :
ADMINISTRATION DE L'ICCN/RFO
II.1.1. CADRE JURIDIQUE
L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature a
été créé par la Loi n° 75-023
du 22 juillet 1975 telle que modifiée et complétée par
l'Ordonnance Loi n° 78-190 du 05 mai 1978. Il est
régi par la Loi N°08/099 du 07 Juillet 2008
portant dispositions générales applicables aux Etablissements
Publics.
En vertu du Décret N° 09/012 du
24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises Publiques
transformées en sociétés Commerciales, Etablissements
Publics et Services Publics, l'ICCN est un Etablissement Public à
caractère technique et scientifique, doté d'une structure
paramilitaire, d'une personnalité juridique et d'une autonomie de
gestion. Il est placé sous la tutelle du Ministère de
l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.
II.1.2. MISSION ET OBJECTIF DE
L'ICCN
II.1.2.1. Mission
L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, en
sigle ICCN, est une Entreprise Publique ayant pour mission: Assurer la
protection de la faune et de la flore dans les aires
protégées ; Favoriser la recherche et le tourisme dans ces
milieux ; Gérer les stations de capture et domestication.
II.1.2.2. Objectif global
Renforcer la capacité de l'ICCN à assurer la
conservation et la gestion durable de la biodiversité dans le
réseau des Aires Protégées de la RDC, en
coopération avec les communautés locales et d'autres partenaires
pour contribuer au bien-être des populations congolaises et de
l'humanité entière.
II.1.3. ORGANISATION DE L'ICCN
L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature est
sous la gestion de deux organes statutaires à savoir : Le Conseil
d'Administration et le Comité de Gestion.
Ø Le Conseil d'Administration :
est l'organe d'inspiration et d'orientation de la politique de l'Entreprise. Il
est composé actuellement de 10 membres à savoir : Un
Président (PCA), les quatre membres du Comité de Gestion et cinq
Administrateurs dont les représentants de deux Tutelles.
Ø Le Comité de Gestion :
est l'organe qui gère l'Entreprise au quotidien. Il coiffe trois
Directions Centrales suivantes :
· La Direction Administrative
· La Direction Financière
· La Direction Technique des Parcs Nationaux (qui
supervise les Directions Technique, Scientifique et du Tourisme).
II.1.4. LA STRUCTURE DE LA RFO
Ø A la tête, la RFO a un chef du site qui est un
Directeur du site supervisant les activités au sein de la RFO ;
Ø Apres lui, il y a un chef du site adjoint qui est un
Conservateur ;
Ø Les Officiers, pour le maintien du calme au sein de
la RFO ;
Ø L'administration s'occupant de la gestion des
ressources de la RFO, la centralisation de tous les services et des
correspondances, et de la rédaction des courriers
électroniques ;
Ø Lutte Anti-braconnage (LAB) travaille sur la
planification des opérations de patrouilles ;
Ø Unité de Conservation Communautaire qui sert
de pont entre l'ICCN et la population pour une bonne conservation des
ressources naturelles de la Réserve ;
Ø Monitoring en collaboration avec LAB pour la
préparation des fiches et planification des patrouilles.
II.1.5. LE PERSONNEL
L'ICCN/RFO a trois types de personnel :
Ø Le personnel technique : est
les conservateurs et les gardes qui ont suivi des formations paramilitaires.
Ces conservateurs et gardes sont gradés en allant de plus petit grade au
plus grand : élève garde, garde de deuxième classe,
garde de première classe, brigadier, brigadier en chef, sous officiers,
officiers, officiers principaux, conservateur assistant, conservateur,
conservateur principal, et à la tête le Directeur (du Site).
Ø Le personnel administratif :
est celui qui n'a pas suivi des formations paramilitaires tel que le comptable,
travailleurs, ouvriers, ...
Ø Le personnel scientifique : est
un personnel qui est dans la Réserve pour seulement de fins des
recherches scientifiques.
CHAPITRE DEUXIEME
LA PROTECTION DE LA RFO
En vue d'atteindre l'objectif de l'ICCN, celui de Renforcer sa
capacité à assurer la conservation et la gestion durable de la
biodiversité dans le réseau des Aires Protégées de
la RDC, la RFO a mis des cellules pour une bonne protection de ses ressources
naturelles. Ces cellules ont pour but d'organiser la surveillance et le
contrôle pour lutter contre les destructeurs de la Réserve.
II.2.1. Application de
l'Ordonnance loi et Arrêté Ministériel par la RFO
Cette application est faite par la cellule de Lutte
Anti-Braconnage (LAB) qui travaille en fonction de l'Ordonnance loi
No 69/041 du 22 août 1969 révisée après
la guerre à l'Ordonnance loi No 69/017 du 14 mai 1969 portant
sur la Conservation de la Nature. Cette Ordonnance loi 69/017 fut
établie pour toutes les Réserves Naturelles Intégrales
appelées aussi les Parcs Nationaux de la RDC.
La RFO, étant une AP habitée par les humains,
soutire de cette Ordonnance loi quelques articles qu'elle essaye de les adapter
à la population dans et autour de la RFO. Elle utilise cette Ordonnance
loi, plus dans son article 5 ou l'article 3 de l'Arrêté
Ministériel portant sur la création et délimitation d'une
Réserve dénommée « Réserve de Faune
à Okapis » stipulant ainsi:
« Sous réserve des
exceptions prévues par la présente Ordonnance loi ou par les
textes créant une Réserve Intégrale, il est interdit dans
les Réserves Intégrales :
i. De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer
ou troubler, de quelque façon que ce soit toute espèce animale
sauvage, même les animaux réputés nuisibles, sauf le cas de
légitime défense. En cas de légitime défense, si
l'animal a été blessé ou tué, l'auteur du fait
devra en faire la déclaration dans un délai de 48 heures à
l'Institut prévu à l'article 14. il incombera à
l'intéressé d'établir la preuve qu'il s'est
réellement trouvé en état de légitime
défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement
l'agression dont il prétendrait avoir été victime. Faute
de preuve suffisante, il sera passible de peines prévues par la
présente Ordonnance loi.
ii. De prendre ou de détruire les oeufs et les nids.
iii. D'abattre, de détruire, de déraciner ou
d'enlever les plantes (ou les arbres) non cultivées.
iv. D'introduire n'importe quelle espèce d'animal et de
plante.
v. De faire des fouilles, terrassements, sondages,
prélèvements des matériaux et tous les autres travaux de
nature à modifier l'aspect du terrain ou de la
végétation.
vi. De bloquer les rivières, de prélever ou de
polluer directement ou indirectement les eaux.
vii. De se livrer à tout fait de pêche.
viii. De faire évoluer un aéronef à
hauteur inférieure à 300 m ».
Si les gardes de la RFO trouvent un infligé en
infraction, on va l'apporter au bureau de la station où il sera
auditionné, lui faire d'abord comprendre et modérer cette
Ordonnance dans son article 5 afin qu'il se retrouve lui même fautif ou
en infraction, ainsi l'Ordonnance loi est appliquée.
En ce qui concerne les gardes et les membres de soutien, la
RFO utilise l'article 23 pour le rôle des gardes et l'article 31 pour les
membres de soutien dans leur rôle de faciliter la tache à
l'Institut en lui procurant toute l'assistance dont il pourrait avoir
besoin.
II.2.2. La Surveillance et la
patrouille
La surveillance est l'application de l'ordonnance loi et/ou
l'arrêté ministériel. Elle est un contrôle
effectué par les observations visant à empêcher la fraude
ou les infractions dans la Réserve. C'est aussi, examiner avec attention
pour obtenir les renseignements. D'après l'ICCN, la surveillance est
l'ensemble des activités visant à garantir
l'intégrité du site par les personnels des gardes (agents de
surveillance).
La patrouille est une expédition en foret (AP) pour
surveiller les animaux, les végétaux dans un secteur
précis contre tout danger extérieur tel que le braconnage des
espèces, destruction de la forêt. Elle doit nécessairement
avoir une mission ou ordre spécifique soit : de la collecte
d'information sur le nombre des animaux : dénombrement, leur
distribution dans une région, etc ; de démantèlement
des pièges et de la prospection ou patrouille de recherche.
II.2.2.1. Techniques de
surveillance
Ø Barrière
de contrôle : l'avantage de la barrière de
contrôle est que ça permet de déceler ou
d'appréhender les infractions sur la Conservation de la Nature entre
autre : viandes de brousse, ivoires, armes, ...
Ø Positions mobiles : permettent
de couvrir un grand secteur pour quelques jours, ça facilite un
déploiement rapide pour une intervention de lutte contre le braconnage
et elles permettent aux gardes de conserver l'énergie.
Ø Postes de patrouilles : ont
comme avantage la permanence des agents de surveillance pour dissuader les
infracteurs. Ces postes aident à élargir la couverture de la
surveillance.
Ø Réseau d'information :
contribue aux planifications de patrouille, il permet de localiser les
activités illégales et aide pour le déploiement des
équipes de gardes avec précision.
Ø Patrouille routière :
C'est une bonne technique qui permet de contrôler les véhicules et
de réduire la circulation des viandes de brousse sur la RN4 (route
nationale n°4) et elle permet de surprendre les trafiquants des ivoires
soit par des armes.
Ø Patrouille aérienne :
permet de localiser rapidement certaines activités illégales
telles que l'exploitation minière le long de la rivière Ituri au
Sud-est et Sud-ouest de la RFO. Cependant, elle est incapable de réagir
immédiatement en cas de repérage des braconniers et des
orpailleurs à cause de retard d'atteindre la station et surtout que
cette technique est valable pour la zone de la savane mais pas de la
forêt.
Ø Patrouille de refoulement :
Elle crée une bonne attente entre la RFO et les communautés
locales et encourage l'implication de la population dans la gestion de RFO.
Toutes ces techniques de surveillance et la patrouille entrent
dans le cadre de la protection de la biodiversité de la Réserve
de Faune à Okapis. Toujours dans le cadre de la protection, il y a une
cellule appelée Law Enfoncement Monitoring (LEM) qui fait maintenant le
suivi de la loi appliquée par la LAB.
II.2.2.2. Les attributions du
LEM
Ø Faire le débriefing, c'est-à-dire
recevoir le rapport de patrouille quand une équipe est lancée sur
terrain.
Ø Préparer les fiches LEM pour les patrouilles
et les piles pour les GPS. Les fiches délivrées pour les
patrouilles sont :
· Fiche d'autorisation de patrouille ;
· Fiche journalière permettant aux patrouilleurs
de collectionner toutes les données utiles ;
· Fiche d'arrestation : pour donner et/ou recueillir
des informations sur un ou plusieurs infligés (braconniers ou
orpailleurs) ;
· Fiche d'accrochage ou rapport d'accrochage remplie
quand il y a un contact entre les gardes de la RFO et les braconniers
armés ;
· A part ces fiches, il y a des matériels pour la
collection des données utiles tels que le GPS, Boussole, ...
Ø Marquer, enregistrer ou classer les saisies ou les
résultats des patrouilles.
Ø Dresser les statistiques des saisies selon les
secteurs d'opérations
Ø Rédiger le rapport de l'état de
surveillance de la RFO.
Ø Monter les cartes selon les besoins.
Ø Conduire les sections de formation LEM.
CHAPITRE TROISIEME
CONSERVATION COMMUNAUTAIRE
La Conservation Communautaire est un concept qui veut que la
gestion, l'élaboration des stratégies et la mise en oeuvre du
plan de gestion des ressources naturelles du pays se fassent avec l'implication
des communautés locales qui en sont les premiers conservateurs et
bénéficiaires.
En RDC et particulièrement dans la RFO, l'Unité
de Conservation Communautaire est née des conflits élastiques
existant entre les communautés locales et les gestionnaires des Aires
Protégées telles que la RFO. Les causes majeures de ces
mésententes étant liées à l'accès
réduit voire limité des CLs aux ressources naturelles
(Réglementation), l'occupation anarchique des terres suite aux
mouvements migratoires, ...
Ainsi, il y a plusieurs axes d'activités qui se
réalisent dans le but d'impliquer les communautés locales dans la
conservation et de créer un climat de confiance entre la RFO et les CLs
pour leur participation à l'utilisation durable des ressources
naturelles dont elles peuvent directement ou indirectement tirer profit et
à relever leur niveau de vie.
II.3.1. L'EDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
Etant donné que l'homme est au centre de la
conservation de la nature et est en même temps la principale cause des
menaces pesant sur cette dernière, il s'avère utile de le former,
l'informer et l'éduquer en matière de la gestion de
l'environnement.
C'est dans cette optique que, pour véhiculer le message
et l'instruction « Protecteur de la nature »,
l'activité d'éducation environnementale a été
initiée au sein de la RFO dans le but de : promouvoir l'utilisation
rationnelle et durable des ressources naturelles du paysage Ituri - Epulu - Aru
(Landscape), sensibiliser la population vivant dans et autour de la
Réserve sur le bien fondé de la conservation de la nature
et de promouvoir l'écotourisme au sein de la RFO.
Activités
réalisées au sein du programme d'éducation
environnementale sont :
Ø La sensibilisation : les
Educateurs descendent dans des villages se situant dans et autour de la RFO
pour informer les différentes couches de la population et leur
transmettre les messages relatifs à la gestion de la RFO en particulier
et les Aires Protégées de la RDC en général. Les
méthodologies d'approche sont : des réunions dans des
villages, des conférences scolaires et académiques, des
émissions des radios diffuses généralement en swahili et
lingala sur les antennes des radios périphériques de la
Réserve ; Des projections audiovisuelles des films sur la
conservation de la nature.
Ø Production des matériels
didactiques : le PEE conçoit des images sur des endroits
publics (monuments, photos, calendriers,...) pouvant transmettre le message sur
la conservation de la nature en attirant la curiosité de la
population.
Ø Développement communautaire :
le programme regroupe les mamans en association pour les encadrer par
des activités telles que le jardinage, tricotage, foyer social, .... A
part cela, le programme a aussi le rôle d'aménager des sources
d'eau potable.
II.3.2. LE SYSTEME DU ZONAGE
II.3.2.1. Définition et
objectifs
Le zonage appelé aussi Plan d'utilisation des terres
dans le paysage forestier Ituri - Epulu - Aru (Landscape), c'est un
système pour délimiter la Réserve en différentes
zones à usages multiples des communautés locales. On
délimite les zones en trois parties dont il y a la zone agricole, zone
de chasse et la zone de conservation intégrale.
Le zonage de la RFO et son implantation participative ont
commencé proprement dit depuis l'an 2000 dans le but de : Concilier
les besoins de la conservation avec la continuation à
perpétuité des activités humaines de subsistance ;
Gérer l'utilisation des ressources naturelles d'une manière
participative, rationnelle et durable ; Découper la RFO en
différentes zones à usages multiples avec la participation des
CLs, leurs chefs et l'administration publique.
II.3.2.2. Les étapes du
zonage
Les activités (étapes)
réalisées lors d'une délimitation de zone agricole
sont :
v La sensibilisation :
Plusieurs réunions et discussions se passent entre les
techniciens de la WCS/RFO et les communautés locales après les
contacts avec les autorités locales. Les techniciens essayent
d'expliquer aux CLs l'importance du zonage et les faire comprendre les
objectifs du zonage. Ces discussions et réunions sont
sanctionnées par de document juridique comme le procès verbal,
etc.
v La prospection et la cartographie
informatisée :
Après avoir signé le protocole d'accord, les
techniciens de la WCS descendent sur terrain pour délimiter les zones
ensemble avec les CLs. Lors de cette prospection, ils prélèvent
des données géographiques du terrain qui seront
informatisées pour donner une cartographie complète.
v Présentation des
résultats :
Les résultats de la prospection sont
présentés au Comité de Coordination du Site (CoCoSi) et
aux différentes couches des CLs. C'est eux qui vont approuver si les
résultats sont appréciables ou non. Si non, les étapes
précédentes sont à reprendre et si oui, on passe à
une autre étape.
v Matérialisation :
Après la prospection et présentation des
résultats, directement on passe à l'étape de jalonnement
qui consiste à mettre les limites artificielles là où il
n'y a pas des limites naturelles (rivière, montagne), on procède
par l'ouverture d'un couloir ou layon de plus ou moins de trois mètres
pour les limites artificielles. En guise de matérialisation physique,
les bornes et les panneaux de petit format sont fixés à chaque
intervalle de 250 m sur les couloirs (jalons) préalablement ouverts.
v Validation et gestion
Ici, il y a maintenant l'exécution par la signature de
procès verbal du bornage et divers protocoles d'accords à tous
les niveaux : local, provincial et national. L'ICCN/RFO et les CLs signent
un acte d'engagement mutuel au respect des limites de la zone en titre d'un
procès verbal de pose borne. Ainsi, les autorités locales
ensemble avec la RFO interpelleront les CLs à la gestion participative
de cet engagement pour la protection de la biodiversité de la
Réserve de Faune à Okapis.
Ainsi, voici dans la carte
de la RFO les zones délimitées :

II.3.2.3. Avantages du zonage
Quelques avantages du zonage sont : Droits d'usage des
terres domanialisées ; Renforcement du pouvoir coutumier ;
Renforcement des pratiques ancestrales de convention ; Gestion
participative de la Réserve par les CLs et l'ICCN/RFO ; Gestion
durable des ressources par une réglementation claire à
l'intention de tous les partenaires (ICCN et CLs) ; Sédentarisation
des populations bantoues et pygmées ; Elaboration d'un guide de
gestion de zones de subsistance avec les CLs ; Encadrement des CLs
à travers leurs initiatives de développement (associations,
groupements agricoles, coopératives, ...) ; Elaboration d'une
stratégie nationale commune de conservation communautaire.
II.3.3. LES ACTIVITES
AGRICOLES
Les activités agricoles au sein de la RFO sont
supervisées par le projet Livelihood dans la RFO.
Livelihood ou Activités Economiques
Alternatives Durables est mis sur pied depuis septembre 2009, dont
l'objectif principal est de limiter la déforestation tout en augmentant
le niveau de vie des communautés vivant dans et vers les
périphéries de la Réserve. Cependant, dans la RFO les
interventions qu'apporte le projet ciblent 4 couches de communautés
à savoir :
Ø Des associations qui seront
bénéficiaires des micros subventions (Small ground) ;
Ø De groupe de mamans qui seront encadrées
à travers les activités suivantes :
l'alphabétisation, l'épargne, la micro finance et la micro
entreprise ;
Ø Des ménages agricoles bantous et/ou
ménages multiplicateurs qui bénéficieront des intrants
agricoles et d'appuis techniques ;
Ø Des ménages pygmées qui ont comme
activité secondaire de l'agriculture. 10(*)
Avec le concourt du programme WCS dans son projet Livelihood,
l'activité agricole mène quelques autres activités pour la
survie des CLs qui sont : L'appui des ménages en intrants agricoles
des ménages agricoles tels que la manchette, lime, houe et les
semences ; Le suivi et l'encadrement technique des ménages
bénéficiaires et/ou ménages multiplicateurs ;
L'installation des champs de multiplication semencière.
II.3.3.1. Stratégies
d'interventions dans les ménages agricoles bantous
La vision du projet Livelihood est d'augmenter le niveau de
vie des communautés locales. Pour y arriver, le projet Livelihood
procède par des principes ci-après :
v Identification des ménages
bénéficiaires : La WCS/RFO organise les
recensements des ménages agricoles, ce qui donne une idée sur le
nombre précis de ménages.
v Réunions de sensibilisation :
Ici la RFO présente l'objectif du projet Livelihood, son but ou
sa mission et ses activités aux agriculteurs en vue de les amener
à comprendre le projet.
v Sélection des ménages :
On sélectionne les deux ménages : les ménages
agricoles ciblés comme bénéficiaires d'appui et
d'encadrement et les ménages multiplicateurs.
v Appui en intrants agricoles : La
WCS/Livelihood apporte aux agriculteurs des outils aratoires et des semences
améliorées pour une bonne production.
v Suivi et encadrement technique et formation :
Pour arriver à cette bonne production agricole, la WCS fait de
suivi et il y a de formation d'encadrement technique à l'intention des
bénéficiaires.
v Production et rendement :
L'efficacité des pratiques agricoles vulgarisées
s'apprécie par rapport aux résultats mesurables, obtenus par
référence aux objectifs préalablement définis et
aussi par l'évaluation de l'adoption des techniques agricoles
vulgarisées. En réalisant les interventions agricoles, le projet
Livelihood vise un but principal, celui d'augmenter la production agricole
paysanne.
v Séchage, vannage, conditionnement et
stockage : Pendant la récolte, des séances de
sensibilisation précédant le séchage, vannage pour
envisager la répartition des productions à des faits
différents. Une partie sera conservée pour
constituer une banque de semences à utiliser pendant la saison
prochaine ; Une deuxième partie sera
destinée à l'alimentation familiale ; la
dernière devra être stockée pour la vente.
v Transformation et commercialisation :
Il est parfois difficile de vendre une production brute, d'où
la nécessité de la transformation. Ici, la transformation est
locale, c'est-à-dire qu'elle se fait au moyen des engins agricoles
paysans : des moulins pour le moulage des cosettes de manioc et des
graines de maïs, des décortiqueuses d'arachide, ...
En vue de permettre la commercialisation des produits
transformés, il est pensé susciter dans le chef des CLs des
initiatives de regroupement des agriculteurs en paysannat agricole pour la
commercialisation des produits agricoles. Ceci peut inciter l'accroissement de
la production agricole d'où l'amélioration des conditions de vie
des ménages agriculteurs.
II.3.3.2. Stratégies de
gestion de champs de multiplication
L'objectif principal d'installation de champs de
multiplication est de vulgariser les variétés
améliorées du manioc dans la RFO, susceptibles d'augmenter la
production agricole. C'est dans ce cadre que le projet prévoit 15 champs
de multiplication en vue de multiplier et diffuser les boutures de manioc
amélioré auprès des ménages agriculteurs non
atteint pendant la distribution. Ainsi, pour arriver à un bon rendement,
plusieurs stratégies sont mises en marche entre autre :
Ø Installation, suivi et entretien des champs
de multiplication : pour raison de visibilité, les champs
de multiplication doivent être placés à des endroits
stratégiques (non loin de la route principale et approximité des
sentiers qui mènent vers les blocs agricoles). Comme pour les
ménages bénéficiaires, des suivis sont organisés
par les agronomes en vue de prendre certaines informations. Pour assurer en bon
état les cultures et maximiser la production, les travaux d'entretien
à exécuter comprennent le sarclo-buttage, le défrichage de
champ.
Ø Gardiennage des champs de
multiplication : étant donné qu'il existe un grand
nombre d'animaux dans la Réserve, et pour protéger les champs
contre les animaux sauvages ravageurs et d'autres formes d'attaque (vol par les
pygmées), on préconise le gardiennage des champs contre des
attaques diurnes. Pour lutter contre les attaques nocturnes et les
fréquences d'arrivée des animaux, WCS/RFO sollicite auprès
de l'ICCN/RFO les refoulements de ces animaux par les gardes.
Ø Récolte des champs de
multiplication : ici, le projet vise la multiplication des
boutures. Le projet a pensé à rentabiliser la production
tubéreuse à deux niveaux :
· Distribuer une partie de la récolte aux
CLs : en vue de vulgariser aux agriculteurs la production et
l'appétibilité des maniocs introduits, une partie de la
production est distribuée aux CLs.
· Vulgariser les communautés en technique
de transformation de manioc en farine : les techniques à
vulgariser comprennent le rouissage, l'épluchage, lavage,
séchage, conditionnement, moulage, stockage, puis la transformation et
enfin, la commercialisation.
II.3.3.3. Stratégies
d'encadrement des ménages multiplicateurs
Pour les ménages multiplicateurs, la philosophie est
presque la même que celle des champs de multiplication mais, certaines
particularités seront proposées :
v Les multiplicateurs bénéficient d'une
motivation financière pour leur permettre de bien avancer dans
l'exécution des travaux ;
v Les productions semencières sont rachetées par
la WCS à un prix dérisoire ou abordable, pour la distribution aux
autres ménages du village ;
v Lors des passassions de marché entre le
multiplicateur et la WCS, la WCS soustrait les frais avancés pour de
divers travaux. Cet acte est sanctionné par la signature d'un protocole
de collaboration entre la WCS/RFO et le multiplicateur.
II.3.3.4. Suivi et
évaluation
Au terme de son exécution, le projet est
évalué sur base de son but principal qui est la réduction
de la pauvreté des ménages encadrés qui, visiblement se
manifeste par l'augmentation des revenus des ménages.
L'évaluation est donc basée sur la comparaison entre la liste des
biens et services nécessaires pour la survie des communautés
avant les interventions et celle des biens et services après les
interventions.
II.3.4. LA PRATIQUE
D'AGROFORESTERIE
L'agroforesterie peut être définie comme un
ensemble de techniques d'aménagement des terres impliquant la
combinaison d'arbres soit avec les cultures, soit avec l'élevage, soit
même avec les deux. Cette combinaison peut être simultanée
ou échelonnée dans le temps et dans l'espace. C'est un
système stable écologiquement sain qui fait toujours appel
à des méthodes compatibles avec les pratiques sociales et
culturelles de la population locale.
La RFO est une AP habitée. Parmi les principales
contraintes actuelles à la réalisation de ses objectifs,
l'exploitation agricole non rationnelle est une menace sérieuse.
L'agriculture itinérante sur brûlis pratiquée dans et
autour de la RFO est un grand facteur de destruction de la Réserve. En
effet, plus de 80 % de la population vivant dans et vers les
périphéries de la Réserve vit uniquement de l'agriculture.
Pour pallier à cette contrainte, un encadrement et une éducation
des agriculteurs avec les techniques appropriées de gestion durable de
la forêt s'avèrent indispensables. Une des techniques
appliquées par la RFO est l'agroforesterie ou les jachères
améliorantes.
Les buts principaux de la pratique d'agroforesterie sont la
rentabilisation des jachères et la sédentarisation des
populations pour limiter le taux de déforestation dû aux
activités agricoles non propices, ainsi qu'offrir les techniques
culturales soutenables et compatibles avec la conservation de la nature.
L'optimisation de la production par unité de surface tout en respectant
le principe du rendement soutenu et le reboisement des espèces
à usages multiples sont ainsi les objectifs assignés par le
programme d'agroforesterie.
II.3.4.1. Méthode
utilisée par le Programme d'Agroforesterie
Pour parvenir à ces objectifs, la méthodologie
utilisée par le programme est la suivante :
Ø Installation des pépinières
communautaires d'arbres à différents usages dans les principales
localités dans et autour de la Réserve ;
Ø Expérimentation avec les agriculteurs de
l'adaptation des espèces légumineuses ligneuses en association
avec les cultures vivrières dans les jachères ;
Ø Vulgarisation des techniques agricoles
appropriées aux agriculteurs pour promouvoir leur production ;
Ø Distribution des intrants agricoles (houes,
machettes, semences, ...) comme accompagnement aux techniques agricoles.
II.3.4.2. Les espèces
utilisées dans le Programme
Pour choisir une espèce parmi les légumineuses,
on doit considérer les critères fondamentaux suivants :
· L'espèce doit s'adapter au milieu
local ;
· Elle doit répondre aux pratiques
culturales ;
· Elle doit pouvoir partager les ressources avec les
cultures intercalaires ;
· Elle doit entretenir et améliorer le sol.
Le Programme d'Agroforesterie utilise quelques espèces
des légumineuses aidant comme fertilisant du sol pour une
rentabilité. Il s'agit de : Leucaena leucocephal, Leucaena
diversifolia et Calliandra calothyrsus. A part la fertilisation des sols,
le Programme a initié un autre volet dénommé la
domestication des arbres forestiers. Cette domestication consiste
à faire sortir certaines espèces d'arbres utiles de l'état
sauvage pour les adapter à la culture au champ. Les espèces
suivantes sont représentées en pépinière et seront
distribuées aux agriculteurs : Cola acuminata, Garcinia cola,
Pipper guinensis, Dacryodes edulis, ...
Ainsi dit et expliqué, nous étions descendus sur
terrain pour visiter de parcelles de démonstration et
témoin ; enfin, nous avions visité aussi un Champ
Communautaire du Groupe des Amis d'Agroforesterie (GAA) à BAPUKELI, 6 km
du Centre Epulu.
CHAPITRE QUATRIEME
RECHERCHE ET MONITORING
II.4.1. RECHERCHE BOTANIQUE
En collaboration avec les institutions, universités et
centres de recherche congolais, belges ou autres, des recherches sont
menées dans la RFO en vue d'améliorer les connaissances sur la
dynamique de la flore et de la faune, d'apporter des informations et de
recommandations utiles pour la gestion de la Réserve ; de renforcer les
capacités de jeunes scientifiques congolais. Le personnel de l'ICCN est
impliqué dans les travaux sur le terrain.
La recherche botanique a commencé les activités
dans la Réserve de Faune à Okapis depuis 1986 dans le but
principal de mener des recherches à long terme pouvant permettre
d'orienter les gestionnaires dans la conservation du Site (RFO/ICCN). Plusieurs
activités de recherche botanique sont réalisées au sein de
la RFO dont : Activité des gestions des infrastructures des
recherches (Arboretum et Herbarium) ; Etude de la phénologie ;
Etude météorologique ; Etude de la dynamique
forestière.
II.4.1.1. L'HERBARIUM
C'est un laboratoire botanique ou un local où on
entrepose des spécimens végétaux d'un milieu connu.
0. Activités de l'Herbarium
Ø Enrichissement de l'Herbarium en collection
botanique ;
Ø Assainissement ou entretien de la
collection ;
Ø Informatisation de l'Herbarium, c'est-à-dire
mettre les données des collections reçues dans
l'ordinateur ;
Ø Echange des collections avec les Herbaria du
monde ;
Ø Identification des collections.
1. Collection des spécimens
Les spécimens récoltés sont
étiquetés et les informations y relatives sont au
préalable écrites dans un carnet de terrain. Ces informations
aident lors de la mise sous presse dans le remplissage de fiche de collection.
Les matériels utilisés lors du pressage de collections sont les
suivants : la presse pour couvrir toutes les collections de part et
d'autre, le carton, les papiers buvards, les lames métalliques, les
papiers journaux et la sangle pour presser ou comprimer les collections.
2. Exemples de quelques collections
Les 10 collections MULUBA KATEMBO
Préféré sont venues des plantes de la forêt primaire
monodominante à Gilbertiodendron dewevrei à Kasenya.
|
N° Coll.
|
Nom vernaculaire
|
Nom scientifique
|
Famille
|
Usage
|
|
01.
|
Mbau
|
Gilbertiodendron dewevrei
|
Caesalpiniaceae
|
Bois d'oeuvre
|
|
02.
|
Eyako/ Checheche
|
Cassia manii
|
Caesalpiniaceae
|
Bois d'oeuvre
|
|
03.
|
Emule ou Eta
|
Greenwayodendron suaveolens
|
Annonaceae
|
Bois d'oeuvre
|
|
04.
|
Kpama
|
Klainedoxa gabonensis
|
Irvingiaceae
|
Bois d'oeuvre
|
|
05.
|
Lianga/ Mwenge
|
Beilschmiedia manii
|
Lauraceae
|
Bois d'oeuvre et alimentation des okapis
|
|
06.
|
Mane/ Gbeletu
|
Pausinystalia macroceras
|
Rubiaceae
|
alimentation des okapis
|
|
07.
|
Ngango
|
Pancovia harmsiana
|
Sapindaceae
|
Bois d'oeuvre
|
|
08.
|
Lipasa
|
Garcinia epunctata
|
Clusiaceae
|
alimentation des okapis
|
|
09.
|
Kumukumu
|
Bacteria phistylosa
|
Passifloraceae
|
Bois
|
|
10.
|
Sopa
|
Atiaris toxicaria
|
Moraceae
|
alimentation des okapis
|
II.4.1.2. LA PHENOLOGIE
La phénologie est l'étude de cycle
végétatif des espèces végétales. Durant ce
cycle de vie, on observe les feuilles, les fruits, s'ils sont tombés par
terre ou sont sur l'arbre. En corollaire avec les données
météorologiques, la phénologie montre les effets ou
impacts des changements climatiques sur la végétation.
Il existe plusieurs facteurs favorisant les changements
climatiques et peuvent être une menace pour la végétation.
Ces facteurs sont : le feu de brousse, le vent, l'inondation, la
concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère.
Dans la RFO par son programme WCS, ces études
phénologiques ont commencé à l'année 1991. Pendant
les périodes de la floraison, la
feuillaison, la chute
des feuilles, etc., il est déjà identifié à la
Réserve 90 traits susceptibles dus aux changements climatiques qui sont
regroupés en 5 traits :
- Habitat spécialisé ;
- Exigence des microclimats ;
- Tolérance environnementale étroite ;
- Interruption environnementale mettant en danger les
espèces ;
- Interaction spécifique entre les espèces.
Tableau : Fiche de
prélèvement des données phénologiques
|
FORET DE LENDA
|
|
|
|
|
komea :
|
mayani ya kukomea
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mpya :
|
mayani teke teke
|
|
|
DATE
|
|
|
|
|
|
maua :
|
maua
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mbegu :
|
mbegu
|
|
|
EQUIPE
|
|
|
|
|
|
changa :
|
mbegu changa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
komea :
|
mbegu ilyokomea
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUU YA MITI
|
|
CHINI YA MITI
|
|
|
|
KIBILA
|
|
komea
|
mpya
|
maua
|
mbegu
|
|
maua
|
changa
|
komea
|
notes
|
Noms scientifiques
|
|
(1)
|
Kokolo
|
1
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
mort
|
Blighia welwitchii
|
|
2
|
Tembu
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Cynometra alexandrii
|
|
517
|
Matela
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Uapaca guineesis
|
|
518
|
Songo
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Ricinodendron heudelotii
|
|
519
|
Songo
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Ricinodendron heudelotii
|
|
3
|
Sange G
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Xylopia aethiopica
|
|
465
|
Kangba
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Parinari excelsa
|
|
(46)
|
Songo
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Ricinodendron heudelotii
|
|
457
|
Ebute
|
8
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Irvingia robur
|
|
467
|
Songo-
|
9
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
Ricinodendron heudelotii
|
|
468
|
Chene
|
9
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
0
|
2
|
0
|
|
Ficus mocuso
|
|
469
|
Eko
|
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
|
2
|
0
|
0
|
|
Julbernardia seretii
|
|
470
|
Njingi
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Parinari excelsa
|
|
4
|
Songo +
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Ricinodendron heudelotii
|
|
(43)
|
Songo
|
5
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
Ricinodendron heudelotii
|
|
436
|
Eko
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Julbernardia seretii
|
|
437
|
Njingi
|
2
|
2
|
2
|
0
|
2
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Parinari excelsa
|
|
5
|
Mbeli
|
6
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Canarium schweinfurthii
|
|
(6)
|
Mawela
|
1
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
mort
|
Ficus exasperata
|
|
(7)
|
Songo -
|
2
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
mort
|
Ricinodendron heudelotii
|
|
(8)
|
Kene
|
1
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
Celtis adolfi-friderici
|
|
9
|
Tembu
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Cynometra alexandrii
|
|
10
|
Njingi
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Parinari excelsa
|
II.4.1.3. LA METEOROLOGIE
La météorologie fait partie des sciences
naturelles physiques ; c'est l'étude, dans le sens le plus large du
terme, de l'atmosphère terrestre : composition,
phénomènes nombreux et complexes qui s'y déroulent,
phénomènes d'interactions entre l'atmosphère et la surface
terrestre, lois régissant divers phénomènes.
Les études météorologiques ont
été amorcées à la RFO à 1986 par le
programme WCS dans trois stations à savoir : la station palais
d'Epulu, Afarama et la station Lenda dans les terrains d'étude.11(*) A la RFO, on
prélève deux données météorologiques :
la température et la pluviométrie. Ces deux données se
mesurent respectivement par un thermomètre enregistreur et un
pluviomètre. La récolte des données se fait sur une fiche
une fois par jour et à une heure précise (à 7 heures 30
minutes).
1. Météorologie du
prélèvement des données
Ø Température : deux
températures sont prises chaque jour : le maximum quotidien
(généralement atteint pendant l'après midi), et le minimum
quotidien (généralement atteint pendant la nuit). Un
thermomètre particulier appelé Thermomètre Enregistreur
est utilisé afin d'obtenir toutes ces informations. Il est
constitué de deux thermomètres liés entre eux dont l'un
enregistre la plus haute température atteinte depuis la dernière
lecture, et l'autre la plus basse. La lecture est faite en degré Celsius
(° C).
Ø Pluviométrie : la
quantité de pluie tombée en 24 heures est récoltée
dans l'appareil pluviométrique placé en pleine aire, au sein de
la station. Les données quotidiennes récoltées sont
additionnées pour constituer la pluviométrie mensuelle.
Diagramme de variation
mensuelle moyenne de température à Epulu/station
palais
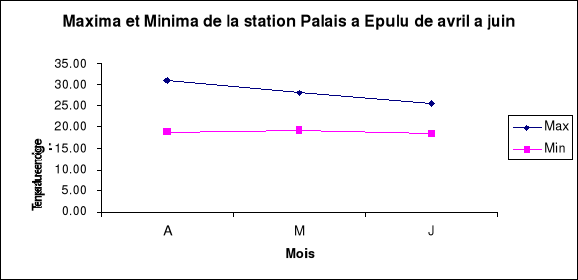
La plus grande valeur a été enregistrée
en avril 2010 soit 30,97°C pour les maxima et a dimuniée progressivement
jusqu'à juin. La valeur de minima est presque identique (sans beaucoup
de variation durant les deux mois du trimestre soit 18,40 (juin) à
19.19°C (mai).
2. Importance de la météo pour la
RFO
La météo influence fortement la période
de floraison, de fructification et de renouvellement des feuilles. Elle peut
aussi affecter les quantités de fruits et de fleurs produites ainsi que
le nombre des plantules qui survivent, facteurs qui déterminent la
disponibilité en nourriture des animaux, donc leur production et leur
mortalité, leurs migrations et leurs déplacements. A une
échelle plus petite, la météo change la distribution
locale des animaux, car ils cherchent à s'abriter du vent, de la pluie
ou du soleil.12(*)
Les données météo sont très
importantes car elles peuvent aider les chercheurs à interpréter
les données de l'abondance, de distribution, de reproduction, de
mortalité et de comportement des animaux et des végétaux.
Elles sont également d'une importance capitale pour les agronomes car le
calendrier agricole d'un milieu déterminé est fonction des
données météo. De plus, on pense que les changements
climatiques sont plus importants aujourd'hui que pendant les derniers
10 000 années.13(*)
C'est ainsi que la RFO/WCS par son Centre de Formation et de
Recherche en Conservation Forestière (CEFRECOF) a amorcé depuis
1986 pour la station palais d'Epulu et 1991 pour les deux terrains
d'études (Afarma et Lenda), le travail de la récolte des
données météo qui se poursuit jusqu'aujourd'hui.
II.4.1.4. LA DYNAMIQUE
FORESTIERE
L'objectif de la dynamique forestière est de
connaître la composition, la structure et la dynamique de la
forêt ; elle permet d'évaluer les puits carbones.
1. Méthodologie pour le placeau de 40 hectares
dans la RFO/Epulu
La première tache des travaux du placeau de 40 ha est
celle d'arpentage. Les autres taches suivront au fur et à mesure que la
première avancera. Après la délimitation des placettes de
20 x 20 m, chacune d'elles sera ensuite subdivisée en 16 carrés
de 5 x 5 m. L'objectif poursuivi dans cette étude est d'inventorier
toutes les plantes ligneuses érigées de diamètre
supérieur ou égal à 10 cm et toutes les lianes de
diamètre supérieur ou égal à 20 cm, assigner
à chacune d'elles une étiquette permanente pourvue d'un
numéro, mesurer son diamètre, cartographier sa position dans la
placette, et aussi assurer son identification complète.
La délimitation des sous placettes ou carrés,
l'étiquetage, la cartographie et la mensuration seront assurés
par des équipes formées de 8 personnes dont un chef
d'équipe qui s'occupera particulièrement de la prise des notes,
un étiqueteur, deux cartographes, un mensurateur, un aide cartographe et
trois techniciens chargés de la détermination préliminaire
des espèces et disposant d'une connaissance profonde de la flore locale.
Ces derniers s'occuperont aussi du transport, de la collection des
échantillons à grande hauteur et du marquage des points de
mesure. Pour nous, notre étude de la dynamique forestière a
été faite sur une seule placette de 20 x 20 m.
2. Matériels utilisés
Chaque équipe de travail aura besoin d'un bureau
portatif, d'un mètre-diamètre, d'au moins sept mètres
rubans, d'un marteau, de pièces de fil à nylon, d'un pieds
à coulisse, de deux crayons, de fiches de terrain et de papier
spécial pour les cartes. Une tige en bois de 1,3 m sera utilisée
pour indiquer le point de mesure de DBH en anglais ou DHP en français
qui est le Diamètre à Hauteur de Poitrine.
Outre ce matériel permanent, des étiquettes en
aluminium numérotées en séries, seront utilisées
pour l'identification de chaque individu. Ces étiquettes seront
fixées aux arbres de petite taille au moyen des morceaux de fil à
nylon tressé de préférence, préalablement
coupés de 0,5 m et introduits dans les trous des étiquettes.
D'autres étiquettes en aluminium très souples, marquées
« A », « B », « C » servira pour distinguer les
tiges multiples ou les ramifications ayant une différence
inférieure à 5 cm de diamètre. Pour les arbres de
diamètre supérieur ou égal à 50 cm, les
étiquettes seront fixées par des clous en aluminium. Des
échelles pourront être nécessaires pour la mensuration au
dessus des contreforts ou des racines échasses. Des morceaux de fil
à nylon seront utilisés pour le transport des étiquettes
portant des numéros consécutifs, de la peinture blanche et une
brosse (à dents) seront utilisées pour marquer les points de
mensuration sur chaque tige, surtout sur les lianes, les étrangleurs et
les grands arbres.
C'est ainsi que nous avons réalisé une
étude de la dynamique forestière ayant une et une seule placette
de 20 x 20 m dont le grand résultat se retrouve en annexe. Voici en
quelques sortes les diagrammes des histogrammes (arbres et sous arbres
abondants de cette placette) :
Les espèces
Abondantes de la Canopée

Nous avons inventoriés 180 espèces (arbres et
sous arbres) dans cette aire d'étude. Dont nous avons trouvé 6
espèces les plus abondantes qui sont Gilbertiodendron dewevrei
avec 34 espèces, Pancovia harmsiana avec 9
espèces, Cola sciaphila avec 5 epèces, Staudtia
gabonsensis avec 4 espèces, Mammea africana avec 4
espèces et Rinorea afzelii avec 3 espèces. Soit 32,8 %
de l'ensemble de l'échantillonnage.
Parmi les espèces du sous bois, nous avons
identifiés 3 les plus abondantes dont nous avons Alornea
floribunda qui a 53 espèces, Scaphopetalum dewevrei avec 9
espèces et Cola congolensis avec 4 espèces. Soit 36,7
%.


A ce qui concerne la répartition spatiale des
espèces, nous voyons que ces espèces retrouvées dans cette
aire d'étude sont groupées en agrégat, pour dire qu'il y a
des surfaces vides dans la placette, c'est-à-dire il y a des
allées. Donc, ces espèces se sont reparties inégalement
dans l'espace.
II.4.2. MONITORING
Par définition du mot MONITORING, C'est
l'opération qui consiste à suivre méticuleusement le
fonctionnement d'un système, d'un processus en temps réel. C'est
ainsi qu'il y a des suivis qui se font pour une bonne protection et
conservation de la Réserve à travers les différents
comités.
II.4.2.1. Le Comité Local
de Suivi pour la Conservation des
Ressources Naturelles
(CLSCRN)
Le CLSCRN a été créé dans la RFO
afin d'harmoniser les relations entre l'ICCN/RFO et les communautés
environnantes. C'est une structure qui joue le rôle d'un pont entre la
RFO et les CLs pour instaurer un climat de confiance indispensable entre ces
deux parties prenantes dans la meilleure gestion des ressources naturelles.
Cette structure assure l'implication effective des CLs dans la conservation des
ressources naturelles et atténue les conflits autour des ressources
naturelles en créant une attitude positive des CLs vis-à-vis de
la Réserve.
Le rôle du CLSCRN, d'une manière
générale, est d'assurer le lien entre l'ICCN et les CLs. Et d'une
manière spécifique, il a comme tâche :
Ø Redynamiser le dialogue dans le cadre de la
sensibilisation sur le bien fondé de la conservation des ressources
naturelles de la Réserve ;
Ø Inciter la population à l'autopromotion
villageoise ;
Ø Identifier les besoins des CLs selon le cas et le
milieu à exécuter avec l'appui de l'ICCN et autres
partenaires ;
Ø Contraindre les membres du CLSCRN et la population
à ne pas se livrer aux activités illégales.
II.4.2.2. Le Contrôle de Séjour et
de Passage (CSP)
Le CSP dans la RFO est une mesure d'accompagnement au zonage
afin de réduire les conflits entre les autochtones et les
immigrés sur la gestion voire l'utilisation des terres, le partage du
pouvoir et par l'occasion gérer le problème de la surexploitation
des ressources naturelles dans la RFO. Le but de cette activité est de
réglementer l'accès aux ressources naturelles et au séjour
dans la Réserve.
Cette activité se réalise en étroite
collaboration avec les entités administratives en place, il y a
installation des postes d'enregistrement pour la livraison des documents de
contrôle (jeton de passage), gratuitement délivrés à
toute personne franchissant la RFO.
Afin de renforcer ce contrôle au niveau local, des
Comités de Contrôle de Séjour et de Passage (CCSP) qui
veillent sur le séjour et l'accès aux ressources naturelles ont
été installés dans quelques villages. Ceux-ci
délivrent le Permis de Séjour Temporaire aux visiteurs et les
cartes des résidents aux autochtones figurant dans le répertoire
des habitants concernés. Ces deux spécimens d'immigration sont
délivrés moyennant une somme d'argent. Ce frais contribue aux
actions de développement communautaire de chaque entité
concernée et vise plus les interventions au niveau social (école,
centres de santé et sport). C'est une approche participative
basée sur la promotion des activités de la conservation, de
développement et celles génératrices de revenus dans le
souci de contribuer à l'amélioration de conditions de vie de la
communauté locale.
Actuellement, il existe quatre postes de CSP, à savoir
Zunguluka, Epulu, Molokay et Adusa tandis qu'il y a cinq sites où
fonctionnent les comités de CSP: Bandisende (entre Zunguluka et Epulu),
Epulu, Molokay, Badengaido et Ekwe (entre Mambasa et Nduye).
Les membres du comité font le recouvrement des
visiteurs en leur faisant payer un permis de séjour temporaire dont la
durée n'excède jamais 180 jours soit six mois. Ils vendent des
cartes des résidents aux personnes ayant été
recensées et répertoriées lors de recensement comme
habitant de la RFO.
CHAPITRE CINQUIEME
LE TOURISME A LA RFO
II.5.1. HISTORIQUE DU TOURISME A
LA RFO
L'Okapi, animal phare de la RFO, a été
découvert par un certain Harry Johnston Hamitton en 1901, comme un
animal endémique de la RDC. Le tourisme dans la RFO a commencé
depuis bien longtemps avec les explorateurs venant capturer les okapis dans le
but de les expédier tous. Le tourisme proprement dit a été
lancé par Monsieur David en 1954 qui s'installa à Epulu et puis
s'est mis à construire l'hôtel touristique.
De 1964 à 1967, il y a eu la destruction massive de
toutes les infrastructures touristiques de la station par la rébellion
de Mulele. En 1968, la station d'Epulu a été prise en charge par
l'Etat Congolais et gérée par l'Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature comme étant toujours un zoo. En 1985, la
Société Zoologique de New-York (SOZONY) s'installa pour
démarrer et mener les activités des recherches scientifiques pour
la conservation. En 1987, l'installation du projet Animals In Motion (AIM)
avait pour but de remettre en état les infrastructures touristiques et
la capture des okapis.
Depuis l'implantation d'AIM à Epulu, le projet est
devenu aujourd'hui Gilman International Conservation (GIC) qui a pour but de
contribuer à la sauvegarde de la faune et flore de la RFO et soutenir
l'ICCN à la gestion de la Réserve. Pour atteindre son but, le
projet GIC, partenaire de l'ICCN, a pour objectifs spécifiques de
promouvoir l'écotourisme et l'éducation environnementale, tout en
mettant en place les infrastructures touristiques appropriées.
Après une certaine période de plus au moins dix
ans de guerre qui a déchiré la RDC, il n'y avait plus
d'activités touristiques dans la RFO. C'est à partir d'ici 2009 -
2010 que le tourisme a repris ses activités dans la Réserve par
les touristes tant internationaux que nationaux. Le tourisme étant un
fait de voyager pour son plaisir ou loisir, la RFO dispose d'une structure
d'accueil des touristes. Elle regorge d'une biodiversité riche en faune
et flore.
II.5.2. INFRASTRUCTURE
TOURISTIQUE
L'accès à la RFO se fait par la Route Nationale
No 4, Kisangani - Bunia. La station d'Epulu est située
à 460 km de Kisangani et d'environ 240 km de Bunia. Une autre
possibilité d'accès à la Réserve, est la voie
aérienne : un aérodrome de l'ICCN est disponible et bien
entretenu. La station d'Epulu possède comme infrastructure : un
bâtiment administratif, un centre d'Accueil, un gite avec toilette et
douche internes, deux bungalows, quatre paillotes, un camping vaste et
verdoyant d'une capacité d'accueil de plus ou moins 100 personnes et une
toilette moderne externe.
II.5.3. ATTRACTION TOURISTIQUE
Les attraits de la RFO sont :
Ø okapis (Animal phare de la Réserve) au zoo et
autres animaux (Singe, Perroquet gris, Eléphants, ...) en forêt.
Ø Présence des pygmées dans leur milieu
naturel
Ø Chasse traditionnelle au filet sélectif par
les Mbuti.
Ø Présence des chauves-souris au Mont M'bia.
Ø Vision panoramique des forêts à partir
du Mont M'bia.
Ø Végétation des rochers (Inselbergs) au
Mont Sida et au Mont M'bia.
Ø Chute au confluent des rivières Ituri et Epulu
qui arrose la Réserve.
Ø Observation des différentes espèces
d'oiseaux.
Ø Possibilité du camping libre à
coté de la rivière Epulu ; etc.
II.5.4. ORGANISATION
Les visites dans la Réserve sont toujours
guidées par les Eco-guides ou les gardes de parc. Pour participer au
fonctionnement de la RFO, un tarif est en vigueur selon le loisir :
Participation à la chasse traditionnelle ; Visite des okapis au
zoo ; Nuit à la belle étoile au campement des pygmées
en assistant aux danses et rites traditionnels ; Visite des salines et
promenade dans la paisible forêt.
Les visites sont disponibles tous les jours du lundi au
dimanche suivant un programme convenu entre le visiteur et le
délégué aux visites. La restauration est à la
charge du visiteur qui doit s'approvisionner soit au départ ou soit au
Centre Commercial d'Epulu. En effet, l'ICCN n'organise pas un service de
restauration à la station.
II.5.5. LOGEMENT
Bungalows : avec un lit double, le prix revient de 30
à 35 $ par nuit.
Gite : avec lit double, 30 à 35 $ par nuit ;
avec lit simple, 20 à 25 $ par nuit.
Camping : sans tente, 15 $ par nuit ; avec votre
propre tente : 10 $ par nuit.
Ainsi, la tente est individuelle. Le paiement s'effectue au
Centre d'Accueil suivant une grille de tarification fixée par la
Direction Générale de l'ICCN.
CONCLUSION
En guise de conclusion, nous voici au terme de notre stage de
professionnalisation effectué à la Réserve de Faune
à Okapis à EPULU pendant une période allant de 13
septembre au 17 octobre 2010. Notre présent rapport de stage
était constitué de deux grandes parties, hormis l'introduction et
cette conclusion, dont la première a parlé des
généralités sur la Réserve de Faune à
Okapis, c'est-à-dire comment est son fonctionnement. La seconde nous
relate le déroulement du stage. Elle nous donne un aperçu
général sur les activités que nous avions parcourus au
sein de la RFO, entre autre la protection de la Réserve, la conservation
communautaire, les activités de recherche et monitoring, et enfin le
tourisme durable.
Ainsi, nous pouvons affirmer en 90 % d'atteindre nos objectifs
assignés et préétablis au début de ce
présent rapport. Pour arriver à atteindre ces objectifs
préétablis, nous avions utilisé les méthodes ou
techniques de documentation à la bibliothèque de la WCS pour la
rédaction du stage surtout la partie de généralités
sur la RFO ; d'interview ou entretien suivi des questions explicatives
pour s'informer du fonctionnement de la RFO/ICCN et ses partenaires (WCS et
GIC) ; d'observation participante aux activités organisées
au sein de deux partenaires de la RFO, ainsi que des visites sur
terrain.
La RFO est une structure organisée du gouvernement
congolais. Elle s'efforce à réaliser le maximum de protection
à travers ses stratégies (politiques de gestion) et moyens pour
arriver à une bonne et/ou meilleure protection et conservation des
ressources naturelles malgré les difficultés qu'elle est entrain
de traverser sans appui du gouvernement central.
RECOMMANDATIONS et/ou
SUGGESTIONS
Il est vrai que dans toutes les organisations ou institutions
publiques ou privées, il ne manque jamais des points positifs et
négatifs, forts et faibles marchant toujours ensemble,
c'est-à-dire deux à deux. Dans cette même optique,
après les observations et constats faits durant notre stage à la
Réserve de Faune à Okapis, quelques recommandations et/ou
suggestions s'avèrent importantes pour une bonne organisation et un bon
fonctionnement de l'ICCN/RFO et ses partenaires (WCS et GIC) d'un
côté et de l'Université Shalom de Bunia d'autre
côté. Ainsi, nous recommandons et/ou suggérons ce qui
suit :
v AU GOUVERNEMENT
Ø Mettre des moyens disponibles et nécessaires
pour une bonne protection et/ou conservation de cette Réserve qui est la
RFO, la seule aire protégée habitée de la RDC ;
Ø Stabiliser la Réserve du point de vue
sécuritaire ; parce que là où il y a la guerre les
choses ne marchent pas toujours bien ; etc.
v A l'ICCN/RFO
Ø Bien vouloir encore instaurer le système de
contrôle de séjour et surtout de passage des véhicules
comme il se faisait dans les années écoulées pour
éviter le braconnage ;
Ø Ensemble avec le GIC, faire la promotion de
l'écotourisme comme ce fut dans le passé, c'est-à-dire
mettre en valeur les sites touristiques abandonnés de la Réserve
entre autre le Mont M'bia et le Mont Sida, donc construire les hôtels
touristiques et aménager ces sites ;
Ø Selon le constat, augmenter le nombre des gardes pour
la bonne surveillance de la Réserve car cette dernière est
très menacée par les braconniers à mains armées et
le nombre des gardes est limité par rapport à la superficie de la
Réserve.
v A la WCS
Ø Echanger régulièrement des
correspondances avec les institutions supérieures et universitaires qui
envoient ses étudiants au Centre de Formation et de Recherche en
Conservation Forestière pour qu'il y ait plus d'harmonie afin d'aider
ces étudiants à participer aux différentes
activités du terrain afin d'atteindre son objectif principal de
concilier la théorie apprise à la pratique sur terrain. Faute de
quoi, il n'y aura pas cette conciliation de matière et de la vie
professionnelle.
v Au GIC
Ø Pousser fort avec le système d'agroforesterie,
car c'est une bonne technique culturale afin de limiter la déforestation
dans la Réserve ; donc élargir le champ d'action afin
d'adapter ce système même aux paysans de la savane telle que Ituri
en général et Bunia en particulier ;
Ø Munir le programme d'éducation
environnementale en moyens financiers suffisants pour la promotion de la
conservation de la nature en général et la gestion rationnelle et
durable de la RFO en particulier, d'autant plus que la prise de conscience de
la population est un processus à long terme et ce programme demande
beaucoup de moyens pour atteindre ses objectifs.
A l'USB
Ø Bien vouloir signer un partenariat avec l'ICCN afin
d'avoir une très bonne coopération et un bon encadrement de la
part des étudiants au sein de la RFO ;
Ø Avoir un protocole de recherche pour bien orienter
les étudiants stagiaires dans leurs recherches de stage ;
Ø Etre à tout moment en contact avec les
autorités de l'ICCN/RFO et ses partenaires pour connaitre à quand
ils ont les activités sur terrain afin de ne pas envoyer les
étudiants faire encore la théorie que de la pratique ;
Ø La prise en charge des étudiants au stage
où nous suggérons d'annexer un petit montant pour le stage aux
frais académiques ;
Ø Equiper l'institution avec des matériels du
terrain tels que le GPS, la boussole, l'ordinateur, les tentes, les instruments
en rapport avec le terrain,...
BIBLIOGRAPHIE
1. Abedi Selemani Asani, Rapport de stage : implication
des communautés locales dans la gestion de la chasse de subsistance dans
la Réserve de Faune à Okapis, promotion 2006 - 2008.
2. Arrêté Ministériel N° 045/CM/ECNT/92 du
02 mai 1992 portant sur la création et délimitation d'une
Réserve dénommée « Réserve de Faune
à Okapis ».
3. Arufu Masimango Mass, Rapport de stage effectué
dans al Réserve de Faune à Okapis du 21 janvier au 21
février 2009.
4. Charles Doumenge, La Conservation des
Ecosystèmes Forestiers, UICN 1980.
5. FAO, Conflits et gestion des Ressources
Naturelles, 2001.
6. Floribert Bujo et Batido D., Synthèse
météorologique de précipitation et température de
la Station Palais d'Epulu de 1986 à 2007, WCS/ VB 2009.
7. Hart, Makana et al., Guide météorologique
pour le placeau de 40 hectares de la RFO, mars 2000.
8. M'monga Kiete Jean Paul et Mahmudi Ali Tambwe, Rapport
de stage effectué à la Réserve de Faune à
Okapis du 15 avril au 15 juin 2009.
9. Ndinga Assitou, Les ectomésodermes de
forêts denses et humides d'Afrique Centrale, Brazzaville, du 28 au
30 mai 1996.
10. Ongendangenda Lombe E.F., Rapport de stage à la
RFO : Relevés phytosociologiques dans une forêt de
transition à Gilbertiodendron dewevrei et à Julbernardia
seretii, mai 1991.
11. Raymond Paluku et al., le Zonage :
Mécanisme de gestion des terres dans la RFO, Découpage des
zones à usages multiples dans la RFO élaboré par
l'ICCN/RFO, mai 2006.
12. Richard Tsombe, Ligne directrices de gestion pour la
Réserve de Faune à Okapis, WWF 1995.
13. Stenphenson, R. Tyler, La Cogestion des ressources
naturelles : réduire la pauvreté par l'apprentissage
local, Paris 2006.
14. White Lee et Ann Edwards, Conservation en forêt
pluviale africaine, éd. Multipresse-Gabon, 2001.
TABLE DE MATIERE
REMERCIEMENTS ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. ... ...
... .. ... ... ... ... ... ... ... .... . i
ABREVIATIONS ET SIGLES .. ... ... ... ... ... .. ... ... .. . ...
... ... .. .... ... ... ... ... ... iii
0. INTRODUCTION ...... ....... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ..... .. ... ... ... ... ... ... ... 1
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LA RESERVE DE
FAUNE A OKAPIS/
EPULU .... .... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... .... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 3
I.1. CADRE JURIDIQUE DE LA RFO ......... ... ... ... ......
... ... ... ... ...... ... ... ...... 3
I.2. LOCALISATION DE LA RFO ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 3
I.3. CLIMAT ... ... ... ... ... .. .. . .. ... ... ... . ..
... .. .. .. .... ... ... ... .. .. .... ... ... ... ... 3
I.4. BIODIVERSITE ... .. .. ..... .... ... ... .. .. ...
... .. .. ... ...... .. ... ... .. .. ..... .... .... ... 4
I.5. OBJECTIFS DE LA RFO .. .... .. .. .. ... ..... ....
... .. .. .... .... ..... .. ... ...... .... ...... 5
I.6. FONCTIONNEMENT DE LA RFO ... .. .. .. .. .. ..... ....
... ... ... ... .... ...... ..... .... 5
1.6.1. Wildlife Conservation Society (WCS) .. ... .. ..
..... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 6
I.6.2. Gilman International Conservation (GIC) ... ... ...
... ... ... ... ... ... .... .... ...... ... 6
I.7. APPROCHE DE GESTION DE LA RFO ... ... ... ... ... ...
.... ... ... ... ... ... ... ... ..6
DEUXIEME PARTIE : DEROULEMENT DE STAGE
...... ... .. ... ... ... .... ..... .... 7
CHAPITRE PREMIER : ADMINISTRATION DE L'ICCN/RFO...
... ... ... ... ... .. .. ..... 8
II.1.1. CADRE JURIDIQUE ... .... .... .... ... ... .. ...
... ... .... .... ... ... ... ... ... .. ...... 8
II.1.2. MISSION ET OBJECTIF DE L'ICCN ... ... ... ... ...
... . . ... ... ... ... ... .. .. .. ... 8
II.1.3. ORGANISATION DE L'ICCN ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 8
II.1.4. LA STRUCTURE DE LA
RFO...................................... ... ... .... ... .... ... . 9
II.1.5. LES PERSONNELS OU CADRES ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ......9
CHAPITRE DEUXIEME : LA PROTECTION DE LA RFO ...
... ... .. ......... ...... 10
II.2.1. Application de l'Ordonnance loi et
Arrêté Ministériel par la RFO ... ...... ... ... ... 10
II.2.2. La Surveillance et la patrouille ... ... ... ...
... ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ......11
II.2.2.1. Techniques de surveillance ... .. ... ... ... ..
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... . 11
II.2.2.2. Les attributions du LEM ... ... ... ... .... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... .. .. 12
CHAPITRE TROISIEME : CONSERVATION COMMUNAUTAIRE
... ......... .... 13
II.3.1. L'EDUCATION ENVIRONNEMENTALE ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... .... ... . 13
II.3.2. LE SYSTEME DU ZONAGE ... ... ... .. .. .. ... ...
... ... .... .... ... ... ... ... ... ...14
II.3.3. LES ACTIVITES AGRICOLES ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... .... 16
II.3.4. LA PRATIQUE D'AGROFORESTERIE ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ..... 19
CHAPITRE QUATRIEME : RECHERCHE ET MONITORING ...
.. ... ... ... ... ... 21
II.4.1. RECHERCHE BOTANIQUE ... ... ... ... .... ..... ...
... .. .. ... ... ... ... ... ... .... 21
II.4.1.1. L'HERBARIUM ... ... ... ... ... ... .. ... ...
... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. 21
II.4.1.2. LA PHENOLOGIE ... ... .. ... ... .... ... .. ..
.... ... ... ... ... .. ... .. .. .. .. ... .. .. . 22
II.4.1.3. LA METEOROLOGIE ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ..... 24
II.4.1.4. LA DYNAMIQUE FORESTIERE ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... .... ... 26
II.4.2. MONITORING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... .. ... .... ... ... ... ... ... ... 28
II.4.2.1. Le Comité Local de Suivi pour la
Conservation des Ressources
Naturelles (CLSCRN) ... .. ... ... ... ... ... . ... .. .. ...
... ... ... ... .... ... .... .... 29
II.4.2.2. Le Contrôle de Séjour et de Passage (CSP)
.. .... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .... 29
CHAPITRE CINQUIEME : LE TOURISME A LA RFO ......
... ... ...... ... ... ... ... 31
II.5.1. HISTORIQUE DU TOURISME A LA RFO ...... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...... 31
II.5.2. INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... .... 31
II.5.3. ATTRACTION TOURISTIQUE ... .... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
II.5.4. ORGANISATION ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...
... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. .. 32
II.5.5. LOGEMENT .... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ...
... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
CONCLUSION ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
RECOMMANDATIONS et/ou SUGGESTIONS ... ... ...
... ... ... .. ... ... ... ... ... ...34
BIBLIOGRAPHIE ... ... ... ... . ...... ... . .. ... ...
... .... ... .. .. .. .. ... ... ... .... ... .... 36
ANNEXES
* 1 Walter, 1973 cité par
Ongendangenda, 1991.
* 2 Hart, 1985.
* 3 Hart, Ibidem
* 4 White, 1983
* 5 Rapport UNESCO, 2006
* 6 Grubb, 1982 cité par
Ongendangenda, 1991.
* 7 Jonathan Kingdon, 2006
* 8 Hart et al., 1986
* 9 Groombridge, 1993
* 10 WCS/RFO, Rapport 2009.
* 11 Bujo F. et Batido D.,
2009.
* 12 White L. et Edwards A.,
2001.
* 13 Hoghton et al., 1990 in
White et Edwards, 2001.
| 


