|
RAPPORT DE LICENCE
DEDICACES
Nous dédions ce travail à nos parents, pour leur
soutient et les sacrifices qu'ils ne cessent de faire montre dans le but de
nous assurer un avenir sans embuches.
Que ce travail soit le fruit de notre profonde gratitude.
REMERCIEMENTS
Les rédacteurs du présent rapport tiennent
à remercier vivement tous les dirigeants du département de
Géographie, pour nous avoir ouvert un environnement propice à
notre épanouissement académique, ainsi que leur soutient moral.
Il s'agit notamment du Dr. IYA Moussa (Doyen de la FALSH) ; Dr. J.P NDAME
(vice-Doyen chargé de la programmation) ; Pr. M. TCHOTSOUA (chef du
département de géographie). Notre gratitude s'adresse aussi
à tous nos enseignants qui, tout au long de notre parcours
académique, nous ont enrichis intellectuellement et psychologiquement.
Il s'agit notamment de : Dr. NGONE, Dr. LOULEO J., Dr. WAKPONOU A., Dr.
BITA Charles Alain (de la Faculté des Sciences Economiques et des
Gestions).
Nous n'oserons oublier notre encadreur et enseignant, M.
BRILTEY BAKULAY, pour l'efficacité et la constance du soutien qu'il a
apporté au fonctionnement de ce groupe.
Les rédacteurs remercient collectivement l'ensemble des
participants actifs et assidus de la population du quartier Burkina, en
soulignant la richesse tant des apports issus du maire de la commune de
Ngaoundéré Ier, du délégué de la
CAMTEL, que des amis et frères.
RESUME
Le quartier Burkina est l'un des quartiers de la ville de
Ngaoundéré animé par une population composite de part leur
appartenance ethnique, et de leurs différentes classes sociales.
Cependant, depuis le début des années 70, un besoin en
infrastructures urbaines se fait de plus en plus sentir dans l'ensemble des
quartiers de la ville de Ngaoundéré et dans les quartiers
récents, y compris Burkina. Et l'une des principales manifestations de
ce manque est la mise en place, par la population locale, des ponts et beaucoup
d'autres infrastructures. Afin d'évaluer les différentes
infrastructures présentes et absentes dans le quartier, nous avons
procédé à des observations directes sur le terrain, et par
des enquêtes. Les observations et les enquêtes ont permis
l'identification ou l'évaluation du potentiel infrastructurel du site
d'intérêt. Le suivi des discutions et des observations ont permis
de comprendre la situation du quartier par rapport aux actions entreprises par
les services locaux et la nécessité de ces infrastructures pour
le développement du quartier. Le quartier Burkina est doté d'un
minimum d'infrastructures locales (une rue principale, abduction en eau
potable, desserte en électricité etc.). Mais l'initiative de leur
mise en place relève d'un effort de la population et des élites
locales. Cette situation est liée à sa position
géographique (relief accidenté ne favorisant pas leur mise en
place). Le rôle de l'Etat, par l'aménagement des ponts et des
voies de communication, se fait peu sentir.
Mots clefs : Burkina, Infrastructures,
Occupation anarchique, Agent, Urbanisation.
ABSTRACT
The Burkina's quater is the one of quater of Ngaoundere most
lively by a various population in case of their ethnic belongs, and their
different social classes. However, since the beginning of the year 70, a need
in urban infrastructures is getting feel nicer and nicer on the whole of
Ngaoundere quarters' and also in recent ones like Burkina. And the major impact
of this shortage is the adjustment for the local population of bridges, streets
and so one and so for. In order to assess the different infrastructures present
and absent in Burkina's quater, whe proceeded by direct observations on the
land, also by investigations. The observations and inquiries enable us to
identify or to evaluate the infrastructural potential of the interest site. The
follow-up of discussions and observations allowed us to understand the
situation of the quater in comparison to the different actions of local
services and the necessity of these infrastructures for the development of the
quater. Burkina is equipped to the minimal local infrastructures that are
requested to this type of quater (one principal street, potable water
adduction, electricity). But, the initiative of their adjustment, in the while
quater, relief to an effort of the population and local elites. This situation
is bounded to his graphic position (uneven relief which doesn't favorise their
adjustment) and the other immoral acts of his population. The role of State, by
the fitting out of bridges and communication highways is getting more.
Key words: Burkina,
Infrastructures, Anarchyc occupation, Agent, Urbanization.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AES-SONEL: American Electricity Society-Société
Nationale d'électricité.
CAMTEL: Cameroon Telecommunication
CAMWATER: Cameroon Water (Camerounaise Des Eaux, C.D.E).
FALSH: Faculté des Arts, Lettres et Sciences
Humaines.
FME : Fonds Monétaire Européen.
HYSACAM : Hygiène et Salubrité du
Cameroun.
ENSAI : Ecole Universitaire des Sciences
Agro-industriels.
RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais.
SNEC : Société Nationale des Eaux du
Cameroun.
UNDP : Union Nationale pour la Démocratie et le
Progrès.
SOMMAIRE
|
INTRODUCTION....................................................................................
|
1
|
|
PROBLEMATIQUE.................................................................................
|
1
|
|
QUESTIONS DE
RECHERCHES.................................................................
|
2
|
|
CONTEXTE
SCIENTIFIQUE......................................................................
|
2
|
|
OBJECTIF
PRINCIPAL.............................................................................
|
4
|
|
OBJECTIFS SPECIFIQUES OU
SECONDAIRES.............................................
|
4
|
|
HYPOTHESES.......................................................................................
|
5
|
|
PREMIERE
PARTIE..............................................................................
|
6
|
|
Rapport de
terrain.....................................................................................
|
7
|
|
Méthodologie..........................................................................................
|
9
|
|
DEUXIEME
PARTIE..............................................................................
|
11
|
|
CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DU
MILIEU.................................
|
12
|
|
I-LE MILIEU
PHYSIQUE..........................................................................
|
12
|
|
1-Relief, sol et hydrographie
........................................................................
|
12
|
|
2-Climat et
végétation................................................................................
|
13
|
|
II-LE MILIEU
HUMAIN...........................................................................
|
13
|
|
1-La population : présentation
générale............................................................
|
13
|
|
2-Présentation de
l'habitat...........................................................................
|
15
|
|
CHAPITRE II : ANALYSE ET ETAT DES LIEUX DES
INFRASTRUCTURES URBAINES DANS LE QUARTIER
BURKINA-FASSO......................................
|
17
|
|
I-PRESENTATION GENERALE DES INFRASTRUCTURES URBAINES DU
QUARTIER............................................................................................
|
17
|
|
1-Historique et
identification........................................................................
|
17
|
|
1.1-Identification......................................................................................
|
17
|
|
1.2-Historique..........................................................................................
|
17
|
|
2-Procédures de mise en
place......................................................................
|
18
|
|
2.1-Les acteurs
impliqués............................................................................
|
19
|
|
2.2-Mise en place des
infrastructures ;.............................................................
|
20
|
|
II-INFRASTRUCTURES URBAINES ET ADAPTATION AUX MODES DE VIE DE
LA
POPULATION...................................................................................
|
22
|
|
1-Possibilités d'accès aux
infrastructures.........................................................
|
22
|
|
2-Importances..........................................................................................
|
24
|
|
3-Place des infrastructures face aux
besoins......................................................
|
25
|
|
CHAPITRE III : FACTEURS LIMITANT ET CONSEQUENCES
SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU
QUARTIER.............................................
|
26
|
|
I-LES FACTEURS
LIMITANT....................................................................
|
26
|
|
1-Un relief
accidenté.................................................................................
|
26
|
|
2-Les critères financiers, logistiques et
politiques ;...............................................
|
26
|
|
3-La pression
démographique........................................................................
|
27
|
|
II-LES
CONSEQUENCES..........................................................................
|
28
|
|
1-Effet de la pression démographique sur les
infrastructures....................................
|
28
|
|
2-Dégradation du
milieu..............................................................................
|
28
|
|
CONCLUSION.......................................................................................
|
30
|
|
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................
|
31
|
|
LEXIQUE.............................................................................................
|
33
|
|
ANNEXE................................................................................................
|
35
|
LISTE DES PHOTOGRAPHIES
|
Photo 1 : prolifération du petit commerce à
Burkina...........................................
|
|
|
Photo 2 : Disposition anarchique des
maisons................................................
|
|
|
Photo 3 : Habitats situés sur une zone à
risque..................................................
|
|
|
Photos 4-5 : Résurgence des blocs de rochers le
long des voies de communication.......
|
|
|
Photo 6 : câbles électriques et
téléphonique.....................................................
|
|
|
Photo 7 : compteurs
d'eau.........................................................................
|
|
|
Photo 8 : point de vente d'eau
potable............................................................
|
|
|
Photo 9 : Erosion
hydrique........................................................................
|
|
|
Photo 10 : Rigole mal
aménagée..................................................................
|
|
LISTE DES TABLEAUX
|
TABLEAU 1 : Catégories
socioprofessionnelles................................................
|
|
|
TABLEAU 2 : Principales sources de ravitaillement en eau
potable..........................
|
|
|
TABLEAU 3 : Principales sources de ravitaillement en
électricité............................
|
|
INTRODUCTION GENERALE
Les effets de la croissance démographique,
couronnée par la pression constante sur les espaces constituent de nos
jours un débat hautement source de polémiques sur la scène
internationale. ASCHER F1(*). Soutient ce point de vue lorsqu'il explore les
tendances actuelles liées à la concentration des hommes au sein
des grandes métropoles. En effet, les impératifs de
développement économique des pays du sud sont le plus souvent
freinés par l'évolution incontrôlée de ce
phénomène. Ainsi, dans une perspective de gestion, de
contrôle et d'aménagement des espaces urbains, l'on se retrouve le
plus souvent confronté à une série de contraintes dont
l'issue dans certains cas demeure presque incertaine. De ce fait,
l'accès aux infrastructures urbaines dans certains quartiers dits
périphériques, caractérisés par une extension
incontrôlée demeure utopique. Dans cette perspective,
BOYER J.C2(*) démontre les liens d'interdépendances
entre le quartier dit périphérique et la ville à laquelle
celle-ci appartient. Il présente les impératifs qui se posent en
ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations au
sein du quartier ; chose peut être faite pour ce qui est du quartier
Burkina dont la situation du point de vue infrastructurel est du moins
controversée. En effet, l'aménagement d'un territoire
répond à quatre actions liées aux besoins des
hommes : exploiter ; qui détermine le lieu de
travail ; habiter : matérialisant l'habitat ;
approprier ; en rapport avec la délimitation des
territoires ; aménager, entendons par là la mise en
place des réseaux des voies de communication, des infrastructures de
base et des espaces tributaires* (R. BRUNET, 1990). Dans cette
optique, Brunet fait ressortir les interactions qui existent entre l'Homme et
le milieu qu'il s'approprie et aménage afin de satisfaire ses besoins.
Dans la même logique, la présence infrastructurelle dans ce milieu
de vie serait donc fonction de plusieurs caractéristiques relatives au
milieu physique, aux efforts conjoints des pouvoirs publics ou à une
volonté des acteurs locaux.
PROBLEMATIQUE
Bien avant l'installation des fonctionnaires
Norvégiens (1925), le site d'étude était constamment
fréquenté par les bergers et les cultivateurs. Dès lors,
le quartier s'agrandit à une ampleur échappant presque à
la vigilance des autorités. Sa situation sur le plan infrastructurel
actuel est donc un héritage acquis de son occupation rapide et
incontrôlée. Cette observation nous amène à
considérer le fait que la mise en place des infrastructures a
précédé l'installation effective de la population. De
même, notre attention majeure sera orientée vers un aspect non
négligeable relatif à l'état initial des infrastructures
dans le quartier. En d'autres termes, il nous reviendra de circonscrire
l'essentiel de notre travail autour des critères d'existence des
infrastructures urbaines dans le quartier, car le devenir de certains quartiers
périphériques est souvent fonction du nombre et du
caractère fonctionnel des équipements urbains pouvant supporter
en partie une éventuelle pression démographique. Ces
différentes analyses débouchent donc sur la question fondamentale
à s'avoir : existe-il des infrastructures urbaines dans le quartier
Burkina-Faso ? La question d'existence infrastructurelle ici serait pour
notre lieu d'étude dépendante de certains préposés
ou agents spécifiques.
QUESTIONS DE RECHERCHES
L'interrogation majeure soutenant l'ensemble de notre travail
est celle de savoir quel est le potentiel en infrastructures urbaines dans
le quartier Burkina-Faso ?
Les interrogations additives à la
précédente sont les suivantes :
Ø Quelle est leur importance et par extension
répondent-elles aux attentes de la population locale ?
Ø Par qui a été prise l'initiative
de leur installation?
Ø Comment se présente l'accessibilité
à ces infrastructures et quels en sont les éléments
influençant leur mise en place ?
Ø La population a-t-elle un impact sur
celle-ci ?
Ø Quelles conséquences entraine l'installation
de ces infrastructures ?
CONTEXTE SCIENTIFIQUE
La notion des infrastructures urbaines est une notion qui n'a
pas laissée certains chercheurs urbanistes, aménageurs, ou les
techniciens du génie civil indifférent. A cet effet, vu
l'importance du sujet, bon nombre d'entre eux, dans le cadre d'une
étude approfondie pour la prise de conscience de l'évolution du
fait urbain, ont posé les jalons de ce sujet. Ainsi, du rapport
d'activités de DOMINIQUE VOLO T., directeur
aménagement urbain de la SOGREAH groupe Artelia (2010), il ressort que
le bon fonctionnement d'une ville, et la réussite de tout projet
d'aménagement urbain, reposent sur la capacité de la
collectivité à planifier son développement, en s'appuyant
sur un ensemble d'infrastructures de qualité, modernes et
adaptées aux besoins (voies de circulation, réseaux
d'assainissement, d'eau, d'énergie et d'électricité,
infrastructures de télécommunications et de traitement de
l'information...).
La transformation des besoins, des façons de penser et
d'agir, des liens sociaux, le développement de nouvelles sciences et
technologies, le changement de nature et d'échelle des enjeux
collectifs, rendent aujourd'hui nécessaire un nouvel urbanisme.
ASCHER F. dans son ouvrage : Les nouveaux
principes de l'urbanisme. La fin des villes n'est pas à l'ordre
du jour. La Tour d'Aigues : éditions de
l'Aube, 2001, 100 p. en analyse les fondements et en définit les
principes. Il revisite ainsi les catégories qui étaient au coeur
de la conception des villes, les actualise et en propose de nouvelles. Que
faire en effet aujourd'hui de la notion de limite et comment concevoir les
espaces alors que se brouillent les distinctions entre ville et campagne, entre
public et privé, entre intérieur et extérieur. Qu'en
est-il des notions de distance, de continuité, de densité, de
diversité, de mixité, alors que les vitesses de
déplacements des biens, des informations et des personnes s'accroissent
de façon considérable ? Comment planifier dans une
société plus ouverte et dans un univers plus incertain ?
Comment décider et agir pour le bien de la collectivité dans une
société plus diversifiée et plus
individualisée ? Voilà quelques-unes des questions
auxquelles répond l'auteur dans cet essai parfois impertinent,
consacré à l'urbanisme, mais qui est aussi une analyse incisive
de la société moderne.
En outre, dans le vocabulaire géographique classique,
la "banlieue" désigne la partie d'une agglomération urbaine
extérieure aux limites administratives de la ville-centre. Mais, depuis
longtemps, le langage courant attribue à ce terme une connotation
péjorative, qui explique sans doute l'apparition d'un second sens dans
les années 1980. Désormais "les banlieues" désignent aussi
des territoires - internes ou externes à la ville-centre - qui
connaissent de graves difficultés économiques et sociales. A cet
effet, l'ouvrage de BOYER J.C. Les banlieues en France,
territoires et sociétés. Paris : Armand Colin, 2000, 206
p. explore ces deux significations, en montrant leur imbrication et en mettant
en évidence les relations du spatial et du social. Les banlieues, au
sens géographique du terme, se caractérisent par une
dépendance de la ville centre toujours présente, quoique moins
forte que dans le passé. Elles sont d'une extraordinaire
variété, même si l'on y rencontre souvent la
répétition des mêmes types de paysages mais le profil de
leurs résidents et de leurs activités est loin de toujours
confirmer l'image d'espaces déqualifiés. Il existe cependant des
quartiers paupérisés, notamment dans les grands ensembles
d'habitat social, qui constituent le témoignage le plus visible des
fractures qui traversent notre société.
Les grandes villes sont le lieu par excellence où les
hommes créent, échangent, se rencontrent. Pourtant on les rend
souvent responsables de tous nos maux. Conscient de ceci, ASCHER
F. dans son ouvrage Métapolis ou l'avenir des
villes. Paris : éditions O. Jacob, 1995, 345 p. (traduit
en portugais en 1998 : Métapolis. Acerca do futuro da cidade.
Traduçao de Alvaro Domingues, Oeiras, Portugal, Celta editora, 240 p.)
analyse la tendance actuelle à la concentration des hommes, des
activités et des richesses dans les métropoles. Est-elle
généralisée ? Quelles formes concrètes
prend-elle ? Les nouveaux modes de communication vont-ils l'enrayer ?
Ceux qui ont le choix vont-ils fuir les grandes agglomérations ou bien
rechercheront-ils toujours plus la variété, le mouvement de la
ville métropolitaine ? Comment mieux maîtriser le
développement urbain ? Quel urbanisme mettre en oeuvre ?
Le développement exponentiel des capitales africaines
est un fait d'une extrême importance en cette fin du
20ème siècle. Après avoir analysé ce
phénomène et indiqué ses principales raisons, Mme
Y. NOSNY et H. CHAUDET, dans leur travail de recherches
intitulé Médecine d'Afrique
Noire; environnement urbain en Afrique subsaharienne
et pathologie: 1992, 39p, font une synthèse de la
pathologie urbaine telle qu'on la rencontre surtout parmi les habitants des
quartiers d'habitations spontanées. En effet, cette
création spontanée des quartiers est la cause d'une desserte en
infrastructures urbaines déséquilibrées et insuffisantes,
des conditions d'hygiène précaires et d'une intégration
économique et politique souterraine au sein de la ville.
Les transports publics révèlent une mutation
profonde de la société qui affecte la vie quotidienne des
personnes, les systèmes politiques, les équilibres
écologiques. Le risque majeur est la dilution du lien social ; la
priorité : reconstruire la ville en tant qu'espace de
citoyenneté. A l'heure de la société de l'information, un
renouveau du service public s'impose. La mobilité s'affirme comme mode
de vie contemporain, l'accessibilité comme enjeu de solidarité,
le transport comme forme de régulation collective.
Révélateur de la mutation, le transport ne peut-il offrir un
champ de réflexion favorable à un débat
démocratique associant tous les acteurs concernés et impliquant
les citoyens selon des formules innovantes ? La prospective est plus utile
que jamais. Plus qu'à prévoir le futur, elle vise à
stimuler l'intelligence collective. La prospective du présent
décèle les transformations déjà à l'oeuvre
dans la société et engage des initiatives permettant de
construire son devenir. Le livre « Quand les transports
publics deviennent l'affaire de la cité. Parlons-en avec la
RATP ». La Tour d'Aigues : éditions de l'aube,
1999, 129 p.de ASCHER F., BRAUN A., DEMUTH G.,
PETRELLA R., et al. présente un exercice original de
prospective qui a réuni quatre experts et des dirigeants de la RATP. Sur
des questions de société, un dialogue s'est établi,
fondé sur la confiance et l'écoute mutuelles. Le débat est
désormais ouvert à tous ceux qui souhaitent " mieux vivre "
demain dans les villes.
En vingt ans, le territoire français a connu de
profondes modifications. Son image, sa réalité changent :
concentration des populations et des activités, grande mobilité
des hommes, différenciation des espaces ruraux,
détérioration de l'environnement, mobilisation des acteurs
locaux, ouverture européenne. L'avenir s'annonce incertain. Fruit d'une
recherche initiée par la Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale,
l'ouvrage de ASCHER F., BRAMS L., DELAMARRE A., ROCHEFORT A., et
al. Les territoires du futur. La Tour d'Aigues :
Datar/éditions de l'aube, 1993, 178 p. propose six images du futur. Il
discute leurs probabilités, leurs conséquences pour notre vie
quotidienne. Il suggère des choix stratégiques aux pouvoirs
publics. Instrument de dialogue, il stimulera la réflexion de tous. Par
ses vues d'ensemble, il veut réduire les incertitudes du futur.
OBJECTIFS
OBJECTIF PRINCIPAL
Notre travail nous emmènera à présenter
de manière succincte, non seulement les différentes
infrastructures urbaines que l'on retrouve dans le quartier Burkina, mais aussi
les agents ayant conduit à leur mise en place.
OBJECTIFS SECONDAIRES OU SPECIFIQUES
Pour atteindre cet objectif, il nous faudra :
Ø Faire une recension des infrastructures dans le site
d'intérêt ;
Ø Enoncer leur importance pour la population
locale ;
Ø Caractériser les facteurs limitant à la
mise en place desdites infrastructures
HYPOTHESES
· Le quartier Burkina, autant que tout autre quartier dit
périphérique, a un faible potentiel en ce qui concerne les
infrastructures urbaines.
· Comme partout ailleurs, les infrastructures urbaines
ont une importance capitale, et bien des fois, ne répondent pas aux
besoins de la population.
· Dans l'optique de permettre un épanouissement de
la population, la commune urbaine de Ngaoundéré Ier a
mis en place certaines infrastructures au sein des quartiers se trouvant dans
son domaine de juridiction, le quartier Burkina y compris.
· Vue les lourdeurs administratives que connaissent les
services en charge de la mise en place et du contrôle des infrastructures
urbaines, la population du quartier Burkina éprouve des
difficultés d'accessibilité à celles-ci.
· Bien que leur mise en place améliore, dans
l'ensemble, les conditions de vie des populations, celles-ci conduisent
à une dégradation du milieu.
PREMIERE PARTIE
RAPPORT DE TERRAIN
Chaque année, les étudiants de niveau III
géographie sont soumis à la rédaction intégrale
d'un rapport de licence. C'est ainsi que, pour le compte de l'année
académique 2009-2010, la promotion des étudiants de licence III
géographie ont été conviés, dans le cadre de leur
sensibilisation à la recherche, d'effectuer un stage de descente sur le
terrain afin de s'imprégner des méthodes et techniques de
recherches en géographie.
En effet, le 28/04/2010, un communiqué a
été affiché au babillard du département de
géographie (FALSH) informant les étudiants de géographie
licence III et Master 1, terrain accompagnés de tous les enseignants
dudit département, qu'une descente sur le est organisée le
01er mai 2010 à 07 heures précise au niveau du
carrefour de l'hôpital norvégien (lieu de rencontre). En outre,
tous les étudiants devraient être munis, pour l'occasion, des
chaussures de terrain, d'un bloc note et d'un appareil photo si possible.
Etant donné le manque de moyens de locomotion en
commun, chaque étudiant s'y rendait par ses propres moyens,
néanmoins, nous nous sommes retrouvé presque au complet au lieu
de rendez-vous aux environs de 07h 30min. Les enseignants quant à eux
arrivèrent au lieu de rendez-vous selon l'ordre ci-après :
Dr. Joseph Pierre NDAME (07h 15min), suivit respectivement de Mr. FOFIRI, Mr.
AOUDOU DOUA, Mme. MEDIEBOU, le Pr. Michel TCHOTSOUA et enfin Mr. BRILTEY
BAKULAY. Etant donc tous réunis, les enseignants
procédèrent à la répartition des étudiants
en fonction des niveaux d'études et aussi des spécialités.
Au bout de cette répartition, une liste de présence fut
exigée et établie par les enseignants. A la suite de ceci, le Pr.
TCHOTSOUA se mit en tête, suivit des étudiants, en direction du
site d'observation (Mt Ngaoundaï). L'itinéraire emprunté
allait de l'hôpital norvégien au quartier Jérusalem, en
passant respectivement par : le quartier Gambara II, et le quartier
Burkina-Faso.
L'observation faite tout au long de l'itinéraire
faisait apparaître une route accidentée, sinueuse, tracée
sur un versant relativement raide au fur et à mesure que l'on montait en
altitude. De plus, au fur et à mesure que l'on évoluait vers le
mont, nous remarquions que les matériaux de constructions des maisons
d'habitation ainsi que l'architecture urbaine étaient différentes
de norvégien au quartier Jérusalem.
Arrivés au site aux environs de 10 heures, le Pr.
TCHOTSOUA prit la parole et expliqua les prés requis pour une bonne
observation du terrain :
- L'observation du haut de la zone d'étude
- L'identification des zones dignes d'intérêt
afin d'obtenir un bloc diagramme de la zone (constitué de la lecture
physique du paysage et de la population).
- Une descente sur le terrain afin de confirmer ou d'infirmer
l'intérêt des zones identifiées.
De plus, le professeur nous présenta sommairement le
programme du jour constitué de trois phases :
- La présentation généralisée de
l'histoire géologique de l'Adamaoua ;
- La lecture du paysage ;
- La répartition des étudiants en fonction des
spécialités et des thématiques.
Notons que cette présentation sommaire fut soutenue par
l'intervention des encadreurs présents, ceci en fonction de leurs
domaines de compétence.
A la suite de cette répartition, chaque groupe se
dirigea vers l'enseignant susceptible de mieux l'orienter par rapport aux
différentes thématiques choisies. C'est ainsi que Mr. BRILTEY et
Mme. MEDIEBOU prenaient en charge les thèmes suivants :
ravitaillement en eau et électricité ; les activités
économiques ; les matériaux de construction et les
infrastructures urbaines dont nous en sommes les membres (04 au total). Les
différents itinéraires empruntés étaient les
suivants : les quartiers Jérusalem - Burkina-Faso - Sabongari
america - le marcher de Bantaï - les quartiers Samari - Sabongari-gare,
lieu dit école publique de Sabongari (lieu d'arrivée).
Tout au long de l'itinéraire, les encadreurs
demandaient que l'on se rapproche plus d'eux pour mieux suivre les
différentes explications en rapport aux thèmes quelconques. Au
fur et à mesure qu'on avançait, les étudiants observaient,
prenaient des photos et posaient des questions aux encadreurs par rapport
à leur thématique respective. Ce qui a emmené Mr. BRILTEY
à se renseigner sur l'état de certaines infrastructures, et
donner des informations en relation avec l'évolution du paysage urbain,
etc.
Par ailleurs, il convient de noter que le jour de la descente
sur le terrain correspondait à la fête du travail, par
conséquent, l'ensemble de la ville était en effervescence. Ce qui
distrayait de temps en temps certains étudiants et même nos
enseignants.
Parvenus au point d'arrivée (école publique de
Sabongari-gare) aux environs de 13heures, le professeur fit un bilan de tout ce
qui été fait et nous donna les dernières instructions ou
directives en relation aux différentes thématiques. A la suite
dudit bilan, il s'est avéré qu'en matière
d'infrastructures urbaines, nous avons observé que certains quartiers
périphériques sont marginalisés et ne disposent pas de
services de base (rues aménagées, hôpitaux,
approvisionnement en eau et en électricité). Enfin, il nous
souhaita bonne chance pour la suite de nos recherches et nous nous
séparons autour de 13 heures.
METHODOLOGIE
Afin de mieux aborder la thématique que nous nous
proposons de développer, un certain nombre de méthodes et
d'outils nous ont été très utiles. Notons tout d'abord
que, les données sur les infrastructures urbaines sont recueillies par
enquête. En effet, nous cherchons des informations sur la présence
et l'état des infrastructures dans le quartier, ainsi que l'adaptation
du milieu de vie de la population à l'avènement de ces
infrastructures. Pour avoir des informations relatives à ce sujet, nous
structurons notre travail en quelques points que sont :
· Le choix du site. Celui-ci n'est pas du tout
aisé, car nous risquons de nous retrouver avec un site
« fantôme » c'est-à-dire où le recueil
des informations nécessaires serait un leurre. Notre choix se porte donc
sur un quartier périphérique en pleine extension depuis sa
création (Burkina).
· L'observation sur la carte : la carte est un
élément clef pour mieux se référer par rapport
à quelque chose. Le but recherché ici est d'émettre des
suppositions et des observations préalables sur le milieu physique et
humain du site d'étude. A cet effet, il a été important
pour nous de nous rendre au département de géographie
(Université de Ngaoundéré) où malheureusement
aucune carte sur le site n'a été disponible. Néanmoins,
nous avons pu nous en procurer une sur internet, ceci avec beaucoup de
difficultés.
· La mise sur pied d'un guide de recherche :
guidés par les objectifs que nous nous sommes fixés, il nous a
été opportun de confectionner un questionnaire, afin de tirer un
maximum d'informations nécessaires à notre travail.
· La descente sur le terrain : guidés par
notre questionnaire, nous effectuons une descente sur le terrain avec pour
objectif non seulement de vivre les réalités du site, mais aussi
de toucher du doigt les différents éléments
observés sur les cartes. Pour ce faire, munis d'un appareil photo
numérique et des blocs notes, nous marchions ici et là, de
maisons en maisons, et ce tout au long de la journée, afin d'avoir des
informations de la population. Au cours de nos discutions avec les habitants du
quartier, l'attention était portée sur l'importance des
infrastructures urbaines. Les modalités de mise en place, la composition
ethnique, l'histoire de l'occupation de cet espace et les méthodes
habituelles de ravitaillement en eau et en électricité ont
été aussi discutées. Le recueil d'informations est suivi
de la prise des photos.
Les perceptions du milieu par les populations, les
déclarations sur ce qu'elles savent de leur milieu (quartier) en
matière infrastructurelle, leur propositions sont alors
enregistrées, pour être traitées avec des logiciels
appropriés (Microsoft Word, Inkscape et Excel) afin de faire des
superpositions avec les infrastructures mises en place, leur état et les
facteurs influençant leur présence dans le milieu.
Dans le but de recueillir assez d'informations, nous fixons
notre échantillon à 40 maisons, en fonction du temps dont nous
disposons.
Afin d'évaluer le degré d'importance des
infrastructures urbaines pour la population résidente du quartier
Burkina, nous avons procédé au questionnement de celle-ci.il en
est de même en ce qui concerne leurs habitude de consommation ou de
ravitaillement en eau et en électricité. Après recensement
des consommateurs, la moyenne est multipliée par le nombre de sous
traitants (non abonnés) pour avoir une idée sur le poids total
exercé par ceux-ci sur ces infrastructures. En outre, des tests d'essaye
ont été effectués dans certaines maisons dans le but
d'apprécier leur état de fonctionnement. Ailleurs, afin
d'évaluer l'état des rues, des observations ont été
faites de la base (à l'entrée du quartier) à l'exutoire
(limites du quartier avec les autres). Ceci nous a aussi permis de les
quantifier et de faire ressortir les facteurs limitant la mise en place de
certaines infrastructures de base.
Au laboratoire, la mise au point des tableaux a
respecté un certain nombre de thématiques, en fonction des
messages à véhiculer (ravitaillement en eau, en
électricité etc.). Il en est de même des illustrations
imageries. Après dépouillage et analyse des résultats,
nous commencions la rédaction de notre travail. Cette rédaction a
été guidée non seulement par nos questions de recherche,
ou encore des informations recueillies, mais aussi par des ouvrages de certains
auteurs scientifiques et enseignants ayant publiés soit dans le cadre de
la description du milieu physique, soit dans le cadre de l'analyse du
phénomène urbain et des interactions entre l'homme et le milieu
qu'il a plus ou moins domestiqué par ses activités et ses
aménagements. Pour ce faire, nous nous sommes rendu tour à
tour : à la Bibliothèque de l'ENSAI, à celle de la
FALSH et enfin à ANTHROPOS. Néanmoins, nous avons aussi pu nous
procurer certains documents, livres et revues scientifiques sur internet.
Il est à noter tout de même que de nombreux
déplacements ont été effectués dans les services
compétents en matière d'infrastructures urbaines de la
région. Il s'agit entre autre de la Camerounaise des Eaux, C.D.E,
American Electricity Society-Société Nationale
d'électricité, AES-SONEL, la Cameroon
Télécommunication, CAMTEL, la Commune de Ngaoundéré
Ier, où, dans certains cas, nous avons été
reçus par les chefs de services (CAMTEL et la Commune de
Ngaoundéré I) et d'autres par des agents.
Malgré certaines résistances de la part des
quelques uns (AES-SONEL où le délégué à
catégoriquement refusé de nous recevoir, et ce à trois
reprises) et les intempéries ou caprices de la nature (ensoleillement
élevé, pluies subites etc.) nous avons pu recueillir assez
d'informations pour la mise en oeuvre de notre travail.
DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DU MILIEU
L'espace de nos jours constitue un cadre de vie indispensable
pour les hommes et même dans le développement de leurs
activités. Ainsi, d'un point de vue général, le quartier
Burkina-Faso, localisé dans la ville de Ngaoundéré
(Adamaoua-Cameroun), se situ entre le 07°18'18,61" latitude Nord, et le
13°36'03,80" longitude Est. Il se distingue comme étant un
relativement homogène et varié de part son cadre naturel et sa
dynamique anthropique.
I-LE MILIEU PHYSIQUE
Ici, il s'analysera dans ses différentes composantes
à savoir : le relief, les sols, l'hydrographie, le climat et la
végétation.
1-Relief, sol et hydrographie*.
Doté d'un relief assez particulier, le quartier
Burkina est implanté aux pieds des Monts Ngaoundaï, plus
précisément au Nord-est de celles-ci. En effet, la
particularité de ce relief vient de la prédominance de versants
relativement raides accentuant la valeur de la pente des Monts, aussi de la
morphologie accidentée et des blocs de roches qui la constituent. De
plus, cette morphologie accidentée accélère le processus
d'érosion hydrique et rend difficile d'accès la zone.
Par ailleurs, l'ensemble du quartier est parsemé de
blocs de roches du fait de sa position géographique (proximité
des montagnes). En effet, on distingue, pour la plupart, des roches basaltiques
et granitiques qui s'altèrent progressivement du fait de
l'érosion. Une brève analyse pédologique laisse
transparaître des sols qui se composent en majorité de
latérites rouges ou brunâtres qui est le résultat de
l'érosion des montagnes due à l'alternance des saisons
sèches et humides. Aussi, ces sols sont riches en fer et en argile.
Le potentiel hydrographique de la région est faible du
fait de l'altitude. Néanmoins, il est caractérisé par un
ensemble de ruisseaux qui constituent en partie les limites naturelles du
quartier.
2-Climat et végétation.
Le climat est presque tempéré puisque cette
zone de savane arborée est située en hauteur. Les variations de
température sont plutôt importantes en saison sèche. La
saison est divisée en deux : Saison sèche et saison
pluvieuse. La saison sèche est marquée par un vent sec venant du
nord tel que l'harmattan qui se transforme en un vent sec et chaud. Quant
à la saison des pluies, elle est marquée par des pluies parfois
violentes et discontinues.
La végétation du quartier a été
considérablement affectée par l'homme. Elle était
essentiellement constituée de savane arborée. Ce pendant, le
couvert végétal s'est dégradé successivement sous
la pratique de l'élevage des Zébus et de l'agriculture. Cette
dégradation s'est accentuée suite à la pression urbaine
sur les espaces. Ces différents changements ont laissé place
à quelques zones de végétation dense
généralement aux abords des petits cours d'eaux. De plus, dans le
quartier, les espèces sauvages ont laissées peu à peu
place aux arbres fruitiers appartenant à la famille des
anacardiacées3(*), des lauracées2 et des
rutacées3.
II-LE MILIEU HUMAIN
1-La population : présentation
générale.
D'après le Djaouro Sali Bindo4, le
peuplement du quartier Burkina a débuté avec l'arrivée des
peuls et des Bororo dont l'activité était l'élevage
extensif* (élevage qui se pratique sur des vastes étendus mais
avec un faible rendement). Peu de temps après, sont venus les
cultivateurs (les Mboum) qui y pratiquaient l'agriculture et de ce fait,
repoussèrent les éleveurs au-delà des montagnes. Il est
important de noter que jusque là, aucune maison d'habitation
n'était construite dans cet espace. L'influence de la présence
des fonctionnaires dans la zone amena les cultivateurs à se rapprocher
de leurs zones de culture. Ainsi, les effets de la croissance
démographique et des phénomènes migratoires sont venus
accentuer la croissance urbaine dans la zone confinant de ce fait les
activités agricoles dans de petits espaces, voire en dehors du quartier.
En 1925, la Mission Protestante Norvégienne, encore
présente de nos jours, s'installe au sud de la ville et l'hôpital
qu'elle y crée entraîne l'installation de nouveaux quartiers.
C'est ainsi que naissent de nouveaux quartiers périphériques
parmi lesquels : Gadamabanga, Mideng, Burkina, Bamenyanga et Venez-Voir au
sein duquel s'installent les Foulbé, les Haoussa, les Mbororo, les
Bédéké, les Perré, les Dii, les Vouté, les
Bamiléké, les Bamoun, les Moundang ainsi que les ressortissants
de la République Centrafricaine et du Tchad. (M.TCHOTSOUA, J.P NDAME
WAKPONOU A. & J. BONVALLOT. 1999).
Par ailleurs, le quartier Studio4(*) est l'un des secteurs de la
ville de Ngaoundéré regroupant un grand nombre d'ethnies (environ
onze) lui attribuant ainsi un caractère social homogène. Par
conséquent, cette diversité ethnique est l'un des facteurs ayant
conduit à la mise en place de sept bureaux de vote dans le quartier.
L'activité dominante dans le quartier demeure celle du petit commerce
(étalage devant les maisons, sur les bordures des rues, petites
boutiques...), faisant ainsi office de la prédominance
d'activités du secteur informel* (cf. photo 1).

Photo 1 : le petit commerce prolifère
à Burkina. (Cliché BELINGA M. 22/05/2010).
Par ailleurs, certaines activités telles que
l'agriculture, le petit élevage (poules, moutons, chèvres...) se
font ressentir. Concernant l'aspect socioprofessionnel*, il s'agit d'un groupe
composite et constitué entre autre de fonctionnaires, de
commerçants, d'agriculteurs et de quelques chômeurs. Une analyse
sur un échantillon de 40 personnes laisse transparaître le
tableau1 ci-dessous.
TABLEAU 1 : les catégories
socioprofessionnelles
|
Activités
|
Nombre de personnes
|
Pourcentage %
|
|
Agriculteurs
|
05
|
12.5
|
|
Commerçants
|
23
|
57.5
|
|
Fonctionnaires
|
05
|
17.5
|
|
Chômeurs
|
07
|
12.5
|
|
Total
|
40
|
100
|
Sources : enquêtes de terrain,
21/05/2010.
Le tableau ci-dessus fait ressortir un pourcentage assez
élevé en ce qui concerne le nombre de commerçants (57.5%),
contrairement au chiffre relatif des agriculteurs et des fonctionnaires
(successivement 12.5% et 17.5%). En outre, la présence des
fonctionnaires de l'Etat peut s'expliquer à travers l'accès
relativement moins cher aux terrains de construction à cause de la
position géographique du quartier5(*).
2-Présentation de l'habitat.
L'observation de l'ensemble du quartier fait distinguer une
occupation anarchique de l'espace, vu la disposition des maisons d'habitation
(cf. photo 2). Aussi, cet habitat est-il dense le long de la voie principale et
des petites ramifications (groupé le long des rues et dispersé un
peu plus en arrière). De plus, le type d'habitat se caractérise
d'une part par des maisons construites avec des matériaux modernes
définitifs, et d'autre part des maisons de fortune (avec des
matériaux de construction semi définitifs ou de
récupération) généralement situées dans des
zones à risque ou à l'intérieur du quartier (cf. photo
3).
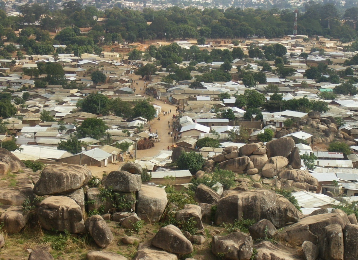
Photo 2 : les maisons sont disposées de
manière anarchique. (Cliché pris par Atangana B.H; 01/05/2010)

Photo 3 : Des maisons de fortune situées
sur une zone non oedificandi. (Cliché Atangana B.
01/05/2010).
CHAPITRE II : ANALYSE ET ETAT DES LIEUX DES
INFRASTRUCTURES URBAINES DANS LE QUARTIER BURKINA.
I-PRESENTATION GENERALE DES INFRASTRUCTURES URBAINES DU
QUARTIER.
Pour une meilleure appréhension de ce thème, il
nous reviendra tout d'abord d'insister respectivement sur l'historique, la
recension ainsi que des modalités de mise en place des infrastructures
urbaines de notre lieu d'étude.
1-Identification et historique.
1.1-Identification.
Burkina-Faso, comme tout autre quartier
périphérique, doit disposer en son sein d'un minimum
d'infrastructures et d'équipements de base. C'est ainsi que nous pouvons
identifier, après observation, des infrastructures urbaines relatives
respectivement au réseau électrique (poteaux de câbles
électriques, transformateur, compteurs...) présents dans la
presque totalité du quartier ; celles relatives à la
distribution d'eau potable (tuyaux, compteurs) ; celles relatives à
la desserte* (rues, ruelles, canalisations d'eaux usées ou de
ruissellement6(*), ponts) et
enfin celles relatives aux télécommunications (poteaux et
câbles).
1.2-Historique.
L'avènement des infrastructures urbaines dans le
quartier studio n'est pas ancien. En effet, la mise en place de
l'électricité s'est faite dans les années 1997 du fait de
la campagne présidentielle. Celles-ci ont été
renforcées lors de la campagne de 2004. (Djaouro Bindo S). C'est donc
dire que la présence de l'électricité est essentiellement
due à des enjeux politiques.
En ce qui concerne les ponts, ceux-ci ont été
mis en place sous l'initiative de la population locale car le besoin
d'être relié à d'autres quartiers de la ville se faisait
ressentir. C'est beaucoup plus tard que ces ponts ont été
améliorés par cette même population avec le concours du
maire de l'ancienne commune urbaine de Ngaoundéré. En outre, la
desserte quant à elle, a succédée à l'installation
des populations du fait d'un manque de plan de lotissement7(*) préalablement
établis. Par ailleurs, il s'agit d'une infrastructure récemment
pensée par les populations et les services publics (commune de
Ngaoundéré Ier) dans le but de résoudre les
problèmes liés au déplacement quotidien des Hommes et des
biens. Elles apparaissent donc, pour la plupart (rues) comme des tracés
sinueux, enclavés à cause de la présence des blocs rocheux
(cf. photos 4 et 5) et ne respectant pas les règles prévues par
la loi régissant l'urbanisme* et l'aménagement* du territoire au
Cameroun8(*).


Photos 4-5 : les deux images présentent la
résurgence des blocs de rochers sur les voies de circulation.
(Cliché Atangana B. 21/05/2010).
2-Procédures de mise en place.
Afin de mieux présenter les différentes
procédures de mise en place des infrastructures urbaines au sein d'un
quartier, il est convenable de définir les acteurs impliqués
d'une part et les méthodes de mise en place.
2.1-Les acteurs* impliqués.
Pour une meilleure coordination des différentes
actions visant l'amélioration des conditions de vie, il serait essentiel
de considérer l'intervention d'entités publiques
spécialisées dans la distribution des services à la
population. Nous nous intéresserons plus précisément aux
différentes actions menées par les sociétés telles
que AES-SONEL ; la Camerounaise des Eaux ; CAMTEL ; la
Communauté Urbaine sans oublier l'apport incontournable de la population
locale dans l'implantation des infrastructures urbaines au sein du quartier
Burkina.
De prime à bord, le premier acteur en charge de
l'installation infrastructurelle dans le quartier Burkina est AES-SONEL. En
effet, il s'agit ici d'une société tout récemment
privatisée9(*) par
l'Etat camerounais. Son objectif de base ici demeure la distribution et
l'entretien du patrimoine électrique de l'ensemble de l'Etat et de ce
fait, se fixe pour objectif majeur l'électrification intégrale du
pays. Ainsi, pour ce qui est du quartier Burkina, les travaux d'infrastructures
électriques débutèrent dans les années 1997 sous
l'impulsion du parti au pouvoir (RDPC). Mais, de nos jours,
l'électrification du quartier n'est pas effective.
La Camerounaise des Eaux (CAMWATER), autre fois
appelée SNEC, est aussi une société privatisée* par
l'Etat camerounais. Elle se fixe pour objectif la desserte en eaux courantes et
potables à tous les citoyens résidents sur le territoire
camerounais. C'est un objectif relativement difficile à atteindre par
celle-ci au vue de plusieurs problèmes rencontrés (milieu
physique inadéquat ; conditions d'abonnement
onéreuses ; revenus de la population faible etc.) comme nous le
démontre l'état des travaux dans le quartier.
Les exigences de la mondialisation ont conduit à une
nécessité de communiquer et de s'informer. C'est pour cette
raison que l'Etat camerounais s'est doté en son sein d'une institution
de télécommunication nommée CAMTEL. La dite
société, créee par un décret présidentiel le
08 Septembre 1998, s'affiche ici comme une société visant la
facilitation de la communication à personnes à moindre coût
et favorise l'accès des citoyens aux différents moyens de
communication. De plus, cette société touche une bonne partie des
camerounais et les résidents du quartier Burkina ne sont pas en reste,
malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans ladite
zone. (NGONO Jean François)10(*)
En ce qui concerne la communication audio-visuelle par
câbles, les habitants du quartier studio ne sont pas lésés.
En effet, c'est dans les années 2001 que le premier distributeur c'est
installé et a ravitaillé presque tous ceux qui disposaient d'un
poste téléviseur récepteur dans le quartier. La croissance
démographique entraîna la mise en place, en 2009, d'un
deuxième opérateur.
L'acteur à ne pas omettre de citer parmi ceux
précédemment évoqués, et qui constitue le moteur de
la mise en place des infrastructures dans la zone est la communauté
locale (environ 10.000 Hts11(*)). En effet, sa contribution dans la
réalisation des projets infrastructurels n'est pas la moindre. De ce
fait, il serait notable de préciser leur quasi participation dans la
réalisation des projets de mise en place d'infrastructures.
2.2-Mise en place des infrastructures.
Comme nous l'avons signalé plus haut, la mise en place
des infrastructures électriques s'est faite en 1997. En effet les
difficultés d'accès du fait d'un relief accidenté et d'un
manque de voies « normales » de circulation n'ont pas
facilité l'installation de ces infrastructures. De plus,
l'électrification du quartier s'est renforcée en 2004
c'est-à-dire sept ans plus tard lors des campagnes
présidentielles. (cf. photo 6)
En ce qui concerne les infrastructures liées à
l'eau potable distribuée par la CAMWATER, c'est le Comité de
développement du quartier avec le concours de la présente
société qui a conduit à l'avènement desdites
infrastructures. Par ailleurs aucun programme de renforcement de ces
infrastructures n'est prévu dans le quartier tant que la route reliant
Burkina-Faso et le château d'eau le plus élevé sera
inexistante. (cf. photo 7)
Le mois de Mai 2006 a été la date à
laquelle le réseau de communication CAMTEL a couvert la région
entière. Pour cela, l'installation des infrastructures des
équipements de télécommunication n'est pas aisée,
mais les efforts fournis par la société sont considérables
du fait de la récente création de cinq points de vente et de la
rénovation* très proche des équipements existants
(poteaux, câbles...).
Les opérateurs évoluant dans la diffusion
audiovisuelle par câble quant à eux n'ont fournis aucun effort en
ce qui concerne l'installation des infrastructures car ils utilisent celles
implantées par la société AES-SONEL.


Enfin, dans la mise en place des différentes
infrastructures, la population locale y est pour beaucoup. En fait, c'est elle
qui a initié, dans le but de permettre une circulation plus
aisée, la construction des différents ponts qui y existent et a
participé à leur rénovation. C'est encore elle qui, avec
la participation du Maire de la Commune Urbaine de Ngaoundéré, a
effectué le traçage de la rue principale et quelques rues
secondaires dans le quartier. De plus, elle s'occupe aussi de la mise en place
des différentes passerelles qui sont faites essentiellement de troncs
d'arbres, de sacs de sable superposés, morceaux de fer de
récupération etc. et les canalisations* bien que précaires
pour l'évacuation des eaux usées et de ruissellement.
II-INFRASTRUCTURES URBAINES ET ADAPTATION AUX MODES DE VIE
DE LA POPULATION.
Afin de mieux appréhender leur cadre de vie, les
hommes ont appris à s'adapter aux multiples aléas* qui leur sont
imposés. En effet, pour une meilleure compréhension du mode
d'adaptation du mode de vie de la population de Burkina et la
réciprocité qui en découle, il nous sera nécessaire
d'explorer les différentes possibilités d'accès aux
infrastructures par ceux-ci d'une part, outre l'importance des infrastructures
pour la population et leur place dans les activités et le mode de vie de
la population de Burkina.
1-Possibilités d'accès.
Habituellement, en ce qui concerne le ravitaillement de la
population du quartier Burkina en eau potable, celle-ci le fait soit au puits,
soit a la source, soit au près de la CAMWATER. Dans le dernier cas, il
s'agit soit d'un branchement direct12(*), soit d'un achat au près de ces derniers (cf.
photo 8). Certains disposent à la fois d'un puits et d'un branchement
à domicile. (YAYA13(*))
Les données d'une enquête en matière de
ravitaillement en eau potable pour un échantillon de 40 foyers, nous ont
conduit aux résultats contenus dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Principales sources de ravitaillement
en eau potable.
|
Principales sources de ravitaillement
|
Nombre de maisons
|
Pourcentage (%)
|
|
CAMWATER
|
16
|
40
|
|
Puits
|
19
|
47,5
|
|
CAMWATER+Puits
|
05
|
12,5
|
|
Total
|
40
|
100
|
Source : enquêtes de terrain.
L'échantillon que nous avons choisi nous permet de
constater que la majorité de notre population (47,5 %) se ravitaille
dans les puits. Par ailleurs, 40% de celle-ci se ravitaille directement et
uniquement à la Camerounaise des Eaux, tandis qu'une minorité
(12,5%) se ravitaille à la fois dans des puits et à la CAMWATER.
Ceci explique le fait que bon nombre de la population du quartier n'a pas
accès aux infrastructures de ravitaillement en eau par les services
publics.

Photo 8 : point de vente d'eau potable au
près d'un abonné à la CAMWATER. (Cliché Atangana B.
01/05/2010).
Par ailleurs, le ravitaillement en électricité
dans le quartier n'est pas toujours effectif car, une bonne partie de la
population n'y a pas accès et de façon légale14(*). C'est ainsi que le tableau 3
suivant illustre avec clarté la situation du quartier par rapport
à l'accès aux infrastructures électriques.
Tableau 3 : Principales sources de ravitaillement
en électricité.
|
Principales sources de ravitaillement
|
Nombre de maisons
|
Pourcentage (%)
|
|
Abonnés directs à AES-SONEL
|
13
|
32.5
|
|
Non abonnés mais sous-traitants
|
25
|
62.5
|
|
Non abonnés et n'ayant pas
d'électricité
|
02
|
05
|
|
Total
|
40
|
100
|
Source : enquêtes de terrain, 21/05/2010.
Ce tableau nous permet d'observer les disparités entre
les différents foyers abonnés légalement ou non au
près des services publics. En effet, 5% de la population ne
bénéficie pas des services d'approvisionnement en
électricité. Ce pendant, bien que n'étant pas
abonnés, 62.5% de l'échantillon a accès à
l'électricité mais en tant que sous-traitants. Néanmoins
une faible majorité de notre échantillon (32.5%), est
abonnée à l'AES-SONEL.
La question d'accessibilité aux infrastructures
routières dans le quartier Studio, comporte beaucoup plus de facteurs
limitant que de possibilités d'accès à celles-ci. C'est
pourquoi nous pouvons noter que les vois de circulations sont presque
impraticables en saison de pluies, tout comme en saison sèche, du fait
de leur mauvais état.
2-Importance.
L'importance des infrastructures urbaines au sein d'une ville
ou même d'un quartier n'est plus à démontrer malgré
le fait qu'elles soient insuffisantes. C'est pourquoi la mise en place des
équipements urbains dans le quartier Burkina est une
nécessité incontournable car, elles améliorent
considérablement les conditions de vie des populations qui y vivent et
assurent par là même le développement du quartier,
et partant de la ville. L'avènement du courant électrique a
conduit au développement des activités économiques
nécessitant son utilisation (salons de coiffure, moulins à
farine, call-box etc.), l'accès facile à l'information (radio,
télévision etc.). En outre, la présence de l'eau potable a
contribuée à la réduction des maladies hydriques* comme
la dysenterie amibienne, le choléra, la fièvre typhoïde....
(BOBBO Salihou)15(*) De
plus, les services de télécommunication comme CAMTEL et d'autres
opérateurs ont facilité la communication entre les populations et
la transmission rapide de l'information. En outre, les voies de desserte sont
très importantes dans le quartier car elles permettent la circulation
aisée des biens et des personnes, l'évacuation d'ordures et
déchets de toute nature (par la société HYSACAM) dans le
cadre de l'assainissement du quartier, et faciliterait même des
interventions policières, pompières ou même une
évacuation d'urgence. Sur la base de ces quelques exemples, il est clair
que les infrastructures urbaines sont très importantes pour le
développement durable* du quartier.
3-La place des infrastructures face aux besoins de la
population.
Parler, un temps soi peu, d'infrastructures urbaines, revient
à les rapprocher inéluctablement de la population. En effet, la
concentration de la population en un milieu précis semble s'accompagner
des besoins primordiaux tels que : se déplacer, accéder
à l'eau potable et à l'électricité, communiquer et
s'informer. Pour le cas échéant qui est celui du quartier
Burkina, l'accent sera ainsi mis sur l'apport initial des infrastructures
urbaines pour la communauté locale.
Ce qu'il faut observer ici est que la situation des quartiers
périphériques par rapport aux infrastructures est du moins
précaire. La corrélation* se fait aussi ressentir entre la
population du quartier qui est de plus en plus croissante, et les
infrastructures de base dont l'état et la disponibilité sont
problématiques. Analysant donc l'importance de celles-ci sous cet
aspect, nous pouvons dire que les besoins communs de la population, en termes
d'équipement, se font de plus en plus ressentir dans le quartier
Burkina. Les avantages tirés des équipements du quartier sont du
moins insuffisants en raison des multiples facteurs parmi lesquels : la
rareté des points d'eau potable, le niveau de vie de la population
relativement faible etc.
CHAPITRE III : LES FACTEURS LIMITANTS ET
CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU QUARTIER.
Afin de mieux aborder cette partie du travail, il nous sera
nécessaire de présenter les différents acteurs ayant un
effet direct sur la mise en place des infrastructures urbaines dans le quartier
Burkina. A cet effet, il serait important de présenter tout d'abord les
différents facteurs limitants, puis leurs conséquences sur le
développement durable du quartier.
I-LES FACTEURS LIMITANTS
Ceux-ci peuvent être soit naturels (le relief,
l'altitude etc.), soit administratifs ou encore liés à la
croissance incontrôlées de la population.
1-Le relief.
Il constitue, pour la plupart, l'un des agents de marque
ayant une influence sur la mise en place des infrastructures au sein du
quartier Burkina. En effet, la position du quartier par rapport aux monts
Ngaoundaï lui est très défavorable pour le
développement des infrastructures urbaines. De ce fait, les effets de la
raideur de la pente sont à l'origine des phénomènes
d'érosion hydrique qui, très généralement,
provoquent des ravinements le long des rues. (cf. photo 9). Le processus
d'abduction d'eau par la CAMWATER, est confronté aux mêmes
problèmes liés à la pente. Par la même occasion, la
composition du sol de la zone est un frein à l'installation des tuyaux
d'abduction d'eau par la société ci-dessus citée.
2-Les critères financiers, logistiques et
politiques.
Le constat majeur que nous pouvons faire ici est celui d'un
paysage urbain en forte extension, échappant presque à la
vigilance des autorités ; ce qui semble animer de multiples
débats liés aux différents besoins de la population
locale. Il se poserait donc, pour tous, des différents problèmes
de moyens financiers, logistiques et humains pouvant être mis en oeuvre
par les différents pouvoirs publics dans l'optique d'une quelconque
solvabilité de la situation du quartier, dont le devenir
relèverait inéluctablement de l'incertitude. Signalons tout de
même que les effets de lourdeur administrative (modalités
d'abonnement très onéreux) ne permettent pas à la
population à faibles revenus, de bénéficier des services
adéquats (l'eau potable et l'électricité etc.). C'est donc
dire que la présence infrastructurelle dans le quartier Burkina
relève de l'effort des particuliers dont le niveau de vie est nettement
plus élevé.

Photo 9 : l'érosion hydrique conduit
à la formation des ravinements le long des rues. (Cliché Atangana
B., 01/05/2010)
Un autre facteur limitant est celui lié à des
raisons purement politiques. En effet, la marginalisation du quartier Burkina
viendrait du fait que, lors des élections municipales de 1997, la
population du quartier Burkina avait majoritairement voté contre le
parti ayant gagné ces élections municipales. Par
conséquent donc ils n'ont pas pu bénéficier du feed
back16(*) de
la part de la commune urbaine de la ville.
3-La pression démographique.
La pression démographique constitue, autant que ceux
précédemment énoncés, un handicap majeur
contribuant à ralentir l'évolution du quartier sur le plan
infrastructurel. En effet, les villes africaines sont celles qui connaissent
actuellement les plus forts taux d'urbanisation dans le monde.
(Géopolis, FME, 1992 (taux d'urbanisation)). Cette croissance
est intimement liée aux mouvements de la population, ayant des
répercutions sur les quartiers dits périphériques comme
c'est le cas au quartier Burkina. En effet, le quartier Studio,
précédé du quartier Joli soir connaissent les plus fortes
évolutions de la population dans la ville de Ngaoundéré.
Ce qui explique la pression que celle-ci exerce sur son environnement, et de
là, sur les différentes infrastructures urbaines en place
(consommation élevée de l'eau potable etc.).
Il est à noter que ces différents facteurs,
ainsi que beaucoup d'autres, ont des répercutions plus ou moins
néfastes tant sur le milieu que sur les infrastructures urbaines.
II-LES CONSEQUENCES.
1-Les effets de la pression démographique sur les
infrastructures urbaines.
La pression démographique est un
phénomène difficile à gérer dans la plupart des
pays d'Afrique et même dans le monde. Ainsi, la majorité des
quartiers périphériques sont densément peuplées et,
ces populations exercent une très forte pression sur les infrastructures
qui s'y trouvent. Cette action conduit ainsi à la
détérioration* de celles-ci. C'est dans cette catégorie
que ce trouve notre site d'étude dont la population est estimée
à environ 10.000 habitants. De ce fait, les équipements ne sont
pas proportionnels au nombre de la population qui les exploitent. Les actes de
vandalisme et de vol liés à la délinquance
juvénile, entrainent la disparition et la destruction des
équipements mis en place, donnant lieu à la réduction de
ceux-ci. La négligence quant à elle, se manifeste par le manque
d'entretient par le ou les services compétents. Tous ces actes
(surexploitation, vandalisme, vol, manque d'entretient etc.) ont pour
conséquences la dégradation continuelle des infrastructures,
outre les effets négatifs sur le développement du quartier.
2-La dégradation du milieu.
L'homme de part ses activités et le milieu dans lequel
il vit entretiennent des interrelations* pouvant conduire dans un cas comme
dans l'autre à des répercutions notables. Ainsi, avant son
humanisation, le quartier Burkina-Faso était constitué d'une
savane arborée qui recouvrait la totalité de la zone.
L'arrivée progressive de l'homme, la croissance urbaine qui s'en est
suivi, ont conduit à la dégradation du milieu. Aujourd'hui, le
milieu naturel subit des modifications au point où on a plus une
végétation homogène mais plutôt
hétérogène et sélectionnée. L'installation
des infrastructures dans le quartier a accentué les processus
d'érosion hydrique pouvant conduire à des éboulements.
Bien plus, la mise en place des équipements liés à l'eau
(tuyaux) et d'électricité (poteaux) et les rigoles non
aménagées ont parfois conduit au développement des
marmites d'érosion (Cf. photo 10).

Photo 10 : rigole non aménagée,
subissant une érosion accélérée. (Cliché
Vondou L.P, 21/05/2010).
Dans le cadre de la pollution atmosphérique, les
tendances actuelles ont conduit à l'utilisation massive des engins de
déplacements rejetant des gaz qui dégradent l'atmosphère
de manière générale. En bref, l'installation des
infrastructures urbaines dans le milieu change complètement sa
donnée naturelle en réduisant les espèces qui s'y trouvent
(faune, flore). Alors, le milieu qui était au départ relativement
naturel devient un milieu artificiel, humanisé et relativement
préjudiciable pour l'homme.
Ainsi, un relief accidenté, couronné par le
manque de moyens logistiques et financiers, et une pression
démographique toujours croissante, ont des effets défavorables
sur le développement durable du quartier.
CONCLUSION
Présenter les facteurs déterminants de la
présence des infrastructures urbaines dans le quartier Burkina
était le principal objectif à atteindre. Pour ce faire, nous
avons formulé un certain nombre de questions qui nous ont servi de
guides pour mieux appréhender l'aspect réel dans lequel se
présentent les infrastructures urbaines dans notre site
d'intérêt. En effet, le quartier Burkina, bien que doté
d'un minimum d'infrastructures urbaines, est le résultat des efforts
perpétués non seulement de sa population, et plus
particulièrement des élites locales, soutenus par les services
publics. L'amélioration des conditions de vie de la population du
quartier Burkina passerait par : une restructuration entière du
quartier, tout en délocalisant les populations des zones à
risque. De plus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il est
nécessaire d'adapter les procédures administratives au niveau de
vie de la population et les modalités d'abonnement en eau,
électricité et télécommunication. Il en est de
même pour la mise à disposition des matériaux de
construction adéquats. Toutefois, une collaboration étroite entre
la population et les services en charge de l'aménagement s'impose
désormais pour assurer des jours meilleurs au quartier Burkina et
à sa population.
BIBLIOGRAPHIE.
ASCHER.F, Métapolis ou l'avenir des
villes, Paris, édition O. Jacob, 1995, 345 p.
ASCHER F., les nouveaux principes de l'urbanisme. La
fin des villes n'est pas encore du jour. La tour d'Aigues ;
édition de l'Aube, 2001, 100p.
ASCHER.F, BRAUN.A, DEMUTH. G., PETRELIA.R. et
al ; « quand les transports publics deviennent
l'affaire de la cité. Parlons-en avec la RATP ». La
Tour d'Aigues, édition de l'Aube, 1999, 129p.
ASCHER.F., BRAMS.L., DELAMARRE.A., ROCHEFORT.A. et al,
les territoires futurs. La Tour d'Aigues : DATAR/édition
de l'Aube, 1993, 178p.
BOYER J.C., les banlieues en France, territoires et
sociétés, Paris : Armand colin, 2000, 206p.
Michel TCHOTSOUA, NDAME.J.P, WAKPONOU A., J. BONVALLOT,
maîtrise et gestion des eaux à Ngaoundéré (Cameroun)
problème et esquisses de solution, Géo-Eco-Trop, Fonds
documentaire IRD, 1999, 23, 91-105.
R. BRUNET, mondes nouveaux, G.U,
Hachette-reclus, 1990.
Y. NOSNY & H. CHAUVET, médecine d'Afrique
noire, environnement urbain en Afrique subsaharienne et pathologie,
article universitaire : 1992, 39p.
WACHTER S., BOURDIN A., PADIOLAU J.G, OFFNER J.M et al,
repenser le territoire : un dictionnaire de critique. La tour
d'Aigues/Montpelier : Aube/ DATAR, 2000, 287p.
C. BOUVET, J., J. MARTIN et al, géographie seconde,
Hachette éducation, B.O.E.N. n°12 du 21 juin 1995, 255p.
Le communal, le FEICOM se mobilise pour l'eau, publication du
FEICOM n°008, 2006, 62p.
Dictionnaire Hachette de poche, édition Hachette,
1973.
Le dictionnaire encyclopédique, LE PETIT LAROUSSE
illustré, édition Larousse, 1994.
Dictionnaire de poche LAROUSSE, Anglais :
français-anglais, anglais-français, édition Larousse,
juillet 2007.
Loi N°2004/003 du 21 avril 2004 régissant
l'urbanisme au Cameroun.
LEXIQUE
1) Acteurs : personne qui participe
activement ou qui agit sur l'espace selon ses moyens, avec une ou des
stratégies.
2) Aléa : évènement
dépendant d'un hasard défavorable.
3) Aménagement : action
volontaire d'une collectivité sur son territoire, pour s'adapter aux
besoins et obtenir une meilleure répartition des hommes et des
activités.
4) Canalisation : conduite assurant le
transport d'un fluide ou de l'énergie.
5) Corrélation : rapport de cause
à effet entre deux éléments.
6) Desserte : c'est le fait d'assurer la
communication ou le transport d'un lieu à l'autre.
7) Détérioration :
dégradation qui fait perdre de la valeur à quelque chose.
8) Développement : processus qui
permet d'améliorer l'existence d'une population : allongement de la
vie, accès à l'instruction, élévation du niveau de
vie, accès aux infrastructures et aux biens de consommation etc.
9) Développement durable :
théorie qui lie le développement au maintient de
l'équilibre homme/ressources et à la protection de
l'environnement.
10) Elevage extensif : élevage
pratiqué sur de vastes étendues.
11) Espaces tributaires : espaces
dépendants de quelque chose.
12) Facteur : élément qui
participe à la réalisation de quelque chose.
13) Hydrographie : ensemble des cours
d'eaux et des lacs d'une région.
14) Infrastructures : ensemble des
ouvrages et équipements au sol, destinés à faciliter le
trafic routier, aérien, maritime ou ferroviaire.
15) Interrelation : relation entre des
individus, des groupes, des disciplines scientifiques, etc.
16) Maladies hydriques : maladies dues
à la consommation ou l'utilisation des eaux souillée
17) Morcellement : division de quelque
chose en deux ou plusieurs parties
18) Privatisée : économie
transférée du secteur public au secteur privé.
19) Recension : inventaire
détaillé et critique (soutenu).
20) Rénovation : transformation
faite dans le but d'améliorer et de moderniser quelque choses.
21) Secteur informel : vaste ensemble
d'activités très diverses (petits métiers de vendeurs
ambulants, de réparateurs ou récupérateurs, petites
entreprises aux techniques rudimentaires) qui fonctionnent en marge des
règlements étatiques et assure le suivi d'un grand nombre de
pauvres dans les pays en développement.
22) Socioprofessionnel :
catégorie sociale définie par l'appartenance à une
profession, à un secteur économique.
23) Urbain : ce qui est propre à
la ville (voirie urbaine, population urbaine etc.)
24) Urbanisme: ensemble des réflexions
et des méthodes qui ont pour but l'aménagement de l'espace des
villes et de leurs alentours en fonction des critères
esthétiques, fonctionnels et sociaux.
ANNEXE : LE QUESTIONNAIRE DE RECHERCHE
GUIDE D'ENTRETIENT
Monsieur/Madame, nous, ATANGANA BAMELA Hyacinthe, EMOUNDOMB
MOANTAMB D.S, KOSYAKBE Armelle, VONDOU Laurent Pierre et MBEPORO YAYA Yves,
tous étudiants à l'université de Ngaoundéré,
nous tournons vers vous dans le but d'obtenir quelques informations
nécessaires dans le cadre d'une recherche académique. En effet,
le travail s'articulant autour des infrastructures Urbaines dans votre
quartier, nous vous assurons que tous ce que vous nous direz sera pris en
compte, et ceci dans le respect de l'anonymat. Etes-vous disposé
à répondre aux questions ?...............merci
monsieur/madame de prendre part à l'évolution de ce travail.
Identification
1-Quel est votre sexe ? M F
2-De quelle ethnie
êtes-vous ?.............................................................
3-Dans quelle tranche d'âge êtes-vous ?
|
15-24 ans
|
25-34 ans
|
35-44 ans
|
45-54 ans
|
55-64 ans
|
65-74 ans
|
75 ans et +
|
|
|
|
|
|
|
|
4-Quelle est votre profession ?
Cultivateur Fonctionnaire Commerçant
chômeur
Autres à
préciser.............................................................................................
Les infrastructures urbaines
1-Quelle importance accordez-vous aux infrastructures urbaines
dans votre vie quotidienne ?
Inutiles Moins utiles Utiles Très utiles
2-Comment trouvez-vous l'état des infrastructures de
votre quartier ?
Très mauvais état Mauvais état Bon
état Très bon état
3-Les infrastructures présentes satisfassent-elles vos
attentes ?
Pas du tout Partiellement Totalement
Ravitaillement en eau
1-Avez-vous accès à l'eau potable ? OUI
NON
2-Etes-vous abonné à la Camerounaise Des
Eaux ? OUI NON
3-Quel est votre principale source de ravitaillement en
eau ? (vous pouvez cocher plusieurs cases)
CAMWATER Puits Sources
Autres à
préciser.............................................................................................
Ravitaillement en
électricité
1Avez-vous accès à
l'électricité ? OUI NON
2-Etes-vous abonné à la SONEL ? OUI
NON
Si non,
pourquoi ?.........................................................................................................................
Nous vous remercions gracieusement, monsieur/madame, pour
votre aimable collaboration et pour votre apport dans l'évolution de ce
travail.
* 1 _ ASCHER F.
Métapolis ou l'avenir des villes. Paris : édition O.
Jacob, 1995, 345 p
* 2 _ BOYER J.C Les
banlieues en France, territoires et sociétés. Paris :
Armand Colin, 2000, 206 p
* 3 _ Espèce à
la quelle appartient le manguier ou «Anacardium occidentale«.
2 Espèce à la quelle appartient le
«persea gratissima« ou l'avocatier.
3 Espèce à la quelle appartiennent
les arbres fruitiers que sont les "citrus aurantium bergania" ou citronnier, et
les «citrus bergania« ou oranger etc.
4 Djaouro Sali Bindo est le chef supérieur
du quartier Burkina, étant entendu qu'il en existe deux chefs.
* 4 _ Véritable nom du
quartier Burkina-Faso, et appellation reconnue par la communauté urbaine
de la ville de Ngaoundéré
* 5 _Le quartier Burkina est
situé au pied des monts Ngaoundaï, milieu caractérisé
par un relief potentiellement dangereux. C'est pour favoriser la croissance de
ce quartier que les ?propriétaires terriens? proposent des terrains
à des prix relativement bas aux acheteurs.
* 6 _ La canalisation sous le
pont reliant le quartier Burkina et le quartier norvégien est en pleine
construction par un particulier et résident du quartier.
* 7 _ Le quartier Burkina
n'est pas doté jusque là d'un plan de lotissement
préalable et aucune action future n'est envisagée sur ce
point.
* 8 _ Article 9 al.1 et
l'article 10 de la loi N°2004-003 du 21 Avril 2004 régissant
l'urbanisme au Cameroun.
* 9 _ Le contexte de
privatisation des entreprises Camerounaises a été initié
en 1995 sous la pression des bailleurs de fonds internationaux à la
suite de la grande récession économique qui a frappé le
monde
* 10 _ NGONO Jean
François est contrôleur des télécommunications et
chef d'agence de la CAMTEL à Ngaoundéré.
* 11 _ Chiffre
esquissé par Djaouro Sali Bindo (chef principal du quartier Burkina), et
par le maire de la commune urbaine de Ngaoundéré Ier.
Car n'ayant pas de données exactes sur la population du quartier Burkina
de nos jours.
* 12 _ Le consommateur son
robinet à domicile
* 13 _ Chef de la section
technique de la Direction régionale de l'Adamaoua CAMWATER
* 14 _ Entendons ici le suivi
et le respect des procédures d'abonnement à l'AES-SONEL
* 15 _ BOBBO Salihou est
l'actuel maire de la commune urbaine de Ngaoundéré Ier
et fervent membre de l'UNDP.
* 16 _ Entendons par
là la rétribution en infrastructures de base (rues, abductions en
eau et en électricité etc.) de la part du parti au pouvoir au
sein d'une commune.
| 


