CHAPITRE VI. ANALYSE DESCRIPTIVE DES DONNÉES
ET
DISCUSSION DES RÉSULTATS
VI.1. Présentation des données
recueillies
Après l'administration du test de mémorisation,
nous avons corrigé les copies des sujets en vue d'attribuer des notes
individuelles conformément à la consigne (voir Annexe).
Après l'annotation des copies d'évaluation, les notes obtenues
ont été encodées dans un tableau « Excel ». Ces
notes encodées nécessitaient cependant d'être
analysées pour pouvoir leur faire acquérir une certaine
intelligibilité, un certain sens. Ainsi, nous avons
procédé à une analyse descriptive des données
complétée par une autre, cette fois-ci inférentielle, pour
nous permettre de nous prononcer sur le caractère significatif ou non
des différences constatées. Ainsi, cette double analyse nous a
finalement permis de décider du sort à réserver à
nos hypothèses de départ, c'est-à -dire leur confirmation
ou leur infirmation.
Tableau1 : synthèse des notes obtenues par les
sujets au test de mémorisation
|
Notes obtenues au test de rappel libre
|
Notes obtenues
au test de reconnaissance
|
|
|
Ecolier
|
Statut
(entendant/ non
entendant)3
|
Information abstraite (sur
45 points)
|
Information concrète (sur
45 points)
|
Total «Concrétude» (sur 90 points)
|
Reconnaissance (sur 27 points)
|
Score
total
(sur 117 points)
|
|
1
|
2
|
10
|
8
|
18
|
18
|
36
|
|
2
|
2
|
26
|
35
|
61
|
25
|
86
|
|
3
|
1
|
28
|
28
|
56
|
19
|
75
|
|
4
|
2
|
33
|
38
|
71
|
22
|
93
|
|
5
|
1
|
39
|
29
|
68
|
20
|
88
|
|
6
|
2
|
14
|
10
|
24
|
13
|
37
|
|
7
|
1
|
31
|
34
|
65
|
16
|
81
|
|
8
|
1
|
34
|
25
|
59
|
17
|
76
|
|
9
|
1
|
34
|
28
|
62
|
17
|
79
|
3 Légende: 1 désigne écolier
entendant, 2 désigne écolier non entendant.
|
10
|
1
|
17
|
21
|
38
|
21
|
59
|
|
11
|
1
|
31
|
32
|
63
|
25
|
88
|
|
12
|
2
|
33
|
36
|
69
|
26
|
95
|
|
13
|
1
|
21
|
28
|
49
|
22
|
71
|
|
14
|
1
|
26
|
27
|
53
|
17
|
70
|
|
15
|
1
|
25
|
24
|
49
|
25
|
74
|
|
16
|
1
|
39
|
44
|
83
|
22
|
105
|
|
17
|
1
|
28
|
24
|
52
|
23
|
75
|
|
18
|
1
|
22
|
26
|
48
|
20
|
68
|
|
19
|
1
|
32
|
36
|
68
|
24
|
92
|
|
20
|
1
|
32
|
30
|
62
|
23
|
85
|
|
21
|
2
|
8
|
15
|
23
|
26
|
49
|
|
22
|
2
|
16
|
18
|
34
|
15
|
49
|
|
23
|
1
|
26
|
18
|
44
|
21
|
65
|
|
24
|
1
|
33
|
35
|
68
|
23
|
91
|
|
25
|
1
|
26
|
24
|
50
|
23
|
73
|
|
26
|
1
|
21
|
17
|
38
|
23
|
61
|
|
27
|
1
|
24
|
27
|
51
|
18
|
69
|
|
28
|
1
|
32
|
27
|
59
|
22
|
81
|
|
29
|
1
|
31
|
34
|
65
|
26
|
91
|
|
30
|
1
|
24
|
24
|
48
|
20
|
68
|
|
31
|
1
|
34
|
23
|
57
|
17
|
74
|
|
32
|
2
|
30
|
40
|
70
|
18
|
88
|
|
33
|
1
|
25
|
24
|
49
|
20
|
69
|
|
34
|
2
|
16
|
19
|
35
|
15
|
50
|
|
35
|
2
|
6
|
8
|
14
|
21
|
35
|
|
36
|
1
|
35
|
27
|
62
|
20
|
82
|
|
37
|
1
|
36
|
38
|
74
|
27
|
101
|
|
38
|
2
|
21
|
30
|
51
|
21
|
72
|
|
39
|
1
|
34
|
35
|
69
|
24
|
93
|
|
40
|
1
|
29
|
21
|
50
|
17
|
67
|
|
41
|
1
|
32
|
30
|
62
|
23
|
85
|
|
42
|
2
|
38
|
38
|
76
|
26
|
102
|
|
43
|
1
|
16
|
24
|
40
|
23
|
63
|
|
44
|
2
|
7
|
5
|
12
|
18
|
30
|
|
45
|
1
|
33
|
32
|
65
|
23
|
88
|
|
46
|
1
|
23
|
24
|
47
|
24
|
71
|
|
47
|
2
|
16
|
23
|
39
|
23
|
62
|
|
48
|
1
|
20
|
18
|
38
|
18
|
56
|
|
49
|
2
|
27
|
35
|
62
|
24
|
86
|
|
50
|
1
|
22
|
23
|
45
|
16
|
61
|
|
51
|
2
|
10
|
11
|
21
|
17
|
38
|
|
52
|
1
|
24
|
23
|
47
|
18
|
65
|
|
53
|
1
|
23
|
24
|
47
|
21
|
68
|
|
54
|
2
|
24
|
40
|
64
|
25
|
89
|
|
55
|
1
|
31
|
24
|
55
|
17
|
72
|
|
56
|
1
|
25
|
25
|
50
|
20
|
70
|
|
57
|
1
|
30
|
30
|
60
|
20
|
80
|
|
58
|
2
|
17
|
17
|
34
|
19
|
53
|
VI.2. Analyse descriptive des données et
discussion du jeu des variables
retenues
Après avoir fait les calculs informatisés sur
les notes obtenues, nous avons constaté que la moyenne
générale des notes obtenues par les écoliers entendant
était de 76.3 points sur 117, soit l'équivalent d'une moyenne de
5.87 items sur neuf alors qu'elle était de 63.88 points sur 117, soit
une moyenne de 4.9 items sur neuf. Deux conclusions se dégagent de ces
résultats. Premièrement, une différence s'observe entre la
performance mnémonique des écoliers entendant et celle des
écoliers non entendant, et ce, en faveur des premiers.
Deuxièmement, la norme déjà établie dans la culture
occidentale par certains psychologues cognitivistes (voir par exemples Miller,
1956 ; Michaux, 1974 ; Matlin, 2001,...) situant le seuil minimal normal de
l'empan mnésique à 5 items et le seuil maximal à 9 items
s'applique, dans notre étude, aux écoliers entendant et non aux
écoliers non entendant pour qui il manque quelques poussières de
points pour se situer à la barre minimale (4.9 items au lieu du minimum
de 5). Le fait que les écoliers non entendant n'arrivent pas à
atteindre le seuil de la compétence mnémonique
considérée comme minimal nous pousse à cette conclusion :
la mémoire de travail des écoliers non entendant du Burundi n'est
pas déficiente mais elle est peu efficiente.
La graphique 1 nous permet de comparer l'efficience de la
mémoire de travail entre les écoliers entendant et ceux non
entendant. Elle compare les totaux des notes obtenues par les écoliers
entendant et ceux non entendant (voir tableau synthétique des notes
obtenues, dernière colonne) ramenés à une moyenne de 9
items.
Graphique 1: Comparaison de la performance de la
mémoire de travail entre les écoliers entendant et non entendant
(en ordonné le total des notes obtenues sur 117 points ramené
à la moyenne de 9 points et en abscisse la catégorie
d'écoliers)
Comparaison de la performance de la mémoire de travail
entre les écoliers entendant et ceux non entendant
|
6 5.8 5.6 5.4 5.2
5 4.8 4.6 4.4
|
|
|
Entendant Non entendant
L'allure de ce graphique nous amène à confirmer
notre hypothèse générale qui postulait une possible
supériorité des écoliers entendant sur ceux non entendant
si nous nous situons sur le plan de l'efficience de la mémoire de
travail. Cependant, cela n'est qu'une tendance générale qu'il
importe de prendre avec précaution d'autant plus que sur les dix
meilleures notes qui sont respectivement de 105, 102, 101, 95, 93, 93,92,
91,91, et 89, quatre reviennent à des écoliers non entendant.
Pourtant, ils représentent un peu moins du tiers des sujets
testés (exactement 18 sujets non entendant contre 40 sujets entendant,
soit 31.03% de l'échantillon).
En outre, alors que la meilleure note chez les écoliers
entendant est de 105 points sur 117, elle est de 102 chez les non entendants,
soit 89.74% contre 87.14 %. Les notes les plus basses sont 56 sur 117 chez les
écoliers entendant, soit 47.86 % contre 30 points sur 117 chez les
écoliers non entendant soit l'équivalent de 25.64 %.
L'écart entre les meilleures notes est de 2.60% alors qu'il est de
22.22% pour les basses notes. Comme illustré aussi par les graphiques
nos 2 et 3, ce contraste veut dire que les scores sont massés
autour des moyennes pour les écoliers entendant alors qu'ils sont
distribués pour ceux non entendant.
Graphiques 2 &3: Comparaison de la
distribution des scores autour des moyennes(en abscisse le nombre
d'écoliers et en ordonné la note totale obtenue sur un total de
117 points)

La structure de ces deux graphiques 2 et 3 nous pousse
à affirmer que, bien que les écoliers non entendant obtiennent
une faible moyenne en comparaison avec les écoliers entendant de
même niveau scolaire, il ne serait pas sensé de conclure que le
fait d'être entendant s'accompagne toujours de déficiences de la
mémoire de travail. Par contre, nous déduisons par là que
quand le fait d'être non entendant s'accompagne de déficience de
la mémoire de travail, cette dernière est alors profonde.
Nous avons également postulé avec nos
hypothèses opérationnelles que certains facteurs notamment la
« Concrétude » et le « Type d'opération
mnémonique » pourraient être explicatifs de la
différence entre les écoliers entendant et les écoliers
non entendant. L'analyse de l'effet de ces variables ou facteurs fait l'objet
de la section qui suit.
VI.2.1. Analyse de l'éventuel effet de la variable
« Concrétude »
entendant) revêt deux modalités à
savoir la nature concrète ou abstraite de l'information
véhiculée par l'item à mémoriser. Si nous
essayons de comparer les notes obtenues par les sujets en isolant cette
variable, nous remarquons que les écoliers entendant obtiennent, pour
les items faisant référence à une information abstraite,
une moyenne de 27.83 sur 45, soit 61.84% tandis que les écoliers non
entendant obtiennent une note moyenne de 19.56 sur 45 soit 43.53%.
L'écart entre les deux moyennes est de 8.27 points, l'équivalent
d'un écart de 18.38%.
Avant de dégager une quelconque conclusion
découlant de cette analyse de données, nous avons d`abord fait
référence à Sockeel et Anceaux (2002, p.101) pour qui
« une bonne façon d'évaluer l'effet d'une variable
indépendante sur une variable dépendante consiste à la
représenter graphiquement. .Si l'échelle est continue on utilise
une courbe, si elle ne l'est pas, un histogramme ». Ainsi, dans notre cas,
l'échelle d'évaluation n'étant pas continue, nous avons
construit l'histogramme correspondant (voir graphique 4 ci--dessous).
Graphique 4 : Comparaison des moyennes des notes
obtenues par les sujets entendant et ceux non entendant lorsque les items font
référence à une information abstraite (en abscisse la
catégorie d'écoliers et en ordonné la moyenne de la note
obtenue par chaque catégorie d'écoliers
sur 45 points)
comparaison des moyennes des notes des écoliers
entendant et des
écoliers non entendant
Moyenne des résultats
|
30 25 20 15 10 5 0
|
|
|
|
Non entendant Entendant
|

A travers la structure de ce graphique, nous constatons que la
moyenne des notes obtenues par les
écoliers entendant est plus grande
que celle des notes obtenues par les écoliers non entendant
quand les
items à mémoriser renvoient à des réalités
abstraites. Cela revient à confirmer
provisoirement une partie de notre première
hypothèse opérationnelle qui postulait que l'efficience de la
mémoire de travail chez les écoliers entendant du Burundi serait
plus élevée que celle des écoliers non entendant du
même milieu quand le matériel à mémoriser se
rapporte aux phénomènes abstraits.
Par contre, les écoliers entendant, quand il est
question de mémoriser des items renvoyant à une information
concrète, obtiennent la note moyenne de 26.78 points sur 45, soit 59.51%
contre 23.66 soit 52.58%. L'écart entre les deux moyennes est
d'exactement 3.12 points, soit 6.93%. La graphique 5 compare les
écoliers entendant et non entendant quand l'information faisant objet de
mémorisation est concrète.
Graphique 5: Comparaison des moyennes des notes
obtenues par les sujets entendant et ceux non entendant lorsque les items font
référence à une information concrète (en abscisse
la catégorie d'écoliers et en ordonné la moyenne de la
note obtenue par chaque catégorie d'écoliers sur un total de 45
points)
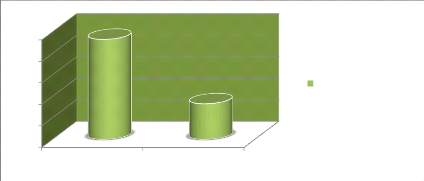
27
26
25
24
23
22
Entendant Non entendant
Moyenne de la note obtenue
Dans tous ces deux cas de figure (graphiques 4 et 5), il
apparaît que la performance mnémonique des écoliers
entendant est supérieure à celles des écoliers non
entendant c'est-- à- dire à la fois lorsque l'information
à rappeler est de nature abstraite et lorsqu'elle est de nature
concrète.
de --2.33%. Par contre, les écoliers non entendant
obtiennent un pourcentage de 45.53% lorsque les items sont abstraits alors
qu'ils obtiennent 52.58% lorsque les items sont concrets, soit une
différence de +7.02%. Il est clair que les écoliers entendant
affichent une performance moindre quand les items sont liés à un
référent concret que quand ils font appel à un
référent abstrait. Cependant, l'ampleur de l'écart entre
ces deux situations ne nous permet pas de conclure que les écoliers
entendant ont des problèmes de mémorisation des items dont les
référents sont concrets car la perte de points peut être
expliquée par la fatigue du moment que la présentation des items
abstraits a précédé celle des items concrets. Par contre,
le gain de points de l'ordre de 7 % est une preuve irréfutable que les
écoliers entendant ont une réelle facilité à
mémoriser les items dont les référents sont concrets.
Notre première hypothèse particulière
postulait que l'écart entre ces deux catégories d'écoliers
serait grand quand le matériel à mémoriser se rapporte aux
objets abstraits mais tendrait à se réduire lorsque le
matériel à mémoriser se rapporte aux objets ou
phénomènes concrets. Cela nous a amené à vouloir
vérifier cette seconde partie de notre hypothèse
opérationnelle en comparant les écarts entre ces deux
catégories d'écoliers au niveau de leur efficience
mnémonique eu égard aux deux modalités de la variable
« Concrétude » (voir graphique 6 ci-- dessous).
Graphique 6 : Comparaison des écarts entre les
écoliers entendant et ceux non entendant selon que le matériel
à mémoriser fait appel à des phénomènes
concrets ou abstraits (en abscisse le type d'item et en ordonné la
moyenne de l'écart entre les ecoliers entendant et non entendant selon
le type d'item)
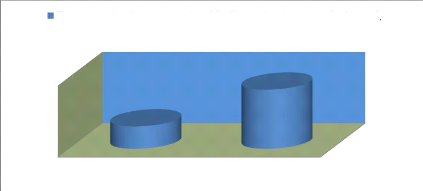
Ecart entre les deux categories d'écoliers selon la nature
des items à mémoriser
Concret Abstrait
3.12
8.27
Le présent graphique 6 met en lumière le fait
que l'écart entre les écoliers entendant et ceux non entendant
est plus grand quand le référent est, dans les items, une
réalité abstraite que quand il évoque une
réalité concrète.
Ici également, il s'est avéré
indispensable de tester si la différence entre les deux situations est
statistiquement significative, pour pouvoir nous y prononcer avec assurance. Ce
travail fait objet de la section consacrée à l'analyse
inférentielle des résultats (voir plus loin). Mais avant d'y
arriver, parlons d'abord de l'effet potentiel de notre deuxième variable
retenue à savoir le « Type d'opération
mnémonique».
VI.2.2. Mise à l'épreuve de l'effet de la
variable « Type d'opération mnémonique »
Nous avions estimé qu'en plus de la nature des items
à mémoriser (voir hypothèses de recherche), le « Type
d'opération mnémonique » demandée pouvait
également avoir un effet sur l'efficience de la mémoire de
travail. Nous avons sérié la variable « Type
d'opération mnémonique » en deux modalités à
savoir l'opération de rappel libre et l'opération de
reconnaissance.
Au regard des données recueillies par rapport aux deux
modalités de la variable « Type d'opération
mnémonique », les écoliers entendant obtiennent une note
moyenne de 55.4 points sur 90 pour le test de rappel libre contre 52.66 sur un
total de quatre vingt-- dix points soit respectivement 61.55% et 58.51%. Si
nous ramenons ces scores sur neuf, soit le score maximal en termes d'items pour
chaque exercice expérimental, nous avons respectivement 5.54 items et
5.26 items, ce qui fait un écart de 0.32 items. Quant au test de
reconnaissance, les écoliers entendant y ont obtenu en moyenne 20.88
points sur 27, soit 77.33%, tandis que ceux non entendant ont obtenu une
moyenne de 20.66 points sur 27, soit 76.52%. En ramenant ces notes moyennes sur
9 items, les deux catégories d'écoliers obtiennent respectivement
6.96 et 6.88 items. Cela fait une différence de 0.08 items.
En comparant ces écarts moyens (Voir graphique 7), nous
constatons que l'écart entre la performance mnémonique chez les
écoliers entendant et les écoliers non entendant est minime pour
le test reconnaissance que pour le test de rappel libre. Cela est une
confirmation de notre hypothèse opérationnelle qui postulait que
l'écart au niveau des scores entre les écoliers entendant et les
écoliers non entendant serait plus grand quand il s'agit d'un test de
rappel libre que quand il s'agit d'un test de reconnaissance.
Graphique 7 : Illustration de l'écart moyen
des scores entre les écoliers entendant et ceux non
entendant selon le type d'opération
mnémonique (en ordonné le type
d'opération
mnémonique et en abscisse l'écart total
entre les écoliers entendant et non
entendant ramené à la moyenne de 9
points)
Etendu de l'écart selon le type d'opération
mnémonique
|
Test de reconnaissance
Test de rappel libre
|
|
0 0.2 0.4
VI.3. Vers une analyse inférentielle des
données
Si l'analyse descriptive des données qui est ci-- haut
reprise nous a permis de confirmer toutes nos hypothèses, tant
l'hypothèse générale que les hypothèses
opérationnelles, nous admettons qu'il s'agit là d'une
confirmation à portée provisoire.
En effet, cette analyse descriptive fait état
d'écarts entre les écoliers entendant et les écoliers
non
entendant en fonction des variables « Concrétude » et
« Type d'opération mnémonique », mais
elle reste muette sur le caractère significatif de ces
écarts. C'est justement cela qui nous a amènéà
envisager une section consacrée à l'analyse inférentielle
afin de pouvoir conclure définitivement, si les différences
constatées sont statistiquement significatives ou non.
CHAPITRE VII. ANALYSE INFÉRENTIELLE
APPLIQUÉE AUX PREMIERS RÉSULTATS
Pour mener à bon port l'analyse inférentielle
qui s'est averée indispensable au vu des résultats de l'analyse
descriptive, nous avons dü procéder à un choix d'un test
statistique parmi toute une diversité : le test d'égalité
des moyennes. C'est un test qui nous a été suggéré
par Sockeel et Anceaux (2002, p.106) quand ils considèrent qu' « on
vérifie l'effet d'un facteur élémentaire sur la variable
dépendante par la comparaison des moyennnes des performances
constatées pour chaque degré de ce facteur ». Le traitement
de données opéré a abouti aux résultats qui sont
repris par le tableau 2 qui suit.
Tableau 2 : Résultat de l'analyse
inférentielle des données
|
Test de Levene
sur l'égalité des
variances
|
|
|
F
|
Significa- tion.
|
t
|
Degré de
liberté
|
Signification (bilatérale)
|
Diffé- rence
de
moyen- nes
|
Diffé-
rence écart-type
|
Intervalle de
confiance 90%
de la différence
|
|
Infé-
rieure
|
Supé-
rieure
|
|
Abstrait
|
Hypothèse
de variances égales
|
13.678
|
.000
|
4.087
|
56
|
.000
|
8.269
|
2.023
|
4.216
|
12.323
|
|
Hypothèse
de variances inégales
|
|
|
3.323
|
21.894
|
.003
|
8.269
|
2.488
|
3.108
|
13.431
|
|
Concret
|
Hypothèse
de variances égales
|
50.354
|
.000
|
1.341
|
56
|
.185
|
3.108
|
2.319
|
-1.536
|
7.753
|
|
Hypothèse
de variances inégales
|
|
|
1.002
|
19.422
|
.329
|
3.108
|
3.103
|
-3.377
|
9.594
|
|
Rappel libre
|
Hypothèse
de variances égales
|
43.132
|
.000
|
2.752
|
56
|
.008
|
11.378
|
4.135
|
3.095
|
19.661
|
|
Hypothèse
de variances inégales
|
|
|
2.090
|
19.844
|
.050
|
11.378
|
5.444
|
.016
|
22.739
|
|
Recon- naissan- ce
|
Hypothèse
de variances égales
|
5.307
|
.025
|
.217
|
56
|
.829
|
.208
|
.960
|
-1.714
|
2.131
|
|
Hypothèse
de variances
|
|
|
.190
|
24.772
|
.851
|
.208
|
1.097
|
-2.052
|
2.469
|
|
inégales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
Hypothèse
de variances égales
|
43.261
|
.000
|
2.508
|
56
|
.015
|
11.586
|
4.619
|
2.333
|
20.839
|
|
Hypothèse
de variances inégales
|
|
|
1.907
|
19.866
|
.071
|
11.586
|
6.076
|
-1.094
|
24.267
|
Ce test d'égalité des moyennes a les
spécifications suivantes :
1. H0 : M1 = M2, c'est- á- dire que M1-M2=0
2. H1 : M1? M2, c'est-á-dire que M1-M2?0
De ces deux formules, nous lisons que l'hypothèse nulle
(H0) suppose l'égalité entre la moyenne 1 (M1) et la moyenne 2
(M2). Lorsque c'est le cas, cela veut dire que la différence entre la
moyenne 1 et la moyenne 2 est nulle. Si non, l'hypothèse alternative
postule que les moyennes 1 et 2 (M1 et M2) sont inégales ; autrement
dit, leur différence est une valeur différente de zéro
(valeur négative ou positive) au niveau de confiance de 90%.
Selon les résultats du tableau 2 dans sa colonne des
significations bilatérales, nous lisons que la valeur de la
signification bilatérale pour le rappel libre est de 0.08, une valeur
qui se situe dans l'intervalle comprise entre -.1 et +.1, donc dans la zone de
rejet de l'hypothèse nulle. Cela étant, nous rejetons
l'hypothèse nulle qui postulait l'égalité des moyennes 1
et 2 et confirmons l'hypothèse alternative. En d'autres mots, au niveau
de confiance de 90% et au seuil de signification de 10%, la différence
entre les écoliers entendant et ceux non entendant est statistiquement
significative. Nous confirmons donc notre hypothèse
générale de départ qui postulait que les
écoliers entendant du Burundi seraient plus performants que les
écoliers non entendant sur le plan de l'efficience de la mémoire
de travail.
Par ailleurs, l'analyse descriptive des données nous
avait indiqué que des facteurs comme la « Concrétude »
des items á mémoriser et le Type de l'opération
mnémonique demandée aux sujets avaient un impact sur
l'écart de l'efficience de la mémoire de travail entre les
écoliers entendant et les écoliers non entendant du Burundi.
En effet, à propos du jeu de la variable «
Concrétude », nous constatons que la valeur de la signification
bilatérale, pour les items abstraits et l'hypothèse nulle, est de
.000. Or cette valeur est comprise entre +0.1 et -01 (10% de niveau de
signification) et ne se situe donc pas par conséquent dans la zone
d'acceptation de l'hypothèse nulle (cfr loi de la distribution normale
de Gauss et Laplace). Cela signifie que la différence entre les
écoliers entendant et les écoliers non entendant est
statistiquement significative pour le cas précis des items renvoyant aux
objets abstraits.
Par contre, la valeur de la signification bilatérale,
pour les items concrets, est de .185. Cette valeur ne se situe pas entre +0.1
et -0.10 et, en nous référant à la loi de la distribution
normale de Gauss et Laplace, elle se trouve dans la zone d'acceptation de
l'hypothèse nulle. Nous déduisons donc que la différence
entre la moyenne 1 et la moyenne 2 est nulle. En conséquence, nous
concluons que la différence entre les écoliers entendant et les
écoliers non entendant n'est pas statistiquement significative lorsque
les items à mémoriser font référence aux objets et
phénomènes concrets. Autrement dit, les deux groupes
d'écoliers (entendant et non entendant) sont « homogènes
» ou « équi-performants » quand les
référents des items à mémoriser sont des objets ou
phénomènes concrets. Cela revient à confirmer notre
première hypothèse opérationnelle de départ selon
laquelle l'efficience de la mémoire de travail chez les écoliers
entendant du Burundi serait plus élevée que celle des
écoliers non entendant du même milieu quand le matériel
à mémoriser se rapporte aux phénomènes abstraits.
En revanche, l'écart se réduirait entre ces deux
catégories d'écoliers au cas où le matériel
à mémoriser se rapporterait aux phénomènes
concrets.
Avec les résultats de l'analyse descriptive, nous
avions réalisé que l'écart entre les écoliers
entendant et non entendant se réduit quand les items à
mémoriser sont concrets en comparaison à leur écart quand
les items sont abstraits. L'analyse inférentielle est venue la
compléter ; elle prouve finalement qu'il ne s'agit pas d'une simple
réduction de l'écart mais que la différence entre les
écoliers entendant et les écoliers non entendant n'est pas
statistiquement significative au seuil de signification de 10%.
Enfin, à propos du jeu de la variable « Type
d'opération mnémonique » sur l'efficience de la
mémoire de travail, nous réalisons, à la lecture des
valeurs du tableau 2, que la signification bilatérale pour la
modalité test de rappel libre de la variable « Type
d'opération mnémonique » est de .050. Cette valeur est
comprise entre 0.10 et -0.10. Donc, cela veut dire qu'elle se situe dans la
zone de rejet de l'hypothèse nulle si nous nous référons
à la loi de la distribution normale de Gauss et Laplace. Autrement dit,
la différence est significative. Nous rejetons par conséquent
l'hypothèse nulle qui postule l'égalité des moyennes 1 et
2 et concluons qu'au seuil de signification de 10%, la différence entre
les écoliers entendant et les écoliers non entendant est
statistiquement significative quand l'opération mnémonique en jeu
est le rappel libre.
S'agissant de la modalité test reconnaissance de la
variable « Type d'opération mnémonique », la valeur de
la signification bilatérale est de .829 . Cette valeur se situe dans la
zone d'acceptation de l'hypothèse nulle selon la loi de distribution
normale de Gauss et Laplace car elle n'est pas comprise entre .10 et -.10 .
Cela signifie que l'hypothèse nulle qui suppose l'égalité
des moyennes 1 et 2 est retenue. En d'autres termes, la différence entre
les écoliers entendant et les écoliers non entendant, au seuil de
signification de 10%, n'est pas statistiquement significative quand
l'opération mnémonique requise est la reconnaissance.
En conclusion, la différence des scores entre les
écoliers entendant et ceux non entendant est statistiquement
significative en ce qui est du test de rappel libre mais elle ne l'est pas pour
le cas du test de reconnaissance. Cela confirme notre seconde hypothèse
opérationnelle qui avançait que l'écart au niveau des
scores entre les écoliers entendant et les écoliers non entendant
burundais serait plus grand quand il s'agit d'un test de rappel libre que quand
il s'agit d'un test de reconnaissance.
66
CONCLUSION
Comme le met en lumière notre formulation du sujet
d'étude, notre recherche s'était assignée comme objectif
de procéder à une comparaison de l'efficience de la
mémoire de travail entre des écoliers burundais entendant et non
entendant. Pour y parvenir, nous avons débuté nos investigations
par un questionnement large axé sur le thème central que ledit
objectif soulève. Ce questionnement large nous a servi de fil conducteur
pour un passage à une autre étape, celle de la revue critique de
la littérature en rapport avec le même thème.
Finalement, en confrontant les résultats de la revue
critique de la littérature à nos pré-requis en
matière de psychologie et aux besoins de notre recherche, nous avons
arrêté les définitions opérationnelles des concepts
que nous considérions comme névralgiques dans le cadre de notre
étude. Egalement, un cadre théorique de référence a
été constitué dans lequel nous n'avons retenu que les
aspects qui touchent directement aux volets psychologiques de la mémoire
et de la surdité. C'est sur base dudit cadre théorique que nous
avons explicité la problématique que soulève
l'étude et formulé des hypothèses qui devaient alors
être soumises à un travail de vérification. En effet, il
s'est agit ici d'adopter la méthode dite « scientifique
générale qui consiste à formuler des
énoncés, appelés hypothèses ou encore des
systèmes d'énoncés, appelés également
théories, puis à les mettre à l'épreuve des faits
un par un » (Sockeel et Anceaux, 2002, p.16).
Ladite vérification d'hypothèses nous a
engagé dans une récolte de données, mais nous avons
dû préalablement déterminer la méthode de recherche
à suivre à cet effet, à savoir la méthode
expérimentale. L'instrument de collecte des données que nous
avons utilisé dans ce cadre, est constitué de deux tests de
mémorisation à savoir un test de rappel libre et un test de
reconnaissance.
Le test de rappel libre a deux composantes bâties sur
deux modalités de la variable «Concrétude»
(la
modalité Item concret et la modalité Item abstrait). Quant au
test de reconnaissance, sa
pertinence reposait sur la
nécessité d'une confrontation de ses résultats avec ceux
du test de
rappel en vue de vérifier l'effet d'une autre variable,
la variable «Type d'opération mnémonique».
Le test a été administré à
cinquante-huit sujets entendant et non entendant dans les proportions
respectives de quarante et dix-huit. Après la collecte des
données et leur encodage, nous avons procédé à leur
analyse descriptive. Cette dernière a provisoirement confirmé nos
hypothèses de recherche émises. En effet, (i)
les écoliers entendant du Burundi s'affichent plus
performants que les écoliers non entendant sur le plan de l'efficience
de la mémoire de travail. Par ailleurs, (ii)
l'efficience de la mémoire de travail chez les
écoliers entendant est plus élevée que celle des
écoliers non entendant quand le matériel à
mémoriser se rapporte à des phénomènes abstraits.
En revanche, l'écart se réduit entre ces deux catégories
d'écoliers lorsque le matériel à mémoriser se
rapporte à des phénomènes concrets.
Enfin, (iii) l'écart au niveau des
scores entre les écoliers entendant et les écoliers non entendant
est plus grand quand il s'agit d'un test de rappel libre que quand il s'agit
d'un test de reconnaissance.
Cependant, l'analyse descriptive à elle seule ne permet
pas par nature de déterminer si les différences constatées
sont statistiquement significatives ou non. Alors, pour tendre vers une
confirmation définitive de nos hypothèses de recherche, nous
avons fait par la suite recours à un test de la statistique
inférentielle : le test de comparaison des moyennes.
Effectivement, la mise en jeu de ce dernier nous a permis de
confirmer d'une part que, sur le plan de l'efficience de la mémoire de
travail, les écoliers entendant sont plus performants que les
écoliers non entendant au seuil de signification de 10%. Cependant,
cette différence dépend tant de l'opération
mnémonique demandée que de la concrétude des items
à mémoriser.
Il s'est en effet avéré que la différence
entre la performance mnémonique des écoliers entendant et celle
des écoliers non entendant est statistiquement significative au seuil de
signification de 10% lorsque les items à mémoriser renvoient
à des objets abstraits mais qu'elle ne l'est pas lorsque les items
à mémoriser font référence à des objets
concrets. Par ailleurs, le type d'opération mnémonique s'est
révélé être une variable explicative de la
différence observée entre nos deux catégories
d'écoliers. La différence entre elles, toujours au seuil de
signification de
10%, est significative quand l'épreuve requiert le rappel
libre mais elle ne l'est pas quand la tâche concerne la
reconnaissance.
En définitive, notre objectif était de
comprendre le fonctionnement cognitif, et surtout mnémonique, des sujets
non entendant du Burundi par le biais d'une comparaison avec d'autres sujets du
même milieu, mais eux entendant. Nous jugeons que notre objectif a
été largement atteint car nous avons pu découvrir,
à la lumière de la comparaison avec des écoliers
entendant, les zones d'effort et les zones de confort des écoliers non
entendant en ce qui est de la mémorisation en mémoire de travail.
Nous reconnaissons toutefois que la mémoire de travail n'est qu'une
composante de la dimension cognitive humaine parmi bien d'autres. Ainsi, nous
clôturons cette dissertation en tendant le témoin à toute
autre initiative de recherche qui viendrait comparer sujets entendant et non
entendant sur d'autres fonctions cognitives.
69
BIBLIOGRAPHIE
Bartz, W. H. (1976). Introduction à la psychologie
(collection multi-choix). Montréal : Les éditions. H.R.W.
Ltée.
Colin, D. (1979). Psychologie de l'enfant sourd. Paris :
Masson.
Da Silva Neves, R. (1999). Psychologie cognitive. Paris : Armand
Colin.
Delay, J. (1950). Les dissolutions de la mémoire.
Paris : P.U.F.
De Ketele, J.-M. (1990). Rédiger un rapport
scientifique. Brochure de cours non publiée, Université
Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique.
Doron, R., & Parot, F. (1991). Dictionnaire de
psychologie. Paris : P.U.F.
Faverge, J.-M. (1966). Méthodes statistiques en
psychologie appliquée. Paris : P.U.F. Filloux, J-C. (1967). La
mémoire (Collection Que Sais-Je ?). Paris : P.U.F. Fontaine, R.
(1999). Manuel de Psychologie du vieillissement. Paris : Dunod.
Gakobwa, B. (1998). Le langage gestuel dans la famille
burundaise ayant un membre sourd.
Mémoire de licence non publié, Université
du Burundi (Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Education), Bujumbura, Burundi.
Geaudreau, J., & Canavaro, A. (1990). L'éducation
des personnes handicapées hier et
aujourd'hui. Montréal : Université de
Montréal (Faculté des Sciences de l'Education). Ghiglione, R.,
& Richard, J.-F. (Ed.). (1999). Cours de psychologie : Bases,
méthodes et
épistémologie. Paris : Dunod.
Gribenski, A. (1957). L'audition. Paris : P.U.F.
Hakizimana, L. (1995). Les barrières
socioprofessionnelles et pédagogiques qui handicapent la
réintégration du sourd dans la
société. Mémoire de licence non publié,
Université du Burundi
(Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education),
Bujumbura, Burundi. Halbwachs, M. (1975). Les cadres sociaux de la
mémoire (Réédition). Paris : P.U.F. Houdé, O.,
Kayser, D., Koenig, O., Proust, J., & Rastier, F.(1998). Vocabulaire de
sciences
cognitives. Paris: P.U.F.
Ivanov, S. (1973). Les mystères de la
mémoire. Moscou : Editions Mir.
Lafon, R. (1976). Vocabulaire de psychopédagogie et de
psychiatrie de l'enfant. Paris : P.U.F. Lang, J.L. (1976). L'enfance
inadaptée. Paris : P.U.F.
Lavallée, M. (1989). Les conditions
d'intégration des écoliers en difficulté d'adaptation et
d'apprentissage. Montréal : P.U.Q.
Lieury, A. (1975). La mémoire : Résultats et
théories. Bruxelles : Dessart, &Mardaga.
Matlin, M.W. (2001). La cognition : Une introduction à
la psychologie cognitive. Bruxelles : De Boeck Université.
Michaux, L. (1974). La mémoire. Paris : Librairie
Hachette.
Muhitira, S. (1984). Des représentations de quelques
familles de Bujumbura en rapport avec l'inaptitude de leurs enfants
sourds-muets à la communication. Mémoire de licence non
publié, Université du Burundi (Faculté de Psychologie et
des Sciences de l'Education), Bujumbura, Burundi.
Naniwe, A. (1995). Problèmes
médicopsychopédagogiques des enfants handicapés.
Notes
de cours non publiées, Université du Burundi
(Faculté de Psychologie et des Sciences de . l'Education), Bujumbura,
Burundi
Ndayikeza, C. (2009). Contribution à l'étude des
effets psychopathologiques du vieillissement : Mise à l'épreuve
de la mémoire à court terme des personnes âgées du
Burundi. Mémoire de licence non publié, Université du
Burundi (Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education),
Bujumbura, Burundi.
Ndayisaba, J., & De Grandmont, N. (1999). Les enfants
différents : Les comprendre pour mieux les aider. Québec :
Editions Logiques.
Nijimbere, M.C. (1991). Etude des problèmes
posés par les modes de communication utilisés dans
l'éducation des handicapés auditifs au Burundi: Cas des centres
de Gitega et de Kamenge. Mémoire de licence non publié,
Université du Burundi (Faculté de Psychologie et des Sciences de
l'Education), Bujumbura, Burundi.
Niyongabo, J. (2006). Cours de Statistiques 1. Syllabus de
cours, Université du Burundi (Faculté de Psychologie et des
sciences de l'Education), Bujumbura, Burundi.
Niyonsaba, G. (2008). Problématique de la prise en
charge psychosociale des handicapés auditifs en milieu
institutionnel. Mémoire de licence non publié,
Université du Burundi (Faculté
de Psychologie et des Sciences de l'Education), Bujumbura,
Burundi.
& Paris: Agence de Coopération Culturelle et
Technique. Oléron, P. (1969). Les sourds muets. Paris: P.U.F.
Piaget, J., & Inhelder, B. (1968). Mémoire et
intelligence. Paris: P. U.F.
Pélicier, Y. (Dir.) (1981). La vie psychologique
normale. Univers de la psychologie (tome
II & II). Paris : Editions Lidis.
Robert, P. (1981). Petit Robert I. Paris:
Le Robert.
Rondal, J.-A., & Seron, X. (Ed.). (1999).Troubles du
langage: Bases théoriques, diagnostic et
rééducation. Sprimont (Belgique): Pierre
Mardaga.
Sillamy, N. (1980). Dictionnaire encyclopédique de
psychologie. Paris: Bordas.
Trannoy, A. (1971). Adaptation des enfants handicapés
physiques. Paris: Casterman.
Sockeel, P., & Anceaux, F. (2002). La démarche
expérimentale en psychologie. Paris: IN PRESS EDITIONS.
Tremblay, L. (1987). Lettre circulaire aux abonnés du
service des plaques porte-clés. Montréal: Association les
amputés de guerre du Canada, succursale de Québec.
Virole, B. (Ed.). (2000). Psychologie de la
surdité. Bruxelles: De Boeck université.
Wall, W.D. (1955). Education et santé mentale.
Paris: I.F.M.R.P.
ANNEXE
PRISE DE CONTACT AVEC LES SUJETS ET CONSIGNE A. Prise de
contact et consigne en Kirundi
A0. Prise de contact et motivation
Ndabaramukije. Nitwa REGINAS NDAYIRAGIJE. Ndiko ngerageza
kuraba ko hari ubudasa bwoba buri hagati y'abanyeshuri bumva n'abatumva mu
bijanye no gufata ku mutwe. Kugira bishoboke ndaza kubaha ikibazo co gufata ku
mutwe. Munyuma, nzogikosora ndabahe amanuta mukwiye, ni ukuvuga bivanye
n'igitigiri c'inyishu nziza muzoba mwashoboye kwibuka mukandika. Ndabasavye ko
mwokorana ishaka mukamenya kuko ni ihiganwa hagati ya mwebwe n'abandi
banyeshure bumva/batumva.
A.1. Consigne générale
Tuza gutangurira ku myimenyerezo ibiri. Muri iyo myimenyerezo
ibiri, murafise uburenganzira bwo kumbaza ibibazo ku vyo mudatahura neza. Mu
nyuma duca dutandukira ikibazo nyamukuru. Mu gihe c'ikibazo nyamukuru, nta
burenganzira bwo kumbaza ibibazo muzoba mugifise, musabwe gusa guca mwandika
inyishu , ni ukuvuga amajambo muzoba mwafashe ku mutwe.
A.2. Consigne pour l'épreuve de rappel
libre
Muri aka kabazo ka mbere, ndabasavye mubanze mwuzuze ku
rupapuro rwa mbere amazina n'amatazirano yanyu, igitsina canyu (ko uri umuhungu
canke umukobwa), imyaka yanyu n'ishuri mwigamwo. Munyuma ndaza gusaba izi
mashini zanje ko zibereka amajambo icenda mu kiringo c'amasegonda cumi n'atanu
gusa. Ico gihe c'amasegonda cumi n'atanu giheze, nca nyegeza ayo majambo.
Mpejeje kuyanyegeza, ubwo nyene muce munyandikira ku rupauro nzoba mpejeje
kubereka amajambo yose mwibuka muri ayo icenda muba muhejeje kubona. Ivyo
bisigura ko uwuza kwibuka amajambo yose azoba atoye ikibazo. Uko mwandika
amajambo menshi mu yo mwabonye ni kwo muronka amanuta menshi. Umwimenyerezo
umwe umwe umara amasegonda mirongo ine n'atanu gusa. Mutegerezwa kugerageza
mukandika ibisomeka kugira ntimuhave mutakaza amanuta.
A.3. Consigne pour l'épreuve de
reconnaissance
Muri aka kabazo kagira kabiri, ndaza kubereka urukwirikirane
rw'amajambo icenda mu kiringo c'amasegonda cumi n'atanu gusa. Mpejeje
kuyabereka nca ndayazimanganya, hanyuma nce ndabereka uwundi murwi w'amajambo
cumi n'umunani. Muri ayo majambo cumi n'umunani harimwo amwe icenda ya mbere
mwari muhejeje kubona. Mugihe muzoba muriko mwandika inyishu, ayo majambo cumi
n'umunani aguma ari imbere yanyu atanyegeje. Igikorwa canyu ni ugutora muri ayo
majambo cumi n'umunani amwe icenda ya mbere na mbere nari nazimanganije muce
muyandika ku rupapuro. Umwanya ndabaha kugira mwandike inyishu n'amasegonda
mirongo ine n'atanu gusa. Inyishu nziza yose muza gutanga muzoyironkako inuta
rimwe. No ngaha nyene, imbere yo gutangura akabazo nyamukuru, ndabaha
imyimenyerezo ibiri. Mu kiringo c'imyimenyerezo, murashobora kubaza utubazo
twose mwiyumvira dufatiye ku gikorwa musabwe gukora, nanje ndaheza ndabishure.
Mu gihe tuzoba twatanguye akabazo nyamukuru, nta burenganzira bwo gusiguza
muzoba mugifise. Muza kwandika gusa inyishu, ni ukuvuga amajambo icenda mutoye
muri ayo cumi n'umunani mwibuka ko mwari muhejeje kubona muri rwa rukurikirane
rwa mbere rw'amajambo icenda
B. Traduction en français de la consigne B0. Prise
de contact et motivation
Bonjour. Je m'appelle RÉGINAS NDAYIRAGIJE. Je suis en
train de chercher à découvrir si des écoliers entendant et
ceux non entendant ont ou pas les mêmes capacités de
mémorisation. Pour pouvoir faire cette comparaison, je vais vous
proposer des exercices de mémorisation. Je corrigerai vos
réponses et vous donnerai les points mérités,
c'est-à-dire en fonction des bonnes réponses que vous aurez
réussies à rappeler. Je vous invite donc à bien travailler
pour réussir le test car il s'agit d'une compétition entre vous
et d'autres écoliers entendant/non entendant.
B.1. Consigne générale
Avec le test proprement dit, vous n'aurez plus le droit de me
poser des questions, vous allez seulement écrire les réponses,
c'est-à-dire les mots mémorisés.
B.2. Version en français de la consigne pour
l'épreuve de rappel libre
Dans cette première épreuve, je vous demande
d'abord d'écrire à la première page votre nom et votre
prénom, votre sexe, votre age et votre école. Ensuite, je vais
projeter sur l'écran disposé devant vous une liste de neuf mots.
Quinze secondes après la projection de cette liste de neuf mots, je vais
faire disparaître la liste. A la suite de cette disparition, votre
tâche sera d'écrire immédiatement sur la page que je vous
aurai indiquée le maximum de mots possible parmi les mots
précédemment lus. A chaque bonne réponse correspond un
point. Gela signifie que celui qui aura reproduit beaucoup de mots aura plus de
points. Ghaque exercice dure quarante-cinq secondes seulement. Je vous
recommande de faire votre mieux pour écrire le plus lisiblement possible
afin de ne pas perdre gratuitement des points.
B.3. Version en français de la consigne pour
l'épreuve de reconnaissance
Dans cette seconde épreuve, je vais d'abord vous
présenter une liste de neuf mots pendant quinze secondes puis la faire
disparaître. Après cette disparition, je vais projeter devant vous
une autre liste de dix- huit mots mais parmi lesquels figurent les neuf qui
venaient de vous être montrés et neuf autres. Les dix-huit mots
resteront affichés devant vous quand vous serez en train d'écrire
les bonnes réponses. Votre tâche sera de reconnaître parmi
les dix-huit mots les neuf premiers de la dernière liste et de les
écrire sur votre bloc- papiers à la page indiquée. Le
temps qui vous est accordé pour écrire les réponses est de
quarante-cinq secondes seulement. A chaque bonne réponse, correspond un
point.
Nous allons d'abord faire deux exercices d'entraînement
pendant lesquels vous allez poser toutes les questions que vous pourrez avoir
et je vais y répondre. Ensuite va venir le moment de l'épreuve
proprement dite. Quand celle-ci aura commencé, vous ne pourrez plus me
poser de questions, vous allez seulement écrire les neuf mots que vous
reconnaîtrez avoir fait partie de la récente liste de neuf
mots.
| 


