Institut national universitaire
Jean-François Champollion
Département Sciences humaines et sociales
Master 1 Gestion de l'environnement
Parcours Valorisation des ressources territoriale
Etude de l'état et de la valorisation des
fruitiers sauvages en zone Afrique tropicales
Cas de la commune Ndali Bénin.
Mémoire de recherche
Achraf ISSIAKOU
Présentation le 14 juin 2024
Tuteur : Mehdi SAQALLI chargé de recherches CNRS UMR 5602
GEODE Géographe de l'Environnement, Maison de la Recherche,
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
Membres du jury :
MARTORELL Frédéric, Chargé d'étude
observatoire et prospective, DDT du Tarn. Chargé de cours SIG,
aménagement, INU Champollion, Albi
AULAGNIER Stéphane, co-responsable de la formation, INU
Champollion, professeur permanent, université Paul Sabatier
Toulouse, cefs-Inare
Remerciements
Ce mémoire de recherche a pu aboutir grâce
à l'implication de plusieurs personnes envers lesquelles je tiens
à témoigner ma profonde gratitude.
Je pense en particulier à mon
tuteur de recherche, Monsieur Mehdi SAQALLI, pour ses conseils
éclairés, sa disponibilité et son soutien tout au long de
ce projet de recherche.
J'exprime aussi ma profonde gratitude à l'ensemble du
corps professoral du master Gestion Sociale de l'Environnement et Valorisation
des Ressources Territoriales dont les enseignements et les encouragements ont
façonné mon parcours universitaire. Un remerciement particulier
aux responsables pédagogiques du master, Frédérique BLOT,
Stéphane AULAGNIER et Aurélie DUPART.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
la commune de N'dali et à ses habitants pour leur accueil chaleureux et
leur collaboration durant la phase de terrain. Sans leur participation active
et leurs témoignages, cette étude n'aurait pas pu être
réalisée. Un merci spécial à Mohamadou SALIFOU pour
son assistance précieuse dans la collecte des données.
Je m'en voudrais de ne pas remercier mes collègues et
amis, en particulier Abdoul Aziz BOUKARY, pour ses discussions stimulantes, son
soutien moral et ses encouragements tout au long de cette période
intense de rédaction.
Je rends un hommage particulier à ma famille, pour leur
amour inconditionnel, leur patience et leur soutien sans faille. Sans eux, ce
projet n'aurait pas pu voir le jour.
Enfin, je remercie toutes les personnes et institutions qui,
de près ou de loin, ont contribué à la réussite de
ce travail de recherche.
À tous, je vous exprime ma plus profonde reconnaissance
et vous dédie ce mémoire.
Sigles
ASECNA : Agence pour la
sécurité aérienne en Afrique et à
Madagascar
DGFRN : Direction Générale
des Forêts et des Ressources Naturelles
FAO : Food and Agriculture
Organization
IGN : Institut Géographique
Nationale
INSAE : Institut National de la
Statistique et de l'analyse Économique
MOOC: Massive Open Online Course
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PAPF : Plans d'Aménagement
Participatifs des Forêts
PFNL : Les Produits Forestiers Non
Ligneux
Liste des tableaux
Tableau 1 : Répartitions de
l'échantillon par village
27
Tableau 2 : Caractéristiques de
l'échantillon
33
Tableau 3 : Espèces végétales
fruitières recensées et les parties utilisées
38
Tableau 4 : Valeur d'usage ethnobotanique des
espèces fruitières sauvages utilisées
40
Tableau 5 : Noms scientifiques, d'usage et locales
des espèces
65
Tableau 6 : Catégories d'usage des
plantes
66
Liste des figures
Figure 1 : Localisation géographique du
milieu d'étude
20
Figure 2 : Carte de la végétation de
la commune de N'dali
22
Figure 3
: Espèces fruitières sauvages
utilisées par les riverains de N'dali 34
Figure 4 :
Proportion d'utilisation des différentes
espèces fruitières sauvages par catégories d'usage
35
Figure 5 : : Fréquence d'usage des
espèces fruitières sauvages
39
Figure 6 : Période d'accessibilité
aux espèces fruitières sauvages
40
Figure 7 : Images de fruits de néré,
poudre et moutarde
43
Figure 8 : Images des amandes de karité et
ses dérivés (beurre et savon)
46
Figure 9 : Feuilles séchées de baobab
et la corde issue de ses écorces
48
Figure 10 : Huile de palme et le fruit
50
Figure 11 : Principales sources de revenu des
enquêteurs
52
Résumé
Cette étude ethnobotanique a été
réalisée au niveau des populations riveraines de la forêt
de N'dali. Elle a permis de décrire les différentes formes
d'utilisation des espèces végétales ligneuses par les
populations et de calculer les valeurs d'usage ethnobotanique associées
à ces espèces. Vingt-trois espèces ligneuses ont
été inventoriées. Diverses usages sont faits de ces
espèces : médicinal, alimentaire, élevage, artisanat, bois
d'énergie, cosmétique ou soins corporels et rituels.
Vitellaria paradoxa (VUT= 8,68), Parkia
biglobosa (VUT= 7,14), Vitex doniana
(VUT=7,01), Adansonia digitata
(VUT= 6,98), Blighia sapida (VUT=
6,92) et Tamarindus indica (VUT= 6,88) sont les
espèces végétales les plus utilisées par les
populations. Au total, l'étude met l'accent sur l'importance de la
valeur d'usage ethnobotanique comme outil de base pour sélectionner les
espèces sur lesquelles l'accent devra être mis dans les plans
d'aménagement pour répondre non seulement au besoin d'utilisation
des populations mais aussi pour améliorer le statut de conservation des
espèces.
Abstract
This ethnobotanical study was conducted among the populations
living near the N'dali forest. It aimed to describe the various forms of use of
woody plant species by the local populations and to calculate the
ethnobotanical use values associated with these species. Twenty-three woody
species were inventoried. These species are used for various purposes:
medicinal, nutritional, livestock, craftsmanship, energy wood, cosmetic or body
care, and ritual uses. Vitellaria paradoxa (Total Use Value = 8.68), Parkia
biglobosa (Total Use Value = 7.14), Vitex doniana (Total Use Value = 7.01),
Adansonia digitata (Total Use Value = 6.98), Blighia sapida (Total Use Value =
6.92), and Tamarindus indica (Total Use Value = 6.88) are the most commonly
used plant species by the populations. Overall, the study highlights the
importance of ethnobotanical use value as a fundamental tool for selecting
species to focus on in management plans, not only to meet the usage needs of
the populations but also to improve the conservation status of the species.
Table des matières
Remerciements
1
Sigles
2
Liste des tableaux
3
Liste des figures
4
Résumé
5
Abstract
6
Table des matières 7
Introduction
9
Chapitre 1 : Problématique et revue de
littérature
11
1.1.
Contexte et justification de
l'étude 12
1.2.
Objectif général et objectifs
spécifiques de l'étude 12
1.3.
Hypothèses 13
1.4.
Définition des Concepts Clés
13
1.4.1.
PFNL 13
1.4.2.
Fruitiers Sauvages 14
1.4.3.
Valorisation des fruitiers sauvages
14
1.4.4.
Afrique tropicale 14
1.5.
Revue de la littérature 15
Chapitre 2 : Méthodologie de
recherche
18
1.
Description de la zone d'étude : N'dali, ses
caractéristiques géographiques, climatiques, et
socio-économiques 19
1.1.
Situation géographique 19
1.2.
Facteurs biophysiques 21
1.2.1.
Climat 21
1.2.2.
Relief et sols 21
1.2.3.
Sols 21
1.2.4.
Végétation 22
1.2.5.
Hydrographie 23
1.3.
Facteurs Humains 23
1.3.1.
Population et Démographie 23
1.3.2.
Activités Économiques
24
1.3.2.1.
Agriculture 24
1.3.2.2.
Élevage 24
1.3.2.3.
Exploitation forestière 24
1.3.2.4.
Commerce 25
1.3.3.
Pression sur les Ressources
Forestières 25
1.3.3.1.
Déforestation 25
1.3.3.2.
Collecte de bois de chauffe 25
1.3.4.
Gestion et conservation des ressources
forestières 26
1.3.4.1.
Initiatives communautaires 26
1.3.4.2.
Politiques gouvernementales 26
1.3.4.3.
Projets de conservation 26
2.
Méthodes d'échantillonnage et de
collecte des données sur les fruitiers sauvages 27
2.1.
Méthode de collecte de données
ethnobotaniques et outils de collecte 27
2.2.
Traitement et analyse des données
collectées 28
2.2.1.
Analyse univariée 29
2.2.2.
Analyse bivariée 29
2.2.3.
Valeur d'usage ethnobotanique 29
Chapitre 3 : Résultats et
discussion
32
1.
État des lieux des fruitiers sauvages
à N'dali 33
1.1.
Description de l'échantillon
33
1.2.
Espèces fruitières sauvage à
N'dali 33
1.3.
Différents usages des espèces
fruitières sauvage de la forêt de N'dali 34
1.4.
Utilisation des parties des espèces
fruitières sauvage exploitées par les populations riveraines de
la forêt de N'dali 35
1.5.
Fréquences d'usage des espèces par la
population locale 39
1.6.
Périodes d'accessibilité aux
espèces et leur accès 40
1.7.
Valeur d'usage ethnobotanique des espèces
végétales sauvages 40
2.
Valorisation des fruitiers sauvages à
N'dali 41
2.1.
Analyse des pratiques de valorisation
traditionnelles des fruitiers sauvages 41
2.2.
Identification des opportunités de
valorisation économique 51
2.3.
Proposition de stratégies de valorisation
durable et de gestion des ressources : gestion vs conservation
raisonnée des espèces 52
3.
Discussion 54
Conclusion
56
Bibliographie
58
Annexe
65
Introduction
Les produits forestiers non ligneux, y compris les fruits
sauvages, suscitent un intérêt croissant ces dernières
décennies, comme en témoignent les nombreuses études et
rencontres scientifiques qui leur sont dédiées (Falconer 1990 ;
Malaise 1993 ; Lamien 2006, Kabaka 2021, Oukara et al., 2024). Cet
intérêt se manifeste également en milieu rural,
principalement en raison de la réduction du pouvoir d'achat de la
majorité de la population rurale et des revenus substantiels que ces
produits génèrent (Malaisse 1997). Cependant, malgré cet
intérêt accru, on observe une diminution progressive des
connaissances relatives aux fruits sauvages. Les changements rapides des
comportements socioculturels, la réduction des contacts avec la nature
et la disparition des écosystèmes naturels en sont les
principales causes (Malaisse 1997 ; Ramirez 2007, Dissou et al., 2020). Or, les
connaissances endogènes constituent une composante essentielle de la
biodiversité locale (Pilgrim et al. 2007).
En Afrique tropicale, les fruitiers sauvages jouent un
rôle crucial pour les communautés locales, en particulier dans les
zones rurales. Ces ressources naturelles offrent non seulement une source
importante de nourriture (Codjia et al 2003) et de revenus (Dossou, 2003), mais
elles contribuent également à la médecine traditionnelle
et à diverses pratiques culturelles (Dossou, 2003). Au Bénin,
plus de 35 espèces fruitières sauvages sont consommées
dans les régions de la Lama, avec plus de 33 espèces disponibles
tout au long de l'année (Codjia et al., 2009). Une diversité
assez importante et qui pourrait être mieux si l' inventaire prenait le
nord du pays en compte.
Malgré leur diversité et leur importance, les
fruitiers sauvages sont souvent négligés dans les politiques de
conservation et de développement, laissant un vide dans la documentation
scientifique et les stratégies de valorisation. La commune de N'dali,
située au nord du Bénin, illustre parfaitement cette situation.
Bien que cette région soit riche en biodiversité, les pressions
anthropiques et les changements climatiques menacent l'équilibre
écologique et la survie de nombreuses espèces de fruitiers
sauvages. Face à ces défis, il est impératif
d'évaluer l'état actuel de ces ressources et d'explorer des
moyens de les valoriser durablement. La valorisation des fruitiers sauvages
pourrait répondre à des enjeux majeurs tels que la
sécurité alimentaire, la préservation de la
biodiversité, et le développement économique local.
(Codjia et al., 2003 ;Sabi et al., 2017 ; El Hadj-Issa et al., 2021). Face
à ces défis, il est crucial de faire un état des lieux et
de réaliser une évaluation approfondie de l'état actuel
des fruitiers sauvages à N'dali, de comprendre leur utilisation par les
populations locales, et d'identifier des stratégies pour leur
valorisation durable .
Chapitre 1 :
Problématique et revue de littérature
1.1. Contexte et justification de l'étude
Les PFNL, dont les fruitiers sauvages font partie, ont
été largement étudiés pour leur contribution
à la subsistance et à l'économie des ménages
ruraux. Diverses études ont montré l'importance de ces ressources
pour les populations locales (FAO, 2002 ; Falconer, 1996). Pourtant, leur
potentiel reste largement sous-exploité et sous-valorisé dans les
politiques de développement rural. Cette étude se justifie par
plusieurs aspects. Premièrement, elle répond à un besoin
crucial de documentation scientifique sur la biodiversité locale,
mettant en lumière des ressources souvent négligées mais
potentiellement vitales. Deuxièmement, dans un contexte global de
changements climatiques et de pressions sur les ressources naturelles, cette
recherche contribuera à une meilleure compréhension des facteurs
influençant la diversité des fruitiers sauvages. Enfin, la
valorisation durable de ces ressources peut constituer une réponse
novatrice aux enjeux de sécurité alimentaire et de
développement économique dans la commune de N'dali. En comblant
un vide scientifique et en offrant des perspectives nouvelles, cette
étude contribuera aux efforts de préservation et de
développement durable.
Dans ce contexte, la question centrale de cette étude
est quel est l'état des lieux actuel de la diversité des
fruitiers sauvages dans la commune de N'dali ? Quelles sont les
stratégies de valorisation qui pourraient contribuer de manière
significative à la sécurité alimentaire et au
développement durable des communautés locales de la Commune de
N'dali ?
1.2. Objectif général et objectifs
spécifiques de l'étude
Cette étude vise à combler un vide scientifique
en documentant la diversité des fruitiers sauvages de la commune de
N'dali, à offrir des perspectives nouvelles et à contribuer aux
efforts de préservation et de développement durable.
De façon spécifique il s'agit :
O1 : Identifier et répertorier les
différentes espèces de fruitiers sauvages présents en zone
forestière de N'dali.
O2 : Recenser les différents usages
des fruitiers sauvages par les populations locales et leur importance dans la
sécurité alimentaire.
O3 : Analyser les techniques de
récolte, de transformation et de conservation des fruits issus des
fruitiers sauvages.
1.3. Hypothèses
Afin d'atteindre ces objectifs, les hypothèses
suivantes ont été formulées :
H1 : La forêt classée de N'dali
abrite une diversité significative d'espèces de fruitiers
sauvages, avec des variations écologiques importantes en termes de types
de sols, de climat et d'altitude.
H2 : Les communautés locales de N'dali
ont des connaissances approfondies sur les usages traditionnels des fruitiers
sauvages, les intégrant dans divers aspects de leur vie quotidienne,
tels que la cuisine, la médecine traditionnelle, et l'artisanat.
H3 : En identifiant les opportunités
de valorisation durable, il est possible de créer des synergies entre la
conservation des fruitiers sauvages, les besoins nutritionnels de la population
locale, et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement
1.4. Définition des Concepts Clés
1.4.1. PFNL
La définition des produits forestiers non-ligneux
(PFNL) de la FAO est probablement la plus appropriée pour nous : Les
PFNL sont des « biens d'origine biologique autres que le bois,
dérivés des forêts, d'autres terres boisées et des
arbres hors forêts ». Ce sont des substances, des matières
premières ou des matériaux utiles obtenus des forêts sans
exploitation forestière, c'est-à-dire sans qu'il soit
nécessaire d'abattre l'arbre (Simons, 1996). Les PFNL peuvent être
récoltés dans la nature, ou produits dans des plantations
forestières des périmètres d'agroforesterie ou par des
arbres hors forêt. Des exemples de PFNL comprennent des produits
utilisés comme nourriture et additifs alimentaires (noix comestibles,
champignons, fruits, herbes, épices et condiments, plantes aromatiques,
viande de gibier), fibres (utilisées dans la construction, les meubles,
l'habillement ou les ustensiles), résines, gommes, et produits
végétaux et animaux utilisés pour des buts
médicinaux, cosmétiques ou culturels" (FAO, 2002). D'autres
appellations comme « produits non-ligneux des arbres » ou encore
« produits agroforestiers » pourraient être
utilisées.
1.4.2. Fruitiers Sauvages
Les fruitiers sauvages se réfèrent aux
espèces arboricoles produisant des fruits comestibles et qui poussent
sans intervention humaine directe. Ces plantes sont souvent trouvées
dans les écosystèmes naturels et semi-naturels, et sont
exploitées pour leurs fruits, leurs graines, et d'autres parties
utilisables (Okullo et Waithaka, 2005).
Des recherches sur les produits forestiers non ligneux (PFNL)
soulignent l'importance des fruitiers sauvages en tant que source de nutrition,
de médicaments traditionnels et de matériaux pour les populations
locales (FAO, 2014).
1.4.3. Valorisation des fruitiers sauvages
Elle désigne l'ensemble des pratiques et
stratégies visant à reconnaître, promouvoir et utiliser de
manière durable les fruits produits par ces arbres. Cela englobe la
récolte, la transformation, la commercialisation et la conservation des
produits issus de ces fruitiers. Les travaux antérieurs indiquent que la
valorisation peut contribuer à la sécurité alimentaire,
à la génération de revenus et à la conservation de
la biodiversité (Leakey et al., 2012). Des études ont
montré que la transformation des fruits en produits à valeur
ajoutée, tels que les confitures, les jus et les huiles, peut
améliorer significativement les moyens de subsistance des
communautés locales (Shackleton et al., 2002).
1.4.4. Afrique tropicale
L'Afrique tropicale se réfère
à la région située entre le Tropique du Cancer et le
Tropique du Capricorne, caractérisée par un climat tropical avec
des variations saisonnières de température et de
précipitations. Cette zone est riche en biodiversité et abrite de
nombreux écosystèmes, incluant des forêts tropicales, des
savanes et des zones humides. Les études sur les PFNL dans cette
région montrent que les écosystèmes tropicaux sont
particulièrement importants pour la conservation de la
biodiversité et la fourniture de services écosystémiques
essentiels (Ndoye et Tieguhong, 2004).
1.5. Revue de la littérature
La présente étude vise à explorer
l'état et la valorisation des fruitiers sauvages dans la commune de
N'dali, située en zone Afrique tropicale. Les fruitiers sauvages jouent
un rôle crucial dans les écosystèmes et les
économies locales, en particulier dans les zones rurales où ils
constituent une source importante de nutrition et de revenus. Cette section
présente une revue de la littérature visant à
synthétiser les connaissances actuelles sur les fruitiers sauvages en
Afrique tropicale, les recherches antérieures sur leur valorisation dans
diverses régions, et un focus sur la situation spécifique de la
commune de N'dali au Bénin.
Codjia et al. (2003) ont bien raison lorsqu'ils affirment que
les forêts tropicales constituent une source et un réservoir
potentiel d'espèces ligneuses qui sans être productrice de bois
d'oeuvre jouent un rôle socio-économique important en fournissant
des aliments et des plantes médicinales. Ces produits ont aussi une
importance capitale sur les plans religieux et socioculturel.
Les fruitiers sauvages en Afrique tropicale sont des
espèces végétales qui poussent naturellement dans les
forêts, les savanes et les zones montagneuses. Ces plantes sont souvent
bien adaptées aux conditions climatiques locales et jouent un rôle
vital dans la sécurité alimentaire des communautés
rurales. Les fruits sauvages, tels que le tamarin (Tamarindus indica),
le baobab (Adansonia digitata), et le karité (Vitellaria
paradoxa), sont riches en nutriments essentiels et en composés
bioactifs bénéfiques pour la santé humaine (Maundu et al.,
2001)
Les fruitiers sauvages en Afrique tropicale
représentent une richesse écologique considérable et
contribuent à la biodiversité en fournissant un habitat et une
source de nourriture pour la faune. Ils jouent un rôle dans la
stabilisation des sols et la régulation des cycles hydrologiques
(Teklehaimanot, 2004). D'après Assogbadjo et al. (2012), ces fruitiers
offrent une diversité génétique importante, essentielle
pour la résilience des écosystèmes face aux changements
climatiques. Des études menées par Akinnifesi et al. (2008)
montrent que des espèces comme Adansonia digitata (baobab),
Vitellaria paradoxa (karité) et Parkia biglobosa
(néré) sont largement répandues et utilisées par
les populations locales.
Selon (Akinnifesi et al., 2008) ces fruitiers
représentent une source de revenus grâce à la
récolte et à la commercialisation des fruits, ce qui est
particulièrement crucial pour les populations rurales vivant en dessous
du seuil de pauvreté.
Les recherches de Kouyaté et Van Damme (2006) mettent
en évidence l'importance culturelle et nutritionnelle de ces fruitiers.
Par exemple, le baobab est non seulement une source de nourriture mais aussi de
médicaments traditionnels. En outre, une étude de FAO (2019)
rapporte que les fruits sauvages contribuent jusqu'à 40 % de l'apport en
vitamines A et C des populations rurales en Afrique subsaharienne.
La valorisation des fruitiers sauvages passe par plusieurs
axes : la conservation, l'utilisation durable et la commercialisation.
D'après Leakey et al. (2005), la domestication des fruitiers sauvages
est une stratégie efficace pour améliorer leur
productivité et leur qualité. Cette domestication permet de
sélectionner des variétés à haut rendement et
à meilleure valeur nutritive.
En ce qui concerne la commercialisation, Ndoye et Tieguhong
(2004) soulignent que les marchés locaux et internationaux offrent des
opportunités pour les produits dérivés des fruitiers
sauvages. Par exemple, le beurre de karité et la poudre de baobab
connaissent une demande croissante sur les marchés internationaux.
Cependant, le défi reste la standardisation et la certification des
produits pour assurer leur compétitivité.
La commune de N'dali présente un potentiel notable pour
la valorisation des fruitiers sauvages. Une étude de Sinsin et al.
(2011) montre que cette région possède une grande
diversité de fruitiers sauvages, notamment Tamarindus indica
(tamarin), Spondias mombin (mombin) et Irvingia gabonensis
(mangue sauvage). Ces espèces sont intégrées dans les
systèmes agroforestiers locaux, contribuant ainsi à la
sécurité alimentaire et à la résilience
économique des ménages.
Ces espèces sont intégrées dans des
systèmes agroforestiers qui combinent arbres fruitiers, cultures
vivrières et parfois bétail. Cela permet une utilisation
efficiente des ressources et augmente la productivité des terres.
Les fruitiers sauvages, bien qu'initialement non
domestiqués, sont de plus en plus cultivés par les agriculteurs
locaux. Ces derniers sélectionnent les arbres les plus productifs et les
plantent autour de leurs habitations ou dans des parcelles spécifiques.
La culture de ces arbres permet d'assurer une production
régulière de fruits, même pendant les périodes de
pénurie alimentaire
Les fruitiers sauvages sont également
protégés au sein des systèmes agroforestiers. Cette
protection peut se manifester par la conservation des arbres existants lors de
la mise en culture des terres agricoles. Les agriculteurs évitent de
couper ces arbres et peuvent même mettre en place des mesures de
protection contre les animaux et les activités humaines nuisibles.
Adjatin et al. (2013) a réussi à former les
communautés locales à la transformation et à la
commercialisation de produits à base de tamarin et de mombin. Les
résultats montrent une augmentation significative des revenus des
ménages participants, soulignant le potentiel économique de la
valorisation des fruitiers sauvages.
Malgré les avancées, plusieurs défis
subsistent. La déforestation et l'expansion agricole menacent la survie
des fruitiers sauvages. Les recherches de Teklehaimanot (2004) appellent
à des politiques de conservation intégrées, associant les
communautés locales. Par ailleurs, la variabilité climatique pose
un risque pour la reproduction et la production des fruitiers.
Pour répondre à ces défis, des approches
participatives impliquant les communautés locales dans la gestion et la
conservation des ressources fruitières sont essentielles. Des
initiatives comme celles décrites par Garrity (2006), qui promeuvent
l'agroforesterie et les pratiques de gestion durable, montrent des
résultats prometteurs.
L'état et la valorisation des fruitiers sauvages en
zone Afrique tropicale, et particulièrement dans la commune de N'dali,
Bénin, révèlent une richesse sous-exploitée mais
prometteuse. Les études scientifiques soulignent l'importance de ces
fruitiers pour la sécurité alimentaire, la nutrition et
l'économie locale. La domestication, la transformation et la
commercialisation des produits issus de ces fruitiers présentent des
opportunités significatives, bien que des défis persistants
nécessitent des approches intégrées et participatives pour
garantir une valorisation durable et équitable.
Chapitre 2 :
Méthodologie de recherche
1. Description de la zone d'étude :
N'dali, ses caractéristiques géographiques, climatiques, et
socio-économiques
Le contexte géographique d'une recherche est crucial
afin de comprendre les dynamiques et les interactions entre les
différents éléments d'un environnement spécifique.
Dans le nord-est du Bénin, la commune de N'dali est un exemple
intéressant pour l'étude des facteurs géographiques qui
influencent à la fois les facteurs biophysiques et humains.
1.1. Situation géographique
La commune de N'dali se situe dans le département du
Borgou, au nord-est du Bénin. Elle s'étend aux latitudes
9°36' et 9°58' Nord et aux longitudes 2°16' et 2°44' Est.
N'dali est bordée au nord par la commune de
Bembèrèkè et de Sinendé, à l'est par la
commune de Nikki et de Pèrèrè, au sud par la commune de
Parakou et de Tchaourou et à l'ouest par la commune de Djougou et de
Pehunco.
Son étendue est de 3748 km2, soit 14,50 % de la
superficie du département et 3,27 % de la superficie totale du
Bénin. Son chef-lieu (centre de N'Dali) se trouve à environ 56 km
de Parakou (capitale du département du Borgou). Selon Sogan (2014).
Le statut de la Commune de N'dali constitue un atout pour le
développement commercial et des transports et, par ricochet, pour les
relations intercommunautaires qui peuvent se développer avec les
communes voisines. En effet, le chef-lieu de la commune est situé
à côté des routes inter-états n°2 et n°6,
principal carrefour reliant Parakou, Malanville, Djougou, Togo, Nikki et
Nigéria.
La forêt de N'dali, en particulier, occupe une position
au coeur de la région, approximativement entre 9°45' et 10°30'
de latitude nord et 2°00' et 2°45' de longitude est, offrant une
riche source de ressources locales. biodiversité. Cette forêt est
importante pour la région car elle fournit une variété de
ressources naturelles nécessaires à la subsistance des
résidents environnants. Les gens dépendent des forêts pour
le chauffage et le bois de construction, pour la chasse et la cueillette de
produits forestiers non ligneux tels que les fruits, les plantes
médicinales et les herbes. De plus, la forêt de Ndali contribue de
manière significative à l'agriculture locale en régulant
le climat et en maintenant la fertilité des sols grâce à la
couverture végétale. C'est également une zone de
pâturage pour le bétail, essentielle à l'élevage,
principale activité économique de la région.
L'écosystème forestier de Ndali est riche en
biodiversité, comprenant plusieurs espèces
végétales et animales endémiques ou menacées
(oiseaux, reptiles, mammifères, etc). Cela fait de la forêt non
seulement un patrimoine naturel à protéger, mais offre
également un potentiel touristique et éducatif pour les
générations futures.
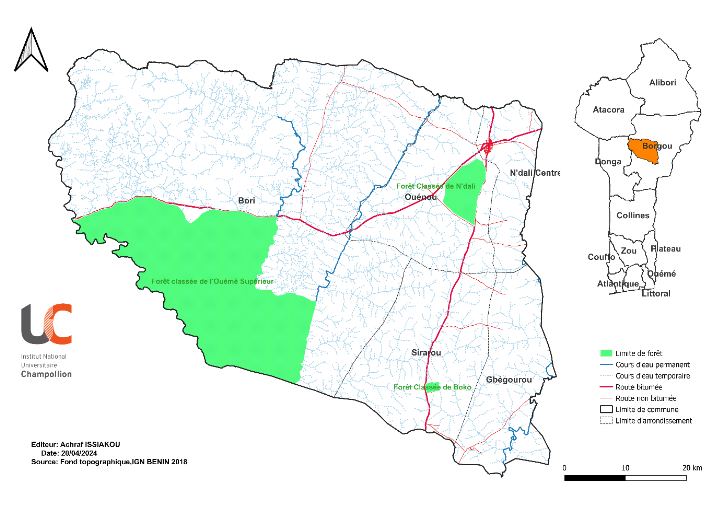
Figure 1 : Localisation
géographique du milieu d'étude
1.2. Facteurs biophysiques
1.2.1. Climat
La commune de N'dali bénéficie d'un climat
tropical soudano-guinéen, caractérisé par une saison
sèche prononcée. La saison des pluies dure
généralement de mai à octobre et la pluviométrie
annuelle moyenne est de 900 mm à 1 200 mm. La saison sèche de
novembre à mars (ASECNA, 2012). Il est dominé par le vent
Harmattan, un vent sec et poussiéreux venant du désert du Sahara.
Les températures varient entre 25°C et 35°C, culminant
à 40°C en mars et avril, créant un environnement favorable
à la formation d'une variété d'espèces
végétales.
1.2.2. Relief et
sols
La commune de N'dali présente un relief principalement
composé de plateaux ondulés et de collines
modérées, caractéristiques de la région du Borgou.
La moyenne d'altitude est d'environ 300 à 400 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Cette topographie modérée favorise le
débit des eaux et réduit les risques d'inondation, tout en
proposant des paysages diversifiés favorables à l'agriculture et
à l'élevage.
1.2.3. Sols
Les sols Ndali sont des sols ferrugineux à dominante
tropicale, riches en fer mais souvent acides et pauvres en matière
organique. Ils sont profonds, non incarnés et sensibles au lessivage
(INSAE, 2004). Leur perméabilité et porosité sont
généralement très bonnes. En revanche, ils
possèdent des réserves minérales (granites, argiles,
calcaires) et sont fortement acides avec une saturation réduite. Ils
présentent une grande homogénéité physique. En
raison des niveaux élevés de culture, les sols sont sensibles
à l'érosion, créant des contraintes importantes pour
l'agriculture (Moussa, 2014). Des argiles et des argiles sableuses se trouvent
également dans certaines régions et conviennent mieux à
certaines cultures, comme le coton, le maïs et les haricots. Parce qu'ils
ont généralement une bonne perméabilité et une
bonne porosité.
1.2.4.
Végétation
La végétation est principalement une savane
boisée, avec une flore arborescente, herbacée et arbustive. Il
s'agit également de corridors forestiers le long des cours d'eau,
dégradés par endroits par l'activité humaine. Il existe de
nombreuses plantes typiques des tropiques, notamment des espèces telles
que le karité (Vitellaria paradoxa), le néré (Parkia
biglobosa) et le baobab (Adansonia digitata) (INSAE, 2004). On note la
présence de parcelles forestières, dont la forêt
classée de l'Ouémé Supérieur et la forêt
classée de N'Dali. Ces dernières années, l'exploitation
forestière et l'exploitation incontrôlée des ressources
forestières ligneuses à des fins agricoles ont augmenté.
Cette végétation joue un rôle vital dans la vie de ses
habitants, fournissant du bois pour la construction et le chauffage, ainsi que
de la nourriture et des médicaments. La couverture
végétale contribue également à la stabilité
du sol et prévient l'érosion.
Source : IGN ; 1992 et INSAE ;
2002
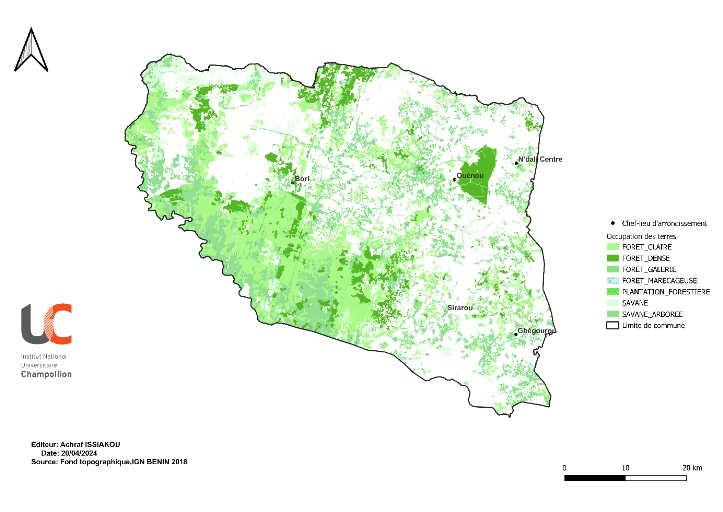 Figure 2 : Carte de la
végétation de la commune de N'dali
Figure 2 : Carte de la
végétation de la commune de N'dali
1.2.5.
Hydrographie
Située sur la ligne de partage des eaux entre les
bassins du Niger et de l'Ouémé, la ville de N'dali est une vaste
pénéplaine de gneiss granitiques. Cette plaine est rythmée
par une succession de collines qui s'étendent du nord au sud. Selon
Sogan (2014), une série de collines traverse la partie occidentale de la
commune de N'dali, située dans les régions de Tèmé
et Kori. Deux affluents de la rivière l'Ouémé, l'OKPARA et
l'APRO, forment le réseau hydrologique. De nombreuses petites
rivières, très pratiques pour la pêche, sont
également présentes sur la commune, mais jusqu'alors peu
exploitées. Selon Sogan (2014).
Ce genre de relief est avantageux pour l'agriculture en raison
de sa monotonie. De plus, la présence de la rivière offre des
opportunités de maraîchage pendant la saison sèche.
1.3. Facteurs Humains
1.3.1. Population
et Démographie
La commune de N'dali compte une population majoritairement
rurale, composée de diverses ethnies dont les Bariba, les Dendi et les
Peulh. La densité de population est relativement faible, avec environ 40
habitants par km², ce qui influence les modes d'utilisation des terres et
la pression sur les ressources forestières.
Le peuplement de la Commune de N'Dali compte une population
majoritairement rurale, composée d'une diversité de groupes
socioculturels dont le groupe Bariba et apparentés (59,1%), le groupe
Peulh et apparentés (22,4%) suivi des immigrants agricoles
constitués des Otamari (5,6%), Yom et Lokpa (3,8%) des
commerçants Yoruba (2,8%), Dendi (1,9%) et autres Nagos, Fon, Adja et
des Haoussa, Djerma venus du Niger. L'Islam constitue la religion dominante
(49,5%) suivi des religions traditionnelles (14,6%). Les catholiques et les
protestants représentent respectivement 13,7% et 3%.
L'évolution démographique au cours des trois
dernières décennies montre une population de N'Dali passant de 45
334 habitants en 1992 à 67 379 habitants en 2002. Sur la base d'un taux
d'accroissement annuel de 3,2 %, la population de 2010 est estimée
à 92 497 habitants. La densité de la population de N'Dali est
aussi en nette croissance. Elle est passée de 12,1
habitants/Km2 en 1992 à 18 habitants/Km2 au
recensement de 2002 pour une moyenne du département estimée
à 28 habitants/Km2.
L'organisation sociale est marquée par
l'hégémonie du groupe Bariba en ce sens que la plupart des chefs
traditionnels et administratifs des villages sont souvent issus de ce groupe
socioculturel. Le pouvoir traditionnel conserve encore à maints
endroits, sa prééminence et on assiste parfois à une
difficile cohabitation des pouvoirs des élus locaux incarnés par
le conseil de village, le chef de village et le Chef d'Arrondissement.
1.3.2.
Activités Économiques
1.3.2.1. Agriculture
L'agriculture est la principale activité
économique. La majorité de la population dépend de
l'agriculture de subsistance, cultivant principalement le maïs, le mil, le
sorgho, le coton et l'arachide. La culture du coton, en particulier, joue un
rôle vital en tant que culture de rente majeure et contribue de
manière significative aux revenus des ménages. Cependant, cet
avantage agricole n'est pas sans conséquences, notamment en raison de la
dégradation des sols et de la perte de fertilité due à des
pratiques agricoles non durables.
1.3.2.2. Élevage
Outre l'agriculture, l'élevage est une autre
activité économique importante. Les habitants de N'dali (les
peulh en l'occurrence) élèvent des bovins, des moutons, des
chèvres et de la volaille. L'élevage extensif contribue à
la sécurité alimentaire et aux revenus des ménages, mais
exerce également une pression sur les pâturages et les ressources
en eau.
1.3.2.3. Exploitation
forestière
L'exploitation forestière à Ndali englobe la
collecte de bois de chauffage, de bois d'oeuvre, ainsi que d'autres produits
forestiers non ligneux tels que les fruits, les feuilles et les plantes
médicinales. Ces ressources jouent un rôle crucial dans la vie des
communautés locales, que ce soit pour leur usage domestique que pour
leur commercialisation.
Contribution de l'exploitation forestière :
Énergie domestique : La cuisson utilise principalement du bois de
chauffage. Le bois d'oeuvre est employé dans la construction de maisons
et d'infrastructures. Les produits forestiers non ligneux offrent des revenus
additionnels et des ressources alimentaires et médicinales.
1.3.2.4. Commerce
Même si le commerce est moins développé
que l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière, il
s'inscrit de plus en plus dans l'économie locale. Les marchés
hebdomadaires offrent aux producteurs et aux éleveurs la
possibilité de commercialiser leurs produits. Les relations commerciales
entre N'Dali et les régions environnantes, ainsi qu'avec les pays
voisins, apportent un soutien à l'économie locale et permettent
une diversification des gains.
1.3.3. Pression sur
les Ressources Forestières
1.3.3.1. Déforestation
À N'Dali, la déforestation est un enjeu majeur,
principalement en raison de l'expansion agricole et de la demande croissante de
bois de chauffe et de charbon de bois. On transforme les forêts en terres
agricoles afin de faire face à la croissance démographique et
à la demande croissante en matière de production alimentaire. La
déforestation a pour conséquence de diminuer la
biodiversité, de détériorer les sols et de perturber les
cycles hydrologiques locaux.
1.3.3.2. Collecte de bois de chauffe
La commune utilise principalement du bois de chauffe pour la
cuisson et le chauffage. La contrainte exercée sur les forêts met
en péril leur capacité à offrir des services
écosystémiques indispensables.
Le bois de chauffe est la principale source d'énergie
pour la cuisson et le chauffage dans la commune. La collecte non
réglementée de bois conduit à une surexploitation des
ressources forestières, accélérant la dégradation
forestière. Cette pression sur les forêts compromet leur
capacité à fournir des services écosystémiques
essentiels.
1.3.4. Gestion et
conservation des ressources forestières
La gestion des ressources forestières est une
préoccupation majeure pour les autorités locales et les
organisations non gouvernementales. Divers projets de reforestation et de
gestion durable des forêts sont mis en oeuvre pour restaurer les zones
dégradées et promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement.
1.3.4.1. Initiatives communautaires
Il existe des projets communautaires tels que la mise en
oeuvre de Plans d'Aménagement Participatifs des Forêts (PAPF) sur
la base d'un contrat de gestion entre l'Etat et les communautés locales
(DGFRN, opt cit ) visant à encourager une gestion durable des ressources
forestières. Des comités villageois de gestion des ressources
naturelles ont été créés pour surveiller et
contrôler l'utilisation des ressources forestières. Ces
comités sont essentiels pour sensibiliser les populations locales aux
pratiques durables et à la reforestation
1.3.4.2. Politiques gouvernementales
En collaboration avec des organisations non gouvernementales
(ONG), le gouvernement béninois a mis en place plusieurs programmes pour
préserver les forêts. Des campagnes de reboisement,
l'amélioration des foyers pour réduire la consommation de bois de
chauffe et la promotion de l'agroforesterie pour intégrer les arbres
dans les systèmes agricoles sont incluses dans ces programmes.
1.3.4.3. Projets de conservation
Des actions de préservation particulières, comme
la mise en place de réserves forestières et la
préservation des zones de biodiversité critique, sont
également en cours. La protection des habitats naturels, la restauration
des écosystèmes dégradés et la préservation
de la biodiversité locale sont les objectifs de ces projets. Il est
crucial que les communautés locales participent à ces projets
afin d'assurer leur réussite et leur pérennité.
2. Méthodes
d'échantillonnage et de collecte des données sur les fruitiers
sauvages
2.1. Méthode de collecte de données
ethnobotaniques et outils de collecte
Pour collecter les données ethnobotaniques, un
échantillon de 52 personnes a été tiré dans cinq
villages de la commune de N'Dali (Banhoun-Gando, N'Dali-Peulh, Sakarou,
Wobakarou, Yèroumarou) qui partagent l'autorité de la forêt
de N'dali et constitué majoritairement des habitants d'appartenances
ethniques Bariba, Paulh et Dendi.
Le choix des personnes à enquêter est basé
sur une approche aléatoire et leur identification a été
faite par convenance ou en boule de neige. Pour l'échantillonnage par
convenance, le choix a été réalisé avec l'aide du
chef de village concerné et a ciblé des individus dont
l'activité, l'expérience ou le statut est en rapport avec la
thématique de recherche. On part de cette liste fournie par le chef du
village pour commencer des interviews individuelles. Les individus ainsi
interviewés fournissent à leur tour des informations sur un ou
plusieurs autres qui sont pris en compte selon leur disponibilité et
accessibilité à répondre à nos questions. Ce
schéma est poursuivi jusqu'à ce qu'on a atteint le nombre
suffisant de sujets soit disponible pour l'échantillon. Le nombre de
participants retenus par village est présenté dans le tableau 1
ci-dessous.
Tableau 1 : Répartitions de
l'échantillon par village
|
Village
|
Nombre de personnes enquêtées
|
Pourcentage (%)
|
|
Banhoun-Gando
|
9
|
17,31
|
|
N'Dali-Peulh
|
12
|
23,08
|
|
Tamarou
|
11
|
21,15
|
|
Wobakarou
|
4
|
7,69
|
|
Gouré Karé
|
16
|
30,77
|
|
Total
|
52
|
100,00
|
Source : notre enquête
Les entretiens ont été réalisés du
29 avril au 17 mai 2024. Le choix s'est porté beaucoup plus sur les
femmes, puisque ce sont elles qui valorisent plus les PFNL. Comme on le disait
plus haut, les répondants ont été questionnés
individuellement sur la base d'une fiche d'enquête. Les principales
données collectées lors des enquêtes sont relatives
à : (i)- espèces végétales utilisées, (ii)-
parties de l'espèce végétale exploitée (iii)- nom
en langue locale des plantes utilisées, (iv)- les usages des plantes,
(v)- les conditions d'accès et la disponibilité des plantes,
(vi)-importance de l'utilisation de chaque espèce
végétale. Ce dernier paramètre a été
apprécié au moyen d'un score d'utilisation attribué par
les répondants selon chaque catégorie d'usage. La grille
d'appréciation utilisée est : 3= espèce fortement
utilisée ; 2 = espèce moyennement utilisée ; 1=
espèce faiblement utilisée ; 0= espèce sans usage).
2.2. Traitement et analyse des données
collectées
L'analyse des données d'enquête collectées
est effectuée à l'aide de méthodes descriptives d'analyse
statistique. Afin de dégager les caractéristiques essentielles
des fruitiers sauvages recensés dans la forêt de N'dali, nous
utiliserons des représentations de données sous forme de
graphiques et de tableaux. Par ailleurs, l'analyse univariée et
l'analyse bivariée sont les méthodes statistiques descriptives
que nous emploierons dans la présente étude. Présentons en
quelques lignes la démarche globale de chacune de ces méthodes.
Nous reprenons à cet effet, l'essentiel des développements des
travaux de Falissard (2005) et du MOOC Introduction à la statistique
avec R1(*).
2.2.1. Analyse
univariée
Comme le nom l'indique, la statistique descriptive
univariée est une méthode d'analyse qui sert à
décrire, présenter et résumer des données sur
chaque variable d'étude, prise séparément. La description
de ces données peut être numérique ou graphique et varie en
fonction de la nature de la variable considérée. En effet, une
variable peut être quantitative ou qualitative. Dans la présente
étude, les variables sont essentiellement qualitatives. Afin de
dégager les tendances dans la population d'étude, le tableau des
fréquences est une manière intéressante de
représenter les données d'une variable qualitative. Pour une
meilleure observation des données, des représentations graphiques
comme les diagrammes en bandes, ou diagrammes en bâtons et les diagrammes
sectoriels (camemberts) viennent enrichir l'analyse descriptive
univariée.
2.2.2. Analyse
bivariée
L'analyse bivariée s'intéresse aux variables
d'étude prises deux à deux. Sous la forme de tableaux à
double entrée, nous présentons la répartition des
observations (distribution conjointe) suivant les modalités de chacune
des (deux) variables considérées. Encore appelé tableau de
contingence, le tableau à double entrée s'interprète en
comparant les fréquences en lignes (profils lignes) ou les
fréquences en colonnes (profils colonnes).
L'étude de la distribution des couples de variables se
poursuit par celle de leur liaison. Nous serions alors amenés à
établir l'existence d'un lien entre les deux variables, d'une
interaction entre lignes et colonnes. Compte tenu du caractère
qualitatif de nos variables (l'âge au décrochage scolaire
excepté), nous utiliserons le test d'homogénéité de
Khi-deux pour mesurer l'association entre lesdites variables. Le test
d'homogénéité de Khi-deux est un test d'hypothèse
dont l'application consiste à comparer les effectifs théoriques
(situation d'indépendance des variables) calculés aux effectifs
observés.
2.2.3. Valeur
d'usage ethnobotanique
La valeur d'usage des espèces a été
calculée selon la méthode utilisée par Philips &
Gentry et Camou Guerrero et al. (1993). La valeur d'usage d'une
espèce donnée (k) au sein d'une catégorie d'usage
donnée est représentée par son score moyen d'utilisation
au sein de cette catégorie. Elle est calculée par la formule :

 ?
?  est la valeur d'usage ethnobotanique de l'espèce k au
sein d'une catégorie d'usage donnée,
est la valeur d'usage ethnobotanique de l'espèce k au
sein d'une catégorie d'usage donnée,
? 
 est le score d'utilisation attribué par le répondant
i,
est le score d'utilisation attribué par le répondant
i,
? n est le nombre de répondants pour une
catégorie d'usage donnée.
La valeur d'usage totale de l'espèce k est alors
calculée par la somme des valeurs d'usage de cette espèce au sein
des différentes catégories d'usage par la formule :

 ?
?  représente la valeur d'usage totale de l'espèce,
représente la valeur d'usage totale de l'espèce,
 ?
?  est la valeur d'usage de l'espèce pour une catégorie
d'usage donnée,
est la valeur d'usage de l'espèce pour une catégorie
d'usage donnée,
? t est le nombre de catégories d'usage.
La valeur d'usage permet de déterminer de façon
significative les espèces ayant une grande valeur d'utilisation dans un
milieu donné. Pour chaque espèce, la valeur d'usage
ethnobotanique totale pour les six catégories considérées
dans cette étude, varie de 0 (minimum) à 18 (maximum).
Exemple de Calcul
Supposons que nous avons les scores d'utilisation pour une
espèce de plante k dans trois catégories d'usage
différentes (médicinale, alimentaire, rituel) avec les scores
suivants :
|
Score par catégorie
|
|
|
Médicinale
|
Alimentaire
|
Rituel
|
|
Répondant 1
|
3
|
1
|
5
|
|
Répondant 2
|
4
|
2
|
5
|
|
Répondant 3
|
5
|
2
|
4
|
|
Répondant 4
|
4
|
3
|
5
|
|
Répondant 5
|
2
|
1
|
5
|
Le nombre total de répondants n = 5 pour
chaque catégorie d'usage.
Calcul de VCk pour chaque
catégorie
? Catégorie 1 : Médicinale
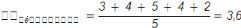
? Catégorie 2 : Alimentaire
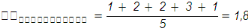
? Catégorie 3 : Rituel

Calcul de la valeur d'usage totale 

En utilisant les valeurs calculées
précédemment pour chaque catégorie :


 3,6 + 1,8 + 4,8
3,6 + 1,8 + 4,8

 10,2
10,2
Chapitre 3 :
Résultats et discussion
1. État des lieux des fruitiers
sauvages à N'dali
1.1. Description de l'échantillon
Le nombre de personnes interrogées dans le cadre de
notre recherche dépendait surtout de leur disponibilité. Au
total, 52 personnes ont été interviewées dont 35 de sexe
féminin et 17 sont des hommes. Ils sont en majorité
âgés de 34 ans ou plus (42,34%).
Tableau 2 :
Caractéristiques de l'échantillon
|
Caractéristique de
l'échantillon
|
Effectif
|
Fréquence
|
|
Sexe
|
Féminin
|
35
|
67,31%
|
|
Masculin
|
17
|
32,69%
|
|
Âge
|
Moins de 23 ans
|
7
|
13,46%
|
|
23-28 ans
|
10
|
19,23%
|
|
28-33 ans
|
13
|
25,00%
|
|
34 ans et plus
|
22
|
42,31%
|
Source : enquête de terrain
1.2. Espèces fruitières sauvage à
N'dali
Les données collectées ont permis d'inventorier
23 espèces végétales fruitières comestibles
sauvages exploitées dans le milieu. Les Parkia biglobosa
(néré), Vitellaria paradoxa (karité),
Vitex doniana (Prunier des savanes), Adansonia digitata
(Baobab), Cola Millenii (Kola de singe) sont les
espèces respectives les plus utilisées par les riverains qui
exploitent le forêt de N'dali (Figure 1). On a également
recensé les espèces telle que Datarium microcarpum
(Détar sucré), Dialium guineense (Tamarinier noir), Diospyros
mespiliformis (Ebénier d'Afrique), Bombax Costatum (Faux Kapokier)
entre autre comme fruitières sauvages exploitées à N'dali.
Les appellations en langues locales peuvent être lues dans le tableau X
de l'annexe.

Figure 3 : Espèces
fruitières sauvages utilisées par les riverains de N'dali
Source : enquête de terrain
1.3. Différents usages des espèces
fruitières sauvage de la forêt de N'dali
Les espèces recensées
durant la recherche sont utilisées à différentes fins.
Elles constituent aussi bien une source alimentaire, médicinale,
élevage que de bois pour les populations. Toutes les 23 espèces
citées sont utilisées comme source d'alimentation. 91,87% servent
en médecine traditionnelle alors que 66,32% sont utilisés afin de
nourrir les animaux dans le cadre de l'élevage. 33,43% des
espèces sont utilisées en artisanat local ; 17,45% comme bois
d'énergie ; 11% durant les rituels et 13,13% comme source de
cosmétique ou soins corporels (Figure 4).
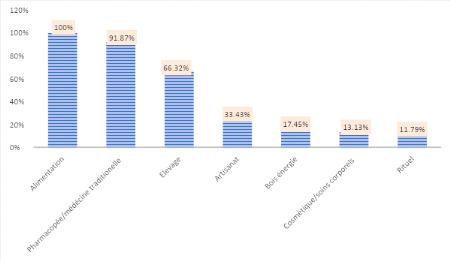
Figure 4 : Proportion
d'utilisation des différentes espèces fruitières sauvages
par catégories d'usage
Source : enquête de terrain
1.4. Utilisation des parties des espèces
fruitières sauvage exploitées par les populations riveraines de
la forêt de N'dali
Différentes parties des plantes fructueuses sauvages
sont exploitées par les populations locales de N'dali comme on peut le
voir dans le tableau 3. Dans cette section, nous allons présenter les
parties des espèces ainsi que leurs usages par nos
enquêtés. Par exemple, les participants à cette
étude affirment qu'ils utilisent les feuilles, graines et la pulpe des
fruits issus de l'espèce Parkia biglobosa (néré).
De même, les enquêtés utilisent les amandes du karité
(Vitellaria paradoxa), ses feuilles, sa racine, son écorce et
sa pulpe. Les feuilles sont utilisées pour traiter l'ictère, la
nausée et la diarrhée, les racines pour les problèmes
gastriques. Ces écorces sont utilisées pour traiter la dysenterie
et les hémorroïdes et les amandes servent à extraire du
beurre pour la fabrication des pommades et de savon alors que la pulpe est
consommée en frais par les populations riveraines de N'dali.
Les interviewés utilisent la pulpe, les graines, les
écorces, les racines et les feuilles de l'espèce Adansonia
digitata (baobab). Cette population l'utilise essentiellement à des
fins médicinales. Cette espèce intervient notamment dans le
traitement du paludisme, l'asthme et les herpès. La corde issue de
l'écorce de baobab sert à attacher les animaux.
Abordant Cola millenii (Kola du singe), les parties
utilisées par les riverains de N'dali sont les feuilles et les bois. Les
feuilles sont utilisées pour le traitement de fièvre,
l'ictère, l'éruption cutanée, le paludisme, et la
varicelle. Les tiges sont utilisées comme cuit dent et set de brosse
végétale et bois d'énergie.
Le tamarin (Tamarindus indica) est utilisé
dans l'élevage à travers les feuilles qui servent d'alimentation
de bétails (feuille) mais également dans l'alimentation de la
population avec notamment la fabrication de boissons et sirop, confiture
(fruit). Ses écorces servent à gérer la constipation.
Le Dialium guineense (Tamarinier noir) est
utilisé dans la médecine traditionnelle essentiellement à
travers ses feuilles, racine, écorce et le fruit. Les feuilles sont
utilisées pour le traitement du diabète, ses écorce comme
remède contre l'anémie et les fruits sont commercialisés
et donc consommés par la population.
Les graines de l'espèce Bombax Costatum (Faux Kapokier)
subissent de transformation locale pour servir de pommade cosmétique,
vermifuge pour le bétail et fabrication de matelas traditionnel. Ses
fleurs servent à l'autoconsommation (sauce gluant) et ses écorces
sont utilisées pour le traitement de la folie, la fièvre, les
courbatures, la hernie, l'épilepsie et les abcès. On les utilise
également pour l'attraction de chance. La racine de Bombax Costatum est
utilisée pour les accouchements difficiles, les hémorroïdes
et l'inflammation des pieds. Ses tiges sont utilisées comme instrument
de musique et ustensiles de cuisine.
Les graines de l'espèce Azadirachta indica
(neem) permettent de fabriquer un insecticide redoutable. L'huile qui en est
issue de ses graines est utilisée comme moyen de contraception alors que
les écorces de l'espèce sont utilisées pour soigner le
paludisme.
Les feuilles et graines du rônier (Borassus aethiopum)
sont utilisées pour fabriquer un savon noir dont les femmes se lavent
pour le bon déroulement de la grossesse. Cette espèce est
utilisée comme remède contre les bronchites et les maux de
gorge.
L'iroko (Milicia excelsa ou Chlorophora
excelsa) est un arbre fétiche respecté et craint à
N'dali en particulier et au Bénin en général. Ces feuilles
qui entrent dans le traitement de la folie et sont souvent utilisées
pendant de rites et incantations. Les cendres de ce bois servaient autrefois
à frotter les incisions des tatouages et les écorces de l'iroko
servent de soin contre la stérilité chez les femmes dans le
milieu.
Concernant, le palmier à huile (Elaeis
guineensis), les populations riveraines utilisent essentiellement ses
fruits qui sont regroupés en régimes. Ils sont composés de
pulpe et d'une noix centrale, qui contient une amande. On en tire deux types
d'huile : l'huile de palme (à partir de la pulpe), et l'huile de
palmiste (que l'on extrait de l'amande centrale).
Les figues (Ficus sur) sont comestibles et
utilisées sous forme fraîche ou séchée par les
autochtones dans de nombreuses régions. Ses racines sont potentiellement
efficaces contre le paludisme. L'écorce interne est utilisée pour
fabriquer la corde tandis que les problèmes de poumon et de gorge sont
traités à l'aide du latex laiteux que l'on trouve dans la
croissance vivante. Le latex laiteux est également administré aux
vaches dont la production de lait est faible. L'arbre est également
utilisé comme remède magique pour les furoncles. La racine de
l'arbre serait utilisée pour aider lorsqu'une vache conserve une partie
du placenta après l'accouchement.
Plusieurs parties (feuilles, pulpe et fruit) de Vitex
doniana (prune noir) pour diverses usages allant de la pharmacopée,
à l'alimentation. La décoction des feuilles du Vitex Doniana est
efficace contre plusieurs affections de la peau telles que la rougeole, les
éruptions cutanées ou encore la varicelle. Des pâtes sont
également fabriquées à base de feuilles et d'écorce
broyées que l'on applique sur les plaies et les brûlures.
La pulpe des fruits est très appréciée
par les enfants. Elle se mange crue, ou en confiture. Ils permettent d'obtenir
une boisson qui entre également dans la composition d'alcools forts et
de vin. Les graines à l'intérieur du noyau sont également
comestibles. La consommation de la pulpe du fruit est recommandée pour
lutter contre la fatigue.
Le fruit constitue la partie la plus valorisée de
l'espèce. Il est consommé cru et commercialisé sur les
marchés ruraux et urbains. Très riche en vitamines A et B, en
glucides et en micronutriments, la pulpe entre dans la préparation de
boissons fraîches ou alcoolisées. Les graines sont
également transformées en thé. Les feuilles, les racines
et les écorces sont utilisées en médecine traditionnelle
et moderne pour le traitement d'une grande variété de maladies
telles que les avitaminoses, les dermatoses, l'épilepsie. Le bois de
Vitex doniana entre dans la construction des maisons et dans la
confection des manches de daba, des crosses de fusil, des tambours, etc. Il est
également valorisé sous forme de bois-énergie.
Les feuilles Lannea acida servent au fourrage pour
les chèvres. Ses fruits, au goût acide à résineux,
sont comestibles, et servent notamment à la fabrication de boissons
alcoolisées. Les jeunes feuilles de l'espèce sont
consommées comme légume par les populations et de fourrage pour
le bétail. Les fruits sont consommés frais ou
séchés et la pulpe sert à préparer une boisson
fermentée. L'écorce de Lannea acida est utilisée
en cas de fièvre, d'aménorrhée, de
stérilité, d'anorexie, de gingivite et de lèpre.
Les racines de l'espèce Opilia celtidifolia
sont réduire en poudre pour traiter les constipations et
l'ictère, et en décoction pour les douleurs abdominales, tandis
que les feuilles rentre dans le traitement de l'ulcère gastrique, ou les
feuilles écrasé à la mains pour les morsures de serpent,
ou encore en poudre comme pommade pour les dermatoses. Ses fruits sont
comestibles.
Tableau 3 : Espèces
végétales fruitières recensées et les parties
utilisées
|
Espèces fruitières sauvage
|
Parties utilisées
|
|
Feuilles
|
Ecorce
|
Racine
|
Fleur
|
Tige
|
Pulpe
|
Fruit
|
Amandes
|
Graine
|
Résine
|
Bois
|
|
Parkia biglobosa
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
x
|
|
|
|
Vitellaria paradoxa
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
|
x
|
|
|
x
|
|
Adansonia digitata
|
x
|
x
|
x
|
|
|
x
|
|
|
x
|
|
|
|
Cola millenii
|
x
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
x
|
|
Ficus sur
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
Tamarindus indica
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
Annona senegalensis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datarium microcarpum
|
x
|
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
Vitex doniana
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
Blighia sapida
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dialium guineense
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
Opilia celtidifolia
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
Khaya senegalensis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diospyros mespiliformis
|
x
|
|
x
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
Gardenia erubescens
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
Strychnos spinosa
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bombax Costatum
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
x
|
|
|
|
Azadirachta indica
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
Borassus aethiopum
|
x
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
Gardenia aqualla
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
Milicia excelsa ou encore Chlorophora excelsa
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
Elaeis guineensis
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
x
|
|
Lannea acida
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
Légende : x= L'espèce est
utilisée dans cette catégorie.
Source : Source : enquête de terrain
1.5. Fréquences d'usage des espèces par la
population locale
Près de la moitié des participants à
notre étude utilise les espèces fruitières sauvages de la
forêt de N'dali quotidiennement dans le cadre de leur activité et
leur alimentation, 40% en font un usage occasionnel alors 11% usent des
espèces durant certaines cérémonies ou rites
traditionnelles.
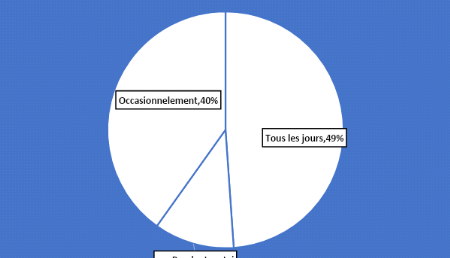
Figure 5 : : Fréquence
d'usage des espèces fruitières sauvages
Source : enquête de terrain
1.6. Périodes d'accessibilité aux
espèces et leur accès
La figure 6 révèle que plus du tiers des
espèces que les enquêtés utilisent sont difficiles à
trouver (33,29%), alors que 31,44% des espèces sont plutôt
accessibles facilement et 14,78% sont rares. De plus, 20,54% des usagers de la
forêt de N'dali affirment que les espèces utilisées ont
connu une évolution dans le temps.
En termes de disponibilité dans le calendrier, 78%
environ des enquêtés déclarent qu'ils trouvent les
espèces fructueuses sauvages durant la saison pluvieuse alors que
très peu d'espèces sont trouvées durant la saison
sèche.
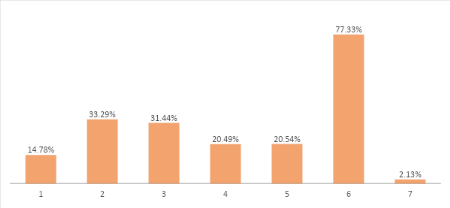
Figure 6 : Période
d'accessibilité aux espèces fruitières
sauvages
Source : enquête de terrain
1.7. Valeur d'usage ethnobotanique des espèces
végétales sauvages
Le tableau 3 présente les
valeurs d'usage ethnobotanique des espèces sauvages recensées
lors de notre étude. A N'dali, les six espèces présentant
un fort potentiel d'usage ethnobotanique sont respectivement Vitellaria
paradoxa (VUT= 8,68), Parkia biglobosa
(VUT= 7,14), Vitex doniana
(VUT=7,01), Adansonia digitata
(VUT= 6,98), Blighia sapida (VUT=
6,92) et Tamarindus indica (VUT= 6,88).
Tableau 4 : Valeur d'usage
ethnobotanique des espèces fruitières sauvages
utilisées
|
Espèces
|
Valeur d'usage totale
|
Rang
|
|
Parkia biglobosa
|
7,14
|
2
|
|
Vitellaria paradoxa
|
8,68
|
1
|
|
Adansonia digitata
|
6,98
|
4
|
|
Cola millenii
|
3,76
|
21
|
|
Ficus sur
|
5,66
|
13
|
|
Tamarindus indica
|
6,88
|
6
|
|
Annona senegalensis
|
5,13
|
15
|
|
Datarium microcarpum
|
4,34
|
3
|
|
Vitex doniana
|
7,01
|
19
|
|
Blighia sapida
|
6,92
|
20
|
|
Dialium guineense
|
5
|
16
|
|
Opilia celtidifolia
|
6,76
|
7
|
|
Khaya senegalensis
|
4,9
|
17
|
|
Diospyros mespiliformis
|
5,42
|
14
|
|
Gardenia erubescens
|
5,96
|
9
|
|
Strychnos spinosa
|
4,78
|
18
|
|
Anacardium Occidentale
|
3,3
|
23
|
|
Bombax Costatum
|
3,89
|
5
|
|
Azadirachta indica
|
5,96
|
9
|
|
Borassus aethiopum
|
5,84
|
11
|
|
Gardenia ternifolia
|
3,32
|
22
|
|
Milicia excelsa ou Chlorophora excelsa
|
5,8
|
12
|
|
Lannea acida
|
6,56
|
8
|
Source : enquête de terrain
2. Valorisation des fruitiers sauvages
à N'dali
Dans cette section, nous présentons les
différentes valorisations que font les populations riveraines de N'dali
à propos des espèces fruitières sauvages recensées.
2.1. Analyse des pratiques de valorisation traditionnelles
des fruitiers sauvages
Les populations de N'dali utilisent les différentes
parties des fruitiers sauvages pour plusieurs fins en utilisant des
méthodes traditionnelles. Ainsi, ils transforment les fruitiers pour
l'alimentation, la commercialisation et comme sources de médecines
traditionnelles comme nous l'avons vu plus haut. Nous ne donnerons pas tous les
détails pour chaque espèce mais nous présentons ici, les
pratiques de valorisation traditionnelle pour trois espèces
fruitières sauvages à N'dali.
Les riverains de N'dali utilisent les graines de
néré (Parkia biglobosa) qui permettent d'obtenir la
« moutarde » (voir Figure 7) après transformation
locale, servent à l'alimentation. De plus, ils sèchent les
graines de l'espèce et l'écrasent pour obtenir un poudre qui pour
faire des jus à la fois consommée et commercialisée par
certains. Son processus de fabrication peut se résumer comme suit :
? Récolte des gousses de
néré
Collecte : Les gousses de néré sont
récoltées directement sur l'arbre ou ramassées
lorsqu'elles tombent naturellement au sol. Cela se fait
généralement à la main.
Séchage : Les gousses récoltées sont
séchées au soleil pour faciliter l'extraction des graines.
? 2. Extraction des graines
Ouverture des gousses : Les gousses séchées sont
ouvertes manuellement pour en extraire les graines. Cela se fait
généralement en les cassant avec un outil ou en les frappant
légèrement.
Nettoyage : Les graines extraites sont ensuite
nettoyées pour enlever les débris et les résidus de
gousses.
? 3. Cuisson des graines
Cuisson initiale : Les graines nettoyées sont bouillies
dans de grandes marmites pendant plusieurs heures. Cette cuisson initiale
permet de ramollir les graines et de faciliter la fermentation
ultérieure.
Égouttage : Après cuisson, les graines sont
égouttées pour enlever l'eau excédentaire.
? 4. Fermentation
Emballage : Les graines cuites sont ensuite emballées
dans des feuilles de bananier ou de teck et placées dans un contenant
hermétique, souvent des jarres en terre cuite ou des récipients
en plastique.
Fermentation : Les graines sont laissées à
fermenter pendant plusieurs jours (généralement 3 à 4
jours). La fermentation naturelle transforme les graines en une pâte
odorante et collante, appelée "afitin". Ce processus est crucial pour
développer le goût caractéristique de la moutarde de
néré.
? 5. Séchage et conditionnement
Séchage : Après fermentation, l'afitin est
souvent séché au soleil pour augmenter sa durée de
conservation. Le séchage peut durer plusieurs jours en fonction des
conditions météorologiques.
Conditionnement : Une fois séchée, la moutarde
de néré est stockée dans des récipients propres et
secs, prêts à être utilisés ou vendus.
? 6. Utilisation culinaire
Préparation : Avant utilisation, la moutarde de
néré séchée peut être
réhydratée et incorporée dans divers plats. Elle est
souvent utilisée comme assaisonnement dans les sauces et les soupes,
apportant une saveur umami unique.
Conservation : La moutarde de néré se conserve
longtemps si elle est bien séchée et stockée dans des
conditions appropriées.

Figure 7 : Images de fruits de
néré, poudre et moutarde
Source : enquête de terrain
Les écorces de karité (Vitellaria
paradoxa) sont utilisées pour traiter la dysenterie et les
hémorroïdes. Des amandes de cette espèce sont extraites du
beurre de karité pour la fabrication des pommades et de savon par les
populations riveraines de N'dali. Le beurre de karité est utilisé
à la fois comme huile de cuisine mais aussi de pommade pour la peau
surtout durant la saison pluvieuse pour lutter contre la fraîcheur. Le
savon est utilisé dans la cosmétique et aussi pour la
commercialisation.
Le processus de fabrication du beurre de karité peut se
résumer en 6 étapes comme suit :
Etape 1 : L'apprêt de l'amande
Les noix sont collectées dans les champs ou
achetées sur le marché auprès des vendeurs. La plupart du
temps, c'est plutôt directement l'amande qui est vendue sur le
marché.
Lorsque les noix sont collectées, elles sont au
préalable cuites au feu pendant environ deux (02) heures. Elles sont
ensuite séchées au soleil. Cette opération peut prendre
plusieurs jours (au moins cinq) dépendamment du temps et de la
température.
Les amandes sont donc extraites par décorticage
facilité par l'opération précédente. Elles sont
ensuite lavées à l'eau puis séchées au soleil
pendant deux (02) à trois (03) jours. Elles deviennent à cette
étape la matière première prête à entamer le
processus proprement dit de la préparation du beurre de
karité.
Etape 2 : La réalisation de la pâte
des amandes
La production du beurre de karité commence par le
concassage des amandes de karité. Il se fait généralement
dans un mortier et la durée de l'opération est fonction de la
force de celui qui l'exécute. Les amandes sont alors réduites en
particules.
Cette farine de particules obtenue après pilonnage est
torréfiée dans une marmite au feu afin qu'elle ne se
noircisse.
La torréfaction dure environ entre vingt (20) et vingt
et cinq (25) minutes. La farine torréfiée est refroidie pendant
dix (10) à quinze (15) minutes à l'air libre.
Les particules torréfiées passent alors au
moulin pour être moulues. Il en sort une pâte à beurre
très épaisse.
Rappelons que l'opération du moulin est assez complexe
et nécessite un opérateur qui maîtrise la technique. Elle
prend bien assez de temps et sa rapidité est fonction de la
qualité de l'amande et de l'expérience du meunier.
Etape 3 : L'extraction de
l'écume
La pâte épaisse obtenue est coupée en de
petits morceaux dans de bassine contenant de l'eau de cinq (05) litres ou dix
(10) litres environ en fonction de la pâte que l'on veut y mettre.
Le mélange est ensuite baratté jusqu'à
obtenir une pâte fine et molle. La couleur marron foncé du
départ devient plus claire après environ quarante (40) minutes de
barattage.
Il faut y ajouter ensuite de l'eau tiède et la faire
bouillir. L'eau tiède va permettre de séparer le beurre des
autres composants de l'amande, notamment les impuretés qui se
déposent au fond du récipient. On y ajoute alors suffisamment de
l'eau et le beurre encore sous la forme de la pâte remonte à la
surface du fait de sa masse par rapport à l'eau.
Le beurre (écume) est ainsi extrait. Il ne reste
qu'à le récupérer.
On peut y ajouter encore de l'eau pour le débarrasser
des impuretés restées et le rendre donc plus propre.
Etape 4 : Le raffinage de
l'huile
Une fois retiré, le beurre (écume) est
malaxé et remis au feu avant d'être cuit pendant environ deux (02)
heures de temps. La pâte se fond et se transforme peu à peu en
liquide très noir. A l'aide d'une tige, il faut remuer le liquide pour
accélérer l'évaporation de l'eau et le dépôt
des impuretés au fond de la marmite.
Peu à peu l'huile apparaît et le liquide noir
s'éclaircit. L'huile apparaît maintenant à la surface et se
transforme progressivement. On reconnaît que l'huile est prête
lorsqu'elle devient plus claire. Alors, il ne faut plus trop remuer pour ne pas
mélanger l'huile aux impuretés qui sont au fond de la marmite.
Lorsqu'une couche épaisse se forme à la surface,
il faut cesser de remuer.
La marmite est alors descendue du feu.
Il faut alors ramasser délicatement l'huile et laisser
le déchet au fond de la marmite. Il faut la laisser refroidir pendant
une durée de dix (10) à quinze (15) heures environ selon la
période froide ou chaude.
Etape 5 : L'homogénéisation de
l'épaisseur du beurre
L'huile complètement refroidie, est transvasée
(le lendemain) dans une autre marmite pour laisser à nouveau les
déchets déposés. L'huile est maintenant
décantée et pure.
L'huile est remuée avec une tige bien propre pendant
une durée de 20 à 30 minutes environ pour
homogénéiser l'épaisseur. Elle devient plus épaisse
et assez lourde.
Etape 6 : Le conditionnement du beurre de
karité
C'est la dernière phase du processus de production.
Le produit obtenu à la fin de l'étape
précédente est légèrement réchauffé.
Cette opération dure environ 5 minutes sur un feu doux.
Pendant ce temps, les moules (ici des calebasses) sont
lavées avec de l'eau chaude pour les débarrasser de l'ancienne
huile qu'elles contiennent. Les calebasses sont spécifiquement
utilisées ici pour donner une forme au beurre après sa
solidification.
Avant de verser l'huile dans les différentes
calebasses, elles sont plongées dans une substance gluante qui facilite
le démoulage une fois l'huile solidifiée.
Le beurre est alors descendu du feu.
À l'aide d'une mesure en fonction du prix et de la
catégorie, le beurre est coulé dans ces calebasses et
laissé dans les calebasses pendant une (01) heure environ.

Figure 8 : Images des amandes de
karité et ses dérivés (beurre et savon)
Source : enquête de terrain
Les poudres issus de la transformation locale de baobab
(Adansonia digitata) sont utilisées comme condiment qui sont
autant consommées que vendues par les personnes qui ont participé
à l'étude. Sa corde issue de l'écorce de baobab servent
à attacher les animaux et le processus de fabrication peut se
résumer comme suit :
? Récolte de l'écorce de
baobab
Sélection des arbres : Les artisans choisissent des
arbres de baobab matures pour récolter l'écorce. Les jeunes
arbres ne sont pas utilisés pour éviter de les endommager et pour
assurer la durabilité de la ressource.
Décorticage : L'écorce est soigneusement
retirée de l'arbre en bandes longitudinales. Cette opération est
réalisée avec précaution pour permettre à l'arbre
de régénérer son écorce.
? 2. Préparation de l'écorce
Découpage et Déchiquetage : Les bandes
d'écorce sont découpées en morceaux plus petits et
déchiquetées en fines fibres. Ce processus peut être
effectué manuellement ou à l'aide de simples outils de coupe.
Trempage : Les fibres obtenues sont ensuite trempées
dans l'eau pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le trempage aide
à assouplir les fibres et à les rendre plus faciles à
travailler.
? 3. Séchage
Séchage au soleil : Les fibres trempées sont
étalées au soleil pour sécher. Cette étape permet
de réduire l'humidité et de préparer les fibres pour le
tissage. Le séchage peut prendre plusieurs jours en fonction des
conditions météorologiques.
? 4. Torsion et Tressage
Torsion des fibres : Les fibres séchées sont
torsadées pour former des fils plus épais et plus solides. Cette
torsion se fait généralement à la main, chaque brin
étant soigneusement roulé pour obtenir une texture
homogène.
Tressage : Les fils torsadés sont ensuite
tressés ensemble pour former la corde. Le tressage peut varier selon
l'épaisseur et la longueur souhaitées pour la corde. Les artisans
utilisent différentes techniques de tressage pour obtenir des cordes de
différentes résistances et usages.
? 5. Conditionnement
Finition : Une fois la corde tressée, elle est
coupée à la longueur désirée et les
extrémités sont sécurisées pour éviter
qu'elles ne se détachent.
Stockage et transport : Les cordes finies sont
enroulées et stockées dans des conditions appropriées
jusqu'à leur utilisation ou leur vente sur les marchés locaux.
Utilisations des Cordes de Baobab
Applications agricoles : Les cordes de baobab sont souvent
utilisées pour attacher des animaux, sécuriser des charges et
construire des structures agricoles.
Usages Domestiques : Elles servent également dans les
tâches domestiques quotidiennes, telles que la fabrication de nattes, de
paniers et d'autres objets artisanaux.
Applications Artisanales : Les cordes peuvent être
utilisées pour créer divers articles d'artisanat, ajoutant une
valeur esthétique et culturelle à leur utilité
pratique.

Figure 9 : Feuilles
séchées de baobab et la corde issue de ses écorces
Source : enquête de terrain
De l'espèce Elaeis guineensis, les villageois
extraient le palmier d'huile. Traditionnellement, son processus de fabrication
traditionnelle allant de la récolte à l'extraction de l'huile, se
déroule en plusieurs étapes bien définies.
? Récolte des régimes de
palme
Sélection et Coupe : Les régimes de
palme, qui contiennent les fruits de palme, sont sélectionnés et
coupés des arbres. Cela se fait généralement à
l'aide d'une machette montée sur une longue perche pour atteindre les
régimes situés en hauteur.
Transport : Les régimes coupés sont
ensuite transportés vers le site de transformation. Ce transport se fait
souvent manuellement ou à l'aide de charrettes ou de bicyclettes.
? Stérilisation
Cuisson à la vapeur : Les régimes de
palme sont soumis à une cuisson à la vapeur pour ramollir les
fruits et faciliter l'extraction de l'huile. Traditionnellement, cette cuisson
se fait en plaçant les régimes dans de grands tambours ou des
fosses spécialement conçues pour cet effet, et en les recouvrant
d'eau bouillante.
Durée : La cuisson peut durer de 30 à
90 minutes selon la quantité de régimes et l'intensité de
la chaleur.
? Battage
Séparation des fruits : Après la
stérilisation, les fruits sont séparés des régimes
par battage. Cela se fait généralement en frappant les
régimes contre une surface dure ou en utilisant des outils manuels.
Collecte des fruits : Les fruits
séparés sont ensuite recueillis et prêts pour
l'étape suivante.
? Macération et Pressage
Macération : Les fruits sont placés
dans des mortiers ou des grandes cuves et sont pilés ou broyés
pour détacher la pulpe des noyaux. Cette opération permet de
libérer l'huile contenue dans la pulpe.
Pressage : La pulpe broyée est ensuite
pressée pour extraire l'huile. Traditionnellement, cela se fait en
utilisant des presses manuelles ou en tordant des sacs contenant la pulpe pour
faire sortir l'huile.
? Clarification
Décantation : L'huile extraite est ensuite
décantée pour séparer les impuretés. L'huile est
souvent recueillie dans des récipients où elle est laissée
au repos pour permettre aux particules solides de se déposer au fond.
Filtration : Parfois, l'huile est filtrée
à l'aide de tissus ou de tamis pour améliorer sa
pureté.
? Conditionnement
Récupération : L'huile clarifiée
est collectée et transférée dans des récipients de
stockage, tels que des bidons ou des jarres en terre cuite.
Conservation : L'huile est conservée dans des
conditions appropriées pour éviter la
détérioration. Elle est prête à être
utilisée pour la cuisine ou vendue sur les marchés locaux.
? Aspects Culturels et Sociaux
Participation communautaire : La production de
l'huile de palme est souvent une activité communautaire, impliquant
plusieurs membres de la famille ou de la communauté.
Tradition et transmission : Les techniques de
fabrication traditionnelle sont transmises de génération en
génération, assurant la préservation des méthodes
ancestrales.

Figure 10 : Huile de palme et le
fruit
Source : notre enquête
2.2. Identification des opportunités de valorisation
économique
Grâce aux espèces végétales
sauvages de la forêt de N'dali, les riverains créent leur source
de revenu. Nous rappelons que pour les populations de N'dali les espèces
recensées une source alimentaire, médicinale, élevage,
rituelle (Les feuilles de Adansonia digitata sont utilisées
dans les bains et les encens pour purifier et protéger, ses
écorces accompagnent la représentation symbolique du
fétiche des morts et les feuilles d'Elaeis guineensis sont
utilisés dans la danse des initiés et comme masque des
initiés alors que chez le groupe socio-culturel baatonou les
feuilles du Parkia Biglobosa sont utilisées pour l'enterrement des
défunts)., artisanale ainsi que de bois d'énergie. Dans ce sens,
les résultats de cette étude révèlent que nos
enquêtés ont le commerce comme activité principale
(44,23%). En effet, les feuilles, graines, tige et racines des espèces
sont utilisées pour la commercialisation de façon brute ou suite
à une transformation comme la « moutarde ». Par
ailleurs, les agriculteurs représentent près du tiers (28,85%)
des personnes ayant participées à l'étude et ces derniers
se réclament même gardiens de ces espèces qu'ils utilisent
pour des fins alimentaires (autoconsommation), médicinales
(pharmacopée pour traiter la paludisme et d'autres maladies) et
même commerciales (vente des espèces aux commerçantes qui
les exposent au marché). Les espèces de la forêt permettent
à 9,62% des enquêtés de nourrir leurs animaux alors que la
même proportion les utilisent pour le traitement de plusieurs maladies
comme énumérées plus haut (hypertension, épilepsie,
etc). A cela s'ajoute leur utilisation durant les rites traditionnels et qui
donne la valeur au métier de guérisseur traditionnel dans le
milieu.

Figure 11 : Principales sources de
revenu des enquêteurs
Source : enquête de terrain
2.3. Proposition de stratégies de valorisation durable
et de gestion des ressources : gestion vs conservation raisonnée
des espèces
La gestion et la conservation des ressources naturelles, en
particulier des fruitiers sauvages, sont des aspects cruciaux pour la
préservation de la biodiversité et la durabilité des
écosystèmes. Dans le contexte de la commune de N'dali au
Bénin, ces pratiques prennent une importance particulière en
raison de l'utilité des fruitiers sauvages de cette région
tropicale.
La gestion traditionnelle des fruitiers sauvages en Afrique
tropicale repose souvent sur des connaissances et des pratiques ancestrales
transmises de génération en génération. Les jeunes
enfants accompagnent souvent leurs parents ou leurs aînés dans les
activités de collecte et de gestion des fruitiers sauvages. Ils
observent les techniques et les méthodes utilisées, apprenant
ainsi de manière informelle. En grandissant, les enfants commencent
à imiter les gestes des adultes. Ils apprennent à identifier les
arbres fruitiers, à reconnaître les signes de maturité des
fruits et à utiliser les outils traditionnels de collecte.
²Certains rites de passage incluent des épreuves ou des
activités liées à la gestion des fruitiers sauvages. Par
exemple, les jeunes peuvent devoir démontrer leur capacité
à identifier les arbres, à collecter les fruits ou à
participer à des activités de reboisement.
Ces pratiques incluent : l'utilisation directe, Technique de
culture, protection coutumière
Utilisation directe : Les
communautés locales exploitent les fruitiers sauvages pour leur
consommation, leurs vertus médicinales et parfois pour le commerce. Cela
inclut la cueillette des fruits, l'utilisation des feuilles, des écorces
et des racines.
Techniques de culture : Bien que les
fruitiers sauvages soient généralement laissés à
l'état naturel, certaines pratiques de gestion incluent la protection
des jeunes plants et la plantation dans des zones propices.
Protection coutumière : Certaines
espèces sont protégées par des tabous (comme le cas de
l'iroko) ou des interdits culturels, limitant leur exploitation et favorisant
leur conservation.
Cependant, ces méthodes de gestion traditionnelle
peuvent être mises à rude épreuve par les pressions
anthropiques croissantes, telles que l'expansion agricole, le changement
climatique et la déforestation. En effet, la présence humaine
quasi quotidienne au sein de la forêt, la recherche et la récolte
des PFNL et autres produits ligneux sont à l'origine de la perte ou de
la disparition d'espèces.
Les riverains et en particulier des exploitants de divers
produits forestiers peuvent renverser la tendance et les amener à
oeuvrer au maintien de l'écosystème. Certes, la collaboration de
tous les acteurs sur la base d'une gestion participative peut déboucher
sur la sélection d'autres activités génératrices de
revenus alternatives, et ce de commun accord avec les décideurs
politiques mais avec l'implication des autorités locales, des notables,
des sages, des tradipraticiens ou guérisseurs traditionnels, des
autorités religieuses, des têtes couronnées ou rois, des
personnes ressources, des chercheurs, etc. Des recherches sur la
régénération des espèces caractéristiques de
l'écosystème vont permettre d'identifier au niveau des
trouées ainsi créées par les exploitations intensives des
PFNL, les espèces végétales pionnières, tardives et
climaciques. La recherche est interpellée afin de déterminer si
la régénération naturelle peut permettre le maintien
à long terme de la forêt N'dali.
La gestion des fruitiers sauvages à N'dali
nécessite une compréhension nuancée et une
intégration des méthodes traditionnelles et raisonnées. En
combinant le savoir-faire local avec les techniques de conservation modernes,
il est possible de créer des modèles de gestion durable qui
préservent non seulement les ressources naturelles, mais aussi les
cultures locales et les moyens de subsistance des communautés. Une telle
approche holistique est essentielle pour la valorisation et la
pérennité des fruitiers sauvages en Afrique tropicale.
3. Discussion
Divers organes des plantes sont utilisés par la
population de N'dali pour la satisfaction de leurs besoins économiques,
alimentaires et socio-culturels (Ezebilo et Mattson, 2010). Ils vont des
fruits, des feuilles, des racines, des amandes aux écorces et parfois
même les fleurs et des écorces (Agbogidi et al. 2010). Dans la
zone d'étude, les feuilles, l'écorce, les racines et les fruits
sont les organes les plus utilisés. L'organe prélevé sur
une espèce est fonction de l'utilité recherchée par la
population ainsi que les connaissances endogènes liées à
l'utilisation de l'organe.
Par ailleurs, notre étude a identifié le
Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Datarium microcarpum, Adansonia
digitata, Bombax Costatum et Tamarindus indica en tant qu espèces ayant
les valeurs d'usage ethnobotanique les plus élevées au niveau de
la commune de N'dali et environnant. Lorsque la valeur d'usage ethnobotanique
totale d'une espèce peu abondante est élevée cela pourrait
se traduire par une pression d'exploitation plus forte sur cette espèce
(Camou-Guerrero et al. 2008 ; Dossou, 2010). On pourrait dire que l'importance
accordée à une espèce ne dépend pas de sa
disponibilité mais de sa capacité à satisfaire les besoins
des populations dans les différentes catégories d'usages (Lykke
et al. 1990). Les résultats de cette étude aident à
identifier les espèces utiles et soumises à une forte pression
qui devraient être considérées comme prioritaires dans
l'aménagement de la forêt afin de contribuer à un
bien-être économique et socioculturel durable des populations.
Néanmoins, ces résultats obtenus à travers l'étude
devraient être relativisés à cause des nouvelles
opportunités futures de marché qui pourraient s'offrir à
telle ou telle autre espèce. Ces utilisations évoluent assez
rapidement (parfois en quelques années) au sein d'un terroir et ne sont
donc pas définitives (Benz et al. 2000). A cet effet, la présente
étude révèle par exemple que Bambusa vulgaris
(bambou commun) est une espèce à faible valeur d'usage
ethnobotanique mais dont la demande actuelle sur le marché pourrait
à l'avenir faire de l'espèce, une des espèces à
forte valeur d'usage dans le milieu (Dossou, 2010).
Conclusion
Cette étude met en exergue l'importance des ressources
de la forêt de N'dali pour les communautés riveraines sur la base
de la valeur d'usage ethnobotanique des espèces fruitières
sauvages de cette forêt. Elle a permis de faire ressortir les
espèces localement qualifiées pour faire partir des
espèces prioritaires à conserver dans l'aménagement de
cette forêt. Ce sont ces espèces qui contribuent à
améliorer le bien-être économique et social des
populations. L'exploitation des valeurs d'usage se révèle
être un outil de base dans la sélection des espèces
d'intérêt socio-économique, culturel et objet de forte
pression anthropique.
Les résultats mettent en évidence la richesse et
la diversité des fruitiers sauvages dans cette région, leur
rôle crucial dans la subsistance des populations locales, ainsi que les
défis et opportunités liés à leur valorisation.
La commune de N'dali abrite une grande variété
de fruitiers sauvages, dont plusieurs espèces endémiques et
d'importance écologique et économique. Ces fruitiers jouent un
rôle crucial dans la biodiversité locale et dans la nutrition des
communautés rurales. Les fruitiers sauvages sont une source essentielle
de nourriture, de médicaments traditionnels, et de revenus pour les
populations locales. Ils contribuent à la sécurité
alimentaire et offrent des opportunités économiques, notamment
par la vente de fruits frais et de produits transformés.
L'exploitation non durable, la déforestation, et les
changements climatiques menacent l'existence de ces fruitiers sauvages. Les
pratiques agricoles extensives et le manque de politiques de gestion durable
exacerbent ces défis.
Des initiatives locales visant à valoriser ces
fruitiers, telles que la transformation des fruits en confitures, jus et autres
produits à valeur ajoutée, montrent un potentiel prometteur. La
sensibilisation et l'éducation des communautés sur les techniques
de gestion durable et la conservation des fruitiers sauvages sont
essentielles.
Pour assurer une gestion durable et une valorisation optimale
des fruitiers sauvages à Ndali, il est recommandé de :
? Renforcer les capacités des communautés
locales par des formations en gestion durable et en transformation des
produits.
? Promouvoir la recherche et l'inventaire des espèces
de fruitiers sauvages pour mieux comprendre leur distribution et leur
état de conservation.
? Mettre en place des politiques et des réglementations
locales pour protéger les fruitiers sauvages contre l'exploitation non
durable.
? Encourager les partenariats entre les autorités
locales, les ONG, et les communautés pour la mise en oeuvre de projets
de conservation et de valorisation.
Bibliographie
Adjatin, A., Dansi, A., Badoussi, E., Loko, Y. L., Dansi, M.,
Azokpota, P., Gbaguidi, F., Ahissou, H., Akoègninou, A., & Akpagana,
K. (2013). Consumed as vegetable in Benin. Int. J. Curr. Microbiol. App.
Sci, 2(8), 1-13.
Agbogidi, O. M. (2010). Ethno-botanical survey of the
non-timber forest products in Sapele Local Government Area of Delta State,
Nigeria. African Journal of Plant Science, 4(3), 183-189.
Akinnifesi, F. K., Sileshi, G., Ajayi, O. C., Chirwa, P. W.,
Kwesiga, F. R., & Harawa, R. (2008). Contributions of agroforestry research
and development to livelihood of smallholder farmers in Southern Africa?: 2.
Fruit, medicinal, fuelwood and fodder tree systems. Agricultural
Journal, 3(1), 76-88.
Akouêhou, G. S. (2012). Evaluation et analyse
socio-économique des marchés des produits forestiers non ligneux,
cas du Néré, du Karité, du Rônier, du Baobab, du
Pommier sauvage et de l'Arbre à Pain?: Les chaines de commercialisation,
les différents maillons, les caractéristiques, les
différents acteurs directs et indirects, les interrelations et les
différents flux dans les zones d'intervention du projet. Rapport
FAO. Cotonou.(PA-PFNL) au Bénin:(PCT/BEN/3305), 118p.
Article Detail. (s. d.). International Journal of
Advanced Research. Consulté 3 juin 2024, à l'adresse
https://www.journalijar.com/article/
Assogbadjo, A. E. (2000). Etude de la biodiversité des
ressources forestières alimentaires et évaluation de leur
contribution à l'alimentation des populations locales de la forêt
classée de la Lama. Cotonou, Benin: These d'Ingénieur
Agronome Faculté des Sciences Agronomiques, University of
Abomey-Calavi, 121.
Azizou, E.-H. I., GBEMAVO, D. S. J. C., HOUNKPEVI, A., MENSAH,
G. A., & SINSIN, B. (2021). Pressions anthropiques et dynamique des
habitats naturels de la Réserve Transfrontalière de
Biosphère du W-Bénin. Annales de l'Université de
Parakou-Série Sciences Naturelles et Agronomie, 11(2),
1-14.
Baco, M. N., Biaou, G., Pinton, F., & Lescure, J.-P.
(2007). Les savoirs paysans traditionnels conservent-ils encore
l'agrobiodiversité au Bénin? BASE.
Bernadette, S. L., Ismaila, T., Vigninou, T., & Thoma, O.
(2019). Caracterisation des Services Ecosystemiques dans la Reserve de
Biosphere Transfrontaliere du W (RBTW) au Nord-Benin. European Scientific
Journal ESJ, 15.
https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n36p278
BONOU, A. (s. d.). This paper is an English draft of
a part of my French published book. To cite this article, better use this book
citation?: Bonou, A., Adegbidi A., Sinsin B.(2013). Valeur économique
des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) au Bénin. Editions
universitaires européennes, ISBN: 978-613-1-51998-7. 101p. http://www.
amazon. fr/Valeur-% C3% A9conomique-Produits. Consulté 9 mai 2024,
à l'adresse
https://www.researchgate.net/profile/Alice-Bonou-2/publication/268517115_Endogenous_knowledge_on_non-timber_forest_products_in_northern_Benin/links/56ba0bff08ae9d9ac67f4931/Endogenous-knowledge-on-non-timber-forest-products-in-northern-Benin.pdf
BONOU, I. A. (2007). Estimation de la valeur
économique des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) d'origine
végétale dans le village de Sampéto (commune de
Banikoara). UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI.
Camou-Guerrero, A., Reyes-García, V.,
Martínez-Ramos, M., & Casas, A. (2008). Knowledge and use value of
plant species in a Rarámuri community?: A gender perspective for
conservation. Human ecology, 36, 259-272.
Cocks, M. L., Bangay, L., Shackleton, C. M., & Wiersum, F.
K. (2008). 'Rich man poor man'--Inter-household and community factors
influencing the use of wild plant resources amongst rural households in South
Africa. The International Journal of Sustainable Development & World
Ecology, 15(3), 198-210.
Codjia, J. T. C., Assogbadjo, A. E., & Ekué, M. R.
M. (2003). Diversité et valorisation au niveau local des ressources
végétales forestières alimentaire du Bénin.
Cahiers Agricultures, 12, 1-12.
Dan, C. B., Sinsin, B. A., Mensah, G. A., & Lejoly, J.
(2012). Influence des activités anthropiques sur la diversité
floristique des communautés végétales de la forêt
marécageuse de Lokoli au Sud-Bénin. International Journal of
Biological and Chemical Sciences, 6(6), 3064-3081.
Dossou, K., Codjia, J., & Biaou, G. (2004). Rôle de
la ressource forestière Blighia sapida (ackee ou faux acajou) dans
l'économie des ménages du Nord-Ouest du Bénin / Role of
the Non Timber Forest Product Blighia sapida (ackee) in household's economy in
North-western Bénin Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin
N° 46 - Décembre 2004. Bulletin de la Recherche Agronomique du
Bénin, 46.
Dossou, L. E. (2008). Diversité biologique et modes
d'utilisation des espèces ligneuses alimentaires de la forêt
classée de Pénéssoulou. MSc Thesis, Université
d'Abomey-Calavi. Bénin.
Dossou, M. K. R. (2003). Valorisation
socio-économique des Produits Forestiers Non Ligneux dans le Nord-ouest
Bénin?: Importance du Blighia sapida dans les économies
locales [PhD Thesis]. Thèse d'Ingénieur Agronome,
Faculté des Sciences Agronomiques-Université d ....
Dossou, M. K. R., Codjia, J. T. C., & Biaou, G. (2004).
Utilisations, fonctions et perceptions de l'espèce-ressource Blighia
sapida (ackee ou faux acajou) dans le Nord-Ouest du Bénin. Bulletin
de la Recherche Agronomique du Bénin, 45, 17-28.
Ekué, M. (s. d.). Diversity and local valorisation
of vegetal edible products in Benin. Cahiers Agricultures.
Consulté 9 mai 2024, à l'adresse
https://www.academia.edu/37852944/Diversity_and_local_valorisation_of_vegetal_edible_products_in_Benin
Ezebilo, E. E., & Mattsson, L. (2010a). Contribution of
non-timber forest products to livelihoods of communities in southeast Nigeria.
International Journal of Sustainable Development & World Ecology,
17(3), 231-235.
Ezebilo, E. E., & Mattsson, L. (2010b). Socio-economic
benefits of protected areas as perceived by local people around Cross River
National Park, Nigeria. Forest Policy and Economics, 12(3),
189-193.
Falconer, J. (1991). La forêt, source d'aliments en
période de disette. Unasylva. FAO, 41, 14-19.
Falconer, J., & Arnold, J. E. M. (1996).
Sécurité alimentaire des ménages et foresterie?:
Analyse des aspects socioéconomiques. Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Falissard, B. (2005). Comprendre et utiliser les
statistiques dans les sciences de la vie. Masson Paris.
Garrity, D. P., Akinnifesi, F. K., Ajayi, O. C., Weldesemayat,
S. G., Mowo, J. G., Kalinganire, A., Larwanou, M., & Bayala, J. (2010).
Evergreen Agriculture?: A robust approach to sustainable food security in
Africa. Food security, 2, 197-214.
Guedje, N. M. (2002). La gestion des populations d'arbres
comme outil pour une exploitation durable des produits forestiers non-ligneux?:
L'exemple de Garcinia lucida (sud-Cameroun). Tropenbos-Cameroon
Programme.
Hama, O., Tinni, I., & Baragé, M. (2019).
Diversité Et Importance Des Produits Forestiers Non Ligneux D'origine
Végétale Dans La Commune Rurale De Tamou, Au Sud-Ouest Du Niger
(Afrique De L'ouest). Revue Ivoirienne Des Sciences Et Technologie,
34.
https://revist.net/REVIST_34/REVIST_34_13.pdf
Ingram, V., Ndoye, O., Iponga, D. M., Tieguhong, J. C., &
Nasi, R. (2010a). Les produits forestiers non ligneux?: Contribution aux
économies nationales et stratégies pour une gestion durable.
Les forêts du bassin du Congo-Etat des Forêts, 137-154.
Johns, T., & Maundu, P. (2006). Biodiversite forestiere,
nutrition et sante des populations dans les systemes de production alimentaire
orientes vers le marche. Unasylva (FAO), 57(224).
Kabaka, P. I. (2021). La production et la commercialisation
des produits forestiers non ligneux au Kwango?: Cas de Mfumbwa et des chenilles
Mikwati. Le développement agro-pastoral au Kwango en RD
Congo.
Kouyaté, A. M., Van Damme, P., De Meulenaer, B., &
Diawara, H. (2008). Contribution des produits de cueillette dans l'alimentation
humaine. Cas de Detarium microcarpum. Afrika Focus, 22(1),
77-88.
La contribution des produits forestiers non ligneux
(PFNL)à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
(s. d.). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Consulté 9 mai 2024, à l'adresse
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/879707/
Lamien, N. (2006). Fructification du Karité (Vitellaria
paradoxa CF Gaertn.)?: Facteurs de déperdition, Amélioration et
prévision des rendements à Boundoukuy, Ouest Burkina-Faso.
These de Doctorat Unique en Biologie et Ecologie Végétales,
Université de Ouagadougou, Burkina Faso.
LAMIEN, N., SOME, A. N. A. N., OUÉDRAOGO, J. S.,
ILBOUDO, B., OUÉDRAOGO, C., & SOMDA, I. (2008). Potentiel productif
de quelques essences fruitières locales au Burkina Faso. Sciences
Naturelles et Appliquées, 30(1).
Leakey, R. R. (s. d.). The Overstory, n1 234 Le 14
février 2011.
Leaky, R. R. B., & Newton, A. C. (1994). Domestication
of tropical trees for timber and non-timber products.
Loubelo, E. (2012). Impact des produits forestiers non
ligneux (PFNL) sur l'économie des ménages et la
sécurité alimentaire?: Cas de la République du Congo
[PhD Thesis, Université Rennes 2].
https://theses.hal.science/tel-00713758/
Malabo, G. E., Walter, S., & Mbala, S. M. (2006). Etat
des lieux du secteur `Produits Forestiers Non Ligneux'en Afrique Centrale et
analyse des priorites politiques.
https://www.fao.org/forestry/14261-065be725d284e9426813b0cafb157d220.pdf
Malaisse, F. (1997). Se nourrir en foret claire
africaine?: Approche écologique et nutritionnelle. Presses
agronomiques de Gembloux.
Malaisse, F. P. (1993). The ecology of Zambezian dry evergreen
forest with recommendations for conservation management. Restoration of
Tropical Forest Ecosystems: Proceedings of the Symposium held on October 7-10,
1991, 75-90.
Matig, O. E., Ndoye, O., Kengue, J., & Awono, A. (2006).
Les fruitiers forestiers comestibles du Cameroun. Bioversity
International.
Maundu, P. M., Ngugi, G. W., & Kabuye, H. S. (s. d.).
Traditional food plants of Kenya.
Michelle, E. B. S. (2021). The importance of social capital in
the adoption of sustainable management practices of non-timber forest products
(NTFPs) in Cameroon?: L'importance du capital social dans l'adoption de
pratiques de gestion durables des produits forestiers non ligneux (PFNL) au
Cameroun. African Scientific Journal, 3(4), 399-399.
https://doi.org/10.5281/zenodo.5639209
Orekan, V. O. A., Tente, B. A., Gibigaye, M., &
Dossou-Koï, B. (2013). Pressions Anthropiques Sur Les Especes Vegetales
Ligneuses Et Caracterisation Des Groupements Vegetaux De La Foret Classee De
N'dali (Nord Benin). Annales des sciences agronomiques,
17(2), 121-135.
Oukara, F. Z., Souakri, K. Z., Sbabedji, M., Bouyaiche, M.,
Kaddouri, A., & Degaichia, H. (2024). Estimation de la production des
écosystèmes forestiers en produits forestiers non ligneux?: Cas
du câprier (Capparis spinosa L.). Annales de la Recherche
Forestière en Algérie, 14(1), 1-13.
Pimm, S. L., Jenkins, C. N., Abell, R., Brooks, T. M.,
Gittleman, J. L., Joppa, L. N., Raven, P. H., Roberts, C. M., & Sexton, J.
O. (2014). The biodiversity of species and their rates of extinction,
distribution, and protection. science, 344(6187), 1246752.
Présentation de la Commune de N'Dali--Cadre
méthodologique. (s. d.). Consulté 3 juin 2024, à
l'adresse
https://123dok.net/article/pr%C3%A9sentation-commune-dali-cadre-m%C3%A9thodologique.q7wknp1o
Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL) / Les
différentes thématiques--Forêts et biodiversité
à Magadascar. (s. d.). Consulté 9 mai 2024, à
l'adresse
https://www.forets-biodiv.org/thematiques/les-differentes-thematiques/produits-forestiers-non-ligneux-pfnl
RRB, L. (1999). Leakey, R.R.B. (1999). Potential for novel
food products from agroforestry trees, Food Chemistry, 64, 1-14.
Sahgui, E. (2019). Diversité et Utilités des
Produits Forestiers Non Ligneux de la Forêt Naturelle de Niaouli (Commune
d'Allada) au Bénin.
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12470.14403
Sokpon, N., & Lejoly, J. (1996). Les plantes à
fruits comestibles d'une forêt semicaducifoliée?: Pobè, au
Sud-Est du Bénin. L'alimentation en forêt tropicale:
interactions bioculturelles et perspectives de développement,
1, 115-124.
Tapsoba, A., Konaté, S., Yelkouni, M., & Sawadogo,
L. (2014). Valorisation Économique des Produits Forestiers non Ligneux
au Burkina-Faso?: Cas de Parkia Biglobosa (Néré).
Université De Ouagadougou: Ouagadougou, Burkina Faso.
https://www.agrinovia.net/wp-content/uploads/2019/03/VALORISATION-ECONOMIQUE-DES-PRODUITS-FORESTIERS-NON-LIGNEUX-AU-BURKINAFASO-CAS-DE-PARKIA-BIGLOBOSA-NERE.pdf
Tchatat, M., & Ndoye, O. (2006). Etude des produits
forestiers non ligneux d'Afrique Centrale?: Reality and prospects. Bois
& Forêts des Tropiques, 289, 27-39.
Teklehaimanot, Z. (2004). Exploiting the potential of
indigenous agroforestry trees?: Parkia biglobosa and Vitellaria paradoxa in
sub-Saharan Africa. New Vistas in Agroforestry: A Compendium for 1st World
Congress of Agroforestry, 2004, 207-220.
Temple, H. J., Anstee, S., Ekstrom, J., Pilgrim, J. D.,
Rabenantoandro, J., Ramanamanjato, J. B., Randriatafika, F., & Vincelette,
M. (s. d.). Prévoir le chemin vers l'atteinte d'un impact
positif net sur la biodiversité pour Rio Tinto QMM.
Thiombiano, D. N. E., Lamien, N., Dibong, S. D., &
Boussim, I. J. (2010). Etat des peuplements des espèces ligneuses de
soudure des communes rurales de Pobé-Mengao et de Nobéré
(Burkina Faso). Journal of Animal & Plant Sciences, 9(1),
1104-1116.
Tieguhong, J. C., Ndoye, O., Vantomme, P., Zwolinski, J.,
& Masuch, J. (2009). S'adapter à la crise en Afrique centrale?: Un
rôle accru pour les produits forestiers non ligneux. Unasylva,
223, 49-54.
Unies, N., & des Nations Unies, O. (s. d.).
REVUE ANNUELLE DU MARCHÉ DES PRODUITS FORESTIERS.
Vunda, M. (2021). La valorisation des ressources
forestières en Afrique centrale?: État des lieux et perspectives
de développement à partir des produits forestiers non ligneux
(PFNL) en Angola, au Cameroun, au Congo, au Gabon et en République
Démocratique du Congo. [Phdthesis, Université Clermont
Auvergne].
https://theses.hal.science/tel-03576787
Annexe
Tableau 5 : Noms scientifiques,
d'usage et locales des espèces
|
Nom scientifique
|
Nom d'usage courant
|
Nom en langues locale
|
|
Parkia biglobosa
|
Néré
|
Afitin(Fo), Sonrou(ba)
|
|
Vitellaria paradoxa
|
Karité ou arbre à beurre
|
Boulanga (De) Limigoto (Fo)
|
|
Adansonia digitata
|
Baobab
|
Chombou(Ba) Koo(Fo), Donwo (De), boboli (Pe)
|
|
Cola millenii
|
Kola du singe
|
koro(De)
|
|
Ficus sur
|
Figuier du Cap
|
gandou, ganié malou (Ba), vogbaminton (Fo), Okpoto
(Yo), Gannou (pe)
|
|
Tamarindus indica
|
Tamarin ou tamarinier
|
Mossosso (Ba)
|
|
Annona senegalensis
|
Pommier cannelle du Sénégal
|
batoko(De), dankorsou ou moufa (De)
|
|
Datarium microcarpum
|
Petit détar ou détar sucré
|
Bessegolou(ba)
|
|
Vitex doniana
|
Prunier des savanes
|
Nyakorokou (Ba), Kpounouwan (Pe), Boyi (De)
|
|
Blighia sapida
|
Akée
|
Direbou (Ba)
|
|
Dialium guineense
|
Tamarinier noir
|
Awin(Yo), Assonsoinman (Fo)
|
|
Opilia celtidifolia
|
Opilia celtidifolia
|
Sakakouko (Bariba), twahantouman (Fon)
|
|
Anacarduim occidentale
|
Anacardier
|
Kaju (Ba)
|
|
Diospyros mespiliformis
|
Ebénier d'Afrique
|
Nouibou (De) Tououri (De) Poupoui (pe)
|
|
Gadenia erubescens
|
|
Dakplado (Fon)
|
|
Strychnos spinosa
|
Strychnine
|
Gorokou (Ba), gbéssègbewékou (Ba),
goulogou (Peuhl), mabatérahi (Peuhl)
|
|
Bombax Costatum
|
Faux Kapokier
|
Mororou(Ba), Kourouhi (peulh)
|
|
Azadirachta indica
|
Neem, Margousier
|
Koribou(ba), kinninintin (Fon), cogognaro (Yoruba)
|
|
Borassus aethiopum
|
Rônier
|
agontin, kolaka (Fon), agbon-oko (Nagot), doukounkandé,
baadorororou (Ba)
|
|
Gadenia aqualla
|
Giginya
|
Dihanli (pe)
|
|
Milicia excelsa ou Chlorophora excelsa
|
Iroko
|
|
|
Elaeis guineensis
|
Palmier à huile
|
Ifa (yo), Detin (Fô)
|
|
Lannea acida
|
Raisinier
|
Zouzou (fon)
yadibou, yoronou, yronédou (Bariba),
toubo, tingoli, bémbéy, tingouli (Peuhl)
|
Source : notre enquête
Tableau 6 : Catégories
d'usage des plantes
|
Nom en français
|
Nom scientifique
|
Usages
|
|
Néré
|
Parkia biglobosa
|
Alimentaire
Elevage
|
|
Karité ou arbre à beurre
|
Vitellaria paradoxa
|
Alimentaire
Pharmacopée
Cosmétique
|
|
Baobab
|
Adansonia digitata
|
Alimentaire
Cosmétique
|
|
Kola du singe
|
Cola millenii
|
Pharmacopée
Bois d'énergie
|
|
Tamarin ou tamarinier
|
Tamarindus indica
|
Alimentation
Pharmacopée
|
|
Petit détar ou détar sucré
|
Datarium microcarpum
|
Médecine traditionnelle
Alimentaire
Artisanal
Fourrage (élevage)
|
|
Tamarinier noir
|
Dialium guineense
|
Pharmacopée
Alimentaire
Commerce
|
|
Ebénier d'Afrique
|
Diospyros mespiliformis
|
Alimentation
Pharmacopée
|
|
Faux Kapokier
|
Bombax Costatum
|
Alimentation
Pharmacopée
Elevage
Artisanat (instrument de musique)
|
|
Palmier à huile
|
Elaeis guineensis
|
Alimentation
Pharmacopée
Cosmétique
|
|
Dakplado (Fon)
|
Gardenia erubescens
|
Alimentation
Pharmacopée
Rites (protection contre les accidents)
|
|
Figuier du Cap
|
Ficus Sur
|
Alimentation
Pharmacopée
Rites (conserve une partie du placenta après
l'accouchement)
|
|
Giginya (Français)
|
Gardénia aqualla
|
Alimentation
Pharmacopée
|
|
Strychnine
|
Strychnos spinosa
|
Alimentation
Pharmacopée
Elevage
Facilitateur de la production de lait de la nouvelle maman.
|
|
Prune noir
|
Vitex doniana
|
Alimentation
Pharmacopée
Rites
|
|
raisinier
|
Lannea accida
|
Elevage (les feuilles servent au fourrage pour les
chèvres)
Alimentation
Pharmacopée
|
|
Opilia celtidifolia
|
|
Alimentation
Pharmacopée
|
Source : notre enquête

Institut National Universitaire Champollion
Sciences humaines et sociales
Master Gestion de l'Environnement
Fiche d'enquête ethnobotanique
Âge :
Sexe : Masculin
Féminin


Activité principale :
Éleveur Agriculteur Chasseur
Commerçant Autres (à
préciser)
................................................................





Nombre total de plantes
utilisées |__|__|
Nous voudrions recueillir des renseignements sur
les plantes que vous utilisez dans le cadre de votre
activité.
|
Q0
|
Q1
|
Q2
|
Q3
|
Q4
|
Q5
|
Q6
|
Q7
|
Q8
|
Q9
|
|
N° d'ordre dans l'usage
|
Nom en langues locales des plantes utilisées
|
Parties utilisées
|
Usage des plantes
|
Fréquence d'usage
|
Importance d'usage de la plante
|
Quand trouve-t-on cette plante ?
|
Comment y accéder ?
|
Conditions d'accès ?
|
Description de la plante
|
|
S'il vous plaît donnez-moi les noms de toutes les plantes
que vous utilisez dans le cadre de votre activité
|
1 - ER = Écorce de Racine
2- ET = Écorce de Tige,
3-- Bu = Bulbe,
4- Fe = Feuille,
5 - Fr = Fruit
6 - Gr = Graine
7- PE = Plante Entière
8 - Ra = Racine
9 - TF = Tige Feuillée
10 - Rh = Rhizome
|
1 - Pharmaceutique
2- Alimentaire
3--Artisanat
4- Rituel
5- Cosmétique
6- Bois de service
7- Bois d'énergie
8- Fourrage
9-Soins corporels
|
1 - Tous les jours
2- Pendant certaines cérémonies
3--Autres (à préciser)
|
0= espèce sans usage
1= espèce faiblement utilisée ;
2 = espèce moyennement utilisée ;
3= espèce fortement utilisée
|
1= Toute l'année
2 = Saison pluvieuse
3 = Saison sèche
|
1=Rareté
2=Difficulté
3=Evolution depuis que je suis enfant
4=Autres (à préciser)
|
1=Au pied d'un arbre
2=Sur sols ou conditions ou conditions hydriques
spécifiques
3=Autres (à préciser)
|
|
|
|0_1_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_2_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_3_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_4_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_5_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_6_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_7_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_8_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_9_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
|
|0_10_|
|
|
|
|_|_||_|_||_
|
|_|_||_|_|
|
|__|
|
|__|
|
|__|
|
|_|_|
|
|
* 1
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/introduction-a-la-statistique-avec-r/



