Le principe de transparence appelle les institutions à
l'adopter dans leurs fonctions afin d'améliore la qualité des
relations et faciliter la prise de decisions. Il convient de souligner que le
système de la communication et de l'information doit occuper une place
importante pour la gestion durable des ressources halieutiques et la
pêche. Les acteurs ont droit à l'information. Ce systéme
d'informtion doit être de qualité, suffisant, clair,
compréhenisble et pertinent. Car l'information non comprise et non
vérifiée empêche une cohérence et peut causer des
incompréhensions entre les diffèrentes parties prenantes. Ces
problématiques causent de la méfiance, et peuvent favoriser des
phénomènes tels que la corruption, des infractions et la
surexploitation.
L'information est au centre du principe de transparence, car
l'ensemble des dispositions passe par cette dernière. Elle permet la
cohesion de l'ensemble des acteurs, cela donne naissance à la confiance
entre eux ( les autorités, la sociète civile , les
pêcheurs, les scientifiques....). Ce phénomène de
transparence permettra aux scientifiques de recolter des données et des
informations fiables afin de connaître l'état et de limiter les
impacts sur les ressources halieutiques, vu que les informatiosn requises vont
être transimises au MEPM. À partir de ces informations, la
delivrance des quotas devient possible.
4. La cogestion responsable et durable des ressources
halieutiques
La cogestion est un processus qui consiste à
l'implication des tous les acteurs de la pêche ainsi que celles des
autorités (ministère de la pêche, ministère de
l'environnement et du développement durable). C'est un modèle de
gouvernance, il est basé sur une gestion de partage. La gestion durable
de la diversité marine se passe à l'échelle nationale et
internationale. Il est impératif que tous les acteurs participent
à la prise de décisions et qu'ils respectent les
réglementations (Jentoft, 2005). La cogestion peut se traduire par la
participation et la contribution financière des industries (usines de
transformations, etc.), elles sont d'une importance capitale à la prise
de décision et la gestion durable.
Une gestion durable ne sera possible que si l'application, le
respect des règles et la cogestion des acteurs concernés sont
tenus en compte. Ce qui offre une opportunité pour une gestion de la
pêche ainsi que de l'aquaculture. En effet, cette cogestion permet de
créer une interconnexion entre les communautés et les
administrations. La cogestion se fait avec différents partenariats et le
partage des pouvoirs entre les autorités et les gestionnaires locaux,
mais la stratégie de
70
cogestion n'est pas le modèle unique. Le processus de
la cogestion demande une charge financière importante sur la gestion de
la diversité marine plutôt que sur le pouvoir public.
L'application de cette dernière a des avantages : un coût moindre,
le respect des réglementations et de bonnes conduites vis-à-vis
des ressources halieutiques (Peter Watt, 2001).
Cela se traduit par les moyens matériels, financiers
ainsi qu'humains afin d'assurer la pêche durable et responsable afin de
réduire la pauvreté. La participation de tous les acteurs
concernés favorise une compréhension des enjeux et cela facilite
la conservation et la préservation, car chacun se sentira
concerné à la prise de décision. Ce défi est
nécessaire, car il faut que ces acteurs soient sérieux pour
respecter les règles du jeu.
La cogestion permet de faciliter la collecte des
données, car elle incitera les pêcheurs à fournir des
renseignements et des informations sur la pratique de leur activité (les
captures et les efforts faits) et cela permettra de faciliter les
décisions adéquates pour une gestion durable et responsable. En
plus, cela permet à l'État de savoir quels types de stocks
d'espèces exploités et en quelle période les exploiter.
Elle favorisera des décisions plus concrètes dans la gestion de
la diversité marine. Nous verrons dans la figure ci-dessous que dans la
cogestion, le devoir de responsabilité est nécessaire pour le
gouvernement ainsi que pour tous les acteurs.
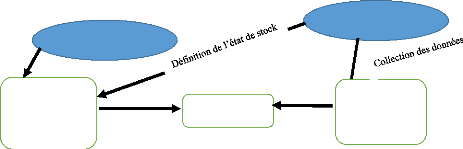
Initiatives des acteurs
Cogestion
Concession de quota
TAC
IMROP
Code de la pêche
MPEM et MEDD ?============= Responsabilité=========?
Acteurs de la pêche
Figure 15 : Cogestion de la pêche et la
conservation des ressources halieutiques
Cependant, la gestion traditionnelle n'est plus efficace en
Mauritanie, car celle-ci ne peut s'adapter à l'évolution et le
développement des outils de la pêche. Bien qu'il soit difficile de
faire participer les acteurs concernés, l'État mauritanien a
souvent une réticence à partager son autorité et est
contrarié de voir ces acteurs empiéter sur ce qu'il
considère comme sa responsabilité.
5. La participation des acteurs à la prise de
décisions
Le processus de cogestion et de participation sont des
processus déterminants pour une gestion durable des ressources
halieutiques et la pêche responsable. Il est important de
déterminer les
71
parties qui participent aux négociations et à la
prise de décision en vue de protéger et gérer les
ressources halieutiques.
Les degrés d'implication à la prise de
décision sont différents en fonction des acteurs d'où
l'importance d'identifier les parties prenantes les plus influentes. Les
acteurs qui participent à la décision sont en partie des
représentants. Le MPEC et les ONG participent à des dialogues et
prennent des initiatives à tous les différents niveaux.
La gestion des ressources passe par la collaboration avec des
acteurs. Cela permet de renforcer les liens entre les parties prenantes, car
chacune d'elles veut continuer à exercer son activité dans le
long terme.
La participation de toutes parties prenantes permet de
créer des plans d'action politique communs tout en tenant compte des
intérêts de tous. Autrement dit, la participation est l'une des
clés de la gouvernance, permettant de consolider les relations et la
confiance entre tous les acteurs. Le principe de participation peut se faire
à toutes les échelles et de plusieurs manières, pouvant
aller de la concertation au partager de responsabilités.
Il est indispensable de souligner que le principe de
participation peut aider le gouvernement mauritanien, car il peut être un
système de transfert de compétences pour la gestion des
ressources halieutiques.
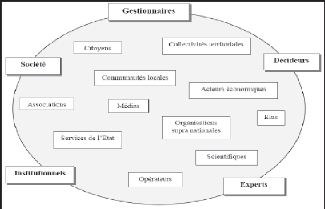
Figure 16 : Table ronde de négociation et de
participation (source Denis et Henocque, 2001)
6. Le cadre juridique et réglementaire de la
pêche en Mauritanie ( Nouadhibou)
Dans le code de la pêche, section des plans de gestion
des pêcheries et des plans d'aménagement, l'article 14 souligne
que des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries doivent
être élaborés annuellement ou pluriannuellement. Les
specialisés définsissent l'état des stocks, le taux et le
volume de captures de ressources halieutiques.
72
La section 2 du code la pêche qui traite des mesures
d'application des réglementations, l'article 39 aborde les limites de
captures des certaines stocks d'espèces en favorisant la conservation
des ressources halieutiques et la protection systématique des
écosystèmes marins. L'article 38 quant à lui évoque
les réglementations pour lutter contre la pollution des hydrocarbures,
des substance toxiques et rejets des captures en mer ainsi que les dispositifs
pour éviter les préjudices écologiques.
Dans cette même optique, la section 4 du même
code sur la déclaration des captures exige la transparence et
l'honnêteté des pêcheurs sur leurs activités. Dans
l'article 34, il est mentionné que toute flotte autorisée
à pêcher dans les eaux nationales mauritaniennes doit transmettre
leurs données statistiques et les informations de leurs captures en
détails à l'organe compètent.
Une amélioration a eu lieu dans la partie relative au
contrôle et à la surveillance des activités de la
pêche : le ministère a fait des efforts pour l'amélioration
dans la surveillance et le contrôles à mettant en place des outils
afin d'assurer le respect et l'application de la loi et les textes
d'application.
L'article 61 de la section 2 met en place des instruments
nécessaires pour la lutte contre la pêche illicite, il favorise la
coopération régionale, sous régionale et internationale
conformément au droit international. Dans la section 7, l'article 44
dispose qu'il est important que tout capitaine et patron de navire de
pêche ait à sa possession un journal de bord de la pêche
dans les directives prévues par l'arrêté ministériel
de la pêche.
En cas d'infraction ou du non-respect aux règles, le
droit de poursuite aura lieu en vue du droit international. Autrement dit,
l'article 85 du code de la pêche 2015 mentionne que tout pêcheur
qui enfreint la réglementation (sur les engins de pêche, les
produits halieutiques...) tout lui sera confisqué et il aura une amende
allant de 100.000 à 150.000.000 Ouguiyas (UM) (250 à 375.000
euros) et une peine allant de 6 à 12 mois d'emprisonnement. S'ajoutant
à cela d'autres sanctions concernant le degré de gravité
de l'infraction, il existe d'autres amendes (voir annexe II).



