UNIVERSITE DE YAOUNDE
II-SOA
UNIVERSITY OF YAOUNDE II-SOA
FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
PO BOX: 1365 YAOUNDÉ-CAMEROON Tel:
(+237) 22213441/Fax: (+237) 22237912
www.fseg.univ-yde2.org

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE
GESTION
BP: 1365 YAOUNDÉ-CAMEROUN
Tel: (+237) 22 21 41 /Fax: (+237) 22 23 79
12
www.fseg.univ-yde2.org
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE
MASTER II EN POLITIQUE PUBLIQUE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du diplôme de master 2 en politique
publique et développement durable
Option : Economie de l'environnement, de
développement rural et de l'agroalimentaire
Par :
KPATAGUELE Chancel Japhet
Titulaire de maitrise en Econométrie
Sous la direction de :
Pr. FOUOPI DJIOGAP Constant
Agrégé de sciences Economiques
Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion
Université de Yaoundé II-Soa
ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
Sommaire
AVERTISSEMENT ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES ET ABREVIATION
v
LISTE DES TABLEAUX
vii
LISTE DES FIGURES
viii
RESUME
ix
ABSTRACT
x
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
12
CADRE D'ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE EN RCA
12
CHAPITRE 1: GENERALITE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE
14
I. EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE
14
II. LES INDICATEURS ET LES INDICES DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE
18
CHAPITRE 2 : LA RCA ET LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
32
I. ANALYSE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE EN RCA
32
II. REVUE DES POLITIQUES ET PROGRAMMES DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION
43
DEUXIÈME PARTIE :
53
IDENTIFICATION DES DÉTERMINANTS DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN RCA
53
CHAPITRE III : MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE
DES DETERMINANTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN RCA
55
I. CADRE ANALYTIQUE DU MODEL LOGIT
55
II. METHODOLOGIE : ENSEMBLE DES DONNEES ET
VARIABLES
62
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION
72
I. ANALYSE DESCRIPTIVE DES VARIABLES
72
II. RESULTATS EMPIRIQUES
78
CONCLUSION GENERALE
81
ANNEXES
81
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
81
TABLES DES MATIERES
81
Avertissement
« L'université de Yaounde II-Soa entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire, ils doivent être considéré comme propre
à leur auteur. »
À
DEDICACE
Mon père KPATAGUELE Eric et à ma mère
NGABA Denise
REMERCIEMENTS
Avant tout propos, je tiens à traduire toute ma
gratitude à l'endroit de tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, ont permis à l'aboutissement heureux de ce mémoire. Je
pense en particulier à Pr. FOUOPI DJIOGAP Constant qui a eu
l'amabilité d'accepter de diriger mon travail durant cette année.
J'ai beaucoup apprécié de travailler sous son encadrement
empreint de rigueur, de suivi régulier et d'une bienveillance
exceptionnelle. Je ne le remercierai jamais assez. J'aimerais qu'il sache que
j'ai énormément appris à ses côtés.
L'expression de ma profonde gratitude s'adresse
également aux enseignants de la Faculté de Sciences Economiques
et de Gestion de l'université de Yaoundé II-Soa et plus
particulièrement à l'endroit de Pr. KAMDEM Cyrille, Coordonnateur
de Master en Economie de l'environnement, de Développement rural et de
l'Agroalimentaire (EEDRA).
Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance envers toute ma
famille pour leur soutien moral, financier et intellectuel afin que ce travail
puisse être mené à bien jusqu'à son terme.
Mon sincère merci à tous les étudiants de
Master EEDRA (2018/2019) et à tous mes compatriotes de Yaoundé et
de Douala pour leur soutien moral.
J'adresse un merci spécial à mes amies NOUBA
Evodie et KENGNI Jolivette, qui ont été un appui inconditionnel
tout au long de cette année.
SIGLES ET ABREVIATIONS
ACDA : Agence Centrafricaine de
Développement Agricole
ANDE : Agence Nationale de
Développement de l'Elevage
BAD : Banque Africaine de
Développement
BEAC : Banque des Etats de l'Afrique
Centrale
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
DRSP2 : Document Stratégique
pour Réduction de la Pauvreté de la seconde
génération
DSDI : Direction des Statistiques de la
Documentation et de l'Informatique
FAO : Food and Agriculture
Organization
FED : Fonds Européen de
Développement
FIDE : Fonds Interprofessionnel
du Développement de l'Elevage
FIDA : Fonds International de
Développement Agricole
FENU : Fonds d'équipement
des Nations Unies
FMI : Fonds Monétaire
international
FNEC : Fédération
Nationale des Eleveurs Centrafricains
ICRA : L'Institut Centrafricain de la
Recherche Agronomique
ICASSES : Institut Centrafricain de la
Statistique et des Etudes Economiques et Sociales
IFPRI : International Food Policy Research
Institute
IPC : Integrated Phase Classification
OCDE : Organisation de Coopération et
de Développement Economique
ODD : Objectifs de Développement
Durable
OMD : Objectif du Millénaire pour le
Développement
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé
PAIA : Projet d'Appui aux Institutions
Agricoles
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PED : Pays en Développement
PDEO : Projet de
Développement de l'Elevage à l'Ouest
PDEOBK : Projet de Développement
de l'Elevage dans la Ouaka et la Basse-Kotto
PED : Pays En Développement
PNDE : Projet National de
Développement de l'Elevage
PNUD : Programme des Nations unies pour le
développement
PED : Pays En Développement
PIB : Produit Intérieur
Brut
PIBA : Produit Intérieur Brut
Agricole
PNIASAN : Programme National
d'Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnel
RCA : République
centrafricaine
UNICEF : Fonds des Nations unies pour
l'enfance
USAID : Agence des Nations unies pour
le développement international
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Indicateurs par
dimension de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
23
Tableau 2 : Indicateurs de
l'ISAM
26
Tableau 3 : Indicateurs
bio-marqueurs de micronutriments
30
Tableau 4 : Productions
vivrières de la RCA de 2012 à 2015 en tonnes
34
Tableau 5 : Importations
alimentaires de la RCA de 2012 à 2015 en millions de FCFA
35
Tableau 6: Régimes
alimentaires des différents groupes de consommation en RCA
39
Tableau 7 : Résultats
de l'enquête sur la malnutrition à Bangui et dans
l'Ombella-Mpoko
43
Tableau 8: Allocations
budgétaires des départements ministériels en lien avec la
SAN
50
Tableau 9: Définition
des variables du modèle
64
Tableau 10:
Explications des variables dummy
66
Tableau 11: Les variables
dummy de l'instabilite politique en RCA
67
Tableau 12:
Statistiques descriptives des variables
76
Tableau 13: Matrice des
corrélations linéaires des variables
77
Tableau 14: Estimation
par le modèle logit
78
Tableau 15: Calcule des
effets marginaux
79
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Situation de
la sécurité alimentaire par préfecture
37
Figure 2 : Evolution de
l'investissement public (FBCF) en RCA
72
Figure 3 : Evolution de
la production agricole en RCA
73
Figure 4 : Evolution de
l'importation des produits alimentaires en RCA
74
Figure 5 : Evolution de
l'indice des prix à la consommation
74
Figure 6 : Evolution de
PIB par tête en RCA
75
Figure 7: Croissance de
la population Centrafricaine
75
RESUME
L'objectif général de ce travail est
d'identifier les déterminants de la sécurité alimentaire
en République Centrafricaine. De manière spécifique, il
s'agit d'une part, d'identifier les déterminants économiques de
la sécurité alimentaire et d'autre part, d'identifier les
déterminants non économiques de la sécurité
alimentaire. L'analyse utilise les données secondaires. Un modèle
économétrique qui est le modèle logit est utilisé
pour identifier les déterminants la sécurité alimentaire.
Nos résultats montrent que l'investissement public est le
déterminant économique majeur de la sécurité
alimentaire et la stabilité politique est le déterminant non
économique majeur de la sécurité alimentaire en RCA. A cet
égard, une augmentation de l'investissement public de 10% entraine une
amélioration de la sécurité alimentaire d'un point et une
amélioration de la stabilité politique conduit à une
réduction de l'insécurité alimentaire en RCA. Tandis que
l'indice des prix à la consommation a un impact négatif sur la
sécurité alimentaire en RCA. En termes de l'implication de la
politique économique, les décideurs politiques doivent augmenter
la part de formation brute du capital fixe (FBCF) dans la richesse crée
enfin de renforcer le capital public pour garantir la sécurité
alimentaire et des actions économiques qui ont une
externalité positive sur la stabilité politique doivent
être menées pour permettre la réduction de
l'insécurité alimentaire dans le pays.
Mots clés : Déterminants,
sécurité alimentaire, modèle logit, RCA
ABSTRACT
The overall objective of this work is to identify the
determinants of food security in the Central African Republic. Specifically,
this involves identifying the economic determinants of food security and
identifying non-economic determinants of food. The analysis uses the secondary
data. An econometric model that is the logit is used to identify the
determinants of food security. Our results show that public investment is the
major economic determinant of food security and political stability is the
major non-economic determinant of food security in CAR. In this regard, an
increase in public investment of 10% leads to an improvement in food security
of one point and an improvement in political stability leads to reduction of
food insecurity in CAR. While the consumer price index has a negative impact on
food security in CAR. In terms of the involvement of economic policy,
policymakers must increase the share of gross fixed capital formation (GFCF) in
the wealth finally created to strengthen public capital and guarantee food
security and economic actions that have externalities on political stability
must be conducted to help reduce food insecurity in the country.
Keywords: Determinants, food security, logit
model, CAR
INTRODUCTION GENERALE
1.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le concept de sécurité alimentaire est apparu
pour la première fois lors de la conférence mondiale sur
l'alimentation de 1974,1(*)
la définition retenue à cette occasion, est que la
sécurité alimentaire consiste à « disposer à
chaque instant d'un : Niveau adéquat de produits de
base pour satisfaire la progression de la consommation et atténuer les
fluctuations de la production et des prix » (Maxwell, 1995, cité
par Kako, 2000). A cette conception de la
sécurité alimentaire essentiellement basée sur l'offre
alimentaire, a succédé à la suite des travaux d'Amartya
Sen sur les famines, une approche plus globale basée sur la notion de
droit d'accès à l'alimentation (entitlements approach). 2(*)La nouvelle approche accorde une
place primordiale à l'accessibilité alimentaire. L'idée
étant que même dans le cas où l'offre alimentaire est
suffisante, certains ménages peuvent avoir un accès limité
à la nourriture du fait de conditions d'échange
défavorables ou d'une insuffisance de moyens.
Depuis lors, la définition de la sécurité
alimentaire généralement utilisée est plus large. En
effet, dans sa définition reformulée, la sécurité
alimentaire est la possibilité pour chaque individu d'accéder en
tout temps à une alimentation salubre et nourrissante, lui permettant
d'avoir une vie saine et active. Pour Hoskins (1990), la sécurité
alimentaire est définie comme la possibilité physique et
économique d'accéder pour tous et en tout temps aux produits
alimentaires. Cette seconde définition est adoptée lors des
travaux du sommet mondial sur l'alimentation en 1996. Ainsi, dans sa
définition vulgarisée, « la sécurité
alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout
moment, un accès physique et économique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour
mener une vie saine et active » (FAO, 1996)3(*). Quatre dimensions sont définies dans la
sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire
comporte quatre dimensions: La disponibilité de la nourriture en
quantité suffisante; La stabilité de l'approvisionnement ;
L'accessibilité physique et économique des denrées et la
qualité nutritionnelle.
L'amélioration de la sécurité alimentaire
fait l'objet d'un consensus unanime, des grandes agences internationales la
mettent au coeur de leurs préoccupations, tandis que les initiatives
régionales de lutte contre la faim gagnent du terrain : en juillet 2014,
lors du sommet de l'Union africaine à Malabo (Guinée
équatoriale), les chefs d'États africains se sont engagés
à mettre un terme à la faim sur le continent d'ici à 2025
et en 2013, lors du premier sommet de la Communauté des États
latino-américains et caribéens, les chefs d'État et de
gouvernement ont approuvé l'objectif Faim zéro 2025 et
réaffirmé l'engagement de la région en faveur de
l'initiative Amérique latine et Caraïbes libérées de
la faim en 2025 lancée en 2005 (Zidouemba et Gérard. 2015).
Au cours des 20 dernières années, le nombre de
crises alimentaires a augmenté d'une moyenne de 15 par an dans les
années 1981 à plus de 30 par an à partir de l'an 2000. Les
crises alimentaires les plus graves provoquées par l'intervention
humaine qui persistent pendant plusieurs années sont
considérées comme des crises prolongées. La plupart des
crises prolongées touchent l'Afrique, où le nombre moyen de crise
a triplé au cours des 20 dernières années. Ces crises sont
essentiellement favorisées par les conflits armés, souvent
accompagnés de sécheresses, d'inondations et des effets de la
pandémie du sida. L'incidence de ce facteur sur la production
alimentaire et la sécurité alimentaire a été
catastrophique pour des millions de personnes qui sont obligées de
quitter leurs foyers, ont l'impossibilité de travailler leurs terres,
coupés des marchés où ils peuvent écouler leurs
produits ainsi que des approvisionnements commerciaux de semences, d'engrais et
du crédit (FAO, 2006).
La RCA dont le développement repose sur le secteur
agricole ne fait pas exception à la situation d'insécurité
alimentaire qui touche le continent africain.
Cependant, on pense que les conditions climatiques
défavorables et les conflits, qui se produisent souvent en même
temps, sont des facteurs clés qui expliquent l'augmentation
récente de l'insécurité alimentaire dans le pays. Un
environnement économique mondial difficile, reflété dans
la baisse des prix des produits extractifs et non extractifs et une faible
croissance, a également contribué à l'augmentation de
l'insécurité alimentaire dans de le pays, la majorité des
personnes en insécurité alimentaire en 2016 vit dans des zones
touchées par des conflits. Le taux de l'insécurité
alimentaire est environ deux fois plus élevé dans les zones
touchées par des conflits en situation de crise prolongée que
dans les zones qui ne sont pas touchées par des conflits, et
généralement, les résultats en matière de nutrition
sont plus graves dans ces zones (FAO, 2017).
Plusieurs travaux, s'interrogeant sur les raisons de la
persistance de l'insécurité alimentaire mettent en avant le
rôle de la pauvreté (Sen, 1981). La croissance durable de
l'agriculture apparaît alors comme une condition essentielle,
étant donné la part de la population dans ce secteur et
l'importance de la pauvreté rurale (World Bank, 2008).
Dans les mécanismes décrits, la faiblesse de
l'investissement est la variable clé et l'investissement en zone rurale
est désigné comme élément essentiel dans la lutte
contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire (World
Bank, 2008 ; Barett et al., 2010 ; De Janvry, 2010 ; De Janvry et Sadoulet,
2010). Comme les ménages se trouvent pris dans un cercle vicieux, il est
nécessaire de trouver des leviers capables de rompre ces
enchaînements (Poulton et al., 2006). On attend de la croissance des
investissements des impacts positifs sur la sécurité alimentaire
non seulement en zone rurale mais aussi en zone urbaine, la baisse des prix
consécutive à la croissance de la production permettant de
satisfaire à la fois les ruraux et les urbains (Timmer, 2000 ; FAO,
2012). Afin de générer cette croissance des investissements, de
nombreux auteurs mettent en avant la nécessité d'infrastructures
publiques, essentielles pour créer un environnement plus favorable
(Barro et Sala-I-Martin, 1995 ; Aghion et Howitt, 1998). En effet, en l'absence
d'investissements publics en zone rurale (ou encore de leur faible
efficacité, voire leur détournement), l'offre de biens publics
(routes, entrepôts de stockage, irrigation, électricité,
accès à la santé et à l'éducation) est
insuffisante, accroissant considérablement les coûts et grevant
ainsi la rentabilité des activités économiques. La
faiblesse de la densité de la population qui rend la construction des
infrastructures plus coûteuse explique partiellement cette situation dans
de nombreux pays d'Afrique Sub-saharienne (Cour, 2001 ; Fafchamps et al.,
2005).
Selon le rapport de l'organisation mondiale l'alimentation et
de l'agriculture (FAO, 2016), 2 million des centrafricains étaient en
situation insécurité alimentaire, soit 48% de la population. La
RCA se classait parmi les pays qui ont une forte prévalence en
sous-alimentation, sur 18 pays en forte insécurité alimentaire,
la RCA se classait 13ème. L'un des symptômes de la
grande pauvreté des ménages est naturellement l'allocation de la
proportion importante voire très importante de leur budget dans l'achat
de nourriture. L'analyse de la dimension économique de
l'insécurité alimentaire sur la base de l'indice part de la
dépense alimentaire au sein des ménages, indique qu'à
l'échelle nationale, 31% de la population centrafricaine ont des
dépenses alimentaires représentant plus de 75% de leurs
dépenses totales, cette situation de l'insécurité
alimentaire est très sérieuse et mérite bien l'attention
sérieuse étant donné que le pays est en train de se battre
pour relancer son activité économique.
Dans cette même logique, on note que pour 75% des
ménages, la dépense alimentaire atteindrait plus de 50% de leurs
dépenses totales. Cette situation explique que la préoccupation
première des ménages demeure l'accès à
l'alimentation et cela au détriment des autres dépenses en lien
avec (i) l'investissement agricole, (ii) la santé et (iii)
l'éducation.
Située au coeur de l'Afrique, la République
Centrafricaine (RCA) a une superficie de 623.000 Km². Elle est
limitée au Nord par le Tchad, au Sud par le Congo et la
République Démocratique du Congo (RDC), à l'Est par le
Soudan et à l'Ouest par le Cameroun. La RCA a une population
estimée à 4.479.444 habitants en 2010, soit une densité de
7,2 hab./Km² (RGPH 2003). Les plus fortes concentrations de populations
sont remarquées le long des axes routiers, notamment dans les
préfectures de l'Ouham, l'Ouham-Pendé, la Ouaka et la Basse-Kotto
et dans la périphérie de la capitale (Bangui). Le relief,
très peu accidenté, est dominé par une dorsale centrale
qui sépare les deux principaux réseaux hydrographiques du pays:
le bassin Tchadien au nord et le bassin Oubanguien au sud. Un pays
enclavé dont l'économie est essentiellement basée sur
l'agriculture, la RCA est encore classée parmi les Pays les moins
avancés malgré ses énormes potentialités qui
demeurent faiblement exploitées. En effet, sur près de 15 000 000
d'hectares de terres arables, seulement 700.000 ha sont mis en culture chaque
année soit environ 2% de ce potentiel.
En effet, l'économie centrafricaine repose encore
largement sur le secteur agricole (agriculture, pêche, chasse,
forêt). Ce secteur emploie environ 70% de la population active du pays et
contribue pour 55% au produit intérieur brut (PIB) en 2008, contre 13,1%
pour le secteur secondaire et 31,9% pour le secteur tertiaire (Banque des
États de l'Afrique centrale, BEAC, 2008). La contribution des
différents sous-secteurs (agriculture, élevage, chasse et
pêche, et forêts) au PIB agricole (PIB-Agri) est très
inégale : en 2008, la part des cultures vivrières dans le
PIB-Agri était de 51,40% alors que celle des cultures de rente (coton,
café, tabac) n'était que de 1,23%. Les sous-secteurs de
l'élevage (bovins, caprins, ovins), de la chasse et pêche et des
forêts représentaient respectivement 22,83%, 9,60% et 14,94% du
PIB-Agri. Les principales productions de rente se sont
généralement repliées. Globalement, les activités
rurales, malgré les conditions agro écologiques favorables dont
elles bénéficient, présentent des performances très
faibles. Pendant trois décennies, les sous-secteurs agriculture et
élevage, qui occupent près de 75% de la population active du pays
et représentent près de 50% du PIB, ont connu une croissance
annuelle moyenne faible de l'ordre de 2%, inférieure de fait au taux de
croissance de la population estimé à 2,5% lors du recensement de
la population de 2003 (BEAC, 2009).
Outre la faiblesse structurelle du secteur agricole, de
nouveaux facteurs contribuent aujourd'hui à accroître la
vulnérabilité des populations. Notamment, ces dernières
années la crise économique mondiale, la volatilité des
cours des denrées alimentaires et les conflits armés sont venues
exacerber les difficultés économiques du pays. Or, selon les
résultats de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de
la Sécurité Alimentaire en RCA (AGVSA), 64 % des ménages
ont recours au marché comme principale source d'approvisionnement des
produits alimentaires. Même parmi les ménages ayant pour
activité principale l'agriculture, 48 % d'entre eux ont recours au
marché comme principale source d'approvisionnement des produits
alimentaires, ce qui explique la faiblesse de production agricole. La
capacité de l'agriculture a assuré la sécurité
alimentaire est alors remise en cause.
L'investissement dans des biens publics à des effets
très positifs sur la croissance agricole, la réduction de la
pauvreté et lutte contre la faim, la fourniture de biens publics est une
part essentielle de l'environnement porteur à mettre en place pour
encourager les investissements agricoles. Les données recueillies dans
de nombreux pays, au cours de cinq décennies, montrent que les
investissements publics consacrés à la R&D agricole, à
l'éducation et aux infrastructures rurales sont plus rentables que
d'autres dépenses comme la subvention des intrants. L'investissement
dans des biens publics utiles à l'agriculture a des incidences
très positives sur la productivité agricole et la
réduction de la pauvreté, ce qui montre que ces deux objectifs
sont souvent compatibles, et non pas antagonistes. En outre, en milieu rural,
les investissements dans les biens publics seront probablement
complémentaires, par nature; ainsi, les investissements dans
l'éducation et les infrastructures rurales ont tendance à
améliorer les investissements agricoles et figurent souvent parmi les
principaux facteurs de croissance agricole et, en général, de
croissance économique en milieu rural. Les effets relatifs d'autres
types d'investissement varient d'un pays à l'autre, d'où la
nécessité de définir localement les priorités en
matière d'investissement mais il faut bien admettre qu'en milieu rural,
les investissements dans des biens publics produisent des résultats qui
se renforcent mutuellement (FAO, 2012).
2.
PROBLEMATIQUE
Les crises alimentaires mondiales au cours des deux
dernières décennies et les différentes émeutes de
faim qui se sont suivies dans de nombreux Pays en Développement ont
remis en cause la capacité du système de production alimentaire
actuel à nourrir une population en pleine croissance. En effet, la
croissance démographique mondiale cumulée aux effets des
changements climatiques sur l'agriculture font peser sur l'humanité le
risque d'un piège malthusien qui ne peut être évité
que par un système productif plus performant et durable. De plus,
l'environnement économique, juridique, institutionnel et
réglementaire justifie la forte aversion à entreprendre des
activités agricoles (FAO, 2009).
Malgré les différents investissements dans le
secteur agricole en RCA, l'agriculture est dominée par de petites
exploitations agricoles familiales pratiquant la culture manuelle sur des
surfaces très restreintes (0,5 à 0,75 Ha par actif). La
fertilité du système agraire est assurée par
l'abatis-brulis. La productivité agricole est très faible et les
cultures sont principalement autoconsommées (FIDA, 2017). Les efforts
d'investissement dans l'agriculture se résument aux engagements des
partenaires du développement de la RCA pour le financement des
activités des différents programmes. Dans les années 80 le
secteur agricole a bénéficié aux financements des
partenaires suivants : le fond européen de développement
(FED) ; le fond arabe pour le développement (FAD) ; la banque
africaine de développement (BAD), le fond international pour le
développement agricole (FIDA), ses partenaires qui financent les
différents programmes de développement agricole sont
obligé en 1998 de quitter pour manque de mesure de pérennisation
des actions menées pendant la période de post-financement. En
janvier 2005, les partenaires reviennent avec le financement dans des nouveaux
programmes, il s'agit de :
- Financement de programme d'appui à la mise en place
des Pôles régionaux de développement, sous le
9emFED réalisé par l'Union Européenne, en
février 2010 ce même partenaire prolonge son intervention sous le
10em FED en déboursant 7 millions de d'euro pour le Projet de
micro-réalisation (PMR2) et 8 millions d'euro pour la relance de
l'économie rurale et l'intégration des activités.
- Financement de la BAD du projet de développement
communautaire et d'appui aux groupes vulnérables d'un montant de 6,24
milliards de FCFA ; de projet d'appui à la réhabilitation
d'infrastructures rurales d'un montant de 3 milliards de FCFA (2 marchés
à bétail, 2 abattoirs, 2 marchés communaux, 1
marché rural, 60 km de pistes, équipement de 6 laboratoires
d'analyse et de contrôle des produits, réhabilitation et
équipement de 2 centres de formation professionnelle) et financement du
projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement de trois chefs-lieux
de préfecture (Bambari ; Sibut ; Bangui), d'un montant de 7,82 milliards
de FCFA.
- Financement de la Banque Mondiale pour instruire un projet
d'appui au secteur agricole, spécifiquement d'appui aux infrastructures
rurales pour un montant de 24 millions USD qui a été mise en
oeuvre novembre 2011.
- Financement de 9 millions de $US par le FIDA pour le
développement des productions agricoles, l'appui à l'accès
aux marchés, l'amélioration du cadre de vie, le renforcement des
capacités des producteurs et des services techniques d'appui et en fin
la coordination, le suivi-évaluation et la gestion.
Suite à ses différents financements, la
production agricole à subit une hausse entre 1980 à 1998, la
croissance de la production était de 15%, après le retrait des
bailleurs en 1998, production agricole a subi une décroissance de -1,8%
et de -0,5% en 2002, une faible augmentation de la production agricole de 1,0%
en 2005 pour atteindre 4,9% en 2009 et 3,7% en 2012 (BEAC, 2010 ; WDI,
2018). Malgré une bonne performance de l'agriculture, Les
approvisionnements alimentaires du pays sont relativement dépendants des
importations, l'importation annuelle des produits alimentaires est
stimmée à hauteur de 70 000 000 000 (KAMAYEN,
2017). En dépit de tout ça l'insécurité alimentaire
règne toujours dans le pays, la problématique d'accès
à l'alimentation et de la disponibilité de la nourriture des
ménages est toujours dans les débats en RCA, 29% de la population
est en insécurité alimentaire aigue selon l'analyse IPC d'Aout
20194(*).
3.
QUESTION DE RECHERCHE
De ce problème découle une question de recherche
à savoir: Quels sont les déterminants de la
sécurité alimentaire en RCA? De cette interrogation principale
de recherche découle deux questions spécifiques.
· Quels sont les déterminants
économiques de la sécurité alimentaire en RCA?
· Quelle sont les déterminants non
économiques de la sécurité alimentaire en RCA ?
4.
OBJECTIF DE RECHERCHE
Cette étude a pour objectif principale d'identifier les
déterminants de la sécurité alimentaire en RCA. De
manière spécifique il s'agira:
· D'identifier les déterminants
économiques de la sécurité alimentaire en RCA.
· D'identifier les déterminants non
économiques de la sécurité alimentaire en RCA.
5.
HYPOTHESE DE RECHERCHE
Pour atteindre ses objectifs nous formulons des
hypothèses suivantes :

 : L'investissement public est le déterminant économique
majeur de la sécurité alimentaire en RCA.
: L'investissement public est le déterminant économique
majeur de la sécurité alimentaire en RCA.

 : La stabilité politique est le déterminant non
économique majeur de la sécurité alimentaire en
RCA.
: La stabilité politique est le déterminant non
économique majeur de la sécurité alimentaire en
RCA.
6.
METHODOLOGIE
L'objectif de notre travail est d'identifier les
déterminants de la sécurité alimentaire. Pour atteindre
cet objectif et vérifier nos hypothèses, nous allons
procéder aux méthodes économétriques. Pour
analyser la relation entre les déterminants identifier et la
sécurité alimentaire, nous allons utiliser le model logit.
Tout au long de ce travail, nous utiliserons logit comme
méthode d'estimation, les données concernant nos variables
proviendront de la base de données de la Banque Mondiale et FAO couvrant
la période de 1990 à 2017 et seront traitées à base
de logiciel STATA 14.
7.
INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES ET PRATIQUE DE L'ETUDE
7.1
INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES
Même si beaucoup de travaux ont mis l'accent sur la
globalisation des échanges comme le facteur principale susceptible
d'améliorer la sécurité alimentaire pour un pays moins
avancé comme la RCA, la stabilité politique et l'investissement
public occupent une place prépondérante parmi les facteurs
améliorant la sécurité alimentaire.
Il est nécessaire de faire une analyse empirique des
déterminants de la sécurité alimentaire pour une mise en
place d'un plan cohérent de réformes économiques. Etant
donné qu'aucune étude empirique n'a été fait sur
les déterminants de la sécurité alimentaire en RCA, cette
étude va contribuer au débat académique sur la
modélisation de ce phénomène dans le pays, et va permettre
de mettre en évidence des données réelles, quantitative
vérifiable pouvant servir a d'autre recherche ultérieures.
7.2
INTÉRÊTS PRATIQUES
La sécurité alimentaire est devenue aujourd'hui
l'une des questions essentielles en matière de développement
durable, elle est un phénomène qui occupe une place importante
dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.
L'agriculture centrafricaine est resté depuis ce temps
une agriculture de subsistance, malgré la part de l'investissement dans
ce secteur, elle n'est pas toujours capable d'assurer la sécurité
alimentaire dans le pays, la faiblesse de capital public est la cause de
beaucoup de phénomène qui joue sur l'économie
centrafricaine. En outre l'instabilité politique qui règne dans
le pays depuis l'indépendance à un impact sur la
sécurité alimentaire des ménages.
Il est donc nécessaire d'analyser cette situation d'une
manière concrète, ce qui nous aiderait à mettre en
évidence son degré d'importance, d'urgence et les interrelations
pour une meilleure élaboration des politique publiques ainsi que la mise
en oeuvre, et le succès des objectifs de développement durable
définis par les Nations Unis.
8.
Organisation du travail:
Dans cette étude notre objectif est d'identifier les
déterminants de la sécurité alimentaire en RCA, pour bien
mené notre étude, nous allons organiser notre travail en deux
parties : la première partie va être consacrée au
cadre d'analyse des déterminants de la sécurité
alimentaire en RCA et dans seconde partie nous allons essayer
d'identifier les déterminants de la sécurité
alimentaire.
PREMIERE PARTIE :
CADRE D'ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN
RCA
INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE
La sécurité alimentaire est devenue une
préoccupation majeure des pays en développement, sa
corrélation avec la pauvreté lui donne une place importante dans
la stratégie de lutte contre la pauvreté, beaucoup de
décideurs politiques ainsi que les organisations internationales
aujourd'hui mettent en avant la sécurité alimentaire dans leur
politique de lutte contre la pauvreté, on peut voir que bon nombre de
personne vivant sous le seuil de l'insécurité alimentaire se
trouve dans les pays pauvres. Dans cette partie, il sera question de faire une
analyse conceptuelle de la sécurité alimentaire (la
généralité de la sécurité alimentaire) dans
le chapitre 1, dans le chapitre 2 il sera question de faire une analyse de la
sécurité alimentaire en RCA.
CHAPITRE
1: GENERALITE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE
INTRODUCTION
A la fin des années 60, l'instabilité de la
situation alimentaire est telle que les pays en développement n'ont pas
de disponibilité alimentaire suffisante en moyenne pour chaque
habitant. Dans les années 70, la situation n'a guère
changé, bien au contraire, elle s'est dégradée donnant
lieu 35% de la population mondiale, soit 90 millions d'individus, en
sous-alimentation. Suite à la persistance de la pauvreté, de la
malnutrition mais surtout des problèmes sévères
liés à l'autosuffisance alimentaire, c'est ce qui d'ailleurs a
poussé les Nations Unies a convoqué en 1974 le premier sommet
mondial sur la question de l'alimentation et qui a permis l'adoption de la
proclamation solennelle selon laquelle : « chaque homme, femme
et enfant a le droit inaliénable d'être libéré de la
faim et de la malnutrition afin de développer pleinement ses
facultés physiques et mentales. Depuis lors le nombre de
conférence sur la sécurité alimentaire ne cesse
d'augmenter, ce pendant la part de la population mondiale vivant sous le seuil
de la pauvreté et l'insécurité alimentaire s'est accru.
Ce chapitre se propose de faire la généralité sur la
sécurité alimentaire. Dans la première section, nous
allons nous appesantir sur l'évolution des indicateurs de la
sécurité alimentaire et dans seconde section nous allons
parcourir les différents indicateurs et indices mesuré la
sécurité alimentaire
I. EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE
Mesurer la sécurité alimentaire est une
tâche difficile en raison de la complexité du concept (Barrett,
2002). Néanmoins, les décideurs politiques ont besoin de savoir
combien de personnes sont à risque, qui ils sont, et la meilleure
façon de les atteindre. En conséquence, des investissements
importants ont été réalisés dans
l'élaboration d'indicateurs utiles et la collecte de données pour
servir cet objectif. Même si les indicateurs disponibles sont loin
d'être parfaits, ils se révèlent utiles sur le plan
opérationnel.
Les indicateurs de sécurité alimentaire et
nutritionnelle, ont évolué avec le concept de la
sécurité alimentaire. L'analyse de l'évolution du concept
de la sécurité alimentaire a permis de mettre en évidence
trois grandes périodes de la vision de la sécurité
alimentaire et de ses déterminants. Jusqu'au début des
années 1980, une première période assimilant la
sécurité alimentaire à la disponibilité
alimentaire, a entraîné le recours principalement aux
évaluations des récoltes, et aux prévisions des volumes de
production. Une seconde période que l'on peut qualifier de post-Sen
considère la sécurité alimentaire comme une fonction des
revenus, des prix, des filets de sécurité sociale et des droits
(entitlements). Elle a conduit à des indicateurs multidimensionnels de
plus en plus complexes utilisant des prix, des revenus et des données
anthropométriques. Enfin, aujourd'hui, la sécurité
alimentaire est considérée dans une perspective de
vulnérabilité ou de risque nutritionnel et incorpore de plus en
plus des indicateurs relatifs au comportement d'adaptation des individus.
Campbell (1991) distingue quatre aspects essentiels de
l'insécurité alimentaire à tous les niveaux d'analyse: (i)
la disponibilité quantitative, (ii) les aspects qualitatifs concernant
les types et la diversité des aliments, (iii) les dimensions
psychologiques liées à des sentiments de privation, de choix
restreint , ou l'anxiété liée à la qualité
ou la quantité de nourriture disponible, et (iv) l'acceptabilité
sociale des modes de consommation, en termes de fréquence et de la
composition des repas ainsi que des modalités d'acquisition de la
nourriture: autoconsommation ou achat, mendicité ou vol.
Une série d'indicateurs reflétant des
informations sur un ou plusieurs des quatre aspects existent, bien que la
plupart des données soient principalement recueillies sur l'aspect (i),
avec beaucoup moins d'attention sur les aspects (ii) à (iv). Les
indicateurs les plus couramment utilisés se fondent sur l'observation
directe de l'insuffisance alimentaire : la faim et la malnutrition qui sont des
conditions suffisantes de l'insécurité alimentaire. Il s'agit de
rechercher des symptômes physiologiques de la privation, le plus souvent
manifestes dans les mesures anthropométriques (taille/âge,
poids/taille, circonférence du bras, ou indice de masse corporelle),
comme dans les évaluations des répondants eux-mêmes sur
l'adéquation de leur régime alimentaire, ainsi que dans les
données sur les apports en nutriments. Il existe un large
éventail de méthodes de collecte de ces données-mesures
directes, échantillonnage aléatoire, non-aléatoire ou
stratifié-avec des variations considérables dans le coût,
la rapidité, l'intrusion et la fiabilité (Babu et
Pinstrup-Andersen, 1994; Strauss et Thomas, 1998).
Les données agrégées disponibles sont
généralement celles liées à la disponibilité
alimentaire au niveau national et sont donc relatives à la
première conceptualisation de la sécurité alimentaire,
à savoir la disponibilité. Les estimations des
disponibilités énergétiques par tête basées
sur les bilans alimentaires (food balance sheets) et des hypothèses sur
la répartition de la consommation énergétique alimentaire
au sein de la population, ne donnent cependant aucune information sur
l'accès des individus à la nourriture. Ces mesures peuvent
sous-estimer ou surestimer la prévalence de l'insécurité
alimentaire (Smith, 1998).
La disponibilité de plus en plus grande de
données d'enquête ménages comme les dépenses de
consommation et l'autoconsommation permet d'avoir par extrapolation des mesures
intéressantes des niveaux de consommation, mais la fiabilité de
ces estimations varie grandement en fonction de la
représentativité de l'échantillon enquêté et
des méthodes d'extrapolation. En outre, il existe presque toujours des
erreurs de mesures dans les niveaux de consommation soit en raison de
déclarations erronées sur les dépenses soit du fait de la
non prise en compte (ou des erreurs dans l'estimation) de l'autoconsommation
(Srinivasan, 1981; Bouis, 1994) ou de la consommation de membres
extérieurs au ménage. Les variations inter et intra individuelles
des besoins en macro et micronutriments - basés sur la
génétique, les niveaux d'activité, l'état de
santé, etc. - compliquent également la définition de
seuils appropriés d'apport et donc l'estimation de l'incidence de la
faim et de la dénutrition (Payne et Lipton, 1994; Higgins et Alderman,
1997).
De plus en plus d'économistes utilisent des
données anthropométriques qui ont l'avantage d'être moins
sujettes à des erreurs de mesure systématiques (Strauss et
Thomas, 1998). Mais la grande faiblesse des mesures anthropométriques
comme indicateurs de sécurité alimentaire est que la santé
est le produit de plusieurs facteurs (et pas nécessairement liée
à la consommation alimentaire). Ces mesures peuvent par
conséquent surestimer la prévalence de l'insécurité
alimentaire.
Barrett (2002) considère qu'il y existe plusieurs
raisons de penser que la plupart des indicateurs sous-estiment la
prévalence de l'insécurité alimentaire. Tout d'abord, en
dépit de la reconnaissance que les mesures de la consommation au niveau
du ménage sont une mauvaise approximation de la consommation au niveau
de l'individu, la plupart des enquêtes sur les dépenses de
consommation s'intéressent aux ménages et non directement aux
individus. Or il est maintenant reconnu que des individus peuvent être en
forte insécurité alimentaire dans des ménages en
sécurité alimentaire. Ensuite, parce qu'une
insécurité alimentaire n'entraîne pas nécessairement
une insuffisance alimentaire, la faim ou la malnutrition, elle est probablement
plus répandue que ses trois sous-produits. Les mesures de
l'insécurité alimentaire demeurent par conséquent
imprécises.
La collecte des données sur la disponibilité
(consommation alimentaire et dépenses, données
anthropométriques) est évidemment très coûteuse,
difficile à réaliser et à analyser. Les politiques et les
partenaires techniques et financiers ont besoin d'économiser des
ressources limitées et du temps pour d'autres projets. D'autres
expérimentations de mesures alternatives de sécurité
alimentaire moins coûteuses et conformes à l'évolution du
concept ont donc vu le jour. Ces mesures concernent : la pauvreté de
revenu et de capital (asset), le nombre d'aliments uniques consommés,
les prix alimentaires, les salaires, les ratios de dépendance et la
morbidité. Lorsqu'elles sont disponibles, ces données permettent
de représenter relativement bien l'état de la
sécurité alimentaire (Chung et al., 1997).
La troisième période de la vision de la
sécurité alimentaire introduit le risque et les comportements
d'adaptation dans la mesure de la sécurité alimentaire.
L'idée est que les individus ne vivent pas passivement
l'insécurité alimentaire mais emploient une séquence
graduée de réponses au risque et à l'adversité (de
Garine, 1972). Compte tenu des difficultés pratiques à estimer
des risques inobservables et subjectifs auxquels les individus sont
confrontés, leurs comportements observables peuvent
révéler beaucoup de choses sur leur bien- être et leur
sécurité alimentaire. L'étude des stratégies
d'adaptation a l'avantage supplémentaire de permettre de saisir les
dimensions psychologiques et sociales de l'acceptabilité de
l'insécurité alimentaire (aspects (iii) et (iv) ci-dessus). En
outre, non seulement les stratégies permettent de localiser les
individus en insécurité alimentaire, mais aussi elles
reflètent l'intensité de leur insécurité. Maxwell
(1996) montre qu'il est possible d'identifier un éventail de
stratégies, et d'établir des échelles de
sévérité et de fréquences pour développer un
indice cumulatif raisonnablement fiable de la sécurité
alimentaire. Les stratégies d'adaptation tout comme leur
intensité sont cependant très contextuelles. Par exemple, la
migration de détresse peut représenter une réponse plus
grave que la vente d'un animal ou la consommation des stocks de semences, mais
il est difficile, voire impossible, même dans une zone limitée, de
généraliser une hiérarchie de réponses ex ante
(Davies, 1996).
L'évolution des indicateurs de sécurité
alimentaire s'est traduite par le passage de mesures objectives et
quantitatives à des mesures subjectives ou qualitatives. Les
premières s'intéressent généralement à des
niveaux cibles de consommation en kilocalories par tête (Siamwalla et
Valdés, 1980; Reardon et Matlon, 1989) ou à des normes de
consommation en volumes (kilogrammes par tête et par an) de
différents produits par pays, basées sur les habitudes
alimentaires (CILSS, 2004). Les secondes quant à elles sont relatives
à l'appréciation que se font les individus eux-mêmes de
leurs problèmes alimentaires : possibilité de choix entre
différents régimes alimentaires, la sensation de la privation ou
l'acceptabilité sociale de la manière d'acquisition des aliments
(Radimer et al., 1992).
II. LES INDICATEURS ET LES INDICES DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE
II.1 Les indicateurs usuels
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN): l'état de
l'art
Un indicateur doit refléter une situation donnée
ou une réalité sous-jacente qui est difficile à quantifier
directement. Il donne généralement un ordre de grandeur sur une
échelle donnée. Plus le phénomène à mesurer
est complexe, plus il y a nécessité d'un ensemble d'indicateurs
pour le saisir. Cela signifie qu'un simple indicateur ne peut pas
résumer la complexité de la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (SAN). Par conséquent un ensemble d'indicateurs (qu'ils
soient compilés ou non dans un indice) doit être construit en vue
de capturer toutes les dimensions de la SAN. Lors de l'analyse de l'impact de
différents facteurs sur la SAN, l'évaluation de l'impact peut
alors être effectuée sur chaque indicateur unique ou sur l'indice
composite de la SAN. Le problème avec la construction d'indice composite
à partir des indicateurs de SAN est qu'elle nécessite la
pondération des différents indicateurs d'une manière ou
d'une autre. Une pondération simple (c'est-à-dire que les
indicateurs ont la même pondération) permet une
compréhension plus facile tandis qu'une pondération plus complexe
peut être justifiée théoriquement ou empiriquement mais
accroit la difficulté en termes d'interprétation de l'indice.
Enfin le choix de la pondération peut être un jugement de
valeur.
L'indicateur doit être également choisi de
manière à ce qu'il réponde à un ensemble de
propriétés souhaitables. Certaines de ces
propriétés sont basées sur la pertinence politique des
indicateurs (l'indicateur devant être crédible,
c'est-à-dire dans un cadre conceptuel et théorique solide,
rapidement disponible, communicable aux utilisateurs finaux), tandis que
d'autres sont basées sur des critères scientifiques
(c'est-à-dire, la robustesse aux variations des paramètres et aux
erreurs de mesure) (Wiesmann, 2004). Dans les aspects techniques de la collecte
des données pertinentes pour un indicateur, en particulier concernant le
coût de la collecte, Chambers (1992) propose les principes de
«l'ignorance optimale» - ne pas collecter plus de données que
nécessaire, et «l'imprécision appropriée» - ne
pas mesurer plus précisément que ce qui est nécessaire. En
outre, la notion de coût de la collecte par rapport aux coûts de
non collecte est discutée dans Haddad et al. (1994). Ce critère
relie les coûts directs de la collecte de données et de l'action
politique que l'information génère, aux avantages que
l'indicateur a en termes d'améliorations apportées par l'action
de la politique (par exemple les coûts de la collecte des données
sur les ménages pour identifier les ménages en
insécurité alimentaire, les coûts de répondre
à cette insécurité alimentaire, et les avantages sociaux
d'y avoir remédié).
Il y a une préoccupation croissante pour
l'amélioration des mesures de la SAN comme une réponse au besoin
urgent d'atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle
durable au niveau mondial. Il est alors nécessaire d'identifier les
populations et les individus qui sont dans un état
d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Plusieurs indicateurs
existent au niveau mondial, national, familial et individuel. Chaque indicateur
reflète un aspect spécifique de la SAN et n'est ainsi pertinent
que pour certaines situations. Cette section documente la liste des indicateurs
qui ont été les plus utilisés dans la littérature
de diverses disciplines. Plusieurs indicateurs énumérés
ci-dessous sont des mesures bien connues approuvées par le Comité
de la Sécurité Alimentaire mondiale (CSA) et utilisées
pour le suivi des réalisations des OMD. Les indicateurs de
sécurité alimentaire présentés dans cette section
sont: L'indicateur FAO de la sous-alimentation (FAOSA); l'Indice de la Faim
dans le Monde (IFM); l'Indice de Sécurité Alimentaire Mondiale
(ISAM); L'indice de la Pauvreté et de la Faim (IPF); L'Indice
d'Engagement de Réduction de la Faim, (IERF); Les indicateurs
anthropométriques (IA); le Score de Diversité Alimentaire (SDA);
les Indicateurs Médicaux et de Bio-marqueurs (IMB).
II.1.1 Un ensemble d'indicateurs
pour couvrir les multiples dimensions de la SAN
L'édition 2013 du rapport SOFI met l'accent sur la
nécessité de considérer de multiples dimensions dans
l'analyse de l'insécurité alimentaire. On parle de
sécurité alimentaire et nutritionnelle « lorsque tous les
individus ont à tout moment accès physiquement, socialement et
économiquement à de la nourriture suffisante, saine et nutritive
leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active»
(Comité de la Sécurité Alimentaire mondiale, 2009). Quatre
dimensions de la sécurité alimentaire se dégagent de cette
définition : la disponibilité des aliments, l'accès
économique et physique à la nourriture, l'utilisation de la
nourriture et la stabilité (vulnérabilité et chocs) dans
le temps. Chaque dimension est décrite par des indicateurs
spécifiques (Tableau 1)
II.1.1.1 La dimension «
disponibilité »
Cinq indicateurs sont utilisés pour saisir la dimension
disponibilité de la SAN. La valeur moyenne de la production alimentaire
par tête est calculée comme le rapport entre la valeur totale de
la production annuelle alimentaire en dollar international (estimation de la
FAO) et la population. Il s'agit d'une mesure transfrontalière
comparable de la taille économique du secteur de production alimentaire
du pays. La suffisance des apports énergétiques alimentaires
moyens mesure l'adéquation de l'apport alimentaire national en calories
et permet de comprendre si la malnutrition est principalement due au manque
d'approvisionnement alimentaire ou à une mauvaise distribution. Les
trois autres indicateurs, à savoir : la part de l'apport
énergétique alimentaire provenant des céréales, des
racines et des tubercules, l'apport protéique moyen et l'apport moyen en
protéine animale permettent de rendre compte de la diversité de
l'approvisionnement alimentaire.
II.1.1.2 La dimension
«accès »
La dimension accès se distingue en accès
physique et économique. L'accès physique est mesuré par
les infrastructures de transport à savoir le pourcentage des routes
bitumées par rapport à l'ensemble des routes, la densité
du réseau routier et ferroviaire. L'accès économique est
mesuré par six indicateurs :
· L'indice national du niveau de prix des produits
alimentaires : prix des denrées alimentaires dans le pays relativement
au prix du panier de consommation générique. Cet indicateur
permet de comparer le prix relatif des denrées alimentaires à
travers les pays et le temps.
§ La prévalence de la sous-alimentation :
proportion de la population estimée à risque par rapport à
l'insuffisance de calorie ; ceci est l'un des indicateurs officiels des OMD
pour surveiller l'objectif lié à la «faim».
§ Le nombre de personnes sous-alimentées
(millions) : c'est l'indicateur phare du sommet mondial de l'alimentation de la
FAO en 1996.
§ La part des dépenses alimentaires du pauvre :
ratio de la dépense alimentaire sur les dépenses totales
liées à la consommation de la classe ayant le plus faible revenu
du pays.
§ La gravité du déficit alimentaire :
consommation alimentaire moyenne des sous-alimentés multipliée
par le nombre de personnes sous-alimentées et divisée par la
population totale. Elle indique le besoin en calories nécessaire pour
changer la condition du sous-alimenté, toute chose étant
égale par ailleurs.
§ La prévalence de l'insuffisance alimentaire :
proportion de la population qui risque de ne pas couvrir les besoins
alimentaires associés à une activité physique normale. Il
s'agit notamment de ceux qui, bien qu'ils ne soient pas
considérés comme sous-alimentés chroniques, ont de fortes
chances d'être conditionnés, dans leur activité
économique, par un accès limité à la nourriture.
II.1.1.3 La dimension
«stabilité »
Cette dimension regroupe à la fois des indicateurs de
chocs et des indicateurs de vulnérabilité.
Indicateurs de chocs:
§ L'instabilité des prix des denrées
alimentaires au niveau national : variabilité de l'Indice du prix
intérieur des produits alimentaires dans les pays et le temps.
§ La variabilité de la production alimentaire par
habitant : variabilité de la valeur nette de la production
alimentaire.
§ La variabilité des disponibilités
alimentaires par habitant (Kcal/personne/jour)
§ La stabilité politique/absence de
violence/terrorisme : la stabilité politique et l'absence de violence
permettent de mesurer les perceptions de la probabilité que le
gouvernement soit déstabilisé ou renversé par des moyens
non constitutionnels ou violents, y compris par la violence et le terrorisme
politique.
Indicateurs de vulnérabilité :
· La valeur des importations alimentaires dans les
exportations totales de marchandises : pourcentage des importations
alimentaires par rapport aux exportations totales de marchandises. Ceci est un
indicateur de l'exposition du pays à l'évolution des conditions
du commerce international.
§ Le pourcentage des terres arables
équipées pour l'irrigation : proportion de terres
irriguées par rapport à la superficie totale. Ceci est une
approximation pour mesurer l'impact potentiel de la sécheresse dans un
pays.
§ Le ratio de dépendance de l'importation de
céréales : approximation pour mesurer l'autosuffisance en
céréale d'un pays et l'impact potentiel des chocs sur le commerce
international
II.1.1.4 La dimension «
utilisation »
Cette dimension, saisie par 10 indicateurs concerne la
façon dont l'organisme optimise les différents nutriments
contenus dans les aliments. De bonnes pratiques de soins et d'alimentation, de
préparation des aliments, de diversité du régime
alimentaire, et de distribution des aliments à l'intérieur du
ménage ont pour résultat un apport adéquat
d'énergie et de nutriments. Ceci s'ajoute à une bonne utilisation
biologique des aliments consommés, et détermine l'état
nutritionnel des individus (FAO, 1996b).
Tableau 1 : Indicateurs par dimension de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
|
Disponibilité
|
Accessibilité
|
stabilité
|
Utilisation
|
|
Valeur moyenne de la production
alimentaire ($I par personne)
(moyenne
sur 3 ans)
|
Pourcentage des routes bitumées sur
l'ensemble du
réseau routier (%)
|
Variabilité de la production alimentaire
par habitant
($I par personne constant
2004-06)
|
Accès à des sources d'eau améliorées
(%)
|
|
Suffisance des apports énergétiques
alimentaires
moyens (%) (moyenne sur 3ans)
|
Prévalence de la sous-alimentation (%)
(moyenne sur 3
ans)
|
Taux de dépendance à l'égard des
importations céréalières (%) (moyenne sur 3 ans)
|
Accès à des services
d'assainissement
améliorés (%)
|
|
Part des céréales, des racines et des
tubercules
dans les apports énergétiques
alimentaires (%) (moyenne sur 3
ans)
|
Part des dépenses alimentaires chez les
populations
pauvres (%)
|
Pourcentage des terres arables aménagées pour
l'irrigation (%) (moyenne sur 3 ans)
|
Pourcentage des enfants de moins de 5 ans émaciés
(%)
|
|
Disponibilités protéiques
moyennes
(g/personne/jour) (moyenne sur 3 ans)
|
Prévalence de l'insuffisance alimentaire
(%) (moyenne
sur 3 ans)
|
Valeur des importations alimentaires par
rapport aux
exportations totales de
marchandises (%) (moyenne sur 3 ans)
|
Pourcentage des enfants de moins de 5 ans présentant un
retard de croissance (%)
|
|
Disponibilités protéines moyennes
d'origine
animale (g/personne/jour)
(moyenne sur 3 ans)
|
Indice national des prix des aliments
(indice)
|
Stabilité politique et absence de
violence/terrorisme
(indice)
|
Pourcentage des enfants de moins de 5 ans présentant une
insuffisance pondérale (%)
|
|
Ampleur du déficit alimentaire (Kcal/personne/jour)
(moyenne sur 3 ans)
|
Instabilité des prix des denrées
alimentaires au
niveau national (indice)
|
Pourcentage des adultes présentant une
insuffisance
pondérale (%)
|
|
|
Nombre de personnes sous-alimentées
(millions) (moyenne
sur 3 ans)
|
Variabilité des disponibilités alimentaires
par
habitant (Kcal/personne/jour)
|
Prévalence de l'anémie chez les enfants de
moins
de 5 ans (%)
|
|
|
Densité du réseau routier (pour 100
km
carrés de surface totale du pays)
|
Variabilité des disponibilités alimentaires par
habitant (Kcal/personne/jour)
|
Prévalence de l'anémie chez les femmes
enceintes
(%)
|
|
|
Densité du réseau ferroviaire (pour 100
km
carrés de surface totale du pays)
|
Prévalence de carence en vitamine A dans la population
(%)
|
|
|
|
Prévalence de la carence en iode (%)
|
|
|
|
Sources : FAOSTAT
II.2 L'indicateur de FAO de
la sous-alimentation (FAOSA)
La FAO fournit un indicateur de la sous-alimentation pour la
plupart des pays et considère l'approvisionnement en énergie
alimentaire comme une approximation de la consommation d'énergie
alimentaire. Cet indicateur comprend trois paramètres à savoir la
quantité moyenne de calorie disponible pour la consommation humaine,
l'inégalité dans l'accès à ces calories parmi la
population et la quantité d'énergie minimale requise (De Haen et
al., 2011). La FAOSA cherche à estimer la proportion de la population
qui est à risque d'une consommation insuffisante de calories. Cette
mesure est jugée non satisfaisante à plusieurs égards
(Svedberg, 2000). Tout d'abord, la disponibilité en calories est un
mauvais prédicteur des résultats nutritionnels. À la
lumière de la flambée des prix des denrées alimentaires en
2008 et 2011, il y a eu une nécessité croissante d'aller
au-delà des calories et d'analyser le degré de diversité
alimentaire (Babatunde et Qaim, 2010). Deuxièmement, l'agrégation
des besoins alimentaires minimaux, spécifiques à l'âge et
au sexe, est fortement critiquée car pouvant conduire à une
sous-estimation importante de la dénutrition (Dasgupta, 1995; Svedberg,
2002).
Troisièmement, les données sur la
disponibilité alimentaire ne sont pas totalement fiables (Svedberg,
2000), la robustesse de l'indicateur est discutable car très sensible
aux trois paramètres mentionnés plus haut (De Haen et al., 2011).
Dans un effort pour essayer de suggérer des améliorations de la
méthodologie actuelle de la FAO, un rapport de l'IFPRI (Smith et al.,
2006) propose une méthodologie pour l'estimation de la prévalence
de la sous-alimentation entièrement basée sur l'analyse
d'enquêtes sur la consommation des ménages. Ce rapport identifie
des divergences considérables entre les estimations basées
exclusivement sur les enquêtes ménages et les estimations FAO de
la prévalence de la sous-alimentation dans les 12 pays d'Afrique
subsaharienne étudiés (plus de 20% d'écart dans 6 des 12
pays étudiés), la principale source de divergence résidant
dans les différences dans les paramètres utilisés pour
produire les estimations de la FAO et ceux de l'IFPRI (disponibilité et
besoins énergétiques, distribution entre les ménages)
plutôt que dans la méthode elle-même. En outre, le faible
niveau des besoins énergétiques minimaux explique pourquoi les
estimations de la FAO sont presque uniformément inférieurs
à ceux rapportés dans le rapport de l'IFPRI (Smith et al., 2006).
Dans ce rapport, les auteurs suggèrent que de meilleures estimations
pourraient être obtenues grâce à une méthode
conceptuellement beaucoup plus simple basée sur le comptage des
ménages considérés comme souffrant
d'insécurité alimentaire dans l'échantillon. Le rapport
reconnait toutefois que cette méthode est très couteuse si les
enquêtes ne sont pas disponibles.
II.3 L'Indice de la Faim
dans le Monde (IFM)
L'Indice de la Faim dans le Monde (IFM) est conçu pour
informer de l'état de la faim à l'échelle mondiale
(Wiesmann, 2006). Calculé chaque année, l'IFM met en
évidence les réussites et les échecs dans le
progrès de la réduction de la faim et fournit des informations
sur les facteurs de la faim. Pour capturer la multidimensionnalité de la
SAN, l'IFM combine trois indicateurs: la sous-alimentation, l'insuffisance
pondérale chez les enfants de moins de 5 ans, et la mortalité
infantile. L'IFM est calculé comme suit:
IFM = (PSA + PEIP + MI)/3
La proportion des personnes sous-alimentées (PSA)
estime la part de la population avec un apport calorique insuffisant. C'est
l'indicateur FAO de la sous-alimentation présenté ci-dessus. La
proportion d'enfants présentant une insuffisance pondérale (PEIP)
est un indicateur de la dénutrition infantile, mesurée par la
proportion des enfants de moins de cinq ans souffrant d'insuffisance
pondérale. Enfin, la mortalité infantile (MI) reflète
l'interaction d'un apport alimentaire inadéquat et un environnement
malsain. Les données sont tirées de rapports publiés par
les organismes des Nations Unies5(*). L'IFM est utilisé pour classer les pays en
développement. Ceux-ci sont répartis en cinq catégories
suivant des seuils choisis arbitrairement: insécurité alimentaire
faible (IFM = 4.9), modérée (5,0 = IFM = 9,9), grave
(10,0 = IFM = 19,9), alarmante (20,0 = IFM = 29,9 ), et
extrêmement alarmante (IFM = 30) (Masset, 2011; Von Grebmer et al.,
2011). L'IFM fournit ainsi un aperçu unique en combinant trois aspects
de la faim. Toutefois, cet indicateur fait l'objet de critiques dans la mesure
où les trois éléments entrant dans le calcul sont
corrélés, entrainant un problème de double comptage
(Masset, 2011).
II.4 L'Indice de
Sécurité Alimentaire Mondiale (ISAM)
L'ISAM est publié par The Economist Intelligence Unit
(2012). Il mesure les risques d'insécurité alimentaire, en
particulier à la suite des émeutes de la faim en 2008 et 2011.
L'ISAM fournit un classement, en termes de
sécurité alimentaire, pour les pays aussi bien à revenus
faibles qu'à revenus élevés. L'indice est fondé sur
un cadre cohérent et évalue la sécurité alimentaire
à travers trois dimensions: l'accessibilité, la
disponibilité et l'utilisation. Les données nécessaires au
calcul de l'ISAM proviennent de plusieurs sources y compris les rapports
annuels sur l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) de la
FAO, l'IFM de l'IFPRI, et d'autres documents. Chaque dimension de l'ISAM est
mesurée par un ensemble d'indicateurs de sécurité
alimentaire et nutritionnelle détaillé dans le tableau 2
ci-après. Les indicateurs sont normalisés puis
agrégés, ce qui permet des comparaisons entre pays. Deux types de
pondération sont utilisés : une pondération neutre et une
pondération d'experts. La pondération neutre suppose que tous les
indicateurs sont d'importance égale tandis que la pondération
d'experts se fait sur la base de poids proposés par cinq membres d'un
groupe d'experts. Contrairement à l'IFM qui se concentre uniquement sur
les économies émergentes, les pays à revenu faible et
moyen, l'ISAM évalue aussi l'accessibilité, la
disponibilité et la qualité des aliments dans les pays
développés.
Tableau 2 : Indicateurs de l'ISAM
|
Accessibilité
|
Disponibilité
|
Qualité et sécurité
|
|
La consommation alimentaire
en pourcentage des
dépenses
totales des ménages
|
approvisionnement
alimentaire moyen en
kcal/
habitant/jour
|
La diversification du régime
alimentaire
|
|
Proportion de la population
vivant en dessous du seuil
de
pauvreté mondial
|
Dépendance à l'aide
alimentaire chronique
|
Directives alimentaires
nationales
|
|
Le PIB par tête (PPA)
|
Les dépenses publiques en
recherche et
développement
de l'agriculture
|
Plan national de la nutrition
ou de la stratégie
|
|
Les taxes sur les importations des produits agricoles
|
Existence d'installations de stockage adéquates
|
système national de contrôle
nutritionnel
|
|
La présence de programmes
de filets de
sécurité alimentaire
|
L'infrastructure routière
|
La disponibilité alimentaire en vitamine A, en fer animal
et végétal.
|
|
L'accès au financement pour
les agriculteurs
|
L'infrastructure portuaire
|
La qualité des protéines
|
|
Volatilité de la production
agricole
|
Agence pour assurer la sécurité et la santé
des aliments
|
|
Risque d'instabilité politique
|
Pourcentage de la population
ayant accès à l'eau
potable
|
|
|
Présence de secteur formel
d'épicerie
|
Source : The Economist Intelligence Unit (2012)
L'ISAM couvre la plupart des indicateurs de la SAN. Par
exemple les taxes sur les importations des produits agricoles peuvent impacter
l'accessibilité, l'investissement dans la recherche agricole
améliore la disponibilité, les agences nationales de
sécurité nutritionnelle influencent la qualité des
aliments consommés.... en tant que tel, l'ISAM est un indicateur assez
complet de la SAN. Toutefois, cette exhaustivité est aussi une faiblesse
dans la mesure où : i) un score donné d'ISAM est
dénué de sens en termes d'action politique sans une
compréhension claire des facteurs ayant conduit à ce score (par
exemple en cas d'un faible score de l'ISAM, faut-il mettre en place des
politiques ciblant les prix des denrées alimentaires, ou celle ciblant
les questions d'assainissement?); ii) il n'y a aucun concept théorique
clair justifiant pourquoi les différentes variables
énumérées dans le tableau 2 ont été
sélectionnées parmi d'autres pour représenter les trois
dimensions. Par exemple, il n'existe pas d'indicateurs de risques à
court terme à l'accessibilité, tels que des mécanismes de
transmission des prix internationaux au niveau national.
II.5 L'indice de la
Pauvreté et de la Faim (IPF)
C'est un indicateur multidimensionnel de la pauvreté et
de la faim liée aux indicateurs OMD. L'IPF est l'un des instruments de
suivi de la réalisation des OMD. La proportion de la population vivant
avec moins d'un dollar par jour, l'écart de pauvreté, la part du
quintile le plus pauvre dans le revenu ou la consommation nationale, la
prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants, et la
proportion de la population sous-alimentée calculée par la FAO
sont les indicateurs utilisés par Gentilini et Webb (2008) pour le
calcul de cet indicateur. Toutefois les auteurs rapportent que la
corrélation entre le taux de pauvreté et l'indicateur
d'écart de pauvreté est très élevée (proche
de 1), ce qui suggère que ces indicateurs sont redondants. En outre,
l'IPF souffre de problèmes similaires à ceux de la FAO, dans la
mesure où la plupart des données sont tirées des
statistiques nationales dont la qualité est une préoccupation
majeure (Masset, 2011).
II.6 L'Indice d'Engagement
de Réduction de la Faim, (IERF)
Alors que les indicateurs précédents soulignent
le statut et l'ampleur des problèmes de sécurité
alimentaire et nutritionnelle, une tentative majeure pour évaluer la
gouvernance et la volonté politique de réduire la
sous-alimentation a été faite à travers l'IERF par Lintelo
(2012). L'idée qui sous-tend la construction de cet indice est que les
indicateurs de SAN existants sont plus axés sur les résultats et
ne permettent pas de rendre compte de la volonté politique. Pour
combler cette lacune, l'IERF évalue l'engagement gouvernemental afin
d'atteindre de meilleurs résultats en matière de nutrition. Un
tel indice pourrait aider les gouvernements et les bailleurs de fonds à
suivre et à prioriser leurs efforts dans la lutte contre la faim. Les
engagements politiques sont évalués à travers les
dimensions de la SAN: la disponibilité, l'accès et l'utilisation.
En outre, il y a trois thèmes identifiés dans l'action
gouvernementale contre la dénutrition: les politiques et les programmes,
les cadres juridiques et les dépenses publiques.
Ces trois thèmes couvrent quatre secteurs: alimentation
et agriculture, autonomisation des femmes, protection sociale et environnement
de la santé. L'engagement gouvernemental sur la dimension de la
disponibilité est évalué à partir de la
dépense publique dans l'agriculture et l'accès des femmes aux
terres agricoles. L'inclusion de la dimension genre dans la dimension de la
disponibilité alimentaire est basée sur l'idée que si les
femmes ont le même accès à la terre et à d'autres
intrants agricoles, la production agricole peut être accrue en même
temps que l'insécurité alimentaire se réduit (FAO, 2011b).
Les indicateurs de l'engagement gouvernemental sur l'accès à la
nourriture couvrent des aspects plus larges comprenant la mise en oeuvre des
programmes nationaux de la FAO pour la sécurité alimentaire, les
dépenses publiques d'éducation et le droit constitutionnel
à la sécurité sociale. Ces dimensions multisectorielles de
l'accessibilité alimentaire embrassent les aspects critiques pour une
réalisation effective des droits civils et juridiques et
l'amélioration de l'accès aux services publics, y compris la
santé et la protection sociale qui peuvent accélérer la
SAN (Lintelo, 2012).
Sur la dimension utilisation, les dépenses publiques de
santé sont utilisées comme proxy de l'engagement du gouvernement
à améliorer les systèmes de santé publique pour la
prévention de la faim et de la dénutrition. Il y a cependant des
inconvénients graves dans l'utilisation de ce proxy, puisqu'il peut ne
pas refléter l'engagement effectif du gouvernement. Par exemple, les
chiffres des dépenses nationales dans le secteur de la santé
comprennent généralement l'appui budgétaire sectoriel,
à savoir le soutien des donateurs internationaux ou bilatéraux
à ce secteur.
Dans de nombreux cas, il a été observé
que l'appui budgétaire sectoriel de la santé augmente alors que
la dépense publique intérieure diminue. Enfin, l'IERF n'est
disponible que pour 21 pays, ce qui est en soi une forte limitation par rapport
aux autres indices.
II.7 Les indicateurs
anthropométriques (IA)
Alors que les indicateurs précédents se
concentrent sur le niveau macro, les indicateurs anthropométriques tels
que le retard de croissance (taille insuffisante par rapport à
l'âge), l'insuffisance pondérale (faible poids pour l'âge)
et l'émaciation (faible poids-pour-taille) mesurent les résultats
nutritionnels au niveau de l'individu. Le résultat nutritionnel est
influencé par des aspects autres que la disponibilité et
l'accessibilité, tels que les interactions entre les pertes de produits
alimentaires, la distribution alimentaire au sein des ménages, la
santé individuelle et les niveaux d'activité et aussi la
qualité de l'environnement.... Contrairement aux indices
génériques, les indicateurs anthropométriques mesurent
directement le point d'intérêt de la politique car ils
reflètent la dénutrition et la façon dont celle-ci affecte
la santé et le bien-être (De Haen et al., 2011). Svedberg (2011)
souligne l'avantage des indicateurs anthropométriques dans la mesure
où ils reflètent directement les déséquilibres
entre les apports et les dépenses énergétiques. Des
résultats anthropométriques faibles sont également
associés à une morbidité et une mortalité plus
élevée (Deaton et Drèze, 2009). Il est reconnu que le
retard de croissance peut refléter les conséquences à long
terme de la sous-consommation des micronutriments essentiels tels que les
vitamines et les minéraux (Walker et al., 2007; Svedberg, 2011) (Walker
et al. 2007, Svedberg 2011). Comme les données anthropométriques
sont tirées d'enquêtes sur les ménages, ils ont aussi
l'avantage d'être ventilées par groupes et par régions,
permettant ainsi une analyse par groupe et par région. Un autre avantage
des normes anthropométriques, en particulier pour les enfants de moins
de cinq ans est qu'elles sont universelles, ce qui permet des comparaisons
internationales (Svedberg, 2011). Néanmoins, les mesures
anthropométriques sont sujettes à des erreurs de mesure, y
compris des erreurs techniques de mesure et l'âge exact des enfants est
parfois peu connu dans les pays en développement
II.8 Le Score de
Diversité Alimentaire (SDA)
La diversité alimentaire représente le nombre
d'aliments différents ou de groupes d'aliments consommés sur une
période de référence donnée (Hoddinott et Yohannes,
2002). Il existe plusieurs scores de diversité alimentaire dans la
littérature correspondant à des objectifs différents
(mesurer la qualité alimentaire individuelle versus l'accès
alimentaire du ménage par exemple). Hoddinott et Yohannes (2002)
soutiennent que les scores de diversité alimentaire sont des indicateurs
pertinents de la SAN pour quatre raisons. Tout d'abord, les scores de
diversité alimentaire sont corrélés avec les mesures de la
consommation alimentaire et sont une bonne mesure de l'accès alimentaire
des ménages et la disponibilité calorique. Deuxièmement,
une alimentation variée est un résultat remarquable en soi.
Troisièmement, une plus grande variété alimentaire est
associée à un certain nombre de meilleurs résultats, en
particulier le poids à la naissance (Rao et al., 2001), le statut
anthropométrique de l'enfant (Hatluy et al., 2000),
l'amélioration de la concentration en hémoglobine (Bhargava et
al., 2001), une réduction du risque de mortalité due aux maladies
cardiovasculaires (Kant et al., 1995) et l'incidence de l'hypertension (Miller
et al., 1992). Quatrièmement, les scores de diversité
alimentaires peuvent être recueillis lors des enquêtes
auprès des ménages et utilisés pour examiner la SAN aux
niveaux individuel et familial.
II.9 Les Indicateurs
Médicaux et de Bio-marqueurs (IMB)
Les indicateurs biochimiques permettent de mesurer les
carences en micronutriments avec précision. Des exemples sont
donnés dans le tableau 3 ci-après
Tableau 3 : Indicateurs bio-marqueurs de
micronutriments
|
Population concernée
|
Indicateur
|
Signification
|
|
Enfants
|
Hb*<11 g/dL
|
Carence en fer
|
|
Les concentrations sanguines
de rétinol dans le plasma
ou le sérum inférieur à 0,70
|
umol/l
|
Carence en vitamine A
|
|
thyroglobuline
|
|
La carence en iode
|
|
Adultes
|
Les femmes non enceintes
(âgées de 15 ans +) avec
Hb
<12g/Dl
Les femmes enceintes avec
Hb<11g/dL
|
Carence en fer
|
|
|
|
*Hémoglobine
Source : Morón et Viteri (2009)
Néanmoins, il faut souligner que les indicateurs de
bio-marqueurs peuvent ne pas se révéler meilleurs que les
indicateurs traditionnels dans la mesure où ils peuvent être
affectés par des facteurs non alimentaires et ne sont pas disponibles
pour tous les nutriments (Kabagambe et al., 2001). En outre, les séries
Lancet sur la dénutrition infantile et maternelle soulignent la
nécessité d'une plus grande précision et fiabilité
des marqueurs pour une meilleure représentation de l'état
nutritionnel (Wasantwisut et Neufeld, 2012). Cependant, cette précision
comporte des coûts économiques élevés dans la
collecte de données et la valeur ajoutée en termes d'informations
sur l'état nutritionnel est encore trop faible pour encourager des
efforts de collecte à grande échelle (Grosh et Glewwe, 2000).
CONCLUSION
La complexité du concept de la sécurité
alimentaire exige des indicateurs appropriés pour la quantifier. Nous
avons fait un tour sur l'historique des indicateurs de la
sécurité alimentaire dans la première section de ce
chapitre, cette section a été breve car le concept de la
sécurité alimentaire reste encore ressent et les débats
sont encore présents sur la question des indicateurs de la
sécurité alimentaire, depuis son apparition, la
sécurité alimentaire ne cesse de suscité des débats
autour de son concept et les indicateurs qui permettent de la mesuré
subissent une parfaite évolution dans le temps. Dans la section 2 de ce
chapitre nous avons parcouru les différents indicateurs et indices de la
sécurité alimentaire, ces indicateurs se diffèrent selon
le type d'analyse. Ce chapitre nous a permis de comprendre le concept de
sécurité alimentaire dans son ensemble et c'est ce qui va nous
permettre d'aborder avec clarté le chapitre suivant qui est
consacré à l'analyse de la sécurité alimentaire en
RCA.
CHAPITRE
2 : LA RCA ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
INTRODUCTION
L'agriculture, principal pilier de l'économie
centrafricaine, emploie environ 70% de la population active du pays et
contribue pour 55% au Produit Intérieur Brut (PIB) en 2008 contre 13,1 %
pour le secteur secondaire et 31,9% pour le secteur tertiaire. Les
différents sous-secteurs de l'agriculture contribuent également
au PIB Agricole (PIBA), la part des cultures vivrières dans le PIBA
étant de 51,40 %, celle des cultures de rente (coton, café,
tabac) de 1,23 %, l'élevage (bovins, caprins, ovins), la chasse et
pêche et des forêts représentaient respectivement 22,83%,
9,60% et 14,94% du PIBA (Ministère de l'Agriculture et Ministère
de l'Elevage, 2014). Elle contribue également à la
création d'emploi car elle est une activité
génératrice de revenus pour plusieurs populations actives. En
effet, environ 60% des productions vivrières sont destinées
à l'autoconsommation (Aquastat, 2005) et l'agriculture vivrière
constitue la principale source de revenu de la population centrafricaine dont
elle emploie approximativement 67% de la main d'oeuvre totale du secteur
agricole (ENDJIKPENO, 2009) tant dans les zones rurales qu'à Bangui. On
a 87% des ménages pratiquant la culture vivrière sur l'ensemble
du territoire (PAM Centrafrique, 2011). Cette caractérisation de
l'agriculture est en effet, une partie introductive de l'analyse de la
sécurité alimentaire en RCA. L'objectif de ce chapitre est de
faire une analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle en RCA dans la
première section et dans la seconde section nous allons passer en revue
les politiques et les programmes de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
I. ANALYSE DE LA SITUATION
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE EN RCA
L'objectif de cette section est de présenter la
situation actuelle de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
I.1 Analyse de la situation de
sécurité alimentaire en RCA
Selon le rapport de l'indice de la faim en Afrique 2016
publié par le Nouveau Partenariat pour le Développement en
Afrique (NEPAD), la RCA est le pays qui connait le score d'indice de la faim le
plus élevé dans le monde. Le pays enregistre un indice de 46,1
points, un score néanmoins en baisse par rapport aux 48 points de
l'année 2008. Il connaît de graves insécurités
alimentaires localisées, entrainées par des récoltes
précoces déficitaires, de mauvaises récoltes, un faible
niveau de stocks alimentaires, la persistance des prix élevés, la
crise politico-militaire, des tensions et une situation
d'insécurité limitant l'accès aux travaux agricoles et
à des sources de nourriture, la situation de déplacés
internes etc6(*). La
proportion de la population disposant d'un revenu inférieur à
1,25 dollar par jour était de 62,8% en 2008 dont la grande
majorité en milieu rural. Avec 37,6% de sa population dénutrie en
2013, la RCA a le taux le plus élevé en Afrique Centrale7(*).
L'ODD2 donne l'occasion d'analyser la situation de la
sécurité alimentaire en RCA en vue d'identifier les
opportunités et les défis liés aux différentes
composantes de la sécurité alimentaire que sont la
disponibilité, l'accessibilité, la
stabilité/durabilité et l'utilisation des aliments.
I.1.1 Disponibilité
alimentaire
La RCA dispose, selon le Ministère de l'Agriculture et
du Développement Rural, d'énormes potentialités naturelles
: 15 millions d'ha de terres arables dont environ 5% seulement sont mis en
culture chaque année ; 16 millions d'ha de pâturage et de parcours
dont 9 millions d'ha sont exploités ; conditions agro-écologiques
favorables ; abondance des ressources en eaux ; importantes
potentialités en matière de pêche ; etc. En outre,
l'économie est centrée sur un secteur agricole fortement pluvial
pouvant contribuer efficacement à sa croissance. En effet, entre 2013 et
2014, les activités agricoles ont connu de sérieuses
perturbations : les superficies emblavées à des niveaux nettement
inférieurs à ceux d'avant la crise, en raison de
l'insécurité persistante et la rareté des intrants
essentiels, tels que les semences et les outils. La récolte de 2014,
estimée à 759.422 tonnes et accusant une baisse de 58% par
rapport à la moyenne pré-crise, a connu une augmentation de 11%
par rapport à 2013 grâce à une augmentation de la
production de manioc. Cependant, la production céréalière
affiche un recul de 54% en 2014 par rapport à 2013. L'effectif du
cheptel abaissé jusqu'à 77% par rapport au niveau
pré-crise, suite aux pillages et aux abatages. Les captures en poisson
étaient en baisse de 40%, à cause d'insécurité dans
les zones de pêche et de perte d'équipement (PAM, 2014).
La production végétale est tirée par les
cultures vivrières qui représentent 95% de sa valeur
ajoutée contre 5% pour les cultures de rente que représentent les
exportations de coton et de café. Les principales cultures
vivrières sont le manioc, le maïs, l'arachide, le paddy, le
sésame, le mil/sorgho et les courges. Leurs productions sont
passées de 1.041.812 tonnes en 2012 à 802.709 tonnes en 2015
après une baisse considérable en 2013.
Tableau 4 : Productions vivrières de la RCA de
2012 à 2015 en tonnes
|
Productions
|
2013
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
Manioc cossettes
|
708 771
|
485 216
|
488 700
|
455 494
|
|
Maïs
|
84 365
|
67 514
|
79 595
|
80 455
|
|
Riz Paddy
|
14 249
|
10 147
|
12 822
|
10 180
|
|
Mil /sorgho
|
54 681
|
27 279
|
30 723
|
30 871
|
|
Arachide
|
131 520
|
91 727
|
101 794
|
96 834
|
|
Sésame
|
28 923
|
17 374
|
27 513
|
34 466
|
|
Courges graines
|
19 305
|
14 673
|
18 275
|
19 020
|
|
Productions totales
|
1 041 814
|
684 208
|
759 422
|
757 042
|
Source : DSDI
La production animale reste difficile à estimer puisque
la situation actuelle ne permet l'actualisation des données sur le
cheptel. Toutefois, les estimations des effectifs du cheptel par espèce
en 2012 donnent 3.950.000 bovins, 5.933.000 caprins, 403.000ovins, 1.068.000
porcins et 6.552.000 volailles. Sur la base des estimations théoriques,
environ 73.210 tonnes de viandes ont été produites en 2012, dont
90% de viandes bovines (VAM, 2014).
La production halieutique potentielle peut être
estimée entre 20.000 et 50.000 tonnes par an, en fonction de l'ampleur
des crues dans les bassins de l'Oubangui et de la Sangha tandis que la
production piscicole est estimée à environ 250-300 tonnes par an
(VAM, 2014).
La production cynégétique (produits de la
chasse) contribue à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la population de même que les produits forestiers non
ligneux (gnetum, champignons, écorces, miel, chenilles, termites,
escargots...) contribuent à l'alimentation et à la nutrition.
Cependant, leurs contributions restent encore à explorer.
Toutes ces différentes productions nationales
vivrières, animales, halieutiques, cynégétiques et
forestières non ligneuses concourent à la sécurité
alimentaire et à la nutrition et sont complétées par des
importations et de l'assistance alimentaires qui étaient relativement
réduites jusqu'au déclenchement de la crise en 2012.
Les importations alimentaires de la RCA sont passées de
28,328 milliards de FCFA en 2012 à 39,127 milliards de FCFA en 2015,
soit 10,799 milliards de FCFA en 3 ans.
Tableau 5 : Importations alimentaires de la RCA de 2012
à 2015 en millions de FCFA
|
Année
|
Importations alimentaires
|
Importations totales
|
Part alimentaire
|
|
2012
|
28.328
|
135.090
|
21%
|
|
2013
|
21.638
|
74.381
|
29%
|
|
2014
|
33.408
|
189.790
|
18%
|
|
2015
|
39.127
|
434.719
|
9%
|
Source : ICASEES
L'assistance alimentaire fournie par le PAM est passée
de 8.775 tonnes en 2013 à 36.530 tonnes en 2015 après une forte
hausse à 45.720 tonnes en 2014 (SPR 200799, 2016). Ces données ne
sont pas complètes puisqu'elles n'indiquent que les contributions du PAM
et ne peuvent prétendre à l'exhaustivité de l'assistance
alimentaire en RCA. Lorsqu'on considère les caractéristiques
agro-écologiques du pays, on se rend compte de l'existence d'une
potentialité pouvant assurer la disponibilité afin de garantir la
sécurité alimentaire à la population. Cependant, le faible
niveau de disponibilité alimentaire est dû à deux grands
facteurs : une production faible avec un système agricole peu
performant, et un système commercial peu efficace avec un faible niveau
d'échange.
I.1.2 Accès à
l'alimentation
La crise politico-militaire déclenchée en 2012 a
provoqué la détérioration de la sécurité
alimentaire dans un pays où le tiers de la population se trouvait
déjà en situation d'insécurité alimentaire (PAM,
2014). Avec la fragilisation des moyens d'existence, les ménages se sont
rabattus sur des activités secondaires (cueillette, travaux journaliers,
taxi-moto...). Ces mécanismes n'ont pas suffi à assurer la
sécurité alimentaire à long terme : une baisse de la
fréquence et de la qualité des repas a été
observée.
Le niveau global de l'insécurité alimentaire
reste actuellement très préoccupant en RCA. Au bout de quatre
années de crise, les ménages ont vu leurs ressources
progressivement s'éroder alors que l'insécurité et les
déplacements se poursuivent.
Selon l'ENSA de 2016, 54% des ménages font face
à l'insécurité alimentaire dont :
· 48% des ménages en insécurité
alimentaire modérée. Ces ménages ont une consommation
alimentaire déficiente donc ne peuvent assurer leurs besoins
alimentaires minimum sans avoir recours à des stratégies
d'adaptation irréversibles telles que la réduction des
dépenses de santé ou d'éducation, le retrait des enfants
de l'école ou la mendicité ;
· 6% des ménages en insécurité
alimentaire sévère. Ces ménages dépendent
étroitement de l'assistance alimentaire et ont une consommation
alimentaire extrêmement pauvre. Ils sont dans une situation de
très grande vulnérabilité économique et recourent
à des stratégies qui mettent irréversiblement en
péril leurs moyens de subsistance futurs (vente de maison, de parcelle
de terrain...).
L'insécurité alimentaire est inégalement
répartie dans le pays. Ainsi la situation est plus critique à
cause des problèmes sécuritaires dans certaines
préfectures où l'insécurité alimentaire touche plus
de 60% des ménages. Il s'agit des préfectures du Haut Mbomou avec
66%, de l'Ouham avec 64%, de la Ouaka avec 63%, de la Lobaye avec 61% et de la
Basse Kotto avec 60% comme le montre la figure suivante. Par ailleurs, les
réfugiés, les retournés et les personnes
déplacées en camps/sites/enclaves sont particulièrement
touchés par l'insécurité alimentaire avec respectivement
77% et 58% des ménages qui se retrouvent le plus souvent dans une
situation de grande vulnérabilité économique.
Figure 1 : Situation de
la sécurité alimentaire par préfecture
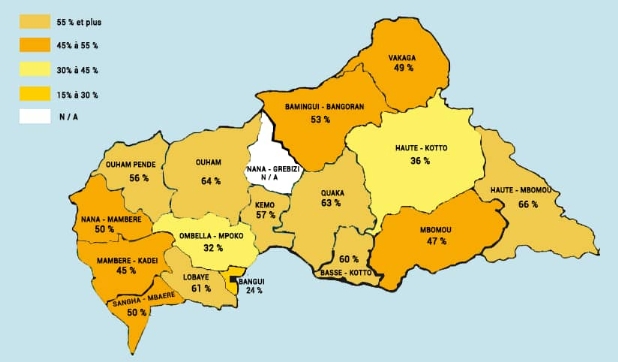
Source : Auteur à partir des données de
la FAO (FAOSTAT, 2019)
L'insécurité alimentaire des ménages est
liée à leur pauvreté. Ces ménages sont fortement
dépendants des marchés pour s'approvisionner et ont du mal
à y accéder financièrement.
Pour plus de 90% des ménages, les marchés sont
la principale source d'approvisionnement et sont donc très
vulnérables à la hausse des prix (VAM, 2017). A cela s'ajoutent
une forte variabilité des prix des denrées sur le territoire
depuis novembre 2016 et la mauvaise intégration au marché due
à des difficultés de transport, à
l'insécurité et à la baisse de production des principales
spéculations du pays les quatre dernières années.
Les prix du riz, du maïs et de l'huile de palme ont
augmenté graduellement surtout entre janvier et mars 2017 (VAM, 2017).
Cette situation a entraîné un faible pouvoir d'achat et des
difficultés d'accès alimentaires pour les ménages pauvres.
En outre, en raison de la recrudescence du conflit, on observe la baisse de la
plupart des sources de revenus et d'alimentation ainsi que des circuits de
commercialisation traditionnels qui restent perturbés à travers
le pays, ce qui va donc continuer d'affecter l'accès à
l'alimentation des déplacés, des retournés, des familles
hôtes et des ménages pauvres. L'agriculture constitue
l'activité principale de la majorité des ménages en RCA.
Ces ménages tirent la majeure partie de leurs revenus de la vente de
leurs productions agricoles.
Les ventes de produits agricoles interviennent de façon
massive au moment des récoltes (entre août et décembre en
fonction des zones agro-écologiques), période où la
disponibilité de ces produits est la plus forte et donc les prix les
plus bas. Les ménages se trouvent ensuite dans l'obligation d'avoir
recours aux marchés pour leur alimentation, aux périodes
où les prix remontent (du début de l'année aux
premières récoltes vers juillet). Les stratégies
commerciales ainsi développées par les ménages, sont
finalement peu efficaces et ne leur permettent pas de tirer le meilleur profit
de leur production. La dépendance des ménages aux marchés
pour leur alimentation et la précarité de leur stratégie
commerciale, les rendent particulièrement vulnérables aux
chocs.
L'accès matériel ou financier aux denrées
alimentaires a été entravé par le déplacement des
populations, l'insécurité et les grandes perturbations du secteur
agricole. La baisse de la production agricole a aussi fait largement augmenter
le prix des denrées alimentaires. Par ailleurs, les consommateurs ont
perdu un tiers de leur pouvoir d'achat par rapport à 2012, ce qui a
encore aggravé leur précarité. Les femmes, les populations
déplacées, les minorités isolées dans les enclaves,
les populations de retour et les réfugiés sont les plus gravement
touchés par l'insécurité alimentaire.
Les systèmes traditionnels de solidarité sociale
se sont effondrés et les déplacements ont détruit les
réseaux de solidarité communautaire et affaibli la
cohésion sociale. Les personnes pauvres et vulnérables ne
bénéficient pratiquement d'aucune protection sociale, hormis les
programmes financés par les bailleurs de fonds. Les dispositifs
nationaux existants sont principalement contributifs et centrés sur les
employés de la fonction publique (RCPCA, 2016).
I.1.3 Utilisation des
aliments
Il existe en réalité une diversité de
denrées alimentaires en RCA. Cependant la notion de manger suivant les
valeurs nutritionnelles des aliments fait défaut pour bon nombre de
centrafricains. Aussi en raison de la crise que le pays a connue, les
ménages, les plus pauvres en premier lieu, ont-ils modifié leurs
habitudes alimentaires pour s'orienter vers la consommation d'aliments «
moins préférés » ou d'aliments issus de la
cueillette. Ainsi environ 60% des ménages ont une consommation
alimentaire qui n'est pas satisfaisante avec 27% des ménages ayant une
consommation alimentaire pauvre et 33% des ménages ayant une
consommation alimentaire limitée (ENSA, 2016).
En effet, les ménages avec une consommation alimentaire
pauvre ont un régime très peu diversifié et très
insuffisant. Ils consomment principalement des céréales (3 jours
par semaine) et des légumes (2 jours par semaine). Les protéines,
les légumineuses et les fruits sont consommés moins d'une fois
par semaine. Le lait n'est pratiquement pas consommé.
Pour les ménages avec une consommation alimentaire
limite, ils consomment plus fréquemment des céréales (plus
de 5 jours par semaine) par rapport au groupe précédent, plus
souvent des légumes (5 jours) et moins souvent des légumineuses
(1 jour). La consommation de fruits, de légumineuses et de
protéines est très faible, celle du lait est pratiquement
inexistante.
Quant aux ménages avec une consommation alimentaire
acceptable, ils consomment beaucoup plus souvent des céréales (6
jours), des légumineuses (3 jours), des légumes (5jours), des
protéines (4 jours), des fruits (2 jours), du sucre (4 jours) et de
l'huile (5 jours). Ils consomment du lait mais peu fréquemment (1 jour
par semaine).
Toutefois, environ 31% des ménages avec une
consommation alimentaire pauvre ou limite ne consomment pas d'aliments riches
en vitamine A, 45% ne consomment pas d'aliments riches en fer et 41% ne
consomment pas d'aliments riches en protéines courant ainsi des
risquesde fortes déficiences en micronutriments (ENSA, 2016).
Tableau 6: Régimes alimentaires des
différents groupes de consommation en RCA
|
Groupe de
consommation
|
Nombre de jours de consommation des aliments sur une
semaine
|
|
Céréales
|
Légumineuses
|
Légumes
|
Fruits
|
Protéines
|
Lait
|
Huile
|
Sucre
|
|
Pauvre
|
3,2
|
0,4
|
2,2
|
0,7
|
0,7
|
0,0
|
2,2
|
1,7
|
|
Limite
|
5,7
|
1,3
|
5,0
|
1,4
|
0,8
|
0,0
|
3,1
|
3,1
|
|
Acceptable
|
6,4
|
3,1
|
5,6
|
2,4
|
4,4
|
1,1
|
5,2
|
4,6
|
|
Total
|
5,6
|
2,1
|
4,8
|
1,8
|
2,6
|
0,6
|
4,0
|
3,6
|
Source : ENSA, 2016
I.1.4 Durabilité
alimentaire
Le concept de durabilité ici se réfère
à l'accessibilité alimentaire de manière durable en raison
des fluctuations en matière de disponibilité,
d'accessibilité physique et économique (infrastructures
routières dégradées ne permettant pas une circulation
facile des produits alimentaires, pouvoir d'achat limité, fluctuations
des prix, insécurité perturbant la production et la
commercialisation des denrées alimentaires). Ces situations sont
changeantes au point où on ne peut parler de durabilité ou
stabilité alimentaire plongeant une partie de la population dans une
situation d'insécurité alimentaire. D'après les
différentes évaluations successives, le taux des ménages
en insécurité alimentaire est passé de 30,5% en 2009 (PAM,
2009) à 50% en 2015 (EFSA, 2015) puis à 54% en 2016 (ENSA, 2016).
Entre 40% et 44% des ménages sont dans une situation alimentaire
limitée, c'est-à-dire qu'ils peuvent basculer d'un moment
à l'autre dans l'insécurité alimentaire ; 6% seulement de
la population sont en sécurité alimentaire.
Vu le résultat de ces évaluations, la question
de la durabilité de la sécurité alimentaire reste encore
posée dans le contexte centrafricain. En effet, l'accès à
l'alimentation est limité principalement par le pouvoir d'achat de la
population qui a fortement régressé d'un tiers par rapport
à l'année 2012 et 65% de personnes interrogées ont
déclaré avoir moins de nourriture que l'année
précédente (CFSAM, 2015). Les prix d'arachide et des farines de
blé ont grimpé respectivement de 28% et 74% par rapport à
leurs niveaux d'avant la crise.
En octobre 2015, les prix de la viande de boeuf avaient
presque doublé alors que le poisson était, en moyenne, 70% plus
cher qu'avant la crise. En outre, la dégradation des routes et des
pistes rurales a également contribué aux difficultés
d'accès à la nourriture. Les routes et les pistes rurales devant
permettre la circulation des denrées alimentaires ont atteint un niveau
de dégradation trop avancé et devenues presque impraticables. Le
transport des vivres d'une localité à une autre se fait pour la
plupart du temps en motocyclettes, ce qui limite la quantité
échangée. Par ailleurs, la circulation des personnes et des biens
est perturbée par l'insécurité. Les producteurs agricoles
ne peuvent vaquer librement à leurs activités. Cette situation
est un facteur important limitant l'accès à l'alimentation d'une
manière durable.
I.2 Analyse de la situation
nutritionnelle
Le contexte nutritionnel de la RCA présente toutes les
formes de malnutrition. Il s'agit notamment de la malnutrition chronique, de la
malnutrition aiguë, de l'insuffisance pondérale et des carences en
micronutriments (minéraux et vitamines). Ces différentes formes
de malnutrition affectent majoritairement les femmes enceintes, les femmes
allaitantes, les enfants de moins de cinq ans, les personnes
âgées, les personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) et les déplacés internes depuis la
recrudescence des crises politico-militaires dans le pays. L'analyse de la
prévalence de la malnutrition aiguë et du retard de croissance en
RCA depuis 2010 montre que les prévalences de malnutrition aigüe
modérée et sévère sont relativement basses avec un
taux élevé de retard de croissance.
Depuis 2010, la prévalence de la malnutrition
aigüe globale et modérée est restée respectivement
inférieure à 8% et 2%8(*). En général, les principales causes de
mortalité infantile et infanto juvénile sont : les maladies
diarrhéiques, les infections respiratoires aigües et la
malnutrition9(*). Il est
avéré que pour les enfants, bénéficier d'une bonne
alimentation dès le début de leur existence garantira qu'ils
puissent atteindre leur plein potentiel de développement. Cependant, une
mauvaise alimentation est souvent accompagnée d'autres risques
liés au développement neurocognitif, notamment une stimulation
insuffisante au cours de la petite enfance10(*).
I.2.1 Sous-nutrition
Dans cette catégorie, on considère
essentiellement les cas de malnutrition chronique, de malnutrition aiguë,
d'insuffisance pondérale et de troubles dues à des carences en
micronutriments. La malnutrition chronique se manifeste par un retard de
croissance, autrement c'est une petite taille par rapport à l'âge
chez le jeune enfant. C'est une situation de carence alimentaire insidieuse
laissant, sur la croissance physique et le développement psychomoteur
des enfants, une empreinte irréversible impactant sur leurs performances
au cours de divers apprentissage (scolaire et socioprofessionnel). En RCA, la
malnutrition chronique affecte 40% ou plus des adolescents (SMART, 2014).
La malnutrition aiguë encore appelée
émaciation présente un des symptômes
caractéristiques qui est la maigreur. Elle résulte d'une
alimentation déficiente en macronutriments (glucides, lipides et
protéines) et en micronutriments, et/ou est conséquente d'un
épisode de maladie. La prévalence de la malnutrition aiguë
globale atteint 6,6% chez les enfants de moins de 5 ans dans le pays. La forme
aiguë sévère avec des complications médicales a
atteint une prévalence de 1,9%, le seuil d'urgence étant
fixé à 2%selon l'Organisation Mondiale de la Santé (SMART,
2014).
L'insuffisance pondérale est la conséquence
visible de la malnutrition chronique et de la malnutrition aiguë. Sa
prévalence est de l'ordre de 20,2% dans le pays. Toutes les tranches
d'âge sont concernées (SMART, 2014).
Les données nutritionnelles recueillies au cours de ces
différentes enquêtes réalisées en RCA depuis deux
décennies ont montré la persistance des trois formes de
malnutrition au sein de la population d'enfants de moins de cinq ans. Il
importe d'insister sur le caractère alarmant de la malnutrition
chronique au sein de cette population et ses conséquences sur la
communauté. Les données récentes issues de l'enquête
SMART de 2014 indiquent des disparités sur le plan géographique
dans le pays tant pour la malnutrition chronique, l'insuffisance
pondérale que pour la malnutrition aiguë. Les figures
ci-après présentent les prévalences par préfecture
avec les niveaux de gravité.
I.2.2 Surnutrition
La RCA fait aussi face au double fardeau de la malnutrition
avec une population en situation de surnutrition. L'enquête STEPS
conduite entre 2010 et 2011 à Bangui et dans la préfecture de
l'Ombella-Mpoko a fourni les indications figurant dans le tableau
ci-après. Les maladies non transmissibles à savoir le
diabète non insulinodépendant, l'infarctus du myocarde,
l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral
et les maladies rénales surgissent généralement suite
à un statut nutritionnel d'obésité lié à une
mauvaise alimentation et l'insuffisance d'exercices physiques. Ces maladies
sont les principales causes de morbidité et de mortalité qui ont
été répertoriées au cours de ces enquêtes en
milieu hospitalier. Le surpoids autant que l'obésité affectent la
population enquêtée en général avec des
particularités entre les femmes et les hommes. Dans la catégorie
des obèses, les femmes sont environ quatre fois plus nombreuses que les
hommes. Par contre, les hommes sont plus nombreux à souffrir de
l'hypertension artérielle et sur l'ensemble des hypertendus environ 90%
ne suivent aucun traitement. La malnutrition constitue donc un problème
majeur de santé publique en RCA.
Tableau 7 : Résultats de l'enquête sur la
malnutrition à Bangui et dans l'Ombella-Mpoko
|
Indicateurs
|
Ensemble
|
Hommes
|
Femmes
|
|
Pourcentage des adultes atteints de surcharge
pondérale
(IMC = 25 kg/m2)
|
20,7%(18,4-23,1)
|
13,8%(10,8-16,8)
|
28,0%(24,9-31,1)
|
|
Pourcentage des adultes obèses (IMC = 30 kg/m2)
|
7,2%(5,8-8,5)
|
3,0%(2,0-3,9)
|
11,6%(9,4-13,8)
|
|
Pourcentage des adultes ayant une tension artérielle
élevée ou actuellement sous traitement médical pour
tension artérielle élevée
|
34,5%(31,8-37,3)
|
36,8%(32,5-41,2)
|
32,3%(29,4-35,2)
|
|
Pourcentage des adultes ayant une tension
artérielle
élevée qui ne sont pas actuellement sous
traitement
médical pour tension artérielle
élevée
|
90,7%(88,0-93,3)
|
94,3%(92,0-96,6)
|
86,6%
(82,5-90,7)
|
|
Pourcentage des adultes ayant un taux de
glycémie
élevé à jeun défini ci-dessous
ou actuellement sous
traitement médical pour une glycémie
élevée
|
21,0%(17,8-24,2)
|
21,7%(17,3-26,2)
|
20,3%(16,6-24,0)
|
Source : Enquête STEPS 2010 - 2011.
II. REVUE DES POLITIQUES ET
PROGRAMMES DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION
En RCA, les gouvernements successifs ont toujours
envisagé la mise en place, avec le concours des partenaires techniques
et financiers, des politiques et programmes de développement agricole et
rural dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et le développement socioéconomique du pays.
Certains sont restés au stade de projets tandis que d'autres ont connu
une mise en oeuvre.
Les leçons tirées de l'évaluation du
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP1
couvrant la période 2008 - 2010) ont permis de fixer les grandes
orientations pour l'élaboration d'un second document de stratégie
de réduction de la pauvreté (DSRP2 pour la période 2011 -
2015). Ces orientations ont visé une croissance
accélérée pro-pauvre axée sur le
développement rural et la lutte contre l'insécurité
alimentaire, le renforcement des infrastructures de base pour soutenir la
croissance, le développement du capital humain et l'accès des
populations aux services sociaux de base en vue d'accélérer les
progrès vers l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD).
La stratégie de réduction de la pauvreté
s'articule autour de trois axes dont la relance économique et
l'intégration régionale comme axe stratégique 2. Le
développement rural et la sécurité alimentaire sont pris
en compte dans la promotion des grappes de croissance de cet axe 2. En
considérant les résultats de l'analyse de la situation du
développement rural et de la sécurité alimentaire dans
l'élaboration de ce DSRP 2, le Gouvernement s'est fixé pour
objectif d'atteindre jusqu'à 2015 une croissance moyenne de
l'activité en termes réels de 8% par an (base line : 2%) et de
réduire de moitié le taux d'insécurité alimentaire
(base line : 30,2%).
II.1 Politiques et programmes dans le cadre de la
sécurité alimentaire et de la nutrition
II.1.1 Stratégie de
Développement Rural, de l'Agriculture et de la Sécurité
Alimentaire
Les actions du Gouvernement pour la période de 2011
à 2015 devaient être guidées par les orientations de la
Stratégie de Développement Rural, de l'Agriculture et de la
Sécurité Alimentaire (SDRASA) qui s'articule autour des axes
suivants : (i) amélioration du cadre institutionnel et de
développement de la production ; (ii) promotion et développement
des organisations professionnelles agricoles et rurales ; (iii)
amélioration de la production, de la transformation et des flux de
commercialisation des produits agricoles à l'intérieur et
à l'exportation ; (iv) relance de la pêche et du
développement de l'aquaculture ; (v) renforcement de la
sécurité alimentaire et promotion du développement
local.
La mise en oeuvre de toutes ces orientations devrait reposer
sur : la promotion des pôles de développement pour réaliser
des synergies entre les centres urbains et les zones rurales ; et la promotion
de l'équité de genre car le développement agricole et la
sécurité alimentaire ne peuvent être atteints sans une
participation équitable des hommes et des femmes. Ainsi le champ
d'action retenu couvre les domaines agrosylvopastoraux et halieutiques, le
système de financement du secteur et les infrastructures
socioéconomiques, ainsi que les questions émergentes liées
à l'environnement, la biodiversité, les énergies
renouvelables et le changement climatique. Les besoins de financement pour la
mise en oeuvre de la SDRASA pour la période 2011-2015 étaient
évalués à environ 151 milliards de FCFA. Cependant les
difficultés de mobilisation de ces ressources n'ont pas permis la mise
en oeuvre de l'ensemble de cette stratégie.
II.1.2 Programme National
d'Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle
Les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains ont
approuvé, à Maputo en 2003, le Programme Détaillé
pour le Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA) qui
définit un cadre général présentant les principaux
axes d'intervention prioritaires pour restaurer et accélérer la
croissance agricole, réduire la pauvreté et la faim et
améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce programme
repose sur quatre piliers, à savoir : (i) extension des superficies
bénéficiant d'une gestion durable des sols et de systèmes
fiables de maîtrise de l'eau ; (ii) amélioration des
infrastructures rurales et des capacités de commercialisation pour un
meilleur accès au marché ; (iii) augmentation de l'offre
alimentaire et réduction de la faim; (iv) recherche agricole,
vulgarisation et adoption de technologies permettant une croissance durable de
la production.
L'objectif général du Programme National
d'Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (PNIASAN) est de contribuer de manière durable à
la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au
développement économique et social et à la
réduction de la pauvreté, ainsi qu' à la réduction
des inégalités entre les populations pour la période de
2014 à 2018. Son élaboration a pour base la SDRASA et le DSRP.
Le PNIASAN s'inscrit dans l'Axe 2 du DSRP 2 (relance
économique et intégration régionale) qui est axé
sur les OMD, ainsi que sur les quatre piliers du PDDAA. Il est structuré
autour de six programmes : (i) le développement des filières
végétales ; (ii) le développement des filières
animales ; (iii) le développement des produits forestiers non ligneux
(PFNL) alimentaires et la promotion des filières pêche et
aquaculture ; (iv) le renforcement des collectivités locales, de la
gestion des ressources naturelles, des infrastructures communautaires de base,
et des services de recherche et d'appui conseil ; (v) la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, réponses aux urgences et actions
transversales ; (vi) le renforcement institutionnel et la coordination
sectorielle.
Ce programme offre un cadre de référence pour
les actions à entreprendre dans le secteur agricole, en vue d'atteindre
les objectifs de réduction de la pauvreté et de
l'insécurité alimentaire d'ici 2018 et devrait induire à
l'horizon 2018, une croissance moyenne annuelle de l'activité agricole
en termes réels de 6% et une réduction du taux
d'insécurité alimentaire à 15%. Les besoins de financement
pour la mise en oeuvre du PNIASAN 2014-2018 étaient
évalués à environ 358 milliards de FCFA. Toutefois, le
gouvernement n'a mobilisé que 6,8 milliards de FCFA auprès du
FIDA pour la mise en oeuvre du Projet de relance des cultures
vivrières et du petit élevage dans les savanes
(PREVES) pour la période de 2012 à 2017
II.1.3 Politique Nationale
de Nutrition.
La vision de la Politique Nationale de Nutrition (PNN) est
d'assurer une nutrition optimale à tous les centrafricains. Cette
politique s'appuie sur les valeurs d'équité, de
solidarité, d'éthique, ainsi que sur la diversité
culturelle avec le respect de l'approche du genre, pour un développement
harmonieux de la nation. Elle fixe les grandes orientations en matière
de nutrition en vue d'améliorer l'état nutritionnel de la
population en général et les groupes vulnérables en
particulier pour leur participation effective au développement
économique et social. L'objectif général de la PNN est de
contribuer à la réduction de la malnutrition sous toutes ses
formes en RCA à travers la prévention et la prise en charge. De
manière spécifique, il s'agit de :(i) réduire la
prévalence de l'insuffisance de poids à la naissance ; (ii)
augmenter le taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois ; (iii)
augmenter la proportion des mères qui introduisent des aliments de
complément à partir de 6 mois selon les recommandations de l'OMS
et de l'UNICEF ; (iv) réduire chez les enfants de moins de 5 ans la
prévalence de la malnutrition aiguë globale, l'insuffisance
pondérale et le retard de croissance ; (v) réduire toutes les
formes de carence en micronutriments chez les femmes en âge de
procréer et les enfants ; (vi) améliorer la prise en charge des
maladies à déterminisme nutritionnel ; (vii) assurer un
accès durable à une alimentation adéquate pour toute la
population, en particulier pour les personnes vivant dans les zones
d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et les groupes
à risque (personnes vivant avec le VIH/SIDA, la tuberculose et les
personnes âgées etc.) ; (viii) renforcer le système
national de surveillance nutritionnelle et de sécurité
alimentaire ; (ix) développer la recherche opérationnelle sur la
nutrition ; (x) assurer la protection sociale des groupes vulnérables et
des minorités ; (xi) mettre en place une structure de coordination
interministérielle des activités de nutrition. Ainsi, sa mise en
oeuvre passe par la promotion d'une alimentation saine et
équilibrée et la lutte contre la malnutrition au travers de
stratégies préventives, curatives et transversales.
Les stratégies préventives concernent : (i) la
promotion de la sécurité alimentaire au sein des ménages ;
(ii) la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant pour la
prévention de la malnutrition ; (iii) le renforcement du système
de surveillance alimentaire et nutritionnelle ; (iv) le renforcement de la
lutte contre les carences en micronutriments ; (v) le renforcement de la
nutrition chez les jeunes et en milieu scolaire ; et (vi) le suivi nutritionnel
des personnes vivant avec le VIH/sida. Les stratégies curatives tiennent
: (i) au renforcement de la prise en charge médicale et nutritionnelle
des cas de malnutrition ; et (ii) à l'amélioration de la prise en
charge diététique des personnes souffrant des maladies à
déterminisme nutritionnel. Les stratégies transversales
s'organisent autour de : (i) l'engagement politique, le plaidoyer et le
partenariat en faveur de la nutrition ; (ii) le renforcement de la
communication pour le changement de comportement en matière de nutrition
; (iii) le renforcement des capacités nationales en matière de
nutrition ; (iv) le renforcement de la recherche opérationnelle en
matière de nutrition ; et (v) le renforcement de la participation
communautaire. Toutefois, cette politique n'a pas été mise en
oeuvre. Le pays s'est engagé, tout comme ses pairs de la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) au
repositionnement institutionnel de la nutrition comme facteur de
développement au travers de la déclaration de Brazzaville12. Un
Comité Technique Multisectoriel de Sécurité Alimentaire
et de Nutrition (CTMSAN) a été mis en place et travaille à
la validation d'une Politique Nationale de Sécurité Alimentaire
et de Nutrition.
II.1.4 Politique Nationale
de Promotion de l'Egalité et de l'Equité
Document phare pour lutter contre les inégalités
de genre dans tous les secteurs économique, politique et social, la
Politique Nationale de Promotion de l'Egalité et de l'Equité
(PNPEE), élaborée et adoptée en 2005,
s'est fixée comme but de créer un cadre macro- économique,
juridique, culturel et politique adéquat, où devront s'inscrire
les schémas de planification et programmes sectoriels de
développement ainsi que les mécanismes institutionnels, de
façon à donner à la fois aux hommes et aux femmes des
possibilités d'actions équitables et à mesurer les impacts
sur ces deux groupes sociaux.
Les objectifs concernent : (i) la promotion de la
participation des hommes et surtout des femmes au développement durable
de leurs sociétés, à titre de décideurs, sur un
même pied d'égalité; (ii) la réduction des
inégalités entre les femmes et les hommes quant à
l'accès aux ressources et aux bénéfices du
développement, et au contrôle de ces mêmes ressources et
bénéfices; (iii) le renforcement de l'approche transversale par
la prise en compte des situations et des besoins des femmes et des hommes dans
l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des
politiques nationales; (iv) la mise en place des mesures spécifiques en
faveur de certaines catégories de femmes et d'hommes, avec des objectifs
bien ciblés afin de réduire les inégalités
constatées ; (v) l'éradication de l'intolérance
individuelle et collective. Son plan d'Action de 2007 a comme objectifs
stratégiques pour le secteur agricole d'améliorer l'accès
des hommes et surtout des femmes aux moyens de production (terre,
crédits, technologies et information).
Le Gouvernement affirmait dans ce document sa volonté
de redonner aux femmes et aux hommes, la place qui leur revient dans le
processus de décision, et son soutien à leur pleine participation
à la consolidation de la paix et du développement. Cependant, le
gouvernement fait face à des difficultés importantes dans la
planification, le suivi et l'évaluation du développement en
raison de manque de données désagrégées par sexe et
de moyens financiers pour la mise en oeuvre des politiques et programmes de
genre ou de discrimination positive en faveur des femmes centrafricaines.
II.1.5 Politique Nationale
de Protection Sociale
La vision de la Politique nationale de protection sociale
(PNPS) est d'assurer une couverture de protection sociale efficace et
accessible à tous les centrafricains. Elle est basée sur les
principes édictés par la Constitution et par les lois pertinentes
en la matière.
L'objectif de la PNPS est de contribuer au changement
qualitatif des conditions de vie des différentes couches sociales par le
développement de mécanismes adéquats et pérennes de
couverture des risques majeurs et de gestion des chocs, et par l'extension de
l'assurance sociale à toutes les catégories de travailleurs et
l'élargissement de la gamme des prestations à tous les risques
sociaux. Ainsi, la PNPS se fixe comme axes stratégiques : (i)
réformer, coordonner et étendre les dispositifs de protection
sociale existants ; (ii) promouvoir l'accès de tous, notamment des
populations pauvres et des groupes vulnérables, aux services sociaux de
base ; et (iii) promouvoir des mécanismes pour garantir une
sécurité de l'emploi et un revenu minimal aux populations.
Validée par les mandants en 2012, cette stratégie qui a pour
vision une couverture de protection sociale, efficace, plus étendue et
accessible à tous les centrafricains, s'appuie sur des principes
directeurs qui intègrent l'équité et
l'égalité de genre. Les orientations et axes stratégiques
inclurent les préoccupations du secteur agricole abandonné
plusieurs années. Toutefois, sa validation n'est pas encore faite au
plan national.
II.1.6 Feuille de Route du
Secteur Agricole
La crise traversée par la RCA de 2012 à 2015 a
occasionné la décapitalisation des exploitations agricoles, le
dysfonctionnement des structures d'appui aux producteurs agricoles et la
rupture de la vision du développement agricole souhaitée par le
Gouvernement.
C'est dans ce contexte que le PNIASAN a été
fondamentalement revu et le Cadre de Programmation Pays (CPP) de la FAO a
été actualisé pour prendre en compte les besoins
émergents. Cette feuille de route, dont l'appui technique et financier
de la FAO a permis son élaboration, s'inscrit dans le cadre de ces deux
documents et retient quatre axes stratégiques prioritaires :
· axe1 résilience, relance durable des
activités agropastorales et développement économique ;
· axe2 agriculture facteur de réconciliation
nationale ;
· axe3 insertion professionnelle et entrepreneuriat des
jeunes pour la modernisation de l'agriculture ;
· axe4 gouvernance agricole et
compétitivité de l'agriculture au niveau régional,
continental et international.
La stratégie de mise en oeuvre de la feuille de route
pour la période 2016-2018 se fonde sur une approche régionale qui
vise d'une part à valoriser les potentialités régionales
et d'autre part, à réduire les disparités
régionales. Les besoins de financement pour la mise en oeuvre de cette
feuille de route 2016 - 2018 sont évalués à 275 milliards
de FCFA. Cependant, en dehors de certains TCP mis en oeuvre par la FAO dans le
cadre de cette Feuille de route, le gouvernement n'a pas réussi à
mobiliser les partenaires pour le financement de cette stratégie.
II.2 Ressources
financières pour la sécurité alimentaire et la
nutrition
Le mécanisme de mobilisation des ressources pour le
financement des politiques et programmes de la sécurité
alimentaire et de la nutrition est basé sur l'appui des partenaires au
développement, la contribution de l'Etat et la participation des
bénéficiaires en nature et/ou en temps de travail. Par rapport
à l'engagement pris par les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
Africaine, réunis à Maputo les 10 et 11 juillet 2003, pour
consacrer au moins 10% de leur budget en faveur de l'agriculture et du
développement rural, l'Etat centrafricain prévoit allouer 10% du
budget national au financement des programmes. Pour ce faire, la contribution
de l'Etat devrait provenir de deux sources : (i) le Fonds de
développement agropastoral (FDAP) pour le financement des programmes de
recherche, de conseil agricole, de l'organisation des producteurs ; (ii) le
budget de l'Etat, notamment les lois de finances pour les investissements et le
fonctionnement des ministères techniques et les services d'appui au
secteur rural. En outre, il se propose de mettre à la disposition des
programmes des locaux et du personnel dont il assure les salaires de base.
Tableau 8: Allocations budgétaires des
départements ministériels en lien avec la SAN
|
Départements ministériels
|
Budget
alloué
|
|
Ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural
|
2,7%
|
|
Ministère de l'Elevage et de la Santé Animale
|
0,3%
|
|
Ministère de l'Environnement, du Développement
durable, des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche
|
0,6%
|
|
Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique
et de la Population
|
13,3%
|
|
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
|
14,7%
|
Source : Loi de finances 2017.
Globalement, la contribution du gouvernement pourrait
être estimée à environ 20% du coût total des
programmes. Toutefois, lorsqu'on considère le budget global de l'Etat
centrafricain, il ne ressort pas clairement une ligne concernant
l'investissement dans le secteur de la sécurité alimentaire et de
la nutrition. Les ressources prévues pour les ministères en lien
avec la sécurité alimentaire et la nutrition au titre de
l'exercice 2017 sont consignées dans le tableau qui suit. Ces ressources
ne sont pas destinées à la sécurité alimentaire et
à la nutrition.
Les financements obtenus à nos jours dans le domaine de
la sécurité alimentaire et de la nutrition proviennent
essentiellement des partenaires techniques et financiers. Le pays ne compte que
sur le financement extérieur pour résoudre les problèmes
de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Globalement,
l'engagement de tous les Gouvernements depuis trois décennies, avec
l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux, n'a pas
permis d'améliorer la situation de la sécurité alimentaire
et de la nutrition en RCA.
CONCLUSION
Ce chapitre est structuré de façon à ce
qu'on comprenne la situation de la sécurité alimentaire en RCA et
d'en passer en revue les politiques et programmes de sécurité
alimentaire en RCA. Nous avons présenté dans ce chapitre dans la
section 1, la situation de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en RCA, nous avons présenté la situation de la
sécurité alimentaire en tenant compte des piliers de la
sécurité alimentaire qui sont : La
disponibilité ; L'accessibilité ; Stabilité et
Utilisation, la situation nutritionnelle est présenté sous deux
ongles qui sont la surnutrition sous-nutrition. Dans la seconde section nous
avons fait une revue de tous les politiques et programmes dans le cadre de la
sécurité alimentaire, cette section est divisée en deux,
la première sous-section était basée sur les politiques et
programmes mises en oeuvre dans le cadre de la sécurité
alimentaire et la deuxième sous-section était consacrée
aux ressources financières mises à la disposition des programmes
de lutte contre l'insécurité alimentaire.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
Le concept de sécurité alimentaire a connu une
évolution depuis les 50 dernières années. Il a
été d'abord analysé dans une perspective malthusienne
c'est-à-dire en termes de disponibilité jusque dans les
années 80. Les conséquences sociales des programmes d'ajustement
structurel en termes de baisse des revenus réels, entraînant des
difficultés alimentaires ainsi que les travaux d'Amartya Sen sur le
rôle des droits d'accès dans les années 80, vont conduire
à élargir le concept de sécurité alimentaire pour
prendre en compte la dimension économique de l'accès qui implique
une attention particulière sur les revenus et les prix. Les
années 2000 vont en conséquence connaître un revirement de
la politique des grandes institutions financières. Ces dernières
vont mettre la lutte contre la pauvreté au centre des
préoccupations, avec la mise en place des cadres stratégiques de
lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Les
crises alimentaires provoquées par les hausses de prix alimentaire de
ces dernières années (2007-2008) sont venues rappeler la
vulnérabilité des populations et ont conduit à introduire
la notion de résilience dans l'analyse de la sécurité
alimentaire. Aujourd'hui, l'insécurité alimentaire est comprise
comme le fruit d'interactions entre plusieurs facteurs (économiques,
naturels) à plusieurs niveaux (international, national, régional,
familial et individuel). Le consensus qui se dégage est que la
pauvreté est la principale cause de l'insécurité
alimentaire mais les politiques à mettre en oeuvre restent
controversées.
Nous avons analysé dans cette partie dans le chapitre
2, la situation de la sécurité alimentaire en RCA, les
différents politiques et programmes de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle que nous avons passé en revue vont nous
permettre de comprendre la persistance de l'insécurité
alimentaire et d'en identifier les déterminants de la
sécurité alimentaire en RCA, c'est ce qui sera l'objet de la
deuxième partie de notre travail.
DEUXIÈME PARTIE :
IDENTIFICATION DES DÉTERMINANTS DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN RCA
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME
PARTIE
Selon Roudart (2008), de 1970 à 2000, la proportion de
personnes sous-alimentées est passée de 35 à 17 % dans les
PED, malgré la croissance démographique. Ce recul de la
sous-alimentation a été plus impressionnant en Asie de l'Est et
du Sud-Est, où elle est passée de 40 % à moins de 15 % de
la population. Cependant, en Afrique subsaharienne, elle reste assez
répandue et reste supérieure à 30 %. La sous-alimentation
est aussi présente dans les pays développés puisqu'aux
États-Unis, l'insécurité alimentaire touche 11% des
ménages en 2003 (U.S.Department of Agriculture). Ainsi quelque soit le
pays, des groupes de personnes éprouvent des difficultés à
satisfaire leurs besoins alimentaires. Ils sont vulnérables aux risques
alimentaires. La vulnérabilité alimentaire est définie
comme « l'incapacité pour des acteurs ou des familles à
résister à un choc extérieur inévitable, difficile
à prévoir. À l'inverse, la résilience
désigne la capacité d'une personne à anticiper et à
réagir de façon à se dégager d'une menace
potentielle ou effective, mais prévisible » (Courade et De Suremain
2001, p.125). Cette perspective microéconomique du problème
alimentaire suscite de l'intérêt depuis les années 1980. Ce
fut la prise de conscience que l'approche strictement agroalimentaire de la
sécurité alimentaire qui se focalise sur les techniques et
pratiques agricoles, était trop réductrice. Cette dernière
se concentrait sur les systèmes agroalimentaires (SAA), reléguant
au second plan la question de l'accès à la nourriture. La notion
de sécurité alimentaire a donc beaucoup évoluée au
cours des dernières décennies. On est passé d'une
conception agroalimentaire avec l'analyse des systèmes de production et
de consommation à une approche sociale et humanitaire avec la prise en
compte des risques, de la vulnérabilité à
l'insécurité alimentaire et de la résilience, puis
à des considérations d'ordre juridique et éthique (droit
à l'alimentation). En outre, la démographie joue un rôle
important dans la répartition et l'utilisation des ressources
alimentaires. Dans cette partie nous allons essayer d'identifier les
déterminants de la sécurité alimentaire, pour ce fait,
nous allons travailler dans cette partie sur deux chapitres, le premier va
s'intéresser à la méthodologie de l'étude et le
deuxième, les résultats et discussions de l'étude.
CHAPITRE
III : MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE EN RCA
INTRODUCTION
À l'échelle globale, les causes structurales de
l'insécurité alimentaire sont de nature politique et
économique, telles que les politiques en matière de production
alimentaire, de prix des aliments, de logement, de transport et d'emploi. Il a
été largement documenté que dans les pays
développés l'insécurité alimentaire des
ménages pourrait être modulée par différents
facteurs de l'environnement physique et social, de l'environnement familial et
individuels. En premier lieu, les facteurs de l'environnement physique et
social comme; le manque de transport, la distribution des ressources
alimentaires, les caractéristiques (prix, qualité,
variété) de l'offre alimentaire dans les magasins et le soutien
social, influencent l'insécurité alimentaire des ménages.
En deuxième lieu, certaines caractéristiques du ménage
augmentent le risque d'être en insécurité alimentaire,
notamment; le revenu, la monoparentalité (spécialement lorsque le
chef du ménage est une femme), le nombre de membres dans le
ménage, les dépenses du foyer, et le manque d'équipement
ménager. Finalement, l'insécurité alimentaire a
été associée aux caractéristiques individuelles
telles que : un faible niveau de scolarité, le fait d'être une
femme, un mauvais état de santé, l'appartenance à une
communauté ethnique minoritaire, les connaissances en alimentation et
nutrition et la capacité de cuisinier. Dans ce travail, nous cherchons
à identifier les déterminants de la sécurité
alimentaire en RCA. Dans la première section, nous présentons le
model d'analyse utilisée pour mener notre étude et nous allons
présenter ensuite dans la seconde section, les variables et les
données utilisées pour l'application empirique.
I. CADRE ANALYTIQUE DU MODEL
LOGIT
La régression logistique est l'un des modèles
d'analyse multivariée les plus couramment utilisées en
épidémiologie. Elle permet de mesurer l'association entre la
survenue d'un événement (variable expliquée qualitative)
et les facteurs susceptibles de l'influencer (variables explicatives).
I.1 Nature du modèle
économétrique
Historiquement, la régression logistique ou
régression binomiale fut la première méthode
utilisée, notamment en épidémiologie et en marketing
(scoring), pour aborder la modélisation d'une variable binaire binomiale
(nombre de succès pour ni essais) ou de Bernoulli (avec ni =1) :
décès ou survie d'un patient, absence ou présence d'une
pathologie, possession on non d'un produit, bon ou mauvais client... Bien
connue dans ces types d'application et largement répandue, la
régression logistique conduit à des interprétations
pouvant être complexes mais rentrées dans les usages pour
quantifier, par exemple, des facteurs de risque liés à une
pathologie, une faillite... Cette méthode reste donc celle la plus
utilisée car interprétable même si, en terme de
qualité prévisionnelle, d'autres approches sont susceptibles, en
fonction des données étudiées, de conduire à de
meilleures prévisions. Enfin, robuste, cette méthode passe
à l'échelle des données massives. Il est donc important de
bien maîtriser les différents aspects de la régression
logistiques dont l'interprétation des paramètres, la
sélection de modèle par sélection de variables ou par
régularisation (Lasso).
I.1.1 Approche descriptive
On observe un échantillon d'individus dont on connait K
de leurs caractéristiques, représentées par les K
variables x1, x2, ..., xK. . On suppose que
les individus sont répartis en deux catégories C0 et
C1. En RCA, une partie de la population (fait partie de la
catégorie C1 des personnes en sécurité
alimentaire), d'autres pas (catégorie C0 des personnes en
insécurité alimentaire). On souhaite analyser et quantifier le
lien existant entre les caractéristiques individuelles xk et
l'appartenance à C0 ou C1. Il faut un outil - un
modèle - spécifique pour pouvoir le faire. C'est dans cette
logique qu'on a choisi le model de Régression logistique (logit).
On part donc du principe que la population que l'on
étudie est scindée en deux catégories, C0 et
C1. On dispose d'un échantillon de n individus indicés
par i, représentatifs de cette population. On connait K
caractéristiques de ces individus, mesurées par les variables
x1 x2, . . ., xK. Pour l'individu i, les K
variables prennent les valeurs x1i, x2i, . . . ,
xKi. On pose que la probabilité P que l'individu i (compte
tenu de ses caractéristiques x1i, x2i, ...,
xKi) appartienne à C1 ou à C0
est une fonction des x1i, x2i, ..., xKi. On
précise un peu la relation fonctionnelle en supposant que les
probabilités d'appartenance dépendent d'une combinaison
linéaire des caractéristiques. Formellement, cela s'écrit
:

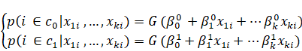 (1)
(1)
ou G est une fonction qui sera définie
ultérieurement et ou les
 ,
,
 , . . .,
, . . ., 
 , et les
, et les 
 ,
, 
 , . . .,
, . . ., 
 , sont les coefficients des combinaisons linéaires. Ce sont les
paramètres du modèle. On notera l'ajout des deux
paramètres
, sont les coefficients des combinaisons linéaires. Ce sont les
paramètres du modèle. On notera l'ajout des deux
paramètres
 , et
, et
 , qui sont appelés parfois paramètres du « terme
constant ». Ils sont associés à la variable x0
valant systématiquement 1. A ce stade, on a donc deux séries de
paramètres âkJ :
, qui sont appelés parfois paramètres du « terme
constant ». Ils sont associés à la variable x0
valant systématiquement 1. A ce stade, on a donc deux séries de
paramètres âkJ :
· la série
 ,
, 
 ,, . . .,
,, . . ., 
 , associée à la catégorie C0 (j = 0) ;
, associée à la catégorie C0 (j = 0) ;
· la série


 , . . .,
, . . ., 
 , associée à la catégorie C1 (j = 1).
, associée à la catégorie C1 (j = 1).
La combinaison linéaire des caractéristiques
peut s'écrire de manière synthétique, pour j = 0 ou j = 1
:

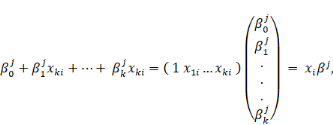 (2)
(2)
Ou xi = (1x1i . . . xKi) est le
vecteur-ligne des caractéristiques de l'individu
i et
ßj le vecteur-colonne 4 des paramètres du
modèle. On peut alors réécrire (1) de
manière
condensée :
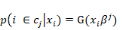
 Pour j= 0,1.
Pour j= 0,1.
Quelle fonction choisir pour G 
 et
et 
 étant des probabilités, on doit avoir :
étant des probabilités, on doit avoir :

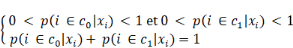 (3)
(3)
Poser 
 assurerait
assurerait 
 > 0. Mais les autres contraintes ne seraient pas
vérifiées. Pour qu'elles le soient, il suffit de normer les deux
quantités
> 0. Mais les autres contraintes ne seraient pas
vérifiées. Pour qu'elles le soient, il suffit de normer les deux
quantités 
 et
et 
 , c'est-`a-dire les diviser par leur somme. On obtient alors :
, c'est-`a-dire les diviser par leur somme. On obtient alors :
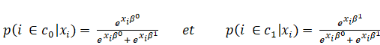
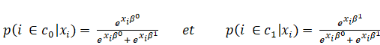
C'est cette forme fonctionnelle qui donne au modèle son
nom de logit. On peut simplifier en remarquant qu'une seule probabilité
suffit pour le représenter, puisque la somme de 
 et de
et de 
 est égale à 1. L'une se déduit de l'autre. On se
centre sur la probabilité d'appartenir à C1. Elle
s'écrit :
est égale à 1. L'une se déduit de l'autre. On se
centre sur la probabilité d'appartenir à C1. Elle
s'écrit :
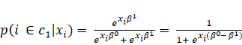
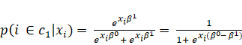
Finalement, si on pose â = â1 ?
â0, on a :
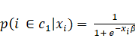
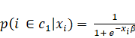 (4)
(4)
I.2 Spécification
théorique du modèle Logit
Le modèle logit a une double nature. D'une part, c'est
un modèle de régression où la variable dépendante
est binaire. D'autre part, c'est une méthode alternative à
l'analyse discriminante linéaire. Par ailleurs, le modèle logit
peut aussi être considéré comme un modèle
économique de choix discrets.
Les modèles Logit depuis très longtemps ont
été introduits comme des approximations de modèles probit
permettant des calculs plus simples. Si les deux modèles sont
sensiblement identiques, il existe cependant des différences. Nous
évoquerons ici les principales différences :
· Les modèles Logit sont construits sur
l'hypothèse des distributions cumulatives logistiques permettant un
traitement plus adéquat des données aberrantes du fait de leurs
extrémités épaissies contrairement aux modèles
Probit qui font l'hypothèse d'une distribution cumulative normale
centrée réduite ;
· Dans les modèles complexes, les modèles
Logit sont plus adaptés parce que sont de manipulation plus
aisée, car le Probit impliquerait la manipulation des intégrales
à plusieurs degrés. Les bases théoriques des
modèles Logit ont été données par Mc Fadden
à travers une théorie de l'utilité.
I.3 Procédure
d'estimation
La méthodologie empirique utilisée dans cette
étude se déroule en quatre étapes et consiste à
déterminer le degré de significativité de chacune des
variables. Pour vérifier la significativité individuelle des
paramètres, le test de Student sera utilisé. L'hypothèse
de nullité du vecteur des paramètres quant à elle sera
testée par le test du rapport de maximum de vraisemblance. Pour
évaluer la qualité des ajustements, nous aurons recours au Psudo
R² de McFadden. En outre, le pourcentage de bonne prédiction nous
permettra de juger du pouvoir prédictif du modèle. Les valeurs
numériques des coefficients du Logit n'ont pas d'interprétation
directe c'est pourquoi nous allons nous intéresser aux signes des
variables pertinentes et aux réactions proportionnelles de la variable
expliquée suite aux changements proportionnels du niveau des variables
explicatives c'est à dire aux élasticités. La variable
endogène dans notre cas étant une probabilité, le calcul
des effets marginaux permet d'apprécier l'impact des variables
explicatives sur la probabilité d'être ou non en
l'insécurité alimentaire.
I.3.1 Vraisemblance du
modèle
Pour vérifier la significativité globale du
modèle, des tests de vraisemblance sont réalisés. Plus la
vraisemblance est élevée, plus le modèle est
considéré comme adéquat pour expliquer les variations de
la variable dépendante. Le test de vraisemblance d'un modèle
consiste à déterminer s'il existe au moins un coefficient non nul
parmi ceux des variables explicatives insérées dans le
modèle. Si c'est le cas, on peut considérer que le modèle
est globalement significatif, et s'intéresser alors aux variables qui
influencent effectivement la variable dépendante qu'on cherche
prédire. La vraisemblance d'un n-échantillon
y1,y2,...,yn est définie comme la
probabilité d'observer cet échantillon.

· Les variables Yi étant indépendantes:

Avec 
 tel que
tel que 
 soient les variances des estimateurs telles que la matrice de variance
covariance soit de la forme :
soient les variances des estimateurs telles que la matrice de variance
covariance soit de la forme :

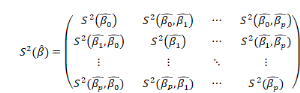
I.3.2 Intervalles de
confiance
Ce test permet de savoir s'il y a une relation entre la
variable Xj et Y.
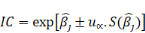
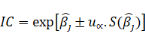
v Si 1 n'appartient à IC : pas de relation
v Si 1 appartient à IC : relation entre Xj et Y
I.3.3 Test de
significativité globale
Ce teste a pour objectif de voir si les variables explicatives
peuvent expliquer le risque de survenue de l'évènement. On va
alors faire un test de rapport de vraisemblance.
On appelle M1: Modèle sans variables et M2:
Modèle avec toutes les variables
On teste :
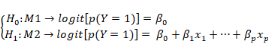
v Est-ce que M1 est meilleur que M2 (qualités
prédictives)?
v La statistique de test est:
ü RV= [-2.ln (vraisemblance au maximum de M1)] -
[-2.ln(vraisemblance au maximum deM2)]
ü Et suit un Khi-deux à p
degrés de liberté
ü Si RV > ÷²(p) On rejette H0, le
modèle 2 est meilleur que le 1, les variables explicatives ont
simultanément une influence sur la probabilité d'apparition de
l'évènement étudié.
I.3.4 Test de
significativité pour une variable
· M1: Modèle sans la variable testée 

· M2: Modèle avec la variable testée 

· On teste:
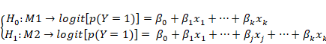
C'est-à-dire : 

· Il y a 2 manières d'écrire la statistique
de test :
ü Sous une loi Normale:
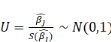
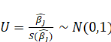 Sous H0
Sous H0
ü Sous une loi du Khi-deux:
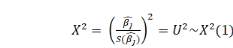
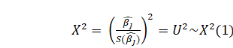 Sous H0
Sous H0
· Sous une loi Normale:
Si |U| > N(0,1) (=1,96 à
95%)
· Sous une loi du Khi-deux:
Si U > ÷²(1)
On rejette HO, le modèle 2 est meilleur que
le 1, le paramètre 
 est significatif, la variable j a une influence sur la
probabilité d'apparition de l'évènement, sachant les
autres variables du modèle.
est significatif, la variable j a une influence sur la
probabilité d'apparition de l'évènement, sachant les
autres variables du modèle.
I.3.5 Qualité de
l'ajustement du modèle
Le pseudo R² de Mac Fadden renseigne sur la
qualité d'ajustement du modèle, c'est-à- dire sur la
capacité des variables explicatives étudiées à
prédire les variations de la variable dépendante. Un pseudo
R² proche de 0 indique que les variables explicatives n'apportent que peu
d'informations tandis qu'un pseudo R² proche de 1 souligne l'importance
des variables explicatives. Pour les régressions multinomiales non
ordonnées, on considère en général qu'un pseudo
R² de 30% indique que le modèle étudié a un bon
pouvoir prédictif. Pour les régressions multinomiales
ordonnées, les pseudo R² sont plus faibles et des valeurs autour de
10% suffisent pour considérer que les variables explicatives contribuent
de façon significative à expliquer les variations
observées de la variable à expliquer.
II. METHODOLOGIE : ENSEMBLE
DES DONNEES ET VARIABLES
Après avoir donné un aperçu
théorique sur la représentation d'un modèle logit, nous
allons mener une étude empirique, en se basant sur ce modèle dont
le but est d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer la
sécurité alimentaire en RCA.
II.1 Méthodologie
d'étude
Notre objectif est d'identifier les déterminants de la
sécurité alimentaire en RCA. Dans les milieux scientifiques, la
sécurité alimentaire fait l'objet de modélisation
économétrique. Ainsi, Agbodji et Abalo (2005) ont mesuré
la pauvreté et modélisé l'état nutritionnel des
enfants au Togo. En outre, plusieurs auteurs ont utilisé le
modèle Logit dans l'analyse de la sécurité alimentaire.
Ainsi, Alderman et Garcia (1993) ont eu recours à ce modèle pour
caractériser l'état Madagascar, ont eu recours au modèle
Logit pour analyser les déterminants de l'insécurité
alimentaire et nutritionnelle des ménages dans les zones rurales au
Pakistan. De même, Rasolofo et Anne (2001), dans l'étude des
corrélations entre sécurité alimentaire et pauvreté
en milieu rural à En nous inspirant des travaux de Alderman et Garcia
(op cit), nous utiliserons le modèle Logit pour l'analyse des
déterminants de la sécurité alimentaire. Le choix de ce
modèle est soutenu par les raisons suivantes:
· lorsque les variables explicatives ne sont pas
normalement distribuées, les estimateurs du modèle Logit sont
plus robustes que ceux obtenus par l'analyse discriminante;
· Les modèles Logit permettent des calculs
simples. Par ailleurs, Moimune, cité par (Gourieroux, 1989), par la
méthode de Monte-Carlo, montre que les estimations des paramètres
et leur précision obtenues par les modèles Probit sont
généralement peu différentes des modèles Logit.
II. 2 Spécification
du modèle économétrique
On cherche donc dans ce cas à expliquer la variable
dichotomique " y " désignant l'insécurité alimentaire et
définie comme suit :
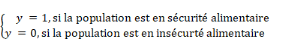
On suppose que la probabilité pour un ménage
d'appartenir au premier groupe (y = 1) est fonction d'un certain nombre de
caractéristiques économiques et non économique. Une
estimation de cette probabilité est donnée par la fonction
logistique suivante :
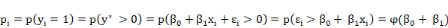
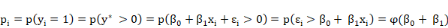
Avec Pi, la probabilité que la population i soit en
insécurité alimentaire ;
Yi désigne le statut de la
sécurité alimentaire de la population i ;
Y*, une fonction des caractéristiques des de la
population ;
Xi ... les variables explicatives ;
Avec ?(.) la fonction de répartition de la loi
logistique. En généralisant, on peut poser que :

On peut prédire le logarithme du rapport entre la
probabilité d'être affectée par l'insécurité
alimentaire et la probabilité de ne pas souffrir du
phénomène :

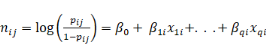
Où les Xij représentent les variables
explicatives et les âij les paramètres à
estimer.
Ainsi notre modèle prend la forme suivante :
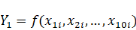
Et l'équation sera sous la forme suivante :
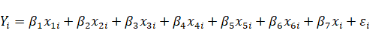
Tableau 9: Définition des variables du
modèle
|
Variables
|
Descriptions de la variable
|
Nature de la variable
|
Type de la variable
|
|
Yi
|
La sécurité alimentaire, elle est la
probabilité pour la population d'être ou non en
sécurité alimentaire.
|
Qualitative
|
Variable a expliquée (variable dépendante)
|
|
X1i
|
L'investissement public, elle est mesurée par la formation
brute de capital fixe (FBCF)
|
Quantitative
|
Variable explicative (variable indépendante)
|
|
X2i
|
Stabilité politique et absence de violence/terrorisme,
mesurent les perceptions de la probabilité que le gouvernement soit
déstabilisé ou renversé par des moyens inconstitutionnels
ou violents, y compris la violence à motivation politique et terrorisme,
y compris par la violence et le Terrorisme
|
Dummy
|
Variable explicative
|
|
X3i
|
La production agricole, elle est la part de la production
agricole dans le produit intérieur brut (PIB)
|
Quantitative
|
Variable explicative
|
|
X4i
|
Importation des produits alimentaires, elle est, elle est
mesurée par le % des marchandises importées.
|
Quantitative
|
Variable explicative
|
|
X5i
|
Indice de prix à la consommation (IPC), mesure
l'évolution générale, sur une période
donnée, des prix des biens et des services acquis, utilisés ou
payés par les ménages pour leur propre consommation. L'indice est
obtenu en mesurant les variations du prix d'achat, a qualité constante,
d'un assortiment fixe
|
Quantitative
|
Variable explicative
|
|
X6i
|
PIB par habitant basé sur la parité de pouvoir
d'achat. Le PIB en PPA est le produit intérieur brut converti en dollars
internationaux en utilisant les taux de parité de pouvoir d'achat.
|
Quantitative
|
Variable explicative
|
|
X7i
|
La croissance démographique, elle mesurée par
l'accroissement annuel de la population totale en %
|
Quantitative
|
Variable explicative
|
Source : Construit par l'auteur
II.3 Ensemble de
données et variables
Les données utilisées pour les estimations sont
annuelles elles proviennent essentiellement des bases de données de la
banque mondiale (WDI). La période d'observation va de 1990 à
2017. Suite aux données manquantes sur la stabilité politique et
absence de violence/terrorisme en République centrafricaine, notre
variable (instabilité politique) est construite en tenant compte des
caractéristiques propres au pays ainsi que l'histoire et le cycle
politique.
Dans cette étude l'instabilité est
mesurée en tenant compte de trois facteurs à savoir les coups
d'Etats, les mutineries et les élections. La variable instabilité
politique a été déjà utilisée par : kant,
2002 ; Khan et Haque 1985 ; Ndiaye et Siri, 2016 ; Ramiandrisoa et
Rakotomanana, 2016 et Frantz, 2017.
Tableau 10: Explications des variables
dummy
|
Variable dummy
|
Explication des variables
|
|
Coup d'Etat
|
· 1966 : Coup d'Etat de J B BOKASSA sur D DACKO,
intitulé la nuit de saint Sylvestre
· 1976 : coup de force manqué
du 3 février, à l'aéroport de Bangui
· 1979 : Bokassa est évincé
dans un coup d'Etat dirigé par Dacko et soutenu par les troupes
françaises après de nombreuses manifestations, arrestations et
massacres.
· 1981 : La présidence de Dacko
est renversée par un coup d'Etat dirigé par le commandant de
l'armée, André Kolingba.
· 3 mars 1982 : tentative de coup
d'état d'Ange Felix Patassé. A la radio nationale François
Bozizé appelle l'armée à se soulever sans succès.
C'est le fameux coup d'état radiophonique.
· 2001 (mai) : tentative manquée
de coup d'état par l'ancien Président André Kolingba. Au
moins 59 personnes ont été tuées. Le président
Patassé réprime la tentative avec l'aide des troupes libyennes et
tchadiennes ainsi que des rebelles congolais conduisant au bouleversement
politique et une instabilité économique.
· 25 Octobre 2002 : les hommes du
général BOZIZE arrivent aux portes de Bangui. Ange Felix
Patassé fait appel aux combattants congolais de Jean -Pierre Bemba qui
entament la reconquête du pays et se rendent coupables d'exactions sur la
population civile.
· 2003 Mars : le général
Bozizé réussit un coup d'Etat alors que le président
Patassé est à l'étranger et se déclare
président.
· 2013 Mars : Le président
Bozizé est renversé par la coalition des rebelles de la
Séléka, dirigé par Michel djotodja.
|
|
Mutineries
|
· Le 18 avril 1996 : une
première mutinerie de 200 à 300 soldats a proclamé qu'ils
n'avaient pas reçu leur salaire depuis 1992-1993. Les forces
françaises sont intervenues en soutien (opération Almandin I) et
agissent en tant que négociateurs
· Le 18 mai 199 : une
deuxième mutinerie a été menée par 500 soldats qui
ont refusé d'être désarmés et ont contesté
l'accord signé en avril. Les forces françaises sont à
nouveau appelées par Bangui (c'est l'opération Almandin II).
· Le 15 novembre 1996 : une
troisième mutinerie est intervenue et 1 500 soldats français ont
été envoyés pour assurer la sécurité des
étrangers présents sur le sol de la République
Centrafricaine.
· En 1997 : une autre mutinerie,
Patassé lève le couvre-feu pour mettre fin à la mutinerie
afin de permettre aux investisseurs de revenir
|
|
Elections
|
· En 1992 : Elections
présidentielles et parlementaires multipartismes organisés
à la dernière place de Kolingba. Il annule les résultats,
sous prétexte d'irrégularités qui ont créé
des tensions dans le camp du parti opposé.
· 1993 : Ange-Félix
Patassé, président suite aux élections, mettant ainsi fin
à 12 ans de règne militaire.
· 1999: Patassé est
réélu président
· 2005 : Bozizé qui remporta le
deuxième tour de l'élection présidentielle avec 64,6% des
voix.
· 2011 : Bozizé est
réélu président
· 2016 : Le Pr. Touadera élu
de la RCA
|
Source : construction de l'auteur
Tableau 11: Les variables dummy de l'instabilite
politique en RCA
|
Années
|
Élections
|
Mutineries
|
Coups d'états
|
Instabilité
|
|
1990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1991
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1992
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
1993
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
1994
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1996
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
1997
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
1998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1999
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
2000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2001
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
2002
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
2003
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
2004
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2005
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
2006
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2007
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2009
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2011
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
2012
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2013
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
2016
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
2017
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Source : construction de l'auteur
II.4 Les autres variables
Les autres variables retenues pour la modélisation de
l'identification des déterminants de la sécurité
alimentaire sont au nombre de sept à savoir : Investissement publique
(X1), La production agricole (X3), Importation des
produits alimentaires (X4), Indice des prix à la consommation
(X5), PIB par habitant (X6) et La croissance
démographique (X7). Ce choix des variables s'inspire des
travaux de la FAO sur les indicateurs de la sécurité alimentaire.
Investissement publique: c'est les
dépenses en formation de brut de capital fixe (FBCF) des administrations
publiques (APU). L'investissement public est constitué d'une part des
dépenses publiques dites « consommation
collective », investissements considérés comme
« non productifs » et en tout cas comme relevant d'une
production « non marchand » (réseau routier,
justice, police, éclairage public, enseignement et recherche etc...) et
d'une part l'accumulation du capital technique des entreprises, qu'elles soient
publiques ou privées. Le choix de cette variable est le fait de
l'importance quand donne aujourd'hui au capital public dans la lutte contre la
pauvreté. On suppose que le capital physique déprécie
chaque année et l'investissement public chaque année a pour
objectif de venir renforcer le capital, cette variable est ici un indicateur de
la dimension accessibilité de la sécurité alimentaire. Il
est donné ici en pourcentage de PIB. Cette variable est
déjà utilisée par Zoudouemba et Gerard, 2015. Et FAO,
2006.
Production agricole : La production
agricole est mesurée ici par la variabilité de production
agricole qui a pour l'indicateur l'indice de production des récoltes.
Cette variable est déjà utilisé par Turki-abdelhedi ,
Clément et Ghorbel-zouari, 2013. Et FAO, 2006.
Importation des produits alimentaires :
elle est mesurée ici par la part des produits alimentaires en
pourcentage des marchandises importées. Cette est déjà
utilisée par Turki-abdelhedi , Clément et Ghorbel-zouari, 2013.
Et FAO, 2006.
Indice des prix à la
consommation : l'indice de prix à la consommation (IPC)
mesure l'évolution générale, sur une période
donnée, des prix des biens et des services acquis, utilisés ou
payés par les ménages pour leur propre consommation. L'indice est
obtenu en mesurant les variations du prix d'achat, a qualité constante,
d'un assortiment fixe de produits de consommation et de services
présentant des caractéristique similaires, étant entendu
que les éléments du panier sont représentatifs des
dépenses d'un ménages pendant une année, ou toute autre
durée spécifiée. Il est l'instrument de mesure de
l'inflation, c'est une mesure synthétique de l'évolution de prix
des produits à qualité constante. Nous utilisons cette variable
pour évaluer l'effet de choc de prix sur la sécurité
alimentaire. Cette variable est utilisée par FAO, 2006.
PIB par habitant : PIB par habitant
basé sur la parité de pouvoir d'achat. Le PIB en PPA est le
produit intérieur brut converti en dollars internationaux en utilisant
les taux de parité de pouvoir d'achat. Le dollar international a le
même pouvoir sur PIB que le dollar américain aux Etats-Unis. Le
PIB aux prix d'acquisition est la somme de la valeur brute ajoutée par
tous les producteurs résidents de l'économie, majorée par
des taxes sur les produits et diminuée des subventions non comprises
dans la valeur des produits. Il est calculé sans déduction des
actifs fabriqués ni de l'épuisement et de la dégradation
des ressources naturelles. Les données sont en dollars constants de
2011. Cette variable est déjà utilisée par Badolo, 2013.
Et FAO, 2006.
Croissance démographique : la
croissance démographique est l'accroissement total de la population,
elle est mesurée par le taux d'accroissement annuel de la population.
Cette variable est déjà utilisée par Zoudouemba, Gerard,
2015. ; Turki-abdelhedi , Clément, Ghorbel-zouari, 2013. Et FAO,
2006.
CONCLUSION
L'objectif principal de ce chapitre était de
présenter l'approche méthodologique de l'identification des
déterminants de la sécurité alimentaire en
République Centrafricaine. Dans notre analyse
l'insécurité alimentaire est une variable binaire qui prend le
chiffre 1 et 0. Nous avons utilisé beaucoup de variable pour identifier
les déterminants économique de la sécurité
alimentaire en RCA, tandis qu'au niveau des déterminants non
économique par manque de données, nous avons seulement
utilisé l'instabilité politique. La variable instabilité
politique est construite en tenant compte de trois différents types
d'instabilité politique à savoir : les coups d'états, les
mutineries et les élections présidentielles. Les autres variables
sont choisies en tenant compte des études empiriques
précédentes. Toutefois, la méthode utilisée dans
notre analyse souffre des limites car elle ne tient pas compte des crises
gouvernementales et constitutionnelles en RCA.
CHAPITRE
IV : RESULTATS ET DISCUSSION
INTRODUCTION
De nos jours, la plupart des études économiques
ne se limitent plus à de simples analyses et conclusions uniquement
basées sur les observations théoriques. Elles doivent
renforcées par des procédures de vérifications empiriques
qui viennent confirmer ou infirmer les hypothèses émises au
préalable. L'économie mathématique a donc pour rôle
de procéder à des estimations économétriques
fondées sur des modèles qui serviront à apporter des
preuves concrètes aux hypothèses fixées. Ainsi ,
l'objectif de ce chapitre est de présenter les résultats des
estimations économétriques des variables qui sont susceptibles
d'influencer la sécurité alimentaire en interprétant les
résultats qui en découlent pour nous permettre de faire des
propositions de politiques économiques.
I. ANALYSE DESCRIPTIVE DES
VARIABLES
Il est question ici de mener une analyse descriptive dans
laquelle, on présentera les évolutions des interactions entre nos
variables à travers le temps
I.1 Evolutions de nos
variables
Figure 2 : Evolution de l'investissement public
(FBCF) en RCA
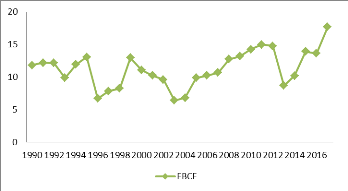
Source : Auteur à partir des données de
la Banque mondiale (WDI, 2019)
L'analyse de l'évolution de la part de la formation
brute de capitale fixe (FBCF) dans le PIB montre une croissance assez faible de
la part du PIB accordé à l'investissement public allant de
11,81% en 1990 à 13,05% en 1995 ou il a baissé en 1996 à
6,69%.
Cependant, la figure nous révèle des pics et des
creux à partir de 1999 jusqu'à 2017, cette variation de
l'investissement public qui va se situer en 2017 à 17,66%, si doit
comparer ce chiffre à celui de 1990, on va conclure que l'investissement
public a subi une augmentation de 4,15% mais ce chiffre est toujours faible
pour un pays en développement comme la RCA.
Figure 3 : Evolution de la production agricole en
RCA
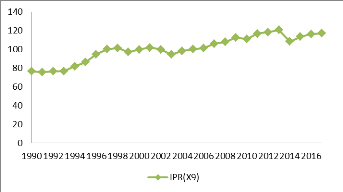
Source : Auteur à partir des données de
la Banque mondiale (WDI, 2019)
L'analyse de l'évolution de la production agricole
nous révèle un faible niveau de la production agricole dans les
années 90, dans les années 2002, on constate une évolution
constante de la production agricole. Bien sûr que la courbe
présente des pics et des creux mais on peut dire que la production
agricole à partir de 2010 est plus soutenue que dans les années
90.
Figure 4 : Evolution de l'importation des produits
alimentaires en RCA

Source : Auteur à partir des données de
la Banque mondiale (WDI, 2019)
La part de l'importation des produits dans le total des
marchandises importées varie depuis 1990 à 2017 entre 20,85%
à 39,32% des marchandises importées. On constate en 2006 une
baisse énorme de l'importation des produits alimentaires (0,47% du total
de l'importation des marchandises) et une hausse importante en 2009 (39,32% du
total des marchandises importées), qui va chuter en 2017 à
21,07%.
Figure 5 : Evolution de l'indice des prix à
la consommation
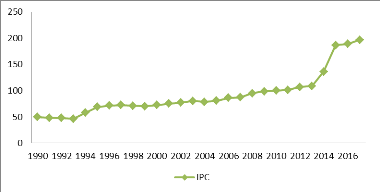
Source : Auteur à partir des données de
la Banque mondiale (WDI, 2019)
L'analyse de l'évolution de l'indice des prix à
la consommation nous révèle une évolution constante de
1993 à 2017.
Figure 6 : Evolution de PIB par tête en
RCA
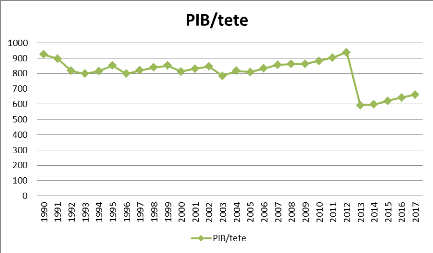 SouSource : Auteur à partir des données de la
Banque mondiale (WDI, 2019)
SouSource : Auteur à partir des données de la
Banque mondiale (WDI, 2019)
Le PIB par tête est la parité de pouvoir de la
population Centrafricaine, l'analyse de la figure nous montre un faible pouvoir
d'achat en RCA. La parité de pouvoir d'achat ne fait que baisser depuis
1990 jusqu'à 2017.
Figure 7: Croissance de la population
Centrafricaine
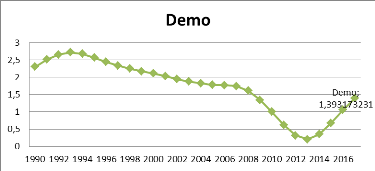
Source : Auteur à partir des données de
la Banque mondiale (WDI, 2019)
L'analyse de la croissance de la population à base de
ce graphique nous montre la décroissance depuis 1995, la croissance de
la population était à 2,51 en 1991 et 2,72% en 1993 et une baisse
consécutive pour atteindre 0,20% en 2013.
I.2 Statistiques descriptives
des variables utilisées
Les statistiques descriptives de nos variables (la moyenne, la
médiane, la valeur maximale, la minimale, l'écart-type) nous
permettent d'avoir une idée générale sur le niveau de
leurs évolutions. Les statistiques descriptives de toutes les variables
étudiées sont présentées dans le tableau ci-dessous
:
Tableau 12: Statistiques descriptives des
variables
|
Variable
|
Obs
|
Mean
|
Std. Dev
|
Min
|
Max
|
|
Yi
|
28
|
0.464
|
0.508
|
0
|
1
|
|
X1
|
28
|
11.274
|
2.754
|
6.405
|
17.668
|
|
X2
|
28
|
0.5
|
0.509
|
0
|
1
|
|
X3
|
28
|
100.456
|
13.69
|
75.83
|
120.7
|
|
X4
|
28
|
22.203
|
7.706
|
0.474
|
39.328
|
|
X5
|
28
|
91.536
|
40.622
|
46.443
|
196.861
|
|
X6
|
28
|
806.204
|
95.161
|
593.056
|
938.824
|
|
X7
|
28
|
1.727
|
0.768
|
0.205
|
2.722
|
Source : Construit par l'auteur à partir de
STATA 14
Le tableau ci-dessus présente les résultats
descriptifs des séries annuelles de l'insécurité
alimentaire, l'investissement public, la production agricole, l'importation des
produits alimentaires, indices des prix à la consommation, produit
intérieur brut par tête, la croissance de la population et les
séries de l'instabilité politiques. Un examen critique des
variables sous notre investigation montre qu'il y'a une diversité
observable parmi les variables étudiées. Les valeurs annuelles
moyennes de toutes les variables sont positives. Par exemple, la valeur
annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation est 91.536,
tandis que celle de l'investissement public est 11.274. Les résultats
globaux montrent de larges écart-types des variables qui
démontrent que les points de données sont loin de la moyenne
indiquant ainsi une hétérogénéité
possible.
I.3 Corrélation entre les
variables
La corrélation permet de connaitre l'intensité
de la liaison qui peut exister entre deux variables. Autrement dit l'influence
qu'une variable exerce sur une autre ainsi que le sens de cette liaison. Le
tableau ci-dessus décrit la corrélation entre nos variables.
Tableau 13: Matrice des corrélations
linéaires des variables
|
Yi
|
X1
|
X2
|
X3
|
X4
|
X5
|
X6
|
X7
|
|
Yi(SeAli)
|
1.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X1(Invpu)
|
-0.196
|
1.0000
|
|
|
|
|
|
|
|
X2(Instpo)
|
-0.358
|
0.285
|
1.0000
|
|
|
|
|
|
|
X3(ProdAgri)
|
-0.072
|
0.291
|
-0.062
|
1.0000
|
|
|
|
|
|
X4(Import)
|
-0.256
|
0.203
|
0.040
|
0.348
|
1.0000
|
|
|
|
|
X5(IPC)
|
-0.047
|
0.484
|
0.113
|
0.749
|
0.016
|
1.0000
|
|
|
|
X6(PIB/tete)
|
-0.278
|
0.046
|
0.435
|
-0.373
|
0.042
|
-0.681
|
1.0000
|
|
|
X7(demo)
|
0.021
|
-0.331
|
0.121
|
-0.857
|
-0.389
|
-0.7014
|
0.424
|
1.0000
|
Source : Construit par l'auteur à partir de
STATA 14
Le résultat ci-dessus nous montre que nos variables ne
sont pas toutes corrélées positivement et encore moins fortement
liées. En effet nous pouvons constater que les variables X1,
X2, X3, X4, X5 et
X6 demeurent négativement corrélées avec un
faible degré de liaison à l'insécurité alimentaire
respectivement (-19,6%, -35,8%, -0,72%, -25,6% , -0,47% et -27,8%). Par contre
la variable X7 est positivement corrélée à
l'insécurité alimentaire, mais son degré de liaison (0,21
%) reste très faible.
II. RESULTATS EMPIRIQUES
II.1 Maximum de
vraisemblance
Tableau 14: Estimation par le modèle logit
|
VARIABLES
|
Yi (insa)
|
|
|
|
X1 (Invpub)
|
0.667*
|
|
(0.371)
|
|
X2 (Instpo)
|
-0.676
|
|
(1.136)
|
|
X3 (proagri)
|
0.194**
|
|
(0.0888)
|
|
X4 (Import)
|
-0.266**
|
|
(0.131)
|
|
X5 (Ipc)
|
-0.146**
|
|
(0.0569)
|
|
X6 (pib_tete)
|
-0.0397**
|
|
(0.0156)
|
|
X7 ( demo)
|
-0.784
|
|
(1.367)
|
|
Constant
|
25.89*
|
|
(15.70)
|
|
|
|
Observations
|
28
|
Robust standard errors in parentheses; *** p<0.01, **
p<0.05, * p<0.1. Pseudo R2=36%
Source: Auteur à partir de STATA 14
Les résultats d'estimation montrent que les
coefficients signalés en étoile sont statistiquement
significatifs, on a le coefficient de la variable X1
(â1) qui est significatif au seuil de 10%, â3
a un coefficient significatif au seuil de 5%, â4 est
significatif au seuil de 5%, â5 est quant à lui
significatif au seuil de 5% et â6 est significatif au seuil de
5%. Le Pseudo R2 nous donne la qualité d'ajustement du
modèle, la qualité d'ajustement pour ce modèle est de 36%.
Selon la théorie le Pseudo R2 de 30% est égal au
R2 de 80%, ce qui revient à dire que la
sécurité alimentaire peut être déterminée
à 36% par les variables sélectionnées.
II.2 calcule des Effets
marginaux
Tableau 15: Calcule des effets marginaux
Marginal effects after logit
y = Pr(Yi) (predict)
= 0.4855269
|
Variable
|
dy/dx
|
Std. Err.
|
Z
|
P>|z|
|
[ 95% C.I. ]
|
X
|
|
Invpu (X1)
Instp (X2)*
Proagri (X3)
Impor (X4)
Ipc (X5)
Pib/t (X6)
Demo (X7)
|
0.1665861
-0.1672541
0.0485302
-0.0664604
-0.036517
-0.0099168
0.195856
|
0.09411
0.27575
0.02212
0.03293
0.01451
0.00397
0.3429
|
1.77
-0.61
2.19
-2.02
-2.52
-2.50
-0.57
|
0.077
0.544
0.028
0.044
0.012
0.012
0.568
|
-0.017875 0.351047
-0.707705 0.373197
0 .005181 0.091879
-.130992 -0.001929
-0.064954 -0.00808
-0.017698 -0.002135
-0.867937 0 .476225
|
11.273
0.5
100.456
22.2026
91.5355
806.204
1.72706
|
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0
to 1
Source: construit par l'auteur à partir de STATA
14
La relation à long terme s'écrit de la
manière suivante :
Yi = 0.1665861*X1 -
0.1672541*X2 + 0.0485302*X3 - 0.0664604*X4 -
0.036517*X5 -0.0099168*X6
+0.195856*X7
II.3 validation du modèle
La validation du modèle passe par l'analyse de pseudo
R2, dans le calcul de maximum de vraisemblance nous avons pu
constater le pseudo R2 est égal à 36% ce qui nous
confirme la bonne qualité d'ajustement du modèle.
CONCLUSION
L'objectif de ce chapitre est d'identifier les
déterminants de la sécurité alimentaire à travers
la modélisation par le modèle logit. Nous avons
sélectionné un certain nombre de variables susceptible
d'influencer la sécurité alimentaire en république
centrafricaine, parmi ces variables nous avons : l'investissement
public ; l'instabilité politique ; la production agricole;
l'importation des produits alimentaires ; l'indice des prix à la
consommation et la croissance démographique. Le résultat de
l'estimation économétrique du modèle de la
sécurité alimentaire avec nos variables
sélectionnées, il ressort que l'investissement affecte
positivement la sécurité alimentaire en RCA, l'analyse nous
montre que le niveau de significativité de l'investissement public sur
la sécurité alimentaire est de 10% ce qui revient à dire
que si on augmente l'investissement public de 10% ca améliore la
sécurité alimentaire d'un point, le calcul des effets marginaux
nous montre qu'à long terme l'investissement public a toujours un effet
positif sur la sécurité alimentaire. La stabilité
politique qui est notre déterminant économique clé affecte
positivement la sécurité alimentaire en RCA, dans cette analyse
nous avons utilisé les séries de l'instabilité politique
pour analyser l'effet sur l'insécurité alimentaire bien que son
coefficient n'est pas statistiquement significatif, son signe nous montre que
l'instabilité politique encourage l'insécurité alimentaire
en RCA. Il en résulte donc que l'instabilité politique est un
phénomène préjudiciable pour le pays.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Cette partie tente d'identifier les déterminants de la
sécurité de la sécurité alimentaire en RCA avec
les outils économétriques appropriés. Cette partie nous a
permis d'affirmer ou infirmer nos hypothèses de bases. La simulation
réalisée à l'aide du modèle logit nous a permis
d'abord de mettre en lumière la dynamique qui explique la persistance
de l'insécurité alimentaire et les faibles progrès dans la
lutte contre la pauvreté en RCA. En effet, la formation brute du capital
fixe (FBCF) représente en moyenne que 11,3% de PIB ce qui n'est pas
significatif d'améliorer la sécurité alimentaire. En
outre, la persistance de l'instabilité politique et
l'insécurité qui règne dans le pays sont autant de
facteurs qui limitent la croissance rapide des revenus et de la consommation
alimentaire. Ensuite, le scénario de dégradation de la
productivité agricole montre des impacts dévastateurs qui sont
plus ressentis par la population en raison, à la fois de la contraction
de l'activité économique globale et de la hausse des prix de
produits alimentaires. L'utilisation de ce modèle inspiré de
plusieurs travaux sur les déterminants de la sécurité
alimentaire, certains test de validation des hypothèses n'a pas
été fait dans ce travail à cause de la petite taille de
notre échantillon ainsi que le test de significativité de nos
variables.
CONCLUSION GENERALE
L'intérêt pour la sécurité
alimentaire date depuis les années 1970 et a connu des hauts et des bas
au fil du temps, en partie en réponse à l'évolution de la
réflexion sur le développement plus large, et en partie à
cause des changements dans la nature même du problème de
l'alimentation dans le monde (Maxwell, 2001). Il y a eu des évolutions
dans la réflexion sur la sécurité alimentaire
elle-même, principalement un abandon progressif de préoccupations
d'offre alimentaire au niveau nationale et mondiale, vers des
préoccupations d'accès familial et individuel à la
nourriture. Plus récemment, le concept de sécurité
alimentaire s'est enrichi avec l'introduction du concept de résilience :
il s'agit de la capacité des ménages ou des individus à
rebondir après un certain nombre de chocs tels que les inondations, la
sécheresse, les conflits, l'instabilité des prix des
denrées alimentaires, l'effondrement des institutions locales ou des
pertes d'emplois. L'introduction de la résilience dans l'analyse de la
sécurité alimentaire permet ainsi de comprendre certaines
décisions souvent radicales des ménages ou individus suite
à un choc. Par exemple, en cas d'une crise de grande ampleur, des
agriculteurs sont souvent obligés de prendre des mesures drastiques :
retirer leurs enfants de l'école, vendre tout actif en leur possession,
ou abandonner l'agriculture et migrer vers les villes. Entre 2002 et 2008,
l'indice des prix de denrées alimentaires de la FAO a doublé,
après quatre décennies de tendance globale à la baisse
(Azoulay, 2012). Cette inflation des prix alimentaires et les troubles sociaux
qu'elle a occasionnés signent le retour de l'enjeu agricole et du
problème alimentaire dans le débat économique. En effet,
avec l'accélération de la globalisation financière, la
finance a dominé les débats en économie tandis que la
macroéconomie sociale en général, l'économie du
développement en particulier, se sont plus concentrées sur la
pauvreté et les inégalités. Ainsi, le thème de la
sécurité alimentaire a été plus
développé par l'économie agroalimentaire. Klatzmann (1988)
souligne que le terme « agro-alimentaire » fait
référence à toutes les étapes de la chaîne
alimentaire, de la production agricole à la consommation. Les travaux de
Malassis (1972, 1973, 1992), Malassis et Padilla (1986), Malassis et Ghersi
(1992), Bricas et Raoult-Wack (1997), Rastoin (1996, 2005, 2006), Mc Michael
(2002) et Combris (2006) ont montré l'importance grandissante des
activités en amont et en aval de l'agriculture. En 2008, le rapport sur
le développement dans le monde de la Banque mondiale (BM) est
consacré à l'agriculture au service du développement. Tout
en préconisant une libéralisation totale des échanges
agricoles, il incite à accroître les investissements dans le
secteur agricole. En effet, la part de l'agriculture dans l'aide publique au
développement est passée de 19 à 3% entre 1980 et 2006.
Quant aux prêts de la BM destinés au secteur agricole, ils ne
représentaient plus que 1,75 milliards USD en 2006, soit 7% de la
totalité des prêts octroyés contre 30% en 1982 (OXFAM,
2007).
L'analyse des déterminants de la sécurité
alimentaire est abordée par beaucoup d'auteurs et les variables
utilisées se diffèrent selon les pays, la diversité de ses
variables s'explique par la diversité des indicateurs de
sécurité alimentaire selon le pays analysé.
Premièrement, il était question de
présenter le cadre d'analyse de la sécurité alimentaire,
en passant par l'historique de la sécurité alimentaire et sa
mesure, nous avons aussi la situation de la sécurité alimentaire
en RCA, c'est-à-dire, le niveau de la sécurité alimentaire
et les indicateurs de la sécurité alimentaire en RCA. C'est ce
qui nous a permis d'ailleurs de bien aborder la partie empirique de notre
travail.
Deuxièmement, il s'agissait d'identifier les
déterminants de la sécurité alimentaire en RCA, suite
à cette analyse nous avons pu identifier certains facteurs
déterminants de la sécurité alimentaire, nous avons
catégorisé ces facteurs en deux, à savoir : les
déterminants économiques et les déterminants non
économiques. Nous avons sectionné les facteurs suivants comme les
déterminants économiques : L'investissement publique ;
La production agricole ; importation des produits alimentaires ; PIB
par tête et l'indice des prix à la consommation. Les
déterminants non économiques retenus sont : La
stabilité politique et la croissance démographique.
A l'issu de cette étude nous pouvons conclure que
l'investissement public à un impact positif sur la
sécurité alimentaire, la production agricole a aussi un impact
positif sur la sécurité alimentaire ; par contre l'indice
des prix à la consommation a un impact négatif sur la
sécurité alimentaire. Nos déterminants non
économiques (stabilité politique et la croissance
démographique), n'ont pas tous les deux un impact positif sur la
sécurité alimentaire, la stabilité politique a un impact
positif sur la sécurité alimentaire tandis que la croissance
démographique a un impact négatif sur la sécurité
alimentaire, bien que les coefficients de nos déterminants non
économiques ne sont pas statistiquement significatifs, on
s'intéresse ici à leurs signes.
Parvenu au terme de notre étude, en termes
d'implication de la politique économique, l'augmentation de
l'investissement de 10%, augmentation de la production agricole de 5%, baisse
de l'indice des prix à la consommation de 5% pourraient améliorer
la sécurité alimentaire en RCA.
En outre, la stabilité politique et la croissance
démographique apparaissent comme une condition nécessaire pour la
sécurité alimentaire, car ces derniers peuvent changer la
situation alimentaire des centrafricains à long terme.
Les chercheurs, le gouvernement, les organismes internationaux
et les donateurs semblent maintenant convenir qu'il est urgent d'augmenter
l'investissement public en RCA en augmentant la part de la formation brute de
capitale fixe (FCBF) dans la richesse crée (PIB), augmenter la
production agricole tout en cherchant la stabilité politique.
En terme de limite, notre étude souffre de manque de
certaines variables défini par la FAO, ce manque est du à son
tour au manque de données qui couvrent la période de notre
étude. Notre étude est beaucoup plus basée sur la
dimension disponibilité, accès et la stabilité de la
sécurité alimentaire. La dimension utilisation n'est pas prise en
compte dans cette analyse, nous n'avons pas des données sur le
changement climatique et l'accès à l'eau potable. Cette
étude pourrait encore bien approfondie à la présence de
ses facteurs manquants.
ANNEXES
Annexe 1 : Evolution de la question alimentaire
|
Années
|
Contexte
|
Stratégies
|
|
1960
|
Guerre froide
Développement autocentré
Indépendance alimentaire.
|
Le concept d'autosuffisance alimentaire
lie
la politique alimentaire à l'identité et
la
sécurité nationales.
Focalisation sur la production
locale vivrière
et sa protection contre les importations.
|
|
1970
|
Mauvaises récoltes dans
plusieurs grandes
régions du
monde (Risques de famine).
Approche globale de
la
question alimentaire
|
Création de réserves internationales
de
céréales.
Gestion de la sécurité
alimentaire par la
communauté internationale.
|
|
1980
|
Apport des travaux de
Amartya K. Sen sur
la
pauvreté, l'économie du bien
être et le
développement
humain.
Approche microéconomique et
prise
en compte de la demande
alimentaire
|
Les questions liées à
l'accessibilité, à
la
répartition des ressources alimentaires et
aux
inégalités sont enfin abordées.
Des
programmes nationaux de sécurité
alimentaire et de
développement agricole
sont mis en place
(Reconnaissance des
interactions entre stratégies alimentaires
et
stratégies de développement).
|
|
Depuis
1990
|
Les aspects sanitaires
nutritionnels et
socio
microéconomiques sont mieux
considérés.
Promotion de la libéralisation
du commerce agricole (Accord
sur
l'agriculture).
Bilan de l'ajustement
structurel.
|
Analyse de la pauvreté en milieu urbain, de
la
vulnérabilité et de la résilience
à
l'insécurité alimentaire.
La promotion
de la sécurité nutritionnelle
et de la
sécurité sanitaire des aliments.
La
gestion des ressources naturelles et
une
agriculture durable sont préconisées
Le droit à l'alimentation et
la
souveraineté alimentaire est de plus en
plus
revendiquée.
|
Source : Auteur
Annexe 2 : Quelques définitions de la
sécurité alimentaire
|
Capacité de tout temps d'approvisionner le monde en
produits de base, pour soutenir une croissance de la consommation alimentaire,
tout en maîtrisant les fluctuations et les prix (ONU, 1975).
· Capacité d'atteindre des niveaux souhaités
de
consommation sur une base annuelle (SIAMWALLA et VALDES, 1980).
· Une certaine capacité de financer des
besoins
d'importations pour satisfaire les
consommations
souhaitées (VALDES et KONANDREAS, 1981).
· La sécurité alimentaire consiste à
assurer à toute personne et à tout moment un accès
physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a
besoin (FAO, 1983).
· L'accès pour tous et en tout temps à une
alimentation suffisante pour une vie active et en bonne santé
(REUTLINGER, 1985; BANQUE
MONDIALE, 1986).
· Un pays et un peuple sont en situation de
sécurité alimentaire quand le système alimentaire
fonctionne de telle sorte qu'il n'y a aucune crainte
de ne pas
posséder une alimentation suffisante (MAXWELL, 1987).
· La sécurité alimentaire correspond à
la capacité pour toute personne de posséder à tout moment
un accès physique et économique aux besoins
alimentaires de
base.
· Une stratégie nationale de sécurité
alimentaire ne peut être envisagée
sans assurer la
sécurité alimentaire au niveau du foyer familial (PAM, 1989).
· La capacité d'assurer que le système
alimentaire fournit à toute la population un approvisionnement
alimentaire nutritionnellement adéquat
sur le long terme (STAATZ,
1990).
· La sécurité alimentaire est assurée
lorsque la viabilité du ménage, défini en tant
qu'unité de production et de reproduction, n'est pas menacée par
un déficit alimentaire (FRANKENBERGER, 1991).
|
Source : Padilla (1997)
Annexe 3 : Analyse descriptives des
variables
Descriptive Statistics
|
Variable
|
Obs
|
Mean
|
Std.Dev.
|
Min
|
Max
|
|
saeli_y_
|
28
|
.464
|
.508
|
0
|
1
|
|
invpub_x1_
|
28
|
11.274
|
2.754
|
6.405
|
17.668
|
|
instpo_x2_
|
28
|
.5
|
.509
|
0
|
1
|
|
ipr_x9_
|
28
|
100.456
|
13.69
|
75.83
|
120.7
|
|
import_x4_
|
28
|
22.203
|
7.706
|
.474
|
39.328
|
|
ipc_x5_
|
28
|
91.536
|
40.622
|
46.443
|
196.861
|
|
pib_tete_x6_
|
28
|
806.204
|
95.161
|
593.056
|
938.824
|
|
demo_x7_
|
28
|
1.727
|
.768
|
.205
|
2.722
|
|
Source : Auteur à partir de STATA 14
Annexe 4 : Matrice de corrélation
Matrix of correlations
|
Variables
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
|
(1) seal_y_
|
1.000
|
|
(2) invpub_x1_
|
-0.196
|
1.000
|
|
(3) instpo_x2_
|
-0.358
|
0.285
|
1.000
|
|
(4) ipr_x9_
|
-0.072
|
0.291
|
-0.062
|
1.000
|
|
(5) import_x4_
|
-0.256
|
0.203
|
0.040
|
0.348
|
1.000
|
|
(6) ipc_x5_
|
-0.047
|
0.484
|
-0.113
|
0.749
|
0.016
|
1.000
|
|
(7) pib_tete_x6_
|
-0.278
|
0.046
|
0.435
|
-0.373
|
0.042
|
-0.681
|
1.000
|
|
(8) demo_x7_
|
0.021
|
-0.331
|
0.121
|
-0.857
|
-0.389
|
-0.701
|
0.424
|
1.000
|
|
Source : Auteur à partir de STATA
Annexe 5: Résultats de l'estimation par le
modèle logit
|
(1)
|
|
VARIABLES
|
seal_y_
|
|
|
|
invpub_x1_
|
0.667*
|
|
(0.371)
|
|
instpo_x2_
|
-0.676
|
|
(1.136)
|
|
ipr_x3_
|
0.194**
|
|
(0.0888)
|
|
import_x4_
|
-0.266**
|
|
(0.131)
|
|
ipc_x5_
|
-0.146**
|
|
(0.0569)
|
|
pib_tete_x6_
|
-0.0397**
|
|
(0.0156)
|
|
demo_x7_
|
-0.784
|
|
(1.367)
|
|
Constant
|
25.89*
|
|
(15.70)
|
|
|
|
Observations
|
28
|
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Source : Auteur à partir de STATA 14
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ASCHAUER, David Alan.,
(1989). «Is public expenditure
productive?». Journal of monetary economics, vol. 23, no 2, p.
177-200.
ASCHAUER, David A., et al.,
(1989). «Public investment and productivity growth in the
Group of Seven». Economic perspectives, vol. 13, no 5, p.
17-25.
ASCHAUER, David A., et al.,
(1990). «Highway capacity and economic
growth». Economic perspectives, vol. 14, no 5, p. 4-24.
ASCHAUER, David Alan., (1990), «Public
Investment and Private Sector Growth», Economic Policy Institute,
vol. 14, no 5, p. 4-24
AZOULAY, Gérard et DILLON, Jean-Claude.,
(1993). ``La sécurité alimentaire en Afrique: manuel
d'analyse et d'élaboration des stratégies''. KARTHALA
Editions, Paris
AWONO, Cyprien et HAVARD, Michel., (2011).
``Le rôle des importations dans la consommation alimentaire au
Cameroun'', GREDI Working paper.
Banque mondiale. (2009), Renforcer la
sécurité alimentaire dans les pays arabes, Washington DC, 84p.les
Pays en Développement. Revue D'économie du
Développement 1, p. 5-20.
BARRETT, Christopher B., (2002). Food
security and food assistance programs. Handbook of agricultural
economics, 2002, vol. 2, p. 2103-2190.
Barrett, Christopher B., (2008).
«Poverty traps and resource dynamics in smallholder agrarian
systems», in:Ruijs, A., Dellink, R.B., Bromley, D.W. (Eds.), Economics of
poverty, environment and natural-resource use, pp. 17-40.
BARRETT, Christopher B. et SWALLOW, Brent M.,
(2006). «Fractal poverty traps». World development,
vol. 34, no 1, p. 1-15.
BEDZEME, T. G. (2011), «Les effets
de l'instabilité des prix internationaux des produits alimentaires sur
la dynamique des marches et de la sécurité alimentaire au
Cameroun». Mémoire de DEA/Master II
BERTHELOT J. (2006),
«Souveraineté alimentaire, prix agricoles et
marchés mondiaux», Forum sur
la souveraineté alimentaire organisé par le
Réseau des organisations paysannes et de
producteurs agricoles de l'Afrique de l'ouest (ROPPA), Niamey,
7-10 Novembre, 15p.
BONJEAN, Catherine Araujo et COMBES,
Jean-Louis., (2010). «De la mesure de l'intégration des
marchés agricoles dans les pays en
développement». Revue d'économie du
développement, vol. 18, no 1, p. 5-20.
BOUËT, Antoine, BUREAU, Jean-Christophe, DECREUX,
Yvan, et al., (2004). «La libéralisation agricole: des
effets ambigus sur les pays en développement». La lettre du
CEPII, no 236.
BOURGEOIS L. (2009), «Crise
économique et sécurité alimentaire : les politiques
agricoles ontelles encore un avenir ?», 15ème Université
d'été de l'innovation rurale,
Mission
Agrobiosciences, Marciac, 5- 7 Août, 7p.
BOUSSARD J-M, DAVIRON B., GERARD F. ET VOITURIEZ
T. (2005), «Food Security and Agricultural
Development in Sub-Saharan Africa: Building a Case for More Support»,
Document de cadrage du Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le
développement (CIRAD) et de la FAO, Rome 2005,
113p.
BOUSSARD J-M. ET DELORME H. (2007),
«La régulation des marchés agricoles
internationaux, un enjeu décisif pour le
développement», L'harmattan, coll. « Biologie
Ecologie Agronomie », Paris, 337p.
CLÉMENT, Alain., (1999).
«Nourrir le peuple: entre Etat et marché, XVIe-XIXe siècle:
contribution à l'histoire intellectuelle de l'approvisionnement
alimentaire». Editions L'Harmattan.
Clément Alain., (2006). Les lois
économiques doivent-elles s'appliquer aux biens de
subsistance? ,
Cahiers d'économie et sociologie rurales, no 79,
p10-36.
Clément Matthieu., (2009), «Les
déterminants socioéconomiques de la faim : une analyse
macroéconométrique à partir de données de
panel», 3èmes Journées du Développement
du
GRES 10-12 Juin, Bordeaux, France, 21p.
CLERC, Denis., (2004). «De
l'état stationnaire à la décroissance: histoire d'un
concept flou». L'Economie politique, no 2, p. 76-96.
COMBRIS, Pierre., (2006). «Le poids des
contraintes économiques dans les choix alimentaires». Cahiers
de Nutrition et de Diététique, vol. 41, no 5, p. 279-284.
FAO (1983), La situation mondiale -
Alimentation et agriculture en Afrique au sud du
Sahara: La femme dans le
développement agricole, Rome, 237p.
FAO (1995), La situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture 1995: Le commerce
agricole à
l'aube d'une nouvelle ère ? , Rome, 320p.
FAO (2000a), La situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture 2000:
Enseignements des 50
dernières années, Rome, 354p.
FAO (2000b), L'état de
l'insécurité alimentaire dans le monde 2000: la faim au quotidien
et
la crainte permanente de la famine, Rome, 40p.
FAO (2002), Agriculture, alimentation et
nutrition en Afrique, Rome, 411p.
FAO (2004a), L'état de
l'insécurité alimentaire dans le monde 2004, Suivi des
progrès
accomplis en vue de la réalisation des objectifs du
Sommet mondial de l'alimentation et de la Déclaration du
Millénaire, Rome, 43p.
FAO (2004b), La situation des marchés
des produits agricoles en 2004», Rome, 56p.
FAO (2004c), L'accord sur l'agriculture
(OMC): Bilan de sa mise en oeuvr, Rome, 743p.
FAO, (2017). La situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture
FAO, (2018). Rapport mondial sur les crises
alimentaires
FAO (2004d), Situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture 2004 : les
biotechnologies agricoles :
une réponse aux besoins des plus démunis, Rome, 226 p.
FAO (2005a), Situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture 2005, Le commerce
agricole et la
pauvreté: le commerce peut-il être au service des pauvres?,
Rome, 225p.
FAO (2005b), La situation
des marchés des produits agricoles en 2005, Rome,
24p.
FAO (2005c), Directives volontaires à
l'appui de la concrétisation progressive du droit à
une
alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale, Directives
adoptées
à la 127ème session du Conseil de la FAO en Novembre 2004,
49p.
FAO (2006a), Sécurité
alimentaire et développement agricole en Afrique subsaharienne,
Rome,
96p.
FAO (2006b), Examen à mi-parcours des
progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif
du sommet
mondial de l'alimentation, 32ème Session, 30 Octobre-4 Novembre,
22p.
FAO (2006c), Le droit à l'alimentation dans les faits,
Rome, 38p.
FAO (2006d), Situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture : L'aide alimentaire pour la
sécurité alimentaire? , Rome, 207 p.
FAO (2007), Le défi du renouveau,
Évaluation externe indépendante de l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Document de travail pour
consultation présenté au Comité du Conseil chargé
de l'Évaluation externe indépendante de la FAO (CC-EEI), Juillet,
390 p.
FAO (2008a), Méthodologie de la FAO
pour mesurer la prévalence de la sous-alimentation,
Division
des Statistiques de la FAO, Octobre, Rome, 16 p.
FAO (2008b), Situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture 2008; les
biocarburants : perspectives,
risques et opportunités, Rome, 156 p.
FAO (2008c), Introduction aux concepts de la
sécurité alimentaire, Programme CE-FAO
«
Sécurité alimentaire : l'information pour l'action
», Rome, 4 p.
FAO (2008d), plan d'action immédiate,
rapport du comité de la conférence chargé du suivi de
l'évaluation externe indépendante de la FAO (CoC-EEI),
35ème session (session extraordinaire), Rome, Octobre, 142 p.
FAO/PAM (2008), Crop and food supply
assessment mission to Swaziland, rapport special de la FAO et du PAM, Rome, 17
p.
FAO (2011), L'état de
l'insécurité alimentaire dans le monde 2011 : Comment la
volatilité
des cours internationaux porte-t-elle atteinte à
l'économie et à la sécurité alimentaire des pays?
Rome, 62p.
FMI (2001),
Libéralisation du commerce mondial et pays en
développement, Etudes
thématiques,
Washington, Novembre, 5p.
GÉRARD, Françoise., (2010).
Dynamique de l'offre, incertitude et régulation des marchés
agricoles.. Thèse de doctorat. Université
Panthéon-Sorbonne.
Gerard, Françoise., (2013).
«Commerce international et sécurité alimentaire».
Communication à l'Académie d'Agriculture: échanges
agroalimentaires internationaux.
GÉRARD, Françoise, DURY, Sandrine,
BÉLIÈRES, Jean-François, et al., (2012).
«Comparaison de plusieurs scénarios de lutte contre
l'insécurité alimentaire au Mali». Cahiers
Agricultures, vol. 21, no 5, p. 356-365.
GERARD, Françoise, PIKETTY, Marie-Gabrielle, et
BOUSSARD, Jean-Marc., (2013). «Stabilisation des prix des
céréales: avantages et coûts du stockage public».
GÉRARD, Françoise, PIKETTY,
Marie-Gabrielle, et BOUSSARD, Jean-Marc., (2002). «Modèle
macro-économique à dominante agricole pour l'analyse de l'impact
du changement climatique et des effets des politiques en termes
d'efficacité et d'équité». Rapport de fin
d'étude GICC, no 10.
IFPRI, (2012), The impacts of public
investment in and for agriculture, in: Mogues, T., Yu, B., Fan, S., McBride, L.
(Eds.). International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
LALLAU, Benoit., (2008),
«Les agriculteurs africains entre
vulnérabilité et résilience. Pour une
approche par les capabilités de la gestion des
risques», Revue Française de
Socio-
économie 2008/1 - no. 1, p.
177- 198.
MALASSIS L., (1972), Agriculture et
Développement : le stade de l'agro-industrie, Ecole
Nationale
Supérieure Agronomique, Montpellier, France, 55 p.
MALASSIS L., (1973), Economie
agroalimentaire, Tome 1 : Economie de la consommation et de la production
agroalimentaire, Paris, éditions Cujas, 432 p.
MALASSIS L. ET PADILLA M., (1986),
Economie agro-alimentaire tome III. L'économie
mondiale, Paris, ditions Cujas, 449p.
MALASSIS, L., (1992), «Politique
agricole, politique alimentaire, politique agro-alimentaire»,
Économie rurale, numéro 211, pp. 47-52. Malassis L. et
Ghersi G. (1992), Initiation à l'économie
agro-alimentaire, Universités francophones, édition Hatier-
Aupelf, Paris, 335p.
MALTHUS, T. R., (1963). Essai sur le
princioe de population: Préface et traduction par le docteur Pierre
Theil [Înline]/T. R. Malthus.-Paris: Édition Gothier.
MINKOUA N, J.R, TEMPLE. L ET KAMGNIA , D.
B., (2010), «Les déterminants de l'instabilité du
prix des produits vivriers au Cameroun». Papier présenté
aux 4ième Journées de recherches en sciences sociales à
AgroCampus- Ouest, 9 et 10 décembre.
NUBUKPO, Kako Kossivi., (2000).
L'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne: le rôle
des incertitudes..
NGO NONGA, F., MINKOUA N, J. R., BEDZEME, T.
G., (2013), «Performances camerounaises en matière de
sécurité alimentaire : le cas des
céréales».
OXFAM (2002), Cultiver la pauvreté :
l'impact des subventions américaines au coton sur
l'Afrique, OXFAM
Briefing paper, 45p.
OXFAM (2007), What agenda now for
agriculture? A response to the World Development
Report 2008, OXFAM Briefing
Note, October, 17p.
OXFAM (2013), La face cachée des
marques : Justice alimentaire et les 10 géants du secteur
alimentaire
et des boissons, Document d'information d'OXFAM, Février, 60 p.
PADILLA M. (1997), «Approvisionnement
et distribution alimentaires des villes», La sécurité
alimentaire des villes africaines : le rôle des Systèmes
d'approvisionnement et de distribution alimentaires (SADA), Programme
Coll. «Aliments dans les villes », 47p
PAM, DGPER, (2012), Évaluation
approfondie de la sécurité alimentaire des ménages
dans
170 communes déclarées a risque. Programme alimentaire
mondial des Nations Unies,
Direction Générale de la Promotion
de l'Économie Rurale, Ouagadougou, p. 60.
SCHRIEDER, G. AND HEIDHUES F. (1995),
«Rural financial markets and the food security of the poor: the case of
Cameroon». African Review of Money Finance and Banking, No. 1/2
(1995), p. 131-154.
SEN A. K. (1981a), Poverty and Famines: An
Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford
University Press, 257p.
SEN A. K. (1981b), Ingredients of Famine
Analysis: Availability and Entitlements, The
Quaterly Journal of
Economics, vol 96, No 3, August, pp 433-464.
SEN A. K. (1993), Ethique et
économie, Presses universitaires de France, Paris, coll.
«
Philosophie morale », 364p.
SEN A. K. (1999), L'économie est une
science morale, Paris, éd. La Découverte, coll.
« Cahiers
libres », 125p.
SEN A.K. (2000), Un nouveau modèle
économique, Editions Odile Jacob (Traduction de
Development as
Freedom, 1999), Paris, 356p.
SMITH, L.C., ALDERMAN, H., ADUAYOM, D.,
(2006), Food insecurity in sub-Saharan Africa: new estimates from household
expenditure surveys. Intl Food Policy Res Inst
SUBERVIE, J. (2007). «La Transmission de
L'instabilité des Prix Agricoles Internationaux et Ses
Conséquences dans les Pays en Développement».
Thèse doctorale, Université d'Auvergne, Clermont- Ferrand
1
TRIMMER, G. (2000). «The Macro
Dimensions of Food Security: Economic Growth, Equitable World Bank»,
Cahiers Economiques De La République Centrafricaine. Mars
2018/Premier numéro
TIMMER C.P., FALCON W.P. ET PEARSON S.R.
(1987), «Analyse de la politique alimentaire,
publié par la Banque Mondiale, éditions
Economica», p. 364.
TURKI-ABDELHEDI, I., LEMENT, A. ET GHORBEL-ZOUARI,
S. (2013), «Les déterminants de la sécurité
alimentaire en afrique: une approche en données de panel».
International Conference on Business, Economics, Marketing & Management
Research (BEMM'13), Economics & Strategic Management of Business Process
(ESMB), vol.2, p.113-117.
UNESCO (1995), Effets des programmes
d'ajustement structurel sur l'éducation et la
formation,
Conférence générale Vingt-huitième session, Paris,
Août, 28p
World Bank, (2019). World Development
Indicators (WDI). World Bank, Washington, D.C.
YABILE, Kinimo Rene. (2013),
«déterminants de la sous-alimentation des ménages en
côte d'ivoire : cas des régions centre et centre-est»,
European Scientific Journal May 2013 edition vol.9, no.14 ISSN: 1857 -
7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
ZIDOUEMBA, P. GERARD., F. (2015),
«Investissement et sécurité alimentaire au
Burkina-Faso». Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement, p
411-437
ZUGASTI, C. Alicia Avilés, GARCÍA,
Rosario Gómez, et MALDONADO, José Sánchez.,
(2001). «The effects of public infrastructure on the cost structure of
Spanish industries». Spanish Economic Review, vol. 3, no 2,
p. 131-150.
TABLES DES MATIERES
SOMMAIRE
i
AVERTISSEMENT
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES
ET ABREVIATION
v
LISTE
DES TABLEAUX
vii
LISTE
DES FIGURES
viii
RESUME
ix
ABSTRACT
x
INTRODUCTION
GENERALE
1
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
2
2. PROBLEMATIQUE
7
3. QUESTION DE RECHERCHE
9
4. OBJECTIF DE RECHERCHE
9
5. HYPOTHESE DE RECHERCHE
9
6. METHODOLOGIE
9
7. INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES ET PRATIQUE
DE L'ETUDE
10
7.1 INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES
10
7.2 INTÉRÊTS PRATIQUES
10
8. Organisation du travail:
10
PREMIERE
PARTIE :
12
CADRE
D'ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE EN RCA
12
INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE
13
CHAPITRE
1: GENERALITE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE
14
INTRODUCTION
14
I. EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE
14
II. LES INDICATEURS ET LES INDICES DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE
18
II.1 Les indicateurs usuels de
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN): l'état de
l'art
18
II.1.1 Un ensemble d'indicateurs pour couvrir les
multiples dimensions de la SAN
19
II.1.1.1 La dimension « disponibilité
»
20
II.1.1.2 La dimension «accès »
20
II.1.1.3 La dimension «stabilité
»
21
II.1.1.4 La dimension « utilisation »
22
II.2 L'indicateur de FAO de la sous-alimentation
(FAOSA)
24
II.3 L'Indice de la Faim dans le Monde (IFM)
25
II.4 L'Indice de Sécurité Alimentaire
Mondiale (ISAM)
25
II.5 L'indice de la Pauvreté et de la Faim
(IPF)
27
II.6 L'Indice d'Engagement de Réduction de la
Faim, (IERF)
27
II.7 Les indicateurs anthropométriques
(IA)
28
II.8 Le Score de Diversité Alimentaire
(SDA)
29
II.9 Les Indicateurs Médicaux et de
Bio-marqueurs (IMB)
30
CONCLUSION
31
CHAPITRE
2 : LA RCA ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
32
INTRODUCTION
32
I. ANALYSE DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE EN RCA
32
I.1 Analyse la situation de la
sécurité alimentaire en RCA
32
I.1.1 Disponibilité alimentaire
33
I.1.2 Accès à l'alimentation
35
I.1.3 Utilisation des aliments
38
I.1.4 Durabilité alimentaire
39
I.2 Analyse de la situation nutritionnelle
40
I.2.1 Sous-nutrition
41
I.2.2 Surnutrition
42
II. REVUE DES POLITIQUES ET PROGRAMMES DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION
43
II.1 Politiques et programmes dans le cadre de la
sécurité alimentaire et de la nutrition
44
II.1.1 Stratégie de Développement
Rural, de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire
44
II.1.2 Programme National d'Investissement Agricole,
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
45
II.1.3 Politique Nationale de Nutrition.
46
II.1.4 Politique Nationale de Promotion de
l'Egalité et de l'Equité
47
II.1.5 Politique Nationale de Protection Sociale
48
II.1.6 Feuille de Route du Secteur Agricole
49
II.2 Ressources financières pour la
sécurité alimentaire et la nutrition
49
CONCLUSION
51
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
52
DEUXIÈME
PARTIE :
53
IDENTIFICATION
DES DÉTERMINANTS DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN RCA
53
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE
54
CHAPITRE
III : MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE EN RCA
55
INTRODUCTION
55
I. CADRE ANALYTIQUE DU MODEL LOGIT
55
I.1 Nature du modèle
économétrique
56
I.1.1 Approche descriptive
56
I.2 Spécification théorique du
modèle Logit
58
I.3 Procédure d'estimation
59
I.3.1 Vraisemblance du modèle
59
I.3.2 Intervalles de confiance
60
I.3.3 Test de significativité globale
60
I.3.4 Test de significativité pour une
variable
61
I.3.5 Qualité de l'ajustement du
modèle
62
II. METHODOLOGIE : ENSEMBLE DES DONNEES ET
VARIABLES
62
II.1 Méthodologie d'étude
62
II. 2 Spécification du modèle
économétrique
63
II.3 Ensemble de données et variables
65
II.4 Les autres variables
69
CONCLUSION
71
CHAPITRE
IV : RESULTATS ET DISCUSSION
72
INTRODUCTION
72
I. ANALYSE DESCRIPTIVE DES VARIABLES
72
I.1 Evolutions de nos variables
72
I.2 Statistiques descriptives des variables
utilisées
76
I.3 Corrélation entre les variables
77
II. RESULTATS EMPIRIQUES
78
II.1 Maximum de vraisemblance
78
II.2 calcule des Effets marginaux
79
CONCLUSION
80
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
81
CONCLUSION
GENERALE
81
ANNEXES
81
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
81
TABLES
DES MATIERES
81
* 1 Conférence
mondiale de l'alimentation est convoquée par l'Organisation des Nations
Unies en 1974 en application d'une résolution de l'Assemblé
générale des Nations Unies, cette conférence
représente le premier sommet international sur l'alimentation
(http://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_1997_num_1_4858).
* 2 Armatya Sen «The
entitlement approach to famine» (http://www.wider.unu.edu)
* 3 Sommet mondial sur
l'alimentation organisé par la FAO du 13 au17 novembre 1996 à
Rome avec la participation de 185 pays
(http://www.fao.org/about/meeting/global-parliamentary-summit/fr/)
* 4 IPC est le cadre
intégré de classification de la sécurité
alimentaire de la FAO
* 5 Les données sur le
pourcentage de personnes sous-alimentées, le pourcentage de
l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans et la
mortalité infantile proviennent respectivement de la FAO, de l'OMS et de
l'UNICEF
* 6 Rapport du NEPAD sur la
sécurité alimentaire en Afrique, 2016.
* 7 Rapport de la Commission
Economique pour l'Afrique, Nations Unies, 2015.
* 8 Rapport final du suivi
des OMD en RCA, 2015.
*
9http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/central_african_republic/c
a_-ptss_v_definitive_1.pdf
* 10
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-international
programs/_docs/globalnutritionseries/Nutrition_exec_summary_FR.pdf



