|
THEME : « GESTION DES DECHETS
SOUILLES PAR LES HYDROCARBURES EN MILIEU FLUVIAL : CAS DU FLEUVE OGOOUE AU
GABON DE 2013 à 2017 »
EPIGRAPHE
« Les déchets constituent la
problématique principale de l'environnement aujourd'hui ».
D
AMIEN.
A.
DEDICACE
Nous dédions ce travail de fin de cycle à notre
mère MENVOULA Brigitte, pour nous avoir donné la
vie ainsi que ses sages conseils.
REMERCIEMENTS
Le présent travail a été
réalisé dans le but de l'obtention du diplôme des
études supérieures en navigation intérieure. Il n'aurait
pas pu voir le jour sans l'appui moral, académique et financier de
nombreuses personnes.
Avant tout nous remercions le gouvernement Gabonais pour
l'effort consenti à notre endroit, surtout pour la prise en charge de
notre formation.
Ensuite, notre profonde gratitude à la direction et
à l'ensemble du corps professoral de l'Ecole Régional de
Formation aux Métiers de la Navigation Intérieure
(ERFMNI), qui par leur sagesse et dévouement, nous ont
assuré un meilleur encadrement durant ces trois années
académiques.
Aussi, nous remercions particulièrement
le Commandant MATONGASIMONINI Marco et MonsieurZRAN
TOPI Lucien, qui ont bien voulu assurer respectivement la direction
et la co-direction de ce travail, en dépit de leurs multiples
occupations.
Egalement, nos remerciements s'adressent
à notre famille, notamment Christian NGUEMA MEYE,
Yolande NKIE NGUEMA pour leur soutien financier.
Enfin, que tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à la réalisation de ce travail
trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements.
RESUME
Pour protéger l'environnement du fleuve Ogooué,
il est primordial que les autorités compétentes, les armateurs
des bateaux respectent les méthodes de traitement et la
réglementation établies pour la construction de ses derniers
à l'égard de la gestion des déchets souillés par
les hydrocarbures en milieu fluvial.
Ainsi, dans un premier temps notre travail présente les
sources des déchets souillés par les hydrocarbures à bord
des bateaux lié aux activités journalières l'instar de la
salle des machines qui est une grande source de déchets à cause
des réparations qui s'y font comme les vidanges des moteurs, les
chiffons utilisés pour le nettoyage des pièces mécaniques
et des citernes ;d'autres sources proviennent des douches et des cuisines
c'est le cas des eaux usées qui sans contrôle font l'objet d'une
pollution pour le fleuve Ogooué.
Dans un second temps ,nous avons parlé des
différentesméthodes employées pour le traitement des
déchets souillés par les hydrocarbures en milieu fluvial dans les
bateaux comme l'installations des cuves de décantation,
desincinérateurs,des épurateurs, du
systèmeO.D.M.E qui contrôle la
quantité règlementaire des effluents à rejeter dans le
fleuve Ogooué .De même sur le plan juridique, desconventions
internationales et des codes comme Marpol de par ses différents annexes
notamment l'annexe I ;II,III et autres qui stipulent comment les
déchets doivent êtregérer ou contrôlerà chaque
niveau de production des déchets et le code de la navigation
Intérieure CEMAC/RDC en son chapitre II sur la protection des eaux et
élimination des déchets provenant à bord des
bâtiments en son article 125,126 et 127 ;à cela s'ajoute le
bon comportement des navigants qui devrait être soucieux de
l'environnement.
ABSTACT
In order to protect the environment of the Ogooué
River, it is essential that the competent authorities, shipowners, respect the
treatment methods and regulations established for the construction of the
latter with regard to the management of oil-contaminated waste. River
environment.
Thus, at first, our work presents the sources of waste soiled
by hydrocarbons aboard the boats related to the daily activities like the
engine room which is a great source of waste because of the repairs which are
done like engine emptying, rags used for cleaning mechanical parts and tanks,
other sources come from showers and kitchens this is the case of wastewater
that without control are subject to pollution for the river Ogooué.
In a second step, we talked about the different methods used
for the treatment of hydrocarbon-contaminated waste in the river environment in
boats such as settling tanks, incinerators, scrubbers, O.D.M.E which controls
the quantity regulation of effluents to be discharged into the
OgoouéRiver. So also on the legal level, international conventions and
codes like Marpol by its various annexes including Annex I; II, III and others
which stipulate how waste should be managed or control at each level of waste
production and the CEMAC / DRC inland navigation code in Chapter II on the
protection of water and the disposal of shipboard waste in its articles 125,
126 and 127; flight behavior that should be environmentally conscious.
LISTE DES ABREVIATIONS
COW : CrudeOilWashing ;
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale ; CDPM : Code
des Ports Maritimes ;
EEDI : indice de conception
d'efficacité énergétique (EnergyEfficiency Design
Index) ;
L.P.G :Liquid Propane Gas ;
MEPC : Comite de la protection du milieu
marin
N.B : « Nota
bene » qui signifie notez bien ;
NOx : oxydes
nitreux ;
O.D.M.E : Oildischarge monitoring
equipment (équipement de surveillance des rejets
d'hydrocarbures) ;
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé ;
ONU : Organisation des Nations
Unies ;
PM : pour matières
particulaires d'après l'expression
ParticulateMatter ;
SEEMP :ShipEnergyEfficiency Management
Plan (Plan de gestion de l'efficacité énergétique des
navires) ;
SACO : substances
qui appauvrissent la couche d'ozone ;
SOx :oxydes de soufre ;
RDC : République
Démocratique du Congo ;
TJB : tonneau de jauge brut ;
V.L.C.C: Very large crude carrier;
ZCE : Les zones d'émission
contrôlées.
INTRODUCTION
1.
Problématique.
Le milieu fluvial fait face à un
phénomène grandissant, celui des déchets souillés
par des hydrocarbures à l'égard de leur gestion.
Au regard de l'actualité environnementale, certains
pays du monde ainsi que des organisations non gouvernementales tentent de
résoudre de façon quotidienne le problème des
déchets issus des hydrocarbures.
Dans ce contexte, ces derniers organisent des
conférences, des forums, des séminaires et créent des
partenariats pour une meilleure résolution de ce problème
crucial.
En plus, ils procèdent à des sensibilisations
via la presse écrite ou audiovisuelle vis-à-vis des producteurs,
les transporteurs et les utilisateurs des hydrocarbures afin de montrer aux
yeux du monde la dangerosité et les risques auxquels l'humanité
est confrontés.
A cela, il convient de signifier que la protection de
l'environnement devrait permettre de prendre des mesures appropriées,
afin de limiter l'impact négatif des activités de
l'humanité sur son environnement.
Ainsi, cette situation permettra de mieux conserver la nature
d'identifier les actions humaines qui l'endommagent au point de porter
préjudice aux générations futures ainsi que la mise en
place des actions correctives.
A titre d'exemple, les forêts, les fleuves, les
océans constituent des habitats les plus écologiquement
dynamiques et les plus biologiquement diversifiés de la planète.
Elles contribuent notablement à maintenir la productivité de la
flore et de la faune marines, des poissons et des oiseaux.
En outre, ces eaux constituent une des espèces
fondamentales qui ont un impact sur la survie et l'abondance de nombreuses
autres espèces dans l'écosystème.
Dans ce cas, l'homme est censé de pouvoir mettre en
place des mécanismes de protection efficaces de
l'écosystème afin d'éviter des dégradations
très importantes relatives à la mauvaise gestion de ces
déchets. Cette situation nous mène à plusieurs
préoccupations majeures, celles de savoir :
· Quelle est l'origine des déchets souillés
par les hydrocarbures dans le fleuve OGOOUE, au Gabon ?
· Comment gérer efficacement ces déchets
pour limiter son impact négatif sur le fleuve OGOOUE, au
Gabon ?
2. Hypothèses
Dans le cadre de cette recherche scientifique, nos
hypothèses se formulent de la manière ci-dessous :
· les déchets souillés par les
hydrocarbures dans le fleuve OGOOUE auraient pour origine les activités
liées aux navires ;
· les déchets souillés par les
hydrocarbures seraient gérés efficacement afin de limiter
son impact négatif sur le fleuve OGOOUE, au Gabon.
3. Objectifs du travail
3.1. Objectif
général
· protéger l'environnement pour éviter de
porter préjudice aux générations futures
3.2. Objectifs
spécifiques
· mettre en place des mécanismes de protection
efficaces de l'écosystème ;
· sensibiliser à travers la presse les
producteurs, les transporteurs et les utilisateurs des hydrocarbures ;
· résoudre de façon quotidienne le
problème des déchets issus des hydrocarbures...
4. Méthodes et
techniques de recherches
La réalisation de tout travail scientifique doit
obéir à des règles cartésiennes afin de guider la
recherche qui permettra de ressortir la vérité sur un fait.
Pour cela notre étude ou travail adoptera les
méthodes et techniques suivantes :
· La méthode descriptive : elle
consiste à déterminer la nature et les caractérisés
des phénomènes ;
· La méthode analytique : elle nous a
servi à analyser les faits, lesphénomènes et les
réalités entrant en jeu dans le traitement du présent
travail ;
· La méthode déductive :
Méthode de pensée par laquelle on conclut à partir
d'observations, qui va du général au particulier.
6. Choix et
intérêt du sujet
Le choix de notre travail porte sur « la
gestion des déchets souillés par les hydrocarbures en milieu
fluvial » afin de vérifier si une meilleure organisation de la
gestion des déchets peut faire l'objet d'une réduction durable de
ces derniers.
7. Délimitation
spatio-temporelle
Une étude scientifique s'examine sur plusieurs plans.
Pour des raisons précises et d'orientations exactes, notre travail se
fera sur le fleuve Ogooué au Gabon et cela de 2013 à 2017.
8. Difficultés
rencontrées
Une telle étude ne peut s'effectuer sans obstacles. En
effet, dès le début, lorsque nous avions expliqués aux
autorités fluviale et maritimes ce que nous comptions faire, ils
étaient tous enthousiasmés mais lorsqu'il était question
de nous procurer des informations liées à notre objet
d'étude, ils étaient on ne peut plus réticent,
prétextant qu'on n'avait pas le droit d'accès à ce
dossier. Certains nous fixant même plusieurs fois des faux rendez-vous.
Donc notre principale difficulté vécue est liée à
la rétention de l'information dont ont fait preuve certains individus
dans les différents services que nous avons visité au Gabon.
Par ailleurs, d'autres obstacles sont liés à la
collecte de données car elle a été une rude
épreuve. En effet, au départ nous avons cru pouvoir trouver une
littérature abondante, variée et récente sur la gestion
des déchets souillés par les hydrocarbures en milieu fluvial en
général mais pour le cas du fleuve Ogooué particulier,
hélas notre surprise a été grande de constater la
rareté de l'information aussi bien sur le net que dans les autres
sources d'informations.
9. Canevas
Outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail est subdivisé en trois chapitres notamment :
· Le premier chapitre portera sur le cadre
théorique et conceptuel ;
· Le deuxième chapitre sera consacré
à la gestion des effluents à bord.
· Le dernier chapitre analysera les déterminants
de la gestion des déchets souillés par les hydrocarbures sur le
fleuve Ogooué.
CHAPITRE I : LA CARDE
THEORIQUE ET CONCEPTUEL.
I.1 Définitions des
concepts
Nous aurons donc :
I.1.1 : Gestion
Ø Ensemble des activités d'organisation, de
planification, de direction et de contrôle nécessaires pour qu'une
entreprise atteigne ses objectifs.1(*)
Ø C'est l'action de gérer, de contrôler ou
encore de maitriser quelque chose ou quelqu'un.
I.1.2 : Déchets
Ø Résidu impropre à la consommation,
inutilisable (et en général sale ou encombrant).2(*)
Ø Ce sont des résidus, débris qui reste
après avoir transformer une matière ou un quelconque produit.
I.1.3 : Souillés
Ø Contaminés, pollués3(*).
Ø C'est le fait d'être tacher par quelque
chose.
I.1.4 : Hydrocarbures
Ø corps organique uniquement composé d'atomes de
carbone et d'hydrogène.4(*)
I.1.5 : Milieu
Ø Ensemble des caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques qui définissent un type d'environnement
géographique naturel ou propre à une espèce animale ou
végétale5(*).
Ø Ensemble des facteurs géologiques,
pédologiques et climatiques6(*).
I.1.6 : Fluvial
Ø Qui est relatif au fleuve, à un cours
d'eau.
Ø Qui est relatif à un cours d'eau
intérieur.
Apres avoir définit les concepts, nous
présenterons les autres définitions
I.2 : Les autres
définitions
I.2.1: Un ballast tank
C'est un réservoir d'eau de grande contenance
équipant certains navires. Il est destiné à être
rempli ou vidangé d'eau de mer afin d'optimiser la navigation.
L'opération de vidange, ou déballastage, effectuée dans de
mauvaises conditions peut poser des problèmes écologiques. Le
ballast est également le nom donné aux capacités de
stockage de combustibles ou d'eau douce : ballast « eau
douce », ballast à combustible.7(*)
I.2.2 : Effluents
Terme générique désignant une eau
résiduaire urbaine ou industrielle, et plus généralement
tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante (dissoute ou
particulaire).8(*)
I.2.3 : Pétrole
Le pétrole est une huile minérale naturelle
issue de la décomposition sédimentaire des composés
organiques à base de carbone notamment et qui s'est accumulée en
gisements au cours des siècles, et qui est utilisée comme source
d'énergie non renouvelable mais aussi par l'industrie des
matières plastiques qui utilise environ 4% de tous les produits
pétroliers.9(*)
I.2.4 : Gasoil
Le Gazole est appelé également gasoil. Le Gazole
est issu du raffinage du pétrole et utilisé pour la production de
chaleur et d'énergie. Le Gazole est utilisé dans les moteurs
Diesels et il n'est pas utile de lui associer du plomb ou tout autre
composé antidétonant à l'opposé de l'essence
étant donné que ces moteurs n'utilisent pas d'allumage par
étincelle électrique.10(*)
I.2.5 : Le filtrat
C'est un liquide plus ou moins purifié recueilli
après filtration d'un mélange.11(*)
I.2.6 : L'environnement
C'est l'ensemble des éléments qui entourent un
individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à
subvenir à ses besoins, ou encore comme « l'ensemble des conditions
naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les
activités humaines 12(*)
I.2.7 : Oléoduc
Un oléoduc est une canalisation destinée au
transport du pétrole. Un oléoduc est souvent
désigné par l'anglicisme plus général pipeline.
Mais pipeline englobe aussi bien les oléoducs que tous les autres tubes
de transports de liquides ou de gaz.13(*)
I.2.8 : Déchets survenant lors de
l'exploitation du bâtiment
Déchets et eaux usées survenant à bord du
fait de l'exploitation et l'entretien du bâtiment.14(*)
I.2.9 : Déchets liés à
la cargaison
Les déchets et eaux usées survenant à
bord du bâtiment du fait de la cargaison.15(*)
I.2.10 : Station de réception
agrées
Les bâtiments au sens de l'article 2b ou les
installations à terre agrées par l'autorité
compétente pour recueillir les déchets survenant lors de
l'exploitation du bâtiment ainsi que les déchets liés
à la cargaison.16(*)
I.2.11 : Ecosystème
C'est un complexe biologique formé de l'ensemble de
facteurs abiotiques et facteurs biotiques existant en équilibre
dynamique à un endroit donné.
I.2.12 : Biosphère
C'est un ensemble des milieux où l'on retrouve la vie
comme l'eau, une partie du sol et de l'air.
I.2.13 : Ordures ménagères
Déchets issus de l'activé quotidienne des
ménages.
I.2.14 : Déchets
ménagers
Un déchet ménager est considéré
comme tout appareil qui ne peut être utilisé comme une machine
à laver.
I.2.15 : Biotique
Se dit de tout facteur ayant un rapport avec la vie.
I.2.16 : Abiotique
Qualifie un milieu où les organismes vivants ne peuvent
exister
I.2.17 : La faune
Elle correspond à l'ensemble des espèces
animales vivant dans un même espace géographique à une
période donnée.17(*)
I.3. Présentation du
fleuve Ogooué au Gabon
Carte 1 : Carte hydrographique du bassin
versant de l'Ogooué
Source :
https://fr.wikipedia.orgconsulté
le 15/08/2018, à Port gentil, à 16h23
Commentaire
Ogooué, fleuve du Gabon, qui traverse le pays en son
centre d'est en ouest pour se jeter dans l'océan Atlantique. Il mesure
environ 1 200 km de long et son bassin s'étend sur
215 000 km2.La source du fleuve se trouve sur les plateaux
Batékés (environ 600 m d'altitude) de la république
du Congo. Le cours d'eau coule d'abord vers le nord-ouest. En aval de Masuku
(dans le sud-est du Gabon), il traverse des rapides, puis reçoit le
Léconi et la Sébé. Après les confluences du Lolo et
de l'Ivindo (environ 180 km plus au nord), il oblique vers l'ouest. En
aval du défilé des Portes de l'Okanda, il devient navigable,
entre en plaine, se dirige vers le sud-ouest et reçoit la Ngounié
(à mi-parcours environ du cours d'eau). À Lambaréné
(située à 15 km environ au sud-ouest) commence le delta de
l'Ogooué : le débit y est d'environ
5 000 m3/s et le régime typiquement
équatorial, avec deux saisons de hautes eaux. Il se jette dans
l'océan Atlantique au sud de Port-Gentil.
CHAPITRE II : LA
GESTION DES EFFLUENTS A BORD.
II.1 Historiques des
bateaux transportant des hydrocarbures
Sous la pression des États-Unis, l'
Organisation
maritime internationale (OMI) rend obligatoire en 1975 la construction des
navires pétroliers double coque dans le cadre de la convention
Marpol 73/78. Les navires
pétroliers à simple coque seront interdits en
2015 en Europe, à la
suite des accidents traumatisants de l'
Erika(12
décembre 1999 au large de la Bretagne) et du
Prestige(13
novembre 2002).Cependant, les doubles coques ont été souvent
imposées par mimétisme plutôt que par choix
réfléchi.
Image1 : présentation du naufrage de l'
Erika

Source :https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-naufrage-de-l-erika
Commentaire
Sur cette image nous présente le naufrage traumatisant de
l'
Erikadu
12 décembre 1999 au large de la Bretagne avec du mazout.
Un pétrolier est un
navire-citerne
servant à transporter le
pétrole ainsi
que ses dérivés. Pour le transport d'autres liquides, les navires
ont d'autres appellations : les
méthaniers
qui transportent le
gaz naturel, les
butaniers qui transportent
le
butane, les
chimiquiers pour le
transport de produits chimiques. On les nomme également tankers (en
anglais : oil
tankers, littéralement « citernes à
pétrole »), ou supertankers pour les plus grands ou alors les
Very large crude carrier communément appelés V.L.C.C., nous avons
aussi les chemicals tankers, Gas tankers pour la famille des gaziers les L.P.G.
(Liquid Propane Gas).
On distingue communément les pétroliers à
coque simple et les
pétroliers à coque double. Ces derniers sont
préférés de nos jours aux premiers car
considérés plus sûrs. En effet, dans ce concept, les
cales sont
séparées du contact direct du fleuve ou de la mer par une
ceinture de
ballasts. Un
espace, en général de deux mètres, sépare ces deux
coques. En cas d'avarie, le pétrole se déverse dans cette
capacité et non dans le fleuve ou la mer. Cette double coque sert avant
tout de protection de la cargaison en cas d'abordage.
Image 2 : Coupe transversale d'un
pétrolier (Oil Tanker) à double coque.
Source :
https://amigopai.wordpress.com/2015/06/23/navios-e-submarinos
Commentaire
Cette image, nous montre comment la structure d'un navire
à double coque est constituée.
On peut classer les pétroliers de diverses
façons : soit selon leur taille, soit suivant le type de produits
qu'ils transportent.
Selon les produits transportés, on trouve :
· les transporteurs de brut, qui transportent le
pétrole brut des champs de production jusqu'aux raffineries, sur les
grandes distances. Ce sont très souvent de très grands navires,
dépassant 100 000 tonnes ;
· les transporteurs de produits raffinés, eux
transportent le pétrole sorti des raffineries jusqu'aux consommateurs.
Certains sont spécialisés dans le transport d'essences
« propres » (kérosène, lubrifiants) et
possèdent des pompes séparées suivant les
produits ;
· d'autres transportent les produits
« sales », comme les résidus du raffinage.
Par taille :
· les supertankers transportent les
produits
pétrolierssur de grandes distances ;
· les pétroliers classiques pour les moyennes
distances ;
· les ravitailleurs et navires d'allègement :
ils permettent de ravitailler les autres navires, ou d'alléger les
pétroliers trop gros pour arriver à un certain terminal ;
ils possèdent des équipements spéciaux permettant
l'amarrage à couple et le transfert de pétrole, certains sont
conçus pour s'approcher des plates-formes
pétrolières ;
· les pétroliers côtiers transportent
différents types de produits dans les estuaires et le long des
côtes ; ils doivent avoir des dimensions limitées et une
bonne manoeuvrabilité pour pouvoir se glisser dans les passages
étroits.
II.2 : Origines des
effluents à bord
Nombreuses sont les sources des déchets
souillés par les hydrocarbures et des effluents à bord.
II.2.1 Les résidus des
hydrocarbures sur les navires cargo
L'une des principales
sources de pollution opérationnelle de l'environnement fluvial ou
maritime par les navires est attribuée à ce jour aux machines de
propulsion situées dans la salle de machine, et s'applique à tous
les types de bateaux ou navires, car tous utilisateurs de carburant fuel. Elle
était occultée dans le passé par les rejets des navires de
transport de produits pétroliers, et surtout les gros pétroliers,
qui étaient amenés à manipuler dans les mêmes
citernes, et par les mêmes tuyaux, alternativement eau de mer et
pétrole, ceci pour permettre la gestion de ballast eau de mer dans
l'espace cargaison durant les voyages navire lège, le bon état de
navigabilité avec hélice de propulsion correctement
immergée. Cette gestion à bord est souvent
source de pollution de tous les navires sans exception. La plupart des
déchets d'hydrocarbures s'érigent dans les puisards ou bouchains
de la salle de machine.
Tableau1 : Quelques chiffres pour situer
l'ordre de grandeur de la consommation des navires ou bateaux en mazout.
|
Type de navire
|
Puissance moteur
|
Vitesse
|
Consommation journalière
|
Résidus générés
|
|
Cargo 20 000 t
|
7 500 ch
|
12 nds
|
20 tonnes/jour
|
0,25 m3/j
|
|
Gazier 35 000 m3
|
10 000 ch
|
17 nds
|
35 tonnes/jour
|
0,4 m3/j
|
|
Pétrolier 300 000 t
|
30 000 ch
|
15 nds
|
95 tonnes/jour
|
1 m3/j
|
|
Gros porte-conteneur
|
50 000 ch
|
25 nds
|
180 tonnes/jour
|
2m3/j
|
Source :
https://www.afcan.org/dossiers_techniques/gestion_dech_huileux2.html
Commentaire
En observant très bien ce tableau, il apparait que
selon le type de navire et cela par rapport à la puissance
délivrée par leurs moteurs, la consommation journalière
est très importante par conséquent les résidus
générés sont plus importantes.
II.2.2 Le chargement et
déchargement des pétroliers
Les opérations de chargements et déchargements
des hydrocarbures sont des manoeuvres complexes dans la mesure où elles
comportent pleins de risques notamment les cassures des pipelines
(oléoducs), le manque d'étanchéité des joints des
flexibles, l'électricité statique, les explosions, en somme tous
ces éléments peuvent faire l'objet d'une source de pollution
s'ils ne sont pas parfaitement évités ou contrôlés.
Les plus gros pollueurs par hydrocarbures se situent dans cette
catégorie des navires. La perte de la cargaison entraîne souvent
une catastrophe écologique ou marée noire insurmontable pendant
des longues années.
Image 3 : Station de chargement et
déchargement des hydrocarbures à Port-Gentil.
 
Source : Port-Gentil (Ancien port)
filmé par ObameNguemaA.
Commentaire
Dans l'image de gauche nous pouvons observer un
mélange de carburant et d'eau qui s'est accumulé au cours des
opérations chargements et déchargements, absolument à
éviter. A droite nous avons les pipelines qui acheminent les
différents produits vers les bateaux et barges, notamment l'essence par
le pipeline vert, le gasoil par le jaune et le pétrole par le noir.
II.2.3 Le nettoyage des
pétroliers
Le nettoyage des cales des navires transportant des
hydrocarbures ou des pétroliers utilisent certaines méthodes ou
techniques pour rendre propre leurs cales ou citernes ce qui engendre toujours
une certaine quantité d'effluent ou eau souillée.
Ø CrudeOilWashing (COW)
On nettoie le « crude » avec du
« crude », le « Crude » est un terme
utilisé pour du pétrole non traité et donc du brut qui
nous vient directement de la terre. L'action dissolvante du
« crude » permet d'avoir un processus de nettoyage bien
plus efficace que quand de l'eau est employée. Mais son
employabilité dans le processus de nettoyage des cales ou citernes fait
toujours l'objet d'une source potentielle d'effluents. Cette méthode
donne l'avantage à tout le monde, c'est du
« win-win », c'est-à-dire gagnant gagnant à
tous les intervenants et cela implique moins de pollution que lorsque le
nettoyage se faisait à l'eau douce ou de mer.
Image 4: schéma illustratif du COW
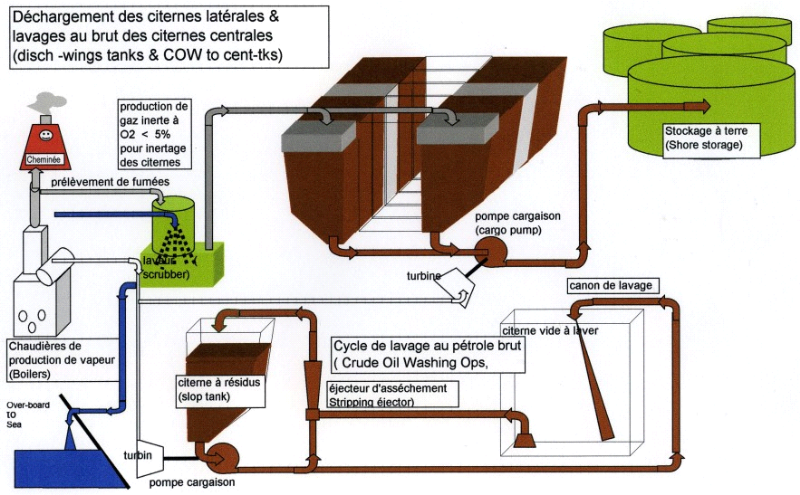
Source :
https://www.afcan.org/dossiers
Commentaire
Le présent schéma nous montre comment se
déroule le lavage d'une citerne avec le COW.
Ø Load on Top(LOT)18(*)
En 1960, la pollution concernait déjà plus les
gens, c'est pourquoi L'industrie rechercha des alternatives. La solution fut
trouvée et est connue comme (LOAD ON TOP).
On continuera à nettoyer à l'eau mais à
la place de pomper le mélange par-dessus bord on pompait pour aller dans
un (specialslop tank).Dans la citerne de slop l'eau et le pétrole furent
séparés, l'eau fut alors pompé par-dessus bord laissant
seulement le pétrole dans le tank. Dans le terminal de
déchargement le pétrole frais est alors charger au
TOP .C'est ce qu'on appelle le LOT (Load On Top).
II.2.4 Les réparations
ou nettoyages des machines
Lors des interventions des mécaniciens dans l'optiques
de réparer ou nettoyer certaines machines ou pièces, ils font
très souvent usage des produits pétroliers, tels que du
pétrole raffiné et de certains torchons (rags) dont l'utilisation
font l'objet des déchets souillés et donc encore une source de
pollution en cas de mauvaise gestion.
Image 5 : Déchets issus des
interventions mécaniques
 
Source : Station de chargement et
déchargement des hydrocarbures dans les barges de SOLEO à
l'ancien port de Port-Gentil, filmé par ObameNguemaA.
Commentaire
Après une réparation d'une bouche de connexion
des flexibles à gauche (image n°4) pour le chargement, nous pouvons
observer que des chiffons imbibés de gasoil trainent et comme autre
déchets des colliers de sécurité. A droite (image
n°5), suite à la réparation d'une motopompe (pour
déchargement) laisse paraitre des résidus de gasoil ce qui finit
en générale par-dessus bord en cas de pluie, de nettoyage du pont
à l'eau ou de déferlement des vagues sur le pont principal par
mauvais temps et finalement engendré une pollution. Apres avoir
exposé les sources potentielles des déchets souillés par
les hydrocarbures, nous expliquerons comment les traités.
II.3. Le traitement
Toute opération de gestions ou nettoyages des
déchets souillés par les hydrocarbures à bord vise, au
final, à traiter, recycler ou éliminer le déchet
souillé de manière efficace et écologique. Les options de
traitement et élimination sélectionnées dépendront
de la quantité et du déchet contaminé, de
considérations environnementales et juridique.
De plus le traitement des déchets constitue un ensemble
d'activités permettant de réduire la quantité de
déchets ou leur caractère dangereux, de les recycler ou
d'augmenter leur valeur en récupérant son énergie ou en
transformant en matériaux pouvant être utilisés de
façon productive.
Pour cela nous avons plusieurs méthodes ou techniques,
à savoir :
II.3.1 : La
décantation à bord
La décantation n'est rien d'autre que la
séparation de l'eau, de l'hydrocarbure et des solides.
Image 6 : schéma illustratif du
processus de la décantation.
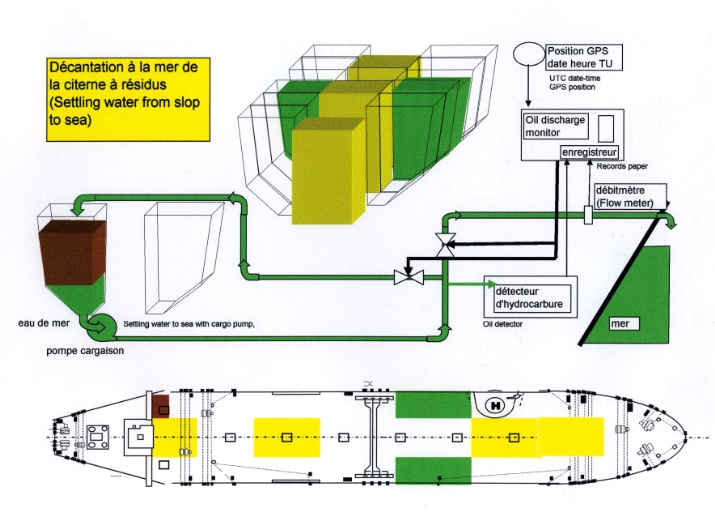
Source :
https://www.afcan.org/dossiers_techniques/gestion_dech_
Commentaire
Comme nous le remarquons très bien, le processus de
décantation consiste à dégager tous les résidus se
trouvant dans la soute du fuel oil pour les stockés dans la sludge tank
ou citerne de boue (déchets).
II.3.2 : La filtration
La filtration est un
procédé
de séparation permettant de séparer les constituants
d'un mélange qui possède une
phase
liquide et une
phase
solide au
travers d'un milieu
poreux.
L'utilisation d'un
filtre permet
de retenir les particules du
mélange
hétérogène qui sont plus grosses que les trous du
filtre (
porosité). Le
liquide ayant subi la filtration est
nommée filtrat ou perméat, tandis que la fraction
retenue par le filtre est
nommé résidu, rétentat ou gâteau.
L'équipement de surveillance des rejets
d'hydrocarbures « Oildischarge monitoring
equipment » (O.D.M.E) est basé sur une mesure de la
teneur en huile dans les eaux de ballast et de décantation, afin de
mesurer la conformité aux réglementations. L'appareil est
équipé d'un GPS, d'une fonctionnalité d'enregistrement de
données, d'un compteur de contenu d'huile et d'un
débitmètre. En utilisant l'interprétation des
données, une unité de calcul pourra permettre à la
décharge de continuer ou l'arrêtera à l'aide d'une valve
à l'extérieur du pont.
Image 7 :O.D.M.E

Source :
http://www.insatechmarine.com/products/emissions/odme
Commentaire
Sur cette image nous pouvons voir l'appareil qui permet de
relever les informations concernant le rejet des effluents à bord.
Principe de fonctionnement
Un point d'échantillonnage sur la conduite de
décharge permet à l'analyseur de déterminer la teneur en
huile du ballast et de décanter l'eau en PPM (Partie Par Million).
L'analyseur est auto-entretenu par des nettoyages périodiques à
l'eau douce, et nécessite donc un minimum de maintenance active de la
part de l'équipage. Les résultats de l'analyseur sont
envoyés à un ordinateur, qui détermine si les valeurs de
la teneur en huile doivent entraîner une décharge par-dessus bord
ou non. Les vannes qui dirigent l'eau de ballast soit par-dessus bord, soit
vers la citerne sont contrôlées par l'ordinateur
intégré, et un signal GPS automatise davantage le processus en
incluant des zones spéciales et complète l'entrée requise
pour le registre des hydrocarbures. Tous les pétroliers dont la jauge
brute est supérieure à 150 doivent avoir à bord des
équipements efficaces de surveillance des rejets d'hydrocarbures. La
décharge huileuse est envoyée en mer par une pompe. Le
mélange huileux doit traverser une série de capteurs pour
déterminer s'il est acceptable de l'envoyer au tuyau de décharge.
Sur la base des réglementations, les valeurs suivantes doivent
être enregistrées par le système:
Ø Date et heure de la décharge
Ø Emplacement du navire
Ø Teneur en huile de la décharge en ppm
Ø Quantité totale déchargée
Ø Taux de décharge
Image 8 : schéma
illustratif du fonctionnement de l'O.D.M.E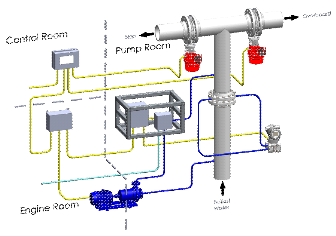
Source :
http://www.insatechmarine.com/products/emissions/odme
Commentaire
Ce dispositif est un système qui permet ou autorise le
rejet en mer des hydrocarbures grâce aux capteurs qui sont
programmés à 15 ppm, quantité autorisée par MARPOL,
sur une distance de 300 mètres lorsque le bateau est en marche, faisant
une vitesse minimum de 3 noeuds ou plus, c'est-à-dire que lorsque le
navire est stoppé ce rejet d'effluent ne pourrait pas être
effectué.
II.3.3 : La
centrifugation
La centrifugation est une opération de
séparation mécanique, par action de la force centrifuge, de deux
à trois phases entraînées dans un mouvement de rotation. On
peut séparer deux phases liquides, une phase solide en suspension dans
une phase liquide, voire deux phases liquides contenant une phase solide.
Une pompe centrifuge est une
machine rotative qui pompe un
liquide en le
forçant au travers d'une roue à aube ou d'une
hélice appelée
impulseur2 (souvent nommée improprement turbine). C'est le
type de pompe industrielle le plus commun. Par l'effet de la rotation de
l'impulseur, le fluide pompé est aspiré axialement dans la
pompe, puis
accéléré radialement, et enfin refoulé
tangentiellement.
Image9 : Pompe centrifuge

Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_centrifuge
Commentaire
Dans le cadre du traitement de déchets, elle est
utilisée afin de séparer les diverses phases en vue d'un
traitement spécifique. Par exemple, des boues humides ainsi
traitées donneront une phase liquide et des boues sèches qui
iront chacune sur une chaîne de traitement particulière
(épuration pour la phase aqueuses et valorisation pour les boues).
II.3.4. Le nettoyage des
citernes.
Hormis les citernes des produits liquides ou les cales
à marchandises, les pompes, les vannes, les bouchains et circuits
doivent être tous bien nettoyés pour éviter toute
contamination ou pollution avec la nature. Le nettoyage des produits
pétroliers déversés au niveau du pont principal ou dans la
salle des machines nécessite un kit des matériels assez
particulier qui sont:
ü Une raclette
ü Une brosse dure
ü Les détergents, dispersants
ü Sciure de bois
ü Le sac de sable
ü Les torchons
ü Un balai
ü Une petite pelle
ü Une pompe de boue (Slurrypump)
ü Une motopompe
ü De l'eau.
N.B. L'eau est utilisée avec la
machine automatique (butterworth), qui est directement incorporée dans
la cale et utilisée pour le nettoyage de ceux-ci. C'est alors
qu'intervient le rejet des effluents dont il est question.
II.3.5 : Le tri des
déchets à bord
En 1973, l'OMI a adopté la Convention internationale
pour la prévention de la pollution par les navires, désormais
connue dans le monde entier sous le nom de MARPOL, laquelle a été
modifiée par les Protocoles de 1978 et 1997 et actualisée par le
biais de divers amendements. La Convention MARPOL couvre une certaine
catégorie de déchets.
Tableau 2 : La classification des
déchets selon l'O.M.I
|
Catégories
|
Déchets
|
|
A
|
Plastique
|
|
B
|
Déchets alimentaires
|
|
C
|
Déchets domestiques
|
|
D
|
Huile de cuisine
|
|
E
|
Cendre de l'incinérateur
|
|
F
|
Déchets opérationnels
|
|
G
|
Résidus de cargaison
|
|
H
|
Carcasses d'animaux
|
|
I
|
Equipements de pêche
|
Source : Le navire SL PITONGA IMO :
9704245 Port-Gentil consulté le 22/08/2018 à
Port-gentil au Gabonà 11h08.
Commentaire
Dans ce tableau, nous avons les différentes
catégories des déchets que l'Organisation Maritime Internationale
contrôle régulièrement.
II.3.6 : Le criblage
Le criblage (ou tamisage) est l'opération qui permet de
sélectionner les grains et de séparer un ensemble de grains en au
moins deux sous-ensembles de granulométries différentes, le
crible ne laissant passer dans ses mailles que les éléments
inférieurs à une certaine taille.
Principe du fonctionnement du criblage
Le criblage est l'opération qui permet la
séparation granulométrique des éléments.
Autrement dit les éléments composant le
matériau à cribler sont séparés en deux
catégories :
· d'une part, ceux qui sont plus grands qu'une certaine
dimension,
· d'autre part, ceux qui sont plus petits.
Le plus souvent, le procédé consiste à
faire passer ou refuser les éléments par un orifice de dimension
donnée, qui est généralement de forme carrée.
Les éléments sont alors triés par rapport
à leur plus petite dimension.
II.4. Le traitement final
D'une part la spécification normalisée des
incinérateurs de bord porte sur la conception, la construction,
l'efficacité, le fonctionnement et les essais des incinérateurs
destinés à incinérer les ordures et autres déchets
produits à bord.
D'autre part évacuation des résidus à
terre, les résidus issus des filtrations (centrifugeuse,
séparateur) doivent être stockés dans une citerne à
résidus le « sloop tank ». Les ports devraient
permettre la vidange de ces citernes (MARPOL I/12). La quantité en
volume de résidus dont le navire souhaite se débarrasser doit
être signalée 24 heures avant son arrivée. Le Code des
Ports Maritimes prévoit l'immobilisation du navire s'il s'avère
qu'il ne dispose pas des capacités suffisantes pour tenir jusqu'au
prochain port d'escale. Ici il s'agit du garbagereceipt ou le reçu de
déversement des déchets domestiques au port est obligatoire et
restera comme une preuve irréfutable que ces ordures ont
réellement étaient jetées à terre dans les
installations appropriées et non par-dessus bord lors de la
traversée du bateau. Bien entendu ce reçu vous sera
délivré par l'officier de quarantaine du port dont il est
question.
II.4.1 Les zones des rejets
autorisées de déversement
Selon les recommandations de l'O.M.I., il est impératif
de suivre à la lettre les obligations imposées, respecter les
quantités des rejets autorisées dans les zones indiquées
et s'abstenir dans les « zones
spéciales »19(*). Cette interdiction implique donc des zones
dites spéciales où le déversement est formellement
interdit en mer tout comme sur les fleuves.
Les zones maritimes qui, pour des raisons techniques
liées à leur situation océanographique et
écologique, ainsi qu'au caractère particulier de leur trafic
maritime, appellent l'adoption de méthodes obligatoires
particulières pour prévenir la pollution des mers.
Conformément à cette Convention, ces zones spéciales
bénéficient d'un niveau accru de protection par rapport aux
autres zones maritimes.
Tableau 3:présentation des zones spéciales
maritimes.
|
Zones spéciales
|
Date d'adoption
|
Date d'entrée en vigueur
|
Date à laquelle les mesures ont pris
effet
|
|
Annexe I : Hydrocarbures ? ? ?
|
|
Zone de la mer Méditerranée
|
2 novembre 1973
|
2 octobre 1983
|
2 octobre 1983
|
|
Zone de la mer Baltique
|
2 novembre 1973
|
2 octobre 1983
|
2 octobre 1983
|
|
Zone de la mer Noire
|
2 novembre 1973
|
2 octobre 1983
|
2 octobre 1983
|
|
Zone de la mer Rouge
|
2 novembre 1973
|
2 octobre 1983
|
*
|
|
Zone des Golfes
|
2 novembre 1973
|
2 octobre 1983
|
1er août 2008
|
|
Zone du golfe d'Aden
|
1er décembre 1987
|
1er avril 1989
|
*
|
|
Zone de l'Antarctique
|
16 novembre 1990
|
17 mars 92
|
17 mars 1992
|
|
Eaux de l'Europe du Nord-Ouest
|
25 septembre 1997
|
1er février 1999
|
1er août 1999
|
|
Zone d'Oman de la mer d'Arabie
|
15 octobre 2004
|
1er janvier 2007
|
*
|
|
Eaux de la zone maritime méridionale de l'Afrique du
Sud
|
13 octobre 2006
|
1er mars 2008
|
1er août 2008
|
|
Annexe II : Substances liquides
nocives ? ? ?
|
|
Zone de l'Antarctique
|
30 octobre 1992
|
1er juillet 1994
|
1er juillet 1994
|
|
Annexe IV : Eaux usées ? ? ?
|
|
Zone de la mer Baltique
|
15 juillet 2011
|
1er janvier 2013
|
**
|
|
Annexe V : Ordures ? ? ?
|
|
Zone de la mer Méditerranée
|
2 novembre 1973
|
31 décembre 1988
|
1er mai 2009
|
|
Zone de la mer Baltique
|
2 novembre 1973
|
31 décembre 1988
|
1er octobre 1989
|
|
Zone de la mer Noire
|
2 novembre 1973
|
31 décembre 1988
|
*
|
|
Zone de la mer Rouge
|
2 novembre 1973
|
31 décembre 1988
|
*
|
|
Zone des Golfes
|
2 novembre 1973
|
31 décembre 1988
|
1er août 2008
|
|
Zone de la mer du Nord
|
17 octobre 1989
|
18 février 1991
|
18 février 1991
|
|
Zone de l'Antarctique (au sud de la latitude de 60° S)
|
16 novembre 1990
|
17 mars 1992
|
17 mars 1992
|
|
Région des Caraïbes, y compris le golfe du Mexique
et la mer des Caraïbes
|
4 juillet 1991
|
4 avril 1993
|
1er mai 2011
|
|
?Annexe VI : Prévention de la pollution de
l'atmosphère par les navires (zones de contrôle des
émissions) ? ? ?
|
|
Zone de la mer Baltique (SOx)
|
26 septembre 1997
|
19 mai 2005
|
19 mai 2006
|
|
Zone de la mer du Nord (SOx)
|
22 juillet 2005
|
22 novembre 2006
|
22 novembre 2007
|
|
Zone de l'Amérique du
Nord
(SOx et particules)
|
26 mars 2010
|
1er août 2011
|
1er août 2012
|
|
(NOx)
|
26 mars 2010
|
1er août 2011
|
***
|
|
Zone maritime caraïbe des
États-Unis
(SOx et particules)
|
26 juillet 2011
|
1er janvier 2013
|
1er janvier 2014
|
|
(NOx)
|
26 juillet 2011
|
1er janvier 2013
|
***
|
Source :
http://www.imo.org, consulté le
12/08/2018, à Port-Gentil, à 21h35.
Commentaire
Bien entendu il sied à préciser que les
déversements sur les fleuves du monde sont strictement interdits et
ceux-ci feront l'objet d'un procès-verbal au bateau. Tous les rejets
seront gardés à bord pour ensuite pouvoir être
transférer à l'arrivée aux installations
appropriées à terre (terminal pétrolier, camion-citerne,
poubelles, incinérateur).
II.5. Les conditions de rejets
des déchets d'hydrocarbures
MARPOL interdit tout rejet d'effluents dont la teneur en
hydrocarbures dépasse 15 ppm (0.0015%).les navires d'une jauge brute
supérieure à 400 doivent être équipés d'un
matériel de filtrage capable d'abaisser la teneur en effluent jusqu'au
chiffre requis, ceux de moins de 400 doivent pouvoir contenir les
résidus et pouvoir les décharger à quai, les navires d'une
jauge brute supérieure à 10.000 doivent en plus être munis
d'un dispositif d'alarme et d'un dispositif permettant l'arrêt
automatique du rejet (O.D.M.E) .Ces rejets sont normalement interdits dans les
zones dites « spéciales ». Ils ne doivent dans tous
les cas ne pas contenir ni de produit chimique, ni de substance dangereuse pour
le milieu marin.
Le rejet des eaux de nettoyage des hydrocarbures, ou des
effluents des citernes ne peuvent pas excéder 15 ppm pour 300
mètres de parcours20(*).' Le déversement des effluents doit passer
par le séparateur à mazout ou à huile qui va les traiter
avant de les rejeter par-dessus bord sur une distance ne dépassant pas
300 mètres pour une quantité de 15 parties par million. Cette
mesure est prise pour éviter les éjections des hydrocarbures ou
les eaux souillées de nettoyage des cales directement par-dessus bord.
Ainsi donc la pollution pourra être contrôlée.21(*)
NB : 15 ppm signifie : 15 parts
par million équivalent à 15 ml ou une cuillerée à
soupe par 1000 litres.
CHAPITRE III : LA
GESTION DES DECHETS SOUILLES PAR LES HYDROCARBURES EN MILIEU FLUVIAL
III.1. Etat des lieux du fleuve
Ogooué
Il faudrait des multiples efforts et la volonté humaine
pendant plusieurs décennies pour éradiquer la pollution
causée par les eaux souillées par les hydrocarbures.
Néanmoins, l'application stricte de cette réglementation suivie
des amendes aux différents navires polluants ne les empêchent pas
d'enfreindre ces règles écologiques.
Comme partout ailleurs, le problème de
déversement des déchets souillés par les hydrocarbures sur
le fleuve est à la base de plusieurs maux dans la vie courante.
L'Organisation Maritime Internationale dans sa branche de lutte contre la
pollution, prévoit des règles rigoureuses dans la matière.
Article 3 une règle 10 de la convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires.
Image 10 : Pollution sur les différents fleuves du
monde.

Source : www.lyc-ferry-conflans.ac-versailles.fr
Commentaire
Comme dans la plupart des fleuves du monde et en particulier
ceux d'Afrique, la pollution par les hydrocarbures entraîne une
destruction progressive de la faune et de la flore. En termes d'impact
environnemental, le principal impact des déchets marins consiste en
l'ingestion et l'étranglement de la faune marine et la
dégradation de l'écosystème au fil du temps.
III.2. La réglementation
des différents déchets dans le milieu fluvial au niveau de la
CEMAC
Comme le stipule le Code de la Navigation Intérieure
CEMAC/RDC22(*) en son
chapitre II sur la protection des eaux et élimination des déchets
provenant à bord des bâtiments en son article
125 : « Le capitaine, les autres membres d'équipage
et les autres personnes se trouvant à bord sont tenus de montrer toute
la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la
pollution de la voie d'eau et limiter au maximum la quantité de
déchets et d'eaux usées survenant à bord. »,
Ensuite l'article 126(a) : « Il est
interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à
partir des bâtiments des huiles usées, des eaux de fonds de
cales ; des graisses usées ou d'autres déchets huileux ou
graisseux ainsi que les slops, des ordures ménagères et d'autres
déchets spéciaux. »,
Enfin l'article 127 dit : «Le capitaine doit
assurer la collecte séparée à bord des déchets
visés au paragraphe a) de l'article 126 ci-dessus dans les
récipients prévus à cet effet et la collecte des eaux de
fonds de cale dans les fonds de cales des salles de machines. Les
récipients doivent être stockés à bord de telle
manière que toute fuite de marchandise puisse être facilement
constatée et empêchée à temps. ».Ainsi,
« les ruptures impriment leur marque au siècle qui
commence »23(*).
III.3. Les conventions
internationales MARPOL 1973/1978, SOLAS 1974 et OPRC.
Pour permettre aux
administrations internationales de procéder à la
vérification des bons usages en conformité aux règles de
prévention de la pollution par les hydrocarbures de l'environnement
maritime et fluvial, plusieurs documents sont mis à leur disposition
notamment la Convention internationale sur la préparation, la lutte et
la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
(OPRC :OilPreparedness, Response and Coopetation)24(*) sont tenues d'établir
des mesures pour faire face aux incidents de pollution, soit à
l'échelle nationale, soit en coopération avec d'autres
pays.
Les navires sont tenus d'avoir à bord un plan
d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures. Les exploitants
d'unités offshore relevant de la juridiction des parties sont
également tenus de disposer de plans d'urgence en cas de pollution par
les hydrocarbures ou d'arrangements similaires, qui doivent être
coordonnés avec les systèmes nationaux pour réagir
rapidement et efficacement aux impacts de pollution par les
hydrocarbures.
Ils sont tenus de signaler les incidents de pollution aux
autorités fluviales et la convention détaille les mesures
à prendre. La Convention appelle à la constitution de stocks
de matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures,
à la tenue d'exercices de lutte contre les déversements
d'hydrocarbures et à l'élaboration de plans
détaillés pour faire face aux impacts de pollution.
Le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la
coopération contre les événements de pollution par les
substances nocives et potentiellement dangereuses étend ce cadre
réglementaire aux événements de pollution mettant en cause
des substances nocives et potentiellement dangereuses, autrement dit des
produits chimiques.
L'Annexe I est entrée en vigueur en octobre 1983. Elle
concerne la prévention de la pollution par hydrocarbures et par rejets
accidentels.
? 1992 : amendement "double coque".
? 2001 : révision de l'amendement 1992 ;
? 2003 : révision de l'amendement 1992
Amendement 1992 : la double coque est obligatoire pour
les nouveaux navires pétroliers, et un planning est défini pour
les navires en service.
L'annexe V de la Convention Marpol, traitant des ordures et
déchets, est entrée en vigueur en 1988. Des amendements
adoptés en juillet 2011 sont rentrés en vigueur en janvier 2013.
Ces amendements apportent des changements significatifs pour le navire, aussi
pour le port d'escale. Ils sont également applicables aux plateformes
fixes.
Tout rejet à la mer est interdit sauf pour les
catégories spécifiquement autorisées dans certaines
circonstances (liste ad-hoc, qui inclut les restes de cargaison). Dans tous les
cas et, en particulier, pour les restes de cargaison ou les produits de
nettoyage, le rejet est seulement autorisé s'il n'est pas nocif pour
l'environnement, le capitaine ou armateur doit être en mesure de prouver
que
c'est le cas.
Tout navire de plus de 12 m devra afficher des consignes ad-hoc, dans la langue
de travail et aussi, si nécessaire en anglais, français et
espagnol pour l'équipage et les passagers dans une emplacements
adaptés. Changements dans la tenue du ½garbage record book½
(carnet des rejets des immondices), il devra être tenu sur tous les
navires de plus de 400 tonneau de jauge brut (tjb) ou ayant plus de 15
personnes à bord, indiquant tout mouvement de déchet (mer et
port). Tout navire de plus de 100 tjbou ayant plus de 15 personnes devra avoir,
par écrit, les procédures de réduction, collecte,
stockage, traitement, destruction des ordures, avec des précisions sur
l'utilisation des installations ou équipements de bord et
désignation des personnels en
charge.
Les rejets à
la mer de résidus solides putrescibles autorisés jusqu'à
présent à grande distance des côtes et en dehors de zones
spéciales sont interdits. La détention du navire est
prévue au cas où des manques dans les procédures seraient
détectés. De façon générale et dans tous les
cas, en cas de visite, au lieu d'être éventuellement
soupçonné puis convaincu d'infraction, le capitaine a,
maintenant, la charge de prouver qu'aucun rejet n'a été fait en
infraction ou n'était nocif pour l'environnement. Il est
bien indiqué que les ports devront s'adapter aux nouvelles règles
(installations de réception des déchets).
AMENDEMENTS A L'ANNEXE IV REVISEE DE MARPOL 73/78.
Après l'actuelle règle 12, ajouter un
nouveau chapitre V et une nouvelle règle 13, libellés comme suit
:
Chapitre V
Contrôle par l'Etat du port
Règle
13
Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port
1. Un navire qui se trouve dans un port ou dans un
terminal au large d'une autre Partie est soumis à une inspection
effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par
ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation
prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a des raisons
précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage
ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer
à bord pour prévenir la pollution par les eaux
usées.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 de la
présente règle, la Partie prend les dispositions
nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à
ce qu'il ait été remédié à la situation
conformément aux prescriptions de la présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle par
l'Etat du port qui sont prévues à l'article 5 de la
présente Convention s'appliquent dans le cas de la présente
règle.
4. Aucune disposition de la présente règle
ne doit être interprétée comme limitant les droits et
obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes
d'exploitation expressément prévues dans la présente
Convention.
III.3.1. Certificat
I.O.P.P.
Les navires pétroliers sont les plus grands pollueurs
de la planète, il aurait fallu imposer le certificat IOPP pour s'assurer
que le nettoyage(COW) et le déversement des produits souillés par
ces derniers ne se fera pas aux endroits interdits. Il sied de rappeler
qu'à partir de 1975, la construction de tous les bateaux transportant du
brut est assujettie à une réglementation rigoureuse en
matière de construction.
Le certificat international de la prévention de la
pollution des hydrocarbures (International Oil Pollution Prevention
certificat), ainsi délivré doit s'assurer que le COW
protège effectivement l'environnement marin. Le contrôle des
systèmes CrudeOilWashing lors des opérations de nettoyage des
citernes sont soumis aux spécifications de l'IMO comme le stipule
l'annexe I de Marpol.
Le certificat IOPP (1973) atteste de la conformité des
installations du navire avec les règles Marpol et reste valable cinq
ans. Il est issu, suite aux inspections en accord avec les prévisions de
la règle 4 de l'annexe I de Marpolapplicable à chaque
pétrolier supérieur ou égal à 150 GT (Gross
Tonnage) et à tout autre navire de plus de 400GT. Ce certificat à
une validité pendant des périodes bien précises
définies selon les audits effectués par les
sociétés de classifications. Les différentes inspections
varient selon le tableau ci-dessous.
Titre 4: Tableau des différentes inspections
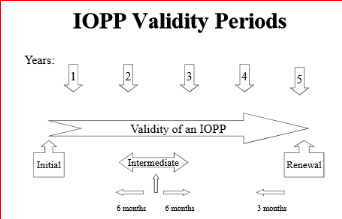
Source : MatongaSimoniniMarco, Chimie de transport, notes
de cours inédit, 1ère année commune, ERFMNI,
Kinshasa, 2016.
Commentaire :
? Inspection initiale : au début de la
construction du navire ;
? Inspection périodique : pendant les
périodes indiqués ;
? Inspections intermédiaires : 6 mois avant ou
après 21/2 années ;
? Inspections trimestrielles : après chaque
trimestre
? Inspection renouvelable : 3 mois avant l'expiration de
5 années du certificat IOPP.
III.4. Le déversement
des produits polluants
Le transport d'hydrocarbures par voies maritimes, fluviales et
lacustres et les pollutions qu'ils occasionnent occupent une place importante
à travers les fleuves, les mers et les océans du monde.
Cependant d'autres produits polluants ou déchets sont tout aussi
susceptibles d'être déversés en mer à l'instar des
matières plastiques selon toutes ses formes et tailles. Et celles-ci se
décomposent lentement dans le milieu marin, prenant plus de 400 ans.
Image 11: pollution par des matières
plastiques à travers nos fleuves dans le monde.

Source : www.lyc-ferry-conflans.ac-versailles.fr
Commentaire
A titre illustratif cette photo nous montre la grande
quantité des matières plastiques flottant en surface sur un
cours d'eau dans le monde. Ces matières non biodégradables, sont
d'une grande nuisance pour la santé.
Certaines rivières et fleuves d'Afrique, notamment le
fleuve Ogooué au Gabon ne fait pas exception à la
règle.
L'Organisation des Nations Unies en sigle « ONU/
Environnement »25(*) définit les déchets marins comme
« tous les matériaux solides persistants, manufacturés
ou traités, qui ont été rejetés,
évacués ou abandonnés dans le milieu marin et
côtier. » Les déchets marins se composent de divers
objets produits ou utilisés par l'homme et rejetés
intentionnellement dans la mer, dans les fleuves ou sur les plages. Ils peuvent
également atteindre la mer via les fleuves, les eaux usées,
les eaux de pluie ou les vents, être perdus accidentellement, comme par
exemple du matériel perdu en mer par mauvais temps (apparaux de
pêche, marchandises), ou laissés volontairement sur les
plages et sur les côtes. De plus « ONU
environnement » estime que 15 % des déchets marins flottent
à la surface des océans, que 15 % se trouvent dans la colonne
d'eau et que 70 % jonchent les fonds marins.
De même, en 2018, il a publié un rapport
intitulé «
Plastique
à usage unique : feuille de route pour la
durabilité »26(*). La pollution par les déchets plastiques est
un défi majeur de notre époque. Les plastiques à usage
unique, ou plastiques jetables, constituent en effet la principale source de
pollution. Chaque année, des millions de sacs plastiques finissent dans
l'environnement du fond marin, polluant ainsi les sols, les lacs, les fleuves
et les océans. C'est pourquoi« Il révèle
l'imagination et l'ingéniosité des hommes pour les transformer en
ressources utilitaires, artistiques ou ludiques, dans les contrées
industrielles ou dans les pays pauvres et émergents»27(*). Selon une autre
étude28(*) 5,25 millions de particules de
matière plastique, pesant 268 940 tonnes au total, flottent actuellement
à la surface des océans du monde.
Outre les problèmes environnementaux et sanitaires que
posent les déchets marins, les ordures et matières plastiques
flottantes constituent un problème à la fois coûteux et
dangereux pour le transport fluvial et maritime. Elles présentent
effectivement un risque et sont susceptibles de se prendre dans les
hélices ou les gouvernails des bateaux et navires.
Pour règlementer le problème des déchets
marins l'organisation maritime internationale (OMI) a été la
première à interdire tout rejet de matières plastiques en
mer il y a près de 30 ans. En effet, l'Annexe V de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL) interdit le rejet à la mer de tous les types déchets
sauf s'il est expressément autorisé en vertu de l'Annexe (les
déchets alimentaires, les résidus de cargaison, et les
agents/additifs de nettoyage qui ne sont pas nuisibles pour le milieu marin).
III.5. La pollution de
l'environnement.
Les déchets marins sont présents dans tous
les océans du monde, et pas seulement dans les régions
densément peuplées. On en retrouve ainsi dans des secteurs
éloignés de toutes activités humaines. Ces déchets
représentent un problème complexe qui a de fortes implications
pour l'environnement marin mais aussi côtier et pour les activités
humaines.29(*) Ce
problème vient non seulement d'une mauvaise gestion des déchets,
d'un manque d'infrastructures,du comportement irresponsable de l'homme et d'une
mauvaise compréhension des conséquences potentielles de ses
actions.
Les déchets marins ont de multiples incidences
négatives sur l'environnement, mais également sur
l'économie, la sécurité et la santé. La plupart des
déchets marins ont un très faible taux de décomposition,
conduisant à une accumulation progressive de déchets dans le
milieu marin.
Les déchets marins résultent du
déversement par l'homme, de manière accidentelle ou
intentionnelle à la mer. La majorité des déchets marins
proviennent de la marine marchande, des bateaux de croisières, des
navires de pêche, des bateaux de plaisance, des exploitations
pétrolières offshores, des plateformes de forages ainsi que des
installations aquacoles.
Des sources de déchets peuvent
également être d'origines côtières ou terrestres.
C'est le cas notamment des déchets présents sur les plages,
les quais, les ports, les marinas ou encore les berges. Mais ils peuvent
provenir également des déchets provenant de décharges
situées près des côtes, des déchets
présents dans les fleuves qui sont déversés à la
mer, du rejet des eaux usées non traitées, du tourisme
côtier. Enfin, on peut également citer le rejet d'importantes
quantités de matériaux à la mer lors
d'évènements climatiques exceptionnels tels que les inondations,
les ouragans ou encore les tsunamis.
L'accumulation de déchets
en mer et la dispersion de ses déchets sont fortement influencés
par les courants océaniques, les cycles de marées, la
topographie à l'échelle régionale et le
vent.
Ces déchets peuvent être notamment des
poubelles jetées au fleuve par les plaisanciers, des mégots des
cigarettes, du matériel de pêche (lignes, filets, fils,
hameçons, ...), des bouteilles, des couches pour bébés,
des piles, des pneus, des seringues, des sacs plastiques, emballages divers,
des vêtements, des canettes.
On ne cessera de le
répéter, en termes d'impact environnemental, le principal impact
des déchets marins consiste en l'ingestion et l'étranglement de
la faune marine. Cela provoque soit la mort directe de l'animal, soit une
mutilation de l'animal pouvant conduire à sa mort. Parmi les autres
menaces, on peut citer notamment l'étouffement des bons benthiques
(relatif aux grandes profondeurs ou fond des mers) par les déchets, la
perturbation des communautés benthiques lors de l'extraction de ces
déchets, le transport éventuel d'espèces envahissantes
entre les océans en utilisant les déchets. L'impact
peutêtre également le résultat d'une modification de la
qualité des eaux entraînant des conséquences pour la faune
et la flore marine. Les espèces animales concernées sont
notamment les
tortues marines, les oiseaux marins ou encore les
mammifères marins qui peuvent ingérer ces déchets
involontairement.
III.5.1. Notion de
pollution
On entend par pollution la dégradation
d'un
écosystème par
l'introduction, généralement humaine, de substances ou de
radiations altérant de manière plus ou moins importante le
fonctionnement de cet écosystème.30(*)
De cette définition on peut alors dire la pollution est
la dégradation d'un milieu naturel par des substances
extérieures, introduites de manière directe ou indirecte.
Demême le terme pollution désigne l'ensemble des rejets de de
composés toxique libéré par l'homme dans
l'atmosphère mais aussi les substances qui sans être vraiment
dangereuses dans l'immédiat pour l'organisme, elles exercent tout de
même une action perturbatrice pour l'environnement.
Les types de pollution :
· Pollution chimique : Dans le système
sol-eau, la pollution chimique se manifeste dans les opérations de
raffinage, de nettoyages, des exploitations pétrolières, des
accidents de transport des hydrocarbures, l'utilisation des pesticides,
fongicides et des détergents.
Dans l'air, le facteur atmosphériquetelque le vent qui
transporte plusieurs corps dont l'anhydride sulfureux (so2),
lefluor(F), l'oxyded'azote
(NO2 ,NO,N2O3 ,N2O5).
· Pollution biologique : ce sont toutes les
pollutions par matière organique susceptible de subir une fermentation
microbiennes (microbes).
· Pollution de l'eau : la plus part des fleuves sont
pollués du fait des activités de l'Homme.
· Pollution écosystème : un
écosystème devient pollué lorsque l'équilibre entre
les facteurs abiotiques et biotiques en interaction est brisé.
NB : on ne parle que de pollution si un
dommage d'ordre biologique apparait, de plus un changement de la faune et la
flore constitue un indice de pollution.
III.6. La gestion des
déchets souillés par les hydrocarbures
Pour une meilleure gestion des déchets souillés
par les hydrocarbures en milieu maritime et fluvial plusieurs mesures ont
été prises à l'instar de l'indice de conception
d'efficacité énergétique (EEDI)31(*)
L'EEDI (EnergyEfficiency Design Index) pour
les navires neufs est la mesure technique la plus importante et vise à
promouvoir l'utilisation d'équipements et de moteurs plus éco
énergétiques (moins polluants). « Mieux connaître
l'impact de ces catastrophes, leurs conséquences sur les
écosystèmes, mais aussi tirer les enseignements des
stratégies utilisées face à l'événement et
évaluer les dommages économiques
provoqués »32(*).L'EEDI exige un niveau d'efficacité
énergétique minimum par mile de capacité pour
différents types de navires et segments de taille. Depuis le 1er janvier
2013, après une phase zéro initiale de deux ans, la nouvelle
conception du navire doit respecter le niveau de référence pour
son type de bateau et navire. Le niveau doit être progressivement
renforcé tous les cinq ans. L'EEDI devrait donc stimuler l'innovation et
le développement technique continus de tous les composants
influençant l'efficacité énergétique d'un navire
dès sa phase de conception. L'EEDI est un mécanisme non normatif,
basé sur les performances, qui laisse le choix des technologies à
utiliser dans une conception de navire spécifique à l'industrie.
Tant que le niveau d'efficacité énergétique requis est
atteint, les concepteurs de navires et les constructeurs sont libres d'utiliser
les solutions les plus rentables pour que le navire se conforme à la
réglementation. L'EEDI fournit un chiffre spécifique pour chaque
modèle de navire, exprimé en grammes de dioxyde de carbone
(CO2) la capacité par mille du navire (plus l'indice EEDI est
petit, plus la conception du navire est économe en énergie).
Le CO2 au niveau de réduction (grammes de
CO2 par tonne-mile) pour la première phase est fixée
à 10% et sera resserrée tous les cinq ans afin de suivre le
rythme des développements technologiques de nouvelles mesures
d'efficacité et de réduction. Les taux de réduction ont
été établis jusqu'en 2025 et au-delà. Une
réduction de 30% est requise pour les types de navires concernés,
calculée à partir d'une ligne de référence
représentant l'efficacité moyenne des navires construits entre
2000 et 2010. L'indice EEDI est conçu pour les plus grands et les plus
énergivores. Segments de la flotte marchande mondiale et englobe les
émissions des navires neufs, couvrant les types de navires suivants:
navires citernes, vraquiers, transporteurs de gaz, navires de charge divers,
navires porte-conteneurs, transporteurs de fret réfrigéré
et transporteurs combinés. En 2014, le MEPC a adopté des
modifications du règlement EEDI visant à étendre le champ
d'application de l'EEDI, aux cargos rouliers (transporteurs de
véhicules), cargos rouliers; les navires rouliers à passagers et
les navires à passagers de croisière à propulsion non
conventionnelle. Ces modifications signifient que les types de navires
responsables d'environ 85% des émissions de CO2 Les
émissions des transports maritimes internationaux sont
incorporées dans le régime réglementaire international.
Depuis 2012, le Comité de la protection de
l'environnement marin (MEPC) a adopté / approuvé ou amendé
des directives importantes visant à faciliter la mise en oeuvre des
réglementations obligatoires33(*) relatives à l'efficacité
énergétique des navires dans l'annexe VI de MARPOL:
· Lignes directrices de 2014 sur l'étude et la
certification de l'indice de conception d'efficacité
énergétique (EEDI), telles que modifiées.
· Directives 2014 sur la méthode de calcul de
l'indice de conception d'efficacité énergétique atteint
pour les navires neufs, telle que modifiée.
· Lignes directrices de 2013 pour le calcul des lignes de
référence à utiliser avec l'indice de conception
d'efficacité énergétique (EEDI).
· Lignes directrices de 2013 pour le calcul des lignes de
référence à utiliser avec l'indice de conception
d'efficacité énergétique (EEDI) pour les navires à
passagers de croisière à propulsion non conventionnelle.
· Directives intérimaires de 2013 pour la
détermination de la puissance de propulsion minimale afin de maintenir
la manoeuvrabilité des navires dans des conditions défavorables,
telles que modifiées.
· Lignes directrices de 2016 pour l'élaboration
d'un plan de gestion de l'efficacité énergétique des
navires (SEEMP)33(*).
· En 2013 l'orientation sur le traitement des
technologies innovantes d'efficacité énergétique pour le
calcul et la vérification de l'indice EEDI obtenu.
Outre ses mesures, l'Annexe VI de MARPOL, adoptée pour
la première fois en 1997, limite les principaux polluants
atmosphériques contenus dans les gaz d'échappement des navires,
notamment les oxydes de soufre (SOx) et les oxydes nitreux
(NOx ), et interdit les émissions
délibérées de substances qui appauvrissent la couche
d'ozone (SACO). L'annexe VI de MARPOL réglemente également
l'incinération à bord des navires et les émissions de
composés organiques volatils (COV) des navires citernes. À la
suite de l'entrée en vigueur de l'Annexe VI de MARPOL le 19 mai 2005, le
Comité de la protection du milieu marin (MEPC) a décidé,
à sa 53e session (juillet 2005), de réviser l'Annexe VI de MARPOL
dans le but de renforcer sensiblement les limites d'émission compte tenu
des contraintes technologiques. Améliorations et expérience de
mise en oeuvre. À l'issue d'un examen qui a duré trois ans,
le MEPC 58 (octobre 2008) a adopté la version révisée de
l'Annexe VI de MARPOL et le code technique de 2008 sur
les NOx associé, qui sont entrés en
vigueur le 1er juillet 2010.
Les principales modifications apportées à
l'Annexe VI de MARPOL33(*)
concernent une réduction progressive des émissions de
SOx x , de
NOx x et de particules et l'introduction de
zones de contrôle des émissions afin de réduire davantage
les émissions de ces polluants atmosphériques dans des zones
maritimes désignées.
Conformément à l'annexe VI de MARPOL
révisée, le plafond mondial de soufre passera de 3,50% à
0,50% actuellement, à compter du 1er janvier 2020.
La MEPC 70 (octobre 2016) a examiné une
évaluation de la disponibilité du fioul pour informer la
décision des Parties à l'Annexe VI de MARPOL et a
décidé que la norme pour le fioul (limite de 0,50% de soufre)
entrerait en vigueur le 1er janvier 2020.
Les limites applicables aux
ZCE pour
les SOx et les particules ont été
réduites à 0,10% à compter du 1er janvier 2015.
Des révisions de la réglementation concernant
les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les composés
organiques volatils, l'incinération à bord des navires, les
installations de réception et la qualité du mazout ont
également été apportées, avec l'ajout d'une
réglementation sur la disponibilité du mazout.
Les mesures révisées devraient avoir un impact
bénéfique significatif sur l'environnement atmosphérique
et sur la santé humaine, en particulier pour les personnes vivant dans
les villes portuaires et les communautés fluviales et
côtières.
III.7. Impact sur
l'environnement dû à la mauvaise gestion.
Le transport maritime et fluvialachemine plus de 90%34(*) des marchandises dans le monde
et transporte plusieurs millions de personnes chaque année.
« Dans les entreprises, la qualité des produits, la
santé-sécurité des salariés, le respect de
l'environnement ne se décrètent pas, ne s'improvisent
pas »35(*). Mais
derrière l'image cultivée par les armateurs d'un mode de
transport propre, se cache une réalité beaucoup plus
nuancée. Gourmands en énergie, chacun de ces monstres flottants
génèrent autant de pollution aux particules ultra-fines qu'un
million de voitures. Peu connue du grand public, cette pollution porte atteinte
à la santé des habitants des villes portuaires.
· Deux polluants émis sont particulièrement
scrutés : l'oxyde de soufre (Sox) et l'oxyde d'azote
(NOx). Importants polluants de l'air, ils accélèrent
la formation de particules fines et ultra-fines. Les émissions de soufre
de ces transports à elles seules seraient responsables d'environ 50 000
morts prématurés par an et de
5 %
à 10 % des émissions mondiales. En
pénétrant dans les plus fines ramifications respiratoires, elles
peuvent entraîner une dégradation de la respiration, une
hyper-réactivité des bronches chez les asthmatiques ou encore une
augmentation de la sensibilité des bronches aux infections microbiennes
chez les enfants.
· Côté oxyde d'azote (NOx), le
transport maritime émet entre 17 et 31% des émissions mondiales.
Ce polluant irrite les voies respiratoires. Il est responsable de bronchites
aiguës, augmente le risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires
à court et long termes. Mais cet important danger pour la santé
publique n'est pas inéluctable.
· La pollution du sol par des substances chimiques nuit
à sa fertilité. Les contaminants peuvent perturber la croissance
des plantes. La consommation des récoltes contenant des polluants ou
l'ingestion directe de la terre contaminée constitue une sérieuse
menace pour la santé de l'homme et des animaux.
· La pollution de l'eau correspond
à la présence dans l'eau de minuscules organismes
extérieurs, de produits chimiques ou de déchets industriels.
Cette pollution ou contamination touche les eaux de surface des
océans, rivières, lacs et les eaux souterraines qui circulent
dans le sol.
À l'échelle de la planète, la
principale conséquence de la pollution de l'eau est une diminution de la
quantité et de la qualité de l'eau potable que les hommes
utilisent.
Titre 1 : La liste des pays les plus et
moins pollués aux particules fines au monde en PM2, 5
Commentaire : Plus de 80% des gens
vivant dans des zones urbaines où la pollution atmosphérique est
surveillée sont exposés à des niveaux de qualité de
l'air ne respectant pas les limites fixées par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). Si toutes les régions du monde sont
touchées, les habitants des villes à revenu faible sont ceux qui
en subissent le plus les conséquences (Norme OMS : 10
ug/m3).
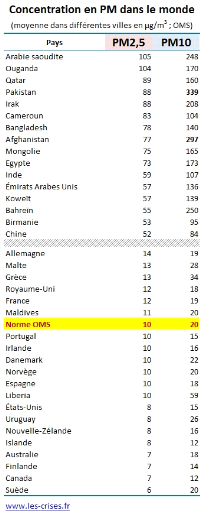
Source :
https://www.les-crises.fr/la-pollution-de-lair-dans-le-monde
III.8. Enjeux liés
à la bonne gestion des déchets souillés par des
hydrocarbures.
La raison majeure pour laquelle les navires polluent autant
est l'utilisation du fuel lourd comme carburant. Même à quai, le
transport maritime et fluvial brûle ce déchet non raffiné,
particulièrement polluant, afin d'alimenter en énergie les
navires. Pour répondre aux exigences de réduction des pollutions,
le gaz naturel liquéfié, aussi appelé GNL, est une
alternative intéressante. Sa combustion réduit de 100% les
émissions d'oxydes de soufre et des particules fines, de 80% des oxydes
d'azote et de 20% du CO2 par rapport au fuel lourd traditionnel.
Aujourd'hui, c'est le carburant carboné le plus efficace d'un point de
vue environnemental. Certains armateurs ont déjà
équipé leurs navires, un choix qui doit être
pérennisé et généralisé.
De plus, ces navires brûlent aujourd'hui du carburant
alors même qu'ils sont en stationnement, polluant alors l'air des
riverains du port. Les systèmes d'alimentation électrique
à quai permettraient d'éteindre leurs moteurs auxiliaires et
ainsi d'utiliser le réseau électrique auquel le port est
raccordé. Seuls les navires adaptés peuvent utiliser un tel
système, qui est actuellement très peu répandu dans le
monde.
De plus, le contrôle des émissions des navires
est un outil indispensable .Aujourd'hui, il existe seulement cinq(5) aires
géographiques dans le monde ou des contrôles sont trop rarement
effectués : La Manche, la zone mer Baltique et mer du Nord,
l'Amérique du Nord et la zone maritime caraïbe des Etats Unis. Ces
zones d'émission contrées(ECA) ou SECA(contrôle uniquement
du soufre) sont issues d'une annexe de la convention internationale MARPOL qui
fixe également des limites aux émissions d'oxyde
d'azote(NOx) et d'oxyde de soufre(SOx).Seulement,
même dans ces aires géographiques, sur 1000 navires en transit,
un seul est en moyenne contrôlé et s'il enfreint la loi, les
amendes s'avèrent peu dissuasives.
CONCLUSION
En somme, il était question dans notre étude, de
la « gestion des déchets souillés par les
hydrocarbures en milieu fluvial : cas du fleuve Ogooué au
Gabon »Pour cela, nous avons analysés trois(3) principaux
axes.
Ø Le premier nous a permis de clarifier les concepts
clés afin de faciliter la compréhension de notre sujet
d'étude.
Ø Le second, il était question de
présenter les sources des déchets souillés par les
hydrocarbures et les traitements envisageables pour ces déchets
à bord des navires.
Ø Enfin, le dernier qui était axé sur la
gestion des déchets souillés par les hydrocarbures en milieu
fluvial, notamment sur l'application de la réglementions en vigueur
à savoir le Code CEMAC/RDC, la Convention Marpol,
leProtocole OPRCafin de bien protéger l'environnement contre les
différentes de pollutions.
Ainsi, pour la réalisation de ce travail, nous avons
fait usage de trois méthodes notamment la méthode
déductive, la méthode analytique et la méthode
descriptive.
Et, à l'analyse des faits sur base de données
mises à notredisposition, nous sommes arrivés à des
résultats suivants qui semblent confirmé nos
hypothèses :
· les déchets souillés par les
hydrocarbures dans le fleuve OGOOUE auraient pour origine les activités
liées à l'exploitation des navires ;
· les déchets souillés par les
hydrocarbures seraient gérés efficacement afin de limiter
son impact négatif sur le fleuve OGOOUE en mettant en applications les
différentes lois soucieuses de l'environnement dans le monde et en
particulier dans la sous-région.
RECOMMANDATIONS
Généralement, toute étude scientifique
nécessite des suggestions dans l'optique d'apporter une
amélioration. Ainsi, nous recommandons à l'endroit des
différents acteurs ci-dessous.
1°Aux Etats membres de la CICOS :
Ø D'adopter ou d'actualiser régulièrement
des mesures visant à protéger l'environnement de manière
générale et particulièrement celui du milieu fluvial.
Ø A l'Etat Gabonais de prendre des mesures plus
protectionnistes du fleuve Ogooué et de son
écosystème.
2°Aux armateurs de la CICOS :
Ø Mettre leurs unités flottants ou bateaux en
conformité avec les technologiques de point en ce qui concerne la
gestion des déchets souillés par les hydrocarbures en milieu
fluvial.
Ø Utiliser les moteurs moins gourmands en hydrocarbure
pour limiter la pollution du fleuve Ogooué.
3°Aux navigants :
Ø D'être suffisamment qualifier ;
Ø Participer aux séances de formations et de
recyclages.
BIBLIOGRAPHIE
A. OUVRAGES
1.
BASTIEN. C., VENTURA.
M.
et
DUVAL.
J., Marées noires et environnement, éditions Institut
océanographique, Californie, 2005.
2.
FRESSOZ. B. et
BONNEUIL. C., L'Événement anthropocène,
éditions Points, Paris, 2013.
3.
LAGADEC. P., Ruptures créatrices, éditions d'organisation,
Paris, 2000.
4. MUDABA. Y., Histoire des hommes et de leurs ordure,
éditions Midi, Paris, 2009.
B. NOTES DE
COURS
1. MatongaSimonini Marco, Chimie de transport, notes de cours
inédit, 1ère année commune, de l'ERFMNI,
Kinshasa, 2016.
2. BulukuEkwakwaAlain, Ecologie et environnement, notes de
cours inédit,3èmeannée Capitaine, de l'ERFMNI,
Kinshasa,2018.
3. Bokembe Guy Gorge, Transport par bateau citerne, notes de
cours inédit,3eme année Capitaine, de l'ERFMNI,
Kinshasa, 2018.
4. NtsinguiDavid, Règlementation maritime
international, notes de cours inedit,3èmeannée
Capitaine, de l'ERFMNI, Kinshasa,2018.
C. WEBOGRAPHIE
1. http://www.imo.org, consulté le
12/08/2018, à Port-Gentil, à 20h54
2. https://www.webcroisieres.com,
consulté le 12/01/2018, à Kinshasa, à 19h05
https://cartebateau.com/fr/,
consulté le 1/01/2018, à Kinshasa, à 18h05
3. http://www.imo.org consulté le
07/10/2018, à Libreville, à 10h20
4. https://wedocs.unep.org ,
consulté le 06/10/2018, à Libreville, à 12h06.
5. https://www.dropbox.com
consulté le 06/10/2018, à Libreville, à 14h12.
6. http://journals.plos.org
consulté le 06/10/2018, à Libreville, à 12h30.
7.
http://www.conservation-nature.fr consulté le 08/10/2018, à
Libreville, à 08h30.
8. https://fr.wikipedia.org
consulté le 13/10/2018, à Libreville, à 15h28
9. http://www.imo.org consulté le
12/10/2018, à Libreville, à 17h03.
10. http://www.imo.org, consulté le
12/10/2018, à Libreville, à 00h00
1. https://www.fne.asso.fr"
https://www.les-crises.fr/la-pollution-de-lair-dans-le-monde
12.
https://www.fne.asso.fr, consulté le 17/10/2018, à
Libreville, à 09h10
13. www. Dictionnaires. Org, consulté le 02/05/2018,
à Kinshasa à 09h01
14. Le Petit Robert de la langue française 2014le
02/05/2018, à Kinshasa, à 09h25.
15. Www. Inc. Org, consulté le 02/05/2018, à
Kinshasa, à 09h28.
16. www.DicosEncarta.com, consulté le 03/05/2018,
à Kinshasa à 08h00.
17. www.DicosEncarta.com, consulté le 03/05/2018,
à Kinshasa à 08h05.
18. www.Wiktionnaire.com,
consulté le 03/05/2018, à Kinshasa, à 08h11
19.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballast_(marine), consulté le
19/10/2018, à Kinshasa, à 22h38.
20.
https://www.dictionnaire-environnement.com, consulté le 19/10/2018,
à Kinshasa, à 22h57.
21. https://www.dictionnaire-environnement.com,
consulté le 19/10/2018, à Kinshasa, à 22h30.
22.
https://www.dictionnaire-environnement.com, consulté le 19/10/2018,
à Kinshasa, à 21h20.
23.
https://www.larousse.fr/dictionnaires consulté le 19/10/18,
à Kinshasa, à 23h03.
24.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement consulté le 19/10/2018,
à Kinshasa, à 23h15.
25. https://fr.wikipedia.org
consulté le 19/10/18, à Kinshasa, à 21h30.
26.
https://www.futura-sciences.com consulté le 21/10/2018, à
Kinshasa à 10h10.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
1
DEDICACE
2
REMERCIEMENTS
3
RESUME
4
ABSTACT
5
LISTE DES ABREVIATIONS
6
INTRODUCTION
7
1.
Problématique.
7
2. Hypothèses
8
3. Objectifs du travail
8
3.1. Objectif
général
8
3.2. Objectifs
spécifiques
8
4. Méthodes et techniques de
recherches
9
6. Choix et intérêt du
sujet
9
7. Délimitation
spatio-temporelle
9
8. Difficultés
rencontrées
10
9. Canevas
10
CHAPITRE I : LA CARDE THEORIQUE ET
CONCEPTUEL.
11
I.1 Définitions des
concepts
11
I.2 : Les autres
définitions
12
I.3. Présentation du fleuve
Ogooué au Gabon
15
CHAPITRE II :
LA GESTION DES EFFLUENTS A BORD.
16
II.1 Historiques des bateaux transportant
des hydrocarbures
16
II.2 : Origines des effluents à
bord
19
II.2.1 Les résidus des hydrocarbures
sur les navires cargo
19
II.2.2 Le chargement et déchargement
des pétroliers
20
II.2.3 Le nettoyage des
pétroliers
21
II.2.4 Les réparations ou nettoyages
des machines
23
II.3. Le traitement
24
II.3.1 : La
décantation à bord
24
II.3.2 : La filtration
25
II.3.3 : La
centrifugation
28
II.3.4. Le nettoyage des
citernes.
29
II.3.5 : Le tri des déchets
à bord
29
II.3.6 : Le
criblage
30
II.4. Le traitement final
31
II.4.1 Les zones des rejets
autorisées de déversement
31
II.5. Les conditions de rejets des
déchets d'hydrocarbures
36
CHAPITRE III : LA GESTION DES DECHETS
SOUILLES PAR LES HYDROCARBURES EN MILIEU FLUVIAL
37
III.1. Etat des lieux du fleuve
Ogooué
37
III.2. La réglementation des
différents déchets dans le milieu fluvial au niveau de la
CEMAC
38
III.3. Les conventions internationales
MARPOL 1973/1978, SOLAS 1974 et OPRC.
39
III.3.1. Certificat I.O.P.P.
41
III.4. Le déversement des produits
polluants
42
III.5. La pollution de
l'environnement.
44
III.5.1. Notion de pollution
46
III.6. La gestion des déchets
souillés par les hydrocarbures
47
III.7. Impact sur l'environnement dû
à la mauvaise gestion.
49
III.8. Enjeux liés à la bonne
gestion des déchets souillés par des
hydrocarbures.
52
RECOMMANDATIONS
53
BIBLIOGRAPHIE
55
A.
OUVRAGES
55
B. NOTES DE
COURS
55
C.
WEBOGRAPHIE
55
* 1Www. Dictionnaires. Org,
consulté le 02/05/2018, à Kinshasa à 09h01.
* 2 Le Petit Robert de la langue
française 2014le 02/05/2018, à Kinshasa, à 09h25.
* 3Www. Inc. Org,
consulté le 02/05/2018, à Kinshasa, à 09h28.
* 4 www.DicosEncarta.com,
consulté le 03/05/2018, à Kinshasa à 08h00.
* 5 www.DicosEncarta.com,
consulté le 03/05/2018, à Kinshasa à 08h00.
* 6
www.Wiktionnaire.com, consulté
le 03/05/2018, à Kinshasa, à 08h11
* 7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballast_(marine),
consulté le 19/10/18, à Kinshasa, à 22h38.
* 8
https://www.dictionnaire-environnement.com,
consulté le 19/10/18, à Kinshasa, à 22h57.
*
9https://www.dictionnaire-environnement.com, consulté le
19/10/18, à Kinshasa, à 22h30.
* 10
https://www.dictionnaire-environnement.com,
consulté le 19/10/18, à Kinshasa, à 21h20.
* 11
https://www.larousse.fr/dictionnaires
consulté le 19/10/18, à Kinshasa, à 23h03.
* 12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
consulté le 19/10/18, à Kinshasa, à 23h15.
* 13
https://fr.wikipedia.org consulté
le 19/10/18, à Kinshasa, à 21h30.
* 14 Code de la Navigation
Intérieure CEMAC/RDC, TITRE VII DES DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ENVIRONNEMENT.
* 15 Code de la Navigation
Intérieure CEMAC/RDC, TITRE VII DES DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ENVIRONNEMENT.
* 16 Code de la Navigation
Intérieure CEMAC/RDC, TITRE VII DES DISPOSITIONS RELATIVES A
L'ENVIRONNEMENT, Chapitre I : Définitions, article 124 d), page 59,
consulté le 23/09/18 à Libreville-Gabonà 15h00.
* 17
https://www.futura-sciences.com
consulté le 21/10/2018, à Kinshasa à 10h10.
* 18Matonga Simonini Marco,
cours de chimie de transport, notes de cours inédit,
1ère année commune, du ERFMNI, Kinshasa, 2016,
consulté le 17/09 /2018 à Libreville à 10h56.
* 19
http://www.imo.org, consulté le
12/08/2018, à Port-Gentil, à 20h54.
* 20
https://www.webcroisieres.com,
consulté le 12/01/2018, à Kinshasa, à 19h05
* 21.
https://cartebateau.com/fr/,
consulté le 1/01/2018, à Kinshasa, à 18h05
* 22Code de la Navigation
Intérieure CEMAC/RDC, page 61, consulté le 23/09/2018, à
Libreville, à 14h08.
* 23
LAGADEC. P., Ruptures créatrices, éditions
d'organisation, Paris, 2000, p. 624.
* 24
http://www.imo.org consulté le
07/10/2018, à Libreville, à 10h20.
* 25
https://wedocs.unep.org , consulté
le 06/10/18, à Libreville, à 12h06.
* 26
https://www.dropbox.com consulté
le 06/10/18, à Libreville, à 14h12.
* 27MUDABA.
Y., Histoire des hommes et de leurs ordure, éditions Midi,
Paris, 2009, p. 346
* 28
http://journals.plos.org consulté
le 06/10/18, à Libreville, à 12h30.
* 29
http://www.conservation-nature.fr
consulté le 08/10/18, à Libreville, à 08h30.
* 30
https://fr.wikipedia.org consulté
le 13/10/18, à Libreville, à 15h28
* 31
http://www.imo.org consulté le
12/10/2018, à Libreville, à 17h03.
* 32
FRESSOZ. B. et
BONNEUIL. C., L'Événement anthropocène,
éditions Points, Paris, 2013, p.336.
* 33
http://www.imo.org, consulté le
12/10/2018, à Libreville, à 00h00
* 34
https://www.fne.asso.fr, consulté
le 17/10/2018, à Libreville, à 09h10.
* 35
BASTIEN.
C., VENTURA.
M.
et
DUVAL.
J., Marées noires et environnement, éditions Institut
océanographique, Californie, 2005, p. 407.
| 


