II.3.2.5 Critères de choix des macrophytes
Le choix du végétal à planter s'est
basé sur quatre critères importants : adaptation aux conditions
climatiques locales, vitesse de croissance rapide, facilité
d'exportation de la biomasse produite et un système racinaire important.
Comme il a été cité précédemment, la plante
testée est Pistia stratiotes. Environ soixante - quinze (75)
plantes ont été placées dans le bassin.
II.3.2.6 Critères de choix du substrat
Les matériaux choisis pour améliorer la
performance des filtres doivent être :
? suffisamment perméable pour éviter le colmatage
;
? économique ;
? écologique avec un potentiel d'impact mineur ou nul
sur l'environnement ? disponibles localement (dans l'ordre pour réduire
les coûts).
76
Et doivent avoir :
? une influence importante sur les taux d'élimination des
nutriments ; ? une surface importante de contact avec les polluants ;
? une bonne conductivité.
II.3.1 Echantillonnage
II.3.1.1 Fréquence
d'échantillonnage
L'échantillonnage a été de deux fois par
mois, entre les mois de septembre 2018 et Février 2019. Il se faisait
toujours pendant la même période de la journée
(Avant-midi). Pendant une période de six mois, nous avons analysé
48 échantillons venant du dispositif expérimental.
II.3.1.2 Lieu de prélèvement
Le prélèvement d'un échantillon d'eau est
une opération délicate à laquelle le plus grand soin doit
être apporté. Il conditionne les résultats analytiques et
l'interprétation qui en sera donnée. Le matériel de
prélèvement doit faire l'objet d'une attention
particulière (Rodier, 2009).
Quatre points ont été retenus pour le
prélèvement des échantillons ; l'entrée du pilote
expérimental planté des Pistia stratiotes et non
planté situé en amont et à la sortie du pilote
expérimental planté des Pistia stratiotes et non
planté situé en aval (photo II.2).
77
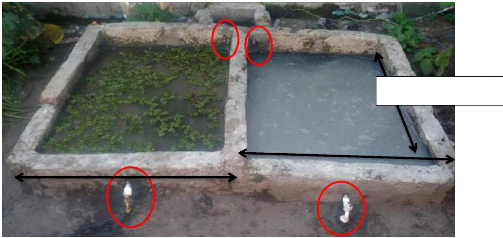
Largeur : 90 cm
Largeur : 90 cm
Longueur : 100 cm
Source : YANGONGO, 2018
Photos II.2 Pilote expérimental montrant le lieu de
prélèvement II.3.1.3 Transport et conservation des
échantillons
Les échantillons d'eaux usées ont
été recueillis dans des bouteilles en plastique de 1.500 ml
préalablement bien lavées et rincées trois fois avec de
l'eau à examiner. Elles étaient remplis jusqu'au bord.
Une fois les prélèvements effectués, les flacons
ont été étiquetés et conservés dans une
glacière à l'abri de la lumière et à une
température maintenue à 4°C conformément à la
norme AFNOR NF EN 25667 (ISO 5667). Cette norme précise la
méthode de prélèvement, les réactifs de fixation
à utiliser, les précautions à prendre lors du transport
des échantillons, etc.
Les échantillons doivent être analysés le
jour même, il est donc admis que le délai maximum entre le
prélèvement et le début de l'analyse ne doit pas
excéder 24 heures, aussi il est préférable de le
raccourcir lorsque l'eau est présumée être très
polluée (Rodier, 2009). Tout prélèvement doit être
accompagné d'une fiche de renseignement sur laquelle on note :
? Lieu de prélèvement,
? Date et heure de prélèvement,
? Etat de l'atmosphère.
78
Le bouchon est placé de telle manière à
ce qu'il n'y ait aucune bulle d'air et qu'il ne soit pas éjecté
au cours du transport. Pour les analyses bactériologiques, les
bouteilles utilisées assurent une fois bouchés une protection
totale contre toute contamination. Elles sont préalablement
stérilisées et protégées dans un emballage
plastique stérile. Les échantillons ont été
acheminés au laboratoire de la Direction d'Assainissement pour les
analyses physico-chimiques et au laboratoire de microbiologie de
l'Université de Kinshasa pour les analyses bactériologiques
où nous avons procédé immédiatement à leur
analyse, dans un délai qui n'excédait pas 24h.
II.3.1.4 Analyses au laboratoire
A l'instar des paramètres (température, pH,
conductivité, turbidité et l'oxygène dissous)
mesurés in situ, les analyses physico-chimiques (MES, Azote
total, Ammonium, Nitrite, Nitrate, DCO et DBO5) ont été
réalisées dans le laboratoire de chimie de la Direction
d'Assainissement de Kinshasa (DAS) et les analyses bactériologiques dans
le laboratoire de microbiologie de la faculté des sciences de
l'Université de Kinshasa. Ces analyses ont été
réalisées suivant différents protocoles reconnus à
chacun de paramètres retenus.
II.3.3 Méthodes d'analyses
Le fonctionnement du pilote expérimental a
été contrôlé par la mesure des paramètres
physico-chimiques et bactériologiques, les échantillons sont
prélevés à l'entrée et à la sortie du pilote
pour les paramètres à examiner au laboratoire et dans le pilote
pour les paramètres réalisés in-situ.
II.3.3.1 Détermination des paramètres
physico-chimiques
Les analyses physico-chimiques ont concerné les
paramètres suivants: Température, pH, Conductivité,
Turbidité, Oxygène dissous, MES, Azote total (NT), Ammonium
(NH4+), Nitrite (NO2 -), Nitrate (NO3 -), DCO et DBO5. Le tableau
II.2 met en évidence leurs méthodes d'analyses.
79
Tableau II.2. Paramètres physico-chimiques
|
N°
|
Paramètre
|
Unité
|
Méthodes de référence
|
|
1
|
Température (T°)
|
°C
|
Thermométrique : Sonde
multiparamètre type Combo Hanna HI 98130.
|
|
2
|
Potentiel
d'hydrogène (pH)
|
Unité
pH
|
Potentiométrie : Sonde multiparamètre type Combo
Hanna HI 98130.
|
|
3
|
Conductivité (CE)
|
ìS/cm
|
Potentiométrie : Sonde multiparamètre type Combo
Hanna HI 98130.
|
|
4
|
Turbidité
|
NTU
|
Electrométrique : Sonde
multiparamètre type Combo Hanna HI 98130.
|
|
5
|
Oxygène dissous
(OD)
|
mg
d'O2/l
|
Potentiométrique : Oxymètre
INOLABO-OXI 730 WTW
|
|
6
|
Matières en
Suspension (MES)
|
mg/l
|
Méthode gravimétrique. Filtration sur membrane
et séchage à l'étuve à 105°C et
pesée.
|
|
7
|
Azote total (NT)
|
mg/l
|
Méthode photométrique. Photomètre lovibond
MD 610
|
|
8
|
Ammonium (NH4 +)
|
mg/l
|
|
9
|
Nitrite (NO2-)
|
mg/l
|
|
10
|
Nitrate (NO3-)
|
mg/l
|
|
11
|
Demande Chimique en oxygène (DCO)
|
mg
d'O2/l
|
Est mesurée par Thermo-réacteur
lovibond RD 125. Par la méthode au bichromate de potassium
(K2Cr2O7)
|
|
12
|
Demande
Biologique en
Oxygène (DBO)
|
mg
d'O2/l
|
Méthode manométrique. Avec
OXITOP et une armoire
thermorégulatrice lovibond
OXIDirect
|
80
II.3.3.2 Méthodes d'analyses
bactériologiques
Cette classe des paramètres bactériologiques
comprend des genres et espèces dont la présence dans les eaux ne
constitue pas en elle-même un risque sur la santé des populations,
mais indique l'importance de la pollution biologique des eaux.
L'étude des paramètres bactériologiques a
porté sur les principaux indicateurs de la contamination fécale,
à savoir les coliformes totaux, les coliformes fécaux et les
streptocoques fécaux. Le dénombrement bactérien a
été effectué selon la méthode du NPP (le nombre le
plus probable) et ces résultats sont déterminés à
partir de la table de Mac Grady (Rejsek, 2002 ; Rodier, 2009).
Les différentes méthodes analytiques
utilisées pour la recherche des germes de pollution sont
représentées dans le tableau II.3.
Source : Dahel, 2009
81
Tableau II.3. Méthodes analytiques
utilisées pour la recherche des indicateurs bactériologiques de
pollution
|
N°
|
Germes
recherchés
|
Temps et
températures
d'incubation
|
Description de la méthode
|
Milieux de culture
|
Références
|
|
1
|
COLIFORMES
TOTAUX ET
FECAUX
|
37°C pendant 24h, en absence de résultats prolonger
à 48 h pour les 2 germes
24h à 37°C pour
les CT et 44 °C pour les CF.
|
Ensemencement en milieu liquide
|
Milieux présomptifs
? Milieux liquides de Bouillon Lactose
Bilié au Vert
Brillant (BLBVB). Selon Afnor NF T90-413.
Milieux confirmatifs
? Milieux liquides d'eau peptonée
exempte d'indole. Selon Afnor NF
T90-413.
|
Rodier,
2009 et
Rejsek,
2002
|
|
2
|
STREPTOCOQU
ES FECAUX
|
24h ou 48h à 37°C
24h à 37°C
|
Ensemencement en milieu liquide
|
Milieux présomptifs
? Milieu de Rothe selon Afnor NF T90-
411.
Milieux confirmatifs
? Milieu de Litsky (liquide) selon Afnor
NF T90-411.
|
Rejsek,
2002
|
82
II.3.3.2.1 Coliformes totaux et fécaux
Sous le terme de «coliformes» est regroupé un
certain nombre d'espèces bactériennes appartenant en fait
à la famille des Enterobacteriaceae. La définition suivante a
été adoptée par l'Organisation Internationale de
standardisation (ISO). Le terme «coliforme » correspond à des
organismes en bâtonnets, non sporogènes, gram négatifs,
oxydase négatifs, facultativement anaérobies, capables de
croître en présence de sels biliaires ou d'autres agents de
surface, possédant des activités inhibitrices de croissance
similaires, et capables de fermenter le lactose (et le mannitol) avec
production d'acide et d'aldéhyde en 48 heures, à des
températures de 35 à 37 °C.
Les coliformes sont intéressants car un très
grand nombre d'entre eux vivent en abondance dans les matières
fécales des animaux à sang chaud et de ce fait, constituent des
indicateurs fécaux de la première importance. Les coliformes
fécaux sont appelés aussi les coliformes thermo-tolérants,
ce sont des coliformes qui fermentent le lactose à 44°C.
Pour la détermination des coliformes totaux et
fécaux, on a utilisé
l'incubateur DNP- 9030A.
1° Recherche et dénombrement des Coliformes
totaux et fécaux
Conformément à la norme NF T90- 413, il consiste
à utiliser des milieux liquides de bouillon lactose bilié au vert
brillant (BLBVB), dans des tubes munis de cloches de Durham (figure II.13). La
présence des germes recherchés se traduit par :
? un virage de couleur dans toute la masse liquide.
? un dégagement de gaz dans les cloches.
83
1. Mode opératoire
La colimétrie comporte deux tests :
· un test présomptif et
· un test confirmatif.
Le dénombrement est effectué suivant la
méthode du nombre le
plus probable (NPP) de la table de Mac Grady (Annexe 1).
2. Test présomptif
Le mode opératoire consistait à :
· on prépare 3 séries de 3 tubes chacun
contenant 9 ml de bouillon lactose bilié au vert brillant (BLBVB) simple
concentration, munis de cloches de Durham ;
· chacun des 3 tubes de la première série
reçoit 1 ml de la dilution 100 (solution mère) ;
· les tubes de la deuxième et troisième
série reçoivent respectivement 1 ml de la dilution
10-1 et 1 ml de la dilution 10-2 ;
· agiter pour homogénéiser, sans faire
pénétrer l'air dans la cloche de Durham ;
· l'ensemble des tubes ainsi préparés est
incubé à 37° C pendant 24 h;
· observer d'abord le changement de couleur ou non dans
les tubes ;
· observer ensuite le trouble dans le milieu, dû
à la croissance des bactéries présentes ;
· observer enfin la production de gaz traduite par le
soulèvement de la cloche de Durham introduit dans le milieu (au moins
1/10 de la cloche devra être vide) ;
· procéder à la lecture, après le
temps d'incubation, en considérant comme « positif » tous les
tubes ayant présenté d'abord un trouble du à une
croissance microbienne.
84
Remarque : Cette phase de la
colimétrie se base sur la propriété commune des
Coliformes à fermenter le lactose tout en produisant du gaz ;
elle ne permet que de présumer de la présence des coliformes dans
l'eau à analyser. De ce fait, l'application du test confirmatif
s'impose.
Test confirmatif
Les tubes positifs présentent un virage de couleur
ainsi qu'un dégagement de gaz dans la cloche de Durham ; ces derniers
sont réensemencés dans des tubes d'eau peptonée exempte
d'indole (épreuve Deikman). Pour cela nous prélevons 2 à 3
gouttes que nous rajoutons dans des tubes contenant de l'eau peptonée
exempte d'indole. Les tubes sont refermés et incubés à
37°C pour les coliformes totaux et 44 °C pour les CF.
3. Expression des résultats
Le mode opératoire consistait à :
? formation d'anneau rouge à la surface des tubes d'eau
peptonée après addition de 2 à 3 gouttes du réactif
de Kovacs témoignant de la production d'indole par E. coui,
suite à la dégradation du Tryptophane grâce à
la Tryptophanase.
? production de gaz dans les cloches des tubes de BLBVB
? nous notons le nombre de tubes positifs et nous exprimons le
nombre le plus probable de germes dans 100 ml d'échantillon d'eau, selon
la table de Mac Grady (annexe 1).
85
II.3.3.2.2 Streptocoques fécaux
Conformément à la norme NF T 90-411, le principe
se résume à la recherche et au dénombrement des
Streptocoques en milieu liquide. Alors que les tubes primaires contiennent
déjà une certaine quantité d'azide de sodium (milieu de
Rothe), le repiquage des tubes positifs se fait sur un milieu nettement
inhibiteur avec une concentration plus élevée en azide de sodium
et de cristaux violets (milieu Litsky), ne laissant se développer que
les Streptocoques ou Entérocoques.
Les streptocoques fécaux sont des bactéries
à Gram-, sphériques à ovoïde formant des chainettes,
non sporulées, se cultivant en anaérobiose à 44°C et
à pH 9,6. La recherche de streptocoques fécaux ne doit être
considérée que comme un complément à celle des
coliformes thermo-tolérants pour être le signe d'une contamination
fécale.
1. Test présomptif
o Conformément à la norme NF T 90-411, nous
avons ensemencé 3 séries de 3 tubes contenant 9ml de bouillon de
Rothe simple concentration (figure II.14) :
? Une 1ère série de 3 tubes avec 1ml
d'eau à analyser de dilution mère (100) ;
? Une 2ème série de 3 tubes avec 1ml de
la deuxième dilution (10-1) ; ? Une 3ème
série de 3 tubes avec 1ml de la troisième dilution
(10-2).
o Nous homogénéisons par agitation du contenu
des tubes de façon à ce que les bactéries et la
concentration en inhibiteurs soient identiques en tout point ;
o Nous incubons les tubes pendant 24 à 48h à
37° C ;
o Les tubes présentant un trouble bactérien
sont présumés contenir des streptocoques et sont soumis à
un test confirmatif.
86
2. Test confirmatif
Après agitation des tubes positifs nous
prélevons 2 à 3 gouttes de chaque tube positif, et nous les
repiquons dans un tube contenant du milieu Litsky; nous incubons à
37°C pendant 24 à 48 h. Nous notons le nombre de tubes positifs et
nous exprimons le nombre le plus probable de germes dans l'échantillon
selon la table de Mac Grady (annexe 1).
II.3.3.2.3 Techniques de quantification
bactérienne
Le calcul du nombre le plus probable de germes est
effectué en se rapportant à la table de Mac Grady (Annexe 1).
? Cas de l'inoculation de chaque dilution d'eau dans 3
séries de 3 tubes de milieu de culture :
Tableau II.4. Calcul du nombre le plus probable
de germes
Tube N°
|
Dilutions
|
|
10-1
|
10-2
|
10-3
|
1
|
+
|
+
|
-
|
2
|
+
|
+
|
-
|
3
|
+
|
+
|
-
|
Résultat
|
3
|
3
|
0
|
|
Source : Dahel, 2009
Légende : (+) : Tube positif, (-)
: Tube négatif.
? Si nous avons 3 tubes positifs dans la première
série 1/10 et 3 tubes positifs dans la deuxième série
1/100, et aucun tube positif dans la troisième 1/1000, alors nous lisons
"3.3.0".
? D'après la table de Mac Grady (annexe 1), "330"
correspond à 240 germes /100ml d'eau (Tableau II.4).
87
II.3.3.3 Analyse statistique
Les résultats obtenus ont fait l'objet d'un traitement
informatique dans le but de garantir leur fiabilité. Les calculs des
moyennes, et des écart-types ont été possible grâce
au logiciel Excel, tandis que les analyses de la variance et la comparaison des
différentes moyennes (ppds) ont été effectuées avec
le logiciel Statistix 8.0.
I II.3.3.4 Eléments de calcul
Pour faire une lecture générale des tendances
évolutives des concentrations des différents paramètres
(Température, pH, Conductivité, Turbidité, oxygène
dissous, MES, Azote total (NT), Ammonium (NH4 +), Nitrite (NO2-),
Nitrate (NO3-), DCO et DBO5) Nous avons procédé aux
tracés de leur évolution en fonction du temps pour
l'entrée et la sortie du pilote expérimental.
Les performances épuratoires ont été
appréciées sur base des abattements des différents
paramètres entre l'entrée et la sortie du pilote. Les abattements
ont été calculés selon les formules suivantes :
? Abattement physico-chimique (%) = CE - CS x
100
CE
o CE : Concentration moyenne de pollution
à l'entrée du pilote expérimental ;
o CS : Concentration moyenne de pollution
à la sortie du pilote expérimental.
? Abattement bactériologique (%) = 1-(NgS/NgE) x
100
o Ngs : Nombre moyen des germes à la
sortie ;
o NgE : Nombre moyen des germes à
l'entrée.
88
| 

