INTRODUCTION
0.1
PROBLEMATIQUE
La situation prévalant en
RépubliqueDémocratique du Congo semble ainsi trouver une
explication dans le fait de la guerre. Mais même quelques années
au-par-avant, (un peu moins de 10 ans) avant que la guerre n'intervienne, le
second9 écrivait :« Famine, maladie, sous-emploi, sans emploi,
impayées, paupérisation, exclusion sociale... telles sont les
caractéristiques de la vie de la majeure partie de la population
Congolaise et Matadienne en particulier tout le monde est d'avis que la
misère qui frappe la population Matadienne dépasse les limites du
tolérable. En dépit du fait qu'il soit parmi les pays les plus
riches d'Afrique quant aux richesses du sol, du sous-sol et humaines, le Congo
occupe actuellement l'une des dernières places au monde quant à
son P.N.B. et son niveau de vie réel.»
Cependant, en observant le vécu du Congolais au
quotidien, on peut se rendre compte que le Congo présente un scandale
dans plusieurs secteurs. A titre exemplatif, nous pouvons citer l'agriculture,
singulièrement les cultures fruitières menées à
travers tout le pays sans pouvoir être acheminées dans de bonnes
conditions et à temps vers le consommateur.
Malgré la diversité des
cultures fruitières que l'on retrouve ici et là dans le
pays, la consommation des fruits ne semble pas faire partie des habitudes
alimentaires. Ce qui explique que sur les marchés comme sur les routes,
les fruits pourrissent. Pourtant ces diverses cultures fruitières
devraient offrir une opportunité pour l'essor d'une industrie de
transformation des fruits en confitures ou en jus.
Il est encore un scandale, lorsqu'on regarde le dynamisme dont
fait preuve le les Congolais dans sa lutte aux multiples acrobaties pour la
survie. Dans sa lutte pour la survie, en effet, il exerce telle ou telle autre
activité aussi bien dans le domaine de la transformation, du commerce
que celui des services juste pour êtremême de faire face aux
problèmes qui se posent quotidiennement sans aucune vision de long
terme.
Non seulement l'amélioration ou la modernisation de son
outil de travail n'est pas son affaire, mais encore il opère dans
l'informel depuis 10, 20, 30 ans ou toute sa vie. Partant de tout ce qui
précède, la question fondamentale à laquelle notre
étude voudrait répondre peut être formulée comme
suit :
Les PME et PMI de la ville de Matadi contribuent-elles
à la lutte contre la pauvreté et du chômage ?
0.2 HYPOTHESES DU
TRAVAIL
Ici, nous voulons apporter deréponse tout à la
fois anticipative et provisoire à la question posée ci-haut.
Nous ne pouvons pas douter que les actions de
PME et PMI débouchent sur une
prolifération des activités génératrices des
revenus à travers la ville de Matadi et donc, qu'elles peuvent avoir une
influence sur la réduction de la pauvreté et du chômage.
0.3 CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Choix : Le sujet d'un travail de fin de
cycle revêt une importance capitale d'où il ne peut pas être
choisi au hasard ou de manière fantaisiste. Il doit compter de
l'intérêtqu'il présente, car à la fin d'un cycle
supérieur et universitaire, l'étudiant est obligé de
traiter un sujet qui sera pour lui l'objet de recherche, afin d'obtenir un
titre Académie.
Intérêt : Tout travail
scientifique suscite un double intérêt : l'une scientifique
et l'autre pratique. Sur le plan scientifique, ce travail aidera tout chercheur
à traiter un sujet similaire, d'avoir les données qui l'aideras
à bien effecteur ses recherches et d'éveiller la conscience de
futur chercheur dans ce domaine.
0.4 METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
- Méthode
A l'égard de Pinto. R, et. M, GRAWITZ,
la méthode est un ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité
qu'elle poursuit, la démontre et la vérifier. Elle est, pour nous
une aptitude concrète vis-à-vis de l'objet ou une voie abstraite
pour arriver à atteindre notre objectif.
Tout au long de ce travail nous évoquerons les
méthodes suivantes :
v Méthode déductive
Elle procède du général au particulier,
elle part de principes généraux dont l'exactitude a
été démontrée.
v Méthode Analytique
Elle est définie comme étant la
détermination d'un travail tout en ses parties. Elle nous permettra de
comprendre et de savoir la nature de nos données.
v Méthode statistique
C'est une science à part entière, mais elle est
utilisée comme méthode en sciences économique pour
quantifier les données, à les analyser et à les
interpréter.
Elle nous servira lors de la récolte des données
chiffrées de les interpréter au cours de notre période
d'étude.
- Technique
C'est un outil de recherche permettant de recueillir les
données nécessaires ou un moyen permettant au chercheur
d'acquérir, de servir, d'appréhender et de traiter les
données dont il a besoin pour comprendre ou expliquer un
phénomène au sujet d'étude.
v Technique documentaire
Elle est basée sur l'étude des documents
écrits cela à travers les ouvrages, les articles, les revues, les
mémoires et les notes des cours nécessaire à notre
travail.
v Technique d'Interview
C'est une technique qui consiste d'interroger les individus
par jeu des questions verbales ou écrites. Posées aux
responsables et aux cadres de PME et PMI de la ville de Matadi. Elle nous
facilite la récolte de données et des éléments
ayant trait à notre Travail.
v Observation directe
Une technique qui consiste à descendre sur le lieu de
recherche qui est les PME et PMI de la ville
de Matadi. Elle nous donne l'occasion de palper la réalité sur
terrain et de recueillir des informations dont nous avons besoin.
0.5 DELIMITATION DU
SUJET
Notre travail est limité dans le temps et dans
l'espace. Pour ce qui est de la délimitation temporelle, nous avons
retenu la période allant de 2016 à 2019.
Quant à la délimitation spatiale, nous allons
nous intéresser sur quelques PME et
PMI de la ville Matadi.
0.6 SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail s'articule autour de Trois chapitres, à savoir :
- Le premier chapitre porte sur les
généralités conceptuelles ;
- Le deuxième chapitre parlerade la
présentation du cadre d'étude ;
- Le troisième chapitrebasera sur l'apport des
PME dans la réduction du chômage et de la pauvreté dans la
ville de Matadi.
Chapitre I.APPROCHE
CONCEPTUELLE ET THEORIQUE
I.1L'ENTREPRENEURIAT
I.1.1 Définition de
l'Entrepreneuriat
L'entrepreneuriat, c'est l'action humaine, soutenue par le milieu
environnant, générant de la valeur sur le marché par la
création ou le développement d'une activité
économique, évoluant avec cette valeur pour finalement affecter
l'économie, et ce, dans le but de mieux répondre aux besoins
individuels et collectifs d'un territoire.
Cette définition
comporte des éléments qui méritent d'être
expliqués à leur tour pour permettre à tout lecteur
d'être bien cerner la réalité dont il est question
:
· L'entrepreneuriat est une action humaine ;
· Cette
action humaine est et doit être soutenue par le milieu environnant
;
· Cette action humaine crée de la valeur par la
création ou le développement d'une activité
économique ;
· Avec cette valeur, cette action affecte
l'économie ;
· Cette action humaine répond et doit
répondre aux besoins individuels et collectifs d'un
territoire.
I.1.2L'entrepreneur
Puisque l'entrepreneuriat est une action humaine, il n'y a
donc pas d'entreprise sans l'homme. Cet homme,c'est l'entrepreneur.
Parmi les différentes acceptions que les dictionnaires
réservent au concept d'entrepreneur, on peut noter celle de chef
d'entreprise, ou encore celle d'une personne qui se charge de
l'exécution d'un travail, ou bien encore celle d'une personne qui dirige
une entreprise pour son compte.
· Modèles d'entrepreneur
On peut distinguer trois modèles d'entrepreneurs, à
savoir : l'entrepreneur inventeur ; l'entrepreneur
artisan et l'entrepreneur manager.
~
L'entrepreneur inventeur est celui qui veut vivre de son
invention, de sa découverte, de sa mise au point. Son approche
procède souvent d'une conviction indéfectible quant à
l'importance de sa découverte. Ce n'est pas le lucre qu'il vise en
premier, mais son souci premier est qu'on reconnaisse son
génie.
~ L'entrepreneur artisan part d'une
maîtrise, d'un savoir-faire manuel ou intellectuel et met ce savoir-faire
à la disposition de tiers. Ce qui préside à la
création d'une activité nouvelle, c'est la conviction qu'une
certaine manière de faire, que la maîtrise acquise dans un domaine
permet de s'affranchir d'un lien de subordination pour devenir son propre
patron.
~ L'entrepreneur manager quant à lui, a
vocation de développer sans cesse l'entreprise qu'il a
créée. Il a vécu diverses expériences
professionnelles et sait ce qu'est une entreprise.
Il connaît la plus part des notions qui constituent les
thèmes de management, même si les concepts ne sont pas toujours
bien assimilés. Comme une locomotive, il tire son entreprise et
l'entraîne toujours plus loin.
Il est intéressé plus par l'action (diriger,
gérer) que par les produits ou les marchés qui sont l'objet de
son action.
Remarque
Il y a des entrepreneurs qui ne sont ni inventeurs, ni
artisans et ni managers, mais appartiennent à un modèle mixte.
I.1.3L'environnement
Le terme environnement a plusieurs acceptions qui varient
avec le contexte et les grilles de lecture qu'on lui applique. Les
dictionnaires sont imprécis à son sujet, et on peut en tirer ce
qui suit : « conditions extérieures susceptibles d'agir
sur le fonctionnement d'un système, d'une entreprise, de
l'économie nationale» ; ou encore « ensemble des
éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie
d'un individu».
· Les caractéristiques de l'environnement
organisationnel
la stabilité ; la complexité ; la diversité
des marchés et l'hostilité.
1) La stabilité, L'environnement d'une
organisation peut aller du plus stable au plus dynamique. Comme le soutient
MINZBERG, un environnement stable est celui dans lequel une organisation peut
prédire les conditions dans lesquelles elle se trouvera ; donc, toutes
choses étant égales par ailleurs, elle peut isoler son centre
opérationnel et en standardiser les activités (établir des
règles, formaliser le travail, planifier les actions) ou peut-être
standardisant les qualifications.
2) La complexité, L'environnement
peut également aller du plus simple au plus complexe. Il est simple
lorsque le savoir requis peut être rationalisé,
décomposé en éléments compréhensibles. Il
est complexe s'il exige de l'organisation la possession d'un savoir
étendu et difficile sur les produits, les clients,... La
complexité de l'environnement entraîne la décentralisation
de la structure.
3) La diversité des
marchés, Elle est fonction du nombre et de la
variété des clients, des produits, des régions, des
marchés auxquels l'entreprise s'adresse. Les marchés peuvent
aller du plus intégrés aux plus diversifiés. La
diversité des marchés amène l'entreprise à
identifier les segments homogènes et à créer dans leur
structure des unités spécialisées pour traiter chacun
d'eux.
4) L'hostilité, Défini à la
fois par la vivacité de la concurrence, la rareté des ressources
disponibles, les relations de l'organisation avec les syndicats, les
gouvernements,... l'environnement de l'entreprise peut aller du plus
accueillant au plus hostile. La variable hostilité affecte la structure
de l'entreprise d'une manière particulière par l'entremise de la
vitesse de réponse : les environnements hostiles exigent des
réactions rapides de la part des entreprises.
I.1.4. La création de la
valeur
Parmi les grandes approches conceptuelles
identifiées par les chercheurs pour cerner le phénomène
complexe de l'entrepreneuriat dans sa globalité il y a la conception de
dialogique individu/création de valeur que BRUYAT définit comme
une dynamique de changement où l'individu est à la fois acteur de
la création de valeur dont il détermine les modalités et
objet de création de valeur, qui par l'intermédiaire de son
support (projet, structure, etc) l'investit voire le détermine.
Pour FAYOL, s'inscrivant clairement dans cette approche,
l'entrepreneuriat est une situation reliant de façon concomitante, un
individu caractérisé par un engagement personnel fort
(consommation de temps, argent, énergie, etc.) et un projet ou une
organisation émergente ou une organisation
« stabilisée» de type entrepreneurial.
La valeur créée renvoie aux apports techniques, financiers et
personnels que génère l'organisation impulsée et qui
procure satisfaction à l'entrepreneur et aux parties prenantes ou
intéressées.
Pour l'entrepreneur il peut s'agir de biens financiers et
matériels mais aussi d'autonomie, voire d'un ensemble des mobiles
irrationnels tels que le pouvoir, l'estime de soi, le goût sportif de la
victoire et de l'aventure, la joie d'être à la base des
conceptions et idées originales. Pour les clients, il s'agit de la
satisfaction procurée par la consommation du produit et/ou service
proposé. Du point de vue financier, il s'agirait de la
profitabilité de la structure créée et des gains
monétaires effectifs et potentiels. L'entrepreneur prend des risques par
son initiative créatrice dont le couronnement est le profit. Tel est le
sens de la création de valeur.
I.1.5. L'impact de la
création activité économique
Toute entreprise créée a un impact sur
l'économie, et cet impact peut être analysé à
travers les éléments tels que : elle crée de l'emploi ;
elle distribue des salaires ; elle a une part dans la valeur ajoutée,
dans la productivité, dans l'exportation, dans la sous-traitance, dans
l'investissement, dans l'innovation,... Le rôle joué par les
Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans les économies modernes peut
bien illustrer nos propos.
En effet, les PME jouent un grand rôle
dans les économies modernes au regard des éléments
irremplaçables qu'elles apportent pour le développement de la vie
économique et sociale. La créativité et le dynamisme dont
elles font preuve permettent de satisfaire le besoin de diversification et le
souci de qualité qui apparaissent dans la population lorsque la
quantité est assurée.
Car, soutient Léon GINGEMBRE, la diversification et la
qualité sont essentiellement le domaine de la petite et moyenne
entreprise qui, plus proche des individus et mieux placée pour
satisfaire et servir leurs besoins, peut détecter les évolutions
et en fonction de sa souplesse de fonctionnement, s'y adapter.
De surcroît, elles constituent un réservoir quasi
inépuisable d'où naissent les grandes entreprises.
Sur le plan des structures sociales, poursuit L. GINGEMBRE,
la petite et moyenne entreprise apparaît également comme un
élément fondamental de promotion car elle permet à ceux
qui le désirent et qui en ont la capacité de progresser et de
parvenir.
D'autres éléments témoignant du dynamisme
de petites et moyennes entreprises se situent dans l'emploi, dans les salaires
distribués, dans la valeur ajoutée, dans le chiffre d'affaires,
dans investissements, dans les exportations.
En outre, le rôle
joué par les P.M.E. dans la sous-traitance est
fondamental. Bruno MAGLIULO note que bon nombre de grandes entreprises, y
compris les plus grandes, s'effondreraient, ou seraient placées devant
de grandes difficultés, si elles ne disposaient pas d'un important
réseau de P.M.E/P.M.I.
sous-traitantes.
I.1.6. Les Petites et Moyennes Entreprises
(P.M.E)
Proposer une définition pour moins satisfaisant du
concept de P.M.E. s'avère d'autant plus malaisé
que la réalité ainsi désignée varie tant dans
l'espace que dans le temps.
Toutefois, c'est de la classification
basée sur le critère de taille que découle la subdivision
entre « Grandes Entreprises » (G.E.) d'une part et
« Petite et Moyenne Entreprise » (PME) de l'autre,
même si la distinction ainsi mise en oeuvre n'est pas parfaitement
claire. D'autant plus que telle subdivision réfère quasi
exclusivement à un critère de quantification, de
compréhension apparemment facile, au détriment de tout
autre.
Car, en effet, non seulement d'autres critères
quantitatifs seraient à prendre en compte, mais encore des
critères qualitatifs sont susceptibles de contribuer à
révéler au mieux les contours de ce qu'il est convenu d'appeler
« Petite et Moyenne Entreprise », en sigle
P.M.E.
Il ressort de différents critères
trois catégories typologiques établies par les chercheurs
à savoir : les typologies quantitatives et les typologies qualitatives
dont la combinaison débouche sur une typologie dite complexe et globale
permettant de fournir les caractéristiques des entreprises
rangées derrière le vocable de
P.M.E.
A.Typologies quantitatives des
P.M.E.
Ces typologies, relèvent de l'approche
économique traditionnelle, qui se refuse à pénétrer
à l'intérieur de la boîte noire de l'entreprise et ne
touche ainsi qu'aux éléments les plus apparents.
Elles sont au surplus les premières disponibles et peuvent
donc servir, par exemple, à établir les critères pour
l'application des programmes d'aide gouvernementaux. Ainsi s'offrent-elles aux
chercheurs comme une première porte d'entrée pour obtenir des
échantillons qui seront étudiés par la suite.
Cette
approche se base sur différents critères de choix tels que les
effectifs, la production, la valeur ajoutée ou des ventes, la mesure des
actifs, le chiffre d'affaires,...pour établir les différentes
catégories que sont les Petites Entreprises, les Moyennes Entreprises et
les Grandes Entreprises.
De tous les critères, Pierre FRANCK
indique qu'on choisit généralement le critère des
effectifs qui ne dépend d'aucun paramètre économique et
permet facilement des comparaisons internationales du fait de son
indépendance au regard des taux de change.
Mais, malgré
cet avantage qu'il offre, il reste cependant un critère non
satisfaisant.
Car, ainsi que le démontre Gérard HIRIGOYEN, la
juxtaposition de critères d'effectif à partir des textes
législatifs ne permet pas de conduire à un classement
précis des entreprises en fonction de leur dimension.
Et la même incertitude, poursuit-il, demeure dans les
études économiques et financières pourtant rigoureuses. Il
signalealors l'existence en France, par exemple, de différentes
typologies d'entreprises que voici.
Une première typologie
établit la distinction entre : la micro-entreprise, celle dans laquelle
on ne rencontre aucun salarié ou dont l'effectif est au plus égal
à 10 (exploitations artisanales inscrites au registre des
métiers, commerces de détail, prestations de services) ;
la P.M.E., l'entreprise industrielle de 11 à
500 salariés ainsi que celle de négoce ou
de prestation de services de 11 à
500 salariés ; enfin, l'entreprise « d'une
certaine dimension », celle dont l'effectif se situe au-delà de
100 ou
500.
Une autre approche typologique établit
quant à elle, la distinction ci-après : les petites entreprises,
celles dont l'effectif ne dépasse pas 10 salariés ; les
entreprises intermédiaires et les entreprises importantes, dont les
effectifs sont supérieures à
100 personnes.
Une autre typologie rend compte de
l'existence de trois groupes d'entreprises : les petites qui emploient moins de
20 salariés, les moyennes de 20 à
499, les grandes avec
500 ou plus.
Il ressort de ces différentes
approches que les typologies quantitatives demeurent dans l'ensemble largement
insatisfaisantes de par leurs critères imprécis et
mouvants.
B. Caractéristiques des
PME
1. La petitesse de la taille
La
petitesse de la taille est l'un des premiers critères utilisés
sinon le premier, pour caractériser les PME. Cette
taille qualifiée parfois d' « humaine » dote l'entreprise
d'atouts essentiels par rapport à la grande entreprise.
Car à cette petite taille est associée une grande
souplesse structurelle, permettant une remarquable capacité d'adaptation
au marché et des prix de revient relativement bas étant
donné la faiblesse des coûts fixes.
2. La centralisation de la gestion
Le
système de gestion de la PME est fortement centralisé. La
distinction « propriétaire - dirigeant » n'est pas visible.
P.A. JULIENnote qu'on peut même parler de « personnalisation »
de la gestion en la personne du propriétaire-dirigeant dans le cas de
toutes petites entreprises. Mais cette forte centralisation se retrouve aussi
dans les moyennes entreprises des secteurs traditionnels.
Il vient souvent à l'esprit de situer la
PME d'après l'un ou l'autre critère quantitatif.
Cependant, les critères quantitatifs diffèrent d'un pays à
un autre, voire d'un secteur à l'autre dans un même
pays.
3. La faible spécialisation
Tant au
niveau de la direction que des employés et des équipements, la
spécialisation est faible et vient avec l'augmentation de la taille de
l'entreprise, nécessitant une mise sur pieds de plusieurs niveaux
organisationnels dans les différentes fonctions.
Une comparaison
axée sur la structure des emplois dans les PME et les
grandes entreprises révèle que les ouvriers, relativement plus
nombreux dans les PME, sont aussi en moyenne moins
qualifiés. Plus précisément, la proportion d'ouvriers
qualifiés diminue quand on passe des petites entreprises aux moyennes et
augmente fortement des moyennes aux grandes.
4.Une stratégie intuitive ou peu
formaliste
Dans les petites entreprises des plans précis
des actions à venir, susceptibles de servir de cadre de
référence pour toute la direction sont inexistants et le
propriétaire dirigeant est suffisamment proche de ses
employés-clefs pour leur expliquer au besoin tout changement de
direction.
5. Un système d'information interne peu
complexe ou peuorganisé
Le transfert d'information dans les petites organisations
s'opère grâce au dialogue ou le contact direct.
6. Un système d'information externe
simple
Les petites entreprises ne recourent pas à des
études de marché coûteuses et complexes. Ainsi, dans les
entreprises artisanales, par exemple, le propriétaire dirigeant peut
discuter directement avec ses clients tant pour connaître leurs besoins
et leurs goûts qu'expliquer différents aspects du (des)
produit(s).
C. Quelle définition pour la P.M.E.
?
Les typologies et caractéristiques ci-dessus donnent une
idée plus ou moins vague de cette réalité
désignée par le concept de PME.
Ce
concept comporte, ainsi que l'ont montré les typologies, deux dimensions
: une quantitative et une qualitative. Les critères quantitatifs,
rappelons-le, sont insatisfaisants puisque mouvants et
imprécis.
Léon GINGEMBRE soutient que les formules
quantitatives mettraient dans l'obligation d'adopter des chiffres qui
diffèreraient suivant les secteurs professionnels
considérés, et aboutiraient à des formules
extrêmement complexes sans traduire la réalité des
faits.
En vérité, poursuit-il, si on examine de
façon plus approfondie la notion de PME, on trouve qu'au-delà des
données quantitatives, un certain nombre de caractères sont
permanents et qu'il est donc préférable de s'orienter vers une
définition qualitative.
Il est indiqué que les
critères de fond, ceux permettant de refléter fidèlement
les caractéristiques structurelles communes aux PME,
peuvent être ramenés à trois.
· Le premier est
la responsabilité directe, personnelle et finale du patron qui
apparaît en définitive bien souvent comme le seul décideur
;
· Le deuxième est la propriété du patrimoine
social qui est souvent le fait d'un homme ou de sa famille, quelle que soit la
forme juridique adoptée, ce qui se traduit le plus souvent par une
confusion des patrimoines ;
· Le troisième, enfin, est
l'existence d'un objectif particulier de richesse débouchant sur un
rôle important des rémunérations personnelles et sur une
recherche de la rentabilité à court terme.
Ainsi, on
pourrait entendre par PME ces entreprises dans lesquelles les
chefs d'entreprises assurent personnellement et directement les
responsabilités financières, techniques, sociales et morales de
l'entreprise, quelle que soit leur forme juridique.
Le patronat à
la tête des PME est un patronat réel,
c'est-à-dire celui qui risque dans ses affaires ses propres capitaux,
exerce une direction administrative et technique effective, et assure, avec son
personnel, des contacts directs et permanents ; ce patronat s'oppose au
patronat de gestion ou de management qui dirige les grandes entreprises
où la propriété et la gestion sont dissociés, la
propriété étant répartie entre un grand nombre
d'actionnaires et la gestion effectuée par un collège des
cadres.
Si les critères qualitatifs permettent de
refléter les caractéristiques communes à toutes les
PME, nous pouvons noter qu'à l'intérieur du
concept de PME les critères quantitatifs permettent
d'établir la distinction entre les petites et les moyennes entreprises.
Des seuils sont établis tantôt en terme de chiffre d'affaires
tantôt en terme d'effectif du personnel.
D. Définition des PME
congolaises
Considérant que les petites et moyennes
entreprises et l'artisanat constituent l'épine dorsale de
l'économie mondiale en général et de l'économie
congolaise en particulier et qu'ils sont l'un des principaux moteurs de
l'innovation, de la création des richesses et de l'emploi ainsi que de
l'intégration sociale en République Démocratique du Congo,
l'Etat Congolais, d'une part, et les organisations patronales
etprofessionnelles des petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat
(PMEA) de l'autre, ont, dans une charte, donné une
définition de cette catégorie d'entreprises.
Au sens de
ladite charte, on entend par Petite et Moyenne Entreprise, toute unité
économique dont la propriété revient à une ou
plusieurs personnes physiques ou morales et qui présente les
caractéristiques suivantes :
- Nombre d'emplois permanents : de 1
(un) à
200 personnes par an ; - Chiffre d'affaires, hors taxes,
compris entre 1 et
4000 USD ;
- Valeur des investissements
nécessaires mis en place pour les activités de l'entreprise
inférieure ou égale à
350.000 USD ;
- Mode de gestion
concentrée.
Se retrouvent dans cette catégorie : la
micro-entreprise ou la très petite entreprise, la petite entreprise et
la moyenne entreprise.
I.2. LA
PAUVRETE
I.2.1. Définition de
la Pauvreté
La pauvreté peut être entendue, selon le
dictionnaire de langue française, comme l'état d'une personne qui
manque de moyens matériels, d'argent ; c'est l'insuffisance des
ressources. Il renvoie à : indigence, misère,
nécessité.
Le pauvre c'est donc une personne qui n'a pas assez d'argent,
un indigent, un nécessiteux.
La Commission européenne,
quant à elle, définit la pauvreté comme « un
phénomène couvrant dans son acception non seulement l'absence de
revenus et de ressources financières, mais inclut aussi la notion de
vulnérabilité, ainsi que des facteurs tels que l'absence
d'accès à une alimentation adéquate, à
l'éducation et à la santé, aux ressources naturelles et
à l'eau potable, à la terre, à l'emploi et au
crédit, à l'information et à la participation politique,
aux services et aux infrastructures ».
Le seuil de pauvreté dont il est question ci-haut est
déterminé aussi bien au niveau mondial que par chaque pays et il
s'agit d'une valeur monétaire fixée « sur la base du
coût par habitant d'un panier de consommation minimum comportant de la
nourriture et quelques autres produits essentiels ».
D'une manière générale, le seuil de
pauvreté est fixé à un dollar des Etats-Unis par
tête par jour. Les origines de ce seuil remontent à la fin des
années 80 lorsque la Banque Mondiale préparait son Rapport sur le
développement dans le monde pour l'année
1990.
Les rapports successifs de cette institution étaient
toujours centrés sur un thème d'étude ; et pour
l'année
1990, l'étude examinait la pauvreté dans
le monde en s'intéressant à 34 seuils nationaux de
pauvreté précis, provenant aussi bien des pays riches que de ceux
pays sous-développés.
On s'est rendu compte que ces seuils augmentaient avec
l'élévation du niveau de vie ; et en mettant l'accent sur les
nations à revenu faible, on voyait que les seuils par pays tendaient
à se situer dans une fourchette allant de
275 à
370 USD par personne et par an, mesurés en dollars
de
1985 et en parité de pouvoir d'achat (PPA).
Ainsi, la limite supérieure de cette fourchette, soit
370 USD (légèrement au-dessus de 1 USD par
jour) a été adoptée comme seuil mondial de
pauvreté. Ce rapport a débouché sur la conclusion que 1,12
milliard d'humains, soit le tiers de la population des pays
sous-développés en
1985, vivait avec en état de pauvreté
absolue.
I.2.2.La réduction de la
pauvreté
Le 21ème siècle s'est ouvert avec une
déclaration de solidarité dite « Déclaration du
Millénaire». Adoptée en
2000 aux Nations Unies par les chefs d'Etat et de
gouvernement tant des pays riches que des pays pauvres, cette
déclaration a débouché sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD),
qui engagent les pays du globe à redoubler d'efforts
pour s'attaquer à l'insuffisance des revenus, à
l'omniprésence de la faim, aux inégalités sociologiques
entre hommes et femmes, à la dégradation de l'environnement et au
manque d'instruction, de services de santé et d'eau potable.
Il
sied de relever que parmi les objectifs poursuivis par cette
déclaration, la réduction de la pauvreté vient en
première position. « Faire disparaître l'extrême
pauvreté et lafaim», tel est le premier des Objectifs du
Millénaire pour le Développement.
La première cible de cet objectif vise à
« réduire de moitié, entre
1990 et
2015, la proportion de la population dont le revenu est
inférieur à un dollar par jour» tandis que la
deuxième cherche de réduire de moitié, entre
1990 et
2015, la proportion de la population souffrant de la
faim».
Des efforts sont déployés pour mettre en place
des politiques et des programmes macroéconomiques, structurels et
sociaux visant à encourager la croissance et à réduire la
pauvreté.
Et depuis lors les gouvernements de pays
sous-développés établissent des Documents de
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté
(DSCRP) et ce, dans le cadre d'un exercice impliquant la société
civile et les partenaires du développement.
Mais
concrètement que veut dire, que signifie réduire la
pauvreté ? A notre entendement, la réponse paraît
simple.
Puisque le seuil de pauvreté est connu et que les
revenus d'une partie de la population se situent en deçà de ce
seuil, réduire la pauvreté consisterait à réduire
l'écart entre ce seuil et les revenus inférieurs au seuil ; ou
mieux ramener ces revenus au niveau du seuil de pauvreté.
I.3. LE CHOMAGE
I.3.1 Définition du
chômage
- Situation d'un individu (« Etre au chômage
») ou d'une partie de la main d'oeuvre d'un pays sans emploie et à
la recherche d'un emploie ; les chômeurs sont inclus dans la
population active. Le chômage peut être total ou partiel
(réduction de l'horaire de Travail par exemple).
Le chômage pose, en général, un
problème de mesure et la définition des indicateurs retenus
varient d'un pays à l'autre.
- Définition du bureau international du travail (BIT).
Le BIT a proposé une définition commune à
tous les pays, pour être reconnu chômeur il faut remplir quatre (4)
conditions : Etre de pourvu d'emploi, être capable de travailler,
chercher un travail rémunéré, être effectivement
à la recherche d'un emploi.
Il élargi la notion aux personnes ayant trouvé un
emploi, mais n'ayant pas encore commencé à travailler pendant la
semaine de l'enquête.
I.3.2 Types de chômages
Selon l'origine et/ou la durée, on distingue :
a. Chômage conjoncturel : qui
résulte d'un ralentissement temporaire de la croissance
économique.
b. Chômage déguisé :
l'emploi dont la productivité est faible, voire nulle.
c. Chômage frictionnel : dû
au temps moyen nécessaire à un chômeur pour trouver un
emploi correspondant à ses qualifications et à ses
aspirations ; il est lié à la mobilité
professionnelle, sectorielle, géographique ; le plein emploi est
réalisé lorsque le chômage est principalement frictionnel.
d. Chômage saisonnier : lorsque
l'activité de salarié fluctuer selon les époques de
l'année (Agriculture, Tourisme, etc.).
e. Chômage structurel : lié
aux changements de longue période intervenus dans les structures
démographiques, économiques, sociales et institutionnelles
(exemple : variation de taux activité, évolution des
qualificationsréguises, de la localisation des emplois, branches ou
régions en déclin, effets de la législation, etc.).
f. Chômage technique : dû
à une interruption du processus technique de production (panne de
machines, pénuries, etc.).
g. Chômage technologique :
innovations qui économisent du travail, notamment par la substitution de
capital au travail (robotisation, informatisation.)
Chapitre II.PRESENTATION DU
CADRE D'ETUDE
Section 1 PRESENTATION DE
LA VILLE DE MATADI
1.1 Bref HISTORIQUE
La ville de Matadi est le chef-lieu de la province du Kongo
central en République Démocratique du Congo. Elle héberge
les principales institutions de la province. Elle est reliée de la
ville Kinshasa par la ligne de chemin de fer Matadi- Kinshasa et la route
Nationale N°1.
La ville est subdivisée en 3 communes ci-après
:
Matadi, Nzanza et Mvuzi.
1.2LANGUES PARLEES
Langues locales : Kikongo et Lingala
Langue officielle : Français
1.3 PRINCIPAUX GROUPES ETHNIQUES
La ville est particulièrement remarquable par
l'homogénéité de sa composition ethnique. C'est une ville
entièrement Kongo dont les principales tribus se présentent de la
manière suivante : BAYOMBE, BANYANGA,
BANDIMBU, BANTANDU, BAMBOMA... Quant aux
dialectes nous citons : KIYOMBE, KINYANGA, KINDIBU, KINTANDU,
KIMBOMA.
La présence de plusieurs composantes tribales dans la
ville entraine ipso-Facto la diversité des dialectes. Néanmoins,
l'utilisation d'une langue commune Kikongo, Lingala, permet à tous les
habitants de la ville de communiquer entre eux et de se comprendre sans peine.
1.4 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE
Située à 365 Kilomètres de la Capitale
Congolaise, Kinshasa, Ville de Matadi s'étend sur une superficie de
110Km2. La ville est étirée à Flanc de colline,
tire son nom de l'environnement accidenté qui l'accueille, de la
proximité des rapides. Elle est bâtie sur un site rocailleux,
expliquant ainsi sa dénomination « MATADI »
Signifiant « PIERRE » en Kikongo. Son altitude varie de
milieu à l'autre.
La frontière avec l'Angola, la Ville de Matadi se situe
à quelques Kilomètre vers le sud et vers l'aval du fleuve. Un
pont haubané de 722 mètres de long, construira en 1983,
dénommé pont OEBK qui relie à la rive droite, permettant
l'accès facile à la ville de Boma et au barrage
hydroélectrique d'Inga.
En amont de la Ville peut être observée le rocher
de Diego Cao, ou le célèbre explorateur portugais scrutait, en
1482, la marque du point limite de sa remontée du Fleuve.
De par, sa position géographique, la Ville de Matadi
est soumise au groupe des climats tropicaux avec des saisons alternées
qui se présentent de la manière suivantes :
La saison des pluies commence en Octobre et va jusqu'à
Mai de l'année suivante, soit approximativement si mois avec une petite
saison Sèche en Janvier et Février de l'année ;
La saison s èche et particulièrement
sensible par son extension et sa durée. Elle dure plus de quatre mois en
moyenne, et tout au plus six mois. Elle débute souvent vers la
deuxième quinzaine du mois de Mai pour s'achever à mi-octobre de
la même année.
1.5 ASPECT DEMOGRAPHIQUES
La Ville de Matadi se retrouve sur une superficie de
110Km2, avec une population de 567 804 habitants (données de
2016). La grande proportion de la population de Matadi est constitué des
jeunes filles et garçons.
Il y a peu de temps, la ligne de démarcation entre la
population de Matadi est celle de Kinshasa s'observait à l'oeil nu,
mais aujourd'hui il suffit de se réveiller à Matadi vous croirez
que vous êtes à Kinshasa, même types d'habillement, de
coiffure, des Maisons, des véhicules en bon état, etc.
Le tableau ci-après résume la répartition
géographie de la population de la Ville de Matadi.
Tableau N°1 : Répartition
géographique de la population de la Ville de Matadi
|
COMMUNE
|
POPULATION
|
%
|
|
MATADI
|
193 054
|
34
|
|
MVUZI
|
164 663
|
29
|
|
NZANZA
|
210 087
|
37
|
|
TOTAL
|
567 804
|
100
|
Source : Mairie de Matadi, 4éme
Trimestre 2018
1.6 Subdivision et organisation
Administrative
La subdivision Administrative de la Ville de Matadi
n'est pas vraiment complexe. Elle compte trois communes : Matadi, Nzanza
et Mvuzi. Celles-ci sont des entités Administratives
décentralisées qui sont actives à cause de leurs
concentrations.
Chaque commune est constituée des quartiers.
La Ville compte au total 17 quartiers. Par ce fait, la loi leur reconnait une
compétence générale des principes sur les affaires
locales. Elles restent subordonnées au contrôle de tutelle par
les Autorités communales.
1.6.1 La commune de Matadi
Avec une superficie de 59 580 km2 ; elle est
la plus vaste de toutes, située au centre de la ville et contient une
réserve d'urbanisation beaucoup plus importante. Elle subdivisée
en 5 quartiers à savoir :
Tshimpi, Salongo, Ville haute, Soyo et Ville basse regroupant
105 avenues et 5 villages.
Cette commune héberge les principales institutions
de la Ville, les installations portuaires, la gare ferroviaire de la ligne de
chemin de fer Matadi -Kinshasa, l'aérodrome, et les plus grandes
entreprises de la Ville à l'instar de la MIDEMA, SEP CONGO, les grands
hôtels et les grands transporteurs. La répartition de la
population de cette commune, par quartiers et par sexe se représente
comme indiqué dans le tableau qui suit :
Tableau n°2 : Représentation de la
population de la commune de Matadi par quartiers et par sexe.
|
SEXE
QUARTIERS
|
Masculin
|
Féminin
|
Total
|
|
SALONGO
|
28 128
|
31 719
|
59 847
|
|
VILLE BASSE
|
13 247
|
13 813
|
27 060
|
|
VILLE HAUTE
|
27 765
|
33 970
|
61 735
|
|
SOYO
|
16 967
|
17 701
|
34 668
|
|
TSHIMPI
|
4 627
|
5 013
|
9 640
|
|
TOTAL
|
90 735
|
102 319
|
193 054
|
SOURCE : Bureau communal des Matadi,
Statistiques arrêtes en 2018
1.6.2 La Commune de Nzanza
Elle a une superficie de 51 363 km2 et renferme 7 quartiers
regroupant 274 avenues. Ces quartiers sont : Nzanza,Nsakala-Nsimba,
Nzingalutete, Lieutenant Mpaka, Banana, Kitomesa et Dibuansakala.
Elle héberge des quartiers populaires en expansion. La
répartition de la population de cette commune par quartier et par sexe
se présente comme indiquée dans le tableau qui suit :
Tableau n°3 : Répartition de la
population de la commune de Nzanza par quartiers et par sexe.
|
Sexe
Quartier
|
MASCULIN
|
FEMININ
|
TOTAL
|
|
BANANA
|
10 414
|
10 259
|
20 673
|
|
KITOMESA
|
15 417
|
17 278
|
32 695
|
|
DIBUA NSAKALA
|
18 889
|
18 537
|
37 426
|
|
MPAKA
|
14 907
|
14 902
|
29 809
|
|
NZANZA
|
16 744
|
16 630
|
33 374
|
|
NSAKALA NSIMBA
|
14 601
|
16 414
|
31 015
|
|
NZINGA LUTETE
|
13 069
|
12 310
|
25 379
|
|
TOTAL
|
102 102
|
107 985
|
210 087
|
Source : Bureau communal de NZANZA,
Statistiques arrêtées en 2018
1.6.3 La commune de Mvuzi
Elle n'a que 24,18 km2 et, elle est donc la plus petite et
compte cinq (5) quartiers, notamment Mvuzi, Ngadi, Mongo, Mpozo et
Mbuzi.
Pour permettre un meilleur encadrement de la population est
surtout une bonne Administration, elles sont à leurs tours
subdivisés en cellules placées sous la surveillance des notables
choisis parmi les habitants de la contrée en raison en leur
moralité, maturité et de leur influence.
Nous reprenons dans le tableau ci-dessous la
répartition par quartiers et par sexe de la population de commune de
Mvuzi.
Tableau n°4 : Répartition de la
population de la commune de Mvuzi par quartiers et par sexe.
|
Sexe
Quartier
|
MASCULIN
|
FEMININ
|
TOTAL
|
|
MBUZI
|
12 618
|
15 858
|
28 476
|
|
MONGO
|
12 458
|
13 992
|
26 450
|
|
MPOZO
|
16 292
|
14 077
|
30 369
|
|
NGADI
|
15 893
|
15 603
|
31 496
|
|
MVUZI
|
22 601
|
25 270
|
47 871
|
|
TOTAL
|
79 862
|
84 801
|
164 663
|
Source : Bureau communal de Mvuzi,
statistiques arrêtées 2018
1.7 Avantages et désavantages liés au
chef au relief de la ville et à la population active
La configuration physique de la ville de Matadi joue un
rôle très important sur le site et sur sa situation
économique à travers ses installations Portugais. La ville
attirée plusieurs investissement intervenant dans différents
domaines.
Les étrangers également y trouvent leur compte
dans différentes l'aspect assez uniforme d'un plateau parsemé,
dominé par des collines. En dépit de ces désavantages,
signalons tout de même que l'appauvrissement de son sol, et les
conditions climatiques difficiles, constituent de sérieux goulots
d'étranglement pour toute mise en valeur des ressources de la ville.
Ainsi, la ville ne doit compter que sur le
développement des secteurs secondaires et tertiaires. En ce qui concerne
la population active, il sied de considérer d'abord que, la population
de Matadi accroit à un rythme accéléré à
cause de plusieurs facteurs qui déroulent de :
- Exode rural ;
- L'arrivée en foules des populations provenant
d'autres villes et d'autres provinces attirées par les activités
portuaires.
Section 2PAUVRETE ET CHOMAGE
EN RD CONGO (Kongo Central)
2.1. Pauvreté en
RDCongo
La taille moyenne des ménages pauvres est de 7
personnes. Ce qui correspond approximativement au double de la composition des
ménages riches.
De même, le taux de dépendance est relativement
élevé dans les ménages pauvres que riches. En effet,
pratiquement 2 enfants sont en âge de travailler dans les ménages
pauvres contre 1 enfant dans les ménages riches.
Graphique 1 : Composition de
ménages

Source : Rapport sur l'évaluation de
la pauvreté en RDC, Banque Mondiale, 2016
Etonnamment, la plupart des chefs des ménages pauvres
sont instruits, surtout pour les ménages dirigés par les hommes.
Près de la moitié des femmes chefs des ménages pauvres
sont sans instruction contre 20% ayant faites au moins les études
secondaires et 30% les études primaires.
Le principal secteur qui emploie les pauvres est
l'agriculture, surtout pour ceux vivant dans les zones rurales (62,3% des
pauvres correspondant à 28 millions de personnes).
Environ 81% des pauvres actifs en milieu rural étaient
employés dans le secteur agricole en 2012 contre 10,6% dans les services
et 2,3% dans le commerce.
Graphique 2 : Répartition des
ménages pauvres par niveau d'éducation et sexe du chef de
ménage
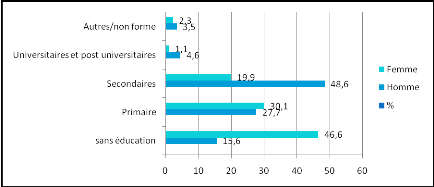
Source : Rapport sur l'évaluation de la
pauvreté en RDC, Banque Mondiale, 2016
Excepté la ville Province de Kinshasa où
l'agriculture occupe faiblement les pauvres (5%) alors que le secteur des
services est prépondérant avec 52,8% suivi du commerce 26,5% ;
les villes secondaires de la RDC emploient les pauvres dans le secteur agricole
et des services à part quasi-égale (31,7% contre 36%). Le
commerce occupe quant à lui les pauvres à hauteur de 19,4%.
Nonobstant cette situation, les pauvres se retrouvent en
majorité dans le secteur informel comme travailleurs indépendants
à concurrence de 75% en 2016.
Graphique 3 : Répartition de
pauvres par secteur d'emploi et zone résidentielle

Source : Rapport sur l'évaluation de la
pauvreté en RDC, Banque Mondiale, 2016
Répartition spatiale des pauvres
Bien que le pays ait enregistré une baisse du taux de
pauvreté de 5,3% au niveau national et 5,6% et 4,1% en milieu rural et
urbain respectivement, les tendances sont contrastées au niveau
provincial.
Dans la plupart des Provinces, l'incidence de la
pauvreté est supérieure à 60% (19/26).
Les Provinces ayant un taux d'extrême pauvreté en
deçà de 60% sont : Nord-Kivu (49%), Kongo-Central (49,3%),
Kinshasa (52,8%), Ex Province Orientale (Bas Uélé, Haut
Uélé, Tshopo et Ituri : 55,2%).
Les Provinces du centre et nord-ouest ont une forte incidence
de la pauvreté alors que la ville de Kinshasa et les Provinces de l'Est
ont des taux de pauvreté bas.
Tableau 6 : Répartition
spatiale du taux de pauvreté
|
Taux de pauvreté
|
Provinces
|
|
30-50
|
Kongo-Central, Nord Kivu, Haut-Uélé
|
|
51-60
|
Kinshasa, Lualaba, Haut Katanga, Ituri
|
|
61-70
|
Kwango, Kasaï, Kasaï oriental, Haut-Lomami,
Equateur, Tshuapa, Tshopo, Maniema, Sud Kivu
|
|
71-95
|
Mai-ndombe, Kwilu, Sankuru, Kasaï Central, Lomami,
Tanganyika, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala, Bas-Uélé
|
Source : FEC, sur base des données du
Rapport sur l'évaluation de la pauvreté en RDC, Banque Mondiale,
2016
Considérant le nombre de pauvres, sa répartition
varie considérablement entre Provinces. Kinshasa, Sud-Kivu, Kwilu,
Lomami, Haut-Katanga et Nord-Kivu comptent plus de pauvres.
Tableau 7 : Répartition
spatiale du nombre de pauvres
|
Nombre de pauvres
|
Provinces
|
|
110 000 - 900 000
|
Tshuapa, Mongala, Bas-Uélé,
Haut-Uélé
|
|
900 001 - 1 500 000
|
Kwango, Kasaï, Lualaba, Mai-ndombe, Equateur, Sankuru,
Maniema, Tanganyika, Ituri, Nord-Ubangi
|
|
1 500 001 - 2 200 000
|
Kongo central, Sud-Ubangi, Tshopo, Kasaï-central,
Kasaï- Oriental, Haut- Lomami
|
|
Plus de 2 200 001
|
Kinshasa, Kwilu, Lomami, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu
|
Source : FEC, sur base des données du
Rapport sur l'évaluation de la pauvreté en RDC, Banque Mondiale,
2016
2.2. Le chômage en
RDC
L'emploi constitue un enjeu majeur pour l'État
congolais. En effet :
- La RDC dispose d'une population jeune et en pleine
croissance, à la recherche d'opportunités et d'emploi ; le
chômage frappe en majorité les jeunes qui constituent l'essentiel
de la population.
- Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans (15,85 %)
est plus élevé que celui des adultes (9,37 %), selon une
publication du BIT Kinshasa/ RDC de 2017.
- Les jeunes femmes semblent également plus
exposées au chômage que les jeunes hommes avec des taux de
chômage respectifs de 20 % et 12 %.
Par ailleurs, il y a lieu de retenir quelques
caractéristiques du marché de travail en RDC :
- Le secteur privé (sans compter les entreprises
publiques privatisées) n'absorbe que 1,2% de la main d'oeuvre ; le reste
de la population obligée de se rediriger dans le secteur informel
(l'agriculture de subsistance) ;
- Le secteur formel, qui emploi d'ailleurs une faible main
d'oeuvre, reste très limité. Il est essentiellement
constitué d'entreprises publiques (elles emploient en moyenne 5.000
à 12.000 personnes chacune), de petites et moyennes entreprises, et d'un
petit nombre de grandes entreprises (actives dans le secteur minier et des
télécommunications) qui appartiennent à des groupes
étrangers. L'eau, l'électricité et le transport
ferroviaire sont le monopole des entreprises publiques.
- Trois secteurs constituent des sources d'emplois en RDC : le
secteur de construction, celui de l'agriculture et le secteur minier. En effet
:
En 2005, la construction employait 71.000 personnes ; ce
nombre s'est accru certainement avec le nombre important des projets
d'infrastructures en attente d'exécution ; En 2005, plus de 10 millions
de personnes travaillaient dans lecteur de l'agriculture (projetée
à 15 millions en 2010). Le secteur minier emploi entre 500.000 et 2
millions de travailleurs formels et informels, et ce secteur est
géographiquement limité (principalement actif au Katanga, dans
les deux Kasaï, et dans quelques provinces de la RD Congo).
Tableau n°08 : Evolution du taux de
chômage
|
Indicateur
|
2005-2008
|
2009
|
2010-2014
|
2017
|
Norme internationale
|
|
Taux de chômage (en %)
|
48,7
|
60,8
|
47,9
|
25,22
|
< 10
|
Source : Ngonga N. (2019, p. 61)
3. Causes et conséquences de cet état de
choses
Analysant l'évolution récente de l'emploi des
jeunes en RDC, Sumata Claude (2019) note que l'inadéquation du
système éducatif, l'ampleur du secteur informel et les
contraintes de l'environnement macroéconomique demeurent des
défis à relever. Notons que la pauvreté et le
chômage qui caractérisent l'économie congolaise
s'expliquent par plusieurs facteurs parmi lesquels nous reprenons quelques-uns
ci-dessous :
- La destruction du tissu économique congolais
(guerres, pillages, insécurité, instabilités, corruption,
mauvaise gouvernance, etc.) est à la base des problèmes de
pauvreté et d'emploi, et même bien de maux qui gangrènent
l'économie congolaise ;
- Le caractère extraverti et peu diversifiée de
l'économie congolaise. A titre d'exemple, la crise financière de
2008-2009 était plus défavorable aux pauvres qui étaient
les plus affectés par les fluctuations des taux de change (perte de
pouvoir d'achat et d'emplois), non compensées par l'accroissement des
revenus ou les opportunités d'emplois ;
- Les contraintes structurelles qui entravent le
développement du secteur privé : le manque de coordination des
agences gouvernementales dans la perception des taxes, multiplicité des
réformes législatives, etc. Les innombrables
prélèvements et impôts formels et informels paralysent le
développement du secteur privé créateur d'emplois, et cela
limite la croissance des PME ;
- La détérioration du système
éducatif est une entrave au développement de certains secteurs
d'activité pouvant employer pas mal des gens, notamment le secteur de la
construction qui peine à recruter une main d'oeuvre qualifiée (en
mécanique, travail des métaux, techniciens, contremaîtres,
chef de chantier, etc.) ;
- Le mauvais climat des affaires (incertitudes juridiques)
empêche le secteur privé de créer des emplois ; à
cela s'ajoute d'autres obstacles : infrastructures et services publics
insuffisants, capital humain et accès au financement limité,
obstacle réglementaire, monopoles d'entreprises publiques (eau,
électricité, transport ferroviaire), incertitudes quant aux
droits fonciers, etc.
- Le système financier reste moins
développé et ne finance pas le développement de
l'activité économique (le crédit à
l'économie ne représente que 7,1% du PIB en 2017), ce qui limite
les opportunités d'emplois. Aussi, les conditions de crédit (taux
d'intérêt excessifs, garanties, etc.) limitent l'accès des
PME, et l'insolvabilité des créanciers (accroissement des
prêts non performants) rend les banques adverses au risque (elles
limitent le crédit) ;
- L'absence de recours légal pour faire appliquer les
contrats jouent négativement sur la création d'emplois ;
- La dégradation du secteur agricole, couplée
à une détérioration des infrastructures et à
l'insécurité, contribue à réduire la
disponibilité alimentaire ;
- La croissance rapide de la population urbaine et la
diminution de l'accès aux marchés et du nombre de
propriétaires d'entreprises contribuent à accélérer
l'incidence de la pauvreté et pèsent sur les ressources et
infrastructures de base (baisse des ressources disponibles).
La pauvreté etLe chômage en RDC sont à la
base de beaucoup de maux qui gangrènent le pays, notamment : la
corruption ; les violences et criminalité (phénomène
« kuluna» et enfants de la rue).
Chapitre III.APPORT DESPME
DANS LA REDUCTION DU CHOMAGE ET DE LA PAUVRETE DANS LA VILLE DE MATADI
Le PME est devenue les principaux moyens de survie pour les
biens de congolais en général et des Matadiens en particulier,
le PME répond à l'entente de la population. Elle contribue
à la création d'emplois et à la réduction de la
pauvreté. La plupart des pays industrialisés on atteint
aujourd'hui un niveau économique et social très enviable par le
biais des PME.
Section I CATEGORISATION
DES PME
Aux fins de la détermination du régime fiscal
applicable, les PME sont réparties en fonctions de leur chiffre
d'affaire annuel, en deux catégories suivantes :
Ø 1er Catégorie : les PME dont
le chiffre d'affaire annuel se situe entre l'équivalent en francs
Congolais de 50 001 et 400 000 Francs Fiscaux.
Ø 2eme Catégorie : les PME dont le chiffre
d'affaire annuel se situe entre l'équivalent en Francs Congolais de
10 001 et 500 00 Francs fiscaux.
Les personne physiques dont le chiffre d'affaire annuel est
égal ou inférieur à l'équivalent en Franc Congolais
de 10 000 Francs Fiscaux, sont soumises au régime de la patente,
tel qu'organisé par l'Ordonnance-Loi n°79-021 du 02 Août1979
portant réglementation du petit commerce. Dans ce cas, elles
relèvent de la gestion des Entités Administratives
Décentralisée.
Il est reconnu au Ministre ayant les Finances dans ses
attributions de réajuster, lorsque les circonstances l'exigent, les
chiffres limitent les catégories des PME.
NB : Il convient de retenir qu'on
relève deux catégories des PME selon que celles-ci sont
répertoriées par la loi et sont recensées par les
statistiques officielles.
I.1 Les PMEformelles
Ayant pratiquement une taille similaire avec celle des PME
informelles, les PME formelles sont d'une forme un peu plus purifiées
des PME informelles. Elles sont soumises aux règles contractuelles,
à des autorisations fiscales. Elles représentent toute
activité enregistrée qui suit la règlementation de l'Etat
et bénéficiant des facilités d'accès au
crédit et aux technologies modernes pour sa meilleurs
productivité.
I.2 Les PME
informelles
Il est important de rappeler que les PME informelles
relèvent du rendement du secteur dont la définition reste
toujours contextuelle car variant selon ses auteurs et les points de vue
considérés suite au fonctionnement d'une base
extralégale.
Pour Monsieur Verhaegent Guy, une PME informelle est toute
activité économique spontanée à caractère
individuel, échappant en grande partie au contrôle de
l'administration, évoluant en marge souvent des obligations
légales et non recensées par les statiques officielles, ne
bénéficiant pas des avantages de l'Etat. (VERHAEGEN, 1985)
Le secteur informel en RD Congo occupe à l'heure
actuelle 25% de la population active. Le reste de cette population active, soit
75% se réfugient dans d'autres activités parmi lesquelles, les
activités agricoles d'autosuffisance.
Le secteur informel comprend les activités
ci-après (NDUBA, 2000, p. 31)
1. Les petites ou très petites entreprises qui
fonctionnent sur un modèle des activités modernes : les
activités de restauration, de répartition, de
transformation,...
2. Les activités spécifiques commerciales :
petites boutiques, petits vendeur, coiffeur, porteurs, etc.
3. Les activités de menus services laveur de voitures,
cireurs, coiffeurs, porteurs,...
4. Les activités de type traditionnel, culturel,
spirituel ou psychologique : guérisseurs féticheurs,
marabouts, pasteurs, charlatans,...
Un grand nombre de demandeurs d'emplois transitent par ce
secteur salarié.
Ils ne peuvent accepter de quitter ce secteur pour l'emploi
salarié que si les salaires sont nettement supérieurs aux revenus
retirés dans les activités informelles.
Section II :Rôle
des PME dans le développement d'une Province ou d'un Pays
La PME est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permet
la résolution des problèmes fondamentaux de développement
par l'intégration de la population au processus de développement
économique.
Depuis les années 70 la PME apparait comme un vecteur
essentiel de la croissance et comme un relais indispensable de la grande
unité de production.
Ainsi, sa création témoigne du dynamisme des
congolais de leur capacité de faire face à la situation nouvelle
née de la crise, de se prendre en charge, de lutter contre le
chômage... car le secteur économique de l'Etat a été
rongé par le pillage et continue à subir les retombées de
la guerre.
Pour remonter la pente, les PME sont à mesure de
créer un tissu économique de base favorisant la valorisation des
ressources naturelles, la multiplication des échanges sur tous les
territoires et ainsi favoriser le décollage de l'économie.
Les PME ont une grande importance sur le développement
socio-économique car elle joue un double rôle : le rôle
économique et le rôle social.
II.1. Le rôle
économique des PME
Ce rôle concerne la contribution à
l'intégration économique, l'augmentation de la consommation des
ressources locales, la création des foyers de richesse,
l'intégration industrielle, l'innovation technologique, la contribution
à la décentralisation et à la régionalisation de
l'économie et de l'industrie.
II.1.1. Contribution à
l'intégration économique
Un bon développement est celui dont la quintessence est
intérieure. De ce fait, il importerait d'accroitre la consommation des
produits et des ressources locales.
A cet effet, la PME se prête mieux à ce
rôle car elle exerce des effets d'entrainement, c'est-à-dire
qu'elle contribue à la valorisation des ressources internes par la
création d'autres activités de base telle que le
développement de l'agriculture, l'intégration du secteur
artisanal, pour une entreprise manufacturée, le développement du
secteur tertiaire.
II.1.2. Augmentation de la
consommation des ressources locales
Les PME sont aptes à utiliser les ressources locales,
ainsi du fait de la faiblesse de leurs investissements, elles éprouvent
des difficultés pour importer les matières qui nécessitent
beaucoup de devises et de formalités pour l'importation.
Pour pallier à cela, elles se tournent vers les sources
intérieures d'approvisionnement, contribuant ainsi à
réduire la dépendance à l'égard des importations et
à élargir le marché intérieur.
II.1.3. Création des
cheminées de richesse
L'existence et/ou la promotion des PME constituent pour l'Etat
une source importante de mobilisation de recettes publiques par le biais de la
fiscalité.
Par des achats des matières premières, des
achats marchandises et des versements des salaires, elles distribuent des
revenus.
II.1.4. Intégration
industrielle et innovation technologique
Les PME dans leur version PMI contribuent à l'essor de
l'industrie et de l'innovation technologique.
Elles occupent une place prépondérante dans la
fabrication des pièces et des composantes pour les grandes entreprises
en raison de la spécialisation de leur compétence et de leur
coût de production.
II.2. Le rôle social des
PME
Par la création d'emplois, on vise à
réduire le chômage, la population se prend en charge et cela
favorise d'une manière la réduction de la pauvreté.
II.2.1. Contribution à la
lutte contre la pauvreté
Nous pouvons souligner que, la pauvreté constitue
aujourd'hui l'un des facteurs incitatifs à la création des PME,
lesquelles s'avèrent dans une certaine mesure comme une stratégie
de survie.
Ainsi, à ce sujet, l'effort des PME ne peut faire
l'objet de contestation car, elles arrivent tout de même à faire
vivre la population congolaise ne fut-ce que par la satisfaction des besoins
primaires (alimentaire, vestimentaire...)
II.2.2. Contribution à
l'ingestion du chômage
La lutte contre le chômage constitue une
préoccupation de tous les pays en voies de développement qui
souffrent d'un taux de chômage élevé. La RD Congo a
été victime des pillages des années 91 et 93 et les
séquelles des guerres de libération et d'agression etc. ;
c'est ce qui a occasionné la destruction des unités de
production, un départ massif des entrepreneurs, la fermeture de
plusieurs autres entreprises locales...
Ce désinvestissement a conduit au chômage ;
c'est dans cet environnement de dégradation du tissu économique
que la population s'est lancée dans la création des petites
unités de production entres autres les PME pour se prendre en charge.
Section III. Synthèse
des résultats
L'enquête menée dans le cadre de la
présente étude devrait rencontrer les objets de notre recherche
ainsi que les hypothèses qui ont été formulés au
départ.
III.1. Statistiques de nombre de
chômeurs
Tableau n°9 Nombre de chômeurs de la ville
de Matadi
|
sexe
Année
|
HOMME
|
FEMME
|
TOTAL
|
|
2016
|
1 370
|
394
|
1 764
|
|
2017
|
1 019
|
505
|
1 524
|
|
2018
|
952
|
342
|
1 294
|
|
2019
|
930
|
266
|
1 196
|
|
TOTAL Général
|
4 271
|
1 507
|
5 778
|
Source : Office National de l'Emploi
(ONEM)
III.2. Statistiques de nombre de
PME créées dans la Ville de Matadi
Tableau n°10
|
ANNEE
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
TOTAL
|
|
PME CREEES
|
47
|
40
|
38
|
22
|
147
|
Source : Division Provinciale de CM
& PMEA
Interprétations des tableaux
· De 2016 à 2017 : 1 756 - 1 524 = 240
Emplois créés
· De 2017 à 2018 : 1 524 - 1 294= 239
Emplois créés
· De 2018 à 2019 : 1 294 - 1 196 = 98
Emplois créés
Donc, de 2016 à 2019 il y a eu au total 568 Emplois
créés dont la majorité par les PME car de 2016 à
2019 il y a eu création de 147 PME.
Conclusion
Au terme de ce travail qui a porté sur l'apport des
PME dans la réduction de la pauvreté dans la ville de Matadi. Le
présent travail s'est subdivisé en trois (3) chapitres.
En effet, nous avons parlé au premier chapitre de la
généralité conceptuelle ; au deuxième la
présentation de la ville de Matadi qui est notre cadred'étude et
le troisième chapitre se focalise sur l'apport des PME dans la
réduction du chômage et de la pauvreté dans la ville de
Matadi.
Il vrai que toute personne doit contribuer à son pays
et c'est par le travail qu'on peut contribuer au pays, les PME contribuent au
développement économique de la RD Congo par la diminution du taux
de chômage et du taux de pauvreté, et ses travailleurs participent
encore au développement économique par les paiements des
impôts.
Après l'examen des différents tableaux de
chômage et de création desPME, nous pouvons conclure en disant que
sur, un total de chômeurs enregistres par l'ONEM de 5 778, 568 ont
trouvé de l'emploi soit 9,8% dont la majorité a été
créée par les PME qui constituent le pilier de l'économie
de la RD Congo en général et de la ville de Matadi en
particulier.
Eu égard à ces résultats, nous pouvons
confirmer notre hypothèse selon laquelle la création des
richesses et d'emploi par des PME réduisent le chômage et la
pauvreté en milieu Urbain de Matadi
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
0. BURDA Michael et alii : Macroéconomie, une
perspective européenne, De Boeck, Paris,
1. BEITONE Alain et alii : Dictionnaire des sciences
économiques, Armand colin, Paris,
2001
2. Livratto Nadine, les PME Définition
économique et politique publiques, Boeck
université,paris,2009.
3. Joëlle bon enfant, Jean Lacroix,
« chômage », Direction des relations internationales
de l'enseignement, centre de langues, 2014.
II. Revues
1. Programme des Nations Unies pour le
Développement/PNUD (2014), « Rapport mondial sur le
développement humain ».
2. Benicourt E. (2001), « La pauvreté selon le
PNUD et la Banque mondiale », Études rurales. En ligne :
https://journals.openedition.org/etudesrurales/68, janvier.
3. Kodila Tedika O. (2010), « Pauvreté en
République Démocratique du Congo : Un rapide état de lieux
», in Revue Congolaise d'Economie, document de travail WP01/10, Mai.
III. Notes de cours
1. CT Toussaint BOTOLOLO, cours de Statistiques
descriptives, inédit, G1 Eco, ULIMAT, 2017- 2018
2. CT Aimé KAYEMBE, cours de Méthode de
recherche en sciences sociales, inédit, G2 Eco, ULIMAT,
2018-2019
3. CT Samuel NTOTO, cours de l'Entrepreneuriat & PME,
inédit, G3 Eco, ULIMAT, 2019-2020
TABLE DES
MATIERES
0. INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
0.1 PROBLEMATIQUE
1
0.2 HYPOTHESES DU TRAVAIL
2
0.3 CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
0.4 METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
3
0.5 DELIMITATION DU SUJET
4
0.6 SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
Chapitre I. APPROCHE CONCEPTUELLE ET THEORIQUE
L'ENTREPRENEURIAT
6
I.1.1 Définition de l'Entrepreneuriat
6
I.1.3 L'environnement
8
I.1.4. La création de la valeur
9
I.1.5. L'impact de la création
activité économique
10
I.1.6. Les Petites et Moyennes Entreprises
(P.M.E)
12
I.2. LA PAUVRETE
19
I.2.1. Définition de la
Pauvreté.......................................................................................19
I.2.2. La réduction de la
pauvreté
20
I.3. LE CHOMAGE
22
I.3.1 Définition du chômage
22
I.3.2 Types de chômages
22
Chapitre II. PRESENTATION DU CADRE D'ETUDE
24
Section 1 PRESENTATION DE LA VILLE DE MATADI
24
1.1 Bref HISTORIQUE
24
Section 2 PAUVRETE ET CHOMAGE EN RD CONGO (Kongo
Central)
31
2.1. Pauvreté en RD Congo
31
2.2. Le chômage en RDC
35
Chapitre III. APPORT DES PME DANS LA REDUCTION DU
CHOMAGE ET DE LA PAUVRETE DANS LA VILLE DE MATADI
39
Section I CATEGORISATION DES PME
39
I.1 Les PME formelles
40
I.2 Les PME informelles
40
Section II : Rôle des PME dans le
développement d'une Province ou d'un Pays
41
II.1. Le rôle économique des PME
42
II.1.1. Contribution à l'intégration
économique
42
II.1.2. Augmentation de la consommation des
ressources locales
42
II.1.3. Création des cheminées de
richesse
43
II.1.4. Intégration industrielle et
innovation technologique
43
II.2. Le rôle social des PME
43
II.2.1. Contribution à la lutte contre la
pauvreté
43
II.2.2. Contribution à l'ingestion du
chômage
44
Section III. Synthèse des
résultats
44
III.1. Statistiques de nombre de chômeurs
45
III.2. Statistiques de nombre de PME
créées dans la Ville de Matadi
45
Conclusion
46
BIBLIOGRAPHIE
47
TABLE DES MATIERES
48



