|

Université de Sfax
Institut des Hautes
Études Commerciales de Sfax
MEMOIRE
Pour l'obtention du diplôme de
MAITRISE EN THEORIES ET TECHNIQUES COMPTABLES
Concentration du marché de l'audit
des sociétés tunisiennes faisant
appel public à l'épargne
Elaboré par :
Akram DAOUD
Aymen HACHICHA
Encadré par :
Melle. Asma BOUCHEKOUA
ANNEE UNIVERSITAIRE 2007/2008
Dee,ee,e4
A mon père « MONGJ »
a*/ m'a /nd/~*éla donns vo/a an ma rappolant *a la
polonté a/t to*/o*rs
l~s rands dommas" d*'/l y tro*de l0 ir*/t dos
saer/~/ess eonsant/s po*r mon
éd*eat/on dt l'axpr~ss/on da mon amo*r
f/l/als st da mas r~eonna/ssaness
/n~/n/~s
A ma mère « NJSSAF »
a*/ a attand* atee pat/snes l~s /r*/ts da sa donns
éd*eat/on st po*r to*t
l'amo*r, l~ so*t/on dt l~s saer/~/ess(
a*o d/~* po*s protè s dt po*s pretà *n5 0onn~
santé"
A mon frère « Men »
a*/ no e~ss~ lama/s d')trs proeis mal réla d/stane~
.7*/ no*s sépare po*r
son sneo*ra sm~nt( st son s*/P/ da mon
trawa/l"
A ma sa*r « FAT MA »
On témo/ na s da mon rand r~spret st po*r sa
eon~/anes f*'alls m'a
aeeordé~, po*r m'alo/r parm/s da fa/rs e~tta
mémo/rs dans l~s donnas
eond/t/ons"
A toli~ eslir gli~ mon eont~l&li. 1 à ma
lo~mat/on
Olier es t~aPall golt éverpmssfon da ma Pfs
giatftlids dt da mon Avolond
attaeismant
DA OUD A f,am
DEDICACES
De plus pro~ond de mon coeur et avec un grandplaisirje
dédie ce travail
A mes chers parents;
.9V-ulle dédicace ne peut exprimer ce que je leurs
dois, pour tout l'amour qu'ils me portent, pour leurs sacri~ices et soutiens
illimités tout au long de ma vie que Dieu les préserve en bonne
santé et longue vie ;
A mes chers frères : 9klahdi, .7-famdi, (ais
Pour l'amour, l'encouragement, la joie et le bonheur qu'il
m'a toujours apporté ; que je lui souhaite tout le bonheur et le
sucées;
A toute la famille ;
A tous mes chers amis et collègues,
Pour tout encouragement et beau moment passé ensemble
;
A tout qui m'a connu et me partage tout bon
sentiment.
Avec ma pro~onde fidélité
Ayman
~~~~~~~~~~~~
C'est avec un grand plaisir que nous réservons ces
quelques lignes en signe de gratitude et de reconnaissance à tous ceux
qui ont contribué à l'élaboration de cette
mémoire.
Nous tenons à remercier vivement Melle
BOUCHEKOUA ASMA pour sa suivi rigoureux et méthodique de
l'avancement de ce mémoire, et pour sa dévouement et son
encouragement qu'elle nous a prodigués.
Et Nous tenons aussi à remercier Mme FAIKA
ESKANDAR CHARFI qui nous a donnés l'opportunité de
réaliser cette mémoire, ainsi pour le temps et les moyens qu'elle
nous a consacrés pour aboutir à l'accomplissement de notre
travail.
Nous tenons également à remercier et à
exprimer notre profond respect à tous les membres du jury qui ont bien
accepté de juger ce travail.
Nous remercions enfin toutes les personnes qui ont
contribué de manière directe ou indirecte à
l'élaboration de ce travail.
DAOUD Akram & HACHICHA Aymen
L'objectif de ce mémoire est d'étudier la
concentration du marché de l'audit tunisien avant et après la loi
relative au renforcement de la sécurité financière.
L'étude empirique porte sur des sociétés faisant appel
public à l'épargne sur la période 2004-2006. Les
résultats montrent que KPMG et Ernst and Young sont les leaders du
marché. Les parts de marché sectoriels restent partagés
entre plusieurs cabinets. Les BIG 4 n'ont pas une position dominante. À
la différence des études portant sur les pays anglo-saxons et la
France, les ratios de concentration confirment une tendance vers l'oligopole
ouvert, signe d'un marché globalement concurrentiel. Les ratios de
concentration globales et sectoriels sont en baisse après la
promulgation de la LSF. Nous pouvons conclure que l'obligation de
cocommissariat offre aux cabinets nationaux des opportunités pour
concurrencer les cabinets internationaux.
Mots clés : Concentration, marché
de l'audit, loi sur la sécurité financière LSF.
TABLES DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE 1 : Cadre théorique et revue de la
littérature 4
Section 1 : La perspective traditionnelle de
l'économie industrielle 5
Paragraphe 1 : Les éléments
fondamentaux 6
Paragraphe 2. Les implications de la relation
SCP 8
Paragraphe 3. Les limites du modèle
SCP 10
Section 2 : La perspective moderne de
l'économie industrielle 11
Section 3 : La situation concurrentielle du
marché d'audit 14
Paragraphe 1 : Le développement de la
concurrence 14
Paragraphe 2 : La pression de la demande
16
Paragraphe 3 : La concentration et la
segmentation du marché de 17
l'audit
Section 4 : Revue de la littérature
empirique 21
Paragraphe 1. Les études empiriques sur
la concentration du 21
marché d'audit
Paragraphe 2. Les conséquences de la
concentration des marchés 24
d'audit
CHAPITRE 2 : Concentration et compétitivité
du marché de l'audit des 28
sociétés tunisiennes faisant appel public
à l'épargne
Section 1. Les aspects
méthodologiques 29
Paragraphe 1. La mesure des parts de
marché (PDM) 30
Paragraphe 2. Les indicateurs de
concentration 31
Section 2. Présentation de
l'échantillon et des résultats 33
Paragraphe 1. Présentation de
l'échantillon 33
Paragraphe 2. Résultats de
l'étude 36
CONCLUSION GENERALE 49
BIBLIOGRAPHIE 52
ANNEXES 56
Annexe 1 : tableau des parts de marché
des différents réseaux d'auditeurs sur le marché tunisien
2004
Annexe 2 : tableau des parts de marché
des différents réseaux d'auditeurs sur le marché tunisien
2005
Annexe 3 : tableau des parts de marché
des différents réseaux d'auditeurs sur le marché tunisien
2006
INTRODUCTION
GÉNÉ RÂLE
Au cours des dernières années, la question de la
concentration du marché de l'audit a pris une importance
particulière suite au regroupement de plusieurs cabinets d'audit. En
effet, nous avons assisté au niveau international à la fusion en
1998 entre Price Waterhouse and Coopers & Lybrand, au regroupement de KPMG
avec Salustro Reydel en 2005 et à la fusion entre Deloitte et BDO Marque
& Gendrot en 2006. Le scandale financier d'ENRON a donné lieu
à la disparition d'Arthur Andersen en 2002. Ces différents
évènements ont ramené les BIG 8 aux BIG 4. Ils ont
généré des craintes quant aux conséquences d'une
concentration élevée du marché de l'audit.
D 'un point de vue économique, une concentration
excessive du marché a pour conséquence généralement
un risque de réduction de la concurrence et un risque de
complicité entre les principaux cabinets impliquant une augmentation des
honoraires et/ou une menace de la qualité de l'audit.
Les premiers travaux empiriques relatifs à la
concentration du marché de l'audit portent sur le marché
américain (Ivancevich et Zardkoohi, 2000 ; Asthana et al., 2004). Des
études plus récentes portent sur le Royaume-Uni (Beattie et al.,
2003 ; Beattie et al., 2008) et la France (Piot, 2006 ; Broyé, 2007).
Grant Thornton (2007) propose une comparaison internationale des pays du G8.
Ces études montrent que les marchés de l'audit dans les
différents pays sont concentrés avec quelques disparités
dans les secteurs. Le niveau de concentration le plus faible est
enregistré en France. Ce résultat est expliqué par
l'existence du co-commissariat.
Sur le marché tunisien, la concentration du
marché de l'audit n'a pas été abordée par aucune
recherche. Elle n'a pas même pris l'attention des spécialistes.
Mais cela n'empêche pas de craindre la situation concurrentielle et ses
implications sur le la qualité d'audit. Le législateur tunisien
l'a pris en compte en promulguant des réglementations rigoureuses. Il a
obligé certaines catégories de sociétés de designer
deux commissaires aux comptes pour la certification de ses états
financiers (article 13 ter du code des sociétés commerciales). En
plus, pour renforcer l'indépendance des
auditeurs, il a instauré le mécanisme de
rotation des auditeurs (l'article 13 bis du code des sociétés
commerciales)
Dans ce cadre, une question capitale se pose : sous l'effet
des regroupements de cabinets qui ont mené à une concentration
accrue du marché de l'audit à une échelle internationale,
quel est l'impact de la loi relative au renforcement de la
sécurité financière (LSF) sur la concentration du
marché de l'audit tunisien ?
Ce mémoire propose une analyse descriptive de la
concentration du marché tunisien d'audit légal des
sociétés faisant appel public à l'épargne en 2004,
2005 et 2006 : une période au cours de la quelle s'est instaurée
les systèmes de Co- commissariat et de rotation des auditeurs.
Nous testons l'hypothèse que les dispositions de la LSF
permettent de diminuer la concentration du marché de l'audit tunisien et
élargir le périmètre d'intervention des auditeurs sur le
marché au profit des cabinets nationaux.
Nous utilisons les parts de marché
pondérées et le ratio de concentration pour mesurer la
concentration du marché. Ces mesures sont calculées globalement
et par secteur. Notre échantillon est composé de 94
sociétés en 2004, 118 sociétés en 2005 et 129
sociétés en 2006.
Notre recherche est organisé comme suit. Dans un
premier chapitre, nous présentons le cadre théorique de notre
étude en se référant à la théorie de
l'économie industrielle et précisément le paradigme «
SCP », ainsi qu'une revue littérature des recherches
antérieures relatives à la concentration et la
compétitivité sur le marché de l'audit. Dans un
deuxième chapitre, nous exposons notre recherche empirique par une
présentation de l'échantillon étudié et une analyse
descriptive de la concentration sur le marché de l'audit en Tunisie.
CHAPITRE 2 ~
CADRE
THÉORIQUE ET
REVUE DE LA
LITTÉRATURE
La concentration et la compétitivité du
marché de l'audit ne peuvent être définies que par rapport
à un corpus théorique auquel ces mots se rattachent. Ce cadre
théorique est celui proposé par les théories
d'économie industrielle [Morvan (1991)].
Généralement, les économistes distinguent
entre la perspective traditionnelle et la perspective moderne issue des
théories d'économie industrielle [Beattie et al. (2003)]. Ainsi,
nous commençons par la présentation des deux paradigmes. Sur la
base de ces paradigmes, nous exposons les composantes du marché de
l'audit et la situation concurrentielle de ce marché. Dans une
quatrième section, nous procédons à la revue des
recherches empiriques.
Section 1: La perspective traditionnelle de
l'économie industrielle
Le paradigme traditionnel en économie industrielle pose
qu'il y a un rapport causal unidirectionnel liant la structure du
marché (nombre de prestataires, parts de marché
respectives et niveau de concurrence) au comportement des
firmes en présence (compétitivité des prix,
équilibre prix-qualité) et ensuite à la
performance économique (Figure 1.1). Ce paradigme est dit
S.C.P. Il a été conçu d'abord par Mason
(1939) et affiné par la suite par Bain (1968). Il a depuis lors
été largement utilisé pour analyser des industries et des
stratégies concurrentielles.
Source: Beattie et al. (2003, p. 14)
|
STRUCTURE
|
|
COMPORTEMENT
|
|
PERFORMANCE
|
|
|
|
|
|
|
Figure 1.1 : Apports de la perspective traditionnelle
d'économie industrielle
Paragraphe! : Les éléments fondamentaux
:
Selon l'approche SCP, les éléments fondamentaux
(Figure 1.2) pour l'analyse du fonctionnement d'un
marché sont :
> Les conditions de base : ce sont
l'environnement physique, légal,
social et économique dans lequel le marché
fonctionne.
> La structure du marché : ce sont les
caractéristiques de
l'organisation du marché (facteurs institutionnels,
environnementaux et physiques) qui permettent d'influencer la
compétition et la formation du prix à l'intérieur du
marché (nombre et taille commerciale des agents économiques,
crédits, barrières). Elle est mesurée en termes de
concentration du marché (offre et demande), d'existence et
d'intensité des barrières à l'entrée, de
degré de différenciation de l'offre (produits, services), de
normes et réglementations en vigueur, etc.
> « Comportement » signifie, selon
Ababacar MBENGUE (2005), « ce
que les firmes font et la manière dont elles le font
», en d'autres termes, les modèles de comportement utilisés
par les entreprises afin de s'adapter au marché. Ces modèles
comportent les stratégies de positionnement, de R&D, de production,
de détermination des prix, de distribution, etc. Ils renferment
également des variables de stratégies générales
comme les pratiques collusives ou encore les activités de fusions et
d'acquisition.
> « Performance » concerne aussi
bien les résultats de l'industrie dans
son ensemble que des firmes individuelles. Elle est
mesurée en termes de rentabilité, d'efficacité de
production, de progrès technique, de croissance, etc.
Goossens, Minten et Tollens (1994) définissent la
performance comme le résultat économique de la structure et de
son comportement. Elle concerne l'efficacité du marché à
certains niveaux (occupation, bien-être économique,
disponibilité des aliments, niveau des prix d'approvisionnement, etc.)
et la manière et la mesure dont les bénéfices sont
distribués dans la société.
Figure 1.2 : Les éléments fondamentaux de
l'approche SCP
|
CONDITIONS DE BASE
|
|
OFFRE
|
|
DEMANDE
|
|
·
|
Matières premières
|
·
|
Elasticité-prix
|
|
·
|
Technologie
|
·
|
Taux de croissance
|
|
·
|
Durée de vie des produits
|
·
|
Possibilité de substitution
|
|
·
|
Rapport valeur/poids
|
·
|
Conditions de commercialisation
|
|
·
|
Règles de la profession
|
·
|
Caractéristiques cycliques ou
|
|
·
|
Conditions syndicales
|
saisonnières
|

|
STRUCTURES DES MARCHES
|
· Nombre de vendeurs et d'acheteurs
· Différenciation des produits
· Barrières à l'entrée
· Structure des coûts
· Intégration verticale
|
|

COMPORTEMENT
|
· Politique de prix
· Politique de production
· Politique de recherche et développement
· Publicité
· Tactiques juridiques
|
|

PERFORMANCE
|
Efficacité dans :
· La production
· L'allocation des ressources
· Le progrès technique
· L'emploi
|
|
Source: Cours Economie Industrielle de
production (Université de Bordeau IV)
Les hypothèses du paradigme « SCP
» sont les suivantes :
ü La « Structure » affecte le
«Comportement»
Une concentration faible du marché (expliqué
par un nombre élevé de firmes, une différenciation des
produits, moins de barrières à l'entrée, etc.) augmente la
compétitivité et diminue les prix.
ü Le « Comportement » affecte la «
Performance »
Une compétitivité importante diminue le pouvoir
des marchés (le pouvoir du marché s'explique par la fixation des
prix au-dessus de ceux qui seraient fixé dans un marché
compétitif).
Le postulat « SCP » suppose qu'une concentration
élevée du marché (un nombre plus réduit de firmes)
conduit généralement à une concurrence moins vive
(exprimé par des prix plus élevés et des volumes plus
faibles).
Paragraphe 2 : Les implications de la relation SCP
:
La relation SCP suppose que les comportements et les
performances dans une industrie sont déterminés par les
structures de cette industrie. Plus explicitement, le nombre, la taille et la
concentration des offreurs, d'une part, et les conditions d'entrée et la
réglementation, de l'autre, déterminent les résultats des
firmes.
Dans ce modèle, la structure de la majorité des
industries est une structure intermédiaire entre la concurrence parfaite
et le monopole. Il s'agit donc de déterminer dans quelle mesure le
niveau des prix et celui des résultats demeurent proches de ceux de la
concurrence ou, au contraire, s'approchent de ceux du monopole. Le
critère de base étant celui d'une structure productive
efficiente.
Ainsi, si les entreprises arrivent à coordonner leurs
activités, elles imposent des prix de monopole et réalisent des
bénéfices de monopole. Toutefois, lorsqu'il y a entente, chaque
entreprise a intérêt à ne pas respecter l'accord et donc
à diminuer
ses prix pour accroître sa part de marché au
détriment des autres. Stigler (1964) démontre que plus le nombre
d'entreprises augmente, plus il est difficile d'identifier les comportements
déviants et de les pénaliser.
De ce fait, l'effet de la structure du marché sur le
comportement et par conséquent sur la performance peut être
résumé en procédant à la comparaison entre deux
marchés qui ont des structures différentes (Figure
1.3) :
Figure1.3 : Comparaison de deux cas possibles de
marché
|
Marché1
|
Marché2
|
|
Caractéristiques structurelles
|
· Beaucoup de vendeurs et d'acheteurs
· Produits homogènes
· Pas de barrières à l'entrée
|
· Peu de firmes avec concentration possible des
acheteurs
· Produits plus différenciés
· Existence de barrières à l'entrée
(et à la sortie)
|
Comportements
|
· Pas d'action
autonome des acteurs
· Pas de superprofit
|
· Conduite variable et autonome
· Existence de superprofit
|
Performance
|
· Allocation optimale des facteurs
· Pas d'innovation
|
· Allocation non optimale des facteurs
· Innovation probable
|
|
Source: Cours Economie Industrielle de
production (Université de Bordeau IV)
Selon Dietsch (1992), d'autres caractéristiques du
marché amplifient également la difficulté d'identification
du comportement des acteurs. Il cite en particulier le taux de croissance du
marché, l'innovation, l'existence de fortes relations de
clientèle ou encore la différenciation des produits.
Les travaux de Bain (1956, 1968) prouvent l'importance
stratégique des barrières à l'entrée dans la
détermination des structures et des performances des marchés.
Dans ses travaux, Bain se concentre sur la question du pouvoir de marché
ou de monopole. Il définit le pouvoir de marché comme la
capacité des firmes établies à fixer leurs prix de vente
au dessus du seuil des prix d'équilibre dans un marché
parfaitement concurrentiel. En presence des barrières à
l'entrée, Bain montre que le pouvoir de marché, induit par la
concentration en faveur des grandes firmes,
pourrait déboucher sur des profits excessifs en cas de
conditions d'entrée difficiles. Donc, la présence de fortes
barrières à l'entrée dans un marché influence
à la fois les comportements des firmes établies, la structure et
les performances du marché.
Paragraphe 3 : Les limites du modèle SCP
:
1. Limites de la relation SCP
M.Rainelli (1993) pense que les limites ont pour origine la
chaîne de causalité entre « Structure », «
Comportement » et « Performance » est univoque. Elle commence
des structures de marché pour arriver à la rentabilité.
Or, ce sens de causalité peut être contesté car les profits
des firmes peuvent également avoir une influence sur les structures des
marchés. En outre, la prise en compte des comportements n'est pas
satisfaisante. Les firmes peuvent avoir des comportements stratégiques
et peuvent par leur action influencer les structures des marchés. Donc,
l'indépendance des structures est mise en cause.
2. Industrie multiproduits et rendements
croissants
Certains auteurs ont contesté la signification
accordée dans ce modèle à la notion de pouvoir de
marché. Dietsch (1992) considère que les limites fondamentales du
modèle SCP traditionnel reposent sur le fait qu'il échoue
à rendre compte du fonctionnement d'une industrie composée
d'entreprises multiproduits et produisant en situation de rendements
d'échelle croissants. Dans ce cas, les résultats peuvent
être contradictoires. En effet, si l'industrie est
caractérisée par des rendements d'échelle croissants, le
modèle prévoit qu'elle comporte un petit nombre d'entreprises,
voire une seule. La structure productive efficiente est en conséquence
une structure de monopole. Or, le modèle SCP conclut à
l'inefficience et à la nonoptimalité sociale d'une industrie
monopolisée.
Section 2 : La perspective moderne de l'économie
industrielle
Le paradigme SCP a connu de nombreuses critiques. Il est
qualifié de naïf par Beattie et al. (2003). Ces critiques ne se
limitent pas à la contestation de la causalité à sens
unique assumée par la forme la plus simple du paradigme et
s'étendent aux problèmes du choix des variables constitutives de
la « structure », du « comportement » ou de la «
performance ». En réalité, tant la théorie
économique la plus ancienne que la plus récente ont
examiné les propositions du paradigme SCP et ont démontré
que le lien uniforme entre la concentration et la performance du marché
disparaît dans des conditions particulières.
Le paradigme moderne dévie de cette stricte
causalité au profit d'une vision plus sophistiquée, selon
laquelle la concentration et la performance sont conjointement
déterminées par les paramètres de l'offre et de la
demande (Figure 1.4)
Figure 1.4 : La perspective moderne des théories
d'économie industrielle


Source: Beattie et al. (2003, p. 14)
Déterminants de l'offre et la demande
|
|
COMPORTEMENT
|
|
|
|
STRUCTURE
|
|
|
PERFORMANCE
|
Beattie et al. (2003) indiquent que l'utilisation d'une
relation indirecte basée sur des déterminants de l'offre et de la
demande est utile pour comprendre la relation entre la structure du
marché, le comportement des acteurs et la
performance. Ces déterminants permettent de retrouver
une situation d'équilibre sur le marché. En effet, une
augmentation de la taille n'a pas forcément des effets négatifs.
Des considérations stratégiques entrent en jeu pour conditionner
la relation entre la structure du marché et la performance
économique [Beattie et al. (2003) et Piot (2006)]. Ces composantes sont
fonction de la capacité des acteurs à améliorer
l'efficience de la production des biens et des services [Piot (2006)].
Dans des recherches anciennes et pour argumenter cette
approche, Friedman (1971) et d'autres ont montré que même un grand
nombre de firmes au sein d'un marché peuvent s'associer pour pratiquer
des prix élevés dans une vision à long terme. En effet,
les profits temporaires qu'une firme pourrait individuellement dégager
aujourd'hui en engageant une guerre des prix contre ses concurrents pourraient
être plus que compensés par des pertes suivantes si ses
concurrents exercent des représailles en baissant leurs prix à
leur tour.
Dans le même courant d'idée, le travail de
Baumol, Panzar et Willig (1982) portant sur la théorie des
marchés disputables (« contestable markets ») a
montré qu'une politique de prix basée sur un prix proche au
coût de revient peut conduire à n'importe quel nombre de firmes
dans un marché. En effet, cette politique est possible si les nouveaux
entrants sont en mesure d'attirer des clients en pratiquant des prix
inférieurs et par la suite réaliser des profits leur permettant
de contourner les barrières à la sortie en cas de
représailles des firmes en place.
Ces résultats interpellent deux des postulats de base
du paradigme SCP : Premièrement, la théorie des marchés
disputables se concentre sur la compétition potentielle plutôt que
la compétition actuelle. La menace des entrants potentiels force les
firmes en place sur le marché à réduire au minimum leurs
dépenses de production et à agir comme si elles étaient
dans un marché purement concurrentiel.
Deuxièmement, et en liaison avec le premier point, la
théorie des marchés disputables implique qu'une structure
particulière du marché n'est pas nécessairement
associée à un niveau particulier de performance. Dès lors,
l'importance particulière accordée au degré de
concentration par la plupart des
travaux s'inscrivant dans la logique du SCP apparaît
sinon injustifié, du moins clairement démesuré. En fait,
les conditions les plus importantes sont le degré d'absence de
barrières à l'entrée et à la sortie. Il ne saurait
y avoir de surprofit dans un marché parfaitement disputable.
Mais la critique la plus importante du paradigme SCP
fondée sur la nouvelle théorie économique est celle
véhiculée par la théorie
évolutionniste du changement économique
développée par Nelson et Winter (1982).
La théorie économique évolutionniste
identifie les capacités dynamiques de firmes comme les
déterminants de leur comportement stratégique et de leur
performance. Similairement à la théorie des marchés
disputables, la théorie économique évolutionniste met
l'accent sur le manque de « réalisme » de la théorie
économique orthodoxe. Par exemple, il est connu que les managers de
plusieurs firmes fixent les prix à un certain pourcentage fixé
au-dessus du coût, en se basant sur un principe simple non conforme aux
stratégies typiquement analysées dans le cadre de l'approche
SCP.
Nash (1990) étudie le cas des firmes qui
considèrent coûteux d'acquérir de l'information sur le
marché ou d'ajuster leurs plans. Une implication de ce comportement des
firmes est que la structure des marchés n'aurait aucun impact
prévisible sur les (politiques de) prix ou les profits des firmes.
On sommant, Les différents critiques adressés
à la théorie d'économie industrielle ont pu la rendre plus
adaptée à tous les secteurs d'activité. Ainsi, les
perspectives traditionnelle et moderne issues des théories
d'économie industrielle constituent un cadre de référence
pour positionner le marché de l'audit.
Section 3: La situation concurrentielle du marché
d'audit
Les cabinets d'audit, en tant qu'organisations
économiques, sont en effet sous l'influence de différents
facteurs qui ont créé de fortes évolutions sur leur
marché :
· Le développement de la concurrence a
entraîné une modification des relations entre professionnels.
· A cette évolution au niveau de l'offre de l'audit
s'ajoutent des pressions au niveau de la demande.
La combinaison de ces deux éléments donne lieu
à une nouvelle structure du marché de la certification,
caractérisé désormais par une concentration de l'offre qui
répond à une segmentation de la clientèle.
Paragraphe 1 : Le développement de la
concurrence
Jusqu'à la fin des années 1980, la profession a
connu un développement très rapide. A partir des années
90, le métier connaît une période d'arrêt. Ces
dernières années, la profession ne réalise pas les taux de
croissance élevés réalisés auparavant même si
elle connaît à nouveau une progression. En tant qu'industrie
parvenue à maturité, nous assistons donc dans le marché de
l'audit, comme toute activité économique, à une
évolution des relations entre professionnels. En effet, dans un
marché saturé, la croissance ne peut se faire qu'aux
dépens des confrères [Bazerman et al. (1997)].
La concurrence entre les professionnels se manifeste par la
création de cultures de cabinets fortes qui dépassent les valeurs
générales de la profession. Des recherches avancées par
Ponemon (1992) montrent que l'identification des auditeurs à leur
profession est dominée par la valorisation des intérêts.
D'un côté, chaque grand cabinet cherche en
particulier à développer des avantages concurrentiels sur ses
confrères, tels que la spécialisation ou la mise en oeuvre de
méthodologies originales. Les différents cabinets d'audit
cherchent à être plus compétitifs en offrant des services
de qualité et en améliorant l'efficacité
générale du cabinet. Ainsi, le potentiel de croissance des
cabinets d'audit dépend de la façon dont ils construisent et
maintiennent un audit de qualité [Richard (2000)].
Mais d'un autre côté, nous remarquons le
développement de la publicité par les cabinets. Un tel
mécanisme est contradictoire avec l'approche traditionnelle de
l'activité en tant que profession libérale.
La pression du marché a conduit les cabinets d'audit
à fournir des prestations dans des conditions de
compétitivité accrue. Eichenseher et al (1983), Cushing et al
(1986), Danos et al (1986), Kinney (1988), Wheeler et al (1990), Maher et al
(1992) et Manson et al (1998) remarquent l'augmentation de la concurrence dans
le marché d'audit. Les recherches ont démontré que la
concurrence a généré :
1. Le comportement opportuniste de certains membres, qui
cherchent à profiter de la réputation de la profession sans se
conformer à ses contraintes, peut être source de tensions [Moizer
(1995)].
2. la domination des structures les plus importantes au sein
des organisations professionnelles peut faire en sorte que leurs
intérêts prennent le pas sur ceux de la profession [Dirsmith &
Haskins (1991)].
3. les pressions concurrentielles sont susceptibles d'entraver
l'unité de la profession.
Nous pouvons conclure que l'augmentation de la concurrence a
poussé les firmes d'audit à pratiquer des stratégies qui
ont un effet sur la structure du marché (grands cabinets et petits
cabinets) et sur l'homogénéité de la profession. Ces
conclusions sont cohérentes avec la perspective moderne.
Paragraphe 2 : La pression de la demande
Les cabinets subissent une forte pression sur les honoraires
de la part de leurs clients. De manière générale, les
entreprises, à la recherche d'économies, font pression sur leurs
fournisseurs. Etant donné que les entreprises pensent que l'audit n'a
aucune valeur ajoutée opérationnelle, elles exercent des
pressions sur leur cabinet d'audit. Beaucoup de cabinets sont ainsi
amenés à réviser leur niveau d'honoraires à la
baisse sous la pression de leurs clients. Pour combler cette réduction,
les cabinets recourent à une diminution du volume horaire des
interventions ou bien à une réduction du taux horaire de
facturation. La qualité d'audit va être
dépréciée voir même l'expression d'une opinion sur
les états financières sera non fiable. Pour remédier
à ce problème, les instances professionnelles françaises
par exemple ont fixé des interventions horaires minimales en fonction de
la taille de l'entreprise contrôlée, mais l'impact peut rester
important. Fischer (1996) montre que les relations entre les cabinets et leurs
clients tendent de plus en plus à mettre en avant la négociation
sur les prix, de manière parfois particulièrement rugueuse. En
Tunisie, ce probleme d'honoraire ne se pose pas. Les honoraires sont
fixés par un barème en fonction du total bilan des entreprises,
total des produits ou l'effectif global mais cela n'empêche pas les
pratiques de réductions contraire à la réglementation.
Beattie & Fearnley (1998) pensent que le recours à
la pratique des appels d'offre pour l'octroi des missions d'audit ne peut
qu'accentuer les tendances à la baisse.
La tendance à la baisse des honoraires est en outre
encouragée par la pratique qui consiste à diminuer le montant des
honoraires d'audit en espérant profiter de la relation
créée avec le client pour proposer d'autres services susceptibles
de dégager davantage de marge (conseil juridique, conseil fiscal ou
conseil en management). Cette situation est contraire à la
déontologie professionnelle traditionnelle des commissaires aux comptes,
ce qui illustre le changement de mentalité et de méthodes
intervenu sur le marché de la certification. Pour contourner ce
problème,
les lois sur la sécurité financière
(Sarbanes Oxley aux Etats-Unis et la loi n ° 2003- 706 du 1 er août
2003 en France) ont interdit le cumul de mandat de commissariat aux comptes
avec d'autres missions. Cette disposition est instaurée en Tunisie par
le code de commerce et le code des devoirs professionnels et reprise par le
code des sociétés commerciales en 2000.
Associée à la concurrence, la pression sur les
honoraires s'est manifestée par des défaillances et des
dépôts de bilan de cabinets en difficulté. Le corollaire de
cette évolution est le développement des regroupements, fusions
et rachats de cabinets qui contribuent à la concentration de la
profession. Cette évolution est conforme avec les prédictions de
la perspective moderne.
Paragraphe 3 : La concentration et la segmentation
du
marché de l'audit
La concurrence entre cabinets a entraîné un
changement de la nature des acteurs du marché. La profession est
dominée par de grosses structures intégrées à des
réseaux nationaux ou internationaux dont la logique économique et
les valeurs s'opposent avec celles du commissaire aux comptes traditionnels,
dont l'approche s'apparente plutôt à celle d'une profession
libérale. Le marché tend à se segmenter entre les gros
cabinets internationaux, les autres cabinets d'audit structurés à
dimension plus nationale et les cabinets à vocation purement
régionale ou locale. Casta et Mikol (1999) affirment que cette
segmentation reflète elle-même une segmentation au niveau de la
clientèle entre les petits clients et les grosses sociétés
ou groupes à forte visibilité. L'émergement des grands
groupes multinationaux, dont l'audit s'effectue à un niveau
international, a suscité le recours à des réseaux de
cabinets pour assurer l'homogénéité des traitements et
réaliser des économies d'échelle.
A ces différences de taille entre cabinets s'ajoutent
également des différences de culture dues à l'emploi de
méthodologies plus ou moins organisées et informatisées,
au recours au personnel différent (jeunes diplômés de
grandes écoles
ou lieu des filières comptables classiques) et à
des relations humaines particulières (le professionnalisme par
opposition à une approche paternaliste). Cependant, l'opposition entre
petites et grandes structures peut être nuancée. En effet, les
petits cabinets peuvent bénéficier des évolutions
méthodologiques développés par les grands et de leurs
efforts pour développer et défendre la profession. Dans ce cas,
l'écart semble surtout exister entre les cabinets qui peuvent se
familiariser aux nouvelles technologies d'audit et conditions
économiques et culturelles et les autres qui sont attachés
à l'attitude traditionnelle du commissaire aux comptes. Cette
évolution du marché de l'audit est similaire à
l'évolution dans d'autres secteurs.
Sur le plan économique, la concentration de la
profession a pour conséquence un problème éventuel de
collusions entre les acteurs pour diminuer le degré de concurrence sur
les prix. Les études empiriques réalisées aux Etats-Unis
sur différentes périodes ont contrairement montré que les
inquiétudes relatives à l'existence de collusions ne sont pas
fondées. En fait, la pratique du lowballing (la diminution des
honoraires pour obtenir un client) a plutôt permis d'aboutir à une
rotation satisfaisante des auditeurs.
Les stratégies de regroupement ont souvent pour
objectif la recherche d'économie d'échelle et des gains
d'efficience. Ces stratégies ont une place prépondérante
dans l'activité d'audit. La concentration du marché conduit en
effet à deux stratégies des cabinets :
- la recherche des gains d'efficience ; et /ou
- l'accroissement de leur pouvoir de marché.
Sous la pression concurrentielle, les gains d'efficience
seront en tout ou partie supportés par les clients engendrant une
augmentation de la compétitivité du service d'audit. Tandis
qu'une hausse de la concentration des auditeurs n'est pas en soi une mauvaise
chose. En effet, si les fusions entre les cabinets engendrent des situations de
monopole, quasi-monopole ou d'oligopole sur le marché, imposant des
barrières à l'entrée et des honoraires excessifs aux
sociétés clientes, alors le pouvoir
de marché va accroître. La Figure
1.5 développée par Piot (2006) illustre ce double impact
contradictoire des fusions de cabinets.
Figure 1.5 : Les effets des fusions de
cabinets
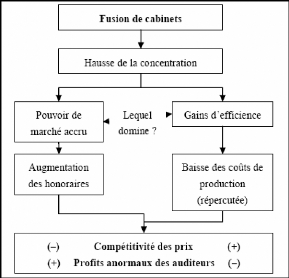
Source: Piot (2006, p. 3)
Selon la figure 1.5, les fusions de cabinets d'audit
produisent une situation concurrentielle se caractérisant par une
relation jointe entre concentration et compétitivité. Cette
relation dépend de l'effet « dominant » du renforcement des
positions dominantes des producteurs ou des gains d'efficience induit par le
regroupement. Sur la base des indicateurs de concentration, Shepherd (1997)
identifient six grandes formes de marché, synthétisées
dans la Figure 1.6.
Figure 1.6 : Classification des marchés selon leur
niveau de
concentration

Source: Piot (2006, p. 4)
En conclusion, compte tenu des caractéristiques
développées du marché de l'audit, la perspective
traditionnelle et moderne de l'économie industrielle semble à
priori applicable à ce marché.
Selon la perspective traditionnelle, les économistes
industriels énoncent l'existence de relations causales directes entre
les structures d'un marché, les stratégies des entreprises sur ce
marché et leurs performances économiques. En effet, une forte
concentration des fournisseurs favorise la collusion, diminue la
compétitivité des biens ou services offerts (en terme de prix ou
de qualité), et permet de générer des rentes anormales de
type oligopolistiques. Or, similairement aux autres secteurs d'activité
économiques, l'ensemble des études réalisées ces
dernières années sur la structure du marché de l'audit [ex
: Beattie et Fearnley (1994), Piot (2006)] souligne une diminution du nombre
des acteurs majeurs dans le marché d'audit et sa domination par les
« BIG four ». Suite aux fusions, les grands réseaux d'audit
sont passés de huit à quatre.
Toutefois, le paradigme moderne se détourne de cette
stricte causalité au profit d'une conception plus sophistiquée
préconisant que la concentration et la performance sont conjointement
déterminées par les paramètres d'offre et de
demande [Beattie et al. (2003)]. Selon cette approche, une
concentration accrue n'a pas forcément des effets négatifs car
l'effet dépend de la capacité des prestataires à
améliorer l'efficience de la production des biens et des services [Piot
(2006)]. Par exemple, une opération de regroupement peut
générer des économies d'échelle (frais de
structure) ou des gains d'apprentissage (expertise sectorielle,
compétences spécifiques). Pour appliquer ce paradigme, les
chercheurs utilisent généralement le modèle d'honoraires
d'audit (Audit Fee Model) pour analyser la taille et déterminer
une situation d'équilibre entre l'offre et la demande au sein du
marché de l'audit.
Section 4 : Revue de la littérature empirique
:
Plusieurs travaux empiriques ont cherché à
mesurer et à expliquer la concentration du marché de l'audit,
particulièrement aux États-unis et au Royaume- Uni. Plus
récemment, des recherches similaires sont réalisées le
marché français. D'autres études s'intéressent
à l'effet de la concentration du marché de l'audit.
Paragraphe 1: Les études empiriques sur
la
concentration du marché d'audit
Pour les études portant sur la concentration du
marché, nous nous intéressons aux études
récentes.
Piot (2006) étudie la concentration de l'offre et
l'intensité concurrentielle du marché de l'audit français.
Il explique les effets des fusions entre les réseaux d'auditeurs sur la
compétitivité du marché. L'échantillon
étudié représente l'ensemble des sociétés
cotées fin 1997 et fin 2003. Cette période se caractérise
par le passage des « BIG Six » aux « BIG Four », ainsi que
par une segmentation sectorielle de ce marché.
Les résultats empiriques montrent une hausse de la
concentration globale. Cette concentration concerne également la
majorité des secteurs étudiés, bien que
certains affichent une diminution. Les ratios de concentration
déterminés confirment une tendance vers l'oligopole restreint, et
par conséquent un marché globalement non-concurrentiel. Le
chercheur remarque aussi la quasi-absence des secteurs de type « ouverts
» et la dominance des structures de type « fermés ».
Toutefois, même si le marché dans sa
globalité et un nombre croissant de secteurs sont
caractérisés par un oligopole restreint, l'intensité
concurrentielle, mesurée par les indices de Herfindahl, reste assez vive
entre les [quatre ou six, selon les segments] grandes firmes d'audit. En fin
2003, les indices de Herfindahl calculés sur les neuf principaux
réseaux d'audit en activité - restent dans la zone de concurrence
monopolistique pour la plupart des secteurs (entre 0,20 et 0,40). Dans cette
situation, la concurrence par les prix demeure et les auditeurs sont
encouragés à différencier leurs services.
Piot conclut donc que la vague de concentration
observée entre 1997 et 2003 a une probabilité faible engendrer
une hausse exagérée des honoraires d'audit, ou encore une
diminution de la qualité d'audit.
En plus, les indices de Herfindahl calculés montrent
que certains secteurs d'activité sont plus concurrentiels que d'autres.
Les regroupements et autres fusions de firmes d'audit ont eu un effet de
redistribution des parts de marché dans des secteurs comme la
chimie-pharmacie et les services. Cette relative « ouverture » du
marché français est due à l'obligation de co-commissariat
aux comptes. Cette obligation a pour effet de permettre aussi aux cabinets
d'audit nationaux de conserver un part de marché sur le segment des
sociétés cotées.
Toutefois, les résultats de Piot montrent des
différences sectorielles importantes. Les caractéristiques
propres aux secteurs d'activité peuvent expliquer les différences
d'intensité concurrentielle. Par exemple, la culture ou les usages du
secteur et les qualifications et les compétences requises pour effectuer
les diligences nécessaires (complexité et les risques de
l'entreprise auditée) peuvent expliquer ces disparités
sectorielles.
Broyé (2007) analyse la concentration du secteur
d'audit en France. Son échantillon est composé de 428
sociétés cotées en bourse, soit 854 mandats de commissaire
aux comptes titulaires. Il utilise comme variable les honoraires d'audit
payés en 2005. Il démontre que la concentration du marché
est forte. Les BIG 4 disposent près de la moitié des mandats,
soit en termes d'honoraires, 86 % des parts de marché. Le cabinet Ernst
& Young détient à lui seul 33 % des parts de marché.
Toutefois, il constate des disparités en fonction des secteurs
d'activité et des compartiments de cotation des sociétés
auditées. Alors que les parts de marché des BIG 4 sont
importantes sur le compartiment A (91 % des honoraires d'audit), elles sont
plus faibles sur le compartiment C, où elles ne détiennent qu'un
tiers des mandats. Finalement, il compare ces résultats avec ceux
observés en Angleterre, où les « BIG four »
perçoivent 99 % des honoraires payés par les 350 premières
entreprises. La comparaison montre que les 428 sociétés de
l'échantillon ont été auditées par 272 cabinets
différents. Ce résultat fait ressortir la
spécificité de la réglementation française qui
impose le co-commissariat.
Grant Thornton1 (2007) étudie la
concentration des acteurs de l'audit dans les pays du G8. Les résultats
de l'analyse de la concentration des auditeurs au sein des économies du
pays du G8 montrent un pic de 99% en Italie, suivie par le Royaume- Uni 98% et
les Etats -Unis 97%.
En Allemagne, le niveau de concentration est relativement
moins élevé soit 83%. Le niveau de concentration le plus faible
des pays du G8 est affiché en France soit 61%. Ce taux est
expliqué par l'existence du co-commissariat aux comptes.
L'étude conclut que la concentration des acteurs de
l'audit dans les pays du G8 explique l'énorme déséquilibre
du marché qui est associé à un risque de
1 Grant Thornton International est une organisation mondiale qui
n'exerce pas d'activité et ne fournit pas de services en son nom propre
ou par d'autres voies.
réduction de la concurrence et en plus une qualité
d'audit plus faible. Elle engendre un risque systémique dans les
marchés financiers internationaux.
Abidin, Beattie et Goodacre (2008) étudient la
concentration du marché de l'audit et le taux des honoraires d'audit
payés par l'ensemble des entreprises industrielles qui figurent sur la
liste du marché local de Grande Bretagne à partir de
l'année1998 jusqu'à 2003. La concentration est mesurée
selon deux critères : le nombre des auditeurs et les honoraires
d'audit.
A partir des résultats obtenus, ces auteurs trouvent
que le marché britannique, comme le marché français, se
caractérise par une structure de type oligopole restreint. En se basant
sur les honoraires d'audit, la part de marché des BIG a connu une
légère augmentation de 1% en 2003 par rapport à 1998. En
revanche, basé sur le nombre d'audit, les parts de marché
diminuent de 76% en 1998 à 68% en 2003. En outre, des indices plus
précis ont montré une légère diminution sur tout le
marché.
La compétitivité entre les cabinets d'audit est
accrue. En effet, Le ratio de changement des auditeurs calculé sur toute
la période est élevé par rapport aux autres recherches qui
ont été faites auparavant.
Cette étude explique l'effet de la disparition du
cabinet Anderson sur la concentration du marché britannique. Cette
disparition a pu diminuer le degré d'inégalité entre les
BIG eux-mêmes. Les parts de marché faibles des cabinets d'audit
non BIG montrent l'existence des barrières à l'entrée.
Paragraphe 2 : Les conséquences de la
concentration des marchés d'audit
Plusieurs travaux posent la question : Est ce que les
regroupements et les fusions des cabinets ont généré une
augmentation du pouvoir de marché et/ou une amélioration de la
qualité d'audit ? Le pouvoir de marché est reflété
par le niveau des honoraires et la rentabilité des firmes d'audit.
Selon l'étude de Iyer et al. (1996) portant sur le
marché britannique, les mégafusions de 1989 n'ont pas
généré une augmentation des honoraires. Ils concluent
qu'elles ont un effet neutre sur la compétition.
Choi et Zéghal (1999) examinent l'effet de la fusion
sur la rentabilité des firmes d'audit. La rentabilité est
mesurée par le résultat par collaborateur avant et après
fusion. Ils trouvent que la performance des grandes entreprises n'est pas
significativement différente des petites entreprises dans plusieurs
pays. Ils concluent que une forte concentration n'entraîne pas
nécessairement une faible compétition.
Ivancevich and Zardkoohi (2000) montrent que les fusions ont
tendance à augmenter la concentration de l'industrie face à
l'augmentation des barrières à l'entrée et la
réticence des clients pour le changement des auditeurs. Cette situation
peut engendrer une augmentation des honoraires ou bien des économies
d'échelle.
Thavapalan et al. (2002) montrent que la fusion entre Price
Waterhouse et Coopers & Lybrand a augmenté la part de marché
des BIG 5. Toutefois cette fusion a entraîné une dispersion plus
équitable des clients de l'audit dans certains secteurs en Australie.
D'autres études ont étudié les
conséquences de la défaillance d'Anderson sur le marché de
l'audit.
Asthana et al. (2004) montrent que le taux des honoraires de
l'audit (pourcentage total actif) des entreprises américaines a
augmenté considérablement en 2002 suite au scandale d'Enron
surtout pour les clients risqués et de grandes tailles. En effet, les
sociétés ne possèdent pas les mêmes risques sur le
marché. Après la défaillance d'Anderson, les cabinets
d'audit tiennent en considération le facteur de risque dans la
détermination de leur honoraire.
Ils trouvent également que les anciens clients
d'Anderson bénéficient d'une
réduction des honoraires
d'audit comparés aux honoraires payés aux BIG 4 dans
des entreprises similaires. Ce résultat est consistent
avec l'existence de compétition entre les cabinets pour l'audit de ces
entreprises.
L'étude de Basioudis et Papadimitriou (2007) ne
confirme pas ces résultats dans le contexte britannique. Les
résultats ne montrent aucun changement dans les honoraires de l'audit
ajustés entre 2001 et 2002 pour les clients antérieurs
d'Andersen.
Conscient de la dominance des cabinets anglo-saxons sur le
marché de l'audit et afin de protéger les cabinets
français, le législateur français a prévu
l'obligation de désigner au moins deux commissaires aux comptes dans les
sociétés faisant appel public à l'épargne.
Selon le cabinet Mazars, « le co-commissariat se
présente comme une solution intéressante aux dysfonctionnements
rencontrés dans le contrôle des comptes et la Corporate Governance
des grandes entreprises »2.
Ainsi, la désignation d'un deuxième commissaire
aux comptes vise à lutter contre le risque de voir les cabinets BIG
s'approprier les mandats de la quasi- totalité des grands groupes
français.
Piot (2005) pense que cette obligation légale de
co-commissariat aux comptes fait du marché français
potentiellement plus « ouvert » que les marchés
anglo-saxons.
Piot (2006) trouve que, en 1997, bon nombre de moyennes ou
grandes firmes françaises optent pour les services d'un BIG 6
conjointement avec réseau national. Ce résultat est
confirmé par les travaux de Broyé (2007). L'obligation de
cocommissariat aux comptes rend le marché français plus ouvert
que le marché britannique.
2 Mazars (2003), « Opinions sur l'audit, Le joint-audit
: une solution d'avenir selon Mazars »,
www.mazars.fr.
Toutefois, Noël (2005) montre que cette obligation
profite essentiellement aux cabinets BIG 4. Les honoraires versés aux
auditeurs BIG, en cas de cocommissariat aux comptes, sont supérieurs
à leurs confrères non BIG.
En résumé, les études empiriques
démontrent que la fusion et le regroupement des cabinets, à
l'échelle international, ont généré des
marchés de l'audit concentrés aux Etats-Unis, en Allemagne, en
Royaume-Uni et en France. Cette structure du marché a un effet sur les
honoraires et la rentabilité des cabinets d'audit. L'instauration de
cocommissariat par le législateur français a permis de diminuer
la concentration du marché.
Il est dés lors intéressant d'étudier la
concentration du marché de l'audit en Tunisie.
CHAPITRE 2 ~
ÉTUDE EMPIRIQUE
SUR LE MARCHÉ
DE L'AUDIT EN
TUNISIE
L'objectif de l'étude est d'analyser la concentration
du marché de l'audit en Tunisie avant et après la loi relative au
renforcement de la sécurité financière. Nous proposons de
tester l'hypothèse que la concentration du marché de l'audit
tunisien est plus faible après l'entrée en vigueur de la LSF.
L'étude est établie sur la base des rapports annuels
publiés par les sociétés tunisiennes faisant appel public
à l'épargne au titre des exercices 2004, 2005 et 2006.
La première section de ce chapitre est consacrée
à la présentation des aspects méthodologiques. Dans la
deuxième section, nous présentons notre échantillon et les
observations empiriques.
Section 1 : Les aspects
méthodologiques
La majorité des études portant sur la
concentration du marché de l'audit propose une analyse globale. Ces
recherches permettent d'apprécier les incitations et contraintes
économiques au niveau de la production de ce service. Piot (2006) et
Beattie (2008) abordent également la concentration de manière
segmentée, au niveau du secteur d'activité des
sociétés auditées.
Trois mesures de concentration du marché ont
été appliquées précédemment dans les
études sur le marché de l'audit. Les deux mesures
employées couramment sont le ratio de concentration (CR) et Indice de
Hirschman-Herfindahl (HI). La troisième mesure, le coefficient de Gini,
est utilisée dans plusieurs études économiques relatives
à l'inégalité des richesses. Cette mesure est relativement
neuve pour les études portant sur le marché de l'audit. Elle a
été employée par Quick et Wolz (1999) dans leur recherche
sur le marché de l'audit allemand et récemment par l'étude
de Beattie et al. (2008) portant sur le marché de l'audit
britannique.
Le calcul des indicateurs de concentration nécessite la
détermination préalable des parts de marché de chaque
auditeur.
Paragraphe 1 : La mesure des parts de marché
(PDM)
Les travaux antérieurs sur la concentration calculent
les PDM selon deux approches : (1) le nombre de clients détenus, (2) les
honoraires d'audit ou, à défaut, la taille des clients
audités.
La première approche, bien que simple d'utilisation,
s'avère particulièrement non efficace sur le plan
économique car elle ne prend pas en considération des
différences de taille entre les sociétés
auditées.
La seconde approche permet de mieux refléter le poids
économique de chaque acteur dans le marché ou segment de
marché examiné. Les études empiriques antérieures
privilégient cette approche, car elle est plus significative du point de
vue économique.
Puisque l'information relative aux honoraires facturés
n'est pas publiée, nous utilisons dans notre étude la taille du
client. Étant donné que les honoraires d'audit et la taille de la
société auditée sont parfaitement corrélés,
plusieurs travaux antérieurs, comme ceux de Moizer et Turley (1987),
Minyard et Tabor (1991) et Piot (2006), retiennent la racine carrée de
cette taille. En outre, les honoraires d'audit en Tunisie sont fonction du
produit brut, total bilan et nombre d'employés. Ces mesures
reflètent la taille de l'entreprise.
Ainsi, nous suivons cette approche en définissant la
taille par le total de l'actif, dans la mesure où la démarche
d'audit est généralement axée sur la validation des postes
du bilan. Pour tenir compte du nombre variable d'auditeurs en fonctions
(généralement deux), chaque société auditée
est divisée à parts égales en fonction du nombre de
mandats qu'elle offre. Par exemple, si deux commissaires sont en fonction, il
est supposé que chacun d'eux audite un demi de la société.
Mathématiquement, la PDM de l'auditeur j dans le segment s
(marché global ou secteur d'activité) se calcule alors comme
suit :

Où :
- Xijs est une variable binaire
codée 1 si la firme i du segment s est auditée par l'auditeur
j,
- Kis désigne le nombre
d'auditeurs nommés par la firme i du segment s,
- Ais est égal au total de
l'actif de la firme i du segment s.
Paragraphe 2 : Les indicateurs de
concentration
Les travaux antérieurs utilisent les mesures de
concentration traditionnelles suivantes :
- ratios de concentration CRk (somme des PDM détenues par
les k plus grands auditeurs, avec k = 4, 6 et 8) ; et
- indices de Herfindahl de même ordre.
Selon Thavalapan et al. (2002), ces indicateurs
présentent l'avantage d'intégrer la dispersion des parts de
marché entre les principaux acteurs considérés, et donnent
donc une représentation économique plus juste de
l'équilibre du marché ou segment de marché
étudié. L'indice de Herfindahl fournit une image
économique du secteur plus minutieuse que celle avancée par les
ratios traditionnels (Moizer et Turley, 1989 et Pong, 1999).
Formellement, et en utilisant les notations
précédentes, le ratio de concentration d'ordre k (CRk) du segment
de marché s (marché global, secteur d'activité) est
défini comme suit :

Stigler (1968)22 définit l'indice de Herfindhal ainsi
que ses déterminants. Il le présente comme «...la somme des
parts de marché, élevées au carré, de chacun des
cabinets d'audit en question». Il ajoute que «...pour un
marché composé de (n) cabinets d'audit, l'indice de Herfindahl
est compris entre 1/n si les parts de marché sont équitablement
réparties entre les acteurs et 1 si le marché est détenu
par un seul acteur...».
L'indice de Herfindhal a été initialement
appliqué par Eihenseher et Danos (1981). Des recherches
postérieures ont repris cette mesure. Nous pouvons citer : Moizer et
Turley (1987) ; Wootton et al. (1994) ; Pong, (1999) ; Choi et Zéghal
(1999) ; Wolk et al. (2001) et McMeeking et al. (2005).
L'indice de Herfindhal mesure les parts de marché
détenues par un cabinet d'audit. Généralement, elle est
égale à la somme du chiffre d'affaires au carré de
l'entreprise auditée (i) divisée par la somme au carré des
chiffres d'affaires des entreprises auditées. D'autres chercheurs
utilisent les honoraires d'audit payés par les entreprises
auditées (Minyard et Tabor, 1981) ou le nombre des entreprises
auditées (Moizer et Turley, 1987).
Dans une étude portant sur le marché de l'audit
français, Piot (2006) calcule l'indice de Herfindahl par la racine
carrée du total actif normée par le nombre d'auditeurs
nommés par une entreprise. L'indice de Herfindahl d'ordre k (Hk) du
segment de marché s (marché global, secteur d'activité)
est calculé comme suit :
22 Cité dans Wolk et al. (2001, p.160).

Dans notre étude empirique, nous utilisons la part de
marché pondérée et le ratio de concentration.
Section 2 : Présentation de l'échantillon
et des résultats
Le marché d'audit examiné dans la
présente étude concerne les auditeurs de toutes les entreprises
tunisiennes faisant appel public à l'épargne (APE) pour la
période 2004 à 2006 : Période marquant l'apparition de la
loi relative au renforcement de la sécurité financière
instaurant l'obligation de designer un Co- commissaire aux comptes pour les
sociétés sous certaines conditions et la rotation des
commissaires aux comptes.
Paragraphe 1 : Présentation de
l'échantillon
Nous avons réalisé une étude auprès
d'un échantillon assez large des sociétés tunisiennes
faisant appel public à l'épargne pour les années 2004,
2005 et 2006.
Toutes les informations sur les entreprises (secteur
d'activité, total bilan), leurs auditeurs ont été
extraites à partir des sites officielles du Conseil du Marché
Financier (CMF) et de la Bourse de Valeurs Mobilières de Tunisie
(BVMT).
La définition des sociétés et des
organismes faisant appel public à l'épargne est donnée par
l'article 162 du code des sociétés commerciales : « Sont
réputées sociétés faisant public à
l'épargne celles qui émettent ou cèdent des valeurs
mobilières en appelant le public à l'épargne ».
Aux termes de l'article 1er de la loi n°
94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier : « Sont réputées sociétés ou
organismes faisant appel public à l'épargne :
1) Les sociétés qui sont déclarées
comme telles par leurs statuts ;
2) Les sociétés dont les titres sont admis
à la cote de la bourse ;
3) Les banques et les sociétés d'assurance quelque
soit le nombre de leurs actionnaires ;
4) Les sociétés dont le nombre d'actionnaires est
égal ou supérieur à cent ;
5) Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières ;
6) Les sociétés et les organismes autres que
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui, pour le
placement de leurs titres, recourent soit à des intermédiaires,
soit à des procédés de publicité quelconques, soit
au démarchage ».
Pour identifier les sociétés et les organismes
faisant appel public à l'épargne, nous avons utilisé la
liste divulguée par le CMF au 13 mai 2008. Notre échantillon ne
contient pas la totalité des entreprises figurant sur cette liste. Il
est composé de 94 sociétés en 2004, 118
sociétés en 2005 et 129 sociétés en 2006 (Tableau
2.1).
Tableau 2.1 : Répartition des entreprises de
l'échantillon par secteur
|
EXERCICE
|
|
SECTEUR
ACTIVITE
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
Nbre
|
%
|
|
FINANCIER
|
39
|
41,49%
|
52
|
44,07%
|
69
|
53,49%
|
|
COMMERCIAL
|
6
|
6,3 8%
|
8
|
6,78%
|
8
|
6,20%
|
|
ASSURANCE
|
11
|
11,70%
|
12
|
10,17%
|
11
|
8,53%
|
|
INDUSTRIEL
|
22
|
23,40%
|
25
|
21,19%
|
24
|
18,60%
|
|
LEASING
|
5
|
5,32%
|
6
|
5,08%
|
8
|
6,20%
|
|
AUTRES
SECTEURS
|
11
|
11,70%
|
15
|
12,71%
|
9
|
6,98%
|

Total des
observations
94
100%
118
100%
129
100%
Les sociétés sont réparties sur plusieurs
secteurs tels que présentés dans le tableau 2.1. Le secteur
financier englobe la majorité des sociétés
observées (plus que la moitié de l'échantillon en 2006).
Il comporte les banques, SICAV, SICAR, SICAF et les FCP. « AUTRES SECTEURS
» représente à la fois le secteur immobilier, tourisme et
loisir, et télécommunication.
La variation du nombre des entreprises pour chaque secteur est
due à la fois à l'admission des nouvelles sociétés
comme des sociétés faisant APE, une ou plusieurs
sociétés ne remplissent pas les critères des
sociétés faisant APE, à l'absence de l'information sur le
site officielle du CMF ou de la BVMT ou à l'omission de notre part.
Le tableau 2.2 montre la fluctuation des observations
effectuées sur l'échantillon. Par rapport aux
sociétés figurant dans la base de données du CMF, nous
avons 12 observations manquantes en 2004, 1 en 2005 et 16 en 2006.
Tableau 2.2 : Etat des observations
collectées
|
ANNEE
|
TAILLE DE
L'ECHANTILLON
|
Nbre de Sté
qui joint la
liste
|
OBSERVATIONS
COLLECTEES
|
OBSERVATIONS
MANQUANTES
|
|
2004
|
|
|
94
|
12
|
|
2005
|
106
|
13
|
118
|
1
|
|
2006
|
119
|
25
|
128
|
16
|
Le tableau 2.3 fournit une description de la taille de
l'échantillon basée sur le total de l'actif. Nous constatons la
dominance du secteur financier. Ce secteur englobe à la fois les
entreprises de très grandes tailles (à l'environ de 4707 Millions
de Dinars) et des petites firmes (122 Mille de Dinars). A l'exception du
secteur « financier » et « autres secteurs », la dispersion
de l'échantillon est presque égale et ce malgré
l'importance de la différence entre les deux extrémités
(MAX et MIN du total de bilan) des tailles du total de bilan des
sociétés appartenant au même secteur.
Nous remarquons également, contrairement aux autres
secteurs, la diminution de la moyenne et la médiane du secteur financier
et leasing.
Tableau 2.3 : Statistiques descriptives de l'actif
total
|
SECT
|
ANNEE
|
TOTAL ACTIF
|
MOYENNE
|
MEDIANE
|
MAX
|
MIN
|
|
FIN.
|
2004
|
25 950 870 157,500
|
665 406 927,115
|
66 150 519,000
|
4 287 610 000,000
|
1 051 865,040
|
|
2005
|
30 045 774 858,754
|
577 803 362,668
|
72 350 756,500
|
4 399 155 000,000
|
461 721,000
|
|
2006
|
33 721 965 586,373
|
495 911 258,623
|
29 430 064,000
|
4 706 982 000,000
|
121 941,641
|
|
COM.
|
2004
|
214 731 383,070
|
35 788 563,845
|
33 054 138,123
|
78 581 674,774
|
5 122 210,578
|
|
2005
|
283 603 030,850
|
35 450 378,856
|
28 835 902,578
|
80 379 994,766
|
4 946 323,909
|
|
2006
|
298 844 087,784
|
37 355 510,973
|
30 334 187,630
|
93 149 020,000
|
4 681 626,667
|
|
ASSUR.
|
2004
|
1 501 267 525,907
|
136 478 865,992
|
134 169 361,826
|
383 427 893,741
|
4 335 582,313
|
|
2005
|
1 703 406 072,800
|
141 950 506,067
|
139 428 689,681
|
416 572 786,667
|
4 124 822,709
|
|
2006
|
1 641 103 754,748
|
149 191 250,432
|
145 269 615,000
|
441 138 465,455
|
4 632 366,250
|
|
INDUS.
|
2004
|
1 141 161 581,394
|
51 870 980,972
|
39 729 166,000
|
197 808 343,159
|
411 442,000
|
|
2005
|
1 257 314 720,540
|
50 292 588,822
|
41 280 820,000
|
208 227 636,062
|
310 645,000
|
|
2006
|
1 295 703 601,905
|
53 987 650,079
|
44 109 074,648
|
215 259 791,649
|
4 521 805,119
|
|
LEAS.
|
2004
|
679 221 897,000
|
135 844 379,400
|
155 232 596,000
|
242 380 400,000
|
43 856 265,000
|
|
2005
|
827 805 690,000
|
137 967 615,000
|
140 841 446,000
|
261 441 866,000
|
49 258 318,000
|
|
2006
|
939 711 199,000
|
117 463 899,875
|
82 902 356,000
|
270 156 183,000
|
50 587 039,000
|
|
A.SECT
|
2004
|
1 435 211 365,639
|
130 473 760,513
|
25 895 265,000
|
1 187 274 000,000
|
3 195 019,000
|
|
2005
|
1 544 186 023,671
|
102 945 734,911
|
22 622 930,000
|
1 172 569 000,000
|
2 933 332,000
|
|
2006
|
1 531 540 675,137
|
170 171 186,126
|
37 924 119,000
|
1 247 059 000,000
|
18 454 731,000
|
|
TOTAL
|
106 013 423 212,072
|
311 804 185,918
|
47 489 985,000
|
4 706 982 000,000
|
121 941,641
|
Paragraphe 2 : Résultats de
l'étude
La présentation de nos résultats est divisée
en trois parties :
· description de la structure du marché ;
· mesure des parts de marché ; et
· analyse des ratios de concentration du marché.
1. Description de la structure du marché
:
L'article 13 Ter du code des sociétés
commerciales exige la désignation de deux commissaires aux comptes ou
plus inscrits au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie pour les
sociétés suivantes :
· les établissements de crédit faisant appel
public à l'épargne et les sociétés d'assurance
multi-branches ;
· les sociétés tenues d'établir des
états financiers consolidés conformément à la
législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes
consolidés dépasse un montant fixé par décret (100
millions de dinars) ;
· les sociétés dont le total des
engagements auprès des établissements de crédit et de
l'encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant
fixé par décret (25 millions de dinars).
Le tableau 2.4 suivant démontre que 27.34 % des
sociétés en 2006 ont désigné deux commissaires aux
comptes en application de la LSF et sauf 5.93 % en 2005.
Tableau 2.4 : Répartition des entreprises de
l'échantillon par nombre de
commissaire aux comptes
ANNEE
|
CAC
|
%
|
COCAC
|
%
|
TOTAL
|
2004
|
91
|
96,81%
|
3
|
3,19%
|
94
|
2005
|
111
|
94,07%
|
7
|
5,93%
|
118
|
2006
|
93
|
72,66%
|
35
|
27,34%
|
128
|
|
Dans le tableau 2.5, nous présentons la
répartition de l'échantillon par nature d'auditeur (BIG/NON BIG).
Nous constatons que les cabinets BIG assurent l'audit légal de environ
30% des entreprises de l'échantillon.
Tableau 2.5 : Répartition des entreprises de
l'échantillon par nature d'auditeur (BIG/NONBIG)
ANNEE
|
CAC
|
COCAC
|
TOTAL
|
%
BIG
|
|
NBIG
|
2 BIG
|
2 NBIG
|
BIG-
NBIG
|
|
29
|
62
|
|
2
|
1
|
94
|
3 1,91%
|
2005
|
31
|
80
|
|
4
|
3
|
118
|
28,81%
|
2006
|
19
|
74
|
4
|
13
|
18
|
128
|
32,03%
|
|
L'article 13 bis du code des sociétés
commerciales prévoit que : « le commissaire aux comptes est
désigné pour une période de trois années
renouvelables. Toutefois, le nombre du mandats successifs, compte tenu du
renouvellement, ne peut excéder pour les sociétés
commerciales soumises à l'obligation de désigner un commissaire
aux comptes inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie,
trois mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique et
cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la forme d'une
société d'expertise comptable comportant au moins trois experts
comptables inscrits au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, et
ce, à condition de changer le professionnel qui engage sa
responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle
des comptes et de changer l'équipe intervenant dans l'opération
de contrôle une fois, au moins, après trois mandats ».
La rotation imposée par cet article est applicable lors
des renouvellements des mandats à partir du 1er janvier 2009.
Nous avons examiné si les sociétés
tunisiennes procèdent au changement de leur auditeur tout en prenant en
considération que le mandat du commissaire aux comptes est de trois ans.
Nous enregistrons 3 changements en 2005 et 5 changements en 2006. Les
changements concernent essentiellement les banques qui sont régies par
une réglementation spécifique. Les autres modifications
intéressent
la nomination du deuxième commissaire aux comptes
conformément à l'article 13 Ter du code des
sociétés commerciales.
2. Mesure des parts de marché :
Le tableau 2.6 présente les PDM
pondérées par secteurs d'activité, et globalement, pour
chacun des réseaux d'audit considérés en 2004 (panel A),
en 2005 (panel B) et en 2006 (panel C).
En 2004, le cabinet international KPMG occupe le premier rang
et Ernst and Young le deuxième d'après la PDM
pondérée. En outre, ces deux cabinets occupent le premier rang en
nombre de mandats suivis du cabinet FINOR, Ils interviennent dans tous les
secteurs de l'échantillon.
L'analyse des parts de marché par secteur
démontre qu'il n'existe pas un seul leadership. En effet, les premiers
rangs, en terme de PDM pondérée sont occupés pour le
secteur d'assurance et commercial par KPMG, le secteur industriel par PWC, le
secteur de leasing par Ernst and Young, le secteur financier GAC et les autres
secteurs par BDO. Nous remarquons que mêmes des cabinets non BIG occupent
le premier rang.
En 2005, KPMG cède le premier rang en terme de part de
marché pondérée et non pondérée à
Ernst and Young. La troisième place est occupée en terme de parts
de marché par GAC.
Les parts de marché sectoriels restent partagés
entre plusieurs cabinets. En effet, GAC, Ernst and Young, SOGER, KRESTON
INTERNATIONAL dominent le secteur financier, Leasing, assurance et industriel
respectivement. KPMG continue à s'imposer dans le secteur commercial.
Les leaderships des autres secteurs sont KPMG et PWC.
En 2006, Ernst and Young continue à occuper la
première place mais il n'est Leadership que dans le secteur industriel
avec KRESTON INTERNATIONAL. KPMG s'impose dans le secteur commercial et des
assurances. FINOR et PWC occupent le premier rang dans le secteur du Leasing et
autres secteurs respectivement.
Nous pouvons conclure que les sociétés faisant
appel public à l'épargne ont une tendance de choisir comme
commissaire aux comptes des cabinets internationaux parmi les BIG ou des non
BIG.
Les résultats démontrent que tous les auditeurs
des entreprises faisant appel public à l'épargne font partie de
la région de Tunis à l'exception de deux auditeurs appartenant
à la région de Sfax.
Cette attitude est à l'origine, à notre avis,
de l'orientation vers une technicité supérieure, un service
d'audit performant soit pour la raison que certaines sociétés
faisant APE appartiennent à des réseaux internationaux (par
exemple les banques) et elles ont une obligation d'avoir des états
financiers certifiés par des cabinets internationaux.
Le législateur tunisien intervient pour réduire
cette concentration, à travers la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005,
relative au renforcement de la sécurité des relations
financières, en instaurant la notion de co-commissariat aux comptes. Il
en résulte, par l'observation du tableau 2.6, que les parts de
marché des leaders (BIG et non BIG) baissent, En effet, les parts de
marché pondérées du Leadership sont 14,83 ; 12,95 et 10,72
en 2004, 2005 et 2006 respectivement.
De l'autre coté, nous remarquons à la fois que
l'apparition de nouveaux cabinets nationaux qui commencent à accaparer
une partie des parts de marchés dans différents secteurs et
l'augmentation de la part de marché pour d'autres cabinets. Le tableau
2.5 précédent confirme ces résultats : le co-commissariat
composé d'un BIG et non BIG ou de deux non BIG domine celle de deux
BIG.
3. Analyse des ratios de concentration du
marché
Le Tableau 2.7 présente les ratios de concentration
d'ordre quatre, six, huit et pour l'ensemble des firmes d'audit
considérées.
De première lecture, la concentration globale
décroît entre 2004 et 2006 pour tous les niveaux de mesure. Ce
résultat traduit l'effet du double commissariat instauré en 2005.
Le ratio de concentration d'ordre quatre (CR4) permet de caractériser le
marché au regard des structures présentées en Figure 1.5.
Il apparaît
que dans les années 2004, 2005 et 2006, le marché
de l'audit est qualifié comme un oligopole ouvert (CR4 juste au-dessus
du seuil de 0,40).
L'examen des différents niveaux de calcul des ratios
de concentration souligne une certaine gradualité dans la diminution de
celle-ci. Plus particulièrement, le niveau de concentration baisse de
manière convexe, autrement dit à un rythme croissant, en fonction
de l'ordre auquel il est mesuré.
Tableau 2.7, Ratios de concentration sur le
marché tunisien de l'audit : 2004-
2005-2006
|
CR4
|
CR6
|
CR8
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2004
|
2005
|
2006
|
2004
|
200
|
2006
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
Financier
|
59,5
|
55,2
|
51,5
|
80,6
|
71,1
|
64,1
|
90,4
|
82,8
|
71,5
|
|
9
|
9
|
1
|
3
|
7
|
9
|
|
6
|
7
|
Leasing
|
1001
|
89,6
|
40,8
|
***
|
1002
|
56,5
|
***
|
***
|
70,3
|
|
|
8
|
6
|
|
|
9
|
|
|
2
|
Assurance
|
53,9
|
55,0
|
56,1
|
74,0
|
73,1
|
68,8
|
90,8
|
84,9
|
79,5
|
|
1
|
7
|
1
|
6
|
6
|
|
|
5
|
2
|
Commercial
|
92,5
|
72,5
|
69,4
|
1003
|
94,9
|
90,1
|
***
|
1004
|
1005
|
|
2
|
5
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Industriel
|
38,2
|
31,3
|
30,9
|
52,9
|
44,7
|
44,7
|
63,6
|
56,8
|
54,8
|
|
7
|
7
|
9
|
8
|
8
|
4
|
5
|
5
|
2
|
A. Secteur
|
75,9
|
61,1
|
68,3
|
87,8
|
72,7
|
82,5
|
95,3
|
81,9
|
94,7
|
|
7
|
9
|
6
|
8
|
7
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Concentratio
|
49,2
|
44,0
|
41,8
|
65,1
|
56,5
|
53,3
|
74,2
|
65,5
|
59,6
|
n globale
|
|
6
|
3
|
3
|
2
|
6
|
9
|
8
|
6
|
Ratios de concentration (CR) d'ordre 4, 6, 8, Tous les ratios
sont calculés à partir de
|
parts de marchés pondérées par la racine
carrée du total de l'actif des sociétés
|
auditées. Il est tenu compte du commissariat conjoint
sous l'hypothèse d'équi-
|
répartition de la mission entre les co-commissaires aux
comptes.
|
1 Sauf 3 commissaires aux comptes intervient dans ce
secteur.
|
2 Sauf 5 commissaires aux comptes intervient dans ce
secteur.
|
3 Sauf 5 commissaires aux comptes intervient dans ce
secteur.
|
4 Sauf 7 commissaires aux comptes intervient dans ce
secteur.
|
5 Sauf 7 commissaires aux comptes
intervient dans ce secteur.
|
|
Au-delà de l'observation globale du marché, le
Tableau 2.7 met également en évidence des situations
intersectorielles particulièrement irrégulières. Le CR4,
par
exemple, s'inscrit dans un intervalle [0,3 8-1] en 2004, lequel
réduit à [0,31-0,69] en 2006.
La concentration globale semble avoir des
répercussions sectorielles fortes dans la mesure où nous
assistons à un changement au niveau de la structure de marché
:
· le secteur de leasing passe de la structure d'un
marché non concurrentiel dominé par une seule firme
détenant plus que 40 % des parts de marché à une structure
proche de marché concurrentiel soit de type oligopole restreint.
Seulement, 3 auditeurs interviennent dans le secteur « leasing » en
2004, En 2006, CR8 est égal à 70,32 %.
· le secteur commercial et les « autres secteurs
» sont caractérisés par une structure non concurrentielle
sous la forme d'oligopole restreint (quatre firmes détiennent plus de
60% de PDM). Le secteur « commercial » reste toujours «
fermé » même si on augmente l'ordre de ratio, En effet, en
2006 il plafonne à 100 % avec seulement sept acteurs.
· Le secteur industriel est caractérisé par
une concurrence pure (aucune firme n'a une influence de marché).
· Les secteurs financiers et assurance ont une structure
de concurrence monopolistique : plusieurs firmes, chacune ayant une
légère influence sur le marché.
Malgré la chute enregistrée au niveau du ratio
de concentration dans ses différents niveaux, les « Autres secteurs
» n'obéissent pas à cette allure et voire leur ratio de
concentration augmente de nouveaux en 2006. Ce résultat peut être
expliqué par l'hétérogénéité des
entreprises en termes de total de l'actif (par exemple, TUNISAIR a un total
d'actif très élevé par rapport aux autres entreprises).
Dans le marché de l'audit, nous ne pouvons pas nier
l'effet des regroupements et les fusions entre les cabinets et surtout les BIG
4. En Tunisie, ces derniers disposent de parts de marché importantes sur
tous les secteurs. Le tableau 2.8
démontrent qu'ils dominent environ le tiers du
marché de l'audit des entreprises faisant appel public à
l'épargne.
Tableau 2.8 : Ratios de concentration des BIG 4 sur le
marché tunisien de
l'audit : 2004-2005-2006
|
CR BIG
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Financier
|
37,11
|
34, 34
|
31,15
|
|
Leasing
|
64,6
|
70,58
|
22,43
|
|
Assurance
|
35,75
|
33,24
|
30,60
|
|
Commercial
|
47,65
|
36,00
|
36,18
|
|
Industriel
|
24,17
|
15,76
|
18,67
|
|
A. Secteur
|
32,74
|
34,47
|
30,67
|
|
Concentration globale
|
36,68
|
33,67
|
29,27
|
|
Ratios de concentration (CR) des cabinets BIG 4 (EY : Ernst and
Young ;
KPMG : Klynveld Peat Marvick Goerdeler ; DTT : Deloitte Touche
Tohmatsu ; PWC : PriceWaterhouse Coopers).
Tous les ratios sont calculés à partir de parts
de marchés pondérées par la racine carrée du total
de l'actif des sociétés auditées, Il est tenu compte du
commissariat conjoint sous l'hypothèse
d'équi-répartition de la mission entre les co-commissaires
aux comptes.
|
En 2005 et 2006, les BIG 4 possèdent des parts de
marché leaders mais elles sont plus faibles qu'en 2004. Ce
résultat montre que le co-audit a des effets très importants sur
la structure du marché. Il a pu affaiblir la concentration et rivaliser
la compétitivité entre les acteurs. Nous remarquons que PWC et
DELOITTE ne possèdent pas des parts de marché importants. Ce
résultat peut être expliqué par le fait que ces cabinets
ont un portefeuille composé essentiellement de services à
l'export et de missions spéciales (audit informatique par exemple).
En outre, le Co-commissariat a pour objectif de renforcer
l'indépendance des auditeurs, améliorer la qualité des
travaux d'audit en assurant une compétence technique plus large et la
possibilité d'émettre des opinions différentes. Par
exemple, en 2006, nous constatons que les deux auditeurs de l'UIB ont
émis deux opinions différentes l'une avec réserve et
l'autre refus de certification.
En conclusion, nous pouvons confirmer notre hypothèse.
En effet, les nouvelles dispositions de la LSF permettent de diminuer la
concentration du marché
de l'audit tunisien et offrir aux cabinets nationaux des
opportunités pour concurrencer les cabinets internationaux. Mais, la
période d'étude ne peut pas mettre en valeur toutes les
conséquences de la loi relative au renforcement de la
sécurité financière car l'obligation de rotation des
auditeurs n'est pas encore entrée en application effective. En effet, le
législateur tunisien a reconnu l'importance de la rotation des
commissaires aux comptes à travers les dispositions de l'article 13 bis
de la loi 2005-96 sus-indiquée. Toutefois, nous ne pouvons pas remarquer
les résultats de cette disposition sur la structure de marché car
la date d'effet est à partir du premier janvier 2009. Par
conséquent, la rotation pourrait, dans certains cas, ne survenir
qu'à partir de 2011.

CD
N
CD
N
(r)
m-1
1-1
N
N
z
o
N
00
C
't)
00
O
M
oc
kr)
O
,--
Cr)
O
1-1
CD
CO
N
4-1
N
kr)
N
UW
N
O N-
O
M
N
N
00
O
N
O CT
01-
O
V')
N
O
N
O
N
N
N
PQ
4T4
L7
o
m-1
00
O
N
N
o
g
O
m-1
kr)
N
N
N
N
N
N
N
u
C.7
g-1
N
00
00
CD1
O
u
u
N
kr)
N
kr)
N cés
et
o
PQ
rn
O
N
et
N rn's
u
No.
cr,
O
CT
N
N N
N N
c
O VD-
(.7
tr)
00
N
1-1
· cr N
N
rn
rn
N
g-1
N
N
N
N
N N
/-1
00
efr
N
1-1
N
N
els
N
N N
M
Os
N
N
N en's
Q
rM
Q
cà
1.
ro) 1. Q -14
715
· 41
-
aw
.)
- - e
·
·c,1
°
·
· 4.
· -c)
8 t,
rI
<
o b
m z
· 1 1.) e
'g)
m Z
ce 0 0
,1-
·) -ee
ce
·
· .,;-;
U g
· -
·
· < N Z
F4 4
re r..7 4
'Et>
"19
") z
0 -0
· .2 c:5
1.)
· ,
'
· è)
E- o
· w -g
z u
co
. .

°UQ-d
ô
· u
P-1 N
-ci e
§ °) g 8 e, g 4.>
· 41:),
E- fe-.
·
·
S ,s :
·°2
U
Z
< 0 ce
On g .<P'
e
WO
·
·
p(),

...,
e
0 -c-d
ce te^
5 ce
0 4.,
al ,--.
co
=,. e
' cij ..-,
-a
I--à ro
dam
m
.., 4 ,-,
,--.
.71 ''
....
, w. .__. e '"" FLI 0
N --
-0 PI
.-e) _; 0Z
.1f. PI F'-:
e ie < cb <
0 « v -,11 e
,.
Ô szL, W
.... 5
co 'cle
e 8
..= ."D) e z
0 0
..., c
o 4
·- E-
rct - t v)
0 P4 ci) ..
·m .
c.
· _
., ci)
-.. Te. U a.,.
. . ..44
14 g%)
Z
N E--:
a., Z
e
r:,,121.
·'''')....0.1
re ,.. 8
el) M.
· U''' 0 =
E- 0 we "g
c.) n
..= L.7
..,:j m
e o -- o
ru e E- .
CY
·
0
,_y re
.a., --
n z
ci)
·
· -E im
W
Ems- ..=
cd 0 A 4-1 7,d M -^AmU rû U -ci
-ri) 1)
5 ...d
-2 0 ce cd
co ....=
o0 4.,
o
L.7
..x
c.) 0
,.. -8 - E- 0
Tc
z re
rct o
o B 0
p., N
-0 e < el) e.,< p4sg
w+->
0 -.r
...
-0
L7-0 eu e
-0 <
-9.
= -
ci).<9 '-'°
.., â
s 0 g 4 .,..) c) U 4' < >4
Zrn
-0 el) 0 à
1:e s-4 ,,, ce 0 ''' ru _A g < ' E A
-5 15 W
·
· co .. 0 il,
.' n en", >7 el)
W r:1 2
= A

|
...,-,1
|
::,
|
rn
|
oc
|
0A
|
te')
|
N
|
|
|
|
Z
|
N
.n
|
1/4.0
|
N
--i
|
00
|
kr)
N
|
kt--)
--1
|
oo
--
--
|
|
|
|
0
|
p
N
c:.
_.
|
--
c:.
|
|
|
N
|
ViD
rn
|
_.
|
00
|
N
|
|
|
|
|
|
rq
ce
|
|
N
|
,--iViD
|
.1-
0
,4
|
|
(c)
X
|
r-
iri
,-;
|
|
0
1-1
.1:
|
|
oo
fn
.1:
|
|
rn
|
.1-
N
|
0
0,
,--
|
|
(..)
|
|
|
C---
1-1
eT
|
|
eT
V iD
M
|
|
N
|
ViD
· --
|
ViD
rn
,4
|
s
ai
|
01
c:;
|
|
01
oo
|
|
.1-
.1-
|
rn t:;
|
|
00 .1:
|
N
|
w
(c)
0
|
|
|
es1
its:
,-,
|
|
|
cc
|
en
|
N
|
ViD
N
|
1:4
O
|
oc
(---:
|
|
|
|
(c)
|
|
N
|
· cp --1
|
oc
|
god
|
oo
|
|
ViD
iri
,--
|
|
|
oo
N
N
|
V:i
|
oo
d:
|
cI
oo
if;
|
S'fl
(c)
|
VD
'C'?
|
|
c>
d:
|
|
-Ir,
|
|
|
Ir)
|
r-
rn
|
(,e)
x
0
|
a,
oo
c5
|
|
oo
en
te-;
|
|
oo
ri
|
|
te-)
|
.1-
|
--.
te-;
|
0
ai
|
|
ca
--.
a;
--.
|
|
M
a;
|
|
M
v:;
|
en
|
N
|
S
s.
--.
|
0
e
c«
|
|
|
|
|
oc
rn
S
|
r-
N
es1
,--,
|
rn
|
.
N
|
ViD
'e?
1-1
|
HS A
|
01
ch
1/4.t5
|
S
Cr)
;
--1
|
01
,--I
;
· --
|
|
|
.1-
'I:
|
|
VD oo
|
.1-
ViD
|
(c)
X
|
S
tr)
cri
--.
|
N
oci
1-1
|
S
CD
tri
· --
|
Ilrà
co
N
|
|
IN
N
N
q
|
C
·1
1-1
|
ViD
cr;
|
N
tr)
t-\i
1-1
|
W
|
00
S
(-ri
--.
|
· Zr IL--;
un
en
|
· --
71:
,an
|
ViD
d-
-
te-;
|
oo
er_i
ou
|
te)
71_:
in
|
.1-
--.
|
N
--.
--.
|
iri
c>
r,i
--.
|
rn
7u"
:
e
a
|
1.
.2 te ni
...1 .z.,
wi
|
tu
ni
.-.
et
te
4
|
cu te gi i.a
r*
.
|
11
.r.,
b
e
0
ce
u
|
7e
.c., ... .
· nle A
4
|
f
g
-,...
te
e
d
|
-,....1 10 cani 0 cu
ms ce
1-.
.0
z
|
te .0 - 0 e t)
e ry
ce
·cu
a ti,
"d.
n e
a ;:l
|
te
'0
1 -1
.%)
ms
e
c)
ele 2
cet
e -g
n
Pi TI
|
|

|
kr)
00
|
VD
-1
|
VD
,--I
|
00
|
01
N
|
Ch
|
cr)
VD
· --
|
|
|
Z
|
00
|
00
|
,--1
--
|
oc
|
d-
N
|
cz,
|
00
c
·I
--
|
|
|
0
4
4,
|
Ni
00
,--
.
|
c::,
el
-
eq
|
|
|
|
01
_,--
.u.,
|
r-
.
|
Ni
.1-
c;
.
|
S
N
od
|
U
|
|
|
|
|
te
.1".
OC
|
|
N
|
N
N
,--;
|
00
01
C;
|
LD
X
|
N
,4
|
|
,--1
kr;
|
|
N 00
71:
|
|
71-
|
tn
chi
|
d-
N
|
U
|
|
|
po
N
kr;
|
|
|
|
4--4
|
--
·
VZ)
C;
|
,r:)
MI-
C;
|
F.
A
|
S
00
C;
|
|
M
..-;
|
|
Co
· --
·
.1
|
N
vD
N
|
O
|
oo
vD
r.;
|
cr)
e:
,--,
|
W
u
ce
|
0
|
|
--
|
|
c.)
71-
N
|
|
rn
|
.1-
ce
· --
|
o,
'1".
,--.
|
d
LD
pe
O
|
N
Ni
S
|
|
|
|
|
|
Ni
|
N
N
--
|
Ch
vD
|
|
Ni
Ni
cri
|
|
cr,
--
S
|
|
|
|
Ln
|
r:; CD
cri
|
N
N
|
U
..1
(c)
|
Ir,
r
/--
|
ce
d:
|
ce)
cD,
· ml:
|
|
|
|
00
|
Ch
mi
|
00
N
C'
|
U,..,
U
|
ch
cz.
s
|
oo
71
|
kri
,_;
--
·
|
|
cr;
000
N
|
|
ch
|
N
tri
tri
|
,4
N
JD
|
C
A
P:1
|
|
oo
0
00
|
|
d-
.
ez
|
|
ch
d-
S
|
rn
|
d-
oo
,--
|
ch
,--
|
L) ,--, tt--) ce) ,-1 ce, N
oo --I. N N ei
1=t
· kn 71: s tek S 41"
un
Ems n .n ez, VD Ith-
E_, -- -
c::: mi
A c
·; N: V1(..)
u r.... cr, oc e
X ce .--+ N 0, 0, ,--,
CD
c' it..,:. 4O 0 v: 1> c:::
GR?
c::
r-1 00 ,--+ /--q
N ri
N . N N
O M d- d- te 00
.1".
O
>1 -- °2. cri d: ": c). s c::
N
W ,--I U1 ,--I ,--I 00
·D /-4 gI gI
|
CM Q
el CI Q
ms 4,
Z1 0 Cij
11 "ti
e ' te 1:1
.z
4 tse .
ce 4 Q e e cl, e
(,..) .0 ce _,$: Q
·Zew Q Q 0 Q
0
cà pi E ;-` a cà
...,,,,
-r, ni .. 41 ro) Q cu
0:1
A ,..1 e e e ,e e L. x -g x e
ce 41 Q . 0 --- -tm n 0 n
a 4
· 4 u '..... ''e z pi a
0-1 TI
|
|
CONCLUSION
GÉNÉ RÂLE
Les fusions réalisées entre les cabinets
d'audit au niveau international (le passage des BIG 8 au BIG 4) ont rendu le
marché de l'audit fortement concentré. En France, Broyé
(2007) conclut que la moitié des parts de marché est
détenu par des BIG. Au Royaume-Uni, Beattie et al. (2008) montrent que
la faillite du cabinet Anderson a pour conséquence la redistribution des
parts de marché entre les BIG mais une forte concentration persiste.
Conscients de l'importance de ce problème de
concentration, l'objectif de notre mémoire est d'étudier la
concentration du marché tunisien d'audit légal avant et
après la loi relative au renforcement de la sécurité
financière. Nous avons proposé une analyse descriptive,
basée sur des observations empiriques, de la concentration sur le
marché de l'audit des entreprises tunisiennes faisant appel public
à l'épargne sur la période allant de 2004 à 2006.
La concentration du marché est mesurée par le ratio de
concentration calculé à partir de parts de marché
pondérées par la racine carrée du total de l'actif des
sociétés auditées.
Les résultats révèlent que le
marché de l'audit tunisien, en 2004, est sous la forme d'une structure
intermédiaire entre l'oligopole ouvert et restreint. Après
l'entrée en vigueur de la LSF, la concentration sur le marché
diminue. Il y a une tendance vers un marché concurrentiel. Le ratio de
concentration global d'ordre 4 s'approche de 40% en 2006. L'analyse sectorielle
montre la diminution des ratios de concentration de différents ordres
à l'exception des « Autres Secteurs ». Toutefois, nous
constatons un plafonnement (70-100) des secteurs dés l'ordre 8 à
part le secteur industriel.
A partir des observations intersectorielles, les parts de
marché des BIG connaîssent des fluctuations soit au profit des
autres BIG soit au profit des cabinets nationaux. En effet, aucun réseau
d'audit ne préserve sa dominance sur un secteur donné. Dans
certains secteurs, les cabinets nationaux occupent des positions de leaders.
La LSF commence à avoir ses effets sur la concentration
et la compétitivité sur le marché de l'audit.
L'instauration du double commissariat affaiblit les parts de
marché des leaders au bénéfice des
cabinets nationaux. En outre, l'apparition de nouveaux acteurs reflètent
la structure du marché : l'absence de barrières à
l'entrée est une caractéristique d'un marché
concurrentiel.
Les conclusions tirées de cette étude ne sont
pas affirmatives et acceptent la révision et nécessitent
d'être mises à jour. En effet, l'obligation de rotation des
commissaires aux comptes ne devient effective qu'en 2009.
Nos résultats et conclusions que nous en tirons
doivent cependant être interprétés en prenant en
considération certaines limites.
Tout d'abord, lors de la collecte des informations
nécessaires à la base de donnée, nous avons
rencontré beaucoup de problèmes relatifs à la
disponibilité des états financiers. Le site officiel du CMF
présente quelques insuffisances. Les états financiers des
sociétés faisant appel public à l'épargne ne sont
pas complets et parfois nous constatons des confusions entre les états
financiers publiés des différentes sociétés. Pour
ces raisons, notre échantillon n'est pas exhaustif. Notre étude
serait plus pertinente si les organisations financières prennent en
considération l'importance et la nécessité de la
divulgation à la fois complète, pertinente et à jour des
états financiers pour qu'elles soient à la disposition des
utilisateurs et des centres de recherche.
En outre, notre objectif se limite aux sociétés
faisant appel public à l'épargne. Ces sociétés
représentent un pourcentage faible des sociétés
tunisiennes soumises à l'obligation de désignation d'un
commissaire aux comptes. Seuls les commissaires aux comptes membres de l'ordre
des experts comptables de Tunisie auditent les entreprises de notre
échantillon. En revanche, en Tunisie, nous avons d'autres acteurs
à savoir les comptables membres de la compagnie nationale des
comptables. Donc, les conclusions de notre travail concernent sauf le
marché de l'audit des sociétés faisant appel public
à l'épargne et ne peuvent pas être
généralisées à l'ensemble du marché
tunisien.
Les futures recherches pourraient étudier le
marché de l'audit tunisien dans sa globalité et l'impact de la
concentration sur la qualité de l'information comptable.
Les résultats démontrent que tous les auditeurs
des entreprises faisant appel public à l'épargne font partie de
la région de Tunis à l'exception de deux auditeurs appartenant
à la région de Sfax.
BIBLIOGRAPhIE
Beattie V. et Fearnley S. (1994), « The Changing Structure
of the Market for Audit Service in the UK - A Descriptive Study », British
Accounting Review, Vol. 26, p. 301-322.
Beattie V. et Fearnley S. (1995), « The Importance of
Audit Firm Characteristics and the Drivers of Auditor Change in UK Listed
Companies », Accounting and Business Research, Vol. 25, No. 100, p.
227-239.
Beattie V. et Fearnley S. (1998), « Audit Market
Competition: Auditor Changes and the Impact of Tendering », British
Accounting Review, Vol. 30, p. 26 1-289.
Beattie V., Goodacre A. et Fearnley S (2003), « And then
there were Four: A Study of UK Audit Market Concentration - Causes,
Consequences and the Scope for Market Adjustment », Journal of Financial
Regulation and Compliance, Vol. 11, No. 3, p. 250-265.
Broyé G. (2007), « Concentration du marché de
l'audit en France : un état des lieux », Revue Française de
Comptabilité, n°399, pp. 34-37
Charles J.P. Chen , Xijia Su , Xi Wu « Market
competitiveness and Big 5 pricing: Evidence from China's binary market »,
The International Journal of Accounting 42 (2007) 1-24.
Choi M.S and Zéghal D. (1999), «The effect of
accounting firm mergers on international markets for accounting services»,
Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, Vol. 8, No. 1,
pp. 1-22.
Cours mastère « Economie industrielle de la
production », Université de bordeau IV.
FRC (2007a) Choice in the UK Audit Market, Interim Report of the
Market Participants Group. (London: Financial Reporting Council).
Gilles Le Blanc, « Firme et organisation de l'industrie :
structure de marché, stratégies d'entrée », CERNA,
Centre d'économie industrielle, Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris.
Grant Thornton, « La concentration des acteurs de l'audit
dans les pays du G8 », communiqué de presse, Paris, 15 juin 2007,
www.grant-thornton.fr.
Herrbach O. (2000), « Le comportement au travail des
collaborateurs de cabinets d'audit financier une approche par le contrat
psychologique », UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES - TOULOUSE I,
Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources Humaines et
l'Emploi, p36-39.
Iyer, V.M. and Iyer, G.S. (1996) .Effect of big 8 mergers on
audit fees: evidence from the United Kingdom. Auditing: A Journal of Practice
and Theory, Vol. 15, No. 2, pp. 123-132.
Lexecon (2002), « Un nouveau regard sur les fusions dans le
secteur de l'audit »,septembre 2002. MEDINA.Y « De quelques
mérites des big four », JUILLET 2007, N° 245 p 58 et 59.
Patrick MORDACQ
MBENGUE A. (2005), « Paradigme SCP, théorie
évolutionniste et management stratégique : débats anciens,
données anciennes, résultats nouveaux », Laboratoire
E.U.R.O.P., Équipe Universitaire de Recherche sur les Organisations et
leurs Performances, Université de Reims - UFR des Sciences
Économiques et de Gestion, XIVième Conférence
Internationale de Management Stratégique, Pays de la Loire, Angers 2005,
AIMS 2005.
Moizer P. et Turley S. (1987), « Surrogates for Audit Fees
in Concentration Studies - A Research Note », Auditing: A Journal of
Practice and Theory, Vol. 7, No. 1, p. 118-123.
Moizer, P. et Turley, S. (1989), « Changes in the UK Market
for Audit Services: 1972-1982 », Journal of Business Finance and
Accounting, Vol. 16, No. 1, p. 4 1-53.
Morvan Y. (1991), Fondements d'Economie Industrielle, 2e
éd. Paris, Economica, pp. 1-639.
Moreau F, « Dynamiques Industrielles et Stratégies
Concurrentielles », Conservatoire national des Arts et Métiers.
Motol.C, « La concentration des acteurs de l'audit pose
probleme aux entreprise », option finance n°877 du 3 Avril 2006,
p52-53
Noël C. (2005), « Le co-commissariat aux comptes
à la française : réponse aux doutes soulevés par
Julien Le Maux », Revue Française de Comptabilité,
Avril, n°3 76, p. 26-29
Oxera (2006) Competition and Choice in the UK Audit Market. (The
Oxera Report) (London: Department of Trade and Industry/Financial Reporting
Council).
Piot C. (2005), « Concentration et Spécialisation
Sectorielle des Cabinets d'Audit sur le Marché des
Sociétés Cotées en 1997-1998», Comptabilité -
Contrôle - Audit, Vol. 11, n°2, pp. 149-173.
Piot C. (2006), « Concentration et
Compétitivité du Marché de l'Audit en France: Une
Étude Longitudinale 1997-2003 », Working Paper, AFC Tunis (2006),
pp. 1-19.
ANNEXES
|
|
|
|
0u-
0 <
E =
.c <
2 -a
|
0 N
e -ô
c. 3
cb .= 21'1:
csi E
co
|
Co
|
1-
0 _1 _1 w 0 ui
|
w
|
e
r-
,_
c)
|
|
|
|
|
, »
0 <
E m
.c cc
ccs <
2"0 Y
|
.è.e. D D
r- 0 0
· - 2 cC
csi 1- cc
Y
|
e.
Ro
ck
co
|
0
:a
as
ô m E
2 u_ 2 -
005 2
|
0)
|
e.
N.
co
|
|
|
|
|
a ,fl
le>. :2 Cr) ...... ; .....--
:0 -0 0 .... 1..L
g :.: . g g "g el .1
_,..<5
Ln in -a "0 2E2z0_1
|
e _ m
csi = cC
- 0 , _I
e `#177;' W
0
|
e
ID
O)
c',
|
_
.e
_. <
2 D
c..) m ré
|
-e
|
O)
'4".
N
|
|
|
|
|
- 0
t; 0 5
-) Dl 0
|
e
gt .
co *
o_
|
e
c.,, m F,
N: TU 1
co 0
|
e. D -
< LI
Ô (D 2 1-
u, w I= < 0
C..) 0 2 J
|
·-
|
e
N
o
|
|
|
|
|
0
<
C.9
|
. -,,
w g 7,2
r...
· - ° 3
2
|
e
? 0
. *
`1" o_
|
-.5
e . D
ID
·-
· 0 Y
ok u_ 2 m P
cr < .0 .- < M
C..) < 2. 2 0
w
|
-
|
e
01
d
|
CÉ
w
(ont 0 CO
|
e
.-
...
· -
|
|
|
N 0
1:0 2
2 0- Li_ Y
|
e 0
r- o 2
Cg E 2
o 1 1-
· -
2a
|
e.
,- 0
co_ <
Co C.9
|
N
-ri)
c, c _1
co 7:1 ch
cl: 0
·
C..) 2 ...
|
0)
|
e.
w
.-
|
-a .e..- E L's
Ô 7
2U
|
e
'n
· 6
|
|
|
CC
0
z
LI
|
e . .2
S'.1 .2 les -
- 0 E 0
-- e cp e
m E
|
e CC
gl.' 0
-
oe z
LI
|
e 2 0
a) irs e
co
csi. E co
,_ o <
m x 5
|
· -
|
o
c.,
d
|
en
-
E
-
CD
2 CD
|
e
el
..o
|
|
|
: ,
0 w
u_ Z
|
e
Co N CD
1"-.. co 2
o 2 o_
LL M
|
e
a)
o e. .=
0) W -
ll z
|
à 0
· !..'
io 2 liji
° Z 2 z <
cs w D w <
m 0 2 u_ .
|
'
|
Co
'4...
c,
|
<
m
- M
t; 0 5
-) Dl 0
|
e
0,
-
r.: ,.C..)
5
o_
|
e
.-
r-
..-
|
|
w
CC
<
°
0
w 2
|
.è.e.
`-
. e w
|
c si Li_> Z
e
r....
. 0
°7 <
u_
|
,_ ..
c
g -a cs
z É
CO W li_ 0 Tu
m < 2 cp
|
-
|
e
`7r
o
|
< ._
1
0
CD 2
|
e
c",
';)- N 0
1:0 2
2 o_
u_ Y
|
e m
a) CL
g
co g o
0 2 _1 CD w
|
e
r- o. -
`-
|
1-
0
J
W
0 W
|
e.
cou) .F
,
. .0 D
Co .0 0
li_ m
|
e w
.cr g:É
cg 0 0
N w
g
|
Ie D 0 1-.--'
'à' ..à..
c0
cl: 0 CÉ 0 c2
0 u_ D -0 0
01 < < <
N
|
C`,
|
a)
-
|
0
<
(9
|
e
0))
a CC
..:. 0
z
LI
|
e
a) Tu
`-
Cd '5 2
c`i>
Z .:C
|
e
N
g
· -
|
0 'es
0
2 u_ .91 m
0 0 0
|
e.
g, 0
r,: <
u_
|
e 1-
c`, O
r- _1 w
ci _1
w
0
|
e ce <
r) cc z
w » wo
cg m_l
r- <_1 I- i=
m r? < _1
|
f0
|
e,
c",
cl
|
_
N U
1:0 2
o_
u_ m
|
e 1-
a 0)
· - J
r..:
· - J
w
0 W
|
e. <
on' a u_
. 0 =
f0 -e m
0 < =
2 u_ Y
|
e
.
0
.5.
|
D -
,,s< e I_
yi....,11(5.
CJ 0 2 _1
|
e w cq
OCe
· 4:.
Lc1
|
e. 0
° (.5M 0
c't s I-L E m
cr - c
C..) ° 2
2
|
e ors,
° '''0 e
co 0
.4: E 3
< W}
|
,....
|
e
Cs1
i'-..
.
|
in
cc
c..)
0
W 2
|
.è.e.
co LI
cr 'e Z
Id -Q <
. x
0 Y c2
|
e w
cr E w
c» 0 m
N .c co
cr 2 w
m
|
e
co
cr
|
«ci) o
c _1 7:1
me)
0 ...
|
e c,
ô m 'is
co u_ .- Ts
Oô c c
!
|
e ri) =
co '-' 0 Y P
co u_ o .-
csj<G>Malp0)
0.0-° g0
<
|
"0
c, . cp
- _z c,
É
2 M
|
`-
|
e
01
· r.
|
0
«,
ô m E
2 u_ 2 T,
005 c
|
e 0
o g <
E 'n- cz
. cn
`-
aci 5
|
ô
c.
cm.
Rn N 0
Dl >
2 0-
u_ m
|
e
a) 1"-., `-
csi
|
W LI 0 0
m < 2 cp
|
z<misdwpze
e .i (5
co 2 .i
co Z Z 0
0 0 W ..<
2u_
|
'ci
e t-
m s 3
:2 ,,.; '''
w.
0 2
|
e
g. 0
a) w
<
|
· -
|
e
.
· 4'.. o
|
ce z <
CCZ -1w0
< -i I- p
coPE<-1
|
e-
o :- 0 3
co 0=c
gri0c7021r.-02021
Clu-D-aCD
1:0 < < < N
|
e -
0) - ..-.. N-
cr. OF
c0
Ciu_D-ac..9
1:0 < < < N
|
cr
`-
ai
|
cÉ Z <
w » cC Z
m_ou0
< _1 I- i=
m i= Z < ,
|
ce z <
cc, »
.D W _1 cÉz csm_iw0-1,:r3
<1=1
1:0 _ <
|
e - 0 -,--.39.
;:o.....21=2,Qg
.- 0 C =
coL,k-D-oco
< < N
|
N
È c7
d CD m
ID <
"g 0
|
`-
|
e
Ro
`1".
0
|
.,,
c..) ->à
· F_,c,;
2 E 5
<W»
|
e
,_ ce m
m _1 w 0
· - < -1 I- I= coPE<-1
|
e es
,... - g)
g ô < Lu »
|
e
o
-1-..
· .1"
|
.5
0 , Ex"-
2eg.
< Lu »
|
e es
c
·I c..) ... F
g= <W>c2
|
e es
'n 0 - F
::."- >g=
< Lij j:_'
|
e
e, _1
W c7
g; 0 -
m0 9 *
< a 0
|
-
|
e
o
co..
O
|
0
w
<
|
e
CO ad
Cst MM
Ro 0 le 5
2 E o
< Lu »
|
e
cl, J
W 2
cd 0 Q
m -à .
< < 0
|
e
CO
O)
o
· -
|
.0 0
c. CO
,E <Z c,
2 M
|
e 7, cc
cr Lu 2
co <
cs1 -a 2
N
|
e Ni
o, È c7)
o .> aa
cf -a ns <
0
|
e -,1 <
Ro 2 2
CD CT) ..t.
r- -a
N
|
· -
|
e
co
c o
d
|
2
e
.
|
W
0
z
ua e
cn "S
< .
|
21-
CC
D
w .-
o
ii3 ,2
cf). 'g
< .
|
J
<
5 cc w 2
>
o
O
|
.-
= 2a
'3
as
|
cc
W
5 .-
=
ce
e _s
LI c.
|
w
il
1-
u) `5
M ce
. -
Z us
|
z .5
73 .,:2
-1 as
|
Ts
.0
o
0 ....
-0 0
e '2
.., ..
Z E
|
To -el (3 C:13
o_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n
E<
e
|
cn
|
· ,.9,
c,
,_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"g
o
E 2
.c
0 2
2 1-
|
Cg
|
e,
c»
c;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a.....,-
? d
.c M
e e
|
-a .
· -
|
e
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a _.
-0 0 _1
le.> -a; E <
:0 .... 0 t- CO
a .- C7)
u9 7 'à'
-g 8 < -- < co co = Lu "C7 2 -- z 0 .
|
|
co
c,
d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ts
o
c ,m
o co
-,7,. E
2 2
m
|
cq
|
e,
co
cl
c,
|
|
|
|
|
|
|
.
c
a
V Li-
2
ciii
|
..r)
co
|
|
|
|
5
0
--
'7; 0
, m
|
oe
|
.-
r-
csi
|
|
|
|
|
|
|
C7)
C
0 -2 0 w . < o
m c.)
|
e
r-
g)
-
`-
|
|
|
|
m w§ o m -5 if,
f m
|
· -
|
e
CO
,-
c;
|
|
|
|
|
|
|
g
a 0
2 m
-a 0
oe <
cc z
|
e
co.
D
|
|
|
|
< .-
'a
3
0 2
|
--
|
e
cr
d
|
|
|
|
|
|
|
*
o_
|
e -- co. oe
|
|
|
oc)
|
<
|
co
|
e oe c4. cs,
|
|
|
|
|
|
|
< I- 0 0 IZ D 0 <
|
c»
`1".
co
|
|
|
|
c_9
2
o_
m
N
CO
2
u_
|
co
· -
|
e
Co
c,
d
,-
|
|
|
|
|
|
|
< I- 0ô CC D o<
|
e
i"...
co
|
|
|
|
CC
0
Z
LI
|
,...
|
e r1"... co
|
|
|
|
|
|
|
m
0 D
rel 0
e .
z 0
|
CO
co
d
|
'a 0 g . »
|
.
2
D
z
z
w
|
n
'6
|
|
(;) a )
=,
w
e
.
u_
|
|
Co
q
,-
|
|
|
|
|
|
|
ce 2
m 0
e e
|
e
co..
m
|
z .= c7) g z m
P 'I' Li;
|
e
Z:
cs,
|
|
co cc
-a 1
-c
.a) 0
u_ m
|
· -
|
el
c,
|
|
|
|
|
|
|
-a e'r- E Lu
3 71)
2 0
|
e
,---
--
|
c)
m
2 0zo » 0 D
|
cbcsi
co
a
|
|
o
<
u_
|
Co
|
e,
(-0
oe
d
|
|
|
|
|
|
|
o
E £:i r3
- D
2ez0.- 0 z w <
2 -a MI CD
|
e
cs,
cg
|
M w 0 o
m
|
e
,j.
..r
csi
|
|
u)
CC
C) g
,
w
|
co
|
e.
co
|
b
;91
-0
.
0
|
w
0
z
D
ci)
ci)
· Ct
|
b
.
=.
"C7
g
|
M
D
w
I--
o
w
(/)
<É
|
b
"C7
c
|
_1 É 0 CC
w
>
0
0
|
b
a)
e.
·
17
n
os
|
M
w
5
Z
<
Z
LI
|
b
1.)
"C7
«9
|
w
il
Ic7,
M
13
_Z
|
;
;]-.)
7
0
|
a
z ;
c7) .
--
13
-I cs
|
Tu .0 o Tr)
a) --
Il 0
e 2
.0 CO
Z E
|
Tu
a
o
C7)
Ô
o_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
is
. 0
2 m
"O 0
< J# CÉ Z
|
--
|
e
c.
cs,
d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C.)
*
a
|
|
Ol
e,..
RO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< 1- 0 0 'Y D 0<
|
--
|
e
r.-
cl
csi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
< I- O 0 iz D 0<
|
· -
|
e
ai
· t. ai
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y Cs D rel 0 kt M Z 0
|
--
|
e
cr
cl
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
iz 2
rn rn
e e
|
· -
|
e
a)
el
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7)
'5 2
g 2
z <
|
--
|
e
-7.
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
Y
<
a u_ . = Ici m . <
2 u_
|
· -
|
e'
ca
.-
d
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-a -e'
2 4
3 3
2 0
|
cr
|
e?,
cr
csi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-a z
a) ,,
E al '-'
C6 .0 D
.0
· - 0
o e<
2 Z a)
|
cq
|
e?,
CO
.-
,-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E V)
as 5
20
|
--
|
e
c.
cr
d
|
b
g
-g
as
|
w
0
z
D
gn)
<
|
b
e
-g
as
|
'Y
D
w
1-
if,
q
<
|
._
a
2
-g
C
|
<
5 iz w 2
0
O
|
.-
=
2
"S
as
|
iz
w
0-
i
LT
|
.-
a
g
-g
ca
|
w
il
1-
co
D
0
z
|
`5
g
-g
as
|
C.9
z
,7)
_1
|
a,'
2
"g
as
|
Tu
.0
0
-8 Cu
e '2
.a co
Z E
|
a)-el
Tu
'ci,
0
ci_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tl)
0
»
|
É
R
Z...'
Z
w
|
· -
|
e
csi
co.
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z
CO
.c c7
g rn
o <
» m
|
W w Z
--
|
e
oe
csi.
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
D
m
2
. =
» 0
|
Nô
|
cr
g.
o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CC w C.9 0 N
|
m.9.
|
a)
`1".
.-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a)
C
'a
-a u-
a) <
.c =
5N
|
c.i
|
e, ro cl o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... F-à E
e
|
É
--o
|
-
ID
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m
1
0
.
f:
N
|
-
|
e oe c
·,.. oe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F
0 '2
0 n
w Ê
N< 0 C..)
|
--
|
e
c.,
o.
.-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z
< M M M 00 2 CÉ 1-
CÉ
|
Nô
|
0
Cq
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J
w
m
g 6
=
cc 0
|
CO
|
e,
CO
r-
o
|
g
-g
.
|
w
0
z
D
gn)
<
|
b
e
.
|
cc
D
w
1--
ifi
<
|
.-
a
2
-g
.
|
_. < 5 iz w 2
>
0
0
|
.-
a
2
'g
.
|
iz
w
C3
i
LI
|
.-
a
g
,,,
|
w
2
I--
co
D
0
Z
|
e
-g
as
|
b? 0 73 _1
|
` .,
· 3 as
|
2
Ts
.o
o
-8 Cu
'2 .. . Z E
|
To
-el
'ci,
0
a_
|
|
|
|



