Université de Rouen
UFR Psychologie, Sociologie, Sciences de
l'éducation
Département de Sociologie
Mémoire de Master 1ère
année
La reconquête du
centre-ville :
Enjeux politiques et sociaux d'un changement
spatial



Par Audrey Lelong
Sous la direction de Nassima Dris
Septembre 2007
A mes parents,
A mes frères...
REMERCIEMENTS
Je remercie toutes les personnes sans qui l'élaboration
de ce mémoire n'aurait pas été possible.
Tour d'abord, un grand merci à Nassima Dris pour son
soutien, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long
de l'année.
Merci à Jean-Christophe Blondel de m'avoir accueillie
pour un stage au service du droit des sols de la mairie de Rouen et de m'avoir
fait découvrir un univers exceptionnel.
Merci à celles et ceux qui m'ont avancé dans mon
travail, en particulier pour la relecture finale.
Ce mémoire traite du rapport à l'espace et des
enjeux politiques qui lui sont liés à travers la question de la
requalification du centre-ville de Rouen. Je prends pour illustration la
construction de l'Espace Monet Cathédrale, qui remplacera le Palais des
Congrès fermé depuis 1996. Cet espace se trouve place de la
Cathédrale située en plein centre-ville de la rive droite de
Rouen.
Le Palais des Congrès de Rouen se situe à
l'ouest de la place de la Cathédrale, au croisement de la rue du Gros
Horloge et de la rue des Carmes. Sa particularité est d'être
érigé à côté de monuments classés
comme la Cathédrale et le Gros Horloge quelques mètres plus
loin.
Ce sujet soulève des questions liées à
l'inscription d'un ensemble moderne dans un centre historique. De ce fait, la
question du patrimoine est essentielle. Nous nous interrogeons sur la place du
centre historique dans l'histoire urbaine et dans les représentations.
Selon un responsable de l'urbanisme, le plan local
d'urbanisme, qui est le document de planification de l'
urbanisme
communal ou
intercommunal et qui a été adopté en septembre 2004
à Rouen a pour objectif de reconquérir le centre-ville
en construisant les nouveaux grands projets urbains:
« Depuis plus de 3 ans, nous essayons de faire
disparaître l'actuel bâtiment abandonné de l'ex-Palais des
Congrès pour le remplacer par un nouveau projet, l'Espace Claude Monet
Cathédrale, susceptible de redonner vie et qualité à cet
endroit majeur de la ville »1(*). Le nouveau projet apparaît donc comme un atout
pour la ville.
Le projet Monet Cathédrale est composé de trois
corps de bâtiments, articulés autour d'une cour ouverte, donnant
sur la façade Romé restaurée et en correspondance avec les
rues adjacentes (rues des Carmes et St Romain). Le rez-de-chaussée sera
en retrait pour prolonger les arcades existantes avec des piliers revêtus
de pierre. Le parvis sud aura une structure en béton
devant laquelle sera posée une façade en plaques de verre clair
et transparent.
Au-dessus du bâtiment, il y aura un plan incliné
formant la toiture qui fera 14,70 mètres de hauteur au minimum et 22
mètres au maximum, qui est la hauteur maximale autorisée par le
PLU, contrairement à la toiture du Palais des Congrès qui fait
19,10 mètres.
Le bâtiment comprendra des locaux commerciaux (dont un
espace bar et restauration) au rez-de-chaussée et à
l'étage, une salle de conventions pour congressistes (jauge de 250
à 300), et enfin des logements de hauts standing dans les étages
supérieurs.
Même s'il y a eu au préalable une réunion
organisée par la municipalité sur le projet, il apparaît
surtout comme une volonté politique de marquage de l'espace.
Quelle est la place des habitants dans ce processus ?
Ont-ils été consultés ? Dans quels objectifs? Les
habitants peuvent-ils s'approprier le nouveau projet ? Une des formes de
l'appropriation de ce projet par les habitants pourrait éventuellement
correspondre aux débats entre les professionnels depuis mars 2005,
période à laquelle le Ministère de la culture a
décidé que ce « dossier sensible » sera
traité par la commission supérieure des monuments historiques.
La sensibilité du dossier est due à la nature du projet,
c'est-à-dire une forme architecturale moderne dans le centre historique,
qui a suscité de nombreuses réactions de la part des habitants.
La commission supérieure des monuments historiques a
étudié la proposition du maître d'oeuvre dessinée
par Jean-Paul Viguier en juin 2005 et a rendu un avis négatif, qui est
consultatif car seul le ministre décide.
Après cet avis négatif sur le projet,
l'architecte propose un nouveau projet en tenant compte des remarques de la
commission.
De décembre 2005 à avril 2006, des avis
complémentaires sont demandés par le Ministre à partir du
projet modifié afin d'éclairer sa décision. Les avis
portent tantôt sur la démolition du Palais des Congrès,
tantôt sur la construction du projet Monet Cathédrale, ce qui a
créé de l'incompréhension chez la plupart des Rouennais au
moment de la publication de ces avis. La municipalité a recensé
parmi les personnes favorables au projet, seulement ceux qui s'étaient
prononcés favorablement pour la destruction du Palais des
Congrès.
L'avis des experts n'a alors pas été pris
totalement en compte et en avril 2006, le Ministre rend un avis favorable au
projet amendé en reprenant certaines recommandations des experts.
Ce projet suscite des avis soit positifs soit négatifs
selon les personnalités politiques. À cette
échéance des élections municipales, on peut émettre
l'hypothèse d'une éventuelle stratégie politique.
La stratégie politique n'est-elle pas l'enjeu majeur de
cette querelle car chaque camp politique a une position différente?
Y a-il vraiment une volonté de protection des abords de la
cathédrale, et donc du patrimoine de la part des politiques ? Si
les personnalités politiques voient, au travers de ce projet un moyen de
conquête spatiale pour affirmer un rapport de pouvoir, la question de la
protection des sites historiques n'est peut-être pas aussi essentielle
qu'on voudrait le faire croire.
Ce qui pose problème est, selon les experts, d'une part
la localisation du projet, c'est-à-dire proche de la Cathédrale
et d'autre part, une hauteur maximale que le bâtiment atteindra pour que
cet espace soit le plus rentable possible pour les promoteurs.
Il est essentiel de prendre en compte que ce bâtiment
n'est pas une propriété de la municipalité, seul
l'Architecte des Bâtiments de France est en mesure de refuser le projet.
C'est le CDR (consortium de réalisation) du
Crédit Lyonnais qui en est propriétaire et qui souhaite le
démolir. Ce CDR avait proposé à la municipalité, il
y a quelques années de vendre le Palais des Congrès pour un euro
symbolique, or, le coût de la démolition ainsi que de la
reconstruction était trop cher pour la commune. Les moyens de la ville
et les dispositions actuelles ne permettent pas d'investir suffisamment. Le CDR
en reste donc propriétaire et est responsable de la nature du nouvel
espace. La mairie peut seulement orienter les débats sur ce projet. La
reconquête voulue du coeur de la ville est donc difficile et très
lourde.
Cette situation complexe de reconquête du centre-ville
au travers de ce projet Monet Cathédrale nous conduit à nous
poser des questions sur l'identité de la ville et sur la participation
des habitants.
Pour effectuer mon étude, je partirai, du
« cadre bâti » de la ville, c'est-à-dire
celui qui se matérialise sous forme de plans, de lois, de
règlements et de réalisations normalisées2(*). La matérialisation est
indissociable des contextes de leur production et de leur
interprétation, qu'il s'agit d'incorporer à ma démarche.
Donc, au-delà de l'observation et de la description de l'espace, je
prendrai en compte le contexte de destruction et de reconstruction, l'avis des
habitants : leurs perceptions et leurs représentations ainsi que la
façon d'agir des politiques.
Ce qui est intéressant à étudier est
l'impact d'un tel projet au niveau social et politique. Quel est l'impact d'une
transformation de l'espace qui modifie l'ensemble existant par de nouvelles
constructions ?
Nous construisons notre raisonnement au travers du
centre-ville et sa signification pour les habitants. Nous cherchons ainsi
à définir cette notion de centre-ville, thème de notre
recherche.
Nos interrogations quant au rôle du centre-ville
comportent deux aspects : la participation des habitants aux Grands
Projets de Ville, d'une part et le rapport au patrimoine des habitants des
politiques, d'autre part.
Si les débats se font vifs, il est important de
s'interroger sur le fort attachement des Rouennais à leur patrimoine.
Nous tentons de comprendre dans quelle mesure la reconquête du
centre-ville pourrait-elle conduire à une crise d'identité et/ou
une crise politique.
Plus précisément, la politique menée pour
la construction moderne de l'espace Monet Cathédrale au sein du centre
historique va-t-elle dans le sens des attentes des Rouennais ?
L'introduction d'une architecture moderne au sein du
patrimoine historique de Rouen nuit-elle à l'identité de la
ville ?
Les processus de consultations concernant l'aménagement
sont-elles démocratiques ou apparaissent-elles comme une mesure
technocratique ?
De nombreux travaux de morphologie urbaine lancés au
cours des années 1970, ont été peu poursuivis. L'approche
morphologique pratiquée jusqu'à aujourd'hui, à quelques
exceptions près, était basée sur l'étude des formes
urbaines anciennes avec une préoccupation patrimoniale. Je voudrais
ainsi partir de ces études tout en intégrant la modernité
urbaine, c'est-à-dire me préoccuper du patrimoine ancien qui est
confronté à la modernisation urbaine.
Contrairement aux études sur le patrimoine de la ville
passée, je me propose d'étudier dans le cadre de ce
mémoire, les formes urbaines dans leur vécu actuel et à
venir.
Pour cela, la problématique soulevée ici,
nécessite une réflexion à partir de la notion de
centre-ville, de patrimoine et de participation des habitants dans la mise en
oeuvre des projets urbains.
1- Centre-ville et centralité
L'expression centre ville recouvre une
réalité complexe, composite et variable. Prenons tout d'abord la
définition proposée par Reynaud3(*) pour qui le centre, c'est essentiellement «
là où les choses se passent, le noeud de toutes les relations
», ceci indépendamment de l'échelon considéré
; ainsi, il est possible de parler de centre de quartier, de centre-ville, de
centre de pays, pour autant qu'une « concentration »
d'éléments caractérisée par la densité de
population, d'activité et de trafic, de facteurs ou de valeurs soit
présente. En outre, le centre peut varier considérablement selon
les individus (ou groupes) : limites, caractéristiques,
éléments de référence, se modifient en fonction des
points de vue et des représentations. La place de la Cathédrale
de Rouen qui est dans le coeur de la ville est en effet le lieu où tout
se passe (spectacle, manifestations de toutes sortes, lieu de rencontre, de
rendez-vous...) et elle peut être vue différemment selon ce que
les personnes viennent y faire.
En général, le coeur de la ville est la partie
fondamentale de l'organisation urbaine : celle qui en assure la vie et
l'activité. Contrairement aux petites villes qui ont un centre-ville
multifonctionnel, les grandes villes ont dans leur centre-ville des quartiers
spécialisés.
À Rouen, la répartition des types d'habitats
permet d'individualiser des quartiers en les spécifiant, selon la
prédominance des maisons sur les immeubles collectifs, l'importance des
espaces verts, l'orientation, l'ancienneté du bâti, les modes
(quartiers anciens recherchés aujourd'hui, délaissés il y
a 40 ans), les activités économiques. Le centre ville est le
plus densément peuplé et présente deux aspects : des
immeubles très serrés autour de la Cathédrale, Saint
Maclou et Saint Ouen et la place du Vieux Marché (se
référer au plan de la page suivante répertoriant les
quartiers de Rouen).

Plan 1 : Les quartiers au coeur de la
ville
|
Population
|
Évolution 1990/99
|
Nombre de logements
|
Évolution 1990/99
|
Habitant par logement
|
Densité
|
|
Vieux marché Cathédrale
|
14054
|
10
|
10773
|
17,2
|
1,5
|
14082
|
|
Saint Marc Croix de pierre
|
14800
|
11,6
|
10114
|
26,3
|
1,6
|
14082
|
|
Centre rive-gauche
|
13191
|
12,7
|
7893
|
15,3
|
1,8
|
8370
|
|
Pasteur
|
4259
|
23,2
|
2845
|
25,2
|
1,7
|
4840
|
|
Gare Saint Gervais
|
6606
|
6,3
|
3906
|
11,1
|
1,8
|
7811
|
|
Jouvenet
|
5151
|
1,8
|
2523
|
5,1
|
2,2
|
5630
|
|
Jardin des plantes
|
5819
|
5,3
|
3107
|
6,8
|
2
|
7667
|
|
St Clément Pépinières
|
6569
|
2,4
|
2952
|
2,6
|
2,1
|
7482
|
|
Grieu Vallon Suisse
|
6601
|
2,6
|
3493
|
6,5
|
2,1
|
4270
|
|
Mont Gargan
|
2588
|
0,5
|
1115
|
4
|
2,4
|
2432
|
|
Quartiers Ouest
|
7763
|
5,1
|
4462
|
21,5
|
2
|
6286
|
|
Sablière Grammont
|
2995
|
-7,7
|
1399
|
2
|
2,3
|
8437
|
|
Sapins
|
4170
|
-8,3
|
2122
|
-1,2
|
2,1
|
5030
|
|
Chatelet Lombardie
|
5976
|
-20,6
|
2327
|
-14,4
|
3
|
5077
|
|
Grand Mare
|
5795
|
-8,2
|
2588
|
-0,73
|
2,6
|
7938
|
STATISTIQUES DES QUARTIERS DE ROUEN, 1999
Source : site Internet de la ville de Rouen.
Bien que certains quartiers en reconversion (quartier Saint
Marc/Croix de Pierre, quartier Pasteur et quartier Ouest) attirent de plus en
plus d'habitants, le quartier Monet Cathédrale reste le plus
peuplé en logement et en habitants. Loin de se déserter, ce
quartier a vu augmenter sa population de 10% en 9 ans (entre 1990 et 1999) et
ses constructions de logement de 17,2% entre ces mêmes dates.
En centre-ville de Rouen, on note un important centre
historique. Dans le seul quartier Vieux marché/Cathédrale on peut
trouver une multitude de monuments classés (La Cathédrale,
l'Office du tourisme, l'Hôtel de Ville, le Gros Horloge, l'Eglise Sainte
Jeanne d'Arc, le palais de Justice, la place du vieux marché...)
La ville de Rouen s'est étendue à partir de son
quartier historique. D'après R. Ledrut, le quartier historique constitue
ce qu'il appelle une centralité « morte »,
opposé à la centralité vivante qui est celle qui s'est
étendue autour du centre historique de Rouen. La centralité
vivante est caractérisée par le centre des affaires, le centre
commercial et administratif :
« Les propriétés
géométriques de l'espace, l'antériorité historique
du noyau initial à partir duquel la ville s'est étendue, les
représentations symboliques qui lui sont associées sont autant
d'éléments qui tendent à faire du coeur
géographique de l'agglomération le principal point d'appui et le
lieu emblématique d'un grand nombre de fonctions
centrales »4(*).
Ainsi, pour Henri Lefebvre5(*), l'histoire de la ville est souvent celle de son
centre historique construit, il y a longtemps. La centralité est donc
l'essence de la ville.
Nous verrons si à Rouen le centre historique ne
constitue pas une centralité morte.
Rouen n'a pas la seule spécificité d'être
une ville historique. Le coeur de la ville a également une fonction
commerciale. L'objectif du développement des rues piétonnes est
d'ailleurs de faire fonctionner ce commerce foisonnant qui tend à
prendre de plus en plus d'importance. La fonction symbolique qui
s'exerçait par l'intermédiaire d'édifices et d'objets
qu'il n'était pas question de s'approprier a connu une grande mutation.
Les monuments de la ville moderne sont plus encore les boutiques et les grands
magasins que la cathédrale et l'hôtel de ville6(*). On arrive donc à
l'extension des agglomérations qui tendent à créer de
nouveaux centres spécialisés, autour d'équipement
regroupant les loisirs, les services et les commerces, autrement dit, des
centres secondaires. Les centres commerciaux, les regroupements de commerces et
de services dans un espace clos tendent à remplacer les centres-villes.
Cette évolution des centres-villes tend à mettre à mal la
thèse de Raymond Ledrut qui propose le couple de centre/non centre et
intériorité/extériorité puisque les
centralités peuvent se construire en dehors du coeur de la ville.
On peut prendre l'exemple de la constitution du centre
Saint-Sever dans les années 1970.
À l'origine, le centre-ville de Rouen occupait la rive
droite de la Seine. Aujourd'hui, il déborde largement. Avec le centre
Saint-Sever et son centre commercial, le centre rive gauche apparaît
comme un véritable prolongement du centre-ville de Rouen. Mais au fil du
temps, les deux centres-villes se distinguent spatialement et socialement. En
effet, le centre ancien peut apparaître réservé aux couches
sociales les plus privilégiées alors que le centre récent
rive gauche n'est pas fréquenté par toutes les couches sociales
de la population de l'agglomération7(*). Il concentre et attire principalement les classes
sociales les plus défavorisées. Les habitants de la rive droite
et de la rive gauche sont perçus au travers des différenciations
sociales, car ceux de la rive droite sont représentés comme ayant
un niveau social et d'études élevées et n'ayant pas
d'accent et habitant un centre d'activité intellectuel8(*).
Avec la reconquête du centre-ville, ces assimilations
vont-elles perdurer ?
La ville va être modifiée, le coeur historique va
être retouché et cela va nous conduire à parler du rapport
au patrimoine des habitants et de leur participation aux projets de ville.
2- Le centre historique : Patrimoine, sens et
représentations
Je partirai notamment des travaux de Raymond Ledrut pour
évoquer cette dialectique entre habitants et patrimoine. Il se
demande : « la forme reçoit-elle ou donne-t-elle un
sens ? »9(*).
D'après lui, on ne peut comprendre la forme sans saisir le lien entre la
forme sociale et la forme spatiale.
Il montre à quel point le centre est qualifié
socialement ; « les grandes artères, les places comme les
monuments sont à la fois d'ordre quantitatif (éléments
d'un réseau spatial) et d'ordre qualitatif (point de
concrétisation de la ville pour chacun de nous) »10(*). À travers ses analyses
empiriques, Ledrut souligne l'importance des dimensions matérielles
(usages du centre) et symboliques du centre ; ainsi, le centre évoque
pour les citadins à la fois un lieu, une forme, un monument, mais aussi
des activités et des qualités particulières.
La dimension subjective du sens que l'on donne au monument est
essentielle pour notre étude. Elle nous permettra de comprendre
l'affection portée par les habitants à leur ville.
L'image possède toujours une résonance
affective, elle déclenche une émotion et « elle exprime
un rapport global de l'homme à la ville »11(*), laquelle se trouve sous cet
angle personnifié. Plus il y a de monuments, plus l'identité de
la ville est forte. On peut comprendre cette corrélation car le monument
est un repère privilégié, c'est-à-dire un moyen de
se repérer mais également de repérer la ville. Il
apparaît comme un « symbole ». Qui n'a jamais fait
visiter la Cathédrale de Rouen à leurs amis étrangers
venus leur rendre visite ? Qui n'a jamais donné rendez-vous Place
de la Cathédrale ?
L'espace n'est pas seulement un ensemble de points, lignes et
surfaces, il est chargé de sens. Certains éléments, en
renvoyant à des moments historiques, des normes éthiques,
politiques ou religieuses et en suscitant des émotions, participent
à la construction de l'identité collective et à
l'élaboration du lien social.
Halbwachs est le premier chercheur en sciences sociales
à analyser de façon détaillée la mémoire
collective. Il montre dans son ouvrage La mémoire collective
dans quelle mesure l'espace joue un rôle fondamental dans les processus
de mémorisation : « Il n'est point de mémoire
collective qui ne se déroule dans un cadre spatial (...) ainsi, le lieu
a reçu l'empreinte du groupe et réciproquement »12(*).
La mémoire peut se définir comme « la
faculté de conserver les idées antérieurement acquises
»13(*), ceci à
un niveau individuel ou collectif.
La symbolique d'une ville, au travers de ces monuments, est
éternelle car l'identité de la ville c'est le patrimoine en
héritage. La Cathédrale existe depuis le XIIème
siècle et le sera jusqu'à la fin des temps. L'héritage des
nombreux monuments a permis à Rouen de présenter sa candidature
des villes au patrimoine mondial à l'UNESCO en septembre 1993.
Pour A. Riegl, « le monument est une oeuvre
créée de la main de l'homme et édifiée dans le but
précis de conserver toujours présent et vivant dans la conscience
des générations futures le souvenir de telle action ou telle
destinée »14(*).
La définition de A. Riegl est cependant insuffisante et
demande à être étoffée. Pour cela, je vais prendre
la définition du monument de H. Lefebvre. Pour cet auteur, le monument a
une multitude de sens15(*). Le monument véritable a un caractère
significatif et symbolique inépuisable pour l'habitant. Les lieux
restent des lieux investis de sens, des « lieux identitaires,
relationnels et historiques »16(*) selon Marc Augé.
Malinowski17(*) et l'école d'anthropologie sociale ont
souligné dans quelle mesure certains espaces ou objets ont,
au-delà de leur fonction instrumentale, une fonction symbolique : ils
sont en mesure de nous mettre en relation avec des systèmes de
connaissance et de croyance et constituent, en d'autres termes, des supports
à notre identité.
Françoise Choay18(*) a ainsi montré que tout est désormais
mémoire, certes, mais mémoire vide car les nouvelles
constructions ne peuvent procurer d'émotions aux habitants. Le projet
moderne Monet Cathédrale ne peut être vu comme porteur
d'identité comme le serait un monument ancien qui a une histoire que
chacun s'approprie.
Dans une volonté de modernisation des centres-villes,
on voit apparaître des compromis entre conservation du patrimoine et
inscription de formes nouvelles et modernes dans ces lieux. André
Malraux fait passer la loi du 4 Août 1962 pour justement associer
revalorisation des patrimoines et modernisation des centres-villes19(*).
Le contexte de requalification n'implique pas que nous vivions
dans un monde de non-lieux20(*), c'est-à-dire des espaces mono-fonctionnels et
cloisonnés caractérisés par une circulation ininterrompue
et ainsi peu propice aux relations sociales mais plutôt dans un monde aux
repères changeants. L'arrivée du moderne dans la ville peut
apparaître choquante et dangereuse pour l'identité de la ville, or
pour Lynch21(*), il ne
faut en aucun cas arriver à la constitution d'une image trop
évidente de la ville, car elle deviendrait trop ennuyeuse. La ville doit
présenter de la stimulation, du rythme et une certaine
ambiguïté. J'en retiens que le projet moderne serait
nécessaire à la ville pour garder un certain dynamisme.
3- Projets urbains et participation des habitants
Par participation, nous entendons la
participation des habitants dans les décisions politiques concernant
leur ville, leur quartier, leur environnement.
La démocratie participative est l'un des objectifs de
la politique de la ville. Cette participation est née à la fois
de la mobilisation d'habitants et de certains représentants de services
publics autour de projets de développement social et urbain. La ville
devient de plus en plus un lieu d'exercice de la citoyenneté, notamment
depuis l'adoption de « La loi JOXE » du 06.06.2002, article L-125-1
qui stipule que « Les électeurs peuvent êtres
consultés sur les décisions que les autorités municipales
sont appelées à prendre ... » et de la loi
Vaillant adoptée le 13.02.2002, qui, selon les investigateurs, devait
devenir un instrument de reconquête citoyenne et il présentait
deux idées fortes allant dans le sens d'une démocratie de
citoyens et d'une révision du pouvoir municipal22(*).
Aujourd'hui, dans un idéal démocratique, chaque
individu veut pouvoir prendre la parole et être considéré
comme citoyen à part entière. Cette volonté est un retour
aux sources de la démocratie qui se définit avant tout comme
« espace de dialogue, d'information et de délibération
pour créer les conditions d'un consensus, de la formation de la
« volonté
générale » »23(*). Par les prises de parole, la société
civile construit l'espace public qui peut se construire par un
volontariat basé sur la participation active d'un grand nombre.
Nous essayerons de voir si la démocratie participative
a été de mise lors des discussions autour du projet et s'il y a
en effet, création d'espace public.
À travers les projets urbains, on peut observer
l'imposition de politiques spécifiques. Le Palais des Congrès
construit en 1970 était le fruit d'une politique d'aménagement
qui se voulait moderne. Philippe Genestier24(*) a décrit les matériaux qui permettent
de produire l'effet voulu, c'est-à-dire moderne. Selon lui, le verre
joue un rôle important pour provoquer la fascination immédiate
recherchée.
Il est intéressant de se demander comment ce
bâtiment va être accueilli et perçu par les Rouennais. Le
projet Monet Cathédrale étant de nouveau très moderne,
dans quelle mesure ce choix est-il judicieux ? Quels sont les
soubassements politiques d'un tel projet?
L'architecture devient un moyen d'accroître la
visibilité des administrations, d'afficher leur modernité, de
présenter une image positive d'elle-même. La compétition
des grandes villes pour le statut de « capitale
régionale » a entraîné une surenchère des
programmes de prestige dont la valeur ajoutée est parfois plus
symbolique que fonctionnelle25(*). Selon Alain Genestier26(*) qui s'est
intéressé aux formes, aux styles, aux ambitions et aux
significations associées à ces réalisations, en a
déduit que les modifications sont la recherche de prestige pour le pays,
les retombées qui peuvent en être attendues pour l'industrie
culturelle et l'aspiration du pouvoir à la reconnaissance. Comme
l'aspect fonctionnel peut être mis au second plan, on a construit des
mètres carrés d'un coût exorbitant sans savoir à
quoi ils étaient destinés, comme l'illustre la Grande Arche de la
défense.
Les habitants sont-ils victimes de la politique? Les habitants
ont-ils un rôle à jouer dans les décisions concernant les
Grands Projets de Ville ? La ville de Rouen souhaite-t-elle plutôt
améliorer les valeurs symboliques ou améliorer le cadre de vie
des habitants ?
Si nous considérons que les citadins sont autre chose
que des spectateurs passifs : qu'ils sont des acteurs à part
entière, tissant un ensemble de relations, s'appropriant la ville
à travers une multitude d'usage et de représentations, quelle
serait leur place dans la gestion de leur environnement ? Quels moyens
ont-ils pour agir ?
La théorie de la démocratie
délibérative d'Habermas est importante pour penser les conditions
de possibilité d'un changement fondé sur l'action positive
déterminée des agents de la société civile.
Habermas propose que la dissémination de la logique de la communication
et sa place centrale dans l'évaluation du monde vécu pourrait
contribuer à la fortification de la démocratie27(*).
Si les habitants ont la possibilité de participer aux
projets urbains, de donner leur avis et qu'ils sont pris en compte pour les
décisions, la ville leur ressemblera.
Maîtriser son logement, être bien chez soi est
insuffisant si, au seuil du logement commence un univers hostile ou
dévalorisant. La difficulté de l'appropriation des espaces tient
au fait qu'ils ne sont pas le résultat de pratiques sociales des
habitants28(*). Ils
doivent s'approprier les lieux que les experts ont conçus pour eux, or
il s'avère beaucoup plus difficile de s'approprier les lieux quand ils
sont imposés.
Y a t-il une incapacité à faire face à la
prolifération des demandes contradictoires ou incompatibles ? Face
à ces difficultés, les experts ont tenté de se substituer
aux futurs usagers du bâtiment en décidant de l'organisation
spatiale à retenir29(*). Dans ce cas, les habitants sont alors de simples
sujets qui ne sont pas écoutés car ils sont vus comme incapables
de s'unir pour trouver un compromis entre eux. Ils se voient alors
obligés de s'adapter à un environnement qu'on leur impose.
Or, l'insistance d'Habermas sur la participation des habitants
à la communication souligne les qualités potentielles des
intervenants, à savoir, l'auto-réfléxion, le sens
critique, la capacité à s'engager dans des actions et à
participer à des débats rationnels, enfin la capacité au
jugement et à l'action morale30(*).
La rénovation urbaine produit des changements trop
importants sur la population pour que les acteurs politiques puissent la mener
à bien sans son accord. Pour manifester son intérêt pour sa
ville, le citadin a plusieurs solutions pour faire entendre son opinion:
Il peut participer aux réunions publiques en assistant aux conseils
municipaux ouverts à tous ou bien assister aux conseils de quartiers.
Ces deux recours permettent une relation entre citoyen et pouvoir politique, ce
qui correspond à la sphère publique selon Habermas. Il la
définit comme étant une suite d'institutions et
d'activités qui a pour fonction de favoriser les relations entre l'Etat
et la société. Elle permet de lutter contre l'absolutisme
étatique, dans le sens où toute formation sociale devait pouvoir
accéder aux structures de pouvoir par ce moyen31(*).
Les conseils de quartiers ont été mis en place
à Rouen de façon expérimentale dans quelques quartiers du
centre ville, dès 1996, sous l'ancienne majorité PS. En 1999, ils
sont généralisés à l'ensemble de la ville puis
rendus obligatoires par la loi de février 2002.
Les conseils de quartiers vont êtres
présentés au public comme des « espaces de concertation
et d'interpellation, un nouveau lieu de démocratie, capable de rompre
avec le dialogue codé entre les professionnels de la politique et les
professionnels du mouvement associatif »32(*).
Les conseils de quartiers doivent avoir trois
fonctions33(*) :
- Celle d'écoute sur les problèmes ressentis par
les habitants, de concertation sur les actions de la mairie.
- Celle de consultation sur les projets concernant le quartier
ou ayant une incidence sur son devenir dans tous les domaines.
- Celle d'information mutuelle et d'interpellation entre les
habitants du quartier et le conseil d'arrondissement.
Le conseil de quartier Vieux Marché -
Cathédrale bénéficie d'une population et d'un cadre
d'intervention privilégiée : le centre historique de la
ville, mais aussi du dynamisme d'un noyau dur de militants
déterminés, dotés d'un savoir-faire acquis au fur et
à mesure des expériences.
Malgré une demande forte de la part des habitants pour
une démocratie locale active, il y a un déficit de la
connaissance de la démocratie locale à Rouen. En effet, selon une
enquête34(*)
menée par la mairie en mai 2005 auprès de 1000 personnes montre
que, 10% des personnes interrogées affirment savoir ce qu'est la
démocratie locale ; 25% indiquent connaître ce qu'est un
conseil de quartier (même si seulement 7% font la différence entre
comité et conseil de quartier) ; 21% se déclarent
prêts à s'impliquer dans un conseil de quartier et 75% des
habitants souhaitent être mieux informés sur l'action des conseils
de quartier.
Comment expliquer un tel décalage entre
l'omniprésence du thème de la démocratie participative
dans le discours politique et l'apparente pauvreté des résultats
constatés ?
Qu'est-ce qui motive les politiques de Rouen à vouloir
favoriser la participation des habitants et pourquoi ne la mettent-ils pas en
oeuvre ?
Notre questionnement initial s'est basé sur des
interrogations majeures qui auront pour but de mettre en lien une relation
entre l'espace et la société ainsi que de mettre en perspective
le rôle des citoyens dans la sphère politique. Nous abordons ces
questions par l'analyse de la place du projet moderne dans le centre
historique, ses effets sur l'identité de la ville et l'attachement des
habitants aux valeurs portées par le centre historique. Enfin, notre
dernier questionnement portera sur le projet urbain et la mise en oeuvre d'un
processus démocratique pour la participation des habitants au devenir de
la ville.
Deux axes ont fondé notre réflexion soit,
centre-ville/patrimoine et centre-ville/enjeux de pouvoir. Grâce à
ses axes, nous pouvons formuler deux hypothèses structurant notre
analyse.
1/ La reconquête du centre-ville
caractérisée par la multiplication des nouvelles formes urbaines
modernes peut enlever à la ville toute son histoire et par
conséquent lui fait perdre son identité de ville d'histoire. Les
habitants peuvent alors avoir des difficultés à construire ou
à conserver une mémoire historique.
2/ Les habitants sont consultés avant que des
décisions soient prises. Ils sont donc des acteurs de la vie politique
et participent donc à l'évolution de leur ville. Avec la
création des conseils de quartiers, chaque citoyen a le droit d'apporter
son avis lorsqu'il est consulté par la municipalité. Mais il est
aussi possible que les habitants n'aient qu'une place secondaire si les
politiques n'appliquent pas la démocratie participative.
Pour étudier la ville, il est indispensable de choisir
plusieurs méthodes d'enquête car les images d'une ville sont
diverses et variées. Dans ce travail j'ai privilégié les
méthodes qualitatives (l'entretien, l'observation, et le
questionnaire comme méthode complémentaire).
Dans un premier temps, pour faire le point sur les
différentes approches et les concepts utilisés, j'ai lu de
nombreux ouvrages et articles.
Dans un second temps, je suis allée à là
rencontre d'acteurs institutionnels (architecte des bâtiments de France,
chef de service du droit des sols, le responsable du service
« monuments historiques ») qui m'ont montré des
documents officiels comme le permis de construire du projet Monet
Cathédrale, des photos de maquette.
Pour récolter tous ces documents, je suis allée
au service départemental de l'architecture de la Seine-Maritime,
à la Direction de l'aménagement et de l'habitat urbain et
à la Direction Régionale des Affaires culturelles.
Les lectures et l'exploitation des documents m'ont permis de
mieux centrer mon sujet et de mieux comprendre les enjeux d'un tel projet au
niveau social et politique.
De plus, j'ai effectué un stage à la direction
de l'Aménagement urbain et de l'Habitat (voir annexe n°1) qui m'a
permis de rencontrer des personnes majeures pour mon enquête (adjoint
à l'urbanisme, chef du service urbanisme...). J'ai également pu
prendre ou consulter des documents officiels ou
« officieux ». Grâce à ces matériaux,
j'ai pu donner plus de contenu à ce mémoire qui manquait de
références documentaires.
1- Les entretiens
Le choix de la méthode qualitative qu'est l'entretien
s'est avéré incontestable. Cette méthode permet d'extraire
des informations et des éléments de réflexions riches et
nuancées. J'ai cherché principalement à entrevoir un
éventuel lien entre patrimoine et habitants, à savoir si les
habitants s'y intéresse ou pas. Pour cela, j'ai eu besoin de paroles qui
sont la manière concrète de l'entretien. Pour que les personnes
s'expriment librement, j'ai choisi d'effectuer des entretiens semi directifs
qui m'ont apporté des informations parlantes quant à ce que je
cherchais à découvrir.
1-1 L'entretien exploratoire
L'entretien exploratoire a permis un échange autour de
mes hypothèses de travail. De ce fait, le contenu de l'entretien a fait
l'objet d'une analyse, destinée à tester mes hypothèses de
travail.
Lorsque j'ai su précisément sur quel sujet
j'allais travailler, j'ai voulu prendre des contacts rapidement avec des
architectes et politiques concernés par le projet car il est souvent
difficile et long d'obtenir des contacts. Or, il en a été tout
autrement car les réponses des architectes ont été rapides
et positives. Bien que mon sujet était encore très flou, j'ai
effectué le lundi 16 Octobre, mon premier entretien avec Monsieur
Lablaude, architecte en chef des monuments historiques, dans son bureau qui se
situe dans l'aile gauche du Château de Versailles. Il m'a expliqué
pourquoi il avait émis un avis défavorable au projet Monet
Cathédrale. Ne sachant pas comment m'y prendre vu que mon sujet
était très peu avancé, j'ai décidé de lui
exposer mon intention de travailler sur la reconquête du centre ville,
tout en étudiant le patrimoine Rouennais ainsi que la mémoire
individuelle ou collective qui peut se construire à travers lui et la
participation des habitants dans la politique urbaine.
Cet entretien qui s'est déroulé de
manière ouverte et souple m'a beaucoup appris. Il a eu pour fonction de
mettre en lumière les différents aspects de l'objet de la
recherche. Il m'a ouvert de nouvelles pistes que je n'avais pas encore
relevées lors de mes lectures. En effet, j'ai pu me rendre compte que
la dimension politique avait une place centrale dans le projet ainsi que dans
la vision des habitants. J'ai pu en faire les deux axes majeurs de mon
étude.
L'entretien exploratoire était pour moi une
façon de trouver des pistes de réflexions, des idées, et
des hypothèses de travail et non pas de vérifier des
hypothèses préétablies.
1-2 Les entretiens semi directifs
Pour ces entretiens, j'ai choisi d'interroger des acteurs du
monde politique concerné par le projet, notamment l'adjoint au maire et
des professionnels de l'urbain. Ils ont pu me donner leur raison de leur
éventuelle motivation pour le projet, leur vision de Rouen dans quelques
années...
J'ai aussi voulu interroger des habitants pour avoir leur
impression sur leur rapport au patrimoine, leur sentiment de participation aux
décisions politiques concernant les grands projets urbains de leur
ville.
Enfin, les dernières personnes enquêtées
ont été les représentants des associations de quartiers,
ce qui m'a permis de savoir quels sont leurs interlocuteurs, à qui ils
transmettent leurs propositions et leur poids dans les décisions
politiques.
2- L'observation
Les méthodes d'observations permettent aux recherches
en sociologie de capter les comportements au moment où ils se produisent
sans l'intermédiaire d'un document ou d'un témoignage.
2-1 L'observation de la Place de la
Cathédrale
Les observations ont été de courtes
durées et ont été réalisées avec une grille
d'observation détaillée (voir annexe n°2). Cinq
thèmes ont été retenus : l'approche sensible,
l'analyse spatiale, les fonctions de la place, une lecture sociale et le
contexte historique et spatiale de la place. La grille reprend donc de
manière sélective les différentes catégories de ce
qu'il y a à observer.
2-2 L'observation des réunions de
quartiers
J'ai fait des observations dans des réunions de
quartiers, et plus précisément celles qui rassemblent les
habitants du quartier Cathédrale. Habitant moi-même dans ce
quartier, je pouvais facilement intégrer les réunions et ouvrir
des débats avec les personnes présentes autour de mes
thèmes de recherches. Le fait qu'ils ne sachent pas que je travaille sur
ces thèmes, m'a permis d'obtenir des propos objectifs de leur part.
Il s'agit ici de l'observation participante car
j'étudie le groupe en participant à ses activités. Pour
mener mon observation, je me suis appuyée sur cinq catégories,
à savoir : le cadre, le moment, les individus
(caractéristiques, tenue vestimentaire, pratique langagière,
corporalité, expression...), les comportements et les relations entre
les personnes.
3- Le questionnaire
Pour recueillir des informations, tant sur le patrimoine
Rouennais que sur la participation des habitants aux décisions
politiques, la méthode de l'entretien ne me paraissait pas suffisante.
Pour avoir une diversité plus grande de l'opinion des habitants, il m'a
semblé nécessaire de construire un questionnaire.
3-1 L'échantillon
Ce questionnaire a été distribué à
une centaine d'habitants actuellement Rouennais où l'ayant
été. La passation de questionnaire a donc été assez
simple du fait que tout le monde pouvait y répondre, mais il a bien
sûr fallu équilibrer les enquêtés, notamment en
fonction du sexe, de l'âge et de leur ville ou quartiers de
résidences afin d'avoir un échantillon
hétérogène.
Pour avoir une vision plus juste des opinions, il aurait
évidemment fallu multiplier les distributions, mais je me suis
fixée une limite de cent à cause des contraintes de temps.
En effet, lorsque j'ai commencé mon enquête, je
m'étais arrêtée à la méthode de l'entretien.
C'est seulement en février que j'ai trouvé la méthode du
questionnaire utile.
3-2 La confection du questionnaire
Lorsque j'ai construit mon questionnaire, j'ai choisi de le
diviser en 4 parties. La première est la partie d'identification
(âge, sexe, profession, ville de résidence, quartier) pour pouvoir
corréler ces variables avec les réponses et ainsi voir s'il peut
avoir un lien. Par exemple, un homme âgé, responsable d'une
association défendant le patrimoine et habitant le centre-ville de Rouen
a un profil qui pourrait expliquer ses réponses.
Ensuite, j'ai partagé mon questionnaire selon trois
thèmes :
Le premier traite de la perception du patrimoine rouennais
par les habitants, le second est la perception de la modernisation du
centre-ville et enfin le troisième est porté sur le
sentiment de participation aux projets politiques.
Mes questions demandent la plupart du temps des
réponses ouvertes. Selon François De Singly35(*), elles représentent des
avantages parce qu'elles privilégient les catégories dans
lesquelles les individus perçoivent le monde social, plutôt que de
les imposer par les modalités des réponses fermées. Aussi,
les questions ouvertes ouvrent des perspectives de codage de l'information
beaucoup plus grande.
4- Les conditions de l'enquête
Je vais dans cette partie, évoquer la façon dont
se sont déroulés les entretiens et les questionnaires.
4-1 Les entretiens
Au premier semestre, j'avais prévu de faire mes
entretiens du mois de janvier au mois de février inclus afin de faire
mes analyses au mois de mars. Mais le temps de prendre tous les rendez-vous
avec mes contacts a été plus long que prévu. J'ai pu
terminer mes entretiens dans la deuxième quinzaine du mois de mars et
chaque entretien a été retranscrit et analysé au fur et
à mesure (préparation de résumés pertinents de
l'information à retirer de chaque entretien). Vu que j'ai
effectué un stage à la mairie de Rouen, que j'ai fait passer des
questionnaires et que j'ai travaillé sur les réactions des
Rouennais36(*) concernant
le projet, j'ai réduit mes entretiens au nombre de 11 (8 habitants, 2
personnes d'associations et 1 architecte).
Les habitants qui ont accepté de répondre
à mes questions habitent tous à Rouen (depuis 5 à 60 ans).
Les critères de sexe et d'âge ont été très
diversifiés. J'ai pu interroger presque autant d'étudiants et
d'actifs, que de retraités.
La facilité pour trouver des contacts s'est aussi
manifestée par le fait que les premières personnes qui ont
accepté de faire l'entretien m'ont donné d'autres contacts, ce
qui m'a permis d'éviter des échecs.
Avec les habitants, les entretiens se sont tous passés
à leur domicile contrairement aux personnes d'associations qui m'ont
donné rendez-vous dans des lieux publics (Musée des beaux arts et
La Halle aux toiles) et à l'architecte qui m'a donné rendez-vous
à son bureau.
Les entretiens ont duré environ une heure durant
laquelle les personnes parlaient spontanément et donnaient leurs avis
personnels car ils ont bien compris que c'est ce que je recherchais. En effet,
je ne voulais pas qu'ils me fassent plaisir par leurs réponses mais
qu'ils disent leur ressenti face au patrimoine, à la reconquête du
centre ville, à la modernité, à la politique urbaine...
Les avis des associatifs sont d'autant plus forts sur la
question de la participation citoyenne que leur objectif est de dénoncer
la politique mise en oeuvre. Au travers leurs réponses, j'ai pu
comprendre qu'ils pensaient que je pouvais avoir un rôle de
« médiateurs » entre la mairie et eux.
Peut-être n'ont-ils pas cru à mon statut d'étudiante en
sociologie.
4-2 Les questionnaires
Au mois de janvier, il été question de faire
passer 100 questionnaires aux habitants actuels ou passés de Rouen. Mais
par soucis de temps, je n'ai pu en récolter que 50. Ils sont, comme pour
les entretiens diversifiés selon l'âge et le sexe.
J'ai pu faire passer facilement les questionnaires aux 20-30
ans et aux 30-40 ans. Mais certains amis à qui j'ai expliqué ce
que j'attendais ont pu faire circuler des questionnaires ce qui m'a permis
d'avoir un échantillon plus diversifié en âge
(jusqu'à 76 ans). Il était important pour moi d'avoir des
réponses de personnes âgées car elles vivent à Rouen
depuis de nombreuses années et ont un regard précis sur la ville
et ses évolutions.
Pour les questionnaires que j'ai moi-même
distribués, je les faisais remplir directement et je repartais avec. Les
autres personnes qui les ont fait passer à ma place ont fait
autrement : ils les ont donnés à leur entourage et leur
disaient de leur rendre plus tard. Cette technique est peu certaine car
beaucoup ont égaré le questionnaire ou n'ont pas pris le temps de
le remplir. Quand le questionnaire n'est pas à redonner directement, il
reste bien souvent oublié sur un coin de table.
Comme le moment de la rédaction est vite arrivé,
je n'ai pas pu en faire remplir d'autres. J'ai donc effectué mon analyse
avec les 50 que j'avais récupéré.
4-3 Les limites de la recherche
Au mois d'octobre, j'avais exposé une vague idée
sur laquelle je voulais travailler, soit le mélange des styles
architecturaux en ville. Je suis partie sur cette idée mais ma
directrice de mémoire m'a très vite mise en garde car mon sujet
n'avait pas d'aspect sociologique.
Tout en gardant un lien avec l'architecture, il fallait que je
change mon axe d'étude mais cela m'a pris quelques semaines.
Je me suis perdue dans des lectures trop vagues et je
n'arrivais pas à trouver un sujet précis. C'est en lisant les
journaux régionaux et l'actualité locale concernant la
polémique autour du projet Monet cathédrale que j'ai voulu
travailler sur la perception des habitants concernant la modernité du
centre-ville ainsi que sur leur rôle dans cette reconquête.
Mon objet d'étude étant devenu très clair
début novembre, j'ai pu commencer les lectures appropriées et la
collecte de documents.
Une autre limite s'est posée à moi, pour
étudier la participation des citoyens aux projets urbains il
était nécessaire que j'interroge des politiques (maire,
adjoints). Or, pendant tout le premier semestre j'ai envoyé des lettres,
des mails, téléphoné aux personnes concernées mais
en vain.
Je devais alors me contenter d'interroger des habitants mais
mon enquête était alors partielle. Tout s'est arrangé au
mois de février lorsque j'ai obtenu mon stage à la mairie de
Rouen. J'ai alors pu effectuer des entretiens informels avec l'adjoint au maire
chargé de l'urbanisme ainsi qu'avec des professionnels de l'urbain.
4-4 Présentation de l'analyse des
données
Afin de pouvoir comprendre comment peut être vécu
et perçu un changement spatial par les habitants et savoir quels enjeux
politiques en découlent, j'ai bâti une analyse en trois
parties :
Tout d'abord, je me suis penchée sur l'importance de la
labellisation pour la ville de Rouen. Il s'agit d'un point de départ
essentiel pour comprendre la motivation de la municipalité pour la
reconquête du centre ville et pour la suite de l'analyse. Dans cette
partie, j'ai également pris en compte la représentation du
patrimoine par les habitants pour savoir comment ils percevaient l'importance
de celui-ci pour l'identité de la ville.
Dans une deuxième partie, j'ai travaillé sur les
avis des habitants concernant la reconquête du centre ville et par
conséquent, sa modernisation. Les notions de mémoire et de
modernisation bâtiront cette partie. J'ai poursuivi la recherche en
interrogeant les positions des politiques pour comprendre leurs motivations et
les enjeux d'une modification spatiale.
J'ai terminé par une troisième partie qui traite
de la légitimité des habitants dans les décisions
relatives à leur environnement urbain. J'ai pris de nouveau deux points
de vue différents (habitants/politiques) sur ces questions :
« Comment les habitants sont intégrés dans les
processus de décisions ? » et « Les politiques
ont-ils la volonté de travailler avec les
habitants ? ».
1- Histoire urbaine
Pour éviter de nous perdre dans les repères
historiques, je décrirai le centre-ville de Rouen à partir des
années 1945, ce qui me permettra de retracer toutes les
évolutions et constructions qui ont pu avoir lieu depuis la fin de la
seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
Les années d'après guerre sont celles de la
reconstruction. Un quart des logements est à reconstruire. Le choix est
fait de conserver le plan ancien de la ville et la même largeur de rues.
La largeur importante des rues et notamment de la rue Jeanne d'Arc est due
à l'action d'élargissement ou de percement des rues voulus par le
maire Charles Verdrel (1858-1868).
Comme dans le reste du pays, la croissance
démographique et la crise du logement entraînent la construction
de nouveaux quartiers, sur la rive gauche (à
Saint-Étienne-du-Rouvray et Grand-Quevilly en particulier) et sur la
rive droite (les Sapins et la Grand'Mare, Canteleu). On édifie sur la
rive gauche la préfecture, puis la cité administrative.
Les transformations de la ville dans les années 70-80
sont liées à l'action de Jean Lecanuet, maire de 1968 à
1993. Dans les années 70, a commencé la restructuration du centre
ville, éliminant des îlots considérés comme
insalubres, ce qui a permis de faire place nette pour la construction
d'ensembles immobiliers tels ceux qui sont bâtis autour de l'Hôtel
de ville à la place d'un quartier aux maisons à pans de bois.
Cependant, on prend vite conscience de la valeur architecturale des quartiers
anciens et on lance des opérations de sauvegarde, par exemple dans les
quartiers Est de la ville. C'est l'époque de la restauration des
façades, de la création des rues piétonnes (la rue du Gros
Horloge est en 1970 la première rue piétonne de France). En 1979
est inaugurée l'Eglise Sainte Jeanne d'Arc, sur la place du Vieux
Marché. De la même époque datent les tours de 18
étages du Front de Seine, ou le Palais des Congrès, sur la place
de la Cathédrale. Plus récemment fut construit l'Espace du Palais
et l'ensemble immobilier de la Place de la Pucelle.
Rouen est classée
Ville
d'art et d'histoire depuis le 12 février 2002. Il s'agit d'une
convention passée entre la commune et la Caisse des Monuments
Historiques permettant à la ville de profiter d'un label de
qualité, d'une aide financière et du raccordement à un
réseau national de promotion. En contrepartie, la ville s'engage
à employer un animateur du patrimoine et des guides agréés
par la Caisse.
La notion de Ville d'art née au tournant du
siècle est caractérisée par la qualité et le nombre
de trésors d'art, notamment historique avec leur décor peint et
sculpté, musées et collections qu'elle renferme, à la
manière d'un immense musée à ciel ouvert37(*). Il n'est pas possible
d'aborder le centre-ville de Rouen sans en saisir la richesse de son
patrimoine, notamment au sein de son coeur historique (se référer
au plan de la page suivante répertoriant les sites patrimoniaux du coeur
de Rouen).
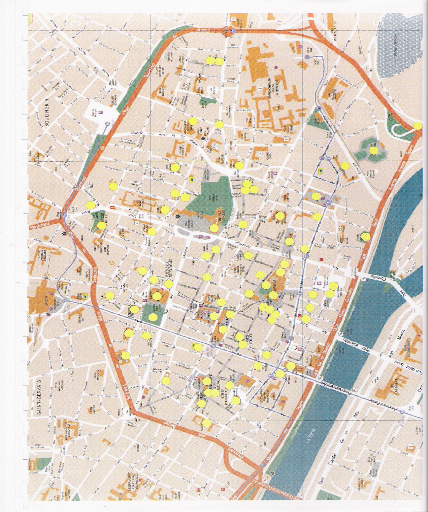
Plan 2 : Les sites patrimoniaux au sein du
coeur de Rouen
Cet espace délimité
géographiquement par les boulevards extérieurs et les quais (et
donc facilement identifiable) recèlent 80% du potentiel historique de
Rouen. L'inventaire des sites classés donne 76 sites patrimoniaux
répertoriés. Un patrimoine donc dense dans le centre historique
et plus diffus hors de celui-ci. L'avantage mais aussi l'inconvénient de
cette répartition est que les visiteurs ne font que très rarement
l'effort de s'aventurer hors des « sentiers battus » de
l'offre patrimoniale mondialement connue à Rouen.
Notons également le nombre important
d'édifices classés dans la région et dans le
département :
|
Haute-Normandie
|
Eure
|
Seine-Maritime
|
|
Monuments classés
|
320
|
132
|
188
|
|
Monuments inscrits
|
577
|
230
|
347
|
|
Objets mobiliers classés
|
4066
|
1867
|
2199
|
|
Objets mobiliers inscrits
|
3694
|
1170
|
2524
|
|
Orgues
|
56
|
15
|
41
|
LES MONUMENTS CLASSES HISTORIQUES EN 1991
(unité : nombre)
Source : Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
Comme on peut le voir dans ce tableau, la loi instaure deux
niveaux de protection complémentaires : l'inscription et le
classement.
Le classement est une protection forte qui correspond à
la volonté de maintenir les caractères du site ayant
justifié sa protection. Les sites classés ne peuvent êtres
ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect
sans autorisation spéciale.
L'inscription sur la liste des sites est une mesure plus
souple. Elle constitue une garantie minimale de protection. Elle impose
d'informer l'administrateur de tout projet de travaux de nature à
modifier l'aspect du site.
Notons qu'il y a environ deux fois plus de monuments inscrits
que classés en Seine-Maritime. La différence est moins
significative pour les objets mobiliers mais il y a tout de même plus
d'objets mobiliers inscrits que classés.
Le patrimoine culturel qui comprend les monuments et objets
immobiliers inscrits et classés implique quelque chose qui nous a
été transmis par ceux qui nous ont précédés.
Ce patrimoine culturel ne peut plus aujourd'hui être ni vendu, ni
donné à des particuliers, ni détruit. Telle est la
différence essentielle entre le patrimoine familial et culturel38(*).
L'inscription d'un monument sur la liste des sites à
protéger demande de suivre une procédure :
|
DEMANDE D'INSCRIPTION
|
|
ÉTUDE PREALABLE
|
|
CONCERTATION LOCALE ET CONSULTATION DES CONSEILS MUNICIPAUX DES
COMMUNES CONCERNEES
|
|
CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES,
PERSPECTIVES ET PAYSAGES
|
|
TRANSMISSION DU DOSSIER PAR LE PREFET AU MINISTRE CHARGE DES
SITES
|
|
PUBLICATION ET NOTIFICATION DE L'INSCRIPTION
|
Qu'ils soient inscrits ou classés les monuments
demeurent des symboles qu'il faut respecter.
Salué par de nombreux auteurs, on voit le symbolique
historique prégnant de Rouen.
Victor Hugo l'avait
surnommée « la ville aux cent clochers » et
Stendhal
« l'Athènes du gothique »39(*). Enfin, Maupassant
écrivait « c'est là un des horizons les plus
magnifiques qu'ils soient au monde. Derrière nous, Rouen, la ville aux
églises, aux clochers gothiques, travaillés comme des bibelots
d'ivoire, en face, Saint Sever, le faubourg aux manufactures, qui dresse ses
mille cheminées fumantes sur le grand ciel vis-à-vis des mille
clochers de la vieille cité. Ici, la flèche de la
cathédrale, le plus haut sommet des monuments humains ; et
là-bas, la « Pompe à feu » de la
« Foudre », sa rivale presque aussi démesurée
et qui dépasse d'un mètre la plus géante des pyramides
d'Egypte »40(*).
De nombreux édifices ont été
endommagés par les bombardements de la
Seconde Guerre
mondiale, mais il reste heureusement quelques bâtiments remarquables,
religieux ou non.
La
Cathédrale
Notre-Dame, d'
architecture
gothique, inspira particulièrement
Claude Monet. Elle
possède, à la croisée du transept, une «
tour-lanterne »
surmontée d'une flèche en fonte qui culmine à 151
mètres de hauteur (la plus haute de France). La façade
occidentale est encadrée de deux tours, la tour Saint-Romain et la
Tour de Beurre.
La valeur de la ville est dans son coeur historique, à
travers ses monuments rares et non reproductibles41(*), c'est pour cela que je me
pencherai longuement sur le terme patrimoine, pour comprendre l'attachement
plus ou moins fort des habitants aux valeurs de leur ville.
La ville de Rouen a-t-elle une identité de ville
historique ? Les habitants l'identifient-elle comme cela ?
Il ne faut pas voir une séparation entre les
habitants d'une part et les monuments de l'autre mais il faut toujours prendre
en compte la dialectique entre le bâti et les rapports sociaux qui se
fondent à travers eux car une ville historique constitue en soi un
monument mais elle est également un tissu vivant42(*).
Les habitants portent-ils un intérêt aux
monuments ? Ont-ils des repères qui leur sont propres, qu'ils ont
construits ? Selon les actes du colloque intitulé « Des
bâtiments au public »,
- Il y a une relation de sens entre les habitants et leur
patrimoine car ils aiment reconnaître un bâtiment et même le
dater.
- Les personnes ont des choix esthétiques, elles aiment
donner leur avis, discuter l'image43(*).
2- La labellisation, un atout majeur
La labellisation est un atout majeur pour la reconnaissance
des villes. Si des villes obtiennent un label, tel que « Ville d'art,
Ville d'histoire », elles sont perçues et reconnues comme
ayant un intérêt certain tant au niveau culturel qu'historique. Ce
label permet la sensibilisation de la population au patrimoine, tout comme sa
préservation qui concourt à renforcer l'identité locale.
Dès lors que le label est attribué à une
ville, il en résulte plusieurs enjeux :
Tout d'abord, un enjeu social, c'est-à-dire
que la population va s'approprier le patrimoine et va voir la
nécessité de le conserver.
Ensuite il y a un enjeu territorial car la
valorisation du patrimoine d'une ville participe au rayonnement de toute une
région. Les actions de valorisation de la ville par
l'intermédiaire de la labellisation ont permis de développer une
image très positive de la ville.
Par ce constat on voit qu'il y a un enjeu identitaire de la
labellisation.
Pour finir, je dois citer un dernier enjeu non
négligeable qui est l'enjeu économique. La
reconnaissance que l'on accorde à une ville n'est jamais sans
conséquence pour son économie car le tourisme va permettre
à la ville de fonctionner.
L'atout majeur de Rouen est lié à son
centre-ville et notamment à son coeur historique qui le
légitimise. La partie de la ville la plus dotée en monuments
historiques est protégée par la loi pour que soit
préservée la valeur patrimoniale de cet espace. C'est ce qu'on
appelle le secteur sauvegardé. Sa protection et sa délimitation
sont stipulées par la loi Malraux et notamment par le premier
article : « Des secteurs dits « secteurs
sauvegardés », lorsque ceux-ci présentent un
caractère historique, esthétique, ou de nature à justifier
la conservation, la restauration ou la mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles, peuvent être créés et
délimités... ».
Il est important d'expliquer les spécificités du
secteur sauvegardé pour comprendre la façon d'agir des politiques
et des professionnels dans celui-ci et aussi pour comprendre les
réactions des Rouennais lors d'une modification spatiale dans le centre
historique.
3- Délimitation et contraintes du secteur
à embellir
Le secteur historique à Rouen est
délimité par la rue de la République, la rue de
l'hôpital, la rue de la Marne, la rue Moulinet, le boulevard de la Marne,
la rue de l'Europe, la rue Fontenelle, la rue du Change et la rue des
Bonnetiers. Tout ce qui est à l'intérieur de cet espace
représente le secteur A et le patrimoine qui s'y trouve est souvent
classé, aussi les transformations urbaines qui ont lieu dans cette zone
sont soumises à des règles très strictes.
En effet, comme il y a dans ce secteur des monuments, des
immeubles ou des parties d'immeubles classés « Monuments
Historiques », il n'y a pas de grande marge de manoeuvre pour
modifier le paysage urbain. Ces monuments ou bâtiments classés
sont régis, ainsi que leurs abords, par la loi du 31/12/1913, qui impose
une protection dans un rayon d'au moins 500 m aux alentours de monuments
classés. Et comme dans le secteur sauvegardé, il y a toujours au
moins un monument classé tous les 500 m, tout le secteur est régi
par cette loi.
Toutes ces mesures draconiennes prises pour conserver le
patrimoine sont bien appliquées. J'ai pu constater l'importance de ce
secteur lors de mon stage au service du droit des sols de la Mairie de Rouen.
Chaque semaine, le chef de service du droit des sols et l'Architecte des
bâtiments de France consacrent une journée pour passer en revue
les travaux qui sont prévus dans le secteur sauvegardé. Ils se
rejoignent sur le terrain pour constater ce que les propriétaires des
lieux veulent modifier et pour donner un avis favorable ou défavorable
aux travaux. L'Architecte des Bâtiments de France est aussi là
pour donner des conseils pour la couleur de la façade à refaire,
les matériaux à privilégier par exemple parce qu'il a
l'autorité sur le secteur sauvegardé ; ainsi son avis ne
peut pas être remis en cause.
Les habitants résidant dans le secteur
sauvegardé ne peuvent donc pas faire ce qui leur plaît pour leurs
travaux extérieurs.
4 L'épreuve du classement de l'UNESCO
Cette harmonie est notamment recherchée depuis que
Rouen s'est présentée deux fois au concours de l'UNESCO et
qu'elle n'a pas été retenue, entre autre, « pour
cause d'une trop grande hétérogénéité
architecturale », (P.A Lablaude, Chef des monuments
historiques, entretien n°1) :
« Tout d'abord, notre dossier manquait un peu de
sens au dire des experts. Il ne suffit pas de disposer d'un patrimoine
historique exceptionnel, encore faut-il avoir une véritable
démarche d'interprétation et d'animation du patrimoine car les
concurrents sont désormais très nombreux et la lutte est
sévère. Ensuite, les abords du centre historique de notre ville
ont été jugés trop peu soignés c'est-à-dire
les quais, les boulevards et les entrées de la ville. (...). Enfin, les
experts ont trouvé une ville très hétérogène
architecturalement. Avoir un patrimoine historique c'est le conserver en ne le
dénaturant pas par d'autres architecture », (Propos de P.
Albertini, Maire de Rouen, sur le site :
www.capidees.net).
Les membres de la municipalité acceptent ces remarques
qui sont à l'origine de cet échec mais se battent maintenant pour
que la ville ait une harmonie architecturale. Cette persévérance
pour la reconnaissance voudrait que chaque habitant fasse un effort, il n'est
pas libre de choisir ce qu'il aime pour son habitation mais ce qui est bien
pour sa ville.
Par exemple, les commerçants doivent avoir des
enseignes très réglementées et encore plus dans le secteur
sauvegardé :
En secteur A, l'enseigne perpendiculaire peut dépasser
de 0,6 m ou 0,8 m selon la largeur de la rue.
En secteur B, elle peut dépasser de 0,8 m, 1 m ou 1,2 m
selon la largeur de la rue.
L'objectif de ces mesures est de parvenir à une
harmonisation de la présentation des enseignes, afin qu'elles
participent à l'embellissement de la ville.
Un autre exemple tiré de mon stage : un
commerçant de la rue du Gros Horloge qui avait fait un soubassement en
placoplâtre a été obligé de refaire des travaux pour
y mettre de la pierre, qui est plus fidèle à l'environnement.
Si ces contraintes existent, c'est pour garder une certaine
harmonie, explique l'Architecte des Bâtiments de France. Il ne s'agit pas
de contraindre les habitants sur ce qu'ils doivent faire chez eux mais c'est un
devoir de conserver l'historicité du lieu, ce qui est le cas pour le
projet Monet-Cathédrale. Il s'agit de supprimer la friche du Palais des
Congrès, de réaliser un projet architectural contemporain et de
qualité tout en respectant les obligations du plan de sauvegarde du
centre-historique. L'Architecte des Bâtiments de France et la
municipalité se réjouissent donc d'avoir enfin une solution pour
redonner vie à ce bâtiment oublié et pour découvrir
les vestiges de la façade Romé. Il s'agit d'un des objectifs de
la reconquête du centre-ville.
Cependant, le projet Monet Cathédrale est très
mal compris pour ces raisons de contraintes qui ont pour but de réussir
à constituer une ville avec une architecture homogène :
« On ne peut rien faire dans cette ville, tout
est toujours beaucoup trop réglementé. Et là, on me dit
quoi ? Un bâtiment en verre !!! A non mais laissez-moi rire,
là on court à la catastrophe. On se fout vraiment de
nous ! », (Eric, Commerçant de la rue du Gros
Horloge, entretien n°3).
En effet, comment les commerçants et habitants du
secteur peuvent comprendre une telle différence entre ce qu'on leur
impose et ce que la municipalité laisse faire juste à
côté de la cathédrale ?
C'est d'autant plus incompréhensible que la ville a une
architecture trop hétérogène. Rouen a en effet des styles
architecturaux très diversifiés et ce phénomène se
renforce malgré les critiques de l'Unesco.
Des villes comme Reims ou Dresde, classées au
patrimoine mondial il y a plusieurs années ont également voulu se
moderniser. Mais aujourd'hui, leur suppression des villes classées est
effective. L'Unesco, qui s'attache à inscrire les villes au patrimoine
mondial, se met aussi un point d'honneur à vérifier si les villes
inscrites respectent les critères qu'elle a proposés. Les villes
classées qui ne respecteraient pas les critères seront
radiées.
5 Remettre en valeur un quartier ancien
La reconquête du centre-ville et notamment du quartier
historique, a pour but de le rendre plus dynamique, plus attrayant et de
valoriser son image. La ville de Rouen a choisi de reconquérir le
centre-ville par la réalisation de projets urbains qui devront
être des lieux qui attire une population qui délaisse le centre de
Rouen au profit de la périphérie.
Remettre en valeur un quartier ancien et lui redonner sa
valeur centrale, c'est agir sur tout le centre et toute la ville44(*).
Les projets urbains destinés au centre-ville se
manifestent par la préservation et la restauration du patrimoine. Il
s'agit également de veiller à ce que les nouveaux édifices
qui seront construits respectent l'environnement historique, ce qui constitue
le débat de la construction de l'espace Monet Cathédrale car il
est difficile de concilier protection et renouvellement du patrimoine urbain.
Il faut en effet construire dans ce qui est déjà existant et par
conséquent respecter l'histoire du lieu.
Cet espace Monet Cathédrale est plus moderne et a plus
de fonctionnalité que les bâtiments du centre-ville ; il
apparaît comme un atout majeur pour rendre plus dynamique le
centre-ville. Ce dynamisme recherché n'est pas nouveau dans les
objectifs des municipalités. Déjà en 1972, il y eut
l'opération de piétonisation de la rue du Gros Horloge qui fut la
première opération de piétonisation de France. Elle avait
bien évidemment pour but de rejeter les automobiles hors du centre-ville
mais aussi de lutter contre l'émergence des nouveaux centres
commerciaux qui sont dans des villes proches (Barentin et Tourville). Il
fallait revitaliser l'espace central en le valorisant le plus possible. Notons
que l'espace commerciale Saint-Sever avait la même portée,
c'est-à-dire, conserver la population Rouennaise et attirer les
habitants des villes extérieures.
Le rôle de la piétonisation du centre-ville de
Rouen qui se poursuit encore à ce jour est faite dans le but d'attirer
les habitants qui préfèrent aller faire leurs achats en
centre-ville. Le commerce est une attraction principale pour les secteurs
piétonniers. D'ailleurs, plus le secteur piétonnier est grand,
plus son attractivité est importante45(*). Pour le commerce, la piétonisation est un
point positif car il y a 50% de fréquentation de la clientèle de
plus lors de la création d'une rue piétonne46(*).
Aujourd'hui, bien que le projet de piétonisation soit
toujours d'actualité, d'autres projets voient le jour pour favoriser
l'attractivité vers le centre, et notamment l'hyper centre de Rouen.
En ce qui concerne l'espace Monet Cathédrale, il s'agit
de mêler la tradition au moderne : tradition parce que les monuments
historiques classés sont conservés et modernité parce que
se greffe à ce patrimoine historique un contenu moderne, orienté
notamment vers des activités de commerces et de loisirs.
Seulement, le changement n'est pas simple à mettre en
place car les professionnels de l'urbain, les politiques et les habitants qui
ont eu à donner leurs avis ne sont pas tous d'accord sur le principe de
concilier architecture moderne et patrimoine historique.
Par exemple, M. Goutal, Inspecteur Général des
Monuments historiques a émis un « avis favorable au
troisième permis de construire qui ne comprend plus la
dépose-repose de la façade Rômé mais sa conservation
en place ». Mais Mme Leprince, conservatrice des monuments
historiques n'est pas du même avis. Pour elle, « le dossier
présenté pour l'Hôtel Romé reprend l'étude
préliminaire d'octobre 2005, en la précisant par quelques
documents graphiques complémentaires. Mes réserves sont donc les
mêmes que celles déjà exprimées dans mon avis du 8
décembre 2005 ».
A travers les avis divergents, nous sentons bien qu'il y a une
envie de conserver l'âme de la ville.
L'architecte retenu pour monter le projet Monet
Cathédrale a une devise qui est celle de « vivre avec son
temps ». Loin de la nostalgie, il y a du plaisir à construire
du moderne, même si l'architecture moderne contraste avec les alentours
ce qui est le cas pour l'architecte de l'espace Monet Cathédrale :
« Certains exigent du pastiche,
c'est-à-dire la reproduction de formes anciennes avec des
éléments contemporains. Même si cela appartient à
l'architecture, je ne l'ai jamais fait : c'est inconcevable pour moi. Le
pastiche est un contresens, une énormité. Selon moi, la
modernité est supérieure », (J.P Viguier,
architecte du projet, extrait du Paris-Normandie du 02/10/2006).
Pourtant cela a déjà été fait sur
la place de la Cathédrale pour le bâtiment où se trouve
actuellement l'enseigne Etam.
Bâtiment qui accueillera l'enseigne Etam après
des travaux de rénovation (1998)

Le bâtiment de l'enseigne Etam rénové
(1999)
La ville de Rouen recherche à valoriser son
centre-ville. Il s'agit désormais de faire évoluer l'espace
urbain tout en conciliant les formes anciennes avec la modernisation du
centre-ville. Dans cette partie, nous verrons que cette tâche est
difficile à effectuer et nous allons comprendre pourquoi.
1- Patrimoine et représentation
Nous avons divisé les habitants en deux
catégories : soit ceux qui ont un fort attachement aux monuments
anciens et ceux qui veulent que leur ville se modernise.
1-1 Représentation du patrimoine par les
habitants
Les habitants accordent beaucoup d'importance au patrimoine
Rouennais et ont conscience du caractère unique de leur ville, seulement
il demeure très mal connu.
Certains habitants se distinguent par leur détachement,
voir leur désintérêt face aux questions patrimoniales.
Mes entretiens étant effectués avec des
personnes intéressées par le sujet, je n'ai pas pu m'en rendre
compte rapidement. Ce n'est qu'avec les questionnaires, qui ont
été distribués à un échantillon large de la
population Rouennaise que j'ai pu relever qu'il y avait une
méconnaissance du patrimoine.
En effet, à la question Quels sont vos monuments
préférés ? la plupart des interrogés ont
répondu la Cathédrale et le Gros Horloge. Leurs réponses
ne m'ont pas interpellé car donner les symboles de la ville comme
favoris va de soi. Habiter la ville aux cent clochers est très
valorisant du fait du patrimoine très important et connu.
Les Rouennais s'identifient aux symboles de la ville
(Cathédrale, Gros Horloge) qui les valorisent. La quasi-totalité
ont répondu positivement à la question : « Le
patrimoine Rouennais est-il connu mondialement ? ».
Les Rouennais ont une image très positive de leur ville
grâce aux monuments qu'elle abrite. Le rayonnement de Rouen leur
paraît être très important et l'image de Rouen comme
étant une ville historique leur semble être connu partout dans le
monde.
En revanche, j'ai pu voir que les monuments symboliques
étaient cités car les autres monuments étaient peu connus.
A la question Etes-vous d'accord avec la
destruction du Palais des Congrès ? presque la moitié
des interrogés disent ne pas savoir où il se trouve et quelle est
sa nature. Par conséquent ces mêmes personnes ne sont pas non plus
au courant des débats autour de ce projet. La méconnaissance du
débat se ressent pour presque tous les sondés.
Parmi ceux qui connaissent le bâtiment, ils en ont une
opinion négative et veulent le voir disparaître. Ils citent en
premier le Palais des Congrès pour la question « quel
monument voudriez-vous voir disparaître ? », car il
n'a plus aucune fonction et il nuit à la place de la Cathédrale.
Il y a une volonté de la part des Rouennais d'embellir le centre-ville
et donc de faire disparaître ce qui nuit à son esthétisme,
ce qui permettrait de mettre en valeur les monuments historiques.
L'espace du Palais est cependant bien apprécié
et sa conservation est tout à fait admise. Du fait de sa fonction
commerciale, il a une importance particulière et son architecture
s'insère bien dans le paysage.
Ensuite, on trouve l'Eglise Jeanne d'Arc, qui a une fonction
symbolique et emblématique; par conséquent, elle a une
importance particulière aux yeux des Rouennais.
Enfin, l'Aître St Maclou, symbole de l'époque
Romaine est un vestige que les Rouennais veulent absolument conserver.
Le Palais des Congrès apparaît comme un espace
ignoré des Rouennais car il est vu comme un bâtiment mort depuis
de nombreuses années qui gâche la place de la cathédrale.
Seules de rares personnes me disent avoir le souvenir d'avoir vu le Palais des
Congrès « vivant ». Cet abandon l'a cruellement
marqué de tags, de palissades accablant les fonctions commerciales,
animatrices des rez-de-chaussée, et produisant, de l'avis
général comme de celui des experts, un aspect désastreux
pour la place de la Cathédrale.
Même s'il est fermé depuis 1996, il fait partie
de la ville et lorsque les guides touristiques font visiter la place de la
cathédrale, le Palais des Congrès est aussi
présenté mais le seul sentiment que les touristes gardent est la
laideur du bâtiment.
La destruction de l'édifice participera alors à
la production de l'espace : le Palais des Congrès n'étant
plus valorisé, ne mérite pas d'être conservé ou
réorganisé et sera donc remplacé par une construction
jugée plus utile et plus adaptée aux nécessités du
moment.
La méconnaissance du patrimoine et des débats
urbanistiques s'accentuent lorsque les personnes sont éloignées
du centre ville et qu'elles sont jeunes. Les personnes âgées du
centre-ville sont les plus au courant des évolutions et des
débats du projet, notamment parce qu'elles lisent davantage les journaux
locaux et bien sûr parce qu'elles vivent à Rouen depuis de
nombreuses années et qu'elles sont intéressées par
« leur » environnement.
Mais au niveau de la population globale, il y a une forte
valorisation du patrimoine symbolique de la ville mais une
méconnaissance du patrimoine de façon plus précise.
Les monuments sont connus et acceptés à partir
du moment où on les a toujours connu, et qu'ils sont des emblèmes
de la ville.
La modernisation du patrimoine n'est pas ce qui dérange
les habitants mais c'est la nouveauté qui dérange :
« J'exagère en disant que l'espace Monet Cathédrale
est vraiment hideux à cause de sa modernité. L'Eglise Jeanne
d'Arc l'est aussi, et pourtant, comme je l'ai toujours connue, je ne trouve pas
qu'elle dénature la paysage.» (François,
ingénieur dans le bâtiment, entretien n°5).
Tout tend donc à devenir patrimoine. En 1963,
André Malraux a décidé de protéger au titre des
monuments historiques quelques édifices représentatifs de
l'architecture moderne. Si la tour Eiffel est reconnue digne d'être
protégée, c'est parce qu'elle met en oeuvre des matériaux
de l'ère industrielle et qu'elle représente l'emblème de
la France. Cependant, une part importante de la production architecturale du
XIXème siècle reste à l'écart du classement et de
l'inscription.
Il faut aussi prendre en compte que les lieux dont la
construction relève d'une architecture contemporaine ont des fonctions
tout à fait différentes des lieux avec une architecture ancienne
qui humanise le cadre bâti contrairement aux constructions modernes qui
sont froides, rectilignes en verre ou en béton.
L'ancienneté des espaces est perçue comme une
valorisation symbolique. Ces espaces sont connus, les personnes s'y attachent
car ils font partie de leur quotidien. S'ils sont valorisés
symboliquement, c'est qu'ils sont appréciés et que leur
disparition déposséderait les habitants de leurs repères
au détriment d'espaces nouveaux dans lesquels personne ne se
reconnaîtrait.
1-2 Les associations de sauvegarde du patrimoine et les
attentes des habitants
Ceux qui sont attachés au patrimoine militent pour la
sauvegarde du patrimoine Rouennais et sont pour la plupart inscrits dans des
associations qui défendent le patrimoine.
Ces associations sont fréquentées la plupart du
temps par des acteurs ayant des caractéristiques communes. Je me suis
basée sur l'association « P'tit Pat Rouennais » pour
mes observations. Il s'agit d'une association de personnes
enthousiasmées par le patrimoine Rouennais, dont l'objectif est de
veiller à la sauvegarde et à la mise en valeur de tous les
éléments du petit patrimoine situé sur le domaine
privé ou public de la ville.
Beaucoup de membres de cette association sont
retraités, soit plus de 60% de l'ensemble des adhérents. Que ce
soit les retraités ou les actifs, qui représentent 30% de
l'association, leurs métiers expliquent leur implication pour le
patrimoine (professeur d'histoire, gardien de musée, photographe,
journaliste...). Tous sont passionnés par l'histoire de la ville et de
la Normandie ; et Rouen étant chef-lieu de la
région
Haute-Normandie et
du
département
de la
Seine-Maritime, ils
militent pour conserver la mémoire normande.
Enfin, dans l'association on trouve 10% d'étudiants qui
sont tous en Master d'histoire ou de géographie. Ils sont les plus
actifs des membres car ils ont créé le site de l'association, un
blog photo sur les monuments Rouennais. Même s'ils sont une
minorité, on voit chez eux un attachement au patrimoine :
« Ca me révolte qu'on puisse de nos
jours détruire le passé sans remord et qu'on fasse pousser des
bâtiments « fashions », loin de procurer les
émotions que nous pouvons avoir devant un monument ancien, gigantesque,
rempli de symboles.
Oui, le Palais des Congrès est moche. Et
alors ! C'était l'architecture des années 70, pourquoi tout
oublier ? » (Laura, 25 ans, Master d'histoire, membre de
l'association « P'tit Pat Rouennais », entretien
n°7).
« Le nettoyage des monuments c'est pareil, c'est
pour faire neuf, moderne. Avant, on mettait de l'huile d'olive sur les
monuments pour qu'ils se salissent plus vite, comme c'était le cas ici
à la Halle aux Toiles » (Nicolas, 28 ans,
Négociateur immobilier, membre de l'association « P'tit Pat
Rouennais », entretien n°2).
La mémoire du lieu et des idéologies
passées est essentielle pour les conservateurs du patrimoine. Les
réticents à la modernité se disent nostalgiques, ou
simplement conscients des époques antérieures : il s'agit
pour eux de respecter les valeurs, la mémoire et l'esthétique du
lieu. Une ville musée telle que Rouen doit garder une valeur
patrimoniale. « Dans la capitale de la Haute-Normandie, si
fière de son patrimoine historique, on se souvient encore des
tollés provoqués par l'édification du Palais des
Congrès en 1976, puis de l'Eglise Sainte-Jeanne d'Arc trois ans plus
tard ». (Paris-Normandie, Édition du 10.03.2006).
Bien que les habitants se sentent attachés au
patrimoine, ils avouent tout de même qu'il faut améliorer cet
espace à c™té de la cathédrale.
Pour ce faire, trois solutions auraient pu les satisfaire.
Une première solution consistait à
réhabiliter le Palais des Congrès actuel. Cela aurait
évité toutes les polémiques sur la façade de
l'hôtel Romé à conserver. Le Palais des Congrès
étant fermé pour des mesures de sécurité, il aurait
été plus simple de faire les travaux nécessaires pour
qu'il soit de nouveau fréquentable.
Alain Bourdin47(*) montre la différence qu'il y a entre la
rénovation et la restauration : Pour lui, la rénovation est
négative car elle coûte cher ; il faut démolir et donc
commencer par perdre beaucoup de temps. Lorsqu'on commence à construire,
on a déjà dépensé beaucoup d'argent : on doit
donc faire haut et dense, ce qui entraîne de nouvelles charges.
Il considère la restauration comme étant le
contraire car elle coûte moins cher, elle permet d'échelonner les
investissements dans le temps et rend la spéculation difficile.
Une deuxième solution était de faire un jardin
à cet endroit. Cette solution n'est pas possible pour des raisons
juridiques. Il faut aller voir du côté du droit de la construction
pour apprendre que les bâtiments construits à côté
d'un monument historique doivent respecter le même cubage, ce qui est le
cas pour le projet Monet Cathédrale. Un jardin n'est donc pas possible.
Une troisième solution a été de faire
circuler une pétition pour demander un référendum qui
stipule que « Le Maire de Rouen soutient et impose un projet
contre l'avis des Rouennais. Sans concertation, le Maire de Rouen veut
démolir le Palais des Congrès et le reconstruire dans un volume
identique. La méthode est inacceptable ! Le moment est venu pour
tous les habitants de Rouen de se mobiliser ensemble, pour choisir le devenir
de ce lieu tant symbolique qu'emblématique de notre ville. Nous
demandons à Monsieur le Maire d'organiser cette démarche
collective et de solliciter, par un référendum local, l'avis des
Rouennais. NON à une reconstruction à l'identique sur la place de
la cathédrale, OUI à l'organisation par la ville d'une
consultation des habitants ».
Cette catégorie de Rouennais qui se dit
attachée au patrimoine et qui est très soucieuse de l'avenir des
formes urbaines me fait affirmer ma première hypothèse car ces
habitants ont tendance à penser que l'évolution de ces formes
urbaines va dénaturer l'identité de la ville et qu'il sera
très difficile d'avoir un attachement particulier au "nouveau
patrimoine".
Le glorification du patrimoine ancien est une certaine forme
de production de continuité avec le passé dans une
société qui privilégie davantage rupture et innovation que
production et tradition. A partir du présent, elle construit un lien
avec le passé en décidant de garder des objets qui nous ont
été « transmis », pour les transmettre
à d'autres à venir. Le patrimoine sert donc à construire
du lien social dans le temps.
Comme le rappelait l'anthropologue Maurice Godelier :
« Il ne peut y avoir de société, il ne peut y avoir
d'identité qui traverse le temps et serve de socle aux individus comme
aux groupes qui composent une société, s'il n'existe des points
fixes, des réalités soustraites (provisoirement mais durablement)
aux échanges de dons et aux échanges
marchands »48(*).
1-3 Les habitants et la volonté de
modernisation
Les habitants qui sont favorables aux transformations urbaines
ne souhaitent pas une ville totalement nouvelle au niveau de son architecture
mais veulent au contraire qu'apparaissent les différents styles
architecturaux des époques antérieures. La reconquête du
centre-ville ne doit pas être conçu comme une rupture avec le
passé ni comme un rejet de la tradition mais comme une cohabitation
entre l'ancien et le moderne :
« Je ne comprends pas vraiment ceux qui sont
contre le projet Monet Cathédrale car il est certes moderne mais cela ne
fait qu'un style de plus sur la place. Cette place est tellement faite de
styles différents que rien ne peut choquer. Le Palais des Congrès
représente l'architecture des années 70. C'était de toute
façon en inadéquation avec la cathédrale »,
(Nicolas, dentiste, entretien n°1).
J'avais d'ailleurs noté lors de mes
observations et de mes recherches la pluralité architecturale des
bâtiments de la place de la Cathédrale.
La cathédrale est une architecture du style roman,
essentiellement du gothique, et approchant la Renaissance. Les trois premiers
étages de la tour St Romain date du XIe et XIIe siècle ; sur
la gauche de la façade, est d'un style gothique et contraste avec la
tour de Beurre, située à droite. D'un côté, une
froide simplicité des lignes ; de l'autre, une richesse
décorative tout à fait caractéristique du gothique
flamboyant. Par ailleurs, la Cathédrale dans son ensemble, est un
bâtiment que la critique pourrait légitimement qualifier
d' « arrogant » pour la ville, dans la mesure
où l'édifice prétend dominer la ville.
Les magasins du Printemps datent de 1928. Ils ont
été deux fois transformés, en perdant leurs
caractéristiques d'origine. En 1981, ont été
supprimées des menuiseries qui donnaient une échelle au
bâtiment, et évidemment des ouvertures qui se sont
révélées désastreuses, dans la mesure où
elles ont fait perdre au bâtiment son caractère originel. Le
rehaussement d'un étage neuf a révélé un toit sans
détails, qui est hors de proportions avec le bâtiment.
Le bâtiment de la « pharmacie du
centre » est de style art décoratif, mais d'une
expression et d'un style assez rigide et il ne montre pas une qualité
esthétique.
Face au site du projet Monet Cathédrale, dans la rue
Saint-Romain, il existe encore une des rares maisons du XVe siècle de la
ville de Rouen.
Cette rue, qui donne sur le projet, montre que la structure de
ses maisons à pans de bois, ne serait-ce que par la présence de
ses encorbellements, est formellement très différente de ses
vis-à-vis. L'unité architecturale de cet espace et de cette rue,
si elle existe, repose sur le simple fait que les matériaux
utilisés sont les mêmes et non sur une unité
architecturale.
Le sud de la Place de la Cathédrale est ourlé de
bâtiments de la Reconstruction (années 1950), dont la facture et
la modénature n'est pas différente sur cette place que dans le
reste de la ville, témoignant ainsi de leur indifférence à
l'espace majeur de la ville au bord duquel ils sont bâtis.
Le Bureau des finances, siège des trésoriers
généraux de France, construit à l'angle de la rue du
Petit-Salut, aligne des arcs surbaissés surmontés d'un entresol
à l'italienne, décoré de feuillages soutenus par des
angelots. Le premier étage, en revanche, est percé de grandes
fenêtres sans meneau central. Cette superposition témoigne d'un
mélange entre le style gothique et l'art de la Renaissance.
Par son implantation privilégiée, le projet de
construction en cause doit également amorcer une transition entre le
fond de la place formée notamment par les bâtiments du Printemps,
de la Pharmacie et de l'Office du Tourisme et la Cathédrale
située en vis-à-vis.
La réponse apportée par l'architecte du
XXIème siècle, pour assurer cette transition, est de créer
une double peau vitrée en façade principale Sud soutenue par une
trame métallique verticale. La densité de cette trame s'estompe
dans les niveaux supérieurs, participe et prépare ainsi à
l'important effet d'élancement de la cathédrale située
à proximité immédiate.
Maquette de l'Espace Monet Cathédrale
vue de la rue du Gros Horloge

Les vitres permettront d'apercevoir la cathédrale en
reflet, comme pour le projet que J.P Viguier a fait à Reims.
La Cathédrale de REIMS
L'architecte avait rencontré des habitants inquiets qui
avaient l'impression que le dossier de la médiathèque
n'était pas réfléchi. Mais avec le recul, les habitants
sont très heureux du rendu. L'incorporation d'une architecture moderne
sur le site du parvis de la Cathédrale n'a pas entraîné un
éclatement de l'architecture mais au contraire une transformation douce.
Le reflet de la Cathédrale gothique dans la médiathèque en
verre juste en face est un mélange qui plait beaucoup aux habitants et
aux touristes.
![]()
En conclusion, les styles de la place de la Cathédrale
ne peuvent en aucun cas être dit unitaires, ni même
cohérents. Il s'agit, pour l'architecte de produire la meilleure
expression de l'architecture de son époque.
Vu la diversité architecturale, faire un immeuble en
colombage pour l'espace Monet Cathédrale n'aurait pas de sens. Pour les
adeptes de la modernité, ce serait reculer d'un pas. Ils
conçoivent le patrimoine dans son aspect dynamique et dans son
intégration au projet urbain.
Envisager sa démolition n'est contesté par
personne. Son remplacement par un édifice neuf, contemporain, ne peut
être considéré que comme un progrès, voire un
embellissement du site.
Les personnes qui se situent dans cette perspective me font
infirmer ma première hypothèse car elles voient à travers
les modifications spatiales une formidable avancée. Pour elles,
l'identité de « ville d'histoire » de Rouen n'est en
rien remise en cause car tous les monuments historiques restent
inchangés et constituent la mémoire historique. Les nouveaux
bâtiments construits révèlent une nouvelle période
architecturale et les oeuvres récentes doivent cohabiter avec les
monuments historiques.
A travers les deux types de réactions face à
l'évolution du patrimoine Rouennais, nous ne pouvons répondre
catégoriquement à ma première hypothèse. L'analyse
ne permet pas en effet de dire si les habitants s'identifieront ou pas au
nouveau lieu car ils disent ce qu'ils pensent ressentir mais seul le temps
permet d'assurer que l'oeuvre contemporaine pourra rétrospectivement
être admiré comme un succès, une banalité ou un
échec.
La moitié des personnes réticentes à un
projet moderne ne savent pas comment ils vont réagir face au
bâtiment lorsqu'il sera construit. Mais ceux qui disent qu'ils ne se
l'approprieront jamais ne seront finalement peut-être pas si
mécontents du résultat. Les surprises de pérennité
face aux critiques destructives sont nombreuses dans ce domaine. Par exemple,
la Tour Eiffel est parmi les édifices exceptionnels qui ont
été décriés, alimentés par des
pétitions négatives alors qu'elle est devenue un des
emblèmes de France et que le temps nous présente aujourd'hui
comme exceptionnellement réussi. Mais à quelques exceptions
près, l'architecture moderne n'a pas réussi à
acquérir une valeur patrimoniale.
2- Le poids des médias dans l'avis des
habitants
Les habitants se font une idée du projet par rapport
à ce qu'ils lisent et voient dans les journaux locaux mais la
façon de présenter le projet est très différente
selon que le journal soit codirigé par le maire (Le Rouen Magazine) ou
par un journaliste d'un journal quotidien.
En effet, dans « Rouen magazine »
consacré au projet Monet Cathédrale49(*) tout paraît
réfléchi car il est dit que « le projet
retravaillé s'est enrichi des remarques des Rouennais et d'expertises
avisées ». Or, les remarques faites par les Rouennais
sont loin d'avoir été prises en compte. La hauteur est toujours
la même que le bâtiment actuel, les matériaux ont
évolué mais pas en faveur des habitants : le bois et le
cuivre qui devait structurer le bâtiment en verre ont été
enlevés du projet.
Dans un second numéro du « Rouen
Magazine » consacré à l'évaluation de la ville
par ses habitants, on trouve de très bons résultats en faveur des
actions que la municipalité a menées. En effet, 86% des
habitants, en 2006, se disent satisfaits des actions en faveur de la
restauration du patrimoine50(*). C'est une hausse de 4% par rapport à 2004.
Or, pour le projet, il s'agit non pas d'une restauration du patrimoine mais
d'une construction nouvelle au sein d'un patrimoine existant.
Dans ce même magazine, on apprend que 31% de la
population Rouennaise trouve que l'argent des impôts n'est pas bien
utilisé par la municipalité. La partie de la population qui pense
que le projet Monet Cathédrale est payé par la commune me dit que
cette construction est un gâchis d'argent public:
« Actuellement le Palais est une verrue repoussante, donc je suis
impatiente qu'il soit détruit. Mais je ne me réjouis pas car
c'est un gâchis d'argent public » (Anne-Cécile,
professeur d'histoire, entretien n°4).
Dans le « Paris-Normandie », on devine un
certain cafouillage dans le projet, aussi bien au niveau politique que social.
Les remises en cause de ce projet sont nombreuses et le recours au tribunal
administratif par l'ancien maire de Rouen, Yvon Robert, qui est aujourd'hui
vice-président du Conseil Général est souvent
abordé.
Contrairement à « Rouen Magazine »
qui donne des informations toujours positives, le « Paris
Normandie » dénonce et rappelle les projets modernes
antérieurs qui ont échoué.
Cette différence est encore plus flagrante si l'on
compare deux enquêtes similaires, l'une publiée dans
« Rouen Magazine », l'autre dans le magazine
« Stratégies »50(*) datant de novembre 2005. Cette enquête classe
23 villes de la mieux notée à la moins bien notée par ses
habitants.
Ces deux enquêtes ont été
réalisées pour interroger les habitants et savoir l'opinion
qu'ils ont de leur ville.
Si l'on en croit « Rouen Magazine » qui
rend compte de l'avis des habitants sur leur ville, on peut attendre que Rouen
soit bien placé par rapport aux autres villes. Or, dans le magazine
« Stratégie », Rouen obtient la plus mauvaise
moyenne avec 53/100. Des thèmes très variés ont
été abordés et, mis à part le commerce et le
transport, Rouen a une mauvaise réputation selon cette enquête.
En effet, Rouen a la plus mauvaise position en ce qui
concerne la ville où on se sent le plus heureux, les actions
pertinentes de la municipalité, la vie en générale,
l'image de la ville, le développement économique et le rôle
des élus. Elle obtient l'avant dernière place en ce qui concerne
la famille et l'éducation, les acquis et les loisirs.
On peut noter que les items choisis pour l'enquête ne
sont pas tout à fait les mêmes pour les deux magazines et qu'il
faut donc le prendre en compte pour la comparaison entre les deux
enquêtes. Nous trouvons cependant des items communs, comme le transport
qui a une évaluation positive de 83% dans « Rouen
magazine » et obtient une note de 70/100 dans le magazine
« Stratégie », ce qui lui donne la
7ème place sur 23 villes notées.
Pour les loisirs, « Rouen magazine » donne
une évaluation positive de 70%, dans
« Stratégie », il obtient une note de 70/100 et il
se retrouve 22ème sur 23.
Pour la sécurité des habitants,
« Rouen magazine » attribue une évaluation positive
de 60% et « Stratégie » publie un résultat de
58/100.
Enfin, pour ce qui est de l'aide sociale, 53% des Rouennais
selon « Rouen magazine » l'évaluent positivement, le
magazine « stratégie » l'évalue positivement
à 60%.
|
Rouen magazine
|
Magazine Stratégie
|
|
Transports en commun
|
83%
|
70%
|
|
Loisirs
|
70%
|
65%
|
|
Sécurité des habitants
|
60%
|
58%
|
|
Aide sociale
|
53%
|
60%
|
Evaluations positives des Rouennais sur différents
thèmes selon deux magazines en 2005.
Les résultats publiés dans « Rouen
magazine » et dans « Stratégie »
comportent une assez grande différence (13 points) pour le thème
transports en commun. Or, pour les thèmes loisirs,
sécurité des habitants et aide sociale on note
une différence beaucoup plus faible entre les résultats des deux
enquêtes.
Dans « Rouen magazine », le Maire se
félicite pour les résultats qu'il qualifie d'encourageants. Mais
si on se penche sur le classement établi par
« Stratégie » on se rend compte que les
résultats sont loin d'être encourageants. Même si l'aide
sociale est évaluée positivement à 60%, elle est
classée 21ème sur un classement de 23 villes. Ce
magazine, insiste bien sur le fait que Rouen n'a que deux atouts, à
savoir, le commerce et le transport en commun. Ce dernier thème avec 70%
d'évaluation positive se trouve en effet à la
7ème place du classement.
Il faut donc se méfier des chiffres qui
« paraissent » bons et que l'analyse glorifie. Les
thèmes supplémentaires notés par le magazine
« Stratégie » montre que Rouen a encore beaucoup de
travail et d'effort à faire pour que la ville ait une bonne
réputation.
3- Les enjeux de la reconquête du
centre-ville
3-1Une fonctionnalité de la place plus grande
mais un processus de
gentrification en marche.
Aujourd'hui la place de la Cathédrale est surtout un
lieu touristique. On la visite, on se rencontre, on y passe. Quand l'espace
Monet Cathédrale sera construit, la place aura des fonctions
supplémentaires vu que le nouveau bâtiment accueillera 1514m2
de commerce (boutiques de luxe et bar), 775m2 de salles de réunion, 50
logements, dont 11 F1, 13 F2, 8 F3, 6 F4, 12 F6 ainsi que 88 places de parking
en sous-sol. L'espace Monet Cathédrale aura de nombreuses
fonctions : la fonction d'habiter, de travailler, de se divertir et celle
de circulation. Ces fonctions sont issues de la Charte d'Athènes et sont
les clés de l'urbanisme moderne. La reconquête du centre-ville
favorisée par la pluralité des fonctions sur un même lieu
est une stratégie qui est aussi utilisée pour le
réaménagement des docks de Rouen. Selon le Maire, « cet
urbanisme, qui est l'occasion de renforcer l'attractivité de Rouen,
obéit à trois principes. La mixité des fonctions :
habiter, travailler, se détendre, sur un même territoire. Une
diversité des formes architecturales et des types
d'habitat »51(*). La place de la Cathédrale rassemblera toutes
les fonctions nécessaires de la vie. Cette « machine à
habiter » ne cesse de se développer depuis l'époque de
Le Corbusier.
Désormais l'espace est pensé pour satisfaire les
habitants par rapport à leur mode de vie. Il est en effet de plus en
plus courant de voir se centraliser des activités diverses comme il en
est question pour le projet.
Ce bâtiment censé reconquérir un espace
peu investi par les habitants ne va peut-être pas être pour autant
un atout majeur pour le commerce de la ville au détriment des centres
commerciaux.
En centre-ville, les personnes s'y promènent mais
achètent en fait très peu contrairement aux centres commerciaux
où elles s'y rendent dans un but précis.
Mais nous pouvons distinguer que les personnes qui se rendent
en centre-ville pour faire leur courses ne sont pas les mêmes que celles
qui préfèrent aller dans des grands centres-commerciaux. A Rouen,
on remarque que le commerce de proximité construit en vu d'attirer les
personnes vers le centre-ville ne satisfait que la partie de la population
âgée ou issue de milieux aisés car ces personnes peuvent se
permettre de faire leurs achats dans des boutiques luxueuses et qui pratiquent
des prix élevés.
Le luxe qui sera encore plus présent dans l'espace
Monet Cathédrale tend en fait à reconquérir le
centre-ville grâce aux plus aisés et mettre en marge ceux qui ne
peuvent accéder à des boutiques de luxe. Le processus de
gentrification procède par une sélection de la population :
Une partie de la population se sentira alors obligée de
fuir en périphérie pour différentes activités,
contrairement à Brest52(*) où une étude a montré que les
habitants de quartiers à fort taux de logements sociaux étaient
des captifs du commerce de proximité alors que les habitants de
quartiers plus favorisés faisant au contraire leurs achats en
périphérie.
3-2 Une mixité renversée
Depuis le début de sa dégradation,
l'extérieur du Palais des Congrès est occupé par des
S.D.F. Du côté de la rue St Nicolas, un banc est très
souvent couvert d'une couverture et non loin de lui se balade son
« propriétaire ».
Du côté de la rue des Carmes, un S.D.F a
installé son lit. Il a élu domicile là et parle de
« sa maison ». Lors d'une conversation avec lui, il a pu me
confier que le Palais des Congrès était le refuge des
pauvres : « Ici on est protégé du vent, de la
pluie, et puis quand on veut pisser, on va derrière, alors je suis
là tout le temps, tout le monde me connaît, ici c'est chez
moi », (Michel, SDF, entretien n°8).
Mais depuis début Avril, sa
« maison » n'est plus accessible. Des plaques de tôle
ont été posées tout autour du Palais, sur lesquelles est
affiché le permis de démolir.
Aussi, l'image de ce bâtiment est doublement
négative du fait de l'esthétique du bâtiment et de sa
fréquentation.
Les Rouennais passent très vite devant le
bâtiment, il est réservé à une population bien
ciblée. Seuls les bancs qui se trouvent devant le palais, face au parvis
de la Cathédrale sont fréquentés par des Rouennais et les
touristes.
Lorsque l'espace Monet Cathédrale aura vu le jour, la
fréquentation de ce lieu sera peut-être
bien différente. Les logements et les boutiques seront
réservés à une population particulière mais
très différente de ceux qui fréquentent les
extérieurs du Palais actuellement.
De par le prix des logements, les types de boutiques qui vont
être à l'intérieur, on s'attend à
passer d'une fréquentation des lieux par des personnes
pauvres à une fréquentation par la population la plus bourgeoise.
L'embourgeoisement du centre-ville connu sous le nom de
gentrification le rendrait selon certains plus dynamique et plus
valorisé.
Que ce soit du côté des habitants ou du
côté des élus, tout le monde partage l'avis selon lequel
l'espace urbain doit être investi par ses habitants. La consultation des
habitants est une pratique démocratique, qui leur permet de participer
activement à la vie de cité.
Depuis la décentralisation des décisions, la
consultation des habitants est de plus en plus sollicitée. Par exemple,
la seule participation des citoyens aux élections municipales
paraît insuffisante aux habitants et par conséquent, la loi de
Démocratie de proximité donne plus de poids à la
Démocratie locale dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Le Maire devient en effet un acteur plus important et plus
responsable, par conséquent il peut consulter ses habitants pour le
guider, ce que pouvait difficilement se faire quand toutes les décisions
étaient prises par l'Etat.
1- Le fonctionnement de la démocratie participative
« en théorie »
La démarche de programmation concertée et
participative (PCP) suppose l'existence d'une volonté forte de s'engager
dans un tel processus qui doit se traduire par la présence du Maire
à la tête du comité de pilotage.
La concertation et la participation concernent chacune des
phases de programmation depuis le début jusqu'à la
réalisation du projet (projet/diagnostic/programme/conception/
réalisation). En théorie, la démarche est linéaire,
mais la plupart du temps, les phases s'entremêlent car il faut toujours
avoir en tête les phases qui vont suivre. Par exemple, en pensant au
projet Monet Cathédrale, il aurait fallu anticiper sur les
réactions des habitants.
Tout au long du processus, trois instances vont être
conduites à intervenir. Tout d'abord, l'instance décisionnelle,
c'est-à-dire le groupe de pilotage comprenant les représentants
de la maîtrise d'ouvrage et des différents partenaires publics et
privés, propriétaires et gestionnaires.
Ensuite, on trouve l'instance opérationnelle, qui
comprend l'équipe de programmation et celle de conduite
d'opération.
Et enfin, l'instance de citoyenneté et d'usagers qui
intervient sous trois modalités, à savoir des individus et des
collectifs comme le conseil de quartier, des groupes de travail animés
par des assistants extérieurs à la maîtrise d'ouvrage et
des débats publics organisés à la fin de chaque
étape.
2- Vision de la démocratie participative par les
élus et les enjeux de pouvoir
La municipalité de Rouen prône une plus grande
participation des habitants :
« La démocratie implique une
participation active à la vie de la cité car le destin d'une
communauté dépend de chacun de ses membres. Face aux grands
enjeux de notre temps, le citoyen est celui qui s'informe, participe et non
celui qui subit passivement le cours des choses », (P.
Albertini, Maire de Rouen, extrait du « passeport
citoyen »).
Dans ce même livret « passeport
citoyen », il est inscrit que « chaque citoyen peut
manifester son intérêt pour la gestion de sa ville en participant
aux réunions publiques, en s'associant aux séances du conseil
municipal qui sont ouvertes à tous. Enfin, les conseils de quartiers
sont des espaces de réflexion et de propositions qui sont largement
ouverts : ils ne demandent qu'à accueillir les
habitants ». 14 conseils de quartiers sont prévus à cet
effet.
La municipalité semble ouverte à des dialogues
avec les habitants qui paraissent être des acteurs de la ville,
essentiels pour la faire évoluer.
Le regard porté par les habitants sur leur ville semble
être pris en compte mais pour l'adjoint au Maire à l'urbanisme,
« la co-production est loin d'être en place à Rouen,
à mon grand regret. Je voudrais que tout fonctionne comme à Nancy
qui avait créé des commissions municipales de quartiers,
surnommées depuis des Ateliers de vie de quartiers ».
(Edgar Menguy, adjoint à l'urbanisme à la Mairie de Rouen,
Entretien n°10).
On pointe le doigt sur une faille de la ville de Rouen. Il n'y
a pas assez de prise en compte de tous les avis, et notamment ceux des
habitants. Une bonne décision n'est pas le résultat d'une
concertation entre les politiques et les experts. Il manque cette prise en
compte des habitants qui est valorisée pas les politiques et voulue par
les habitants mais qui est pourtant peu réelle.
Les réunions publiques qui ont eu lieu les 5 mai et 9
juin 2004 avaient pour but de parler avec les habitants et de prendre en compte
leurs attentes. Or, lorsque ces réunions ont eu lieu, les habitants ont
exprimé ce qu'ils souhaitaient et ce qu'ils ne souhaitaient pas pour le
remplacement du Palais des Congrès. Ils avaient notamment dit ce qui ne
leur plaisait pas dans le projet proposé par J.P Viguier. Même si
leur avis a été noté, cela va-t-il influencer le
projet ?
Pour illustrer cette pratique de décider sans les
habitants, on peut prendre pour explication celle de Schumpeter lorsqu'il parle
de la participation des habitants : « Le citoyen typique,
dès qu'il se mêle de politique régresse à une niveau
inférieur de rendement mental (...) la masse électorale est
incapable d'agir autrement que les moutons de Panurge »53(*).
C'est tout à fait se qui se passe pour Rouen, car en
théorie, c'est aux habitants de composer ou de recomposer leur ville,
or, ils n'ont le choix que lors des élections. Une fois les
élections terminées, ils n'ont plus à décider de
rien.
La participation demeure donc un idéal de la
démocratie qui est légitimée par les politiques mais qui
est en pratique très peu utilisée à en croire les
Rouennais.
Néanmoins, il est très difficile de concilier
toutes les volontés tant elles sont divergentes. En effet, comment
satisfaire ceux qui souhaitent un bâtiment en pans de bois, ceux qui sont
pour l'aménagement d'un jardin, ceux qui sont pour la construction d'un
bâtiment futuriste...
C'est pour cette raison que le Parti Socialiste a
demandé un référendum pour satisfaire le plus d'habitants.
Il a été distribué sur la place de la Cathédrale en
mars 2005 des tracts ayant pour but de sensibiliser les personnes sur
l'environnement des habitants et sur leur pouvoir de faire changer ce qu'on
leur impose au niveau urbain si chacun se mobilise. Pour le Parti Socialiste,
si un référendum est créé pour consulter les
Rouennais au sujet du devenir de l'espace où se trouve le Palais des
Congrès, les déçus du résultat se feront au moins
une raison car la décision sera démocratique.
Le problème du non-respect de la démocratie
participative profite aux partis politiques qui ne sont pas élus car ils
peuvent prendre position et aller dans le sens de la majorité de la
population si elle est contre la municipalité en place. Donc, le Palais
des Congrès est un alibi pour les enjeux politiques qui se situent
ailleurs.
Les avis favorables ou défavorables des politiques
concernant le projet sont ainsi une stratégie politique. Vu que la
municipalité est pour le projet et que la plupart des habitants sont
contre, le Parti Socialiste n'a pas hésité à être
partisan du non.
Lors de mon stage au service du droit des sols, j'ai pu me
rendre compte à quel point les projets urbains sont un moyen de gagner
des élections, mais aussi de les perdre :
« Si Menguy signe ça, c'est fini pour
lui, on est trop proche des élections pour accepter des projets
merdiques comme ça », (Extrait d'une réunion entre
le chef du service urbanisme, celui du droit des sols et l'Architecte des
Bâtiments de France).
C'est ce qui c'était passé pour Yvon Robert lors
des élections municipales de 1995. Au lendemain des élections, le
Paris Normandie avait écrit que « l'attitude du PS pendant
7 années d'opposition soit la cause principale de l'échec de Yvon
Robert. Sa désinvolture qui frôle l'irresponsabilité
notamment dans le dossier du projet Monet-cathédrale a pesé lourd
dans les urnes », (Hélène, éducatrice
spécialisée, entretien n°6).
J'ai notamment appris dans une réunion lors de mon
stage que les Verts s'étaient désolidarisés du PS pour
l'histoire du Castorama de Darnetal car Yvon Robert voulait absolument faire
passer le projet, contrairement aux Verts. Bien qu'il y était peu
favorable lui-même, il a accordé le projet. Malheureusement ce fut
une tactique qui n'a pas marché car il a perdu les élections.
Le rôle du politique est donc
prépondérant au moment de la mise sur agenda car il affirme une
stratégie politique et électorale :
« L'architecte, qui a appris à
défendre ses projets tant devant les habitants et les élus qu'en
justice, estime qu'Yvon Robert, bien seul, est motivé par des ambitions
politiques. Il se base sur les avis défavorables mais il oublie de
joindre des avis favorables ! » (extrait de J.P Viguier,
architecte du projet, Paris-Normandie du 2/10/2006).
Les projets proposés sont sources de conflits entre
partis politiques : « Yvon Robert a une position :
c'est fait par Albertini et son équipe, donc nous sommes
contre ! » (Nicolas, négociateur
immobilier, membre de l'association "P'tit Pat Rouennais", entretien
n2).
Quel que soit le projet, les différents partis
politiques se rejoignent très rarement, pour toujours avoir une partie
de la population qui les suit. Il y a les pour et les contre, et les habitants
voteront pour le candidat qui a la même idée qu'eux.
« Je souhaite que ce projet ne voit jamais le jour et je suis
prêt à voter pour quelqu'un qui me proposerait une autre solution,
dommage que Mr Albertini ne comprenne pas ça ! »
(Nicolas, négociateur immobilier, membre de l'association
"P'tit Pat Rouennais", entretien n2).
Les habitants, qu'ils soient de gauche ou de droite peuvent
avoir des avis qui se recoupent. Par exemple, 54% des personnes ayant
répondu aux questionnaires sont de gauche et 40% sont de droite mais ces
40% ne sont pas tous pour le projet, et par conséquent pas en accord
avec Mr Albertini.
Il n'y a donc pas de lien entre l'appartenance politique des
habitants et leur avis sur le projet : sur les 40 % des personnes qui sont
de droite, il y a plus de personnes contre que pour le projet.
On pourrait croire que la municipalité de droite se
lance sans hésiter dans la rénovation de quartiers anciens pour
permettre à la bourgeoisie locale d'avoir encore plus sa place dans le
centre-ville. En revanche, le Parti Socialiste tend plus à trouver des
alternatives pour le devenir de l'espace quand le Palais des Congrès
sera détruit. Il se montre en effet plus réticent et on peut
émettre l'hypothèse qu'il est hostile à une
ségrégation qui reposerait sur la classe sociale au sein du
centre-ville.
Conseils de quartiers et participation
Les habitants voulant participer à la vie locale
peuvent s'inscrire dans les conseils de quartiers. Ces conseils de quartiers
sont divisés en différents groupes de travail. Par exemple, un
groupe de travail sur le patrimoine. Les personnes qui y participent peuvent
donner leur avis ou être consultés.
Seulement, les conseils de quartiers sont souvent un lieu
où chacun se plaint de ces problèmes quotidiens (voirie,
propreté...).
Durant mes observations dans les réunions du conseil de
quartier « Vieux-marché/ Cathédrale », j'ai
remarqué une forte homogénéité des membres qui y
étaient présents et je me suis interrogée sur la
légitimité des conseils de quartiers si tous les habitants n'y
sont pas représentés.
D'après les caractéristiques des participants,
l'âge, la profession ainsi que le diplôme paraissent offrir le
meilleur moyen pour intégrer un conseil et exposer les problèmes
de sa ville et de proposer des solutions.
Quoiqu'il y ait la parité homme/femme dans les conseils
de quartiers, on observe des membres
« stéréotypés ». En effet, sur 412
conseillers inscrits lors du renouvellement de février 200454(*), on comptait 38% de
retraités. Les actifs qui étaient 58% au 31 décembre 2005
ont des caractéristiques communes, c'est-à-dire un niveau
d'études élevé et ils ont pour la plupart des professions
libérales.
Les jeunes sont en revanche faiblement
représentés : 1% des membres ont entre 18-25 ans et 13%
ont entre 25-39 ans.
|
Fréquentation des conseils de quartiers 2004-2007
|
|
Retraités
|
38%
|
|
Actifs
|
58%
|
|
Inactifs
|
4%
|
|
18-25 ans
|
1%
|
|
25-39 ans
|
13%
|
|
39-50 ans
|
38%
|
|
50-75 ans
|
48%
|
Données recueillies sur le site www.rouen.fr
Pour être membre d'un conseil de quartier, il n'y a
pourtant aucune contrainte et le droit d'expression est ouvert au plus grand
nombre. Cela voudrait alors dire qu'il y a une
« sélection naturelle » des habitants, chacun
sachant quel est son rôle. Pour y remédier, il me semble qu'il
serait bien d'effectuer des tirages aux sorts pour désigner les
personnes qui seront dans le conseil de quartier. Ainsi, chaque habitant est
susceptible d'être choisi et le conseil assurerait une
représentation plurielle de la population. Mais cette solution du tirage
au sort suppose que tous les habitants veulent participer à
l'élaboration de sa ville, seulement, beaucoup d'habitants ne sont pas
intéressés par les évolutions de leur ville. Par
exemple, « lors d'une réunion entre la municipalité
et les habitants de la rive gauche, lorsque le Maire en est venu à
parler du Palais des Congrès, pas un mot. Personne dans le public n'a
souhaité obtenir de précisions sur le projet d'espace
Monet-Cathédrale. Visiblement, la polémique n'intéresse
pas la rive-gauche car la place de la Cathédrale semble loin. Mais il
est aussi possible que les habitants n'osent rien dire car ils pensent que ce
n'est pas leur rôle ». (Édition du 09.06.2006,
Paris Normandie)
La sociologie de la domination a montré que
l'inégal accès à certains espaces publics était
indexé à la distribution différenciée des capitaux
sociaux et culturels. L'autorité de la parole serait alors
corrélée à l'autorité sociale du locuteur.
L'espace public est donc « restreint »
à une tranche de la population et fermé sur une élite
informée, concernée et éclairée.
Tous les membres du conseil sont au courant de tout ce qui se
passe dans la ville et se sentent en effet très concernés par les
évolutions urbaines.
L'adhérence au conseil de quartier est la plupart du
temps un moyen de se faire entendre, de se sentir utile comme le dit un
membre interrogé :
« Ici on parle de tout, ce qui nous
dérange. Il y a toujours quelqu'un de la mairie pour écouter. Ce
qu'on dit c'est rapporté plus haut. C'est un peu le seul moyen qu'on a
de se faire entendre. Et puis quand on doit donner un avis sur un projet, on le
donne et dans ces cas là, on sent qu'on met notre empreinte dans les
futurs projets », (Nicolas, dentiste, entretien n°1).
Cette participation satisfait une partie de la population
seulement, car les conseils de quartiers sont créés pour qu'ils
émettent des avis consultatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune
décision à prendre. La municipalité peut prendre en compte
ce qui ressort des réunions mais peut également passer outre. Les
conseils de quartiers n'ayant aucun moyen pour s'opposer aux décisions
prises.
Le fait que ce soit les élus qui aient le pouvoir de
tout décider met à mal la théorie d'Habermas selon
laquelle les citoyens ont des recours pour émettre leur avis.
Nous sommes dans ce que Weber appelle la domination
légale-rationnelle, caractéristique des sociétés
modernes. Des règles sont rationnellement établies pour
accéder au pouvoir et celui qui l'exerce a un statut légal.
L'Etat peut exercer le « monopole de la violence
légitime » ; par conséquent, il exerce une
domination sur la population, mais cette domination est rationnelle et fait le
moins possible appel à la violence.
La liberté de parole des individus pour participer
à la production de la ville pourtant prônée par Pierre
Albertini,, est en fait une « liberté
négative »55(*) qui a remplacé la confiance qu'accordait
l'Etat aux individus par une méfiance prudente, car la confiance en les
habitants était vue comme dangereuse. La « liberté
négative » a également eu comme conséquence de
demander la participation des habitants pour la recherche de garanties pour la
municipalité au lieu de rechercher ce qu'ils veulent vraiment.
Selon les habitants, Ivon Robert faisait plus de choses en les
annonçant aux habitants. « Albertini lui, fait des effets
d'annonces, il met les gens devant le fait accompli, il décide de choses
tout seul. (Exemple du projet du rond point place cauchoise). Avec Albertini on
ne sait jamais où on va », (Nicolas, Négociateur
immobilier, membre de l'association « p'tit pat Rouennais, entretien
n°2).
C'est pour cette raison de domination de l'Etat sur les
dominés que sont les habitants, que des associations se sont
crées, comme celle du « P'tit Pat Rouennais » car
elles ont une reconnaissance juridique.
« Avant quand j'étais dans le conseil
Cathédrale, j'étais dans le groupe de travail
« patrimoine », c'était pas mal, j'ai appris
beaucoup et je pense avoir aussi beaucoup apporté. Mais au final, un
conseil de quartier c'est plutôt pour parler de ses petits
problèmes quotidiens (...) et même quand on veut réellement
être puissant, on ne peut pas car la municipalité fonce bille en
tête sans nous écouter, et franchement on n' a rien à dire
à cela, alors j'ai créé mon association sur le patrimoine,
et maintenant je me sens plus puissant », (Daniel,
retraité, Président de l'association « P'tit Pat
Rouennais », entretien n°11).
Dans une ville, seules les associations peuvent aller en
justice si elles sont en parfait désaccord avec les projets de la
municipalité. Elles ont donc un pouvoir qui peut avoir un effet sur
l'évolution de la ville. Dans une association on agit, alors que dans le
conseil de quartier on donne un avis consultatif.
Notre analyse sur la participation des habitants nous donne
une réponse précise pour répondre à notre
deuxième hypothèse. En effet, bien que les habitants soient
parfois consultés par la municipalité sur différentes
questions, il est indéniable que leur rôle s'arrête
là. Le fait d'émettre son avis en conseil de quartier ne donne
pas au citoyen un rôle fondamental vu que son avis est seulement
consultatif. L'effort de démocratie participative, tel qu'il est
qualifié, ne change pas le fonctionnement interne de la
municipalité qui dirige toujours seule.
4- Choix démocratique et concours
d'architecte
Cette idée d'un concours d'architectes est
abordée par la majorité de personnes dans les entretiens.
De plus en plus de ville y ont recours afin de donner le choix
à la population de choisir parmi plusieurs projets pour la construction
d'édifices publics. Un concours d'architecte avait eu lieu à
Rouen pour le projet de l'Eglise Jeanne d'Arc : « L'Eglise
Jeanne d'Arc est une réussite mais elle est le fruit d'un concours
d'architecte. L'architecte avait pris en compte les avis d'associations comme
les avis des « Monuments Rouennais », (Daniel,
retraité, Président de l'association « p'tit pat
Rouennais », entretien n°11).
En effet, on retrouve des matériaux de l'Eglise qui
rappellent la Place du Marché comme le souhaitait la plupart des
personnes consultées. Un apport de matériaux nobles dans une
construction moderne pour y donner l'âme du lieu et ainsi faire une
transition douce entre le bâtiment moderne et ses alentours de
constructions anciennes, notamment, des immeubles à pans de bois.
Le concours d'architecte apparaît être un moyen
démocratique de choisir un projet. La concertation de différents
acteurs de la ville, dont les habitants, leur donne une
légitimité dans leur rôle d'habitant.
Par le choix que la population fait parmi les
différentes maquettes qui leur sont proposées, on observe la
représentation qu'ils se font de leur ville. Par conséquent, les
édifices publics construits dans leur registre symbolique et
architectural incarnent les valeurs que la communauté juge juste de
défendre. C'est pour cela que le projet Monet Cathédrale est
assez mal accueilli par les habitants car ils pensent qu'il dénature les
monuments environnants. Le seul fait de rajouter des matériaux nobles
comme le bois et la pierre dans la construction aurait apaisé les
réactions des Rouennais et le projet Monet Cathédrale aurait
peut-être pu devenir un symbole de la ville au même titre que la
Cathédrale ou le Gros Horloge : « L'Eglise
Jeanne d'Arc est maintenant présente sur de nombreuses cartes
postales, alors qu'à l'époque, elle n'était pas
souhaitée par la plupart des Rouennais », (Daniel,
retraité, Président de l'association « p'tit pat
Rouennais », entretien n°11). Cette réputation de
l'Eglise Jeanne d'Arc peut être expliqué selon Laurent C. par
« le fait que la célébrité de l'édifice
ne provient pas seulement de la valeur esthétique de son architecture et
de son décor mais aussi des multiples polémiques qu'il a
suscitées »56(*). Si on prend l'idée de l'auteur, on peut alors
s'attendre à de grandes surprises car les polémiques autour de
l'espace Monet Cathédrale ont été très nombreuses.
Alors pourquoi ne deviendrait-il pas le nouveau symbole de Rouen ?
La ville est un outil de travail.
Les villes ne remplissent plus normalement cette fonction.
Elles sont inefficaces : elles usent les corps, elles
contrastent l'esprit.
Le désordre qui s'y multiplie est offensant :
leur déchéance
blesse notre amour-propre et froisse notre
dignité.
Elles ne sont pas dignes de nous.
Le Corbusier, 1925.
Tout au long de ce mémoire, j'ai analysé les
processus de requalification du centre-ville à travers deux
paramètres qui sont la patrimonialisation et la participation citoyenne
au niveau local afin de déterminer les enjeux politiques et spatiaux
d'un changement spatial, ce qui m'a amené à me poser deux
questions qui ont bâti mon analyse : L'introduction d'une
architecture moderne au sein du patrimoine historique de Rouen nuit-elle
à l'identité de la ville ? et Les processus de
consultations concernant l'aménagement sont-elles démocratiques
ou apparaissent-elles comme une mesure technocratique ?
Ces questions ont été posées pour
réfléchir sur la démolition du Palais des Congrès
et la construction de l'espace Monet Cathédrale.
Afin de répondre correctement et le plus
précisément possible à ces questions, j'ai choisi
différentes méthodes et techniques de terrain, à savoir,
la recherche de documents, l'entretien et le questionnaire.
Dans cette conclusion, je vais revenir sur certains aspects
abordés dans les diverses parties.
J'ai affirmé dans ma première hypothèse
que la stratégie de reconquête du centre-ville par la construction
de formes urbaines modernes nuisait à l'identité de la ville et
par conséquent à la mémoire urbaine qui se transmet d'une
génération à une autre. Je n'ai pu affirmer ou infirmer
l'hypothèse car je me suis retrouvée face à deux types
d'acteurs : tout d'abord ceux qui restent attachés au patrimoine
ancien et qui ont une réticence face à la modernisation des
formes urbaines. Pour eux, le patrimoine et sa sauvegarde constitue une valeur
fondamentale et risque d'être mis en péril par les
évolutions urbaines.
Ensuite, il y a ceux qui pensent que la modernisation des
formes urbaines est indispensable car elle va de pair avec l'évolution
de la société. Ce n'est pas pour autant qu'ils souhaitent une
modernisation totale du centre-ville car eux-mêmes sont très
attachés au patrimoine ancien. L'importance du patrimoine Rouennais est
immense pour une très grande majorité des Rouennais et il
constitue une fierté. Mais une confrontation des différents
styles architecturaux leur apparaît être une bonne manière
de satisfaire tous les habitants et de laisser une place pour chaque
époque.
Dans ma deuxième hypothèse, j'ai affirmé
que les habitants avaient une place grandissante dans les processus de
décisions des politiques locales au niveau des décisions
urbanistiques. Lors de mon enquête, j'ai pu en effet voir que les
politiques prônent cette participation citoyenne car elle semble
être la seule solution pour produire efficacement la ville. Or,
même si la participation est plus encouragée qu'auparavant, j'ai
pu remarqué les obstacles à celle-ci : divergences des avis,
l'impossibilité de faire ce que proposent les habitants... Par
conséquent, les avis des habitants ne sont pas pris en compte pour faire
évoluer les projets. Entre la réalité et la
théorie, un écart se creuse. Même si les conseils de
quartiers existent dans le but de faire une place aux citoyens, leurs avis et
commentaires ne sont que consultatifs. A Rouen, les politiques font ce qui leur
semble être le plus simple, c'est-à-dire décider avec les
maîtres d'oeuvre et les architectes ce qui est bon pour la ville,
surtout aux prémices des projets. En effet, l'intégration des
habitants au projet est différente selon le stade d'avancée de
celui-ci. J'ai remarqué que les habitants se sont sentis
concernés seulement après la conception de la maquette mais ce
n'est pas ce qu'ils souhaitent. Selon eux, si leur avis était pris en
compte, les projets seraient mieux acceptés. Un gros effort reste donc
à faire pour que les habitants se considèrent comme les acteurs
de leur ville.
Ce mémoire a été pour moi une
façon de me plonger dans la sociologie urbaine et je pense qu'il
constituera une bonne base pour poursuivre en Master « Politique
locale et développement ». Je voudrais durant mon stage de fin
d'études reprendre certains aspects de mon enquête comme la
patrimonialisation et la politique locale pour les développer.
Ouvrage :
Augé M., Non-lieux, Seuil, Paris, 1992.
Bevort A., Pour une démocratie participative,
Presses de Sciences Po, La bibliothèque du citoyen, 2002.
Champy F., Sociologie de l'architecture, Paris, La
Découverte, Repères, 2001.
Cefaï D., Pasquier D. (dir.), Les sens du
public, PUF, 2003.
Choay F., L'allégorie du patrimoine, La
couleur des idées, Le Seuil, 1992.
Clavel M., Sociologie de l'urbain, Anthropos, 2002.
De Singly F., L'enquête et ses
méthodes : le questionnaire, Paris, Nathan, 1992.
Desse R.P., Le nouveau commerce urbain, Presses
Universitaires de Rennes, Espace et Territoires, 2001.
Dris N., La ville mouvementée, Espace public,
centralité, mémoire urbaine, Paris, l'Harmattan, 2001.
Halbwachs M., La mémoire collective, Paris,
Puf, 1950.
Ledrut R., Sociologie urbaine, PUF, coll. SUP, 1968,
222 p.
Ledrut R., Les images de la ville, Anthropos, Paris,
1973.
Lynch, K., L'image de la cité, Paris, Dunod,
1969, 222 p.
Malinowski B., Une théorie scientifique de la
culture et autres essais, Maspero, Paris, 1968.
Mollet A. (dir.), Quand les habitants prennent la
parole, Paris, Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1981.
Neveu C., (dir.), Espace public et engagement
politique, L'harmattan, 1999
Reynaud R., « Centre et périphérie »
in : Bailly A., Ferras R., Pumain D. (dir.), Encyclopédie de
géographie, Economica, Paris, 1992.
Sue R., La société civile face au
pouvoir, Presses de sciences po., La bibliothèque du citoyen,
2003.
Coll., Une nouvelle civilisation ? Hommage à
Georges Freidman, Paris, Gallimard, 1973.
Les revues :
Revue de l'Art, « Quand Auguste Perret
définissait l'architecture moderne au XXe siècle »,
n°121, 1998.
Revue Espace et société,
« Les sens des formes urbaines », n°122,
n°3/2005.
Revue Espace et Société,
« Ville, action « citoyenne » et débat
public », n°123, n°4/2005.
Revue Espace et Société, «
Ville et Démocratie », n°112, n°1/2003.
Revue L'homme et la société,
« Ville et mouvement », n°145, n°2002/3.
Sciences Humaines, « Qu'est-ce que
transmettre ? Savoir, mémoire, culture, valeurs », Hors
série n°36, mars-avril-mai 2002.
Revue Urbanisme, « Les valeurs d'une
ville ». Hors série n°24, mars-avril 2005.
Revue Urbanisme, « Imaginer, dire et faire
la ville ». Hors série n°19, juillet-août 2003.
Revue Etudes Normandes, n°1, 2001.
Les quotidiens :
Paris - Normandie, 13 janvier 2005.
Libération, 13 septembre 1996.
Paris - Normandie, le 10 mars 2006.
Paris - Normandie, 02 octobre 2006.
Paris - Normandie, le 09 juin 2006.
Paris - Normandie, 11 juillet 2006.
Les mensuels :
Rouen Magazine, « Vue de Rouen,
sondage : la ville jugée par ses habitants », n°
258, du mercredi 31 janvier au mercredi 14 février.
Rouen Magazine, « Cap à l'ouest,
réaménagement des docks », n° 267, du mercredi 6
au mercredi 20 juin 2007.
Les lois :
Atelier d'urbanisme, Rouen, secteur sauvegardé,
Renseignements d'ordre général et législation en vigueur,
24 novembre 1981.
Rapports :
Actes du colloque « Des bâtiments au
public » organisés par la Direction générale de
l'Urbanisme, de l'Habitat et de la construction, Ministère de
l'Equipement, des Transports et du logement, 4ème semestre
1998.
Mémoire :
Morel J., Rouen, Mémoire 44, La mise en oeuvre d'un
projet municipal d'animation du patrimoine, mémoire de DESS
« politique locale et développement », sous la
direction de N. Dris, Université de Rouen, 2004.
Sites Internet :
www.agicom.fr
www.rouen.fr
Annexe 1 : Rapport de stage
Annonce du stage
Mon stage a été réalisé à
la direction de l'aménagement urbain et de l'habitat de la mairie de
Rouen sous la direction de Jean-Christophe Blondel, chef de service du droit
des sols. J'ai effectué ce stage à titre personnel car un stage
n'est pas obligatoire en première année de Master mais seulement
en deuxième année.
L'urbanisme me passionne depuis que j'ai découvert
cette discipline à l'université. J'ai alors voulu voir ce
qu'était l'urbanisme « opérationnel »,
c'est-à-dire sur le terrain pour avoir une idée concrète
des métiers qui existent dans ce domaine et pour voir si ça me
plaisait. De plus, je souhaite passer le concours d'attaché territorial
avec pour spécialité urbanisme, après avoir fait le master
politique et développement local au sein de l'université de
Sociologie de Rouen.
Pour obtenir ce stage j'ai écrit une lettre au
responsable du service du Droit des Sols de la mairie de Rouen expliquant mes
projets futurs et ma volonté de travailler dans l'urbain à la
suite de mes études.
J'ai eu une réponse téléphonique
très rapide. Un entretien m'a été proposé le lundi
5 février avec le chef du service du Droit des Sols qui m'a
accordé un stage du 19 au 23 février 2007 au centre municipal
Pélissier, annexe de la mairie de Rouen qui est la Direction de
l'Aménagement urbain et de l'Habitat.
Descriptif du service et du déroulement du
stage
- Le service
La Direction de l'Aménagement urbain et de l'Habitat,
regroupe le Service Urbanisme, le Service Études et Travaux, le Service
Application du Droit des Sols, le Service Affaires Foncières et
Domaniales et le Service Logement et Habitat.
J'ai effectué mon stage dans le service Application du
Droit des Sols et j'ai découvert un univers passionnant qui
m'était inconnu. Il contrôle les projets d'architectures et de
travaux de bâtiment dans le respect des règles de l'urbanisme. Il
cherche la qualité architecturale, la durabilité des
matériaux et l'harmonie des couleurs dans le but d'embellir le cadre de
vie des habitants, de sauvegarder leur patrimoine, de contribuer à une
invitation à la visite et plus généralement au rayonnement
de la ville.
Le déroulement des semaines est toujours similaire,
mais il y a de nombreux imprévus qui viennent se remettre sur l'agenda.
- Le stage
Ma première journée a été pleine
de découvertes. Comme c'est le cas tous les lundis matins, avec le chef
de service et les deux instructrices, nous avons passé en revue les
demandes de permis de construire ou de démolir.
Les instructrices sont celles qui font l'analyse juridique des
demandes réglementaires déposées sur la commune sur la
base du Code de l'urbanisme.
Ce travail s'effectue, pour les dossiers les plus importants,
avec les architectes et les promoteurs d'où la nécessaire
connaissance des règles en vigueur, ainsi qu'une capacité
à lire des documents juridiques et les plans de construction.
Les instructrices ont en charge :
· Les autorisations d'utilisation et d'occupation
du sol (certificats d'urbanisme, déclarations de travaux, permis de
construire ou de démolir, permis de lotir ...).
· Les permanences avec l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF).
· Les renseignements du public et des
professionnels.
· Les réunions avec les services
extérieurs (DDE, Agence d'urbanisme ...).
· Les préparations des commissions
d'urbanisme.
· Le suivi des Dossiers pré-contentieux.
Le passage en revue des différents dossiers avec le
chef de service prend généralement 4 heures car les dossiers sont
nombreux et tout doit être examiné dans le moindre détail.
On regarde les plans, les photos, les intentions de travaux. Tout est
vérifié pour que les modifications voulues respectent le code de
l'urbanisme. J'ai été surprise du temps pris pour chaque dossier.
Souvent des documents supplémentaires sont demandés aux
propriétaires pour s'assurer de la légalité des travaux
à venir.
Si les travaux sont effectués dans le secteur
sauvegardé les précautions sont encore plus importantes. Dans un
premier temps, le chef de service examine le dossier et s'il ne voit pas
d'inconvénient, il passe ensuite par l'Architecte des Bâtiments de
France qui va émettre un avis favorable ou défavorable. Mais le
dossier peut également être refusé sans passer par
l'Architecte des Bâtiments de France si le chef de service refuse
dés le départ pour des raisons juridiques.
L'après-midi il y a eu une réunion avec le
Directeur du service, des architectes et les responsables d'un magasin de
bricolage de Rouen. Ils venaient avec leur architecte pour faire une demande de
changement de clôture. Les plans passent entre les mains du directeur, du
chef de service et moi-même. Le directeur donne en premier son avis qui
est plutôt favorable car les clôtures sont de verdures. Ensuite, le
chef de service prend la parole et détruit le projet en refaisant un
nouveau plan en cinq minutes. Il dit que le projet de l'architecte n'a pas de
sens, n'est pas esthétique. Le directeur a montré son affection
pour le nouveau projet dessiné.
Tant bien que mal, les responsables du magasin tente de se
défendre, mais la conclusion de la réunion est peu satisfaisante
pour eux. Le directeur leur dit que la réponse leur sera donnée
sous une quinzaine de jours.
Après la réunion, le directeur et le chef de
service parlent entre-eux et ce dernier dit au directeur « Si
Menguy57(*) signe
ça, c'est fini pour lui, on est trop proche des élections pour
accepter des projets merdiques comme ça ». Le directeur
acquiesce et lui dit d'appeler les responsables du magasin pour leur donner un
avis défavorable.
Le soir, il y avait une réunion avec l'adjoint au
Maire, le chef de service et les artisans qui posent des enseignes de magasins
suite à une demande forte de leurs parts. Cette réunion avait
pour but de mettre à plat ce qui était interdit pour les
enseignes dans Rouen. Notamment, dans le centre historique les mesures sont
strictes (pas de PVC, pas de néons, pas de couleur trop vive). À
la fin de la réunion, le chef de service m'a présenté
à Monsieur Menguy, avec qui j'ai pu discuter des thématiques qui
m'intéressaient sans lui dire mon projet de recherche.
Ma deuxième journée a voulu que je sois
productive. Un gros dossier traitant de la nouvelle loi sur
« l'accessibilité des personnes handicapées dans
les lieux privés et publics » vient d'arriver dans le service et ce
dossier est très fourni et peu synthétisé mais cette loi
est essentielle pour tous car elle modifie les normes pour les permis de
construire. J'ai alors lu ce dossier et fait une synthèse, surtout
à base de tableaux pour plus de clarté. Et j'ai fait des
comparaisons avec l'ancienne loi pour voir ce qui avait évolué.
J'ai aimé ce travail pour cette raison : la loi
est sans cesse modifiée car les styles de vies changent et je trouve
intéressant de se tenir au courant des évolutions de la loi. Ma
synthèse a d'ailleurs été le support de la réunion
le soir même, mais je n'ai pas pu y assister. Cette réunion
était entre le chef de service et les instructrices qui doivent avoir
une formation dès qu'une loi change.
Le troisième jour, je suis allée sur le terrain
toute la matinée avec le chef de service et l'Architecte des Batiments
de France pour aller voir les lieux au sein du secteur sauvegardé qui
sont dans les demandes de permis de construction ou de reconstruction.
Contrairement à la consultation des dossiers, les
visites sont très rapides. Quinze minutes en moyenne. Les
propriétaires des lieux reformulent leur volonté devant
l'Architecte des Bâtiments de France qui dit très vite sa
décision. Il donne aussi quelques conseils. Par exemple, pour le
ravalement d'un restaurant rue Eaux de Robec, elle conseille sur la couleur et
sur l'écriture de l'enseigne, elle propose de mettre une enseigne
verticale...
J'ai vu la différence entre les décisions prises
pour des travaux au sein du coeur historique ou au contraire qui sont en
dehors de celui-ci. Les mesures sont strictes quand il s'agit du coeur
historique car il s'agit d'un secteur sauvegardé.
L'après-midi, toujours en présence du chef de
service et de l'Architecte des Bâtiments de France, nous sommes
allés au bureau de ce dernier pour regarder les différentes
maquettes des futurs projets. Des discussions naissent de ces projets et des
modifications sont suggérées et seront rapportées à
l'architecte responsable du projet.
Pour mon quatrième jour j'ai beaucoup lu de documents
sur les modifications du code de l'urbanisme ainsi que sur différents
sujets d'actualité sur l'urbain. J'ai discuté avec le chef de
service du concours d'attaché territorial car il a déjà
été jury de ce concours, il y a quelques années.
L'après-midi, il n'y avait rien de prévu, mais
quatre rendez-vous ont en fait eu lieu. Lorsque les personnes appellent pour
prendre des rendez-vous et que le chef de service est disponible, il fait venir
les gens directement pour les satisfaire au mieux. Il m'a toujours fait
participer au rendez-vous pour que je voie toutes les facettes du
métier. Les personnes viennent aussi bien pour demander quelle couleur
serait préférable pour leur ravalement, pour persuader le chef de
service de reprendre leur dossier de construction car il a déjà
été refusé une fois ou pour apporter des documents
manquants au dossier. Il y a également un représentant de briques
qui est venu présenter son panel pour vendre ses briques pour la
restauration d'un immeuble rive gauche.
Pour mon dernier jour, j'ai voulu discuter de mon sujet de
mémoire avec le chef de service. Il m'a alors montré le permis de
construire du projet Monet Cathédrale (que l'on m'avait
déjà montré quelques mois auparavant lorsque je
m'étais rendue à la mairie pour avoir des documents sur ce
sujet), il m'a montré les trois projets proposés par l'architecte
pour cet espace Monet Cathédrale.
Il m'a également fait consulter tous les documents qui
pouvaient m'intéresser sur mes différents thèmes
(patrimoine, démocratie participative...). J'ai trouvé un grand
intérêt en discutant avec lui de ce projet. En effet, il est
toujours très intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel,
d'autant plus qu'il est responsable des permis de construire, même si
dans ce cas c'est l'Architecte des Bâtiments de France qui décide
au finale vu que le projet s'inscrit dans le secteur sauvegardé.
L'après-midi il y a eu une réunion avec le
directeur du service, l'adjoint au Maire et le chef de service pour passer en
revue les différents projets prévus hors du secteur
sauvegardé. Les négociations peuvent être longues pour
mettre tout le monde d'accord sur la même idée.
Les apports du stage
Ce stage m'a permis de voir les différents
métiers qui existaient au sein de ces services. Des secrétaires
au directeur, en passant par les instructrices, le chef de service, chacun a
une tâche spécifique et j'ai pu faire le tour de tous pendant
cette semaine.
Au fil des réunions et des rendez-vous sur le terrain,
j'ai pu voir l'importance du secteur sauvegardé pour les
décisions à prendre.
Il y a des règles spécifiques à ce
secteur et comme je travaille sur ce secteur pour mon mémoire de Master
1, j'ai pu prendre note de tout ce qui pouvait m'être utile.
Un apport majeur de mon entrée dans ce service a
été la rencontre avec des personnes que je n'arrivais pas
à contacter, comme l'adjoint au maire. Mais j'ai aussi pu avoir des
documents propres à la mairie qui ont été essentiels pour
mon analyse. Sans ce stage, mon mémoire aurait eu nettement moins de
contenus.
Comme ce stage était pour moi un moyen d'avancer dans
ma recherche mais aussi une entrée dans un secteur qui, je
l'espère sera le mien dans le futur, j'ai voulu me documenter sur les
différentes épreuves du concours d'attaché territorial que
je veux passer et j'ai pu apprendre ce qu'on attendait d'un candidat pour un
concours comme celui-ci.
Annexe 2 : Grille d'observation de la place de la
cathédrale
1/ Approche sensible
Place ouverte - fermée ?
Place lumineuse - sombre ?
Place intime - solennelle ?
Place sécurisante - angoissante ?
Place étroite - spacieuse ?
Place gaie - triste ?
Place colorée - terne ?
Place calme - bruyante ?
2/ Analyse spatiale
Aspect monumental
Forme
Volume d'ensemble
Relief
Style dominant
Le bâti :
- Organisation de la disposition
- Le rythme
- La couleur
- Le style : un ou plusieurs ?
- La cohérence architecturale
- Types de bâtiments : publique, privé,
religieux
- Rapport de taille : place - bâti
Articulation avec les autres places
Le sol : Matériaux, couleurs
Signes, expressions symboliques
Environnement naturel, végétal
3/ Les fonctions de la place
Fonction de circulation (voiture, piéton...)
Fonction commerciale
Fonction de rencontre
Fonction résidentielle
Fonction administrative
Rythme et activité au cours de la journée
4/ Lecture sociale
La rue a-t-elle une dominante sociale ? Semble-t-elle
homogène ou hétérogène socialement ?
5/ Contexte
Historique :
En quoi la place est-elle une création de
l'histoire ? En quoi est-elle significative d'une époque ?
Constitue-t-elle un patrimoine pour la ville ? En quoi contribue-t-elle
à donner une image et une identité à la ville ?
A-t-elle subie des remaniements?
Spatiale :
Comment la place s'articule-t-elle avec le tissu urbain ?
Est-elle en rupture ou en continuité ?
Annexe 3 : Grille d'entretien
IDENTITE :
1/ Âge
2/ Situation familiale
3/ Profession
4/ Lieu de résidence (avez-vous toujours habité
Rouen ? Etes-vous né à Rouen ? Pourquoi êtes-vous
parti de Rouen ou pourquoi êtes-vous venu à Rouen?)
VILLE ET PATRIMOINE :
5/ Comment percevez-vous la ville de Rouen ?
(Agréable, calme, bruyante...)
6/ Quel est votre intérêt pour le
patrimoine ?
7/ Quel(s) monument(s) affectionnez-vous le plus ?
(Pourquoi celui-là et pas un autre ? Vous rappelle-t-il quelque
chose ? Fait-il partie de vous ?)
8/ Quelle est, selon vous, l'importance du patrimoine dans la
ville de Rouen ? (Plus que dans d'autres villes ? Fait-il partie de
l'identité de la ville ? Pensez-vous que la ville est très
réputée pour son patrimoine ? Est-ce un atout
touristique ?
9/ Quel est votre sentiment lorsqu'on parle de la construction
d'un bâtiment moderne à côté de la
cathédrale ? (Peine, joie, regret.)
10/ Pensez-vous que vous vous rappellerez de l'actuel Palais
des Congrès ? Vous rappelez-vous par exemple de la rue du
Général Leclerc avant les travaux du teor ?
VILLE ET POLITIQUE :
11/ Pensez-vous que le projet Monet Cathédrale est un
projet politique ? Pensez-vous qu'il y a un clivage droite/gauche autour
du projet ?
12/ Participez-vous à des conseils de quartiers de
Rouen ?
13/ Avez-vous participé aux réunions de conseils
de quartiers portant sur cette thématique ?
14/ Avez-vous été tenu au courant de
l'évolution du projet (par la presse, par la mairie, par le conseil de
quartier ?
15/ Vous a-t-on demandé de donner votre avis ?
16/ En ce qui concerne les transformations urbaines, avez-vous
le sentiment d'être mené par les politiques ?
17/ Une ville pensée par ses habitants est-elle
utopique ?
Annexe 4 : Questionnaire
Sexe : F M
Age : _ _ ans
Ville de résidence :
Si Rouen, quel quartier :
Si vous habitez en périphérie, avez-vous habitez
Rouen ?
Profession :
1- Quel est votre intérêt pour le patrimoine
Rouennais ?
2- Quels sont les monuments que vous affectionnez le
plus ?
3- Pourquoi celui-là (ou ceux- là) ?
4- Quelle est l'importance du patrimoine dans la ville de
Rouen ? Fait-il partie de l'identité de la ville ?
5- Pensez-vous que le patrimoine Rouennais soit
connu :
- localement OUI NON
- nationalement OUI NON
- mondialement OUI NON
6- Quel bâtiment préfèreriez-vous voir
disparaître ?
- L'Eglise Jeanne d'Arc
- Le Palais des Congrès
- L'Aître St Maclou
- L'Espace du palais
7- Etes-vous d'accord avec la destruction du Palais des
Congrès ?
8- Comment réagissez-vous face à la destruction
d'un lieu qui vous est familier ?
RECONQUETE ET MODERNITE DU CENTRE VILLE
|
9- Quelle(s) action(s) peuvent être nécessaire(s)
pour reconquérir le centre-ville ?
10- Que pensez-vous de la volonté municipale de
moderniser le centre-ville ?
11- La construction d'un bâtiment moderne à
côté d'un monument historique est-elle un gâchis?
q Oui
q Non
12- Etes-vous pour ou contre la construction de l'espace Monet
Cathédrale ?
13- Pensez-vous pouvoir facilement vous identifier au nouveau
lieu ?
q Oui
q Non
14- Pensez-vous que vous vous rappellerez du Palais des
Congrès dans quelques années ?
Pourquoi ?
q Oui
q Non
SENTIMENT DE PARTICIPATION POLITIQUE
|
15- La politique urbaine menée à Rouen est-elle
conforme à ce que vous attendez ?
q Oui
q Non
q Je ne sais pas
16- Les habitants sont-ils assez concertés pour prendre
les décisions ?
q Oui
q Non
q Je ne sais pas
17- La ville gouvernée par ses habitants est-elle une
utopie ?
18- Que traduisent, selon vous les vifs débats
concernant le projet Monet Cathédrale ?
Annexe 5 : échantillon du questionnaire
________________________________________________________
|
Prénom
|
Profession
|
Age
|
Ville de résidence
|
Participation à la vie locale ?
|
|
Elodie
|
Etudiante
|
22
|
Rouen
|
Non
|
|
François
|
Ingénieur
|
34
|
Saint Etienne du Rouvray
|
Oui
|
|
Eric
|
Etudiant
|
25
|
Rouen
|
Non
|
|
Karima
|
Vendeuse
|
42
|
Mont Saint Aignan
|
Non
|
|
Guillaume
|
Assureur
|
28
|
Rouen
|
Non
|
|
Charlotte
|
Danseuse
|
29
|
Rouen
|
Non
|
|
Anne-sophie
|
Etudiante
|
22
|
Rouen
|
Non
|
|
Cyril
|
Etudiant
|
22
|
Déville les Rouen
|
Non
|
|
Aurore
|
Educatrice spécialisée
|
37
|
Barentin
|
Non
|
|
Amalia
|
Etudiante
|
23
|
Mont Saint Aignan
|
Oui
|
|
Renaud
|
Manageur
|
32
|
Rouen
|
Non
|
|
Delphine
|
Commerciale
|
43
|
Maromme
|
Non
|
|
Christophe
|
Plombier
|
43
|
Mont Saint Aignan
|
Non
|
|
Denis
|
Maître-nageur
|
32
|
Rouen
|
Non
|
|
Nicolas
|
Banquier
|
52
|
Rouen
|
Oui
|
|
Laure
|
Professeur des écoles
|
26
|
Rouen
|
Non
|
|
Léanne
|
Etudiante
|
23
|
Saint Etienne du Rouvray
|
Non
|
|
Vincent
|
Professeur de sport
|
29
|
Déville les Rouen
|
Non
|
|
Anne
|
Coiffeuse
|
42
|
Rouen
|
Non
|
|
Pierre
|
Etudiant
|
22
|
Rouen
|
Non
|
|
Denis
|
Ambulancier
|
54
|
Evreux
|
Non
|
|
Ginette
|
Retraitée
|
63
|
Rouen
|
Oui
|
|
Alphonse
|
Retraité
|
67
|
Mont Saint Aignan
|
Oui
|
|
Oliver
|
Chômage
|
22
|
Rouen
|
Non
|
|
Nicolas
|
Dentiste
|
47
|
Barentin
|
Oui
|
|
Charles
|
Etudiant
|
23
|
Saint Etienne du Rouvray
|
Non
|
|
Robert
|
Retraité
|
68
|
Rouen
|
Oui
|
|
Julia
|
Etudiante
|
22
|
Déville les Rouen
|
Non
|
|
Sophie
|
Assureur
|
51
|
Rouen
|
Non
|
|
Franz
|
Pompier
|
26
|
Rouen
|
Non
|
|
Patrice
|
Colonel d'armée
|
39
|
Rouen
|
Non
|
|
Manon
|
Etudiante
|
26
|
Rouen
|
Non
|
|
Chantal
|
Chef d'équipe
|
47
|
Rouen
|
Oui
|
|
Rudy
|
Chômage
|
21
|
Mont Saint Aignan
|
Non
|
|
Julien
|
Etudiant
|
23
|
Rouen
|
Non
|
|
Elodie
|
Assureur
|
29
|
Rouen
|
Non
|
|
Elise
|
Educatrice spécialisée
|
37
|
Mont Saint Aignan
|
Non
|
|
Julien
|
Correcteur
|
26
|
Rouen
|
Oui
|
|
Georges
|
Retraité
|
72
|
Mont Saint Aignan
|
Non
|
|
Davy
|
Avocat
|
29
|
Saint Etienne du Rouvray
|
Non
|
|
Caroline
|
Technicienne de surface
|
21
|
Mont Saint Aignan
|
Non
|
|
Pauline
|
Mère au foyer
|
23
|
Rouen
|
Non
|
|
Karl
|
Chômage
|
38
|
Rouen
|
Non
|
|
Bélinda
|
Typographe
|
32
|
Petit Quevilly
|
Non
|
|
Thierry
|
Coach
|
43
|
Rouen
|
Non
|
|
Julie
|
Assistante de direction
|
27
|
Barentin
|
Oui
|
|
Yannick
|
Fleuriste
|
35
|
Rouen
|
Non
|
|
Serge
|
Retraité
|
76
|
Grand Quevilly
|
Oui
|
|
Arnaud
|
Chef de secteur
|
31
|
Rouen
|
Non
|
|
Lina
|
Ouvrière
|
45
|
Rouen
|
Non
|
Annexe 6 : Tris à plat
|
Q4 Le patrimoine fait-il partie de l'identité de la
ville ?
|
|
Non-Répondants
|
1
|
2%.
|
|
Oui
|
43
|
88%
|
|
Non
|
3
|
6%
|
|
Je ne sais pas
|
2
|
4%
|
|
Total répondants
|
49
|
100%
|
|
Q5 Le patrimoine est-il connu:
|
|
Non-Répondants
|
0
|
.
|
|
localement
|
11
|
22%
|
|
nationalement
|
10
|
20%
|
|
Mondialement
|
29
|
58%
|
|
Total répondants
|
50
|
100%
|
|
Q6 Quel bâtiment préfèreriez-vous voir
disparaître ?
|
|
Non-Répondants
|
0
|
.
|
|
Le Palais des Congrès
|
32
|
64%
|
|
L'Espace du Palais
|
5
|
10%
|
|
L'Eglise Jeanne d'Arc
|
8
|
16%
|
|
L'Aître Saint Maclou
|
4
|
8%
|
|
Total répondants
|
50
|
100%
|
|
Q7 Etes-vous en accord avec la destruction du Palais des
Congrès?
|
|
Non-Répondants
|
0
|
.
|
|
Oui
|
23
|
46%
|
|
Non
|
5
|
10%
|
|
Je ne sais pas
|
22
|
44%
|
|
Total répondants
|
50
|
100%
|
|
Q12 Etes-vous pour ou contre la construction de l'espace
Monet Cathédrale ?
|
|
Non-Répondants
|
0
|
.
|
|
Pour
|
14
|
28%
|
|
Contre
|
34
|
68%
|
|
Je ne sais pas
|
2
|
4%
|
|
Total répondants
|
50
|
100%
|
|
Q17 Les habitants sont-ils assez concertés pour
prendre les décisions ?
|
|
Non-Répondants
|
1
|
2%.
|
|
Oui
|
12
|
24,5%
|
|
Non
|
32
|
65,3%
|
|
Je ne sais pas
|
5
|
10,2%
|
|
Total répondants
|
49
|
100%
|
|
Q16 La politique urbaine menée à Rouen
est-elle conforme à ce que vous attendez ?
|
|
Non-Répondants
|
2
|
4%.
|
|
Oui
|
5
|
10%
|
|
Non
|
5
|
10%
|
|
Je ne sais pas
|
37
|
76%
|
|
Total répondants
|
49
|
100%
|
Annexe 7 : Extrait d'entretien
_______________________________________________________________
NICOLAS 28 ANS NEGOCIATEUR IMMOBILIER. TRESORIER DE
L'ASSOCIATION « P'TIT PAT ROUENNAIS ».
A. : Habitez-vous Rouen ?
N. : Non, j'habite à la campagne à une
vingtaine de kilomètres d'ici. Mais j'ai toujours été
très attaché à cette ville depuis tout petit pour le
tourisme, les monuments. Je suis né à Rouen et je suis parti
à l'âge de 10 ans car mes parents ont décidé d'aller
vivre à la campagne.
Rouen, C'est une ville sympa, il y a plein de choses à
voir et par rapport au patrimoine, il y a plein de choses à
protéger encore, plein de monuments qui, depuis la seconde guerre
mondiale sont encore en ruine. (ex. Eglise St Paul).
A. : Au lieu de détruire le Palais des
Congrès pour faire du moderne, vous auriez préféré
que soient restaurés les monuments qui en avaient besoin ?
N. : Non pas forcément mais en fait je suis contre
le projet Monet Cathédrale car il ne va pas assez loin. Si on veut faire
du contemporain il faut faire plus que ça. Faire quelque chose de plus
innovent, de plus marquant au lieu de construire un simple immeuble en verre.
Faire quelque chose de vraiment futuriste soit il faut construire dans le style
de Rouen. Vous savez le pastiche, pour que la ville ressemble à la
Normandie !
A.: Pourtant sur la maquette du projet, le bâtiment a
l'air très moderne ?
N. : Non parce qu'au début lorsqu'on a
rencontré l'architecte Viguier il nous a montré ce qu'il avait
déjà fait, c'était pas mal mais ce qui est beaucoup moins
bien c'est ce qu'il a fait en face de la cathédrale de Reims (...). Il y
a trois ans, quand il y a eu les premières propositions pour
détruire le Palais des Congrès j'avais écrit sur le site
Internet de Rouen que c'était inutile de remplacer un verrue en
béton par une autre verrue en verre. Le seul avantage serait qu'il
serait plus facile à mettre par terre dans 30 ans. Ce qui est beaucoup
plus grave c'est qu'à l'intérieur va être fait des salles
de réunions, des commerces, et des logements et au moment où le
bâtiment devra être détruit, il faudra évacuer les
habitants.
(...)
Ce qui ne m'a pas plus c'est que l'architecte nous a pris pour
des gogols au départ parce qu'il nous a dit qu'il allait se servir de
l'histoire de la ville pour en tirer quelque chose. Ce qu'il nous a
montré la première fois, c'était complètement
affreux. Ca ressemblait à des bâtiments de la rive gauche.
C'était carré, et pour rappeler les colombages, il avait
simplement mis des grandes croix en acier. (...) Les architectes d'aujourd'hui
ne respectent pas ceux qui les ont précédés et ils
détestent ce qui a été fait avant. On n'a pas à
réemployé les matériaux anciens. Pour eux, le pastiche
n'est pas imaginable. Ils veulent résolument de la
modernité ! Cette modernité a d'ailleurs fait que le premier
projet n'est pas passé, il en a présenté un
deuxième avec du verre teinté, avec matériaux nobles, de
la pierre. C'était pas mal. Pour le troisième projet, il a mis du
verre transparent et il a enlevé les matériaux nobles. Au fur et
à mesure du temps, on en a fait un bâtiment le plus rentable
possible. Ca ne me déplait pas que ça traîne parce que les
promoteurs vont se lasser.
A. : Mais le fait que ça traîne ne va pas
faire que le projet sera retiré ?
Les projets urbains traînent tout le temps. Ca ne
démarre jamais à la bonne date et ça ne finit jamais
à la bonne date non plus.
Ca traîne d'autant plus que l'ancien Maire de Rouen a
porté plainte. Les travaux sont maintenant prévus au moment des
élections. Donc personne n'osera commencer les travaux.
Généralement, je suis à droite mais
là je suis plutôt pour la gauche. De toute façon, au niveau
local la gauche et la droite ça change pas grand-chose. Ce qui change
c'est la personne. Personnellement je ne suis pas très attaché
à Pierre Albertini.
Ivon Robert faisait plus de choses, notamment la concertation
avec les habitants. Albertini lui fait des effets d'annonces, il met les gens
devant le fait accompli, il décide de choses tout seul. (ex. le projet
du rond point place Cauchoise). Avec Albertini on ne sait jamais où on
va.
A. : Etes-vous d'accord avec les propositions des
Rouennais pour remplacer le projet Monet Cathédrale ? (Jardin)
N. : Non, je ne suis pas pour faire un jardin à la
place, il faut savoir qu'un jardin c'est complètement illusoire. Sous le
Palais des Congrès il y a un parking en béton bien solide, donc
la seule chose qu'on pourrait faire c'est de casser le parking, remplir de
terre, aménager un jardin. Mais là on pourrait passer à
combien ça coûte pour « quelle est la ville qui gaspille
le plus d'argent ? ». En plus il faut savoir, qu'à
l'endroit du Palais des Congrès, il y a eu des destructions dues
à la guerre et laisser la place vide remémorerait l'histoire. Au
moyen Age en plus tout était serré alors pourquoi maintenant
vouloir faire une place immense. Après la seconde guerre mondiale une
avenue devait être construite de la Cathédrale à la Seine
et les architectes avaient refusé pour ce souci de ne pas faire
d'espaces dégagés. (...) La ville de Rouen s'est
présentée deux fois au concours du patrimoine de l'UNESCO et elle
a été refusée deux fois car elle n'est pas assez
homogène. Si la ville était totalement en colombage il n'y aurait
pas eu de problème. Alors allez faire du moderne juste à
côté de l'ancien c'est courir à la catastrophe.
Aujourd'hui on veut que du neuf. On nettoie les monuments pour
qu'ils soient blancs. Ca ne correspond pas à notre époque mais il
faut que ça fasse neuf ! Avant on voulait du vieux. Ici, à
la halle aux toiles on mettait de l'huile sur les murs extérieurs pour
que ça fasse vieux. Ca change à toutes les époques !
Parfois je suis peut-être mauvaise langue quand je dis
que le bâtiment en projet est totalement stupide.
Quand t'as toujours vu le truc, c'est normal. L'Eglise de la
place du marché, je l'ai toujours vu donc, elle a beau être
moderne c'est pas choquant pour moi. Ca me dérange sans doute qu'on
change à ce que je connais. Je suis habitué à voir le
Palais des Congrès, même s'il n'est pas idéal sur cette
place.
Annexe 8 : Exemples d'articles de journaux se
rapportant au sujet
______________________________________________________________
(Édition du 09.06.2006, Paris-Normandie)
L'exercice a duré deux heures, le temps pour le Maire
de lister les projets, de défendre son bilan et de répondre aux
questions. Extraits.
Le Maire face aux habitants
Il n'y avait pas vraiment foule. Cinquante Rouennais, pas
plus, ont répondu à l'invitation du Maire, mercredi soir. Dans
une salle de la MJC, rive gauche, Pierre Albertini a présenté les
projets en passe d'aboutir et ceux qui émergent, avant de
répondre aux questions des habitants. « Nous sommes presque
entrés en période électorale », a-t-il fait
remarquer.
PALAIS DES CONGRES. Pas un mot. Personne dans le public n'a
souhaité obtenir de précisions sur le projet d'espace Monet
Cathédrale. Visiblement, la polémique n'intéresse pas la
rive-gauche. La place de la Cathédrale semble loin. Mais il est aussi
possible que les habitants n'osent rien dire car ils pensent que ce n'est pas
leur rôle.
Néanmoins, le Maire a dévoilé une
maquette. En fait, des petits cubes blancs censés représenter les
immeubles et le nouvel édifice. Pas de quoi se faire vraiment une
idée. « C'était la maquette de travail »,
précise Pierre Albertini.
(Édition du 10.03.2006, Paris-Normandie)
Jusqu'à la fin mars, la Maison de l'architecture
cherche à promouvoir les réalisations les plus contemporaines. Un
pari pas gagné d'avance, surtout dans l'Agglo de Rouen.
L'architecture contemporaine
Rouen ville musée, ne rime pas avec modernité.
Dans la capitale haut-normande, si fière de son patrimoine historique,
on se souvient encore des tollés provoqués par
l'édification du Palais des Congrès en 1976, puis de l'Eglise
Sainte-Jeanne d'Arc trois ans plus tard. Plus sage, la fac de droit s'est
intégrée dans le paysage; mais l'agrandissement du rectorat fait
encore bondir certains.
Dans l'agglomération, où l'on recense pourtant
moins de vieilles pierres, on ne se montre parfois pas plus ouvert. La gare du
métro de Sotteville ou le lycée Elisa-Lemonnier à
Petit-Quevilly ne passe toujours pas. On mesure alors l'étendue du pari
engagé par la Maison de l'architecture, qui vient de lancer la
première édition du « Mois de l'architecture contemporaine
».
« Elle déroute, parce qu'elle est méconnue
et souvent ignorée de l'enseignement et des médias, explique
Pascal Victor, Président de la Maison de l'architecture. Elle est
d'autant plus incomprise que le patrimoine de la ville est fort ». D'un
autre côté, on ne peut pas repousser les limites de la ville. Ni
construire comme avant.
Heureusement, « les choses changent depuis peu de temps,
reconnaît Pascal Victor, dans des communes à l'avant-garde, comme
Sotteville. L'architecture contemporaine devient aussi symbolique d'une
manière de penser, d'une ouverture d'esprit. Elle donne une image forte.
Les élus en prennent conscience petit à petit. Mais cela reste
aussi dangereux pour eux, quand une architecture est mal perçue
».
D'où l'intérêt « de montrer les
choses, d'en parler tranquillement, de créer des rencontres qui font
avancer le débat ». Le « Mois de l'architecture contemporaine
», déclinaison régionale de l'opération nationale
« Vivre les villes », s'articule autour de quatre opérations
(voir ci-dessous) menées dans l'agglomération rouennaise et dans
l'Eure (à Louviers et à Val-de-Reuil).
G. L.

Paris Normandie, le 02 octobre 2006.
Paris-Normandie, le 02 octobre 2006.

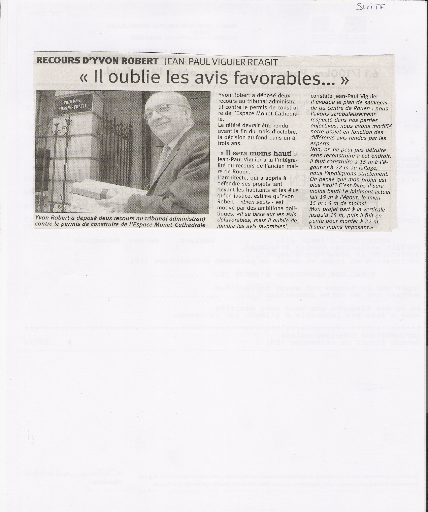
Paris-Normandie, le 11 juillet 2007

Annexe 9 : Calendrier
De début octobre à mi-novembre, j'ai
consacré mon temps à l'exploration. Pendant cette période,
j'ai récolté les documents qui m'étaient
nécessaires (photos de la maquette, consultation du permis de
construire, lois sur les secteurs sauvegardés...) ainsi que la
théorie qui correspondait à mon sujet. Courant octobre, j'ai pris
mes premiers contacts avec des professionnels qui ont donné un avis sur
le projet tel que l'architecte en chef des monuments de France et l'inspecteur
général des monuments historiques.
J'ai profité des réponses rapides et favorables
pour demander à l'architecte en chef de faire mon premier entretien avec
lui. Il s'est déroulé le 18 octobre et m'a permis de m'ouvrir de
nouvelles pistes de recherches.
J'ai également eu mes premiers contacts avec des
habitants pour programmer des entretiens.
Début novembre j'ai effectué quelques heures
d'observation avec une grille détaillée pour voir la
manière dont les habitants perçoivent la place et ce qu'ils
viennent y faire.
Après ces premières démarches, j'ai
rédigé un premier texte provisoire pour poser les bases de mon
enquête.
Fin novembre, j'ai commencé à faire des fiches
par thèmes à savoir le centre-ville, le patrimoine et la
participation des habitants sur lesquelles je mettais les données
théoriques et les premières données d'enquêtes. Cela
m'a aidé à poursuivre la rédaction de la première
partie du mémoire, tout en continuant mes lectures.
Début janvier, j'ai rendu ma « partie
théorique », et en attendant le résultat, j'ai pris
tous mes premiers rendez-vous pour mes entretiens. Au mois de février et
mars, j'ai effectué neuf entretiens et deux supplémentaires au
mois d'avril. Mis à part les deux derniers qui se sont greffé
à mon agenda, j'ai pu me tenir à ce que j'avais prévu de
faire.
Au milieu du mois d'avril j'ai commencé la
rédaction finale de mon mémoire pour le terminer fin mai. La
rédaction a finalement été plus longue que prévue
et je n'ai pu finir à temps pour soutenir en juin.
* 1 Propos d'Edgar Menguy,
Maire-Adjoint chargé de l'urbanisme de la ville de Rouen.
* 2 Clavel M., Sociologie de
l'urbain, Anthropos, 2002, p.52.
* 3 Reynaud R., « Centre
et périphérie » in : Bailly A., Ferras R., Pumain D.
(dir.), Encyclopédie de géographie, Economica, Paris,
1992.
* 4 Grafmeyer Y.,
Sociologie urbaine, Paris, Nathan, 1994.
* 5 Clavel M., Sociologie
de l'urbain, Anthropos, 2002, p. 59.
* 6 Ledrut R., Sociologie
urbaine, PUF, coll. SUP, 1968, p. 159.
* 7 Cité par Clavel
M., op.cit, 2002.
* 8 Bulot Y.,Langue
urbaine et identité, langue et urbanisation linguistique à
Rouen, L'Harmattan, 1999.
* 9 Ledrut R., Les formes
et le sens dans la société, Paris, Librairie des
Méridiens, 1984.
* 10Ledrut R., Les
images de la ville, Anthropos, Paris, 1973, p.113.
* 11 Ledrut R, op. cit.,
1984, p.22.
* 12 Halbwachs M., La
mémoire collective, Paris, Puf, 1950, p.209.
* 13 Dictionnaire Larousse.
* 14 Cité par Champy
F., « Des valeurs et des pratiques de l'architecture
contemporaine », L'homme et la société,
n°145, n°2002/3, p.11.
* 15 Cité par Busquet
G., « Henri Lefebvre, les situationnistes et la dialectique
monumentale. Du monument social au monument- spectacle », L'Homme
et la Société, n°146, octobre-décembre 2002.
* 16 Cité par Dris N.,
« L'irruption de Makkam Ech Chabid dans le paysage algérois :
monuments et vulnérabilité des
représentations », L'Homme et la
société, n°146, octobre-décembre 2002.
* 17 Malinowski B., Une
théorie scientifique de la culture et autres essais, Maspero,
Paris, 1968.
* 18 Choay F., op.cit,
1992.
* 19 Atelier d'urbanisme,
Rouen, secteur sauvegardé, Renseignements d'ordre général
et législation en vigueur, 24 novembre, 1981.
* 20 Augé M.,
Non-lieux, Seuil, Paris, 1992.
* 21 Lynch, K., L'image
de la cité, Paris, Dunod, 1969.
* 22 Lévy A.,
« La démocratie locale en France », Espace et
Société, n°112, n°1/2003, p.162.
* 23 Sue R., La
société civile face au pouvoir, Presses de sciences po., La
bibliothèque du citoyen, 2003, pp. 99-101.
* 24 Cité par Champy
F., « Des valeurs et des pratiques de l'architecture
contemporaine », L'homme et la société,
n°145, n°3/2002, pp.11-15.
* 25 Champy F.,
Sociologie de l'architecture, Paris, La Découverte,
Repères, 2001.
* 26 Cité par Champy
F., op.cit, 2002, pp.11-15.
* 27 Cité par Duarte
F., Frey C., « Démocratie participative et gouvernance interactive
au Brésil, Santos, Porto Alegre et Curitiba », Espace et
société, n° 123, n°4/2005.
* 28 Mollet A. (dir.),
Quand les habitants prennent la parole, Paris, Ministère de
l'Urbanisme et du Logement, 1981.
* 29 Champy F.,
op.cit, 2001.
* 30 Dahlgren P., « A
la recherche d'un public parlant » in Cefaï D., Pasquier D.
(dir.), Les sens du public, PUF, 2003, p. 294.
* 31 Le Texier E.,
« Minorités et espaces publics dans la ville. Le
« «chicano park » à san
diego », Espace et Société, n° 123,
n°4/2005.
* 32
Libération, 13 septembre 1996.
* 33 Neveu C., (dir.),
Espace public et engagement politique, L'harmattan, 1999, p. 33.
* 34 Bilan 2005 de
l'observatoire de la démocratie locale de la ville de Rouen.
* 35 De Singly F.,
L'enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris,
Nathan, 1992.
* 36 Recueillis sur le blog de
la ville de Rouen.
* 37 Choay F.,
L'allégorie du patrimoine, La couleur des idées, Le
Seuil, 1992.
* 38 Sciences
Humaines, « Qu'est-ce que transmettre ? Savoir,
mémoire, culture, valeurs », Hors série n°36,
mars- avril- mai 2002.
* 39 Site
wikipédia.
* 40 Rouen vue par Guy de
Maupassant dans le journal Un Normand.
* 41 Melissinos A.,
« La ville vaut d'être vécue », Urbanisme,
hors- série n°24, mars- avril 2005.
* 42 Choay F.,
op.cit.,1992.
* 43 Actes du colloque
« Des bâtiments au public » organisé par la
Direction générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
construction, Ministère de l'Equipement, des Transports et du logement,
4ème semestre 1998, pp. 96-98.
* 44 Bourdin A., Le
patrimoine réinventé, PUF, Espace et Liberté, 1984,
p.52.
* 45 Desse R.P., Le nouveau
commerce urbain, Presses Universitaires de Rennes, Espace et Territoires,
2001, p.129.
* 46 Dresse R.P., op. cit.,
2001.
* 47 Bourdin A.,
op.cit, 1984.
* 48 Sciences humaines,
op.cit., 2002.
* 49 Rouen Magazine,
« Vue de Rouen, sondage : la ville jugée par ses
habitants », n° 258, du mercredi 31 janvier au mercredi 14
février 2007.
* 50 www.agicom.fr
* 51 « Rouen
Magazine », Cap à l'ouest, réaménagement des
docks, n° 267, du mercredi 6 au mercredi 20 juin 2007.
* 52 Dresse R.P., op. cit.,
2001, p.70.
* 53 Bevort A., Pour une
démocratie participative, Presses de Sciences Po, La bibliothèque
du citoyen, 2002, p.11.
* 54 Observatoire de la
démocratie locale, Bilan 2005.
* 55 Tourraine A.,
Qu'est-ce que la démocratie ?, Fayard, Le Livre de Poche,
1994, p.36.
* 56 Cité par Laurent
C., « Quand Augute Perret définissait l'architecture moderne
au XXe siècle », Revue de l'Art, n°121, 1998,
p.61.
* 57 Adjoint au maire à
l'urbanisme.



