|

DÉDICACE
Je dédie ce travail,
À mon époux, LONGMENE FOPA Arnaud, fidèle
compagnon et proche conseillé, pour tous
ses efforts consentis, son
soutien sur tous les plans ;
À mes Parents, papa TIATSOP Paul et Maman DJEUDEUNE
Valérie, modèle éducateurs
pour les efforts consentis
et la confiance placée en ma modeste personne ;
II
REMMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail n'a été
possible que grâce au concours de plusieurs personnes. Nous tenons
à exprimer nos sincères remerciements :
À notre directeur de mémoire, le Pr TSALEFAC
Maurice qui a bien voulu nous encadrer ce travail malgré ses multiples
responsabilités. Au Dr JULIUS TATA NFOR qui a accepté nous suivre
dans la réalisation ;
Aux enseignants du Département de Géographie de
l'Université de Dschang, les Pr KUETE Martin, NGAPGUE Jean Noël,
YEMMAFOUO Aristide, les Dr NDOKI Désiré, TCHEKOTÉ
Hervé, ÉTAME Soné, DONFACK Oliver, NGOUANET
Chrétien, LÉMOUOGUE Joséphine, ainsi que les enseignants
missionnaires, Pr FOTSING Jean-Marie, Mrs TIENTCHEU Clément, Mrs UMARU
Hassan, NGOU NJOU, KAMKUMO ; donc les cours ainsi que les conseils nous ont
été capitaux pour l'accomplissement de ce travail. Dans une
atmosphère empreinte de convivialité et de proximité, ils
ont su, à travers leurs conseils, leurs critiques et leurs
encouragements, guider nos premiers pas sur le chemin exigeant de la recherche
;
Au Dr MOYÉ Eric pour sa proximité, sa sympathie,
ses conseils et surtout son soutien à notre endroit dans le traitement
des données récoltées sur le terrain ;
Au délégué d'Arrondissement de
l'Agriculture et Développement Rural de Galim ainsi qu'aux responsables
chargés de la météorologie à la station de
Bamendjing qui ont mis à notre disposition les données et les
informations fiables pour la réalisation de cette étude.
Aux chefs traditionnels, les majestés MBEGHANG Samuel
et KETSOBOP Martin pour les informations qu'ils nous ont fourni, sans oublier
le chasseur des pluies Papa VEKOP David pour avoir partagé ses
connaissances et pratiques avec nous.
Aux Cartographes, Gimfack Sadio Stanis, Moyap Kevin dont les
différentes interventions nous ont permis d'avoir les différentes
cartes de la localité.
À mes Beaux-frères, belles-soeurs et
belles-mères respectivement, Papa JOU FOPA Jean Ricard, Maman FOPA
Esther, maman MAYEMFO FOPA Mireille et MASSOUANFO SEGNING Sandrine, qui restent
très présent dans ma vie ;
À mes frères et soeurs, amis et proches,
respectivement TAFOR Berlin, Romeo, Vannelle, Bescherelle ainsi qu'à
tous nos camarades de promotion pour leur soutien moral, le partage
d'expérience et de matériel pour la réalisation de cette
étude.
III
RÉSUMÉ
La localité de Bagam est de nos jours une cible de la
variabilité climatique. Elle figure parmi les localités de
l'arrondissement de Galim, situé au versant Sud des monts Bamboutos
(Ouest-Cameroun). Dominée par les pratiques agricoles, les perceptions
paysannes de cette localité affectent au quotidien leurs
activités. Ces étant notamment liées aux
irrégularités pluviométriques mais aussi à une
hausse de température. Cette problématique nous amène
à nous interroger sur la question de l'influence des perceptions
paysannes sur les pratiques et les croyances sociales et spatiales d'où
l'hypothèse selon laquelle leurs activités dépendent de
leurs perceptions par rapport à la variabilité climatique.
L'objectif de cette étude vise à montrer en quoi les perceptions
paysannes de la variabilité climatique impactent les activités en
milieu montagnard. Pour mieux apprécier les perceptions paysannes de la
variabilité climatique et les influences sur leurs activités, une
enquête semi-structurée à concerner cent personnes
réparties dans dix villages du groupement Bagam. Pour arriver à
ces résultats, nous avons fait appel à une méthodologie
qui a pris en compte quelques approches et techniques. Selon l'approche
qualitative et quantitative, le traitement et l'illustration des données
se sont effectués par les logiciels SPSS, Word, Excel, Map info et
Arcgis. L'effet de cette approche est lié à l'augmentation de la
température, et aux irrégularités pluviométriques
dont la population de Bagam approuve aujourd'hui par rapport au temps
passé que la variabilité climatique est une réalité
dans leur zone par exemple en février 2018, la pluviométrie
était de 91,8mm, 2012 la pluviométrie était de 80,7mm et
une hausse de température qui sévit depuis 2016 à 2018.
Outre, les effets de cette perception de la variabilité climatique ont
poussé ces paysans à faire des pratiques pouvant leurs aider
à surmonter leurs difficultés. Nous pouvons citer entre autre
chasser ou dévier les pluies ; les prières collectives de demande
des pluies à travers les rites traditionnels, modification des dates de
semis, la transhumance, l'utilisation des pesticides, utilisation des semences
résistantes aux mauvaises conditions climatiques, plantation des avocats
greffés. La nécessité de rendre plus accessible et
facilement réalisable les pratiques et croyances contribueront
certainement à rendre durable les effets de ces pratiques d'une part et
d'autres part faciliterait leur diffusion sur l'étendue du territoire.
La sensibilisation des villageois sur la notion du climat contribuerait aussi
à réduire l'implication de ces derniers dans la modification du
climat.
Mots clés : Perception paysanne,
Variabilité climatique, Bagam
XII
ABSTRAT
The locality of Bagam is nowadays a target of climatic
variability. It is amongst the localities of Galim Sub Division located on the
southern flank of Mount Bamboutos, West Region of Cameroon. Dominated by
agricultural practices, this zone has witnessed difficulties related to the
harsh climatic conditions. These difficulties are not only inherent in time and
space, but also in the identification of peasant strategies to face these
climatic problems. This problem has pushed us to the question of taking into
account the perceptions of the village communities in the study of climate from
which the hypothesis according to which climatic variability can also be
studied without the intervention of the measured data, that is to say reporting
the figures of the meteorological situation. The objective of this study is to
document the perceptions of village communities on the notion of climatic
variability. To better appreciate the perceptions of climate variability and
the adaptation strategies put in place, a semi-structured survey involving 100
people distributed in the 10 villages of Bagam was used. To arrive at the
results, we used a methodology that took into account some approaches and
techniques. According to the qualitative and quantitative approach, the
processing and illustration of the data were carried out using SPSS, Word,
Excel, Map Info and Arcgis software. The effects of this approach is related to
the increase of temperature and rainfall irregularities thereby influencing the
population of Bagam to conclude that climatic variability is a reality
especially when compared to the past. For instance, in 2018 rainfall was
91.8mm, 2012 rainfall was 80.7mm as well increase temperatures since 2016-2018.
The effects of this perceptions to climatic variability has influence these
peasants to put in place adaptation strategies such as to hunt or deviate the
rains, a collective traditional rites for the returns of rain, modification of
the planting season, transhumance, the use of pesticides, the use of resistant
seeds on bad climatic conditions. In view of the persistent negative effects of
climate variability, we estimated that that these strategies are insufficient
to combat the effects of climatic variability in the locality. The need to make
these strategies more accessible and easily implemented will certainly
contribute in making the effects of these practices sustainable on one hand, to
facilitate their dissemination over the vast territory. Food insecurity in some
households could be improved.
Key words: Perception, Climate
Variability, Peasant Adaptation, Bagam.
1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
L'étude climatique à l'usage des savoirs
vécus demeure de nos jours une préoccupation majeure pour
l'avenir de l'humanité. Les perceptions qu'avaient les paysans dans le
passé ne sont plus les mêmes dans le temps actuel,
particulièrement dans la localité de Bagam.
Néanmoins, les paysans se sont vus imposé un
rythme non habituel du climat avec des conséquences dans divers domaines
de la vie rurale d'où la question principale est celle de savoir quelle
perception la population locale de Bagam a de la variabilité climatique
en milieu montagnard ? Cette question nous conduit à examiner l'objectif
général qui est celui de documenter les perceptions locales de la
variabilité climatique dans la localité de Bagam.
L'hypothèse générale de cette étude est que les
perceptions paysannes sur la variabilité climatique impacte leurs
activités du quotidien. Ce qui nous a amené à identifier
quatre hypothèses spécifiques vérifiables sur le
terrain.
De ce qui précède, il est question pour nous
dans la première partie de faire un état de lieux sur la
variabilité climatique dans la zone d'étude, ce qui nous
amène à présenter en premier temps les facteurs physiques
et humains favorables à l'étude de la perception climatique puis
présenter en second temps les perceptions locales de la
variabilité climatique. Ensuite, la deuxième partie portera sur
l'opérationnalité des pratiques mise en place par les paysans
pour faire face à la variabilité climatique ainsi qu'une
confrontation entre le climat perçu des paysans de Bagam et les
données mesurées de la station météorologique de
Bamendjin.
I- CONTEXTE DE RECHERCHE
1- Définition du sujet
La notion de perception climatique est mondiale à nos
jours suite aux multiples perturbations du climat, soit par augmentation de la
température soit par sa régression, soit par une abondance ou un
déficit des pluies mais aussi les irrégularités
pluviométriques bref les phénomènes climatiques. De ce
fait chaque communauté à sa façon de percevoir cette
péjoration climatique à travers les stations météos
pour certains et la perception de l'oeil pour d'autres. Ainsi nous avons des
groupes internationaux, continentaux, nationaux, régionaux et locaux qui
font face à la variabilité climatique puis se mobilisent afin de
limiter ces aléas à l'échelle globale.
À l'échelle internationale nous avons la
publication du rapport spécial commandé au Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC) lors de la
Conférence des Nations Unies de décembre 2015 en France (COP21)
qui a accouché de l'accord de Paris sur le climat stipulant une hausse
de 1,5°C des températures. Ce groupement scientifique a pour but
de
2
gérer sereinement les controverses sur la science,
d'établir les consensus ou dissensus sur les questions données et
d'informer les États membres sur l'état de la recherche sur ces
sujets.
L'Union Africaine pense que le continent africain est le plus
vulnérable face à ces phénomènes de
variabilité et de changement climatique. Cette
vulnérabilité s'observe d'une part à travers sa forte
dépendance à l'agriculture pluviale et d'autre part par le
mauvais rendement dont souffre un certain nombre de pays subsahariens.
Au niveau national, le ministère de l'agriculture et le
développement rural du Cameroun stipule que le climat est un facteur
indispensable de production agricole. Ainsi une pluviométrie peu
abondante et des températures extrêmes peuvent entraver ou
stimuler le développement des plantes. C'est le cas par exemple des
régions de l'Extrême-Nord et du Nord qui entre 2001 et 2007
étaient considérées comme les régions les plus
pauvres avec une baisse importante du régime pluvial mais aussi à
un dessèchement des cours d'eau : cas du Lac Tchad. Ceci influence sur
les performances agricoles.
Nous avons aussi le comice agropastoral de 2011 à
Ébolowa où l'État camerounais soulignait l'importance de
l'agriculture rappelant que l'agriculture de deuxième
génération devrait contribuer à l'émergence du
Cameroun à l'horizon 2035. Cependant la maitrise des impacts
négatifs du climat reste un véritable problème.
L'échelle régionale nous ramène sur des nombreuses
études qui ont été faites dans le cadre de la
variabilité climatique et la dynamique des milieux agraires sur les
hauts plateaux de l'Ouest. C'est l'exemple de Tsalefac (1999) qui a fait un
penchant sur la quantité annuelle et interannuelle des pluies en
montrant que la répartition des pluies a un impact sur l'activité
agricole. Ce canal nous amène directement dans la localité de
Bagam où nous nous sommes engagés d'analyser l'idée qu'ont
les paysans sur le climat local de Bagam depuis plusieurs années.
2- Justification
Le climat n'est pas qu'une série de chiffres mais bien
une impression qui est ressentie. Le village Bagam est à cet effet une
zone à dominance agricole (culture vivrière, maraichers, de
rente, l'élevage porcine, élevage des chèvres...). Deux
raisons nous ont conduits au choix de notre sujet à savoir les raisons
économiques et scientifiques.
Sur le plan économique, il faut rappeler que le village
Bagam est bien connu comme une zone de forte production agricole. Qui dit
production agricole dit équilibre climatique et une bonne maitrise de la
variabilité climatique. Notre souci est donc de mesurer le rôle du
climat, ou mieux de comprendre l'effet de la perception paysanne de la
variabilité climatique sur la productivité, le système
animal et végétal.
3
Sur le plan scientifique, il s'agit pour nous d'un
élément de curiosité afin d'accomplir une mission dans la
recherche scientifique étant donné notre proximité avec le
village Bagam pour y avoir grandi, j'ai eu cette envie d'y faire des recherches
sur les perceptions climatiques en m'inscrivant dans la filière
géographie à l'Université de Dschang. Ce sujet
présente divers intérêts à savoir
l'intérêt économique, climatique et environnement, social
et politique
L'intérêt climatique et environnemental
réside au fait qu'il est judicieux de dire que l'étude du climat
local du village Bagam permettra à une prise en compte des suggestions
des paysans et de leurs stratégies. Aussi, le respect des normes
environnementales serait profitable si on sensibilise la population locale dans
le cadre de la lutte contre la dégradation du cadre de vie en limitant
la déforestation, les feux de brousse qui contribuent d'une
manière ou d'une autre à la variabilité climatique
locale.
Sur le plan économique, ce sujet a une portée
économique parce que à partir du moment il y'aura sensibilisation
de la population à une adaptation face à la péjoration
climatique et au calendrier des activités mais aussi une
amélioration des rendements dans différents secteur
d'agriculture, ceci contribuera à l'augmentation du PIB tant à
l'échelle d'arrondissement, départementale que nationale.
Sur le plan socioculturel, il est tout à fait clair que
ce sujet est intéressant dans la mesure où lorsqu'il y'aura une
sensibilisation efficace, la société profitera des
méthodes mises en place pour étudier le climat sans
l`intervention des données issues de la station
météorologique autrement dit l'apport des techniques paysannes
dans l'adaptation à la variabilité climatique. De ce point de
vue, la population locale se sentira motiver d'être l'un des acteurs
contribuant à la mise en place des stratégies pour faire face
à la variabilité climatique.
Sur le plan politique, ce sujet a une portée politique
dans la mesure où la lutte contre la variabilité climatique
locale par cette population contribue à la lutte contre les changements
climatiques à l'échelle nationale puis démontre
l'efficacité des politiques étatiques face au climat.
2-Délimitation spatiotemporelle
a-Délimitation spatiale
L'espace concerné par notre étude est celui qui
couvre le groupement Bagam. Cette localité est en effet située
dans l'Arrondissement de Galim, département des Bamboutos, Région
de l'Ouest. C'est un Groupement de 107 chefferies de troisième
degré, couvrant environ 291 km2 de superficie et qui partage
ses frontières avec plusieurs chefferies des Régions de l'Ouest
notamment les chefferies Bamessingué, Bamenyam, Bamendjing, Bati,
Bamesso, Bamendjida et Bamenkoumbo et du Nord-Ouest parmi lesquelles Baligam,
Baligashu, Balikumbat, Bafandji). Son profil démographique,
socio-économique et environnemental montre un potentiel important
4
en ressources naturelles (ressources en eau, ressources
halieutiques, minières, agricoles, touristiques, etc.), mais une
détérioration continue des conditions culturelles,
socio-économiques et environnementales (Plan de Développement
Local de Bagam)
Sur le plan géographique, Bagam s'étend entre
10°15'0» et 10°25' 0» de longitude Est ; et entre 5°
25' 0» et 5° 40' 0» de latitude Nord. D'après les points
cardinaux, Bagam est limité au Nord par Ngoketundja, au Sud par
Bamenkoumbo, à l'Ouest par Bamenyam enfin à l'Est par Bamendjing
(Plan de Développement de Local de Bagam)
b-Délimitation temporelle
La période de notre étude va du passé au
temps présent ; c'est-à-dire de 1960 à 2018. Pour mener
à bien notre étude nous nous sommes rapprochés à la
station météorologique de Bamendjing afin d'entrer en possession
des données factuelles. En effet les données que nous avons
obtenues sont des données pluviométriques, les
températures Maxima et Minima, les données d'évaporation
et d'évapotranspiration allant de 2007 à 2018. Outre nos
données sont constitués en fonction du temps, c'est-à-dire
nous nous sommes documentés auprès de la délégation
départementale d'agriculture des Bamboutos puis nous avons eu les
rapports trimestriels des activités de la DDADER de Galim notamment des
années 2012, 2016, 2017 et 2018. Donc les données pouvant
permettre la réalisation de cette étude se situe entre 2007
à 2018.
II- PROBLÉMATIQUE
L'étude du climat avec les chiffres donne l'impression
que les savoirs locaux c'est-à-dire les paysans avec diverses
indicateurs ne peuvent pas via les expériences du passé, faire
ressortir la connaissance et l'évolution du climat dans les zones
montagnards. Depuis plusieurs décennies le Cameroun fait face à
la variabilité climatique. Face à cet état de chose, nous
nous sommes penchés dans le village Bagam afin de comprendre la
perception des populations face à cette notion de «
variabilité climatique » ; mais le constat fait est qu'avant les
paysans de Bagam avaient une pensée positive sur le climat, de nos jours
leurs intervention sont négatives.
La pensée négative qu'à la population de
Bagam face au climat se traduit ici par les pratiques sociales et spatiales.
Ceci dit, le réel problème de cette recherche est que les
perceptions que la population de Bagam a du climat influence les
activités sociales et spatiales. Autrement dit le regard porté
par les paysans sur l'évolution du climat impacte sur leurs pratiques et
leurs croyances.
Pour mesurer le degré des savoirs locaux sur la
variabilité climatique nous nous sommes posé comme question
principale celle de savoir : Quelle est l'influence des perceptions
paysannes de la variabilité climatique sur les pratiques sociales et
spatiales en milieu montagnard ?
5
En d'autres termes dans quelle mesure les perceptions
paysannes sur l'évolution du climat ont une influence sur leurs
pratiques et leurs croyances au quotidien ?
Après cette question principale découle plusieurs
questions spécifiques :
- Quels sont les facteurs physiques et humains permettant
d'étudier le climat de cette localité ?
- Quelles perceptions ont les paysans sur la variabilité
climatique dans la localité de Bagam ? - Quel est
l'opérationnalité des pratiques et les croyances paysannes face
à la variabilité climatique?
- Quel est le rapport du climat perçu avec les
aléas climatiques ?
III- REVUE DE LA LITTÉRATURE
Dans le cadre de ce travail, plusieurs ouvrages, articles et
mémoires scientifiques ont été consulté.
1-Percetion paysanne
Parlant des perceptions des paysans sur cette notion de
variabilité climatique, TIDJANI et AL (2016) ont réalisé
une recherche sur les « Perceptions de la variabilité climatique et
les stratégies d'adaptation dans le système Oasien de
Gouré au Sud-Est du Niger » où il ressort les perceptions au
niveau des précipitations et températures en montrant ces effets
sur les ressources végétales, ressources en sol et enfin les
stratégies d'adaptation. Il faut relever que cet auteur à
certains points de convergences avec notre travail et des points de
divergences. Les points de divergences notamment au niveau des
éléments qui favorise l'étude des perceptions locales de
la variabilité climatique, mais aussi la confrontation de ces
perceptions aux données météorologiques afin
d'évaluer leur niveau de corrélations.
En 2013 à Paris, lors d'une conférence le BGRM a
organisé une journée scientifique portant sur « la
perception du changement climatique » il pense que les sciences sociales
sur la perception du changement du climatique et ses impacts tels que
perçus à l'échelle individuelle mettent en évidence
des différences en fonction des contextes socioéconomiques et
culturels.
Les études d'AXA/IPSOS en 2012 stipulent que pour mieux
comprendre la perception mondiale des risques liés au changement
climatique, AXA a sollicité l'Institut IPSOS, afin de mettre en place
une étude d'opinion internationale sur les risques climatiques. En
interrogeant par internet plus de 13000 personnes âgées de 18 ans
et plus résidant dans 13 pays du monde sur 3 continents.
DOUMBIA et DEPLEU (2013) ont travaillé sur «
Perception paysanne du changement climatique et les stratégies
d'adaptation en riziculture pluviale dans le centre ouest de la côte
d'Ivoire » où ils analysent la compréhension du paysan de la
notion du changement climatique
6
dans la production du riz dans le département de Daloa.
Ils révèlent que l'impact le plus net en riziculture pluviale est
rattaché à la forte variation interannuelle et la faiblesse des
rendements obtenues.
La perception des perceptions des effets de l'érosion,
FOTSING JM (1993) a travaillé sur l' « Érosion des terres
cultivées et propositions de gestion conservatoire des sols en pays
Bamiléké » où il souligne que la pluie est le
principal agent qui menace de plus en plus les terres agricoles du pays
Bamiléké. Ce travail se situe dans les exemples d'érosion
enregistrés à Bagam où l'origine est liée est forte
pluie du passé
JEAN BOSCO et Al (2016) ont travaillé sur l'
«Agriculture paysanne et stratégies d'adaptation au changement
climatique au Nord-Benin » l'étude de ces travaux
s'intéressent à la compréhension des stratégies
développées par les producteurs en situation de changement
climatique, de ses effets perceptibles dans le paysage agraire et les mesures
mises au point pour y faire face. Il ressort que l'utilisation des moyens de
productions est raisonnée pour tenir compte des risques mais aussi une
autre voie d'adaptation explorée par les producteurs est basée
sur le développement de nouvelles activités agricoles pour tenter
de répartir les risques et/ou s'adapter aux nouvelles conditions de
productions, pratique de l'élevage par les agriculteurs.
DENANGAN et Djibril (2016) ont mené des études
sur la « variabilité climacique et les stratégies
d'adaptation en zone pastorale au Sénégal : Expérience de
la ferme agricole de Guelakh-Peulh » au sortir de cette étude, les
changements climatiques étant un fait réel partout dans le monde,
les populations de Guelakh-Peulh ont mis sur pied plusieurs stratégies
notamment la construction des puits modernes pour la disponibilité
permanente à l'eau, la culture fourragère pour le bétail,
l'agroforesterie et l'utilisation du compost pour restaurer la fertilité
des sols.
TIDJANI et AKPONIKPE (2012) ont réalisé un
travail sur « Évaluation des stratégies paysannes
d'adaptation aux changements climatiques : Cas de la production du maïs au
Nord-Benin ». Pour eux, l'évaluation sous ces scénarios des
méthodes paysannes d'adaptation aux changements climatiques
sélectionnées permet de recommander l'adoption des
variétés améliorés à un cycle court de
maïs et déconseiller : la pratique de semis tardifs à la
fois pour la variété locale et améliorée de
maïs et la réduction de la densité de semis tous
scénarios confondus, les densités appliquées étant
déjà propices pour faire face aux variations climatiques
actuelles dans la commune.
2- La variabilité climatique mesurée en milieu
montagnard
Sur la question de la variabilité climatique, YUFENYUY
(2016) a travaillé sur « le rôle des variabilités
climatiques dans l'émergence du paludisme et autres pathologies dans la
localité de
7
Kumbo au Nord-Ouest du Cameroun ». Dans ce travail, il
perçoit la variabilité climatique dans le Kumbo comme celui qui
contribue à la croissance de l'épidémie du paludisme. Il
met en évidence le rôle de la variabilité du climat et
d'autres pathologies dans le Kumbo. Aussi le rapport de l'hôpital
Baptiste de Banso (HBB) en 2014 montrait que plus de 30% des patients est
dû au paludisme particulièrement les enfants et les femmes, mais
les femmes sont les plus affecté par cette pathologie.
Dans la recherche de FONING (2016) portant «
variabilité climatique et impact sur les exploitations agricoles
paysannes : le versant Est des monts Bamboutos (Babadjou) », il montre
qu'à partir des années 2000, on a assisté à une
baisse sensible de la production dû à la variabilité
climatique. Il se justifie en ceci que pour certains, la variabilité du
climat se manifeste en l'occurrence de nombreux séquences sèches
qui s'étendent parfois sur de très longues périodes
à l'intérieur des périodes humides (périodes de
culture). Il résulte que les cultures s'assèchent et que les
paysans sont obligés de ressemer parfois. De même, on observe un
prolongement inhabituel des pluies qui est à l'origine de la pourriture
des récoltes. Pour d'autres, les saisons sèches sont anormalement
longues ou courtes, perturbant ainsi le calendrier agricole. Il stipule aussi
que pour les paysans, ces perturbations sont attribuées à des
faits maléfiques, ou non-respect de la coutume ; d'où de
nombreuses cérémonies sacrées qui sont organisées
pour implorer la pitié des dieux.
En milieu tropical d'altitude, plusieurs associations
internationales et gouvernementales se sont réunies autour de cette
question. Ainsi le GIEC (2007) estime que l'Afrique est le continent le plus
vulnérable à la variabilité climatique et la situation est
croissante à travers la combinaison de plusieurs stress à
différents niveaux de L'UA en 2014 pense par rapport à ses
prévisions relatives à la variabilité et au changement
climatique que le monde connaitra une augmentation de 2°c au cours des
deux prochaines décennies (2011-2020) et (2020-2030). Il stipule aussi
que l'Afrique connaitra très probablement un réchauffement au
cours de ce siècle et il sera susceptible d'être plus fort que le
réchauffement global en toute saison avec le réchauffement des
régions sèches subtropicales plus humides.
IV- CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE
Cette revue de littérature nous oblige à sortir
des approches générales et englobantes pour une étude
spécifique. La pertinence de ce sujet mérite une explication des
concepts comme perception et variabilité climatique.
1-Perception
La perception est l'action de saisir, de comprendre, de
représenter ou d'interpréter des phénomènes par
l'esprit ou par le sens. La perception paysanne des phénomènes
climatiques peut
8
être définie donc comme la façon des
paysans de comprendre, de représenter ou d'interpréter les
changements du climat qu'ils observent.
Ce concept tire son origine du vocable latin « perceptio
» et se rapporte à l'action et à l'effet de percevoir
(recevoir au moyen de l'un des sens les images, les impressions ou les
sensations externes, ou comprendre et connaitre quelque chose).
Elle désigne aussi l'ensemble des mécanismes et
des processus par lesquels l'organisme prend connaissance du monde et de son
environnement sur la base des informations élaborées
par ses sens, elle a généralement
une fonction cognitive d'interprétation des informations
sensorielles. Le Dictionnaire Larousse, définit la
perception comme l'action de percevoir par les organes de sens. C'est aussi
l'idée, la compréhension plus ou moins nette de quelque chose.
Les
théories de la perception s'organisent en fonction des
réponses qu'elles apportent à trois grandes questions bipolaires
: La question de l'inné et de l'acquis, la question du rationalisme ou
de l'empirisme, la question du globalisme ou de
l'élémentarisme.
Plusieurs auteurs ont utilisé ces théories.
Ainsi, Pour des auteurs comme JOHN L, WILLIAM J, GEORGE B, DAVID H, CLARK ou
Donald H, les perceptions sont apprises et
résultent de l'expérience et d'apprentissages.
Pour d'autres comme BARUCH S, EMMANUEL K, EWALD H, JOSEPH M, les gestaltistes
ou GIBSON, elles sont essentiellement automatiques et résultent de
capacités innées. Pour beaucoup de ces derniers, la perception
est une réponse passive, qui reflète plus ou moins directement la
structure de la stimulation.
Selon MERLEAU-PONTY, PASCAL D (2007), la perception
désigne un « contact naïf avec le monde » que la
philosophie à la tâche de « réveiller », en
remontant en déca des
constructions, et des idéalisations de la science, en
déca même des convictions de l'attitude naturelle, afin de
critiquer, de rectifier, de refonder les significations fondamentales qui
régissent notre intelligence de l'être et même
l'accès à notre propre être.
La théorie proposée par DAVID M. distingue trois
ordres de représentations extraites des informations sensorielles :
l'esquisse primitive, la représentation à 2,1 /2, la
représentation 3D. Seule cette dernière implique un accès
à la signification des objets.
L'esquisse d'une conception de la perception comme traitement
de l'information Les informations extraites par les mécanismes
sensoriels sont spécifiques de quelques caractéristiques de la
stimulation et par là restent fractionnées.
Tableau 1: Schéma conceptuel de la
perception
|
CONCEPT
|
DIMENSION
|
COMPOSANTE
|
INDICATEUR
|
|
|
Géomorphologique
|
-Erosion
-Glissement de terrain
|
9
PERCEPTION
|
PHYSIQUE
|
Biogéographique
|
-Extinction de certaines espèces
végétales
-Apparition de certaines espèces d'insectes et les
espèces de plantes -Développement de certaines maladies
liées aux animaux
|
|
Hydrologique
|
-Fréquence de sècheresse agricole -Fréquence
de sècheresse météorologique
-Fréquence des inondations -Fréquences de
sècheresse hydrologique
|
|
ANTHROPOGENIQUE
|
Anthropologique/ Culturelle
|
-Changement de système ou technique ancestral de culture
-Migration ou mobilité -Offrande aux dieux avec les sacrifices des
animaux -financement des rites par la communauté villageoise
|
|
Socioéconomique
|
-Perturbation du calendrier agricole -Réduction des
rendements -Augmentation de la productivité à travers les
pesticides
-Réduction des revenues de production
-Fluctuation des prix de certains produits agricoles sur le
marché -Taux de production en tonne par kg dans le temps et l'espace
-Nombre de non-migrants climatique dans le temps et l'espace
|
2- Le concept de « variabilité climatique
»
Le climat désigne l'ensemble des
phénomènes météorologiques qui se produisent
au-dessus d'un lieu dans leur succession habituelle. Cette définition
s'apparente à celle du climatologue Max Sorre qui le définit
comme étant l'ambiance atmosphérique au-dessus d'un lieu dans
leur
10
succession habituelle. Le climat se distingue également
selon ces régions (équatoriale, tropicale,
tempéré). De nos jours à cette notion de « Climat
» s'est ajouté à celle « Variabilité » et
de « Variabilité climatique ».
La variabilité d'un phénomène
désigne le changement de celui-ci. Cette variabilité est souvent
prévisible ou connue à l'avance. La variabilité climatique
se définit comme étant la variation de l'état moyen du
climat à des échelles temporelles et spatiales. Autrement dit,
c'est la variation naturelle intra et interannuelle du climat. Elle est une
caractéristique inhérente du climat qui se manifeste par les
différentes entre les statistiques de long de terme des
éléments climatiques (pluies, température,
humidité, durées des saisons) calculées pour des
périodes différentes. La variabilité du climat est souvent
perçue à travers l'irrégularité des
paramètres climatiques dans leur évolution.
De nombreux auteurs se sont prononcés sur ce terme. Il
s'agit de l'OMM (2013), Besant et Al (2007), AMANI M, MENDANCA(2004) et le GIEC
(2007) qui pensent la variabilité climatique est une fluctuation
saisonnière et interannuelle du climat parfois péjorative qui se
manifeste par un retard de pluies et le prolongement de la saison sèche
ou souvent par le prolongement de la saison des pluies et le raccourcissement
de la saison sèche.
Ce concept a été vite perçu par la
majorité des paysans lors de l'enquête de terrain ceci dû au
fait qu'ils connaissent des perturbations au niveau des retours de pluies et la
température qui devient de plus en plus élevé pendant la
saison pluvieuse conséquence terme variabilité climatique
certains l'attribuant à la sorcellerie et d'autres à un
phénomène naturel.
Tableau 2: Schéma conceptuel de la
variabilité climatique
|
CONCEPT
|
DIMENSION
|
COMPOSANTE
|
INDICATEUR
|
|
VARIABILITÉ CLIMATIQUE
|
Spatiale
|
Mauvaise répartition des
pluies
|
-Variabilité du nombre de jours
pluvieux
-variabilité des séquences pluvieuses
|
|
Intensification zonale des
températures extrêmes
|
-Variabilité des Séquences sèches
-Variabilité des saisons
|
|
Temporelle
|
Pluviométrie
|
-Les pluies journalières
-Ecart pluviométrique mensuel -Ecart pluviométrique
annuel -Ecart Pluviométrique inter annuel
-Ecart pluviométrique intra et inter
saison
|
|
Température
|
-Température journalière
-Ecart mensuel des températures -Ecart annuel des
températures -Ecart inter annuel des températures
|
11
|
|
|
Différents modes d'interprétation de la
|
|
Socioculturelle
|
Perceptions paysannes
|
variabilité climatique par les paysans
|
3-Pratique paysanne
Les activités agricoles, spécialement les
productions végétales, assurent une part
prépondérante de l'alimentation et des revenus des membres de
l'exploitation. Une analyse de la gestion des parcelles de culture par les
personnes vivant dans les unités de production permet de comprendre les
pratiques agricoles actuelles. Au Sénégal par exemple plusieurs
facteurs concomitants sont intervenus de manière décisive dans
les évolutions des pratiques agricoles par les paysans notamment la
généralisation de la culture attelée dans l'ensemble du
Sénégal et plus globalement l'incidence du programme agricole et
de la nouvelle politique agricole ; la détérioration des
conditions pluviométriques durant les vingt dernières
années ; la pression foncière liée au croit
démographique ...Dans la poursuite, les principaux changements
intervenus dans les pratiques agricoles depuis la fin des années
soixante intègrent non seulement l'évolution des techniques et de
l'organisation du travail, mais ils s'évaluent également en
fonction de la productivité du travail et de la terre ainsi que des
indicateurs d'évolution du milieu. Cette mise en perspective
apprécie la capacité d'adaptation et d'innovation de la
population agricole et pastorale, dans un contexte difficile. Etant
donné que la variabilité climatique est visible partout dans le
monde particulièrement en Afrique et surtout à Bagam, les paysans
pratiquent au quotidien des techniques visant à atténuer les
effets de celle-ci.
Tableau 3: Schéma conceptuel
des pratiques et croyances paysannes
|
CONCEPT
|
DIMENSION
|
COMPOSANTE
|
INDICATEUR
|
|
PRATIQUES ET CROYANCES PAYSANNES
|
Climatique
|
Excès de pluies
|
Faire appel à un chasseur de pluies
|
|
Excès de chaleur
|
S'abriter à l'ombre
|
|
Socioéconomique
|
Pratique paysanne
|
Exécution des rituelles par des danses et les chansons
dans les lieux sacrés
|
|
Matériel du rituel
|
Financement des rites par la communauté villageoise
|
|
Culturelle
|
Croyances ancestrales
|
-Collecte des semences par les chefs traditionnels
-Interdiction de semer avant les rituels
-L'arrivé des pluies après le rite
exécuté
|
|
Adoration des lieux
sacrés
|
-offrandes aux dieux (sacrifices des animaux)
-Exécution des danses
traditionnelles
|
|
Anthropique
|
Migration/
|
-Transhumance
|
12
|
|
Mobilité
|
-raison d'étude
|
|
Espace
|
Espace de culture
|
-l'irrigation des champs -Drainages des parcelles
|
|
Temps
|
Température
|
-Usage des engrais apportant un surplus d'eau suite à un
stress hydrique
|
|
Précipitations
|
Utilisation des produits
phytosanitaires
|
|
Planifié
|
Production agricole
|
-Planification des activités
agricoles en fonction de l'offre climatique
-La pratique des cultures contre saison
|
|
Programme
|
-Modification du calendrier
agricole
-Choix des cultures résistantes aux conditions du
milieu
|
VI-OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
1-Objectif principal
Notre objectif général de recherche est de montrer
en quoi les perceptions paysannes de la
variabilité climatique influencent les pratiques sociales
et spatiales en milieu montagnard
2- Objectif spécifique
Nous en déclinons plusieurs objectifs spécifiques
:
- Etayer les facteurs physiques et humains
permettant d'étudier les perceptions climatiques à
Bagam
- Comprendre les perceptions paysannes sur
l'évolution du climat de Bagam
- Montrer l'opérationnalité de ces
pratiques et croyances dans la localité de Bagam
- Montrer que le climat perçu à
Bagam est en lien avec les aléas climatiques
VII-HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE
1-Hypothèse principale
Les pratiques ou des activités sociales et spatiales
dépendent des perceptions paysannes de la
variabilité climatique
2-Hypothèse spécifiques
- Il existe plusieurs facteurs physiques et
humains ayant permis l'étude de la perception
climatique.
- Le climat perçu par les paysans a un
impact sur leurs activités au quotidien.
- Face à cette péjoration climatique certaines
pratiques et croyances paysannes sont
opérationnelles
- Le climat perçu par les paysans à Bagam est
lié aux aléas climatiques
13
VIII-MÉTHODOLOGIE
1-Enquête préliminaire et
questionnaires
Notre enquête s'est basée sur des dimensions
qualitatives et quantitatives, réalisé particulièrement
pour les enquêtes préliminaires en novembre 2018, puis
l'enquête par questionnaire en avril 2019 effectués au niveau de
10 villages du groupement Bagam à base d'un questionnaire semis
structuré. Il est à noter que le choix des villages enquête
s'est fait en tenant compte des réalités notamment dans les
domaines social, agricole, écologique de Bagam. Cette démarche,
nous ouvre la voie sur une perception des effets de la variabilité
climatique et les mesures d'adaptation paysannes mise en place. Le site
d'enquête effectué dans les villages sont illustrés dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 4: Répartition de l'échantillon
enquêté par Village
|
Village
|
Personnes enquêtés
|
|
Menfoung
|
10
|
|
Kiéneghang
|
11
|
|
Mbévé 2
|
10
|
|
Bagam chefferie
|
10
|
|
Galim centre
|
15
|
|
Tata
|
10
|
|
Menghoh
|
8
|
|
Tsinégark
|
8
|
|
Tsisap
|
10
|
|
Barfack
|
8
|
Le tableau 4 est un échantillonnage aléatoire de
paysan enquêtés ce qui nous a permis à un moment
donné d'aller vers les personnes cibles. Cependant le critère de
choix a été appesanti sur l'âge, le sexe et
l'activité socioprofessionnelle. Cet échantillon de 100 personnes
est composé de 50% des agriculteurs, 20% des
agriculteurs/éleveurs, 17% des traditionnalistes, 10% des
éleveurs nomades et 3% des chasseurs de pluies. Dans cette étude
la représentativité de la femme a été à
l'ordre de 23% avec un âge moyen de 35 ans accompagné d'un taux
d'instruction de 3%. L'ampleur observée dans chaque village nous a
amené à choisir le ratio de 8, 10, 11 et 15 personnes partant
d'un village à l'autre.
De même, il faut souligner qu'au niveau de
l'étude de cette variabilité et ses stratégies, la tranche
d'âge de personnes enquêtées concernait des personnes allant
de 30 à 70 ans. Les raisons de ce choix sont que les personnes de la
trentaine lors de l'étude, ont une idée par rapport à la
pluviométrie et température du passé alors les personnes
âgées entre 60 à 70 ans sont des personnes pouvant
données de l'information claire aux changements environnementaux.
14
2- Les entretiens
Les entretiens ont été également une voie
susceptible de nous aider dans la réalisation de cette recherche. Ces
entretiens se sont tenus dans le groupement Bagam notamment avec le
délégué d'arrondissement de l'agriculture et du
développement rural de Galim, les chefs traditionnels et leurs notables,
les grands exploitants, le chef de service de la météorologie de
Bamendjing ainsi que les grands exploitants agricoles de Bagam. Les chasseurs
des pluies, et les éleveurs nomades afin de mieux croiser les
données recueillis et préciser les grandes périodes de
rupture. Au sortit de ces entretiens, nous avons retenu que la
variabilité climatique est une réalité de nos jours, au
quotidien il adopte plusieurs mesures pour y faire face.
3-Traitement et représentations des
données
Cette partie implique non seulement l'utilisation des
logiciels tels que : Spss, Arcgis, Excel et Word, mais aussi l'utilisation de
l'appareil photographique, les données sous formes de tableaux et
graphiques à travers Excel et Word étaient également
incontournables. Comme tel, l'ensemble des données recueillies sont
élaborées dans les tableaux. Les statistiques de la population
sont résumées sur les graphiques et les tableaux.
Pour calculer la corrélation entre la production
agricole et les données climatiques telles que la température et
la précipitation. Nous avons utilisé la corrélation de
Pearson. Pour le faire, on procède par chercher les valeurs de Z pour X
et Y.
X--Paramètres climatiques (température et
précipitation) alors que Y-- à la production de maïs. La
valeur Z est calculée à travers la formule suivante :
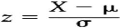
X : Paramètres climatiques
u : Moyenne
Ô : Ecart type
Après avoir calculé la variable Z, nous avons
procédé par le calcul de la corrélation de
Pearson, qui est une corrélation entre deux variables
quantitatives définit par :
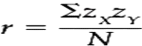
N : nombre d'année
considéré
r : varie entre 0 et 1
Remarque : lorsque la valeur r--1, c'est qu'il y'a forte
corrélation entre les variables. Mais si r--0, cela prouve que la
corrélation entre les variables est faible. Pour déterminer la
contribution des variables climatiques dans le changement de production
agricole, on a procédé par calculer la corrélation de
détermination r2 d'où la
proposition=r2*100.
15
4-Difficultés rencontrée et
résolutions lors de la recherche
Au cours de nos investigations, nous nous sommes
confrontés à un certain nombre de difficultés auxquelles
nous avons cherché rapidement les voies de résolution.
-Lors de notre enquête sur le terrain, Bagam
étant une localité encore enclavé, pendant nos
séjours sur le terrain nous avons passé une semaine sans
électricité avec des conséquences possibles sur
l'utilisation de nos appareils ; ce qui a largement influencé nos
enregistrements ainsi que les prises d'image.
- L'autre difficulté résidait au fait que la
plupart des informateurs étaient réticent à
répondre à nos question, estimant que nous étions des
agents de l'État envoyés les espionner ; d'autres nous
identifiaient aux services de renseignement travaillant pour l'armée
étant donné la proximité de notre zone d'étude avec
la région du Nord-Ouest en proie à l'insécurité.
Pour pallier à cela nous avons insisté et expliquer à ces
populations le bien fondé de notre enquête enquêtés
l'importance de cette recherche.
- Nous avons aussi eu des difficultés d'ordre
méthodologiques relatives à la collecte des données sur le
terrain. À cet effet, nous avons eu du mal à avoir des rapports
annuels ou semestriels de Bagam, au niveau de l'arrondissement et même
à l'échelle départementale, au même titre que des
photographies aériennes du passé et du présent ; ce qui ne
nous a point aider lors de la réalisation des cartes.
5- Synthèse de l'étude
Tableau 5 : Synthèse de
l'étude
|
THEME : PERCEPTION PAYSANNE DE LA VARIABILITE CLIMATIQUE
EN MILIEU MONTAGNARD DE LA LOCALITÉ DE BAGAM
(OUEST-CAMEROUN)
|
|
PROBLÈME GÈNÉRAL
|
Les perceptions paysannes sur l'évolution du climat ont
une influence sur les activités et les pratiques sociales et
spatiales.
|
|
Question principale Quel est l'influence des
perceptions paysannes de la variabilité climatique sur les pratiques
sociales et spatiales en milieu montagnard ?
|
Objectif générale
Montrer en quoi les
perceptions paysannes de la variabilité climatique
influencent sur les pratiques et les croyances sociales et spatiales en milieu
montagnard
|
Hypothèse générale Les
perceptions paysannes dépendent des pratiques sociales et spatiales
|
|
Question spécifique
|
Objectif spécifique
|
Hypothèse spécifique
|
16
|
1-Quels sont les facteurs physiques et humains
permettant d'étudier le climat local de Bagam ?
|
-Etayer les facteurs physiques et humains ayant
favorisés l'étude de la perception climatique de Bagam
|
-Il existe plusieurs facteurs qui nous permettant
d'étudier la perception climatique de Bagam
|
|
2-Quel est la situation de la perception
paysanne de la variabilité climatique à Bagam ?
|
-Comprendre les perceptions paysannes sur la variabilité
climatique
|
- Le climat perçu par les paysans a un
impact sur leurs activités du quotidien
|
|
3-Quel est l'opérationnalité de
ces pratiques et croyances face à la variabilité climatique?
|
-Montrer les pratiques et croyances paysannes
face à la variabilité climatique
|
-Face à cette péjoration climatique, les pratiques
et les croyances sont opérationnelles
|
|
4-Quel est le rapport entre le climat
perçu et les aléas climatiques ?
|
-Montrer que le climat perçu par les
paysans est liés aux aléas climatiques
|
-Le climat perçu par le paysan est lié aux
aléas climatiques
|
IX- RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Dans le cadre de cette recherche, le travail a
été structuré en quatre chapitres ainsi qu'il suit :
Le Premier chapitre examine les éléments
physiques et humains qui favorisent l'étude de la perception
climatique.
Le deuxième chapitre analyse les
perceptions paysannes de la variabilité climatique dans la
localité de Bagam. Cette partie consistera de voir le regard de la
population locale de Bagam sur la variabilité climatique puis de faire
une mise en évidence en insistant sur les indices passé et actuel
du climat mais aussi en mesurant l'influence de ceci sur leurs
activités
Le troisième chapitre porte sur
l'opérationnalité des pratiques et croyances face à cette
péjoration climatique
Le quatrième chapitre analyse les
rapports entre le climat perçu avec les aléas climatiques. ll
s'agit pour nous d'établir les liens entre ce qui est dit par les
paysans et les données découlant de la station
météorologique puis des données issues des archives
17
CHAPITRE I : LES FACTEURS PHYSIQUES ET HUMAINS FAVORISANT
l'ÉTUDE DE LA PERCEPTION CLIMATIQUE DANS LA LOCALITÉ DE BAGAM
Introduction
Situé dans l'arrondissement de Galim, Bagam est une
zone où l'activité agricole est crucial en particulier le vivrier
et le maraicher. Qui dit monde rural, dit monde agraire par conséquent
une bonne maitrise des phénomènes climatiques. De nos jours, dans
le groupement Bagam, on observe une perturbation des paramètres
climatiques selon laquelle certains éléments des atouts physiques
et humains favorisent l'étude des perceptions climatique de cette zone.
Ce dérèglement climatique nous amène a
déclaré à la première hypothèse que les
facteurs physiques et humains sont favorables pour étudier les
perceptions climatiques à Bagam. Il sera question pour nous dans ce
chapitre d'insister sur les éléments qui permettent
d'appréhender la notion de perception climatique. Les résultats
obtenus sont les suivants.
I.1. Facteurs physiques de la localité de Bagam
Il s'agit ici de mettre en exergue les différents
éléments physiques qui sont favorables dans l'étude des
perceptions.
I.1.1. Situation de la zone d'étude
Administrativement, le Groupement Bagam est situé dans la
Région de l'Ouest Cameroun, Département des Bamboutos,
Arrondissement de Galim. Localisé au Nord-Ouest de la ville de Mbouda
(chef-lieu du Département des Bamboutos), il couvre une superficie
estimée à 291 km2 et partage ses frontières
avec plusieurs Chefferies des Régions de l'Ouest (Bamessingué,
Bamenyam, Bamendjing, Bati, Bamesso, Bamendjida et Bamenkoumbo) et du
Nord-Ouest dont (Baligam, Baligashu, Balikumbat, Bafandji) (Plan de
Développement Local de Bagam). Géographiquement, Bagam
s'étend entre 10°15'0» et 10°25' 0» de longitude Est
; et entre5° 25' 0» et 5° 40' 0» de latitude Nord (Plan de
Développement Local de Bagam) : figure18.
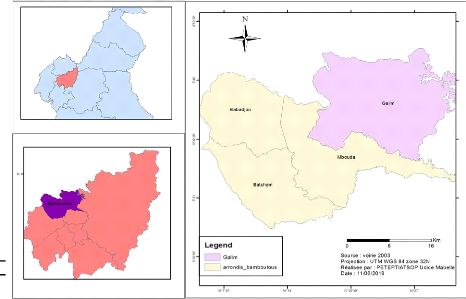
.
S
F
I.
18
D'après le PDL, Le climat de Bagam est du type
camérounien d'altitude : une courte saison sèche de novembre
à février et une longue saison de pluies de mars à
novembre. La température moyenne annuelle est d'environ 20°C, ce
climat est très influencé par la chaine des Monts Bamboutos qui
culminent à 2740m. Ce qui amène le MINADER a
déclaré que « Le climat est un facteur indispensable de
production agricole ». D'après l'enquête de terrain la
population de cette zone distingue en leur langue locale deux saisons
climatique :
a-« Ghab mbun »ou saison
pluvieuse
Le « Ghab mbun » est
Caractérisé par une longue saison pluvieuse qui va de mi-mars
à mi-novembre. Cette période constitue pour eux une
période où le dur labeur commence c'est-à-dire chacun se
bat pour ces activités champêtres afin d'être pleinement
à l'aise pendant le «Ghab
zièhkoukh » pour qualifier la saison de famine pour certains
qui est généralement vécu au mois d'avril, mai, juin. Ce
climat est très pluvieux par conséquent elle est qualifié
d'un climat tropical humide. La pluviométrie est de l'ordre de 1700
à 2000 mm d'eau par an.
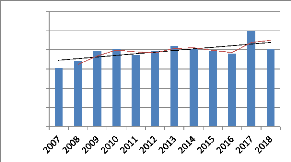
3000,00
R2 = 0,4468
y = 42,194x + 1684,8
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
19
Source : Station météo Bamendjing,
2019
Figure 2 : Précipitation interannuelle de
Bagam (2007-2018)
La variation interannuelle observée sur la figure 19
(2007 à 2018) présente les différentes années de
pluie. Il ressort qu'à Bagam la quantité de pluies reçues
en 2017 est de 2484,89 mm tandis que 2007 avaient enregistrés une
quantité de pluies de 1520,10 mm. Il faut aussi noter que de 2007
à 2018 la pluviométrie n'est pas médiocre, ce qui
permettait une pratique agricole sans aucune difficulté, mais davantage
on note ces variations annuelles de pluies. Nous allons nous intéresser
sur les précipitations mensuelles des pluies de 2007 à 2018.
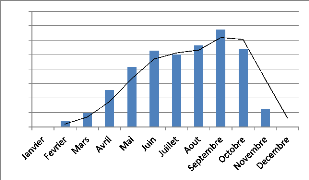
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0 21
48
127,5
206,7
263 249,6
282
336,6
268,5
62
0
Source : Station météo Bamendjing,
2019 Figure 3 : Variation Mensuelle des précipitations en 2011
à Bagam
La figure 3 nous montre l'évolution mensuelle des
pluies à Bagam en 2011. Suite à cela nous pouvons dire que les
pluies varient de 0 à 336,6 mm/mois. De même la seconde
observation est que ces pluies sont inégalement réparties en ce
sens que les mois de Juin (263mm), Aout (282mm), Septembre (336,6mm) et Octobre
(268,5mm) reçoivent assez de pluie par contre Février et Mars
enregistrent une pluviométrie à quantité insuffisante de
pluies.
b) « Ghab Né yob » ou saison
sèche
20
Le « Ghab né yob» c'est-à-dire saison
sèche est la saison la plus courte de l'année allant de
mi-Novembre à mi-Mars donc elle dure 03mois. A Bagam cette
période est consacrée pour eux au «pohk counk
» (tapé le haricot), « kwah fack »
(défrichage) et le «fack garden » (faire le garden
notamment le maraichers).
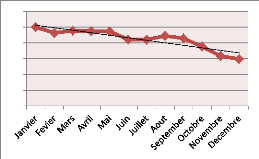
30
25
20
R2
15 = 0,8041
10
0
5
y = -0,7965x + 26,369
Source : station météo Bamendjing
2019
Figure 4 : Évolution des
températures mensuelles en 2011 à Bagam
.
Dans la figure 4, il ressort que de 2007 à 2018 la
température annuelle varie entre 15 à 25°C.
On observe que Décembre est le mois de l'année
qui détient une faible température égale à
15°c par contre Janvier regorge une température plus
élevé égale à 25°C. De nos jours on constate
que cette température est plutôt accrue.
I.1.3. Le relief et sol en plein dégradation
L'altitude moyenne est de 1.100 m. Le relief se compose
principalement de plaines alluviales, de vallées hydro morphes et de
montagnes arrondies. Les sols du Groupement Bagam sont pour la plupart
d'origine volcanique et comptent parmi les plus fertiles du Département.
Il existe aussi des sols ferralitiques de nature basaltique, des sols hydro
morphes dans les bas-fonds couverts de raphia. Ces sols sont propices aux
cultures maraichères, une activité à succès de ce
groupement. Mais ce sol est exposé de nos jours à une
dégradation.
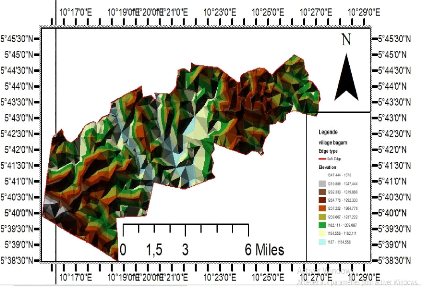
21
FF
Source : Laboratoire de Cartographie, 2019 Figure
5 : Carte du relief et sol de Bagam
Au regard de la figure 5, il ressort que
l'élévation des pentes du relief de Bagam varient entre 1127
à 1375m. On constate que la majorité espaces de cette zone est
couvert de moyenne montagne, les zones de faible pente ou plaine sont
représentatives à 30% alors que le relief est dominé par
les pentes moyennes variant entre 1209 à 1292m ; c'est l'exemple de la
couleur jaune, orange et rouge foncé présent sur la carte.
- L'hydrographie favorable à
l'irrigation
Un dense réseau hydrographique parcoure le territoire
avec comme principaux fleuves : Noun, Mifi, Mevobo, Megho, Menuzeu, Fondop,
Mongalung et Montse Zegan. En rapport avec le thème de recherche, le
relief de Bagam fait face depuis des décennies au glissement de terrain,
l'érosion. Avec l'hydrographie, on observe le réseau de certain
cours d'eau qui débordait le lit initial du cours d'eau pendant les mois
d'abondances d'eau mais aussi l'assèchement d'autre cours d'eau en des
mois avec déficit d'eau.
I.1.4. Végétation et faune sous l'emprise du
climat et les cultures
Bagam fait partie du grand ensemble formé par la
chaîne des monts Bamboutos, reconnu au niveau mondial comme zone
clé de biodiversité en raison de sa richesse et de son fort taux
d'endémisme floristique et faunistique. La végétation est
constituée de formations sub-montagnardes associées à des
savanes arbustives et herbacées, des forêts raphiales dans les
bas-fonds, les forêts galeries autour des cours d'eaux et des
forêts sacrés conservées depuis des
22
siècles grâce à la tradition. Cette
végétation laisse place en majeure partie à des cultures
vivrières. Les cultures de rente et pérennes, avec notamment le
café, les arbres fruitiers et le kolatier, viennent enrichir cette
végétation. La faune mammalienne est devenue très rares en
raison de la forte poussée démographique.
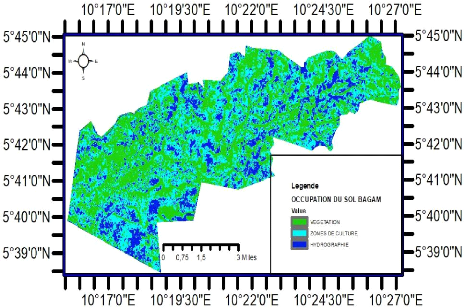
Source : Laboratoire de Cartographie,
2019
Figure 6: Carte de l'hydrographie et de la
végétation de Bagam
La figure 6 est la carte de la végétation et de
l'hydrographie de Bagam. Force est de constater que l'hydrographie est bien
présente dans la zone ceci à travers de multiples cours d'eaux
qui tarissent en saison pluvieuse et s'assèchent en plein saison
sèche. On remarque dès lors que la végétation est
peu abondante mais permet toujours la satisfaction des paysans notamment les
Bororos dans l'élevage bovine.
I.2. Facteurs humains favorisant l'étude des
perceptions climatiques
On sous-entend ici les différents
éléments anthropiques qui participent à l'analyse de la
compréhension de la variabilité climatique depuis ces
dernières années.
I.2.1. Population : cible première de la
variabilité climatique
En tenant compte du dernier recensement général
de la population et de l'habitat de 2005, du taux d'accroissement annuel de la
population et du diagnostic récent conduit dans le cadre de
l'actualisation du plan de développement local, la population de Bagam,
peut être estimée à environ 50 000 âmes avec 48%
d'hommes contre 52% de femme.
23
En rapport avec des personnes enquêtées sur le
terrain, il ressort de la figure 7 que 70% d'hommes contre 30% de femmes ont
été enquêtés. En fonction du niveau d'étude
on note que 65% de personnes se sont arrêtés au cycle primaire,
30% au secondaire et 5% au supérieur. On note que la plupart des femmes
(28%) ont fait que le cycle primaire.
I.2.2. Peuplement en rapport avec la migration
climatique
Bagam, en raison de ses terres fertiles, de
l'hospitalité légendaire de sa population accueille une
diversité ethnique remarquable faisant de ce Groupement un Cameroun en
miniature. Les Menghakas et les Bororos constituent les principaux
groupes ethniques autochtones présents dans les villages de la commune.
Ils cohabitent paisiblement avec de nombreuses autres populations venant de
presque toutes les grandes aires culturelles du Cameroun. Ces Bororos ou
éleveurs nomades installés dans à Bagam
révèlent une perturbation climatique liée à
l'élevage bovine dans cette localité.
I.2.3. Les principales activités sous les caprices
climatiques
Parmi les activités récurrentes que l'on
découvre Dans la localité de Bagam, nous en déclinons
plusieurs selon la profession des paysans.

7%
26%
16%
8%
11%
32%
commerçant agriculteur eleveur agriculteur/eleveur
benskineur fontionnaire
Source : Enquête de terrain
2019
Figure 7 : les principales activités de
Bagam
L'on note à travers la figure 7 que Bagam regorge
plusieurs activités dépendant des fonctions il s'agit des
commerçant qui sont à l'ordre de 8%, les benskineurs avec 7%, les
éleveurs estimés à 11% de personnes, les fonctionnaires,
les agriculteurs, les agriculteur/éleveur. Cependant ce qui retient
notre attention dans le cadre de ce travail est l'agriculture et
l'élevage car ces éléments subissent au quotidien les
effets du climat.
a- L'agriculture
Dans la région de l'Ouest en général et
dans le Département des BAMBOUTOS en particulier le village Bagam est la
destination rêvée pour la pratique de l'agriculture. Cette
activité qui est pratiquée essentiellement de manière
traditionnelle occupe la majeure partie de la population et représente
la source principale du revenu familial.
24
L'agriculture périurbaine est surtout faite des
cultures maraichères. Mais comme l'association des cultures est une
pratique courante dans la région de l'Ouest, l'agriculture
périurbaine est aussi faite de bananiers et des fruitiers qu'on plante
derrière la maison ou un recoin de la cour Les cultures d'exportation
sont représentées par les parcelles de caféiers,
b- L'élevage
L'élevage est essentiellement du type traditionnel. Des
populations de la commune élèvent autour de leurs cases de la
volaille des chèvres et moutons qui sont attachés dans les
parcelles en jachère ou laissés en divagation.
Conclusion partielle
En somme, il était question pour nous dans ce chapitre
de mettre en exergue les différents éléments qui subissent
des influences liées au climat dans la localité de Bagam. Certes
nous nous sommes appesantis sur les éléments physiques comme le
climat, le relief, l'hydrographie, la végétation, la faune, le
sol et la flore. Ensuite quelques aspects humains a tiré notre attention
c'est l'instar de la population, les principales activités
économiques (agriculture, élevage). Tout compte fait, il est
à noter que le village Bagam à travers ces facteurs suscite une
étude de la perception de la variabilité dans cette zone.
25
CHAPITRE II :
LES PERCEPTIONS LOCALES DE LA VARIABILITÉ
CLIMATIQUE À
BAGAM
Introduction
L'ambiance climatique est connue de nos jours dans des
communautés villageoises. Cette ambiance est marquée par une
série de fluctuations des paramètres climatiques ainsi que des
multiples constats faites. La localité de Bagam est aussi une cible dans
l'étude des phénomènes climatiques. De ce fait ce chapitre
porte sur les perceptions locales de la variabilité climatique, il est
donc question pour nous dans un premier temps de mesurer l'appréciation
des populations face à la variabilité climatique. L'autre
étape sera d'évoquer les perceptions de variations au
régime de précipitation et de température avant de mettre
en évidence l'effet de ces perceptions sur les activités
paysannes en se basant notamment au niveau de quelques éléments
géomorphologiques, biogéographiques, agricoles, élevages
et les mutations sociales.
II.1. Savoirs locaux sur la variabilité
climatique
Il s'agit pour nous d'évaluer le niveau de connaissance
du paysan sur cette notion de variabilité climatique.
II.1.1. Regard des paysans par rapport à la
variabilité climatique
Au regard de la figure 1, il en ressort que 92% contre 5% des
paysans pensent qu'il y'a variabilité climatique dans le groupement
Bagam. Certains estiment que c'est un phénomène naturel, d'autres
par contre l'attribut au mysticisme, à la sorcellerie et à la
colère des dieux ou des ancêtres. Cependant 5% des paysans pensent
qu'il n'y'a pas variabilité climatique dans cette zone, ils
évoquent que tout est comme avant à l'instar de la pluie,
certains attestent qu'il pleut normalement puis la température n'a pas
changé depuis des décennies jusqu'à nos jours, ils
estiment que le retour des pluies a été toujours
accompagné d'une hausse de températures tandis que d'autres
affirment que tout va bien car ils n'ont jamais cessé de gagné
leur pain quotidien, ces paysans sont des personnes exerçant pour la
plupart un métier stable à l'instar des mécaniciens car
ils ne nécessitent ni pluie, ni soleil pour vaquer à leur
occupation.
On note également que 3% des paysans n'ont rien dit, ce
silence est lié au niveau de connaissance dans le domaine. Ils
concernent d'une part des personnes qui, par manque de moyen n'ont jamais
été à l'école tout en privilégiant
l'agriculture plus que tous pour des hommes et le mariage pour des femmes. On a
aussi remarqué pour d'autres ce manque de confiance en soi de certains
paysans en ce sens où ils estiment que c'est l'autre qui peut mieux nous
répondre (Figure8)

5% 3%
pourcentage de ceux qui pensent qu'il ya variabilté
climatique
92%
pourcentage de ceux qui pensent pas de reponse
qu'il n' ya pas
variabilté

l
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure8: Statistiques des points de vue par rapport
à la variabilité climatique
II.1.2. Mise en évidence de la perception de la
variabilité climatique
Cette partie consiste à évaluer les indicateurs
dans le temps passé et le temps présent afin de retracer
l'évolution du climat et ces effets. Comme tel, ces perceptions sont de
plusieurs ordres:
II.1.2.1. Perceptions paysannes des variations dans le
régime des précipitations et des températures
Nous entendons ici dégager les indices passé et
actuel issu des perceptions paysannes pouvant conduire à tracer
l'évolution de la pluviométrie et de la température dans
la localité de Bagam.
II.1.2.1.1. La pluviométrie
Lors de notre enquête sur le terrain, nos résultats
par rapport aux précipitations étaient plus axés sur le
retour des pluies car il détermine le point focal des objectifs annuels
fixé par le paysan.
a-Le retour des pluies ou le « kouh mbun
»
Le « Kouh mbun » ou retour des pluies en
opposition avec le « ghouh mbun » est une
étape de la saison de pluie qui varie d'une année à une
autre. Au Niger, le démarrage de la saison des pluies se fait de plus en
plus tardivement par rapport à la période d'avant 1970, puis
elles sont de faibles quantités et inégalement réparties
dans le temps et l'espace TIDJANI A.D et al (2016). Comme tel, les perceptions
paysannes à Bagam sera examinées dans le passé et le
présent.
Avant Actuelle
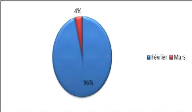
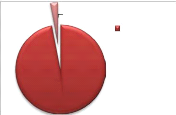
97%
3%
ceux qui pensent que les pluies revenaient en Mars
26
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure9: Réponse de la population par
rapport au retour dans des pluies.
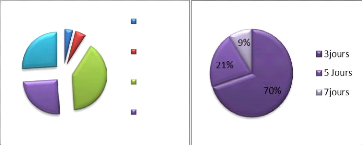
26%
25%
4% 5%
40%
5jours 7jours 14jours 21jours
27
La figure 9 parle du retour des pluies. Ainsi il ressort que
97% contre 3% des paysans affirment qu'avant les pluies revenaient en Mars
notamment le 15 Mars. En effet à cette période ils n'y'avait pas
de difficulté dans la maitrise du climat. Bagam étant
qualifié comme une zone à dominance agricole, les paysans
savaient qu'en fin Février chacun devrait déjà labourer sa
parcelle puis apprêter les semences pour ensuite semer vers les 13 et 14
Mars et attendre les pluies le 15 Mars. Dans cette posture l'expérience
vécue avait toujours marché jusqu'à ce que cette
modification du climat s'installe. C'est à travers ceci que nous allons
nous pencher sur le retour actuel du climat.
Dans le temps actuelle, le diagramme portant sur le retour
actuel des pluies dans la zone de Bagam nous montre que 96% contre 4% de la
population sont d'accord du fait que maintenant les pluies reviennent
plutôt en Février en ce sens que depuis ces dernières
années on note une perpétuelle variation du retour des pluies,
tantôt en Février, tantôt en Mars. C'est ce que l'un de nos
informateurs au nom de Fometio, un retraité agriculteur nous a
révélé le 2 avril 2019 à Mengoh. Ce dernier nous a
fait savoir qu'en 2017, les pluies sont revenues le 07 Mars alors que personne
n'était pas préparé en avance qu'il devait pleuvoir ce
jour. De même qu'en 2018, c'est plutôt le 10 Février qu'on
reçoit les premières pluies au lieu du mois de Mars habituel. En
2019, c'était en fin Janvier. De tout ceci, nous comprenons que le
retour actuel des pluies ne respecte plus le retour normal qui était
initialement prévu chaque 15 Mars. Au regard de tout ceci, nous disons
que ces résultats de notre zone d'étude épousent la
situation des retours des pluies au Niger Tidjani D et al (2016).
b- Les séquences mensuelles des pluies
Les journées successives des pluies étaient plus
représentatives dans le temps par rapport à maintenant. De ce
fait l'enquête de terrain a montré qu'avant les séquences
hebdomadaires des pluies étaient plus nombreuse. La figure 3 nous
indiquera les différentes séquences mensuelles des pluies.
Passé Actuelle
28
Source : Enquête de terrain
2019
Figure10: Réponse des paysans sur les
Séquences mensuelles des pluies
Par rapport aux statistiques mensuelle des pluies dans le
passé de la figure 10, nous disons que 40% contre 2% de personnes
pensent qu'avant ils avaient une séquence de 14jours de pluies ce qui
leur permettaient d'exercer leurs activités en particulier l'agriculture
dans le but d'avoir un haut rendement. On note aussi que 26% de paysans pensent
qu'avant les séquences de pluies étaient supérieur
à 21 jours, puis 25% estiment que c'étaient plutôt une
séquence de 21 jours de pluies. Enfin 5% des paysans qui pensent que ces
séquences étaient de 7 jours.
Contrairement au temps passé, 70% contre 9% de paysans
pensent qu'actuellement les séquences de pluies sont les
séquences de trois jours de pluie. Pour 21% de paysans avec les
séquences de cinq jours de pluies. Tout compte fait à travers les
différentes prises de position dans le passé et le
présent, nous notons qu'à Bagam les séquences
passées des pluies étaient successives sur une période de
14 et 21 jours. Plus de 21 jours, c'était normale et importante pour la
croissance normale de la plante. Or actuellement on note plutôt les
séquences de 3jours, 5 jours et 7 jours. Ceci démontre les
plaintes des paysans sur le fait qu'ils ont une insuffisance d'eaux dans le sol
ce qui ralentie la croissance des plantes.
II.1.2.1.2- La température
La température est considérée dans le
cadre de ce travail comme l'un des indicateurs qui doit être
évalué dans le temps passé et actuel de la localité
de Bagam.
Passé Actuelle
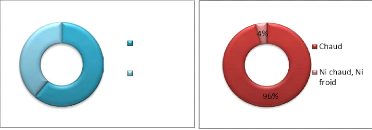
39%
61%
Ni chaud, Ni froid
Froid
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 11 : Réponse des paysans sur la
température dans le temps passé à Bagam
La figure 11, fait allusion au pourcentage de personnes
concernant la température dans. L'évidence a montré que
61% contre 39% pensent qu'ils faisaient plus froid à l'époque
tandis que les 39% autres personnes estiment que tout tournait à la
normale c'est-à-dire qu'il ne faisait ni chaud, ni froid. Il est donc
à noter qu'avant on avait d'un côté la température
qui était normale puis de l'autre coté la présence
omniprésente du froid.
29
Concernant le diagramme Sur la température dans le
présent, il ressort que 96% contre 04% de personnes ont
déclaré que maintenant il fait chaud. Ce phénomène
a été plus ressenti depuis ces 03 dernières années.
On note donc que depuis le passé jusqu'au temps présent, la
température à subit de perpétuelle modification. Cette
idée épouse celui du GIEC qui stipulait à la
conférence des nations unies en 2015, en France qu'il y'a une hausse de
1,5°C des températures.
II.1.2.1.3. Séquence de sècheresse
Dans cette rubrique nous pouvons dire que la population de Bagam
par de différents points vus estime que les séquences de
sècheresse dans le temps à changer par rapport au temps
présent. (Figure12).
Passé Actuelle
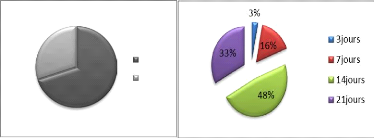
30%
70%
2jours 3jours
Source : Enquête de terrain 2019
Figure12: Réponse des paysans par rapport
à la séquence de sècheresse
La figure 12, présente les preuves émis par les
paysans par rapport à la séquence sèche dans le temps. Il
ressort de ce diagramme que 70% des paysans pensent qu'avant les
séquences de sècheresse étaient de 2 jours tandis que 30%
des paysans estiment plutôt que c'étaient les séquences de
3jours de sècheresse.
Il faut noter qu'à travers le diagramme du temps
actuel, 48% contre 3% de paysans affirment qu'actuellement les séquences
mensuelles de sècheresse est de 14 jours notamment au mois de Mars,
Avril parfois le mois de Mai. Par contre 33% de Personnes estiment aussi
qu'actuellement c'est une séquence de 21 jours de sècheresse
c'est l'exemple de 2019 où au mois de Mars et Avril, on a
enregistré 14 jours et plus de séquence de sècheresse.
Nous avons également 16% de personnes qui attestent que c'est
plutôt une séquence de 7 jours de sècheresse. En
résumé les séquences de sècheresse dans le
passé ont varié par rapport à celle de maintenant.
II.1.2.2. Perceptions liées aux calculs
économiques
Au domaine économique la perception est plus
tournée vers le « pabé » où près de 70%
contre 30% de femmes exercent pendant la période du labour. En effet ces
femmes laissent leurs champs en dépit du pabé pour après
labourer le leurs après. L'entretien Fait à Menghoh le 17
30
Mars à 13h avec Maman ZEBOVE Jeanne nous a permis de
comprendre qu'elle préfère faire du bapé afin d'entretenir
son propre en retour ainsi que son ménage. De ce point de vue
économique nous déclarons que, ce n'est pas seulement le climat
qui dérègle mais aussi l'homme qui dérègle le
climat en ce sens qu'en donnant du plus-value au pabé, l'on se retrouve
toujours en retard par rapport aux autres.
II.2.1.Perception des effets de la variabilité
climatique dans quelques domaines
Les effets de la variabilité sont perçus par les
paysans notamment sur quelques éléments géomorphologiques,
biogéographiques, hydrologiques et agricoles.
II.2.1.1. Perceptions des effets de la variabilité
climatique sur quelques éléments
géomorphologiques
Cette étude permet de montrer comment certains
éléments dits géomorphologique ont subi des mutations
depuis plusieurs décennies. Nos résultats ont été
plus regardants sur l'érosion et le glissement de terrain.
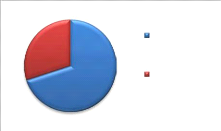
30%
70%
ceux qui pensent qu'il y'a érosion
ceux qui pensent qu'il n' y'a pas érosion
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure13: Réponse des paysans par
rapport à l'érosion dans le temps et l'espace
Au regard de la figure 13, il ressort que 70% contre 30% des
paysans pensent que depuis des décennies il y'a érosion dans le
groupement Bagam. Ceci est une conséquence des espaces situés sur
le passage du torrent en montagne comme dans les basses altitudes. Après
de forte pluies torrentielles, les tissus écologiques pour la plupart
sont attaqués progressivement et les eaux de ruissellement érode
parfois jusqu'à la nappe ferralitique. Ces résultats se
rapprochent de celui de J-M FOTSING (1993) qui estime que les fortes pluies
sont la cause première de l'érosion sur des espaces cultivables
en pays Bamiléké « La pluie est le principal agent
d'érosion qui menaces à des degrés divers, les terres
agricoles du pays Bamiléké ». Lors de note enquête de
terrain plusieurs cas ont été enregistrés notamment
à Barfack, à Menfoung sur l'itinéraire
Maçan-Mbévé 2 puis à Kieneghang au fond de la Ferme
pilote. D'après la figure les 60% de personnes qui pensent.

31
Source : Cliché Peteptiatsop Udice
2019.
Planche 1: Erosion enregistré au Bas-fonds de la
ferme de Kiénéghang
La planche 1 illustre un exemple d'érosion dans la
localité de Bagam notamment dans le village Kiénéghang. Il
ressort de cette érosion de 5 à 7 m de profondeur, que ce
phénomène s'était mis en place depuis plus d'une dizaine
année. Cette dernière constitue un obstacle pour le paysan car au
fur et à mesure que les années passent le regard est plus
fixé sur l'avenir de l'espace agricole.
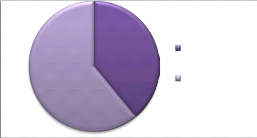
61%
39%
il n'y'a pas glissement
il y'a glissement
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure14: Réponse des paysans sur le
glissement de terrain dans le temps et dans l'espace
La figure 14, est un diagramme illustrant le pourcentage de
personnes par rapport au glissement de terrain dans le temps et dans l'espace.
Comme tel 61% pensent qu'il n'y'a pas glissement à Bagam alors que 39%
des paysans estiment qu'il y'a toujours eu glissement de terrain. Cependant
autre perceptions se sont nées de notion du glissement de terrain
certain l'attribuant aux totems et d'autre à la position d'un terrain
par rapport à un cours comme l'atteste la figure suivante.
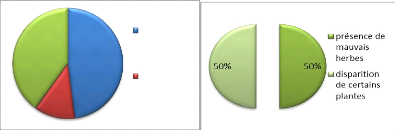
40%
12%
48%
présence abondante des herbes
l'existance de certains plantes
32
|
53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les totèmes la position du terrain par
rapport à un cours d'eau
|
Source : Enquête de terrain
2019
Figure15 : Le Glissement de terrain et ses
origines dans le temps et
l'espace .
La figure 15 est un histogramme mettant en relation le
glissement de terrain et ses sous-concepts. Les résultats de cette
étude montrent que 48% de paysans estiment que le glissement de terrain
est liée au totems en ce sens que lorsque quelqu'un vend un terrain puis
dans la posture de le reprendre utilise une stratégie d'aller
s'installé à travers son totems et de faire écrouler la
parcelle petit à petit jusqu'à ce que l'acheteur abandonne tandis
que 52% de paysans pensent que le glissement de terrain à Bagam est
plutôt liée à sa position par rapport à un cours en
ceci que la quasi-totalité des parcelles situé près d'un
cours d'eaux s'écroule toujours au fur et à mesure que les
années passe, il se traduire aussi par le fait qu' après les
pluies abondantes, les cours d'eaux tarissant fragilisent les abords de ces
cours d'eaux par conséquent glissement de terrain.
II.2.1.2. Perceptions des effets de la variabilité
climatique sur quelques éléments biogéographique.
Dans le cadre de notre recherche, nous avons noté que
la variabilité climatique trouve aussi ces justifications dans le
domaine biogéographique.
II.2.1.2.1. Variabilité de la
végétation
L'analyse de la végétation naturelle nous permet
d'évaluer son état dans le passé et dans le présent
dans le but d'apporter une justification propre à cet indicateur.
Passé Actuelle
33
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure16 : Réponse de la population sur
l'état de la végétation dans le passé à
Bagam
La figure 16 révèle l'état de la
végétation dans le passé. A l'analyse de cette figure, il
ressort qu'avant 40% des paysans attestent que la végétation
était constitué de Beaucoup d'herbes ce qui empêchait la
transhumance remarquable dans certaines zones par contre 40% des paysans
estiment qu'il y'avait l'existence de certaines plantes à l'instar de la
pastèque sauvage. Mais on note aussi que 12% de personnes affirment
qu'avant il y'avait beaucoup d'arbres qui protégeait le couvert
végétal à une quelconque dégradation du sol.
Il ressort par contre qu'actuellement dans Bagam, 50% des
paysans soulignent qu'il y'a présence de mauvais herbes dans la
localité notamment pendant la période de Semis du haricot de la
saison sèche ou le Gounh néyop. Ces mauvais herbes
résistants à l'insecticide, constitue sur un certain type de sol
une des causes à un mauvais rendement du haricot. 50% des paysans
attestent qu'au fil du temps, l'on note la disparition de certains arbres.
C'est l'exemple du Tsi-tsang c'est-à-dire l'arbre à
poches d'eaux qui se transformait en fleur après quelques temps. En
effet pour ceux qui avaient cet arbre sur leur espace savait qu'à partir
du moment cet arbre fleurissait, c'est que la saison sèche s'annonce
déjà. Ils notent aussi l'abatage remarquable des arbres comme
l'eucalyptus qui est en pleine disparition dans cette zone par
conséquent le couvert végétal est exposé à
de multiples risques, la disparition de certaines plantes comme la
pastèque sauvage mais également l'apparition de certaines plantes
comme le Folon à Kieneghang, Mbévé 2. De tout ceci, le
climat a eu un impact sur la végétation.
II.2.1.2.2. Le comportement des oiseaux dans le temps et
l'espace
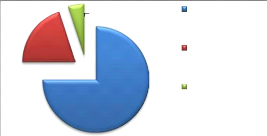
20%
5% il y'avait migration
des oiseaux
75%
il n' y'avait pas migration des oiseaux
Pas de reponse
Source : Enquête de terrain 2019
Figure17: Réponse de la population par
rapport à la Migration des oiseaux dans le temps
et dans l'espace.
Il ressort de la figure 17 que 75% contre 5% de personnes
estiment qu'il y'avait migration des oiseaux des oiseaux dans le temps et
l'espace ; c'est le cas des Duidun ou hirondelle rustique qui migrait
plus en saison de pluie. Actuellement nous avons la migration des pique-boeufs
lors
34
de la saison sèche pour ne revenir qu'en saison de
pluie. Enfaite, la migration des pique-boeufs est liée au fait que lors
de la transhumance à la recherche de la pâture, les boeufs
étant en déplacement, ces pique-boeufs migrent également
pour ne revenir qu'en saison de pluie. Les 20% de personnes qui estiment qu'il
n'y'a pas migrations d'oiseaux. Donc ces oiseaux migrateurs ont toujours
migrés parce que sont les mauvaises conditions climatiques
particulièrement tous les débuts de la saison.
II.2.1.2.3. Les types d'insectes dans le temps et
l'espace
Passé Actuelle
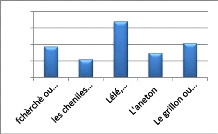
|
100%
50%
0%
|
|
|
Chenilles vertes
|
Les termites
|
40%
30%
20%
10%
0%
Figure18: Réponse de la population concernant le
type d'insectes dans le passé
Source : Enquête de terrain.
La présente figure 18 nous fait part du type d'insecte.
Ainsi nous remarquons qu'avant on avait des espèces de fourmis
tisserandes qu'il qualifiait de fchrètchrè (20% de
personnes l'on certifiées) , 10% de personnes estiment qu'il y'avait les
chenilles yaourts ou gégans puis 35% pensent qu'il y'avait le
lélé encore appelé moumout c'est les
moucherons, ensuite 15% qui pensent qu'il y'avait le Bounk ou
l'anéton enfin 20% que estiment qu'il y'avait le métsé
c'est-à-dire le grillon ils poursuivent en disant qu'avant il
faisait de la sauce du grillon.
Outre nous voyons que la majorité d'insecte dans le
temps a disparu au fil des années. Il ressort qu'actuellement il y'a
deux types d'insectes qui est le plus ressenti dans cette zone. De ce fait 90%
de personnes pensent que l'insecte de l'heure est la chenille verte en ceci
qu'elle détruise les plants de maïs en cas de déficit d'eaux
notamment ces trois dernières années par contre le reste de 10%
estiment qu'il y'a aussi les termites qui rongent non seulement les tiges de
maïs dans les espaces appelé Dounfounvh
c'est-à-dire espace de pâture mais servant aussi à la
pratique des denrées agricoles mais aussi vont jusqu'à entrer
dans les maisons ceci a été plus observé à
Mbévé2.
35
II.2.1.2.4. Perceptions des effets de la variabilité
climatique dans l'évolution de l'eau

20%
7%
73%
il y'a inondation
il n'ya pas inondation
Pas de reponse
Source :
Enquête de terrain 2019.
Figure19 : Réponse des paysans par rapport
à l'inondation dans le temps et l'espace
La figure 19 est le diagramme illustrant l'inondation dans le
temps et l'espace. Apres analyse, nous constatons que 73% contre 7% de
personnes pensent qu'il y'a inondation pour certains après chaque un an
et pour d'autre, elle varie d'année en année, en ce sens que les
zones située dans les Bas-fonds sont les plus exposées aux
risques d'inondations après des fortes pluies pour certains, mais pour
d'autres, cette inondation est liée à la sorcellerie, au
mysticisme. C'est ce que tente de nous relater Feuko Martin (le 30 Mars
à Kiéneghang). Ce dernier nous a fait part d'un cas d'inondation
à Kieneghang nommé lac Monning en dessous de la colline
Mont tsocpèh. Mais Il a noté que cette
inondation se met en place chaque5 ans après conduisant parfois à
un tarissement d'eau jusqu'au marché kieneghang.
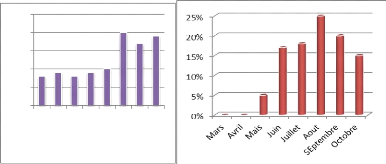
25%
20%
15%
10%
0%
5%
Mars Avril Mai Juin Juillet Aout SEptembre Octobre
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure20 : Réponse des paysans sur les mois
abondance ou déficit d'eau
La figure 20 montre les pourcentages de mois `abondance et
déficit d'eaux. Ainsi, Il ressort que dans le passé, de Mars
jusqu'en Juillet on avait une quantité suffisante en eau alors le mois
d'Aout jusqu'en Octobre constitue les mois d'abondances en eau (notre
enquêtes sur le terrain nous a affirmé). On constate qu'il
n'y'avait pas déficit d'eau dans le passé.
On constate que dans le temps actuelle, les pluies peu
abondantes au mois Mars, Avril et Mai ont un impact sur la quantité
d'eau dans le présent. On note actuellement un grand déficit
d'eau
36
notamment le mois de Mars et Avril parfois le mois de Mai
alors que le mois d'Aout, Septembre et Octobre sont marqués par une
abondance d'eau ce qui est à l'origine de l'assèchement de
certains cours d'eaux, la sècheresse des plantes en Mars et Avril. Tout
compte fait les quantités d'eaux dans le passé notamment en Mars
et Avril ont subi des mutations négatives dans le présent.
II.2.1.3 Perceptions des effets de la variabilité
climatique dans le domaine agricole
L'État Camerounais en 2011 à Ebolawa soulignait
que « dans le domaine agricole, la maitrise des impacts négatifs du
climat reste un véritable problème » alors que TSALEFAC
(1999) pense plutôt que la répartition annuelle et interannuelle
des pluies à un impact sur l'activité agricole. Ces
pensées se rapportent aussi dans notre zone d'étude car ces
phénomènes négatifs du climat se vit aussi à Bagam.
Depuis des décennies l'agriculture à Bagam a subi beaucoup de
mutation tant sur son calendrier que sur le rendement ainsi que le prix sur le
marché parce ce que le climat à varié.
II.2.1.3.1. Perturbation du calendrier agricole
Le paysan est de nos jours troublé parce qu'il ne sait
plus à quel sens se voué en raison de la perturbation du
calendrier agricole.
Tableau6: Méthode culturale pour la
planification de la production en maïs et du haricot
dans le passé
|
Les travaux du paysan
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Défrichage et nettoyage du champ
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Labourer
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
semer
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sarcler
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arracher l'herbe dans le champ
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
Recolter et sacler
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
V'
|
|
|
|
Semer du haricot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
Recolter le haricot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
Source : Enquête de terrain
2019.
Au regard du tableau 6, nous remarquons qu'avant, les
agriculteurs défrichaient leurs champs entre le mois de Janvier à
Février puis labouraient au mois de Février à Mars pour
semer au mois de Mars-Avril. La récolte pouvait donc se faire aux mois
d'Août, Septembre et Octobre.
37
De même, avant ils sarclaient de nouveau le champ pour
semer du haricot pour enfin récolté au mois de Novembre-
Décembre.
Tableau 6: Méthode cultural actuel pour
la planification de la production en maïs et du
haricot
|
Les travaux du paysan
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Défrichage et nettoyage du champ
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Labourer
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
semer
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fertiliser
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sarcler
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appliquer l'insecticide
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
Récolter
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
V'
|
|
|
Semer du haricot
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
V'
|
|
|
Récolter le haricot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
'
|
V'
|
Source : Enquête de terrain
2019.
Il ressort du tableau 7 que tout n'est plus comme avant en ce
sens qu'actuellement à travers les pluies précoces de
Février, les agriculteurs ne sèment qu'au mois de Février
et Mars afin d'être parmi les premiers personnes a récolté.
On a également constaté que les récoltes s'effectuait en
Aout, septembre et Octobre par contre dans le temps actuel, elle est
généralement consacrée au mois de juillet, Août. On
remarque dès lors qu'actuellement on applique de l'insecticide au lieu
de sarcler. Cependant l'enquête de terrain nous a aussi enseigné
que la majorité des agriculteurs qui produisent du maïs utilisent
le Lico- Maïs pour désherbés leurs champs estimant accroitre
le rendement. Donc les aléas climatiques ont impacté le
calendrier agricole.
II.2.1.3.2. Sècheresse agricole
Le manque d'eau dans le sol conduit à la
sècheresse agricole. Cette situation varie d'année en
année mais ces dernières décennies sont les plus
marquantes pour les paysans.
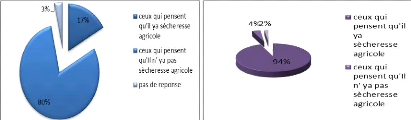
38
Passé Actuelle
Source : Enquête de terrain 2019.
Figure21: Réponse des paysans sur la
sécheresse à Bagam
A l'issue de la figure 21, nous constatons que 80% contre 17%
des paysans pensent qu'il y'avait pas sècheresse agricole dans le
passé autrement dit le terme sècheresse agricole n'existait pas
dans le passé.
On constate également qu'actuellement 94% contre 4% des
paysans attestent qu'il y'a sècheresse agricole, c'est le vécu
quotidien du paysan surtout au mois de Mars, Avril. Ce besoin en eau des
plantes épouse celui d'Agridea (2013) qui pense que le maïs aime
les climats chauds « le maïs a des besoins hydriques importants. Il
consomme la moitié de l'eau nécessaire à sa croissance
entre 3 semaines avant et 3 semaines après la floraison. Un manque d'eau
durant cette période se traduit par une chute du rendement ». On
peut donc comprendre pourquoi dans le présent, avec les pluies moins
abondantes et les déficits d'eaux enregistrés, les paysans se
plaignent de la sècheresse de ces plants.
II.2.1.3.3. Réductions des rendements agricoles
La production agricole dans le temps s'effectuait sans
l'intervention des pesticides mais le rendement était favorable ; Au fil
de plusieurs années 60% de ménages de Bagam ont constaté
une baisse de rendement, ce qui leurs a poussé à se pencher vers
l'utilisation des pesticides afin de booster leurs rendements agricoles
malgré le cout élevé de ces engrais chimiques. Cependant
certains attribuent cette baisse de rendement agricole au
phénomène climatique tandis d'autre l'attribue à la
pauvreté du sol car l'utilisation répétitif des
insecticides notamment le gramozole déracine le sol de ces
éléments nutritifs c'est l'exemple des ignames, le macabo
où le rendement n'est plus comme dans le passé. Cependant
L'inconvénient repéré sur le terrain est que le paysan ne
se retrouve plus en termes de prix des denrées sur le marché,
nous soulignons que malgré le cout élevé des intrants, la
sècheresse agricole qui perdure, le prix de ces denrées ne
satisfait plus le paysan.
|
il y'a baisse de
|
|
|
|
|
|
|
60%
|
|
rendement
|
|
|
|
|
ilnn'y'a pas baisse
|
|
|
|
|
de rendement
|
|
|
48%
|
|
pas de reponse
|
|
|
2%
|
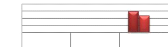
1
2
3
0,8
0,6
0,4
0,2
0
39
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure22: Réponse
des agriculteurs sur la basse des rendements à Bagam
De ce graphique (figure22), nous comprenons que 60% contre 2%
des ménages estiment qu'actuellement par rapport au passé, il y'a
baisse de rendement ce qui conduit à l'utilisation des pesticides afin
d'augmenter la production tandis que l'autre franche des agriculteurs pensent
qu'ils sont situés dans les Bas-fonds, donc l'effet de la teneur en eau
du sol n'impacte pas considérablement les plantes.
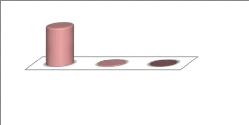
pas de reponse
il n' y'a
baisse de
prix
il y'a baisse de prix
98%
2% 0%
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure23: Réponse des paysans sur la fluctuation
des prix de denrées sur le marché.
La figure 23 nous indique que 98% contre 2% des paysans
pensent que sous l'effet du climat et le coût élevé des
engrais chimiques, les prix des denrées devraient être abordables.
On constate qu'avant, au mois d'Avril et Mai, la cuvette de maïs
était à 3000f alors qu'actuellement c'est plutôt à
1900F, 2000F, 2300F. Concernant le haricot, avant le prix étaient
à 8000F, 10000F, 12000F maintenant elle est plutôt à 5000F,
6000F le paradoxe est qu'en mois d'Aout, Septembre, lorsque l'agriculteur veut
s'en acheter encore la semence du haricot, on remarque plutôt le
doublement des prix. Nous déduisons que la variabilité climatique
influence de manière indirecte les prix des denrées agricoles.
Tableau 7 : Evolution de la production de
maïs 2014-2018 d'un grand Exploitant
|
Année
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Production en (Kg)
|
6,18 tonnes
|
6,605 tonnes
|
5,253 tonnes
|
6,409tonnes
|
8,5 tonnes
|
Source : Enquête de terrain
2019.
40
Le tableau 8 nous fait part de l'évolution de la
production en maïs de Fometio de 2014 à 2018 sur un (01) hectare et
demi de champ. Lors de notre entretien nous avons remarqué que
l'instabilité du climat impacte sur la variation des rendements des
années 2014, 2015, 2017 et 2018. On souligne aussi qu'en 2016, le
producteur n'avait pas une semence approprié (les composites) pour
résister aux mauvaises conditions climatiques ; raison pour laquelle il
n'a récolté que 5, 253 tonnes de kg de maïs. Par contre au
regard des années précédentes, il s'est tourné vers
l'hybride CH101 avec une bonne pluviométrie de 2018, il a pu atteint 8,5
tonnes. Donc l'impact de la variabilité climatique reste visible sur
l'évolution du rendement agricole. Tableau 8 : de
production en maïs à la ferme pilote de
Kiéneghang
|
Année
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Production en kg
|
148,5 tonnes
|
165 tonnes
|
115,5 tonnes
|
148,5 tonnes
|
198 tonnes
|
198 tonnes
|
Source : Ferme de keinéghang
2019.
Le tableau 9 nous parle de la production en maïs de 2014
à 2019.Cependant on note qu'après un entretien avec NGUIVO
Marthe, la représentante de la ferme pilote de Kiéneghang,
pratiquant le maïs sur 33 hectares. Il s'est avéré que la
variabilité climatique menace les exploitants de cette localité.
Il ressort que l'année 2016 a été fortement frappé
par l'excès de soleil d'où faible rendement de 115,5 tonnes de
kg. Donc dans l'ensemble, l'excès de soleil est un obstacle à la
croissance normale de la plante d'où les impacts sur le rendement.
II.1.3.4. Perceptions des effets de la variabilité
climatique dans le domaine de l'élevage II.1.3.4.1. La présence
des maladies liée aux animaux.
L'élevage étant considéré comme
une activité que le paysan exerce au quotidien, elle a toujours subi
l'influence liée au climat notamment au retour des pluies de
Février, Mars mais également pendant le mois d'Août,
Septembre.
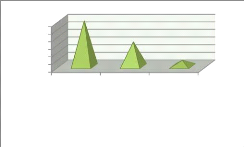
40%
60%
50%
30%
20%
10%
0%
il y'a il n' y'a
présence présence
des des
maladies maladies des animauxdes animaux
pas de reponse
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 24: Réponse
du paysan sur la présence des maladies à Bagam
41
La figure 24 nous montre le pourcentage de réponse sur
la présence des malades liée aux animaux en campagne. Dans la
localité de Bagam on souligne qu'il y'a la peste porcine, les maladies
des poules, enfin la maladie des chèvres. Au regard de la figure 28, il
ressort que 60% contre 8% des paysans pensent qu'il existe les maladies
liée aux poules, aux chèvres et aux Porcs au mois de
Février et Mars 40% des ménages sont victimes de ces
phénomènes certains enregistres 4 décès de porcs et
7 décès de poules tandis que d'autres dépassent une
quinzaine de décès. La maladie liée aux chèvres est
plus récurrente en saison pluvieuse notamment en Aout, Septembre mais
l'on enregistre peu de décès dans les ménages.
Conclusion partielle
En somme, il était question pour nous dans ce chapitre
de vérifier l'hypothèse selon laquelle il y'a variabilité
climatique à Bagam. Il ressort qu'effectivement la variabilité
climatique est de nos jours une réalité dans le vécu
quotidien du paysan ceci se traduit par une hausse de température, et le
retour précoces des pluies mais aussi aux calculs économiques
avec le pabé. Certes les perceptions de ces effets s'observe
sur la modification de la végétation, perturbation du calendrier
agricole, la sècheresse agricole, baisse de rendement, transhumance.
Face au regard porté par le paysan sur la variabilité climatique,
il n'en demeure pour nous d'analyser l'opérationnalité des
pratiques et croyances de ces paysans.
42
CHAPITRE III : OPÉRATIONALITÉ DES
PRATIQUES ET CROYANCES FACE A LA PÉJORATION CLIMATIQUE
Introduction
La population de Bagam dans le passé avait les
meilleures conditions climatiques qui aujourd'hui les mettent plutôt dans
les conditions troubles et leur amènent parfois à craindre
l'avenir. Cette zone connue d'ailleurs comme une zone où
l'activité l'agricole (maraicher et vivrier) domine contraint les
paysans à réfléchir sur comment faire pour ne pas
être coincé par la variabilité climatique. De ce fait, il
est question pour nous dans ce chapitre de présenter les pratiques et
les croyances paysannes issu des effets perçu de la variabilité
climatique afin de faire face à cette nouvelle donnée climatique
Ensuite comprendre si c'est le climat qui dérègle l'homme ou
c'est l'homme qui dérègle le climat.
III.1. Les Pratiques et croyances quotidienne du paysan
Plusieurs Pratiques et croyances sont effectuées par
les paysans notamment dans le système climatique, agricole, anthropique,
culturel et économique pour cette nouvelle donnée climatique.
III.1.1. Pratiques paysanne dans le système
climatique
Nous examinons le degré du paysan sur comment il fait dans
la mesure où il y'a l'excès de pluies ou l'excès de
chaleur.
III.1.1.1. Lorsqu'il pleut excessivement
La figure 25 montre le pourcentage de réponse de la
population par rapport au processus de
déviation ou chassé les
pluies
.
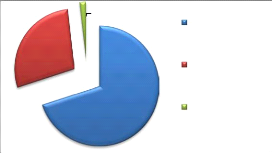
28%
2%
70%
ceux qui pensent qu'on peut devier les pluies
ceux qui pensent qu'on ne peut pas devier les pluies
pas reponse
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 25 : Réponse de la population par
rapport à la déviation ou chassé les pluies
La figure 25 fait recours au pourcentage de réponse sur
le processus de déviation ou chassé les pluies à Bagam. Il
en découle que 70% contre 2% des paysans estiment que c'est la meilleure
pratique à adopter pour effectuer les récoltes en Août et
en septembre ou pour faire une quelconque festivité dans le village.
C'est l'exemple des funérailles organisé au mois de
43
novembre, les mariages, les congrès pendant les grandes
vacances. Ceci nous rappelle une année où nous étions en
vacance dans cette zone, le jour du congrès, ils étaient
obligés de contacté le chasseur des pluies afin que la pluie ne
met pas en péril ce festival.
L'autre franche de 28% des paysans pense que cette pratique
n'est que du hasard, ils estiment que le chasseur de pluie n'est pas Dieu pour
empêcher qu'il ne pleuve. Dans la poursuite des explications sans tenir
compte du contexte scientifique, un entretien a été fait à
Mbévé 2 avec un déviateur de pluie exerçant ce
travail depuis une dizaine d'année. Comme tel VEKOP David, le 6 Avril
2019 à Mbévé 2 nous a confié qu'il dévie les
pluies chaque année quand besoin se pose.
Au sortir de cet entretien, les étapes
préalablement émises par notre chasseur de pluie stipule que tout
ce don vient de Dieu, la pluie appartient à Dieu donc on devrait d'abord
programmer cette tâche à temps afin d'être satisfait. Au
prime abord plusieurs conditions doivent être respectées. Par
exemple, l'on ne doit pas faire l'amour à la veille du jour où il
veut chasser la pluie, lavé sa face le grand matin avec de l'eau
tiède, utilisé les outils recommandés tel que la cendre,
la tige du sisongo, l'aubergine sauvage (chjichji) et le cola pour
dévier dans un sens bien précis. Par ailleurs on note qu'une
déviation successive de plusieurs jours et dans tous les sens peut
conduire à la mort du chasseur de pluie. Nous soulignons par contre que
lorsque l'on parvient à respecter les ordres prescrits et à
répondre aux attentes des paysans, l'on est davantage
sollicité.
III.1.1.2. Lorsqu'il fait trop chaud
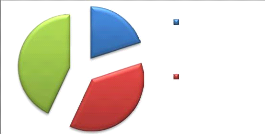
43%
20%
37%
se caché à l'ombre
supporte
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 26 : Réponse des paysans par rapport
à la chaleur de Bagam
La figure 26 nous fait part des pourcentages de réponse
sur la pratique exercée par le paysan pour faire face à la
chaleur. Nous notons que 43% des paysans optent pour l'exécution des
tâches en particulier champêtre aux heures fraiches en ce sens que
psychologiquement préparé de l'ampleur du soleil et la chaleur
qui survient vers midi en saison sèche et au mois de Mars et Avril de la
saison pluvieuse, le paysan notamment les cultivateurs s'arrangent à
aller au champ à 5h30 minutes puis rentre à la maison avant midi
(12h) pour y retourner dans l'après-midi pour
44
la plupart. Au cas où la distance du champ est assez
longue, ils préfèrent plutôt s'abriter à l'ombre
(20% des paysans), notamment en bas des arbres pour continuer dans
l'après-midi. De même la franche de 37% des paysans
préfèrent supporter la chaleur dans la mesure où perdre
quelques heures pénalise l'objectif par conséquent ils auront les
difficultés à se rattraper.
III.1.2. Les pratiques paysannes au système
culturel.
III.1.2.1. La collecte de semences dans des ménages
pour la chefferie afin d'avoir un meilleur rendement.
Il ressort de la figure 27 que Bagam est une localité
où la tradition est et demeure primordiale. Ce qui amène les
chefs traditionnels et les notables de ce village à collecter les
semences auprès des différents ménages afin d'implorer les
dieux, faire les rites traditionnels pour enfin augmenter les rendements
agricoles de chaque ménage car ces semences sont bénis par les
ancêtres. On note que 53% des paysans trouvent satisfaction en cette
stratégie. Par contre 26% de paysans estiment qu'ils donnent pour
donner, qu'ils n'ont jamais vu d'effet sur le rendement. Concernant la franche
de 21% des paysans qui attestent que donner ne servira à rien. On
souligne qu'en effet un bon rendement dépend d'une bonne
pluviométrie et d'une pression modérée du vent. Donc
envoyer les semences manqué quoi faire (figur27).
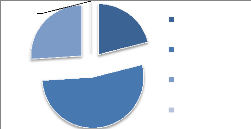
0%
26%
53%
21%
ça ne sert à rien
c'est tès important
on donne que pour donner
Pas de réponse
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 27 : Réponse des paysans sur la
collecte des semences par les notables et chef de
quartier
III.1.2.2 Le tsocyac ou Ouvrir le village
Le tsocyac est un processus qui consiste
à chasser, à vider le village de mauvaise choses comme les
totems, les démons, les sorciers qui peuvent empêcher qu'il ne
pleuve. La figure 56, nous explique la stratégie de tsocyac.
62% contre 38% des paysans estiment que le tsocyac
consistent à chasser les mauvais gens dans le village afin
qu'il pleut à temps. Au cours de l'entretien avec le Chef
Mbéghang, chef de 3ème degré rattaché à la
chefferie supérieur de Bagam, il s'est avéré que c'est un
processus où le chef et ses notables fait une sortie non avertie en
avance à la population, aux heures tardives de la nuit afin de mettre
main sur des sorciers qui hantent le village avec les mauvais sacs, les
gris-gris pour soutirer dans le champ des autres. En
45
rapport avec le diagramme nous mentionnons que 62% des paysans
croient à ce processus affirmant qu'ils ont vu certains sorciers rendre
l'âme après cette exercice mais d'autres se rendent à la
chefferie pour se confesser. On souligne aussi que d'autre à travers
leurs subconscients parviennent à aller garder leurs mauvais sacs dans
le village voisin dans le but d'être protégé par contre 38%
des paysans ne croient pas à cela car le seigneur est le début,
le commence et la fin de toute chose (figure 28).
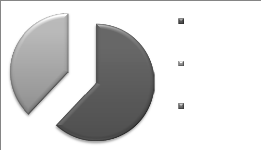
38%
0%
62%
ceux qui croient au stocyack
ceux qui ne croient pas au stocyack
pas de réponse
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 28: Réponse
des paysans par rapport au stocyac à Bagam
III.1.3. Les pratiques paysannes dans le système
agricole
Nous allons énumérez plusieurs stratégies
liées à l'agriculture à l'instar de la modification du
calendrier agricole, l'irrigation, plantation des avocatiers greffés,
l'utilisation des semences résistantes aux mauvaises conditions
climatiques.
III.1.3.1. Modification de la date de semis
Face à ce dérèglement climatique, le
paysan voué pour la plupart à l'activité agricole a
modifié son calendrier agricole. Il ressort que 70% contre 28% ont
attesté modifier le calendrier de la date des semis à chaque fois
que le climat change. Cette situation leur impose de s'adapter aux diverses
stratégies pouvant leurs aidé. Les plaintes des agriculteurs ont
été toujours axées sur le retour des pluies en estimant
que parfois c'est tôt, parfois c'est tard. Suite à ces
perturbations ils ont préféré changé leurs
méthodes d'avant. Le tableau 6 et 7 nous illustre le calendrier de
planification de la production du maïs et du haricot. On laisse entrevoir
qu'au fil des années les agriculteurs ont décidé de faire
avec cette nouvelle donné climatique (figure29).
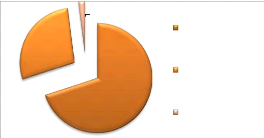
28%
2%
70%
ceux qui ont modifier le calenrier agricole
ceux qui n'ont pas changé le calendrier
pas de réponse
46
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 29 : Réponse des paysans sur la
modification du calendrier de semis
Ainsi le paysan opte pour un nouveau calendrier afin de faire
face à cette nouvelle donnée climatique. Actuellement le paysan
connait qu'il peut semer en février tout dépend de
l'arrivé des pluies. Nous illustrons le calendrier utilisé pour
la plupart des paysans (tableau 11).
Tableau 11: Nouveau calendrier de production de maïs
et du haricot
|
Les travaux du paysan
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Défrichage et nettoyage du champ
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Labourer
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
semer
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fertiliser
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sarcler
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Appliquer l'insecticide
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
|
|
|
Récolter
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
V'
|
|
|
Semer du haricot
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
|
V'
|
|
|
Récolter le haricot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V'
|
V'
|
Source : Enquête de terrain
2019.
47
III.1.3.1. L'utilisation des semences résistantes
aux mauvaises conditions climatique
La figure 30 fait mention des pourcentages de réponse
sur l'usage des semences résistantes aux mauvaises conditions
climatiques. Il ressort que 62% des paysans utilisent les semences
résistantes pendant que 36% des paysans utilisent plutôt les
semences naturelles à cause de la déception en termes de
rendement enregistrée suite à l'usage de l'hybride (maïs)
TZEE-W SR, CMS 8806, CMS 9015 qui dure 85 à 95 jours. Face à ces
conditions difficiles du climat, les agriculteurs pour la plupart des grands
exploitants se sont penchés sur l'usage de l'hybride CHH 101, le Shaba
avec un cycle de maturité de 130 jours. Il s'agit des semences dont leur
système physiologique a été modifié. En dehors de
leurs résistances au niveau du climat, on note aussi l'augmentation des
rendements affirma certains producteurs lors de l'enquête sur le
terrain.

36%
2%
62%
ceux qui utilisent les semences resistantes
ceux qui n' utilisent pas les semences resistantes
Source : Enquête de terrain 2019
Figure30 : Réponses paysannes sur
l'utilisation des semences résistantes aux mauvaises Conditions
climatiques
III.1.3.3. Le plant du maïs sur un sol non
labouré

73%
3%
24%
Ceux qui plante sur un sol non labouré
ceux qui plante sur un sol labouré
pas de réponse
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 31 : Réponse de la population sur
le type de sol approprié pour semer à Bagam
Nous pouvons observer à travers la figure 31 que 73%
des paysans sèment sur des sols labourés ce qui prouve la
sècheresse des plants de maïs, du haricot mais aussi le
renversement de ces plants par la pression du vent, parfois par manque d'eau on
obtient des faibles rendements. Par contre la franche de 24% des paysans
sèment sur un sol non labouré car l'expérience montre
48
qu'un sol non labouré garde beaucoup d'humidité.
Donc un sol compacte solidifie la tige de la plante et la protège contre
le vent mais lorsque la plante atteint le niveau de sarclage, on applique le
Lico-maïs pour désherbé le champ.

Source : Cliché Peteptiatsop Udice, 9 mars
2019.
Photos 1: Semis du maïs sur sol non
labouré
La photo 1 nous amène sur le semis de maïs sur un
sol non labouré. Cette stratégie est moins utilisé par les
paysans en ce sens que l'habitude était qu'on doit labourer avant de
semer donc le changement de stratégie devient un perd temps. Outre
certains paysans trouvent pleinement satisfaction en cette stratégie en
ce qui concerne cette nouvelle donnée climatique. Il ressort que le
paysan défriche, puis sème le maïs, à 3 semaines, on
désherbe la parcelle avec le Lico-Maïs.
III.1.3.4. L'irrigation
L'irrigation à Bagam s'effectuait dans le temps pour la
plupart des cas en saison sèche mais de nos jours elle devient
remarquable en saison pluvieuse notamment dans le domaine du maraicher.

29% 56%
15%
ceux qui irrigue
ceux qui n' irrigue pas
pas de réponse
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 32 : Réponse des paysans sur la
technique d'irrigation à Bagam
Les résultats présentés à travers
la figure 32 révèlent que près de 56% contre 15% des
agriculteurs irriguent leurs champs. En effet, avant cette méthode
n'était pas remarquée en saison pluvieuse mais actuellement, les
agriculteurs pratiquant dans le maraicher et optent pour l'irragation par
aspersion à travers les motopompes ; particulierement en saison
pluvieuse au
49
mois de Mars et Avril où on note deficit d'eau pouvant
impacté sur la croissance de la plante. c'est l'exemple de la culture du
pastèque en ce sens que lorsqu'on sème après trois jours
sans pluie, l'on est contraint de resemer. L'autre methode d'irrigation est
celle par gravité qui consiste à élargir le sommet des
bions afin de retenir de l'eau et la stabiliser. Donc l'obtention de la
méthode d'irrigation par aspersion à travers le motopompe et par
gravité restent meilleures pour certains agriculteurs. La franche de 29%
des paysans pensent l'irrigation par aspersion et par gravité ne sont
pas fiable en raison de la distance de la parcelle par rapport à un
cours d'eaux.

Source : Cliché Peteptiatsop Udice, 9 mars
2019 à 8 h.
Planche 2 : Irrigation à
Barfack
Il ressort de la planche 2 que nombreux sont les paysans qui
optent pour l'irrigation par aspersion à travers les motopompes. Cette
photo fait reference au champ de tomates et d'aubergines. En effet dans le
temps cet irrigation favorise une bonne croissance de la plante en saison
sèche mais aussi au les mois de Mars et Avril de la saison
sèche
III.1.2.5. L'usage de la technique de semis dans les
sions
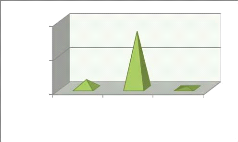
100%
50%
0%
ceux qui
sème dans
les çions
ceux qui
sème sur
les bions
pas de reponse
Source : Enquête de terrain 2019
Figure 33 : Réponse des agriculteurs sur
les méthode de semis à Bagam
La figure 33 nous montre les pourcentages des paysans sur la
pratique de semis à Bagam. Il ressort de notre enquête de terrain
que 13% des paysans sèment actuellement sur les sions que sur les bions
alors que 84% des paysans ont toujours semer sur les bions parce que
dépassé par la
50
sècheresse agricole. En effet, semer dans les sions
pour certains paysan constituerait un moyen de lutte contre la
sècheresse agricole dans la mesure où des fortes pluies
s'accompagnaient d'une bonne quantité d'eau dans les sions. Ce qui
permet à ce que la plante ne soit pas en manque d'eau même pendant
les séquences de 7 à 10 jours de pluie car l'eau tariée
dans les sions ne cesserait de faciliter la croissance normale de la plante. On
note par consequent qu'au mois de Mai où les quantités de pluie
sont suffisantes pour la plantes, les agriculteurs transforment ces sions en
bions.
III.1.3.6. L'usage de l'insecticide après les pluies
précoces
Cette stratégie est plus utilisée dans le
domaine du maraicher en cas de pluie précoce. La Figure 34 nous
renseigne sur le pourcentage des agriculteurs sur l'utilisation de
l'insecticide après les pluies précoces de Février.

10%
90%
ceux qui applique l'insectide
ceux qui n'applique pas l'insectide
Source : Enquête de terrain
2019
Figure 34: Réponse des agriculteurs sur
l'utilisation de l'insecticide
Il ressort de cette figure 34 que 90% contre 10% des
agriculteurs pratiquant dans le maraicher applique de l'insecticide au
lendemain des pluies précoces notamment au mois de février ce qui
permet d'éviter les échecs lors de la récolte tel que la
pourriture des tomates. Nous prenons l'exemple du DDADER de Bamboutos en 2018
dans lequel le village Bagam à enrégistré le
flétrissement et les attaques des chenilles sur la tomate.
III.1.3.7. La plantation des avocatiers
gréffés comme pratique paysanne
Pour pallier au problème de déforestion à
Bagam, la majorité des paysans optent pour la plantation des avocats
gréffés. Bagam doué d'une superficie de 291km2 avec
beaucoup de terre non esploité par les paysans, plusieurs d'entre eux se
tourne vers ce domaine pour les fins climatiques et commerciales.
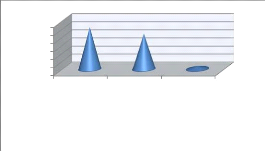
40%
60%
50%
30%
20%
10%
0%
pourcentage
de paysans
qui
plante
l'avocat
gréffés
pourcentage de paysans qui ne plante pas l'avocat
gréffés
pas de réponse
51
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 35: Réponse des paysans sur la
plantation des avocats gréffés à Bagam
Il réssort à la figure 35 que 52% contre 44% des
paysans optent pour la plantation des avocats gréffés non
seulement pour faire face à la variabilité climatique mais aussi
pour le commerce en ce sens que Bagam fait face aujourd'hui à l'abbatage
des arbres qui conduit à la deforestation par conséquent la
présence de la chaleur dans cette localité. Donc la chaleur qui
sévit dans Bagam dépuis ces année est aussi liée
à la déforestation raison pour laquelle 52% des paysans plantent
au quotidien les avocats gréffés.

Source : Cliché Peteptiatsop Udice, 10 mars
2019 à 8h Photos 2: Plantation des avocats gréffés
à Ngoyock
La photo 2 nous renseigne sur la stratégie de
plantation des avocats gréffés dans le village Ngoyock. Il
ressort que cette plantation est étendue sur un hectare et demi. En
effet ladite plantation est considéré comme source de commerce
mais également un moyen de lutte contre le rechauffement climatique par
les paysans.
III.1.3.8. Diversification des activités
Au regard de la diversification des activités
utilisée comme moyen d'adaption par les paysan, il ressort que 60%
contre 40% des paysans dans le temps présent diversifient leurs
activités afin d'accroitre les rendements. Certains pratiquent le
vivrié en saison pluvieuse puis en saison sèche, ils migrent pour
le maraicher. On souligne que certains optent également pour la culture
du maîs
52
et du haricot en deux cycle. Nous avons aussi constaté
que la plupart des femmes pratiquent l'activité agricole puis la
période de repos. c'està dire d'Octobre à Novembre, elles
se livrent dans le commerce de rue ou le commerce de détail
(figure36).
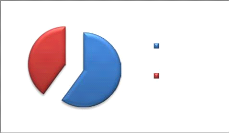
40%
60%
Diversification des activités
Pas de
diversications
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 36 : Réponse des paysans sur la
diversification des activités
IV.1.4. La transhumance Bovine
L'élevage bovine à Bagam est très
développé et diversité. Ce qui créait les conflits
entre éleveurs et agriculteurs. Compte tenu du dérèglement
climatique, beaucoup d'éleveurs nomades appelés Bororos sont
obligés de quitter leurs zones de pâturage pour d'autres zones
plus prometteuses pour la pâture en saison sèche.
Il y'a il transhumance n' y'a pas bovine transhumance Pas bovine
reponse
Source : Enquête de terrain 2019
Figure 37 : Pourcentage de Réponse sur la
transhumance bovine à Bagam
.
La figure 37 nous amène sur le pourcentage de personnes
sur la transhumance bovine. Il
découle du graphique que 95% contre 0% de personnes
estiment que depuis longtemps il y'a transhumance des boeufs mais plutôt
de petite quantité. Actuellement, accentué par les
phénomènes climatiques, ils sont obligés de faire
transhumer tous les boeufs en saison sèche dans les zones à
pâture importante. On note aussi que toujours dans cette localité
la majorité des éleveurs nomades quittent leurs destinations pour
les zones comme Menfoung, Kiéneghang, Meloundoung, Fadamaré,
même jusqu'au Noun.
53
III.1.5. La migration comme pratique paysanne
|
80% 60% 40% 20%
0%
|
|
|
il y'a migration climatique
|
il n y'apas
migration
climatique
|
pas de reponse
|
Source : Enquête de terrain 2019
Figure 38: Pourcentage de Réponse sur la
migration climatique à Bagam
La figure 38 présente le pourcentage de réponse sur
la migration climatique. Il ressort que 67% contre 30% des paysans estiment
qu'il y'a pas de migration liée au climat depuis les longues
années mais plutôt une migration saisonnière à la
recherche du bien vivre de certain paysan estimant que le bonheur se trouve
plutôt en ville notamment à Douala et Yaoundé mais aussi
des jeunes qui migrent en ville universitaire pour les raisons d'étude.
On constate aussi une polémique selon laquelle la migration climatique
serait liée à la paresse parce que vue les nombreuses
activités que regorge la zone rurale, l'on devrait s'adapter, supporter
cette nouvelle donnée climatique au lieu de migrer. Cependant la
migration climatique dans la localité de Bagam concerne plus les
éleveurs nomades.
III.1.6. Les non-migrants climatiques
D'après la figure 67, l'on comprend qu'il y'a assez de
non-migrants climatiques (67% contre 30% des paysans l'ont affirmé). A
ce stade, d'après notre enquête de terrain, il ressort que
beaucoup ne migrent pas parce qu'ils ont déjà une activité
qui leur permet de s'épanouir. Pour d'autres, ce sont les pères
de famille avec beaucoup d'enfants ; donc migrer pour eux c'est assez
délicat parce qu'ils estiment que ce n'est pas la zone d'accueil qui
sera saine. C'est-à-dire sans cette modification du climat car la
variabilité climatique est générale.
III.1.7.Création des associations
Dans la localité de Bagam plusieurs associations ou Gic
sont crées dans le but d'un intérêt commun. C'est l'exemple
du Gic Ameb, Apmo, Aparo à Kiénéghang font dans la
production du maîs et du haricot dans l'optique de d'augmenter les
rendements. En 2018, au cours du semestre les activités se sont
déroulées sans aucune difficultés majeures. Cependant les
pluies précoces et violentes ont été à l'origine de
l'anticipation des semailles. Il faut noter que les principales
activités ont été le semis du maîs et du haricot du
premier cycle, la fertilisation et l'entretien des
54
parcelles, raison pour laquelle ces associations
réfléchissent ensemble et met sur pied des stratégies
communes pour faire face au climat (DAADER).
III.1.8.Epargne et credit alloué par structure
Tableau 12 : financement des projets dans les postes
agricoles
|
Structure
|
Crédit alloué(fcfa)
|
Engagement Au cours de
la période
considerée
|
Cumul Engagé (Fcfa)
|
Reliquat (Fcfa)
|
% de
réalisation
|
Observation
|
|
DAADER
|
840000
|
00
|
00
|
840000
|
0%
|
0% engagement
|
|
Tous les 7 PA
|
424000
|
00
|
00
|
2968000
|
0%
|
0% engagement
|
Source : DAADER de Bamboutos, 2019.
Au regard du tableau 12, nous notons que la DAADER a mis à
la disposition de 7 postes agricoles de la localité une somme 424 000F
dont le credit alloué 840 000F afin d'investir dans le domaine et le
rendement agricole de la localité.
III.1.9. Le role de l'Etat et les société
civiles dans la mise en place des stratégies
-Subvention au paysan.
Tableau 13: Suivi des programmes/ projets
prioritaires du document de stratégie de la réduction de la
pauvreté (DRSP).
|
Programme s/
projets
|
Nombre d'encadreur
|
Indicateurs d'activités
|
Prévues
|
Réalisées
|
Réalisatio n
%
|
Observations
|
|
PNVRA
|
|
|
|
|
|
|
|
ACEFA
|
|
Nombre de projet financés
|
05
|
02
|
|
8500000
|
|
PAUEF2C
|
01
|
Quantité engrais reçue
|
|
10 sacs
|
|
|
|
Projets agropole riz pluvial
|
00
|
Quantité de riz produite
|
Mal connu
|
200ha
|
Mal connu
|
|
Source : DAADER de Bamboutos, 2019.
Le tableau 13 stipule que Le projet agropole riz pluviale dans
la localité de Bagam a reçu un financement donc nous ignorons la
nature et la hauteur. Il a mis en place 100 ha en 2013 et 2014, faute des
difficultés liées au séchage, le gestionnaire a dû
acheter un groupe électrogène donc la
55
consommation a été exorbitante pour faire
fonctionner le système. Comme solution ; le projet a
bénéficié d'un financement de l'État pour
l'installation d'une ligne triphasée qui n'a jamais été
réalisée. Il est à noter que la production de 2013 et 2014
a été bradé à UNVDA « Upper Noun Valleys
Development Authorities » dans le Nord-Ouest de peur de perdre
entièrement à cause de la moisissure (DAADER).
III.2. Les contraintes dans la pratique paysanne
Malgré les multiples pratiques effectuées par
les paysans, nous relevons que ces dernières trouvent des insuffisances
pour faire face au climat.
III.2.1. Insuffisance d'information sur l'évolution
le climat
L'absence de la station météorologie dans la
localité de Bagam constitue un frein dans l'étude du climat.
Cependant les paysans les paysans ont cette difficulté de s'informer sur
l'évolution de la température, la pluviométrie,
l'évaporation et l'évapotranspiration.
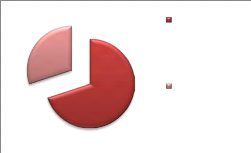
30%
70%
la station météo a une place importante dans
l'étude des perceptions
la station météo n'est pas importante dans
l'étude des perceptions
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 39: Réponse des paysans sur
l'importance de la station météo
Au regard de la figure 39, 70% des paysans estiment
l'insuffisance de l'information sur le climat est dû au fait qu'il n'y'a
pas de station météo dans la localité car la station
météo occupe une place importante dans le perfectionnement du
climat perçu. Cependant la franche de 30% des paysans pensent qu'ils
sont assez informés sans la météo. Il ressort donc que les
paysans ne sont pas suffisamment informés sur cette péjoration
climatique.
III.2.2. Problème d'encadrement des postes
agricoles
La campagne de Bagam est confrontés à plusieurs
difficultés notamment le manque de moyens de locomotions pour certains
CPA, les difficultés pour certains postes agricoles d'acquérir un
site mais aussi le mauvais état des routes et des pistes de collecte. On
constate qu'en dehors du climat, les postes agricoles de Bagam font face
à des multiples problèmes.
56
Conclusion partielle
Dans ce chapitre, il était question de présenter
l'opérationalité des pratiques et croyances paysannes dans le
cadre de l'adaptation à la variabilité climatique. Il ressort que
les paysans dans leurs pratiquent tentent de demontrer qu'ils font face
à la variabilité climatique. Ces pratique sont notamment
liées au système climatique, culturel, agricole. Certes, il faut
noter que dans l'opérationnalité des pratiques, l'on se demande
toujours si c'est le paysan qui dérègle le climat ou c'est le
climat qui dérègle le paysan à Bagam.
57
CHAPITRE IV: LE CLIMAT PERCU AVEC LES ALEAS CLIMATIQUES
Introduction
L'étude du climat avec les chiffres apporte une
certaine précision dans plusieurs études climatologiques. Il sera
question pour nous dans ce chapitre de vérifier l'hypothèse selon
laquelle il y'a un lien entre le climat perçu et les aléas
climatiques. Il consistera pour nous d'analyser les différents rapports
qu'entretiennent le climat perçu de l'oeil par les paysans et celui des
aléas climatiques. Il sera judicieux donc d'analyser les rapports
climatiques, hydrologiques, biogéographiques et
agricoles.
IV.1.Rapport climatique
Il s'agit ici de confronter la pluie et la chaleur
perçu de l'oeil et ressenti par les paysans aux données
météo afin d'analyser s'il y'a corrélation entre ce que
les paysans ont dit et ce dont la météo
dispose.
IV.1.1. Variabilité pluviométrique
Le regard du paysan :
Suite de la perception fait par le paysan, on remarque
à la figure qu'avant les pluies
revenaient au mois de mars notamment
chaque 15 Mars déclarent 97% contre 3% des paysan tandis que dans le
présent la plupart des cas c'est en Février que les pluies
reviennent ; affirma 96% contre 4% des paysans.
La station météo :
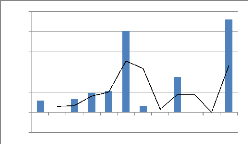
100
-20
40
80
60
20
0
11,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
13,1 18,9 21
80,7
6 0
35
0 0
91,8
Source : Station météo Bamendjing
2019
Figure 40 : Variation de pluie du mois de
Février (2007-2018)
La figure 40 nous montre la variation interannuelle des pluies
du mois de Février. Certes la présente figure malgré que
nous n'avons pas eu les échéances des années en dessous de
2007, il ressort qu'en 2007, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 on note la
présence des pluies au mois de Février d'ailleurs qualifié
de pluies précoces alors que 2008, 2014, 2016 et 2017 sont des
années au mois sec comme l'indique l'Indice de Gaussen (p< 2t). On
note également que
58
l'année 2018 regorge une pluviométrie
élevée de 91,8 mm de pluie par contre en 2013 on a
enregistré 6 mm. Au regard de tout ceci, l'évidence montre que
les paysans ont raison de resté dans cette embrouille parce que la
tradition était que les pluies revenaient qu'en Mars. Nous comprenons
à ce stade qu'actuellement il y'a cette variation des retours des
pluies.
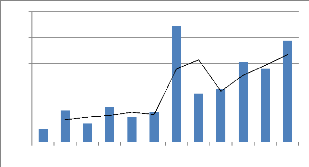
250
200
150
100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60,4
25,3
66,9
35,4
48 58
222
92,5 102,5
153,25
140,3
194,1
Source : Station météo Bamendjing
2019.
Figure 41: Variation interannuelle des pluies du
mois de Mars (2007-2018)
La figure 41 fait part des variations de pluviométrie
au mois de Mars. Il ressort que de 2007 à 2018, le mois de Mars a
été marqué par la présence des pluies c'est
l'instar de 2013 qui regorgeait une pluviométrie de 222 mm par contre
2007 avaient 25,3 mm de pluie en Mars. On comprend que pendant ces multiples
années, la quantité des pluies reçu au mois de Mars varie
d'une année à l'autre en ce sens qu'entre 2008 à 2012, la
tendance était constante puis de 2012 à 2014, elle était
croissante avant de décroitre jusqu'en 2015. Cette tendance connaitra
une légère croissante en 2018.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire
que les données obtenues à la station météo
montrent qu'il y'a retour des pluies au mois de Février notamment les
années citées à la figure 41. Cependant on constate des
variations et irrégularités pluviométriques
observées pendant ces années écoulées. Tout compte
fait le regard du paysan est en lien approximatif de celle de la station
météo.
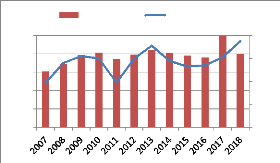
2500
2000
1500
1000
500
0
Pluviometrie Jour pluvieuse
180
160
140
120
100
59
Source : Station météo Bamendjing
2019.
Figure 42 : Relation interannuelle entre la
pluviométrie et les jours pluvieux (2007-2018)
La figure 42 porte sur la relation entre la
pluviométrie et le nombre de jours de pluies à Bagam. Il est
à noter que la pluviométrie interannuelle varie de 1500 à
2500 mm tandis que le nombre de jours de pluie va de 140 à175 jours.
Nous constatons que le nombre de jours pluvieux varie en fonction de la
pluviométrie. C'est l'exemple de 2007 où la pluviométrie
était à 1500 mm avec le nombre pluvieux de 140 jours. 2011 a
enregistré près de 1800 mm de pluie avec 140 jours pluvieuse, ce
qui peut se justifier avec les séquences mensuelles actuelle de 5
à 7 jours de pluie affirmé par le paysan tandis que pendant les
années 2015, 2017 et 2018 leurs pluviométrie étaient
conséquent du nombre de jours de pluie c'est-à-dire au fur et
à mesure que la pluviométrie augmente, le nombre de jour
pluvieuse augmente également dans cette localité. Au regard de
tout ce qui précède nous disons que la pluviométrie et le
nombre de jour pluvieuse sont inégalement répartie au fil des
années.
IV.2.2.Variabilité de la température
Le regard du paysan :
D'après la figure 43 les paysans pensent que la
température dans le temps était modéré affirme 61%
contre 39% des paysans tandis que dans le temps présent la
température connait plutôt une hausse attestent 96% contre 4% des
paysans en soulignant qu'il fait plus chaud depuis ces 3 décennies.
60
La station météo stipule :
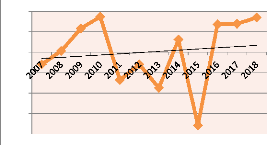
-0,5
-1,5
0,5
-1
-2
0
1
y = 0,0292x - 0,1848
R2 = 0,0164
Source : Station météo Bamendjing
2019.
Figure 43: Anomalie interannuelle de
température (2007-2018)
La figure 43 nous montre les anomalies interannuelles de
température à Bagam, Nous comprenons que 2008, 2009,2010, 2014
puis de 2016 à 2018 sont des années comportant les anomalies
positives tandis que 2007, 2011, 2012, 2013 et 2015 ont des anomalies
négatives.
Cependant il est à noter que entre 2008 à 2010,
la température était élevé puis de 2011 à
2015, elle était faible ; et depuis 2016 à 2018, cette même
température était élevée. Ce qui justifie la
chaleur qu'accuse les paysans depuis ces 03 dernières années
l'attribuant pour certain à la variabilité climatique et pour
d'autre à un phénomène naturel en ce sens que le retour
des pluies est marqué par la présence de la chaleur. Cette
idée épouse celui du rapport de l'organisation
météorologique (2019) qui stipule qu'il y'a une hausse de
température à l'échelle globale entre 2016 à
2018.
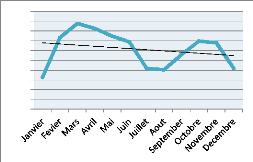
23,5
22,5
21,5
20,5
19,5
18,5
23
22
21
20
19
y = -0,0592x + 21,956
R2 = 0,0544
2007
2011
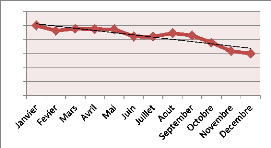
30
25
20
15
10
0
5
y = -0,7965x + 26,369
R2 = 0,8041
2016
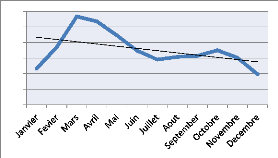
y = -0,1435x + 23,479
23
25
24
22
21
20
19
R2 = 0,2149
61
Source : Station météo Bamendjing
2019.
Figure 44 : Evolution des températures
2007, 2011 et 2016 à Bagam
La figure 44 Montre l'évolution de température
de 2007, 2011 et 2016. De manière générale la
température dans la localité de Bagam a des courbes
évoluant en dent de scie dont les fluctuations sont marquées au
mois de (Février, Mars et Avril). On note qu'en 2007 la
température variant entre 20 à 22,66°C, était de
22,16°C en Février alors qu'en Mars elle était de
22,87°C puis 22,62°C en Avril. Cependant en 2011 variant entre 15
à 25°C, le mois de Février regorgeait 23,11°C, Mars
enregistrait 23,82°C ; par contre, Avril enregistrait 23,68°C. En
2016 Variant entre 21 à 24,66°C, on note une augmentation de
température en Février estimé à
22 ,69°C, en Mars elle était de 24,66°C puis
en Avril était de 24,35°C. On constate que plus les années
passent plus la température augmente à l'ordre de 1°C. Tout
compte fait cette évolution est liée à la chaleur que
vivent les paysans depuis ces dernières années notamment au mois
de Février, Mars et Avril.
IV.2. Rapport hydrologique
62
Nous allons à ce niveau, mettre en relation les
sècheresses hydrologiques, météorologiques perçu
par les paysans en 1998, 2007, 2009, 2012 et 2015 aux variations interannuelles
de précipitation de 2007 à 2018.
IV.2.1. L'inondation dans le temps et l'espace
Le regard du paysan :
L'inondation à Bagam est plus récurrente au mois
d'Aout et Septembre dans les zones de Bas-fonds.

20%
7%
73%
il y'a inondation
il n'ya pas inondation
Pas de reponse
Source : Enquête de terrain
2019.
Figure 45 : Réponse de la population par
rapport à l'inondation dans le temps et l'espace à
Bagam.
D'après cette figure 45, 73% contre 20% des paysans
estiment qu'il y'a inondation dans le temps et l'espace en particulier dans les
Bas-fonds ceci après de forte pluie du mois d'Aout et
Septembre.
IV.2.2. Sècheresse hydrologique et
météorologique
La nature des cours d'eaux suite au regard des paysans
démontre qu'en 1998, la notion de sècheresse hydrologique et
météorologique n'était pas accentué. On a
également constaté que cette situation est devenue
préoccupante pendant les années 2007, 2009, 2012 et 2015
où cette sècheresse était bien visible. Il faut noter que
cette visibilité est penchée sur le niveau du lit de certains
cours d'eaux particulièrement au mois de Mars, Avril et Mai de la saison
pluvieuse parfois accentué par des fortes sècheresses de
Décembre et Janvier .
La station météo :
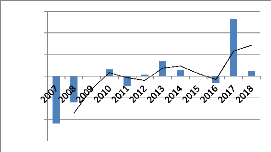
-200,00
-400,00
-600,00
400,00
600,00
200,00
0,00
-439,00
-244,10
63,70 2,30
-94,20
13,00
136,50
52,90
-1,70
-63,85
525,79
48,60
63
Source : Station météo
Bamendjing, 2019
Figure 46: Variation interannuelle des
précipitations à Bagam (2007-2018)
Au regard de la figure 46, Nous constatons que le paysan n'est
pas loin de la réalité car la météo stipule que
2007, avec une pluviométrie de -439,00, 2008, 2011 et 2016 ont une
tendance négatives par rapport à la normale car c'est une
année déficitaires ; par conséquent ont fait face à
la sécheresse hydrologique et météorologique. On remarque
également que certaines années appartenant aux anomalies
positives enregistrent les faibles quantités des pluies notamment
2009, 2012 et 2015.
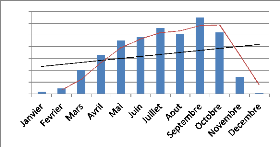
350
300
250
200
150
100
50
0
y = 8,4822x + 108,12
R2 = 0,0693
Figure 47: Variabilité mensuelle de pluie à
Bagam (2007-2018)
Source : Station météo Bamendjing,
2019.
La figure 47 porte sur la variabilité mensuelle de
précipitation à Bagam, nous constatons que le mois de Juillet,
Aout, Septembre et Octobre sont des mois exposé au risque d'inondation
sur des espaces situé sur des basse altitudes notamment les Bas-fond.
Donc ces données pluviométriques sont liées à
l'inondation que vit certain paysan au mois d'Aout et septembre.
IV.2.2. Le déficit d'eau dans le temps et l'espace
Le Regard du paysan :
Il ressort de la figure 48 qu'avant avec les pluies
régulières, on assistait à une quantité suffisante
en eau au mois de Mars, Avril et Mai, a une abondance en mois d'Aout, septembre
et
64
Octobre. On note qu'actuellement que le mois de Mars, Avril
parfois Mai connaissent un grand déficit d'eau.
La station météo :
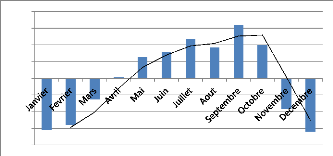
-100
-150
-200
200
150
100
-50
50
0
Source : Station météo Bamendjing
2019
Figure 48: Anomalie Mensuelle des pluies à
Bagam (2007-2018)
La figure 48 fait remarquer une perturbation mensuelle des
pluies pendant ces années. On note qu'à travers les pluies, on a
déficit d'eau pendant la saison des pluies au mois de Mars, Avril et
Novembre. Ce qui conduit parfois à l'assèchement de certain cours
d'eau. Par contre l'abondance d'eau surgit dans cette localité qu'en
Juillet, Aout et Septembre traduisant le tarissement de certains cours d'eaux.
Nous voyons que le déficit et l'abondance d'eau dont souligne le paysan
est en lien avec les anomalies pluviométriques mensuelles de 2007
à 2018. IV.3. Rapport biogéographique
Il s'agit pour nous de mettre en relation l'évolution
de la végétation perçu par les paysans et
l'évolution de la carte de végétation des années
1998 et 2018.
IV.3.1. La variabilité au niveau de la
végétation
Le regard du Paysan :
La présente figure 50 nous montre l'évolution de
la végétation dans le temps et l'espace. Il ressort que la
végétation naturelle dans le passé a subi de
perpétuelle mutation tant sur la disparition de certains plantes mais
aussi la présence de mauvais herbes. Donc le paysan affirme que la
végétation a changé qu'il y'a des choses qui existaient
avant mais qui n'existe plus aujourd'hui.
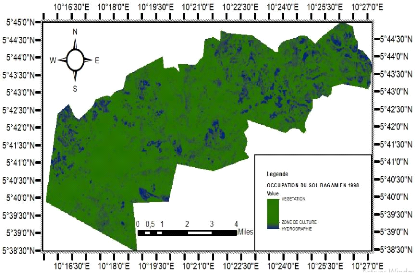
65
Source : Laboratoire de cartographie,
2019
Figure 50: Carte de la végétation et
l'hydrographie de 1998
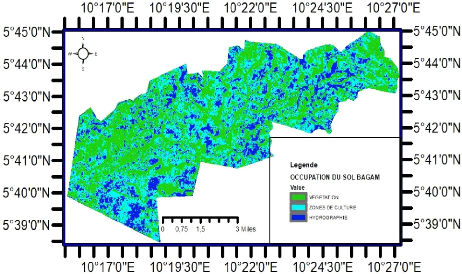
Source : Laboratoire de cartographie,
2019
Figure 51: Carte de la végétation et
l'hydrographie de 2018.
Au regard de ce qui précède, la figures 50 et 51
nous fait part de l'évolution de la végétation de 1998 et
2018. Il ressort de ces deux cartes qu'en 1998, la végétation
était très dense ce qui peut justifier le regard du paysan sur le
fait qu'avant il existait beaucoup de plantes et d'arbres,
66
les zones de cultures étaient faiblement dense. Ceci
concorde avec le PDL de Bagam qui stipule que cette «
végétation est constituée de formations sub-montagnardes
associées à des savanes arbustives et herbacées, des
forêts raphiales dans les bas-fonds, les forêts galeries autour des
cours d'eaux et des forêts sacrés conservées depuis des
siècles grâce à la tradition » tandis
qu'en 2018 on constate que sous l'effet du climat et les raisons agricoles la
végétation est devenue peu dense en ce sens qu'on note la
disparition de certains plantes et arbres. « Cette
végétation laisse place en majeure partie à des cultures
vivrières. Les cultures de rente et pérennes » PDL de Bagam.
On note dès lors que la végétation a été
impactée à travers le climat mais aussi l'agriculture.
IV.4. Rapport agricole
Nous allons nous focalisé sur le rapport entre la
sècheresse agricole et les anomalies mensuelles des pluies mais aussi
nous mettrons en exergue la baisse de rendement avec Agri stat et une
corrélation entre les statistique agricole avec la pluviométrie
et la température.
IV.4.1. La sècheresse agricole
Le regard du paysan
A travers cette figure 52 le paysan estiment qu'avant la
notion de sècheresse agricole n'existait pas mais actuellement elle
constitue un casse-tête pour le paysan.
La Station météo :
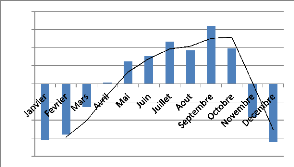
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
Source : Station météo
Bamendjing 2019
Figure 1: Anomalie mensuelle de
pluviométrie à Bagam (2007-2018)
La figure 52 nous renseigne sur les anomalies
pluviométriques à Bagam de 2007 à 2018. Il ressort
qu'à travers une insuffisance de pluie enregistrée au mois de
Mars et Avril, les plantes par déficit d'eau s'assèchent
progressivement pour ne reprendre sa bonne croissance qu'au mois de Mai. Donc
cette sècheresse qu'accuse le paysan concorde avec la station
météo en ce sens qu'on observe de manière
générale que le mois de mars et Avril enregistrent les anomalies
pluviométriques négatives.
67
IV.4.2. Baisse de rendement
En rapport avec la figure 52, nous pouvons dire que le baisse de
rendement apparait à partir du moment où par manque de pluie,
situé sur des montagnes la plante perd sa croissance normale par
conséquent il y'aura baisse de rendement.
Tableau 14 : Mise en place des cultures, pression
parasitaire, incidence sur les cultures et prévisions de récoltes
PA 2018.
|
Spéculation
|
Période de
mise en
place
|
Pression parasitaire observée
|
Superficie
|
Solutions prodiguées
|
Incidence sur les cultures et prévisions des
récoltes
|
observation
|
|
Maïs
consommé
|
Février- Avril
|
Passage des
chenilles
(laves des
papillons
|
53 ha de pannar 12
|
Traitement
|
Baisse e
rendement
|
Avec les
pluies elles ont disparu
|
|
Tomate
|
Février- Mars
|
Flétrissement
et attaques
des chenilles
|
4,32ha
|
Jachère,
alterner les
produits de
traitement
|
Baisse de
rendement
|
|
|
Piment
|
|
Flétrissement
|
4,5ha
|
jachère
|
Baisse de
rendement
|
|
Source : DDADER de Bamboutos, Enquête de
terrain 2019
Le tableau 14 nous renseigne par rapport à
l'état d'avancement de la campagne en termes de la production en
denrée agricole. Les résultats enregistrés nous montrent
une baisse de rendement presque dans tous les différents types de
cultures (Maïs, tomate et piment). Il en découle que cette baisse
de rendement en 2018 est liée au fait que la rentrée des pluies a
eu lieu en mi-Février ce qui a favorisé la bonne levée du
maïs mais les vents ont occasionné la versée des plants de
bananier sur la quasi-totalité du village. L'on note également la
présence des chenilles qu'a fait mention le paysan qui ne cesse de
perforer les plants par conséquent contribue d'une manière
à une autre à une baisse de rendement.
-La corrélation de Pearson
Tableau 15: Corrélation de Pearson
|
Test des variables
|
Corrélation de
Pearson (r)
|
Coefficient de
détermination (r2)
|
Contribution dans le changement(%)
|
|
Pluviométrie (mm) et mais (tons)
|
0,71
|
0,504
|
50.41%
|
68
|
Température (°c) et
|
0,413
|
0,17
|
17.06%
|
|
mais(Tons)
|
|
|
|
Source: Agri stat et station
météo Bamendjing 2019.
La corrélation de Pearson nous a permis de faire une
corrélation entre la production agricole de 2000 à 2008 et les
données climatiques de 2007 à 2018. Il ressort de ce tableau 11,
que la pluviométrie à une forte influence sur la production
agricole avec un taux de contribution de changement de 50,41% avec 0,504 comme
coefficient de détermination alors que la température contribue
à une faible influence d'ordre 17,06%. On note dès lors qu'il y'a
d'autre facteurs influençant sur la production agricole comme le manque
de fertilisant.
Conclusion partielle
En définitive, il était question dans ce
chapitre d'établir une corrélation entre le climat perçu
de l'oeil avec les aléas climatique. Il ressort que le climat
perçu par les paysans est approximativement liée à celui
de la station météo notamment les irrégularités
pluviométriques qu'il évoque a été analysé
au niveau de la variabilité interannuelle des pluies issu de la station
météo mais également la chaleur, la sècheresse
agricole qu'ils ont évoquée ont été
approuvés par les anomalies mensuelles des températures de la
station. Tout compte fait certains indices soulevés par le paysan ne
sont pas pris en compte par la station météo
69
CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES
Au demeurant, il ressort qu'à l'état actuel de
la question de la Variabilité climatique au Cameroun, il ne fait aucun
doute que cette question est réellement préoccupante au regard
des différents avis recueillis dans plusieurs communautés
notamment de la localité de Bagam. Ces populations ne cessent de vivre
cette hausse de chaleur et ces irrégularités
pluviométriques depuis ces dernières années. Il faut
rappeler qu'avant les paysans étaient satisfait du climat ; par contre,
actuellement ils ont un penchant négatif sur cette notion. Il
était donc question pour nous dans la réalisation de cette
étude de comprendre dans quelle mesure les perceptions paysannes sur la
Variabilité climatique influencent les activités sociales et
spatiales en milieu montagnard. Ce qui nous a conduits à quatre
hypothèses suite aux quelles les résultats ont été
vérifiés.
La première hypothèse stipulait que les facteurs
physiques et humains sont favorables dans l'étude de la perception
paysanne de la variabilité climatique où notre objectif principal
était de présenter les éléments physiques et
humains qui permettent l'étude de la perception par les paysans. Au
sortir de ces résultats, nous avons énuméré comme
élément physique, le climat, le relief, le sol, la
végétation et l'hydrographie tout comme les
éléments humains nous font part de la démographie, le
peuplement ainsi que les activités économiques
prédominantes de la localité comme l'agriculture et
l'élevage. On note donc que tous ces éléments subissent de
l'influence climatique perçu par les paysans.
La deuxième hypothèse nous renseigne sur
l'impact de la perception paysanne sur leurs activités sociales et
spatiales. En effet, il a été question pour nous de faire un
état de lieu sur la Variabilité climatique où nous avons
constaté que cette notion est une réalité à Bagam.
Comme résultat nous notons que 92% contre 3% des paysans ont
estimé qu'il y'a variabilité climatique à Bagam. Certain
l'attribuant à un phénomène naturel, d'autres voyant
plutôt la sorcellerie ou une conséquence de la colère de
Dieu comme explication à ce phénomène. Dans la poursuite
de la mise en évidence de ces perceptions locales de la
variabilité climatique, il ressort également qu'avant, le retour
des pluies étaient en Mars notamment chaque 15 Mars (97% contre 3% des
paysans l'ont affirmé), puis on enregistrait 14 séquences
journalières de pluies ; par contre, actuellement, ce retour des pluies
est plus remarqué en Février (96% contre 4% des paysans l'ont
affirmé) avec les séquences pluvieuses de trois à cinq
jours. Il ressort aussi qu'avant la température était
modéré (61% des paysans l'ont attesté), accompagné
de deux jours de séquences sèches tandis qu'actuellement on a une
hausse de température (96% des paysans ont attesté) avec une
séquence de 14 jours de sècheresses. On note aussi que
l'érosion a toujours existée dans le temps et l'espace puis le
glissement de terrain dans le temps et l'espace n'est pas trop pris en compte,
l'état de la végétation montre que certaines
espèces de plantes ont disparu au
70
fil des temps à l'instar de la pastèque ; mais
également les oiseaux migrateurs qui ont toujours migré au
début de la saison sèche. Les espèces d'insectes dans le
temps par rapport à ce jour ont disparu comme le grillon, l'caneton
alors qu'actuellement on note la présence des chenilles, les termites.
Il ressort que l'abondance d'eau conduit à l'inondation ou tarissement
des cours d'eau alors que le déficit favorise plutôt
l'assèchement de certain cours d'eau.
La troisième hypothèse stipulait sur
l'opérationnalité des pratiques et croyances des paysans face
à la Variabilité climatique. Il ressort qu'en réponse
à cette Variabilité climatique de la température et des
précipitations, les populations font recours à des pratiques
d'adaptation dans presque tous les domaines de production. Bien que certains de
ces pratiques soient efficaces, leurs adaptations restent limitées par
des contraintes matérielles, financières et techniques. Ces
contraintes sont aussi liées à l'accès à
l'information des paysans.
La quatrième hypothèse attestait qu'il y'a un
lien direct entre le climat perçu et les aléas climatiques. Elle
vise à faire une corrélation entre les perceptions paysannes et
les aléas climatiques. Les résultats obtenus montrent qu'il y'a
un lien direct notamment entre le retour de pluie des paysans et les
irrégularités pluviométriques de la station
météo, la chaleur qu'accuse les paysans et les anomalies de
température de la météo mais aussi au niveau de
l'abondance et déficit d'eau en liaison avec la variation mensuelle des
températures. La nécessité de rendre plus accessible et
facilement réalisable ces stratégies d'adaptation contribueront
certainement à rendre plus durable les effets de ces pratiques d'une
part et d'autres part faciliterait leur diffusion sur l'étendue du
territoire. L'insécurité alimentaire dans certains ménages
pourrait être améliorée
Pour résoudre le problème soulevé par
notre thématique, nous avons relevé un certain nombre de
perspectives sur divers plans dans le but de faciliter une bonne
compréhension du climat dans la localité de Bagam. Ces
perspectives pourront à l'avenir permettre la prise en compte de tous
les intervenants dans la chaine climatique avec un impact positive sur
différentes activités. Il s'agit de quelques perspectives sur le
plan politique, économique et technique.
Au plan politique
? L'adaptation à la variabilité climatique doit
se faire localement et doit se baser sur les connaissances et les pratiques
locales. Il s'agit d'associer les villageois à l'élaboration de
la politique d'adaptation afin que celles-ci intègrent davantage dans
les moeurs locales.
? Pour mieux perfectionner les perceptions paysannes dans les
campagnes, la création d'une station météorologique dans
la localité serait profitable pour tous dans l'enregistrement des
données.
71
> Le service de gestion des catastrophes naturelles
aujourd'hui encastré au ministère de l'administration
territoriale doit aussi s'intéresser aux champs agricoles ravagés
par les oiseaux granivores ou autres mollusques comme les chenilles
désolatrices. Ce service doit être isolé de ce
ministère pour que son action soit de plus en plus visible
particulièrement dans la localité.
> Les campagnes de sensibilisation doivent être
menées auprès des paysans sur la réduction de
l'utilisation des pesticides pour réduire les risques de
dégradation du sol.
Au plan économique
> Nous avons constaté la non implication des
chercheurs ou spécialistes du climat dans le développement rural.
Nous invitons donc les pouvoirs publics à soutenir la recherche dans le
domaine afin d'encourager ceux-ci à s'investir davantage dans ce plan de
développement.
> Au regard des coûts élevés des
intrants et les produits phytosanitaires sur le marché, nous implorons
l'Etat à subventionner ces produits qui pourra soulager la plupart des
paysans aux abois dans la localité. Il s'agit précisément
de ceux spécialisés dans le vivrier mais aussi le maricher.
> L'amélioration des prix des denrées et une
quête de stabilisation par l'Etat fera la fierté des agriculteurs
et leurs motivera davantage à mieux investir dans le domaine.
Au plan technique
> Il faut modifier le calendrier agricole. Les semis
doivent être mis au sol durant le mois où les pluies sont
régulières et le mois d'Avril semble approprier pour ce
changement de calendrier ; il s'agit d'harmoniser le calendrier agricole qui
doit être accepté par tous à travers une forte
sensibilisation.
> Faire une reforme semencière. L'on voit là
une refonte des semis et une redistribution aux paysans des semences
résistantes aux maladies cryptogamiques.
>
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1- Ouvrages et rapports
ANOUGUE T, BETGUIRO N, (2013)., « rapport de l'étude
sur la vulnérabilité des communes de la région de
l'Extrême Nord aux effets des changements climatiques », 106p.
CECILIA T AND RICHARD (2010)., gender, poverty and migration.
CHAMPAUD J (1983)., villes et campagne du Cameroun de
l'Ouest, Édition de l'ORSTOM, Paris, collection Mémoire.
CHAMPAUD J, (1980)., Genèse et typologie des villes du
Cameroun de l'Ouest .
72
CHARLES E, (2009)., Migration au Cameroun : Profil
national 2009, Préparé pour l'OIM, 109 P.
DERRUAU M (1976)., géographie humaine, Paris,
Armand colin.
DOMINIQUE S, (1986)., les bases de la production
végétale, collection sciences et techniques agricoles, Tome
I, 463p.
DOMINIQUE, S (1984)., les bases de la production
végétale, collection sciences et techniques agricoles, Tome
II, 312p.
FAO-ADAPT. « Programme-cadre sur l'adaptation au changement
climatique ».
LIENOU et GIL M, (2005)., Changements des régimes
hydrologiques des rivières du Sud Cameroun : Un impact de la
variabilité climatique en zone équatoriale, IAHS
publ.296.
TSALEFAC M, (2012)., « préparation nationale
à la conférence des nations unies sur le développement
durable (rio+20) », rapport du Cameroun, 44p.
UA (2014), « stratégie africaine sur les changements
climatiques ».
WATANG, Z (2015)., Les enjeux de la prise en compte des
changements climatiques dans les politiques de développement rural dans
la région de l'Extrême-Nord Cameroun.
2-Les mémoires, articles scientifiques et
thèses
Agriguide (2012)., « Les meilleures méthodes de
production biologique appliquées aux cultures vivrières et
marchandes », 122p.
AWANMU (2008)., « Variabilité climatique et
maladies respiratoires dans la ville de Dschang », thèse de Master,
Uds, 128p.
BRENAC, P (1990)., « Evolution de la
végétation et du climat dans l'Ouest-Cameroun », 92-103p.
CARLOS B, ANA R, LUCÍA A, IVÁN C (2011).,
«rural migration in Bolivia: the impact of climate change, economic crisis
and state policy».
CARNEY, D. (1998)., « Sustainable Rural Livelihoods: What
contribution can we make? London: Department for International Development
».
CECILIA T, with BUDOOR B, and SUSANNAH F, (2013)., « urban
poverty, food security and climate change ».
CHANTAL G (1990)., « De la ville au village : Le cas des
Bafou des Hauts plateaux de l'Ouest-Cameroun », Université de
Yaoundé.
CHARITO B AND LORNA V WITH VIOLETA (2009)., « Migration
local development and governance in small towns: two examples from the
Philippines ».
73
DAOUDA H, (2007)., « Adaptation de l'agriculture aux
changements climatiques : Cas du département Téra au Niger
», Mémoire de fin d'études-Université Senghor.
DOUMBIA et DEPIEU (2013)., « perception paysanne du
changement climatique et stratégies d'adaptation en riziculture pluviale
dans le centre Ouest de la Cote d'Ivoire », 4822-4831p. EPKO K (2014.),
« L'impact différencié de l'agriculture de transformations
sur les stratégies
de subsistance : Une étude de cas dans la région du
Sud-Ouest du Cameroun », thèse de Master, Université
d'Utrecht, 108p.
FONING K (2016)., « variabilité climatique et impact
sur les exploitations agricoles paysannes : le versant Est des Monts Bamboutos
: Cas de Babadjou. »
FOTSING, JM (1993).,« Erosion des terres cultivées et
propositions de la gestion conservatoire des sols en pays
Bamiléké », 351-366p.
TSALEFAC M, (1999)., « variabilité climatique,
crise économique et dynamique des milieux agraires sur les Hauts
plateaux de l'Ouest ».
TIDJANI.A.D et al (2016)., « Perceptions de la
variabilité climatique et stratégies d'adaptation dans le
système Oasien de Gouré (Sud-Est du Niger) », 25-37p.
YUFENYUY M, (2016)., « the role of climate variability on
the emergence of malaria among other pathologies in Kumbo North West region of
Cameroon ».
3-Dictionnaires
BRAND & DUBROUSSET M, (1981). Dictionnaire
thématique, Histoire Géographie seconde, Édition
SIREUIY.
BRUNET R& Al, (1993), Les mots clés de la
géographie, Dictionnaire critique, Collection Dynamique du
territoire, Édition Reclus, la documentation française.
Dictionnaire critique des mots de la géographie,
4ème Édition.
4-Webographie
www.rtcc.org/leiden :
consulté le 25 février 2019
www.ascleinden.nl/publications/
climatechange consulté le 6 Mars 2019
http://www.ipcc-data.org-gcm-intro.html
: consulté le 10 février 2019
http://www.cru.uea.ac.uk/data:
consulté le 21 février 2019
georepere.e-monsite.com/.../chap-21-problemes-agriculture-tropicale.pdf
: consulté le 16 mars 2019
http://developpementdurable.revues.org/1143
consulté le 5 mars 2019
http://www.memoireonline.com/05/11/4539/m_Les-effets-de-la-degradation-des-ecosystemes-de-mangroves-dans-la-dynamique-migratoire-des-popula14.html
: consulté le 30 décembre 2018
74
http://www.youscribe.com/catalogue/dictionnaires-encyclopedies
annuaires/savoirs/definition-de-perception-geographie-2266900 : consulté
le 21 décembre 2019
https://www.bfm.admin.ch//bfm/fr/home/themen/perception_analysen/weltweite_perception
html : consulté le 18 mars
2019.nada.stat.cm/index.php/catalog/20/download/156
: consulté le 10 janvier 201
75
ANNEXES
I-Identification
1 : Nom
2 : Prénom
3 : Age
4-Sexe : Masculin Féminin
5-Statut matrimonial : Marié Célibataire
Veuf /veuve Divorcé
6-Nombre d'enfant en charge
7-Activité Menant : Commerçant Cultivateur
Eleveur
Benskineur Enseignant
Autres
|
8- Niveau d'étude : Primaire Secondaire
|
Supérieu
|
Autres
9-Diplôme le plus
élevé
II- Etats des lieux de la
perception de la variabilité climatique par les paysans
10-D'après vous y'a-t-il variabilité climatique ?
Oui Non
11- Si oui quelle preuve pouvez-vous apporté pour montrer
qu'il y'a variabilité climatique ? -Excès de soleil
- Les pluies précoces

-Retard des pluies : -Excès de pluies -Excès de
vents
Autres
12-Si non pourquoi n'y'at-il pas variabilité climatique
?
-Départ normal des pluies -retour normal des pluies :
-Chaleur modéré
Autres
13-Combien de séquence hebdomadaire mensuelle
de pluies avez-vous observé dans le passé ?
|
7jours
|
14jours
|
21jours 21 jours et plus
|
|
Autres
|
|
|
|
|
|
|
14-Combien de séquence hebdomadaire mensuelle de pluies
avez-vous observé dans le présent ?
76
3 jours 5 jours 7 jours 14 jours
Autres
15-Combien de séquence mensuelle sèche
avez-vous observé dans le passé ?
2jours 5jours 14jours
Autres
16-Combien de séquence mensuelle sèche
avez-vous observé dans le présent ?
7jours 14jours 21jours
Autres
Domaine géomorphologique
17-Quel était l'état de l'érosion dans le
passé par rapport à
maintenant ?
20-Y'a-t-il déjà eu glissement de
terrain depuis des décennies jusqu'à maintenant ?
Oui Non
..
Autres
a) Si oui quelles sont des années qu'on a observé
ces
phénomènes ?
b) A le phénomène de glissement de terrain est-il
lié ? -Aux totems
- Position de la terre par rapport à un cours d'eaux
Autres
Domaine Biogéographique
21-Quel était l'état de la végétation
dans le temps ?

-La présence de beaucoup d'arbre -L'existence de certaines
plantes -Présence de beaucoup d'arbre
Autres
22- Quel est l'état actuel de la végétation
?
-Présence des mauvaises herbes
-Disparition de certaines plantes
23-y'avait-il migration de certains insectes à l'instar
des oiseaux dans le temps par rapport à
maintenant ? Oui Non
Autres
24- Avez-vous connu l'apparition de certains
espèces d'insectes et certaines espèces de plantes dans le temps
par rapport à maintenant ?
77
25-Avez-vous eu tarissement ou assèchement des cours
d'eaux dans le temps par rapport à maintenant ?
Oui Non
Autres
26-Avez-vous déjà eu un déficit
ou une abondance de pluies ?
Oui Non
Autres
27-Si oui quels sont les années qui vous a le
plus marquez par manque de pluie ou par abondance de pluie ?
-Année d'abondance de pluie
-Année des pluies déficitaires
28- Avez-vous déjà eu les cas d'inondations ? Oui
Non
Autres
29- Si oui quel est le nombre de cours d'eaux intermittents et
asséché que vous avez observez
depuis longtemps ?
-Domaine
météorologique
30-Quel est l'état de la foudre c'est-à-dire le
grondement d'éclairs, le coup de tonnerre dans
votre localité ?
31-Y'a-t-il eu des
répercutions de cette dernière sur le tissu écologique
?
Oui Non
Autres
32-Est-ce que par moment il y'a eu changement de
formes de précipitation ?
Oui Non Autres
33-Si oui comment peut-être les autres formes que vous
avez
observé ?
34-Quel est le nombre de fréquence de
grêle que vous avez observé dans le temps par rapport à
maintenant ?
35-Quel est le nombre de pluie d'averse ou
torrentielle dans le passé et dans le présent ?
-Dans le passé
-Actuellement
IV- MILIEU ANTHROPOGENIQUE Domaine Anthropique/Culturel
78
36-Y'a-t-il changement des systèmes de cultures ou
technique ancestrales dû à la variabilité climatique ?
Oui Non
Autres
37-Si oui qu'est-ce qui a changé ?
-Mode de vie : oui Non
-Offrande aux dieux par les animaux : oui Non
-Financements des rites : Oui Non Autres
38- Quel est la fréquence des années durement
frappés par la famine parce que la variabilité
climatique ?
39- Quelles peuvent-être les différents changements
d'habitude alimentaire que vous avez mis en place face à la
famine ?
-Domaine socio-économique
40-Quels sont les tendances migratoires au fil des années
(nombre des migrants) dues à la
variabilité climatique
41-Quel est le nombre des
Non-migrants au fil de ces
années ?
Pourquoi ces personnes n'ont-ils pas
migré ?
42-Comment était votre
productivité en denrées agricoles dans le temps et l'espace ?
-Réduction des rendements : Oui Non
-Augmentation de la productivité: Oui Non
Autres
43- Quelle sont les fluctuations des prix des
denrées agricoles observées sur le marché dans le temps et
l'espace ?
-Cher : Oui non
Autres
-Moins cher : Oui Non
Autres
44-Comment diversifiez-vous les denrées en cas
de moyen de subsistance ?
79
45-Quel est le taux de production (Haricot, Maïs,
arachide...) en tonne de kg dans le temps et
l'espace ?
46-Quelle est l'évolution des revenues
agricole dans les ménages dans le temps et
l'espace ?
47-Quels sont les stratégies que vous
adoptez pour faire face à la variabilité du climat sans la
météo ?
|
-Adoration des dieux, des rites
|
. ?
|
|
-Les chansons
|
?
|
|
-Des danses traditionnelles
|
?
|
Autres
ENTRETIEN AVEC LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
-Commune de Galim
1) Quels sont les tendances climatiques à Bagam durant
ces dernières années sans la
météo?
2) Y'a-t-il variabilité climatique dans cette
zone ?
3) Est-ce-que la population se plaint face au
climat ?
4) Quels sont les impacts observés après
étude ?
5) Quel Stratégie avez-vous mis à la disposition
de la population afin de mieux étudier le climat
sans forcément intervention des données de la
météo ?
-Chefferie supérieur de Bagam
1) Que dites-vous du climat de Galim notamment Bagam ? Autrement
dit y'a-t-il ou pas
variabilité climatique ?
2) Quels sont les indicateurs du passé au climat actuel
qui vous permettent de dire qu'il y'a
dérèglement climatique ?
3) Quels sont les stratégies mise en oeuvre par la
chefferie Bagam afin d'offrir à sa population
une meilleure possibilité pour faire face au climat?
-Les chassons ?
-les danses traditionnelles ?
-les rites pour implorer les dieux pour les retours des pluies ?
80
-Le tsocyack 7
-Collecte des semences dans les ménages afin de
leurs
bénir 7
-Financement des rites par la communauté villageoise 7
5) comment se qualifie les différentes saisons
climatique en la langue locale 7
81
MEAN MONTHLY TEMPERATURE 2007-2019
|
YEARS
|
J
|
F
|
M A
|
|
M
|
J J A
|
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
2007
|
20,14
|
22,17
|
22,88
|
22,63
|
22,24
|
21,94
|
20,58
|
20,52
|
21,29
|
21,98
|
21,90
|
20,59
|
|
2008
|
21,83
|
21,56
|
24,14
|
22,61
|
22,48
|
21,97
|
21,48
|
20,82
|
20,92
|
21,92
|
21,86
|
21,22
|
|
2009
|
22,39
|
23,74
|
25,00
|
23,52
|
22,47
|
22,28
|
21,83
|
21,32
|
21,87
|
22,32
|
21,78
|
20,88
|
|
2010
|
22,02
|
24,17
|
24,12
|
24,62
|
23,90
|
22,83
|
21,61
|
21,78
|
22,15
|
22,57
|
22,40
|
20,65
|
|
2011
|
24,98
|
23,11
|
23,82
|
23,68
|
23,60
|
21,03
|
20,98
|
22,21
|
21,39
|
18,81
|
15,81
|
14,86
|
|
2012
|
15,36
|
18,50
|
23,84
|
24,40
|
23,27
|
22,93
|
21,95
|
21,42
|
21,20
|
23,04
|
21,69
|
21,28
|
|
2013
|
22,26
|
24,13
|
22,58
|
22,06
|
22,77
|
21,90
|
20,91
|
20,81
|
20,87
|
21,51
|
10,88
|
0,00
|
|
2014
|
0
|
0
|
10,29
|
23,05
|
22,09
|
22,37
|
22,68
|
21,79
|
22,84
|
20,17
|
20,71
|
21,22
|
|
2015
|
18,87
|
23,66
|
24,24
|
20,27
|
23,39
|
11,24
|
14,39
|
21,51
|
21,18
|
20,85
|
21,32
|
20,07
|
|
2016
|
21,32
|
22,69
|
24,67
|
24,35
|
23,45
|
22,48
|
21,90
|
22,07
|
22,14
|
22,50
|
22,02
|
20,96
|
|
2017
|
22,15
|
22,34
|
24,74
|
22,33
|
23,39
|
22,27
|
22,57
|
22,42
|
22,41
|
22,86
|
21,84
|
21,42
|
|
2018
|
20,54
|
24,02
|
24,33
|
24,19
|
23,71
|
22,88
|
22,20
|
22,30
|
22,44
|
22,54
|
22,19
|
21,24
|
|
2019
|
22,39
|
23,35
|
24,47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
TABLE DES MATIÈRES
DÉDICACE i
REMMERCIEMENTS ii
LISTE DES TABLEAUX iii
LISTE DES FIGURES iv
LISTE DE PLANCHE ET PHOTOS v
LISTE DES ABRÉVIATIONS vi
ABSTRAT vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
I- CONTEXTE DE RECHERCHE 1
1- Définition du sujet 1
2- Justification 2
2-Délimitation spatiotemporelle 3
II- PROBLÉMATIQUE 4
III-QUESTION DE LA RECHERCHE Erreur ! Signet non
défini.
1- Question principale Erreur ! Signet non
défini.
2- Questions spécifiques Erreur ! Signet non
défini.
IV- REVUE DE LA LITTÉRATURE 5
1-Percetion paysanne 5
2- La variabilité climatique mesurée en milieu
montagnard 6
3-Adaptation paysanne de la variabilité climatique en
milieu MontagnardErreur ! Signet non défini.
V- CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE 7
1-Perception 7
2- Le concept de « variabilité climatique » 9
3-Adaptation 11
VI-OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 12
1-Objectif principal 12
2- Objectif spécifique 12
VII-HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE 12
1-Hypothèse principale 12
2-Hypothèse spécifiques 12
VIII-MÉTHODOLOGIE 13
1-Enquête préliminaire et questionnaires 13
2- Les entretiens 14
3-Traitement et représentations des données 14
4-Difficultés rencontrée et résolutions lors
de la recherche 15
5- Synthèse de l'étude 15
IX- RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 16
PREMIÈRE PARTIE : Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE I : Erreur ! Signet non
défini.
0. introduction Erreur ! Signet non
défini.
I.1. Facteurs physiques de la localité de Bagam
Erreur ! Signet non défini.
I.1.1. Situation de la zone d'étude Erreur !
Signet non défini.
83
I.1.2. un climat en perpétuelle changement Erreur
! Signet non défini.
I.1.3. Le relief et sol en plein dégradation
Erreur ! Signet non défini.
I.1.4. Végétation et faune sous l'emprise du climat
et les cultures Erreur ! Signet non défini.
II.2. Facteurs humains favorisant l'étude des perceptions
climatiquesErreur ! Signet non défini.
II.2.1. Population : cible première de la
variabilité climatique Erreur ! Signet non
défini.
II.2.2. Peuplement en rapport avec la migration climatique
Erreur ! Signet non défini.
II.2.3. Les principales activités sous les caprices
climatiques Erreur ! Signet non défini.
Conclusion partielle Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE II : 24
LES PERCEPTIONS LOCALES DE LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE
À BAGAM 25
00. Introduction 25
II.1. Savoirs locaux sur la variabilité climatique 25
II.1.1. Regard des paysans par rapport à la
variabilité climatique 25
II.1.2. Mise en évidence de la perception de la
variabilité climatique 26
II.1.2.1. Perceptions paysannes des variations dans le
régime des précipitations et des
températures 26
II.1.2.1.1. La pluviométrie 26
II.1.2.1.3. Séquence de sècheresse 29
II.1.3.Perception des effets de la variabilité climatique
dans quelques domaines 30
II.1.3.1. Perceptions des effets de la variabilité
climatique sur quelques éléments
géomorphologiques 30
II.1.3.2.
Perceptions des effets de la variabilité climatique sur quelques
éléments
biogéographique. 32
II.1.3.2.1. Variabilité de la végétation
32
II.1.3.2.2. Le comportement des oiseaux dans le temps et l'espace
33
II.1.3.2.3. Les types d'insectes dans le temps et l'espace 34
II.1.2.4. Perceptions des effets de la variabilité
climatique dans l'évolution de l'eau 35
II.1.3.3. Perceptions des effets de la variabilité
climatique dans le domaine agricole 36
II.1.3.3.1. Perturbation du calendrier agricole 36
II.1.3.3.2. Sècheresse agricole 37
II.1.3.3.3. Réductions des rendements agricoles 38
II.1.3.4. Perceptions des effets de la variabilité
climatique dans le domaine de l'élevage 40
II.1.3.4.1. La présence des maladies liée aux
animaux. 40
Conclusion partielle 41
DEUXIÈME PARTIE : RAPPORT ENTRE LE CLIMAT PERCU ET LE
CLIMAT MESURÉ AINSI QUE LES STRATÉGIES D'ADAPTATION
PAYSANNESErreur ! Signet non défini.
CHAPITRE III: Erreur ! Signet non défini.
RAPPORT ENTRE LE CLIMAT PERCU ET LE CLIMAT MÉSURÉ
57
000. Introduction 57
III.1.Rapport climatique 57
III.1.1. Variabilité pluviométrique 57
III.2.2.Variabilité de la température 59
III.2. Rapport hydrologique 61
III.2.1. L'inondation dans le temps et l'espace 62
III.2.2. Sècheresse hydrologique et
météorologique 62
84
III.2.2. Le déficit d'eau dans le temps et l'espace
63
III.3. Rapport biogéographique 64
III.3.1. La variabilité au niveau de la
végétation 64
III.4. Rapport agricole 66
III.4.2. Baisse de rendement 67
Conclusion partielle 68
CHAPITRE IV: STRATÉGIES D'ADAPTARTION PAYSANNE FACE A
LA PÉJORATION
CLIMATIQUE 42
0000. Introduction 42
IV.1. Les mesures d'adaptation mise en place par la
population locale 42
IV.1.1. La stratégie d'adaptation dans le
système climatique 42
IV.1.1.1. Lorsqu'il pleut excessivement 42
IV.1.1.2. Lorsqu'il fait trop chaud 43
IV.1.2. La stratégie d'adaptation au système
culturelle. 44
IV.1.2.1. La collecte de semences dans des ménages
pour la chefferie afin d'avoir un meilleur
rendement. 44
V.1.2.2 Le tsocyac ou Ouvrir le village 44
IV.1.3. La stratégie d'adaptation dans le
système agricole 45
IV.1.3.1. Modification de la date de semis
45
IV.1.3.1. L'utilisation des semences résistantes aux
mauvaises conditions climatique 47
IV.1.3.3. Le plant du maïs sur un sol non labouré
47
IV.1.3.4. L'irrigation 48
IV.1.2.5. L'usage de la technique de semis dans les sions
49
IV.1.3.6. L'usage de l'insecticide après les pluies
précoces 50
IV.1.3.7. La plantation des avocatiers gréffés
comme moyen d'adaptation 50
IV.1.3.8. Diversification des activités 51
IV.1.4. La transhumance Bovine 52
IV.1.5. La migration comme moyen d'adaptation 53
IV.1.6. Les non-migrants climatiques 53
IV.1.7.Création des associations 53
IV.1.8.Epargne et credit alloué par structure 54
IV.1.9. Le role de l'Etat et les société civiles
dans la mise en place des stratégies 54
IV.2. Les contraintes d'adaptation paysanne 55
IV.2.1. Insuffisance d'information sur l'évolution le
climat 55
IV.2.2. Problème d'encadrement des postes agricoles
55
Conclusion partielle 56
CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 56
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 71
85
| 


