|
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 1
Institut d'études politiques de Paris
ECOLE DE LA RECHERCHE DE SCIENCES PO
CHSP
Mémoire en Histoire
Le Docteur Bendjelloul :
l'opposition loyale à la colonisation
?
(1930-1962)
Hélène Koning
Mémoire dirigé par David
Todd
Soutenu le 24 mai 2024
Jury :
M. M'hamed Oualdi, professeur des universités M.
David Todd, professeur des universités
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 2
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 3
Remerciements
À M'hamed Oualdi pour m'avoir proposé ce
sujet stimulant et m'avoir accompagné dans les premiers mois de cette
recherche.
À David Todd, mon directeur de mémoire,
pour son accompagnement bienveillant et ses précieux
conseils.
À la communauté du Centre d'Histoire de
Sciences Po, et plus particulièrement à Guillaume Piketty,
à Florence Bernault et aux participants au séminaire «
Histoire des Afriques », à Louise Guttin-Vindot, ainsi qu'à
Noémie Prevel du service des Ressources et de l'Information Scientifique
de la bibliothèque de Sciences Po.
À mes amis et ma famille, pour leur soutien et
leur intérêt pour ce travail. Merci particulièrement
à ceux qui ont donné du temps pour me relire.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 4
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 5
Avant-propos
Les noms de ville mentionnés dans ce
mémoire sont ceux qui était en cours au moment de production des
sources citées. Lorsque le nom actuel de la ville est différent,
il est indiqué entre parenthèses.
Exemple : Bougie (Bejaia)
La transcription des noms de familles se fait selon
l'orthographe la plus courante dans les sources consultées.
Les expressions indigènes, Français
musulmans ou Algériens musulmans sont synonymes dans les sources, et
seront employées dans ce mémoire pour désigner les
personnes colonisées vivant en Algérie à cette
époque. Le terme colonisés, décrivant leur situation
devant l'Etat français, sera également
employé.
Les expressions colons, colonisateurs ou
Européens seront de la même manière employées comme
des synonymes, selon le contexte.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 6
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 7
Table des matières
Remerciements 3
Avant-propos 5
Introduction 9
Partie I - Le Docteur Bendjelloul, champion
assimilationniste de la cause
algérienne (1930-1938) 23
I - Le réformisme assimilationniste, programme
politique du Docteur Bendjelloul 25
II - Toute remise en cause du système colonial
est-elle nationaliste en puissance ? 33
III - Popularité de Bendjelloul : figure de proue
d'un mouvement d'ampleur dans toute
l'Algérie 42
Partie II - Adaptation stratégique de Bendjelloul
dans un contexte d'instabilité
politique (1939-1945) 53
I. La poursuite des engagements de la FEM dans un
contexte de crise internationale 55
II. Transposition des stratégies des
élus face à la Révolution nationale 63
III. La sortie de guerre et la reprise de la vie
républicaine : hésitations face à une
souveraineté française incertaine
72
Partie III - Chercher une issue au conflit colonial dans
les institutions françaises
(1946-1985) 87
I. Bouleversements de l'échiquier politique
algérien et installation de Bendjelloul dans la
vie politique française 89
II - À l'Assemblée Nationale (1951-1955)
: persister dans la revendication légale 97
III - La motion des 61 : dernier effort des
réformistes (1955 - 1962) 105
IV - La vie en métropole après la fin de
la représentation politique des Algériens 113
Conclusion 119
Table des figures et Index 125
Bibliographie 126
Guide des Sources 131
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 8
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 9
Introduction
Entre 1932 et 1938, les services de surveillance de
l'administration coloniale d'Algérie ont les yeux braqués sur la
Fédération des Élus Musulmans (FEM). Celle-ci organise des
meetings réunissant plusieurs milliers de personnes, ses tournées
électorales occasionnent des manifestations dans tout le
département de Constantine, elle appelle à la mobilisation des
masses colonisées dans de nombreux tracts ainsi que dans leur journal,
l'Entente franco-musulmane. C'est pourtant l'application des lois
françaises sur le sol algérien et la citoyenneté
française pleine et entière pour les Algériens de statut
musulman que revendiquent ces élus. Et la France coloniale voit cela
d'un très mauvais oeil. Les partisans d'une Algérie
française représentent à cette époque le courant
majoritaire parmi les colonisés. Le président de la FEM, Mohammed
Salah Bendjelloul, dit Docteur Bendjelloul, est le leader charismatique de ce
printemps algérien des années 19301 et le champion de
l'assimilationnisme en Algérie au XXe siècle : alors
même qu'à partir des années 1940 cette option politique
perd l'adhésion de la population et que son propre bras droit, Ferhat
Abbas, devient la figure de proue du nationalisme algérien, Bendjelloul
maintient ses convictions en faveur d'une Algérie rattachée
à la France. Jusqu'en 1956, il reste membre des institutions
françaises et utilise ses mandats pour réclamer au colonisateur
des réformes en Algérie.
Pourtant, aucun travail de l'historiographie
francophone ou anglophone n'est consacré à cette figure politique
importante de l'Algérie avant l'indépendance. Bendjelloul est
souvent mentionné dans les travaux traitant de la décennie 1930
en Algérie, sans que son parcours et ses idées ne fassent l'objet
d'une étude dédiée2. Il ne semble pas non plus
que l'historiographie
1 Julien Fromage, « Innovation politique et
mobilisation de masse en « situation coloniale»: un « printemps
algérien » des années 1930 ? L'expérience de la
Fédération des Élus Musulmans du Département de
Constantine » Thèse de doctorat, EHESS, Paris, 2012.
2 Charles-Robert Ageron, Histoire de
l'Algérie contemporaine. Tome II : De l'insurrection de 1871 au
déclenchement de la guerre de libération (1954), Paris,
Presses Universitaires de France, 1979. Julien Fromage dans sa thèse de
2012 consacre un chapitre entier à Bendjelloul, son arrière-plan
familial, ses modes d'actions, et son rôle au sein de la FEM, et souligne
qu'un travail de recherche dédié à la carrière de
Bendjelloul dans son ensemble serait le bienvenu. C'est à cette
tâche que s'est attelé le présent mémoire. J.
Fromage, Un « printemps algérien » ? op.
cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 10
arabophone se soit emparée de la figure de
Bendjelloul, hormis Houari Safsaf et Fatiha Safer dans un article publié
en 20211.
Bendjelloul, contrairement à d'autres
personnalités ayant pris position dans le débat autour de
l'indépendance de l'Algérie, n'a pas de postérité
politique pour perpétuer sa mémoire. L'historiographie
algérienne et l'historiographie française étudient
plutôt l'impact des figures qui ont joué un rôle durant la
guerre d'indépendance ou dans l'histoire du nationalisme, comme Messali
Hadj et Ferhat Abbas. Les habitants de l'Algérie qui ont dû
quitter le pays à l'indépendance sont trop souvent
présentés comme des partisans de la France et rassemblés
indistinctement sous des vocables collectifs comme « pieds noirs » ou
« harkis », sans que les différents courants politiques et les
raisons de leur départ ne soient précisés. Bendjelloul,
partisan de la France mais dénonçant inlassablement l'oppression
coloniale, ne correspond ni à l'épopée nationaliste
algérienne ni au mythe du harki profrançais. L'étude de sa
carrière politique apparaît donc comme un outil précieux
pour nuancer les dichotomies dont souffre encore trop souvent la recherche sur
le sujet.
Cette nouvelle approche de la recherche sur la
décolonisation de l'Algérie est menée depuis quelques
années par des chercheurs comme Fatiha Safer en Algérie ou Malika
Rahal en France, dont les travaux portent respectivement sur les élites
réformistes algériennes2 et sur les nuances
idéologiques au sein du mouvement national3. Les figures
individuelles étudiées par Rahal suivent encore souvent un
parcours allant de l'assimilationnisme au nationalisme, et ne permettent pas
tout à fait de remettre en question la vision téléologique
du nationalisme comme aboutissement de la pensée politique des
Algériens. Au-delà de l'histoire de l'Algérie, des
recherches récentes ont souligné la diversité des courants
de pensée et des influences politiques
1 Houari Safsaf et Fatiha Safer, « 1956 -1930
Ù?? ?? ????????? ?????? ???? ??????? ?????? ???? Ù? ?????? ????
???????- Dr. Mohamed Salah Bendjelloul and his political struggle within the
integrating elite between 1930-1956 », Maghreb Journal of Historical
and Social Studies, 13-2, 2021, p. 204?224.
2 Voir par exemple Houari Safsaf et Fatiha Safer,
« ????????? ??????? ?????? ????? Ù? ??????? ????????? ??????????
??????- The Amalgamating Liberal Elite and its Positions on the Issue of
Algerian National Identity », Oussour, New Ages Magazine, 11-2,
2021, p. 493?514 ; Fatiha Safer, « ????????? ????? ????? Ù?
????????? ?????? ????? [Les positions de l'élite algérienne sur
la politique d'intégration de la France] », Oussour, New Ages
Magazine, 5-17, 2015, p. 333?349.
3 Malika Rahal, « Les Représentants
colonisés au Parlement français: le cas de l' Algérie,
1945- 1962 », Université de Bordeaux 3, 1996 ; Id. ,
« La place des réformistes dans le mouvement national
algérien », Vingtième Siècle. Revue
d'histoire, 83-3, 2004, p. 161?171 ; Id., L'UDMA et les
Udmistes, Alger, Éditions Barzakh, 2017. Id., Ali
Boumendjel. Une affaire française, une histoire algérienne,
Paris, La Découverte., 2022 ; Id., « Mohammed Salah
Bendjelloul », in Tramor Quémeneur, Ouanassa Siari
Tengour, et Sylvie Thénault, Dictionnaire de la guerre
d'Algérie, Paris, Bouquins, 2023.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 11
des militants décoloniaux. Les diverses formes
de contestation du colonialisme se révèlent souvent
éloignées d'un nationalisme triomphant. Frederick Cooper montre
comment l'idée d'une fédération de l'Union
Française faisait consensus parmi les élites colonisées au
sortir de la Seconde Guerre Mondiale1. Concernant la période
de la conquête française au XIXe siècle, David
Todd montre que le Second Empire favorisait l'idée d'un royaume arabe
distinct de la France dans sa structure administrative et sa culture, bien loin
de la société inégalitaire instaurée par la
politique de colonie de peuplement de la IIIe République2.
David Motadel pour sa part met à jour l'alliance anti-impériale
de l'Allemagne nazie avec certains militants nationalistes des colonies de
leurs ennemis, particulièrement dans les colonies anglaises en Inde et
au Moyen-Orient, mais aussi dans les colonies françaises et italiennes
en Afrique du Nord3. Arthur Asseraf propose dans sa monographie le
portrait d'un Algérien participant activement à la colonisation
de l'Afrique subsaharienne pour le compte de la France, apportant une remise en
cause inédite de la dichotomie
colonisateurs-colonisés4. L'étude de la
carrière de Bendjelloul, un assimilationniste qui n'a jamais rejoint les
nationalistes et a vécu en France après l'indépendance,
s'inscrit dans ce courant de réévaluation des formes d'opposition
à la colonisation. Son parcours montre que les sentiments qui relient un
individu à une nation sont une construction sociale autant que les
nations elles-mêmes, et qu'il n'existe pas de déterminisme
intellectuel qui mènerait certaines catégories de personnes
à adopter les mêmes opinions. La comparaison avec
l'évolution simultanée de la figure bien connue d'un Ferhat Abbas
ne fait que renforcer l'étonnement face à la persistance de
Bendjelloul dans la voie du réformisme : Abbas et Bendjelloul ont le
même âge, ils sont tous deux Algériens et musulmans et
professent les mêmes idées jusqu'en 1938. Les orientations
politiques sont en partie des choix calculés, en partie le
résultat de différents facteurs vécus, mais s'ajoute
toujours à cela une part de subjectivité
individuelle.
1 Frederick Cooper, Français et Africains ?
Être citoyen au temps de la décolonisation, tr. Christian
Jeanmougin, Paris, Payot, 2014.
2 David Todd, « Chapitre 2. L'Algérie, un
échec de la colonisation informelle », in Un empire de
velours, Paris, La Découverte, 2022, p. 63?104.
3 David Motadel, « The Global Authoritarian
Moment and the Revolt against Empire », The American Historical
Review, 124-3, 2019, p. 843?877, ici p. 855?857.
4 Arthur Asseraf, Le désinformateur : Sur
les traces de Messaoud Djebari, un Algérien dans le monde colonial,
Paris, Fayard, 2022.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 12
Ainsi, durant sa longue carrière politique, de
1924 à 1956, dans différentes institutions, par différents
moyens et avec différents niveaux de popularité, Bendjelloul
proclame ses convictions assimilationnistes : l'avenir de l'Algérie
passe par l'intégration dans la nation française. Dès
lors, il s'agira de suivre l'apparente constance politique de Bendjelloul :
Quels sont les arguments et les raisonnements qu'il invoque pour
défendre l'assimilationnisme réformiste ? Quels sont ses modes
d'action politique et comment évoluent-ils face aux changements de
régime en France et aux débats sur l'Algérie qui
s'intensifient et se polarisent de plus en plus tout au long de sa
carrière ? Le présent mémoire suivra la chronologie de la
carrière de Bendjelloul, selon les institutions desquelles il a
été membre et les changements de régime politique en
métropole.
Revue de littérature
Le cas du Docteur Bendjelloul est un indice
révélateur des biais politiques et mémoriaux des travaux
sur l'évolution politique des Algériens. Il est la figure
principale de la contestation du colonialisme dans les années 1930 et
défend des idéaux assimilationnistes et réformistes. Il ne
rejoint jamais la lutte nationaliste et occupera des mandats parlementaires
dans les institutions françaises du débarquement allié en
Afrique du Nord jusqu'à la première année de la guerre
d'indépendance de l'Algérie.
Dans l'historiographie, comme nous avons pu le voir
ci-dessus, il passe d'une image de champion du peuple algérien dans les
travaux traitant du début de sa carrière, à celle d'un
bourgeois profrançais déconnecté du peuple dans les
travaux traitant des années 1940-1950, et souvent ces derniers ne le
mentionnent même pas. La périodisation des recherches influe
fortement sur la manière dont Bendjelloul est présentée,
et ceux qui font l'histoire de l'Algérie choisissent souvent de ne
mentionner que l'un des aspects de sa carrière, sans montrer
l'évolution de son positionnement dans le paysage politique
algérien. Ainsi, Charles-Robert Ageron dans son ouvrage majeur
Histoire de l'Algérie Contemporaine parle de Bendjelloul comme
d'un acteur central de la vie politique algérienne de la décennie
1930, assimilationniste et leader politique talentueux, mais le nom de
Bendjelloul n'apparaît plus après 19461. Plus
récemment, la thèse que Julien Fromage consacre au printemps
politique algérien des années
1 C.-R. Ageron, Histoire de l'Algérie
contemporaine, op. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 13
19301 n'aborde pas la carrière
ultérieure de Bendjelloul. Les auteurs qui traitent de sujets
plus spécifiques sur l'Algérie coloniale mentionnent Bendjelloul
sans expliciter les enjeux liés aux actions de Bendjelloul durant la
période qu'ils étudient2. L'article sur Bendjelloul
dans le Dictionnaire de la guerre d'Algérie, signé
Malika Rahal, décrit de manière factuelle et
équilibrée la carrière de Bendjelloul, insistant sur la
période où il a été le plus influent mais faisant
également mention de sa carrière dans les institutions
parisiennes après la Seconde Guerre Mondiale. À défaut de
théoriser son positionnement politique, Rahal offre des formules utiles
parce que s'abstenant de jugement : il est « considéré comme
dangereux » par « les autorités françaises », il
« revendique la citoyenneté française en même temps
que le maintien de l'identité algérienne », il signe le
Manifeste en 1943, il est élu dans diverses institutions et il «
rallie la cause de l'indépendance » à partir de
19553. La présente recherche tentera, au-delà de ces
faits, de souligner les motifs politiques guidant Bendjelloul à travers
les évolutions de sa carrière politique.
Dans l'historiographie algérienne francophone,
la plupart des travaux publiés en français adoptent une
manière téléologique d'écrire l'histoire de
l'Algérie : ils suivent le fil des figures et des idées
nationalistes dès qu'elles apparaissent, sans s'intéresser outre
mesure aux autres courants politiques algériens, quelle que soit
l'importance qu'ils aient pu avoir en leur temps. Les auteurs algériens
minimisent souvent l'ampleur du rôle de Bendjelloul dans la
décennie 1930, considérant peut-être que le fait qu'il
n'ait jamais rejoint le FLN discrédite l'ensemble de son action. Il est
souvent mentionné comme un épiphénomène, et les
auteurs se concentrent sur les nationalistes et l'Etoile Nord-Africaine. Cette
dernière était pourtant marginale sur le sol algérien
à l'époque où le mouvement réformiste était
à son apogée. Le grand historien algérien Mahfoud Kaddache
reconnaît, dans sa thèse d'État en 1980, que les
élites réformistes ne sont ni passives ni béni-oui-oui.
Elles réclament certes « de sérieuses réformes »
dans le sens de
1 Julien Fromage, Un « printemps algérien
» ? op. cit.
2 Jacques Cantier, L'Algérie sous le
régime de Vichy, Paris, Odile Jacob, 2002 ; Jacques Bouveresse,
Un parlement colonial? Les Délégations financières
algériennes 1898-1945, Mont-Saint-Aignan, Publications des
universités de Rouen et du Havre, 2008 ; Benjamin Stora, Le
nationalisme algérien avant 1954, Paris, CNRS éd., 2010 ;
Joshua Cole, Lethal Provocation : The Constantine Murders and the Politics
of French Algeria, Ithaca London, Cornell University Press,
2019.
3 M. Rahal, « Mohammed Salah Bendjelloul »,
op. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 14
l'assimilation, mais dans le but d'évoluer
socialement1. Ce reproche de quête d'avantages personnels est
souvent fait à l'encontre des politiciens assimilationnistes : le
contraste est en effet marquant entre les sacrifices des martyrs du FLN qui ont
enduré la vie au maquis, la prison, la torture et la mort pour
l'indépendance de l'Algérie, et le combat des réformistes
qui se déroulait sur les bancs de l'Assemblée et dans les
cabinets des autorités françaises. Ce mémoire tentera de
démontrer que les actions de Bendjelloul n'étaient pas uniquement
motivées par la recherche de gains personnels mais sur de réelles
convictions politiques.
L'affirmation de la langue arabe comme langue
universitaire en Algérie rend plus difficile la prise en compte de cette
historiographie dans le présent mémoire. Le seul travail
récent qui mentionne le Docteur Bendjelloul semble être l'article
de Fatiha Safer et Houari Safsaf, chercheurs à l'université
algérienne de Sidi Bel-Abbès2. Les travaux de ces
auteurs sont consacrés depuis 2015 aux réformistes et
assimilationnistes algériens dans la première moitié du
XXe siècle3.
Dans leur article, Safer et Safsaf reconnaissent
l'importance de Bendjelloul dans les années 1930, rappelant l'expression
de Mahfoud Kaddache qui évoquait un « Gandhi algérien »
en raison de son refus de la lutte armée et de son attachement à
exprimer ses revendications dans le cadre de la légalité
coloniale4. Par rapport aux travaux plus anciens d'historiens, ils
nuancent l'opposition radicale entre traîtres partisans de la France et
militants héroïsés de la cause nationale et soulignent
« la profondeur des divergences intellectuelles et idéologiques et
des divergences entre les membres de l'élite eux-mêmes
»5. Ils soulignent également que ces revendications
assimilationnistes reflétaient peut-être les aspirations de
l'élite francisée, mais pas celles de la population
algérienne. Leur article parle très peu de la carrière de
Bendjelloul dans les institutions françaises après 1945. Cette
disparité est peut-être un effet de l'accès
inégal
1 Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme
algérien. Question nationale et politique algérienne,
1919-1951, Alger, Société Nationale d'Edition et de
Diffusion, 1980.
2 Houari Safsaf et Fatiha Safer, « 1956 -1930 ???
?? ????????? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ???????- Dr.
Mohamed Salah Bendjelloul and his political struggle within the integrating
elite between 1930-1956 », art. cit.
3 Voir note 2 page 7.
4 Mahfoud Kaddache, Histoire du mouvement national
algérien, 1939-1945, Tr. M'hamed Ibn Albar, Alger, Dar El Oumma,
2011, vol. 2. Cité dans Houari Safsaf et Fatiha Safer, « ????
??????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ??????? 1956 -1930 ??? ?? ????????? ??????-
Dr. Mohamed Salah Bendjelloul and his political struggle within the integrating
elite between 1930-1956 », art. cit, p. 206.
5 Ibid., p. 211.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 15
aux sources suivant le pays et la langue d'origine des
chercheurs, en miroir des lacunes des travaux des chercheurs français
n'utilisant pas les archives en langue arabe.
L'historiographie anglophone propose souvent une
perspective moins enclavée que les historiographies algériennes
et françaises. Phillip Naylor par exemple propose une analyse originale
du positionnement politique de Bendjelloul dans son Historical Dictionary
of Algeria1. Il définit Bendjelloul comme un «
nationaliste modéré », et considère que par ses
efforts en faveur de l'égalité civique des Algériens,
Bendjelloul a contribué au développement du nationalisme
algérien, bien que les révolutionnaires aient condamné sa
modération2. Cette position est assez isolée dans
l'historiographie sur Bendjelloul. Cet article est très
appréciable par sa nuance, l'originalité de ses analyses et par
la prise en compte de la longue durée de la carrière de
Bendjelloul, mais le terme « nationaliste », même
modéré, ne permet pas de saisir les motivations de Bendjelloul.
On préférera l'expression d'opposition loyale (« loyal
opposition ») proposée par James McDougall3, insistant
sur les convictions francophiles de Bendjelloul et sur son choix résolu
du réformisme revendicatif comme moyen d'action.
Méthode
Le présent travail propose une vision
d'ensemble de la carrière publique du Docteur Bendjelloul, de la
décennie 1930 à la fin des années 1950. L'étude du
parcours individuel d'un personnage aujourd'hui méconnu permet
d'apporter des nuances aux différents grands récits de la
période coloniale en Algérie : si Bendjelloul n'est plus connu,
c'est que personne ne s'est emparé de sa mémoire pour la
perpétuer et que ses idées ne semblent pas pouvoir servir une
cause politique. L'étudier permet d'éclairer ce que les grands
narratifs ne prennent pas en compte et d'apporter de la nuance au récit
de l'évolution politique des Algériens au XXe
siècle.
1 Phillip C. Naylor, « Bendjelloul, Mohammed
Saleh (1893-1985) », in Historical Dictionary of Algeria, Lanham,
MD, United States, Rowman & Littlefield Unlimited Model, 2015, p.
119.
2 Ibid.
3 James McDougall, A History of Algeria,
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 183. « The élus
thus sought to constitute a `loyal opposition', not only recognising but
actively appropriating French sovereignty in Algeria, and articulating their
demands on it through a vigorous and sometimes spectacularly populist politics
of protest ».
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 16
Se concentrer sur un individu est une manière
de surmonter les enjolivements ou les mythes d'une histoire souvent
résumée à des lieux communs : trop souvent l'histoire
coloniale de la France est réduite à la guerre d'Algérie,
renvoyant dos à dos colonisateurs et insurgés, minimisant les
treize décennies de lutte politique et d'oppression coloniale qui ont
précédé le conflit armé et l'indépendance.
Suivre la carrière d'un individu sur plus de trente ans
révèle la contingence des choix politiques de l'individu, les
errances des politiques coloniales et de leurs services de renseignement, les
différents futurs imaginés par les acteurs. La focale
placée sur l'individu souligne aussi le rôle que jouent les
relations humaines dans les évènements historiques. La biographie
démystifie l'histoire et la ramène à hauteur d'homme. On
s'inscrira ici dans ce que l'historien Pascal Balmand a appelé la
biographie politique « nouvelle manière », qui « vise
moins à présenter un profil dans son exhaustivité
qu'à mieux cerner l'histoire collective par l'éclairage de
l'histoire singulière »1. Dans un article de 1999,
Guillaume Piketty défend la pertinence scientifique de l'exercice
biographique en histoire, et cite la préface de Jacques Legoff à
sa biographie de Saint Louis : « dessiner la courbe d'une destinée
[permet de poser] ce problème des rapports de l'individu et de la
collectivité, de l'initiative personnelle et de la
nécessité sociale qui est, peut-être, le problème
capital de l'Histoire »2.
On doit néanmoins rester en garde contre ce que
Bourdieu a appelé l'illusion biographique : à suivre de trop
près ce que le sujet observé dit de lui-même, on finit avec
les mêmes angles morts que lui et on reproduit la partialité de sa
perception de lui-même. Par exemple, l'individu se considère libre
d'influences dans ses actes, et le rôle de l'historien est de
révéler les tendances sociales de l'époque et la
manière dont le contexte a pu l'influencer3. Dans le cadre de
sa biographie de Pierre Brossolette, Piketty souligne l'acuité de ces
questions de libre arbitre et de soumission à la norme dans le contexte
de la résistance française à l'occupation : on pourrait en
dire autant pour le contexte colonial dans lequel émerge et
évolue Bendjelloul. Cependant, l'idée que le colonisé
dissimule ses réelles intentions a trop souvent
1 Jacques Cantier, « Les gouverneurs Viollette et
Bordes et la politique algérienne de la France à la fin des
années vingt », Outre-Mers. Revue d'histoire, 84-314,
1997, p. 25?49, ici p. 47. Note 26 : Guy Bourde et Hervé Martin, Les
Écoles historiques, Paris, Éditions du Seuil, 1983. Le
chapitre XIV, rédigé par Pascal Balmand, est consacré au
retour du politique.
2 Guillaume Piketty, « La biographie comme genre
historique? Une étude de cas. », Vingtième
Siècle. Revue d'histoire, 63, 1999, p. 119?126, ici p. 120. Pour un
exemple de biographie montrant les interactions entre destin individuel et
contexte impérial, voir A. Asseraf, Le désinformateur,
op. cit ; M'hamed Oualdi, Un esclave entre deux empires. Une
histoire transimpériale du Maghreb, Paris, Seuil, 2023.
3 Pierre Bourdieu, « L'illusion biographique »,
Actes de la recherche en sciences sociales, 62-1, 1986, p.
69?72.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 17
été utilisée par les
colonisateurs pour refuser d'entendre les revendications qui leur
étaient adressées. En se basant sur les écrits de
Bendjelloul, on tâchera de contourner l'a priori négatif
systématique des autorités coloniales et d'envisager la
possibilité que les déclarations des colonisés
reflètent leurs véritables intentions. Pour autant, il n'est pas
question de tomber dans l'écueil inverse et de survaloriser les sources
produites par les colonisés. Dans leur article « Remettre le
colonial à sa place », Camille Lefebvre et M'hamed Oualdi appellent
à traiter à égalité les sources produites par les
colonisateurs et celles produites par les colonisés. Les
premières, rédigées en langues européennes et
archivées de manière systématique, ont largement
été privilégiées jusqu'à présent dans
l'historiographie du fait colonial. Les travaux de recherche reproduisaient
alors, sans la relativiser, l'illusion d'omniscience et de domination des
autorités coloniales, manquant les interstices des
sociétés coloniales. D'autre part, les sources produites par les
colonisés, du fait de leur rareté relative, ont pu dans d'autres
cas être employées sans la distance critique nécessaire
à un usage scientifique. Oualdi et Lefebvre appellent donc à
« embrasser dans un même regard la diversité des
documentations contemporaines européennes et africaines en leur
appliquant la même réflexivité critique »1.
Lefebvre et Oualdi rejettent l'idée selon laquelle « ceux qui
agiraient selon des modalités perçues comme européennes ou
globalisées s'inscriraient dans le sillage de la grande effraction
coloniale » et seraient moins authentiquement des témoins de leurs
sociétés d'origine que d'autres « restés
fidèles à des authenticités traditionnelles [...] ou
nationales ». Or, soulignent-ils, les uns et les autres sont « les
produits à la fois de l'histoire du moment colonial et d'une histoire
qui ne se limite pas à celle-ci »2. Si dans ce texte il
est question des chercheurs contemporains, nul doute que cette lecture
s'applique aussi aux acteurs historiques : comment juger qu'en 1935 ou en 1945
les convictions d'un militant nationaliste algérien seraient plus
authentiques que celles d'un partisan assimilationniste ? Connaître la
fin de l'histoire ne justifie pas un traitement différencié des
acteurs historiques et de leurs idées. Ainsi, le parcours et les prises
de position de Bendjelloul révèlent certaines des
stratégies et discours alternatifs disponibles pour un politicien
algérien du XXe siècle, tout en contenant certains
thèmes et modes d'action communs avec les nationalistes. Il n'est pas
question de nier la faiblesse des
1 Camille Lefebvre et M'hamed Oualdi, « Remettre
le colonial à sa place. Histoires enchevêtrées des
débuts de la colonisation en Afrique de l'Ouest et au Maghreb »,
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 72e année-4, 2017, p.
937?943, ici p. 942.
2 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 18
résultats politiques de la voie
réformiste, mais d'enrichir et de nuancer la présentation qui
peut être faite du paysage politique algérien pendant la
colonisation, à travers le regard d'un acteur qui a imaginé
d'autres solutions pour l'Algérie que le statu quo colonial ou la guerre
d'indépendance.
Sources
Le sujet de ce mémoire et le choix de suivre la
démarche assimilationniste de Bendjelloul a impliqué une
concentration sur les sources de sa vie publique. Les sources privées
des acteurs n'ont pas été employées. L'usage des sources
de surveillance a été réduit et celles-ci sont
employées principalement pour observer les effets des stratégies
de Bendjelloul sur ses interlocuteurs coloniaux. Si l'usage de sources
privées et notamment de sources en arabe serait absolument
nécessaire à une étude des liens entre colonisés et
des débats en leur sein, le présent mémoire est une
biographie politique : la carrière de Bendjelloul au sein des
institutions françaises a essentiellement produit des sources en
français, permettant d'embrasser le sujet du présent
mémoire sans recourir à des sources en arabe.
Puisque la présentation de la vie de
Bendjelloul n'est pas la fin en soi de ce mémoire, il sera peut fait
mention de sa vie personnelle ou de ses archives privées. Pour la
période 19301939, les archives utilisées sont celles de la
préfecture de Constantine et du Cabinet du Gouverneur
Général d'Algérie (GGA)1. Ces dossiers
contiennent des notes de surveillance, mais également des coupures de
presse, des tracts, des comptes-rendus de meetings politiques, qui permettent
un accès moins biaisé au discours de la Fédération
des Élus Musulmans (FEM). Un autre moyen de retrouver le discours
politique de Bendjelloul est la presse. Dans les années 1930, FEM du
Département de Constantine publie son propre organe de presse,
L'Entente Franco-Musulmane2. Il semble que Bendjelloul n'y
écrit pas lui-même, mais on trouve souvent des articles sur les
actions qu'il entreprend et des comptes-rendus plus ou moins exhaustifs de ses
prises de paroles publiques. Ces journaux donnent accès à sa voix
politique pour la décennie 1930, mais offrent également un regard
sur l'image de leader que la FEM, c'est-à-dire les partisans de
Bendjelloul, veut diffuser à son sujet.
1 Archives conservées aux Archives Nationales
d'Outre-Mer (ANOM), Aix-en-Provence.
2 Les numéros consultés proviennent des
archives de l'administration coloniale, mais d'autres numéros sont
également conservés par la BnF.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 19
Pour la deuxième partie de ce mémoire,
les archives concernant la période du régime de Vichy sont elles
aussi celles du Cabinet du GGA et de la préfecture de Constantine.
À partir de 1943, des archives d'autres fonds contiennent des
enquêtes réalisées a posteriori sur des
évènements survenus durant cette période et peuvent
également être une source d'information sur la période de
Vichy. Après le débarquement allié et la reprise de la vie
politique, les procès-verbaux des séances de l'Assemblée
Consultative Provisoire (ACP) et des Assemblées Constituantes sont une
source abondante qui n'a pu être exploitée que par
sondage1. Les archives de l'ACP sont riches en indices sur les
mécanismes de reprise de la vie démocratique sous
l'autorité de la France Libre2.
Sous la IVe République enfin, les
archives des journaux officiels du Conseil de la République et de
l'Assemblée Nationale sont aussi une source fiable pour reconstituer
l'action de Bendjelloul dans ces institutions3. La faible
fréquence de ses interventions au Conseil de la République et
à l'Assemblée Nationale a permis une consultation assez
complète des discours disponibles, ce qui permet d'étudier
à travers un corpus bien défini et complet sa manière de
se positionner dans le cadre des institutions françaises, et ce sur
toute la période 1943-1956. Les archives de la préfecture de
police de Paris ont également été consultées dans
le but de comparer la surveillance politique dont Bendjelloul fait l'objet en
1930 avec celle dont il fait l'objet après-guerre4.
Cependant, jusqu'au début de la guerre d'indépendance, il ne
semble pas que le député Bendjelloul ait fait l'objet d'une
surveillance politique en métropole. La surveillance qui reprend avec le
conflit et le vote de l'état d'urgence permet essentiellement de
récolter des renseignements de nature privée, peu utiles pour
comprendre les rapports de Bendjelloul avec les autorités
françaises.
Contrairement à une idée a priori
selon laquelle le faible traitement de Bendjelloul dans la
littérature signifiait une faible présence dans les sources, une
difficulté de ce mémoire a plutôt été
l'absence de manque. Pour les sources liées aux mandats parlementaires
de Bendjelloul par
1 Le Journal officiel de la République
Française est intégralement numérisé et
disponible en ligne sur Gallica, le site de la bibliothèque
numérique de la BnF.
2 Archives Nationales, Pierrefitte-sur-Seine. Cotes
C//15258-C//15269 pour l'ACP d'Alger et C//15270-C//15281 pour l'ACP de
Paris.
3 Journal officiel de la République
Française, Gallica, BnF.
4 Dossier n°106704 : Bendjelloul (1958-1961).
Cote : 354W1209. Archives de la Préfecture de Police de Paris,
Pré-Saint-Gervais. Consulté en partie sur dérogation du
Service de la mémoire et des affaires culturelles de la
Préfecture de Police.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 20
exemple, le constat est le même pour toute
personne s'y confrontant1: utiliser ces sources implique de
procéder par sondage, et parfois de renoncer à des fonds entiers.
Contrairement aux mémoires de Rahal et de Roudaut, le présent
travail se concentre sur un seul individu. De plus, on ne peut pas dire que ses
mandats aient été caractérisés par des prises de
paroles profuses. Cependant, la carrière de Bendjelloul l'a conduit
à prendre part à une demi-douzaine d'institutions : Conseil
général de Constantine, Délégations
financières, Assemblée Consultative Provisoire, Assemblée
Nationale Constituante, Conseil de la République et Assemblée
Nationale. Renoncer à l'exhaustivité a permis de se concentrer
sur les textes qui semblent les plus importants : les prises de paroles en
séance publique et certaines des propositions de loi dont les textes
étaient accessibles en ligne, indiquant qu'elles ont été
publiées au Journal Officiel et diffusées plus largement
dès l'époque d'émission du texte. De même, pour la
décennie 1930, c'est surtout par des discours publics et des adresses au
gouvernement français par courrier et dans la presse que Bendjelloul
cherche à obtenir des réformes. Les archives du Conseil
Général de Constantine et des Délégations
financières n'ont donc pas été favorisées comme
source pour la première partie de la présente
étude.
Ce mémoire est divisé en trois parties
qui suivent la chronologie de la carrière du Docteur Bendjelloul, en
fonction des changements institutionnels auxquels il adapte son combat
politique : l'Algérie sous la IIIe République du
début de sa carrière en 1939, puis les institutions de Vichy et
du Gouvernement Provisoire de la République Française de 1940
à 1945, et enfin les institutions métropolitaines de la
IVe République de 1945 au vote de la loi d'état
d'urgence en 1956, date après laquelle son action politique
disparaît progressivement. Dans ce contexte instable, nous verrons dans
le présent mémoire comment Bendjelloul adapte son discours et ses
modes d'action, avec une certaine cohérence dont il sera discuté
dans le présent mémoire.
La première partie est consacrée
à la décennie 1930, la partie la plus traitée de son
parcours, et analyse son programme politique et son rapport à la
légalité coloniale. Nous nous demanderons ce qui dans l'action
politique du Bendjelloul des années 1930 faisait de lui un personnage
contestataire vu comme une menace par l'ordre colonial, sans qu'il ne soit
récupérable par le récit nationaliste
ultérieur.
1 Malika Rahal, Les Représentants
colonisés au Parlement français, op. cit ; David
Roudaut, « Les députés des départements
d'Algérie sous la IVe République », Paris, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 21
La seconde partie traite de la manière dont
Bendjelloul ne prend pas le tournant nationaliste de la plupart de ses
contemporains dans le sillage de l'échec du Congrès Musulman
Algérien et de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que de son adaptation
aux changements de régimes politiques en métropole entre 1939 et
1946.
La troisième partie, enfin, porte sur les
modalités de son positionnement politique en tant qu'élu
colonisé d'institutions métropolitaines entre 1946 et 1956. Nous
nous pencherons sur les continuités observées entre ses discours
politiques d'avant-guerre et ceux tenus au Parlement. Nous chercherons aussi
les différentes manières dont Bendjelloul se positionne face aux
évolutions de son contexte politique en métropole et en
Algérie, sans embrasser les idées nationalistes mais sans cesser
pour autant d'exprimer ses revendications au nom de ses mandants
algériens.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 22
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 23
Partie I - Le Docteur Bendjelloul, champion
assimilationniste de la cause algérienne
(1930-1938)
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 24
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 25
I - Le réformisme assimilationniste, programme
politique du Docteur Bendjelloul
Né en 1893 à Constantine d'un
père instituteur de formation dans une famille de notables
désargentés1, Mohammed Salah Bendjelloul effectue ses
études de médecine à la faculté d'Alger dans les
années 1910. Selon les documents de surveillance coloniale, Bendjelloul
aurait ensuite été médecin de colonisation dans les
Aurès dans les années 1920 avant d'installer son cabinet dans sa
ville d'origine2. C'est à partir de ce moment que son
activité politique devient publique, en tant que Président de la
Fédération des Elus Musulmans (FEM) du département de
Constantine, de 1932 à la Seconde Guerre Mondiale.
Durant ses études, Bendjelloul est
témoin de l'essor du mouvement Jeune Algérien auquel
appartiennent alors beaucoup de futurs personnages politiques de sa
génération3. Ce mouvement politique, notamment
dirigé par l'Emir Khaled, le petit-fils d'Abdelkader, revendique des
réformes du système politique et l'égalité des
droits pour les Algériens et les colons européens4. Le
courant Jeune Algérien constitue l'émergence d'un discours
politique assimilationniste. Les Jeunes Algériens respectent les formes
et les cadres d'expression du discours politique français. Ils
s'expriment en français, utilisent la presse, revendiquent
l'accès aux droits civiques et à la citoyenneté
française avec maintien du statut personnel musulman. Cette notion
juridique distinguait les Français de statut personnel musulman des
citoyens français de plein droit. Les colonisés souhaitant
exercer leur pleine citoyenneté devaient renoncer à leur statut
personnel musulman, ce qui s'apparente pour eux à une apostasie. L'un
des combats des assimilationnistes est la revendication de la pleine
citoyenneté sans abandon du statut personnel.
1 Entretien avec M'hamed Bendjelloul, fils de
M.S.Bendjelloul, In Julien Fromage, Innovation politique et mobilisation de
masse en « situation coloniale » : un « printemps
algérien » des années 1930 ? L'expérience de la
Fédération des Elus Musulmans du Département de
Constantine, Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2012.
2 Sous-Direction des Services Actifs de Police -
Service Central des Renseignements Généraux, « A/S de M.
BENDJELLOUL Mohamed Salah, ex-député de Constantine »,
Gouvernement Général d'Algérie, 1958. GGA 7G 1403, ANOM,
Aix-En-Provence.
3 J. McDougall, A History of Algeria, op.
cit, p. 181.
4 Voir Charles-Robert Ageron, « Le mouvement
«Jeune-Algérien» de 1900 à 1923 », in
Genèse de l'Algérie algérienne, Saint-Denis,
Éditions Bouchène, 2005, p. 107-130.
Dans ce mémoire, on entend par
assimilationnisme une aspiration à l'égalité
formulée par les colonisés dans les formes du discours politique
du colonisateur. Les adhérents à cet idéal, souvent des
élites éduquées, se distinguent par une francophilie
affirmée et professent leur reconnaissance au colonisateur, se
considérant comme les preuves de la réussite de la mission
civilisatrice. Bendjelloul s'inscrit dans cette dynamique, mais y associe une
stratégie de mobilisation populaire revendicative, qui légitime
le mouvement tout en répandant l'idée assimilationniste
au-delà de l'élite urbaine.
A - La préface de 1935, une profession
d'assimilationnisme
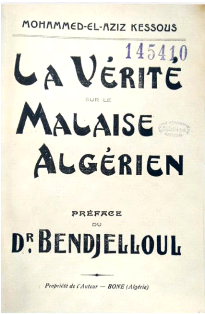
Figure 1 Deuxième couverture de «
La
Vérité sur le Malaise
Algérien » de
Kessous, Bône (Annaba),
Société anonyme de l'imprimerie rapide, 1935.
En 1935, Mohammed-El-Aziz Kessous, alors
rédacteur en chef de l'Entente, publie un essai de 115 pages
intitulé « La Vérité sur le Malaise Algérien
»1. La préface de ce livre est écrite par
Bendjelloul, et est l'une des sources écrites par lui les plus longues
dont nous disposions, et également la seule qui ait été
publiée. « La Vérité sur le Malaise Algérien
» s'inscrit résolument dans l'idée assimilationniste, et ce
dès le verso de la page de titre où l'auteur dédicace son
livre « à [ses] Maîtres de l'Ecole Primaire, de
l'Enseignement Secondaire et des Facultés.
»2.
Une analyse rapide de la couverture est
révélatrice du rôle de Bendjelloul sur la scène
politique algérienne des années 1930 : son nom est imprimé
en plus grand que nom de l'auteur, et semble lui servir de légitimation,
voire d'argument de vente.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 26
1 Mohammed-El-Aziz Kessous, La
Vérité sur le Malaise Algérien - Préface du Dr
Bendjelloul, Bône (Annaba), Société anonyme de
l'imprimerie rapide, 1935.
2 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 27
Dans sa préface, Bendjelloul appelle Kessous
son « cher ami » et « un des membres les plus
représentatifs de la jeunesse intellectuelle indigène
»1. Il loue la qualité du travail de l'auteur pour
« rétablir les faits dans leur exactitude » et « exposer
[les] justes revendications » des Elus Musulmans, dans un contexte de
« calomnies » et de « ragots » dont ils sont
victimes2. En effet, moins d'un an avant la publication de ce livre,
les 3 et 5 août 1934, la ville de Constantine avait été
endeuillée par de violentes émeutes antisémites,
perpétrées par des Algériens musulmans partisans de
Bendjelloul ayant cru, dans un contexte de tensions exacerbées par la
situation coloniale, que leur leader avait été assassiné.
Cette émeute avait été instrumentalisée par les
ennemis de l'assimilation des colonisés comme une preuve de leur
sauvagerie et du danger qu'ils représenteraient s'ils étaient
intégrés au corps des citoyens français3. Afin
de contrer cette campagne de diffamation, Bendjelloul professe « les
sentiments et les intérêts qui lient indéfectiblement
à la France » les représentants des Algériens
musulmans, et espère que, grâce au travail de Kessous, « on
ne mettra plus en doute [leur] patriotisme » :
La France a comblé de bienfaits notre pays,
nous l'avons toujours proclamé et nous le proclamerons toujours. C'est
elle qui a construit ces écoles où des milliers d'enfants
s'adaptent de plus en plus à une vie moderne où l'instruction est
le premier des biens ; c'est elle qui a tracé des routes, établi
des ponts, construit des hôpitaux, défriché des
forêts, fertilisé des marais ce dont nous lui serons
éternellement reconnaissants. Mais n'est-il pas vrai que ces
progrès sont encore loin de suffire à tous les besoins,
qu'ils ont été inégalement répartis et que leur
jouissance est pratiquement refusée à la plus grande partie de la
population laborieuse ? 4
Bendjelloul reprend des thèmes
rhétoriques coloniaux, comme la mission civilisatrice ou plus loin la
référence à l'empire romain, mais il ne se contente pas
d'acclamer la colonisation,
1 Mohammed Salah Bendjelloul, « Préface
», in La Vérité sur le Malaise Algérien -
Préface du Dr Bendjelloul, Bone (Annaba), Société
anonyme de l'imprimerie rapide, 1935, respectivement p. 7 et p. 5.
2 Ibid.
3 Pour une enquête de fond sur cet
évènement et la complexité des facteurs ayant mené
au pogrom, voir Joshua Cole, Lethal provocation, op. cit.
L'auteur y présente également la rhétorique
antisémite employée par Bendjelloul à cette époque
à des fins électoralistes. Si les sources
sélectionnées pour la réalisation de ce mémoire ne
donnent pas suffisamment de matière pour discuter de cet aspect du
discours politique algérien, le recours à l'antisémitisme
de Bendjelloul et d'autres élus algériens musulmans est un fait
avéré.
4 M. S. Bendjelloul, « Préface »,
art. cit., p. 7.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 28
comme l'ont fait les colons quelques années
plus tôt lors des célébrations du centenaire de la
colonisation de l'Algérie. Il commence par louer le travail accompli
factuellement, avant de dénoncer les injustices dans la
répartition des bénéfices en découlant. Il appelle
les colonisateurs français, qui se voient comme les héritiers de
l'Empire Romain en Afrique du Nord, à imiter leurs ancêtres : ne
réduisant pas l'Afrique du Nord à une ressource en biens et en
soldats mais laissant se développer l'élite intellectuelle :
« des poètes, tel Apulée, des empereurs, tel
Septime-Sévère, et des penseurs, tel Saint-Augustin
»1. Plus largement, il affirme que la masse paysanne est
restée dans le même état depuis la conquête
malgré les nombreux bienfaits énumérés dont ne
bénéficie pas la majorité des Algériens. Le
principal apport de la colonisation pour ces masses est la
sécurité, mais elle a été acquise au prix de la
participation des Algériens à toutes les guerres du Second Empire
et de la IIIe République. Cela leur confère « le
droit de réclamer un traitement politique plus équitable et une
vie matérielle meilleure »2. Dans ce texte, Bendjelloul
reste réformiste et peu radical dans ses revendications. Il ne remet pas
en cause la colonisation en soi mais appelle simplement à des
améliorations : il ne dit pas que les Algériens ont droit
à un traitement politique équitable mais « plus
équitable » ; il ne réclame pas vie matérielle digne
mais « une vie matérielle meilleure ».
Deux pôles de demande sont identifiables : la
situation humanitaire, ou soulagement de « l'épouvantable
misère dont souffre le paysan algérien »3, et le
problème politique de la place des musulmans dans la cité
française :
La France est aujourd'hui la deuxième
puissance musulmane de l'Univers, et il se trouve que ses ressortissants
Mahométans sont groupés à sa porte, la prolongent dans
l'espace, et participent activement à sa vie économique et
politique. C'est là une situation unique qui lui impose des devoirs
spéciaux, très différents de ceux qui incombent aux autres
puissances musulmanes, telles l'Angleterre ou la Hollande, dont les sujets
mènent, à des milliers de lieux, une existence tout à fait
particulière4 .
1Ibid., p.
6.
2 Ibid., p.
8.
3 Ibid.
4 Ibid., p.
9.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 29
A ceux qui jugent que l'Islam est incompatible avec la
civilisation européenne, Bendjelloul répond avec une dimension
transimpériale qui se retrouve régulièrement au cours du
parcours politique de Bendjelloul. Il affirme que les
spécificités de l'Algérie dans l'empire colonial donnent
à la France une relation unique et une responsabilité
particulière envers ces populations. La religion musulmane de celles-ci
est une donnée avec laquelle la France doit composer, affirme
Bendjelloul : si l'attachement des Algériens à l'Islam n'est pas
négociable, il n'entre pas plus en contradiction avec le statut de
citoyen français, tout comme l'attachement de certains Français
à la chrétienté1.
Ainsi, l'assimilationnisme de Bendjelloul
formulé dans ce texte se base sur une appropriation des motifs
discursifs des colonisateurs français, pour mettre ces derniers face
à leurs contradictions. Il demande d'eux ce que la propagande de la
mission civilisatrice et de la France pays des Lumières promet : la
liberté et l'égalité pour les colonisés. Ce texte
est un aperçu clair et argumenté du programme porté par
Bendjelloul en tant qu'élu au sein des institutions
coloniales.
B - Être élu en situation coloniale :
l'opposition loyale
Les Algériens musulmans engagés en
politique présentent des opinions variées et développent
différentes stratégies face aux contraintes du cadre colonial
auxquelles ils sont soumis. Suite aux émeutes antisémites du 5
août évoquées plus haut, ainsi qu'à la publication
à Paris de propos algériens nationalistes par l'Etoile
Nord-Africaine, le Conseil général du département de
Constantine se réunit et, sous la pression de leurs collègues
européens, les élus indigènes de cette institution
professent leur loyalisme envers la France2. Lors de cette
réunion est discutée une motion aux accents pour le moins
paternalistes proposée signée par les membres européens du
conseil et adressées aux élus musulmans. Les conseillers
musulmans
1 Ibid., p. 10.
« Nous continuerons à nous sentir les Frères des autres
musulmans, qu'ils soient noirs ou jaunes, de même que tous les
catholiques se sentent fils de la même église, mais c'est
là un sentiment élevé, qui nous honore plutôt que
nous rabaisser, et qui ne nous fera jamais oublier que nous sommes
français tout court. »
2 Conseil Général de Constantine,
Extrait du procès-verbal de la séance du 28 octobre
1934, Constantine, Conseil Général de Constantine, 1934. In
Archives de la Préfecture de Constantine, « Politique
Indigène - Evènements du 5 août 1934 », 93 B3 277,
ANOM, Aix-en-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 30
Chérif Saadane et Ferhat Abbas mènent la
critique de ce texte jugé insultant, et Bendjelloul déclare
:
Messieurs, je ne voterai pas le (sic) motion de M.
Vallet. Si je reconnais qu'ici la souveraineté est la
souveraineté française, il existe dans cette motion des
considérants que je ne puis tolérer.1
C'est ici un exemple de l'opposition légale
déployée par les élus algériens : dans le cadre des
institutions mises en place par la République Française, face
à leurs collègues européens, Bendjelloul et ses
alliés s'opposent à leur vision du monde par des débats et
de votes de motions. Bendjelloul affirme son attachement à la
souveraineté française sur l'Algérie, condition de sa
prise de parole dans le cadre de ces institutions.
Ce document témoigne d'une atmosphère
politique tendue entre élus départementaux colons et
colonisés, parce que les Européens remettent en question la
loyauté des élus indigènes. On voit apparaître trois
camps dans le discours des acteurs : les Européens colonialistes, qu'ils
soient ou non arabophiles ; les élus assimilationnistes, qui sont
appelés et s'appellent eux-mêmes « les jeunes
»2 ; et les chefs indigènes. La sincérité
de ces derniers est remise en question par les jeunes intellectuels
assimilationnistes, qui essayent de faire entendre leurs revendications et de
se faire une place dans la politique où jusqu'ici siégeaient les
« Vieux Turbans », représentants de grandes familles
algériennes. Face aux insinuations de leurs homologues européens,
chaque camp rivalise de loyalisme envers la France. Bendjelloul s'écrie
par exemple :
Ici, nous sommes reconnaissants à la France
d'avoir fait de l'Algérie ce qu'elle est. Je suis son serviteur, je
pense en français et je parle, j'ignore presque ma langue maternelle. Je
tiens à le répéter, il n'y a ici qu'une
souveraineté : celle de la France.3
Il est important de souligner que ses paroles
répondent à une remise en cause du patriotisme des membres
algériens musulmans du Conseil général du
département de Constantine. Cette profession de foi profrançaise
est prononcée, sinon sous la contrainte, au
1 Ibid.
2 Conseil Général de Constantine, «
Procès-Verbal du 28 octobre 1934 ». Abbas en
s'autodésignant, et Panisse à la page 8 en répondant
à Bendjelloul.
3 Ibid., p. 8 In
Archives de la Préfecture de Constantine, « Politique
Indigène - Evènements du 5 août 1934 », 93 B3 277,
ANOM, Aix-en-Provence.
moins sous la pression. Néanmoins, ces paroles
sont celles de Bendjelloul et on peut retrouver des affirmations
peut-être moins radicales mais semblables dans d'autres contextes, il
semble établi que c'est bien dans le cadre de la souveraineté
française que la figure de proue assimilationniste voit l'avenir de
l'Algérie.
L'absence de remise en question de la
souveraineté française ne signifie cependant pas l'absence de
remise en question du système d'oppression colonial, et les archives de
l'action des Elus constituent une description précieuse et
détaillée du système colonial dans ses violences et
injustices quotidiennes qu'ils dénoncent inlassablement. Dans une lettre
de six pages datées du 3 avril 1934, Bendjelloul fait état au
préfet de l'exaspération des populations indigènes
misérables, victimes de l'arbitraire des « fonctionnaires
subalternes » et de l'injuste attribution des ressources1. Il
liste vingt-deux raisons de cette exaspération, dénonçant
par exemple la « brutalité inouïe » qui accompagne
parfois la perception des impôts (point 8), les expropriations qui «
vont toujours bon train » (point 14) ou encore l'attitude
réactionnaire des opposants aux réformes indigènes (point
1), réformes qu'il appelle de ses voeux en conclusion de la lettre. Il
présente sa plainte comme un acte de loyauté envers la France :
il voit monter la colère et le risque d'émeutes et appelle
à des réformes pour éviter des affrontements qui ne
feraient qu'empirer la situation.
« En pareilles circonstances, notre devoir est
de vous dire franchement la vérité, en vous signalant la
situation désespérée des nôtres »
2.
Si Bendjelloul ne voit pas dans l'oppression coloniale
une raison de revendiquer l'indépendance, il ne s'en accommode pas pour
autant. Il se mobilise pour faire cesser les injustices, mais selon les modes
d'expression autorisés : la presse, les institutions françaises,
les campagnes électorales, l'interpellation des autorités
métropolitaines, ...
Selon une « fiche bleue » de la
préfecture de Constantine, synthétisant tous les renseignements
recueillis par la police de surveillance, Bendjelloul aurait envoyé en
août 1932 un télégramme au président du conseil,
c'est-à-dire au plus haut niveau de l'Etat français, ainsi qu'au
ministre de l'Intérieur, pour dénoncer des mauvais traitements -
la fiche parle de « soi-
1 Mohammed Salah Bendjelloul, « Lettre au
Préfet du Département de Constantine », 3 avril 1934, 93 B3
277, ANOM, Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 31
2 Ibid., p.
6.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 32
disant mauvais traitements » - subis par les
habitants de la commune d'Aïn-M'Lila lors de la perception des
impôts et demander une enquête « par des "gens de France"
»1. On reconnaît ici un mode d'action politique typique
de Bendjelloul tout au long de sa carrière : relayer les plaintes des
populations au plus haut niveau de l'Etat, en métropole, pour
dénoncer la corruption des échelons intermédiaires de
l'administration française, en Algérie. Dans une lettre au
journal La Dépêche de Constantine de juin 1935,
Bendjelloul justifie sa pratique de contourner le Gouverneur
Général pour s'adresser directement à Paris : les portes
sont fermées au dialogue, et l'administration coloniale en
Algérie a pris parti contre lui2.
Ainsi, par différents moyens d'action,
Bendjelloul s'inscrit dans une opposition loyale au système colonial et
à ses travers, sans se départir de ses convictions francophiles :
il souhaite que l'Algérie devienne toujours plus française, et
c'est pour cette raison qu'il critique les exactions françaises. Cette
loyauté assimilationniste est mal reçue par les colons
européens, qui voient dans toute critique une menace de sa
souveraineté.
1 Fiche de Renseignement individuel sur Mohammed Salah
Bendjelloul, In Préfecture de Constantine, « Dossier Bendjelloul
(1934-1940) - Surveillance politique des indigènes », 9310115,
ANOM, Aix-En-Provence.
2 Article de la Dépêche de Constantine du
1er février 1935 [Publication et commentaire d'une lettre du
Dr Bendjelloul au Rédacteur en Chef]. In « Dossier
Fédération des Elus Musulmans d'Algérie, 1935- 1936
». 93 B3 277, ANOM, Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 33
II - Toute remise en cause du système colonial
est-elle nationaliste en puissance ?
La Fédération des Elus Musulmans (FEM)
du Constantinois, présidée par Bendjelloul à partir de
1932, est fondée le 29 juin 1930 à Constantine par Chérif
Sisbane, président de la section arabe des Délégations
Financières, assemblée chargée de gérer le budget
de l'Algérie indépendamment du gouvernement
métropolitain1. Cette organisation a pour but « d'unir
et de coordonner les efforts des représentants indigènes et de
collaborer avec les pouvoirs publics, en les éclairant sur les besoins
de la population musulmane »2 dans une dynamique explicitement
assimilationniste3. Son action reste peu combative avant la
présidence du Docteur Bendjelloul, qui lui impulse une dynamique plus
populaire et contestataire.
Ce tournant revendicatif des Elus peut s'expliquer par
l'humiliation du centenaire de la colonisation, fêté en grandes
pompes à Alger et à Paris. Les premières
générations d'intellectuels algériens ayant suivi une
éducation française ne reçoivent aucune place dans ce
qu'ils envisageaient pourtant comme l'occasion de marquer un tournant dans les
pratiques coloniales et de faire des réformes en faveur de
l'égalité des colons et des Algériens
musulmans4. L'absence criante de réforme et d'intention de
changement lors des célébrations du centenaire va pousser les
membres de cette élite à entrer dans une démarche de
contestation plus explicite.
1 Pour une étude approfondie de l'histoire et
du fonctionnement des Délégations financières, voir
Jacques Bouveresse, Un parlement colonial? Les Délégations
financières algériennes 1898-1945, Mont-Saint-Aignan,
Publications de l'Université de Rouen et du Havre, 2008.
2 Le Chef de la Sûreté
Départementale, Rapport Spécial: Création d'une
Fédération des élus musulmans du Département de
Constantine, Constantine, Sûreté Départementale de
Constantine, 1930. In Préfecture de Constantine, « Dossier
Constitution de la Fédération des Elus Musulmans 1930 »,
1930- 1934, 93 B3 277, ANOM, Aix-En-Provence.
3 Chérif Sisbane, Note sur les
réformes désirées par la Fédération des
élus des indigènes du département de Constantine,
Constantine, Imprimerie P. Braham, 1931.
4 Sur les enjeux entourant les fêtes du
centenaire de la colonisation de l'Algérie, voir notamment Jan C.
Jansen, « Fête et ordre colonial. Centenaires et résistance
anticolonialiste en Algérie pendant les années 1930 »,
Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2014, vol.121
no 1, p. 61-76.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 34
A - La mobilisation autour du projet Viollette :
l'assimilation contre l'oppression coloniale
En 1936, l'avènement du Front populaire permet
pendant quelques mois d'espérer une politique coloniale libérale
et réformiste. Le sénateur Maurice Viollette, ancien gouverneur
général de l'Algérie très favorable aux
réformes et proche de la FEM, propose au parlement un projet de loi
accordant le droit de vote à un plus grand nombre de Français
musulmans, sans que ceux-ci ne soient forcés à renoncer à
leur statut personnel. Si les assimilationnistes soutiennent ce projet comme un
premier progrès, le lobby colonial du parlement métropolitain,
composé notamment des députés des colons algériens,
mène durant plusieurs années une intense campagne contre la FEM
et contre ce projet ; jusqu'à ce qu'il soit
abandonné.
Lors d'une conférence publique à Guelma
le 2 août 1937, le Docteur Bendjelloul explique à la population
les raisons qui l'ont poussé à lancer un mouvement de
démissions collectives des élus, suivi massivement, en
particulier dans le Constantinois. L'administrateur adjoint de l'arrondissement
de Jemmapes (Azzaba) rapporte ses paroles au préfet de Constantine :
Bendjelloul se déclare « partisan convaincu du projet Violette
», dans lequel il voit l'aboutissement des revendications de la population
musulmane. Mais ses efforts se sont « toujours heurté à
l'indifférence sinon à l'opposition des pouvoirs publics »,
et la FEM, face à cette situation, « a
décidé que ses adhérents renonceraient à leur
mandat en signe de protestation » 1. Avec ces démissions
collectives, le but de la FEM n'est pas de sortir des institutions
françaises pour couper toute relation avec le système colonial,
mais d'obtenir des réformes de ce système. Pour cela, les
élus utilisent les moyens légaux à leur disposition. Le
dossier que les archives de la préfecture de Constantine consacrent
à la FEM en 1937 permet de mieux comprendre la stratégie et les
différents modes d'action de la Fédération : les rapports
de surveillance traitent de ce mouvement de démissions collectives
d'élus organisé à l'été 1937, mais le
dossier contient aussi, par exemple, des correspondances et échanges
entre Bendjelloul et l'administration pour demander des autorisations de se
réunir. Par exemple, le dossier contient une copie d'une lettre
datée du 3 août 1937 dans laquelle Bendjelloul informe
l'administrateur de la commune mixte de Guergour de sa venue pour une
réunion publique les
1 Le sous-préfet de l'arrondissement à
Monsieur le Préfet - Centre d'Information et d'Etudes de Constantine,
« Rapport n° 4605 - Surveillance politique Indigène -
Conférence du Dr Bendjelloul ». Guelma, 1937. In
Préfecture de Constantine, « Dossier sur l'action de la FEM -
Journaux, rapports de surveillance et divers », août 1937, 93 B3
280, ANOM, Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 35
19 et 20 août, et lui demande un local pour
accueillir l'évènement. Le fonctionnaire colonial exprime ses
craintes à ses supérieurs1, mais le préfet
l'encourage à ne pas interdire la réunion « par caprice
», d'autant plus que, « dans plus de vingt communes [...], des
réunions semblables ont déjà eu lieu qui, grâce aux
dispositions prises par l'Autorité Locale, n'ont provoqué aucun
incident »2.
Comme le signale le préfet, Bendjelloul
déploie avec la FEM une importante mobilisation politique en cet
été 1937, enchaînant les réunions dans toute la
région. Les administrateurs rapportent à chaque fois la
présence de quelques milliers d'« indigènes ». Le
Capitaine Metens, commandant de la section de gendarmerie nationale de Bougie
(Bejaia), est chargé de maintenir l'ordre lors de la réunion
publique « organisée par le Docteur Bendjelloul » à
Kerrata (Kherrata) le 17 août 1937. Dans son rapport, il témoigne
des appels au calme des orateurs, suivis par la foule présente. Ce calme
contraste avec le ton revendicatif des orateurs, Abbas, Mostefaï et
Bendjelloul : ils expliquent leurs démissions par une litanie de
critiques de la situation d'oppression économique et juridique que
subissent « les indigènes ». Ils déclarent qu'ils se
mobiliseront sans se fatiguer « pour lutter jusqu'à
l'amélioration de la situation des indigènes dans une
Algérie Française ».3 Ils dénoncent avec
vigueur l'accaparement des terres par les gros colons et les grandes compagnies
terriennes, enjoignent leurs auditeurs à ne plus accepter les salaires
trop bas pour peu à peu être en mesure d'exiger « un salaire
égal à celui des français (sic) car les indigènes
ont un ventre comme les Français »4. Le droit du sang,
acquis par les sacrifices des Algériens dans les guerres coloniales et
en Europe, est également invoqué. Les communes mixtes, avec leurs
administrateurs et leurs caïds, doivent disparaître. Il est à
noter que les mots colonisés ou système colonial ne font pas
partie du vocabulaire des élus musulmans. Le compte-rendu du Capitaine
Metens rapporte que la réunion se serait finie sur les mots suivants
:
Nous avons vu le Gouverneur Général,
des Ministres, le Président de la République, qui nous ont fait
des promesses sans aucune réalisation. Nous voulons
1 Administrateur Adjoint de la commune mixte de
Guergour au Sous-préfet de Bougie, Lettre n° 8991. Lafayette, 5
août 1937. In Ibid. doc.cit.
2 Ibid. In Ibid.
3 Rapport du Capitaine Metens, Commandant la section
sur une réunion publique à Kerrata le 17 août 1937. In
Ibid.
4 Ibid. In Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 36
continuer nos revendications dans le calme mais si
nous avons besoin de vous pour une action énergique est-ce que vous
répondrez "présent" ? La masse des indigènes a
répondu "Oui".1
L'assimilationnisme des Elus n'est donc pas le
résultat d'un aveuglement sur la mauvaise foi de leurs interlocuteurs
français, ni une acceptation résignée des injustices du
système colonial. Selon ce rapport, ils affirment leur volonté de
continuer à se mobiliser dans le calme et à demander à
leurs partisans de faire de même. Les Elus sont bien favorables à
la présence française en Algérie, mais revendiquent une
réforme en profondeur du système, en fait la fin de l'oppression
coloniale.
B - L'accusation de nationalisme
On l'a vu, Bendjelloul revendique une plus grande
présence de la France dans le quotidien des colonisés, afin que
ceux-ci aient à terme un niveau de vie et des droits égaux
à ceux des Français. Les partisans de l'ordre colonial ont raison
de voir ces revendications de Bendjelloul comme une menace pour l'empire
français, mais formulent à tort cette menace comme étant
« nationaliste », se montrant incapables de reconnaître la
francophilie motivant les revendications des assimilationnistes. Ainsi, un
document de six pages interne au service de surveillance politique des
Indigènes de la Préfecture de Constantine, non daté et non
signé, décrit Bendjelloul en « héros National »,
autour duquel se serait formé « une sorte de Front Commun »
enthousiaste et « prêt à obéir à tous ses mots
d'ordre » 2.
Un dossier de surveillance de la préfecture de
Constantine sur la Fédération des Elus contient une traduction
d'un article paru dans le troisième numéro du journal arabophone
El Midane le 11 juillet 1937.3 Cet article contient une
photographie de l'Emir Khaled, mis en scène en train de parler depuis le
paradis à la nation algérienne pour l'appeler à
l'unité. L'article contient également une photographie de
Bendjelloul, qui appelle lui aussi à l'unité.
Bendjelloul
1 Ibid.
2 Préfecture de Constantine, « Dossier
Bendjelloul (1934-1940) - Surveillance politique des indigènes »,
doc. cit.
3 « Traduction du troisième numéro
d'EL MIDANE du 11 juillet 1937 », Constantine, 13 juillet 1937. In
Préfecture de Constantine, « Dossier sur l'action de la FEM -
Journaux, rapports de surveillance et divers », doc.
cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 37
est ainsi visuellement et discursivement
associé à l'émir Khaled, descendant d'Abdelkader, et est
placé comme leur héritier. Il est appelé
le valeureux leader de la cause algérienne,
le Docteur BENDJELLOUL qui combat les instigateurs de désordre,
l'élu indépendant qui défend le peuple musulman
algérien lésé dans ses droits, humilié dans sa
dignité1.
Un journal, publié dans les milieux proches de
la FEM, est saisi en ce même été 1937 par les services de
surveillance de l'activité politique des indigènes. Le journal
publie dans son premier numéro un appel au peuple algérien
à sortir de sa torpeur et à voir les Français comme des
ennemis desquels se libérer. Les éléments
rhétoriques empruntent à un vocabulaire nationaliste, invoquant
le sang des ancêtres, maudissant les « traîtres ». Le
Gouverneur Général de l'Algérie prend connaissance de ce
texte « d'une particulière violence » et demande au
préfet de Constantine d' « inviter » Hacène
El-Ouarezgui, le rédacteur du journal, « à observer plus de
modération et l'informer que [le Gouverneur Général
n'hésitera] pas à provoquer contre le journal toutes mesures
utiles »2 en cas de récidive. Le 28 juillet, le
préfet de Constantine répond au Gouverneur Général
que suite à ces mises en garde, « l'intéressé »
a professé son loyalisme et affirmé que « les faits
signalés ne se renouvelleraient pas »3.
L'article en question contenait également une
photographie de Bendjelloul, avec en légende le texte suivant
:
1 Ibid.
2 Le Gouverneur Général de
l'Algérie à Monsieur le Préfet de Constantine (Affaires
Indigènes). Courrier n° 6643 E.S. du 17 juillet 1937 «
Politique Indigène - Journal "El Midane" ». In Préfecture de
Constantine, « Dossier Article du journal El Maidane du 27 juin 1937 et
traduction en français par la préfecture », 93 B3 280, ANOM,
Aix-En-Provence.
3 Le Préfet du Département de
Constantine à Monsieur le Gouverneur Général de
l'Algérie (Cabinet). Courrier n° 3828 : « Politique
indigène - Journal "El Midane" » du 28 juillet 1937. In
Ibid.

Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 38
Figure 2 Portrait du Docteur Bendjelloul dans le
journal El Midane du 27 juin 19371
Ce portrait est l'empreinte du courage qui ne peut
être égalé, du caractère ferme et audacieux. - Le
Docteur BENDJELLOUL, Président de la Fédération des Elus
Musulmans du Département de CONSTANTINE, dirigeant du mouvement
politique algérien. 2 (traduction de
l'administration du Gouverneur Général)
Ainsi, sans que les discours de Bendjelloul ne soient
antifrançais ou nationalistes, sa personne suscite l'admiration et
l'espoir de la fin de la domination française3. Il faut
cependant
1 Ibid.
2 Ibid. p.
5.
3 Préfecture de Constantine, « Dossier
Article du journal El Maidane du 27 juin 1937 et traduction en français
par la préfecture », doc. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 39
relever que cet article émerge dans un milieu
proche de la FEM, et que le journal est domicilié à la même
adresse que l'Entente. Bendjelloul était-il au courant voire en
accord avec le contenu de ce journal ? L'article nationaliste ne reprend
pourtant pas les thèmes et les revendications assimilationnistes de la
FEM. Pour savoir si Bendjelloul jouait double jeu entre la presse francophone
de la FEM et la presse arabophone, une recherche plus approfondie sur
Hacène El-Ouarezgui et sur les sociabilités politiques à
Constantine serait nécessaire.
Au-delà d'idées nationalistes, il est
certain que Bendjelloul a entretenu tout au long des années 1930 une
rhétorique accusatrice et parfois violente envers ses adversaires
défenseurs de la colonisation traditionnelle, et a fréquemment
lancé des accusations de traîtrise et employé une
rhétorique religieuse à des fins politiques, bien avant que le
FLN ne retourne ces ressorts rhétoriques contre les assimilationnistes
tels que lui. Bendjelloul a souvent employé les mêmes
stratégies de diabolisation manichéenne des élus «
Béni Oui-Oui » passifs face aux Français pour promouvoir son
programme politique, de la même manière que les nationalistes ont
par la suite diabolisé son action.
Quoi qu'il en soi, tout au long de la décennie
1930, l'activité politique des Elus est accusée d'être
source d'agitation sociale. Dans un rassemblement public le 17 mai 1936, les
Elus affirment devant leurs électeurs s'être abstenus de faire des
meetings pendant plus d'un an en réponse à « un désir
exprimé par M. Régnier » pour « dissiper le malaise
algérien »1, euphémisme désignant dans les
années 1930 l'animosité montante entre colonisés
revendiquant des réformes et colons défendant aveuglément
leurs intérêts. Ce « désir exprimé par M.
Régnier » est en fait un décret de répression de
l'expression politique des Algériens colonisés,
dénoncé avec vigueur dans d'autres contextes par Bendjelloul et
les élus comme une violation des valeurs de la France et des
libertés des Algériens musulmans au même titre que le code
de l'indigénat.
Le projet politique porté par Bendjelloul et la
FEM s'oppose au statu quo colonial, et les garants de cet ordre des choses
perçoivent le danger que représentent leurs revendications. Une
des fiches de surveillance des archives de la préfecture de Constantine
est intitulée « Renseignements sur la moralité, les
antécédents et les tendances politiques des nouveaux
Elus
1 A. Debabeche, « Nos élus engagent une vive
Action », L'Entente franco-musulmane, 28 mai 1936,
n°29.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 40
aux dernières Elections aux
Délégations Financières » et reprend les
thèmes majeurs des autres documents produits sur le sujet par les
services de surveillance de la préfecture. Cette fiche nous renseigne
sur la perception de Bendjelloul par l'administration dans les années
1930 :
En résumé, le Docteur BENDJELLOUL
est un adversaire dangereux de l'Autorité contre laquelle il s'est
ouvertement dressé. Son caractère autoritaire, son
tempérament violent, sa nature orgueilleuse, son ambition, sa
moralité qui n'a pas été à l'abri de tout
soupçon, font que, bien que sa valeur intellectuelle soit, au demeurant,
assez moyenne, cette personnalité n'abandonnera la lutte que de vive
force.
Je crois devoir, par ailleurs, mettre en garde la
Haute Administration contre le peu de foi que l'on pourrait accorder aux
promesses que le Docteur BENDJELLOUL pourrait faire
ultérieurement.
A l'heure actuelle, il est en tout état de
cause, le véritable responsable de la situation troublée et
inquiétante que j'ai eu l'honneur de vous signaler. J'estime, en
conclusion, qu'il constitue un danger public
1.
L'auteur de cette source présente Bendjelloul
comme un ennemi déclaré de l'administration, luttant «
sournoisement » contre elle. Les actes « d'hostilité ouverte
contre elle » détaillés dans le document sont en fait des
actes de résistance aux pressions ou d'expression d'un désaccord,
comme dans cet exemple l'abstention de voter la confiance au Gouverneur
Général :
A partir de ce moment, il a agi avec
persévérance, tenu en haleine ses partisans et entamé
sournoisement la lutte contre l'Administration.
Son premier acte d'hostilité ouverte a
été de ne pas voter la mention de confiance proposée par
le Conseil Général à l'adresse de Monsieur le Gouverneur
Général CARDE.
1 Préfecture de Constantine, « Dossier
Bendjelloul (1934-1940) - Surveillance politique des indigènes »,
doc. cit., p. 17.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 41
Il a agité le premier, le projet d'une
Délégation d'Elus Indigènes à PARIS. La
légitime résistance de la Haute Administration lui a donné
l'idée de provoquer les démissions collectives de 1933
1.
Ces extraits montrent comment l'assimilationnisme,
dénoncé par la suite par les nationalistes comme une attitude
passive voire une collaboration avec le système colonial, est en
réalité perçu comme un défi à l'ordre
colonial par les colonisateurs.
Cette source est d'une malhonnêteté
évidente : elle est formulée de manière à passer
rapidement sur les succès de Bendjelloul, voire à les ignorer.
Par exemple, son élection n'est pas attribuée à sa
campagne électorale organisée au contact des populations et dans
la presse, mais est présentée comme le fruit de manigances et de
manipulation de la population. Le succès électoral n'est pas
explicitement mentionné, l'auteur se contentant de décrire
Bendjelloul comme un ambitieux intriguant « dès que les
circonstances le lui ont permis », c'est-à-dire dès son
large succès électoral et populaire, pour briguer et obtenir la
Présidence de la Fédération des Elus Musulmans. Ce rapport
se déroule sans la moindre mention de son programme politique, comme si
son seul mobile était l'influence personnelle. De plus, ses
alliés sont appelés « le parti Bendjelloul »,
évitant ainsi à l'auteur de devoir développer sur leurs
idées politiques et présentant au contraire comme une mafia ou un
çoff, un groupe d'influence visant l'intérêt personnel du
groupe et de sa figure de proue. Le terme « agitation » est
employé en lieu et place de campagne électorale ou mobilisation
politique. Le terme d'agitation montre que l'auteur de cette source
considère Bendjelloul comme un ennemi qui cherche à causer du
trouble, sans direction politique claire. Il insiste sur son caractère
et ses écarts moraux et ne mentionne aucune de ses revendications
politiques, ni de discours ou d'antécédents politiques, aux
Jeunes Algériens par exemple. On sait pourtant par le reste des sources
disponibles que Bendjelloul tenait des réunions et publiait des articles
présentant sa stratégie d'opposition légale et ses
revendications sociales et civiques pour les Algériens
musulmans.
1 « RENSEIGNEMENTS sur la moralité, les
antécédents et les tendances politiques des nouveaux Elus aux
dernières Elections aux DELEGATIONS FINANCIèRES », s. d.
In Dossier Bendjelloul de 1934 à 1940 ; Préfecture de
Constantine, « Dossier Bendjelloul entre 1934 et 1940 - Surveillance
politique des indigènes », 93 10 115, ANOM,
Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 42
III - Popularité de Bendjelloul : figure de proue
d'un mouvement d'ampleur dans toute l'Algérie
Bien que les sous-entendus alarmistes des rapports de
surveillance relèvent largement d'un aveuglement idéologique, il
est indéniable que durant une bonne partie de la décennie 1930,
la stratégie et la rhétorique de la FEM a reposé sur une
sorte de culte de la personnalité envers Bendjelloul. On l'observe dans
les tracts électoraux des candidats FEM, avec des expressions comme
« En votant Saadane, vous votez Bendjelloul ! » ou « votre grand
et dévoué serviteur Bendjelloul » 1. Cette
personnalisation de la politique de la Fédération ne signifie pas
pour autant l'absence de programme politique. Bendjelloul est plutôt
présenté comme le champion de cet assimilationnisme revendicatif,
l'incarnation du politicien colonisé audacieux et passionné.
C'est peut-être sa personne qui captive les foules, mais cette
popularité a bien un but politique et ne sert pas uniquement
l'intérêt personnel de Bendjelloul.
A - La rhétorique musulmane, marqueur d'une
identité spécifiquement algérienne
Dans l'un des dossiers de surveillance de la
préfecture de Constantine consacrés aux Elus Musulmans se trouve
un tract publié en réaction à une attaque
perpétrée sur la voiture du candidat FEM par les partisans des
candidats administratifs. Ce texte loue la réaction calme des foules et,
dans la droite ligne des idéaux de légalité des
réformistes assimilationnistes, les enjoint à prendre leur
revanche dans une victoire électorale, en votant massivement pour
Chérif Saadane2. Cette réaction calme et digne est
qualifiée de « profondément islamique ». Le parti de
Bendjelloul se présente comme « les défenseurs de votre foi,
de votre honneur et de vos intérêts » 3, et la fin
du tract finit par la triple exclamation : « Vive la France ! Vive
l'Algérie ! Vive l'Islam ! ».
1 Préfecture de Constantine, « Dossier
Fédération des Elus Musulmans - Tracts et divers », octobre
1934, 93 B3 277, ANOM, Aix-En-Provence.
2 « Tract bilingue adressé aux
«Electeurs musulmans de la 4me Circonscription», Arrivé
à la préfecture de Constantine le 12 octobre 1934 ». In
Préfecture de Constantine, « Dossier Fédération des
Elus Musulmans - Tracts et divers », doc. cit.
3 « Tract bilingue adressé aux
«Electeurs musulmans de la 4me Circonscription», Arrivé
à la préfecture de Constantine le 12 octobre 1934 »,
doc. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 43
Le recours à la religion est un
élément récurrent de la rhétorique politique de
Bendjelloul. Dans sa préface au livre de Kessous, Bendjelloul
défend l'Islam dans un discours adressé aux
Français1. Ici il emploie une rhétorique islamique
dans ses discours adressés aux Algériens musulmans.
Par-là, il se rapproche des intérêts et de la vision du
monde de ses électeurs. Ces références à la
religion des électeurs, religion qui désignait également
leur statut civique de Français musulmans, apparaissent dans des
discours clairement en faveur de la France et de ses valeurs.
En votant en masse pour le Docteur SAADANE
:
Vous votez pour BENDJELLOUL et tous ceux qui vous
défendent.
Vous votez pour le respect de votre foi, de votre
dignité et pour l'aboutissement de vos justes
revendications.
Vous montrez que vous êtes de vrais
musulmans, ayant conscience de votre dignité d'hommes, de vos devoirs et
de vos droits.
Vous montrez au noble et généreux
peuple de France que vous êtes dignes de sa
confiance2.
De plus, les tracts de la FEM affichent le même
texte en arabe et en français, souvent sur la même page. Cela
montre leur ambition d'inclure dans le champ politique algérien les
différents éléments de la société, les
notables éduqués en français aussi bien que les
arabophones3.
Certaines sources de surveillance emploient aussi un
langage religieux pour parler de la popularité de Bendjelloul, mais
plutôt pour dévaloriser la signification politique de l'engouement
revendicatif des Algériens colonisés à partir de cette
époque. Ce genre de dépolitisation orientalisante des
revendications des colonisés est un fait observé dans d'autres
contextes d'oppression coloniale : dans les années 1950 par exemple, la
répression d'une société secrète fantasmée
par autorités anglaises en actuelle Tanzanie provoquera la
révolte dite
1 Voir supra, I.A-La préface de 1935, une
profession d'assimilationnisme.
2 Tract bilingue adressé aux «
électeurs musulmans de la 4e circonscription » du
département de Constantine, In Préfecture de Constantine, «
Dossier Fédération des Elus Musulmans - Tracts et divers »,
doc. cit.
3 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 44
des Mau Mau et sa brutale
répression1. Dans le dossier Bendjelloul de la
préfecture de Constantine, un document interne au service de
surveillance politique des indigènes emploie librement le champ lexical
de la religion pour parler de la popularité de Bendjelloul dans la
population musulmane algérienne : il prétend qu'on « fait
croire » au peuple que Bendjelloul « a reçu une Inspiration
Divine (sic) », il compare les représentants de la FEM à des
« Aèdes (sic) [...] chantant la Gloire (sic) de [Bendjelloul]
» et conclut en affirmant que « dans toutes les couches de la
Société (sic) BENDJELLOUL apparaît comme une sorte de
prophète »2. Un tel langage religieux était-il
réellement employé à des fins politiques par les Elus,
voire par les Algériens du peuple eux-mêmes ? De telles sources
témoignent en tout cas de l'inquiétude des services de l'ordre
colonial face à la très grande popularité de Bendjelloul
chez ses auditeurs, qui soutiennent en masse et avec enthousiasme son
action.
B - Plus qu'un leader charismatique, un programme
politique
L'entreprise politique de Bendjelloul est
marquée par la recherche d'un rapport direct à ses
électeurs. Sa stratégie connaît un succès massif
dans les années 1930 et Bendjelloul continuera dans une moindre mesure
à endosser ce rôle de porte-parole du peuple jusqu'à la fin
de sa carrière 3.
Le dimanche 17 mai 1936, la FEM organise une
réunion publique au théâtre municipal de Constantine. Dans
l'Entente du 28 mai 1936, A. Debabeche, secrétaire de la réunion,
fait un rapport de cette journée4. Il évalue à
cinq mille le nombre des auditeurs ayant pu assister à la réunion
et estime qu'au moins autant de personnes ont dû rester dehors faute de
place dans la salle. Le Docteur Bendjelloul préside la réunion,
entouré des élus de la ville. L'article mentionne
1 Florence Bernault, Cours Magistral de Formation
Commune Introduction du African History since 1800, « Session 9:
Settlers Colonies and Violent Decolonization: South Africa and Kenya »,
semestre d'automne 2022, Sciences Po Paris. Cours non
publié.
2 Préfecture de Constantine, « Dossier
Bendjelloul (1934-1940) - Surveillance politique des indigènes »,
doc. cit., p. 26.
3 Voir infra : partie II le télégramme
à Pétain de 1942 et partie III la profession de foi de 1951 et la
motion des 61 de 1955.
4 A. Debabeche, « Nos élus engagent une vive
Action », art. cit., p. 2.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 45
la présence de deux policiers chargés du
service d'ordre, et au début et à la fin de la réunion, on
appelle au calme, un enjeu important de la crédibilité politique
des Algériens colonisés.
Bendjelloul débute en rappelant son action
« et celle de ses amis (Fédération) », et remercie la
population d'avoir voté « en bloc pour les indépendants
», par opposition aux candidats soutenus par l'administration. Il annonce
ensuite que cette réunion a pour but de renouveler l'expression de la
confiance de la population envers ses mandants, et l'article témoigne du
soutien enthousiaste de l'assistance en rapportant les applaudissements et les
cris de celle-ci :
Vive Bendjelloul ! Vive la Fédération
!
Il [Bendjelloul] demanda à la salle de se
prononcer (La salle manifesta par des applaudissements
répétés sa confiance au Dr Bendjelloul, à ses amis
et à la Fédération).1
La désignation des autres membres de la FEM
comme les « amis » de Bendjelloul est un choix sémantique qui
mérite d'être souligné. Il représente l'unité
des Elus autour du programme incarné par Bendjelloul, figure de proue
admirée. Dans son discours, Bendjelloul reconnaît que «
l'action efficace que le peuple était en droit d'attendre d'eux ne
paraît pas avoir eu d'effets »2. On voit ici qu'il tire
sa légitimité populaire non seulement des urnes mais aussi d'un
rapport plus fréquent et plus personnel à ses électeurs.
Cette démarche précède la tenue du Congrès
algérien, pour lequel les élus ont besoin « d'une
autorité accrue » 3.
Après que divers représentants ont
exprimé l'avis et les revendications principales de l'assistance pour ce
congrès, Bendjelloul répond qu'il « avait déjà
envisagé toutes les réformes demandées depuis 1933 »
et promet qu'il « ne cessera [de revendiquer la réalisation des
revendications de la population] jusqu'à entière satisfaction de
tous ses mandants. (Applaudissements) »4. En se montrant
prévenant et informé sur les besoins de ses mandants, Bendjelloul
reste au-dessus des délégués qui se sont exprimés,
ne se montrant pas dépendant
1 A. Debabeche, « Nos élus engagent une vive
Action », art. cit.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 A. Debabeche, « Nos élus engagent une vive
Action », art. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 46
de leurs informations, ce qui relativise les allures
de démocratie participative qu'aurait pu avoir cette
réunion.
Ce soutien massif ne signifie pas l'absence de
contestation de l'autorité de Bendjelloul comme chef du mouvement.
Ainsi, le dossier de surveillance « Journal de la Fédération
des Elus Musulmans », constitué autour du mois de décembre
1934 par la Sûreté Départementale de Constantine, relate
entre autres les conflits qui opposent à cette époque Bendjelloul
et Zenati, le rédacteur en chef du journal assimilationniste La Voix
Indigène. Celui-ci a d'abord été le premier soutien
de presse de la Fédération et de Bendjelloul, avant que des
conflits divers ne conduisent La Voix indigène à
reprendre son indépendance politique et la Fédération
à fonder son propre organe de presse. Dans ce dossier de surveillance
donc, l'administrateur de la commune mixte de Fedj-M'zala explique qu'une
interview controversée de Bendjelloul, dans laquelle il aurait
émis des réserves au sujet du projet Violette, aurait
soulevé contre lui une vague de remise en question parmi ses partisans :
des lettres et des délégations « lui auraient
été envoyées de différents points du
département » pour le sommer « de revenir sur ses
déclarations »1.
L'Interview donné par le Dr Bendjelloul
à la "Presse Libre" a provoqué l'indignation de Zenati et a
provoqué/entraîné (sic) une rupture que l'on attendait
d'ailleurs depuis longtemps. Zenati ainsi que plusieurs jeunes élus,
trouvaient que Bendjelloul était trop "tiède", manquait d'allant
et ne réalisait pas les espoirs que l'on avait mis en lui.
[...]
On envisagerait même de lui susciter un
concurrent aux prochaines élections, le Dr MOUSSA vraisemblablement,
s'il ne se ralliait pas publiquement et solennellement au projet
Viollette.
ABBAS et SAADANE, impatients de prendre la
tête du mouvement, mènent la danse, affirmant qu'il n'est pas un
chef et qu'on n'est plus sur (sic) de lui.
1 L'Administrateur de la Commune Mixte de Fedj-M'zala,
Rapport au Préfet de Constantine (Affaires indigènes) n°
40.C.- Objet: Renseignements au sujet du Dr Bendjelloul et de Mr Zenati,
Fedj-M'zala, Arrondissement de Constantine, Commune Mixte de Fedj-M'Zala,
1934.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 47
Des bruits sont répandus un peu partout
contre lui. A Châteaudun, on prétendait ces jours-çi (sic),
qu'il était "vendu aux Français".1
Selon l'usage des services du surveillance coloniaux,
les sources de ces renseignements ne sont pas mentionnées, et la
fiabilité des rumeurs évoquées dans ce rapport n'est pas
évaluée. Les contestations émaneraient
d'assimilationnistes déçus de le trouver moins radical que leur
programme. De plus, l'administration aurait intérêt à
entretenir de telles rumeurs afin de déstabiliser l'autorité de
Bendjelloul. Un article de La Voix Indigène du 8 janvier 1935
prouve cependant l'existence d'une contestation de Bendjelloul au sein du camp
assimilationniste. L'article retranscrit et répond à un tract
intitulé « Aux Musulmans. Une mise au point » que Bendjelloul
aurait fait distribuer à Constantine 2. Dans ce tract,
Bendjelloul répond aux critiques qui lui sont faites suite à
l'entretien controversé mentionné plus haut. Dans le tract, il
affirme que soutenir le projet Violette était bien son élan
personnel, et qu'il a seulement dit craindre que son adoption éventuelle
ne déclenche des violences « anti-arabes »3. Ce
démenti pourrait être le résultat des pressions
exercées sur lui et mentionnées dans la note de surveillance,
mais cette dernière est une source moins fiable que le tract et
l'article de La Voix Indigène, sources produites par les
acteurs de la controverse eux-mêmes.
Bendjelloul réaffirme son soutien et celui de
la FEM au projet Violette, en insistant sur le maintien du statut personnel
:
Ce projet que nous avons soutenu dans nos campagnes
et qui reste un idéal pour les musulmans sera notre ligne de conduite et
la Fédération des Elus des Musulmans [...] continuera à
faire le sien (sic) et le défendra comme elle l'a défendu dans le
passé, à condition que cependant notre STATUT PERSONNEL SOIT
INTEGRALEMENT RESPECTE. 4 (majuscules dans
l'original)
Le président de la FEM distingue dans son
discours sa personne de son mouvement, tout en les montrant dans une
unité d'action et de pensée. L'expression "Elus des
Musulmans" (italique ajouté) accentue leur rôle de
représentation du peuple et leur lien, leur service de leurs
1 Ibid.
Châteaudun-du-Rhumel, actuelle Chelgoum-el-Aïd.
2 Rabah Zenati, « Le Docteur Bendjelloul »,
La Voix Indigène, n°299, 08/01/1935, Constantine,
Imprimerie Attali.
3 Ibid.
4 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 48
électeurs, qui sont intégrés
à la politique et dont la mobilisation est sans cesse encouragée
dans les tracts de la FEM.
Le tract se conclut par une attaque de Bendjelloul,
sur la défensive, envers La Voix Indigène et son
directeur, qui dans un précédent numéro avait
accusé Bendjelloul de ne pas être aussi attaché que lui
à l'assimilation et au projet Viollette. On voit dans la formulation de
ces articles que le journal n'est pas un organe de propagande émanant
directement de la FEM. Là où l'Entente se contente souvent
d'acclamer et de rapporter telles quelles les actions et déclarations de
Bendjelloul, La Voix Indigène témoigne d'une posture
plus critique tout en restant dans l'ensemble favorable au chef de la FEM : le
journal soutient le projet de Bendjelloul par conviction assimilationniste,
mais reste libre de le critiquer.
On ne sait pas si les lettres de réaction
à l'interview mentionnées plus haut sont envoyées par
d'autres notables assimilationnistes ou si elles reflètent
réellement la volonté de toutes les couches sociales de la
population algérienne. Les historiens algériens s'accordent
à penser que les assimilationnistes représentaient la voix de
l'élite algérienne de cette époque mais pas celle de la
population musulmane. Même dans ce cas, la popularité de
Bendjelloul n'est pas un chèque en blanc mais est fondée sur sa
fonction de représentant des aspirations de ses mandants. Bien que les
assimilationnistes de cette époque soient appelés les amis ou les
partisans de Bendjelloul, ce n'est pas seulement une personne charismatique
qu'ils suivent mais bien des idées, un but politique.
C - L'apogée du réformisme : le
Congrès Musulman Algérien
La deuxième moitié des années
1930 voit également une convergence dans la lutte des différents
courants politiques algériens. Sous l'influence grandissante des
Oulémas, les questions relatives à l'enseignement en arabe et
à la liberté de culte musulman se greffent au programme de la
FEM. Les Oulémas sont eux aussi implantés dans la ville de
Constantine où ils bénéficient d'un écho important
dans la population musulmane, peu encline dans sa majorité à
adhérer à la vision laïcisante et francisée de la vie
publique que pratique Bendjelloul. La popularité de Bendjelloul est
grandissante tout au long de cette décennie, et il semble presque
toucher du doigt les premiers résultats de ses revendications avec son
alliance avec le sénateur
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 49
Maurice Violette, qui défend en
métropole un projet certes bien moins ambitieux que les demandes des
Elus Algériens mais tout de même de tendance
assimilationniste.
Avec le gouvernement du Front Populaire, Bendjelloul
est un acteur majeur de l'expérience du premier Congrès Musulman
Algérien (CMA), qu'il préside entre 1936 et 1938. Cette grande
conférence prend des allures d'Etats généraux
algériens : différents niveaux de délégués
locaux préparent la réunion plusieurs mois en amont en
recueillant dans des cahiers de revendications les doléances et les
plaintes des Algériens colonisés, puis les
délégués de tous les courants politiques algériens
se réunissent à Alger à partir du 7 juin 1936 pour
discuter des orientations à donner à la lutte commune. Une
déclaration est rédigée, et le 22 juillet 1936 une
délégation menée par le Docteur Bendjelloul est
envoyée Paris pour la remettre au gouvernement 1.
La cause de la mobilisation du CMA est la
misère matérielle du peuple algérien et l'absence de
réformes, tandis que les autorités continuent leurs brimades. La
réclamation de réformes socio-économiques est au coeur de
la politique algérienne et est le moteur de la politisation des
Algériens dans les années 19302.
Dans ce contexte, des partisans de la FEM se
rassemblent pour une réunion d'information le matin du dimanche 17 mai
1936, puis une deuxième réunion, privée, a lieu pour les
représentants des différents courants politiques de la ville de
Constantine l'après-midi du même jour 3. Elle est
coprésidée par Lamine Lamoudi, Cheikh Benbadis et Bendjelloul,
dans cette dynamique d'union transpartisane précédant la tenue du
CMA. Le but de la réunion, affirme Lamoudi, est que les
représentants des « diverses couches sociales des populations
musulmanes » réfléchissent ensemble à « comment
sortir de la pénible situation économique et politique où
se débat le peuple musulman »4. Lors de cette rencontre,
Bendjelloul revendique que ce soient les élus qui représentent le
peuple et non des militants, appelant ainsi les autres
1 Charles-Robert Ageron, « Sur l'année
politique algérienne 1936 », in De « l'Algérie
française » à l'Algérie algérienne,
Saint-Denis, Éditions Bouchène, 2005, p. 387-416.
2 A. Debabeche, « Nos élus engagent une
vive Action », art. cit. p2, « Nos élus engagent une
vive action - Compte rendu de la séance du 17 mai 1936
».
3 Ibid. p.
2.
4 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 50
mouvements à respecter les institutions
républicaines de représentation du peuple 1. On
pourrait voir ici une tentative d'augmenter son prestige et celui de son groupe
politique à l'occasion de cet évènement national, mais
cette exigence s'inscrit aussi dans sa stratégie d'opposition
institutionnelle, qu'il demande aux autres partis participant au CMA de
rejoindre.
L'article 2 des statuts du CMA2 donne à
l'organisation les objectifs suivants :
-Evolution des populations
musulmanes
-Entente et rapprochement des races
-Harmonie et paix sociale par l'égalité
des droits et des charges
-Respect absolu de toutes les convictions
politiques, philosophiques et religieuses.3
Ces objectifs sont des idéaux très
généraux. Le premier tiret sous-entend la nécessité
de réformes socio-économiques, le troisième tiret
réclame l'égalité des droits pour les musulmans et les
colons : cet article deux inscrit donc le CMA dans une dynamique
réformiste et assimilationniste. Les autres partis n'adhèrent pas
pour autant à la vision assimilationniste, mais croient tous à ce
moment-là à la pertinence de la stratégie
réformiste.
Cela ne signifie pas qu'ils se rallient à
Bendjelloul, qui est régulièrement accusé de vouloir
s'imposer ou d'être autoritaire, et est écarté du second
CMA.
Le Chef de la Sûreté
Départementale, dans un rapport du 3 juin 1936, témoigne de
différentes altercations entre le Docteur, qui préside la
séance, et les autres participants à une réunion
préparatoire au CMA 4. Les membres de la FEM reprochent par
exemple à Bendjelloul ses tensions avec les communistes, qu'il appelle
publiquement « les bolchévistes » et accuse de vouloir
accaparer les masses.
1 Ibid. « Je
voudrais qu'on laissa (sic) à la Fédération l'initiative
des revendications de la masse et je demande aux militants de
l'intérieur de s'entendre avec les élus de leur région
».
2 « Statuts du Congrès Musulman
Algérien », 6 août 1937. In Archives du Gouvernement
Général d'Algérie, Centre d'Information et d'Etudes, GGA
40G 71, ANOM, Aix-En-Provence.
3 Ibid., p.
1.
4 Chef de la Sûreté
Départementale, « Rapport «Congrès Musulman» de la
Sûreté départementale de Constantine », Constantine,
Sûreté départementale de Constantine, 3 juin 1936, 93 B3
278, ANOM, Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 51
Le Petit Parisien annonce le 8 octobre 1936 la
destitution du Docteur Bendjelloul comme président du CMA. Le journal
publie la déclaration du comité exécutif du Congrès
musulman1, qui annonce que Bendjelloul aurait donné
différentes interviews controversées aux yeux du comité.
Les interventions et l'attitude du Docteur sont jugées « absolument
incompatibles avec l'esprit et le programme du congrès
»2. Le comité déclare avoir envoyé une
lettre au Docteur lui demandant de démentir ses interviews. Bendjelloul
aurait refusé, entraînant donc sa destitution de la
présidence du Congrès musulman.
La même déclaration affirme que «
les dangers de guerre civile se précisent en Algérie de
façon inquiétante »3. L'article est court, les
modalités d'une telle guerre civile ne sont pas décrites plus
précisément qu'avec des termes comme agitation, embrigader les
musulmans, groupement de désordre, .... La seule situation qui est
clairement décrite est « la création des jeunesses vertes et
des armées vertes du prophète », que le communiqué
dénonce comme des groupements fascistes sous un voile religieux. Le
communiqué se finit par « un pressant appel à l'unité
du congrès algérien du 7 juin qui doit être placé
au-dessus des questions de personnalités, quelles que soient
l'importance et l'influence de ces personnalités »4.
Face aux périls qu'encourt l'Algérie, le comité
exécutif du CMA exhorte ses soutiens à rester unis
derrière lui et à ne pas suivre Bendjelloul dans sa rupture avec
le CMA, qui continue d'avoir besoin de la légitimité que
confère l'adhésion des masses pour faire le poids face au lobby
colonial. Malheureusement, la violente et catégorique opposition des
colons faisant pression sur le gouvernement conduit au retrait du projet de loi
Blum-Viollette qui est suspendu définitivement le 4 mars 1938. C'est un
échec politique pour l'union algérienne et également, aux
yeux de beaucoup, l'échec symbolique de la solution politique dans le
cadre des institutions coloniales.
Les stratégies des divers membres du CMA
divergent à la suite de l'échec de leurs revendications et le
rejet du projet Blum-Violette. La fondation de l'Union Populaire
Algérienne par Ferhat Abbas a pu être interprétée
comme un acte de sécession par les services
1 « Le docteur Benjelloul (sic) destitué
de la présidence du comité exécutif du congrès
musulman algérien », Le Petit Parisien, 08 octobre
1936.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 52
de renseignement, y voyant un conflit personnel de
Abbas contre Bendjelloul. La création d'un parti représentant la
voie politique des Elus assimilationnistes a bien été un projet
d'Abbas, mais qui a été soumis au vote lors d'une réunion
de la FEM du 5 juillet 1937 et adopté à
l'unanimité1. Ni ce parti ni celui que Bendjelloul tente de
lancer en parallèle ne connaîtront de réel succès,
et Charles-Robert Ageron, dans son Histoire de l'Algérie
contemporaine, affirme que « l'échec personnel de Bendjelloul
à la tête du Congrès musulman algérien fut aussi
celui des élus ». En effet, l'échec du projet Blum-Violette
et les politiques favorables au lobby colon menées sous Vichy dans les
années qui suivent marquent la fin de l'âge d'or pour le courant
réformiste. Plusieurs partisans de l'assimilation, déçus,
se rallieront peu à peu à la solution nationaliste,
désormais convaincus que le système colonial ne peut être
réformé. Si l'échec du CMA marque la fin d'une
décennie de grande popularité de Bendjelloul en Algérie,
ce n'est pas la fin de son combat assimilationniste, qu'il poursuivra par
différents moyens pendant plus de vingt ans encore.
1 Chef de la Sûreté Départementale
de Constantine. Rapport n°2542 du 5.7.37. « Surveillance Politique
des indigènes - Réunion chez le Dr Bendjelloul ». In
Préfecture de Constantine, « Dossier sur l'action de la FEM -
Journaux, rapports de surveillance et divers », op.
cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 53
Partie II - Adaptation stratégique de
Bendjelloul
dans un contexte d'instabilité politique
(1939-1945)
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 54
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 55
I. La poursuite des engagements de la FEM dans un
contexte de crise internationale
Après l'échec des revendications du
Congrès Musulman Algérien, la popularité de Bendjelloul
est sérieusement entamée, avec la décrédibilisation
des idées assimilationnistes. C'est aussi à cette époque
qu'il se sépare de Ferhat Abbas, son lieutenant au sein de la
Fédération des Elus Musulmans (FEM) depuis le début des
années 1930. Ce dernier crée son propre parti, l'Union Populaire
Algérienne, s'orientant vers une critique plus radicale du
système colonial en tant que tel et non simplement de son
fonctionnement. Bendjelloul fonde la même année le Rassemblement
Franco-Musulman Algérien, qui connaît peu de
succès.
Si le réformisme et l'opposition légale
restent consensuels dans le paysage politique algérien contestataire, ce
n'est plus le cas de l'assimilationnisme, et au sortir de la Seconde Guerre
Mondiale il semble qu'une majorité de colonisés n'imaginent plus
que leur pays doive rester sous la souveraineté française, et
imaginent leur émancipation de diverses manières1.
Pourtant, Bendjelloul maintient au travers des incertitudes
géopolitiques et des changements de régime sa stratégie de
collaboration avec l'Etat français dans le but d'obtenir des
réformes du système colonial inégalitaire. Moins soutenu
par la population et par les élus, son action à partir de 1940
semble recevoir un bien plus faible écho auprès de la France
ainsi qu'auprès des Algériens.
A la fin de la période, le nationalisme a connu
un tel essor que Bendjelloul apparaît comme un politicien
modéré sur la scène politique algérienne et
française, loin de l'image de causeur de trouble et d'ennemi du statu
quo colonial qui l'auréolait durant la décennie 1930. Dans cette
deuxième partie, nous verrons comment Bendjelloul développent des
stratégies discursives et d'action adaptées aux bouleversements
qui agitent l'Algérie entre 1939 et 1946. Ces changements permettront de
révéler les parties de son discours qui perdurent dans
différents contextes, par exemple l'amélioration des conditions
de vie, la dénonciation des injustices coloniales ou la francophilie, et
quels éléments rhétoriques sont destinés à
convaincre ses différents interlocuteurs.
1 Sur l'essor du nationalisme algérien dans les
années 1940, voir par exemple Annie Rey-Goldzeiguer, « 8. Le
nationalisme algérien décolle », in Aux origines de la
guerre d'Algérie, 1940-1945, Paris, La Découverte, 2006,
p.175?196 ; Jacques Cantier, L'Algérie sous le régime de
Vichy, Paris, Odile Jacob, 2002.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 56
A - L'engagement volontaire comme gage fort de
loyalisme
A la fin de l'été 1939, la France entre
en guerre. Bendjelloul et Ferhat Abbas s'engagent volontairement, et la FEM
annonce cesser son action « jusqu'à la fin des hostilités
»1. Entre septembre et novembre 1939, le cabinet du
préfet de Constantine consacre un dossier aux « Notabilités
Indigènes ayant contractées un engagement pour la durée
des hostilités : Abbas et Bendjelloul »2. Y sont
rapportés quelques détails concrets sur l'engagement et
l'affectation de Bendjelloul et Abbas, mais les autorités
françaises ne tirent pas de conséquences politiques de ce geste
fort, que ce soit pour le contexte immédiat ou à plus long terme.
Il faudra attendre décembre 1943 pour que l'enrôlement des
populations coloniales dans la campagne de libération de la
métropole soit associé à des promesses de réformes
du cadre colonial3.
Le 9 septembre, un courrier adressé au
Gouverneur Général de l'Algérie (GGA) Georges Le Beau,
probablement par le préfet de Constantine, informe ce dernier
que
f...] Seul, parmi les Notables Indigènes
non soumis à des obligations militaires, le Docteur BENDJELLOUL a
contracté, depuis le 30 août, un engagement volontaire pour la
durée de la guerre. 4
L'intéressé aurait confirmé
à l'auteur de ce courrier que « plusieurs de ses amis
étaient sur le point de contracter un engagement volontaire eux aussi
»5. Six jours plus tard, le préfet de Constantine
adresse au GGA une notice au sujet de Bendjelloul. La notice indique qu'il
s'est engagé volontairement pour la durée de la guerre depuis le
8 septembre, et a été affecté à l'Hôpital
Militaire Laveran au grade de médecin-auxiliaire, au Service des
fiévreux à Constantine6. Un peu plus d'un mois plus
tard, c'est de l'engagement volontaire d'Abbas, contracté le 6 octobre
1939, que le préfet informe le GGA. La notice jointe au courrier
indique
1 Gouvernement Général de
l'Algérie, « Dossier FEM «Entente n°134»
[numéro censuré] », Alger, 02 novembre 1939, GGA 40G 71,
ANOM, Aix-En-Provence.
2 Préfet de Constantine, « Dossier:
Notabilités Indigènes ayant contractées un engagement pour
la durée des hostilités. Abbas et Bendjelloul »,
Constantine, Préfecture de Constantine, 15 septembre 1939, 93 B3 791,
ANOM, Aix-En-Provence.
3 Voir infra, le discours de De Gaulle à
Constantine le 12 décembre 1943. Partie II-3, p71.
4 Préfet de Constantine, « Dossier :
Notabilités Indigènes ayant contractées un engagement pour
la durée des hostilités. Abbas et Bendjelloul », op.
cit., 5-8.
5 Ibid. p. 5?8.
6 Ibid. p. 1?4.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 57
qu'Abbas a été engagé au grade de
pharmacien auxiliaire à la réserve du personnel des armées
mais affecté « provisoirement » à ce même
Hôpital Militaire de Constantine depuis le 18 Octobre 1939 1.
Dans son courrier du 9 septembre, le préfet indique également
qu'une autre figure de la FEM, le Docteur Chérif Saadane, aurait lui
aussi pris contact avec la Direction du Service de Santé de
l'Armée pour connaître les conditions de son éventuel
engagement. Il ne prend pas immédiatement sa décision
définitive, et la suite du dossier ne le mentionne plus.
Pour les assimilationnistes, cette guerre est une
occasion de démonstration de loyalisme, que Bendjelloul et Abbas
saisissent. Le 8 novembre, Abbas passe un autre cap dans ce mode d'action
politique : le préfet rapporte au GGA que Ferhat Abbas, avec qui il a eu
ce jour-là un entretien, lui a déclaré vouloir rejoindre
le front et non plus seulement servir dans un hôpital à
l'arrière et « qu'il demanderait à M. le Docteur BENDJELLOUL
de suivre son exemple »2. Abbas endosse ici un rôle de
héros français idéalisé, se montrant prêt
à sacrifier sa vie pour sa patrie, la France. Cette affirmation faite au
préfet contient une forte dimension démonstrative, une
affirmation d'appartenance à la France. Nul doute que dans l'esprit de
ces hommes, une telle exemplarité appelait en retour l'accord de
réformes du statut civique des colonisés aussi radicales que leur
engagement.
Du côté de la FEM, l'engagement de
Bendjelloul « pour la durée de la guerre » est valorisé
et paraît en Une de l'Entente du jeudi 2 Novembre 19393.
L'article maintient l'ambiguïté sur son affectation, ce qui permet
de donner à ce texte le ton grave de dernières volontés.
Ils reproduisent « l'appel émouvant » à la population
algérienne que le Docteur aurait rédigé plus de deux mois
plus tôt, le 30 août 1939, donc un peu plus d'une semaine avant son
engagement volontaire effectif. Que la datation de cet article soit authentique
ou non, elle présente l'engagement du leader comme une réaction
immédiate et spontanée à l'imminence de la guerre de la
métropole. Dans son texte, Bendjelloul loue l'engagement des «
centaines de mille » de musulmans qui ont accompli leur devoir. Nul besoin
pour le leader politique de les exhorter à rejoindre les drapeaux
semble-t-il. La mobilisation est explicitement décrite comme une
expression unanime de la volonté assimilationniste du peuple
:
1 Ibid. p. 10?15.
2 Ibid. p. 9.
3 Gouvernement Général de l'Algérie,
« Dossier FEM «Entente n°134» [numéro
censuré] », doc. cit, p. 1.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 58
[...] vous démontrez ,
· en volant
au secours de la France menacée, que vous voulez vous mettre sur les
rangs au même titre que les meilleurs fils de l'Europe ,
· vous
tracez ainsi, désormais, votre voie dans l'avenir et votre place dans la
Nation.1
Ici, comme depuis le début de sa
carrière, Bendjelloul lit les actions des Algériens à la
lumière de ses propres convictions francophiles et assimilationnistes.
Ses destinataires sont les Algériens musulmans eux-mêmes, chez qui
Bendjelloul tente semble-t-il de susciter un enthousiasme patriotique en
parlant comme si ces sentiments étaient déjà les leurs.
Mais il s'adresse tout autant aux autorités françaises : il leur
force implicitement la main en promettant à ses lecteurs que leur
engagement dans la guerre leur acquiert le droit d'une pleine
citoyenneté française.
Dans le même texte, Bendjelloul combat la
propagande de l'ennemi allemand
qui, par une campagne insidieuse essaye de vous
détourner du droit chemin de la loyauté, de la reconnaissance, du
devoir et de l'honneur, et qui par ailleurs vous conteste le titre d'homme
civilisé et vous classe parmi les `négroïdes à peine
perfectibles par dressage' et `bien après les juifs' dont on connait sa
conduite avec eux. 2
Aux sentiments pour la France qui doivent animer le
colonisé, en plus de la loyauté, du devoir et de l'honneur,
Bendjelloul rajoute la reconnaissance, reprenant le discours de la mission
civilisatrice des mouvements coloniaux, qui considèrent que les
colonisés devraient être reconnaissants envers les colonisateurs
pour les progrès sociaux, techniques et moraux apportés par eux.
En temps de guerre, une telle rhétorique peut être un discours
dirigé en réalité vers les autorités coloniales
sceptiques de la loyauté de colonisés. C'est aussi, on l'a vu, la
conviction d'un assimilationniste bénéficiaire de l'école
française.
Cependant, si Bendjelloul a fait sienne
l'idéologie de la mission civilisatrice, il ne légitime pas pour
autant les abus et ne se contente pas de son statut de colonisé, et les
Elus réclament encore des réformes au début de la guerre.
Le 21 août 1939, sous la présidence de Mohamed Bendjelloul, le
Conseil d'administration de la Fédération des Elus de Constantine
se réunit et vote à l'unanimité une motion
réclamant des réformes urgentes en faveur des
1 Docteur Bendjelloul, « Aux Musulmans »,
L'Entente franco-musulmane n°134, 02 novembre 1939,
p.1.
2 Ibid. On trouve de telles expressions dans
Adolf Hitler, Mein Kampf ( Mon Combat). Tome I, tr. J.
Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes, Nouvelles éditions latines, vers
1925, p. 106 et 475.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 59
Musulmans. Cette motion, accompagnée d'une
lettre du Docteur Bendjelloul, est adressée au président du
conseil des ministres, Edouard Daladier1. Les Elus l'y alertent sur
« le mécontentement des Indigènes algériens »
face au retard pris sur les promesses de réformes de la situation
algérienne. La situation est d'autant plus grave que les ennemis de la
France, c'est à dire les puissances de l'Axe, « [trouvent] un
aliment substantiel dans l'inaction du gouvernement » pour sa propagande
antifrançaise auprès des colonisés2. Ils
appellent donc avec urgence à des réformes en Algérie
malgré le climat de crise internationale. Ils reprennent les
revendications qu'ils n'ont eu de cesse de porter depuis le début de la
décennie : « le projet Viollette, l'augmentation de la
représentation locale indigène dans toutes les Assemblées,
l'abrogation [du décret Régnier] et [du décret] 8 mars
1938 restreignant [...] l'enseignement de la langue arabe »3.
En outre, L'Entente du 2 novembre 1939 juxtapose les courriers de
Bendjelloul aux autorités, les réponses de celles-ci et le cas
échéant les décisions prises. La troisième page du
journal est intitulée « Démarches du Président de la
Fédération », et contient par exemple un arrêté
préfectoral établissant l'égalité d'allocations
entre mobilisés indigènes et citoyens et des courriers de
Bendjelloul, dans lesquels celui-ci propose une amélioration de cet
arrêté en apportant l'éclairage des conditions
concrètes d'accès des Algériens Musulmans à ces
allocations et en dénonçant les lacunes dans leur mise en
oeuvre4. Les lecteurs peuvent ainsi constater la poursuite de
l'action revendicative du président de la FEM, dans son rôle de
notable relayant avec empressement les revendications des populations,
notamment des plus démunis dans ce cas précis.
B - La censure
Si dans ce numéro de guerre de
L'Entente, les membres de la FEM souligne aussi avec enthousiasme les
adaptations faites par l'armée française pour les soldats
musulmans en plein jeûne du ramadan, ils n'hésitent pas à
poursuivre leur dénonciation du système colonial. Les
1 Docteur Bendjelloul, « « Les
Réformes Algériennes» », L'Entente franco-musulmane
n°134, 02 novembre 1939 p.1.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 « Intervention en faveur des familles des
mobilisés», L'Entente franco-musulmane n°134, 02
novembre 1939 p.3.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 60
gros titres de ce journal lient explicitement l'appel
sous les drapeaux des colonisés et leurs droits, bafoués par les
autorités depuis des décennies. Certaines de ces phrases sont
censurées, et une deuxième édition révisée
est disponible dans le même dossier des archives du GGA.
L'en-tête de la Une est par exemple
révisé. L'original rappelle les sacrifices de la guerre
précédente et les déceptions répétées
de l'entre-deux guerres, accusant d'égoïsme, de stupidité et
d'injustice les partisans du statu quo colonial, opposés aux
réformes. Dans l'édition révisée, l'en-tête
n'a plus son ton revendicatif et protestataire, et se contente de valoriser les
attitudes patriotes des colonisés1. Signé K.A., cet
en-tête au ton bien plus désillusionné et revendicatif que
l'appel du Docteur Bendjelloul publié juste en-dessous pourrait bien
venir de Ferhat Abbas, responsable éditorial du journal, dont l'un des
noms de plume pendant les années 1930 est Kamel
Abencérages2. Mais en ce début de Seconde Guerre
Mondiale, l'objectif de ces critiques amères reste d'obtenir des
réformes dans le cadre des institutions françaises. En dessous de
son réquisitoire signé d'un pseudonyme, Abbas signe de
manière cette fois bien identifiable une adresse « A la Population
Musulmane de la Circonscription de Sétif », où il vit et est
élu.3 Il annonce que la FEM
cesse toute activité politique pour se
consacrer tout entier au salut de la nation dont dépend notre avenir. Si
la France démocratique cessait d'être puissante, notre
idéal de liberté serait à jamais
enseveli.4
On sait l'importance de l'argument du droit du sang
versé pour les progrès des droits civiques des Algériens
colonisés après la Première Guerre Mondiale, et on
connaît la stratégie assimilationniste présentant les Elus
et avant eux les Jeunes Algériens comme meilleurs Français que
les Français eux-mêmes. En se présentant comme un
Français exemplaire et héroïque, Bendjelloul et dans une
plus grande mesure Abbas préparent la suite de leur combat politique.
S'il semble qu'Abbas n'ait pas été envoyé au front, il est
néanmoins désolant de voir l'échec de cette
stratégie courageuse : ces engagements volontaires ne seront pas pris en
compte
1 Gouvernement Général de l'Algérie,
« Dossier FEM «Entente n°134» [numéro
censuré] », doc. cit.
2 Tramor Quémeneur, Ouanassa Siari Tengour, et
Sylvie Thénault, « Abbas, Ferhat (1899-1985) », In
Dictionnaire de la guerre d'Algérie, Bouquins, 2023, p.
3?146.
3 Gouvernement Général de l'Algérie,
« Dossier FEM «Entente n°134» [numéro
censuré] », op. cit, p. 5.
4 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 61
après la démobilisation des deux hommes
en 1940 1 et seront ensuite largement éclipsés par les
accusations de nationalisme dans le cas d'Abbas et de collaboration dans le cas
de Bendjelloul.
1 Etat Major 19e Région, « Note sur les
Partis et Groupements Musulmans Algériens (politiques et religieux) -
III. Les Fédérations d'Elus Musulmans », Alger, Imprimerie
Fontana, septembre 1941, GGA 40G 71, ANOM, Aix-En-Provence.
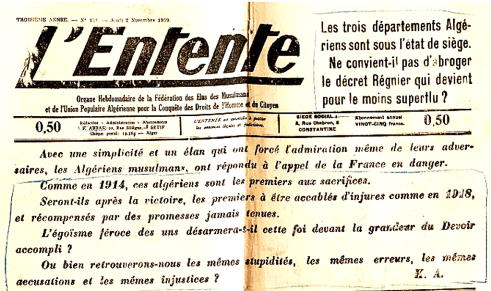
Figure 3 La Une de l'Entente du 2 Novembre 1939
avant (ci-dessus) et après censure (ci-dessous (« Dossier FEM
«Entente n°134» [numéro censuré] », GGA 40G
71, ANOM, Aix-
En-Provence).
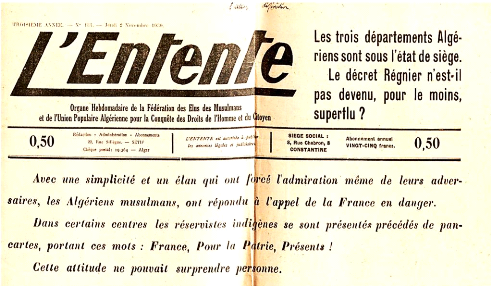
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 62
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 63
II. Transposition des stratégies des élus
face à la Révolution nationale
A. Poursuite de l'action de la FEM sous un nouveau
régime
Avec la démobilisation suite à la
défaite française, Bendjelloul et Abbas tentent de poursuivre le
combat politique de la FEM. Depuis l'échec du CMA, Bendjelloul est en
perte de vitesse politiquement. La population, suite aux échecs des
revendications réformistes, au changement de régime et à
la suppression des instances représentatives élues, se
désintéresse de la politique. Selon un rapport de renseignement
du CIE, c'est pour remédier à cette indifférence à
son égard que Bendjelloul recourt à sa stratégie
habituelle : l'action politique auprès des autorités au nom de
ses mandants, ou, selon les mots de la note de renseignements, « prouver
qu'il n'hésit[e] pas à intervenir en haut lieu en faveur de ses
amis »1. Dix jours après la capitulation, le 28 juin
1940, Bendjelloul écrit au préfet pour se plaindre de
dérives autoritaires de l'administration, protestant contre « les
vérifications d'identité entreprises par la police et les mises
en résidence forcées prononcées par l'administration
»2. Il jugerait que son groupement serait visé
particulièrement par ces mesures d'exceptions injustifiées,
contrairement à « ses anciens adversaires », et déplore
que « certains agents de police mobile » aient « reçu de
l'argent » des personnes interpellées « pour les remettre en
liberté »3. Ainsi, dans les mois qui suivent la
défaite française et l'instauration du régime de Vichy,
Bendjelloul continue de jouer son rôle de notable revendicatif, relais
politique des revendications de ses mandants. Toujours selon l'auteur de ce
rapport, Bendjelloul parle des problèmes de la population aux
autorités mais il parle aussi aux populations de ses démarches
auprès des autorités, se positionnant ainsi en « champion
»4, en élu digne de confiance dans son rôle
d'intermédiaire entre les populations qu'il défend et l'Etat
colonial. L'auteur affirme cependant que « l'enquête
1 « A/S. du Docteur Bendjelloul », Rapport
de Renseignement n° 798 daté du 5 juillet 1940, Constantine, Centre
d'Information et d'Etudes de Constantine, 5 juillet 1940. In Préfecture
de Constantine, « Dossier Bendjelloul (1934-1940) - Surveillance politique
des indigènes », op. cit.
2 « A/S. du Docteur Bendjelloul», doc.
cit.
3 Ibid., p. 1.
4 Ibid., p. 2.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 64
menée jusqu'à présent par le
Centre d'Information et d'Etude (CIE, service de surveillance) ne permet pas de
supposer [que Bendjelloul cherche à] amorcer un mouvement plus ample
» et pressent qu'il va s'en tenir à « la ligne adoptée
depuis le début de la guerre » et que « ses sentiments envers
la France ne sont pas altérés »1. Une telle
formulation prudente et se refusant à être alarmiste est
particulièrement rare dans les documents de surveillance coloniale, ce
qui mérite d'être souligné.
Le mois suivant pourtant, peut-être suite aux
encouragements de Ferhat Abbas, Bendjelloul aurait tenté de rassembler
les Elus et de refaire paraître l'Entente2. Une note
de surveillance mentionne un article censuré dans son ensemble dans
lequel ils auraient réaffirmé le programme d'action de la FEM, et
cite leurs mesures principales. L'abolition des grandes
propriétés faisait déjà partie de leurs
revendications passées, ainsi que la suppression des affaires
indigènes, caïds, communes mixtes et services de police,
c'est-à-dire la fin du système de l'administration coloniale.
Mais, signe de l'époque, ils auraient proposé de remplacer la
police par des milices. La réduction d'un dixième du personnel
administratif, et l'amélioration de l'habitat indigène sont
là encore des revendications connues par le passé mais elles sont
complétées par de nouvelles mesures empruntées au
programme de la révolution nationale, telles que la suppression des
femmes fonctionnaires et la suppression de la prostitution dans les
villes3. S'il est fiable, ce document fournit un
élément important d'analyse du programme de la FEM : la direction
assimilationniste et anticoloniale de leur programme ne change pas, mais la
formulation des revendications précises reprend les centres
d'intérêts du gouvernement auquel il s'adresse. Le
démantèlement des grandes propriétés coloniales
leur semblait ne pas nécessiter de traduction pour correspondre à
l'idéologie de la révolution nationale. Leurs autres mesures
économiques et sociales visant un assouplissement du cadre colonial sont
maintenues, mais accompagnées de mesures empruntées au programme
vichyste. La revendication centrale de la pleine citoyenneté sans
abandon du statut personnel est quant à elle mise de côté
car pensée pour un régime démocratique et donc trop
opposée à la politique du nouveau régime.
1 Ibid., p. 3.
2 Etat Major 19e Région, « Note sur les
Partis et Groupements Musulmans Algériens (politiques et religieux)-
III. Les Fédérations d'Elus Musulmans », doc. cit,
p. 4.
3 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 65
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 67
Le 8 août 1941, le CIE de la préfecture
d'Alger informe le cabinet du préfet de l'annonce publique de
collaboration faite par Bendjelloul une semaine plus tôt. Le texte a
été lu à Radio Alger par l'ancien secrétaire
général de la FEM, un certain Bendjemaa, et aurait causé
la rupture de Bendjelloul avec plusieurs membres de la FEM, choqués par
cette attitude de collaboration proactive avec les autorités
vichystes1. Le texte de cette déclaration n'a pas
été publié, et les circonstances précises ayant
mené à cette déclaration ne sont pas connues. Un an plus
tard, en septembre 1941, le service de renseignement de l'Etat Major de la 19e
Région, c'est-à-dire le corps d'armée regroupant les
unités militaires d'Algérie, publie une « Note sur les
Partis et Groupements Musulmans Algériens »2 et analyse
cette annonce publique de collaboration comme le retour d'un politicien ne
pouvant plus supporter de vivre dans l'ombre. Selon le fascicule, Bendjelloul
aurait souhaité continuer son action politique sous le nouveau
régime, mais en aurait été empêché par la fin
de la représentation démocratique. Le thème de la
déception, de l'amertume face à sa popularité
empêchée, est l'explication officielle reprise par toutes les
sources ultérieures abordant l'attitude de Bendjelloul pendant
l'administration de Vichy en Algérie. Il se serait notamment
retiré dans « une attitude boudeuse » et aurait «
[affecté] de se désintéresser des questions politiques
» parce qu'il n'aurait pas reçu de rôle dans les nouvelles
institutions, privilégièrent des politiciens plus traditionnels
et moins revendicatifs3.
Dans cette source comme dans plusieurs autres,
l'engagement de Bendjelloul « dans de nombreuses oeuvres sociales »
en parallèle de ses actions politiques est vu uniquement comme une
manoeuvre électorale visant à « conserver une certaine
popularité parmi le menu peuple de Constantine, tout en lui
évitant de se compromettre trop vivement aux yeux de l'Administration
»4. Parmi les initiatives de bienfaisance qu'il dirige ou
auxquelles il participe,
1 Préfecture d'Alger - Police des
Renseignements Généraux, « Dossier Dr Bendjelloul »,
Alger, 1944-1945, 91 1K 590/1, ANOM, Aix-En-Provence.
2 Etat Major 19e Région, « Note sur les
Partis et Groupements Musulmans Algériens (politiques et religieux)-
III. Les Fédérations d'Elus Musulmans », doc.
cit.
3 Le régime de Vichy remplace les institutions
représentatives métropolitaines et algériennes par des
collèges restreints de conseillers nommés par le gouvernement :
la Commission financière algérienne, la Commission administrative
départementale et le Conseil national remplacent respectivement les
Délégations financières, le Conseil Général
et l'Assemblée Nationale. Voir Charles-Robert Ageron, « Livre IV -
Forces politiques et évolution politique de l'Algérie 1939-1954
», In Histoire de l'Algérie contemporaine, Paris, Presses
Universitaires de France, 1979, p. 545?622.
4 Etat Major 19e Région, « Note sur les
Partis et Groupements Musulmans Algériens (politiques et religieux)-
III. Les Fédérations d'Elus Musulmans », doc. cit,
p. 5.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 66
trois sont citées dans ce document : le
Dispensaire indigène de Constantine, la Société
indigène de prévoyance et le Comité des meskines. L'auteur
est clair sur le fait que cette liste est non exhaustive et y voit un
élément de plus pour le portrait d'agitateur public qu'il brosse
de Bendjelloul1. Pourtant, cet engagement social a toujours
été l'une des caractéristiques soulignées par les
notes de surveillance à son sujet, depuis les années 1920, soit
avant même son engagement politique dans les institutions
françaises.
L'auteur de ce fascicule de 1941 présente aussi
l'action individuelle des quatre leaders principaux, soulignant le
déclin de la popularité de la FEM auprès des masses «
se [désintéressant] de plus en plus des problèmes
politiques » ainsi que la désunion régnant entre les chefs.
La source affirme que cette déclaration radiophonique de Bendjelloul a
provoqué la démission de Saadane et Abbas de la FEM, et qu'au
cours du mois suivant cet évènement, les « milieux
évolués des villes », l'électorat traditionnel des
assimilationnistes, se sont ralliés à Abbas. Bendjelloul
conserverait sa popularité auprès des « ruraux » et du
« petit peuple urbain »2, mais pour l'élite
colonisée c'est Abbas qui apparaît désormais « comme
le champion du mouvement revendicatif représenté autrefois par la
Fédération des Elus »3, supplantant peu à
peu Bendjelloul comme figure revendicative algérienne.
B - Un témoignage d'allégeance anticolonial :
le télégramme à Pétain
Durant la période de Vichy, les élus
algériens, privés de représentation démocratique
auprès des autorités coloniales, ont cherché à
renouer le contact avec elles par d'autres moyens, dans un contexte de
durcissement des discriminations envers les colonisés et d'aggravation
de leur situation socio-économique4. Ainsi, Ferhat Abbas
s'adresse à Pétain en 1941 par un long texte présentant la
situation en Algérie, résumant les évolutions des
politiques coloniales depuis 1830 et appelant à des
réformes5. Le 10 Août 1942, le CIE de Constantine
signale l'envoi par
1 Ibid., p. 6.
2 Ibid., p. 8.
3 Ibid.
4 Pour une analyse de la politique coloniale de Vichy,
voir Jacques Cantier et Éric T. Jennings (dir), L'Empire colonial
sous Vichy, Paris, Odile Jacob, 2004.
5 Voir notamment le mémoire au Maréchal
Pétain de Ferhat Abbas, In Le jeune Algérien (1930) : de la
colonie vers la province; (suivi de) Rapport au Maréchal Pétain
(avril 1941) / Ferhat Abbas, Paris, Garnier Frères,
1981.
Bendjelloul d'un télégramme au
Maréchal Pétain1. Il y annonce qu'il se rallie
à l'Axe au nom des populations musulmanes, en signe de protestation
contre l'emprisonnement de Gandhi par les Anglais2.
1 CIE de Constantine, Gouvernement
Général d'Algérie, « A/S du Docteur Bendjelloul du 10
Août 1942 : Copie de télégramme à Pétain,
Laval etc. », Rapport de renseignement, Constantine, 1942. 93 B3 785,
ANOM, Aix-En-Provence.
2 Sur la propagande antiimpérialiste de
l'Allemagne nazie, voir D. MOTADEL, « The Global Authoritarian Moment and
the Revolt against Empire », art. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 68
GOUVERNEMENT GENERAL de l'ALGERIE
-
Direction des Affaires Musulmanes
-
Centre d'Information et d'Etudes
Alger, le 10 Août 1942
RENSEIGNEMENT
Source : C.I.E Constantine
A/S DU DOCTEUR BENDJELLOUL
Le docteur Bendjelloul vient d'envoyer à Monsieur le
préfet de Constantine une lettre pour lui transmettre la copie d'un
télégramme qu'il a adressé hier, 9 août, à
Monsieur le Maréchal PETAIN, à Monsieur le Président
LAVAL, en communication à Monsieur le Gouverneur Général,
et «traduisant, écrit-il, l'état d'esprit des musulmans du
monde entier».
Ci-dessous, la copie de ce télégramme :
«Musulmans Algériens ont honneur vous exprimer
respectueusement leur indignation et protestations contre arrestations Mahatma
Gandhi et ses collègues Stop Vous prie les transmettre au Gouvernement
britannique. Cette mesure détruit définitivement autorité
et prestige britanniques auprès musulmans monde entier qui tous
souhaitent avec vous victoire allemande et anéantissement total
puissance anglaise Stop Vous demande autorisation prier vendredi prochain en
tout lieu pour libération Gandhi et Inde et réalisation votre
politique et vos voeux les plus chers Stop. Sentiments respectueux et
dévoués. Dr Bendjelloul.»/.
Destinataires :
M. le Directeur des Affaires Musulmanes C.I.E. Alger
C.I.E. Oran
Figure 4 Reproduction de télégramme du
10 août 1942 de Bendjelloul au Maréchal
Pétain1
1 CIE de Constantine,
Gouvernement Général d'Algérie, « Copie de
télégramme à Pétain », op.
cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 69
Ce télégramme contient des
éléments fréquents dans le discours de Bendjelloul : il se
place en porte-parole de sa communauté, recourt à l'Islam et
professe son loyalisme. L'argumentation de ce télégramme est
surprenante en ce qu'elle diffère fortement de la grille de lecture
contemporaine des enjeux de la Seconde Guerre Mondiale. Ce document semble
authentique : le courrier circulant entre administrations coloniales en
Algérie présente comme fiables les renseignements qu'il relaie :
il cite in extenso et entre guillemets le télégramme, et
mentionne précisément les dates et les moyens par lequel cette
source est en leur possession : c'est Bendjelloul qui aurait lui-même
envoyé une copie de ce télégramme au préfet de
Constantine, peut-être pour partager cette déclaration de
loyalisme aux autorités coloniales d'Algérie et améliorer
ses rapports avec eux.
Premièrement, on peut remarquer la
rapidité avec laquelle Bendjelloul réagit aux
évènements internationaux : le 8 août 1942, Gandhi, soutenu
par le parti du Congrès, appelle les Indiens à un mouvement
massif de désobéissance civile pour réclamer
l'indépendance de l'Inde. Le lendemain, les Anglais emprisonnent les
leaders du Parti du Congrès, engendrant grèves et manifestations
dans tout le sous-continent1. Selon le document ci-dessus, contenu
dans les archives de la préfecture de Constantine, c'est le jour
même que Bendjelloul aurait envoyé ce télégramme
à Laval et Pétain, et l'aurait envoyé le lendemain, le 10
août, au préfet de Constantine, qui en fait part au Gouvernement
Général d'Alger dans le courrier dont il est question
ici2. Malgré le contexte de guerre mondiale et de domination
coloniale, les évènements en Inde ont été connu
presque immédiatement en Algérie, et pour Bendjelloul le lien
entre le combat de Gandhi et ses propres opinions politiques est suffisamment
fort pour que la réaction de soutien à Gandhi et de
réprobation de l'action impériale anglaise soit tout aussi
immédiate. Ce télégramme est un intéressant
témoignage de solidarité transimpériale entre
colonisés3.
Ensuite, ce télégramme nous montre les
conséquences que Bendjelloul tire de cet évènement pour
ses allégeances au gouvernement de Vichy et aux puissances de l'Axe. La
formulation de ce texte répond au soupçon habituel de
duplicité du colonisé : si avant cette arrestation, les «
musulmans [du] monde entier » auraient pu être favorables aux
Alliés, leur
1 Michel Boivin, « Chapitre III. L'Empire
britannique et le développement du nationalisme », in Histoire
de l'Inde, Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, 2021, vol.6e
éd., p. 53?83.
2 CIE de Constantine, Gouvernement Général
d'Algérie, « Copie de télégramme à
Pétain », doc. cit.
3 Sur les horizons mondiaux créés par
les médias tels que la radio, voir Arthur Asseraf, Electric News in
Colonial Algeria, Oxford, New York, Oxford University Press,
2019.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 70
politique coloniale répressive en Inde leur
fait perdre ce prestige au profit des puissances de l'Axe. Un an après
sa déclaration radiophonique en faveur du nouveau gouverneur
général nommé par Vichy, Bendjelloul professe franchement
son ralliement à Pétain, affirme souhaiter la victoire de
l'Allemagne nazie sur les Alliés, et propose de prier pour la «
réalisation de [la] politique » et des « voeux les plus chers
» du Maréchal. Cette profession de loyalisme est brève mais
solennelle et résolue. Bendjelloul ne se contente pas d'organiser des
prières publiques pour la libération de Gandhi, mais il
écrit au plus haut niveau de l'Etat pour demander l'autorisation, selon
son habitude. Il ajoute au coeur de sa demande une démonstration
d'adhésion collective des Algériens colonisés pour les
autorités françaises, voire d'affection personnelle pour le
Maréchal, dans le contexte du culte de la personnalité
répandu à cette époque1. Bendjelloul fait
preuve d'une grande audace en écrivant au plus haut niveau de l'Etat,
mais aussi en élevant à une échelle internationale son
rôle de porte-parole, ici non plus seulement de ses électeurs ou
des Algériens mais de toute l'Oumma, voire des colonisés du monde
entier. En s'adressant à Pétain, il lui demande de transmettre de
sa part au gouvernement britannique l'indignation des Musulmans
Algériens. Il s'érige ici en ambassadeur des Algériens,
positionnant ses revendications politiques sur la scène
géopolitique internationale.
Ce télégramme est envoyé à
Vichy quelques mois seulement avant le débarquement allié en
Afrique du Nord. Dans la suite de sa carrière au sein des institutions
françaises, on retrouve quelques accusations de collaboration contre
Bendjelloul, sans qu'il ne semble avoir fait l'objet de sanctions. Sur la copie
du télégramme contenue dans les archives de la préfecture
du Constantine, on trouve la mention manuscrite
« Que ne publions nous ce
télégramme pour ridiculiser définitivement ce pantin
dangereux de Bendjelloul, qui ne sait de quoi il parle !
»2
Il semble donc qu'un lecteur ultérieur de ces
archives y ait trouvé un outil pour nuire à Bendjelloul, à
une époque où celui-ci occupait encore une fonction publique. Ce
télégramme sera effectivement souvent mentionné par les
opposants à l'élection de Bendjelloul à l'Assemblée
Consultative Provisoire. Mais sa collaboration réelle ou supposée
n'a pas eu
1 Voir J. Cantier, L'Algérie sous le
régime de Vichy, op. cit.
2 CIE de Constantine, Gouvernement Général
d'Algérie, « Copie de télégramme à
Pétain », doc. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 71
d'impact notable sur la carrière de Bendjelloul
et sur ses relations avec les autorités françaises après
la libération.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 72
III. La sortie de guerre et la reprise de la vie
républicaine : hésitations face à une souveraineté
française incertaine
Après le débarquement en Afrique du Nord
le 8 novembre 1942, les armées anglo-américaines occupent
l'Algérie. Leur alliance avec les autorités vichystes d'Afrique
du Nord est très contestée par les Forces Françaises
Libres, ce qui entraîne un climat d'instabilité politique. Les
partisans du Général De Gaulle prennent progressivement le
contrôle de la vie politique algérienne dans le courant de l'hiver
1943. Pourtant, aucune mesure ne s'attaque à la colonisation, qui ne
semble remise en question par aucune des forces en présence. En
parallèle, les combats de la campagne de Tunisie emploient une vaste
majorité de soldats maghrébins, et la préparation de la
campagne d'Italie et du débarquement en Provence ne laisse pas de doute
sur l'emploi massif de colonisés dans ces opérations. Alors que
depuis 1939 la guerre semblait une affaire européenne, l'Afrique du Nord
se retrouve au centre des attentions, et Alger devient la capitale de la France
libre. Face à cette crise de souveraineté, les colonisés
s'activent pour être pris en compte, non plus comme un simple
réservoir de soldats, mais comme une force politique avec laquelle leurs
divers interlocuteurs se doivent de composer. La fin du régime de Vichy
en Afrique du Nord leur permet de retrouver une plus grande diversité de
modes d'actions : certains retrouvent les institutions dans lesquelles ils
étaient élus avant 1940, multiplient les rencontres avec les
autorités des différentes forces d'occupation, publient des
textes, organisent des réunions, des manifestations, fondent des
journaux. Tous réclament avec gravité des réformes,
avertissant les colonisateurs que la crise internationale ne peut
éclipser la crise algérienne qui couve depuis bien trop
longtemps. Dans cette partie, nous allons observer le moment crucial où
la majorité des Algériens colonisés adhèrent au
nationalisme. Pourtant, Bendjelloul reste le champion de l'assimilationnisme,
et commence même à être reçu avec plus d'attention
par les autorités coloniales, inquiètes face à la
montée inexorable du nationalisme algérien.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 73
A - Espoirs déçus : le Manifeste et la
déclaration de Constantine
Face à l'émergence d'un nouvel ordre
politique et à l'imminence de la mobilisation militaire, des
personnalités algériennes de différents courants se
réunissent durant l'hiver 19421943 pour organiser la défense des
intérêts du peuple algérien. Leur porte-parole Ferhat Abbas
rédige un mémoire intitulé « L'Algérie devant
le conflit colonial : Manifeste du peuple algérien » qu'ils signent
et remettent le 31 mars 1943 au Gouverneur Général (GGA) Marcel
Peyrouton, ainsi qu'aux autorités anglo-américaines le lendemain.
Ageron rapporte que le Manifeste était initialement adressé aux
Alliés par Abbas, mais que pour ménager le gouvernement
provisoire français, le Docteur Bendjelloul et le Docteur Saadane aurait
dissuadé Abbas d'adresser le Manifeste aux Nations unies et auraient
proposé une deuxième version modifiée du manifeste,
s'adressant au gouvernement français siégeant à Alger.
Ageron doute cependant de la spontanéité de cette révision
du manifeste, pensant que l'initiative serait en réalité
l'exigence des autorités françaises 1.
Ce texte est considéré comme la
première formulation du nationalisme algérien2, et par
nationalisme, on entend la promotion de l'indépendance d'un peuple
doté d'une unité culturelle et d'une autonomie d'action
vis-à-vis d'une autorité supérieure. Le Manifeste
présente un courant de pensée majeur parmi les élites
algériennes, envisageant la fin de l'empire colonial français qui
se dessine alors. Le discours reste teinté d'assimilationnisme et
légitime ses revendications en les basant sur les valeurs
républicaines françaises bafouées par la colonisation. Il
emploie également la rhétorique de guerre morale employée
par les Alliés. Le Manifeste est cependant sans équivoque dans
ses conclusions : la colonisation est irréformable, et l'admiration que
les signataires éprouvent pour la France ne justifie pas sa domination
du peuple algérien. Le Manifeste du Peuple Algérien exprime bel
et bien une vision nationaliste, et affirme que la création d'un Etat
algérien est l'unique solution aux problèmes de la colonisation.
Ce texte présente ainsi l'évolution d'une grande partie de la
classe politique algérienne d'un l'assimilationnisme déçu
à la revendication de l'autonomie.
1 Charles-Robert Ageron, Histoire de
l'Algérie contemporaine. 2, De l'insurrection de 1871 au
déclenchement de la guerre de libération, 1954, Paris,
Presses Universitaires de France, 1979, 558ss.
2 László J. Nagy « Le Manifeste du
peuple algérien: document fondamental du nationalisme algérien
», Chronica. 1 janvier 2004, vol.4. p. 102.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 74
L'argumentaire du texte puise des arguments efficaces
dans le contexte géopolitique bouleversé par la guerre, en
dénonçant l'enthousiasme des colons pour le pétainisme ou
en comparant l'oppression coloniale à l'invasion de la France par
l'Allemagne. L'exemple de l'humiliation de l'Allemagne en 1918 est
rappelé comme un avertissement : maintenir les injustices entre les
peuples c'est semer les germes d'une guerre future. Selon un motif
rhétorique typique de la FEM, Abbas présente l'expression des
revendications du peuple algérien comme sa responsabilité au
service de la paix : les Algériens remplissent leur devoir en exprimant
leurs revendications, aux « grandes nations » de prendre eux aussi
leurs responsabilités en les prenant en compte1. Les
expressions « Occident » ou « grandes nations »
récurrentes dans le texte sont par contre des innovations qui indiquent
que l'irruption des Alliés en Algérie donne lieu à une
reconfiguration du dialogue colonial. Bien que les autorités
gouvernementales françaises restent souveraines sur les populations
algériennes, les puissances anglo-saxonnes sont vues comme les
vainqueurs de la France, et le Manifeste montre que les Algériens se
perçoivent comme occupés par les Alliés2. Le
texte appelle la France à s'inspirer de la politique de l'Empire
Britannique « en pays arabes » et des Etats-Unis aux Philippines :
dans un contexte où la France est au bénéfice de
l'alliance avec les puissances anglo-saxonnes pour la libération de son
territoire métropolitain, l'évocation des Alliés comme
modèles rappelle aussi discrètement que la grandeur de la France
en Algérie est éclipsée par de plus grandes puissances,
que l'ordre du monde change et que les colonisés y voient leur
intérêt.
Après un panorama historique de la colonisation
en Algérie, le manifeste conclut au sujet des projets de réformes
de la colonisation qu'« aucun n'a abouti et, nous pouvons le dire
maintenant, aucun ne pourra jamais aboutir »3 et annonce
:
« L'heure est passée où un
musulman algérien demandera autre chose que d'être un
Algérien musulman. »4
Ainsi, le manifeste revendique une identité
nationale, et l'abandon explicite de l'assimilationnisme par ceux qui quelques
années plus tôt y voyaient la solution d'avenir de
1 Ferhat Abbas, Le Manifeste du Peuple
Algérien, Paris, Orients, 2013.
2 C.-R. Ageron, Histoire de l'Algérie
contemporaine, op. cit, p. 558.
3 Ferhat Abbas, Le Manifeste du Peuple
Algérien : suivi du Rappel au peuple algérien / préface de
Jean Lacouture, Paris, Orients, 2013, p. 33. Comparer avec la «
Motion des 61 » publiée vingt ans plus tard, voir
infra.
4 Ibid., p. 35.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 75
l'Algérie. Cela constitue une réelle
évolution du paysage politique algérien. Le Manifeste n'est pas
une déclaration d'indépendance ni la formulation d'un réel
programme nationaliste, mais on pourra retenir la formulation
intéressante d'Ageron qui le décrit comme « une solennelle
revendication de l'autonomie de la nation algérienne
»1.
Bendjelloul fait également partie de la
délégation qui avec Ferhat Abbas remet le mémoire au
gouverneur général le 31 mai 1943. Il n'est donc pas un
observateur tiède participant au manifeste sous la pression d'un
contexte politique changeant, mais il s'engage personnellement dans la
poursuite du projet du manifeste et se risque à le défendre
devant les autorités coloniales. Il semble ainsi adhérer à
l'idée qu'aucune réforme n'aboutira jamais, et que l'idéal
d'émancipation des Elus ne semble plus pouvoir se réaliser que
dans une Algérie souveraine.
Pourtant, quelques mois plus tard, un
évènement vient réveiller les espoirs des
assimilationnistes. Le 12 décembre 1943, le Général De
Gaulle promet dans un discours à Constantine d'accorder les droits
entiers de citoyens à plusieurs dizaines de milliers de musulmans sans
renoncement à leur statut personnel, leur ouvre plusieurs postes
administratifs, augmente la part de colonisés dans les assemblées
locales et promet une amélioration du niveau de vie. Bendjelloul
accueille avec enthousiasme ces annonces bien en-deçà des
revendications du Manifeste et allant plutôt dans le sens du projet
Blum-Violette abandonné quelques années plus
tôt2. Dans ses mémoires de guerre, De Gaulle affirme,
et cette anecdote est reprise par d'autres contemporains de
l'évènement, que Bendjelloul et d'autres assimilationnistes
auraient versé des larmes en entendant ce discours du 12
décembre3. Les observateurs ont bien compris que cette
affirmation de l'égalité de droit entre Français et
Musulmans était la réalisation de l'idéal pour lequel
Bendjelloul combattait avec acharnement depuis une quinzaine d'années.
Je pense que c'est cette déclaration de Constantine qui est le moment
clé pour la suite de la carrière de Bendjelloul. Sa signature du
manifeste en mai indiquait qu'il se laissait séduire par la
revendication nationale distincte de la France, qui, alors occupée par
les Allemands d'une part et les Alliés d'autre part, ne possédait
plus d'autonomie sur la scène internationale ni même
sur
1 Charles-Robert Ageron. « Ferhat Abbas et
l'évolution politique de l'Algérie musulmane pendant la Seconde
guerre mondiale » Genèse de l'Algérie
algérienne. Saint-Denis : Éditions Bouchène, 2005, p.
259?284.
2 C.-R. Ageron, « Livre IV - Forces politiques et
évolution politique de l'Algérie 1939-1954 », art.
cit.
3 C.-R. Ageron, Histoire de l'Algérie
contemporaine, op. cit, p. 564.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 76
son propre territoire. Mais avec le discours de
Charles De Gaulle, l'espoir renaît pour les assimilationnistes. De Gaulle
leur montre que la nouvelle France qu'il est en train de construire leur sera
favorable. Il affirme avec audace l'égalité que même le
Front Populaire n'avait pas réussi à leur accorder. Avec un tel
revirement, seulement six mois après l'installation du Comité
Français de Libération Nationale (CFLN) à Alger, quelles
transformations du système colonial ne devenaient-elles pas possibles
?
Deux jours après le discours, un
arrêté institue une commission de réformes pour
concrétiser les promesses faites par le Général. Diverses
personnalités politiques algériennes, colons et colonisés,
sont entendus, et de leurs avis divergents résulte l'ordonnance du 7
mars 1944. Même les musulmans les plus modérés la trouvent
insatisfaisante : la citoyenneté française avec maintien du
statut personnel est accordée seulement à 16 catégories de
musulmans, ce qui représente moins de 100 000 personnes1. Le
statu quo est conservé pour les millions d'autres Musulmans, et le CFLN
rejette sur la future Assemblée constituante la responsabilité de
statuer à leur sujet. L'abolition du code de l'indigénat et la
proclamation de l'égalité civile représentent
malgré tout des mesures symboliques fortes et attendues, et si cette
ordonnance du 7 mars devient le texte le plus audacieux de l'histoire
législative de l'Algérie française, les avancées
restent dérisoires alors que le débarquement allié avait
donné à certains l'espoir d'un état algérien
indépendant, à d'autres celui d'une intégration totale de
tous les colonisés dans la citoyenneté française. Par la
suite, les revendications des partisans de l'assimilation trouveront appui sur
les promesses de cette ordonnance du 7 mars, sans succès.
B - Bendjelloul, premier Algérien musulman
à être élu dans une institution nationale française
: l'Assemblée consultative provisoire
Pour se doter d'une légitimité plus
large aux yeux des Anglo-saxons dans sa revendication de la souveraineté
française, le Gouvernement Provisoire de la République
Française se dote d'une Assemblée Consultative Provisoire (ACP).
Comme son nom l'indique, les résolutions votées par cette
assemblée ont seulement valeur d'avis pour le
gouvernement2.
1 C.-R. Ageron, « Livre IV - Forces politiques et
évolution politique de l'Algérie 1939-1954 », art. cit, p.
565.
2 Pierlot (Yvon Morandat), Rapport sur
l'Assemblée Consultative Provisoire, Délégation
A.1.I, s.d., p. 6. 72AJ/234, Archives Nationales,
Pierrefitte-sur-Seine.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 77
À la fin du mois d'octobre 1943 les conseillers
généraux des trois départements algériens
désignent leurs représentants au sein de l'Assemblée
consultative. Les deux hommes qui se présentent pour le
département de Constantine sont élus, Monsieur Paul Cuttoli
à l'unanimité et le Docteur Bendjelloul avec 20 voix sur 22
exprimées1. Le fait qu'il soit la seule personnalité
musulmane membre de l'ACP et qu'il le soit après avoir été
élu par ses pairs prouve que Bendjelloul disposait d'une
crédibilité certaine ou en tout cas de rapports positifs avec les
autres conseillers généraux européens du
département de Constantine. Bendjelloul est ensuite élu au sein
de l'ACP comme président du sixième Bureau2. En cette
fin de Seconde Guerre Mondiale, Bendjelloul apparaît bien
intégré dans les milieux politiques européens et dans
cette nouvelle institution, la première de dimension nationale dont il
fasse partie.
S'il ne semble pas rencontrer d'obstacles à sa
participation aux institutions du nouveau régime français, de
nombreuses contestations s'élèvent cependant pour dénoncer
son attitude conciliante, voire son adhésion explicite au régime
de Vichy. Dans son rapport non daté sur les luttes autour de la
composition de l'ACP, le résistant gaulliste de la première heure
Yvon Morandat brosse un portrait à charge du
délégué et du Docteur Tamzali, bien que celui-ci ne soit
pas un membre officiel de l'ACP3 :
Pour en revenir aux choix des
délégués coloniaux et sans faire de personnalités
(sic), on peut regretter que les Docteurs BENJELLOUL et TAMZALI soient
délégués. Le premier, nationaliste algérien, a
toujours combattu la France, à moins que son représentant
n'emploie les arguments sonnants et trébuchants, sa collusion avec les
Commissions d'armistice était notoire. 4
Morandat accuse Bendjelloul d'être
malhonnête et motivé par l'argent dans ses convictions politiques,
mais ne donne pas plus d'explications sur l'origine de son avis sur
Bendjelloul. Il tombe dans l'erreur commune d'avant-guerre consistant à
considérer comme
1 Archives de l'Assemblée Consultative
Provisoire, « Dossier «Conseil Général Afrique du
Nord» », 17 avril - 1er novembre 1943, C//15260/94001/469, Archives
Nationales, Pierrefitte-sur-Seine.
2 Ibid.
3 Anne-Marie Gouriou, archiviste et Roseline Salmon,
conservateur du patrimoine, « Annexe du répertoire:
Assemblée consultative provisoire (Alger et Paris) 1944-1945 ». Le
docteur Tamzali n'apparaît sur aucune des listes officielles successives
des délégués de l'ACP.
4 Pierlot (Yvon Morandat), Rapport sur
l'Assemblée Consultative Provisoire, doc. cit, p.
1.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 78
nationalistes les assimilationnistes
réformistes1. Cependant, si ce document n'est pas
daté, il est certain qu'il a été écrit après
la publication du Manifeste du Peuple Algérien en février 1943,
dont Bendjelloul est signataire. Dans son rapport désabusé sur le
retour de la compétition politique et sur la dilution de l'idéal
résistant, l'auteur souligne également les actes de sympathie
envers Vichy de Bendjelloul comme de Tamzali. L'auteur n'a apparemment pas
connaissance du télégramme de Bendjelloul à Pétain,
qui aurait constitué un argument fort contre le Docteur, et il ne
précise pas ce qu'il entend par « collusion avec les Commissions
d'Armistice ». Il est marquant que seules les nominations des
Algériens musulmans soient dénoncées dans ce rapport,
alors que plusieurs autres délégués faisaient l'objet
à la même époque de procédure d'invalidation pour
indignité nationale : la méfiance systématique et les
discriminations envers les colonisés ne vont pas prendre fin avec
l'arrivée au pouvoir des résistants.
Une note de renseignements non signée datant du
9 novembre 1943 rapporte que les détracteurs sont nombreux parmi les
coreligionnaires du Docteur Bendjelloul, et qu'ils font campagne contre lui
auprès du comité de la libération et auprès de
l'ACP en rappelant ses faits et gestes à l'époque de la
révolution nationale. La déclaration de loyalisme de Bendjelloul
à la radio était par nature publique, et Bendjelloul souffre en
1943 d'une réputation de collaborateur. Le 3 novembre 1943 le
congrès algérois du mouvement résistant Combat
écrit aux délégués de la résistance
chargés des validations des délégués à
l'ACP, les appelant à l'exclusion du Docteur Bendjelloul pour donner
suite à la révélation du télégramme à
Pétain du 9 août 1942, et plus largement « de l'attitude
générale du conseiller général Bendjelloul »,
qu'ils décrivent comme un « pro-hitlérien », «
pendant la période dite de la Révolution Nationale
»2. Une aussi lourde accusation accompagnée de preuves
ne pouvait que mener à la condamnation de Bendjelloul. Cependant une
note manuscrite au crayon à la fin du courrier indique qu'il a
été arrêté en 1942 puis remis en liberté sur
l'intervention d'une personne haut placée dans le Gouvernement
provisoire de la République française dont le nom est
difficilement lisible. Il aurait été arrêté de
nouveau la même année, peut-être par Giraud, et mis en
liberté sur intervention de Robert Murphy, le représentant des
Etats Unis en Afrique du Nord. Les archives dont nous disposons
1 Voir supra, Partie I « II : Toute remise en cause
du système colonial est-elle nationaliste en puissance ? ».
p11.
2 Archives de l'Assemblée Consultative
Provisoire, « Dossier 490 Bendjelloul : voeu de Combat, mouvement de
libération français tendant à l'exclusion de Mohamed
Bendjelloul », novembre 1943, C15260/94001.490, Archives Nationales,
Pierrefitte-sur-Seine.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 79
ne permettent pas de connaître les
détails des liens entre Bendjelloul et les différentes personnes
mentionnées dans cette note manuscrite, mais il semble possible
d'établir que Bendjelloul a bénéficié de l'appui de
personnages influents parmi les Alliés afin d'échapper aux
mesures d'épuration. Signe de ce contexte d'épuration, au verso
de ce courrier se trouve un texte similaire appelant à l'éviction
de l'ACP du résistant Henri d'Astier de La Vigerie en raison de ses
convictions monarchistes et de l'irrégularité de son
élection comme délégué. Le document suivant dans le
dossier est le procès-verbal d'une réunion tenue deux jours
après l'envoi de ce courrier. Le bureau y propose la validation de
différents délégués, et parmi eux Messieurs
d'Astier de La Vigerie et Bendjelloul. Une note du 22 novembre 1943 indique que
Bendjelloul aurait été soumis par la commission de validation des
délégués de l'ACP à « un questionnaire
précis relatif à son passé politique et notamment à
son attitude sous le gouvernement de Vichy »1 et que, soutenu
par des collègues de l'ACP, il n'aurait pas été
invalidé. La tentative de Bendjelloul d'employer son habituelle
stratégie d'opposition loyale sous le régime de Vichy se retourne
contre lui lors de ce changement de régime : il s'était
employé à faire connaître ses actions de protestation ou sa
participation au nouveau système politique, soit par la
déclaration à la radio en 1941 soit en faisant lui-même
suivre son télégramme à Pétain à la
préfecture de Constantine et au Gouverneur Général
d'Algérie, quelques mois seulement avant le débarquement
allié en Afrique du Nord.
En cherchant Bendjelloul dans les archives de
l'épuration, on trouve un autre document : lors de l'enquête au
sujet des agissements de l'ancien ministre vichyste Max Bonnafous, Bendjelloul
a témoigné par écrit de ses relations avec celui-ci
lorsqu'il était préfet de Constantine entre 1940 et
19412. Bendjelloul y décrit lui-même son action et sa
relation aux autorités françaises pendant la période de
Vichy.
Dans son témoignage en faveur de Bonnafous,
Bendjelloul loue la politique agricole de l'ancien préfet, qui allait
dans le sens des revendications de la FEM en favorisant les petites
exploitations. Mais c'est surtout sur le plan politique que Bendjelloul affirme
avoir apprécié la gouvernance du préfet vichyste
:
1 Préfecture d'Alger - Police des Renseignements
Généraux, « Dossier Dr Bendjelloul », doc.
cit.
2 Mohamed Bendjelloul, « Déposition du
Docteur Bendjelloul, délégué à l'Assemblée
Consultative Provisoire. Président de la Fédération des
Elus Musulmans d'Algérie », 1945. In Haute Cour de
Justice, « Dossier Bonnafous - Première Partie de la
Procédure, Liasse IX : Liberté provisoire et documents annexes
», 3W75, Archives Nationales, Pierrefitte-sur-Seine.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 80
Très informé des questions
musulmanes, Monsieur Max BONNAFOUS ne fit point la politique des Grandes
familles et rechercha l'aide, le concours et l'amitié des jeunes
intellectuels dont j'étais, contre lesquels les hommes de VICHY
voulaient jeter l'exclusive. 1
Malgré le durcissement des rapports entre les
autorités coloniales et les élus musulmans pendant la
période de Vichy2, Bendjelloul affirme que Max Bonnafous a
donné aux élites intellectuelles musulmanes la place
prépondérante qu'ils attendaient depuis le début du
XXe siècle. Là où ce sont plutôt les
élites traditionnelles qui étaient les interlocuteurs
privilégiés du régime de Vichy3, Bonnafous leur
a permis de collaborer avec lui. Bendjelloul indique également qu'il
attribue à l'action de Max Bonnafous le fait de ne pas avoir
été arrêté sous Vichy de même que plusieurs de
ses amis et il affirme avoir collaboré avec le préfet pour lutter
contre les campagnes de propagande fasciste visant la population musulmane. En
conclusion il insiste encore, et jure que durant son mandat Max Bonnafous s'est
toujours conduit « comme un homme de gauche et comme un
républicain, comprenant et aidant l'évolution démocratique
nécessaire des masses musulmanes »4. Bendjelloul s'est
apparemment retrouvé en union de pensée et de vision politique
avec Max Bonnafous.
Il est étonnant que Bendjelloul se
révèle de cette manière alors qu'il avait lui-même
fait l'objet d'accusations de collaboration suite à la
révélation de son télégramme à Pétain
lors de sa nomination à l'ACP deux ans plus tôt. Cela est d'autant
plus étonnant qu'il le fait pour défendre un Français qui
avait occupé un poste haut placé dans le gouvernement : il n'est
ni un de ses mandants ni un musulman ni même un colonisé ou un
indigent. Bendjelloul se sent peut-être redevable envers Bonnafous pour
sa protection, dont il dit avoir bénéficié durant la
période de Vichy. L'ancien ministre ne pourra plus améliorer la
situation des colonisés, il ne peut donc pas s'agir d'une manoeuvre
visant à obtenir en contrepartie des réformes en faveur de
l'Algérie colonisée. Assiste-t-on ici à l'un des signes de
la transformation de Bendjelloul en politicien français et à
l'érosion de sa figure de héros combattant la France ? S'il est
vrai que Bendjelloul
1 Mohamed Bendjelloul, « Déposition du
Docteur Bendjelloul », doc. cit.
2 Éric T. Jennings, « La politique
coloniale de Vichy », in L'Empire colonial sous Vichy, Paris,
Odile Jacob, 2004, p. 13?27.
3 Ibid.
4 Mohamed Bendjelloul, « Déposition du
Docteur Bendjelloul », doc. cit ; in HAUTE COUR DE
JUSTICE, « Dossier Bonnafous », doc. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 81
même dans les années 1930 a toujours
tenté de faire alliance avec les politiciens français et
d'entretenir avec différents courants politiques des relations
cordiales, ici il semble qu'un cap est franchi : Bendjelloul vient
spontanément à l'aide de Bonnafous et, en apparence du moins,
sans contrepartie. Il utilise pour cela sa légitimité
d'élu de l'ACP, dont il utilise le papier à entête pour
faire sa déposition.
Dans cette déposition Bendjelloul se
présente en quelque sorte comme un vichysto-résistant
lui-même, employant les institutions de Vichy pour oeuvrer en faveur des
populations musulmanes. Je pense qu'on peut étendre cette analyse
à la manière dont Bendjelloul conçoit son action dans le
cadre des institutions coloniales au cours de sa carrière. En France,
avant que ne s'impose le grand narratif atlantiste de guerre morale, la Seconde
Guerre Mondiale et l'occupation de la France par l'Allemagne était
surtout comprise comme une humiliation militaire et une violation de la
souveraineté nationale. Pour les Algériens colonisés, le
changement de régime politique constituait moins un bouleversement
majeur de leurs droits civiques ou de leurs conditions de vie que la guerre en
soi.
Bendjelloul ne se contente pas d'être
validé comme membre de l'ACP, et entreprend de restaurer son
activité politique d'avant-guerre. Le dossier de la police des
renseignements généraux de la préfecture d'Alger de 1944
contient un grand nombre de petites fiches de signalement d'une ou deux phrases
indiquant sans commentaire des échanges d'argents ou des
déplacements du Docteur Bendjelloul, ainsi que les personnes
l'accompagnant et les endroits qu'il fréquente1. L'importance
matérielle de ce dossier et la faiblesse de son contenu témoigne
du regain de surveillance dont Bendjelloul est l'objet au printemps 1944. Ces
rapports de surveillance mettent aussi en avant la rivalité entre les
partisans d'Abbas et ceux de Bendjelloul, et la volonté de ce dernier de
lutter pour faire remonter sa popularité. Ces notes laissent
transparaître le contexte de dépassement politique de Bendjelloul
par les Amis du Manifeste, plus radicaux. Ces derniers affirmeraient notamment
que l'ancien leader mène une « politique que les `revendicatifs' ne
peuvent plus admettre à l'heure actuelle »2,
témoignant de l'évolution du paysage politique algérien au
début des années 1940.
1 Préfecture d'Alger - Police des Renseignements
Généraux, « Dossier Dr Bendjelloul », doc.
cit.
2 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 82
Le 6 juillet 1944, un rapport de la Police des
Renseignements Généraux (PRG) de la préfecture d'Alger
signale que le Docteur Bendjelloul a écrit la veille au commissaire
à l'information afin d'être autorisé à faire
reparaître « [son] journal [l'Entente] qui a paru à
Alger, puis à Constantine, jusqu'en 1941 »1. Bendjelloul
décrit les caractéristiques du journal, qui serait hebdomadaire
et tirerait à 10 000 numéros par semaine. Il en serait le
directeur politique, et un membre expérimenté de la FEM,
Smaïl Lakhdari, en serait le rédacteur en chef. Les raisons
avancées par Bendjelloul pour l'arrêt de l'activité de
l'Entente en 1941 sont sa résistance à la censure et sa
protestation contre « le numerus clausus imposé aux Médecins
Israélites »2. Bendjelloul se présente comme
ayant eu une place centrale dans les activités de ce journal avant la
guerre, sous-entendant que ce qui y était publié était
l'expression de son opinion et de sa volonté, éclipsant le
rôle important des rédacteurs en chefs successifs, Kessous, et
Abbas. Bendjelloul se présente aux autorités comme un homme
politique influent et comme ayant résisté à la censure et
à l'antisémitisme endémiques du régime de
Vichy.
La situation de Bendjelloul est un cas unique à
cette époque : il est le seul homme politique algérien relevant
du statut musulman à représenter les colonisés
algériens à l'ACP. Il ne s'agit pas d'un hasard de parcours, et
on voit qu'il dispose d'un réseau fourni et efficace de soutiens dans
les milieux politiques français et même peut-être
au-delà. Pour autant, Bendjelloul ne considère pas sa position
personnelle privilégiée comme un accomplissement, et
dépose le 23 mars 1945 une proposition de loi « tendant à
inviter le gouvernement à faire représenter les musulmans
algériens à l'assemblée consultative provisoire par six
délégués élus par les conseils
généraux d'Algérie »3. Dans ce texte
législatif rédigé dans un ton très personnel,
Bendjelloul présente son expérience en tant qu'unique membre
musulman de l'ACP. Face aux « intérêts locaux et d'ordre
social ou économique des Français et des musulmans [qui] peuvent
s'opposer », Bendjelloul tente de défendre les uns sans
léser les autres en conciliant ces intérêts opposés,
mais il reconnait que « [sa] modeste voix ne peut souvent rien au sein
d'une forte majorité »4. Bendjelloul décrit comme
« particulièrement angoissante » la situation politique
en
1 Ibid.
2 Ibid.
3 Mohamed Bendjelloul, « Proposition de
résolution n°390 tendant à inviter le Gouvernement à
faire représenter les musulmans algériens à
l'Assemblée consultative provisoire par six
délégués élus par les conseils
généraux d'Algérie », Archives de l'Assemblée
Consultative Provisoire, 23 mars 1945, C15248/94001.23, Archives Nationales,
Pierrefitte-sur-Seine.
4 Ibid., p. 2.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 83
Algérie. Il présente les quatre
principaux courants (PPA, Amis du Manifeste, FEM et Oulémas) et leurs
revendications. Il s'attache à se montrer en lien avec chacun d'eux : il
plaide depuis longtemps pour la fin de la mise en résidence
surveillée de Messali Hadj, il est l'ex-collègue de Abbas, et il
loue l'action des Oulémas pour la scolarisation. Il se positionne ainsi
en chef de file de l'Algérie musulmane, en porte-parole consensuel et
représentatif. Il montre comment la crise économique et sociale
aigüe favorise ce qu'il décrit comme un « danger
»1 : le développement de l'idée
séparatiste ou autonomiste dans la population musulmane.
Face à l'aggravation continue en Algérie
du mécontentement et de l'esprit séparatiste, la solution que
propose Bendjelloul est la mise en application effective de l'ordonnance du 7
mars établissant l'égalité entre Français et
Musulman. Il déplore que les décrets d'application ne soient pas
encore sortis et réclame comme mesure prioritaire l'augmentation de la
représentation des musulmans au sein des assemblées locales
algériennes, ainsi qu'au sein de l'Assemblée consultative
provisoire, mesure qui « sera de nature à apaiser les passions
politiques qui s'allient en Algérie et à faire redresser
promptement la situation »2. Comme avant la guerre on voit que
face à la crise sociale et économique, Bendjelloul
interprète les revendications populaires selon ses convictions
politiques et valorise des réponses institutionnelles et l'augmentation
des droits au sein des institutions coloniales françaises. Après
la signature du Manifeste puis la déclaration de De Gaulle, sa foi en la
citoyenneté française comme émancipation semble
restaurée. On retrouve la rhétorique du devoir accompli par les
élus musulmans exprimant leurs revendications, devoir d'informer les
autorités françaises du danger que représenterait le
maintien du statu quo et le refus de réformer le système
colonial. Mais contrairement au ton revendicatif d'avant-guerre, le ton de
cette proposition de résolution est grave et suppliant :
La désillusion et le désespoir de
ceux-ci [les membres musulmans Algériens de l'ACP,
c'est-à-dire Bendjelloul] seraient portés à leur
comble et les élus fédérés perdraient tout courage
si leurs efforts depuis 1931 et si l'effort de guerre apporté par
l'Algérie en 1939 et 1940 et depuis 1942 à ce jour ne devait pas
être couronné par la représentation de musulmans à
l'Assemblée consultative provisoire.3
1 Ibid., p. 6.
2 Ibid., p. 4.
3 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 84
Les émotions et le sentiment d'urgence de
Bendjelloul face à la situation de l'Algérie sont explicites dans
ce passage, un peu plus d'un mois avant l'insurrection du Constantinois du 8
mai 1945. L'implication émotionnelle dont Bendjelloul témoigne
dans ce bref résumé de sa carrière depuis 1931 prouvent
que son engagement politique va bien au-delà d'une quête
d'intérêts personnels.
Ce texte n'a malheureusement pas été
distribué aux délégués avant le 15 mai 1945, en
même temps que vingt-deux autres propositions diverses1. Le 28
juin 1945, deux mois après les massacres de Sétif et Guelma, la
SFIO propose un long texte appelant à des réformes audacieuses
pour sauver l'Algérie française en faisant justice aux
revendications des populations musulmanes. Les socialistes appellent notamment
à la mise en application intégralement et sans délai de
l'ordonnance du 7 mars 1944, trois mois après que Bendjelloul l'a
demandée, apparemment sans effet. Cinq mois plus tard, le 28 juillet
1945, José Aboulker, délégué algérien de
l'ACP, propose une résolution allant dans le même sens que
Bendjelloul en demandant la représentation de l'Algérie à
l'Assemblée constituante par un nombre égal de
représentants de chaque collège électoral français
et musulman2. Comme Bendjelloul dans sa proposition de
résolution, il se base sur la déclaration du 7 mars 1944
affirmant que les musulmans et les colons sont également français
et ont les mêmes droits. Cette résolution a été
adoptée le 2 août 1945 par l'Assemblée consultative
provisoire.
Les bouleversements institutionnels qui secouent la
métropole pendant et après la Seconde Guerre Mondiale sont un
moment propice aux espoirs d'une réforme en profondeur du système
colonial et de la place des colonisés dans le monde. De nombreux
courants de pensée propose des réformes, de nouvelles
institutions voient le jour, le vocabulaire colonial change en partie sans que
la réalité de l'oppression ne connaisse une véritable
remise en question. Tout au long de ces bouleversements institutionnels et
politiques, Bendjelloul poursuit sa stratégie d'opposition loyale,
adaptant la formulation de ses revendications au contexte et aux régimes
politiques successifs. Il n'hésite pas à prendre des risques dans
l'exercice de ses mandats, que ce soit dans un contexte d'épuration pour
défendre d'autres hommes accusés de
1 Assemblée Consultative Provisoire, «
Feuilleton n°127 : Ordre du jour du Mardi 15 mai 1945 ».
2 Mohamed Bendjelloul, « Proposition de
résolution n°390 [Représentation des Musulmans à
l'ACP] », doc. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 85
collaboration, mais aussi pour parler au nom de ses
mandants algériens, en alertant les autorités françaises
sur l'imminence d'une insurrection au printemps 1945. A l'Assemblée
constituante, dans un contexte d'hostilité au nationalisme
algérien, il poursuivra sur cette voie en réclamant l'amnistie
pour les Algériens emprisonnés suite à la
répression de l'insurrection du 8 mai. Les échecs
répétés de ses appels ne mettent pas un terme à sa
stratégie d'opposition loyale à la colonisation, et il poursuit
sa carrière dans les institutions métropolitaines de la
IVe République à partir de 1946, espérant
peut-être que la nouvelle constitution et le renouvellement partiel de la
classe politique française seront plus favorables à son
idéal d'union franco-musulmane.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 86
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 87
Partie III - Chercher une issue au conflit colonial
dans les institutions françaises
(1946-1985)
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 88
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 89
I. Bouleversements de l'échiquier politique
algérien et installation de Bendjelloul dans la vie politique
française
Après la fin de la Deuxième Guerre
Mondiale, Bendjelloul intensifie sa stratégie d'intégration des
institutions métropolitaines. Après avoir été
membre de l'Assemblée Consultative à Alger et à Paris, il
est élu pour faire partie de la première Assemblée
Constituante. Il n'est pas membre de la deuxième Assemblée
Constituante, et après le vote de la nouvelle constitution et la
proclamation de la IVe République, Bendjelloul est élu
conseiller de la République pour le département de Constantine
entre 1946 et 1948. Il participe à la vie de ces institutions en
étant membre de différentes commissions mais
particulièrement sur les questions touchant
l'Algérie.
A - L'Assemblée Constituante (1945-1946) : fin
de non-recevoir pour les demandes de Constitution
Algérienne
Après avoir été membre de
l'Assemblée Consultative d'Alger puis de celle de Paris, Bendjelloul est
élu à la première Assemblée Nationale Constituante
de novembre 1945 à juin 1946. A partir de ce moment, son combat se
déplace du sol algérien aux institutions métropolitaines.
Cependant, il restera toujours en lien avec sa circonscription. Les rapports de
surveillance indiquent qu'il traverse régulièrement la
Méditerranée entre Paris et Alger ou Constantine1.
Dans ses mandats, il s'implique surtout sur les questions en lien avec
l'Algérie : son statut politique, les droits des musulmans, le respect
de l'Etat de droit... Par exemple, un extrait du rapport bimensuel au
gouverneur général du 30 novembre 1945 indique que le groupe
parlementaire des Elus Musulmans algériens est intervenu auprès
du Général De Gaulle le 26 novembre 1945 en vue de l'amnistie de
tous les musulmans « ayant fait l'objet de mesures administratives ou de
poursuites judiciaires » à la suite des évènements de
Sétif et Guelma. Et le rapporteur de rajouter que cette démarche
a été « commentée [...] dans un sens
très
1 Préfecture d'Alger - Police des
Renseignements Généraux, « Dossier Dr Bendjelloul »,
Alger, 1944, 91 1K 590/1, ANOM, Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 90
favorable » en milieu musulman1. Ce
rapport nous renseigne aussi sur la postérité de la FEM : elle
cesse d'exister en tant qu'organisation reconnue après la guerre, mais
ses membres restent en lien et continuent de s'allier pour faire entendre leurs
revendications.
Dans un courrier au Gouverneur Général
d'Algérie (GGA) du 10 mars 1945, Bendjelloul, aux côtés de
Lakhardi et de Benhabylès, sont considérés par le
préfet d'Alger Louis Périllier comme des « amis de la France
», changement majeur par rapport aux descriptions unanimes de Bendjelloul
comme ennemi par les notes de surveillance jusqu'ici : s'il peut se montrer
« assez violemment [revendicatif] », il « [n'ira] pas jusqu'au
séparatisme, ni même à l'autonomie », mais «
[restera] dans le cadre de la souveraineté française
»2. Selon le préfet, il est urgent que l'administration
coloniale renoue avec ces réformistes francophiles si elle veut contrer
l'engouement nationaliste se répandant dans le pays, avec Abbas comme
chef de file qu'il convient de faire « disparaî[tre] » ou en
tout cas de réduire au silence3. Parmi les signataires du
manifeste, Périllier affirme que plusieurs ont renié Abbas et le
manifeste du peuple algérien après l'annonce par De Gaulle du 12
décembre 1943. Le préfet appelle le GGA à soutenir ces
élus et fonctionnaires modérés, afin de les encourager
à ne pas céder à la pression des nationalistes qui les
appellent des traîtres, et à soutenir cette voie politique
alternative au nationalisme en Algérie.
Le contexte du début d'année 1945 est
particulièrement important pour l'Algérie : le
Général De Gaulle a accordé le droit de vote à tous
les hommes algériens de plus de 21 ans, et les élections
prochaines apparaissent comme un plébiscite, pour ou contre les partis
nationalistes, pour ou contre la souveraineté française ; le
dossier « Autour des élections cantonales et législatives -
Indignité de certains musulmans - Année 1945 » contient la
correspondance du Gouverneur Général de l'Algérie avec le
Préfet de Constantine et le Ministère de l'Intérieur au
sujet des mouvements politiques algériens. Dans un compte-rendu
d'entretien du 22 octobre 1945, l'auteur du rapport qui est sûrement le
préfet de Constantine
1 Gouvernement Général d'Algérie,
« Dossier Fédérations des Elus, surveillance : rapports de
police », 1936-1945, 81F705, ANOM, Aix-En-Provence.
2 Louis Périllier, Préfet d'Alger,
« Lettre n. 363 Cab/P sur l'action de Ferhat Abbas » F/DELTA/RES/0192
III-8, Fonds Paul Tubert, La Contemporaine, Nanterre.
3 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 91
Petitbon y décrit de manière très
méprisante un entretien avec Bendjelloul, venu se plaindre de ses
faibles résultats aux élections cantonales et
législatives. Le préfet déroule tout son compte-rendu sur
le même ton méprisant :
BENDJELLOUL voulait être
plébiscité et croyait naïvement qu'il le serait, car l'homme
est impulsif et prend ses désirs pour des réalités. [...]
le succès de BENDJELLOUL n'est pas aussi spectaculaire qu'il aurait pu
l'être. BENDJELLOUL ne peut plus se poser en président de la
Fédération des Elus à la Constituante. Tant mieux pour
nous.1
Ainsi, si le préfet d'Alger, moins familier de
Bendjelloul, pense que la domination coloniale de la France en Algérie a
besoin de s'appuyer sur les modérés, le préfet de
Constantine Petitbon ne semble pas avoir pris la mesure de l'ampleur du
mouvement nationaliste, et continue de voir Bendjelloul comme un ennemi dont
les défaites seront bénéfiques à la cause
française. Le Docteur demande que les résultats soient
modifiés en sa faveur, ce à quoi le Préfet répond
:
[Il] est impossible à un préfet de
falsifier les résultats d'une élection. Cela se pratique
peut-être en Orient, mais pas en France. 2
Cette demande de Bendjelloul semble indiquer sa
certitude que les autorités coloniales peuvent influer sur les
résultats des élections, sans que son interlocuteur ne
reconnaisse cette possibilité, ni que l'on sache d'où Bendjelloul
tire cette conviction. L'entretien se finit par un accord entre les deux hommes
: le préfet va invalider l'élection de Lakhdari, l'un des
partisans le plus anciens de Bendjelloul, afin de permettre que l'élu
suivant sur sa liste puisse siéger. Le préfet conclut : «
Nous avons gagné./. »3
Ce dossier contient plusieurs de ces analyses
biaisées et contradictoires des relations entre personnalités
politiques algériennes. Mis à part dans le rapport du
préfet d'Alger Périllier du 10
1 « Compte-Rendu de visites BENDJELLOUL-LAKHDARI
», 22 octobre 1945. In Gouvernement Général de
l'Algérie, « Dossier «Autour des élections cantonales
et législatives - Indignité de certains musulmans - Année
1945» », GGA 8CAB 169, ANOM, Aix-En-Provence.
2 Ibid., p.4.
3 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 92
mars 1945, Bendjelloul est encore souvent
considéré comme un ennemi de l'administration1. Y sont
par exemple mentionnées des « manoeuvres » de Bendjelloul
visant selon la Police des Renseignements Généraux (PRG) à
soutenir Abbas et à favoriser son élection, afin d'être
associé à son succès2.
Un élément crucial de la question
algérienne à cette époque est la discussion du statut de
l'Algérie dans la nouvelle constitution de la IVe
République. Le Journal Officiel (JO) de l'Assemblée Nationale
Constituante du 7 février 1946 indique que « Mohamed Bendjelloul et
plusieurs de ses collègues » ont déposé une
proposition de loi « tendant à établir la Constitution de
l'Algérie afin que celle-ci soit inscrite dans la Constitution de la
République française »3. Le président de
séance l'annonce à l'Assemblée, qui donne son assentiment
pour que cette proposition soit envoyée à la Commission de la
Constitution. Le texte de cette proposition de loi n'a semble-t-il pas
été publié, mais ce court passage du JO reflète
déjà certaines facettes du débat sur les nouvelles
relations de la France à son empire colonial dans l'immédiat
après-guerre. Cette proposition de loi reçoit l'assentiment sans
remous de l'assemblée : si la question de l'indépendance
algérienne est inacceptable en 1946, c'est aussi l'époque de
l'Union Française et d'un regain d'espoir de réformes du cadre
colonial pour les élites colonisées4. La proposition
de Bendjelloul, autour de laquelle il a réuni des élus,
probablement tous Algériens musulmans, esquisse la possibilité
d'une identité légale algérienne distincte de celle de la
France, mais le titre indique que cette distinction ne signifie pas
séparation ou indépendance et reste dans le cadre de « la
République Française »5. Une proposition de loi
au titre similaire sera
1 « BENDJELLOUL ne peut plus se poser en
président de la Fédération des Elus à la
Constituante. Tant mieux pour nous. ». Ibid. p1.
2 Gouvernement Général de
l'Algérie au Ministre de l'Intérieur, courrier 1949/CDP, 5
octobre 1945. In Gouvernement Général de
l'Algérie, « Dossier «Autour des élections cantonales
et législatives - Indignité de certains musulmans - Année
1945» », doc. cit.
3 Assemblée nationale Constituante, « Journal
Officiel- Séance du 7 février 1946 », p. 245.
4 Frederick Cooper, Français et Africains ?
Être citoyen au temps de la décolonisation, tr. Christian
Jeanmougin, Paris, Payot, 2014.
5 Assemblée nationale Constituante, « Journal
Officiel- Séance du 7 février 1946 », doc. cit, p.
245.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 93
à nouveau déposée par
Bendjelloul, Ourabah et Sid Cara en 1947 au Conseil de la
République1. La loi du statut de l'Algérie
elle-même est votée durant la Seconde Assemblée
Constituante, dans laquelle Bendjelloul n'est pas élu. Dans les
conversations ultérieures au sujet de l'Algérie au parlement, ce
vote du statut de l'Algérie reste évoqué comme une
occasion manquée. Ainsi, le 20 février 1948 par exemple,
Bendjelloul participe brièvement aux débats sur les
circonscriptions algériennes par une déclaration de principe : il
rappelle que le statut organique de l'Algérie a été mal
voté, que les musulmans n'ont pu faire que des déclarations de
principe, et que ce statut « n'a donné satisfaction ni aux
Français, ni aux Musulmans, car il n'a pas résolu le malaise
politique algérien »2. Il rappelle sa position
déjà exprimée à l'époque : il faut «
laisser le soin aux populations algériennes, françaises et
musulmanes, de décider elles-mêmes et entre elles de leur propre
sort et d 'établir un statut de l'Algérie
»3.
B - Implication au sein du Conseil de la République
(1946-1948)
Au début de la première
législature du Conseil de la République, Mohammed S. Bendjelloul
devient membre de la commission des affaires étrangères et de la
commission du suffrage universel, du règlement et des
pétitions4, deux commissions assez importantes et
politisées5. L'existence d'une commission du suffrage
universel, du règlement et des pétitions notamment est
liée au contexte unique de cette première législature de
la IVe République et fait entre autres écho aux
revendications de suffrage universel portée par les Elus
Algériens depuis de nombreuses années. Bendjelloul obtient
également des postes au sein du Conseil de la République. Il est
élu le 27 décembre 1946 l'un des six secrétaires du
Conseil de la République, rôle administratif important pour la
préparation des séances par exemple, ou pour la gestion
des
1 Mohammed Salah Bendjelloul, Chérif Sid Cara
et Abdelmajid Ourabah, « Annexe n° 208 : Proposition de loi tendant
à doter l'Algérie d'une constitution, présentée par
MM Bendjelloul, Sid Cara et Ourabah » in Documents
Parlementaires, Conseil de la République, Paris, 1947.
2 Conseil de la République, « Journal
Officiel du 20 Février 1948 », p. 314.
3 Ibid.
4 Conseil de la République, « Journal
Officiel du 29 Janvier 1947 - Débats Parlementaires n°4
».
5 David Roudaut, Les députés des
départements d'Algérie sous la IVe République, Paris,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013, p 69.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 94
affaires courantes de l'Assemblée. Il est
élu en cinquième position avec 182 voix1, et
d'après les noms de famille des autres secrétaires, il est le
seul colonisé à obtenir ce poste. Bendjelloul ne se contente donc
pas d'occuper son mandat parlementaire mais cherche également à
se rendre présent au sein de l'institution elle-même. Cette
implication dans l'institution ne porte apparemment pas de fruits. D'ailleurs,
en séance plénière, Bendjelloul ne prend pas souvent la
parole dans les débats, tout en restant en moyenne plus actif que ses
collègues algériens musulmans2 : cette période
est marquée par l'absentéisme et l'effacement croissant des
députés colonisés au parlement3.
Comme avant la guerre, Bendjelloul réclame
l'égalité dans la loi entre Algériens musulmans et
Français, et cherche dans son mandat parlementaire des occasions de
rappeler son objectif à ses collègues et de faire avancer cette
cause dans des lois pensées pour la France métropolitaine. Lors
du débat du 1er février 1947, on voit Bendjelloul
prendre la parole pour que les cadis et autres magistrats musulmans
d'Algérie soient ajoutés dans le texte d'une loi listant les
types de magistrats français. En demandant que les magistrats musulmans
soient compris dans cette loi portant sur le système juridique
français, Bendjelloul revendique la citoyenneté ou au moins
l'égalité des Français et des Algériens devant la
loi, et cherche à faire prendre en compte par le droit français
l'existence de ses sujets musulmans. Cette intervention de Bendjelloul ne donne
pas l'occasion à des débats ni même à d'autre
réaction que celle du garde des Sceaux qui lui fait une longue
réponse pour dire qu'en raison du statut distinct de la justice
musulmane en Algérie, il est impossible juridiquement d'accéder
à sa demande, et qu'il faut repousser sa demande à un
débat ultérieur du Parlement qui serait spécifiquement
consacré à la question du statut de la justice en Algérie.
Bendjelloul retire ses amendements4. Sans pouvoir juger de la
sincérité du ministre, on constate une fois de plus le faible
impact des démarches de Bendjelloul dans le cadre de sa stratégie
de réformisme légal.
1 Conseil de la République, « Journal
Officiel - Débats parlementaires du Vendredi 27 Décembre 1946 -
2e Séance ».
2 David Roudaut, Les députés des
départements d'Algérie sous la IVe République,
op. cit, p. 70.
3 Ibid.
4 Conseil de la République, « Journal
Officiel du 1er Février 1947 - Débats Parlementaires
n° 6 ».
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 95
Dans le cadre de son mandat au Conseil de la
République, Bendjelloul est cité comme co-auteur de quelques
propositions de loi, sans que l'on puisse déduire le rôle
précis qu'il a tenu dans la rédaction de chaque texte. L'une des
propositions tend à « doter l'Algérie d'une Constitution
»1. Ce texte nous renseigne sur l'adoption de l'idée de
constitution algérienne, déjà présente dans le
Manifeste du Peuple Algérien, par Bendjelloul et ses collaborateurs, Sid
Cara et Ourabah, lui aussi signataire du Manifeste. Dans un contexte où
plusieurs projets de statuts de l'Algérie sont déposés
devant le Parlement et où « chacun prétend résoudre
le problème algérien selon sa doctrine ou ses tendances »,
les trois députés algériens affirment que « le seul
moyen logique et démocratique de trouver une solution au problème
algérien est de consulter [les populations algériennes]
»2. L'article unique de leur proposition de loi appelle donc
à convoquer les Algériens « en un collège
électoral unique appliquant le suffrage universel à tous les
éléments ethniques du pays » pour qu'ils élisent
leurs représentants dans le but d'établir « la Constitution
algérienne ». Ce texte serait ensuite soumis au «
référendum populaire algérien » : « C'est de
cette manière seule que l'on saura ce que les algériens (sic)
veulent faire de leur pays »3.
En 1957, le juriste Ivo Rens mentionne ce projet dans
son livre L'Assemblée algérienne4,
étudiant rétrospectivement ce que la vie démocratique
algérienne aurait pu être : Bendjelloul, Sid Cara et Ourabah
relaient par les moyens légaux et institutionnels la revendication d'une
autodétermination du peuple algérien. Ils s'inspirent en outre de
la procédure adoptée pour l'établissement de la
Constitution de la IVe République en prévoyant que le
texte élaboré en moins d'un an par l'Assemblée
algérienne constituante soit soumis au peuple par
référendum5. Cette demande dans les formes constitue
sûrement une démonstration de loyalisme et de bonne volonté
: il ne s'agit pas de faire sécession mais d'obtenir de la
métropole des changements
1 M. S. Bendjelloul, C. Sid Cara et A. Ourabah, «
ANNEXE N° 208 Proposition de loi tendant à doter l'Algérie
d'une constitution, présentée par MM Bendjelloul, Sid Cara et
Ourabah », art. cit.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ivo Rens, L'Assemblée
algérienne, A. Pedone, Paris, Librairie de la Cour d'Appel et de
l'Ordre des Avocats, 1957. Il compte Sayah Abdelkader parmi les coauteurs de ce
texte, apparemment par erreur.
5 Ibid., p. 32.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 96
pour l'Algérie, en respectant le cadre de la
vie institutionnelle française. Selon Ivo Rens, leur proposition n'en
est pas moins « une conception révolutionnaire »1.
Dans l'immédiat après-guerre, l'idée d'une
fédération française était en faveur dans les
milieux politiques colonisés2, mais la demande d'une
constitution algérienne n'en est pas moins audacieuse : Rens,
écrivant en pleine guerre d'indépendance, souligne qu' « une
Constituante n'aurait pu qu'entériner une manière de
sécession », bien que l'idée de souveraineté
algérienne ne soit pas explicite dans le texte de la proposition de loi
: demander une constitution distincte de celle de la métropole
coloniale, c'est reconnaître que l'Algérie n'est pas la France.
Deux constitutions différentes pour la France et l'Algérie
entraînent de facto une différence légale entre les deux
territoires, et accordent à l'Assemblée constituante
algérienne susmentionnée une forme de souveraineté sur le
territoire algérien.
Ainsi, Bendjelloul poursuit son combat politique, mais
il n'apparaît plus comme le tribun qu'il a été dans les
années 1930, lorsqu'il était un personnage crucial du paysage
politique algérien. L'impact de Bendjelloul au Conseil de la
République a été limité en termes de succès
politiques, bien qu'il reste présent et engagé dans diverses
commissions et par des amendements et propositions de loi tout au long de son
mandat. Il semble ainsi poursuivre une stratégie légale de
présence au parlement, mais peut-être sans en faire une
arène de combat et de confrontation. Ses revendications gardent un
potentiel de réforme radicale du système colonial, mais restent
lettre morte.
1 Ibid., p. 31.
2 Frederick Cooper, Français et Africains ?
Être citoyen au temps de la
décolonisation.
tr. Christian Jeanmougin, Paris, Payot,
2014.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 97
II - À l'Assemblée Nationale (1951-1955) :
persister dans la revendication légale
Le Docteur Bendjelloul ne se représente pas aux
élections de 1948 pour le Conseil de la République, puis, en
1951, il est élu à l'Assemblée Algérienne au mois
de février. Cette institution créée par la loi du 20
septembre 1947, portant sur le statut organique de
l'Algérie1, remplace et élargit les
prérogatives des Délégations
financières2, dont Bendjelloul avait été membre
avant la guerre. Le 17 mai de la même année Bendjelloul est
élu à l'Assemblée nationale, institution clé de la
IVe République, où se concentre son action pendant ces
dernières années de sa carrière. S'il garde une
rhétorique revendicative en comparaison avec les autres élus
algériens, Bendjelloul apparaît désormais surtout comme un
modéré proche de l'administration, par contraste avec les
mouvements nationalistes.
A - L'assimilationnisme réformiste : le choix
raisonnable ?
Il est difficile de trouver des sources où la
voix de Bendjelloul se fait entendre sans passer par le filtre de la
surveillance coloniale, qui accorde plus d'importance à ses
soupçons qu'aux convictions politiques réellement
exprimées par Bendjelloul. Le Barodet, recueil des professions de foi de
tous les députés élus de 1882 à 2007, se
révèle donc une source précieuse pour accéder
à la voix politique de Bendjelloul telle qu'il la présente de
lui-même à ses électeurs3. Bendjelloul se
présente avec deux colistiers, Mostefa Benbhamed et Youcef Kessous :
même en faisant abstraction des contraintes implicites imposées
par le contexte colonial de la campagne électorale, ce texte n'est
peut-être pas non plus entièrement le reflet de
1 Assemblée Nationale, « Loi n° 47-1353
du 20 septembre 1947, portant statut organique de l'Algérie
».
2 Jacques Bouveresse, Un parlement colonial ? Les
Délégations financières algériennes 1898-1945,
Mont-Saint-Aignan, Publications de l'Université de Rouen et du Havre,
2008.
3 Mohammed Salah Bendjelloul, Mostefa Benhamed et
Youssef Dr. Kessous, « «Aux électeurs musulmans de la
deuxième circonscription de Constantine» - Déclaration de la
Liste des Républicains indépendants », in Recueil des
textes authentiques des programmes et engagements électoraux des
députés proclamés élus à la suite des
élections générales des élections
générales du 17 juin 1951, Paris, Imprimerie de la Chambre
des députés, 1951, p. 927?930.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 98
ses idées personnelles. Malgré tout,
l'étude de cette source est utile pour étudier l'expression
politique de Bendjelloul à la veille de la guerre
d'indépendance.
Cette profession de foi commence par des
références au mois du ramadan durant lequel se déroule la
campagne. Tout le premier paragraphe emploie une rhétorique religieuse
pour s'excuser de rappeler les électeurs « aux sordides
préoccupations politiques » au cours du mois de jeûne «
qui purifiera vos coeurs et élèvera vos âmes
»1. Les trois colistiers rappellent que la date des
élections leur est imposée et qu'ils auraient souhaité
qu'il en fût autrement. Et de clore cette captatio benevolentiae
: « C'est à vous de montrer que vous êtes toujours
à la hauteur des circonstances et que si pour vous le spirituel
prédomine, le temporel par contre ne vous laisse pas indifférents
». On voit que les candidats de cette liste s'adressent à des
électeurs d'ordinaires exclus ou en tout cas peu familiers du jeu
politique français. Ils s'excusent, expliquent leurs démarches,
et notamment les « raisons majeures qui les poussent à vouloir
entrer au Parlement » en plus d'avoir déjà « le grand
bonheur » de représenter leurs électeurs aux seins d'autres
assemblées.
Dans le paragraphe suivant, Bendjelloul et ses
colistiers regrettent de ne pas pouvoir présenter aux musulmans une
liste d'union, « persuadés que seul le travail dans l'union est
profitable »2. Déplorant les « intransigeances
» des autres partis et confiants du vote des Algériens de leur
circonscription, ils se présentent malgré tout. Le thème
de l'union est un mot clé du discours politique de Bendjelloul. Une
douzaine d'années plus tôt, le Congrès musulman qu'il
présidait se réunissait également en affirmant qu'un
esprit d'union était nécessaire à l'action politique
algérienne face à l'hostilité du lobby colonial. Quelques
années plus tard, le groupe des 61 est aussi un moment d'union des
Algériens encore élus dans les institutions françaises,
réunis par le sentiment d'urgence face à l'entêtement des
autorités coloniales. Dans cette profession de foi, l'union est
définie comme la primauté de l'intérêt collectif des
musulmans, par opposition aux intérêts de quelques
individus.
Après cette explication du contexte de
l'élection, la suite du texte expose le programme des candidats pour les
domaines économiques, sociaux, culturels et politiques. Le volet
économique se propose de diminuer les charges pour le contribuable en
réduisant le train de vie
1 Ibid.
2 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 99
de l'Etat, sans donner de précisions sur des
mesures concrètes. Ils promettent aussi de réclamer des
crédits pour relancer les affaires des Algériens, agriculteurs ou
commerçants. Peut-on, à défaut de la notion anachronique
de populisme, parler de clientélisme ici ? Ou bien est-ce simplement la
compréhension de la politique de ces élus qui se voient comme des
relais des besoins et des revendications de leurs mandants ?
L'appréciation, notables ou démagogues, dépend ici de
l'épistémè politique choisie.
Le volet social de leur programme, traité avec
gravité, réclame « l'application des lois sociales et de la
sécurité sociale en Algérie avec les mêmes
conditions qu'en France », notamment concernant le chômage. Le volet
culturel enfin met l'accent sur l'éducation nécessaire en
français et en arabe, afin « d'harmoniser notre double
qualité de citoyen et de musulman pour le plus grand bien du pays et des
musulmans ». On voit bien ici en quoi l'assimilationnisme des élus
algériens au cours de la période coloniale diffère de ce
qui est entendu aujourd'hui par assimilation en France : pas question ici
d'effacer les particularités culturelles et religieuses des
Algériens colonisés, mais au contraire de traiter leur culture
avec le même respect des libertés que celle des nationaux
français de métropole.
Les trois candidats modérés
présentent implicitement leur stratégie politique en situation
coloniale : par leur radicalité, les nationalistes n'ont rien
apporté et attirent sur eux la répression. Avec des
revendications moins frontales, les modérés se présentent
comme plus raisonnables et donc susceptibles d'obtenir des résultats. La
liste de Bendjelloul se décrit comme réaliste à deux
reprises dans l'exposition de son programme. Ils présentent leur
stratégie d'opposition légale : ils feront « de [leur] mieux
pour faire améliorer certains textes » régissant les
Algériens musulmans, mais « en réalistes » ils
s'emploieront surtout à tirer le maximum d'avantages des textes tels
qu'ils existent déjà, conscients de la difficulté pour un
politicien colonisé de modifier la loi de l'Etat colonial, même
lorsqu'il est élu dans les institutions métropolitaines. Le texte
ne laisse pas pour autant sous-entendre que les élus partent battus dans
la bataille parlementaire pour les droits des Algériens, et la suite
montre qu'ils comptent avoir une action revendicative selon leurs convictions
assimilationnistes :
La Constitution nous reconnaît la
qualité de citoyens et c'est en partant de ce principe que nous
chercherons à être traités comme tels. Combattre les
illégalités, faire cesser les abus, revendiquer notre place
partout, arriver à participer au gouvernement du pays par notre
présence partout, voilà les réalisations qui
ne
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 100
manqueront pas d'être heureuses dans votre
marche progressive vers l'égalité pure et
simple1.
Ce texte est une sorte de manifeste de
l'assimilationnisme comme idéal politique. L'égalité et la
citoyenneté promises par les textes de loi sont à
conquérir par le colonisé, qui se base sur ces textes de loi et
sur les moyens institutionnels à sa disposition pour les
revendiquer.
Si on compare cette profession de foi avec les trois
autres listes élues pour les autres circonscriptions du
département de Constantine, on remarque que la liste de Bendjelloul
publie un texte plus structuré et deux fois plus long que les autres. Si
tous les candidats assurent les électeurs d'être «
profondément conscient[s] de vos intérêts et de vos devoirs
»2 et d'avoir pour seule ambition de les servir, la liste de
Bendjelloul est la seule à recourir à une rhétorique
religieuse et à s'adresser aux électeurs en faisant
référence à leur contexte de manière à ce
qu'ils se sentent concernés. Les autres élus ne font
référence ni au contexte politique de leur élection, ni
aux autres partis, ni à de précédents mandats... Ils
passent sous silence l'existence de partis plus radicaux, se plaçant en
décalage avec la réalité de la montée du
nationalisme parmi leurs électeurs. Par exemple, la liste de Benaly
Chérif présente une variation plus universaliste de
l'assimilationnisme. Ils promettent d'avoir pour unique but de servir « la
cause de l'Algérie et de tous ses habitants que le destin a
solidairement unis »3. Pas de rhétorique proprement
musulmane ici, contrairement à la liste de Bendjelloul qui assume de
s'adresser aux électeurs du second collège, composé
uniquement d'Algériens musulmans. Chez Benaly Chérif, les
Européens semblent inclus dans la communauté algérienne
que les députés s'engagent à servir. Le fond
assimilationniste transparaît malgré tout dans les mesures
proposées, qui peuvent se résumer à la volonté
d'élever le niveau de vie des Algériens au niveau de celui des
Français.
1 Ibid.
2 Ibid.
3 Chambre des Députés, « Programmes
électoraux des élus du deuxième collège du
département de Constantine », Recueil des textes authentiques
des programmes et engagements électoraux des députés
proclamés élus à la suite des élections
générales des élections générales du 17 juin
1951, 1952.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 101
Particularité de la profession de foi de ce
candidat, la clôture du discours par les exclamations « Vive
l'Algérie ! Vive la France ! »1.
Pour conclure, l'argumentaire de la liste de
Bendjelloul ne capitalise pas sur la personne de l'ancien leader, rompant avec
la forte personnification de la communication de la FEM dans les années
1930 : son nom n'est jamais mentionné et c'est toujours au pluriel que
le document s'adresse au lecteur. C'est seulement dans les deux
dernières phrases qu'il est fait mention du « passé »
des trois candidats, et nul doute qu'ici c'est surtout du passé de
Bendjelloul dont il est question, mais sans que le texte ne l'évoque
explicitement. En guise de signature, les noms des trois hommes sont
écrits sobrement, sans autre mention, contrairement aux professions de
foi des autres élus du département, qui signent en indiquant
leurs mandats précédents et leurs titres : est-ce un signe que sa
popularité a baissé dans sa circonscription ? Ou bien est-ce le
résultat de négociations avec les deux colistiers, ou même
le reflet de cette volonté politique d'union de la classe politique
musulmane qui les empêche d'ériger Bendjelloul en leader comme
c'était le cas lors des campagnes électorales dans les
années 1930 ?
Dans leur profession de foi de 1951, Bendjelloul et
ses colistiers expliquent leur absence de la précédente
législature par leur volonté de « laiss[er] la place
à d'autres pour leur donner la possibilité de réaliser
leur programme », et leur retour pour les élections de 1951 par la
déception des espoirs que ces partis avaient suscité2.
Bendjelloul se positionne ainsi au-dessus du jeu politique, maîtrisant
ses rouages et les expliquant aux électeurs. Quelle part de vrai y
a-t-il dans cette affirmation ? Y avait-il réellement eu des
négociations avec l'Union Démocratique du Manifeste
Algérien (UDMA) par exemple pour que Bendjelloul ne se présente
pas et leur laisse leur chance ? Cela semble peu probable : l'engouement
populaire massif pour les partis nationalistes depuis la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, la lame de fond électorale en leur faveur aux
premières élections de la IVe République,
auraient assuré l'élection des nationalistes sans l'aide des
modérés, avant que l'Etat colonial n'intervienne pour truquer les
votes en faveur de ces derniers. Dès les premières années
de la IVe République, le fait que les élections en
Algérie soient truquées est un fait établi, et
publiquement dénoncé au moins par les députés
communistes. Au cours des débats autour de la modification
des
1 Ibid., p. 930.
2 M. S. Bendjelloul, M. Benhamed et Y. Dr. Kessous,
« Barodet », doc. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 102
circonscriptions algériennes le 20
février 1948, le conseiller de la République Marcel Lemoine
s'élève contre des fraudes électorales et un
découpage artificiel des circonscriptions en Algérie :
déséquilibrer la représentation démocratique
empêche l'élection d'une « gamme comportant des
représentants de toutes les tendances, pouvant donner des garanties de
calme et d'harmonie dans un pays où deux populations vivent et veulent
vivre côte à côte », et pousse à la formation de
« deux blocs qui se heurtent et se dressent violemment l'un contre
l'autre, presque sans trait d'union, avec tous les graves dangers qui en
résultent »1.
Pour conclure, la liste de Bendjelloul se montre
convaincue de la plus grande efficacité de la stratégie
légale et réformiste, notant les faibles résultats des
mandats des députés sortants. Cette stratégie discursive
peut paraître malhonnête au regard du contexte d'intensification
des diverses formes de répression de la politique algérienne, et
particulièrement envers les partis nationalistes. De plus, il ne semble
pas que les précédents mandats des candidats de cette liste aient
été plus fructueux. Ici se pose encore la question des raisons de
la persévérance du combat assimilationniste légal de
Bendjelloul : après vingt ans passés à combattre
l'oppression coloniale en tentant d'intégrer de nombreuses institutions
françaises, le Docteur Bendjelloul n'a pas connu beaucoup de
succès. Pourtant, il affirme continuer à croire en l'obtention de
réformes en vue de l'égalité des Algériens avec les
Français. Les sources dont nous disposons ne nous donnent pas d'indices
permettant de mettre en doute cette foi en la stratégie d'opposition
légale qu'il professe ici devant ses électeurs.
B - Être élu algérien dans un contexte
de guerre de décolonisation
Le 17 juin 1951, Bendjelloul et ses deux colistiers
sont élus avec 74,5 % des voix exprimées, occupant donc les trois
sièges à pourvoir pour le département de Constantine
à l'Assemblée Nationale2. Il s'investit dans
différentes commissions : justice et législation jusqu'en 1953,
puis commission de l'intérieur et commission des pensions jusqu'en
19553.
1Conseil de la
République, « Journal Officiel du 20 Février 1948 »,
doc. cit, p. 315.
2 Mohamed, Salah Bendjelloul - Base de
données des députés français depuis 1789 -
Assemblée nationale,
https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/615,
consulté le 7 mai 2024.
3 Assemblée Nationale, « Feuilletons
parlementaires du 5 juillet au 6 décembre 1951 - Tome Premier
».
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 103
Comme au Conseil de la République, il s'emploie
à ce que l'Algérie soit prise en compte dans les textes
votés pour la métropole, proposant par exemple une loi «
tendant à étendre à l'Algérie les dispositions
prises en métropole en faveur de l'enseignement privé », qui
ne sera pas adoptée1.
La fin de son mandat est marquée par le
déclenchement de la guerre d'indépendance, et l'Assemblée
devient une arène où s'opposent des visions
irréconciliables sur la politique à suivre, entrainant des
changements de gouvernement à répétition. A
l'été 1954 déjà, Bendjelloul aurait pris la parole
pour « une mise en garde solennelle » du gouvernement, « au nom
de l'Islam » : la situation en Algérie est critique, le prestige de
la France est « tombé à zéro auprès des
populations musulmanes »2. Après la Toussaint rouge et
la déclaration de guerre du FLN contre la France, Bendjelloul multiplie
les interpellations au gouvernement et à ses collègues, prend la
parole pour souligner la gravité de la situation dans les
départements algériens. Plusieurs autres députés
prennent conscience de la gravité d'une situation que Bendjelloul
exposait déjà dix ans auparavant. Le conflit s'enlise, la loi
instaurant l'état d'urgence est votée dans la nuit du 31 mars
1955 après des débats houleux, au cours desquels Bendjelloul a
fait partie des opposants à cette mesure. Cette loi implique que les
élections ne soient pas tenues en Algérie tant que l'état
d'urgence n'est pas levé, les Algériens ne sont donc plus
représentés à l'Assemblée après la fin de
cette deuxième législature en 1956.
Lors des débats du 4 février 1955,
Bendjelloul affirme que la France ne peut désormais plus se contenter de
répression des insurgés ou même de réformes
progressives, et appelle encore de ses voeux une assimilation totale de
l'Algérie à la France :
Il n'y a pas d'autre terme à
l'évolution de l'Algérie que l'autonomie (...) ou l'assimilation
totale (...). Nous sommes, nous, partisans des réformes qui conduiront
à l'assimilation de l'Algérie et de la
métropole.3
1 Mohamed, Salah Bendjelloul - Base de
données des députés français depuis 1789 -
Assemblée nationale,
https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/615,
art. cit.
2 Assemblée Nationale, « Journal Officiel du
10 août 1954 - Débats Parlementaires ».
3 Assemblée Nationale, « Journal Officiel
du 4.2.55 - 2e séance ». Cité d'après Mohamed,
Salah Bendjelloul - Base de données des députés
français depuis 1789 - Assemblée nationale,
https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/615,
art. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 104
En ce début de guerre d'indépendance,
Bendjelloul n'a pas encore renoncé à l'assimilation et au
réformisme. Il sait la gravité et la profondeur de la crise. Il
sait que les chances de réussite d'une politique d'intégration de
l'Algérie à la métropole coloniale ont disparu depuis
longtemps aux yeux des nationalistes algériens, et que les colons
français n'ont pas témoigné de changement d'état
d'esprit. De la part d'un homme qui connaît bien le contexte
algérien, continuer de croire à l'assimilation ne relève
plus du calcul politique rationnel mais de la conviction intime ou de la
croyance. Cette conviction disparaît rapidement dans les mois de guerre
qui suivent cette déclaration, et à partir de l'été
1955, Bendjelloul rejette officiellement la politique d'intégration,
après trente ans de persistance dans le combat assimilationniste. Les
contemporains de Bendjelloul perçoivent la profondeur de ce changement
chez celui qui s'était « jusqu'ici signalé au Palais
Bourbon, par son extrême francophilie »1. Si
désormais Bendjelloul abandonne le volet assimilationniste de son combat
politique, il ne se retire pas pour autant et poursuit son action revendicative
légale au sein du Groupe des 61.
1 J.F. Dupeyron, « Les semaines algériennes
succèdent aux semaines marocaines », Sud Ouest, 26
septembre 1955.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 105
III - La motion des 61 : dernier effort des
réformistes (1955 - 1962)
Après le début de la guerre
d'indépendance en novembre 1954, Bendjelloul occupe encore son mandat
pendant un an, jusqu'au vote de l'état d'urgence en Algérie en
1955, en conséquence duquel les élections ne sont plus tenues sur
le sol algérien. Dans ce contexte, il est l'artisan majeur d'une
déclaration commune de soixante-et-un élus algériens de
différentes institutions françaises, dite « Motion des 61
»1. Publiée le 20 août 1955, cette motion
reconnaît que l'idée nationaliste est désormais majoritaire
dans la population algérienne et que leurs représentants
élus se doivent de relayer cette orientation.
Les signataires de la motion représentent
différentes tendances politiques. On y retrouve notamment Ferhat
Abbas2, leader de l'UDMA depuis la fin de la guerre, ce qui montre
que la rupture idéologique ou personnelle entre lui et Bendjelloul
n'était pas totale, comme le croient les services de renseignements
depuis le milieu des années 1940. Cette diversité de signataires
s'inscrit en continuité de la volonté de Bendjelloul d'être
l'interlocuteur de l'Etat français au nom d'une Algérie unie dans
ses revendications. Son aspiration au leadership lui impose d'être
consensuel. Dans le cas de la motion des 61, cette union réussit
à attirer l'attention voire à inquiéter les
autorités françaises, qui multiplient les notes de surveillance
au sujet des différents signataires3. Cet acte perçu
comme une forme de rébellion nationaliste au sein même des
institutions coloniales provoque une crise politique.
L'appréciation de l'importance de Bendjelloul
au sein du Groupe des 61 varie selon les documents de ce dossier4.
Ainsi, dans une note du 12 avril 1956, le Chef de la PRG d'Alger résume
les différentes tendances au sein des 61 en citant les principaux chefs
de file de chacune,
1 Phillip C. Naylor, « Bendjelloul, Mohammed
Saleh (1893-1985) », in Historical Dictionary of Algeria, Lanham,
MD, United States, Rowman & Littlefield Unlimited Model, 2015, p.
119.
2 Gouvernement Général de
l'Algérie, « Liste des signataires de la motion Bendjelloul (Motion
hostile à l'intégration) », 1955, GGA 11CAB 78, ANOM,
Aix-En-Provence.
3 Gouvernement Général de
l'Algérie, « Dossier Assemblée Algérienne - session
du 27.9.55- réformes-intégration », 27 septembre 1955, GGA
11CAB 78, ANOM, Aix-En-Provence.
4 Gouvernement Général de
l'Algérie, « Dossier Comité de Coordination et d'action des
Elus Musulmans dit «Groupe des 61» », 1955 -1957, GGA 12CAB 205,
ANOM, Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 106
et Bendjelloul n'apparaît pas1. Cela
peut être simplement le signe que Bendjelloul est déjà
démissionnaire et ne participe donc pas à ces questionnements
entre élus siégeant encore, mais cela nous invite à voir
que le groupe des 61 n'est pas un groupe structuré avec des leaders
identifiés et une ligne claire, mais désigne plutôt un
ensemble de personnalités élues au déclenchement de la
guerre d'indépendance algérienne et s'accordant pour publier des
textes revendicatifs. Deux ans plus tard, le « Groupe des 61 » semble
toujours actif, et le chef de la PRG propose une analyse de leurs motivations 2
: les bourgeois musulmans qui étaient en politique pendant la
colonisation ne veulent pas d'une victoire totale du FLN mais cherchent
à conserver leur statut au moyen d'une accession à
l'indépendance « en accord avec la France », « à
échéance plus ou moins lointaine ». Cette vision du notable
opportuniste agissant par crainte pour son influence est souvent reprise dans
l'historiographie française et algérienne. Cela contredit ce que
ces hommes présentent d'eux-mêmes dans les textes qu'ils publient,
et, bien qu'il ne faille pas accepter sans analyse leur discours ou nier la
diversité de leurs motivations, ce serait une erreur également
d'en faire totalement abstraction et de prendre pour argent comptant les
commentaires hostiles de l'administration coloniale.
A - Une pluralité de leaders et une unité
relative
Les archives administratives disponibles
révèlent que la question de « l'interlocuteur valable »
est cruciale durant cette période de crise. Les différentes
personnalités ou tendances s'accusent de vouloir « jouer à
l'interlocuteur valable », seul capable de parler au nom du peuple
algérien, selon les mots du Gouverneur Général Jacques
Soustelle3. Le dossier de surveillance « Dossier Comité
de Coordination et d'action des Elus Musulmans dit «Groupe
1 « Note de renseignements du 12.4.56 : A/S
activité du groupe des "61" ». In Ibid., p.
41.
2 Le Commissaire Divisionnaire - Chef de la PRG Jean
Fachot, « A/S activité du Docteur BENDJELLOUL Mohamed [Au sujet
d'un voyage de Bendjelloul en France] », Note de Renseignement,
Constantine, Police des Renseignements Généraux, 16 avril 1958,
91 4I 170, ANOM, Aix-En-Provence.
3 Voir par exemple la note de renseignements du 3
janvier 1956 « A/S du Comité de Coordination et d'Action des Elus
Musulmans dit groupe des "61" », In Gouvernement Général de
l'Algérie, « Dossier "Groupe des 61" », doc. cit, p.
13.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 107
des 61» » (1955-1957)1
témoigne des luttes entre courants algériens et en leur sein pour
définir qui représente légitimement la volonté du
peuple algérien, et qui est l'interlocuteur de l'Etat
français.
Un sujet majeur de désaccord au sein du groupe
des 61 est la question de la démission comme stratégie de
revendication politique. D'une part, certains refusent de démissionner
et d'abandonner les derniers lieux dédiés au dialogue avec la
France, tandis que d'autres prônent une démission collective en
signe de protestation. Parmi ces derniers se trouve Bendjelloul, qui avait
déjà lancé un mouvement de démission collective en
1935, mais aussi Abbas et Abd-el-Kader Cadi. Ce dernier avait été
élu aux législatives de 1951 dans la première
circonscription de Constantine sans même avoir publié de programme
électoral, indice fort que ce député aurait
été au bénéfice de truquages des élections
par l'administration coloniale2. Sa présence dans cette liste
des membres du groupe des 61 partisans de la démission collective nous
indique que des hommes élus avec le soutien des autorités
françaises peuvent quatre ans plus tard s'engager activement dans ce
mouvement revendiquant l'autonomie algérienne. De la même
manière, il est important de noter que leurs adversaires, les opposants
aux démissions, ne sont pas pour autant opposants au nationalisme ou
satisfaits de la politique française : dans une motion opposée
aux démissions3, ils utilisent l'expression « poste de
combat » pour parler de leurs mandats électifs, et enjoignent leurs
collègues à y rester coûte que coûte. Ils
réclament une « politique de respect de la personnalité
algérienne et d'autonomie dans l'interdépendance » et
dénoncent la répression que subissent les populations musulmanes.
Ils dénoncent également la politique « dite
d'intégration » qu'ils considèrent comme une « duperie
»4. Ainsi, pour les différents membres du Groupe des 61,
quelle que soit leur tendance, le fait que l'Algérie doive devenir
indépendante semble être acté et inéluctable. Ils se
différencient cependant des militants nationalistes en ce qu'ils
prévoient d'obtenir cette autonomie par des moyens légaux.
Ils
1 Gouvernement Général de l'Algérie,
« Dossier «Groupe des 61» », doc. cit.
2 Chambre des Députés, « Programmes
électoraux des élus du deuxième collège du
département de Constantine », art. cit.
3 « Motion à la suite de la réunion
du groupe des «61» tenue ce 23 décembre 1955 ». In
Gouvernement Général de l'Algérie, « Dossier
«Groupe des 61» », doc. cit.
4 « Motion à la suite de la réunion du
groupe des «61» tenue ce 23 décembre 1955 », doc.
cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 108
semblent ne pas avoir perdu tout espoir de dialogue
avec à France. L'accent mis par la métropole coloniale sur le
combat contre le FLN empêche le dialogue avec les éléments
nationalistes pacifiques, qui emploient les moyens légaux de
contestation pour revendiquer l'autonomie de l'Algérie.
Une semaine après la publication de la motion
du 23 décembre 1955 exprimant la position des opposants à la
stratégie démissionnaire, une motion est votée par une
large majorité du Groupe des 61, voire à l'unanimité selon
le chef des RG du district d'Alger1. Le texte se présente
comme une réaction à une motion signée par
quatre-vingt-deux maires algériens, qui les accusent d'instrumentaliser
la crise dans leur intérêt politique. En réponse à
cette attaque des colons européens, les signataires réaffirment
vigoureusement la nécessité de reconnaître « le
principe d'une nationalité algérienne » et « la
nécessité de convier au dialogue [...] les représentants
qualifiés des populations musulmanes de toutes tendances, ce qui exclut
tout pourparler avec les édiles municipaux d'Algérie
»2. Ils réclament pour cela la libération de tous
les internés politiques. Au moment où cette motion est
rédigée, la France n'a pas de gouvernement auquel s'adresser du
fait de l'intense instabilité politique de cette fin de IVe
République. Les signataires de la motion donnent un mois au futur
gouvernement pour « promouvoir une politique conforme aux aspirations
légitimes du peuple algérien »3. Dans le cas
contraire, ils démissionneront collectivement. En fait, la
majorité des signataires s'abstiendra de démissionner. Le
rassemblement des tendances opposées du Groupe des 61 pour cette motion
indique la difficulté pour les élus du second collège de
se faire entendre par le gouvernement, et la nécessité de faire
des compromis et de former des délégations et des motions
communes pour tenter de maximiser leurs chances d'être entendus. Leurs
nombreuses tentatives entre 1955 et 1958 resteront lettre morte.
1 Gouvernement Général de l'Algérie,
« Dossier «Groupe des 61» », doc. cit.
2 Ibid.
3 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 109
B - Les craintes des autorités coloniales
L'intense lutte autour de la parole légitime et
de la représentation de la volonté du peuple a lieu dans un
contexte d'instabilité politique chronique en métropole et d'un
manque de capacité de décision. Ainsi, ces sources indiquent
aussi une crise de la gouvernance du côté des Français :
les notes sont essentiellement descriptives, les informations sont
envoyées aux supérieurs hiérarchiques sans qu'on ne voie
formulées des indications claires sur la conduite à tenir ou sur
la réponse à apporter aux revendications des élus
algériens. Ce dossier révèle en outre la crainte de la
France que les élus soient en lien avec le FLN1. Plusieurs
notes de surveillances reproduisent les témoignages d'indicateurs de
renseignement affirmant que tel ou tel membre du Groupe des 61 s'apprête
à rejoindre le FLN au Caire pour s'accorder, ou qu'un membre du FLN a
pris contact avec les 61. Bendjelloul apparaît plusieurs fois dans ces
rumeurs, peut-être en raison de ses liens avec Ferhat Abbas, qui se
trouve au Caire, peut-être aussi en raison de sa réputation
d'ancien leader contestataire, voire d'ennemi de la France. Le 25 avril, soit
vingt-deux jours plus tard, un autre renseignement indique que le FLN a pris
contact avec les 61 et que « Fares, Ould Aoudia et Mesbah [trois leaders
du mouvement] ont aussitôt été désignés
» pour rejoindre le FLN au Caire, et aucune mention de Bendjelloul n'est
faite. Ces informations contradictoires montrent le peu de crédit qu'il
faut accorder aux rumeurs transmises dans ces notes de renseignement. En outre,
d'autres notes de renseignements font état de menaces envers les
élus algériens ou de distanciation explicite du FLN, qui affirme
ne pas avoir besoin de la solution légale proposée par les 61. On
sait par ailleurs que le FLN a été fondé justement par des
anciens partisans de Messali Hadj, lassés par les échecs
répétés du réformisme. Ainsi, sans que l'on puisse
en être certain, il semble tout de même peu probable que des liens
significatifs aient été établis. En revanche, il est vrai
que Ferhat Abbas a signé en 1955 la première motion du Groupe des
61, indiquant que celui qui deviendra en septembre 1958 le président du
gouvernement provisoire de la République Algérienne était
en lien avec Bendjelloul et les élus. On peut imaginer que ces liens
éventuels aient perduré pendant la guerre, mais les indices
manquent. N'ayant à disposition que les sources de l'administration sur
cette
1 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 110
question, nous sommes forcés de partager son
incertitude sur les rapports entre les nationalistes modérés et
le FLN1.
Quoi qu'il en soit, ces sources suggèrent que
la politique algérienne n'est pas aussi polarisée et
cloisonnée qu'une lecture a posteriori le laisse à penser : des
élus modérés rentrent en contact avec des élus
moins modérés, on cherche des alliances, parfois des menaces sont
adressées par le FLN aux modérés, les élus
circulent entre Alger et Paris, se rendent parfois au Caire ou à
Genève, s'y rencontrent, ... Le fait que la PRG prenne au sérieux
ces rumeurs montre que Bendjelloul était encore perçu par
l'administration comme le leader des modérés et comme un danger
potentiel, se situant vers le milieu du spectre allant des loyalistes aux
insurgés2.
L'action de Bendjelloul au sein du Groupe des 61
pourrait apparaître comme un revirement final après une
carrière de loyaliste. En prenant en compte les revendications contenues
dans les diverses motions produites par le groupe, on peut pourtant contredire
cette appellation de loyaliste à l'égard de Bendjelloul.
Après une longue carrière à ne voir l'avenir de
l'Algérie que sous la souveraineté française, il se montre
prêt à reconnaître la volonté de la population, et
à relayer cette réalité aux autorités coloniales.
Le terme d'opposition loyale lui convient mieux : il poursuit un idéal
d'Algérie développée selon des critères
français et défend en cela une forme d'assimilation, plus
économique et sociale que culturelle. Il utilise pour cela les outils
que la législation française et ses institutions mettent à
sa disposition, n'hésitant pas à braver l'autorité tout en
restant dans le cadre de la légalité : il ne semble donc pas que
son assimilationnisme découle d'une volonté de plaire à
l'Administration coloniale. Lorsqu'un gouvernement s'éloigne de son
idéal pour l'Algérie ou que la violence de la guerre
d'indépendance semble enterrer tout espoir de voir cet idéal se
réaliser, il prend la parole, s'efforce de rassembler les figures
politiques algériennes autour de ce qu'il voit comme le bien de
l'Algérie, de la même manière qu'il justifiait sa
collaboration avec les Français par le bien de
l'Algérie.
1 Parmi les nombreuses notes de renseignements
craignant des liens entre le FLN et les 61, voir « Note de renseignements
du 25.4.56 : A/S activité du groupe des "61" » In
Ibid.
2 Note de renseignements du 3.4.56, Alger, PRG N°
3806. Réponse à la note du 25 mai par le chef PRG au directeur de
la sûreté nationale en Algérie, du 29.6.56 : A/S du groupe
des «61», confirmant que Bendjelloul avait été
chargé par le Groupe des 61 de prendre contact avec les leaders des
Mouvements Nationalistes Algériens ». In Gouvernement
Général de l'Algérie, « Dossier «Groupe des
61» », doc. cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 111
C - Bendjelloul, défenseur des Algériens
même pendant la guerre
Selon les différents rapports des RG, la motion
des 61 était un véritable projet politique pour Bendjelloul. Il
aurait voyagé pour mobiliser ses membres et aurait voulu prendre le
leadership des 61 pour en faire un mouvement là où d'autres
signataires s'opposaient à en faire un parti unifié au nom duquel
un représentant pourrait parler1. Un rapport
réalisé par la PRG du Département de Constantine en
août 1958 résume en une page ce que l'administration coloniale
sait de sa carrière politique2. Ce document est partiel,
voire volontairement partial : la rubrique « Attitude politique
passée » ne contient que l'expression « Opportuniste » :
le seul dénominateur commun des actions de Bendjelloul aurait
été son intérêt personnel. Au sujet de l'engagement
de Bendjelloul dans la motion des 61, l'auteur emploie également le mot
« opportuniste ». L'une des thèses de ce mémoire est
qu'au-delà de la quête de l'intérêt personnel, ce
sont les convictions politiques de Bendjelloul qui guident son action : il
croit en la France, déplore les oppressions du système colonial
en Algérie et veut obtenir des réformes démocratiques par
des moyens légaux.
L'auteur de ce rapport de 1958 indique qu'en plus de
la motion, Bendjelloul s'efforce de centraliser les plaintes de «
"victimes de la répression" » (guillemets dans le texte original)
et considère cette action comme un « soutient (sic) discret
à la Rébellion » visant à « discréditer
les Forces de l'Ordre ». Son travail de centralisation des plaintes de la
population est vu comme séditieux et intéressé, et n'est
pas reconnu comme la poursuite de la stratégie d'opposition loyale qui
caractérise Bendjelloul depuis le début de sa
carrière3. Le commissaire Maurin ne voit dans les populations
colonisées que des ennemis et non des citoyens contrairement à
Bendjelloul, leur élu, qui les représente et les défend
face au gouvernement français. Cette
1 Le Chef de Service de la Sûreté
Nationale chargé de la Surveillance du Territoire en Algérie et
au Sahara à Monsieur le Général d'Armée, «
Renseignements sur le Docteur Bendjelloul Mohamed, ancien député
[activités assez suspectes] », Rapport de surveillance, n.d.,
été 1957, 91 1K 590, ANOM, Aix-En-Provence.
2 R. Maurin, Commissaire Principal Adjoint des
Renseignements Généraux du District, « Notice de
Renseignements sur Bendjelloul » (Constantine : Police des Renseignements
Généraux du Département de Constantine, 12 août
1958), 91 4I 170, ANOM, Aix-En-Provence.
3 Le Chef de Service de la Sûreté
Nationale chargé de la Surveillance du Territoire en Algérie et
au Sahara, « Renseignements sur le Docteur Bendjelloul Mohamed, ancien
député - activités assez suspectes », doc.
cit.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 112
action de centralisation et de relais des plaintes des
populations par Bendjelloul contient un discours politique : ce geste professe
la volonté de Bendjelloul de voir l'Algérie reconnue comme la
France. Bendjelloul relaie les plaintes des Algériens auprès de
leur gouvernement, le tenant ainsi pour responsable de ses actes devant ses
ressortissants, comme il l'est devant les citoyens français de la rive
nord de la Méditerranée. Son comportement contraste d'autant plus
avec le FLN, qui, lui, réagit aux manquements de l'Etat français
en le remplaçant, et met en place des relations proto-étatiques
avec les Algériens au fur et à mesure de la
guerre1.
1 Malika Rahal et Benjamin Thomas White, « UNHCR
and the Algerian War of Independence: Postcolonial Sovereignty and the
Globalization of the International Refugee Regime, 1954-63 », Journal
of Global History 17, no 2 (juillet 2022): 331?52.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 113
IV - La vie en métropole après la fin de la
représentation politique des Algériens
Après 1956, le seul titre employé par
les rapports de police au sujet de Bendjelloul est « ancien
député » ou « ex-député » : il n'a
plus occupé de poste officiel après la fin de son mandat à
l'Assemblée nationale. La fin de ses fonctions représentatives ne
signifie pas pour autant la fin de son engagement politique. Les notes de
renseignement à son sujet durant la guerre rapportent de multiples
déplacements entre Alger et Paris, des rencontres avec des
personnalités politiques françaises ou algériennes, lui
prêtent des ambitions politiques et l'accusent de vouloir tirer avantage
de la situation, en se posant comme représentant des populations dont il
continue de relayer les plaintes au Gouvernement
Français1.
A - Les rapports de Bendjelloul avec l'administration
au début de la ye République
Après les deux années d'interruption de
la vie électorale en Algérie, Bendjelloul se présente aux
élections législatives pour la première législature
de la Ve République en 1958. L'administration coloniale
évalue sa candidature et des rapports de renseignement sont
commandés à son sujet, résumant son parcours depuis les
années 19302. Dans l'un de ces documents, le Commissaire des
RG de Constantine, Charles Chabot, juge qu'il a encore un « certain
potentiel électoral » et que sa candidature pourrait être un
exemple de résistance au FLN pour certains intellectuels musulmans
« attentistes »3. Chabot décrit Bendjelloul comme
une source d'agitation politique, « nuisibl[e] à la pacification en
raison du caractère fantasque
1 Parmi les très nombreux rapports à
voir dans cette activité de recueil des plaintes une oeuvre
antifrançaise, voir Le Commissaire Divisionnaire - Chef de la PRG Jean
Fachot, « A/S activité du Docteur BENDJELLOUL Mohamed [Au sujet
d'un voyage de Bendjelloul en France] », 91 4I 170, ANOM,
Aix-En-Provence.
2 Par exemple R. Maurin, Commissaire Principal Adjoint
des Renseignements Généraux du District, « Notice de
Renseignements sur Bendjelloul », doc. cit.
3 Le Commissaire Principal Charles Chabot, «Note
des Renseignements Généraux sur le candidat Bendjelloul aux
législatives», Constantine, Service Départemental des
Renseignements Généraux de Constantine, 1958, 91 4I 170, ANOM,
Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 114
et contradictoire de sa personnalité et de son
penchant pour la démagogie »1. Ce document manifestement
hostile à Bendjelloul indique que le passage à la Ve
République n'a pas signifié la fin de l'influence de
l'administration française sur les élections en
Algérie.
En outre, le rapport de Chabot pose la question du
présent mémoire : quelle est la doctrine politique de Bendjelloul
? quel est son rapport avec la France, avec l'Algérie ? Cette source
n'est cependant pas fiable lorsqu'il s'agit de juger de l'orientation politique
de Bendjelloul. L'auteur adopte un a priori négatif systématique
lorsqu'il commente les actions de Bendjelloul : il insiste sur des faits
défavorables tels que les soupçons de collaboration pendant la
guerre, tandis que toutes ses actions de bienfaisance sociale sont lues comme
une stratégie électorale calculée dans le but de regagner
sa popularité. Comme tous les rapports de ce genre, l'auteur ne cite pas
l'origine des informations qu'il fournit, empêchant de vérifier
sur quelle base il forme de tels avis. Au sujet de la position de Bendjelloul
depuis « les évènements du 1er Novembre 1954
», l'auteur affirme que le Docteur n'a cessé « de prôner
une assimilation totale de l'Algérie à la Métropole tout
en exprimant des sentiments nettement nationalistes, voire antisémites
» 2. Ainsi, l'auteur semble employer le mot nationaliste pour
désigner toute revendication algérienne, et ne semble pas se
questionner réellement sur les opinions politiques des colonisés.
Il ne semble pas que l'on puisse s'attendre à une analyse lucide des
convictions politiques de Bendjelloul au cours de sa longue carrière,
que l'auteur rapporte pourtant ici avec précision. Cette source est-elle
donc inexploitable ? En réalité, la volonté presque
explicite de l'auteur de brosser un portrait à charge nous indique ce
qui ne peut pas être dit de Bendjelloul. Par exemple, l'auteur affirme
qu'il réclame l'intégration totale de l'Algérie à
la France. Ce n'est pas ce qui est réclamé par le groupe des 61,
qui pourrait être considéré comme son groupe politique
depuis le début de la guerre. On connaît cependant les convictions
assimilationnistes de Bendjelloul, et les biais de l'auteur de cette source
n'hésiterait pas à l'accuser de nationalisme militant s'il en
avait eu l'occasion : on peut donc considérer cette analyse des
convictions politiques de Bendjelloul comme digne d'être prise en compte.
Ce rapport confirme également ce que l'on sait des modes d'action
politique du Docteur : les RG ne peuvent offrir aucun exemple d'appel à
la vengeance ou à la sécession. Même lorsqu'on lui attribue
avoir dit que « les Français sont
1 Ibid.
2 Ibid.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 115
tous des criminels » à la suite d'un
attentat commis par un militaire, l'action à laquelle il enjoint ses
auditeurs, selon ce rapport, est de formuler des doléances qu'il
relayera politiquement et légalement1. Ici encore, le
contexte aurait facilement permis de le présenter comme nationaliste et
appelant à la violence, mais l'auteur ne parvient pas à masquer
le recours résolu de Bendjelloul à des modes d'actions politiques
légaux et non violents. Les convictions assimilationnistes et le choix
de la revendication par voie légale apparaissent ainsi comme les
caractéristiques irréfutables de la carrière de
Bendjelloul, et constituent les convictions politiques guidant son action
durant sa longue carrière.
B - L'émigration des élus algériens
vers la métropole
« Il y a des dizaines de mille de musulmans qui
ont dû quitter leurs foyers, et leurs femmes ne les ont pas suivis. Ici
en France il y en a des milliers qui vivent seuls comme moi ou le Bachagha
Ameziane et dont les épouses sont demeurées en Algérie.
»
Lettre de Bendjelloul à sa
fille2
Dans le dossier de surveillance de Bendjelloul des
archives du Gouvernement Général d'Algérie, on peut
trouver, dactylographiées par l'administration, des lettres assez
intimes portant sur la libération d'un neveu de Bendjelloul, Hamou. Bien
que le contenu de ces lettres ne soit pas politique, le courrier employé
par Bendjelloul arbore un en-tête officiel : « Assemblée
Nationale - République Française :
Liberté-Egalité-Fraternité ». Elles permettent un
regard sur la vie familiale des Algériens pendant la guerre, entre
Paris, Alger et Constantine, avec des emprisonnements, des libérations,
des négociations, des familles pour la plupart séparées.
Cette fuite vers la France des élus algériens est attestée
par l'administration dès mars 1957 au moins, par exemple dans une note
datant de mars et qui montre le déplacement des
1 Sous-Direction des Services Actifs de Police -
Service Central des Renseignements Généraux, « A/S de M.
BENDJELLOUL Mohamed Salah, ex-député de Constantine»,
Gouvernement Général d'Algérie, 1958, GGA 7G 1403, ANOM,
Aix-En-Provence.
2 Mohammed Salah Bendjelloul, « A/S Lettres de
Monsieur Bendjelloul à sa fille et à son neveu », Paris, 14
mars 1959, In Gouvernement Général D'Algérie,
« Dossier Bendjelloul », GGA 7G 1403, ANOM,
Aix-En-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 116
démarches politiques de Bendjelloul vers les
élus européens d'Algérie ou vers Paris1. Cette
même note indique qu'il est de passage à Alger pour tenter
d'obtenir, à l'aide un avocat algérien, la libération d'un
de ses proches, Abdelmajid Bentchicou, et qu'il « semble avoir perdu toute
audience auprès des élus du [deuxième] Collège
» à Alger2.
En France, après la fin de ses mandats
parlementaires, Bendjelloul continue d'être actif sur le plan politique,
notamment au sein de la communauté Nord-Africaine de Paris. La
préfecture de police de Paris lui consacre un dossier de surveillance
individuel3. Ce dossier contient plutôt des
éléments sur sa vie privée, et ne mentionne pas son
implication dans le groupe des 61 ou sa candidature aux élections
législatives de 1958, contrairement à son dossier de surveillance
des RG en Algérie datant de la même période. Dans ce
dossier parisien, on trouve entre autres une lettre au Préfet de Police,
Maurice Papon, datant du 2 juillet 1958. Dans cette lettre, il suggère
au préfet de mettre à disposition les casernes militaires
désaffectées de son département, pour le logement des
travailleurs nord-africains4. Il y demande aussi un emploi comme
secrétaire pour la fille d'un de ses amis, Fatima D. (pseudonyme). Le
dossier contient également une brève note des RG de
l'année suivante, indiquant que cette même femme est
accusée dans un procès pour tentative d'homicide volontaire
contre son amant. La note indique que lors de son interrogatoire, F.D. aurait
« accusé violemment M. Bendjelloul d'être un chef des
fellaghas » et prétendu que des parents de Bendjelloul auraient
transmis de l'argent en Belgique en soutien à des combattants
nationalistes. Cette tentative de l'accusée de détourner
l'attention de la police et de politiser son geste révèle quelque
chose du climat de tension qui règne entre Algériens
émigrés en métropole pendant la guerre. Elle indique aussi
que l'accusée avait compris ce qui intéressait les
autorités dans les affaires touchant à des Algériens,
surtout des Algériens politisés comme Bendjelloul. Et elle ne s'y
est pas trompée :
1 « Note de renseignements n° 2954 du 8.3.57
: A/S Passage à Alger du Docteur Bendjelloul ». In
Gouvernement Général de l'Algérie, « Dossier
«Groupe des 61» », doc. cit, p. 46.
2 Ibid.
3 « Dossier Bendjelloul 1958-1961 - n°106704
», 1958-1961, 354W1209, Archives de la Préfecture de Police de
Paris, Pré-Saint-Gervais.
4 Mohamed Salah Bendjelloul, « Lettre à
Monsieur l'Inspecteur Général de l'Administration, Préfet
de Police [Maurice Papon] », Moligt-les-Bains, 2 juillet 1958, 354W1209,
Archives de la Préfecture de Police de Paris,
Pré-Saint-Gervais.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 117
les RG ne peuvent s'empêcher de signaler cette
déclaration. Se peut-il que l'accusée ait été
elle-même apparentée au FLN et que cette tentative d'assassinat
ait eu des mobiles politiques ? D'autres sources indiquent que Bendjelloul
avait déjà été parmi les cibles potentielles des
nationalistes1. Aussi l'intitulé du dossier de police
judiciaire « Tentative d'homicide volontaire sur Bendjelloul » aurait
pu laisser croire à une tentative d'assassinat politique. Cependant, le
dossier de police judiciaire, consulté sur dérogation,
révèle une affaire purement privée, sans implications
politiques : l'accusée est en fait la maîtresse parisienne de
Bendjelloul, vivant avec lui à Paris avant que sa femme ne le rejoigne
en France.
Dans le dossier de surveillance de Bendjelloul de la
préfecture de police de Paris, les derniers documents datent de 1983,
deux ans avant la mort du Docteur qui a alors 90 ans. Bendjelloul s'est
installé à Paris avec sa femme, et suite aux différentes
réformes de la propriété, le couple a perdu ses revenus.
Bendjelloul écrit donc au Ministre des rapatriés pour demander
que lui soit attribuée une licence de taxi pour subvenir à ses
besoins. Cette dernière trace nous renseigne sur la fin de la vie de
Bendjelloul : il n'a pas trouvé sa place dans l'Algérie
indépendante, et continue jusqu'au bout de s'adresser au plus haut
niveau de l'Etat pour demander une amélioration de sa situation
matérielle, ici seulement la sienne. Il ne parle plus au nom d'autres,
n'a pas cherché à coaliser d'autres personnes dans son cas pour
parler en leur nom. Le dossier indique que sa demande n'a pas
abouti.
1 Voir par exemple Gouvernement Général
de l'Algérie, « [Dossier Bendjelloul - 1946] ». En 1945
déjà, le cabinet du gouverneur général indique au
ministère de l'Intérieur avoir été mis au courant
d'un projet d'assassinat de Bendjelloul par deux personnes
arrêtées, soupçonnées d'être membre du
PPA.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 118
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 119
Conclusion
Etudier le parcours politique de Bendjelloul donne
à voir ses moyens d'action variés, à travers plusieurs
régimes politiques et de nombreuses institutions. Sa trajectoire offre
un point de vue riche sur la vie politique algérienne dans le courant du
XXe siècle. Sa popularité décline
progressivement, et il ne connaît aucun succès politique
significatif, ni durant sa carrière ni après celle-ci. La
popularité de l'idée assimilationniste telle que la
conçoit Bendjelloul décline également :
l'émancipation des colonisés se fait par l'accès à
la souveraineté nationale, par la création d'une nation
algérienne indépendante sur le plan institutionnel et culturel,
et non par l'intégration égalitaire des Algériens et de
leur culture dans les institutions de la nation française. A chaque
étape de son parcours, on voit Bendjelloul vivre selon ses convictions
assimilationnistes, revendiquant son algérianité au sein des
institutions françaises et du système colonial. Avec les
évolutions de son contexte, il reformule, adapte, développe ou
réduit à l'essentiel ses revendications en faveur de la concorde
franco-musulmane, de l'intégration des Algériens musulmans dans
la nation française. Après l'indépendance, il reste vivre
en France, et nous ne disposons pas de sources en dévoilant les raisons.
Est-ce le choix d'un francophile revendiqué, admirant la qualité
de vie, les institutions, les valeurs de la métropole coloniale dans
laquelle il s'est formé comme homme politique ? Ou est-ce le destin
forcé d'un modéré menacé par le FLN et
empêché de finir ses jours sur sa terre natale ?
Cette étude n'avait pas vocation à
l'exhaustivité. Plusieurs aspects de la vie de Bendjelloul, comme les
premières années de sa carrière ou ses engagements en
dehors de l'action politique, n'ont pas été abordés. Les
sources sélectionnées ont permis de montrer que si Bendjelloul
n'est certainement pas nationaliste dans sa conception de l'Algérie et
dans son rapport à la France, c'est bien vers la fin du système
colonial que son action politique est dirigée. Pour lui, l'assimilation
signifie l'élévation des Algériens colonisés au
niveau de vie des Européens et l'octroi des mêmes droits civiques,
abolissant les discriminations sur lesquelles se basent le système
colonial. Il utilise pour cela les outils que la législation
française et ses institutions mettent à sa disposition,
n'hésitant pas pour autant à braver l'autorité : son
assimilationnisme ne découle donc pas d'une volonté de plaire
à l'autorité coloniale, et collaborer avec elle est pour cet
homme politique un moyen pragmatique d'atteindre ses objectifs.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 120
1 Voir par exemple les accusations rapportées
par le préfet d'Alger dans Préfecture de Constantine - Affaires
Indigènes, « Dossier [Assemblée Générale FEM
du 29 Avril 1934] », Constantine, 1934, 93 30 284, ANOM, Aix-en-Provence ;
et les accusations d'opportunisme dans Préfecture d'Alger - Police des
Renseignements Généraux, « Dossier Dr Bendjelloul »,
Alger, 1944-1945, 911K590/1, ANOM, Aix-en-Provence ; Le Chef de Service de la
Sûreté Nationale chargé de la Surveillance du Territoire en
Algérie et au Sahara, « Renseignements sur le Docteur
La France métropolitaine apparaît comme
l'arbitre capable de réguler les méfaits de la
société coloniale, et un des éléments les plus
récurrents de l'action de Bendjelloul est le recours au plus haut niveau
de l'Etat pour exprimer ses revendications. Ce trait caractéristique
témoigne d'une foi en l'autorité du pouvoir central
français qui serait le garant des valeurs républicaines
d'égalité et de droits humains.
Les changements répétés de
gouvernement et de régimes politiques ont fait perdurer l'espoir que les
réformes promises seraient bientôt mises en oeuvre.
Régulièrement, des évènements semblent indiquer une
évolution des mentalités françaises : l'élection du
Front populaire et le projet Blum Viollette, la nouvelle politique coloniale
annoncée par De Gaulle au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les
opportunités pour Bendjelloul de devenir un élu parisien pour
porter lui-même ses revendications au coeur de l'État colonial.
Ces espoirs, systématiquement déçus, expliquent
peut-être en partie la persévérance de Bendjelloul, sans
expliquer pourquoi plusieurs de ses collègues auparavant
assimilationnistes rejettent la politique d'intégration bien avant 1955.
Une limite inhérente à ce projet est liée à
l'individualité des résultats : les dynamiques constatées
chez Bendjelloul sont-elles généralisables à sa cohorte
politique ? Il est marquant de retrouver parmi les signataires de la motion des
61 des noms déjà présents dans les archives datant des
années 1930, comme Smail Lakhdari ou le Docteur Tamzali. Un travail de
thèse souhaitant approfondir la question du courant réformiste
algérien tirerait profit d'une approche prosopographique de ces
contemporains assimilationnistes de Bendjelloul, en plaçant ce courant
dans le contexte maghrébin, voire plus largement dans le contexte des
colonies françaises.
Cet idéal de libération de
l'Algérie par l'assimilation, idéal d'être aussi libre que
les Français de France, n'est pas seulement un idéal individuel
pour Bendjelloul. La personnalisation de sa politique dans les années
1930 puis son implication dans des affaires de trafic ou de collaboration et
ses fréquentes affirmations de loyalisme ont fait dire à certains
que c'était son intérêt personnel ou l'intérêt
de sa classe sociale qui motivait l'action de Bendjelloul1. En
étudiant ses revendications, on voit que ce sont ses électeurs
que Bendjelloul
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 121
place au coeur de son action. L'élu relaie les
plaintes concrètes des populations aux autorités
françaises : en attribuant à celles-ci la responsabilité
des conditions de vie et les droits des Algériens musulmans, il affirme
les droits de ses mandants auprès de leur gouvernement, à
égalité avec les Français. Pour cela, il reformule les
plaintes selon ses convictions assimilationnistes, mais il adapte
également son expression politique à ses interlocuteurs, pour les
convaincre que promouvoir la cause des Algériens musulmans est dans leur
intérêt. Comme la plupart des réformistes des années
1930, il reprend certaines antiennes de l'idée de mission civilisatrice.
Puis, durant la Seconde Guerre Mondiale, il souligne l'importance
stratégique pour la France de donner tort à la propagande
allemande en créant un sentiment de loyauté envers la
métropole chez les Musulmans : pour que ceux-ci acceptent de se battre
pour une France libérée et souveraine, il faut leur donner des
raisons d'imaginer leur propre liberté dans ce cadre français
à restaurer. Dans le contexte de réflexion sur les nouvelles
institutions de la IVe République et de l'Union
Française enfin, il fait partie des hommes politiques algériens
qui placent l'Algérie au coeur des débats sur le
fédéralisme, la constitution, la citoyenneté, le suffrage
universel. Ces trois exemples montrent que le dénominateur commun de son
action est le progrès du niveau de vie et des droits des
Algériens : ses emprunts aux programmes de la mission civilisatrice, de
la victoire alliée ou du fédéralisme reflètent en
réalité les intérêts de ses interlocuteurs
français, dont il reprend le langage politique pour faire progresser ses
revendications.
Pour Bendjelloul, l'assimilation des Algériens
dans la nation française est d'abord une question de droits politiques
et de niveau de vie. Les questions culturelles sont marginales dans son
discours. Il souhaite que les Algériens bénéficient comme
lui d'une éducation, mais plus pour les opportunités
économiques et politiques que cela leur apporterait ; et lorsqu'il
évoque l'Islam c'est pour insister sur l'enrichissement moral qu'est la
religion pour les Français musulmans. Bendjelloul appelle de ses voeux
l'entente franco-musulmane et le développement de l'Algérie, pas
la dissolution de la culture algérienne musulmane dans la culture
française. Cette idée est résumée dans le mantra
des Elus dans les années 1930 : la citoyenneté avec maintien du
statut personnel.
Bendjelloul Mohamed, ancien député
[activités assez suspectes] », Alger, n.d. (vers 1958), 911K590,
ANOM, Aix-en-Provence.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 122
Bendjelloul se positionne en médiateur entre
les autorités coloniales et les populations colonisées, dont il
se présente comme l'interprète. Il voit leurs
intérêts du côté de la citoyenneté
française en raison de ses convictions personnelles, mais à
partir du débarquement allié et particulièrement au sein
du Groupe des 61 son action révèle que son idéal d'une
Algérie française est malgré tout subordonné
à l'intérêt des Algériens. Dès les
années 1930, il considère comme son devoir d'avertir les
colonisateurs que des réformes sont nécessaires s'ils veulent
maintenir leur autorité sur les populations. A partir du milieu des
années 1940, ces appels deviennent plus pressants et plus ambitieux, et
Bendjelloul demande plusieurs fois au cours de ses différents mandats de
doter l'Algérie d'une constitution propre, offrant
l'autodétermination à tous les habitants de l'Algérie,
quel que soit leur statut personnel. Dans les premiers mois de la guerre
d'indépendance, il continue de se déclarer personnellement
partisan de l'intégration. Mais lorsqu'il devient indéniable
qu'un entêtement dans cette voie ne ferait qu'aggraver la
répression envers les populations, Bendjelloul renonce publiquement
à son idéal d'assimilation. Il s'efforce alors de rassembler les
figures politiques algériennes autour de l'autodétermination,
qu'il voit comme le bien de l'Algérie de la même manière
qu'il justifiait jusqu'ici sa collaboration avec les Français par le
bien de l'Algérie.
Au terme de cette étude de la carrière
du Docteur Bendjelloul, on ne peut que constater l'échec des politiciens
réformistes à régler le conflit colonial : sur toute la
période étudiée la France refuse de collaborer avec les
réformistes, et l'Algérie devient indépendante
après huit années de lutte nationaliste armée, violemment
réprimée par un Etat français en faillite.
Discréditées par les nationalistes et écartées des
négociations par la France, les élites réformistes et
parmi eux Bendjelloul ne jouent pas le rôle-clé qu'ils ont
cherché à avoir dans la résolution du conflit colonial en
Algérie. Cette situation contraste avec la résolution d'autres
conflits coloniaux ailleurs dans l'Empire français : en
Côte-d'Ivoire par exemple ou au Sénégal, ce sont les
modérés Félix Houphouët-Boigny et Léopold
Sédar Senghor qui sont favorisés dans les négociations
avec la France et qui forment l'élite politique à
l'indépendance de leurs pays respectifs1. Comment expliquer
les résultats si différents des réformistes de part et
d'autre du Sahara ? Si le statut particulier de l'Algérie et du lobby
colonial a certainement joué un rôle
1 Frederick Cooper, Français et Africains?
être citoyen au temps de la décolonisation, tr. Christian
Jeanmougin, Paris, Payot, 2014.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 123
crucial dans cette politique coloniale
différenciée, une étude comparative des idées et
des parcours de réformistes de différents espaces coloniaux
permettrait néanmoins d'enrichir la compréhension de la
complexité des expériences coloniales dans l'Empire
français. Plusieurs moments de cette étude ouvrent à une
mise en perspective impériale ou transimpériale : Bendjelloul est
comparé à Gandhi, il fonde en 1947 une association de soutien aux
Egyptiens frappés par une épidémie de choléra, il
est député au moment où l'Assemblée vote l'ordre du
jour gouvernemental sur l'Indochine et débat sur l'indépendance
de la Tunisie et du Maroc. L'étude des liens entre différents
territoires colonisés et entre différents empires est une
question de plus en plus souvent étudiée1 et qui
permet de proposer une histoire des colonies décentrée de la
métropole. Le milieu des assimilationnistes algériens offre un
angle d'approche original à la question des relations
transimpériale.
1 Voir par exemple M'hamed Oualdi, A Slave Between
Empires: A Transimperial History of North Africa, New York, NY, Columbia
University Press, 2020 ; Michael Goebel, Anti-Imperial Metropolis: Interwar
Paris and the Seeds of Third World Nationalism, Cambridge, Cambridge
University Press, 2015 ; Maureen Murphy, « Paris, capitale anticoloniale ?
», Hommes & migrations. Revue française de
référence sur les dynamiques migratoires, 1338, 2022, p.
19-25.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 124
Table des figures
Figure 1 Couverture de La Vérité sur
le Malaise Algérien de Kessous. Bone, 1935 266
Figure 2 Portrait du Docteur Bendjelloul dans le
journal El Midane du 27 juin 1937 388
Figure 3 La Une de l'Entente du 2 Novembre 1939 avant
et après censure 622
Figure 4 Reproduction de télégramme du
10 août 1942 de Bendjelloul au Maréchal Pétain
688
Index des noms propres
Abbas (Ferhat), 9-11, 30, 35, 46, 51-52,
55-64, 66, 73-75, 81-83, 90, 92, 105,
107, 109
- Amis du Manifeste, 81, 83
- UDMA, 101, 105
Benbhamed (Mostefa), 97
Cadi (Abd-el-Kader), 99
De Gaulle (Général Charles), 56, 72,
75-
76, 83, 89-90, 121
Fédération des Élus Musulmans
(FEM), 8-
9, 18, 25, 33-39, 42-50, 53, 55-60, 63-
66, 74, 79, 82-83, 90, 101, 121
Front de Libération Nationale (FLN),
13,
39, 103, 106, 108-110, 112-114, 120
Gandhi, 14, 67-70
Hadj (Messali), 10, 83, 109
-Parti du Peuple Algérien (PPA), 83
Jeunes Algériens, 28, 41, 60
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 125
- Emir Khaled, 25, 39
Kessous (Mohammed-El-Aziz), 26-27, 43,
82, 125
Kessous (Docteur Youcef), 97, 101
Lakhdari (Docteur Smaïl), 82, 91, 121
Oulémas, 48, 83
Ourabah (Abdelmajid), 93, 95
Parti Communiste, 50, 101
Paul Cuttoli, 77
Projet Viollette, 34, 46-47, 49, 51-52, 75
Rabah Zenati, 46-47
Saadane (Docteur Chérif), 30, 42, 57,
66,
73
Sid Cara (Chérif), 93, 95
Tamzali (Docteur Abdennour), 77-80, 121
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 126
Bibliographie
1) Histoire Politique et méthode
Marc ANDRE, « Généalogies
résistantes », in Une prison pour mémoire: Montluc, de
1944 à nos jours, Lyon, ENS Éditions, 2022, p.
223-287.
Camille LEFEBVRE et M'hamed OUALDI, « Remettre le
colonial à sa place. Histoires enchevêtrées des
débuts de la colonisation en Afrique de l'Ouest et au Maghreb »,
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 72e année-4, 2017, p.
937-943.
Céline MARANGE, « De l'influence politique
des acteurs coloniaux », Vingtième Siècle. Revue
d'histoire, 131-3, 2016, p. 3-16.
Gilbert MEYNIER, « L'Algérie et les
Algériens sous le système colonial. Approche historico
historiographique », Insaniyat. Revue algérienne
d'anthropologie et de sciences sociales, 65-66, 2014, p.
13-70.
Guillaume PIKETTY, « La biographie comme genre
historique? Une étude de cas. », Vingtième Siècle.
Revue d'histoire, 63, 1999, p. 119?126.
Fouad SOUFI, « Mahfoud Kaddache, 1921-2006. La
quête du pays réel, l'exigence de l'archive », Insaniyat.
Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, 37, 2007,
p. 7-15.
Pierre BOURDIEU, « L'illusion biographique »,
Actes de la recherche en sciences sociales,
62-1, 1986, p. 69?72.
2) Outils
Base de données des députés
français depuis 1789 - Site de l'Assemblée Nationale. En ligne :
https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/recherche.
Tables nominatives, Résumé de l'ensemble
des travaux parlementaire, Anciens sénateurs de la IVe
République. Site du Sénat. En ligne :
https://www.senat.fr/senateurs-4eme-republique/senatl.html.
Anne-Marie Gouriou, archiviste et Roseline Salmon,
conservateur du patrimoine, « Annexe du répertoire:
Assemblée consultative provisoire (Alger et Paris) 1944-1945. Cotes
C//15247 à C//15281 ». En ligne :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/sm/C_15247_15281_annexe_Al
ger.pdf
3) Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 127
Histoire de l'Empire français
Jacques CANTIER et Éric T. JENNINGS,
L'Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile Jacob, 2004.
Frederick COOPER, Français et Africains ?
être citoyen au temps de la décolonisation, tr. Christian
Jeanmougin, Paris, Payot, 2014.
Eric JENNINGS, Vichy sous les tropiques : Le
régime de l'Etat français, Indochine, Guadeloupe,
Martinique, Paris, Grasset, 2004.
Michael GOEBEL, Anti-Imperial Metropolis: Interwar
Paris and the Seeds of Third World Nationalism, Cambridge, Cambridge
University Press, 2015.
Maureen MURPHY, « Paris, capitale anticoloniale ?
», Hommes & migrations. Revue française de
référence sur les dynamiques migratoires, 1338, 2022, p.
19?25.
M'hamed OUALDI, Un esclave entre deux empires.
Une histoire transimpériale du Maghreb, Paris, Seuil,
2023.
David MOTADEL, « The Global Authoritarian Moment
and the Revolt against Empire », The American Historical Review,
124-3, 2019, p. 843-877.
David TODD, Un empire de velours, Paris, La
Découverte, 2022.
4) Histoire de l'Algérie
Osama ABI-MERSHED, Apostles of Modernity:
Saint-Simonians and the Civilizing Mission in Algeria, Stanford, Stanford
University Press, 2010.
Charles-Robert AGERON, « Le mouvement
«Jeune-Algérien» de 1900 à 1923 », in
Genèse de l'Algérie algérienne, Saint-Denis,
Éditions Bouchène, 2005, p. 107-130.
Charles-Robert AGERON, « Sur l'année
politique algérienne 1936 », in De « l'Algérie
française » à l'Algérie algérienne,
Saint-Denis, Éditions Bouchène, 2005, p. 387-416.
Charles-Robert AGERON, Histoire de
l'Algérie contemporaine. Tome II : De l'insurrection de 1871 au
déclenchement de la guerre de libération (1954), Paris,
Presses Universitaires de France, 1979.
Noureddine AMARA, « Être algérien en
situation impériale, fin XIXème siècle - début
XXème siècle : L'usage de la catégorie «
nationalité algérienne» par les consulats français
dans leur relation avec les Algériens fixes au Maroc et dans l'Empire
Ottoman », European Review of History, 19-1, 2012, p.
59.
Arthur ASSERAF, Electric News in Colonial
Algeria, Oxford, New York, Oxford University Press, 2019.
Arthur ASSERAF, Le désinformateur : Sur les
traces de Messaoud Djebari, un Algérien dans le monde colonial,
Paris, Fayard, 2022.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 128
Afifa BERERHI, Naget KHADDA, Christian PHELINE et
Agnès SPIQUEL (dir.), Défis démocratiques et
affirmation nationale : Algérie, 1900-1962, Algérie, Chihab
Editions, 2016.
Kamel BOUGUESSA, Aux Sources du Nationalisme
Algérien : Les pionniers du populisme révolutionnaire en
marche, Alger, Casbah, 2000.
Jacques BOUVERESSE, Un parlement colonial ? Les
Délégations financières algériennes 1898-1945,
Mont-Saint-Aignan, Publications de l'Université de Rouen et du Havre,
2008.
Benjamin Claude BROWER, « Review of A Diplomatic
Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold
War Era », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 63-5, 2008, p.
1201-1203.
Jacques CANTIER, L'Algérie sous le
régime de Vichy, Paris, Odile Jacob, 2002.
Jacques CANTIER, « Les gouverneurs Viollette et
Bordes et la politique algérienne de la France à la fin des
années vingt », Outre-Mers. Revue d'histoire, 84-314,
1997, p. 25-49.
Tayeb CHENNTOUF, L'Algérie politique: 1830-
1954, Alger, OPU, 2003.
Julia A. CLANCY-SMITH, Rebel and Saint: Muslim
Notables, Populist Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia,
1800-1904), Berkeley, University of California Press, 1994, vol.
18.
Joshua COLE, Lethal Provocation: the Constantine
Murders and the Politics of French Algeria, Ithaca London, Cornell
University Press, 2019.
Matthew CONNELLY, A Diplomatic Revolution:
Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era,
Cary, United States, Oxford University Press, Incorporated, 2002.
Mahfoud KADDACHE et Sari DJILALI, L'Algérie
dans l'histoire. V : La résistance politique 1900-1954 - bouleversements
socio-économiques., Alger, Office des publications universitaires,
1989.
Mahfoud KADDACHE, Histoire du nationalisme
algérien. Question nationale et politique algérienne,
1919-1951, Alger, Société Nationale d'Edition et de
Diffusion, 1980.
James MCDOUGALL, A History of Algeria,
Cambridge, Cambridge University Press,
2017.
László J. NAGY, « Le manifeste du
peuple algérien: document fondamental du nationalisme algérien
», Chronica, 4, 2004, p. 99?106.
Jean-Pierre PEYROULOU, Guelma, 1945. Une subversion
française dans l'Algérie coloniale, Paris, La
Découverte, 2009.
Jennifer PITTS, « Liberalism And Empire In A
Nineteenth-Century Algerian Mirror », Modern Intellectual
History, 6-2, 2009, p. 287-313.
Tramor QUEMENEUR, Ouanassa SIARI TENGOUR, et Sylvie
THENAULT, Dictionnaire de la guerre d'Algérie, Paris, Bouquins,
2023.
Malika RAHAL et Benjamin Thomas WHITE, « UNHCR and
the Algerian war of independence: postcolonial sovereignty and the
globalization of the international refugee regime, 1954-63 », Journal
of Global History, 17-2, 2022, p. 331-352.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 129
Annie REY GOLDZEIGUER, Aux origines de la guerre
d'Algérie, 1940-1945 : De Mers-el-Kébir aux massacres du
Nord-Constantinois, Paris, La Découverte, 2006.
Benjamin STORA, Le nationalisme algérien avant
1954, Paris, CNRS éd., 2010.
Benjamin STORA, Dictionnaire biographique de
militants nationalistes algériens, Paris, L'Harmattan,
1985.
5) Histoire du réformisme
algérien
Daho DJERBAL, « 3 - Elites locales et pouvoir
politique dans l'Est algérien (1930-1940) », in Omar LARDJANE,
Elites et Sociétés Algérie et Egypte, Casbah
éditions, Alger, 2007.
Julien FROMAGE, « Le docteur Bendjelloul et la
Fédération des élus musulmans », in Histoire de
l'Algérie à la période coloniale, Paris, La
Découverte, 2014, p. 398-401.
Julien FROMAGE, « Innovation politique et
mobilisation de masse en « situation coloniale» : un « printemps
algérien» des années 1930 ? L'expérience de la
Fédération des Elus Musulmans du Département de
Constantine » Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2012.
Phillip C. NAYLOR, « Bendjelloul, Mohammed Saleh
(1893-1985) », in Historical Dictionary of Algeria, Lanham, MD,
United States, Rowman & Littlefield Unlimited Model, 2015, p.
119.
Malika RAHAL, Ali Boumendjel. Une affaire
française, une histoire algérienne, Paris, La
Découverte, 2022.
Malika RAHAL, L'UDMA et les Udmistes, Alger,
Éditions Barzakh, 2017.
Malika RAHAL, « La place des réformistes dans
le mouvement national algérien », Vingtième
Siècle. Revue d'histoire, 83-3, 2004, p. 161-171.
Malika RAHAL, « Les Représentants
colonisés au Parlement français : le cas de l'Algérie,
1945- 1962 », Mémoire de Master, Bordeaux, Université de
Bordeaux 3, 1996.
David ROUDAUT, « Les députés des
départements d'Algérie sous la IVe République »,
Mémoire de Master, Paris, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 2013.
Fatiha SAFER, « ????????? ????? ????? û?
????????? ?????? ????? [Les positions de l'élite algérienne sur
la politique d'intégration de la France] », Oussour, New Ages
Magazine, 5-17, 2015, p. 333-349.
Fatiha SAFER et Ibrahim MAHDID, « ???????? ??????
??? ???? ãÇÏÞ?Ç ????? [Le journal Al-Iqdam,
organe officiel du mouvement khalédien] », Oussour, New Ages
Magazine, 6-23, 2016, p. 179-192.
Fatiha SAFER et Houari SAFSAF, « ????????? ???????
?????? ????? û? ??????? ????????? ?????????? ?????? The amalgamating
liberal elite and its positions on the issue of algerian national identity
», Oussour, New Ages Magazine, 11-2, 2021, p.
493-514.
Fatiha SAFER et Houari SAFSAF, « ?????? ???? ???????
?????? ???? û? ?????? ???? ??????? 1956 -1930 û?? ?? ????????? -
Dr. Mohamed Salah Bendjelloul and his political struggle within the integrating
elite between 1930-1956 », Maghreb Journal of Historical and Social
Studies, 13-2, 2021, p. 204-224.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 130
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 131
Guide des Sources
Sources imprimées
1) Ouvrages
Ferhat ABBAS, Le jeune Algérien (1930) :
de la colonie vers la province; (suivi de) Rapport au maréchal
Pétain (avril 1941) / Ferhat Abbas, Paris, Garnier Frères,
1981.
Ferhat ABBAS, Le Manifeste du Peuple
Algérien, Paris, Orients, 2013.
Mohammed Salah BENDJELLOUL, Mostefa BENHAMED et
Youssef Dr. KESSOUS, « Déclaration de la Liste des
Républicains indépendants », in Recueil des textes
authentiques des programmes et engagements électoraux des
députés proclamés élus à la suite des
élections générales des élections
générales du 17 juin 1951, Imprimerie de la Chambre des
députés, 1951, p. 927?930, Bibliothèque de Sciences Po -
Fonds numérisés. En ligne :
https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/ark:/46513/sc16m27g#?c=&m=&s=&cv=
Mohammed-El-Aziz KESSOUS, La Vérité
sur le Malaise Algérien - Préface du Dr Bendjelloul, Bone
(Algérie), Société anonyme de l'imprimerie rapide,
1935.
Ivo RENS, L'Assemblée
algérienne, A. Pedone., Paris, Librairie de la Cour d'Appel et de
l'Ordre des Avocats, 1957.
2) Archives du Conseil de la République et de
l'Assemblée nationale
Journaux officiels, comptes-rendus in extenso,
feuilletons, bulletins et annexes au journal des débats consultés
en version numérisée sur Gallica. (Sondage)
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 132
Sources Manuscrites
1) Archives de la Préfecture de Police de Paris,
Pré-Saint-Gervais
Dossier Bendjelloul, n°106704, 354W120,
1958-1961. Partiellement consulté sur dérogation
Dossier Bendjelloul, Police Judiciaire, JA 427, janvier
1959. Consulté sur dérogation.
2) Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine Archives
de l'Assemblée Consultative Provisoire :
- Dossier Conseil Général Afrique du
Nord, C//15260/94001/469, avril-novembre 1943. Voir notamment Dossier 490
Bendjelloul : voeu de Combat, mouvement de libération français
tendant à l'exclusion de Mohamed Bendjelloul.
- ACP - Proposition de résolutions, Dossiers
22 à 26 : Algérie, C//15248/94001.22-26,
février-août 1945.
Archives de la Haute Cour de Justice :
- Dossier Bonnafous - Première Partie de la
Procédure, Liasse IX : Liberté provisoire et documents annexes,
3W75, 1945. Voir notamment « Déposition du Docteur Bendjelloul,
délégué à l'Assemblée Consultative
Provisoire. Président de la Fédération des Elus Musulmans
d'Algérie ».
3) Archives de La Contemporaine
- Fonds Paul Tubert, F delta res 192, 1940-1962.
Tracts, notes confidentielles de la Préfecture d'Alger, rapports du
Préfet de Constantine, rapports de police, le "Manifeste du peuple
algérien", comptes-rendus de missions, coupures de presse.
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 133
4) Archives nationales d'Outre-Mer
- Archives de presse : L'Entente franco-musulmane,
El-Midane, La Voix Indigène. (Sondage)
- Archives de la Préfecture de Constantine :
Cabinet du Préfet, Centre d'Information et d'Etudes de Constantine,
Sûreté départementale de Constantine puis Service
Départemental des Renseignements Généraux de Constantine,
Administration des Communes Mixtes. (Sondage)
Voir notamment :
o Sous-préfecture de Constantine (1945-1962) :
9314 58
o Sûreté générale, Affaires
politiques : 93 B3 277-280, 93 B3 785 et 791
- Archives du Gouvernement Général
d'Algérie : Cabinet du Gouverneur Général, Service Central
des Renseignements Généraux. (Sondage)
Voir notamment :
o Surveillance politique des indigènes : GGA
7G 1403, GGA 40G 71, GGA 9H 23/38/53
o Cabinet civil du Gouverneur Général :
GGA 8CAB 89 et 169, GGA 11CAB 78, GGA 12CAB 205
- Préfecture d'Alger : Cabinet du
Préfet, Service de Liaisons Nord-Africaines, Police des Renseignements
Généraux. (Sondage)
Voir notamment
o Surveillance politique des Indigènes : 91 1K
1172, 91 1K 590
o Police des Renseignements Généraux : 91
4I 170
Hélène Koning - « Le Dr
Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »
- Mémoire IEP de Paris - 2024 134
| 


