|
__
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR (UCAD)
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG)
Laboratoire de Politiques Commerciales
(LAPOCOM)
Master Professionnel II en Politiques et
Négociations Commerciales Internationales (PNCI)
*************************
Mémoire de fin d'étudespour l'obtention du
diplôme de Masteren Politiques et NégociationsCommerciales
Internationales
Thème :
DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE : CAS DU SÉNÉGAL
|
Présenté et soutenu par
|
Mamadou Lamine BOUSSO
|
|
Encadrant
|
11èmpromotion
Renforcement des capacités
Année 2022-2023
Monsieur Idrissa Yaya DIANDY
Maître de Conférences Agrégé en
Sciences Economiques
|
DEDICACE
Louanges au Maître de l'Univers,
ALLAH, l'Unique sans associé que nous adorons et en qui
nous plaçons tout notre espoir ! Gloire et Pureté à notre
Créateur qui déverse abondamment ses bienfaits
sur nous sans le moindre effort de notre part. Le Roi des rois
qui accorde ses faveurs et sa miséricorde à ses humbles esclaves
que nous sommes !
Que la paix et le salut soient sur son Messager, notre
bien-aimé prophète Mouhammadque la paix et la
bénédiction d'ALLAH soit sur lui !
A tous camarades de promo particulièrement
àMadame PeindaGUISSE NDIAYE et à Monsieur
Oumar BAKHOUM.
A tous mes collègues de la Direction du Commerce
Extérieur, Madame NIANEMessin Marie Justine
SADIO,Madame DIAGNE Fama DIAKHATE,Abdou Khoudos
DIAGNE, Mame Cheikh Ibrahima NDAW,
Khadidiatou TRAORE, Moussa TINE,
Abdoulaye DIOP, et à Doyen El hadji Youssoupha
COBAR.
A Khadija, Adama,
Moustapha, Alpha, Samba, Fatou Ly
GUEYE, Modou GUEYE, Mouhamadou
Moustaphaet SeydaMariame.
A ma reine, ma précieuse mère Adja Fatoumata
DEME ! Je ne saurai te montrer ma gratitude DEME
Ndiobbo, je ne saurai te remercier assez, et comme il se doit. Tu nous
as consacré ta vie et fait de notre bonheur ton unique souci. Puisse le
Très Haut nous accorder à chaque souffle de notre vie
l'opportunité de te rendre fière et de te combler !
A notre cher Papa qu'ALLAH SWT lui accorde
son Paradis le plus élevé !
REMERCIEMENTS
Ce mémoire a été rendu possible
grâce au soutien et au suivi de mon encadreur, MonsieurIdrissa
Yaya DIANDY, Maître de Conférences Agrégé en
Sciences Economiques; nous lui exprimons notre profonde gratitude pour
les conseils, discussions, critiques et autres remarques toujours pertinentes,
votre disponibilité et votre appui m'ont été d'une
importance capitale.
A Madame DIAW AWATRAORE,Professeure
Agrégée en Sciences Economiquespour ses orientations.
Nos remerciements àMonsieur Cheikh
BAMBAMANGA, doctorant dans leLaboratoire de
Financespour le Développement (LFIDEV)pour sa
disponibilité, ses orientations et précieuses contributions.
Nos remerciements à Monsieur El Hadji Ibrahima Paul
PAYE, Commissaire aux Enquêtes
Economiques, Chef de la Division de l'Accès aux
marchés et de la Règlementation des Echanges,
Direction du Commerce Extérieur, pour sa
disponibilité et son accompagnement.
Nous remercionsà Monsieur Malick SANE,
Professeur Titulaire des Universités,
Responsable du MASTER II Politiques et Négociations
Commerciales Internationales (PNCI).
Nos remerciements à Monsieur Ansou Souba
BADJI,Directeur du Commerce Extérieur
pour les flexibilités accordées sur nos horaires de travail pour
pouvoir suivre cette formation.
Nos remerciements à Madame KhadyBA,
Cheffe de la Division de l'Analyse et des Etudes de Marchés,
Direction du Commerce Extérieur.
Nous remercions également Monsieur El hadji
OmarNDIAYE, Directeur des Ressources Humaines de la
SONACOS pour ces sages conseils et motivations.
A Monsieur AdamaCISSE,Ingénieur
Statisticien, Economiste au Ministère du Développement Industriel
et des Petites et Moyennes Industries, pour ses contributions et
précieux conseils.
A Madame NDIAYEAnta NDAO,
Contrôleur du Contrôle Economique, pour ses
observations et précieux conseils.
A Madame SARRNdeye Seynabou
NDIAYE, Economiste, Cheffe du Bureau
Etude de marché de la Direction du Commerce Extérieur,
pour ses conseils et orientations.
A Monsieur FARA MAKHA DIOP, Chef du
Bureau de l'Expansion du Commerce Electroniquede la Direction
du Commerce Extérieur, pour ses conseils et encouragements.
Nous remercions les différents enseignants du
Master 2 PNCI de la Faculté des Sciences Economiques et
de Gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta
DIOP de Dakar pour la qualité des cours qu'ils nous ont
dispensés.
A tous ceux qui m'ont permis d'obtenir les informations et les
données dans le cadre de ce travail.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACDI Agence Canadienne de Développement
International
ANSD Agence Nationale de la Statistique et
de la Démographie
ARDL Auto Régressive Distributed Lag
CCI Centre du Commerce International
CNUCED Conférence des Nations unies sur
le commerce et ledéveloppement
CTCI Classification Type pour le Commerce
International
FAO Organisation des Nations Unies pour
l'alimentationl'agriculture
FBCF Formation Brut du Capital Fixe
FCFA Franc de la Communauté
Financière Africaine
FOPROMEXFonds de Promotion des Exportations
GMM Méthode des Moments
Généralisés
HH Indice de Diversification des Exportations
d'Herfindahl-Hirschman
HOSHeckscher, Ohlin et Samuelson
MCO Moindres Carrés Ordinaires
MEUR Million euros
OLS Ordinary Last Squares
OUV Ouverture Commerciale
PIB Produit intérieur Brut
PME Petites et Moyennes Entreprises
POP Population Totale
PPMX Part des Produits Manufacturés
dans les Exportations
PRN Part des Ressources Naturelles
PSEPlan Sénégal Emergent
SDSPStratégie de Développement du
Secteur Privé
SES Situation Sociale et Economique
SN-EXPORT 2035Stratégie Nationale de
Développement des Exportations
SN-ZLECAfStratégie Nationale de la Zone
de Libre-Echange Continentale
Africaine
STRADEX Stratégie de Développement
et de Promotion des Exportations
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
USA Etats Unis d'Amérique
VAR Modèle Vectoriel
Autorégressif
WDI World Development Indicators
WGI World Governance Indicators
ZES Zones Economiques Spéciales
LISTE
DES TABLEAUX ET FIGURES
Tableau 1 : Orientation géographique
des échanges du Sénégal,
1990-2021......................9
Tableau 2 : Exportations par groupes de
produits (solde moyen sur la période 1990-2021)...11
Tableau 3 : Signes
attendus...............................................................................34
Tableau 4 : Statistique descriptive des
variables.......................................................35
Tableau 5 : Matrice de
corrélation.......................................................................36
Tableau 6 : Résultats
stationnarité des
variables.....................................................37
Tableau 7 : Résultats du test de
cointégration........................................................38
Tableau 8 : Résultat des estimations
du modèle......................................................38
Figure 1 : Croissance du PIB réel du
Sénégal.......................................... ...............6
Figure 2 : Evolution de la structure de
l'économie sénégalaise (% du PIB)
......................7
Figure 3 : Evolution des échanges
extérieurs sur la période 1990-2021(milliers de dollars)....8
Figure 4 : Clients du
Sénégal en % des
exportations..................................................9
Figure 5: Evolution de l'indice de
diversification des exportations sénégalaises1990-2021.12
Chapitre 1 RESUME
Les exportations jouent un rôle crucial dans la
stimulation de la croissance économique et la réduction de la
pauvreté. De ce fait, elles font l'objet de plusieurs études sur
l'impact de leur fluctuationsur la croissance économique. Ainsi,
l'objectif de ce travail de recherche est donc d'examiner la relation entre la
diversification des exportations et la croissance économique au
Sénégal de 1990 à 2021. Pour y parvenir,l'outil
économétrique des séries temporelles basé sur le
modèle de croissance linéaire développé par Mankiw
et al (1992)a été utilisé.Les estimations sont
effectuées à partir de la méthode des moindres
carrés ordinaires (MCO) construite par Legendre (1805) et Gauss
(1809)afin d'examiner les déterminants de la croissance
économique au Sénégal.Les résultats montrent que la
diversification des exportations est un déterminant important de la
croissance. En effet, l'indice de diversification des exportations (HH) a un
effet positif et significatif sur la croissance. Par contre, l'Ouverture
Commerciale (OUV) n'a aucuneffet sur la croissance économique. Partant
de ce résultat, la principale implication de politique économique
demeure la mise en place de mécanismes d'incitation à la
diversification des produits exportés.
Mots-clés : Diversification,
exportations, croissance économique, MCO
ABSTRACT
Exports are one of the drivers of economic growth and poverty
reduction. As such, they are the subject of several studies on the impact of
their fluctuations on economic growth. Therefore, the objective of this
research is to examine the relationship between export diversification and
economic growth in Senegal from 1990 to 2021. To achieve this, the econometric
tool of time series based on the linear growth model developed by Mankiw et al
(1992) was used. Estimates are made using the ordinary least squares (OLS)
method constructed by Legendre (1805) and Gauss (1809) to examine the
determinants of economic growth in Senegal. The results show that export
diversification is an important determinant of growth. Indeed, the Export
Diversification Index (HH) has a positive and significant effect on growth.
However, Trade Openness (OUV) has no effect on economic growth. Based on this
result, the main implication for economic policy remains the establishment of
mechanisms to incentivize the diversification of exported products.
Keywords: Diversification, exports,
economic growth, OLS
SOMMAIRE
DEDICACES.......................................................................................I
REMERCIEMENTS.............................................................................II
LISTE DE SIGLES ET
ABREVIATIONS...................................................IV
LISTE DES TABLEAUX ET
FIGURES.....................................................VI
RESUME...........................................................................................VII
ABSTRACT.....................................................................................VIII
SOMMAIRE.....................................................................................IX
INTRODUCTION
GENERALE..............................................................1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ECONOMIE SENEGALAISE ET
DYNAMIQUE DU COMMERCE
EXTERIEUR.........................................5
SECTION 1 : CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE SENEGALAISE...5
SECTION 2 : DYNAMIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR..................7
SECTION 3 : POLITIQUES DE DIVERSIFICATIONS DES EXPORTATIONS
SENEGALAISES.........................................................................13
CHAPITRE 2 : CONCEPTUALISATION ET REVUE DE LA
LITTERATURE SUR LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE
ECONOMIQUE..................................................................................19
SECTION 1 :
CONCEPTUALISATION.............................................19
SECTION 2 : DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS A LA LUMIERE DE LA
LITTERATURE THEORIQUE........................................................22
SECTION 3 : REVUE DES TRAVAUX EMPIRIQUES SUR LA DIVERSIFICATION
DES EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE............24
CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EFFET DE LA DIVERSIFICATION
DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE .........................28
SECTION 1 : METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE.........................28
SECTION 2 : ESTIMATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS....35
SECTION 3 : IMPLICATIONTIONS DE POLITIQUES ECONOMIQUES...44
CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS.............................................47
REFERENCES....................................................................................49
ANNEXES.........................................................................................55
TABLE DES
MATIERES.....................................................................56
Chapitre 2 INTRODUCTION GENERALE
Avec l'accélération du commerce mondial durant
la seconde moitié du XXe siècle, une structure des
échanges très différente a pu être observée
de celle prévue par les théories commerciales classiques
fondées sur une concurrence parfaite, des avantages comparatifs et des
rendements d'échelle constants (Krugman, 1980). Selon la théorie
de la division du travail et de la spécialisation au service de la
croissance économique et du développement formulée en
1776par Adam Smith et le modèle du commerce international de Heckscher,
Ohlin et Samuelson (HOS), les pays devraient se spécialiser dans la
production des biens pour lesquels ils disposentd'un avantage comparatif.
Or, la littérature récente montre plutôt
que les pays ont tendance à diversifier leur production et leurs
exportations à mesure qu'ils se développent.1(*) Dans la plupart des
études menées, il est fait référence au «
phénomène de concentration », qui consiste essentiellement
en une concentration des produits de base et des marchés et qui est
considéré comme le principal facteur de l'instabilité des
recettes d'exportation. Ainsi, les pays dans lesquels la concentration des
produits est importante subiraient les effets négatifs de la
volatilité des prix du marché par le biais des fluctuations des
recettes en devises. En ce sens, il est généralement
avancé qu'un élargissement de la base d'exportation par le biais
d'une diversification du portefeuille commercial national peut aider à
préserver la stabilité des recettes d'exportation, stimulant
ainsi la croissance économique à long terme.2(*) En outre, certains estiment que
pour que les pays pauvres puissent s'enrichir, il est important qu'ils
modifient la composition de leurs exportations. Les débats sur la
thèse de Prebisch-Singer (1959) et la nécessité de
l'industrialisation ont donné la priorité à la
diversification des économies pour les rendre moins tributaires des
produits de base en raison de la détérioration des termes de
l'échange, de la faiblesse de la valeur ajoutée et de la lenteur
de la croissance de la productivité.
De même, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) (2004) maintient que, faute de
diversification des exportations dans les pays en développement, la
baisse et les fluctuations des recettes d'exportation ont eu une incidence
négative sur les revenus, les investissements et l'emploi. Grâce
à la diversification, les risques liés aux investissements sont
répartis sur un portefeuille plus large de secteurs économiques,
ce qui se traduit par une augmentation des revenus (Acemoglu et Zilibotti,
1997). Selon Romer (1990), la diversification peut être
considérée comme un facteur qui contribue à
améliorer l'efficacité des autres facteurs de production. De
plus, la diversification aide les pays à se protéger contre les
détériorations des termes de l'échange en stabilisant les
recettes d'exportation. La croissance économique et les changements
structurels dépendent des types de produits qui sont
échangés (Hausmann et Klinger, 2006 ; Hwang, 2006).Ainsi,
grâce à la diversification de ses exportations, une
économie peut progresser vers la production et l'exportation de produits
plus élaborés, ce qui peut contribuer fortement à son
développement économique. Par ailleurs, la diversification des
exportations permet d'atteindre au niveau national certains objectifs
macroéconomiques, à savoir une croissance économique
durable, une balance des paiements satisfaisante, des créations
d'emplois et une redistribution des revenus.
En ce qui concerne l'Afrique, il existe une forte
dépendance aux exportations de produits de base, ce qui crée des
systèmes économiques peu propices à la création de
richesse (CNUCED VII). Bien que cette situation trouve ses origines dans le
passé colonial, elle s'est aggravée au cours de la période
suivant l'indépendance (Dadzie, 1988). C'est pour renverser cette
tendance que le Gouvernement du Sénégal avait pour ambition de
transformer la structure de son économie en vue de soutenir une
dynamique de croissance forte et durable avec comme levier d'action, la
multiplication des volumes d'exportation par 2,5 à l'horizon 2023.Ainsi,
le commerce occupe une place centrale dans l'axe 1 du Plan
Sénégal Emergent (PSE) intitulé "transformation
structurelle de l'économie et croissance". En effet, le secteur du
commerce joue un rôle essentiel dans l'économie
sénégalaise, que ce soit en termes de contribution au produit
intérieur brut (PIB), de chiffre d'affaires, de création
d'emplois ou de capacité à stimuler les autres secteurs de
l'économie.
En 2020, le secteur du commerce a contribué à
hauteur de 57,5% du PIB (Rapport ANSD SES, 2021). Des progrès ont
également été réalisés avec la
diversification des produits d'exportation. Selon toujours le même
rapport, au cours des quinze dernières années (depuis 2006), le
Sénégal a ajouté vingt-sept nouveaux produits à sa
liste d'exportation. Ces produits ont contribué à hauteur de 63
dollars au revenu par habitant.
Plusieurs études ont mis en évidence le lien
entre la diversification des exportations et la croissance économique.
Dans une étude datant de 2008, Hesse constate que l'effet de la
diversification des exportations sur la croissance peut être non
linéaire. Les pays en développement bénéficient
généralement de la diversification de leurs exportations, tandis
que les pays plus avancés obtiennent de meilleurs résultats en se
spécialisant dans leurs exportations.Dans une étude portant sur
la Côte-d'Ivoire sur la période 1995-2018, Kouakou et N'zue (2020)
ont confirmé l'hypothèse selon laquelle la diversification des
exportations a un effet positif sur la croissance économique à
court terme. Cependant, à long terme, le pays a intérêt
à se spécialiser dans certains produits clés pour
maximiser les bénéfices commerciaux. Ces études soulignent
l'importance de trouver un équilibre entre la diversification des
exportations et la spécialisation, en fonction du stade de
développement économique d'un pays. Par conséquent,
l'intérêt de notre sujet réside dans le fait qu'il peut
servir de base pour une évaluation de l'utilisation du levier des
exportations comme source de croissance dans le cadre du PSE.
Dans le cadre de cette étude, la question principale
qui se pose est de savoir si la diversification des exportations pourrait
favoriser la croissance économique du Sénégal. Pour y
répondre, il faudra étudier les questions spécifiques
suivantes afférentes à la diversification des exportations du
Sénégal et sa croissance économique.
v Comment la structure des exportations
sénégalaises a-t-elle évoluée durant ces 30
dernières années ?
v Les exportations du Sénégal sont-elles
suffisamment diversifiées pour permettre à son économie de
tirer profit du commerce extérieur ?
Pour ce mémoire, l'objectif principal est d'analyser la
relation entre la diversification des exportations du Sénégal et
sa croissance économique.Afin de mieux cerner notre objectif principal,
nous nous fixons les objectifs spécifiques suivants :
· Apprécier l'évolution de la structure des
exportations sénégalaises entre 1990 et 2021 ;
· Évaluer les effets de la diversification des
exportations sur sa croissance économique.
Les hypothèses se rattachant à nos objectifs se
formulent de la façon suivante :
H1. Les exportations du Sénégal
ne sont pas suffisamment diversifiées sur la période.
H2. Il existe un effet positif de la
diversification des exportations sur la croissance économique.
Dans cette perspective, le plan utilisé pour traiter
notre thème est la suivant :
- Dans le premier chapitre, il sera abordé le contexte
qui sous-tend l'économie sénégalaise et l'examende la
dynamique de son commerce extérieur. Une analyse préliminaire du
comportement global de l'économie, à travers des quantités
agrégées, a été réalisée pour offrir
une vue d'ensemble et comparative de la situation économique pendant la
période d'étude. Cela nous a permis d'évaluer la tendance
de nos flux d'échanges internationaux et, par conséquent, de
mieux comprendre les défis à relever en matière de
diversification des exportations.
- Ensuite, dans un deuxième chapitre, il sera
procédé à une revue de la littérature
théorique et empirique concernant la relation de causalité entre
diversification des exportations et croissance économique.
- Enfin, un modèle vectoriel à correction
d'erreur permettant de tester la causalité entre ces deux variables est
exposé dans un troisième et dernier chapitre.
Chapitre 3 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ECONOMIE SENEGALAISE
ET DYNAMIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR
Ce premier chapitre se concentre sur la présentation de
l'économie sénégalaise et la dynamique du commerce
extérieur. Il s'agit d'explorer les aspects clés qui
façonnent le paysage économique du Sénégal, en
mettant l'accent sur son rôle dans le commerce international.
SECTION 1 : CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE
SENEGALAISE
L'évolution de l'activité économique
sénégalaise affiche une trajectoire erratique sur la
période 1990-2021 (figure1). Cette dynamique est
symptomatique d'une économie qui peine à maintenir des taux de
croissance élevés sur une longue durée. Toutefois,
à partir de 2014, les résultats s'améliorent sensiblement
avec une forte progression du PIB réel. En effet, l'économie
affiche des performances exceptionnelles entre 2015 et 2017 avec des taux de
croissance supérieurs à 6% et des perspectives qui tablent sur un
maintien de cette tendance.
Dès lors se pose la question de la consolidation
à long terme de ces résultats. Cette nouvelle dynamique
impulsée par la mise en oeuvre du Plan Sénégal
Émergent (PSE) justifie en partie la finalité de
cette étude consistant à proposer des solutions sous forme de
politiques publiques destinées à assurer une résilience de
l'économie sénégalaise par la diversification des
exportations. Pour ce faire, l'analyse des données historiques de la
croissance sur la période 1990-2021 sera utile pour une identification
et une compréhension des obstacles traditionnels affectant le maintien
de bonnes performances sur une longue durée. En effet, la connaissance
de ces contraintes va guider dans le choix des instruments à mettre en
oeuvre pour les lever.
Figure 1 :Croissance
du PIB réel du Sénégal

Source :Auteur, données World
Development Indicators (Banque Mondiale)
Les informations tirées du comportement de
l'économie sénégalaise sur la période 1990-2021
permettent de dresser le diagnostic suivant :
ü Une structure de l'économie peu
diversifiée ;
ü Un taux d'investissement encore faible ;
ü Une croissance économique liée à
celle de la valeur ajoutée du sous-secteur agricole ;
ü Une forte dépendance vis-à-vis de
l'extérieur pour les approvisionnements en produits alimentaires et
énergétiques ;
ü Un cadre macroéconomique stable, mais
vulnérable aux chocs exogènes.
Il est reconnu que le processus de changement structurel est
crucial afin de rattraper les retards de développement (Kuznets, 1966,
Rodrik, 2013, McMillan et Rodrik, 2011). L'élément
déclencheur de cette évolution est le différentiel de
productivité entre secteurs qui favorise le déplacement de la
main d'oeuvre attiré par les gains de rémunération.
L'industrialisation joue traditionnellement un rôle clé dans ce
mouvement. En effet, cette évolution devrait se manifester par un
redéploiement de l'activité économique des secteurs
à faible productivité aux secteurs à forte
productivité. En d'autres termes, une migration devrait progressivement
s'opérer du secteur traditionnel vers le secteur moderne
caractérisé par des rendements d'échelle, des gains de
technologie et de productivité ainsi qu'une croissance plus rapide. Or,
la configuration de l'économie sénégalaise montre un
processus de transformation structurelle plutôt lent marqué par
une prédominance des activités de services qui occupent plus de
50% contre environ 17% et 20% respectivement pour l'agriculture et l'industrie.
La part de l'industrie qui devrait contribuer à illustrer la dynamique
de transformation, évolue très peu sur la période
d'observation.
Figure 2 : Evolution de la
structure de l'économie sénégalaise (% du PIB)
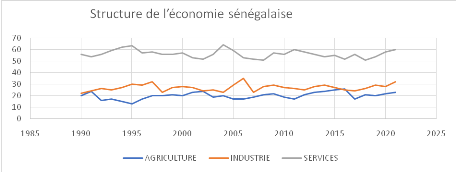
Source :Auteur, données World
Development Indicators (Banque Mondiale)
Sur cette figure, le constat est que la distribution de la
main d'oeuvre confirme également cette lenteur du processus de
transformation structurelle. La structure de l'emploi montre en effet une
répartition en faveur de l'industrie 26,94% et des services 56,28%
tandis que la part de l'agriculture stagne autour de 16,78% sur la
période d'observation. La main d'oeuvre du secteur des services
relativement au total des effectifs enregistre toutefois un repli important en
fin de période.
SECTION 2 : DYNAMIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR
2.1Situation globale des échanges extérieurs
L'évolution du commerce extérieur du
Sénégal a connu une tendance à la hausse des exportations
et des importations au cours des 30 dernières années (graphique
3). Les importations ont connu une hausse très importante. De 1,4
milliard de dollars en1990, ces dernières ont atteint 8,1 milliards de
dollars en 2019 avec des pics de 6,5 milliards de dollars en 2008 et 6,6
milliards de dollars en 2013. Cette tendance haussière des importations
a toutefois été atténuée par des baisses
enregistrées en 2009 et 2016. Pendant la période sous revue, les
exportations ont également progressé, mais à un niveau
plus faible et à rythme plus lent. Ainsi, de 0,9 milliard de dollars en
2000, elles sont estimées à 2,2 milliards dollars en 2010 pour
ressortir à 4,2 milliards dollars en 2019. En somme,sur ce graphique,il
est noté que les importations croient plus vite que les exportations.
Figure 3 : Evolution des
échanges extérieurs sur la période 1990-2021(en milliers
de dollars)
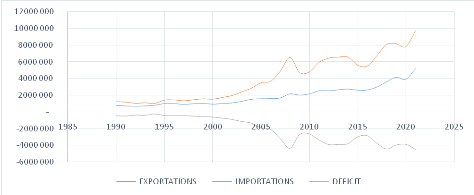
Source : Auteur à partir des
données de la banque mondiale
Globalement, la valeur moyenne des exportations du
Sénégal est estimée à 2 037 milliards pendant la
période 1990-2021 alors que celle des importations est établie
à 4 273 milliards, soit un déficit de la balance commerciale de 2
236 milliards.
Sur la période 1990-2021, le déficit de la
balance commerciale semble structurel. Il est d'une part, marqué par des
situations de détérioration se traduisant par un niveau qui passe
de -0,46 milliard en 1990 à -2,62 milliards en 2010 pour ressortir
à près de -4,5 milliards en 2021, avec des pics en 2008 (-4,36
milliards) et 2018 (-4,45 milliards). Ces dégradations résultent
de l'effet conjugué de l'envolée des cours internationaux des
produits alimentaires et énergétiques ainsi que de
l'accroissement des importations de biens et services consécutif aux
investissements dans les domaines miniers, des télécommunications
et des infrastructures économiques et sociales. Ces évolutions
indiquent d'autre part, l'atténuation du déficit de la balance
commerciale pendant la période 2012-2016, en relation avec la
consolidation des exportations de produits miniers et la baisse des cours des
matières premières, notamment les replis de ceux du
pétrole observé sur la période 2013-2016.
2.2
Orientation géographique des échanges du
Sénégal
L'orientation géographique des exportations du
Sénégal ne s'est pas beaucoup modifiée au cours des trois
dernières décennies (Tableau n°1).
L'Afrique est restée le premier client du Sénégal avec
plus de 39.9% des exportations.
Tableau 1 : Orientation
géographique des échanges du Sénégal, 1990-2021 en
FCFA
|
RUBRIQUES
|
IMPORTATIONS
|
EXPORTATIONS
|
BALANCE COMM
|
|
ZONES
|
VALEUR
|
PART EN %
|
VALEUR
|
PART EN %
|
SOLDE
|
|
TOTAL
|
128 215 000 000
|
100
|
61 123 000 000
|
100
|
- 67 092 000 000
|
|
Amérique
|
9 628 946 500
|
8
|
2 444 920 000
|
4
|
- 7 184 026 500
|
|
Europe
|
59 658 439 500
|
45
|
17 603 424 000
|
28
|
- 42 055 015 500
|
|
Asie
|
34 797 551 000
|
27
|
12 224 600 000
|
19
|
- 22 572 951 000
|
|
Afrique
|
22 770 984 000
|
18
|
24 388 077 000
|
41
|
1 617 093 000
|
|
Océanie
|
641 075 000
|
1
|
1 528 075 000
|
3
|
887 000 000
|
|
Divers
|
718 004 000
|
1
|
2 933 904 000
|
5
|
2 215 900 000
|
Source :Calculs Auteur, données
ANSD
La composition géographique des importations du
Sénégal indique que l'Europe est le premier fournisseur du
Sénégal pendant la période 1990-2021. En effet,
près de 60 milliards des 128 milliards que représentent les
importations totales de marchandises du Sénégal (soit 45%)
proviennent de l'Europe. En moyenne 1,159 milliard par an (soit 27%) des
importations de marchandises du Sénégal proviennent de l'Asie au
moment où 18% d'elles viennent du continent africain. La France demeure
le principal fournisseur du Sénégal avec en moyenne plus de 17%.
Ensuite, parmi les autres plus importants fournisseurs figurent la Chine et le
Nigéria.
Figure 4 : Clients du Sénégal en %
des exportations
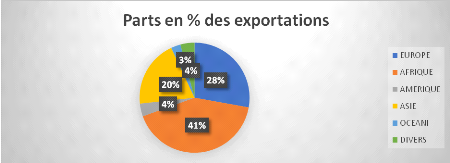
Source : Auteur, données ANSD
La destination géographique des exportations de
marchandises du Sénégal indique que les exportations sont
estimées en moyenne à 2 037 milliards par an pendant la
période 1990-2021. Le tableau montre 01 que plus de 40% des exportations
du Sénégal sont destinées au marché africain avec
24 milliards dont le premier destinataire est le Mali pour une valeur moyenne
de 4 444 milliards soit 18%. La Côte d'Ivoire qui se trouve être le
plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest francophone n'absorbe que 3%
des exportations du Sénégal. En outre, ce tableau ci-dessus
montreque le deuxième partenaire d'exportation des produits du
Sénégal est l'Europe. La plupart de ces exportations sur le
marché européen est destinée à la France. L'Italie,
l'Espagne et la Suisse occupent aussi une bonne place parmi les pays
européens acheteurs de produits du Sénégal. L'Asie est le
troisième marché des produits sénégalais. Ce
continent absorbe environ 19% des exportations du Sénégal dont le
premier client est l'Inde avec 90 milliards alors que la Chine n'acquiert que
1,9% des exportations du Sénégal. Par ailleurs, ce tableau
indique que la destination géographique de plus de 5% des exportations
du Sénégal sur le marché mondial n'est pas clairement
établie.
2.3 Structure des échanges
extérieurs par groupes de produits
Les combustibles minéraux, lubrifiants et produits
connexes ont occupé le premier rang des importations du
Sénégal, suivis des machines et matériels de transport,
des produits alimentaires et animaux vivants, des articles manufacturés,
des produits chimiques qui ont couvert près de 90% du total des
importations (tableau 2). Le tableau suivant décrit la structure des
échanges extérieurs par groupes de produits du
Sénégal sur la période 1990-2021.
Tableau 2: Exportations
par groupes de produits (solde moyen sur la période 1990-2021) en
FCFA
|
PRODUITS
|
EXPORTATIONS
|
PART
|
|
RUBRIQUES
|
VALEUR
|
EN %
|
|
Alimentation - Boissons - Tabacs
|
- 370 495
|
21
|
|
Energie et lubrifiants
|
- 775 045
|
20
|
|
Matières premières animales et
végétales
|
74 048
|
3
|
|
Matières premières minérales
|
93 287
|
5
|
|
Autres demi - produits
|
- 496 776
|
9
|
|
Produits finis destines à l'agriculture
|
- 16 495
|
15
|
|
Produits finis destines à l'industrie
|
- 747 882
|
8
|
|
Produits finis destines à la consommation
|
- 471 423
|
2
|
|
Or industriel
|
373 833
|
7
|
|
Autres
|
78 768
|
10
|
|
TOTAL
|
- 2 336 947
|
100
|
Source : Auteur, données ANSD
Le tableau 2 présentant les
exportations par groupes de produits offre une perspective
détaillée de la répartition des exportations sur une
période de 31 ans, de 1990 à 2021, en FCFA. Cette analyse permet
de saisir les dynamiques économiques et commerciales qui ont
influencé l'évolution des exportations au fil du temps.
Premièrement, il est évident que certaines
catégories de produits jouent un rôle prépondérant
dans le panorama des exportations. Notamment, les secteurs de l'énergie
et des lubrifiants, ainsi que celui de l'alimentation, des boissons et des
tabacs, se distinguent par leur contribution significative, représentant
respectivement 20% et 21% du total des exportations. Cette constatation
souligne l'importance stratégique de ces secteurs dans l'économie
nationale.
En outre, la présence de diverses catégories de
produits dans le tableau témoigne d'une certaine diversification des
exportations. Outre les produits finis destinés à l'agriculture
et à l'industrie, on observe également des exportations de
matières premières minérales et animales, ainsi que d'or
industriel. Cette diversification peut être perçue comme un atout
pour la résilience économique, réduisant la
dépendance excessive à l'égard d'un seul secteur.
Parmi les observations notables, l'importance de l'or
industriel dans le paysage des exportations ne peut être
négligée, représentant une part substantielle du total des
exportations avec 7%. Cette constatation met en lumière le rôle
crucial que joue ce secteur dans l'économie nationale et souligne la
nécessité de surveiller de près son évolution.
De plus, l'utilisation de données sur une
période aussi étendue permet d'identifier les tendances à
long terme dans les exportations de chaque catégorie de produits. Cette
analyse historique offre une perspective précieuse pour comprendre les
évolutions structurelles de l'économie et peut servir de base
pour des projections futures.
Figure 5 : Evolution de l'indice de diversification
des exportations sénégalaises sur la période
1990-2021
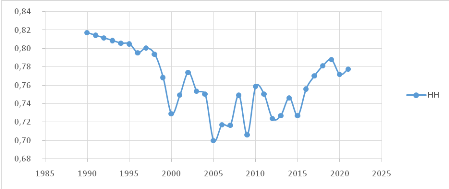
Source :Auteur, données de la CNUCED
Pendant toute la période considérée par
notre étude, l'indice de diversification des exportations du
Sénégal a toujours oscillé entre 0,7 et 0,8 (figure 4)
révélant une plus grande tendance à la diversification
entre 2000 et 2015. Il peut être noté, également, une
diversification plus importante du panier des exportations en 2019 après
une baisse entre 1999 et 2018.
Le panier des exportations sénégalaises a
connu une certaine diversification de 2003 à 2017 avec une
évolution erratique dans le temps (NACE ANSD, 2020). C'est pourquoi le
Sénégal a récemment pris des mesures destinées
à favoriser le développement de l'horticulture nationale par la
promotion de partenariats public-privé, à travers le projet des
agropoles notamment le lancement des ZES Diamniadio, Sandiara et Diass et la
relance de l'industrie pharmaceutique entre autres, qui devraient renforcer la
compétitivité internationale.
SECTION 3 : POLITIQUES DE DIVERSIFICATIONDES EXPORTATIONS
SENEGALAISES
Le Sénégal est une économie ouverte et
intégrée dans le commerce mondial. Le secteur du commerce
contribue de manière significative à la création de
richesses. La part du commerce extérieur dans le PIB du
Sénégal avoisine les 63% (Banque Mondiale, 2020). Les
importations représentent toujours près de la moitié du
PIB avec un déficit commercial moyen de 1 836 milliards de FCFA par an.
L'exportation de biens et services, qui représentent plus de 17 % de
notre PIB, est essentielle à notre émergence. Les exportations
ont connu, au cours de ces trente dernières années, une tendance
haussière passant de 494 milliards de FCFA en 1990 à 3 381
milliards de FCFA en 2021 (ANSD).Au lendemain de la dévaluation du franc
CFA et de la libéralisation de son économie, le
Sénégal ne s'est pas doté d'une stratégie propre au
développement des exportations. Ce qui fait que les programmes nationaux
de développement successifs ont servi de cadre de définition de
la politique en faveur des exportations jusqu'au début des années
2000.
Depuis 2001, plusieurs stratégies de
développement des exportations visant à promouvoir ses
exportations vers le marché international, le développement
industriel et la création d'emplois ont vu le jour. Parmi ces
stratégies,il peut être relevé :
3.1 La Stratégie de
Développement et de Promotion des Exportations (STRADEX)
La STRADEX a eu pour objectif principal d'accroître les
capacités d'offre à l'exportation et de contribuer ainsi à
la réduction de la pauvreté qui sévit notamment dans le
milieu rural. Depuis la dévaluation du franc CFA, les indicateurs
macro-économiques du Sénégal sont globalement positifs
avec une croissance économique supérieure à 5% en 1995.
C'est dans ce contexte qu'un cadre institutionnel et opérationnel de
développement et de promotion des exportations (STRADEX) par les PME a
été mis en place. La STRADEX vise une meilleure valorisation de
nos potentialités en vue de répondre à la demande
internationale. Cette stratégie, initiée par le Gouvernement avec
l'appui technique du Centre du Commerce International (CCI) et financier du
Canada, à travers l'Agence Canadienne de Développement
International (ACDI), présente la stratégie de
développement des principales grappes d'exportation au
Sénégal.
Après l'identification du potentiel d'offre à
l'exportation et suite à l'étude de la demande internationale,
cinq grappes de produits et services ont été ciblées pour
constituer les éléments de base de la stratégie de
développement et de diversification des exportations
sénégalaises. Les grappes sectorielles, ci-après, ont
été retenues. Il s'agit :
ü Des produits de la mer ;
ü Des produits culturels et de l'artisanat d'art ;
ü Des produits horticoles, oléagineux et de
cueillette ;
ü Des produits alimentaires et non alimentaires
destinés aux communautés africaines résidant à
l'étranger ;
ü Des télé-services.
Ce programme a pour objectif de favoriser un accroissement des
ventes à l'export et un meilleur positionnement des produits et services
cibles sur les marchés européen, nord-américain et
africain.
En outre, plusieurs réformes et stratégies ont
été adoptées. Celles relevant de la promotion des
exportations sont notamment :
3.2 La Stratégie Nationale
de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (SN-ZLECAf)
L'objectif global est de contribuer significativement à
la croissance des exportations en rapport avec les objectifs du PSE. De
manière spécifique, il s'agit de/d':
ü développer l'offre exportable ;
ü diversifier le marché des exportations de biens
et de services ;
ü améliorer la compétitivité des
entreprises ; et
ü renforcer les capacités institutionnelles.
La vision de cette stratégie est de faire du
marché africain le principal levier d'intégration aux
échanges pour l'émergence. En somme, la SN-ZLECAfvise à
dynamiser la croissance des exportations, alignant ses objectifs avec le Plan
Sénégal Émergent (PSE). À travers ses objectifs,
elle aspire à créer un environnement propice à
l'épanouissement économique et à la promotion durable du
commerce au sein de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine.
3.3 La Stratégie Nationale
de Développement des Exportations (SN-EXPORT2035)
Avec l'ambition des autorités, la vision peut
être formulée comme suit :faire les exportations, un levier
essentiel du Plan Sénégal émergent (PSE) pour favoriser la
transformation structurelle de l'économie en vue d'une croissance forte,
durable et inclusive, à l'horizon 2035. Les éléments
d'orientations stratégiques de cette stratégie se résument
ainsi :
ü valoriser la part des produits manufacturés dans
les exportations, spécifier les produits concernés ;
ü renforcer l'accès aux marchés en
accélérant l'élimination des barrières tarifaires
et non tarifaires qui bloquent les exportations
sénégalaises ;
ü parfaire les plateformes commerciales et services
connexes d'appui aux exportations en améliorant la diffusion de
l'information commerciale et la compréhension des accords
commerciaux ;
ü mettre en place un Fonds (FOPROMEX) dédié
à la promotion des exportations ;
ü améliorer la cohérence et l'efficience de
la gouvernance institutionnelle des exportations ;
ü accroître la part des PME dans les exportations
en spécifiant les produits concernés ;
ü inverser la structure des exportations par
l'augmentation de la part des produits manufacturés.
La SN-EXPORT 2035 incarne l'engagement des autorités
sénégalaises à faire des exportations un pilier crucial du
PSE, propulsant ainsi la transformation structurelle de l'économie vers
une croissance robuste, durable et inclusive d'ici à 2035. Les
orientations stratégiques clairement définies, allant de la
valorisation des produits manufacturés à l'amélioration
des plateformes commerciales, de l'accès aux marchés à la
promotion des PME, témoignent d'une vision ambitieuse et
intégrée pour stimuler le potentiel exportateur du pays. La mise
en oeuvre de ces axes stratégiques devrait contribuer de manière
significative à positionner le Sénégal sur la voie
d'undéveloppementéconomique durable.
3.4 La Stratégie de Développement du Secteur
Privé (SDSP 2021-2025)
En comparaison avec les initiatives antérieures,
l'élaboration de la SDSP 2021-2025 prend appui sur celle de la
période 2013-2017. Elle a la particularité de viser la mise en
place d'un cadre complet spécifiquement dédié au
développement du secteur privé, et qui repose sur une vision
globale et partagée. Ce cadre doit également s'appuyer sur un
dispositif institutionnel rationalisé et destiné à
canaliser toutes les actions futures s'inscrivant dans la poursuite de cet
objet. L'élaboration de cette stratégie intervient à un
moment où diverses actions témoignent de la volonté
commune du Gouvernement et du Patronat de consolider leur partenariat, pour
mieux faire face aux défis et enjeux qui les interpellent.
Cette stratégie s'articule autour de trois axes :
ü Le renforcement des bases à long terme du
développement ;
ü L'amélioration de l'efficacité de
l'intervention de l'État ;
ü Le renforcement des capacités du secteur
privé.
La SDSP se distingue par son approche novatrice axée
sur la création d'un cadre dédié au développement
du secteur privé, reposant sur une vision partagée. En mettant
l'accent sur le renforcement des bases durables du développement,
l'amélioration de l'efficacité de l'intervention étatique
et le renforcement des capacités du secteur privé, cette
stratégie repose sur la collaboration entre le Gouvernement et le
Patronat pour relever les défis à venir. Elle représente
ainsi un jalon crucial dans la consolidation du partenariat public-privé
pour catalyser la croissance économique et faire face aux enjeux
contemporains.
3.5 L'Etude
Import-Substitution
Cette stratégie d'industrialisation se veut une
solution pour faire régresser la demande de biens importés. Dans
l'optique d'opérationnalisation de la politique des Zones Economiques
Spéciales (ZES), le Sénégal a validé au
début du premier trimestre de l'année 2020, les conclusions et
recommandations de l'étude sur l'import-substitution au
Sénégal. L'objectif principal de cette étude est de
présenter le schéma d'opérationnalisation qui conduira au
mieux la stratégie d'industrialisation de l'import-substitution
considérée comme une solution pour faire régresser la
demande de biens importés pour prévenir les chocs externes.
3.6 La Nouvelle Politique et
Stratégie de Développement Industriel (NPSDI)
Cette stratégie vise un secteur industriel
diversifié et compétitif, pourvoyeur d'emplois et apportant une
pleine contribution au développement inclusif et durable du pays, pour
un Sénégal émergent à l'horizon 2035.
Les objectifs de cette stratégie se déclinent
ainsi :
ü Développer la compétitivité de
l'industrie sénégalaise et ses capacités productives dans
la transformation des matières premières agricoles,
sylvo-pastorales et halieutiques ;
ü Développer des unités de transformation des
ressources minérales et des hydrocarbures ;
ü Augmenter la couverture locale de la demande nationale de
produits pharmaceutiques afin de diminuer la dépendance aux
importations ;
ü Favoriser l'émergence de pôles industriels
dans des secteurs à haute intensité technologique, porteurs
d'innovation, de croissance et d'emplois ;
ü Renforcer le positionnement du Sénégal dans
l'économie numérique notamment l'industrie 4.0 ;
ü Créer un pôle manufacturier à haute
valeur ajoutée autour des industries d'assemblage et de
fabrication ; et
ü Aassurer le développement de produits et services
créatifs de qualité et compétitif.
La NPSDI du Sénégal se fixe des
objectifs ambitieux pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035.
Elle s'articule autour du développement d'un secteur industriel
diversifié et compétitif, visant à créer des
emplois et à contribuer de manière significative au
développement inclusif et durable du pays. Les principales orientations
stratégiques comprennent le renforcement de la
compétitivité de l'industrie locale, la diversification des
capacités productives, la promotion de pôles industriels
innovants, la consolidation de la position du pays dans l'économie
numérique, et la création d'un pôle manufacturier à
haute valeur ajoutée. De plus, la stratégie vise à
réduire la dépendance aux importations, notamment en augmentant
la couverture locale de la demande nationale de produits pharmaceutiques.
L'ensemble de ces objectifs vise à positionner le Sénégal
comme un acteur majeur dans le contexte de l'industrie mondiale, en favorisant
la création d'emplois, l'innovation et une croissance économique
durable.
Conclusion partielle
Le premier chapitre de notre sujet a abordé la
présentation de l'économie sénégalaise et la
dynamique du commerce extérieur. Dans la première section, il a
été mis en lumière l'évolution de l'activité
économique du Sénégal sur la période 1990-2021,
soulignant les performances exceptionnelles entre 2015 et 2017. Cependant, des
défis ont été, également,identifiés tels
qu'une économie peu diversifiée, un faible taux d'investissement,
une dépendance vis-à-vis de l'extérieur et une lenteur du
processus de transformation structurelle.
La deuxième section s'est concentrée sur la
dynamique du commerce extérieur, notant une tendance à la hausse
des exportations et importations au cours des 30 dernières
années. Le Sénégal fait face à un déficit
structurel de sa balance commerciale, avec des importations croissantes plus
rapidement que les exportations. L'orientation géographique des
échanges montre l'Afrique comme le principal client du
Sénégal, suivi de l'Europe et de l'Asie.
La troisième section a exploré les politiques de
diversification des exportations sénégalaises. Il a
été fait état de la Stratégie de
Développement et de Promotion des Exportations (STRADEX), le Plan
Sénégal Emergent (PSE), la Stratégie Nationale de la Zone
de Libre-Echange Continentale Africaine (SN-ZLECAf), la Stratégie
Nationale de Développement des Exportations (SN-EXPORT 2035), la
Stratégie de Développement du Secteur Privé,
l'Étude Import-Substitution et la Nouvelle Politique et Stratégie
de Développement Industriel. Ces stratégies visent à
accroître les exportations, diversifier les marchés,
améliorer la compétitivité et renforcer la transformation
structurelle de l'économie.
Ce chapitre suggère une orientation vers une croissance
plus forte, durable et inclusive, en mettant l'accent sur la diversification
des exportations et la transformation structurelle de l'économie
sénégalaise.
Chapitre 4 CHAPITRE 2 : CONCEPTUALISATION ET REVUE DE LA
LITTERATURE SUR LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONSET LA CROISSANCE
ECONOMIQUE
Ce chapitre est articulé autour de trois sections. La
première section présente, tour à tour, l'approche
conceptuelle des termes diversification et croissance économique
où un accent particulier est mis sur les enjeux de la diversification et
les déterminants de la diversification, dans une deuxième
section, la revue de la littérature théorique est abordée
en premier lieu et les études empiriques suivent dans la
troisième section et traite succinctement des méthodologies
empruntées par les chercheurs antérieurs ainsi que les
résultats auxquels ils ont aboutis. Les analyses théoriques
identifient, notamment le levier des marges intensive et extensive. S'agissant
des théories empiriques, les résultats peuvent être de
trois ordres : positive, négative ou non linéaire.
SECTION 1 : CONCEPTUALISATION
Il y a deux concepts sur lesquels l'on mérite de
s'appesantir. Il s'agitde la diversification et la croissance
économique.
1.1 Diversification
Le débat sur la diversification date de bien longtemps.
Il a commencé aux USA et en Amérique Latine entre les deux
guerres lorsque l'on a assisté à la chute spectaculaire des cours
des matières premières. Avec le temps, la diversification a
commencé à être prise en compte dans les politiques
industrielles et commerciales des pays industrialisés et maintenant dans
celles des pays en développement. En général, la
diversification économique est définiecomme une stratégie
de développement qui consiste à prendre position sur de nouveaux
marchés pour diminuer le risque de volatilité des capitaux. Quand
on se focalise sur la diversification des exportations, plusieurs
définitions ont été proposées par différents
auteurs dans la littérature. Ainsi, Alwang et Seigel (1994) et De
Pineres et Ferrantino (1997) définissent la diversification des
exportations comme le développement du portefeuille des exportations
d'un pays des produits primaires aux produits industriels. Love (1983) et
Hirsch et Lev (1971) la définissent comme le fait de ne pas
spécialiser le portefeuille des exportations à un nombre
limité de biens à l'exportation. Il peut donc être
déduit que plus le nombre de biens à l'exportation est important,
plus diverses seront les exportations d'un pays.
1.1.1 Les enjeux de la diversification
Pour mieux apprécier les coûts et les avantages
de la diversification, il convient d'en préciser les principales
caractéristiques. En se basant sur les études de Berezin (2002),
on note que : la diversification des exportations peut être horizontale
et/ou verticale. La diversification horizontale vise l'émergence d'un
nouveau produit à l'exportation, tandis que la diversification verticale
consiste à élargir la gamme des produits à l'exportation
fabriqués dans un même secteur, afin d'aboutir à la
constitution d'une filière complète, partant du produit de base
jusqu'aux produits ou services incorporant une plus forte valeur
ajoutée. La diversification des exportations répond à la
loi des rendements décroissants : la diversification peut
s'avérer contreproductive s'il faut réallouer les ressources
affectées aux produits performants au profit de nouveaux produits.
1.1.2 Les déterminants de la diversification
La diversification joue un rôle important dans le
développement et la croissance d'une économie. En effet, elle
peut contribuer, selon certains auteurs, à accroître la
productivité des facteurs, à renforcer l'investissement et
à stabiliser les recettes d'exportations. Le rapport sur la
diversification en Afrique de la Commission Économique pour l'Afrique
des Nations Unies (2006) répertorie cinq catégories de variables
agissant sur le processus de diversification. Il s'agit notamment :
- des facteurs physiques : l'investissement, la croissance et
le capital humain ;
les politiques publiques : les politiques budgétaires,
commerciales et industrielles (de par leur impact sur le renforcement du tissu
industriel) ;
les variables macroéconomiques : les taux de changes et
d'inflation ainsi que les soldes extérieurs ;
- des variables institutionnelles : la gouvernance,
l'environnement de l'investissement et la situation sécuritaire
(conflits, ...) ;
- de l'accès aux marchés : le degré
d'ouverture aux échanges de biens, de services et de capitaux
(élimination des barrières tarifaires et non tarifaires),
l'accès aux financements bancaires ou de marché.
1.1.3 Croissance économique
La croissance économique est une notion quantitative
qui traduit l'augmentation de la production nationale de biens et services sur
une longue période. Elle se différencie du développement
économique, objectif ultime de toute nation qui est de nature
plutôt qualitative. Selon Chenery 1980, le développement
économique peut être défini comme « l'ensemble des
transformations intimement liées qui se produisent dans la structure
d'une économie et qui sont nécessaires à la poursuite de
la croissance. Ces changements concernent la composition de la demande, de la
production et des emplois, aussi bien que la structure de commerce
extérieur et des mouvements de capitaux avec l'étranger ».
Il ressort de cette définition qu'il ne peut pas avoir de
développement économique sans croissance préalable ; c'est
d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la littérature
économique s'est énormément intéressée aux
moyens de créer et d'entretenir la croissance économique.
Plusieurs types de croissance économique sont spécifiés
dans la littérature ; les développements qui suivent ne sont pas
exhaustifs.
La croissance extensive par exemple, se définit comme
un accroissement de la production résultant d'une augmentation de la
quantité de facteurs utilisés. Elle ne traduit pas une
utilisation plus efficace des facteurs de production à la
différence de la croissance intensive qui est observée lorsque la
production augmente pour un volume constant de facteurs utilisés.
La croissance appauvrissante est un autre type de croissance
économique mise en évidence par J. Bhagwati (1958). Selon cet
auteur, les pays exportateurs de produits de base du fait de la
dégradation continue de leurs termes de l'échange sont contraints
à produire et exporter davantage pour des capacités d'importation
sans cesse réduites. La croissance économique entraîne dans
ce cas un appauvrissement du pays puisque l'accroissement de la production
n'entraîne pas de hausse de la consommation.
La littérature économique relève aussi
que la croissance économique peut être endogène,
c'est-à-dire auto-entretenue ; équilibrée, par un
investissement dans tous les secteurs de sorte à éviter les
goulets d'étranglement ; ou déséquilibrée, par une
politique d'investissement concentrée en certains pôles
susceptibles d'avoir des effets d'entraînement sur les autres
secteurs.
SECTION 2 : DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS A LA
LUMIERE DE LA LITTERATURE THEORIQUE
La relation entre la diversification des exportations et la
croissance économique a fait l'objet de plusieurs débats dans la
littérature. Dans une perspective historique, il est apparu que les
analyses traditionnelles en l'occurrence, les théoriciens classiques des
avantages absolus d'Adam Smith (1776), des avantages comparatifs de Ricardo
(1817) et de la loi des facteurs des théories néoclassiques
d'Heckshen (1919) d'Ohlin (1933) et de Samuelson (1949), sont fondées
sur la spécialisation internationale pour booster la croissance
(approche interbranche dans les échanges internationaux).
En ce qui concerne les échanges intrabranches, les
analyses ont porté sur la différenciation des produits, mise en
évidence par Helpman et Krugman en 1985, ce qui remet en cause les
théories traditionnelles sur les avantages comparatifs et factoriels et
conduit à une nouvelle division internationale du travail sur les
processus productifs. Mais l'offre reste rationnée sur les
stratégies de spécialisation et de différenciation pour
dynamiser une croissance. La prise en compte du rôle de la
diversification des exportations dans la croissance fait l'objet des analyses
contemporaines.
En effet, selon les théories traditionnelles, les
différentes nations sont amenées à se spécialiser
dans la production des biens pour lesquels ils disposent d'un avantage
comparatif. Or, les nouvelles théories considèrent que les
avantages comparatifs sont plus une conséquence qu'une cause des
échanges internationaux.
En se spécialisant, chaque pays multiplie ses avantages
; ce n'est pas parce qu'un pays est plus compétitif dans un produit
qu'il l'exporte, mais c'est surtout en l'exportant qu'il devient plus
compétitif (Montoussé, 2013). De plus, si les théories de
l'échange international privilégiaient les avantages de la
spécialisation internationale, les théories mercantilistes,
reprises par les keynésiens mettent l'accent sur le rôle des
exportations en tant qu'instrument de la politique économique dans la
croissance.
Selon les modèles structurels de développement
économique, les pays devraient passer des exportations primaires aux
exportations de produits manufacturés pour parvenir à une
croissance durable (Chenery 1979 ; syrgrin, 1989). Pour les pays
dépendant des produits de base, la diversification verticale des
exportations permettrait de réduire la détérioration des
termes de l'échange selon la thèse de Prebish-singer (1959), ce
qui est bénéfique pour la croissance.
Plus récemment, les théories de la croissance
endogène, dues aux économistes tels que Romer (1986, 1990), Lucas
(1988), Barro (1990), Barro et Sala-i-Martin (1995, 2003) et Grossman et
Helpman (1991), ont mis l'accent sur l'importance de la diversification. La
croissance endogène selon eux, est assimilée à un
phénomène auto-entretenu par l'accumulation de quatre facteurs
principaux : le capital physique, la technologie, le capital humain et le
capital public. En vue d'une croissance endogène à long terme,
ces trois modèles (Romer, Lucas et Barro) de la croissance
endogène d'une manière générale et celui de Romer
(1986,1990) en particulier, introduisent la diversification comme l'un des
déterminants de la croissance économique.
Selon ces théories, plus le panier d'exportations d'un
pays est diversifié, plus le taux d'accumulation du capital humain est
élevé, ce qui entraîne une productivité plus
élevée et donc une croissance économique accrue (Mayer,
1996). Dans le même contexte, la théorie du cycle de vie du
produit stipule qu'une forte diversification des exportations peut être
d'une part, obtenue grâce à l'innovation et rester au-dessus des
autres pays et d'autre part, liée directement à une augmentation
de la croissance.
En somme, les théories classiques et
néoclassiques du commerce international s'appuyaient sur l'idée
selon laquelle, les différences de dotations en facteurs poussent les
pays à se spécialiser et à exporter des biens et services
dont ils possèdent un avantage comparatif. Mais la mise en oeuvre de ces
théories en Afrique n'a pas favorisé le développement.
Certains pays développés (Botswana, Australie, Canada...) ont
plus mis l'accent sur la diversification pour s'industrialiser et se
développer. C'est pour autant dire quec'est la diversification qui est
au coeur du développement et non la spécialisation, car une
spécialisation trop poussée stimule la dépendance. La
vérification empirique du lien entre diversification des exportations et
croissance économique a fait l'objet des travaux et résultats
divers.
SECTION 3 : REVUE DES TRAVAUX EMPIRIQUES SUR LA
DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE
Plusieurs travaux empiriques ont, d'une façon
spécifique, pris en compte la relation entre la diversification des
exportations et la croissance économique.En effet, l'analyse des travaux
économétriques menés par Gutiérrez de
Piñeres et Ferrantino (2000) dans le cas des pays de l'Amérique
latine (le Chili, l'Uruguay, la Colombie...) en s'appuyant sur les
données de panel, montre qu'il existe bien une interaction positive
entre la diversification des exportations et la croissance économique.
Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par De Ferranti et
al. (2002) et Al-Marhubi (2000) dans des pays en développement ;
Hammouda et al. (2009) en Afrique du Nord entre 1980-2002 ; Mejia (2011) ;
Mudenda et al. (2014) dans le cas de l'Afrique du Sud. A travers les
modèles structurels de développement, Chenery, (1980), estime que
les pays devraient passer des exportations primaires aux exportations de
produits manufacturés pour aboutir à une croissance durable.
Dans le même ordre d'idées, Feenstra et Kee
(2004) dans leurs analyses sur le lien entre la productivité d'un pays
et la variété sectorielle de ses exportations, datant des
années 1984-1997 sur un échantillon de 34 pays, concluent qu'une
hausse de 10% de la diversité des exportations dans toutes les branches
entrainerait une augmentation de 1,3% de la productivité d'un pays. En
outre, la diversification des exportations vers les produits
manufacturés conduit à un taux de croissance plus
élevé, plus de productivité et un bien-être accru
(Haussman et al, 2007 ; Palma, 2005). En se focalisant sur la méthode
des moments généralisés, dans certains pays en
développement au cours de la période 2000-2009, Khodayi, hamed et
al (2014), arguent que la réduction de la spécialisation des
exportations, autrement dit l'augmentation de la diversification des
exportations a un effet significativement positif sur le taux de croissance
économique d'un pays.
C'est dans ce contexte que Hesse (2009), stipule que la
spécialisation principalement autour des produits de base expose les
pays à des chocs externes défavorables, entraînant une
détérioration des termes de l'échange avec pour
conséquence un ralentissement de la croissance. Naudé et Rossouw
(2011) concluent à une relation en U entre la spécialisation des
exportations et la croissance du revenu par habitant en Chine et en Afrique, en
utilisant des séries chronologiques.
En élaborant un modèle
économétrique des déterminants de la croissance
économique dans les économies de rente, riches en ressources
naturelles, à partir des données d'un échantillon
composé de 85 pays pour la période de 1965-1998, Gylfason (2005)
tente de comprendre les relations d'une part, entre la diversification
économique et la croissance et d'autre part, entre les autres
déterminants de la croissance et la diversification. Il conclut que tout
ce qui est bon pour la croissance encourage la diversification
économique.
Dans cette même perspective Sanassee et al. (2014), ont
montré dans un modèle à correction d'erreur
appliqué à Maurice qu'une augmentation de 1% de la
diversification des exportations se traduirait par une augmentation de 0,09% du
PIB réel à court terme et de 0,11% du PIB réel à
long terme. L'ajustement ne prendrait pas du temps selon les auteurs, parce que
la croissance économique contribue aussi à accroître la
diversification. A partir d'une approche économétrique par les
moindres carrés ordinaires (MCO), sur une période de 1981-2016,
Owan et al. (2020), soutiennent ainsi l'existence d'une relation positive et
significative entre le produit intérieur brut non pétrolier comme
mesure de la diversification économique et la croissance
économique tandis que les exportations non pétrolières
comme proxy de la diversification des exportations avaient un effet positif,
mais non significatif sur la croissance économique du Nigéria.
Dans leur analyse fondée sur l'hypothèse
d'existence d'une relation entre la diversification des exportations et la
croissance économique par le biais des externalités de
l'apprentissage par l'exportation et de l'apprentissage par la pratique, Herzer
et al. (2006) estiment une fonction de production type Cobb-Douglas
augmentée sur la base de données de séries chronologiques
du Chili sur la période 1962-2001. Leurs résultats montrent que
les diversifications horizontale et verticale des exportations favorisent la
croissance économique. Cette constatation corrobore les résultats
de Olaleye et al. (2013) qui concluent qu'une augmentation de la production du
secteur agricole entraînera une amélioration significative du
bien-être de la population au Nigeria. Des résultats similaires
ont été trouvés par plusieurs auteurs comme Agosin (2007)
et Ferreira (2009) ; Bakari, (2016), Lotti et Karim, (2017) dans la plupart des
pays de leur échantillon.
Imbs et Wacziarg (2003) dans leurs analyses portant sur
différents pays, sur la relation entre la concentration sectorielle
nationale et la structure du revenu par habitant, ont montré que la
diversification avait une relation en U inversé avec le niveau de
développement. Ainsi, selon eux, la croissance se manifeste par une
augmentation de la diversification sectorielle, mais à un certain seuil
de revenu par habitant, la distribution sectorielle de l'activité
économique a tendance à se reconcentrer. Mais leur étude a
surtout mis l'accent sur l'importance d'une gestion saine des facteurs
macroéconomiques dans les efforts de diversification des
économies.
Selon Levin et Raut (1997), lorsque les exportations totales
d'un pays comprennent une plus forte proportion d'exportations de produits
manufacturés, cela a un effet positif sur la croissance
économique.
En utilisant les données
désagrégées sur les exportations, Klinger et Lederman
(2004) montrent qu'alors que la diversification augmentait dans les pays peu
développés, elle diminuait lorsque les pays dépassaient un
certain revenu intermédiaire. Les nouveaux produits exportés
selon ces auteurs, avaient une forme d'une courbe en U inversée par
rapport aux revenus, ce qui présage que les économies deviennent
moins concentrées et plus diversifiées à mesure que les
revenus augmentent. Ce n'est qu'à des niveaux de revenus relativement
élevés qu'une augmentation de la croissance s'accompagne d'une
plus forte spécialisation et donc d'une plus faible diversification. Ces
résultats vont dans le même sens avec ceux obtenus par Cadot,
Carrère et Strauss-Kahn (2011).
Par ailleurs, Bakari et Mabrouki (2016), analysent la relation
entre la croissance économique, l'exportation et l'importation au Maroc
en s'appuyant sur les techniques de modélisation VAR et de
causalité au sens de Granger. Leurs résultats montrent
l'existence d'un effet de causalité qui va de la croissance
économique vers l'exportation alors qu'il n'existe aucun effet qui va de
l'exportation vers la croissance. Ce résultat est similaire avec ceux
obtenus par Sachin et al. (2015) dans le cas de l'Inde.
Cependant Chang et al. (2000), Sharma et Panagiotidis (2005)
trouvent des résultats qui ne semblent pas valider l'hypothèse de
la croissance tirée par les exportations. Nicet-Chenaf et Rougier (2008)
soulignent qu'une trop grande diversification des exportations peut nuire
à la croissance d'un pays. L'auteur a utilisé la méthode
des moments généralisés (GMM) et s'est concentré
sur la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, l'Algérie et
l'Israël.
Aditya et Roy (2009) sont parvenus également à
des conclusions similaires sur l'effet de la diversification des exportations
sur la croissance en utilisant la même démarche dans un
échantillon de 68 pays. De plus, Gutiérrez de Piñeres et
Ferrantino (2000) en utilisant les données des séries temporelles
obtiennent un effet négatif entre la diversification des exportations et
la croissance en Chili et en Colombie.
Conclusion partielle
En conclusion de ce chapitre, l'analyse approfondie a
porté sur la conceptualisation et la revue de la littérature sur
la diversification des exportations et la croissance économique. La
première section a détaillé les concepts clés de
diversification et de croissance, mettant en évidence les enjeux et
identifiant les déterminants de ce processus crucial. La revue de la
littérature théorique dans la section suivante a souligné
l'évolution des théories du commerce international, passant de la
spécialisation à la reconnaissance croissante de la
diversification comme moteur essentiel de la croissance, en particulier selon
les théories de la croissance endogène.
La dernière section a exploré les travaux
empiriques, révélant une diversité de résultats sur
la relation entre la diversification des exportations et la croissance
économique. Certains auteurs ont appuyé une corrélation
positive, mettant en lumière les avantages potentiels de la
diversification, tandis que d'autres ont signalé des effets
négatifs ou des seuils critiques.
En résumé, cette exploration approfondie a
jeté les bases nécessaires pour comprendre les aspects
théoriques et empiriques de la diversification des exportations et de
son impact sur la croissance économique. La prochaine étape
consistera à appliquer ces connaissances à notre contexte
spécifique, en analysant de plus près les données pour
évaluer comment ces concepts s'appliquent à notre sujet de
recherche.
Chapitre 5 CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EFFET
DE LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE
Dans cette partie,il s'agit principalement de mesurer l'effet
de la diversification des exportations sur la croissance économique. La
méthodologie que nous adoptons joue un rôle fondamental dans
l'attente de notre objectif de recherche, car elle détermine la
manière dont nous collectons, analysons et interprétons les
données nécessaires pour répondre à notre question
de recherche. En d'autres termes, c'est à travers la méthodologie
que nous nous efforçons d'atteindre une compréhension approfondie
et rigoureuse du sujet étudié. Le modèle de croissance
linéaire développé par Mankiw et al (1992) sera
adopté.Nous utiliserons comme modèle d'estimation, la
méthode des moindres carrés ordinaires (MCO).
SECTION 1 :METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Cette section met en évidence successivement la
présentation du modèle théorique, la source des
données, la liste des variables retenues, leurs descriptions et signes
attendus et la spécification du modèle empirique.
1.1 Présentation du
modèle théorique
Nous nous basons dans notre étude, sur le modèle
de croissance de Mankiw et al. (1992), Knight et al. (1993), Ghra et
Hadjmichael (1996) et Demetriades et Law (2006).
Notre point de départ est la fonction de production de
type CobbDouglass suivante :
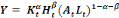 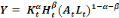 (1) (1)
Avec :
- Y, le Produit Intérieur Brut
réel par tête ;
- K, le stock de capital physique ;
- H, le stock de capital humain ;
- L, le travail brut ;
- A, facteur reflétant le niveau de
technologie et d'efficacité dans une économie donnée ;
- t, la période.
On suppose que  , c'est-à-dire que la recette est supposée
décroissante pour tout le capital (capital physique et capital humain).
Le travail brut (L) et le niveau de technologie (A) sont donnés par les
fonctions suivantes : , c'est-à-dire que la recette est supposée
décroissante pour tout le capital (capital physique et capital humain).
Le travail brut (L) et le niveau de technologie (A) sont donnés par les
fonctions suivantes :
  (2) (2)
  (3) (3)
Avec :
- n, le taux de croissance exogène du
travail ;
- g, le taux de croissance exogène du
progrès technologique ;
- I, un vecteur des variables
institutionnelles qui peuvent affecter le niveau de technologie et d'efficience
dans une économie donnée ;
 - -  , un vecteur des coefficients reliant ces variables institutionnelles. , un vecteur des coefficients reliant ces variables institutionnelles.
Dans ce modèle, la variable A dépend des
améliorations technologiques exogènes, du degré
d'ouverture commerciale et du niveau des autres variables. Il est
évident que la variable A, dans notre étude, diffère de
celle employée par Mankiw et al (1992). A l'état
d'équilibre, le rendement par ouvrier augmente à un taux constant
g (la composante exogène du taux de croissance de la variable
reflétant le niveau de technologie et d'efficience d'une
économie). Ces résultats peuvent être obtenus directement
à partir de la définition du rendement par ouvrier efficace
(productivité moyenne du travail) :
À partir des équations
précédentes, on obtient en log linéarisant
l'équation (4) suivante :
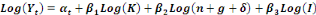 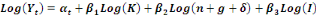 (4) (4)
Avec :
- Y, le Produit Intérieur Brut par
ouvrier (PIB/tête) ;
- I, un vecteur regroupant les variables
institutionnelles ;
- K, le stock du capital en investissement ou
accumulation du capital physique ;
- n, taux de croissance du travail (force de
travail) ;
- g, taux de croissance de la technologie ou
du progrès technologique ;
- ä, taux de dépréciation
du capital.
1.2 Source des données
Toutes les données sont tirées de la base WDI
(World Development Indicators) de la Banque mondiale à l'exception de
celles de l'indice de diversification des exportations et de la
stabilité politique. Elles proviennent respectivement du centre de
données du CNUCED et de WGI (World Governance Indicators). Les
données utilisées dans notre étude sont des données
annuelles et couvrent la période 1990 à 2021.
1.3 Liste des variables retenues
Le choix de nos variables est inspiré par la
littérature économique. Plusieurs travaux empiriques ont
expliqué les variables susceptibles de permettre de mesurer la relation
entre la diversification des exportations et la croissance économique. A
la lumière des travaux précédents dans la
littérature économique, nous avons retenu les variables
ci-après pour cette étude :
Il s'agit du Produit Intérieur Brut par habitant
(PIBh), l'Indice de Diversification des Exportations (HH), l'Ouverture
Commerciale en pourcentage du PIB, la Formation Brut du Capital Fixe en
pourcentage du PIB (FBCF), la part du Crédit Privé
accordée au secteur privé dans le PIB, la Part des Produits
Manufacturés dans les Exportations (PPMX), la Part des Ressources
Naturelles dans le PIB (PRN), la Population Totale (POP) et la Stabilité
Politique (STAT). Ces variables sont mises en évidence par de nombreuses
études empiriques (Hesse 2008, Kouakou et N'zue 2020).
1.4 Description des variables et
signes attendus
Dans le cadre de cette étude, nous explorerons
plusieurs variables clés qui jouent un rôle central dans l'analyse
et la compréhension du sujet en question. Ces variables, soigneusement
sélectionnées, permettent d'approfondir notre
compréhension et d'établir des liens significatifs au sein de
notre analyse.
D'après la revue de la littérature nos
variables sont les suivantes :
Ø Le Produit Intérieur Brut par habitant (PIBh)
qui mesure l'augmentation de la production par habitant (de biens et de
services) d'un pays pendant une longue période
(généralement l'année). La croissance du PIB par habitant
indique l'amélioration moyenne du niveau de vie de la population d'un
pays. Nous l'utilisons dans le modèle comme une variable
dépendante.
Ø L'indice de diversification des exportations
utilisé ici est celui de Herfindahl-Hirschman (HH). Celui-ci est compris
entre 0 et 1. En outre, de faibles valeurs de l'HH (valeurs proches de
zéro) indiquent une répartition plus uniforme des exportations
parmi une série de produits ou un ensemble diversifié de produits
d'exportation, tandis que des valeurs élevées (proche de
l'unité) révèlent un degré élevé de
concentration des produits exportés ou d'un portefeuille d'exportations
moins diversifié. Misztal (2011) a analysé la relation entre la
diversité des exportations et la croissance économique dans
l'Union européenne (UE) spécifiquement pour la période
1995-2009. Les résultats du modèle vectoriel autorégressif
(VAR) et de la décomposition de la variance ont montré que le
degré de diversité des exportations est l'un des
déterminants les plus importants du revenu par habitant et que 30% de la
variation du revenu par habitant s'explique par la densité des
exportations. L'étude a également révélé une
relation non linéaire entre le degré d'intensité des
exportations et le revenu par habitant. En d'autres termes, la diversité
des exportations augmente dans les pays à revenu par habitant
relativement faible, tandis que l'intensité des exportations augmente
dans les pays à revenu par habitant relativement élevé.
Ø L'ouverture Commerciale (Ouv), mesurée par la
somme des importations et des exportations sur le PIB. En d'autres termes, elle
mesure le degré de participation d'un pays aux échanges
internationaux et au commerce international et prend en compte : les tarifs
douaniers, les obstacles non tarifaires, les accords commerciaux, la
facilitation des échanges et l'ouverture aux investissements
étrangers.
Elle peut avoir deux effets sur la croissance : d'une part, la
dotation initiale de l'économie peut conduire à une mauvaise
spécialisation et donc un impact négatif sur la croissance chez
Krugman, (1987) et Young, (1991) ; d'autre part, l'ouverture peut permettre
l'accroissement du rythme d'accumulation du capital via le progrès
technique et le transfert de technologie (Romer, 1990).
Ø La Formation Brute de Capital Fixe (FBCF), est
l'agrégat qui mesure, en comptabilité nationale, l'investissement
(acquisition de biens de production) en capital fixe des différents
agents économiques résidents. L'investissement massif par les
entreprises dans le capital physique tels que les machines, les
équipements, les outils, ...etc est considéré comme l'un
des moteurs de la croissance et de la production selon Ahn et Hemmings (2000),
De Long et Summers (1992). Cet investissement en capital physique, aussi bien
en quantité et qualité, accroît la productivité du
travail par le renforcement de l'intensité capitalistique.
Ø Le Crédit Privé (CP) dans une
économie mesure l'ensemble des prêts accordés par les
institutions financières privées, telles que les banques
commerciales et les institutions de crédit, aux agents
économiques privés, tels que les ménages et les
entreprises.
Cependant, il faut noter que les recherches théoriques
et empiriques portant sur la relation entre le développement financier
et la croissance économique ont une importance pour les
économistes. L'analyse du sens de causalité entre la finance et
la croissance économique remonte aux travaux de Bagehot (1973). Depuis,
les économistes sont en désaccord sur le rôle du secteur
financier dans la croissance économique. D'aucuns soutiennent que le
développement financier est un facteur essentiel au développement
économique, tandis que d'autres révèlent que c'est la
croissance économique qui détermine le niveau de
développement financier d'un pays.
Ø La Part des Produits Manufacturés dans les
Exportations (PPMX) peut avoir une influence significative sur la croissance
économique d'un pays. Toutefois, il convient de noter que la relation
entre ces deux facteurs est complexe et dépend de nombreux autres
paramètres économiques et contextuels. En effet, les petites
économies ouvertes peuvent néanmoins croître plus
rapidement que leurs partenaires commerciaux sans encourir le risque d'une
crise de la balance des paiements si elles réussissent à
augmenter la variété de leurs produits. Ce lien entre croissance,
commerce et variété des produits a été mis en
évidence dans la littérature récente (Krugman, 1989 ;
Oliveira Martins, 1992 ; Funke et Ruhwedel, 2001). Cependant, l'augmentation du
nombre de variétés exigera un processus important de
restructuration économique du fait que la production demeure encore
relativement concentrée sur des produits homogènes et que la
densité d'entreprises est encore sensiblement plus faible.
Ø La relation entre la Part des Ressources Naturelles
(PRN) dans le PIB et la croissance économique est un sujet complexe et
peut varier d'un pays à l'autre en fonction de nombreux facteurs. Un des
grands débats en économie du développement concerne le
rôle des ressources naturelles sur la croissance des pays richement
dotés Sachs et Warner (1995) ; Sala-i Martin et Subramanian (2003) ;
Isham et al. (2005) ; Mehlum et al. (2006) ; Boschini et al. [2007]). En effet,
aucun consensus ne semble émerger sur l'effet réel de l'abondance
en ressources naturelles sur la croissance économique Alexeev et Conrad
(2009) ; Frankel (2010). Néanmoins, une vaste littérature essaie
de trouver les différents canaux qui peuvent expliquer l'effet (positif
ou négatif) de la ressource sur la croissance (corruption, insuffisance
de dépenses publiques, absence d'investissements, détournement
des forces productives vers les secteurs aux rendements d'échelles les
plus faibles...). Parmi les différents facteurs proposés, les
institutions et le système constitutionnel des pays sont un
élément clé de la gestion des ressources naturelles et
conditionnent l'effet négatif que celles-ci peuvent avoir sur
lacroissance (Mehlum et al. (2006) ; Andersen et Aslaksen (2008).
Ø La Population (POP) peut avoir un impact significatif
sur la croissance économique. L'interaction entre la taille de la
population, la démographie et le développement économique
peut être complexe et varier selon les circonstances et les politiques en
place. Les travaux de l'un des précurseurs sur la question notamment
Bloom ont ouvert une brèche importante dans la recherche de l'impact de
la structure de population sur la croissance économique. Bloom, et al.
1997 ses premiers travaux en la matière « demographic
transitions and economic miracles in emerging Asia » concluent que la
performance économique réalisée en Asie de l'Est
s'expliquait par la transition démographique caractérisée
par une croissance de la population en âge de travailler
supérieure à celle de la population passive durant la
période 1965-1990.
Ø La Stabilité (STAB) d'un pays a un impact
significatif sur la croissance économique. Une économie stable
offre un environnement propice à la croissance et à
l'investissement, tandis qu'un pays instable peut faire face à des
obstacles qui freinent le développement économique. Depuis le
début du vingtième siècle, les nouvelles stratégies
de développement ayant pour objectif principal la lutte contre la
pauvreté et les inégalités ont accordé une place
capitale à la qualité des institutions (El Jabri, 2022 ; Clarke,
2013). Elle constitue désormais le pilier d'un développement
durable, particulièrement pour les pays en voie de développement.
Dans cette perspective, le maintien de la stabilité politique constitue
l'une des préoccupations majeures dans la mesure où de nombreuses
initiatives visant la suppression de l'instabilité politique ont
été entreprises par les organisations internationales.
Tableau 3 : Signes
attendus
|
Codes variables
|
Coefficients
|
Résultats attendus
|
Sources
|
|
PIBh
|
-
|
-
|
World Development Indicators
|
|
HH
|
|
Positif
|
CNUCED
|
|
OUV
|
|
Positif
|
World Development Indicators
|
|
FBCF
|
|
Positif
|
World Development Indicators
|
|
CP
|
|
Positif
|
World Development Indicators
|
|
PPMX
|
|
Positif
|
World Development Indicators
|
|
PRN
|
|
Négatif
|
World Development Indicators
|
|
POP
|
|
Positif
|
World Development Indicators
|
|
STAB
|
|
Positif
|
World Development Indicators
|
Source :Construction de l'auteur à
partir des travaux empiriques
1.5Spécification empirique
du modèle
En s'inspirant de l'équation (4), notre modèle
empirique qui décrit la relation entre le taux de croissance et l'indice
de diversification des exportations peut s'écrire de la façon
suivante :
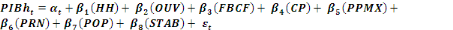 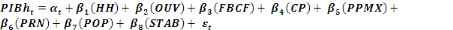 Pour t [1990 - 2021] (5) Pour t [1990 - 2021] (5)
La variable endogène est le Produit intérieur
Brute par Habitant (PIBH)
§ Les variables exogènes sont :
ü HH : Indice de Diversification des Exportations
ü OUV : Ouverture Commerciale
ü FBCF : Formation Brut du Capital Fixe
ü CP : Crédit Privé
ü PPMX : Part des Produits manufacturés dans
les Exportations
ü PRN : Part des Ressources Naturelles dans les
exportations
ü POP : Population Totale
ü STAB : Stabilité Politique
 ü ü  : terme d'erreur : terme d'erreur
SECTION 2 : ESTIMATION ET INTERPRETATION DES
RESULTATS
Dans cette section, nous procédons aux estimations des
variables de notre modèle et ensuite analysons les résultats
obtenus.
Tableau 4 : Statistique
descriptive des variables
|
Variable
|
Obs
|
Mean
|
Std. Dev.
|
Min
|
Max
|
|
PIBh
|
33
|
673593.2
|
85152.971
|
560203.4
|
857019.4
|
|
HH
|
33
|
.765
|
.034
|
.7
|
.817
|
|
OUV
|
33
|
54.607
|
8.374
|
38.774
|
80.648
|
|
FBCF
|
33
|
21.003
|
5.362
|
14.597
|
34.371
|
|
CP
|
33
|
20.065
|
6.951
|
11.237
|
32.297
|
|
PPMX
|
33
|
32.879
|
11.854
|
4.381
|
56.833
|
|
PRN
|
33
|
2.927
|
.944
|
1.717
|
5.934
|
|
POP
|
33
|
11716540
|
2926588.7
|
7536001
|
17316449
|
|
STAB
|
33
|
-.314
|
.244
|
-.988
|
.047
|
|
Source : Auteur, sur stata
Le tableau 4 montre
l'hétérogénéité de nos variables. On
constate pour l'indice de diversification des exportations (HH), il existe un
écart important autour de la moyenne. S'agissant du PIBh, le
Sénégal a enregistré en 1994 un montant de 560 203
milliards de dollars par rapport aux années
précédentesoù il était autour de 590 000
milliards de dollars. Cette mauvaise performance peut être
expliquée par la dévaluation qui a conduit à un
ralentissement des activités économiques.
Tableau 5 : Matrice de
corrélation
|
Variables
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
|
(1) PIBh
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) HH
|
-0.240
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) OUV
|
0.818
|
-0.311
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) FBCF
|
0.955
|
-0.162
|
0.869
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
(5) CP
|
0.827
|
-0.052
|
0.618
|
0.767
|
1.000
|
|
|
|
|
|
(6) PPMX
|
-0.105
|
-0.398
|
0.071
|
-0.046
|
-0.423
|
1.000
|
|
|
|
|
(7) PRN
|
0.555
|
-0.143
|
0.735
|
0.613
|
0.547
|
0.097
|
1.000
|
|
|
|
(8) POP
|
0.965
|
-0.330
|
0.850
|
0.936
|
0.841
|
-0.009
|
0.661
|
1.000
|
|
|
(9) STAB
|
0.614
|
-0.377
|
0.490
|
0.477
|
0.643
|
-0.339
|
0.163
|
0.601
|
1.000
|
Source : Auteur, sur stata
Le tableau 5 ci-dessus montre une corrélation
négative entre le PIBh et HH. Cela prouve la faible diversification des
produits exportés par le Sénégal. Toutefois, le tableau
renseigne qu'avec la FBCF, on a une corrélation positive pour l'ensemble
des variables. Ce qui atteste l'importance de l'investissement dans le
développement de l'industrie et la croissance économique.
Également, la STAB est corrélée positivement avec le PIBh
ce qui prouve le poids de la stabilité politique sur les performances
économiques d'un pays.
2.1 Tests de stationnarité
et de cointégration des variables du modèle
2.1.1 Test de stationnarité ou
tests de racine unitaire
Pour tester la stationnarité des variables nous avons
deux tests celui de Dickey-Fuller Augmenté et de
Phillips-Perron. Le choix du test de stationnarité
dépend souvent de la nature spécifique des données et de
l'objectif de l'analyse.Pour tester la stationnarité des variables de
notre modèle nous allons utiliser le test de Dickey-Fuller
Augmenté.
Les hypothèses à tester sont les
suivantes :
H0 : La variable X est non stationnaire
H1 : La
variable X est stationnaire
Tableau 6 :
Résultats stationnarité des variables
|
VARIABLES
|
T. STAT
|
I (.)
|
P Value
|
|
PIBh
|
-2.570
|
1
|
0.0993
|
|
HH
|
-4.547
|
1
|
0.0002
|
|
OUV
|
-5.587
|
1
|
0.0000
|
|
FBCF
|
-3.385
|
1
|
0.0115
|
|
CP
|
-3.743
|
1
|
0.0036
|
|
PPMX
|
-2.944
|
0
|
0.0405
|
|
PRN
|
-4.227
|
1
|
0.0006
|
|
POP
|
-3.174
|
2
|
0.0215
|
Source : Auteur, sur stata
Globalement le tableau (6) montre que les variables du
modèle sont stationnaires à des niveaux différents. En
outre, ces résultats du test de racine unitaire de Dickey-Fuller
Augmenté (ADF) et celui de Phillips-Perron (PP) nous ont montré
que la variable PPMX est stationnaire à niveau tandis que les variables
PIBh, HH, OUV, FBCF, CP et la PRN sont stationnairesen différence
première. En fin la variable POP est stationnaire en différence
second. Puisque toutes les variables ne sont pas intégrées de
même ordre, elles ne pouvaient donc pas être
cointégrées au sens de Granger selon la théorie
économétrique, ce qui nous a guidés à choisir un
modèle à correction d'erreur (MCE).
2.1.2 Test cointégration des variables du
modèle
Les hypothèses à tester pour la
cointégration des variables sont les suivantes :
H0 = Absence de cointégration
H1 = Présence de cointégration
Tableau 7 :
Résultats du test de cointégration
|
Rang maximal
|
Parms
|
LL
|
Valeurs Propres
|
Trace
|
5%
|
|
0
|
42
|
439.68813
|
-
|
148.4859
|
94.15
|
|
1
|
53
|
475.77811
|
0.90255
|
76.3059
|
68.52
|
|
2
|
62
|
501.43275
|
0.63648
|
44.9364*
|
47.21
|
|
3
|
69
|
508.2754
|
0.47440
|
24.9967
|
29.68
|
|
4
|
74
|
513.92535
|
0.35690
|
11.3114
|
15.41
|
Source : Auteur, sur stata
Au moins nous avons deux relations de cointégration, on
rejette l'hypothèse H0 on note une relation de cointégration
entre les variables du modèle.Ainsi, nous utiliserons dans le cadre de
ce travail de recherche le modèle à correction d'erreur.
2.2 Interprétations desrésultats et
discussions
2.2.1 Résultats des estimations
du modèle à correction d'erreur
Tableau 8 :
Résultat des estimations du modèle
|
lPIBH
|
Coef.
|
St.Err.
|
t-value
|
p-value
|
[95% Conf
|
Interval]
|
Sig
|
|
HH
|
0.12
|
0.198
|
0.60
|
0.055
|
-0.29
|
0.529
|
*
|
|
lOUV
|
-0.09
|
0.09
|
-1.00
|
0.325
|
-0.276
|
0.095
|
|
|
lFBCF
|
0.199
|
0.078
|
2.54
|
0.018
|
0.038
|
0.361
|
**
|
|
lCP
|
-0.057
|
0.04
|
-1.42
|
0.167
|
-0.14
|
0.026
|
|
|
lPPMX
|
-0.05
|
0.019
|
-2.61
|
0.015
|
-0.089
|
-0.011
|
**
|
|
PRN
|
-0.008
|
0.009
|
-0.88
|
0.386
|
-0.027
|
0.011
|
|
|
lPOP
|
0.438
|
0.105
|
4.17
|
0000
|
0.221
|
0.655
|
***
|
|
STAT
|
0.024
|
0.037
|
0.63
|
0.532
|
-0.054
|
0.101
|
|
|
Constant
|
6.328
|
1.485
|
4.26
|
0000
|
3.263
|
9.394
|
***
|
|
|
Mean dependent var
|
13.413
|
SD dependent var
|
0.122
|
|
R-squared
|
0.968
|
Number of obs
|
33
|
|
F-test
|
89.728
|
Prob > F
|
0.000
|
|
Akaike crit. (AIC)
|
-141.177
|
Bayesian crit. (BIC)
|
-127.708
|
|
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1
|
|
Source : Auteur, sur stata
Après estimation, nous constatons que le modèle
est globalement significatif en effet au moins 4 variables ont un effet
significatif sur le PIBh qui est la variable à expliquer. En effet, le
tableau 8 montre que l'Indice de Diversification des exportations (HH), la
Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) et la démographie (POP) ont un
effet positif et significatif sur la croissance économique. Par contre,
la Part des Produits Manufacturés dans les Exportations (PPMX) a un
effet négatif sur la croissance.
Il faut noter donc quela diversification des exportations est
un déterminant important de la croissance économique du
Sénégal, même si la variable d'ouverture s'avère
être non significative.
Des conclusions similaires ont été
trouvées par la plupart des études qui ont confirmé
l'hypothèse qu'une expansion et une diversification des exportations
conduisent à une augmentation de la production, cette relation positive
n'est pas toujours soutenue dans la littérature. En effet, Michaely, M.
(1977) a constaté que la relation positive significative entre
diversification des exportations et croissance économique se
réalise le plus souvent dans les pays développés que dans
les pays les moins avancés. Il a donc soutenu qu'un niveau minimum de
développement était nécessaire pour que les exportations
aient un effet sur la croissance économique. De même, Chang et
al(2000). Dans un contexte VAR ont examiné les relations entre les
revenus, les exportations et les importations à Taïwan de 1971
à 1995. Ils ont constaté que la diversification des exportations
avait un léger effet négatif sur les revenus et que, par
conséquent, l'hypothèse de croissance tirée par les
exportations ne s'appliquait pas à Taïwan. Sharma et Panagiotidis
ont cherché à tester l'hypothèse de croissance
tirée par les exportations dans le cas de l'Inde sur la période
1971-2001 en utilisant différentes approches et leurs conclusions ont eu
tendance à renforcer les arguments infirmant la croissance tirée
par la diversité des exportations.
Le constat sur la Formation Brute du Capitale Fixe (FBCF) est
que si elle augmente de 10% le PIB augmente de 2% toutes choses égales
par ailleurs.
Quant aux produits manufacturés, les résultats
révèlent un effet négatif sur la croissance
économique. Si la PPMX augmente de 10% le PIB baisse de 0,5%. Selon
Bensafta, K.M. (2014), le signe négatif de ce coefficient suppose
l'existence d'un effet seuil : en dessous de 40% de part des exportations
des produits manufacturés dans les exportations totales, la relation est
négative et ce résultat suggère que la transmission
positive de l'exportation des produits manufacturés vers la croissance
commence à partir du seuil de 40%. En dessous de ce seuil, l'impact peut
être négatif. Bien que nous ne disposons pas de données
permettant d'appuyer cette position, il semble plausible de croire que certains
effets d'apprentissage puissent être néfastes.
En outre, dans le cas de la transformation destinée
à l'exportation vers d'autres pays moins développés, par
exemple, il est possible que des goûts inadéquats se
développent et affectent les industries locales. Ces possibilités
sont probablement reliées aux activités de marketing des
entreprises transnationales. Willmore (1990), par exemple, souligne l'impact
négatif de certains produits nouveaux et différenciés
exportés par des firmes étrangères établies en
Amérique centrale sur les autres pays membres du marché commun.
Dans cette optique, Levin et Raut (1997), ont conclu qu'il pouvait y avoir une
forte incidence positive sur la croissance économique lorsque
les exportations totales d'un pays comprennent une plus forte
proportion d'exportations de produits manufacturés.
Pour la variable Population, les mêmes constats ont
été notés, si elle augmente de 10% le PIB augmente de 4.4%
toutes choses égales par ailleurs. Cela montre que le dividende
démographique a un effet favorable sur les performances
économiques du Sénégal. Des résultats similaires
ont été avancés par un groupe de chercheurs et à
l'issue de leurs recherches, c'est ainsi qu'un concept révolutionnaire a
pris l'essor en l'occurrence le « dividende démographique ».
Dans ce même ordre d'idées, Bloom et al. (1997) ont tenté
d'expliquer les performances économiques réalisées dans
l'Asie sud-est et l'Asie du Sud durant la fin du 20esiècle et
ont trouvé que la transition démographique, le passage de fort au
faible taux de mortalité et fertilité était
l'élément moteur de cette forte croissance que l'on a
qualifié de miraculeuse. Après cette étude, il y a eu un
regain d'intérêt sur les questions démographiques dans le
monde et son lien avec l'économie. Dans la foulée, nous pouvons
citer les travaux des auteurs considérés comme des pionniers en
la matière ; Bloom, Canning et Fink (2008) ; Bloom, Canning, Fink, et
Finlay (2009) ; Bloom, Canning, Fink (2009) ; Bloom, Canning, Fink, et Finlay
(2007) ; Bloom, Canning, Fink et Finlay (2009).
Par contre, nos résultats montrent un effet non
significatif dans le PIB des variables Ouverture Commerciale (OUV),
Crédit Privé (CP), Part des Ressources Naturelles dans les
Exportations (PRN) et le la Stabilité Politique (STAB). Ces
résultats pourraient s'expliquer du fait que nos exportations ne sont
pas suffisamment diversifiées afin de pouvoir influencer sur la
croissance économique du fait de la faible industrialisation de
l'économique sénégalaise.
Pour plusieurs auteurs (Aka, 2010 ; Esso, 2010, Kuipou et al.,
2015), le secteur financier joue un rôle déterminant sur la
croissance économique. Les travaux d'Esso (2009), sur les pays de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) exceptée
la Guinée-Bissau, présente des résultats divergents quant
à l'effet du secteur financier sur la croissance économique.
L'auteur montre que le ratio des crédits octroyés au secteur
privé du Bénin affecte négativement le Produit
Intérieur Brute (PIB) par tête au seuil de 10%. Cet effet est
également négatif au seuil de 5% au Togo. En revanche, le ratio
du crédit alloué au secteur privé sur le PIB par
tête du Mali a un effet positif au seuil de 10%. En dépit de ces
pays, le secteur financier n'a aucun effet sur le PIB par tête du Burkina
Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal. Dans les
pays en développement, le secteur financier n'affecte pas
forcément la croissance économique pour plusieurs raisons :
« la nature et l'orientation des crédits distribués, la
concentration bancaire, le niveau élevé des taux
d'intérêt, la faiblesse des dispositifs institutionnels,
comptables, réglementaires et prudentiels » (Sène, 2018, p.
2).
S'agissant de la variable stabilité politique (STAB)
les résultats font ressortir un effet non significatif sur la croissance
économique sénégalaise. Le taux de croissance
économique est en moyenne le plus élevé dans les pays
stables, environ plus de deux fois plus élevé que les pays
instables. En revanche, ce sont les pays instables qui connaissent les taux de
croissance le plus et le moins élevé.Depuis le début du
vingtième siècle, les nouvelles stratégies de
développement ayant pour objectif principal la lutte contre la
pauvreté et les inégalités ont accordé une place
capitale à la qualité des institutions (El Jabri, 2022 ; Clarke,
2013).Elle constitue désormais le pilier d'un développement
durable, particulièrement pour les pays en voie de développement.
Dans cette perspective, le maintien de la stabilité politique constitue
l'une des préoccupations majeures dans la mesure où de nombreuses
initiatives visant la suppression de l'instabilité politique ont
été entreprises par les organisations internationales. Au
départ, le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le
développement des Nations Unies de 1987 (CMED, 1988), dit rapport
Brundtland, définit le développement durable (DD) comme le «
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins ».
2.2.2 Tests de validation du modèle
2.2.2.1 Test de corrélation des
résidus de Breusch-Godfrey
Tests d'hypothèses
H0 : les erreurs sont non-auto corrélées
H1 : les erreurs sont autos corrélées
|
lags(p)
|
chi2
|
Df
|
Prob > chi2
|
|
1
|
5.829
|
1
|
0.0158
|
Source :Auteur, test sur stata
Au seuil de 5% on rejette H0 ; les erreurs ne sont pas
corrélées ; la probabilité est inférieure
à 5%.
2.2.2.2 Test de normalité des erreurs
Hypothèses à tester
H0 : les erreurs ne suivent pas une loi normale
|
VARIABLES
|
OBSERVATION
|
PR(SKEWNESS)
|
PR(KURTOSIS)
|
ADJ_CHI2(2)
|
PROB>CHI2
|
|
RÉSIDUS
|
33
|
0.2145
|
0.1643
|
3.76
|
0.1525
|
H1 : les erreurs suivent une loi normale
Source :Auteur test sur stata
Au seuil de 5% on rejette H0 les erreurs suivent une loi normale
la probabilité est supérieur à 5%.
2.2.2.3 Test de stabilité (Chow, Cusum)
Hypothèses à tester
H0 : le modèle est stable
H1 : le modèle n'est pas stable
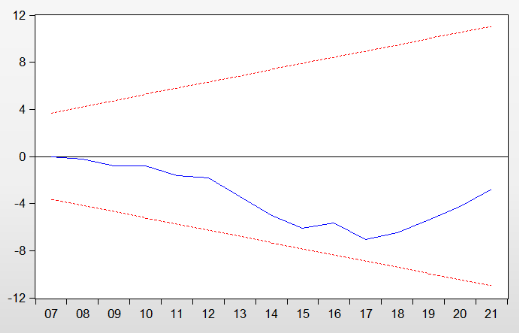
Source :Auteur, sur stata
D'après les différents tests
économétriques effectués, on peut avancer que notre
modèle est bien spécifié, que la distribution des
résidus est normale, qu'il y'a une absence d'auto corrélation
ainsi qu'une absence d'hétéroscédasticité entre les
résidus. Le modèle est donc structurellement et
conjoncturellement stableau cours de la période d'étude la courbe
ne touche pas le corridor. Les tests montrent que nos résultats sont
robustesde ce fait, il peut être utilisé à des fins de
prévisions économétriques. Et on peut
affirmer que la diversification des exportations améliore
la croissance économique au Sénégal.
SECTION 3 : IMPLICATIONS DE POLITIQUES ECONOMIQUES
Notre méthodologie repose sur une modélisation
basée sur l'approche des moindres carrés ordinaires (OLS),
développée par Legendre (1805) et Gauss (1809), pour estimer les
coefficients d'une régression linéaire. Cette technique a
été appliquée à notre étude portant sur le
Sénégal sur la période de 1990 à 2021. Les
résultats de nos estimations ont révélé que la
diversification des exportations stimule la croissance économique. Plus
précisément, la diversification des exportations s'est
avérée positive mais non significative sur la croissance du
Sénégal. Étant une mesure inverse de l'indice de
concentration, un coefficient négatif indique une relation
négative entre la concentration des exportations et le PIB par habitant,
traduisant ainsi une relation négative entre la diversification et la
variable dépendante, à savoir le PIB.
La question centrale de notre étude était
d'explorer l'effet de la diversification des exportations sur la croissance
économique au Sénégal. Pour ce faire, nous avons d'abord
testé la causalité entre la diversification des exportations
sénégalaises et sa croissance économique, puis
examiné l'impact de cette diversification sur la croissance. Notre
analyse, basée sur des éléments factuels, la
théorie et une étude empirique sur la période de 1990
à 2021, vise à tirer des conclusions et à formuler des
implications de politiques économiques, même si la
littérature existante ne parvient pas à des conclusions
unanimes.
Le cadre théorique suggère que la
diversification des exportations favorise la croissance économique,
contredisant certains auteurs affirmant que la concentration des exportations a
des effets négatifs retardant la croissance. L'examen des faits au
Sénégal révèle un faible niveau de
développement et de diversification comparé au plan mondial,
principalement en raison de l'exportation massive de produits primaires et du
manque d'industrialisation.
Notre analyse des faits a mis en lumière les politiques
de diversification entreprises par le Sénégal, mais malgré
ces réformes, les exportations du pays ne sont pas encore suffisamment
diversifiées.
À la lumière de ces résultats, les
actions ci-après peuvent être envisagées pour une
coordination renforcée des politiques commerciales, la promotion de la
diversification des exportationset la stimulation de la croissance
économique.
· Favoriser l'intégration des entreprises locales
dans les chaînes de valeur mondiales.
· Investir dans la recherche et le développement
pour créer des produits compétitifs sur le marché
mondial.
· Fournir un soutien financier et technique aux
industries émergentes pour leur accès aux marchés
internationaux.
· Mettre en place des incitations fiscales pour
moderniser les équipements et les infrastructures.
· Mettre en place des politiques industrielles et des
incitations fiscales ciblées pour le secteur manufacturier.
· Investir dans le renforcement des institutions
publiques pour assurer l'État de droit et la transparence.
· Promouvoir le dialogue politique et mettre en place des
mécanismes de médiation pour prévenir les crises
politiques et sociales.
En mettant en oeuvre ces recommandations, il est possible de
créer un environnement propice à la croissance économique
durable et inclusive, en exploitant efficacement les facteurs qui ont
été identifiés comme ayant un impact positif sur le
PIB.
Pour finir, il convient de souligner que ces actions vont
au-delà du cadre de notre étude et prennent en compte tous les
aspects de l'économie sénégalaise.
Conclusion partielle
Le chapitre 3 de cette étude se concentre sur l'analyse
de l'effet de la diversification des exportations sur la croissance
économique au Sénégal. La méthodologie
adoptée, basée sur la méthode des moindres carrés
ordinaires (MCO), est détaillée, mettant en lumière la
présentation du modèle théorique, la source des
données, la liste des variables retenues, leurs descriptions, signes
attendus et la spécification du modèle empirique.
Le modèle théorique repose sur la fonction de
production de type Cobb-Douglas, avec une variable dépendante
représentant le Produit Intérieur Brut par habitant (PIBh). Les
données utilisées proviennent de diverses sources, telles que la
base WDI de la Banque mondiale, le centre de données du CNUCED et les
Indicateurs Mondiaux de Gouvernance (WGI). Les variables retenues,
inspirées par la littérature économique, incluent le PIB
par habitant, l'Indice de Diversification des Exportations (HH), l'Ouverture
Commerciale (Ouv), la Formation Brute du Capital Fixe (FBCF), le Crédit
Privé (CP), la Part des Produits Manufacturés dans les
Exportations (PPMX), la Part des Ressources Naturelles dans le PIB (PRN), la
Population Totale (POP) et la Stabilité Politique (STAB).
La spécification empirique du modèle est
présentée, mettant en avant la relation entre le taux de
croissance et l'indice de diversification des exportations. Les
résultats des estimations du modèle à correction d'erreur
sont analysés, montrant que plusieurs variables, telles que l'Indice de
Diversification des Exportations, la Formation Brute du Capital Fixe, la
Population et la Stabilité Politique ont des effets significatifs et
positifs sur la croissance économique.
Les tests de stationnarité, de cointégration, et
de validation du modèle sont également présentés,
démontrant la robustesse des résultats. Les implications de
politiques économiques sont abordées, suggérant une
coordination efficace des politiques commerciales, la promotion de la
diversification des exportations et l'amélioration de la
stabilité politique pour favoriser une croissance durable.
CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS
Le commerce extérieur et les exportations permettent
à une nation de poser les bases d'une économie robuste et
résiliente aux aléas de l'environnement économique. Au
Sénégal, les exportations restent de faible portée au plan
mondial en dépit de tous les atouts dont regorge le pays. Cette
insuffisance soutient la nécessité de donner un nouveau souffle
à cette partie de l'économie. C'est dans ce contexte que
s'inscrit le travail que nous venons de réaliser sur la diversification
des exportations qui pour nous est une piste louable pour contourner la
faiblesse des exportations au niveau mondial.
Par ailleurs, notre étude a détecté de
façon prioritaire les déterminants qui favorisent la
diversification pour enfin analyser quelle influence ont ces variables sur la
croissance économique. Ainsi, notre étude révèle
que l'Indice de Diversification des exportations (HH), la Formation Brute du
Capital Fixe (FBCF), la Part des Produits Manufacturés dans les
Exportations(PPMX) et la démographique (POP) ont un effet positif sur la
croissance économique. Par contre, les variables Ouverture commerciale
(OUV), Crédit Privé (CP), Part des Ressources Naturelles dans les
exportations (PRN) et Stabilité politique (STAB) n'ont pas d'impact sur
la croissance économique sénégalaise.
Bien que notre étude ait révélé
une influence de certaines variables sur la croissance économique
sénégalaise dans le long terme, nous restons optimistes sur
l'efficacité des stratégies de diversification des exportations.
Nous recommandonsles mesures suivantes qui permettrontd'améliorer la
cohérence des actions de l'État en faveur de la diversification
des exportations afin d'inverser la tendance d'une économie
concentrée.
Ainsi, l'étude recommande dans un premier temps la
réorganisation des secteurs traditionnels exportateurs et dans un second
temps l'extension de la transformation à la gamme supérieure de
produits exportés.
Nos résultats invitent à une recommandation
spécifique. Le Sénégal devrait renforcer son processus de
diversification en se concentrant sur le développement de chaînes
des valeurs. Cela implique une réorganisation des secteurs
traditionnelles d'exportation avant d'engager un processus de transformation de
ces produits exportés vers une gamme plus importante, potentielle source
de valeur ajoutée. Une politique de remontée des filières
avec des mécanismes de limitation des chocs sectoriels serait donc
idéale.
Etant donné que nos résultats ont montré
que l'indice de diversification des exportations (HH) a contribué de
manière positive mais non significative sur la croissance
économique, des politiques de promotion des exportations devraient
être élaborées et appuyées pour stimuler la
croissance. En outre, il faudrait créer un environnement propice
à l'attrait des investissements directs étrangers dirigés
à l'exportation, mettre en place des infrastructures de transport et de
communication efficaces, en oeuvrant pour l'emploi de main-d'oeuvre
qualifiée, en développant des opportunités de
coopération entre l'industrie et les universités en particulier,
un environnement politique stable et en améliorant les connaissances
techniques et juridiques des entreprises, seraient les moyens
d'améliorer l'environnement des affaires. Aussi, l'étude a
révélé que la croissance économique au
Sénégal serait stimulée si la promotion des exportations
était soutenue par des investissements accrus dans la formation de
capital et des améliorations de la qualité de la vie puisque ces
deux variables avaient un effet positif et significatif sur la croissance du
PIB réel.
Cependant, nous pouvons affirmer et reconnaitre que nos
hypothèses n'ayant pas été totalement validées,
notre étude présente des lacunes qui sont exploitables pour
améliorer nos résultats et apporter un plus à la recherche
sur ce thème. Comme faiblesses, nous notons la non prise en compte de
certaines variables telles que le taux de change, l'indice de production
industrielle et la non-disponibilité de certaines données.
Le Sénégal a une économie d'apparence
diversifiée ce qui n'est pas conforme à la réalité
économique. Cette réalité montre clairement que les
matières premières et ses dérivées constituent
l'épine dorsale de nos exportations. Partant de ce constat
apprécier l'effet de la diversification sur les exportations devient
difficile sur le plan économétrique.
Par ailleurs, il faut noter que malgré les
résultats de l'étude, la réalité économique
et au regard de l'environnement économique international très
instable, la diversification reste une piste favorable pour mettre
l'économie sénégalaise à l'abri des risques et aux
chocs exogènes. Cependant, la recherche pourra s'intéresser
à l'effet des nouvelles technologies sur le commerce.
REFERENCES
Acemoglu, D. et F. Zilibotti (1997), « Was Prometheus
unbound by chance? Risk diversification and growth », Journal of Political
Economy 105(4), pages 709 à 751.
Ahluwalia, M. S., Carter, N. G., & Chenery, H. B. (1979).
Growth and poverty in developing countries. Journal of development
economics, 6(3), 299-341.
Ahn, S. et Hemmings, P. (2000). Influences des politiques
sur la croissance économique dans les pays de l'OCDE : une
évaluation des données probantes.
Aka, B. E. (2010). Développement Financier, Croissance
Économique et Productivité Globale des Facteurs en Afrique
Subsaharienne. African Development Review, vol. 22, n°1, p.
23-50.
Alexeev M. et Conrad R. [2009], « The Elusive Curse of Oil
», The Review of Economics
Al-Marhubi, F. (2000). Export diversification and growth: An
empirical investigation. Applied Economics Letters, 7(9), 559-562.
https://doi.org/10.1080/13504850050059005and
Statistics, 91 (3), p. 586-598.
Andersen J. J. et Aslaksen S. [2008], « Constitutions and
the resource curse », Journal
Bagehot, W. (1873). Lombard Street: A Description of the
Money Market. London, H. S. King.
Bensafta, K.M. (2014). Les exportations des produits
manufacturés et convergence du niveau de vie : cas d'un pays exportateur
de pétrole
Bernhofen, DM et Brown, JC
(2018). Rétrospectives : sur le génie
derrière la formulation de l'avantage comparatif de David Ricardo en
1817. Journal des perspectives économiques, 32 (4),
227-240.
Boschini A. D., Pettersson J. et Roine J. [2007], «
Resource Curse or Not: A Question of Appropriability », Scandinavian
Journal of Economics, 109 (3), p. 593-617.
Cuddington, JT, Ludema, R. et Jayasuriya, SA
(2002). Redux Prebisch-singer (n° 1506-2016-130803).
Dadzie, K. (1988). La dépendance économique de
l'Afrique vis-à-vis de l'exportation des produits de base. Politique
étrangère, 647-666.
David E. Bloom et Jeffrey G. Williamson, Demographic
Transitions and Economic; Miracles in Emerging Asia, NBER Working Paper N°
6268, November 1997.
David E. Bloom, David Canning, et Günther Fink, Disease
and development revisited, NBER Working Paper N°15137, July 2009.
David E. Bloom, David Canning, et Günther Fink,
Population Aging and Economic Growth, World Bank Working Paper N°32,
September 2007.
David E. Bloom, David Canning, Günther Fink, et Jocelyn
E. Finlay, Fertility, female labor force participation, and the demographic
dividend, Journal of Economic Growth, Vol. 14, 2009, p. 79-101.
David E. Bloom, David Canning, Günther Fink, et Jocelyn
E. Finlay, The cost of low fertility in Europe, NBER Working Paper
N°14820, March 2009.
David E. Bloom, David Canning, Günther Fink, et Jocelyn
Finlay, Realizing the demographic dividend: Is Africa any different? Program on
the Global demography of aging, Havard University, May 2007.
De Long, JB, Summers, LH et Abel, AB
(1992). Investissement en équipement et croissance
économique : quelle est la force du lien ?. Documents
Brookings sur l'activité économique, 1992 (2),
157-211.
Dornbusch, R., Sturzenegger, F., Wolf, H., Fischer, S. et
Barro, RJ (1990). Inflation extrême : dynamique et
stabilisation. Documents Brookings sur l'activité
économique, 1990 (2), 1-84.
Esso, L. J. (2009). Développement financier, croissance
économique et inégalités de revenus entre les pays de
l'UEMOA. Consortium pour la Recherche Économique et Sociales (CRES),
Dakar-Sénégal, 31 p.
Esso, L. J. (2010). Re-examing the Finance-Growth Nexus:
Structural Break, Threes-hold Cointegration and Causality Evidence from the
ECOWAS. Journal of Economic Development, vol. 35, n°3, p. 57-79.
Frankel J. A. [2010], « The Natural Resource Curse: A Survey
», NBER Working Papers 15836, National Bureau of Economic
Research, Inc.
Funke, M. et Ruhwedel, R. (2001). Variété
des exportations et performances à l'exportation : preuves
empiriques en Asie de l'Est. Journal de l'économie
asiatique, 12 (4), 493-505.
Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Trade, knowledge
spillovers, and growth. European economic review, 35(2-3),
517-526.
Hausmann, R. et B. Klinger (2006), Structural transformation
and patterns of comparative advantage in the product space, Center for
International Development at Harvard University, CID Working Paper n° 128,
Cambridge, Massachusetts.
Helpman, E. (1987). Imperfect competition and international
trade: Evidence from fourteen industrial countries. Journal of the
Japanese and international economies, 1(1), 62-81.
Hwang, J. (2006), Introduction of new goods, convergence and
growth, Harvard University Job Market Paper, Cambridge, Massachusetts.
Isham J., Woolcock M., Pritchett L. et Busby G. [2005], «
The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and
the Political Economy of Economic Growth », World Bank Economic Review, 19
(2), p. 141-174.
Krugman, P. (1980), « Scale economies, product
differentiation, and the pattern of trade », American Economic Review
(70)5, pages 950 à 959.
Krugman, P. (1980). Économies d'échelle,
différenciation des produits et structure des échanges. La
Revue économique américaine, 70 (5), 950-959.
Krugman, P. R. (1987), "A model of Innovation, Technology
Transfer, and the World Distribution of Income", Journal ofPolitical Economy,
87, Pages 253-256.
Krugman, PR (1989). Organisation industrielle et commerce
international. Manuel d'organisation industrielle, 2 ,
1179-1223.
Lucas Jr, RE (1988). Sur les mécanismes du
développement économique. Journal d'économie
monétaire, 22 (1), 3-42.
Mayer, N., & Perrineau, P. (1996). Le Front national
à découvert (p. 418). Presses de Sciences Po.
Mehlum H., Moene K. et Torvik R. [2006], « Institutions
and the Resource Curse », Eco nomic Journal, 116 (508), p. 1-20.
Misztal, P. (2011). Export diversification and economic growth
in European Union member states. Oeconomia, 10(2), 55-64.
Moussa, Hamidou Hama; (2005-12). Les effets des
investissements publics sur la croissance économique au Niger. Dakar.
(c) NU. IDEP.
Moussa, M. (1978). Ajustement dynamique dans le
modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson. Journal d'économie
politique , 86 (5), 775-791.
Note d'Analyse du Commerce Extérieur du
Sénégal, Edition 2021
Oliveira Martins, J., Scarpetta, S. et Pilat, D.
(1996). Taux de majoration dans les industries manufacturières :
estimations pour 14 pays de l'OCDE (n° 162). Éditions
OCDE.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) (2004), La situation des marchés des produits
agricoles 2004, Rome.
Oumba, C. N. (2021). Diversification des exportations et
croissance économique au Congo. Annale des Sciences Economiques et
de Gestion,
Romer, GS (1990). Réponse de la communauté
de poissons et des espèces de la zone de surf à un gradient
d'énergie des vagues. Journal de biologie des
poissons, 36 (3), 279-287.
Romer, P. M. (1990), "Endogenous Technological Change",
Journal of Political Economy, Vol.98, N° 5, pp. 1002-1031.
Romer, P. M. (1990), « Endogenous technological change
», Journal of Political Economy (98)5, pages 71 à 102.
Sachs J. D. et Warner A. M. [1995], « Natural Resource
Abundance and Economic Grow th »,NBER Working Papers 5398, National Bureau
of Economic Research, Inc.
Sala-I Martin X. et Subramanian A. [2003], « Addressing
the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria », NBER Working
Papers 9804, National Bureau of Economic Research, Inc.
Samuelson, Pennsylvanie (1949). Une nouvelle
péréquation internationale des prix des facteurs. La revue
économique, 59 (234), 181-197.
Sène, B. (2018). La relation entre finance et
croissance revisitée dans les pays de l'Afrique Subsaharienne : banque
versus marchés financiers. L'Actualité économique,
Revue d'analyse économique, vol. 94, n°1, mars, p. 1-29.
Smith, A.(1776) « An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations », London : Strahem and Caddell.
Yetkiner, I. H. (2003). A Short Note On The Solution Procedure
Of Barro And Sala-i-Martin for Restoring Constancy Conditions.
Septième session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED VII)
Young, A. (1991), "Learning by doing and the Dynamic Effects
of International Trade", Quarterly Journal ofEconomics, Vol.116, Issue 2, Pages
369-405
ANNEXES
Annexe 1 : Base de données de l'étude
(1990-2021)
|
ANNEES
|
PIBPH
|
HH
|
OUV
|
FBCF
|
CP
|
PPMX
|
PRN
|
POP
|
|
1990
|
593 750
|
0,82
|
45
|
15
|
20
|
4
|
2
|
7 536 001
|
|
1991
|
592 384
|
0,81
|
42
|
15
|
19
|
10
|
2
|
7 754 289
|
|
1992
|
583 630
|
0,81
|
41
|
15
|
20
|
15
|
2
|
7 974 514
|
|
1993
|
575 544
|
0,81
|
39
|
15
|
20
|
20
|
2
|
8 196 551
|
|
1994
|
560 203
|
0,81
|
55
|
17
|
13
|
26
|
3
|
8 416 997
|
|
1995
|
576 077
|
0,81
|
53
|
15
|
11
|
25
|
3
|
8 632 681
|
|
1996
|
573 708
|
0,80
|
46
|
16
|
12
|
48
|
3
|
8 843 423
|
|
1997
|
577 588
|
0,80
|
47
|
16
|
12
|
46
|
3
|
9 051 539
|
|
1998
|
597 789
|
0,79
|
48
|
19
|
11
|
53
|
3
|
9 261 526
|
|
1999
|
620 802
|
0,77
|
49
|
18
|
12
|
57
|
2
|
9 478 564
|
|
2000
|
629 932
|
0,73
|
49
|
19
|
15
|
27
|
2
|
9 704 287
|
|
2001
|
641 633
|
0,75
|
50
|
19
|
11
|
29
|
2
|
9 938 027
|
|
2002
|
626 754
|
0,77
|
53
|
20
|
12
|
51
|
2
|
10 180 950
|
|
2003
|
645 732
|
0,75
|
51
|
17
|
13
|
36
|
3
|
10 434 504
|
|
2004
|
659 030
|
0,75
|
54
|
17
|
14
|
39
|
2
|
10 698 691
|
|
2005
|
670 186
|
0,70
|
55
|
18
|
16
|
45
|
2
|
10 974 057
|
|
2006
|
668 190
|
0,72
|
54
|
21
|
16
|
43
|
2
|
11 263 387
|
|
2007
|
669 227
|
0,72
|
59
|
21
|
16
|
36
|
2
|
11 563 869
|
|
2008
|
675 944
|
0,75
|
63
|
23
|
19
|
39
|
3
|
11 872 929
|
|
2009
|
676 202
|
0,71
|
52
|
20
|
19
|
38
|
4
|
12 195 029
|
|
2010
|
680 435
|
0,76
|
52
|
19
|
21
|
38
|
3
|
12 530 121
|
|
2011
|
670 997
|
0,75
|
58
|
21
|
24
|
40
|
4
|
12 875 880
|
|
2012
|
679 083
|
0,72
|
62
|
21
|
24
|
39
|
5
|
13 231 833
|
|
2013
|
676 859
|
0,73
|
61
|
22
|
26
|
29
|
3
|
13 595 566
|
|
2014
|
699 701
|
0,75
|
58
|
23
|
27
|
29
|
3
|
13 970 308
|
|
2015
|
724 247
|
0,73
|
58
|
23
|
27
|
29
|
3
|
14 356 181
|
|
2016
|
749 645
|
0,76
|
54
|
24
|
28
|
32
|
4
|
14 751 356
|
|
2017
|
783 586
|
0,77
|
58
|
26
|
30
|
29
|
3
|
15 157 793
|
|
2018
|
809 952
|
0,78
|
62
|
28
|
30
|
28
|
3
|
15 574 909
|
|
2019
|
824 768
|
0,79
|
64
|
30
|
30
|
24
|
3
|
16 000 781
|
|
2020
|
813 698
|
0,77
|
60
|
30
|
29
|
26
|
3
|
16 436 120
|
|
2021
|
844 279
|
0,78
|
69
|
34
|
30
|
27
|
4
|
16 876 720
|
Source : WDI, WGI, CNUCED
TABLE DES
MATIERES
DEDICACE.................................................................................. ..............I
REMERCIEMENTS.....................................................................................II
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS.......................................................IV
LISTE DES TABLEAUX ET
FIGURES...........................................................VI
Chapitre 6
RESUME..................................................................................................VII
ABSTRACT..............................................................................................VIII
SOMMAIRE.............................................................................................IX
Chapitre 7
INTRODUCTION GENERALE
......................................................................1
Chapitre 8 CHAPITRE
1 : PRESENTATION DE L'ECONOMIE SENEGALAISE ET DYNAMIQUE DU
COMMERCE EXTERIEUR ....................................................5
SECTION 1 :
CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE SENEGALAISE......5
2.1 Situation globale des échanges
extérieurs........................................7
2.2 Orientation géographique des échanges du
Sénégal.............................9
2.3 Structure des échanges extérieurs par
groupes de produits....................11
SECTION 3 : POLITIQUES DE
DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS
SENEGALAISES..........................................................................................13
3.1 La Stratégie de
Développement et de Promotion des Exportations
(STRADEX)..............................................................................13
3.2 La Stratégie Nationale de
la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (SN-ZLECAf)
..........................................................................14
3.3 La Stratégie Nationale de
Développement des Exportations (SN-EXPORT
2035).....................................................................................15
3.4 La Stratégie de
Développement du Secteur Privé (SDSP
2021-2025).....................................................................................16
3.5 L'Etude
Import-Substitution.....................................................16
3.6 La Nouvelle Politique et
Stratégie de Développement Industriel
(NPSDI)..................................................................................17
Chapitre 9 CHAPITRE
2 : CONCEPTUALISATION ET REVUE DE LA LITTERATURE SUR LA DIVERSIFICATION DES
EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE
...............................................................................................................19
SECTION 1 :
CONCEPTUALISATION..................................................19
1.1
Diversification........................................................................19
1.1.1 Les enjeux de la
diversification.................................................20
1.1.2 Les déterminants de la
diversification.........................................20
1.1.3 Croissance
économique..........................................................21
SECTION 2 : DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS A LA
LUMIERE DE LA LITTERATURE THEORIQUE
.......................................................22
SECTION 3 : REVUE DES TRAVAUX EMPIRIQUES SUR LA
DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS ET LA CROISSANCE.............24
Chapitre 10 CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L'EFFET DE LA
DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE
ECONOMIQUE................................28
SECTION 1 : METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE ...........................28
1.1 Présentation du
modèle théorique
................................................28
1.2 Source des données
................................................................30
1.3 Liste des variables
retenues.......................................................30
1.4 Description des variables et signes
attendus.....................................30
1.5 Spécification empirique du
modèle...............................................34
SECTION 2 : ESTIMATION ET INTERPRETATION DES
RESULTATS.......35
2.1 Tests de stationnarité et de
cointégration des variables du modèle...........36
2.1.1 Test de stationnarité
ou tests de racine unitaire...............................36
2.1.2 Test cointégration des variables du
modèle....................................37
2.2 Interprétations des résultats et
discussions.......................................38
2.2.1 Résultats des
estimations du modèle à correction
d'erreur.................38
2.2.2 Tests de validation du
modèle...................................................41
2.2.2.1 Test de corrélation
des résidus de Breusch-Godfrey.......................41
2.2.2.2 Test de normalité des
erreurs .................................................42
2.2.2.3 Test de stabilité
(Chow, Cusum)..................................... ........42
SECTION 3 : IMPLICATIONS DE POLITIQUES
ECONOMIQUES....................44
CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS....................................................48
REFERENCES.........................................................................................49
ANNEXES...............................................................................................55
TABLE DES
MATIÈRES............................................................................56
* 1 Voir Imbs, J., et R.
Wacziarg (2003) et Cadot, Carrère et Strauss-Kahn (2011a), entre
autres.
* 2 Voir Meilak (2008) ;
Loayza et al. (2007) ; Banque mondiale (1999) ; Ghosh et Ostry (1994) ; et
Bleaney et Greenaway (2001), entre autres.
| 


