|
_REPUBLIQUE DU BENIN_
*******
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE(MESRS)
*******
UNIVERSITE D'ABOMEY -CALAVI (UAC)
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
(FASEG)
*******
MEMOIRE DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCE
ECONOMIQUE
ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA DEMANDE DU MAÏS ET
DE SES DERIVES AU BENIN
OPTION : Economie
appliquée
|
Réalisé et soutenu
par :
|
|
AYEDOUN A. O. Alfred & OGOU A. Eugène
|
|
Sous la supervision de :
|
|
Maître de mémoire
|
Maître de stage
|
|
Dr. Laurent OLOUKOÏ
|
Dr. SOSSOU C. Hervé
|
Enseignant à la FASEG Chef du PAPA
Novembre 2016
PRELIMINAIRE
LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI
IMPROBATION AUX IDEES EMISES DANS CE DOCUMENT, CELLES-CI DOIVENT ETRE
CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS
DEDICACE
Je dédie cette oeuvre :
Ø A mes très chers parents, CHABI
Sévérine et AYEDOUN Samuel, pour leur amour indéfectible
et vos sacrifices pour moi. Recevez ce mémoire comme une preuve de la
consécration de vos efforts quotidiens. Que l'Eternel vous prête
longue vie, pour que vous puissiez jouir des fruits de vos entrailles.
Ø A ma soeur Caroline et son époux, pour leur
soutien et accompagnement. Que l'Eternel leur comble de ses riches
bénédictions.
AYEDOUN O. A. Alfred
DEDICACE
Je dédie ce mémoire :
Ø A Mr BIAOU A. Felix et son épouse.Sansleur
amour et leur assistance aussi morale que matérielle, rien ne serait
possible. Recevez à travers ce modeste travail le réconfort de
vos efforts, le témoignage respectueux de ma profonde reconnaissance.
Ø A ma mère AFFOUDA Y. Sabine. Toi qui n'as
ménagé aucun effort pour assumer ton rôle de mère
à mes côtés, saches que c'est de toi que me vient cette
force.
OGOU Akiyo Eugène
REMERCIEMENTS
Il serait difficile de rester indifférents aux efforts
de tous ceux qui se sont investis dans notre formation à la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) et à la
réalisation de ce mémoire.
Nos remerciements les plus indicibles vont à l'endroit
de :
v Dr. Laurent OLOUKOÏ, notre maître de
mémoire pour sa disponibilité permanente malgré ses
multiples occupations. Qu'il trouve ici nos sincères reconnaissances,
v Dr. SOSSOU C. Hervé, Chef du Programme Analyse de
Politique Agricole, pour l'accueil chaleureux et l'attention
particulière qu'il nous a accordé lors du déroulement de
notre stage,
v Tout le personnel du Programme Analyse de Politique Agricole
pour son sens de courtoisie et pour l'accueil et l'ambiance chaleureux dont il
a fait preuve,
v Dr. ADEGBOLA Patrice, Directeur général de
l'INRAB et à tous les chercheurs de l'INRAB pour leurs
différents apports et suggestions dans cet ouvrage,
v Tout le corps professoral de la FASEG,
v Toutes les familles AYEDOUN, OGOU, CHABI, et BIAOU
v Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à la réalisation de cette oeuvre.
Enfin, nous ne saurions terminer sans remercier Dieu, pour son
soutien, sa sagesse et son intelligence dont il nous gratifie chaque jour.
SIGLES
ET ABREVIATIONS
|
AIDS
|
:Almost Ideal Demand System
|
|
CRA
|
:Centre de Recherche Agricole
|
|
FAO
|
:Food and Agricutural Organisation of the United Nation
|
|
FASEG
|
:Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
|
|
FCFA
|
: Franc de la Communauté Financière Africaine
|
|
IITA
|
: International Institut of Tropical Agricultural
|
|
INRAB
|
: Institut National de Recherche Agricole au Bénin
|
|
INSEE
|
: Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
|
|
LESR
|
: Laboratoire d'Economie et de Sociologie Rurale
|
|
MAEP
|
: Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la
Pêche
|
|
MAP
|
: Matrice Analyse de la Politique
|
|
ONASA
|
: Office National d'Appui à la Sécurité
Alimentaire
|
|
ONS
|
: Office National de Soutien des revenus agricoles
|
|
PAM
|
: Programme Alimentaire Mondial
|
|
PAPA
|
: Programme Analyse de la Politique Agricole
|
|
PAPVIRE-ABC
|
: Projet d'Appui à la Production Vivrière dans
les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines
|
|
PDAVV
|
: Projet de Diversification Agricole par la Valorisation des
Vallées
|
|
PPAAO
|
: Programme de Productivité Agricole en Afrique de
l'Ouest
|
|
PPMA
|
: Projet de Promotion de la Mécanisation Agricole
|
|
PSRSA
|
: Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole
|
|
PUASA
|
: Programme d'Urgence d'Appui à la
Sécurité Alimentaire
|
|
RNDH
|
: Rapport National sur le Développement Humain
|
|
SCRP
|
: Stratégie de Croissance pour la Réduction de
la Pauvreté
|
SOMMAIRES
INTRODUCTION
2
CHAPITRE
1 : CADRE THEORIQUE
3
SECTION 1 : Problématique, Objectifs et
Hypothèses
4
SECTION 2 : Revue de la
littérature
6
CHAPITRE
2 : CADRE INSTITUTIONNEL
22
SECTION 1 : Présentation du lieu de
stage
23
SECTION 2 : Déroulement du stage au
PAPA
32
CHAPITRE
3 : CADRE METHODOLOGIQUE ET RESULTATS
34
SECTION 1 : Méthodologie de
recherche
35
SECTION 2 : Résultats des analyses et
interprétation
42
Conclusion partielle
54
Conclusion et recommandations
60
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
61
TABLE DES MATIERES
63
LISTE
DES TABLEAUX
Tableau 1: Les différents types
d'élasticité prix de la demande
2
Tableau 2 : Classification des biens selon
leur élasticité-revenu
41
Tableau 3 : Niveau d'éducation en
fonction du sexe
44
Tableau 4: Age moyen des enquêtés
en fonction du sexe
44
Tableau 5: Quantité consommée
des produits
47
Tableau 6: Dépenses moyennes des
ménages
48
Tableau 7: Dépenses moyennes des
ménages par produits
49
Tableau 8 : Statistiques descriptives des
variables du modèle
50
Tableau 9: Déterminants de la demande
du maïs et de ses dérivés dans le modèle AIDS
51
Tableau 10 : Elasticités revenu
56
Tableau 11 : Elasticité prix propre des
produits
57
Tableau 12 : Elasticités prix
croisés
59
LISTES
DES FIGURES
Figure 1 : Principaux produits
dérivés du maïs ; source : Production et valorisation du
maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest, archive
de la FAO
12
Figure
2 : Organigramme du PAPA
30
Figure 3: Effectifs des ménages
enquêtés au niveau de chaque département par sexe.
44
Figure 4 : Niveau d'alphabétisation en
fonction du sexe
45
Figure 5: Situation matrimoniale
47
Figure 6: Occupation des
enquêtés
47
Figure 7: Types de produits consommés
par les ménages selon le sexe
48
Figure 8: Proportion de consommation des produits
selon la tranche d'âge
50
Résumé
Parmi toutes les cultures vivrières, le maïs se
singularise par la très large extension de son aire de culture et de
consommation. Il constitue le principal aliment de base de toute la partie
méridionale du Bénin, soit les 2/3 de la population nationale.
Ainsi, une meilleure compréhension des facteurs qui déterminent
la demande du maïs et de ses dérivés est importante dans le
cadre de la formulation des politiques permettant de réduire la
vulnérabilité des ménages et d'assurer la
sécurité alimentaire. C'estpourquoi, cette étude a
été élaborée afin d'analyser les différents
facteurs économiques ou non qui influencent la demande du maïs et
de ses dérivés au Bénin.
Pour déterminer les facteurs qui expliquent la demande
du maïs et de ses dérivés au
Bénin,nousavonsutilisédesdonnées issues d'une
enquête menée par le Programme Analyse de la Politique Agricole
(PAPA/INRAB) auprès de 390 ménages béninois. L'analyse
s'est effectuée en se basant sur le modèle du système de
demande presque idéale (AIDS). Les résultats de cette
étude montrent que le sexe et l'âge sont des facteurs qui ne sont
pas liés aux prix des produits mais qui influencent la demande des
beignets du maïs. Les prix du maïs et de ses dérivés,
les dépenses des ménages affectées à la
consommation du maïs et de ses dérivés expliquent la
quantité demandée de ces derniers. Cependant, la demande du
maïs frais, de la pâte du maïs, d'akassa et de kokoyaya est
élastique à leur prix propre tandis que la demande du maïs
bouilli, du maïs grillé, d'egbo, aklui et des beignets du maïs
est inélastique. De plus, l'étude a montré que les biens
tels que : egbo et beignets du maïs sont substituables aux autres
biens, tandis que les biens tels que : maïs frais, pâte du
maïs, akassa et kokoyaya sont complémentaires entre eux et aux
autres biens.
Enfin, pour soutenir l'économie béninoise et
lutter contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement doit
mettre en place une politique qui vise à augmenter la production du
maïs afin de satisfaire la demande nationale. De même, il doit
appliquer une politique de régulation des prix afin de booster la
consommation.
Mots clés : Déterminant,
Demande du maïs, consommation, élasticités.
INTRODUCTION
La crise alimentaire et financière qui a frappé
le monde entier notamment les pays africains en 2008 et qui a compromis la
sécurité alimentaire au Bénin a amené les
autorités des divers pays touchés à mettre en place des
mesures correctives. En effet, au lendemain de la crise, le Gouvernement
béninois a pris un certain nombre de mesures. Au plan agricole, bon
nombre de programmes ont été conçus et mis en oeuvre. On
peut citer notamment le Programme d'Urgence d'Appui à la
Sécurité Alimentaire (PUASA), le Projet de Diversification
Agricole par la Valorisation des Vallées (PDAVV) et le Projet de
Promotion de la Mécanisation Agricole (PPMA).
En vue de permettre à l'agriculture de jouer
efficacement son rôle dans l'économie, un processus de
réflexions concertées entre tous les acteurs du monde agricole et
rural a été engagé. Ce processus a conduit à
l'élaboration du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole
(PSRSA) qui considère dès lors la promotion des filières
comme l'axe majeur à partir duquel le secteur agricole contribuerait
à la mise en oeuvre des OSD. Ainsi, selon la « note
d'orientation stratégique de promotion des filières agricoles au
Bénin, 2011 », les filières ci-après sont
retenues pour être promues : maïs, manioc, riz, viande, poisson
pour les questions de sécurité alimentaire et
nutritionnelle ; ananas, coton, crevettes pour les produits d'exportation.
Aussi, les filières comme les cultures maraichères, l'anacarde et
le lait sont prises en compte. Les critères qui ont favorisé le
choix de ces filières sont au nombre de cinq (5) : contribution de
la filière à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ; contribution de la filière à
l'amélioration de la croissance économique ; contribution de
la filière à l'amélioration des revenus des
ménages ; degré d'intégration de la filière
dans la structure de l'économie béninoise ;
développement équilibré et durable des régions.
Au nombre des filières à promouvoir, figure en
bonne place le maïs. Plusieurs raisons expliquent ce choix. En effet,
certains anciens travaux dont celui de Nago (1989) révélaient
déjà que la contribution du maïs est de 85% dans
l'alimentation humaine sous diverses formes (frais, grillé, pâte,
bouillie, akassa). Aussi, selon le PSRSA (2011), la production vivrière
est dominée par le maïs qui est l'aliment de base du
béninois et qui représente plus de 76% de la production
céréalière.
Habituellement cultivé au sud et au centre
(départements de l'Ouémé/Plateau, Mono/Couffo,
Atlantique/Littoral et Zou/Collines), la production de maïs s'est
étendue aux zones de production du coton dans les régions
septentrionales. Le volume de la production a franchi la barre des 800 000
tonnes en 2004 (statistiques agricoles MAEP) et celle de 1 million de tonnes en
2009. C'est la seule céréale pour laquelle, le Bénin
dégage des excédents exportables vers les pays voisins, le Niger
en l'occurrence. Si un tel essor se maintient, cette filière pourrait
devenir une filière d'exportation tout en maintenant sa place dans la
consommation intérieure et dans nos habitudes alimentaires.
Ainsi, le maïs a une importance économique de
premier ordre au niveau mondial pour l'alimentation humaine, pour
l'alimentation animale ou comme source d'un grand nombre de produits
industriels (FAO, 2002). Le maïs occupe aujourd'hui la première
place dans le système alimentaire national et reste la
céréale la plus consommée loin devant le riz et le sorgho.
Il constitue le principal aliment de base de toute la partie méridionale
du Bénin, soit les 2/3 de la population nationale (Adégbidi et
al., 2003 ; PSRSA, 2010). Le maïs est largement cultivé pour ses
grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Aliment de
base, il est consommé sous plusieurs formes. C'est le produit agricole
qui fait l'objet du plus grand nombre de transformations
A cet effet, cette culture a besoin d'une meilleure attention
de la part des acteurs qui l'animent. Il reste à réorganiser et
structurer la filière en veillant à la régularité
et à la pérennité de l'approvisionnement en intrants, de
la commercialisation primaire et de l'écoulement croissant vers les
marchés extérieurs des surplus de production après la
garantie de la sécurité alimentaire. Cependant, pour assurer la
sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté au
Bénin, il est important de savoir les différents facteurs qui
influencent le niveau de consommation du maïs et de ses
dérivés auprès des ménages béninois.
Dans le but de faire ressortir ces facteurs, le présent
mémoire se donne le privilège de réfléchir sur le
thème qui suit : « Analyse des facteurs déterminants de
la demande du maïs et de ses dérivés au
Bénin ». Ce document est subdivisé en trois grands
chapitres. Le premier est consacré au cadre théorique, le
deuxième aborde le cadre institutionnel et le dernier présente la
méthodologie de recherche et fait l'analyse des résultats.
CHAPITRE 1 : CADRE
THEORIQUE
Ce chapitre contient deux sections. Nous allons
présenter dans la première section la problématique, les
objectifs et les hypothèses de recherche. La seconde section est
consacrée à la revue de littérature.
SECTION 1 : Problématique, Objectifs et
Hypothèses
1.1.
Problématique
Le Bénin est un pays dont l'économie est
basée fondamentalement sur l'agriculture. Cette dernière occupe
la majeure partie de la frange active de la population et contribue pour une
part importante au Produit Intérieur Brut (PIB). Les revenus de
l'agriculture représentent au Bénin près de 36% du PIB,
88% des recettes d'exportation et ce secteur emploie 70% de la population
active (Adégbola et al. 2012). L'agriculture demeure un secteur riche en
opportunités tant au niveau de la production, de l'exportation, que
celui de la transformation. Ainsi la place prépondérante de
l'agriculture dans l'économie béninoise repose sur une gamme
très réduite de cultures vivrières dont les principales
sont le maïs, le manioc, le sorgho, le niébé, l'igname
etc.
De toutes ces cultures vivrières, le maïs se
singularise par la très large extension de son aire de culture et de
consommation. La culture du maïs occupe près de 70% de la
superficie totale consacrée aux céréales et
représente environ 75% de la production céréalière
(MAEP, 2010). De 230.000 tonnes au début des années 70, la
production du maïs au Bénin est passée de 1.065.329tonnes
durant la campagne 2009-2010 à 1.345.821tonnes pendant la campagne
2013-2014, soit un accroissement de 26.33% (RNDH, 2015). Cette
céréale constitue la base de l'alimentation au Sud du
Bénin et est également cultivée au Nord comme culture de
rente. Il est à ce jour la céréale la plus
consommée au Bénin loin devant le riz et le sorgho et tient une
place prépondérante dans la sécurité alimentaire de
la population. Le maïs rentre aujourd'hui dans l'alimentation des
populations de toutes les régions du pays sous diverses formes (soient,
quarante-trois (43) mets locaux sont à base de maïs qui constitue
de ce fait, la principale céréale cultivée au Bénin
et contribue d'une façon significative à la satisfaction des
besoins alimentaires de base de la population mais également pour
l'alimentation du bétail et donc pour l'élevage).
En effet, 70 % des populations du Sud et Centre-Bénin,
se nourrissent de la pâte de maïs le soir et de la bouillie de
maïs le matin. Sur le plan national, la consommation moyenne par habitant
et par an est de 69 kg et cette consommation est la plus élevée
dans le département de l'Ouémé (103 kg/habitant/an), puis
dans celui du Mono (96 kg/habitant/an), et enfin dans celui de l'Atlantique (92
kg/habitant/an). Les autres départements se situent en dessous de la
moyenne (69 kg/habitant/an).
C'est la seule céréale pour laquelle le
Bénin dégage des excédents exportables vers les pays
voisins, le Niger en l'occurrence. Si un tel essor se maintient, cette
filière pourrait devenir une filière d'exportation tout en
maintenant sa place dans la consommation intérieure et dans nos
habitudes alimentaires. On ressort de ces observations que le marché
national du maïs n'est pas négligeable. Et il fait aussi l'objet
d'importantes transactions commerciales avec les Etats voisins, dont le
Nigeria, le Niger et le Togo (ONS).
Compte tenu de l'importance que présente cette
céréale aussi bien pour la sécurité alimentaire que
pour l'économie nationale, le Gouvernement béninois lui a
accordé une place capitale dans son document de réduction de la
pauvreté (SCRP, 2007). Grâce au potentiel dont dispose le
Bénin dans ce secteur, il a bénéficié d'un Centre
National de Spécialisation agricole du PPAAO qui a pour objectif
d'appuyer les programmes de recherche développement sur le maïs. Ce
centre met l'accent sur la politique de la production agricole et la politique
de marché dont la demande est quasi-inexistante.
Le rapport de CERNA (2010) sur la consommation alimentaire
des ménages ressort que le maïs est la céréale la
plus consommée par les ménages au Bénin quelle que soit la
fréquence de consommation (déjeuner et dîner). Par
ailleurs, la confrontation des besoins domestiques de consommation aux
disponibilités en produits vivriers permet d'obtenir le bilan vivrier
(ONASA, 2009). Ce bilan vivrier pour le cas spécifique du maïs est
excédentaire en 2009 même en forte hypothèse de
consommation du maïs par les populations béninoises. Au cours de la
campagne agricole 2009-2010 (en hypothèse de consommation moyenne), 52
communes ont dégagé des surplus commercialisables, soit une offre
de maïs de près de 517000 tonnes. Les départements du
Borgou, de l'Alibori et du Plateau dégagent à eux seuls plus de
63% de cette offre locale. Le Bénin subit une forte pression de demande
de maïs sur ses stocks disponibles (PAM, 2012). Ces stocks ont
été vivement sollicités en raison d'une importante demande
intérieure de la part des ménages et des institutions et de la
demande extérieure venant du Sahel et du Nigéria.
Ainsi, comme le pense Keynes, c'est la demande
anticipée d'un bien qui détermine le niveau de production
réelle de ce dernier. Car il ne sert à rien de continuer à
produire un bien ou d'augmenter le stock quand la production de ce dernier
n'est pas demandée ou ne trouve pas de débouchée. Donc la
demande (consommation) constitue un des facteurs clés
d'amélioration de la production.
In fine, vue l'importance qu'occupe cet aliment dans la
consommation alimentaire des ménages et la forte pression de la demande
intérieure des ménages, il est important de délimiter les
données économiques ou non, qui peuvent influencer la demande de
cet aliment et celle de ses dérivéspour assurer la
sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté au
Bénin. D'où notre thème de recherche
« Analyse des déterminants de la demande du maïs
et de ses dérivés au Bénin ».Dans le
but d'apporter des propositions de réponse à ce sujet, nous nous
proposons d'axer nos réflexions sur les différentes questions qui
suivent :
- Qu'est-ce qui explique la demande du maïs et de ses
dérivés au Bénin ?
- Comment la demande du maïs et de ses
dérivés évolue-t-elle par rapport à ces
facteurs ?
1.2.
Objectifs de recherche
1.1.1. Objectif
global
Cette recherche a pour objectif principal d'analyser les
facteurs qui expliquent la demande du maïs et de ses dérivés
au Bénin.
1.1.2. Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, l'étude vise
à :
Ø Estimer les déterminants de la demande du
maïs et de ses dérivés au Bénin ;
Ø Calculer les élasticités prix et revenu
de la demande du maïs et de ses dérivés au Bénin.
1.3.
Hypothèses
Les hypothèses retenues pour l'étude et dont la
vérification pourrait permettre d'analyser les facteurs qui
déterminent la demande du maïs et de ses dérivés au
Bénin sont :
H 1 : Quand le revenu des ménages
augmente, la demande du maïs et de ses dérivés augmente.
H 2 : L'augmentation des prix du
maïs et de ses dérivés entraine une baisse de la demande du
maïs et de ses dérivés.
H 3 : Le maïs et ses
dérivés sont des biens normaux.
H 4 : La demande du maïs et de ses
dérivés est inélastique par rapport au prix et au
revenu.
SECTION 2 : Revue de la littérature
Cette section comprend quatre parties. La première
partie aborde l'historique et l'évolution de la production du maïs
et de ses dérivés au Bénin, la deuxième fait une
clarification conceptuelle de la demande, ensuite la troisième partie
présente les facteurs déterminants la demande et enfin la
dernière partie remémore quelques études empiriques
menées par les chercheurs.
2.1.Historique et évolution de la production du
maïs et de ses dérivés au Bénin
Son nom vernaculaire le plus commun est maïs. Ce terme
vient de l'espagnol maíz, emprunté lui-même à la
langue des Taínos de Haïti qui le cultivaient. De nombreux autres
noms vernaculaires ont été appliqués à cette
céréale, notamment blé indien, blé de Turquie et
blé de Barbarie. Désuets pour la plupart, ces noms
témoignent de la confusion qui a longtemps régné en Europe
sur l'origine de la plante. Le maïs occupe une place de choix dans
l'alimentation des populations du Bénin; cela explique le niveau
élevé de la production du maïs dans le pays.
Après son introduction au Bénin au XVIe
siècle par les Portugais, la culture du produit s'est d'abord
développée dans la partie méridionale avant de
s'étendre depuis une vingtaine d'années à la zone
septentrionale. Néanmoins, plus de 80 % de la production sont encore
assurés par la zone sud, dont environ 40 % des surfaces emblavées
sont consacrés à la culture du maïs (Nago, 1986).
Malgré le caractère rudimentaire des techniques
culturales, la production nationale a enregistré une hausse importante
au cours des dix dernières années, passant de 750.447 tonnes en
2000-2001 à 1.205.200 tonnes en 2009-2010. Cet accroissement
résulte principalement de la croissance démographique, de la
capacité de cette céréale à s'adapter à des
zones agro-écologiques diverses, de l'évolution des choix
d'emballement et de l'importance du maïs dans les transactions
commerciales et l'alimentation des populations dans l'ensemble du pays.
Les variétés cultivées se distinguent par
plusieurs caractéristiques: la durée du cycle de culture, le
rendement, la couleur, la forme et la dureté du grain. Bien qu'elles
aient des rendements peu élevés (750 kg/ha en moyenne contre plus
de 3.500 kg/ha pour les variétés sélectionnées),
les variétés locales sont les plus cultivées et les plus
consommées dans le pays car elles sont moins exigeantes pendant la phase
culturale, se conservent mieux durant le stockage et leurs
caractéristiques physico-chimiques (grains blancs et tendres en
général, teneur en amidon élevée...) et
répondent mieux aux exigences des préparations alimentaires,
domestiques et artisanales (DPP/MAEP 2010)..
Le maïs est en effet, parmi les produits vivriers
du pays, celui qui fait l'objet du plus grand nombre de transformations
alimentaires: une quarantaine de produits en dérivent (figure 1 :
principaux produits dérivés du maïs ; source :
Production et valorisation du maïs à l'échelon villageois en
Afrique de l'Ouest, archive de la FAO). Bon nombre de ces
produits sont préparés aussi bien par les ménages que par
le secteur artisanal.
La plupart des technologies de transformation du maïs
utilisées dans le secteur artisanal proviennent du patrimoine culturel
local. Il s'agit, en effet, de techniques domestiques, transmises et
pérennisées à travers l'éducation familiale, qui
furent progressivement intégrées et utilisées à
plus grande échelle dans des activités marchandes. Les
événements socio-économiques ayant favorisé cette
évolution technologique sont nombreux mais interdépendants: exode
rural, explosion urbaine, chômage, difficultés économiques,
etc.
Les procédés utilisés sont
généralement longs et complexes. Les trois quarts des produits
élaborés sont de nature fermentée. A l'origine, certains
de ces aliments étaient préparés et consommés
exclusivement par quelques groupes ethniques. Mais le brassage des populations
et le développement de l'artisanat alimentaire ont favorisé la
diffusion des produits et des procédés de fabrication,
particulièrement dans les centres urbains comme Cotonou.
Parmi les produits commercialisés par le secteur
artisanal, deux grandes catégories peuvent être
distinguées: Les produits prêts à cuire (produits
semi-finis), qui sont achetés essentiellement par les ménages
urbains pour gagner du temps dans la préparation de certains aliments;
les produits prêts à consommer, qui comprennent les plats
cuisinés, les snacks et les boissons.
ü LES PRODUITS SEMI-FINIS: DESCRIPTION ET
FABRICATION
Les produits semi-finis dérivés du maïs
sont constitués par les farines et les pâtes fermentées
(mawè et ogui). Les farines ordinaires et torréfiées sont
des produits de première transformation obtenus après mouture des
grains secs (teneur en eau: 10 à15 %) avec ou sans torréfaction
préalable.
- Le mawè est un produit consistant, de couleur blanche
et de saveur acide qui est la base de départ pour la préparation
de nombreux aliments. Pour son élaboration, le maïs est
concassé, tamisé avant d'être finement moulu. Après
addition d'eau et pétrissage, le produit est mis à fermenter
pendant 2 à 7 jours. C'est un produit riche en eau et en amidon, mais
pauvre en protéines. Les opérations pénibles
identifiées dans cette préparation sont le lavage du gritz, le
tamisage et le pétrissage.
- L'ogui est une pâte fermentée moins
consistante, moins blanche, mais plus humide que le mawè (teneur en eau:
80-85 %). Il est obtenu selon un procédé différent qui
comporte, préalablement à la mouture et à la fermentation,
des étapes de précuisson et de trempage des grains. Son pH et ses
teneurs en amidon et en protéines sont proches de ceux du mawè.
Les opérations jugées pénibles par les transformatrices
sont les mêmes que celles relevées dans la technologie du
mawè. L'ogui est également utilisé pour la
préparation de divers aliments.
ü LES PRODUITS FINIS: DESCRIPTION ET
FABRICATION
Les pâtes cuites sont obtenues par cuisson à
l'eau bouillante des produits crus précédents. Le malaxage, le
pétrissage, la cuisson et l'emballage sont généralement
les opérations technologiques jugées les plus pénibles
pour leur préparation.
Ces pâtes cuites sont de plusieurs types:
- La pâte ordinaire (owo) faite à partir de la
farine entière ;
- La pâte au jus de poulet (amiwo): pâte
aromatisée obtenue par cuisson de la farine de maïs dans le jus de
poulet additionné d'huile et de divers condiments ;
- L'akassa: pâte acide, visqueuse et consistante,
obtenue par cuisson de l'ogui ou du mawè. Avant sa commercialisation, le
produit est généralement façonné en boule et
emballé dans des feuilles végétales ;
- Le lio: pâte acide d'origine fon obtenue par double
cuisson de l'ogui: une première cuisson (partielle) du produit cru et
une seconde cuisson (à la vapeur) du produit semi-cuit après
façonnage en boule et emballage dans des feuilles
végétales. Ces produits sont, de ce fait, nettement plus stables
que les autres pâtes cuites ;
- L'ablô: pâte légèrement
salée et sucrée d'origine mina qui est préparée
à partir du mawè additionné de farine de blé et de
divers ingrédients (levure, sel, sucre). L'ensemble est
homogénéisé, pétri et façonné en
boulettes qui sont cuites à la vapeur ;
- Les autres pâtes fermentées cuites: le
gowé (préparé à partir du maïs entier), le
côme (produit de texture grossière d'origine ghanéenne) et
l'akpan (pâte semi-cuite obtenue à partir du mawè ou de
l'ogui et consommée après dilution dans de l'eau glacée).
Ces pâtes sont commercialisées sous forme de boules
emballées dans des feuilles végétales.
- Le couscous de maïs
(yèkè-yèkè) est un produit traditionnel,
consommé surtout lors des cérémonies coutumières
organisées par le groupe ethnique Mina. Il est obtenu par granulation
(routage) puis par pré-cuisson à la vapeur du mawè. Sa
production artisanale a fortement diminué au cours des trente
dernières années en raison de la pénibilité du
travail de préparation et de la concurrence du riz et du couscous de
blé (produits importés). Les bouillies sont
préparées à partir de pâtes fermentées et
présentent donc une saveur légèrement acide. Elles
diffèrent l'une de l'autre par leur densité, leur texture et leur
couleur plus ou moins blanche. Elles sont consommées après
addition de sucre, parfois accompagnées d'arachides grillées. On
distingue principalement deux types:
- L'aklui: le mawè est malaxé puis
granulé avant d'être cuit dans l'eau jusqu'à l'obtention
d'une bouillie semi-liquide parsemée de grumeaux mous dont on provoque
la formation au cours de la cuisson du mawè à l'aide d'une
palette en bois;
- Le kokoest une bouillie légère,
préparée indifféremment à partir du mawè ou
de l'ogui. Elle ne comporte ni granules ni grumeaux et est surtout
destinée aux enfants en période de sevrage.
- Les beignets sont élaborés soit à
partir des pâtes fermentées crues, soit à partir des
farines (ordinaires ou torréfiées). Les pâtons,
préparés, assaisonnés de condiments divers (sucre, sel,
piment) et façonnés sous différentes formes, sont frits
dans l'huile (arachide, coco ou palmiste). On obtient ainsi plusieurs types de
beignets: klè-klè (beignet sucré en boulette ou en
rondelles), klaklu (beignet en brindilles obtenu à partir de la farine
torréfiée), avounmi (produit en boulettes), massa (boulettes
préparées à partir du mawè additionné de
farine de blé, de sucre, et de levure), etc. Les beignets sont
consommés soit seuls soit avec l'arachide grillée ou l'amande de
coco.
- Les produits en épi ou en grain. Le maïs frais,
sec ou à peine mûr, en épi ou en grain, est grillé
ou cuit à l'eau et consommé avec des arachides (grillées
ou bouillies) ou de l'amande de coco. Divers types de mélange sont ainsi
produits (maïs et arachides grillés, maïs et arachides cuits,
maïs cuit et arachide grillée), qui portent tous la
dénomination bokoun.
- Les boissons sont de deux types: le chakpalo: une
bière locale légèrement sucrée et de couleur brune
dont la préparation s'effectue en plusieurs étapes - maltage du
maïs (trempage + germination + séchage pendant 6 ou 7 jours),
concassage, brassage (humectage + pétrissage + délayage dans
l'eau et cuisson de la farine), filtration du mélange et fermentation du
filtrat. Cette boisson est très appréciée des
consommateurs, particulièrement pendant les périodes chaudes.
Elle est vendue après addition de glace;
- Le sodabi: une eau-de-vie qui est originellement obtenue par
distillation du vin de palme fermenté. Du fait de la chute de la
production de ce vin, d'autres types de moût fermenté tels que
celui à base de maïs sont actuellement utilisés pour la
préparation du sodabi.
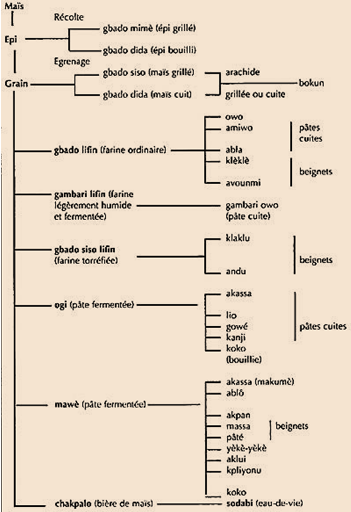
Figure1 : Principaux produits
dérivés du maïs ; source : Production et valorisation du
maïs à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest, archive
de la FAO
Source : Agro bénin (2011)
2.2.Clarification conceptuelle de la fonction de demande
L'objectif de ce paragraphe est de définir certaines
terminologies utilisées. Nous allons nous limiter seulement à
quelques termes ou expressions, indispensables à la compréhension
ou dont l'usage est souvent sujet à confusion. De plus, nous ne nous
plongerons pas dans la diversité des définitions
retrouvées dans la littérature, mais à celles
réellement utilisées dans ce travail.
Ø La demande
Selon la théorie
microéconomique traditionnelle la fonction de demande est définie
comme étant la relation entre la quantité optimale
demandée d'un bien et les valeurs possibles des variables qui la
déterminent.
Cette définition appelle plusieurs commentaires :
· La relation que la fonction établit concerne la
quantité optimale demandée du bien
considéré en ce sens qu'elle vise le meilleur choix de
consommation que le consommateur peut faire de ce bien en tenant compte non
seulement de ses préférences mais aussi de la contrainte
budgétaire que le prix des biens et son revenu limité lui
imposent.
· La fonction de demande est une fonction à
plusieurs variables parce que le choix de consommation dépend de
plusieurs variables : le prix du bien considéré, le prix des
autres biens, le revenu du consommateur, ses goûts et
préférences, sa richesse, etc.
· L'analyse microéconomique
élémentaire de la fonction de demande privilégie les trois
premières variables : le prix du bien, le prix des autres biens et le
revenu du consommateur. Cela revient à considérer les autres
variables comme constantes, et par conséquent à raisonner
"ceterisparibus", c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs
: en particulier, les goûts et préférences du
consommateur.
Say (1803) a formulé la loi des
débouchés. Cette loi stipule que, de manière a priori
surprenante, le processus de production ouvre les débouchés aux
produits. C'est-à-dire que selon lui, c'est l'offre qui crée sa
propre demande. Marshall (1890) expliquait la demande grâce au principe
de l'utilité marginale. Son analyse postule que pour tout prix
réel, les acheteurs sont désireux d'acquérir la
quantité de marchandises que les vendeurs sont prêts à
offrir.
Or selon Keynes, ce n'est pas l'offre qui crée sa
propre demande, mais plutôt la demande future qui suscite la production.
Autrement dit c'est la demande anticipée qui détermine le niveau
de production.
Les fonctions de demande font intervenir différents
paramètres d'élasticité dont chacun mesure la
réponse de la demande aux changements d'une variable
déterminée. Le coefficient d'élasticité peut
être défini comme la variation en pourcentage de la demande
provoquée par une variation de 1 pourcent de la variable
considérée, toutes choses restant égales
par ailleurs. Les principaux coefficients d'élasticité
sont:
- L'élasticité directe de la demande: la
variation de la quantité demandée est proportionnelle à la
variation du prix du produit considéré.
- L'élasticité croisée de la demande: la
variation de la quantité demandée est proportionnelle à la
variation du prix d'un autre produit.
- L'élasticité croisée peut être
positive ou négative, selon que les produits considérés
sont interchangeables ou complémentaires.
- L'élasticité-revenu de la demande: le
changement de la quantité demandée est proportionnel à la
variation du revenu.
Il existe deux mesures de l'élasticité revenu:
l'élasticité-revenu des dépenses consacrées au
produit considéré et l'élasticité-revenu de la
quantité achetée de ce produit. En toute rigueur, ces mesures
devraient être identiques quand le produit est défini de
façon précise puisqu'elles sont calculées en supposant que
tous les autres paramètres sont constants. Mais en pratique ceci est
rarement le cas (FAO, 1995).
En effet, la demande du maïs et de ses
dérivés est la quantité de maïs que les
ménages sont disponibles à acquérir à un prix
donné. Autrement dit, c'est la quantité de maïs et de ses
dérivés demandée par les ménages à un prix
donné.
Ø Différence entre demande et
consommation
L'INSEE définit la consommation comme la valeur des
biens et services utilisés pour la satisfaction directe des besoins
humains que ceux-ci soient individuels (consommation finale des ménages)
ou collectifs (consommation finale des services non marchands par les
administrations publiques et privées).
L'analyse néo-classique construisait la fonction de
demande d'un bien en privilégiant la relation prix et quantité
demandée. Keynes (1969) propose de relier la consommation globale avec
le revenu. Il s'appuie ici sur l'existence d'une loi psychologique fondamentale
selon laquelle «en moyenne et laplupart du temps, les hommes tendent
à accroître leur consommation au fur et à mesure que
lerevenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que
l'accroissement du revenu ». Selon Keynes, c'est le revenu courant
des ménages qui détermine leur niveau de consommation. L'analyse
keynésienne reposait sur l'hypothèse du revenu courant : les
changements de consommation de la courte période dépendaient des
variations du seul revenu courant.
Duesenberry (1949) montre que le niveau de consommation
atteint pendant une période donnée dépend non seulement du
revenu courant mais aussi du niveau le plus élevé atteint pendant
la période précédente. Il insiste sur l'importance des
facteurs psychologiques dans la fonction de consommation en disant que la
consommation évolue en raison de l'existence d'un double effet : un
effet de démonstration (qui évolue en effet de
différenciation) et un effet d'imitation. Les catégories les
moins favorisées cherchent à imiter la consommation ou à
copier le style de vie des classes supérieures.
Or, Friedman quant à lui dans sa théorie du
revenu permanent avance que les valeurs de la consommation et du revenu
prévues par le consommateur, dépendent non seulement du montant
des recettes et des dépenses en cours, mais également des
constatations du passé et des anticipations sur l'avenir. Pour conclure
sa théorie, il déclare que les ménages adapteraient leur
consommation par rapport à leur revenu permanent et non leur revenu
courant. De même Modigliani vient compléter Friedman soit disant
que la consommation d'une période dépend non pas du revenu
courant, mais de l'estimation que les agents économiques font de la
somme actualisée des revenus perçus ou à percevoir au
cours de leur vie.
Ensuite quant à l'approche sociologique de la
consommation, plusieurs auteurs ont également élaboré des
théories. Baudrillard, considère la consommation comme un
actesymbolique. Le consommateur n'achète pas un objet uniquement pour la
satisfactionqu'il recherche de son utilisation, mais pour afficher son
appartenance à ungroupe social qui lui sert de référence.
Quant à Bourdieu (1979), les choix de consommation sont
déterminés par les groupes d'appartenance et en particulier les
classes sociales. Dans le même ordre d'idée, Veblen (1899)parle de
la consommation ostentatoire qui est une consommation destinée à
montrer un rang social, un mode de vie ou une personnalité.
Selon la théorie microéconomique, la notion de
demande doit être distinguée de celle de consommation. Alors que
la première est une notion ex ante (en termes de projets), la seconde
est une notion ex post (en termes de réalisations) : la fonction de
demande indique par exemple quelle serait la demande optimale du consommateur
pour tel bien si le prix de celui-ci, affiché par le marché,
était de tel ou tel montant ; la fonction de consommation montre comment
a évolué la consommation effectivement constatée de tel
bien en fonction par exemple des différentes valeurs que le prix a pu
prendre.
D'après la FAO (1995), la consommation est un
phénomène matériel qui peut se mesurer en unités
physiques. La demande au contraire est une notion économique. La
fonction de demande décrit la corrélation entre le prix d'un
produit et la demande de ce produit (c'est-à dire qu'elle indique le
volume de la demande qui correspond à chaque niveau de prix), toutes
choses égales d'ailleurs. La consommation peut changer soit sous l'effet
des variations de prix, il y a alors un déplacement le long de la courbe
de la demande, soit sous l'effet d'autres facteurs tels qu'une variation des
revenus, c'est alors la courbe de la demande elle-même qui se
déplace, c'est-à-dire qu'elle varie indépendamment du prix
du produit. La demande de produits alimentaires au niveau de la consommation
détermine, par la voie d'une demande d'élaboration ou de
«marketing» connexes (transformation primaire et secondaire,
conditionnement, distribution), la demande dérivée de produits
agricoles au niveau de l'exploitation. C'est cette demande induite que
perçoit le producteur, ou du moins qu'il devrait percevoir si les
signaux du marché n'étaient pas faussés par les influences
de mesures en tous genres décrites plus haut.
Au vue de ces définitions, la consommation du maïs
et de ses dérivés est l'acte par lequel, les ménages
utilisent ces biens (maïs et ses dérivés) pour satisfaire
leurs besoins tandis que la demande du maïs et de ses
dérivés est la quantité du maïs que les
ménages sont disponibles à acquérir à un prix
donné. Il ressort de cette comparaison que la demande du maïs est
une action qui précède (ex ante) la consommation du maïs (ex
poste). Autrement dit, la consommation du maïs prend en compte sa
demande.
2.3.Les facteurs déterminants la demande
Selon la théorie économique, la demande d'un
bien est fonction de plusieurs variables parce que le choix de consommation
dépend de plusieurs variables tels que : le prix du bien
considéré, les prix des autres biens, le revenu du consommateur,
ses goûts et préférences, sa richesse etc. Mais l'analyse
microéconomique élémentaire de la fonction de demande
privilégie les trois premières variables : le prix du bien, le
prix des autres biens et le revenu du consommateur. Cela revient à
considérer les autres variables comme constantes, et par
conséquent à raisonner "ceterisparibus", c'est-à-dire
toutes choses égales par ailleurs : en particulier, les goûts et
préférences du consommateur tels que les décrit sa
fonction d'utilité sont considérés comme stables.
La demande d'un produit alimentaire est fonction de plusieurs
variables: le prix du produit considéré, les prix des produits
complémentaires ou de substitution, les revenus, certains
paramètres démographiques, les goûts et habitudes. A court
ou moyen terme, les principaux déterminants sont les prix et les
revenus, et ce sont aussi les variables qui ont le plus de chance d'être
immédiatement modifiées par le changement de politique. La
modification du prix d'un produit a souvent deux effets, un effet de revenu et
un effet de substitution. Ce dernier joue toujours dans le même sens,
c'est-à-dire que toute baisse de prix du produit entraîne
invariablement un accroissement de la quantité demandée. Mais
l'effet revenu n'est pas le même selon que le produit soit de
qualité courante ou non. Dans le cas d'un produit de qualité
courante, l'accroissement du revenu qu'implique la baisse de son prix provoque
une augmentation de la quantité demandée et renforce donc l'effet
de substitution. Mais s'il s'agit d'un produit «inférieur»,
l'effet revenu est négatif et compense donc en partie l'effet de
substitution puisqu'il joue en sens inverse (FAO, 1995a). Cependant, dans le
cas des produits «inférieurs», l'effet net d'une baisse de
prix est toujours un accroissement de la demande et vice versa. Au contraire,
quand ce sont les revenus qui changent sans que le prix du produit ne bouge,
tout accroissement de revenu se traduit par un accroissement de la demande de
produits de qualité courante, alors qu'il entraîne une baisse de
la demande de produits «inférieurs». La demande des
différentes denrées alimentaires au niveau des ménages
dépend aussi de plusieurs paramètres démographiques,
notamment le nombre et l'âge des membres de la famille et l'âge de
la personne qui achète la nourriture. L'âge des membres de la
famille joue de deux façons. Premièrement, les enfants et les
personnes âgées mangent en moyenne moins que les autres.
Deuxièmement, la structure de la consommation des enfants n'est pas la
même que celle des adultes. L'effet de l'âge de la personne qui
achète la nourriture peut tenir au fait que les besoins changent dans
une vie, car chaque génération a ses préférences.
La taille des ménages peut elle aussi influer sur la demande car il peut
y avoir un effet d'échelle à ce niveau. Les goûts et les
habitudes alimentaires peuvent par exemple entraîner des variations
saisonnières de la consommation pour des raisons qui ne sont pas
liées à la variation saisonnière des prix, mais à
des tabous religieux ou sociaux, voire simplement à une méfiance
face à une nourriture inhabituelle (FAO, op.cit).
Selon AMOUSSOUGA (2000), la demande individuelle est une
relation fonctionnelle indiquant le montant maximal d'un bien qu'un agent
économique est prêt à acheter pendant une période de
temps donnée pour chaque prix possible du bien. Selon cet auteur les
principaux facteurs influençant la décision des consommateurs
s'énumèrent comme suit :
Ø Le prix : En théorie, il existe une relation
inverse entre le prix d'un bien et la quantité demandée de ce
bien. Cette relation inverse est valable pour la plupart des produits en
économie. Elle est qualifiée par les économistes de «
loi de la demande », toutes choses étant égales par
ailleurs.
Ø Le prix des autres biens : Lorsque la hausse du prix
d'un bien engendre l'augmentation de la demande d'un autre bien, ces deux biens
sont dits substituts (exemple du café et du thé).
L'existence de substituts influence la demande. Par contre, quand la
hausse du prix d'un bien diminue la demande d'un autre, ces deux biens sont
dits complémentaires. C'est le cas de plusieurs produits qui ne
se consomment pas seuls (exemple du thé et du sucre). Cette relation
fait ressortir la notion d'élasticité croisée.
Ø Le revenu : Si la quantité demandée
d'un bien baisse quand le revenu diminue, ou augmente quand le revenu
s'accroît, ce bien est dit normal. Cependant, tous les biens ne
sont pas normaux ; ainsi quand la demande du bien baisse alors que le revenu
augmente, on parle de bien inférieur.
Ø Les goûts et préférences : Il
s'agit là du déterminant le plus évident de la demande ;
si on aime un bien, on en consomme davantage. En général, les
économistes n'essaient pas d'expliquer les goûts des agents
économiques, mais étudient ce qui se passe quand les goûts
changent. Le changement dans la demande peut être le résultat de
changement dans les habitudes alimentaires.
Sur le plan mathématique, la relation de
préférence est définie dans l'ensemble par rapport aux
paniers de consommation. C'est-à-dire qu'un agent peut exprimer une
préférence entre deux paniers de bien. On suppose que cette
relation est complète lorsque l'agent est toujours
capable de comparer deux paniers de biens. Si l'agent préfère A
à B et B à C, alors il préfère A à C : on
parle ainsi de relation transitive.
De plus, on supposera également qu'un consommateur
préfère toujours consommer plus que moins. C'est-à-dire
que si on prend un panier puis on augmente la quantité d'un ou de
plusieurs biens, alors le nouveau panier sera préféré au
panier initial ; c'est le principe de non
satiété. Cette hypothèse est contestable : on
peut en effet penser que le consommateur va se "saturer" au bout d'un moment et
que la consommation de biens supplémentaires ne lui apporte plus de
satisfaction supplémentaire. On va choisir de se placer dans un cadre de
long terme (où la saturation est moins probable : l'agent risque moins
de se saturer s'il peut répartir sa consommation sur toute une
année par exemple).
L'expérience prouve que dans tous les pays quel que
soit le niveau de revenu, l'élasticité-prix et
l'élasticité-revenu de la demande alimentaire varient en sens
inverse des revenus des ménages, de sorte que la réduction de la
consommation frappera plus durement les plus pauvres, tant au niveau
quantitatif qu'en valeur nutritionnelle (FAO, 1995b). Cet effet sera encore
plus marqué si les ménages pauvres paient, pour leur nourriture,
des prix unitaires plus élevés que les ménages riches;
ceci est le cas par exemple s'ils ne disposent pas du montant suffisant pour
profiter des réductions sur les achats en quantité ou s'ils n'ont
pas de quoi accéder aux moyens de transport pour se rendre dans les
centres commerciaux qui cassent les prix. Quand les revenus baissent et que les
prix montent, les ménages continuent à s'approvisionner en
consacrant une part plus grande de leurs revenus à la nourriture et en
achetant les denrées les moins chères. Ils s'efforcent aussi
d'améliorer leur ravitaillement au moyen de transferts interindividuels
(par exemple en se procurant des vivres auprès de parents qui vivent
à la campagne).
Dans le cadre du présent mémoire, nous entendons
par facteur déterminant de la consommation tout facteur pouvant
influencer directement ou indirectement la prise de décision de tout
membre de ménage à choisir de consommer le maïs et (ou) ses
dérivés. Ce choix peut être guidé par certaines
caractéristiques physiques (couleurs etc...) et surtout les
critères financiers tels que le prix d'achat du produit concerné
et des autres produits de même que le revenu du ménage sans
oublier l'environnement géographique du consommateur (urbain ou
rural).
2.4.Etudes empiriques sur la demande des produits
agricoles
Plusieurs études ont été
réalisées au Bénin sur la filière du maïs. Les
travaux sur le maïs ont connu une importance notoire ces dernières
années. Ces travaux ont été conduits sur le territoire
national par des institutions et des centres de recherche. Ils ont
également fait l'objet dethèses et mémoires
d'étude. Les méthodes utilisées au cours de ces travaux
sont bien précises et le point sur les résultats auxquels ils
sont parvenus se présente comme suit.
Adegbola (2002), a dirigé une étude sur les
facteurs qui influencent la décision d'adoption des greniers par les
producteurs du maïs. Au terme de cette recherche, il parvient à
conclure que le niveau d'éducation formelle des producteurs, le contact
avec les agents de vulgarisation, l'orientation vers le marché, le
nombre d'année d'expérience dans la production du maïs, le
degré de problème de stockage et l'aptitude du grenier
amélioré à réduire les pertes dues aux insectes
constituent les principaux facteurs qui influencent positivement la
décision d'adoption des greniers par les producteurs du maïs. C'est
pourquoi il préconise que la vulgarisation doit commencer ses actions
par les producteurs ayant une expérience dans l'agriculture et en
particulier ceux qui ont reçu une éducation formelle. De
même, Adégbola et Arouna (2004) ont montré que
l'utilisation des systèmes améliorés de stockage procure
un revenu nettement supérieur à celui des systèmes locaux.
Cela permet aux producteurs adoptants d'acquérir plus de biens
matériels que les non adoptants. Il en est de même pour
l'investissement sur le capital humain. De plus, l'adoption de ces
systèmes améliorés ont contribué à
l'augmentation des facteurs de production (terre, capital, main d'oeuvre). Leur
recherche a donc montré qu'il y a un impact positif de l'utilisation des
revenus induits par l'adoption des systèmes améliorés de
stockage du maïs sur l'acquisition des biens matériels, et
l'investissement sur le capital humain et sur la production.
Allagbe (2006), a mené une étude par rapport
à l'impact de rotation du système culture maïs soja sur la
fertilité des sols. Il ressort de son étude que le maïs se
comporte mieux sur les parcelles qui ont abrité le soja l'année
précédente. Les calculs économiques qu'il a
effectués ont montré que le revenu agricole obtenu de la pratique
du soja maïs est plus important que celui de la pratique maïs
après maïs.
Adegbola, al. (2011) ont mené une étude sur la
filière maïs dans le but de voir l'impact de l'adoption des
variétés améliorées du maïs au Bénin.
Au bout de leurs travaux ils ont révélé que l'adoption des
variétés améliorées du maïs induit un
accroissement de la productivité de la terre. Ils ont également
montré que cette adoption a permis aux producteurs d'améliorer
leur niveau de vie (le revenu tiré de cette production de 2,427F CFA et
d'accroître les dépenses d'investissement en bien
matériels, dépenses de scolarisation des enfants et de la
santé des membres de ménages respectivement de 54.012F CFA, 2307F
CFA par enfant scolarisé) et d'assurer leur sécurité
alimentaire. Ils ont finileurs travaux en tirant la conclusion
ci-après : « pour réduire la pauvreté
et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
une attention particulière doit être prêtée à
la filière maïs puisqu'elle fait partie des filières
prioritaires au Bénin ».
Adegbola, al. (2011) en cherchant à connaitre la raison
principale qui pousse les ménages à constituer des stocks de
maïs, déclarent à la fin de leur étude que
l'autosuffisance alimentaire reste la raison principale qui motive les paysans
au Sud-Bénin à constituer des stocks de maïs.
Arouna, al.(2011), ont fait ressortir que les revenus
supplémentaires issus de l'adoption des systèmes
améliorés de stockage du maïs ont permis une augmentation
des dépenses d'acquisition des biens matériels par le
ménage, une amélioration des investissements sur le capital
humain (santé et éducation) et dans la production agricole.
Adegbola et Aloukoutou (2011) ont montré que le
Bénin n'a pas un avantage comparatif à exporter son maïs
sous forme de grains mais plutôt après transformation. Ils
mentionnent également que l'exportation du maïs sous forme de
grains n'est bénéfique au pays que s'il est produit au centre et
pour des systèmes de production donnés. Pour finir leurs travaux,
ils conclurent que la transformation du maïs en farine
améliorée et en provende, non seulement d'être rentable sur
le plan financier et économique, offre un avantage comparatif pour le
Bénin pour leur exportation.
De plus, Djalalou-Dine (2006), dans sa thèse a
analysé les facteurs déterminant la demande du riz au Centre et
Sud du Bénin. Il a fait recours aux modèles de Système de
Dépense Linéaire (LES) et du prix Hédonique pour estimer
ces facteurs. Il ressort de ses études qu'il existe une
différence significative entre les facteurs qui influencent la demande
du riz local et ceux qui déterminent la demande du riz importé.
Il conclut son travail en disant que le riz local présente plusieurs
insuffisances comparativement au riz importé, ce qui justifie
l'attachement que les consommateurs ont pour le riz importé.
Retenons que plusieurs travaux ont été
effectués sur la filière maïs, mais ces travaux dans leur
globalité ont, d'une part montré l'importance de l'adoption des
différentes variétés du maïs et des techniques de
stockage et d'autre part mis en exergue la compétitivité de la
filière maïs au Bénin. Ainsi, ces études ont
occulté pour la plupart le fait que l'offre d'un produit peut être
influencée par la demande exprimée par le consommateur. De
même, les deux modèles (LES, prix Hédonique)
utilisés par Djalalou pour analyser les déterminants de la
demande du riz au Centre et Sud du Bénin, ne peuvent pas nous permettre
d'obtenir les résultats escomptés au cours de notre recherche.
Donc pour pallier ce manque d'information, il est important qu'une étude
soit faite pour expliquer les déterminants de la demande du maïs et
de ses dérivés au Bénin en utilisant une nouvelle
méthodologie.
CHAPITRE 2 : CADRE INSTITUTIONNEL
Ce chapitre a pour objectif premier de faire une brève
présentation de la structure qui nous a accueillis pour le
déroulement de notre stage, et pour objectif second de décrire le
déroulement de ce stage
SECTION 1 : Présentation du lieu de stage
1.1.
Historique du PAPA
L'entité qui a abrité notre stage est le
Laboratoire d'Economie et de Sociologie Rurale (LESR) créé en
1975 et installé depuis lors dans l'enceinte du Lycée Technique
de Porto-Novo. Ce n'est qu'en 1996 qu'il est devenu Programme Analyse de la
Politique Agricole. Il est l'un des trois (03) programmes du Centre de
Recherche Agricole à vocation nationale basé à Agonkanmey
(CRA-Agonkanmey) qui lui, est l'un des six (06) Centre de l'Institut National
des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB).Créé
parledécretn°92-182du6juillet1992,l'InstitutNationaldesRecherchesAgricoles
du
Bénin(INRAB)estlaseuleinstitutionnationalequis'inscritdanslarechercheagricoleau
Bénin.IlestplacésouslatutelleduMinistère
del'Agriculturedel'ElevageetdelaPêche (MAEP)etrépond,
aveclesdifférentsacteurs du monde agricole, auxenjeuxnationauxet
internationauxdel'agriculture et du développement.
En janvier 2015,le
PAPAestdéplacéàCotonoudanslesancienslocauxdelaDirection
Généraledel'INRABaprèsquelaDirectionGénéralearejointsonnouveausiègesisdans
l'enceinte duCRAAgonkamey.LeProgrammeAnalysede la Politique Agricole a
également connule changementdesonChef de
Programme.Eneffet,quelquemoisaprèssa nomination auposte de Directeur
duCRAAgonkanmey, leDrPatriceIguéADEGBOLAapasséla main au
DrHervéSOSSOU.Ce changement de dénomination se justifie par une
nouvelle orientation donnée à cette structure lors des
réflexions sur le plan Directeur de la Recherche Agricole Nationale.
Cette nouvelle orientation consiste en l'analyse des impacts des
stratégies de développement dans le cadre de la politique
agricole. Dans ce sens le PAPA exerce toutes les activités
dévolues au LESR, avec toutefois de nouvelles fonctions à lui
assignées pour les réformes de la recherche agricole au
Bénin adoptées en 1992.
1.2.
Mission du PAPA
Lamissiondu
ProgrammeAnalysedelaPolitiqueAgricoleestde«déterminerlesgoulots
d'étranglementdesstratégiesde développementpar l'analyse
desinstrumentsde politique
agricole(politiquedesprix,politiquemicro-économique,politique de
crédit,politique de production et politique foncière) et
partant, de fournir aux décideurs des informations
détaillées sur lesquelles ils pourront baser leur
prisededécision».Le Programme d'Analyse de la Politique Agricole
est un programme de recherche par excellence.
1.3.
Structure du PAPA
Dans le projet d'élaboration actuellement en
étude, le programme Analyse de la Politique Agricole est
structuré en six sous programmesen dehors du service administratif et
financier et du secrétariat. Il s'agit notamment des sous programmes :
· Analyse de Politique Sectorielle ;
· Sociologie des innovations ;
· Transfert des technologies;
· Micro-économie des technologies ;
· Macro économie des technologies ;
· Statistiques et biométrie.
Fonction de chaque sous-programme
Ø Le sous-programme Analyse de Politique
Sectorielle s'occupe du contexte sous régional et du suivi de
l'évolution de la situation nationale. Il a la responsabilité de
l'évaluation ex ante et à posteriori de politique
agricole/sectorielle pour la réduction de la pauvreté. Il
s'intéresse aux études diagnostiques et prospectives sur les
filières et les marchés de produits agricoles et appuie la
Direction Générale de l'institut dans le positionnement de la
recherche au niveau de la politique sectorielle.
Ø Le sous-programme Sociologie des
innovations se focalise sur les missions qui lui sont ainsi
assignées :
· La microsociologie des différentes innovations
agricoles ;
· Réalise des études prospectives sur ces
innovations.
Ø Sous-programme Transfert des
innovations est mis en oeuvre à travers trois (03)
volets :
· Suivi des expériences de transfert des
technologies sur le plan international;
· Participer au processus d'élaboration des
technologies ;
· Analyse des systèmes de communication au sein
des acteurs;
Ø Le sous-programme Micro-économie des
technologies est axé sur trois volets :
· Economie des exploitations agricoles;
· Analyse de rentabilité ;
· Elaboration des outils méthodologiques de
formation pour la réalisation des référentiels
technico-économiques;
Ø Le sous-programme Macro économie des
technologies a pour mission :
· D'étudier l'impact des technologies ;
· Analyser la compétitivité des
filières agricoles ;
· D'étudier l'impact des réformes
tarifaires et non tarifaires sur le secteur agricole.
Ø Le sous-programme Statistiques et
biométrie est transversale aux autres sous programmes.Sur
la base des données collectées et celles secondaires, elle a pour
tâches de produire ou de constituer des statistiques agricoles tant sur
le plan national, régional qu'international. Elle s'occupe aussi de la
programmation et de l'analyse des données.
Pour ce qui est du service administratif et financier et du
secrétariat, il a pour fonction : le suivi des courriers, la saisie
des rapports et des publications, la tenue de la caisse et de la
comptabilité, le traitement des justificatifs, etc.
1.4.
Ressources humaines du PAPA
Pour mener à biensesactivités,le PAPAdispose
d'unpersonnelscientifique composé de
chercheursettechniciensdontlesprofilssontvariésetcomplémentaires.Ony
rencontre notamment les agroéconomistes, les sociologues,les
économistesetc.Les principaux responsables qui sont
leschargésdedivisionsont:
· LeChef ProgrammeAnalysedela
PolitiqueAgricole(C/PAPA)
Ilest le responsable del'ensemble duprogramme.Ilcoordonne
toutesles activitésdu programmeetilestégalementleChargéde
ladivisionAnalysede la Politique Sectorielle et Veille Stratégique
(C/APSVS).Il a pour rôle de:
o réaliser lesétudes diagnostiques ;
o élaborer et évaluerlesprotocoles de recherche
;
o diriger etdeconduireleséquipes derecherche ;
o réaliser des rapports desynthèse ;
o évaluerlesactivités de recherche;
o mobiliser lefinancementpourla recherche;
o élaborer et d'adapterlesoutils d'analyses
depolitiqueagricole ;
o fairele suivi-évaluationdes activités
planifiées.
Iladeuxcollaborateurschargésdusuivicontextesousrégionaletdusuiviévolutiondela
situation nationale.
· LeChargé dela
Sociologie-Anthropologie des Innovations (C/SAI)
LeC/SAIapour rôle de:
o concevoiret de conduiredes études prospectives;
o planifierles activitésassorties de budget;
o élaborer et d'adapterlesoutils d'analyses
depolitiqueagricole;
o fairele suivi-évaluationdes activités
planifiées.
Iladeuxcollaborateurs
:uncollaborateurchargédelaMicrosociologiedesinnovationsetun autre
chargédesEtudes prospectives des innovations.
· LeChargédel'Economie des
Exploitations Agricoles et des Innovations (C/EEAI)
Il a pour rôlede:
o concevoiretdeconduire
desétudesprospectivessurl'adoptionetl'impactdes
innovations,larentabilité desinnovations,le fonctionnementdes
exploitations agricoles ;
o planifierles activités assorties de budget;
o élaborer et adapterles outils d'analyses
depolitiqueagricole ;
o fairele suivi-évaluationdes activités
planifiées.
Ila troiscollaborateurschargés desEtudes
derentabilité des innovations, des Etudes de fonctionnement des
exploitations agricoleset d'Adoption et impact des innovations.
· LeChargéduTransfert des Innovations
(C/TI)
LeC/TIapourtâchede :
o concevoiretconduire desétudesprospectivessur la
microsociologie desdifférentes innovations agricoles ;
o planifierles activités nécessaires;
o élaborer etd'adapterlesoutils d'analyses
depolitiqueagricole;
o fairele suivi-évaluationdes activités
planifiées.
Ila sa charge deuxcollaborateurs affectés
auSuividutransfert desinnovationsetau développement participatif des
innovations.
· LeChargéde la Macro-Economiedes
PolitiquesAgricoles (C/MEPA)
Ilsefocalisesurl'analysemacroéconomique,l'analysedeschaînesdevaleursagricoles
et
filièresetsurl'impactdesréformestarifairesetnontarifairessurlesecteur
agricole.Pour ce faire, il apourrôlede:
o concevoiret de conduiredes études prospectives;
o planifierles activités assorties de budget;
o élaborer et adapterles outils d'analyses
depolitiqueagricole;
o fairele suivi-évaluationdes activités
planifiées.
LeC/MEPAatroiscollaborateursquise chargentchacunde l'analyse
macroéconomique,de l'analysedeschaînesdevaleursagricoles
etfilièresetde l'impactdesréformestarifaireset non tarifaires sur
lesecteuragricole.
· LeChargédel'Economie et Statistiques
(C/ES)
Il estchargé de:
o concevoiret de conduiredes études prospectivessur les
innovations agricoles;
o planifier les activitésyafférents;
o élaborer et adapterles outils d'analyses
depolitiqueagricole;
o fairele suivi-évaluationdes activités.
Ilapourcollaborateurslesresponsablesdescollectesetgestiondebasesdedonnéesetde
programmation.
· La secrétaire
Elle apourtâchede:
o gérerles courriers, classeet archiveles documents;
o gérer les rendez-vous, lesréunionset les
stocks ;
o élaborer les correspondances administratives;
o planifierles activités du secrétariat.
· Le comptable
Il sechargede:
o élaborer des procéduresdegestion
financière;
o élaborer les bilans et lesétats financiers;
o planifierles besoinsfinanciers;
o concevoir le budgetet mettreen
placeunecomptabilitématière;
o assurer lesuivi financierdes projets;
o élaborer les TDR et les cahiers decharges.
Ilcoordonnesesactivitésetplanifiesontravailenutilisantl'outilinformatique
etleslogiciels comptables.
L'organigrammedetoutcet ensemblese présenteainsiqu'il
suit:
C/PAPA
Secrétaire
Comptable
C/ SAI
C/ EEAI
C/ TI
C/MEPA
C/ES
Chargéde la Microsociologie desinnovations
ChargédesEtudes prospectivesdes innovations
Chargédel'analyse macroéconomique
Chargédel'analysedes chaînesde valeurs
agricolesetfilières
Chargédel'impactdes réformestarifaireset
nontarifairessurle
Secteuragricole
Chargé des
Etudesde rentabilitédes innovations
Chargé Adoptionet impact des innovations
Chargédes
Etudesde fonctionnement des exploitations
Chargé Suivi dutransfert
des innovations
Chargé du développement participatifdes
innovations
Chargé de la programmation
Chargé des collectes et gestion de bases de
données
Figure
2 : Organigramme du PAPA
1.5.
Organisation technique
L'organisation technique du PAPA montre le dispositif mis en
place dans l'exécution de ses activités. Cette organisation peut
être vue sous deux angles :
ü Les travaux en
équipes : ce sont des travaux qui impliquent la
participation de tous les agents du PAPA. Dans ce cas, le programme gagne un
protocole par compétition après un appel à protocole de
recherche lancé par l'INRAB ou d'autres institutions. Ces travaux sont
coordonnés par le Chef programme et les résultats sont mis
à l'actif du PAPA. Lorsque le programme gagne des consultations, des
équipes de chercheurs sont constituées pour réaliser ces
consultations en fonction de la nature du travail et des compétences des
chercheurs.
ü Les travaux individuels : un
chercheur peut toutefois gagner seul un protocole de recherche chez des
bailleurs ou institutions. De ce fait, il peut exécuter seul le travail
ou associer d'autres chercheurs. Les travaux individuels sont aussi les
encadrements des étudiants en fin de cycle pour la préparation de
mémoire.
1.6.
Mobilisation de fonds
Le Programme Analyse de la Politique Agricole a des sources de
financement diversifiées : la première source vient des
fonds compétitifs de l'INRAB auxquels le PAPA participe. Ceci sert
à la mise en exécution des protocoles de recherche gagnés
par le PAPA. La structure peut gagner aussi des appels à protocoles de
recherche ; de ce fait, les financements obtenus servent à conduire
la recherche et à payer d'autres agents recrutés. La structure
peut gagner aussi des consultations et pour ce, les financements servent aux
activités de consultation. Le PAPA a établi des collaborations
avec des partenaires (IITA, GTE, AfricaRice, etc.) ou s'associe à
d'autres chercheurs dans des projets de développement agricole.
1.7.
Moyens et outils utilisé au PAPA
Dans l'accomplissement de sa mission, le Programme Analyse de
la Politique Agricole disposait d'un local situé dans l'enceinte du
Lycée Technique de Porto-Novo. Ce local servait de bureau pour les
fonctionnaires du PAPA. Mais aujourd'hui, le siège du PAPA est à
Cadjehoun dans la ville de Cotonou et comprend des bureaux dotés
d'infrastructures nécessaires.
· Au nombre des approches
méthodologiques utilisées au PAPA nous
avons :
ü Les diagnostics participatifs à travers les
enquêtes structurées et semi-structurées.
ü Les méthodes quantitatives à travers les
analyses de rentabilité, les analyses d'investissement, la
modélisation (régressions, programmation linéaire),
etc.
ü Les méthodes qualitatives structurées
(Delphi) et semi-structurées (fonctionnement de marchés).
· Pour ce qui concerne les outils, ils sont
de trois types :
ü Les outils de collectes : au nombre des outils de
collecte utilisés au PAPA, nous avons : le questionnaire pour la
collecte des données structurées ; le guide d'entretien pour
la collecte des données non structurées ou informelles ; la
grille d'observation et l'appareil photographique pour faire des lectures de
données et des observations ; la grille de lecture pour visualiser
les points à aborder lors de la recherche documentaire.
ü Les outils de saisie : il s'agit des logiciels
tels que World, Access, PowerPoint, SPSS, EPIDATA
ü Les outils d'analyse : l'outil d'analyse de
politique agricole souvent utilisé au PAPA et la Matrice Analyse de la
Politique (MAP) afin de faire ressortir la profitabilité de la
politique. Un autre outil utilisé pour les analyses sociologiques est
l'Analyse du contenu.
Le PAPA dispose aussi des logiciels d'analyses statistiques et
de programmation tels que : Mini tab, SAS, GAMS, LINDO, Mat Lab. Au nombre des
logiciels économétriques et d'analyse financière des
projets utilisés, nous avons : LIMDEP, STATA, SHAZAM, COMFAR expert
III, DAD.
SECTION 2 : Déroulement du stage au PAPA
Cette section de notre travail a pour but de décrire le
déroulement de notre stage. Ainsi dans un premier temps nous allons
mentionner les tâches exécutées et dans un second temps il
sera question de faire part des difficultés auxquelles nous avons
été confrontés.
2.1.Taches exécutées
Nous devons tout d'abord mentionner que notre séjour au
PAPA s'est bien passé et que nous avions eu des relations pacifiques et
cordiales avec les membres de l'administration.
En effet, au coursdestrois
(03)moispassésauseinduProgramme Analyse de Politique Agricole,nous avons
participé à diverses activités telles que :
ü La rédaction d'une revue documentaire sur le
Projet d'Appui à la Production Vivrière et de renforcement de la
résilience dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des
Collines (PAPVIRE-ABC). Cette tâche nous a permis de maîtriser les
éléments essentiels d'une revue documentaire et de même,
elle nous a permis de connaitre les contraintes et les opportunités
liées à l'agriculture et en particulier les productions
vivrières au Bénin.
ü Faire la saisie des données collectées
d'une enquête réalisée par le PAPA
Hormis ces différentes tâches, nous avons suivi
une formation sur la création d'un masque de saisie à travers le
logiciel ACCESS et sur l'analyse des données à partir du logiciel
Stata.
2.2.Difficultés rencontrées
Tout au long de notre stage, nous avons rencontré de
difficultés mais pas en tant que telles. Il faut cependant souligner
qu'il s'est posé quelques fois le problème de
disponibilité de certains responsables compte tenue de leurs lourdes
tâches. Nous mentionnons que le Programme d'analyse ne dispose pas d'une
bibliothèque et de connexion internet (wifi) pour les recherches, ce qui
nous a causé un peu de problème et limité nos recherches
lors de la rédaction de la revue documentaire.
Ensuite, lors de la rédaction de notre mémoire,
nous n'avons pas eu assez d'informationspouvant nous permettre de
rédiger facilement notre mémoire et de plus, les données
statistiques auxquelles nous avons eu accès sont de vieilles dates et ne
facilitent notre analyse.
CHAPITRE 3 : CADRE
METHODOLOGIQUE ET RESULTATS
SECTION 1 : Méthodologie de recherche
1.1.
Présentation de la zone d'étude
Le Bénin est un des plus petits pays d'Afrique de
l'Ouest avec une population de presque 9,9millions d'habitant. Son
économie repose sur l'agriculture de subsistance et la production de
coton.Le secteur agricole constitue
la principale source de création de richesse au niveau national et est
une source de devises importante. Le secteur emploie plus de 70 pour cent de la
population active. Plus de 60 pour cent des actifs masculins et 35,9 pour cent
des actifs féminins réellement occupés exercent une
profession agricole. La contribution du secteur agricole au PIB a
évolué de 32,3% en 2005 à 36% en 2011.Le taux de
croissance du PIB réel devrait se situer entre 5,5 et 6 % en 2016.
Après avoir progressé de 5 à 7 % entre 2012 et 2013,
la croissance avait fléchi à 6,5 % en 2014 puis
à 5 % en 2015, en raison principalement du ralentissement des
activités de réexportation vers le Nigéria et de la baisse
de la production agricole. En dépit du
léger déclin enregistré ces derniers mois, le Bénin
a enregistré en 2015 l'un des taux de croissance du PIB les plus
élevés parmi les pays de l'Union Economique et Monétaire
Ouest-africaine (Banque Mondiale, 2016).
1.2.
Echantillonnage
Afin de pouvoir estimer les élasticités des
demandes, il faut en général trois sortes de
données : le revenu (ou la dépense totale) des
ménages, la quantité consommée des différents biens
et leurs prix d'achat. Lorsqu'on veut examiner les différences à
travers des régions ou à travers des différentes couches
de la population, il faut un échantillon représentatif des types
de ménages et des zones géographiques d'intérêt.
Les données utilisées dans cette étude
sont tirées d'une enquête menée par le Programme Analyse de
Politique Agricole (PAPA/INRAB). Cette enquête a été
réalisée auprès de 390 ménages consommateurs du
maïs et de ses dérivés répartis sur huit (08)
départements.
1.3.
Données
Dans le cas de cette étude ; les données
utilisées proviennent de notre lieu de stage et contiennent les
informations suivantes :
· Données sur les caractéristiques
socioéconomiques des ménages
· Type de maïs et de produits transformés du
maïs consommé
· Quantité et coût de maïs et de
produit transformé
· Les critères privilégiés lors de
l'achat du maïs
· Les contraintes liées à
l'approvisionnement du maïs
· Aspects sociologiques
Mais dans le cas de notre étude, c'est essentiellement
les trois premières informations (les caractéristiques
socioéconomiques des ménages, type de maïs et de produits
transformés du maïs consommé, quantité et coût
de maïs et de produit transformé) qui nous intéressent.
1.4.
Méthode d'analyse des données
Pour ces données, l'analyse minutieuse des
caractéristiquessociodémographique et économique des
ménages agricoles a été faite. Cette analyse a
été appuyée par des statistiques descriptives (moyenne,
fréquence relative et écart-type). L'objectif de cette analyse
est de présenter le profil des ménages agricoles et certaines
caractéristiques de l'environnement socioéconomique
immédiat de ces derniers. Une telle description est essentielle dans la
mesure où ces caractéristiques socioéconomiques peuvent
influencer la demande du maïs et de ses dérivés au
Bénin.
De même, la connaissance des élasticités
de la demande en matière de politique alimentaire estfondamentale. Les
élasticités étant les nombres sans dimension et permettent
de prédire, les effetsde changements de certaines variables telles que
les prix et les salaires sur la quantité des biens consommés.Par
exemple, quel sera l'effet d'une augmentation (en pourcentage) du salaire ou
des prix (du maïs ou des autres biens) sur la demande du maïs.
Ilfaut cependant noter que ce schéma est théorique et que la
demande alimentaire subit, trèssouvent, l'influence de certaines
variables extra-économiques, notamment socioculturelles (Ethnie,
Religion, Age, Sexe, Classe sociale etc...). Concernant l'analyse des
données proprement dite, nous avons utilisé le logiciel
SATAT12
1.4.1.
Présentation du modèle à utiliser
Pour estimer les élasticités, nous avons
adopté le modèle AIDS (AlmostIdealDemand System) qui a
été proposé par Deaton&Mullebauer (1980). Comme son
nom l'indique, c'est jusqu'à maintenant le meilleur modèle pour
estimer une fonction de consommation. Sa popularité provient du fait que
le modèle AIDS est très général (il n'exige pas une
spécification explicite de la fonction d'utilité), facile
à estimer (étant linéaire), et il est conforme avec les
restrictions de la théorie économique qui sont nécessaires
afin d'assurer une maximisation de l'utilité du consommateur. Le
modèle AIDS s'écrit comme suit:
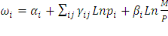 (1) (1) 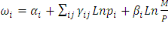
Où   sont les coefficients budgétaires ; sont les coefficients budgétaires ;
  : les prix des biens : les prix des biens  , ,  ; ;
M : la dépense totale par tête ;
  sont les paramètres à estimer ; sont les paramètres à estimer ;
P : une approximation linéaire de l'indice de Stone qui
s'écrit :
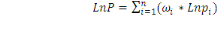 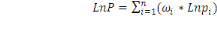 .. ..
L'équation relie donc, les coefficients
budgétaires des biens avec le logarithme des prix à la
consommation et de la consommation réelle. Pour qu'il soit issu de la
maximisation d'une fonction d'utilité, le système
d'équations va être estimé sous les contraintes
d'additivité (1.1), d'homogénéité (1.2) et de
symétrie (1.3).
(1.1) Additivité
  ; ;
  ; ;
  ; ;
(1.2) Homogénéité
  ; ;
(1.3) Symétrie
  . .
· Méthode d'estimation
Cette méthode d'estimation a été
utilisée par Oloukoi et Adégbola (2005b) lorsqu'ils cherchaient
à estimer les élasticités de demande des amandes de noix
d'anacarde au Bénin.
- Coefficients budgétaires   : La technique a consisté à calculer dans un premier temps
les coefficients budgétaires c'est-à-dire la part que
représentent les dépenses sur un bien i dans les
dépenses totales du ménage. : La technique a consisté à calculer dans un premier temps
les coefficients budgétaires c'est-à-dire la part que
représentent les dépenses sur un bien i dans les
dépenses totales du ménage.
- Indice de Stone P : Pour l'indice de
Stone, d'abord le logarithme népérien des prix d'achat moyens de
chaque bien a été calculé. Ensuite, le logarithme
népérien de l'indice de Stone a été obtenu par la
somme du produit des coefficients budgétaires et du logarithme
népérien des prix d'achat moyens de chaque bien.
- Dépenses par ménage M :
Le logarithme népérien des dépenses a été
obtenu par le logarithme népérien du montant total alloué
par chaque ménage à l'acquisition des neuf biens
considérés. Les informations sur les revenus ne sont pas souvent
fiables. Il a été préféré dans cette
étude d'utiliser les dépenses totales de consommation issues des
enquêtes auprès des ménages. Le niveau de consommation
varie très peu d'une saison à une autre contrairement au revenu.
Selon Ravelosoa et al (1999), «la consommation, qui varie moins, est
considérée comme une mesure plus exacte du revenu permanent des
ménages, et pour cette raison elle est souvent considérée
préférable comme mesure agrégée du bien-être
du ménage ».
- Dépenses réelles par ménage
M/P : Le logarithme népérien des dépenses
réelles est le logarithme népérien du rapport de M et de
P.
- Elasticités : Les
élasticités revenus et prix sont déduites de ces
estimations par les relations suivantes:
 (1.3) (1.3) 
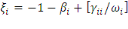 (1.4) (1.4) 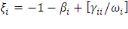
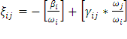 (1.5) (1.5) 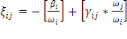
Où   représente l'élasticité de la demande, représente l'élasticité de la demande,   l'élasticité prix propre et l'élasticité prix propre et   l'élasticité noncompensée de Marshal. l'élasticité noncompensée de Marshal.
1.4.2.
Interprétation et utilité des élasticités
Les élasticités mesurent la sensibilité
des acheteurs et des vendeurs à une variation dans les conditions du
marché et permettent alors d'analyser l'offre et la demande avec une
plus grande précision. « Étant des nombres sans
dimension, les élasticités permettent des comparaisonsentre
classes et par conséquent l'énoncé de jugement de valeur
quant à l'effet des politiquesétatiques ». Par exemple,
lorsque le revenu par tête augmente, que se produit-il sur le
marché du maïs? Quel est l'effet des changements des conditions de
marché sur les consommateurs ? Et si l'effet s'amplifie, quel serait
l'impact pour l'économie globalement ?
Pour analyser ces questions, Sawadogo (1990), précise
que l'on doit disposer d'une
« Connaissance des réactions à la marge
des agents économiques, au changement des variables sous le
contrôle du décideur ».
Il existe quatre (4) types d'élasticités,
l'élasticité-prix de la demande,
l'élasticité-revenu, l'élasticité-prix
croisée de la demande et l'élasticité-prix de l'offre.
1.4.2.1. Elasticité-prix demande
L'élasticité-prix exprime la variation relative
de la demande (ou de l'offre) induite par une variation relative du prix,
toutes choses égales par ailleurs. L'élasticité-prix
directe fournit la variation que subira la demande (ou l'offre) en
réponse à la variation de 1 % du prix.
Dans le cas de la demande, les élasticités-prix
directes sont négatives puisque la plupart du temps une augmentation du
prix entraîne une diminution de la consommation (exception faite des
biens de « Giffen» dont la consommation augmente avec le prix).
C'est-à-dire que lorsque son prix monte, la quantité
demandée augmente. Les produits dont l'élasticité (en
valeur absolue) est supérieure à 1 sont fortement sensibles au
prix ; cela indique qu'une augmentation de 1 % du prix fera diminuer la
consommation (ou fera augmenter l'offre de plus de 1 %). Ainsi, la variation de
la consommation et celle de l'offre sont plus que proportionnelles à la
variation du prix. Ceux dont l'élasticité (en valeur absolue) est
inférieure à 1, est inélastique et est donc peu sensible
aux prix. Les différents types d'élasticités sont
présentés dans le tableau1 ci-dessous.
Tableau1: Les différents types
d'élasticité prix de la demande
|
Différentes valeurs de l'élasticité
|
Comportement de la demande
|
Comportement du consommateur et du vendeur
|
|
Demande parfaitement inélastique
|
une hausse du prix laisse la quantité demandée
inchangée
|
|
Demande inélastique
|
1% de hausse du prix conduit à une baisse de 0,4% de la
quantité demandée
|
|
Demande à élasticité unitaire
|
1% de hausse du prix conduit à une baisse de 1% de la
quantité demandée
|
|
Demande élastique
|
1% de hausse du prix conduit à une baisse de 2% de la
quantité demandée
|
Source : Adapté de
Ravelosoa, et al (1999)
1.4.2.2. Élasticité-prix croisée
de la demande
La consommation d'un bien peut être influencée
par le prix d'autres biens et l'on parle alors d'élasticités
croisées. Ce type d'élasticité permet de distinguer les
biens complémentaires des biens concurrents (substituts).
- Un bien est dit « complémentaire » si
l'augmentation de son prix diminue la consommation du bien initial, alors que
le prix de celui-ci est resté inchangé (  <0). <0).
- Un bien est considéré comme «
substituable » si une augmentation relative de prix de celui-ci implique
une augmentation relative de la consommation du bien initial (  >0). >0).
L'évaluation de l'impact de la variation du prix d'un
bien substitut permet de déterminer à quel point ces deux
substituts sont proches du point de vue du consommateur.
1.4.2.3. Elasticité-revenu
Elle mesure la variation en pourcentage (%), de la
quantité demandée d'un bien suite à une variation de 1% du
revenu des consommateurs. Les élasticités par rapport au revenu
sont des informations essentielles pour prévoir les structures de la
demande des consommateurs à mesure que l'économie croît et
que les gens deviennent plus riches. Il s'agit cette fois-ci de comprendre
l'impact d'une variation du revenu sur la consommation du maïs. L'un des
apports essentiels de cette notion d'élasticité-revenu est
qu'elle permet une classification des biens (Tableau 2).
Ainsi, la consommation d'un bien « inférieur
» diminue avec l'augmentation du revenu. Celle d'un bien « normal
» augmente moins que proportionnellement avec le revenu, la consommation
d'un bien de luxe augmente plus que proportionnellement avec le revenu.
Tableau2 : Classification des biens
selon leur élasticité-revenu
|
Valeur de l'élasticité-revenu
|
Caractéristique du bien
|
|
Bien inférieur
Bien normal
Bien de luxe
|
Source : Ravelosoa, et al.
(1999)
SECTION 2 : Résultats des analyses
etinterprétation
Cette section est consacrée dans une première
partie à une caractérisation du profil socioéconomique des
ménages ; puis dans nous allons estimer notre modèle, calculer
les élasticités et enfin interpréter les
résultats.
2.1.
Caractéristiques socioéconomiques des ménages
Cette section porte sur les caractéristiques
sociodémographiques des ménages. L'objectif de cette section est
de présenter un profil des ménages et certaines
caractéristiques de l'environnement socioéconomique
immédiat des ménages ciblés par l'enquête. Une telle
description est essentielle dans la mesure où ces
caractéristiques socioéconomiques et environnementales peuvent
être des déterminants de la demande.
Ø Nombre d'enquêté au niveau de
chaque département par sexe
L'analyse du graphique montre que la population la plus
enquêtée est celle du Zou et elle regorge plus de femmes que
d'hommes, tandis que l'Alibori représente la population masculine la
plus enquêtée. Nous notons également que les hommes
consommateurs du maïs et de ses dérivés ont
été plus enquêtés (soit une proportion de 55,81%)
que les femmes (soit une proportion de 44,19%).
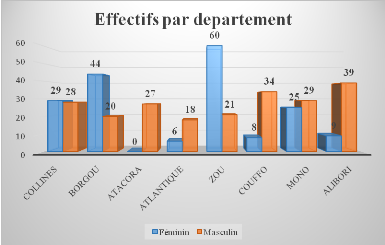
Figure3: Effectifs des ménages
enquêtés au niveau de chaque département par sexe.
Ø Niveau
d'alphabétisation
L'analyse du niveau d'alphabétisation par sexe montre
que sur un total de 100 enquêtés de sexe féminin, 82,42%
sont analphabètes et 17,58% sont alphabètes ; de même,
sur 100 enquêtés de sexe masculin, 81,73% sont analphabètes
et 17,58% sont alphabètes.
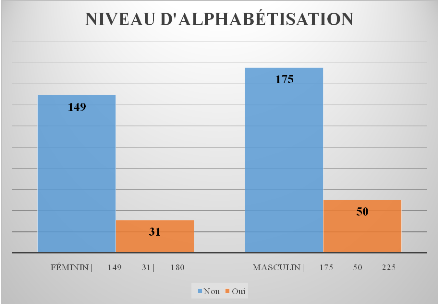
Figure4 : Niveau
d'alphabétisation en fonction du sexe
La figure nous montre que les ménages
analphabètes sont largement supérieurs aux ménages
alphabètes d'une part, et ce constat est plus remarqué au niveau
des hommes d'autre part.
Ø Niveau d'étude
L'analyse du niveau d'étude des enquêtés
en fonction du sexe révèle que 62,56% des enquêtés
n'ont aucun niveau (soit 30,26% de femmes et 32,31% d'hommes), 17,69% ont le
niveau primaire, 14,62% ont le niveau secondaire et 5.13% ont le niveau
supérieur.
Tableau3 : Niveau d'éducation
en fonction du sexe
|
Sexe
|
Niveau d'étude
|
Total
|
|
Aucun
|
primaire
|
Secondaire
|
Supérieur
|
|
Féminin
(%)
|
118
69,01
|
40
23,39
|
13
7,6
|
0
0
|
171
100
|
|
Masculin
(%)
|
126
57,53
|
29
13,24
|
44
20,1
|
20
9,13
|
219
100
|
|
Total
(%)
|
244
62,56
|
69
17,69
|
57
14,62
|
20
5,13
|
390
100
|
Le tableau ci-dessus montre qu'au fur et à mesure que
le niveau d'étude évolue, moins les enquêtés sont
nombreux d'une part et d'autre part ce constat est vraiment fréquent au
niveau des enquêtés de sexe féminin.
Ø Age moyen des
enquêtés
Les résultats issus de l'enquête
révèlent queles femmes enquêtées ont un âge
moyenégal à38,488 ans soit environs 39 ans et les hommes ont un
âge moyen égal à34.81 ans soit environs 35 ans. Autrement
dit, si les enquêtés de sexe féminin devraient avoir le
même âge ce serait 39 ans et 35 ans pour les enquêtés
de sexe masculin si elles devraient avoir le même âge. De plus la
probabilité associée au test de Student prouve qu'il existe une
différence significative (au seuil de 1%) entre l'âge moyen des
hommes et celui des femmes enquêtés. Nous pouvons alors dire que
les consommateurs de maïs et de ses dérivés
enquêtés ont un âge moyen de 37 ans.
Tableau 4:Age moyen
des enquêtés en fonction du sexe
|
Sexe
|
Nombre d'observation
|
Age moyen
|
|
Féminin
|
180
|
38,48889
|
|
Masculin
|
210
|
34,81429
|
|
Test-statistique
|
t = 2,7153
Pr(|T| > |t|) = 0,0069
|
|
Probabilité de Student
|
Ø Situation matrimoniale
D'après ce graphique, on constate que la
majorité des enquêtés sont mariés (soit 84.62%). Par
ailleurs, 9.74% des célibataires, 3.59% des divorcés, 1.54% des
veufs et 0.51% autressituations matrimoniales ont été
enquêtés. On déduit donc que la grande partie des
consommateurs du maïs et de ses dérivés au Bénin sont
des mariés.
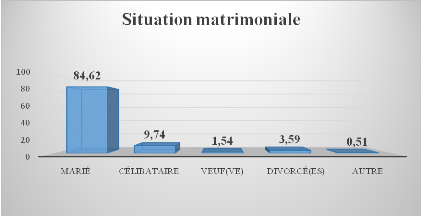
Figure 5: Situation
matrimoniale
Ø Occupation des
enquêtés
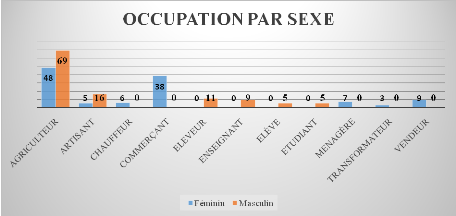
Figure 6: Occupation des
enquêtés
L'analyse des résultats sur l'occupation des
enquêtés par sexe montre que sur 100 personnes pratiquant
l'agriculture, 41,03 sont des femmes et 58,97 des hommes. Sur 100 personnes
pratiquant l'artisanat, 23,81 sont des femmes et 76,19 sont des hommes. Le
graphe montre que seules les femmes exercent le commerce et seuls les hommes
sont des éleveurs. On constate que les hommes sont nombreux à
pratiquer l'agriculture et l'artisanat.
Ø Demande du maïs et de ses
dérivés au niveau des ménages
ü Les différents produits
consommés par les ménages
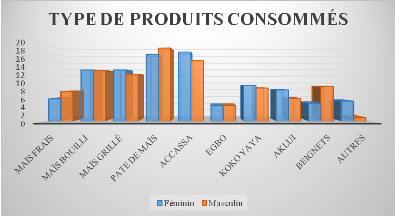
Figure 7: Types de
produits consommés par les ménages selon le sexe
Ce graphique montre que la pâte du maïs est le
premier produit consommé par les ménages (femmes comme hommes),
ainsi vient l'akassa, le maïs bouilli, maïs grillé kokoyaya,
Aklui et maïs frais. On constate alors que la pâte de maïs est
plus consommée par les hommes que les femmes tandis que l'akassa est
plus consommé par les femmes que les hommes.
ü Quantité moyenne des produits
consommée par les ménages selon le sexe
Tableau 5:
Quantité consommée des produits
|
Types de produits consommés
|
Quantité moyenne (kg) consommée selon le sexe
|
|
Féminin
|
Masculin
|
|
Maïs frais
|
8.13
|
9.97
|
|
Maïs bouilli
|
2.37
|
2.39
|
|
Maïs grillé
|
2.58
|
2.70
|
|
Pâte de maïs
|
2.77
|
3
|
|
Akassa
|
2.04
|
1.8
|
|
Egbo
|
2.38
|
2.30
|
|
Kokoyaya
|
1.21
|
1.05
|
|
Aklui
|
2.46
|
1.83
|
|
Beignets de maïs
|
3.85
|
4.28
|
Le tableau révèle qu'en moyenne, les hommes
consomment beaucoup plus des produits dérivés du maïs tels
que : le maïs frais, le maïs bouilli, maïs grillé,
pâte de maïs, et beignets de maïsque les femmes, tandis que les
femmes consomment seulement trois produits (akassa, kokoyaya et aklui) plus que
les hommes. Nous pouvons donc dire que la quantité consommée des
produits peut être influencée par le sexe.
ü Quantité moyenne consommée de
chaque produit selon la tranche d'âge
Le graphique ci-dessous montre qu'en moyenne, les
ménages âgés de 0 à 35 ans demandent plusieurs
produits (le maïs bouilli, maïs grillé, pâte de
maïs, akassa, et Beignets de maïs) que les ménages qui ont
plus de 35 ans, tandis que les plus âgés (36 ans à plus)
consomment plus de maïs frais et d'Aklui que les ménages (0 - 35
ans). On peut donc conclure que l'âge peut être un facteur qui
influence la consommation des ménages. Autrement dit la quantité
demandée des produits dérivés du maïs par les
consommateurs est relative à l'âge des consommateurs.

Figure 8: Proportion de consommation des
produits selon la tranche d'âge
Ø Les dépenses (coûts) des
ménages
ü Dépense moyenne des ménages par
sexe
Le tableau ci-dessous montre qu'en moyenne les hommes
dépensent 150 F CFA par jour alors que les femmes dépensent en
moyenne 165 F CFA dans la consommation du maïs et de ses
dérivés. La probabilité associée au test de Student
(0,33), montre qu'il n'existe pas une différence significative entre la
dépense moyenne des femmes affectées à la consommation du
maïs et de ses dérivés et celles des hommes.
Tableau 6:
Dépenses moyennes des ménages
|
Sexe
|
Nombre d'observation
|
Dépense moyenne
|
|
Féminin
|
180
|
163,2778
|
|
Masculin
|
210
|
151,5
|
|
Test-statistique
|
0,9683
Pr(|T| > |t|) = 0,3335
|
|
Probabilité de Student
|
ü Dépenses moyennes des ménages
selon le type de produit
Tableau 7: Dépenses moyennes
des ménages par produits
|
Types de produits
|
Dépenses moyennes des ménages
|
|
Maïs frais
|
219,93
|
|
Maïs bouilli
|
192,67
|
|
Maïs grillé
|
183,33
|
|
Pâte de maïs
|
549,27
|
|
Akassa
|
307,39
|
|
Egbo
|
233,33
|
|
Kokoyaya
|
221,5
|
|
Aklui
|
143,27
|
|
Beignets de maïs
|
82,62
|
Le tableau ci-dessus montre qu'en moyenne, les ménages
affectent plus leur revenu à la consommation de la pâte de
maïs, l'akassa, kokoyaya et maïs frais, tandis que le beignet du
maïs est le produit auquel ils allouent moins leur revenu. Nous pouvons
donc conclure qu'au Bénin, les produits tels que : pâte de
maïs, akassa, kokoyaya et maïs frais, font partir des aliments de
base des ménages.
2.2.Déterminants de la demande du maïs et de ses
dérivés
Nous allons faire une statistique descriptive des variables du
modèle. Ensuite faire un tableau présentant les détails
sur les facteurs expliquant la demande du maïs et de ses
dérivés.
Les paramètres estimés par le modèle AIDS
sont présentés dans le tableau 8. La variable dépendante
est la quantité demandée de chaque produit  . Les variables indépendantes sont le logarithme
népérien des dépenses affectées à la
consommation du maïs et de ses dérivés (lcout), logarithme
népérien du maïs frais (lprix1), logarithme
népérien du prix du maïs bouilli (lprix2), logarithme
népérien du prix du maïs grillé (lprix3), logarithme
népérien du prix de la pâte du maïs (lprix4),
logarithme népérien du prix d'akassa (lprix5), logarithme
népérien du prix d'egbo (lprix6), logarithme
népérien du prix de koko yaya (lprix7), logarithme
népérien du prix d'aklui (lprix8), logarithme
népérien du prix des beignets du maïs (lprix9). . Les variables indépendantes sont le logarithme
népérien des dépenses affectées à la
consommation du maïs et de ses dérivés (lcout), logarithme
népérien du maïs frais (lprix1), logarithme
népérien du prix du maïs bouilli (lprix2), logarithme
népérien du prix du maïs grillé (lprix3), logarithme
népérien du prix de la pâte du maïs (lprix4),
logarithme népérien du prix d'akassa (lprix5), logarithme
népérien du prix d'egbo (lprix6), logarithme
népérien du prix de koko yaya (lprix7), logarithme
népérien du prix d'aklui (lprix8), logarithme
népérien du prix des beignets du maïs (lprix9).
|
Variables
|
Moyenne
|
Stand. déviation
|
Minimum Maximum
|
|
Ln de quantité demandée de maïs frais
(lqtkg1)
Ln de quantité demandée de maïs bouilli
(lqtkg2)
Ln de quantité demandée de maïs
grillé (lqtkg3)
Ln de quantité demandée de pate de maïs
(lqtkg4)
Ln de quantité demandée d'accassa (lqtkg5)
Ln de quantité demandée d'egbo (lqtkg6)
Ln de quantité demandée de kokoyaya (lqtkg7)
Ln de quantité demandée d'aklui (lqtkg8)
Ln de quantité demandée de beignets
(lqtkg9)
Ln du prix de maïs frais (lprix1)
Ln du prix de maïs bouilli (lprix2)
Ln du prix de maïs grillé (lprix3)
Ln du prix de pate de maïs (lprix4)
Ln du prix d'accassa (lprix5)
Ln du prix d'egbo (lprix6)
Ln du prix de kokoyaya (lprix7)
Ln du prix d'aklui (lprix8)
Ln du prix de beignets (lprix9)
Ln dépenses ou coût (lcout)
|
1.35
0.69
0.81
0.62
0.78
1.02
0.19
0.65
1.31
3.83
4.31
4.27
4.84
3.60
3.88
3.30
3.59
3.14
4.74
|
0 .16
0.20
0.18
0.21
0.25
0.70
0.12
0.09
0.20
0.14
0.17
0.23
0.15
0.20
0.09
0.07
0.10
0.11
0.86
|
0 2.77
0 1.80
0 1.80
0 1.80
0 2.05
0.70 1.80
0 1.10
0 2.079
0 2.71
3.22 4.61
3.22 5.01
1.10 5.01
3.91 5.86
3.22 4.60
3.22 8.41
3.22 3.91
3.22 4.31
1.61 3.91
2.30 6.40
|
Tableau 8 : Statistiques
descriptives des variables du modèle
Tableau 9:Déterminants de la
demande du maïs et de ses dérivés dans le modèle
AIDS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
VARIABLES
|
Maïs frais
|
Maïs bouilli
|
Maïs grillé
|
Pâte de maïs
|
Akassa
|
Egbo
|
Kokoyaya
|
Aklui
|
Beignets du maïs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lprix1
|
-0.522***
|
-0.0276
|
-0.0279
|
-0.0224
|
-0.0442
|
-0.00101
|
-0.00717
|
-0.0106
|
-0.0232
|
|
(0.200)
|
(0.0184)
|
(0.0183)
|
(0.0176)
|
(0.0274)
|
(0.00307)
|
(0.00836)
|
(0.00726)
|
(0.0186)
|
|
lprix2
|
-0.0353**
|
0.0649
|
-0.055***
|
-0.0479***
|
-0.0878***
|
-0.00329
|
-0.0153
|
-0.0187*
|
-0.0431**
|
|
(0.0146)
|
(0.158)
|
(0.0180)
|
(0.0172)
|
(0.0252)
|
(0.00375)
|
(0.00972)
|
(0.0102)
|
(0.0207)
|
|
lprix3
|
-0.0252*
|
-0.0413*
|
0.0514
|
-0.0382*
|
-0.0628*
|
-0.00375
|
-0.0140*
|
-0.0104
|
-0.0333*
|
|
(0.0149)
|
(0.0238)
|
(0.0986)
|
(0.0219)
|
(0.0361)
|
(0.00259)
|
(0.00770)
|
(0.00828)
|
(0.0180)
|
|
lprix4
|
-0.0175
|
-0.0312*
|
-0.0287*
|
-0.506***
|
-0.0487*
|
-0.00224
|
-0.00712
|
-0.0101
|
-0.0178
|
|
(0.0117)
|
(0.0171)
|
(0.0167)
|
(0.175)
|
(0.0251)
|
(0.00260)
|
(0.00854)
|
(0.00615)
|
(0.0175)
|
|
lprix5
|
-0.0194**
|
-0.0332***
|
-0.031***
|
-0.0320***
|
-0.421***
|
-0.0036**
|
-0.0119**
|
-0.00702*
|
-0.0257**
|
|
(0.00823)
|
(0.0110)
|
(0.0106)
|
(0.0111)
|
(0.105)
|
(0.00181)
|
(0.00555)
|
(0.00420)
|
(0.0123)
|
|
lprix6
|
-0.0235*
|
-0.0428**
|
-0.0388**
|
-0.0387**
|
-0.0659**
|
0.294
|
-0.0107
|
-0.0125*
|
-0.0245
|
|
(0.0135)
|
(0.0174)
|
(0.0180)
|
(0.0169)
|
(0.0258)
|
(0.211)
|
(0.0100)
|
(0.00759)
|
(0.0227)
|
|
lprix7
|
-0.0280
|
-0.0346
|
-0.0372
|
-0.0378
|
-0.0479
|
-0.00539
|
-0.325***
|
3.64e-05
|
-0.0591
|
|
(0.0362)
|
(0.0593)
|
(0.0543)
|
(0.0584)
|
(0.0878)
|
(0.00831)
|
(0.0988)
|
(0.0136)
|
(0.0494)
|
|
lprix8
|
-0.0238*
|
-0.0411**
|
-0.0381**
|
-0.0371*
|
-0.0632**
|
-0.00340
|
-0.0114
|
0.279*
|
-0.0274
|
|
(0.0133)
|
(0.0193)
|
(0.0184)
|
(0.0189)
|
(0.0288)
|
(0.00282)
|
(0.00933)
|
(0.145)
|
(0.0211)
|
|
lprix9
|
-0.0128
|
-0.0177
|
-0.0186
|
-0.0139
|
-0.0286
|
-0.000415
|
-0.00499
|
-0.00710
|
0.700**
|
|
(0.0139)
|
(0.0225)
|
(0.0211)
|
(0.0208)
|
(0.0342)
|
(0.00271)
|
(0.00777)
|
(0.00738)
|
(0.274)
|
|
lcout
|
0.0352***
|
-0.059***
|
0.0551***
|
0.0566***
|
0.0881***
|
-0.06**
|
0.0217***
|
0.0125**
|
-0.0479***
|
|
(0.0116)
|
(0.0126)
|
(0.0124)
|
(0.0131)
|
(0.0172)
|
(0.00259)
|
(0.00695)
|
(0.00618)
|
(0.0162)
|
|
sexe
|
0.00517
|
-0.00392
|
0.000923
|
0.00379
|
-0.0119
|
0.00259
|
0.0157
|
-0.0120
|
0.0330*
|
|
(0.0147)
|
(0.0174)
|
(0.0175)
|
(0.0194)
|
(0.0247)
|
(0.00572)
|
(0.0134)
|
(0.00886)
|
(0.0175)
|
|
age
|
0.000431
|
-0.000258
|
0.000234
|
-0.000533
|
-0.000216
|
-0.000183
|
0.000158
|
0.000172
|
0.00131**
|
|
(0.000525)
|
(0.000723)
|
(0.000690)
|
(0.000628)
|
(0.000807)
|
(0.000244)
|
(0.000538)
|
(0.000264)
|
(0.000639)
|
|
Constant
|
3.886***
|
1.738**
|
1.380***
|
3.839***
|
3.675***
|
2.226***
|
1.471***
|
1.902***
|
4.199***
|
|
(0.836)
|
(0.787)
|
(0.519)
|
(0.909)
|
(0.639)
|
(0.824)
|
(0.228)
|
(0.562)
|
(0.911)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB : ***, **, * représente respectivement la
significativité à 1%, 5% et 10% ; les valeurs entre
parenthèses sont les erreurs standard
Nous ressortons du tableau 9 que:
Au seuil de 1%, la demande du maïs frais est
influencée par le prix du maïs frais et les dépenses
affectées à la consommation du maïs et de ses
dérivés. Ainsi, au seuil de 5%, cette même demande est
influencée par les prix du maïs bouilli et de l'akassa. Enfin, au
seuil de 10%, cette demande est influencée par les prix du maïs
grillé, egbo et d'aklui. Donc à 99% de chance, la quantité
demandée du maïs diminue quand son prix augmente et elle augmente
au même pourcentage quand les dépenses affectées à
la consommation du maïs et de ses dérivésaugmentent. A 95%
de chance, cette quantité diminue quand les prix du maïs bouilli et
de l'Akassa augmentent. A 90% de cas, la quantité du maïs frais
diminue quand les prix du maïs grillé, d'egbo et d'aklui
augmentent.
Au seuil de 1%, la demande du maïs bouilli est
influencée par le prix d'Akassa et les dépenses associées
à la consommation du maïs et de ses dérivés.
Cependant, au seuil de 5%, cette demande est influencée par les prix
d'egbo et d'aklui. Au seuil de 10%, la demande du maïs bouilli est
influencée par les prix du maïs grillé et de la pâte
du maïs. Donc à 99% de chance, la quantité demandée
du maïs bouilli diminue quand le prix d'akassa et les dépenses
affectées à la consommation du maïs et de ses
dérivés augmentent. A 95% de cas, cette quantité
demandée diminue lorsque les prix d'égbo et d'aklui augmentent.
Cette quantité diminue également quand les prix du maïs
grillé et de la pâte de maïs augmentent.
Au seuil de 1%, la demande du maïs grillé est
influencée par les prix du maïs bouilli et l'akassa et les
dépenses affectées à la consommation du maïs et de
ses dérivés. Au seuil de 5%, elle est influencée par les
prix d'egbo et d'aklui. Au seuil de 10%, elle est influencée uniquement
par le prix de la ·pâte du maïs. Donc à 99% des cas,
la quantité demandée du maïs grillé diminue quand les
prix de maïs bouilli de l'akassa augmentent et augmente quand les
dépenses affectées à la consommation du maïs et de
ses dérivésaugmentent. A 95% de chance, cette quantité
diminue quand les prix de maïs bouilli et d'akassa augmentent. A 90% des
cas, cette quantité diminue quand le prix de la pâte du maïs
augmente.
Au seuil de 1%, la demande de la pâte du maïs est
influencée par les prix du maïs bouilli, de la pâte du
maïs, d'akassa et les dépenses affectées à la
consommation du maïs et de ses dérivés. Au seuil de 5%, elle
est influencée par les prix d'egbo et d'aklui. Seul le prix du maïs
grillé l'influence au seuil de 10%. Donc à 99% de chance, la
quantité de la pâte du maïs demandée diminue quand son
prix, les prix du maïs bouilli et d'akassa augmentent et de même,
elle augmente quand les dépenses affectées à la
consommation du maïs et de ses dérivés augmentent. A 95% de
cas, cette quantité diminue quand les prix d'egbo et d'aklui augmentent.
A 90% de cas, cette quantité diminue quand le prix du maïs
grillé augmente.
Au seuil de 1%, la demande d'akassa est influencée par
les prix d'akassa, du maïs bouilli, et les dépenses
affectées à la consommation du maïs et de ses
dérivés. Au seuil de 5%, elle est influencée par les prix
d'egbo et d'aklui. Au seuil de 10%, elle est influencée par les prix du
maïs grillé et de la pâte de maïs. Donc à 99% de
chance, la quantité d'akassa demandée diminue quand les prix
d'akassa, du maïs bouilli augmentent et de même, elle augmente quand
les dépenses affectées à la consommation du maïs et
de ses dérivés augmentent. A 95% de cas, cette quantité
diminue quand les prix d'egbo et d'aklui augmentent. A 90% de cas, cette
quantité diminue quand les prix du maïs grillé et de la
pâte du maïs augmentent.
La demande d'egbo est influencée par le prix
d'akassa et les dépenses affectées à la consommation du
maïs et de ses dérivés au seuil de 5%. Donc à 95% de
chance, cette demande diminue quand le prix d'akassa augmente et les
dépenses affectées à la consommation du maïs et de
ses dérivés augmentent.
La demande de kokoyaya est influencée par : son
prix et les dépenses affectées à la consommation du
maïs et de ses dérivés (au seuil de 1%) ; le prix
d'akassa (au seuil de 5%) et le prix du maïs grillé (au seuil de
10%). Donc à 99% de cas, la quantité de kokoyaya demandée
diminue quand son prix augmente et elle augmente quand les dépenses
affectées à la consommation du maïs et de ses
dérivés augmentent. A 95% de chance, elle diminue quand le prix
d'akassa augmente. A 90% de chance, elle diminue quand le prix du maïs
grillé augmente.
La demande d'aklui est influencée par : le prix du
maïs bouilli et les dépenses affectées à la
consommation du maïs et de ses dérivés (au seuil de
5%) ; les prix de la pâte du maïs, d'akassa, d'egbo et d'aklui
(au seuil de 10%). Donc à 95% de chance, la quantité d'aklui
demandée diminue quand le prix du maïs bouilli et les
dépenses affectées à la consommation du maïs et de
ses dérivés augmentent. A 90% de chance, cette quantité
diminue quand les prix de la pâte du maïs, d'akassa, d'egbo et
d'aklui augmentent.
La demande des beignets du maïs est influencée
par : les dépenses affectées à la consommation du
maïs et de ses dérivés (au seuil de 1%) ; les prix du
maïs bouilli, d'akassa, des beignets du maïs et l'âge (au seuil
de 5%) ; le prix du maïs grillé et le sexe (au seuil de 10%).
Donc à 99% de chance, la quantité des beignets demandée
diminue quand les dépenses affectées à la consommation du
maïs et de ses dérivés augmentent. A 95% de chance, cette
quantité diminue quand les prix du maïs bouilli, d'akassa et des
beignets du maïs augmentent. Elle augmente au même pourcentage
lorsque l'âge du consommateur est compris entre 0 - 35 ans. A 90% de
chance, cette quantité diminue quand le prix du maïs augmente et
elle augmente quand le consommateur est de sexe masculin.
Conclusion partielle
En conclusion, chaque produit subit une influence des prix des
autres biens, des dépenses affectées à la consommation du
maïs et de ses dérivés et de son propre prix. A l'exception
du Maïs bouilli, Maïs grillé et Egbo qui ne sont pas
influencés par leur propre prix. Donc un changement de prix de l'un des
produits peut ainsi avoir un effet sur la quantité demandée d'un
autre produit. C'est donc l'importance du point suivant qui traite le
comportement de chaque produit face à un éventuel changementde
son prix, du prix d'un autre ou des dépenses affectées à
la consommation du maïs et de ses dérivés.
2.3.Estimation des élasticités à l'aide
du modèle AIDS
Notre objectif est de tester le modèle AIDS permettant
de prévoir le comportement des consommateurs du maïs et de ses
dérivés face à une variation de leur revenu (coût ou
dépenses) ou à une modification des prix des produits. Dans la
présentation qui suit, les élasticités revenu sont
présentées en premier lieu, les élasticités prix
des différentes spéculations suivent etenfin viennent les
élasticités prix croisés. En définition,
l'élasticité de la demande individuelle du consommateur est
égale à la variation relative de la demande en fonction de la
variation relative de la variable. On considère
généralement :
ü L'élasticité par rapport au prix du
bien
ü L'élasticité par rapport au revenu
ü L'élasticité croisée par rapport
au prix des autres biens
2.3.1.Elasticités revenu
Elles mesurent la variation de la demande par rapport au
revenu, toutes choses étant égales par ailleurs.
Après l'estimation des élasticités-revenu
(tableau 10), nous constatons qu'elles sont de signe attendu.En termes de
valeurs, les élasticités-revenu de certains produits sont
légèrement supérieures à 1 tandis que d'autres sont
comprises entre 0 et 1.Ainsi, parmi ces produits dont
l'élasticité-revenu est légèrement
supérieure à un, figurent le Maïs frais (  =1.03), le Maïs grillé ( =1.03), le Maïs grillé (  =1.07), la Pâte du maïs ( =1.07), la Pâte du maïs (  =1.09), l'Akassa ( =1.09), l'Akassa (  =1.11) et Kokoyaya ( =1.11) et Kokoyaya (  =1.11).Donc une augmentation de 1% des dépenses totales conduit
à une augmentation de plus d'un % de la quantité demandée
respective de ces différents produits. Ce qui est conforme à
notre première hypothèse selon laquelle, l'augmentation du revenu
des ménages entraine une augmentation de la demande du maïs et de
ses dérivés. =1.11).Donc une augmentation de 1% des dépenses totales conduit
à une augmentation de plus d'un % de la quantité demandée
respective de ces différents produits. Ce qui est conforme à
notre première hypothèse selon laquelle, l'augmentation du revenu
des ménages entraine une augmentation de la demande du maïs et de
ses dérivés.
Par exemple, une augmentation de 1% des dépenses
totales entraîne une augmentation de 1.11% de la quantité
demandée d'Akassa.
Quant aux autres produits à
élasticité-revenu comprise en 0 et 1 figurent le maïs
bouilli (  =0.91), Egbo ( =0.91), Egbo (  =0.94), Aklui ( =0.94), Aklui (  =0.98) et les Beignets du maïs ( =0.98) et les Beignets du maïs (  =0.96). Une augmentation de 1% des dépenses totales conduira
à une augmentation de la quantité demandée de ces produits
(Maïs bouilli, Egbo, Aklui, Beignets du maïs) mais dans une
proportion plus faible que celle des dépenses. =0.96). Une augmentation de 1% des dépenses totales conduira
à une augmentation de la quantité demandée de ces produits
(Maïs bouilli, Egbo, Aklui, Beignets du maïs) mais dans une
proportion plus faible que celle des dépenses.
Nous constatons que la demande du maïs et de ses
dérivés est vraiment sensible à la variation des
dépenses totales (revenus). C'est-à-dire, dès que le
niveau de vie des ménages Béninois s'améliore, ils tendent
à augmenter leur niveau de consommation. On déduit alors, que les
produits tels que : le Maïs bouilli, Egbo, Aklui et les Beignets du
maïs constituent des biens normaux tandis que le Maïs frais, le
Maïs grillé, la Pâte du maïs, l'Akassa et
Kokoyayareprésententdes biens supérieurs pour les ménages.
Ces derniers biens sont qualifiés de supérieurs parce qu'ils sont
surement chers sur le marché.
En réalité, le maïs représente
l'aliment de base de la population béninoise et certains de ses
dérivés font également partir des aliments courants que
les ménages béninois consomment. De l'importance qu'occupe le
maïs dans l'alimentation des ménages béninois, il ne peut
pas cependant être qualifié d'un bien supérieur. De plus,
vu les valeurs des élasticités revenu obtenues pour ces produits
qui parmi elles sont légèrement supérieures à 1,
nous pouvons alors être en mesure de dire que le maïs et ses
dérivés constituent des biens normaux et non
supérieurs.
Nous concluons que notre troisième hypothèse
selon laquelle le maïs et ses dérivés sont des biens normaux
est vérifiée.
Tableau 10 : Elasticités
revenu
|
Produits
|
Elasticités revenu
|
|
Maïs frais
|
1.03
|
|
Maïs bouilli
|
0.91
|
|
Maïs grillé
|
1.07
|
|
Pâte du maïs
|
1.09
|
|
Akassa
|
1.11
|
|
Egbo
|
0.94
|
|
Kokoyaya
|
1.11
|
|
Aklui
Beignets du maïs
|
0.98
0.96
|
2.3.2.Les élasticités prix propres (  ) )
Par définition, l'élasticité prix de la
demande est égale à la variation relative de la demande du bien
en fonction de l'augmentation relative du prix.
En effet, l'analyse du tableau 11 montre que les
élasticités de la demande du maïs et de ses
dérivés par rapport à leur prix sont de signe attendu.
Les produits les plus sensibles aux variations des prix sont : Kokoyaya
avec une élasticité prix propre (  = -2.69), suivi de la pâte du maïs ( = -2.69), suivi de la pâte du maïs (  = -1.88), d'Akassa ( = -1.88), d'Akassa (  = -1.63) et le Maïs frais ( = -1.63) et le Maïs frais (  = -1.42).De plus, le Maïs bouilli, le maïs grillé,
l'Egbo, Aklui, et les Beignets du maïs sont des produits dont la
quantité demandée est moins sensible à leur prix.Ainsi
toute hausse de 1% du niveau du prix d'Akassa, de Kokoyaya, de la Pâte du
maïs et du Maïs frais se traduit par une baisse de la quantité
demandée respective (1.63%, 2.69%, 1.88%, 1.42%) de ces produits. Donc
nous déduisons que la demande d'akassa, de Kokoyaya, de la pâte du
maïs et du maïs frais, est élastique au prix tandis que celle
du Maïs bouilli, Maïs grillé, Egbo, Aklui et des Beignets est
inélastique au prix. = -1.42).De plus, le Maïs bouilli, le maïs grillé,
l'Egbo, Aklui, et les Beignets du maïs sont des produits dont la
quantité demandée est moins sensible à leur prix.Ainsi
toute hausse de 1% du niveau du prix d'Akassa, de Kokoyaya, de la Pâte du
maïs et du Maïs frais se traduit par une baisse de la quantité
demandée respective (1.63%, 2.69%, 1.88%, 1.42%) de ces produits. Donc
nous déduisons que la demande d'akassa, de Kokoyaya, de la pâte du
maïs et du maïs frais, est élastique au prix tandis que celle
du Maïs bouilli, Maïs grillé, Egbo, Aklui et des Beignets est
inélastique au prix.
Ces résultats viennent alors infirmer notre
hypothèse selon laquelle, la demande du maïs et de ses
dérivés est inélastique par rapport au prix. Alors cette
hypothèse est vérifiée pour certains produits et
rejetée pour d'autres. Donc pour favoriser la consommation du maïs
et de ses dérivés, il serait important de mettre en place une
politique qui vise d'une part à réguler les prix du maïs et
de ses dérivés sur le marché et accroître la
capacité productive des maïsiculteurs et des transformateurs du
maïs d'autre part.
Tableau 11 : Elasticité prix
propre des produits
|
Produits
|
Elasticités prix propre
|
|
Maïs frais
|
-1.42
|
|
Maïs bouilli
|
-0.85
|
|
Maïs grillé
|
-0.94
|
|
Pâte de maïs
|
-1.88
|
|
Akassa
|
-1.63
|
|
Egbo
|
-0.65
|
|
Kokoyaya
|
-2.69
|
|
Aklui
Beignets du maïs
|
-0.56
-0.42
|
2.3.3.Elasticités prix croisé
La demande d'un bien dépend du prix de ce bien, mais
aussi du prix des autres biens.Une élasticité croisée
positive signifie que l'augmentation du prix d'un bien entraîne
l'augmentation de la demande de l'autre bien. Les deux biens sont donc
substituables.
En effet, d'après les valeurs des
élasticités croisées obtenues dans le tableau 12, nous
constatons que le maïs bouilli est substituable au Maïs frais, au
Maïs grillé, à la Pâte de maïs, auKokoyaya,
à Egbo et à Aklui. De plus, le bien Egbo et les Beignets du
maïs sont substituablesà tous les autres dérivés. En
fin, le dérivéAklui est substituable au Kokoyaya et à
Egbo.
Ainsi, une élasticité croisée
négative signifie que l'augmentation du prix d'un bien entraîne la
diminution de la quantité demandée d'un autre bien. Les deux
biens sont alors dits complémentaires.
Toujours, le tableau 12 révèle que le maïs
frais, la pâte du maïs, l'akassa et kokoyaya sont
complémentaires à la fois entre eux et aux autres biens
(Maïs bouilli, Maïs grillé, aklui, Beignets de maïs et
Egbo). De même, le maïs bouilli est complémentaire à
l'Akassa et aux beignets de maïs. Dans plus, Aklui est
complémentaire au Maïs frais, Maïs bouilli, Maïs
grillé, Akassa, Pâte de maïs, et aux Beignets du
maïs.
Tableau12 :
Elasticités prix croisés
|
Maïs frais
|
Maïs bouilli
|
Maïs grillé
|
Pâte de maïs
|
Akassa
|
Egbo
|
Koko yaya
|
Aklui
|
Beignets de maïs
|
|
Maïs frais
Maïs bouilli
Maïs grillé
Pâte de maïs
Akassa
Egbo
Koko yaya
Aklui
Beignets de maïs
|
-1.42
0.017
-0.11
-0.13
-0.15
0.03
-0.31
-0.031
0.023
|
-0.04
-0.85
-0.10
-0.12
-0.14
0.03
-0.24
-0.024
0.027
|
-0.043
0.02
-0.94
-0.13
-0.145
0.027
-0.27
-0.03
0.025
|
-0.036
0.046
-0.096
-1.88
-0.14
0.035
-0.24
-0.016
0.03
|
-0.051
-0013
-0.13
-0.15
-1.63
0.01
-0.31
-0.056
0.019
|
-0.027
0.082
-0.072
-0.10
-0.12
-0.65
-0.14
0.014
0.036
|
-0.027
0.082
-0.071
-0.09
-0.11
0.06
-2.69
0.016
0.036
|
-0.031
0.068
-0.076
-0.10
-0.12
0.05
-0.11
-0.56
0.033
|
-0.048
-0.73
-0.12
-0.013
-0.16
0.027
-0.52
-0.036
-0.42
|
Conclusion et recommandations
Cette étude présente les résultats de
l'estimation d'un système de demande du maïs et de ses
dérivés au Bénin. Nous avons appliqué un
modèle presque idéale proposé par Deaton (1988), puis
étendu par Huang et Lin (2000).
Au terme de cette étude, les résultats obtenus
mesurent quantitativement la relation entre les prix, le total des
dépenses et la demande des consommateurs pour divers groupes d'aliments.
Ils établissent également une relation entre la demande du
maïs et de ses dérivés et des variables
socioéconomiques telles que l'âge et le sexe. Les résultats
de l'étude sont les suivants : Les estimations des paramètres des
équations des parts budgétaires révèlent que
l'âge, le sexe, le revenu (dépenses totales) et les prix des
différents biens sont des facteurs importants qui expliquent les
variations de la demande observées au niveau des ménages.
En effet, les ménages cherchent à consommer plus
le maïs et ses dérivés quand leur niveau de vie
s'améliore (revenu). Autrement dit, la consommation des ménages
augmente de façon proportionnelle à leur revenu. Alors, le
maïs et ses dérivés constituent des biens normaux pour les
ménages béninois.De plus, une variation positive des prix du
maïs frais, de la pâte du maïs, d'akassa et de kokoyaya
entraîne une forte diminution de la quantité demandée de
ces biens, alors que la variation positive des prix du maïs bouilli, du
maïs grillé, d'egbo, aklui et des beignets du maïs influence
faiblement la quantité demandée de ces biens. On note alors que
la demande dumaïs frais, de la pâte du maïs, d'akassa et de
kokoyaya est élastique tandis que la demande du maïs bouilli, du
maïs grillé, d'egbo, aklui et des beignets du maïs est
inélastique. Ensuite, nous ressortons de ses résultats que le
maïs et ses dérivés sont complémentaires et
substituables entre eux.
Enfin, pour soutenir l'économie béninoise et
lutter contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement doit
mettre en place une politique qui vise à augmenter la production du
maïs afin de satisfaire la demande nationale. De même, il doit
appliquer une politique de régulation des prix afin de booster la
consommation.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Adégbola P., Aloukoutou A. et Diallo B.
(2012). Analyse de la compétitivité du maïs local
au Bénin, pp2.
Adégbola P., Djinaou A., Ahoyo N., Allagbe M.,
Gotoechan H., Adjanohoun A., Mensah A. (2013/CNS-Maïs).
Synthèse bibliographique des travaux de recherche effectués sur
la filière maïs de 2000 à 2012 au Bénin
Amoussouga G. (2000). Cours
d'économie. FASEG/UNB.
Banque mondiale (2016).
www.banquemondiale.org/fr/country/bénin/overview.
BOURDIEU P. (1979), La Distinction, Critique
sociale du jugement, réédition Minuit, 1996.
CERNA (2013). Rapport sur la consommation
alimentaire des ménages urbains au Bénin.
Djalilou-Dine A. (2006). Analyse des facteurs
déterminants la demande du riz au centre au sud su Bénin,
thèse d'ingénieur agronome.
DUESENBERRY J.S (1949), Income, Saving and
the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press.
Fandohan P.(2000) : Introduction du grenier
fermé en terre au Sud-Bénin pour le stockage du maïs.
Rapport technique de la recherche- INRAB- PTAA. 29 p.
FAO (1995a). La situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture 1995. Accessible sur le site
http://www.foa.org .
FAO (1995b). Le consommateur face aux
réformes in La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
1995. Accessible sur le site
http://www.fao.org.
http://www.agrobenin.com/wp-content/uploads/2011/08/ma%C3%AFs2.jpg.
INRA (2006). Laboratoire de recherche sur la
consommation, accessible sur le site
http://www.ivry.inra.fr/corela/theme
modal.php,
KEYNES J.M (1969), Théorie
générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie,
Payot.
Les grands dossiers de Sciences humaines, numéro 22,
mars 2011.
MAEP (2010) : Analyse économique et
financière de cinq (05) chaines de valeurs ajoutées (CVA) de la
filière maïs au Bénin.
MAEP (2010) : Annuaire de la statistique :
campagne 2009-2010. Cotonou, Bénin.
Oloukoi L. et Adegbola P. (2005b).Estimation
des élasticités de demande des amandes de noix d'anacarde au
Bénin à partir d'un modèle AIDS.
ONS (2010) rapport d'étude du prix
planché du maïs au titre de la campagne 2010-2011.
PAM (2012). Rapport évaluation rapide
de la sécurité alimentaire et des marches/ Bénin et
Togo.
Ravelosoa, R., S., Haggblade et H., Rajemison,
(1999). Estimations des élasticités de demande
Madagascar à partir d'un modèle AIDS, Antananarivo INSTA.
RNDH (2015). Rapport national sur le
développement humain, agriculture, sécurité alimentaire et
développement humain au Bénin. P.121.
Sadoulet, E. & A. de Janvry (1993).
DemandAnalsis in QuatitativeDevelopment Policy Analysis, Agricultutral Resource
EconomicsUniversity of Califormia, June 199, pp28-47.
Sawadogo K. (1990). Consommation urbaine et
politique alimentaire au Libéria : une approche en termes de
systèmes complets de demande, Revue Economique et Sociale
Burkinabè, n°XXXI.
VEBLEN T. (1899), La théorie de la
classe de loisir, Gallimard, réédition.
Wêtohossou C.(1995): Stratégies
paysannes de gestion des stocks de maïs : le cas du Bénin :
228-231. In : CIRAD et FSAUNB (eds.) Production et valorisation du maïs
à l'échelon villageois en Afrique de l'Ouest. Actes du
séminaire «Maïs prospère» tenu à Cotonou
(Bénin), 25-28 janvier 1994.
TABLE
DES MATIERES
DEDICACE
iii
DEDICACE
iv
REMERCIEMENTS
v
SIGLES ET ABREVIATIONS
vi
SOMMAIRE
vii
LISTE DES TABLEAUX
viii
LISTES DES FIGURES
viii
Résumé
x
INTRODUCTION
1
CHAPITRE
1 : CADRE THEORIQUE
3
SECTION 1 : Problématique, Objectifs et
Hypothèses
4
1.1. Problématique
4
1.2. Objectifs de recherche
6
1.2.1. Objectif global
6
1.2.2. Objectifs spécifiques
6
1.3. Hypothèses
6
SECTION 2 : Revue de la
littérature
6
2.1. Historique et évolution de la
production du maïs et de ses dérivés au Bénin
7
2.2. Clarification conceptuelle de la fonction de
demande
13
2.3. Les facteurs déterminants la
demande
16
2.4. Etudes empiriques sur la demande des produits
agricoles
19
CHAPITRE
2 : CADRE INSTITUTIONNEL
22
SECTION 1 : Présentation du lieu de
stage
23
1.1. Historique du PAPA
23
1.2. Mission du PAPA
24
1.3. Structure du PAPA
24
1.4. Ressources humaines du PAPA
25
1.5. Organisation technique
30
1.6. Mobilisation de fonds
30
1.7. Moyens et outils utilisé au
PAPA
30
SECTION 2 : Déroulement du stage au
PAPA
32
2.1. Taches exécutées
32
2.2. Difficultés rencontrées
32
CHAPITRE
3 : CADRE METHODOLOGIQUE ET RESULTATS
34
SECTION 1 : Méthodologie de
recherche
35
1.1. Présentation de la zone
d'étude
35
1.2. Echantillonnage
35
1.3. Données
35
1.4. Méthode d'analyse des
données
36
1.4.1. Présentation du modèle
à utiliser
37
1.4.2. Interprétation et
utilité des élasticités
39
1.4.2.1. Elasticité-prix demande
39
1.4.2.2. Élasticité-prix
croisée de la demande
40
1.4.2.3. Elasticité-revenu
41
SECTION 2 : Résultats des analyses
interprétation
42
2.1. Caractéristiques
socioéconomiques des ménages
42
2.2.Déterminants de la demande du maïs
et de ses dérivés
49
Conclusion partielle
54
2.3. Estimation des élasticités
à l'aide du modèle AIDS
54
2.3.1. Elasticités revenu
55
2.3.2. Les élasticités prix propres
(  )
56 )
56
2.3.3. Elasticités prix croisé
58
Conclusion et recommandations
60
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
61
TABLE DES MATIERES
63

| 


 )
56
)
56

