_
Faites votre page de garde !
REMERCIEMENTS
Mes sincères remerciement à l'endroit de Mme
MARIE- SAINTE MICHELINE pour avoir accepté de diriger et coordonner ce
mémoire. Sa lecture attentive et critique des versions successives de ce
texte a très largement contribué à ce que cette recherche
soit menée à son terme.
Je tiens également à remercier toutes les
personnes qui, de près ou de loin et parfois même sans le savoir,
ont permis à ce travail d'aboutir.
LISTE DES ABREVIATIONS
BEAT : Brevet d'Etudes Agricoles
Tropicales
BIT : Bureau International du
Travail
CETA : Collège
d'Enseignement Technique Agricole
CEMA : Collège
d'Enseignement Moderne Agricole
CLA : Classification of Learning
Activities
CPR : Centre de Promotion
Rurale
DEAT : Diplôme d'Etudes
Agricoles Tropicales
ENSFEA : École Nationale
de Formation en Enseignement Agricole
ETFP : Enseignement Technique et
Formation Professionnelle
INSEE : Institut National de la
Statistique et des Études Économiques
IFSE : Ingénierie de la
Formation et Système de l'Emploi
LTA : Lycée Technique
Agricole
PIB : Produit Intérieur
Brut
PND : Plan National de
Développement
SNFAR : Stratégie
National pour la Formation Agricole et Rurale
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
1
LISTE DES ABREVIATIONS
2
SOMMAIRE
3
INTRODUCTION
4
PARTIE 1 : LE CONTEXTE HISTORIQUE ET
PROBLEMATIQUE GENERALES
6
Chapitre 1 : Itinéraire historique
du système éducatif agricole béninois
6
Chapitre 2 : Approche conceptuelle
12
1. Concept de
l'efficacité
12
1.1 L'efficacité interne
13
1.1.1 Programme et Contenu
15
1.1.2 Qualité de l'Enseignement et du Corps
Professoral
15
1.1.3 Intégration de l'Enseignement
Pratique
15
1.1.4 Accès à l'Enseignement
Agricole
16
1.1.5 Adaptation aux besoins locaux
16
1.2 L'efficacité externe
16
1.3 Rentabilité des investissements
d'enseignement Agricole dans le contexte béninois
18
1.3.1 Insertion Professionnelle
18
1.3.2 Marché du Travail :
20
1.3.3 Secteur Informel
21
PARTIE II : PRESENTATION DES
HYPHOTHESES ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
24
Chapitre 1 : les différentes
hypothèses énoncées pouvant permettre de mesurer
l'efficacité du système éducatif béninois
24
1. Présentation du lycée
agricole de Kika
26
2. Evolution de l'effectif
29
PARTIE III : PRESENTATION DES
RESULTATS
31
Chapitre 1 : les résultats
obtenus
31
Chapitre 2 : Discussion et
vérification des hypothèses de recherche sur l'efficacité
du système éducatif béninois.
36
Conclusion
38
RÉFÉRENCES -
BIBLIOGRAPHIQUES
40
Annexe
42
INTRODUCTION
Comme d'autres pays africains, l'économie du
Bénin repose principalement sur l'agriculture. Le secteur agricole
représente 15% des revenus de l'État, 75% des revenus
d'exportation et 32% du PIB. Environ 70 % de la population béninoise
participe à la production agricole, mais malgré un nombre
important de producteurs à l'échelle nationale, la production
agricole contribue faiblement à la recette de l'État. Les
pratiques traditionnelles de la production agricole et le manque de
connaissances quant à l'attente d'une meilleure productivité
contribuent en partie à cette contre-performance.Face à cette
situation, le gouvernement béninois a compris que la contre-performance
observée ne pouvait être dissociée de l'efficacité
de son système d'enseignement agricole, surtout dans le contexte de
recherche pour un développement durable. Les autorités du secteur
agricole béninois ont donc pris la décision de repenser le
concept d'éducation adopté. Ce dernier étant défini
comme un processus de formation et de développement des aptitudes, des
connaissances, de l'esprit et du caractère de l'individu,
L'éducation englobe l'acquisition du savoir, du savoir-faire et du
savoir-être. Pendant la première décennie du XXe
siècle, la formation technique et professionnelle, en particulier dans
le domaine agricole, demeurent un système en attente de réformes.
L'offre de formation ne correspond pas aux besoins du marché du travail
et la formation pratique est insuffisante.
Dès les années 1991, Le système
éducatif du Bénin a connu des transformations importantes. Il est
possible pour toutes personnes dans le pays d'obtenir une formation
professionnelle à la fois efficace et fiable. Selon la revue de l'UNESCO
réalisée en 2013 sur les politiques de formation technique et
professionnelle au Bénin, L'enseignement dispensé dans les
lycées et collèges techniques agricoles apparaît en
déphasage avec les réalités du pays. Il a
été observé un écart entre la population active
dans le domaine agricole et le nombre d'élèves et lycéens
qui sont inscrits dans les établissements agricoles.
Fort de ce constat, Il est impératif de mesurer
l'efficacité du système d'enseignement agricole béninois.
Le choix de notre sujet se justifie en deux étapes.
Dans un premier temps, nous avons constaté que l'offre
de la formation n'est pas en adéquation avec les réalités
du marché du travail. Dans un second temps, on constate que seuls 10%
des diplômés de l'enseignement agricole exercent dans un
métier du secteur agricole. L'objectif de notre étude est de
déterminer à quel point le système d'enseignement agricole
au Bénin est-il efficace du point de vue interne et externe. À
savoir si le Bénin dispose d'un meilleur système éducatif
dans le domaine agricole? À savoir si les élèves issues
des collèges et lycées de formations agricoles du Bénin
accèdent -ils facilement au marché de l'emploi?
Pour parvenir au bout de notre recherche, notre travail sera
subdivisé en trois parties. Dans une première partie nous
aborderons le contexte historique et la problématique de notre sujet.
Après une deuxième partie démontrant notre démarche
méthodologiqueainsi que la population cible et enfin une
troisième partie qui sera consacrée à la
présentation de nos résultats et la vérifications de nos
hypothèses.
PARTIE 1 : LE CONTEXTE
HISTORIQUE ET PROBLEMATIQUE GENERALES
Dans cette première partie, il s'agira de
présenter l'itinéraire historique de système
éducatif agricole béninois, expliquer les facteurs à
prendre en compte pour mesurer l'efficacité d'un système
éducatif.
Chapitre 1 :
Itinéraire historique du système éducatif agricole
béninois
Depuis son indépendance à nos jours, La
formation professionnelle agricole et rural au Bénin a connu deux phases
au plan structurel et administratif. La première phase correspond
à l'époque où le ministère chargé de
l'Agriculture était responsable de la direction de l'enseignement
agricole et des établissements d'enseignement technique agricole.
À partir de 1975, commence la deuxième phase où le
Ministère chargé de l'Éducation est chargé de
superviser les collèges et lycées agricoles. Au moment où
le Ministère de l'Agriculture était chargé de la direction
de l'enseignement agricole, la stratégie de formation professionnelle
agricole développée était en accord avec les objectifs de
la politique agricole nationale. Par ailleurs, il existait une parfaite
synergie entre les flux d'apprenants pour les formations d'entrée, d'une
part, et les besoins réels des professions ouvertes et du marché
du travail, d'autre part.
Cependant, depuis 1975, tous les établissements
d'enseignement technique secondaire et de la formation professionnelle ont
été placés sous la juridiction du ministère
national de l'Éducation, et il n'y a plus de réformes de
l'enseignement agricole directement liées aux politiques agricoles.
Toutes les réformes conçues et mises en oeuvre ont
été intégrées dans le cadre global du sous-ensemble
auquel elles appartiennent désormais, à savoir «
l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle (ETFP) ». Ainsi,
de 1960 à nos jours, le Bénin a connu deux réformes
majeures en matière de formation professionnelle agricole à
savoir : la ruralisation de l'éducation mise en oeuvre dans la
première décennie après l'indépendance et la
Promotion de l'entrepreneuriat agricole.
Ruralisation de l'éducation : Pour
soutenir la politique agricole dans la « lutte contre l'exode
rural », le ministère national de l'Éducation a
créé le Plan de développement économique et social
(PDES) en 1966, qui se concentre sur la ruralisation de l'éducation. Le
programme vise à initier les technologies agricoles à un nombre
suffisant de jeunes écoliers pour faciliter leur intégration
post-études dans le secteur agricole productif. Sa première
partie s'adresse à un public qui entend continuer à apprendre. Il
s'agit d'élèves du primaire et du secondaire de l'enseignement
général. Dans cette optique, plusieurs écoles primaires
ont été sélectionnées à travers le pays. Ces
écoles pilotes sont appelées : « écoles primaires
ruralisées ». Au niveau secondaire également, quatre
collèges d'enseignement agricole moderne (CEMA) ont été
créés à Adjohoun, Come, Kandi et Savalou. Les
étudiants de ces écoles et collèges recevaient des cours
de sciences agricoles en plus de l'enseignement classique et effectuaient des
heures de travaux pratiques dans des domaines gérés par les
établissements d'enseignement. Du matériel technique et des
livres agricoles publiés par le Bureau de recherche technique et de
documentation (BTED), l'organisme directeur, ont été
distribués aux enseignants. Des examens Pratiques Agricole comptaient
à la fois pour l'évaluation continue des connaissances et
à l'examen du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC). Les
étudiants inscrits à ces cours ont la liberté de
poursuivre leurs études classiques au lycée ou à
l'université, selon leur propre choix. Les jeunes agriculteurs et
artisans qui souhaitent devenir des centres d'innovation technologique dans
leur environnement bénéficient d'une formation de courte
durée dans le deuxième pilier du programme de
développement économique et social. Ces écoles partenaires
offrent une formation pratique aux élèves de niveau CM2
après deux années de préparation. Les apprenants
participent activement à la gestion collective des ressources de
formation pour cultiver un esprit coopératif dans le milieu agricole.
L'École normale de Porto Novo et le Centre de formation des
maîtres d'agricoles Ouidah ont été utilisés pour
former les enseignants de ces écoles d'enseignement
général ruralisées et coopératives (écoles
pratiques agricoles). Malheureusement, la réforme éducative, qui
articulait fortement la politique agricole à celle éducative dans
tous ses domaines, n'a duré que six ans. L'initiative s'est
estompée en 1973 par manque de volonté politique devant relayer
les bailleurs de fonds dans la prise en charge du fonctionnement du dispositif
mis en place(SNFAR versionvalidée de Décembre 2014
p.16.)
En 1972, la "révolution"a créé
l'École Nouvelle, qui représente la nouvelle philosophie
éducative. Le programme basé sur la professionnalisation de
l'éducation a continué entre 1974 et 1989 à travers :
· la mise en place d'un dispositif d'orientation
post-primaire vers les métiers en faveur des apprenants
précocement éjectés du circuit scolaire ;
· la généralisation des coopératives
scolaires de production dans tous les établissements publics du pays.
Cette ère a été marquée au niveau
du système éducatif par une seule réforme :
La réforme de 1975 portant sur l'École Nouvelle
et qui préconisait une meilleure professionnalisation de l'enseignement.
Il était même prévu un dispositif d'orientation vers les
métiers à partir de la fin du cours primaire pour
récupérer les « rebuts » du système
éducatif. La Promotion de l'entreprenariat agricole : À travers
la crise économique et financière qu'a connu le Bénin dans
années 80 a contraint le gouvernement, sous l'injonction de la Banque
Mondiale et du Fonds Monétaire International, à signer un
Programme d'Ajustement Structurel. L'une des conséquences de ce
programme a été le gel de recrutement systématique dans la
fonction publique avec le dégraissage du personnel Agent Permanent de
l'Etat (APE). En réponse à cette conjoncture socio-
économique difficile, le gouvernement a procédé à
la révision des programmes de formation dans les collèges et
lycées agricoles. Les nouveaux programmes ainsi mis en place dès
1996 reposaient sur trois piliers fondamentaux que sont la polyvalence, la
technicité et la culture entrepreneuriale. Cette nouvelle orientation de
l'enseignement technique agricole tournée vers la formation à
l'auto-emploi va être confirmée dans le « Document de
réforme et d'orientation de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle » de 2001.
La polyvalence qui consacre l'abandon des
spécialités au profit d'un profil plus généraliste.
Cette décision vient du fait que les exigences de l'auto-emploi vont au-
delà de la maîtrise des compétences pointues pour couvrir
un champ de compétences plus large en raison de la gamme variée
des activités (cultures, élevage, pêche, constructions
rurales, comptabilité, transformation...) et de la mobilité
qu'elles demandent aux promoteurs.
La technicité : l'installation en agriculture exige la
maîtrise d'un ensemble de savoir et de savoir-faire indispensables
à la réussite de l'entreprise. Il a été
prévu également que l'apprenant, à défaut de
s'installer, puisse justifier de ses compétences techniques pour assurer
des prestations de service à des tiers. La culture entrepreneuriale : la
création et la gestion d'une entreprise agricole exigent des aptitudes
cognitives qui vont au-delà des savoirs techniques. Elle doit
également prendre en compte les aspects liés à la
conquête du marché, la gestion des ressources matérielles
et financières, le management ainsi que la capacité de s'adapter
à toutes les situations qu'impose l'évolution de la
profession.
En marge des établissements classiques de formation
agricole, plusieurs centres de formation professionnelle agricole ont vu le
jour. Il s'agit de la création des :
· Centres de Promotion Rurale (CPR) et des Centres
Féminins de Promotion Rurale (CFPR) ;
· Maisons Familiales et Rurales (MAFAR) ;
· Écoles de métiers de l'ONG BORNE fonden.
A ces centres s'ajoutent :
· Le Centre Songhaï mis en place depuis 1985 ; et
Les dispositifs informels de renforcement de capacités
des ressources humaines du secteur agricole toutes catégories
confondues, des initiatives des ONG et des projets et programmes de
développement rural.
Aujourd'hui encore, les orientations en matière de
formation professionnelle agricole mettent l'accent sur l'insertion
professionnelle à réaliser grâce à l'exercice
d'emplois décents et à l'auto-emploi, en développant le
partenariat public et privé (PPP). Pour mettre en oeuvre ces nouvelles
orientations, une des stratégies adoptées est la
spécialisation des métiers agricoles en augmentant les
capacités des offres de formation se traduisant par la création
des nouveaux Lycées agricoles et la généralisation des
centres Songhaï, comme moteur de développement de l'agriculture.
L'objectif majeur poursuivi est d'adapter les produits au marché du
travail. A cet effet, il faut :« La mise en place d'un système de
pilotage de la formation technique et professionnelle (FTP) par la demande,
avec pour corollaire une offre de formation diversifiée, s'inscrivant
dans le cadre des priorités de développement fixées par
l'Etat ».
La mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs et
partenaires de la FTP, en particulier à travers le Conseil National de
la FTP pour impliquer davantage les professionnels dans la conception, la mise
en oeuvre et l'évaluation des formations.
La définition d'un cadre juridique pour
développer le partenariat entre les centres et établissements de
formation et l'entreprise » Si l'augmentation de l'offre de formation
s'inscrit dans la mise en oeuvre d'orientations prises, sa pertinence se heurte
toutefois à différents obstacles qui handicapent à priori
la qualité des produits attendus par rapport aux exigences du
marché du travail :
· L'insuffisance de ressources humaines ;
· L'insuffisance et l'inadaptation des équipements
et matériels techniques (c'est ce qui explique sans doute
l'opération 120 jours pour équiper les Lycées
techniques);
· Peu d'enseignants des Lycées techniques
agricoles sont formés à leur métier, en particulier pour
être des formateurs (et non uniquement des enseignants) dans le cadre de
la mise en oeuvre de l'APC ;
· L'existence de zones agro écologiques bien
définies (avec indication des cultures à privilégier)
n'est pas prise en compte pour spécialiser les formations (en effet,
à l'heure actuelle, les Lycées techniques agricoles utilisent le
même programme de formation) ;
Dans l'enseignement supérieur, si le nombre de
structures spécialisées augmente (universités
thématiques, centres universitaires spécialisés etc.), il
est à noter qu'il se pose à la fois des questions de gestion des
flux, d'équipements et de formation des enseignants.
Revue des politiques de formation technique et professionnelle
au Bénin (2013).
Schéma du dispositif national de Formation
Professionnelle Agricole au Bénin
« Extrait du document intitulé "Les
dispositifs et les systèmes de financement de la formation agricole et
rurale au Bénin - Vol. 1, du réseau FAR »
Chapitre 2 : Approche
conceptuelle
Dans ce chapitre il s'agira de définir les concepts
généraux de notre sujet :
Définir un concept n'est pas une tâche facile, il
n'y a pas de définition exhaustive pour un concept. En fonction du
contexte, de la discipline, du milieu, le concept change. Comme presque toutes
les recherches, nous n'allons pas échapper à ce rituel qui
consiste à définir des concepts. Dans la partie ci- dessous, nous
définissons le concept d'efficacité selon quelques auteurs dans
différentes disciplines.
1. Concept de l'efficacité
L'efficacité est perçue dans les sciences
économiques comme une « construction d'une économie critique
ou alternative » selon Maris (1997). Pour cet auteur, l'efficacité
est un concept indispensable pour une en économie dans la mesure
où elle permet de produire des textes, des conseils, des
théories, des expertises auprès des princes, des personnes
aisées. En un mot, l'efficacité permet de faire des gains, elle
est une stratégie utilisée pour se faire une place dans la
société, pour se faire respecter par l'autre et pour se faire
accepter par ses pairs.
En sciences sociales, plus précisément en
sociologie, l'efficacité est définie comme une « croyance en
ses propres capacités à résoudre des problèmes
spécifiques, à mener à bien une tâche et à
maîtriser son environnement » (Pourtois, 2004, p.5). On pourrait
dire que cette socialisation permet à l'individu de se faire sa place
dans son milieu. L'efficacité est perçue comme un moyen
d'inclusion ou d'exclusion sociale d'un individu dans le sens où si
l'individu n'arrive pas à montrer qu'il est capable de gérer ses
problèmes dans la société, ce dernier risque d'être
exclu par ses pairs car il risque d'être considéré comme un
être faible.
Pour Sall (1997), dans les sciences éducatives,
l'efficacité est définie comme une « l'ordre de la
visée ». Selon cet auteur (Sall, 1997), elle renvoie aux
intentions, objectifs, effets visés, les ressources mobilisées
que l'individu met en place pour atteindre ses objectifs. On pourrait dire
qu'elle amène l'individu à être assez ambitieux car, elle
permet à l'individu de se projeter dans le futur tout en mettant tout en
oeuvre pour y parvenir. C'est dans ce contexte que selon Psacharopoulos et
Woodhall (1988) le concept d'efficacité est utilisé pour
décrire les relations entre les facteurs investis (inputs) et le produit
(output) ».
De ces différentes définitions, nous constatons
que peu importe l'origine disciplinaire, l'efficacité est à la
fois un capital économique, social et politique qui permet à
l'individu d'être ambitieux, de se surpasser pour réaliser
créer son identité sociale, ses rêves par crainte
d'être rejeté par ses pairs.
L'efficacité dans notre recherche consistera à
déterminer si l'ensemble des ressources allouées à
l'enseignement agricole béninois ont un effet positif ou non sur les
résultats escomptés, par conséquent mesurer l'impact de
l'investissement dans l'éducation. Il sera alors question ici
d'évaluer l'ampleur de cet effet. Cependant, l'investissement dans
l'éducation ne peut se faire qu'en prenant en compte l'efficacité
interne et l'efficacité externe.
1.1 L'efficacité
interne
L'efficacité interne de l'éducation concerne la
relation entre résultats pédagogique obtenus et objectifs
pédagogique visés, tant au sein du système dans son
ensemble qu'au sein d'établissements d'enseignement spécifiques.
Pour évaluer l'efficacité interne, il peut être
nécessaire de comprendre le but de la formation, ses objectifs et
l'éventail de mesures qui reflètent ses divers effets ainsi que
le degré de réussite dans l'obtention de ces effets
(apprécier le rapport entre le nombre d'apprenant achevant avec
succès la formation ou produits du système et le nombre
d'inscrits en début de formation). On fait ainsi le choix de
l'estimation de l'efficacité pédagogique mesurée par des
résultats à des tests de connaissances (Eicher, 1983). Le but de
cette étude est d'évaluer comment atteindre le niveau de
résultat souhaité avec le minimum de ressources (étude
coût-efficacité). Deux méthodes sont donc
favorisées.
Dans la première, un test est élaboré
pour évaluer les compétences avant et après l'utilisation
d'un dispositif.
Dans la deuxième partie, on examine les taux de
réussite, d'échec ou d'abandon pour deux dispositifs
différents. Si les taux de réussite sont plus
élevés, l'un des dispositifs sera considéré comme
plus efficace que l'autre. Effectivement, pour évaluer
l'efficacité d'un système d'enseignement spécifique, il
est nécessaire de le comparer à des méthodes
d'enseignement de référence, afin de déterminer lequel
d'entre elles est le plus efficace, notamment en ce qui concerne
l'efficacité pédagogique" et les coûts (Orivel et Orivel,
1999).
En réalité, l'objectif de tout système
éducatif ne se limite pas à l'accès de tous les apprenants
à l'école, mais surtout à ce que tous puissent terminer le
cycle avec les connaissances et les compétences de base
nécessaires. Il est donc essentiel que l'éducation soit
quantitative, bien que cela ne soit pas suffisant. La dimension qualitative
semble également essentielle. Quand on aborde la question de la
qualité de l'école, la méthode la plus courante est de se
concentrer sur les méthodes d'organisation, les programmes, les
méthodes et les ressources utilisées (les infrastructures, la
formation des enseignants, la taille des classes et les méthodes de
groupe d'élèves, la disponibilité de matériel
pédagogique, etc.).
Dans cette perspective, une formation de qualité serait
une formation où les classesd'apprentissage ne seraient pas
surchargées, où chaque classe disposerait de ses enseignants et
où chacun disposerait de ses propres équipements.
Plusieurs facteurs sont à la base de
l'efficacité interne de l'enseignement agricole auBénin et
ceux-ci peuvent varier en fonction de différents critères. Voici
quelquesaspects à considérer pour évaluer
l'efficacité de cet enseignement :
1.1.1 Programme et Contenu
La pertinence des programmes d'enseignement agricole est
cruciale pour répondre aux besoins du secteur agricole en
évolution. Au Bénin, l'actualisation des programmes pour inclure
des compétences pertinentes, telles que l'agroécologie, la
gestion agricole durable et l'entrepreneuriat, est nécessaire pour
préparer les étudiants aux défis actuels et futurs de
l'agriculture.
1.1.2 Qualité
de l'Enseignement et du Corps Professoral
La qualité de l'enseignement et des enseignants est un
facteur déterminant de l'efficacité du système
d'enseignement agricole. Des efforts doivent être déployés
au Bénin pour garantir la formation continue des enseignants, leur
qualification et leur motivation, ainsi que pour encourager l'innovation
pédagogique afin d'optimiser l'apprentissage des étudiants. La
disponibilité de manuels d'élèves et de guides
d'enseignants est un autre facteur important de la politique éducative.
En effet, le rôle positif des outils pédagogiques (manuels
scolaires, guides du maître, etc.) sur la progression des
élèves est couramment admis dans la littérature. Par
exemple, pour améliorer la qualité des apprentissages, certaines
étudesrecommandent fortement la dotation de manuels scolaires pour
chaque matière principale (Lockheed et Verspoor, 1991 ; Verspoor, 2003 ;
Mingat, 2003), et cela, au profit de tous les élèves (Kremer et
al. 2000).
1.1.3 Intégration de
l'Enseignement Pratique
L'intégration de l'enseignement pratique est
essentielle pour renforcer les compétences des apprenants et les
préparer à la réalité du terrain. Au Bénin,
un renforcement des programmes de stage, des fermes écoles et des
projets pratiques en collaboration avec le secteur agricole est
nécessaire pour offrir aux apprenants une expérience
concrète et diversifiée.
1.1.4 Accès à
l'Enseignement Agricole
L'accès à l'enseignement agricole doit
être équitable et accessible à tous les segments de la
population. Au Bénin, des efforts doivent être
déployés pour améliorer l'accessibilité
géographique, financière et sociale de l'enseignement agricole,
notamment en renforçant les infrastructures éducatives dans les
zones rurales et en offrant des bourses aux étudiants
défavorisés.
1.1.5 Adaptation aux besoins
locaux
L'enseignement agricole doit répondre aux besoins
actuels des acteurs, et tout aspect pouvant contribuer à son
développement tout en tenant compte des spécificités
régionales et locales de l'agriculture au Bénin. Il est important
que les étudiants apprennent des compétences et des techniques
qui sont directement applicables dans leurs contextes locaux
1.2 L'efficacité
externe
L'efficacité externe s'intéresse à
l'influence de l'éducation reçue par les individus après
qu'ils soient sortis des écoles et établissements de formation
pour mener à bien leur vie future au sein de la société
(Mingat et Suchaut, 2000). Cette analyse se concentrera sur l'impact de
l'éducation en dehors du secteur éducatif. Notre
évaluation de l'efficacité externe nous permettra de comparer le
coût de l'éducation avec ses avantages sociaux, en observant dans
quelle mesure l'éducation répond aux besoins du marché du
travail, tout en évaluant également la capacité du
système à préparer les étudiants et les
étudiantes rôle futur dans la société. Ceci se
mesure, entre autres, par les perspectives d'emploi et de revenus des
étudiants.
Évaluer l'efficacité externe d'un système
d'enseignement agricole Béninois implique de se poser la question de
savoir si les apprenants qui en sortent sont non seulement
bénéfiques sur le plan social et économique (ou
productives), mais aussi capables de développer leur personnalité
dans les divers aspects (cognitif, émotionnel, relationnel ou
symbolique). Par conséquent, il est essentiel que l'efficacité
externe prenne en considération les objectifs de la
société, les exigences du marché du travail et les
aspirations individuelles. Les objectifs, les besoins et les désirs
peuvent être présents ou à venir. Dans cette perspective,
on pourrait prendre l'exemple de mesurer le nombre d'apprenants qui ne trouvent
pas d'emploi quelque temps après leur sortie de l'école. Il est
également possible d'évaluer le nombre de diplômés
insérés professionnellement dans leur domaine de formation.
Cependant, L'efficacité externe qualitative sera
concentrée sur la qualité des sorties et des entrées. Elle
fera une comparaison entre les compétences acquises pendant la formation
et les compétences nécessaires pour occuper des postes de
production. L'efficacité externe qualitative peut représenter,
par exemple, la corrélation entre les compétences
réellement mises en pratique dans la vie professionnelle ou sociale et
les compétences développées par le système de
formation, ou encore la corrélation entre les compétences
nécessaires et celles acquises pendant la formation.
En général, qu'il s'agisse d'une approche
quantitative ou qualitative, l'efficacité externe pourrait être
associée à la réalité ou à la recherche
d'une plus grande réalité si les responsables de l'école
ont une vision claire, à court et à moyen terme, de la structure
actuelle ou future de l'emploi, des exigences de citoyenneté et des
aspirations des individus. Il est également nécessaire d'avoir
une politique de sélection équilibrée pour la
planification ou la gestion de la formation des ressources humaines
essentielles à l'essor économique, social et culturel, afin
d'assurer un plus grand réalisme. De Ketele (1997) affirme que la
gestion prévisionnelle est solidement fondée.
Selon les attentes suscitées par l'essor récent
de la démocratie dans tous les domaines, la création et la mise
en place d'une politique volontariste de discrimination positive afin de
diminuer l'inéquité d'accès, d'une part, et la mise en
place de procédures de gestion prévisionnelle, d'autre part,
soulèvent de graves problèmesd'équité.À
l'avenir, l'évaluation de l'efficacité externe de l'enseignement
devra prendre en considération la mondialisation de l'économie,
la mobilité et les compétences entrepreneuriales des
étudiants qui ont quitté le système d'enseignement et de
formation. En effet, ils devront générer des emplois et ne plus
dépendre du marché de l'emploi traditionnel.
1.3 Rentabilité des
investissements d'enseignement Agricole dans le contexte béninois
1.3.1 Insertion
Professionnelle
Insertion Professionnelle : Le terme insertion vient du latin
« inserere », qui veut dire « insérer,
introduire, mêler, intercaler ». Dans le Larousse l'insertion est
définie comme le fait de s'insérer, de s'attacher sur, dans
quelque chose. C'est aussi, la manière de s'insérer dans un
groupe, de s'y intégrer. L'insertion professionnelle dans notre contexte
constitue la phase de transition de l'amateurisme des éducateurs
à l'intégration d'une structure professionnelle en disposant du
savoir-faire et du diplôme qui peuvent constituer leur capital humain
vers l'insertion professionnelle. Le capital humain se traduit par les
aptitudes, les capacités d'un individu à suivre une formation et
à obtenir des qualifications élevées. Pour Gary. S Becker
(1964), la décision d'investir dans le capital humain fait l'objet d'un
calcul économique qui permet à l'individu d'évaluer le
rendement marginal associé à une formation. Ce calcul permet de
connaître les coûts directs, coûts indirects, et coûts
d'opportunité engendrés par la formation. Dans le même
temps, ce calcul économique permet de connaître le surcroît
de revenus permis par l'augmentation du niveau de formation. (Marie-Sainte,
2022-2023, p. 35).
Le concept du capital humain, introduit par Gary Becker, est
fondamental pour comprendre la valeur des investissements dans
l'éducation et la formation. Selon Becker, le capital humain
représente les connaissances, les compétences et les
qualifications qu'une personne acquiert tout au long de sa vie grâce
à l'éducation et à la formation. Dans notre contexte des
apprenants de l'enseignement agricole, cet apport du capital humain est d'une
grande pertinence. De plus, les apprenants acquièrent des
compétences spécifiques liées à l'agriculture, tant
théoriques que pratiques. Un enseignement efficace doit donc chercher
à développer de manière holistique le capital humain des
apprenant, pour répondre au besoin du pays en matière
d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de
développement durable.
Bien que cette théorie ait pour avantage de faire
progresser la théorie de l'offre de travail en rapprochant la formation
et l'emploi par une logique de marché, elle présente
néanmoins quelques limites, notamment l'accent mis sur la
productivité individuelle et supposée mesurable. Ceci pose un
problème surtout lorsque l'on sait que le processus de production est de
type collectif dans l'ensemble. D'où la prise en compte des
théories complémentaires et alternatives à la
théorie du capital humain.
Par ailleurs, abordant dans les limites de la théorie
du capital humain, SPENCE (1973) fait l'hypothèse que l'éducation
n'est pas un moyen d'augmenter le capital humain mais un moyen de
sélection. Dans cette perspective, les individus investissent dans
l'éducation pour envoyer des signaux aux employeurs. À l'inverse
de la théorie du capital humain, la théorie du signal, qui pense
que l'éducation n'a pas d'influence sur la productivité du futur
travailleur, elle est seulement utile pour prouver la compétence du
diplômé face à un employeur. Il va loin en expliquant par
exemple qu'un employeur pour choisir le meilleur candidat ou employé,
peut se baser sur des critères tels que l'école
fréquentée par ce dernier, voir aussi la réputation de
cette école par rapport à d'autres écoles.
1.3.2 Marché du Travail
:
D'une manière générale, le marché
du travail est l'intersection théorique entre l'offre de travail (les
individus qui fournissent des emplois) et la demande de travail (les
entreprises et les gouvernements qui ont besoin d'emplois et les fournissent).
Le marché du travail au sens étroit fait référence
au début et à la fin du travail sur une période
donnée. » L'offre de main- d'oeuvre comprend les chômeurs
(ceux qui recherchent du travail) et les salariés. Ils ont des
compétences différentes. La demande de main d'oeuvre provient des
entreprises, des administrations ou des particuliers qui ont besoin de main
d'oeuvre (plus ou moins qualifiée) pour produire des biens et
services.
L'objectif de l'école s'étend au-delà du
secteur de l'éducation, car il vise à permettre aux
étudiants de s'intégrer facilement dans le monde
socioprofessionnel après leurs études. L'efficacité
externe du système éducatif est cruciale, mais son analyse est
souvent négligée dans les évaluations globales en raison
des obstacles à l'information, de la rareté et du manque
d'accès à l'information nécessaire. L'efficacité
externe de l'école peut être évaluée sous deux
angles complémentaires : individuel et collectif. La première
approche examine dans quelle mesure les investissements dans l'éducation
et la formation pendant le jeune âge améliorent la vie
économique et sociale, tandis que la seconde approche examine dans
quelle mesure la répartition de l'éducation et la formation
primaires maximisent les avantages sociaux et économiques que la
société peut tirer de ces investissements. Le chapitre vise
à se concentrer sur la dimension économique des effets de
l'éducation, en mettant l'accent sur la relation entre
l'éducation et le marché du travail.
Au Bénin, les besoins en matière de
création d'emplois à l'horizon 2025 sont importants. Pour
maintenir le taux d'activité de 64 pour cent de la population en
âge de travailler (de 10 ans et plus) enregistré en 2005, et dans
une hypothèse de plein emploi, le Bénin doit créer de 2008
à 2025 près de 3 millions d'emplois supplémentaires, soit
une augmentation de 85 pour cent du nombre d'emplois, ou un taux annuel
d'accroissement des emplois de près de 5 pour cent. Sur la
période 1992-2002, le taux de création d'emplois est en moyenne
de 3,7 pour cent pour une croissance moyenne du PIB de 5 pour cent.
L'élasticité emploi-valeur ajoutée est ainsi de 0,73 entre
1992 et 2002 (rapport de BIT 2005).
1.3.3 Secteur
Informel
Au Bénin, le secteur informel rythme la vie nationale
et constitue le volet de la sécurité et du bien-être de la
population béninoise (JonhIgué, 2019). En effet, les petits
métiers et la réexportation constituent les activités
phares du Bénin avec une offre de près de 80% et une contribution
au PIB de l'ordre de 65% (JonhIgué, 2019).
Comme dans les autres pays à faible revenu de la
région, le contexte du marché de l'emploi au Bénin est
marqué par une dualité forte qui oppose le secteur informel (au
sein duquel il est utile d'établir une distinction entre l'agriculture
et les activités non agricoles) et le secteur formel
caractérisé par le paiement d'impôts et de taxes, ainsi que
par l'enregistrement des travailleurs à un régime de
sécurité sociale. Le tableau ci-dessous présente la
distribution des emplois par grands secteurs institutionnels et sa dynamique
dans le temps
Le concept « secteur Informel » fait l'objet d'un
débat qui transparaît dans les recherches et publications
scientifiques depuis plusieurs années. L'intérêt croissant
porté au thème tient aux transformations observées dans
les villes du tiers-monde du fait de la dégradation des systèmes
économiques depuis le début de la décennie 70 notamment
quand pour la 1ère fois le BIT utilisa ce même concept pour
caractériser la situation de l'emploi urbain au Kenya (P. Martinet
1991). Depuis lors, plusieurs définitions ont été
proposées pour mieux saisir la réalité de ce secteur. Ces
définitions sont à la fois pertinentes et équivoques. De
ces tentatives, deux retiennent notre attention. La première est la
suivante : « le secteur informel est caractérisé par les
activités économiques qui se réalisent en marge de la
législation pénale, sociale, fiscale et échappe à
la comptabilité nationale ». La deuxième définition
est formulée comme suit : « le secteur informel est l'ensemble des
activités qui échappent à la politique économique
et sociale et donc à toute régulation de l'État ».
À ces deux définitions s'ajoutent celle du BIT
qui considérait ce secteur comme relevant de « toute
activité non enregistrée et/ ou dépourvue de
comptabilité formelle, écrite, exercée à titre
d'emploi principal ou secondaire par une personne en tant que patron à
son propre compte. Cette personne active ou occupée est alors
considérée comme chef d'unité de production informelle
».
Le terme d'économie informelle utilisé à
partir de 2002 par le BIT illustre mieux l'informalité en termes
d'unité de production et de caractéristiques de l'emploi ou du
travailleur.
Au Bénin, le secteur informel rythme la vie nationale
et constitue le volet de la sécurité et du bien-être de la
population béninoise (Jonh Igué, 2019). En effet, les petits
métiers et la réexportation constituent les activités
phares du Bénin avec une offre de près de 80% et une contribution
au PIB de l'ordre de 65% (Jonh Igué, 2019).
Comme dans les autres pays à faible revenu de la
région, le contexte du marché de l'emploi au Bénin est
marqué par une dualité forte qui oppose le secteur informel (au
sein duquel il est utile d'établir une distinction entre l'agriculture
et les activités non agricoles) et le secteur formel
caractérisé par le paiement d'impôts et de taxes, ainsi que
par l'enregistrement des travailleurs à un régime de
sécurité sociale. Le tableau ci-dessous présente la
distribution des emplois par grands secteurs institutionnels et sa dynamique
dans le temps
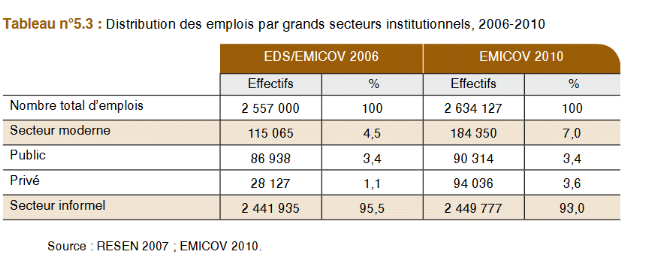
PARTIE II :
PRESENTATION DES HYPHOTHESES ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
L'objectif de notre étude est de mesurer
l'efficacité du système d'enseignement agricole béninois.
Dans cette rubrique, nous allons vous présenter dans un premier temps
nos hypothèses et dans un second notre méthodologie de recherche
et la population cible.
Chapitre 1 : les
différentes hypothèses énoncées pouvant permettre
de mesurer l'efficacité du système éducatif
béninois
Au-delà de toutes les présentations qui ont
été faites, nous pouvons retenir que le terme efficacité
faite référence entre les facteurs investis (inputs) et les
produits (output). Cependant, les conclusions concernant l'efficacité ne
peuvent pas se limiter à une dimension spécifique des relations
car ces relations peuvent être examiner à partir de divers points.
L'efficacité interne et externe doivent être pris en compte
lorsqu'ils s'agit d'investir dans l'éducation.
Hypothèse 1 : La formation est efficace en
termes de rendement interne.
En outre, l'efficacité interne de l'éducation
s'intéresse aux relations entre les inputs scolaires et les
résultats scolaires au sein d'un système éducatif. Toute
mesure visant à établir l'équation entre les
résultats obtenus par les étudiants et les objectifs
pédagogiques (exprimés en termes de savoir, de savoir-faire et de
savoir-être) peut faciliter l'évaluation de l'efficacité
interne.Elle s'attache à mesurer : le nombre de formés achevant
le programme de formation, le nombre de formés obtenant le diplôme
offert par le programme de formation. D'après ce qui
précède, nous pouvons nous demander si le système
d'enseignement agricole béninois est-il efficace en termes de rendement
interne, c'est-à-dire en terme de taux de réussite. .
Hypothèse 2 : la formation est efficace en
termes d'insertion professionnelle.
En outre, l'efficacité interne de l'éducation
s'intéresse aux relations entre les inputs scolaires et les
résultats scolaires au sein d'un système éducatif. Toute
mesure visant à établir l'équation entre les
résultats obtenus par les étudiants et les objectifs
pédagogiques (exprimés en termes de savoir, de savoir-faire et de
savoir-être) peut faciliter l'évaluation de l'efficacité
interne.Elle s'attache à mesurer : le nombre de formés achevant
le programme de formation, le nombre de formés obtenant le diplôme
offert par le programme de formation. D'après ce qui
précède, nous pouvons nous demander si le système
d'enseignement agricole béninois est-il efficace en termes de rendement
interne.
Hypothèse 1 : La formation est efficace en
termes de rendement interne (taux de réussite).
Par ailleurs, apprécier l'efficacité externe
d'un système éducatif revient à se demander si les
individus éduqués sont utiles (ou productifs) socialement et
économiquement. L'efficacité externe peut être
utilisée pour déterminer l'efficacité de
l'éducation par rapport aux objectifs sociaux et aux besoins du
marché du travail. De plus, cela permet "d'apprécier la
capacité du système éducatif à préparer les
élèves et les élèves à leur rôle futur
dans la société". L'idée d'impact poursuivi ou atteint est
évoquée par l'efficacité externe. L'impact, qui est
généralement défini en se basant sur la population
scolaire (LEGENDRE 1993, p. 476), touche à la fois les produits sortant
du système (avec ou sans diplôme) et la société.
En ce sens, nous nous sommes demandé si le
système d'enseignement agricole béninois est-il efficace en
termes d'insertion professionnelle.
Hypothèse 2 : la formation est efficace en
termes d'insertion professionnelle (marchés du travail)
Pour répondre à ces questionnements nous avons
élaboré une méthodologie de recherche qui nous a permis de
récolter les données, les traitées et enfin les analyser
et interpréter.
Chapitre 2 : Méthodologie et population
cible
Pour la vérification de nos hypothèses nous
adopterons une approche mixte (l'enquête quantitative est faite par
échantillonnage à participation volontaire et l'interview
semi-directif est utilité pour la partie qualitative). Laméthode
quantitativea consisté en la mise en place d'un questionnaire
d'enquête pour vérifier l'efficacité du système
d'enseignement agricole au Bénin : cas du LTA-Kika. L'objectif de
notre enquête vise à interroger les lycéens de la promotion
du LTA-Kika ayant débuté leurs formation en 2017 et ayant
été diplômés en 2020. Pour l'élaboration de
notre questionnaire nous nous appuierons sur Google forms. Le questionnaire est
constitué de 13 questions au total.
L'enquête qualitative a donné lieu à des
interviews par téléphones grâce à un guide
d'entretien préalablement établi et soumis aux anciens
lycéens.
Les questions étant assez simples nous avons soumis le
questionnaire via le réseau social WhatsApp et Messenger.
1. Présentation du lycée
agricole de Kika
Le lycée technique agricole de Kika est un lycée
public de formation agricole mixte et à régime internat et
externat. Il est créé en 2010 par arrêté 2010
N° 186 MESFTP/DC/SGM/DET/SA du ministère de l'enseignement
secondaire, de la formation technique et professionnelle et est
érigé sur une superficie de près de 100 ha dans les
terroirs villageois de Kika 1 et 2. Le lycée est situé à
environ à 20 km de Parakou, la troisième ville du Bénin et
à 20 km environ de la frontière Bénin-Nigéria. Le
lycée se trouve dans le terroir villageois de Kika 2, arrondissement de
Kika, Commune de Tchaourou, Département du Borgou. Il offre 06 six
filières de formations en Science Technique Agricole à savoir
:
· La Production Végétale ;
· La Production Animale ;
· La pêche et aquaculture ;
· L'Aménagement et Équipement Rural ;
· La Foresterie ;
· Et la Nutrition et Technologie Alimentaires.
La formation au lycée technique agricole de kika est
d'une durée de quatre années de formations dont deux ans de tronc
commun suivi de deux ans de spécialisation dans l'un des six secteurs de
formation disponible dans l'établissement. La formation au sein du LTA
se termine avec le passage de l'examen d'obtention du Diplôme d'Etude
Agricole et Tropicale (DEAT).
En effet, durant les deux premières années de
formation, l'accent est mis sur tous les secteurs afin de permettre à
l'apprenant d'avoir des prérequis dans chaque secteur, et tout ceci
à travers des cours théoriques et des cours pratiques. Notons que
le lycée étant technique les heures de cours théorique
sont égales aux heures de cours pratique. La troisième
année est une année de spécialisation dans un domaine. Il
faut préciser que les années d'études sont
subdivisées en périodes d'études appelées blocs
pédagogiques, c'est dans ces blocs que sont construites les
compétences principales.
Enfin, un stage pratique est prévu à chaque
année de formation. Pour la première année, le stage dure
un mois et est effectué au sein du LTA Kika. Le but est de faire
connaître aux élèves l'environnement dans lequel ils
évoluent. Des sorties pédagogiques ainsi que des exposés
sont prévus lors de ce stage. Afin de préparer les
élèves aux réalités auxquelles ils seront
confrontés durant les années suivantes, les élèves
sont amenés à s'autogérer durant toute la durée de
ce stage.
Durant la deuxième année, le stage dure
également un mois et a pour but de faire découvrir le monde rural
et administratif aux élèves. Les stages sont par exemple
effectués dans des directions générales ou techniques du
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que
dans celles du Ministère du Cadre de Vie et du Développement
Durable. Ils visent notamment à initier les élèves au
processus d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de campagne
agricole ainsi qu'au fonctionnement des services publics et privés
intervenant dans le secteur agricole.
Le stage de troisième année qui dure
également un mois se déroule dans des entreprises agricoles de
production et vise à permettre à l'élève de
comprendre leur mode de fonctionnement tout en affinant la pratique
professionnelle.
Le stage de 4è année dure 4 mois et vise la
confirmation des pratiques de production et la collecte d'informations entrant
dans le cadre de l'élaboration du mémoire projet de
l'élève finissant.
Le mode d'évaluation en cours de formation en vigueur
au LTA Kika comme dans l'ensemble des établissements d'enseignement
secondaire est le contrôle continu de connaissance. La moyenne des
contrôles continus de connaissance permet d'autoriser le passage en
classe supérieure à tout élève ayant
totalisé au moins 10/20 à la fin de l'année. Le
Diplôme d'Etudes Agricoles Tropicales (DEAT) sanctionne la fin
réussie du cycle de formation au LTA Kika. Il est obtenu à l'issu
d'un examen qui comporte 3 phases à savoir : la phase écrite, la
phase pratique et la soutenance du mémoire projet devant un jury
constitué par la Direction des Examens et Concours du MESFTP.
Globalement sur les trois dernières années, le
Lycée technique agricole de KIKA enregistre une baisse des effectifs de
ses apprenants, 613 en 2020 contre 667 en 2019 et 770 en 2018.
La proportion des élèves filles de
l'établissement, dont l'effectif a aussi baissé sur la
période avec une moyenne par année de 119, varie entre 15% et
19%. En plus des raisons évoquées sur la baisse des effectifs en
général, il faut envisager également le manque de
commodités au niveau de leur dortoir. Mais il est à noter que ces
effectifs peuvent évoluer à la hausse dans les années
à venir avec l'intensité de la campagne de sensibilisation
à la formation technique et professionnelle qui a démarré
avec la mise en oeuvre la Stratégie Nationale de l'EFTP.
2. Evolution de l'effectif
Le graphe ci-dessous fait part de l'évolution de
l'effectif de lycée agricole de Kika sur trois (03) ans notamment
2018/ 2019/ 2020.
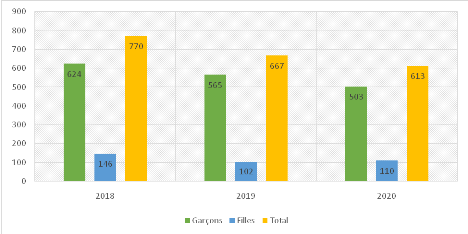
Figure : Evolution des effectifs des apprenants du
lycée de 2018 à 2020
Les effectifs des apprenants au niveau des
spécialités ont connu la même tendance à la baisse.
En première et deuxième année, les apprenants forment un
tronc commun et ce n'est qu'en 3ème et 4ème
année qu'ils sont dans les spécialités. Par ordre
d'importance, les spécialités « Production
animale » et « Production
végétale » sont celles qui concentrent le plus grand
nombre d'apprenants.
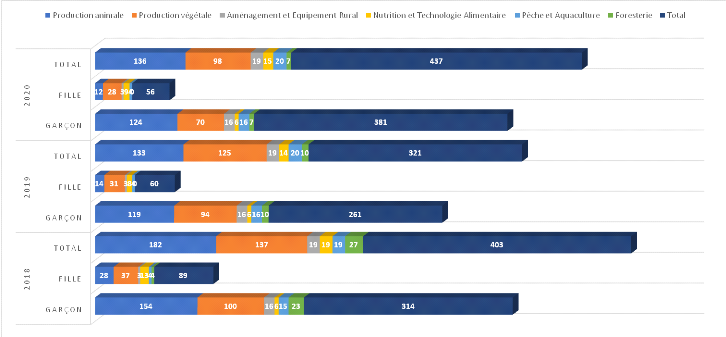
PARTIE III : PRESENTATION
DES RESULTATS
Dans cette partie il est question de présenter les
résultats obtenus à l'issu de l'enquête empirique et la
vérification des hypothèses émises plus haut en discutant
bien sûr ces résultats.
Chapitre 1 : les
résultats obtenus
Suite à notre enquête nous avons pu recueillir
des données qui nous permettent de vérifier nos deux
hypothèses. Pour vérifier nos hypothèses nous allons
prendre en compte les données quantitatives issues de notre
enquête de terrain que nous avions effectué. Pour rappel les
résultats présentés s'appuient sur une enquête
réalisée auprès des lycéens diplômées
de 2020 du LTA Kika. Cette recherche s'inscrivait dans la problématique
de notre mémoire : dans quelle mesure l'enseignement agricole
béninois est-il efficace ?
Nous avons pu collecter 74 réponses sur les 123 qui ont
débuté le lycée technique agricole de Kika en 2017(soit
60,16 %de la population ciblée) dont 30 des répondants de notre
enquête sont des femmes et 44 sont des hommes.
La population enquêtée a une tranche d'âge
variée mais l'âge de la majorité est compris entre 27 et 30
ans.
Les questionnaires de ses enquêtes dérivent des
hypothèses préétablies qui traitent tout d'abord
l'efficacité de la formation à travers son rendement interne, et
ensuite l'efficacité de la formation en termes d'insertion
professionnelle.
Hypothèses 1 : La formation est efficace en
termes de rendement interne
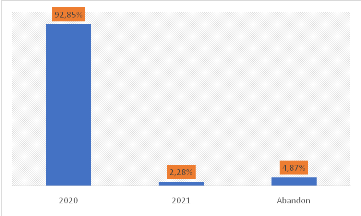
Tableau : Année de fin de
formation
« Source : enquête de
terrain »
La quasi-totalité des lycéens (69 sur 74) qui
ont commencé le LTA Kika en 2017 ont obtenu leur diplôme en l'an
2020. Seulement une personne (01) sur 74 l'a obtenu un an après,
c'est-à-dire en 2021 et quatre (04)ont abandonné le cursus.
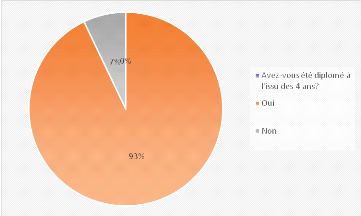
Tableau : Pourcentage des personnes diplômés
« Source : enquête de
terrain »
69 personnes sur 74 des interviewés ont obtenu leur
diplôme à l'issu des quatre années réglementaires de
la formation au LTA-Kika (c'est-à-dire de 2017 à 2020).
Hypothèse 2 : la formation est efficace en
termes d'insertion professionnelle
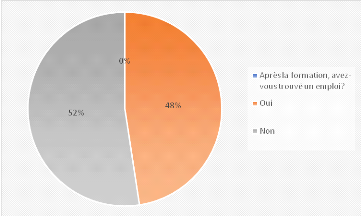
Tableau : Obtenu d'emploi après être
diplômé
« Source : enquête de
terrain »
Près de la moitié des personnes
interviewés(36 sur 74) ont réussi à avoir un emploi
après la fin de leur formation.
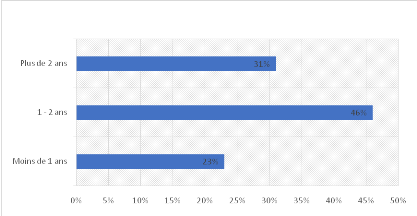
Figure : Après combien de temps avez-vous eu votre
premier emploi?
« Source : enquête de
terrain »
Près du quart des enquêtés (8
diplômés) ont mis moins d'un an avant l'obtention de leur premier
emploi alors que 17diplômésont attenduentre 1 an et 2 ans avant de
l'avoir.
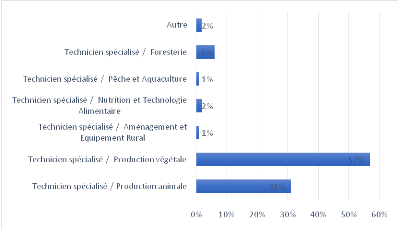
Figure : Emploi actuel
« Source : enquête de
terrain »
Parmi ceux qui ont eu leur emploi,21 diplômés
sont des techniciens spécialisés en production
végétale, 11 en production animale alors que 2
diplômés sur 36 sont des techniciens spécialisés en
foresterie. On y retrouve néanmoins 1 diplômé qui a un
emploi n'ayant pas le lien avec leur formation suivie en LTA-Kika (voir Figure
en bas).
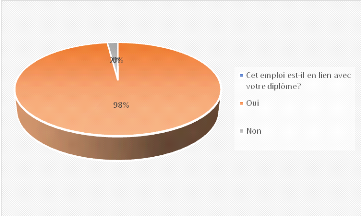
Tableau : Lien entre l'emploi et le diplôme
« Source : enquête de
terrain »
Pour 35 des 36 diplômés qui ont trouvé un
emploi, ce dernier est en lien avec leur diplôme d'après les
résultats de notre enquête.
Chapitre 2 :
Discussion et vérification des hypothèses de recherche sur
l'efficacité du système éducatif béninois.
Cette étude a été mené
auprès de 60,16% (plus précisément 74anciens
lycéens) des lycéens qui ont commencé le LTA-Kika en 2017
en tenant compte d'une répartition équitable selon le genre et
les autres variables socio-démographiques afin d'obtenir la
représentation de notre population. Sur les 74 qui ont acceptés
répondre à notre questionnaire, 69 (soit environ 93%) ont obtenu
leur diplôme à l'issue des quatre années
réglementaires, c'est-à-dire à la fin de l'année
2020 et nous notons 4,87% d'abandon. Etant donné qu'un programme de
formation est généralement considéré comme efficace
s'il permet à un pourcentage élevé de ses participants
d'atteindre les objectifs prévus ou de réussir les
évaluations associées, on conclut que le programme de LTA Kika
est efficace. C'est d'ailleurs ce qu'affirme un ancien élève
à travers l'étude qualitative :
« Les enseignants de LTA-Kika ont une
pédagogie orientée pratique et cela nous permet de confronter la
pratique à la théorie contrairement à l'enseignement
général. Malgré la difficulté connue de ces
formations, on constate que le taux de passe d'année en année
s'améliore au vu de la rigueur qui y va avec »
(Propos recueilli, source : enquête).
Il convient alors de dire que l'hypothèse selon la
formation est efficace en terme rendement interne est
vérifiée.
Par ailleurs, les résultats de l'étude montrent
que près de la moitié des diplômés de LTA-Kika ont
trouvé un emploi à l'issue de la formation. Parmi ces derniers,
8l'ont obtenu en moins d'un an et approximativement la moitié (soit 17
sur les 36 ayant un emploi) ont attendu entre 1 et 2 ans après
l'obtention de leur diplôme. Qui puis est, dans 98% des cas, les emplois
obtenus ont un lien avec le diplôme obtenu. Un ancien
étudiantaffirme que : « La formation reçue
à LTA-Kika m'a permis de trouver un emploi au bout de 5 mois, bien avant
j'ai commencé par gagner de l'argent de côté, ce qui n'est
pas le cas de nombreux de mes frères qui ont fait l'enseignement
général et ont obtenu leur BAC » (Propos
recueilli, source : enquête). Un autre disait
tantôt ; « La formation suivie à LTA-Kika en
technique agricole, axée sur les meilleures pratiques du secteur.
Grâce aux compétences techniques solides et à ma
compréhension approfondie des défis contemporains de
l'agriculture, j'ai été rapidement recruté par une
exploitation agricole de renom. Mon expérience de terrain
combinée à sa formation m'a permis de m'intégrer
rapidement dans mon nouveau rôle et de contribuer de manière
significative à l'optimisation des processus de production et à
la durabilité environnementale de l'entreprise. »
On peut remarquer qu'à travers ces résultats, la
formation en LTA-Kika favorise une insertion professionnelle facile, comme le
soutient Aïfa (2023) dans un contexte similaire (lycée technique
agricole de Bariénou au Bénin).Il va de soi que notre
deuxième hypothèse qui stipule que la formation est efficace en
termes d'insertion professionnelle est
vérifiée.
Conclusion
En somme, cette étude dans quelle mesure l'enseignement
agricole est-il efficace au Bénin nous a permis dans un premier temps
d'avoir une idée sur le système éducatif agricole du
Bénin et dans un second temps connaître son efficacité. Par
conséquent traiter ce sujet est digne d'intérêt.
L'enseignement agricole au Bénin est en constante évolution pour
répondre aux besoins du pays en matière d'agriculture durable, de
sécurité alimentaire et de développement durable. Les
lycées agricoles jouent un rôle essentiel dans la promotion de
l'agriculture durable au Bénin formant de futurs agriculteurs,
techniciens spécialisés et professionnels agricoles. Ils
contribuent également à l'amélioration des connaissances
et compétences dans le secteur agricole, ce qui est crucial pour le
développement économique et social du pays. Au cours de cette
étude nous avons pu nous rendre compte que plusieurs facteurs favorisent
l'insertion professionnelle dans le domaine agricole au Bénin. Il s'agit
notamment de leurs diplômes et expériences professionnelles. La
théorie la plus utilisée est la théorie du signal qui a
été développée par Spencer, qui pense que
l'éducation n'a pas d'influence sur la productivité du futur
travailleur, elle est seulement utile pour prouver la compétence du
diplômé face à un employeur. Il va loin en expliquant par
exemple qu'un employeur pour choisir le meilleur candidat ou employé,
peut se baser sur des critères tels que l'école
fréquentée par ce dernier, voir aussi la réputation de
cette école par rapport à d'autres écoles.
En définitif, le Bénin est doté de
plusieurs écoles et centres de formation professionnelle efficaces
offrant de bonnes formations suscitant un grand intérêt pour les
apprenants (car les données collectées montrent que plus de 93%
des apprenants ayant entamés une formation, réussissent la
formation). Néanmoins, la période post diplôme reste une
grande préoccupation car la plupart des diplômés ont du mal
à trouver un emploi surtout dans leur domaine d'étude.
Le gouvernement béninois doit donc mettre en place des
mesures nécessaires permettant aux apprenants de préparer leur
insertion professionnelle. Il doit mettre également à pied au
niveau de chaque école et centre professionnel des équipes qui
pourront orienter les apprenants vers un domaine non seulement à
très forte demande d'emploi mais également en adéquation
avec les besoins du pays en termes d'employabilité.
RÉFÉRENCES -
BIBLIOGRAPHIQUES
OUVRAGE GÉNÉRAUX:
GARY. S. BECKER, (1964), Human Capital, A Theoretical and
Empirical Analysis, Columbia University Press for the National Bureau of
Economic Research, New York. p 45 et S.
Evaluation de l'e?icacité externe de la formation des
agriculteurs
Présentée par Nelly STEPHAN sous la direction de
M. Alain MINGAT
REVUES ET ARTICLES CONSULTÉS
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2161
https://www.reseau-far.com/revue-des-politiques-de-formation-technique-et-professionnelle-au-benin/
https://journals.openedition.org/ries/9416?lang=fr
(Abdel Rahamane Baba-Moussa p.167-176)
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/vulnerabilites/chapter/eduquer-et-soigner-avec-kant%E2%80%AF-la-route-educative-vers-lhumain/
(Kant (2004 : p 104)
Cours consultés
RACHEL LEVY, (2022 -2023), Cours de Principe
d'économie, M1 IFSE/ ENSFE
MARIE-SAINTE MICHELINE, (2022-2023), Cours d'économie
du travail, Master 1 IFSE/ ENSFEA
MURILLO AUDREY (2022 - 2023), cours d'Introduction au
système de formation, M1 IFSE/ENSFEA
SITOGRAPHIE
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2161
https://www.universalis.fr/encyclopedie/le-capital-humain-une-analyse-theorique-et-empirique/1-une-autre-sorte-de-capital/
https://journals.openedition.org/formationemploi/1495
https://pspdb.dev.gouv.bj/server/storage/app/PolitiqueFichiers/7_Document-SNFAR_MAEP_Dec.2014.pdf
https://www.reseau-far.com/ressources/files/fichierPDF_Atelier_drechange_sur_le_systeme_national_de_FPA_au_Benin.pdf
https://formations.auf.org
https://normandie-univ.hal.science/hal-03318680/file/CARTOGRAPHIE%20REDEVABILITE%20AU%20BENIN.pdf
https://www.fondation-carrefour.net/la-sociologie-de-leducation/
Annexe
Annexe 1 : Questionnaire d'enquête sur
l'efficacité du système d'enseignement agricole au
Bénin
Le questionnaire ci - dessous est élaboré dans
le cadre de mon mémoire d'initiation à la recherche
Économie du travail à l'Ecole Nationale Supérieure de
Formation de l'enseignement agricole (ENSFEA) de Toulouse.
Je travaille sur << L'efficacité du
système d'enseignement agricole au Bénin >> cas des
diplômées du Lycée Technique Agricole de Kika. Les
questions sont pour la plupart fermées et quelques-unes ouvertes. Ce
questionnaire s'adresse aux diplômés du DEAT promotion 2020
déjà inséré dans la vie professionnelle ou en
quête d'emploi. Les réponses recueillies dans cette enquête
seront utilisées dans un cadre purement académique.
Elles ne feront pas l'objet de publication pour d'autres
fins.
Votre Nom et Prénom
Quel est votre âge ?
Votre sexe ?
Année de début de la formation ?
Année de fin de la formation ?
Avez-vous été diplômé ?
Si oui en quelle année
Après la formation avez-vous trouvé un
emploi ?
Si oui quel était-il ?
Était-il en lien avec votre diplôme ?
Quel a été votre parcours professionnel
jusqu'à ce jour ?
Quel est votre emploi actuel ?
Quel est votre lieu (ville) de travail actuel ?
Annexe 2 : Les autres résultats du
questionnaire d'enquête sur l'efficacité du système
d'enseignement agricole au Bénin
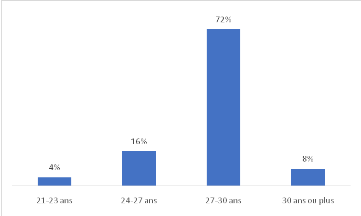
Source : enquête de terrain
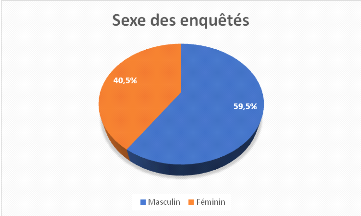
Annexe 3 : Lien Google forms du questionnaire
d'enquête sur l'efficacité du système d'enseignement
agricole au Bénin
Google Forms du questionnaire publié en ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM2Su6EFY-zIp-3QL9ZdB4R5RlIKmsQ5eWxWt2QA-A4tTWtQ/viewform
Annexe 4 : Réseau utilisé
WhatsApp
Mésanger
Annexe 5 : difficultés au cours de la
réalisation du questionnaire :
Nous avons été confrontés à un
certain nombre de difficultés lors de la collecte des
données :
Sachant que les questionnaires ont été
distribués en ligne, il nous a été difficile de rentrer en
contact avec des enquêtés en raison du fait que certains d'entre
eux ne disposent pas de téléphone adéquat à ce type
d'enquêtes.
Nous tenons à notifier que la sensibilisation des
enquêtés n'a pas été chose facile car la
majorité préfère garder l'anonymat (donc ne veut pas
communiquer leur identité à savoir le nom et prénom).
Guide d'entretien
Présentez-vous, s'il vous
plaît ?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Quel est votre dernier diplôme ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En quelle année l'avez-vous obtenu ?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous un emploi ? Si oui, quelle est l'utilité de
la formation dans le cadre de votre emploi actuel ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pensez-vous que vous avez été bien
formé ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
| 


