Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page i
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
SOMMAIRE
SOMMAIRE i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES ABRÉVIATIONS iv
LISTE DES TABLEAUX vi
LISTE DES FIGURES vii
LISTE DES ANNEXES viii
RESUME ix
ABSTRACT x
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE 2
CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE 6
CHAPITRE III : METHODOLOGIE 18
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION 40
CONCLUSION GENERALE 54
SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 55
REFERENCES 59
ANNEXES I
TABLE DES MATIERES XII
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page ii
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
DÉDICACE
Je dédie tout ce travail à mes
précieux parents,
M. et Mme
TAYO
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page iii
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont à l'endroit :
+ Du Père Créateur, pour avoir été
avec nous tout au long de ces années et avoir rendu possible
l'achèvement de ce travail
+ De M. NKOTH Abel Fils, pour ses enseignements et la
supervision de ce travail
+ Du Directeur de l'École des Sciences de la
Santé de l'Université Catholique d'Afrique Centrale (ESS-UCAC),
le Pr NKOUM Benjamin Alexandre pour avoir déployé ses ressources
afin que nous puissions concilier la pratique à la formation
théorique reçue durant ses trois années
+ De tout le personnel administratif et d'appuis de
l'ESS-UCAC, pour n'avoir ménagé aucun effort dans
l'accomplissement de leurs devoirs pour le bien de notre formation
+ De Mme YANKWA Sylvie, Mme DIWANDJA Solange et Mme ATEBA
Pulchérie, nos responsables de classe durant ce cycle de formation, pour
nous avoir accueilli, enseigné, coordonné et pour avoir
contribué à grande échelle à notre
développement professionnel et social
+ De M. ASSOUMOU Parfait et à la
Fédération des Mouvements d'Apostolat de l'ESS-UCAC, pour la
disponibilité et la revitalisation de notre foi catholique
+ De M. EBONDA Normand Davy et Mme SAHA Esther, pour toute la
disponibilité, l'intérêt et le suivi portés à
notre travail
+ De M. TOKAM, chef service du laboratoire du CMC-AGH de
Mimboman et toute son équipe pour les enseignements, le soutien et
l'intérêt portés à ce travail
+ De M. MABOU NOUKI Yvan, pour l'accompagnement durant ces
années, la disponibilité et l'intérêt porté
à ce travail
+ De Nos chères camarades Mlle KOUAKEP NJANPIEP
Horchata Karlyne, Mlle
MAGNE APOGWA Leslie Nayelle, tous nos camarades de promotion
et à toutes nos
connaissances au sein du campus dans son grand ensemble, pour
le soutien débordant + De ma grande famille, pour le soutien, la
protection et les prières
+ De mes précieux parents sans qui tout ceci n'aurait
été possible, mes frères, et soeurs pour l'amour sans
limite et les encouragements débordants
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
LISTE DES ABRÉVIATIONS
ADH : Arginine dihydrolase
AMY : Amygdaline
|
API 20E
|
:
|
Appareillage et Procédure d'identification 20
éléments
|
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page iv
BEA : Bile Esculine Agar
EMB : Eosin Methyline Blue
ESS
: École des Sciences de la Santé
|
CETIC CIT
|
: Collège d'Enseignement Technique et Commercial
: Citrate
|
GEL
GLU
H2S
CMC-AGH : Centre Medico-Chirurgical African Genesic
Health
: Gélatinase
: Glucose
INO LDC
IND : Indole
: Inositol
:
Lysine décarboxylase
MAN : Manitol
MEL : Mélibiose
NPP : Nombre le Plus Probable
ODC : Ornithine décarboxylase
ONPG : Ortho-nitro-phényl-galacto-sidase
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
OMS
ONU
RHA
: Organisation Mondiale de la Santé
: Organisation des Nations Unies
: Rhamnose
: Tryptophane désaminase
: Sorbitol
: Université Catholique d'Afrique Centrale
TDA SOR UCAC UFC
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page v
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VP : Voges Proskauer
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page vi
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Maladies hydriques causées par des
pathogènes bactériens 9
Tableau 2 : Limites de qualité pour les paramètres
bactériologiques des eaux 11
Tableau 3 : Références de qualité pour les
paramètres bactériologiques des eaux 11
Tableau 4 : Présentation du matériel, consommables,
réactifs et équipements pour l'analyse 23
Tableau 5 : Répartition de la population suivant la
situation socio-professionnelle 40
Tableau 6 : Répartition de la population suivant le sexe
et l'âge 40
Tableau 7 : Sources d'approvisionnement en eau utilisées
par la communauté de Ngoa-Ékélé
41
Tableau 8 : Distribution de sources de pollution selon le point
d'approvisionnement 42
Tableau 9 ; Méthodes de traitement des eaux
employées par les populations à domicile 44
Tableau 10 ; Fréquence de traitement des eaux par les
habitants 45
Tableau 11 ; Méthodes de traitement employées au
niveau des points d'eau 45
Tableau 12 ; Germes isolés par source et selon que l'eau
soit traité ou pas 46
Tableau 13 : Récapitulatif des germes retrouvés
dans les points d'échantillonnage des eaux 46 Tableau 14 :
Récapitulatif du dénombrement bactérien des eaux de la
localité de Ngoa-ékélé
47
Tableau 15 : Récapitulatif des problèmes
répertoriés concernant les eaux Ngoa-ékélé
et
suggestions proposées 55
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page vii
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Source du CETIC de Ngoa-ékélé
21
Figure 2 : Puits 1 21
Figure 3 : Puits 2 22
Figure 4 : Puits 3 22
Figure 5 : Puits 4 22
Figure 6 : Puits 5 22
Figure 7 : Algorithme de recherche des coliformes 27
Figure 8 : Algorithme de recherche des entérocoques
27
Figure 9 : Algorithme de recherche des salmonelles 28
Figure 10 : Dispositif de filtration de l'eau dans
l'environnement d'analyse 29
Figure 11 : Aspect des colonies sur EMB 30
Figure 12 : Aspect des colonies sur BEA 30
Figure 13 : Aspect des eaux peptonnées après
incubation à 37°C pour 24h 30
Figure 14 : Image lames porte-Objet après coloration de
GRAM 31
Figure 15 : Résultat catalase positif et oxydase
négatif 32
Figure 16 : Test oxydase négatif 32
Figure 17 : Image de d'une micro gallérie API 20E
après ensemencement 33
Figure 18 : Aspect de quelques milieux Sélénite
après incubation durant 24h à 37°C 34
Figure 19 : Aspect d'une micro gallérie API 20E
après incubation durant 24h à 37°C 34
Figure 20 : Résultat d'identification des
entérobactéries avec le logiciel APIDENT 34
Figure 21 : Milieu kliger avant incubation 35
Figure 22 : Colonies sur gélose Hektoen 35
Figure 23 : Images après incubation des milieux Kliger
à 37°C durant 24h 36
Figure 24 : Proportion des facteurs de pollution dans la
localité de Ngoa-ékélé 43
Figure 25 : Proportion des habitants qui traitent l'eau de
manière individuelle 44
Figure 26 : Principales maladies dont sont victimes les
consommateurs 49
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page viii
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Clairance étique I
Annexe 2 : Autorisation de recherche du sous-préfet de
Yaoundé 3 II
Annexe 3 : Notice d'information III
Annexe 4 : Formulaire de consentement éclairé
V
Annexe 5 : Questionnaire VI
Annexe 6 : Généralités sur les milieux de
culture utilisés VIII
Annexe 7 : Principe coloration de gram X
Annexe 8 : Informations sur la galerie api 20e XI
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page ix
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
RESUME
L'eau représente l'élément constitutif
majoritaire du corps d'un être vivant. Elle est estimée à
60% dans la composition de ce dernier avec une consommation minimale de
1,5L/Jr. Pour cela, Il incombe qu'elle soit de bonne qualité sanitaire
pour ainsi évoquer sa potabilité, ceci dans l'optique
d'éviter que les populations soient sujets à diverses maladies
d'origine hydrique. Des études ont permis d'établir que la
pollution hydrique était la cause d'une mortalité qui
s'élève d'années en années chez les populations des
pays en voie de développement. À ce propos, il a
été important pour nous, de savoir quel est le réel profil
bactériologique des eaux consommées dans de telles zones. C'est
ainsi que notre recherche a porté sur " L'évaluation
bactériologique des eaux de consommation des populations de
Ngoa-Ekélé à Yaoundé ". Il s'agit d'une
étude descriptive type transversale qui a été basée
sur des collectes d'eau de consommation dans cette localité au niveau de
deux sources et cinq puits, associée à la détermination du
profil bactériologique de ces eaux. Cette détermination s'est
faite par une méthode de dénombrement directe, la filtration sur
membrane et l'identification grâce à l'usage de milieux
spéciaux et des galeries miniaturisées API 20E
couplé à l'usage du logiciel APIDENT version 2.0 pour la
nomenclature des espèces. Les facteurs de pollution et les pathologies
associées à ces eaux ont été recensés par
usage d'un questionnaire soumis à 53 participants. Les données
ont été recueillies par le logiciel CSPro et traitées par
les logiciels Excel et SPSS. Les résultats obtenus ont
révélé que sur les sept points d'eau
étudiés, les sources regorgent de Klebsiella oxytoca et
entérocoques, les puits regorgent de Klebsiella gr. 47,
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes et
entérocoques. Ce qui traduit à 67% la répartition du genre
Klebsiella et à 33% la répartition du genre
Enterobacter dans les eaux de la localité s'agissant des
coliformes. La présence des entérocoques équivaut à
100% car retrouvés dans tous les échantillons testés. Des
facteurs majeurs justifiant l'existence de ces germes dans les eaux ont pu
être associés, notamment les latrines, les rigoles puis les
dépotoirs retrouvés à proximité des points d'eau.
L'étude a pu associer le non traitement des eaux par les populations
à ces facteurs environnementaux. Les maladies hydriques affectant les
consommateurs et pouvant être associées au profil bactérien
existant ont été recensées révélant la
parution au sein de la population étudiée de la fièvre
typhoïde et paratyphoïde à 48,39%, les gastro-entérites
et la dysenterie à 22,58%, puis les infections de la peau à
6,45%. En somme, les eaux de la localité de
Ngoa-ékéléé s'avèrent impropres à la
consommation.
Mots clés: eau, évaluation, potabilité,
pollution, profil bactériologique, Yaoundé
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page x
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
ABSTRACT
Water represents the major constituent element of the body of
a living being. It is estimated at 60% in the composition of the latter with a
minimum consumption of 1.5L / Jr. For this, it is incumbent that it is of good
sanitary quality to thus evoke its potability, this in order to avoid that the
populations are subject to various water-borne diseases. Studies have
established that water pollution is the cause of mortality which rises from
year to year among populations in developing countries. In this regard, it was
important for us to know the real bacteriological profile of the water consumed
in these countries. This is how our research focused on "The bacteriological
evaluation of drinking water from the populations of Ngoa-Ekélé
in Yaoundé". This is a descriptive cross-sectional study which was based
on collections of drinking water in this locality at two sources and five
wells, associated with the determination of the bacteriological profile of
these waters. This determination was made by a direct enumeration method,
membrane filtration and identification thanks to the use of special media and
API 20E miniaturized galleries coupled with the use of the APIDENT version 2.0
software for the nomenclature of species. The pollution factors and pathologies
associated with these waters were identified using a questionnaire submitted to
53 participants. The data were collected by CSPro software and processed by
Excel and SPSS software. The results obtained revealed that at the seven water
points studied, the springs were full of Klebsiella oxytoca and enterococci,
the wells were full of Klebsiella gr. 47, Klebsilla pneumoniae, Enterobacter
aerogenes and enterococci. This translates to 67% the distribution of the genus
Klebsiella and to 33% the distribution of the genus Enterobacter in the waters
of the locality speaking of coliforms. The distribution of enterococci is
equivalent to 100% because they are found in each sample tested. The major
factors justifying the existence of these germs in the water turned out to be:
the latrines, the ditches and then the dumps found near the water points. The
study was able to link the non-treatment of water by the populations to these
environmental factors. Water-borne diseases affecting consumers and which may
be associated with the existing bacterial profile have been identified,
revealing the appearance in the population studied of typhoid and paratyphoid
fever at 48.39%, gastroenteritis and dysentery at 22.58%. , followed by 6.45%
skin infections. In short, the waters of the locality of
Ngoa-ékéléé are found to be unfit for
consumption.
Keywords: water, evaluation, drinkability, pollution,
bacteriological profile, Yaoundé
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 1
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
INTRODUCTION
Dans le monde entier et pour chaque individu, l'eau occupe une
place de choix, car non seulement rentre dans la constitution du corps humain
mais aussi dans l'assouvissement des besoins élémentaires (usage
domestique, usage corporel, usage dans les industries agro-alimentaires) pour
ne citer que ceux-là. « L'eau est un droit fondamental. Sans eau,
il est impossible de survivre » affirme Henrietta Fore, la directrice
générale du Fond des nations unies pour l'enfance (UNICEF). En
2010, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a reconnu que « le droit
à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'Homme,
essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de
tous les droits de l'Homme ». Le droit de l'Homme à l'eau signifie
que chacun, sans discrimination, « a droit à un approvisionnement
suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une
eau potable et de qualité acceptable par les usagers personnels et
domestiques, qu'il s'agisse de boisson, d'assainissement individuel, de lavage
de linge, de préparation des aliments ou d'hygiène personnelle et
domestique », rapporte l'ONU sur son site internet. Cependant, les
ressources en eaux dans les pays en voie de développement
s'avèrent rares et de qualité sanitaire douteuse. Face à
cette situation, notre intérêt s'est porté sur une
évaluation bactériologique de ces eaux de consommation au
Cameroun et principalement ville de Yaoundé, localité de
Ngoa-ékélé. Notant l'existence d'une pléthore de
bactéries pouvant se retrouver dans les eaux, à l'instant des
entérobactéries, coliformes et entérocoques pour ne citer
que ceux-là, nous avons ainsi envisagé de ressortir les
différents facteurs favorisant la présence de bactéries,
d'identifier les bactéries présentes dans les eaux de
consommation de cette localité et de déterminer les pathologies
causées par les bactéries présentes dans ces eaux sur la
population. Dans la suite des écrits, nous vous présenterons tout
d'abord la problématique qui se dégage de cette étude,
ensuite une revue de la littérature en rapport à notre
thématique, puis la méthodologie employée pour parvenir
à nos objectifs et les résultats obtenus accompagnés de
discussion.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 2
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE
1. CONTEXTE DE L'ETUDE
Cette étude a étét faite dans le cadre
d'un travail d'initiation à la recherche en vue de l'obtention du
diplôme de Technicien Médico-Sanitaire, option Analyses
Médicales.
2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU THEME
L'accès à une eau de boisson saine est une
condition indispensable à la santé, un droit de l'homme essentiel
et une composante clé des politiques efficaces de protection sanitaire.
L'importance de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour la
santé et le développement transparaît dans les conclusions
d'une série de forums politiques internationaux. Parmi les plus
récents, figure notamment l'adoption des Objectifs de
développement durable par les pays en 2015 incluant une cible et des
indicateurs pour la sécurité sanitaire de l'eau de boisson. En
outre, l'Assemblée générale des Nations Unies a
déclaré en 2010 qu'une eau de boisson sûre et saine et
l'assainissement étaient un droit de l'homme essentiel à la
pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de
l'homme. Ces engagements sont conformes à un soutien de longue date,
notamment l'adoption par l'Assemblée générale des Nations
Unies des Objectifs du Millénaire pour le développement en 2000
et la proclamation de la période 2005 - 2015 Décennie
internationale d'action sur le thème « L'eau source de vie ».
L'accès à une eau de boisson saine influe également de
manière importante sur la santé et le développement aux
niveaux national, régional et local. Pour certaines régions, il a
été démontré qu'investir dans l'approvisionnement
en eau et l'assainissement pouvait déboucher sur un
bénéfice économique net, dans les cas où la
réduction des effets sanitaires préjudiciables et des coûts
des soins de santé fait plus que compenser ces dépenses. Cette
constatation s'applique aux infrastructures d'approvisionnement en eau de
grande ampleur comme au traitement de l'eau à domicile.
L'expérience a également montré que les interventions
visant à améliorer l'accès à une eau saine,
qu'elles soient dans le cadre des zones rurales ou urbaines,
bénéficient particulièrement aux plus démunis et
peuvent constituer une composante efficace des stratégies de
réduction de la pauvreté. (OMS | Directives de qualité
pour l'eau de boisson: Quatrième édition intégrant le
premier additif, s. d.)
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 3
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
C'est de tout ce qui précède, que s'enracine
« L'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Eélé », thème et raison
d'être de notre étude.
3. PROBLEMATIQUE PROPREMENT DITE
L'accès à l'eau a toujours été une
préoccupation majeure pour l'Homme. Aujourd'hui, la principale
difficulté n'est pas l'accès à l'eau mais plus
précisément l'accès à l'eau potable. En effet, ceci
s'explique compte tenu du fait que l'eau peut être le véhicule
d'un très grand nombre d'agents pathogènes rejetés dans le
milieu extérieur par les matières fécales humaines ou
animales.
L'eau est au coeur du développement durable et est
essentielle au développement socio-économique, à la
production d'énergie et des aliments, à la santé des
écosystèmes et à la survie de l'humanité. Alors que
la population mondiale augmente, il est essentiel qu'un équilibre soit
établi afin que les communautés aient suffisamment d'eau pour
leurs besoins. Au niveau humain, la question de l'eau ne peut pas être
considérée indépendamment de celle de l'assainissement.
Elles sont essentielles pour réduire le fardeau au niveau mondial des
maladies liées au manque d'eau potable et améliorer la
santé, l'éducation et la productivité économique
des populations rapporte (ONU, 2018). Malheureusement cette eau est d'autant
plus précieuse à la vie humaine qu'elle est le véhicule et
voie de dissémination de nombreux microorganismes (bactéries,
virus, parasites) qui induisent des maladies au sein des populations. Nous
savons que ces affections à l'instar des gastroentérites,
choléra, dysenterie, fièvre typhoïde (...) liées
à l'eau causent des maladies et des décès partout dans le
monde, surtout dans les pays en voie de développement. L'OMS
déclare que dans les pays en voie de développement, 4/5 de toutes
les maladies sont causées par l'eau. Ceci est la cause de 3,4 millions
de décès chaque année notamment des enfants.
Au Cameroun, les pouvoirs publics multiplient les efforts pour
améliorer l'accès à eau potable. Malgré cela, le
taux d'accès à l'eau potable atteint à peine 33% selon une
étude et l'approvisionnement en eaux de consommation se présente
sous différentes formes (sources, forages, pompes, rivières et
puits) pour la grande majorité et varie en fonction de
différentes zones d'habitation. En 2015, le gouvernement camerounais a
signé avec la société générale de France et
la société import-export des États-Unis, deux conventions
de financement d'un montant total de 36,110 millions de francs CFA
dédiés au projet d'alimentation en eau potable
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 4
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
de la ville de Yaoundé et ses environs. Ce projet
devait accroitre la production en eau à Yaoundé de 300.000
mètres cube par jour.
Dans la localité de Ngoa-Ekélé, la
population étant dense et les ressources en eau ne couvrant pas les
besoins avec une nature en terme de qualité inconnue, il est primordial
d'étudier ou évaluer le degré de potabilité des
points d'approvisionnement en eau existants afin de pouvoir contribuer à
améliorer les conditions de vie des populations c'est-à-dire,
contribuer à réduire dans la mesure d'une pollution
bactérienne existante, les problèmes de santé que
rencontreraient les habitants et consommateurs d'eau de la localité
ainsi que le taux de mortalité qu'occasionne les maladies causées
par l'eau polluée.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 5
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
4. QUESTIONS, HYPOTHESE ET OBJECTIFS DE
RECHERCHE
a) QUESTIONS DE RECHERCHE Question
générale
· Quel est l'impact de la consommation des eaux de la
localité de Ngoa-Ekélé sur la population ?
Questions spécifiques
· Quels facteurs pourraient justifier la présence
de bactéries dans les eaux de cette localité ?
· Quelles sont les bactéries présentes
dans les eaux de cette localité?
· Quelles sont les pathologies causées par ces
eaux sur la population ?
b) HYPOTHESE DE RECHERCHE
Elle stipule que les eaux de consommation de la
localité de Ngoa-Ekélé regorgeraient de microorganismes
pathogènes de type bactérien et que la présence de ces
pathogènes dans ces eaux découlerait ou serait conséquente
de certains facteurs de pollution, en amont.
c) OBJECTIFS DE RECHERCHE Objectif
général
· Contribuer à la réduction des maladies
et décès d'origine hydrique dans la population camerounaise, en
précis dans celle de la localité de
Ngoa-ékélé à Yaoundé
Objectifs spécifiques
· Recenser les différents facteurs favorisant la
présence des bactéries dans les eaux de la localité
· Identifier les bactéries présentes dans
les eaux de consommation de la localité de Ngoa-Ekélé /
Établir le profil bactériologique des eaux de la
localité
· Déterminer les pathologies causées par
les bactéries présentes dans ces eaux sur la population
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 6
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE
I. DEFINITIONS DES CONCEPTS
Eau de consommation : est un terme
réglementaire qui couvre les eaux de distribution publique
destinée à des diverses utilisations.
Eau potable : est une eau que l'Homme peut
boire sans risque de tomber malade car possède des
caractéristiques microbiologiques, chimiques et physiques
répondant aux directives de l'OMS ou aux normes nationales relatives
à la qualité de l'eau de boisson.
Évaluation : est une fonction qui
consiste à présenter le contenu d'un élément en
précis en comparaison à une base légale spécifique
pour la mesure de la performance des résultats.
Limites de qualité : valeurs de
numération obligatoires à respecter scrupuleusement
Pollution : est une dégradation de
l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de
matière accidentelle ou non, d'éléments n'étant pas
présent naturellement dans le milieu, entrainant ainsi une perturbation
de l'écosystème pouvant nuire aux entités présentes
aux alentours.
Profil bactériologique : c'est une
représentation des micro-organismes de types bactériens pouvant
être présents dans un milieu de manière naturelle ou
non.
Références de qualité :
valeurs indicatives à satisfaire, établies à des
fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et
d'évaluation des risques pour la santé des personnes, elles
constituent en fait un premier niveau d'alerte.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 7
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
II. GÉNÉRALITES SUR L'EAU
1. LE CYCLE DE L'EAU
Le cycle hydrologique externe perpétuel de l'eau douce
fonctionne par évaporation, condensation et précipitation, son
moteur thermique est le rayonnement solaire. Ce cycle alimente les continents
et y maintient la vie et tous les écosystèmes que nous
connaissons. L'eau s'évapore constamment au-dessus des océans,
des lacs et des forêts, elle est condensée sous forme de nuages et
ensuite transportée dans le ciel par les vents. Dans le ciel, les nuages
se condensent sous forme de vapeur d'eau autour des particules de
poussières, puis tombent en précipitations sous forme de pluie ou
de neige, sous l'action de phénomènes
météorologiques complexes. L'eau qui ruisselle
pénètre dans le sol ou elle s'infiltre et va remplir les nappes
souterraines. Elle traverse des couches de plus en plus profondes du sol et va
abandonner dans son cheminement la quasi-totalité des impuretés
dont elle s'était chargée. Les eaux souterraines circulent elles
aussi, une partie se jetant directement dans la mer et le reste venant
alimenter les rivières. Enfin, l'eau peut revenir directement à
sa phase liquide dans l'atmosphère par la transpiration des
végétaux qui éliminent ainsi une partie de l'eau contenue
dans le sol et conservent une partie de l'eau de pluie dans leur
feuillage.(Attig & Bernou, 2020)
2. LES TYPES D'EAU
L'eau recouvre à peu près les trois quarts de la
surface terrestre. Elle existe dans l'atmosphère et sous la terre. Elle
est principalement dans les océans mais on la retrouve aussi dans les
rivières, les lacs, la neige et les glaciers. Par ailleurs, nous
retrouvons au-delà de 99 % de l'eau potable dans les glaciers, les
champs de glace ou sous terre.
Cette section distique entre les différents types d'eau
qui constituent l'approvisionnement mondial et canadien; là où il
se trouve et combien nous en avons. Parmi ceux-ci :
? L'eau de surface : sur terre, dans les cours d'eau, les lacs ou
les terres humides, ? Les eaux souterraines : omniprésentes dans le
sous-sol dans les interstices des particules de roches et de sol, ou dans les
crevasses et fissures des roches,
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 8
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
? L'eau atmosphérique : présente dans
l'atmosphère soit en tant que solide (neige, glace), liquide (pluie) ou
gaz (brouillard, brume)
(Canada, 2007)
3. POLLUTION DE L'EAU
Diverses formes de pollution affectent les ressources en eau,
entre autres :
La pollution « thermique »,
conséquence du déversement dans le milieu aquatique de
quantités considérables d'eau utilisées pour le
refroidissement des centrales thermiques ou nucléaires, peut faciliter
le développement d'amibes libres, pathogènes pour les baigneurs,
surtout en période de faibles débits (étiage), en plus de
modifier l'équilibre biologique des eaux au regard des espèces
piscicoles.
La pollution radioactive est celle qui
inquiète le plus la population, or elle est, et de très loin, la
plus faible. Cette inquiétude est liée en particulier à
une méconnaissance des différents types de rayonnements et de
leur dangerosité.
La pollution chimique est probablement la
plus fréquente, très largement répandue et très
diverse. Il s'agit d'abord de contaminations par des composés
inorganiques, par exemple : sodium, nitrates, phosphates, métaux
lourds (plomb, mercure, cadmium)...
La pollution microbiologique est très
importante. Son origine est avant tout d'origine fécale, due aux
déjections humaines et animales, au travers des eaux usées plus
ou moins bien maîtrisées. Les microorganismes de pollution
fécale des eaux sont des bactéries susceptibles de provoquer des
troubles gastro-intestinaux (salmonelles, shigelles, E. coli, vibrion
cholérique...), des virus (entéro-virus de type poliovirus,
coxackie et echovirus, virus de l'hépatite A, corona et rota-virus,
virus de Norwalk et assimilés...) responsables, selon les cas, de
gastro-entérites, hépatites ou syndromes
neuro-méningés.
(Hartemann, 2013)
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 9
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
4. MALADIES ASSOCIÉES À LA CONSOMMATION
D'UNE EAU NON POTABLE DU POINT DE VUE BACTERIOLOGIQUE
Parmi les maladies d'origine hydrique associées
à des pathogènes de type bactérien, les maladies suivantes
ont été consignées dans ce tableau :
Tableau 1: Maladies hydriques causées par des
pathogènes bactériens
|
Micro-organismes
|
Affections
|
|
Aeromonas spp
|
Gastro-entérites, Syndromes cholériques
|
|
Campylobacter jejuni/C. coli
|
Gastro-entérites
|
|
Clostridium perfringens
|
Indicateur de contamination fécale peu
spécifique de gastro-entérites
|
|
Escherichia coli, entéropathogènes,
entérotoxiques, entéroinvasifs
|
Gastro-entérites et syndromes cholériformes,
Indicateur de contamination fécale
|
|
Enterococcus spp
|
Aucune en relation avec l'eau. Indicateur de contamination
fécale
|
|
Légionella pneumophila
|
Pneumopathie, fièvre (in-halation d'aérosols)
|
|
Leptospira spp
|
Leptospirose ictérohémorragique
|
|
Pseudomonas aeruginosa
|
Infections cutanées , suppuratives ou
éruptives, surinfections, pneumopathies
|
|
Salmonella
|
Fièvres typhoïdes typhiques et para-
typhiques
|
|
Salmonella typhimurium, S. enteritidis
|
Gastro-entérites, infections systémiques
|
|
Shigella dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S.
sonnei
|
Gastro-entérites et dysenterie
|
|
Vbrio cholerae, Vibrio spp
|
Gastro-entérites et cholera , infections
cutanées
|
|
Yersinia enterolitica
|
Gastro-entérites
|
|
Staphylococcus aureus
|
Infections cutanées suppuratives, indicateur de
contamination de proximité
|
(L'analyse de l'eau - 10e éd. - Jean Rodier,Bernard
Legube,Nicole Merlet, s. d.)
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 10
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
5. PROCEDES DE TRAITEMENT DES EAUX
Le traitement des eaux a pour but de détruire tous les
organismes nocifs qui sont présents dans l'eau pour la rendre propre
à la consommation. On note entre autre les procédés
suivant :
Aération : La méthode de
l'aération, en mettant l'eau en contact étroit avec l'air,
augmente la teneur en oxygène de l'eau. Cela permet d'éliminer
les substances volatiles, telles que l'acide sulfurique et le méthane,
qui ont un effet sur le goût et l'odeur, de réduire la teneur de
l'eau en dioxyde de carbone, et d'oxyder les minéraux dissous dans
l'eau, tels que le fer et le manganèse, de façon à ce
qu'ils puissent être éliminés par sédimentation et
filtration.
Filtration : Un filtre permet de
décontaminer l'eau en bloquant physiquement les particules et en les
séparant de l'eau qui le traverse. Les filtres à membrane
fonctionnent avec des mécanismes de décontamination semblables
à ceux des autres filtres. Ils peuvent être très
performants en bloquant des organismes encore plus petits tels que les virus.
Les filtres à usage domestique peuvent être confectionnés
dans des récipients en argile, métal ou plastique. Concernant les
filtres en céramique, l'eau passe lentement à travers un filtre
en céramique ou un filtre à bougie. Durant ce processus, les
particules en suspension sont séparées de l'eau de façon
mécanique.
Ébullition : L'ébullition est
une méthode très efficace de désinfection de l'eau, mais
cette méthode nécessite beaucoup d'énergie. L'eau doit
être portée à ébullition à gros bouillons. En
plus du coût important de la source d'énergie nécessaire
pour faire bouillir l'eau, cette méthode de désinfection a le
défaut de changer le goût de l'eau. Ceci peut être
amélioré en aérant l'eau, en la secouant vigoureusement
dans un bidon fermé après refroidissement.
Désinfection chimique : De nombreux
produits chimiques peuvent désinfecter l'eau mais le produit le plus
souvent utilisé est le chlore. Avec un dosage approprié, le
chlore élimine la plupart des virus et bactéries, mais certaines
espèces de protozoaires (notamment le cryptosporidium) sont
résistantes au chlore. Il existe plusieurs sortes de chlore pour une
utilisation à domicile ; sous forme liquide, en poudre ou en
pastilles.
Désinfection solaire (procédé
SODIS) : Les rayons ultraviolets du soleil ont la capacité de
détruire les pathogènes présents dans l'eau. Pour cela, il
faut remplir des
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
récipients en plastique transparent de un ou deux
litres avec de l'eau claire et les exposer à la lumière directe
du soleil. La période de temps nécessaire pour détruire
les pathogènes varie selon la transparence du récipient,
l'intensité de la lumière du soleil et la clarté de l'eau.
Laisser l'eau refroidir et secouer vigoureusement avant utilisation.
(05_traitement_eau_boisson_urgence.pdf, s. d.)
III. NORMES DE POTABILITE BACTÉRIOLOGIQUE SUR LES
EAUX DE CONSOMMATION
La qualité bactériologique est
évaluée par la recherche de bactéries
témoins de contamination fécale. Ces germes montrent que
des micro-organismes pathogènes (comme les staphylocoques, les
salmonelles, les entérovirus...) peuvent aussi s'introduire dans le
réseau hydrologique. Leur présence dans l'eau
révèle donc un manque de fiabilité des équipements
(défaut des captages, dysfonctionnement ou absence des installations de
traitement, insuffisance dans l'entretien des ouvrages). Le risque principal
est l'apparition de troubles intestinaux (comme des gastro-entérites par
exemple) d'autant plus importants que les contaminations sont fréquentes
et massives. (Syndicat de la Faye - Qualité de l'eau > Normes de
l'eau, s. d.)
? Les eaux de distribution doivent respecter scrupuleusement les
valeurs consignées dans ce tableau :
Tableau 2 : Limites de qualité pour les
paramètres bactériologiques des eaux
|
PARAMETRES
|
LIMITES DE QUALITE
|
|
Escherichia coli (E. coli)
|
0
|
/ 100 mL
|
|
|
Entérocoques
|
0
|
/ 100 mL
|
|
? Les eaux de distribution doivent satisfaire aux valeurs
suivantes :
Tableau 3 : Références de qualité
pour les paramètres bactériologiques des eaux
|
PARAMETRES
|
REFERENCES DE QUALITE
|
|
Bactéries coliformes
|
0
|
/ 100 mL
|
|
|
Bactéries sulfito-réductrices y compris les
spores
|
0
|
/ 100 m/
|
|
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 11
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 12
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
|
Germes aérobies revivifiables à 22°C
|
variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur
habituelle
|
|
|
Germes aérobies revivifiables à 37°C
|
variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur
habituelle
|
|
PROFIL BACTERIOLOGIQUE
C'est une représentation des micro-organismes de types
bactériens pouvant être présents dans un milieu de
manière naturelle ou non. Nous avons tenu à circonscrire pour
cette étude, l'identification des germes constituants les indicateurs de
la limite qualité des eaux de boisson puis certains constituants la
référence qualité au moyen de la filtration sur membrane.
Quelques indications sont fournies concernant certains micro-organismes que
l'on peut retrouver dans les eaux. (Syndicat de la Faye - Qualité de
l'eau > Normes de l'eau, s. d.)
Escherichia coui : l'apparition de
cette bactérie dans l'eau indique la présence éventuelle
de micro-organismes pathogènes. C'est la principale bactérie du
groupe des coliformes fécaux. Ces derniers sont des
indicateurs d'une contamination d'origine fécale car ils apparaissent
toujours en grande quantité dans les déjections animales et
humaines. C'est pour cela que les coliformes fécaux constituent un bon
test de contamination des eaux par des matières fécales.
Certaines souches d'Escherichia coli sont pathogènes pour
l'homme et peuvent provoquer des troubles intestinaux ressemblant à une
gastro-entérite, au choléra ou à la dysenterie.
Entérocoques : ils appartiennent
à la famille des streptococcacae, ce sont les hôtes normaux de
l'intestin, ils ne sont pas considérés comme pathogènes
mais peuvent provoquer des infections localisées. Leur recherche,
associée à celle des coliformes fécaux (Escherichia
coli), constitue un bon indice de contamination fécale. Ils
dénotent donc la présence éventuelle de micro-organismes
pathogènes. Parmi les entérocoques, on peut citer les
streptocoques fécaux dont la recherche est faite pour
juger de l'efficacité d'un traitement de désinfection. Leur forte
résistance aux agents désinfectants en fait également des
représentants de la contamination virale car leur résistance est
comparable à celle des virus. Enfin, leur meilleure
résistance dans les eaux que les coliformes met en évidence une
pollution plus ancienne.
Bactéries coliformes (coliformes totaux) :
les bactéries coliformes sont présentes dans les
matières fécales mais se développent également dans
les milieux naturels (sols, végétation,
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
eaux naturelles). Ce ne sont donc pas des bactéries
d'origine strictement fécale. Ces entérobactéries,
très répandues, sont des micro-organismes de l'intestin jouant un
rôle dans les phénomènes digestifs. Elles sont
également trouvées au niveau de la cavité buccale, des
organes génitaux et des voies aériennes supérieures. La
présence d'un petit nombre de coliformes totaux dans les eaux
souterraines non traitées n'a qu'une signification réduite sur le
plan sanitaire. En général, l'absence des coliformes ne signifie
pas que l'eau ne présente pas de risque pathogène car les kystes
de certains parasites sont plus résistants à la
désinfection que les coliformes. Lorsque des coliformes totaux sont
détectés dans les eaux de distribution, une recherche
d'Escherichia coui et d'Entérocoques est engagée.
Certaines espèces de coliformes sont pathogènes, mais
excepté Escherichia coui, les espèces pathogènes
véhiculées par l'eau sont sans réel impact sanitaire.
Bactéries sulfito-réductrices y compris
les spores : micro-organismes anaérobies sporigènes, ces
germes ont la particularité de développer une forme de
résistance : les spores. Ils se retrouvent dans les matières
fécales, les sols et les rivières. Les plus fréquents sont
les Clostridium perfringens qui se retrouvent
uniquement dans les fèces mais en bien moins grand nombre qu'
Escherichia coui. Leurs spores les rendent résistants à
l'action des désinfectants et notamment du chlore et leurs permettent de
survivre dans l'eau beaucoup plus longtemps que les coliformes. Leur
présence ne signifie pas forcément un dysfonctionnement du
système de désinfection. Par contre, cela montrera un
dysfonctionnement du traitement de filtration et de clarification, lorsqu'il
existe. L'absence de spores dans une nappe souterraine ou une nappe alluviale
peut être un signe d'efficacité de la filtration naturelle. Il est
particulièrement important de prêter attention à ce
paramètre pour les eaux superficielles.
Germes aérobies revivifiables :
appelés aussi germes totaux, ils n'ont pas d'effets directs sur
la santé, mais sous certaines conditions ils peuvent
générer des problèmes dans les systèmes de dialyse.
Une faible valeur des germes totaux est le témoin de l'efficacité
du traitement et de l'intégrité du système de distribution
(pas de stagnation de l'eau, entretien efficace...). Leur trés grande
sensibilité en fait un signal d'alarme, avant apparition des
bactéries sulfito-réductrices et des coliformes. Leur
présence en grand nombre est le signe d'une dégradation de la
qualité de l'eau, soit à la ressource, soit dans le
réseau. Les bactéries d'origine résiduaire
(environnementale) sont dénombrées à 22°C sur une
période de 72 heures d'incubation, et les bactéries d'origine
intestinale (humaine ou animale) à 37°C sur une période
d'incubation de 24 heures. L'ancien décret n° 89-3 du 3 janvier
1989, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine,
fixait la limite des germes totaux à 100 / mL pour les
germes aérobies
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 13
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 14
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
revivifiables à 22°C et à 20 / mL
pour les germes aérobies revivifiables à 37°C et
ceci pour les eaux non désinfectées. Pour les eaux qui sont
traitées, les limites étaient respectivement de 20 / mL et de 2 /
mL.
? Quelques germes pathogènes (OMS |
Directives de qualité pour l'eau de boisson: Quatrième
édition intégrant le premier additif, s. d.)
Campylobacter : Les Campylobacter spp. sont
des bâtonnets spiralés incurvés à Gram
négatif, micro-aérophiles (besoin d'une faible teneur en
oxygène) et capnophiles (besoin d'une teneur élevée en
dioxyde de carbone), dotés d'un seul flagelle polaire dépourvu de
gaine. Les Campylobacter spp. comptent parmi les agents de
gastro-entérite aigüe les plus importants dans le monde. Des
approvisionnements en eau de boisson contaminés ont été
identifiés comme étant une source importante de flambées
de campylobactériose. La détection de flambées et de cas
en lien avec l'eau est en augmentation. E. coli (ou les coliformes
thermotolérants) est un indicateur approprié de la
présence/absence de Campylobacter spp. dans les approvisionnements en
eau de boisson.
Klebsiella : Les Klebsiella spp. sont des
bacilles non mobiles, à Gram négatif, qui appartiennent à
la famille des Enterobacteriaceae. Le genre Klebsiella comprend plusieurs
espèces, notamment K. pneumoniae,K. oxytoca, K. planticola et K.
terrigena. Les Klebsiella spp. ingérés avec l'eau de boisson ne
sont pas considérés comme une source de maladies
gastro-intestinales dans la population générale. Les Klebsiella
spp. détectés dans l'eau de boisson sont
généralement présents dans des biofilms et il est peu
probable qu'ils représentent un risque sanitaire. Ces bactéries
sont relativement sensibles aux désinfectants et leur
pénétration dans les réseaux de distribution peut
être évitée par un traitement approprié. Klebsiella
est un coliforme et peut être détecté par les tests
habituels utilisés pour les coliformes totaux.
Enterobacter sakazakii :
Bactérie mobile, en forme de bâtonnet, à Gram
négatif, non sporulante, qui a été observée comme
contaminant dans les préparations pour nourrissons. Les Enterobacter
spp. sont biochimiquement similaires à Klebsiella ; cependant,
contrairement à Klebsiella, Enterobacter est ornithine positif.
Enterobacter sakazakii s'est avéré plus résistant au
stress osmotique et hydrique que d'autres membres de la famille des
Enterobacteriaceae. La maladie provoquée par E. sakazakii chez des
nourrissons a été mise en lien avec la consommation de
préparations commerciales non stériles pour nourrissons.
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Salmonella : Les Salmonella spp.
appartiennent à la famille des Enterobacteriaceae. Ce sont des bacilles
mobiles à Gram négatif qui ne fermentent pas le lactose, mais la
plupart produisent du sulfure d'hydrogène ou des gaz issus de la
fermentation des glucides. La transmission, impliquant le plus souvent S.
typhimurium, a été associée à la consommation d'eau
souterraine contaminée et à des approvisionnements en eaux de
surface contaminés. Lors d'une flambée de maladie associée
à un approvisionnement d'eau de pluie communal, les excréments
d'oiseaux ont été désignés comme étant la
source de la contamination. Les Salmonella spp. sont relativement sensibles
à la désinfection. Escherichia coli (ou les coliformes
thermotolérants) est généralement un indicateur fiable
pour les Salmonella spp. dans les approvisionnements en eau de boisson.
Shigella : Les Shigella spp. sont des
bacilles à Gram négatif, non sporulants, non mobiles de la
famille des Enterobacteriaceae, qui peuvent se multiplier en présence ou
en absence d'oxygène. Comme ces organismes ne sont pas
particulièrement stables dans des environnements aqueux, leur
présence dans l'eau de boisson indique une contamination fécale
humaine récente. Les données disponibles sur leur
prévalence dans les approvisionnements en eau peuvent être
sous-estimées car les techniques de détection
généralement utilisées sont relativement peu sensibles et
peu fiables. La lutte contre Shigella spp. dans les approvisionnements en eau
de boisson est d'une importance particulière pour la santé
publique en raison de la gravité de la maladie que ces bactéries
provoquent. Les Shigella spp. sont relativement sensibles à la
désinfection.
Vibrio : Les Vibrio spp. sont de petites
bactéries incurvées (en forme de virgule), à Gram
négatif, avec un seul flagelle polaire. La transmission est
principalement due à une contamination de l'eau résultant d'un
assainissement insuffisant mais celui-ci n'explique pas totalement la
récurrence saisonnière et d'autres facteurs doivent intervenir.
La présence des sérotypes pathogènes V. cholerae O1 et
O139 dans les approvisionnements en eau de boisson est un problème
d'importance majeure pour la santé publique et elle peut avoir des
conséquences économiques dans les communautés
affectées. Vibrio cholerae est très sensible aux
procédés de désinfection. Pendant la distribution. Vibrio
cholerae O1 et non O1 ont été détectés en l'absence
d'E. coli dans l'eau de boisson.
Yersinia : Le genre Yersinia est
classé dans la famille des Enterobacteriaceae et comprend sept
espèces. Les Yersinia spp. sont des bacilles à Gram
négatif qui sont mobiles à 25 °C mais pas à 37
°C. Bien que la plupart des Yersinia spp. détectés dans
l'eau soient
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 15
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 16
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
probablement non pathogènes, des données
indiquent que, dans certaines circonstances, la transmission de Y.
enterocolitica et de Y. pseudotuberculosis à l'homme peut se produire
à partir d'eau de boisson non traitée. Les déchets humains
ou animaux sont la source la plus vraisemblable de Yersinia spp.
pathogènes.
IV. METHODES DIAGNOSTIQUES POUR L'ANALYSE BACTERIOLOGIQUE DE
L'EAU
L'analyse bactériologique proprement dite se pratique
selon deux types de méthodes : les méthodes de
dénombrement direct par comptage de colonies isolées après
ensemencement sur ou dans un support nutritif solide et les méthodes de
dénombrement indirect, par calcul statistique après
répartition de l'inoculum dans un milieu de culture liquide. Quel que
soit le type de méthodes employé, le résultat de la
numération n'est toujours qu'une approximation du nombre réel de
germes présents dans l'échantillon analysé. De nombreuses
causes d'erreur peuvent en effet influer sur le résultat, par exemple
l'homogénéisation, la réalisation des suspensions
mères et des dilutions, la qualification du manipulateur. De plus, la
précision des techniques bactériologiques est faible : elles
donnent une valeur qui se range à l'intérieur d'un intervalle de
confiance plus ou moins large. Pour pallier cette incertitude et pour tenir
compte de la sensibilité variable du consommateur, les normes
bactériologiques imposées sont telles que la limite de
sécurité n'est pas dépassée même si le nombre
de germes trouvé est sous-estime par rapport à la valeur
réelle. (Méthodes usuelles d'analyse bacteriologique pour le
contrôle sanitaire courant des eaux de mer et des coquillages, s.
d.)
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 17
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
1. METHODES DE DENOMBREMENT DIRECT
Ces méthodes ne sont pas applicables aux coquillages.
Elles sont parfois utilisées pour les eaux de mer. L'ensemencement a
lieu sur un milieu gélose sélective, soit directement, soit
après filtration d'un certain volume 4 d'eau sur une membrane et
dépôt de celle-ci sur le milieu solide. Les bactéries
donnent naissance dans des conditions favorables à des colonies typiques
isolées les unes des autres, différentes suivant les
espèces, et qui peuvent être comptées. Connaissant le
volume d'eau ensemencé ou filtré, le résultat final du
dénombrement peut être exprimé en fonction d'un volume pris
comme unité : par exemple n colonies pour 100 ml d'eau.
2. METHIODES DE DENOMBREMENT INDIRECT
L'inoculum est réparti dans un certain nombre de tubes
contenant un milieu de culture liquide. La présence de la
bactérie ou du groupe de bactéries recherchées se
manifeste par une réaction caractéristique. Un tube est
considéré comme étant positif lorsqu'il est le
siège de cette réaction caractéristique. On postule alors
qu'il contenait à l'origine au moins un germe recherché. Une
évaluation quantitative n'est possible qu'en jouant sur les volumes de
la prise d'essai et en prenant comme hypothèse que les germes sont
repartis de façon homogène dans l'inoculum : si l'ensemencement
porte par exemple sur 10,1 et 0,1 ml d'inoculum dans trois tubes de milieu
liquide, et si le germe recherche est présent seulement dans le premier
de ces tubes, il y a au moins un germe dans 10 ml d'inoculum, mais il n'y en a
pas dans 1 ou 0,1 ml. Si l'unité de volume d'expression du
résultat est de 100 ml, il s'ensuit que le nombre de germes est compris
entre 10 et 100 dans 100 ml d'inoculum. Afin d'affiner le dénombrement,
plusieurs tubes par serie sont ensemencés avec le même inoculum.
Pour couvrir une gamme assez étendue de numérations, susceptibles
de convenir à la plupart des besoins en hygiène conchylicole on
est parfois amené à faire varier les volumes ensemencés
par tube, le nombre de series et l'échelonnement des dilutions
décimales. D'ordinaire on répète l'ensemencement du
même inoculum dans 3~4 ou 5 tubes d'une même
serie.et on utilise trois séries
dans lesquels les inoculums sont respectivement de 10 ml, 1 ml et 0,1 ml.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 18
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
CHAPITRE III : METHODOLOGIE
1. PRÉSENTATION DU LIEU
D'ÉTUDE
La localité Ngoa-Ekélé est un quartier
de l'arrondissement de Yaoundé III, limitrophe des quartiers Olezoa au
Sud, Mvolyé à l'Ouest et Mélen au Nord. Nous avons
effectué des prélèvements d'eau au niveau des sources,
forages, pompes et puits de ladite localité, du moment où les
populations y viennent pour s'abreuver. Il s'agit d'un quartier dont la
population est majoritairement jeune plus précisément
estudiantine, ce quartier est assez bondé et représentatif
à première vue, d'un quartier résidentiel.
Néanmoins il serait important de mentionner que les ressources en eau
fournies par la camerounaise des eaux sont à la limite non
représentatives pour couvrir en termes de proportionnalité, les
besoins de la population. Finalement, le recours aux ressources souterraines
s'avère fortement marquée. À cet effet, nous avons tenu
à étudier la qualité sanitaire de ces points
d'approvisionnement souvent non répertoriés et non traités
mais qui soulagent les populations, ceci dans l'optique de fournir des
renseignements adéquats sur la qualité des eaux consommées
pour que si nécessaire, des mesures puissent être prises
individuellement ou à plus grande échelle.
2. TYPE D'ETUDE
Il s'agit d'une étude non expérimentale,
descriptive type transversale car, elle met au centre de sa réalisation
une évaluation qui aura fonction de présenter le contenu
réel en terme de germes présents dans les eaux de la
localité, en comparaison à une base légale
spécifique (les normes sur la qualité de l'eau de boisson) pour
la mesure de la performance des résultats qui, permettront dans ce cas
d'établir ou pas la potabilité d'un plan de vue
bactériologique des eaux consommées par les populations de
Ngoa-Ekélé.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 19
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
3. LES PARTICIPANTS
3.1 Technique d'échantillonnage ou de recrutement /
Nombre de participants requis ou souhaités
La technique d'échantillonnage utilisée pour
cette étude est probabiliste de convenance. Nous avons pris les
variables qui ont constituées nos participantes tel qu'ils se sont
présentés à nous et tel que la répartition
géographique nous aura permis. La taille de l'échantillon a
été calculée par la formule de Lorenz : N=
P.Q.Zà2 / d2 avec P : présence
supposée= 67% ; Q=1-P : degré de précision=5% ;Zà :
niveau de précision désirée=1,96 ; d : précision
acceptable 5% . Selon la Banque Africaine de Développement,
l'utilisation de l'eau de la camerounaise des eaux par la population au
Cameroun est de 33 %, il reste 67 % de la population qui utiliseraient sources,
forages, pompes et puits afin de combler leurs besoins en eau. Ce qui nous
donne le nombre de participants de notre population d'étude
établi à 53 individus de la localité.
3.2 Critères de sélection des
participants
? Critères d'inclusion : sont à
considérer pour cette étude les éléments suivants,
les points d'eau (sources, forages, pompes et puits) de la localité
où les populations viennent s'abreuver, tout individu de ladite
localité faisant valoir de façon volontaire, son approbation
à participer à notre étude.
? Critères d'exclusion : sont exclus de cette
étude, les points d'eau dont l'accès est refusé au grand
public, toute personne vivant dans la localité mais qui ne consomme pas
les eaux de la localité, toute personne d'âge inférieure
à 18ans, toute personne faisant valoir son droit de retrait de
participation à notre étude qu'importe le moment avant
divulgation des résultats et toute personne dont on aurait eu à
perdre ses données.
3.3 Modalités de recrutement
Pour cette étude, nous effectuons des descentes en
journée au niveau des points d'eau d'intérêt de la
localité et nous soumettions le questionnaire à tout individu
inclut précédemment qui sera présent lors de notre
échantillonnage sur les sites et tout individu de la localité
rencontré dans leur domicile pendant nos descentes sur le terrain. Au
final nous avons obtenus 53 questionnaires remplis par 53 participants de la
localité.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 20
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
4. PROCEDURE DE COLLECTE DES ECHANTILLONS
a. TECHNIQUE DE PRELEVEMENT GLOBALE
Condition de prélèvement
: Le prélèvement des points d'eau étaient
conditionné par leur appartenance à notre aire
géographique de recherche, soutenue par une approbation de collecte
orale donnée par les propriétaires / utilisateurs. À cela
s'ajoute l'absence de variations climatiques pouvant biaiser notre analyse.
Conditionnement : Les
échantillons d'eau étaient conservés dans des bouteilles
en plastique propres et transparentes pouvant contenir 1,5 L d'eau.
Modalités de transport : Les
échantillons étaient transportés à l'aide d'une
glacière à température comprise entre 2 et 4°C pour
moins de 8heures.
Délai d'analyse : Le
délai d'analyse était de 8heures.
Critères d'éligibilité des
échantillons : Les échantillons se devaient
d'être bien étiquetés et les volumes pouvant couvrir la
réalisation de l'analyse se devait d'être respectés (au
moins 1,5 L par échantillon d'un site de prélèvement).
b. PRELEVEMENT PROPREMENT DIT AU NIVEAU DES
SOURCES
Matériel : Solution hydro alcoolique,
récipient d'eau, marqueur, papier, stylo, glacière contenant des
glaçons
Après s'être nettoyé les mains, le
récipient est tenu de telle sorte que l'eau de source puisse
s'écouler dans ce dernier jusqu'à ce qu'il soit rempli. Par la
suite, ce récipient est fermé hermétiquement et
étiqueté pour être rangé dans une glacière.
La figure ci-après représente notre premier point
d'échantillonnage de la localité.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 21
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Figure 1 : Source du CETIC de
Ngoa-ékélé
c. PRELEVEMENT PROPREMENT DIT AU NIVEAU DES
PUITS
Matériel : savon, solution de
décontamination, une éponge, récipient d'eau, marqueur,
papier, stylo, glacière contenant des glaçons
Après avoir décontaminé le saut qui sert
à recueillir l'eau au niveau du site ainsi que nos mains, l'eau est
recueillie dans le puits à l'aide de ce saut et par la suite, elle est
transvasée dans notre récipient que nous fermions
hermétiquement. Pour clore, l'étiquetage de l'échantillon
est effectué et il est rangé dans la glacière. Les figures
ci-après représentent nos points d'échantillonnage
complémentaires à la source.

Figure 2 : Puits 1
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 22
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Figure 3 : Puits 2
Figure 4 : Puits 3

Figure 5 : Puits 4
Figure 6 : Puits 5
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 23
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
5. PROCEDURE D'ANALYSE DES ECHANTILLONS
a. PRESENTATION DU MATERIEL ET CONSOMMABLES, DES REACTIFS
ET DES EQUIPEMENTS UTLISÉS POUR L'ANALYSE
Pour l'analyse de nos échantillons, nous avons eu
recours à l'usage du matériel, consommables, réactifs et
équipements consignés dans ce tableau.
Tableau 4 : Présentation du matériel,
consommables, réactifs et équipements pour
l'analyse
|
Matériel et consommables
|
Réactifs
|
Équipements
|
|
Stylo
|
Eau distillée
|
Distillateur
|
|
Papier format
|
Milieux EMB, BEA, Eau
|
Autoclave
|
|
Marqueur permanant
|
peptonnée, Sélénite,
|
Incubateur
|
|
Burette graduée
|
Hektoen, Kliger
|
Réfrigérateur
|
|
Ballon à fond plat
|
Violet de gentiane
|
Balance
|
|
Boites de pétri
|
Lugol
|
Vacupum
|
|
Tube en verre de culture
|
Alcool-acétone
|
Microscope
|
|
Membranes filtrantes
|
Fuschine
|
Ordinateur
|
|
Échantillon d'eau
|
Huile à immersion
|
Minuteur
|
|
Pince
|
Disques d'oxydase
|
|
|
Bec bunsen
|
Péroxyde d'hydrogène
|
|
|
Gaz
|
Galérie miniaturisée API 20E
|
|
|
Anse
|
Huile de paraffine
|
|
|
Pipette pasteur
|
Chlorure ferrique
|
|
|
Lame porte-objet
|
VP1-VP2
|
|
|
Papier absorbant
|
Réactif de KOVACK'S
|
|
|
Tubes à hémolyse
|
Solution de décontamination
|
|
|
Conteneurs de déchets
|
|
|
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 24
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
b. MÉTHODE D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS : LA
FILTRATION SUR
MEMBRANE
C'est la technique de concentration la plus utilisée au
laboratoire pour ce qui est de l'analyse des eaux. Le plus
généralement, on procède à une filtration sur
membranes en esters de cellulose, de porosité 0,22 ìm ou 0,45
ìm, susceptibles de retenir les bactéries. Après
filtration de l'eau à étudier, la membrane est
déposée sur un milieu gélosé approprié. Ceci
permet aux colonies de coliformes de se développer
préférentiellement au cours d'une incubation de 18 à 24
heures, et sous un aspect suffisamment caractéristique pour autoriser un
diagnostic présomptif. Celui-ci peut d'ailleurs être
confirmé par des repiquages judicieux. Son domaine d'application
privilégiée est les eaux claires ne contenant pas de
matières en suspension susceptibles de colmater : eaux d'alimentation,
de surface et de baignade claires. (L'analyse de l'eau - 10e éd. -
Jean Rodier,Bernard Legube,Nicole Merlet, s. d.)
? Description du dispositif de filtrage
Le dispositif dans son ensemble comporte les
éléments suivants : Un entonnoir-réservoir cylindrique ou
conique, en acier inoxydable ou plastique à usage unique, de taille
variable généralement de 50 à 500 mL, gradué. Ce
réservoir est destiné à être appliqué
exactement sur la surface plane, cylindrique, du support métallique lui
servant de base. Un support métallique formant une sorte de cuvette
conique dont le bord supérieur reçoit une plaque poreuse
(généralement de 50 mm de diamètre) destinée
à supporter une membrane filtrante de même diamètre. La
partie inférieure de la cuvette est prolongée par un tube creux,
muni d'un robinet, permettant le passage d'une aspiration par trompe à
vide et l'évacuation du liquide filtré. Un dispositif
d'assemblage des deux pièces précédentes, variable selon
le modèle d'appareil (collier de serrage, pince amovible, clip, etc.)
permet de solidariser réservoir et support et d'assurer
l'étanchéité, en évitant toute fuite du liquide
contenu dans le réservoir. Un matériel de liaison supportant
l'ensemble de cet appareil de filtration et le reliant à un dispositif
d'obtention du vide. Dans sa version la plus simple, représentée
sur le schéma, il consiste en une fiole à vide en verre, de
capacité suffisante pour éviter des vidanges trop
fréquentes de l'eau filtrée (5 litres par exemple), reliée
à une trompe à eau ou une pompe à vide par
l'intermédiaire d'un flacon de garde, muni d'un manomètre. Dans
des dispositifs plus complexes, la fiole à vide est remplacée par
une rampe supportant plusieurs appareils de filtration. La face
supérieure du support métallique et la plaque poreuse au contact
avec la
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 25
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
face supérieure de la membrane sont
généralement stérilisées à la flamme. Le
réservoir peut être stérilisé de la même
façon. Directement au contact des eaux analysées, son flambage
doit être particulièrement soigné ; le refroidissement est
alors relativement long, d'où l'avantage des entonnoirs à usage
unique. Les membranes filtrantes utilisées sont
généralement constituées par des esters de cellulose ; le
diamètre des pores est généralement de 0,45 ìm
(parfois de 0,22 ìm). Un quadrillage en surface facilite les
dénombrements bactériens.
? Technique de la filtration sur membrane
Flamber la face supérieure (plaque poreuse) de
l'appareil. Fermer le robinet du support et mettre en marche la pompe à
vide. Prélever une membrane stérile en la saisissant par son bord
extérieur, avec une pince flambée et refroidie ; la
déposer sur la plaque poreuse. L'entonnoir-réservoir
flambé et refroidi est placé au-dessus de la membrane. Installer
le dispositif de fixation (dans certains modèles d'appareils, ce
dispositif, toujours prévu, est inutile, l'adhérence du
réservoir sur la membrane étant suffisante). Agiter soigneusement
le flacon d'eau à analyser et verser l'eau, stérilement, dans le
réservoir jusqu'au repère (50 ou 100 mL selon l'appareil et selon
le type d'analyse pratiquée). Ouvrir le robinet du support suffisamment
pour laisser l'eau s'écouler lentement sous l'action du vide. Si le
contenu du réservoir correspond à la prise d'essai
nécessaire, rincer avec de l'eau stérile (40 à 50 mL)
dès la filtration terminée. Sinon, fermer le robinet à ce
moment-là, remplir à nouveau le réservoir avec de l'eau
à analyser, et rincer lorsque tout l'échantillon a
été filtré. Dès que la membrane paraît
sèche, fermer le robinet, enlever le dispositif de fixation et, avec la
pince à creuset, le réservoir. Prélever la membrane avec
une pince flambée en la saisissant par son extrême bord, et
l'introduire sur le milieu de culture choisi ou lui faire subir le traitement
selon la méthode utilisée parmi celles qui seront décrites
ultérieurement. Lorsque le volume d'échantillon à filtrer
est important, et que la teneur en matières en suspension n'est pas
négligeable, la membrane peut être colmatée avant
l'utilisation complète de la prise d'essai nécessaire à
analyser. Plusieurs membranes devront donc être successivement
utilisées. Remarques - Un matériel permettant de filtrer au lieu
même de prélèvement l'échantillon à
étudier est commercialisé. La membrane peut alors être
placée sur un milieu de transport et transférée
après retour au laboratoire sur un second milieu constituant le milieu
d'inoculation définitif. - La membrane peut également être
immédiatement placée sur le milieu définitif et
aussitôt incubée dans les conditions particulières pour
sélectionner les catégories de germes que l'on veut
étudier. Utiliser pour cela, des incubateurs pouvant fonctionner dans un
véhicule.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 26
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
? Dénombrement sur membrane filtrante
La membrane après la filtration peut être
déposée sur la surface d'une gélose. Les bactéries
retenues à la surface sont nourries à travers la membrane par les
pores de celle-ci. Dans le cas des eaux d'alimentation ou des eaux de surface
de bonne qualité, il n'y a généralement aucune
difficulté à filtrer 100 mL. La sensibilité est donc, dans
ce cas, 100 fois supérieure à celle obtenue normalement par
incorporation en gélose, 20 fois à celle-ci lorsque l'inoculum
peut exceptionnellement être porté à 5 mL. Pour de telles
eaux, des volumes plus importants peuvent souvent être filtrés.
Les avantages de cette méthode sont : absence de choc thermique,
différenciation plus aisée des colonies, possibilité de
repiquage. En outre, la filtration permet de séparer les
bactéries du milieu analysé, donc des éventuels
inhibiteurs contenus dans ce milieu. Néanmoins, il n'est pas possible,
sur la surface des membranes (généralement de 50 mm de
diamètre), de dénombrer valablement plus de 80 à 100
colonies car, au-delà, les phénomènes de confluence et
surtout de compétitions sont considérés comme importants.
Il convient donc dans ce cas d'effectuer des dilutions. De plus, la
présence abondante de matières insolubles dans
l'échantillon filtré (fin dépôt minéral,
plancton, etc.) peut colmater les pores, faire obstacle au passage des
nutriments et donner ainsi des résultats erronés par
défaut. Le support utilisé pour la membrane peut être soit
une gélose pour isolement, le plus souvent sélective en vue de la
mise en évidence de germes ou de groupes de germes
déterminés ; soit un tampon absorbant imprégné de
solution nutritive. Le dépôt de la membrane sur la gélose
ou le tampon absorbant doit être fait avec le plus grand soin, sans
permettre à des bulles d'air de séparer en quelque point que ce
soit la membrane de son support. Pour cela, saisir la membrane par une pince
à son extrême bord, la mettre en contact par
l'extrémité opposée avec le support nutritif ; puis la
dérouler, en quelque sorte, sur celui-ci, ce qui assure progressivement
le contact. L'expression des résultats se fait sous forme d'un nombre
d'unités formant colonies (UFC).
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
c. ALGORITHMES DE RECHERCHE DES COLIFORMES, DES
ENTEROCOQUES ET DES SALMONELLES
? CAS DES COLIFORMES
Mise en culture de la
membrane filtre de
notre
échantillon dans
milieu EMB à 37°C
pour 24h
En cas de croissance de
colonies, description et
Gram de controle
présentant des Bacilles
Gram-
Réalisation test de
catalase et test
d'oxydase,
obtention
catalase+ et oxydase-
|
Réalisation inoculum pour identification sur
galérie miniaturisée API 20E suiite à une incubation de
24h à
37°C
|
|
Après lecture de la
galérie, attribution du nom de l'espèce au moyen du
logiciel
APIDENT version 2.0
|
Figure 7 : Algorithme de recherche des
coliformes
? CAS DES ENTEROCOQUES
Mise en culture de la
membrane filtre de
notre
échantillon
dans le milieu BEA à
37°C pendant 24h
En cas de croissance,
on note le virage du
milieu au noir
et le
Gram présente des
cocci Gram+ en
chenette
Réalisation du test de
catalase,
obtention
catalase-
Entérocoques spp
Figure 8 : Algorithme de recherche des
entérocoques
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 27
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
? CAS DES SALMONELLES
Mise en culture de la
membrane filtre de
notre
échantillon dans le milieu
eau peptonnée pour
le
préanrichissement à 37°C
pendant 24h
|
Mise en culture de 1mL
du bouillon du pré-
enrichissement dans le
milieu Sélénite pour
l'enrichissement à
37)c
pour 24h
|
Mise en cuture du
bouillon d'enrichissement
dans le
milieu Hektoen
par la méthode des
quadrans, isolement
de
colonies à 37°C après
24h
Identification des
salmonelles par mise en
culture de
l'inoculum à
l'aide du milieu Kliger à
37°C pour
24h
|
Dégagement gazeux, fermentation du glucose au niveau du
culot, non fermentation du lactose au niveau de la pente et
production de H2S Salmonella Spp
|
|
Figure 9 : Algorithme de recherche des
salmonelles
d. MODE OPÉRATOIRE DE L'ANALYSE
BACTÉRIOLOGIQUE DES ÉCHANTLLONS
? 1er jour
Lorsque les échantillons parviennent au laboratoire, la
prise du pH, la description de la couleur et de la turbidité sont
réalisées. Par la suite, la filtration des échantillons
(eaux) est réalisée grâce au dispositif de pompe
prévu à cet effet. Chaque échantillon est filtré
individuellement selon les proportions indiquées en fonction du germe
qu'on souhaite isolé dans un milieu. Ainsi, 100ml d'eau sont
filtrés autour de la flamme en ayant au préalable aseptisé
tous les entonnoirs à la flamme et la membrane filtrante est
déposée dans le milieu EMB pour le dénombrement des
coliformes en particulier Escherichia coui. Il en est de même
pour la membrane suivante qui est mise dans le milieu BEA pour le
dénombrement des entérocoques. Les boites sont
étiquetées et mise à l'étuve à 37 °C
pour 24h. Puis, 1000ml d'eau sont filtrés pour la recherche des
salmonelles et la membrane est introduite à l'aide de la pince dans un
tube pour culture contenant de l'eau peptonnée. Le tube est mis à
l'étude à 37°C pour 24h. La figure ci-après
présente le dispositif de filtration employée pour nos
échantillons dans l'environnement de travail.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 28
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Figure 10 : Dispositif de filtration de l'eau dans
l'environnement d'analyse
? 2ème jour
Les milieux de culture sont sortis de l'étuve
après 24h d'incubation. La description des colonies avec
dénombrement par UFC pour 100ml est réalisée pour chaque
milieu de chaque échantillon filtré et renseignée sur la
fiche de paillasse. Sur EMB, les colonies sont roses d'aspect visqueux, de
taille égale à 5um et d'autres sont rouges de plus petite taille
en fonction de chaque échantillon. Sur BEA, les colonies sont de
très petite taille, d'aspect noir et transparente pour certaine en
fonction de l'échantillon d'eau filtré. Dans le tube de culture,
l'on observe le milieu qui est devenu trouble tirant vers le blanc pour
certains échantillons. De ce bouillon, 1ml est prélevé et
introduit dans un tube de culture contenant du milieu sélénite et
remis à l'étuve pour 24h à 37°C. Les figures
ci-après présentent les aspects de ces différentes
croissances en fonction des milieux.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 29
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 30
Figure 11 : Aspect des colonies sur EMB
Figure 12 : Aspect des colonies sur BEA

Figure 13 : Aspect des eaux peptonnées
après incubation à 37°C pour 24h
Par la suite, des frottis sont réalisés sur lame
porte-objet à l'aide de colonies isolées prises individuellement
sur dans chaque milieu, additionnées à de l'eau distillée
stérile. Ces frottis sont colorés au Gram. La lecture
microscopique est effectuée après séchage des lames. Les
lames des colonies roses et rouges sur EMB présentes des bacilles Gram-,
celle des colonies noires et transparentes prises sur BEA présentes des
cocci à Gram+. Les figures ci-après illustrent les lames suite
à la coloration de Gram.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 31
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Figure 14 : Image lames porte-Objet après
coloration de GRAM
En continuité, des tests de catalase et d'oxydase sont
réalisés pour une colonie isolée de chaque
échantillon pour chacun des milieux utilisés. Les
bactéries possédant une chaîne respiratoire complète
sont dotées d'un cytochrome oxydase. La mise en évidence de cette
oxydase est effectuée en présence d'une solution aqueuse à
1% de chlorhydrate de diméthylparaphénylène diamine qui
forme un complexe violet au contact de cette enzyme. Les colonies sont
prélevées à l'aide d'une pipette Pasteur. Placer un disque
d'oxydase sur une lame propre et stérile. À l'aide d'une pipette
Pasteur (il est strictement interdit d'utilisé l'anse de platine pour ne
pas fausser le résultat) une goutte de suspension bactérienne
pure est déposée sur " un disque oxydase", celui-ci contient de
l'oxalate de diméthyl paraphénylène diamine. Les
bactéries oxydase-positives donnent rapidement une coloration violette
foncée ; dans le cas contraire, il n'y a pas de coloration.
Certaines bactéries ont la faculté de
dégrader le peroxyde d'hydrogène (H2O2). En présence d'une
bactérie productrice de catalase, on observe à partir d'H2O2 une
libération d'oxygène gazeux selon la réaction : H2O2 donne
H2O + 1/2O. La méthode consiste à prélever une colonie du
germe à étudier (ex. les staphylocoques pour les Gram + et les
entérobactéries pour les Gram -) sur l'extrémité
d'une anse de platine que l'on plonge ensuite dans une goutte d'eau
oxygénée (à l'aide d'une pipette Pasteur). Le
dégagement de bulles gazeuses signe la présence de
l'enzyme.(Denis et al., 2012)
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Les tests de catalase effectués sur les colonies roses
et rouges sur EMB sont tous positifs et ceux d'oxydase négatifs. Les
tests de catalase effectués sur les colonies noires et transparentes de
BEA sont tous négatifs et oxydase positifs. Les figures suivantes
illustrent des résultats de catalase et d'oxydase de certains
échantillons.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 32
Figure 15 : Résultat catalase positif et oxydase
négatif
Figure 16 : Test oxydase négatif
Pour clore cette journée, des suspensions
bactériennes sont réalisées à l'aide de l'eau
distillée stérile et de colonie isolée prise
individuellement dans chaque milieu EMB de chaque échantillon à
l'aide d'une anse, autour de la flamme. Suivant le principe d'utilisation de la
mini galerie APÏ 20E, après l'avoir
étiqueté, la suspension est prélevée à
l'aide d'une micropipette et mise dans les 20 puits constituant la mini galerie
de façon à remplir jusqu'au bas inférieur de l'orifice
d'ouverture, les puits des caractères biochimiques ONPG, TDA, IND, GLU,
MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY et ARA uniquement à l'aide de cette
suspension sans bulle d'air. De façon à remplir totalement
l'orifice des puits des caractères biochimiques CIT, VP, et GEL
uniquement à l'aide de la suspension. De façon à remplir
jusqu'au bas inférieur de l'orifice d'ouverture des puits des
caractères biochimiques ADH, LDC, ODC, H2S et URE à l'aide de
cette suspension à laquelle on rajoutera de l'huile de paraffine
jusqu'au niveau du haut supérieur de l'orifice d'ouverture de ces puits
afin de créer l'anaérobiose. Les galeries sont ainsi
constituées pour chaque colonie sur EMB de chaque échantillon et
mises à l'incubateur à 37°C pour 24h. La figure
ci-après illustre la mini galerie remplie avant son incubation.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 33
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Figure 17 : Image de d'une micro gallérie API
20E après ensemencement
? 3ème jour
Les milieux en tube incubés sont sortis après
24h et à l'aide d'une anse, des ensemencements par la technique des
cadrans sont réalisés dans des géloses Hektoen pour chaque
échantillon à l'aide des bouillons sélénite
obtenus. Ces géloses sont étiquetées et mises à
l'incubateur pour 24h à 37°C. Les mini galeries sont sorties
également après 24h et la lecture est lancée. Pour chaque
galerie, une lecture avant révélation est réalisée
et au moins trois caractères se doivent d'être positifs pour que
la révélation puisse être effectuée, sinon
ré-incubation de la galerie à 37°C pour 24h. La
révélation est faite pour les caractères biochimiques TDA,
IND et VP respectivement à l'aide des réactifs suivants :
chlorure ferrique, VP1-VP2 et réactif de Kovack's. La réaction
dure 10min pour la TDA, 5min pour IND et VP puis, puis la lecture est
réalisée. Cette lecture est basée sur le virement de
couleur ou pas observable au niveau du puits de chaque caractère. Les
résultats de lecture sont exprimés en positif ou négatif
pour chaque caractère, et consignés dans le calepin du kit API
20E puis, présentés au final après
séparation des caractères en groupe de 3 et 2, en un des groupes
de chiffre qui constitue le nombre qui permet d'identifier
spécifiquement le germe isolé lors de la culture. Cette
identification a été réalisé à l'aide du
logiciel APIDENT version 2.0 sur un ordinateur de marque DELL. Certaines
souches n'ont pas été identifiables. Les figures ci-après
illustrent l'aspect des milieux sélénites après
incubation, une galerie après incubation et un résultat
d'identification fournie par le logiciel APIDENT.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 34
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Figure 18 : Aspect de quelques milieux
Sélénite après incubation durant 24h à
37°C
Figure 19 : Aspect d'une micro gallérie API 20E
après incubation durant 24h à 37°C
Figure 20 : Résultat d'identification des
entérobactéries avec le logiciel APIDENT
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
? 4ème jour
Les géloses Hektoen sont sorties après 24h et
des suspensions sont de nouveau réalisées à l'aide des
colonies isolées sur ce milieu pour chaque échantillon. Par le
suite à l'aide de suspension des différentes colonies
isolées sur Hektoen en fonction des échantillons, des
ensemencements sont réalisés sur milieu Kliger, milieu solide
coulé en pente pour l'identification des germes en partant du
suppositoire qu'il s'agisse des salmonelles. À l'aide d'une anse, la
suspension d'un échantillon unique est prélevée et une
piqure centrale dans le culot de la pente est réalisée puis, au
niveau de la pente, des stries longitudinales sont effectuées en sortant
du tube. Les tubes sont étiquetés, fermés de moitié
et mis à l'incubateur pour 24h à 37°C. Les figures ci -
après illustrent le milieu Kliger après ensemencement et l'aspect
des colonies sur milieu Hektoen après 24h d'incubation à
37°C.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 35
Figure 21 : Milieu kliger avant incubation
Figure 22 : Colonies sur gélose
Hektoen
? 5ème jour
Les milieux sont sortis après 24h et la description de
chacun est effectuée et consignée dans la fiche de paillasse.
Principe de la production d'H2S, la mise en évidence de la production
d'H2S se fait grâce à la présence de thiosulfate de sodium
et de citrate ferrique (fer III). En effet, chez une souche dite H2S +: Le
thiosulfate est réduit en anaérobiose en H2S. L'H2S ainsi
formé se combine au citrate de fer présent pour former un
précipité de sulfure de fer noir. Principe de la lecture de la
fermentation des glucides, le milieu de Kligler
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
contient 2 glucides: glucose et lactose (10 fois plus de
lactose que de glucose). Les entérobactéries utilisent d'abord le
glucose et ensuite, éventuellement le lactose. La production de gaz se
traduit par l'apparition de bulles au niveau du culot, ou encore par la
formation d'une poche qui décolle complètement le milieu du fond
du tube. (Denis et al., 2012)
La production de gaz est visible de par la fragmentation de la
gélose initialement stable en un bloc lors de l'ensemencement. Certains
culots de pente sont à présents jaunes, c'est la marque de
l'utilisation du glucose par les bactéries tandis que d'autres reste
oranges. Certaines pentes prennent la couleur jaune qui marque l'utilisation du
lactose par les bactéries pendant que d'autres demeurent de couleur
orange. Aucune production de H2S n'a été observable pour les
échantillons testés, du fait de l'absence de points noirs dans le
milieu. L'identification des germes isolés pour tous les
échantillons testés n'aura permis de détecter des
salmonelles dans les échantillons. Les figues ci-après illustrent
les milieux Kliger après incubation lorsqu'il y'a utilisation de lactose
et glucose par la bactérie.

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 36
Figure 23 : Images après incubation des milieux
Kliger à 37°C durant 24h
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 37
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
e. ASSURANCE QUALITE POUR L'ANALYSE DE NOS
ECHANTILLONS
Lors de la préparation des milieux de culture
employés pour les analyses, les milieux autoclavables ont bien
été autoclavés et leurs coulages se sont faits dans les
boites de pétri et dans les tubes de culture autour de la flamme. Suite
aux préparations des milieux, des tests de stérilité, de
fertilité et de spécificité ont été
réalisés pour chaque milieu avant utilisation et leur
conservation s'est faite entre 2 et 8°C au réfrigérateur
pendant deux semaines.
Lors du processus d'analyse, toutes les manipulations
effectuées ces jours ont été effectuées dans le
respect des principes d'asepsie indiqués pour ces dernières, ce
sont : la décontamination de la surface de travail avant et après
chaque manipulation, la stérilisation avant passage de chaque
échantillon des accessoires du Vacupum pour la filtration et la
réalisation de celle-ci autour de la flamme, la stérilisation des
tubes où ont été réalisées les suspensions,
le travail permanent autour de la flamme pour ne citer que ceux-là. Les
algorithmes d'identification des gerles établies ont scrupuleusement
été suivis.
f. GESTION DES DECHETS
Au sorti de notre manipulation, tous les déchets non
infectieux ont été rassemblés dans des poubelles pour
déchets non infectieux, tous les milieux de culture coulés dans
les boites de pétri et en tubes utilisés ont été
autoclavés et détruits selon le protocole prévu à
cet effet et tous les déchets infectieux ont été
rassemblés dans des poubelles pour déchets infectieux. Toute la
verrerie utilisée a été décontaminée et
recyclée.
g. LIMITES DE L'ANALYSE ET ALTERNATIVES
PROPOSEES
L'analyse de nos échantillons a pris forme dès
la base sur la méthode de la filtration sur membrane avec
dénombrement après incorporation de la membrane en milieu solide
et isolement des salmonelles après usage de la membrane filtre en milieu
liquide. Cependant, cette méthode ne permet d'isoler que certains germes
(coliformes, entérocoques, salmonelles) tout en excluant la
possibilité d'en isoler d'autres. Il serait approprié de
concilier d'autres méthodes d'analyse pour s'assurer à plus
grande échelle d'isoler la quasi-totalité des germes à
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 38
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
rechercher dans les eaux de boisson, ce sont : la
méthode par incorporation en milieu liquide pour l'isolement des
bactéries sulfito-réductrices, la méthode utilisant le NPP
Pour l'isolement de Vibrio cholerae et bien d'autres.
6. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET
CONSIDÉRATION ÉTHIQUES
Pour mener à bien ce travail, nous avons eu à
remplir diverses formalités d'ordre administratif et à tenir
compte de certaines considérations éthiques. Elles sont entre
autre : la demande d'une clairance éthique au sein du sein du
Comité Institutionnel d'Éthique de la Recherche pour la
Santé Humain de l'UCAC, une demande d'autorisation de collecte
adressée au Sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3
et une auprès du chef de quartier, une autorisation de mise en stage au
sein du laboratoire de l'ESS-UCAC et, la mise à disposition de notice
d'information appuyée par une fiche de consentement
éclairé pour les participants ayant répondus à
notre questionnaire.
7. TRAITEMENT DES DONNEES ET PRESENTATION DES
RESULTATS
Les données obtenues après analyse et
enquêtes au travers du questionnaire ont été
traitées à l'aide des logiciels Windows, Excel, CSPro et SPSS.
Pour ensuite permettre de présenter nos résultats sous forme de
tableau, de représentation graphique et en base de fichiers pour
conservation des données recueillies.
8. DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés rencontrées durant cette
collecte ont été présentes à plusieurs niveaux,
déjà au niveau de l'obtention d'autorisations administratives de
collecte pour effectuer la collecte d'échantillon et pour la
réalisation des enquêtes auprès des populations de la
localité de Ngoa-Ékélé, puis lors de l'achat et
rassemblement du matériel du fait de la rareté de
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
certains produits. Aussi, quelques difficultés au
départ en rapport à l'utilisation du dispositif de pompe, en
rapport à l'analyse en elle-même. La plus grande difficulté
s'est portée sur l'analyse statistique des résultats de nos
analyses.
9. LIMITES DE L'ETUDE
Comme limites de notre étude, il est à noter
qu'elle offre des résultats qui ne donnent pas une connaissance globale
sur la qualité bactériologique des eaux de consommation de la
ville de Yaoundé et encore moins du Cameroun, du fait qu'elle ne
concerne qu'une petite portion de la ville en elle-même. À cela
s'ajoute le fait que la recherche, de par les ressources disponibles n'a pu
rendre possible l'isolement de toutes les bactéries impliquées
dans les survenues maladies d'origine hydrique qui ne cessent d'être des
problèmes de santé publique et qui constituent des
références qualité pour les eaux. Aussi nous n'avons pu
analyser les eaux des points différents des sources et puits de la
localité mentionnés dans ce travail, notamment les forages,
pompes et rivières du fait qu'il a été impossible de les
répertorier.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 39
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 40
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION
1) PRÉSENTATION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DE LA
POPULATION ET DES POINTS D'ÉCHANTILLONAGE
L'évaluation bactériologique des eaux de
consommations de la localité de Ngoa-Ékélé a
nécessité une participation active de la population
concernée lors d'enquêtes effectuées sur le terrain. La
détermination de la taille minimale de cette population à
questionner a été définie à 53partcipants. Les
tableaux ci-dessous donnent une caractérisation globale de ladite
population en fonction de la catégorie socio-professionnel des
participants, de leur sexe et de leur l'âge.
Tableau 5 : Répartition de la population suivant
la situation socio-professionnelle
Catégorie socio - professionnelle
|
Employé/ ouvrier qualifié
|
|
Compte propre
|
|
Chômeur
|
|
Étudiant(e)
|
|
Élève
|
|
7
|
7
|
2
|
32
|
5
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Ce tableau indique que la population est fortement
représentée par les étudiants.
Le tableau suivant donne une répartition de cette
population suivant le sexe et l'âge. Tableau 6 :
Répartition de la population suivant le sexe et l'âge
Age Total
|
18-24
|
25-31
|
32-38
|
39 et plus
|
|
|
Sexe
|
Homme
|
21
|
11
|
3
|
1
|
36
|
|
Femme
|
9
|
4
|
1
|
3
|
17
|
|
Total
|
30
|
15
|
4
|
4
|
53
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Ce tableau indique que notre population est dominée par
le sexe masculin et se retrouve plus dans la tranche d'âge comprise entre
18-24, avec pour sens le fait qu'elle soit à la base plus estudiantine
qu'autre chose.
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Pour cette étude, les points d'échantillonnage
des eaux de consommation étudiés exclusivement ont
été des sources et des puits. Le tableau ci-après
récapitule les points d'approvisionnement les plus utilisé dans
la communauté de Ngoa-Ékélé.
Tableau 7 : Sources d'approvisionnement en eau
utilisées par la communauté de Ngoa-
Ékélé
Source d'approvisionnement Pourcentage
|
Source
|
Source1
|
47,11%
|
|
Source2
|
34,62%
|
|
Puits
|
Puit1
|
2,88%
|
|
Puit2
|
4,81%
|
|
Puit3
|
4,81%
|
|
Puit4
|
3,85%
|
|
Puit5
|
1,92%
|
|
Total
|
|
100,00%
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Ce tableau démontre que parmi les sept (7) points
trouvés, les plus utilisés par la population sont les deux
sources, ce qui est dû non seulement à l'emplacement de ces
derniers mais également à la qualité de l'eau à
priori définie par les consommateurs. Ces sources sont utilisées
pour effectuer presque tous les activités quotidiennes (Consommation
buccale, usage corporel, usage domestique).
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 41
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 42
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
2) ILLUSTRATION DES FACTEURS FAVORISANT LA
PRÉSENCE DE BACTÉRIES DANS LES EAUX DE
NGOA-ÉKÉLÉ
L'environnement correspond à l'ensemble de tout ce qui
nous entoure. Il est à noter que celui dans lequel les points d'eau
étudiés se retrouvent, présente divers
éléments qui, pour la plupart contribue à dégrader
un tant soit peu leur qualité. Le tableau ci-après
présente en gros la distribution de ces facteurs de pollution
environnementaux par point d'approvisionnement en eau concerné selon les
avis de la population.
Tableau 8 : Distribution de sources de pollution selon le
point d'approvisionnement
|
Point d'eau
|
|
Sources de pollution recensées à
proximité de la source d'approvisionnement
|
|
|
|
S1
|
Latrines
|
Dépotoir
|
Champ
|
Rigole
|
Eaux
stagnantes
|
Points de
lessive et
vaisselle
|
Industrie
|
|
S2
|
Latrines
|
Dépotoir
|
Champ
|
Rigole
|
Eaux
stagnantes
|
Points de
lessive et
vaisselle
|
industrie
|
|
P1
|
Latrines
|
Dépotoir
|
/
|
Rigole
|
Eaux
stagnantes
|
/
|
/
|
|
P2
|
Latrines
|
dépotoir
|
Champ
|
Rigole
|
Eaux
stagnantes
|
/
|
/
|
|
P3
|
Latrines
|
Dépotoir
|
Champ
|
/
|
/
|
/
|
/
|
|
P4
|
Latrines
|
Dépotoir
|
champ
|
/
|
/
|
/
|
/
|
|
P5
|
Latrines
|
/
|
/
|
Rigole
|
/
|
/
|
/
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Ce tableau indique que les points d'eau de la localité
se retrouvent à proximité de diverses sources de pollution avec
la plus représentée étant les latrines, car
présentes de part et d'autre dans l'environnement.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 43
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
La figure ci-dessous donne une répartition en termes de
pourcentage de ces facteurs de pollution environnementaux, en rapport à
leur proximité vis-à-vis de l'ensemble des points
d'échantillonnage.

Points de lessive et vaisselle 3%
Latrines
26%
Rigole
24%
Industrie
1%
Eaux
stagnantes
8%
Champ
18%
Dépotoir
20%
Figure 24 : Proportion des facteurs de pollution dans
la localité de Ngoa-ékélé
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Cette figure présente les latrines comme le facteur de
pollution dominant dans la localité par observation flagrante de la
population concernée. À cela s'ajoute les rigoles, occupant la
deuxième place et en cohésion avec le 1er, compte tenu
du fait que de ces latrines fortement répandus dans la localité
les voies d'évacuation employées pour la majeure sont les rigoles
nécessitant des couts moindres. Ce qui vient expliquer à
suffisance la parution des dépotoirs comme 3e facteur de
pollution le plus marqué de la localité.
À ces facteurs d'ordre environnemental, l'étude
a permis de ressortir un autre facteur qui favorise la présence des
germes isolés dans les eaux de consommation de cette localité. Ce
facteur fait référence au non traitement des eaux par les
populations avant usage personnel ou encore au niveau des sites
d'approvisionnement eux-mêmes.
La figure suivante donne un aperçu global sur la
proportion d'habitants qui traiteraient leur eau avant consommation dans la
communauté de Ngoa-Ekélé.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 44
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Figure 25 : Proportion des habitants qui traitent l'eau
de manière individuelle
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Il s'avère que la grande majorité de la
population ne traite pas de l'eau depuis chez eux avant usage, après
approvisionnement depuis le site, faute de connaissances à propos, soit
par manque financier. Néanmoins, les procédés de
traitement employés par la portion de la population traitant leurs eaux,
ont pu être consignées dans le tableau ci-après en
ressortant le pourcentage d'utilisation de chaque procédé.
Tableau 9 ; Méthodes de traitement des eaux
employées par les populations à domicile
Méthode de traitement effectif
(en %)
|
Ébullition
|
36,4%
|
|
chloration
|
59,1%
|
|
Filtration aux chandelles de céramique
|
4,5%
|
|
Total
|
100,0%
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Il en ressort que la méthode la plus utilisée au
niveau individuelle, est la chloration avec un pourcentage de
réalisation de 59,1% auprès des populations qui traitent leur eau
dans la localité de Ngoa-ékélé. Ceci pourrait
s'expliquer de par le cout réduit et l'accessibilité facile
à ce produit. Toutefois, l'usage fréquent demeure une
interrogation et le respect des
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 45
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
proportions une énigme. Le tableau ci-après
présente la fréquence de traitement de ces eaux par les
consommateurs pratiquant une méthode de traitement quelconque.
Tableau 10 ; Fréquence de traitement des eaux par
les habitants
Fréquence de traitement effectif (en%)
|
Par Jour
|
50,00%
|
|
Fréquence Non déterminée
|
50,00%
|
|
Total
|
100,00%
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
Ce tableau indique que la moitié de la population qui
traite leurs eaux avant usage, le fait à une fréquence non
déterminée, soit de manière anarchique. Ce qui ne
contribue pas réellement à réduire considérablement
les pathogènes présents à long terme et encore moins les
affections hydriques à l'exemple des gastro-entérites. Lors de
l'enquête effectuée auprès des populations, d'aucun ont
mentionné l'existence d'un dispositif de filtre existant au niveau du
point S1 de la source et l'absence de ce dispositif au niveau du point S2. Les
utilisateurs d'eau de puits / propriétaires ont
révélé qu'ils effectuent des désinfections de l'eau
de leurs puits à fréquence irrégulière pour la
plupart par usage du chlore. Le tableau ci -après présente ces
méthodes en pourcentage de réalisation obtenu auprès des
populations.
Tableau 11 ; Méthodes de traitement
employées au niveau des points d'eau
Méthode de traitement Effectif (%)
|
Désinfection chimique
|
28,6%
|
|
Utilisation d'un dispositif de filtration
|
71,4%
|
|
Total
|
100,0%
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-Ekélé à Yaoundé
L'utilisation du dispositif de filtration s'applique à
la source S1 et les procédés de désinfections chimiques au
niveau des puits.
De tout ce qui précède, il en découle que
les points utilisées seraient traités pour certains et pour
d'autres pas, accusant ainsi la forte probabilité de pollution
bactérienne dans
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 46
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
d'autres plus que d'autres en fonction de leur
proximité aux agents polluants également. Le tableau ci-dessous
fait ressortir à nouveau la proportion de germes isolés par
points en précisant s'ils sont traités, qu'importe à
quelle fréquence ou pas.
Tableau 12 ; Germes isolés par source et selon que
l'eau soit traité ou pas
|
|
|
|
|
|
État du point d'eau
|
|
Germes recherchés
|
|
Escherichia coui
|
|
Entérocoques Bactéries
coliformes
|
|
|
|
|
|
|
Source1
|
0/ 100ml
|
1/ 100ml
|
09/ 100ml
|
Eau traitée
|
|
Source2
|
0/ 100ml
|
4/ 100ml
|
20/ 100ml
|
Eau non traitée
|
|
Puit1
|
0/ 100ml
|
150/ 100ml
|
1000/ 100ml
|
Eau traitée
|
|
Puit2
|
0/ 100ml
|
300/ 100ml
|
200/ 100ml
|
Eau non traitée
|
|
Puit3
|
0/ 100ml
|
10/ 100ml
|
1000/ 100ml
|
Eau traitée
|
|
Puit4
|
0/ 100ml
|
100/ 100ml
|
700/ 100ml
|
Eau non traitée
|
|
Puit5
|
0/ 100ml
|
200/ 100ml
|
100/ 100ml
|
Eau non traitée
|
La source1 présente moins de germes relativement aux
autres, cela peut être dû au fait que cette source soit
traitée sur le long terme par le dispositif de filtration
implanté, par contre la source2 n'est pas traitée selon les
informations recueillies dans la communauté. Les puits quant à
eux traités ou pas, présentent plus de germes en leur sein
contrairement aux sources ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'ils sont
moins aménagés que les sources.
À l'ensemble de ces facteurs réunis, les
répercutions les plus visibles sont à l'heure actuelle les
troubles intestinaux que causent ces microorganismes invisibles à l'oeil
nus et mal connus par les habitants de Ngoa-ékélé
présents dans les eaux consommées par ces derniers.
3) IDENTIFICATION DES GERMES BACTÉRIENS
PRÉSENTS DANS LES EAUX DE CONSOMMATION DE
NGOA-ÉKÉLÉ
Après réalisation d'une série d'analyses
des eaux échantillonnées auprès des points connus, les
résultats bactériologiques suivants ont été obtenus
et consignés dans les tableaux ci-après :
Tableau 13 : Récapitulatif des germes
retrouvés dans les points d'échantillonnage des
eaux
Points d'eau Germes isolés des points
d'échantillonnage
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 47
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
|
Sur EMB
|
Sur BEA
|
Sur Kliger
|
|
Puits 1 (P1)
|
Klebsiella oxytoca
|
Entérocoques
|
Souche non identifiable
|
|
Puits 2 (P2)
|
Souche non identifiable
|
Entérocoques
|
Souche non identifiable
|
|
Puits 3 (P3)
|
Klebsiella gr.47
|
Entérocoques
|
Souche non identifiable
|
|
Puits 4 (P4)
|
Klebsiella penumoniae
|
Entérocoques
|
Souche non identifiable
|
|
Puits 5 (P5)
|
Enterobacter aerogenes
|
Entérocoques
|
Souche non identifiable
|
|
Source 1 (S1)
|
Klebsiella gr.47
|
Entérocoques
|
Souche non identifiable
|
|
Source 2 (S2)
|
Enterobacter aerogenes
|
Entérocoques
|
Souche non identifiable
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-ékélé à Yaoundé
Ce tableau indique que les genres bactériens
impliqués dans la contamination des points d'eau de la localité
de Ngoa-ékélé se révèlent être du
genre klebsiella, du genre Enterobacter et du genre
Enterococus. À l'exemple des entérocoques (streptocoques
fécaux) retrouvés dans ces points d'eau, leur présence
pourrait s'expliquer par la présence et la proximité à
chaque point d'eau, de points de pollution tels que les latrines dans
l'environnement. Notons qu'ils sont des marqueurs de contamination d'origine
fécale de même que Escherichia coli non
répertorié ici. Ce qui permet de comprendre à suffisance
pourquoi les entérocoques sont présents pour chaque point d'eau
testé. Pour ce qui est des coliformes, le genre Klebsiella est
présent spécifiquement au niveau des points P1, P3, P4 et S1 et
le genre Entérobacter présent spécifiquement au
niveau des points P5 et S2 vu qu'étant des
entérobactéries, ils ont pu se retrouver via les
excréments libérés dans les latrines à
proximité des points d'eau. Il est important de faire mention que ces
genres appartiennent au même groupe d'entérobactéries avec
des similitudes à l'exception prêt que Klebsiella est
immobile et Enterobacter mobile.
À cela il a été défini une
répartition du dénombrement bactérien qui a
été effectué en comparaison aux normes établies
concernant la qualité d'une eau de consommation. Ce dénombrement
a été consigné dans le tableau ci-après :
Tableau 14 : Récapitulatif du dénombrement
bactérien des eaux de la localité de Ngoa-
ékélé
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 48
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
|
Germes recherchés
|
|
Escherichia coli Entérocoques
Bactéries coliformes
|
|
|
|
Normes
|
0 / 100ml
|
0/ 100ml
|
0/ 100ml
|
|
S1
|
0/ 100ml
|
1/ 100ml
|
09/ 100ml
|
|
S2
|
0/ 100ml
|
4/ 100ml
|
20/ 100ml
|
|
P1
|
0/ 100ml
|
150/ 100ml
|
1000/ 100ml
|
|
P2
|
0/ 100ml
|
300/ 100ml
|
200/ 100ml
|
|
P3
|
0/ 100ml
|
10/ 100ml
|
1000/ 100ml
|
|
P4
|
0/ 100ml
|
100/ 100ml
|
700/ 100ml
|
|
P5
|
0/ 100ml
|
200/ 100ml
|
100/ 100ml
|
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-ékélé à Yaoundé
Il s'avère que les eaux de la localité ne
respectent pas les limites et références établies quant
à la qualité d'une eau de consommation selon l'OMS ou encore
selon le Syndicat des eaux de la Faye, ce qui les rendent impropres à la
consommation humaine avec pour impératifs que des procédés
de traitement soient appliqués afin d'éradiquer de tels
germes.
4) DÉTERMINATION DES PATHOLOGIES CAUSÉES
PAR LES GERMES PRÉSENTS DANS LES AUX DE NGOA-ÉKÉLÉ
SUR LA POPULATION
D'après l'étude réalisée dans la
communauté de Ngoa-Ekele, un certain nombre de maladies a
été relevé chez les individus enquêtés, la
figure ci- après permet d'illustrer ces dernières.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 49
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ

Figure 26 : Principales maladies dont sont victimes les
consommateurs
Source : Enquête sur
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation des
populations de Ngoa-ékélé à Yaoundé
Cette figure indique que les plaintes d'affections
présentes chez la population s'articulent autour de : la Fièvre
typhoïde et paratyphoïde, les Gastro-entérites, la Dysenterie.
Ces maladies-là occupent une très grande proportion parmi les
maladies dont seraient victimes les individus de la localité. Ceci
pourrait s'expliquer par le fait que, les populations en consommant des eaux
contenant des coliformes et entérocoques sans traitement
approprié avant usage seraient en contact direct avec les agents
pathogènes induisant de ce fait des maladies spécifiques à
la consommation d'une eau non potable présentées ci-dessus.
Notons qu'idéalement une recherche de ces bactéries pour chaque
individu serait plus conséquente dans l'interprétation de ces
résultats, néanmoins l'étude aura tenu compte des apports
de nos participants à avis cohérents. Coliformes induisant des
gastroentérites, infections de la peau et dysenterie bacillaire et
Entérocoques induisant des gastroentérites. Puis fièvre
typhoïde et paratyphoïde faisant suite à la présence
des Salmonelles dans ces eaux à une époque / moment remontant
avant notre étude sur le terrain.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 50
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Étude de l'hypothèse de
recherche
Pour étudier la liaison existant entre les facteurs de
pollution et les germes isolés, il nous suffit d'étudier la
liaison qu'il existe entre les germes isolés et le type de source
d'approvisionnement puisque la qualité d'eau d'un point
d'approvisionnement dépend de ces derniers.
Soient les hypothèses suivantes :
H0 : La présence de pathogènes
est conséquente du type de source d'approvisionnement
H1 : La présence de pathogènes
ne dépende pas du type de source d'approvisionnement.
Soit Z la statistique de ce test ;
? ?
j : La jème
modalité de la variable type de germes trouvé
i : La ième
modalité de la variable source de
d'approvisionnement
nij: effectif observé de la
jème germe (en unité par millilitres)
du ième source d'approvisionnement
mij: effectif théorique de la
jème germe (en unité par millilitres)
du ième source d'approvisionnement.
X : la variable germe trouvé
Y : la variable source d'approvisionnement
Z suit la loi de khi-deux à á=5% (niveau de
confiance 95%) et à 5 degré de liberté
Si X et Y sont
indépendantes (rejette de H0), alors
On a selon la loi de khi-deux. Déterminons maintenant la
valeur de Z
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Effectifs observés ( par millilitres) Effectifs
théoriques (s'ils
étaient indépendantes)
Total
|
S1 ou
S2
|
5
|
29
|
34
|
|
P1
|
150
|
1000
|
1150
|
|
P2
|
300
|
200
|
500
|
|
P3
|
10
|
1000
|
1010
|
|
P4
|
100
|
700
|
800
|
|
P5
|
200
|
100
|
300
|
|
Total
|
765
|
3029
|
3794
|
Germe
point
|
Source
(1 ou
2)
|
26010
|
102986
|
|
Puit1
|
879750
|
3483350
|
|
Puit2
|
382500
|
1514500
|
|
Puit3
|
772650
|
3059290
|
|
Puit4
|
612000
|
2423200
|
|
Puit5
|
229500
|
908700
|

Entérocoques Bactéries
coliformes
= 14386849,31
Alors avec un risque de 5% de se tromper, on accepte
l'hypothèse qu'il y a une liaison entre les germes isolés et le
type de source, et par conséquence, il y a une forte liaison entre les
germes retrouvés au niveau de chaque point d'échantillonnage et
les facteurs de pollution qui les avoisinent.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 51
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 52
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
5) DISCUSSION
À la suite de tout ce qui précède, il est
à noter que la caractérisation de notre population a permis de
relever la prédominance des étudiants avec la tranche d'âge
la plus représentée étant celle de 18 à 24ans ,
ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'à la base cette localité
est réputée pour sa population étudiante plus que tout
autre chose compte tenue de la présence des plusieurs institutions
universitaires dans les environs avec les âges royalement
représentés avoisinant 18 à 24ans pour ce qui est des
étudiants. Cette caractérisation aura également permis de
relayer la prédominance du sexe masculin dans notre population, ce qui
s'expliquerait par la poursuite habituelle des grandes études par les
individus masculins que ceux du sexe féminin. Par ailleurs, la
caractérisation de points d'eau de la localité, points
d'échantillonnage pour la réalisation de notre évaluation
bactériologique aura permis de faire mention du fait que, les points les
plus utilisés dans cette localité seraient les sources pour usage
diverses suivis des puits. Le sens de cette utilisation viendrait de la
facilité d'accès aux sources et la mise à
disponibilité en tout temps, toute heure sans forme de restriction pour
n'importe quel individu. Aussi, elle viendrait du fait que le plus grand nombre
des consommateurs décèlent en ces eaux de sources « natures
» plus de potabilité que les eaux provenant des puits.
Par la suite de nombreux facteurs pouvant justifier
l'existence du profil établit précédemment ont pu
transparaitre notamment, de la présence des latrines, rigoles,
dépotoirs, champs, eaux stagnantes etc... à proximité des
points d'eau disponibles au sein de la localité. Notons que le facteur
à prédominance dans le volet environnemental est la
présence des latrines avec un pourcentage de répartition dans la
localité défini à 26%, suivit de la présence des
rigoles avec 24% ou les excréments de ces latrines sont
déversés pour la grande majorité. Cette survenue à
prédominance des latrines prend tout son sens en comparaison à
l'étude de (Mpakam et al., s. d.) portant sur l'étude des
facteurs de pollution des ressources en eau en milieu urbain : cas de Bafoussam
(Ouest-Cameroun) qui permet de soutendre l'idée selon laquelle, la
contamination est influencée par le degré d'aménagement et
la distance qui les sépare des latrines et en gros, la distance
séparant les points de pollution présents dans un environnement
de même que les points d'eau. À ces facteurs environnementaux,
l'étude aura permis de relayer le soucis du non traitement des eaux par
les populations avant usage, que ce soit depuis le site ou individuellement,
ceci compte tenu du fait que 62% de la population ne traite pas leur eau. Cet
élément transparait ici comme un potentiel facteur justifiant /
pouvant permettre d'expliquer l'existence et le maintien d'un tel profil.
Notons que parmi les 38% de la population traitant leur eau dans la population,
la moitié effectue ce traitement à des fréquences non
déterminables voir discontinues réduisant de ce fait les effets
souhaités quant
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 53
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
à l'usage du traitement des eaux. Ceci pourrait
s'expliquer par faute de connaissances ou de moyens financiers des habitants de
cette localité qui sont pour la majorité de simples
étudiants à revenus pratiquement inexistants.
Les analyses en laboratoire ont permis de déterminer le
profil bactériologique des eaux de consommation de cette
localité, avec la présence des coliformes et entérocoques
dans 100ml d'eau filtré pour chaque échantillon, avec leurs
présences justifiées par le fait qu'il s'agisse de germes de
contamination fécale qui, découleraient probablement de la
présence des facteurs de pollution énumérés plus
haut à l'instar des latrines. Il est à noter que les genres
bactériens isolés dans ces eaux pour ce qui est des coliformes
sont : le genre klebiella avec 67% et le genre Enterobacter
avec 33% de représentation lors des isolements et identifications
réalisées. Concernant les entérocoques, répartition
après isolement à 100% car présents dans chaque
échantillon testé. De par les résultats obtenus
après les analyses effectuées sur les eaux il ressort que les
paramètres bactériologiques recherchés durant cette
étude présentent une non-conformité relative aux valeurs
indicatives des normes de potabilité établies par le syndicat des
eaux de la Faye et des normes internationales de l'OMS. Ces résultats
des analyses bactériologiques ont montré que les eaux de puits
étaient toutes contaminées par la plupart des germes
recherchés, de même que l'a démontré (Soncy et al.,
2015) dans l'évaluation de la qualité bactériologique des
eaux de puits et forage à Lomé, Togo. Elles sont fortement
contaminées par les germes de contamination fécale. La
contamination des eaux de la localité, suite à un
dénombrement sur filtration membranaire a induit 100% de
non-conformité soit aucun point ne présentant des valeurs en
dessous de celles fixées par les critères d'évaluation
permettant de statuer sur la potabilité d'une eau de consommation.
À la suite de ce profil bactériologique
établi pour ce qui est des eaux de consommations de la localité
de Ngoa-ékélé puis des facteurs justifiant ce profil qui
ont pu être ressortis, relayons que la survenue de maladies hydriques sur
la population s'est faite marquée lors de nos enquêtes suites aux
informations et peintes des participants consommateurs avec comme indications
générales que la fièvre typhoïde et paratyphoïde
sévit à 48,39% dans la population, les gastro-entérites et
la dysenterie à part égale, soit 22,58% chacune , et les
infections de la peau à 6,45%.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 54
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
CONCLUSION GENERALE
Parvenus au terme de ce travail ayant porté sur «
l'évaluation bactériologique des eaux de consommation de la
localité de Ngoa-ékélé à Yaoundé
» avec pour objectif principal de contribuer à la réduction
des maladies hydriques au sein de la localité, il en ressort que
nombreux facteurs de pollution des eaux existent au sein de celle-ci, notamment
ceux liés à l'environnement d'une part notamment la
proximité des latrines, rigoles et dépotoirs par rapport aux
points d'approvisionnement en eaux et d'autre par l'inaction de l'Homme en ce
qui concerne le traitement de ces eaux avant usage collectif ou individuel. De
ces nombreux facteurs et suite aux analyses effectuées, un profil
bactérien de ces eaux de consommation a pu être établi,
c'est ainsi qu'il comprend des coliformes du genre Klebsiella et du
genre Enterobacter, des entérocoques avec absence
marquée d'Escherichia coui. Toutefois, un tel profil indique
que les eaux de cette localité sur le plan qualité, ne respectent
pas les normes établies en rapport aux eaux de consommation qui,
impliquent l'absence des entérocoques et des coliformes dans 100ml d'eau
filtrée au préalable. En droite ligne existentielle de ce profil,
en ressort diverses maladies hydriques survenant à prédominance
dans la localité et dont sont victimes les consommateurs, notamment: la
fièvre typhoïde et paratyphoïde, les gastroentérites,
la dysenterie et des infections de la peau. Suite à tout cela et de part
certains tests spécifiques, l'hypothèse de recherche
établie a pu être validée, indiquant ainsi que les eaux de
la localité de Ngoa-ékélé regorgent des
pathogènes bactériens résultant de la présence d'un
ensemble des facteurs de pollution développés dans le travail,
qui partagent l'environnement avec les points d'eau. Les eaux examinées
dans la localité de Ngoa-ékélé sont de
qualité impropre pour les paramètres bactériologiques
étudiés, du fait de la présence d'une pléthore de
facteurs induisant ou justifiant l'existant et/ou le maintien du profil
bactériologique établie. Ceci dit, leurs consommations
présentent de sérieux risques pour la santé humaine,
induisant la survenue de diverses maladies dans la population consommatrice.
Face à toutes ces observations, de nombreux problèmes ont pu
transparaitre et des suggestions dans l'optique d'améliorer, rectifier
ou éradiquer leurs survenus ont été soumises pour
appréciation et / ou amélioration afin de pouvoir contribuer
efficacement à la réduction des maladies hydriques au sein de
Ngoa-ékélé à Yaoundé.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 55
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES
Tableau 15 : Récapitulatif des problèmes
répertoriés concernant les eaux Ngoa-ékélé
et
suggestions proposées
Problème Suggestions Cibles
|
L'existence et la proximité des foyers de
pollution par rapport aux points d'approvisionnement en eaux de la
localité
|
Effectuer la sensibilisation et l'éducation de la
population sur les dangers et répercutions de la consommation d'une eau
non potable
|
Les autorités - les organismes de santé
communautaire - les éducateurs
|
|
Mettre sur pieds des mesures d'action d'hygiène
communautaire régulières
|
Les populations
|
|
Construction des latrines à distance
réglementaire des points d'eaux
|
Les populations
|
|
Évacuation des excréments par des services
spécialisés et non dans les rigoles
|
Les populations
|
|
Le non traitement des eaux avant usage collectif ou
individuel
|
Effectuer la sensibilisation et l'éducation de la
population sur les bienfaits du traitement des eaux avant usage
|
Les autorités - les organismes de santé
communautaire - les éducateurs
|
|
Effectuer des formations sur le traitement / désinfection
des eaux de manières simples, efficaces et accessibles à tous
|
Les organismes de santé communautaire - les
éducateurs
|
|
Effectuer des dons au sein de la communauté
|
Les autorités
|
|
La présence d'un profil
bactérien
|
Effectuer la désinfection des eaux depuis les points
|
Les autorités - les populations
|
|
Effectuer des contrôles qualités
régulièrement
|
Les autorités - les éducateurs
|
|
Les maladies recensées
|
Se faire dépister et suivre un bon traitement
|
Les populations
|
|
Bonne hygiène de l'eau à consommer
|
Les populations
|
Comme perspectives, nous tenons à confronter les
résultats obtenus à ceux d'une étude similaire au sein de
la localité, qui userait d'une autre méthode et à
étendre cette recherche à l'étendu de la ville de
Yaoundé puis toutes les villes du Cameroun.
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page 59
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
REFERENCES
05_traitement_eau_boisson_urgence.pdf. (s. d.).
Consulté 21 avril 2021, à l'adresse
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/05_traitement_eau_boisson_urgence.p
df?ua=1
Attig, I., & Bernou, A. (2020). Evaluation des
propriétés physico-chimiques et bactériologiques des eaux
de consommation de la ville de Bouira.
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/11135
Canada, E. et C. climatique. (2007, janvier 9). Sources d'eau
[Recherche]. aem.
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/eau-apercu/sources.html
Denis, F., Bingen, E., Martin, C., Ploy, M.-C., & QUENTIN, R.
(2012). Bactériologie médicale. Elsevier Masson.
Hartemann, P. (2013). Eau de consommation, risque, santé.
Sciences Eaux Territoires, Numéro 10(1), 14?21.
L'analyse de l'eau--10e éd. - Jean Rodier,Bernard
Legube,Nicole Merlet. (s. d.). Consulté 21 avril 2021, à
l'adresse
https://www.decitre.fr/ebooks/l-analyse-de-l-eau-10e-ed-9782100756780_9782100756780_9.html
Mpakam, H. G., Kenmogne, G. R. K., Tatiétsé, T. T.,
Maire, E., Boeglin, J., & Ekodeck, G. E. (s. d.). Étude des
facteurs de pollution des ressources en eau en milieu urbain: Cas de Bafoussam
(Ouest-Cameroun). 27.
OMS | Directives de qualité pour l'eau de boisson:
Quatrième édition intégrant le premier additif. (s.
d.). Consulté 13 avril 2021, à l'adresse
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/drinking-water-quality-guidelines-4-including-1st-addendum/fr/
Soncy, K., Djeri, B., Anani, K., Eklou-Lawson, M., Adjrah, Y.,
Karou, D. S., Ameyapoh, Y., & Souza, C. de. (2015). Évaluation de la
qualité bactériologique des eaux de puits et de forage à
Lomé, Togo. Journal of Applied Biosciences, 91,
8464-8469-8464?8469.
https://doi.org/10.4314/jab.v91i1.6
Syndicat de la Faye--Qualité de l'eau > Normes de
l'eau. (s. d.). Consulté 13 avril 2021, à l'adresse
http://siaep.faye.free.fr/qualite_de_leau/normes_de_leau/normes_de_leau.html
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page I
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
ANNEXES
Annexe 1 : CLAIRENCE ÉTHIQUE

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page II
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Annexe 2 : autorisation de recherche du
sous-préfet de Yaoundé 3

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page III
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Annexe 3 : Notice d'information
INVITATION À PARTICIPER AU PROJET DE
RECHERCHE PORTANT SUR L'EVALUATION BACTERIOLOGIQUE DES EAUX DE CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGO EKELE A YAOUNDE
Mme, Mlle, M.
Cette recherche pour laquelle votre participation est
sollicitée porte sur l'évaluation physico-bactériologique
des eaux de consommation (sources, forages, pompes, rivières, puits) du
quartier à Yaoundé. Elle vise à déterminer le
profil bactériologique des eaux de consommation dans le quartier de Ngoa
Ekélé à Yaoundé.
Un profil bactériologique qualifie un ensemble
d'éléments bactériens se retrouvant dans un milieu
quelconque.
Objectifs
Les objectifs de ce projet de recherche sont de :
Établir le profil bactériologique des eaux
consommées par les populations de Ngoa Ekélé. Pouvoir
identifier en définissant à quelle proportion, les
bactéries présentes dans les eaux de consommation de la
localité et déterminer les facteurs favorisant la présence
de ces derniers puis les pathologies causées par ces eaux dans la
population.
Les renseignements donnés dans cette notice
d'information visent à vous aider à comprendre exactement ce
qu'implique votre éventuelle participation à la recherche et
à prendre une décision éclairée à ce sujet.
Nous vous demandons donc de lire le formulaire de consentement attentivement et
de poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez prendre tout le
temps dont vous avez besoin avant de prendre votre décision.
Tâche
Votre participation à ce projet de recherche consiste
à remplir un questionnaire et à créer une
disponibilité pour la collecte de leurs eaux de consommation.
Risques, inconvénients, inconforts
Risques de refus liés aux comportements sociaux :
Inconforts
Bénéfices
Le bénéfice direct que vous pourrez tirer de la
participation à cette recherche est de savoir si vous êtes victime
d'une contamination liée à l'utilisation de votre eau
Confidentialité
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page IV
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Les données recueillies par cette étude sont
soumis à l'exigence de confidentialité. Les résultats de
la recherche, qui pourront être diffusés sous forme
d'articles, de rapport de recherche ou de communications à des
congrès scientifiques, ne permettront pas de vous identifier.
Les données recueillies seront conservées sur
support de communication (numérique et imprimé) et
conservées sur support numériques sécurisés. Aucun
nom ne sera porté, seul des numéros seront attribués aux
différents échantillons
Les données seront détruites après la
publication finale du rapport de recherche et des articles; elles ne seront pas
utilisées à d'autres fins que celles décrites dans le
présent document. Participation volontaire
Votre participation à cette étude se fait sur
une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de participer ou
non et de vous retirer en tout temps sans préjudice et sans avoir
à fournir d'explications.
Responsable de la recherche
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute
question concernant ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec
TCHAMDA TAYO Laurel Kévine par courriel à l'adresse suivante"
laureltchamda@gmail.com"ou
au téléphone "691533656"
Question ou plainte concernant l'éthique de la
recherche
Cette recherche est approuvée par le comité
d'éthique de la recherche l'École des Sciences de la Santé
de l'Université Catholique d'Afrique Centrale. Un certificat de
conformité éthique portant le numéro (n*****) a
été émis le (******)
Pour toute question ou plainte d'ordre éthique concernant
cette recherche, vous devez communiquer avec le secrétaire permanent du
comité d'éthique de l'École des Sciences de la
Santé, par téléphone au numéro ********* ou par
courrier électronique***********. Université Catholique d'Afrique
Centrale (UCAC)
École des Sciences de la Santé (ESS)
BP 1110 Yaoundé - Cameroun /
www.ess-ucac.org
contact@ess-ucac.org Tel :
237 242 096 991
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page V
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Annexe 4 : Formulaire de consentement
éclairé
Engagement du chercheur
Moi, TCHAMDA TAYO Laurel Kévine m'engage à
procéder à cette étude conformément à toutes
les normes éthiques qui s'appliquent aux projets comportant la
participation de sujets humains.
Consentement du participant
Je soussigné, , confirme avoir lu et compris la
notice
d'information au sujet du projet «L'évaluation
bactériologique des eaux de consommation des populations de Ngoa
Ekélé» J'ai bien saisi les conditions, les risques et les
bienfaits éventuels de ma participation. On a répondu à
toutes mes questions à mon entière satisfaction. J'ai
disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à
ma décision de participer ou non à cette recherche. Je comprends
que ma participation est entièrement volontaire et que je peux
décider de me retirer en tout temps, sans aucun préjudice.
J'accepte donc librement de participer à ce projet de
recherche
Date et Signature du participant :
Contact du chercheur
Courriel :
laureltchamda@gmail.com
Téléphone : 691533656
Date et Signature du chercheur :
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Annexe 5 : Questionnaire
ETUDE SUR L'ÉVALUATION
BACTÉRIOLOGIQUE
POPULATIONS DE NGO-ÉKÉLÉ
À YAOUNDÉ
DES EAUX DE CONSOMMATION DES
DISPOSITIONS DE CONFIDENTIALITE
QUESTIONNAIRE
Les informations collectées au cours de cette
enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N°91/023
du 16
décembre 1991 sur les recensements et
enquêtes statistiques qui stipule en son article 5 que
« les renseignements individuels
|
S0Q1
|
d'ordre économique ou financier figurant sur tout
questionnaire d'enquête statistique ne peuvent en aucun cas être
utilisés à
des fins de contrôle ou de répression
économique ».
|
|
|
S0Q2
|
Localité:
|
|
|
|
SECTION 0 :
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Endroit exact:
|
|__|__|
|
|
Numéro du questionnaire
|
|
Sexe :
1=Homme ; 2=Femme
|
|
|
S0Q3
S0Q5
|
Âge
|
|
|
S0Q4
|
|
|__|
|
|__|__|
Catégorie socio -
professionnelle
|
S0Q6
|
1= Employé/ouvrier qualifié ; 2=
Compte propre
3= Chômeur ; 4= Étudiant(e)
__________________________________
SECTION 1 : CONNAISSANCE
SUR L'UTILISATION DES EAUX
Autres (à préciser)
|
|__|
|____|
|
|
Source d'approvisionnement (les deux les plus
utilisées) en eau :
|
|
S1Q1
|
S1= Source1 ; S2= Source2 ; P1=
Puit1 ;
P 2= Puit2 ; P3= Puit3 ; P4=
Puit4 ;
P5= Puit5 ;
|
|____|
|
|
S1Q3
|
À quelle fin utilisez-vous cette
eau ?
1= Usage corporelle ; 2= Consommation
buccale ;
|
|
|
S1Q2
|
3= Usage domestique ;
4= Autres (à préciser)
|
|__|
|
S1Q4
Y'a-t-il des sources de pollution à
proximité ?
1= Oui
2= Non (si non aller à
S1Q5)
|__|
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page VI
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
|
1Q41
|
Si oui, lesquelles (vous pouvez sélectionner
plusieurs) ? Eaux stagnantes ;
Latrines ;
Dépotoir 1= Oui
Champ ; 2= Non
Industrie ;
Rigole ;
Points de lessive et vaisselle ;
Autres (à préciser)
|
|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|
|
|
|
S1Q5
|
Êtes-vous habituellement sujets aux maladies
suivantes (vous pouvez sélectionner plusieurs) ?
Gastro-entérites
Fièvre typhoïde et paratyphoïde
Cholera 1= Oui
Dysenterie 2= Non
Shigellose 3= Refus
TIAC
Infections de la peau Autres (à préciser)
|
|
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
|
|
|
|
S1Q6
|
L'eau du point d'approvisionnement est-elle souvent
traitée ? 1= oui ; 2= Non (si non aller à S1Q8)
; 3=Ne sais pas (si ne sais pas aller à
S1Q8)
|
|
|__|
|
|
|
S1Q61
|
Si oui, quel est le moyen est utilisé pour cela
au niveau du point même (Les deux les plus utilisés) ?
1= Désinfection chimique ; 2= Utilisation d'un dispositif
de filtration ; 3= Autres (à préciser)
|
|__|
|__|
|
|
|
S1Q62
|
Quelle est la fréquence de ce traitement au niveau
du point ? 1= Semaine ; 2= mois ; 3= année ; 4= ne sais pas
|
|__|
|
|
S1Q7
|
A votre niveau ou de manière personnelle,
traitez-vous habituellement l'eau depuis chez vous ?
1= Oui 2= Non (si non fin du questionnaire)
|
|__|
|
|
S1Q71
|
Si oui, quel est le moyen que vous utilisez pour le
traitement de
cette eau ? (Les deux les plus
utilisés)
1= Ébullition ; 2= chloration ; 3= Aération
4= Rayons UV ; 5= Filtration aux chandelles de
céramique
6= Autres (à préciser)
|
|__|
|__|
|
|
S1Q72
|
Quelle est la fréquence de ce traitement
?
1= Par Jour ; 3=Par Semaine ; 3= Fréquence Non
déterminée
|
|__|
|
NOM, SIGNATURE ET DATE DE L'ENQUETÉ
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page VII
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page VIII
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Annexe 6 : Généralités sur les
milieux de culture utilisés
|
Milieu de culture
|
Principe
|
Usage
|
Aspect après usage
|
|
Gélose EMB
|
Le principe repose sur l'aptitude des
entérobactéries à fermenter ou non le lactose et/ou le
saccharose. Le milieu est rendu inhibiteur vis-à-vis des autres
bactéries par l'éosine et le bleu de méthylène.
|
Isolement et dénombrement des
entérobactéries (Escherichia coui)
|
Présence de colonies rondes, de couleur rose à
rouge et muqueuses.
|
|
Gélose BEA
|
La présence d'azoture de sodium inhibe les
bactéries Gram-et de la bile de boeuf inhibe les bactéries Gram+,
à l'exception des streptocoques du groupe D. Cette
différenciation est basée sur leur capacité à
hydrolyser l'esculine qui occasionne le virage du milieu au noir.
|
Isolement et identification des entérocoques et
streptocoques du groupe D
|
Présence de colonies noires à bords
éclaircis faisant virer le milieu en noir
|
|
Eau peptonnéé
|
La tryptone apporte le carbone, l'azote, lez vitamines et les
minéraux nécessaires à la croissance des bactéries.
Le chlorure de sodium maintient la balance osmotique du milieu.
|
Pré-enrichissement en vue de la recherche des salmonelles
dans les aliments.
|
Trouble du milieu
|
|
Bouillon sélénite
|
La sélectivité de ce milieu vis-à-vis des
salmonelles est basée sur la présence du sélénite
qui inhibe les
|
Enrichissement sélectif en vue de la recherche des
salmonelles.
|
Trouble du milieu avec changement de coloration tirant à
l'orangé
|
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page IX
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
|
bactéries Gram + et la part desz germes fécaux Gram
- à l'exception de ces derniers.
|
|
|
|
Gélose hektoen
|
La sélectivité de ce milieu est
|
Isolement des
|
Présence de
|
|
basée sur la présence de sels biliaires, de BBT et
de fuschine acide qui inhibe les bactéries gram +, E coli dans une
moindre mesure, les proteus et les campylobactères. La
différenciation des entérobactéries est basée sur
leur capacité à fermenter différents sucres :le lactose,
le saccharose et la salicine. Une différenciation
supplémentaire reposant sur la production
d'hydrogène sulfuré est possible grâce à la
présence de thiosulfate et de citrate de fer. Elle se traduit par des
colonies à centre noir.
|
Salomonelles et Shigelles
|
colonies rondes, de petite taille et de couleur orangée
|
|
Gélose Kliger
|
Il s'applique sur l'aptitude
|
Identification des
|
Fragmentation de
|
|
des entérobactéries à
fermenter ou non le lactose et le glucose avec ou sans production
de gaz ou de sulfure d'hydrogène.
|
salmonelles
|
la gélose, virement de couleur au jaune du culot et/ou de
la pente, possible points noirs dans la gélose.
|
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page X
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Annexe 7 : Principe coloration de gram

Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page XI
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
Annexe 8 : Informations sur la galerie api 20e
PRÉSENTATION
API 20E est un système d'identification
standardisé pour l'identification des Enterobacteriaceae et autres
bacilles à Gram négatif non fastidieux, comportant 21 tests
biochimiques miniaturisés, ainsi qu'une base de données. Le
coffret de 25 tests comprend : 25 galeries API 20E, 25 boites
d'incubation, 25 fiches de résultats, 1 barrette de fermeture et 1
notice.
PRINCIPE
Le système API® BioMérieux (Appareillage et
Procédé d'Identification) est une version miniaturisée et
standardisée des techniques biochimiques conventionnelles pour
l'identification des bactéries. Lorsqu'une suspension bactérienne
de densité convenable est répartie dans les différentes
alvéoles qui composent la micro galerie (contenant de substrats
déshydratés), les métabolites produits durant la
période d'incubation se traduisent par des changements de couleur
spontanés ou révélés par addition de
réactifs. Elle permet l'identification d'une centaine de bacilles
à Gram négatif dont les Entérobactéries. Elle
comprend 20 tests biochimiques. La lecture se fait suivant un tableau de
lecture et l'identification obtenue par, un catalogue analytique ou un logiciel
d'identification.
LECTURE ET EXPRESSION DES RÉSULTATS
D'IDENTIFICATION
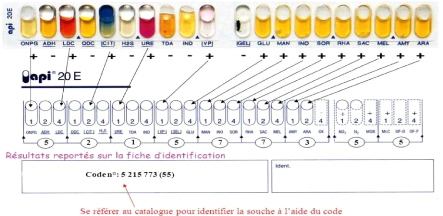
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page XII
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES ABRÉVIATIONS iv
LISTE DES TABLEAUX vi
LISTE DES FIGURES vii
LISTE DES ANNEXES viii
RESUME ix
ABSTRACT x
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE 2
1. CONTEXTE DE L'ETUDE 2
2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU THEME 2
3. PROBLEMATIQUE PROPREMENT DITE 3
4. QUESTIONS, HYPOTHESE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 5
a) QUESTIONS DE RECHERCHE 5
Question générale 5
b) HYPOTHESE DE RECHERCHE 5
c) OBJECTIFS DE RECHERCHE 5
CHAPITRE II : REVUE DE LA LITTERATURE 6
I. DEFINITIONS DES CONCEPTS 6
II. GÉNÉRALITES SUR L'EAU 7
1. LE CYCLE DE L'EAU 7
2. LES TYPES D'EAU 7
3. POLLUTION DE L'EAU 8
4. MALADIES ASSOCIÉES À LA CONSOMMATION D'UNE EAU
NON
POTABLE DU POINT DE VUE BACTERIOLOGIQUE 9
5. PROCEDES DE TRAITEMENT DES EAUX 10
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page XIII
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
III. NORMES DE POTABILITE BACTÉRIOLOGIQUE SUR LES EAUX
DE
CONSOMMATION 11
PROFIL BACTERIOLOGIQUE 12
IV. METHODES DIAGNOSTIQUES POUR L'ANALYSE BACTERIOLOGIQUE DE
L'EAU 16
1. METHODES DE DENOMBREMENT DIRECT 17
2. METHIODES DE DENOMBREMENT INDIRECT 17
CHAPITRE III : METHODOLOGIE 18
1. PRÉSENTATION DU LIEU D'ÉTUDE 18
2. TYPE D'ETUDE 18
3. LES PARTICIPANTS 19
3.1 Technique d'échantillonnage ou de recrutement / Nombre
de participants requis ou
souhaités 19
3.2 Critères de sélection des participants 19
3.3 Modalités de recrutement 19
4. PROCEDURE DE COLLECTE DES ECHANTILLONS 20
a. TECHNIQUE DE PRELEVEMENT GLOBALE 20
b. PRELEVEMENT PROPREMENT DIT AU NIVEAU DES SOURCES 20
c. PRELEVEMENT PROPREMENT DIT AU NIVEAU DES PUITS 21
5. PROCEDURE D'ANALYSE DES ECHANTILLONS 23
a. PRESENTATION DU MATERIEL ET CONSOMMABLES, DES REACTIFS ET
DES EQUIPEMENTS UTLISÉS POUR L'ANALYSE 23
b. MÉTHODE D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS : LA
FILTRATION SUR
MEMBRANE 24
c. ALGORITHMES DE RECHERCHE DES COLIFORMES, DES
ENTEROCOQUES ET DES SALMONELLES 27
d. MODE OPÉRATOIRE DE L'ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE
DES
ÉCHANTLLONS 28
e. ASSURANCE QUALITE POUR L'ANALYSE DE NOS ECHANTILLONS 37
f. GESTION DES DECHETS 37
g. LIMITES DE L'ANALYSE ET ALTERNATIVES PROPOSEES 37
6. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET CONSIDÉRATION
ÉTHIQUES 38
7. TRAITEMENT DES DONNEES ET PRESENTATION DES RESULTATS 38
8. DIFFICULTES RENCONTREES 38
9. LIMITES DE L'ETUDE 39
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION 40
Mémoire rédigé par TCHAMDA TAYO
Laurel Kévine, TMS Page XIV
ÉVALUATION BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE
CONSOMMATION DES
POPULATIONS DE NGOA-ÉKÉLÉ À
YAOUNDÉ
1) PRÉSENTATION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DE LA
POPULATION ET DES
POINTS D'ÉCHANTILLONAGE 40
2) ILLUSTRATION DES FACTEURS FAVORISANT LA PRÉSENCE
DE
BACTÉRIES DANS LES EAUX DE
NGOA-ÉKÉLÉ 42
3) IDENTIFICATION DES GERMES BACTÉRIENS
PRÉSENTS DANS LES EAUX
DE CONSOMMATION DE NGOA-ÉKÉLÉ 46
4) DÉTERMINATION DES PATHOLOGIES CAUSÉES PAR
LES GERMES
PRÉSENTS DANS LES AUX DE
NGOA-ÉKÉLÉ SUR LA POPULATION 48
5) DISCUSSION 52
CONCLUSION GENERALE 54
SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 55
REFERENCES 59
ANNEXES I
TABLE DES MATIERES XII



