
Mémoire recherche
Master 2 Economie Théorique et Appliquée
du
Développement Durable
Ressources non renouvelables et
développement
soutenable : L'or du Burkina est-il vraiment
une
bénédiction ?
Par Razamwendé Saturnin SAWADOGO Dirigé par :
A. AKNIN, V.GERONIMI
Septembre 2015
2
A mon père et à ma
mère,
A ma patrie, le Burkina Faso !
A la conquête de la liberté et du
progrès !
3
Remerciements
Du fond du coeur,
Je remercie mon professeur et encadreur : Mme A. AKNIN, pour le
thème et l'encadrement et les nombreuses observations ;
Je remercie mon professeur et encadreur : Mr V. GERONIMI, pour la
correction, les conseils et le soutien;
Mes remerciements vont également à :
Ma
compagne, Myriam Legrand, pour la correction et les critiques.
Abraham
SAWADOGO pour son soutien moral et matériel
Hajar DAOUDI pour le
soutien moral et la correction
Richard BITIE pour la lecture et la
correction
Merci à tous !
4
Sommaire
Liste des sigles et acronymes 6
Résumé 7
Introduction 8
Chapitre I : Entre bénédiction et
malédiction des ressources naturelles : littérature
théorique et empirique 10
I. Les ressources naturelles facteurs de croissance
10
1. La théorie des avantages comparatifs
11
2. Le « Big push » par les ressources
naturelles 11
II. La malédiction des ressources naturelles :
Littérature théorique et empirique. 12
1. Evidences empiriques 12
2. Théories explicatives 13
a) L'évolution à long termes des prix
mondiaux. 13
b) La volatilité des prix des matières
premières 14
c) L'éviction permanente du secteur manufacturier
14
d) La mauvaise qualité institutionnelle
16
III. Développement soutenable et
malédiction des ressources naturelles 19
1. Le développement soutenable et la
malédiction des ressources naturelles 19
2. Soutenabilité forte ou faible 20
3. La règle de Solow-Hartwick 21
Conclusion 22
Chapitre II : Spécialisation primaire et
développement soutenable au Burkina Faso 23
Introduction 23
I. Généralité sur le Burkina Faso
23
1. Evolution récente des indicateurs de
développement socio-économiques du
Burkina Faso 24
a) La croissance économique au Burkina Faso
24
b) Les sources de la croissance au Burkina Faso
26
c) Les inégalités et la pauvreté au
Burkina Faso 28
2. De la stabilité politique au Burkina Faso
29
II. Du boom minier au Burkina Faso 29
1. Développement du secteur minier 30
2. Cadre réglementaire et institutionnel
31
3. Les potentialités et les facteurs explicatifs
du boom minier 32
a) Les facteurs explicatifs du boom minier au Burkina
Faso 32
5
b) Les potentialités du secteur minier
burkinabè 34
III. Contribution, vulnérabilité et risques
36
1. Contribution du secteur minier à
l'économie burkinabè 36
2. Contribution du secteur au développement local
38
3. Vulnérabilité et risques de
malédiction 39
Conclusion 44
Chapitre III : De la soutenabilité du secteur
minier burkinabè 46
Introduction 46
I. A là quête d'un indicateur de
développement soutenable 47
1. De l'IDH à la mesure du capital humain
47
2. L'épargne nette ajustée 48
3. La Formation Brute de Capital Fixe 49
II. Du choix de la non pondération du capital
physique et du capital humain 50
III. Burkina Faso et l'hypothèse d'un changement de
régime d'accumulation de
capital physique et humain 51
1. Evaluation du capital humain 51
a) L'espérance de vie au Burkina Faso
51
b) Taux de scolarisation au primaire 53
c) De l'accumulation du capital humain au Burkina Faso
55
2. De l'accumulation du capital physique au Burkina Faso
55
Conclusion 58
Bibliographie 59
6
Liste des sigles et acronymes
BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux
BNAF Brigade Nationale Anti-Fraude de l'or
BUMIGEB Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina
CDEAO Communauté économique des États
d'Afrique de l'Ouest
EVI Economic Vulnerability Index
FMI Fonds Monétaire International
IDE Investissements Directe Etrangers
IDH Indice De Développement Humain
IMFPIC Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions
Industrielles et
Commerciales
IRVM Impôt sur les Revenus des Valeurs
Mobilières
ITS Inspection Technique des Services
LBM London Bullion Market
SEMAFO Société Exploitation Minière en
Afrique de l'Ouest
TBM Taxe des Biens de Mainmorte
TPA Taxe Patronale et d'Apprentissage
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
7
Résumé
La malédiction des ressources naturelles autorise
à s'inquiéter sur l'avenir d'un pays, dès lors que
l'exploitation d'une ressource naturelle connait un boom substantiel. C'est le
cas du Burkina Faso depuis 2009 avec l'exploitation de l'or. Pour
vérifier que l'or du Burkina Faso est une bénédiction,
nous analysons graphiquement la dynamique d'accumulation des différents
capitaux avant et après le boom minier, et constatons que si le Burkina
Faso est passé d'un régime d'accumulation de capital physique
relativement faible a un niveau plus élevé après le Boom
minier, ceci n'est pas le cas au niveau du capital humain qui quant à
lui présente un nouveau régime plus bas. Pour conjurer la
malédiction des ressources naturelles dans ce pays, une attention
particulière doit être accordée à l'accumulation du
capital humain afin que les générations présentes et
futures puissent garder au moins un niveau de bien être constant.
Mots clés : malédiction des
ressources naturelles, développement soutenable,
Burkina Faso.
8
Introduction
Depuis 2009, l'exploitation de l'or a connu une expansion
considérable au Burkina Faso. L'or s'est hissé au rang de premier
produit d'exportation et a fortement impacté la structure de la balance
commerciale et des revenus de l'Etat. Entre 2006 et 2010, la production
aurifère du Burkina a été multipliée par 8. Faisant
de ce pays le 3e producteur d'or d'Afrique de l'Ouest.
Les potentialités du secteur aurifère justifient
de nos jours un grand optimisme affiché par les politiques et un grand
espoir pour le peuple burkinabè qui y voit de belles perspectives pour
l'amélioration de ses conditions de vie et le garant d'un avenir radieux
pour les générations futures. L'augmentation des dépenses
d'explorations minières et les modifications du code minier pour
augmenter l'attrait d'investissement étranger dans ce pays
témoignent de cet optimisme. Ainsi en 2012, plus d'un tiers des projets
d'explorations ou de forage prospectif opéré par des
sociétés minières étrangères en Afrique de
l'ouest ont eu lieu au Burkina Faso.
La théorie économique quant à elle, voit
dans les ressources naturelles une opportunité pouvant être
à la base d'un «big push » pour le décollage
économique mais également le risque d'une malédiction
pouvant compromettre l'avenir des générations futures. En effet,
les ressources naturelles constituent une importante source de revenu pouvant
financer une bonne partie des investissements nécessaires pour amorcer
le décollage économique des pays qui en sont dotés. Elles
sont à la base d'importants afflux d'Investissements Directs Etrangers
et de recettes fiscales au service des stratégies nationales de
développement.
Malheureusement, l'expérience a prouvé que
l'abondance de ressources naturelles est très souvent associée
à des guerres civiles, à la misère des populations
locales, à la mauvaise gouvernance et a la dégradation de
l'environnement ( Karl 1997, Aknin 2009). Les chercheurs ont ainsi pu observer
que l'abondance des ressources naturelles n'a pas toujours été le
gage d'une croissance saine et soutenable mais plutôt la source de
plusieurs maux qui ont transformé la bénédiction de la
nature en ce qu'ils ont convenu d'appelé la malédiction des
ressources naturelles (Aknin 2009). Selon Carbonier (2007), l'impact
négatif des ressources naturelles est mis en exergue sur trois plans :
la performance économique, les risques de guerre civile, et le
fonctionnement des institutions et la gouvernance.
La théorie économique sur la
soutenabilité faible permet de dégager théoriquement une
cause fondamentale de l'échec des stratégies de
développement soutenable dans les
9
économies extractives : Le faible taux d'accumulation
des facteurs de productions, notamment le capital humain et le capital
manufacturier. Dès lors qu'il y'a exploitation de ressources non
renouvelables, la première condition de soutenabilité faible est
la capacité de l'économie à accumuler les capitaux
substituts. En effet, le développement soutenable tel
qu'énoncé par le rapport Bruntland (1987) est celui qui permet de
subvenir aux besoins de la génération actuelle sans compromettre
à la capacité des générations futures à en
faire de même. Dès lors, la science économique distingue la
soutenabilité forte, selon laquelle aucun capital ne peut remplacer
l'autre et la soutenabilité faible qui accepte l'hypothèse de
substituabilité.
Le développement est soutenable tant que la destruction
d'un capital est compensée par l'accumulation d'un autre capital.
Appliqué au cas du Burkina, cette définition de la
soutenabilité voudrait donc que l'exploitation de la ressource non
renouvelable qu'est l'or et la dégradation environnementale qui s'en
suit soit accompagnée par l'accumulation de capital humain et/ou
physique de sorte à permettre aux générations futures de
subvenir à leur besoin. Le Burkina Faso satisfait-il cette condition de
la soutenabilité faible ?
En nous basant sur ce concept de soutenabilité faible,
l'or du Burkina serait une vraie bénédiction si le boom minier
s'accompagne d'un taux d'accumulation de capital physique et humain
significativement plus élevé que celui observé en moyenne
avant le boom minier.
L'objectif de cette étude est double, mettre en
évidence les risques associés au développement du secteur
minier burkinabè à la lumière de la théorie de la
malédiction des ressources naturelles dans un premier temps, ensuite
vérifier l'hypothèse du passage d'un régime d'accumulation
faible à un régime élevé depuis le boom minier de
2009.
Pour répondre a cette question, nous explorons la
littérature sur la malédiction des ressources naturelles et le
développement soutenable dans notre premier chapitre. Le chapitre 2
présente les spécificités de l'économie
burkinabè. Le chapitre 3 discute de la pertinence des indicateurs de
développement soutenable en nous permettant de dégager des
indicateurs pour mesurer l'accumulation de capital physique et humain au
Burkina Faso afin de vérifier l'existence ou non d'un changement de
régime dans l'accumulation de capital physique et humain.
10
Chapitre I : Entre bénédiction et
malédiction des ressources naturelles : littérature
théorique et empirique
Les ressources naturelles constituent avec le capital naturel
au sens large, un facteur de production d'une importance considérable
dans la dynamique économique. La découverte de gisements miniers,
pétroliers ou autres dans un pays apparait de prime abord comme une
bénédiction lorsqu'on ne considère que les
opportunités de revenu que son exploitation peut engendrer.
Néanmoins, certains Etats ont échoué malgré
l'abondance de ressources, à rehausser le niveau de vie des populations.
Dans le pire des cas, on observe une régression des indicateurs de bien
être après la mise en exploitation des ressources. Ce
phénomène a inspiré l'émergence de la
théorie de la « malédiction des ressources naturelles
».
Pour mieux appréhender le phénomène, nous
passons d'abord en revue la contribution des ressources naturelles au
développement. Ensuite nous évoquons quelques preuves empiriques
soutenant la théorie de la malédiction des ressources naturelles
et les théories explicatives, notamment le syndrome hollandais,
l'éviction du secteur manufacturier, etc. Enfin, nous tentons un
rapprochement entre le concept de développement soutenable et la
théorie de la malédiction des ressources naturelles, en insistant
sur les implications de la règle de soutenabilité faible sur
cette dernière.
I. Les ressources naturelles facteurs de croissance
Les ressources naturelles peuvent contribuer de
différentes manières à la croissance économique et
au développement des Etats qui en sont dotés. Qu'elles soient
renouvelables ou non renouvelables, les ressources naturelles sont
recherchées sur le marché international de sorte
qu'exportées à l'état brut, elles génèrent
d'important flux de devises pour ces pays. Ensuite, ces ressources naturelles
interviennent directement dans le processus de fabrication de produits de
grande consommation, les pays qui en sont dotés peuvent ainsi
bénéficier d'avantages comparatifs, les transformer sur place et
être plus compétitif sur le plan international. Selon Gelb (2010,
page 1) : « On note ainsi entre 1975 et 2004 une progression de 175% de la
part de l'Amérique latine sur les marchés internationaux de
métaux ». L'émergence de grands pôles industriels tels
que la Chine, la Corée, la Malaisie ou l'Indonésie est en grande
partie lié aux bénéfices que ces pays ont su tirer de
leurs ressources naturelles.
On peut établir théoriquement un lien positif
entre ressources naturelles et croissance économique à travers
une relecture de deux principales théories économiques : la
théorie des
11
avantages comparatifs de Ricardo (1817), et la théorie
du Big push de Rosenstein-Rodan (1943).
1. La théorie des avantages comparatifs
Initialement élaborée pour démontrer les
avantages du commerce international et de la spécialisation, la
théorie des avantages comparatifs de D. Ricardo (1817) est toujours
d'actualité pour définir comment un pays riche en une ressource
peut en tirer avantage dans le commerce mondial. En effet, dès lors
qu'un pays regorge d'une ressource, il dispose d'un certains avantage sur les
produits finis incorporant cette ressource. Une politique permettant de
pratiquer des prix faibles sur cette ressource à l'intérieur du
pays peut constituer une base pour l'émergence d'un secteur de
transformation. Dans sa définition des avantages comparatifs, Ricardo
insiste sur les gains d'une telle structuration du commerce mondiale. Chaque
Etats se spécialisant dans les produits sur lesquels il jouit d'un
avantage comparatif de productivité.
2. Le « Big push » par les ressources
naturelles
Le sous développement du tiers monde est très
souvent associé à un manque d'infrastructures, une insuffisance
de l'épargne et de l'investissement, de sorte que dans certains cas ce
phénomène est assimilable à un piège de
pauvreté. A cet effet, Sachs (2005) propose la solution du Big push par
un accroissement de l'aide internationale pour la réalisation des
différents investissements nécessaires au développement.
Les études sur les pièges à pauvreté et
l'efficacité de l'aide au développement (Easterly, 2005), tendent
à montrer les limites d'une telle prescription. Néanmoins,
l'exploitation des ressources naturelles se traduisant par un important afflux
de ressources financières, peuvent servir de levier au financement des
infrastructures de développement et provoquer le décollage
économique de ces Etats. En effet, selon Roseinstein-Rodan (1943), au
premier stade de développement, les investissements dans l'industrie
naissante d'un secteur peut accroitre le profit des autres secteurs. Ainsi en
investissant simultanément dans plusieurs secteurs, on peut atteindre un
équilibre haut alors que pris individuellement, aucun secteur n'aurait
pu se développer seul.
De toute évidence, les ressources naturelles
lorsqu'elles sont bien gérées, sont une
bénédiction. Des Etats comme le Botswana, la Norvège ou
l'Indonésie ont profités de la rente tirée des ressources
pour diversifier leur économie et gagner le pari de l'industrialisation.
Le Botswana a entamé sa période post coloniale avec un faible
taux d'investissement et un
12
niveau substantiel d'inégalité. Il est le
deuxième plus grand investisseur sur l'éducation (dépenses
publiques en % PNB), et bénéficie du taux de croissance le plus
élevé au monde depuis 1965 (Van der Ploeg. 2011). La
Norvège est le troisième exportateur de pétrole du monde
après l'Arabie Saoudite et la Russie, mais il est l'un des pays les
moins corrompus au monde et bénéficie d'institutions bien
développées, une gestion transparente et des politiques
favorables au marché (Van der Ploeg. 2011).
II. La malédiction des ressources naturelles :
Littérature théorique et empirique.
De nombreuses études empiriques ont mises en
évidences l'existence de la malédiction des ressources
naturelles. Nous pouvons citer entre autres : Sachs et Warner (1995, 1997,
1999, 2001) ; Gelb (1988) ; Auty (1990, 1998). En tant que fait stylisé,
des théories ont émergées pour tenter de comprendre
comment le phénomène opère, et éventuellement
comment conjurer la malédiction.
1. Evidences empiriques
La malédiction des ressources naturelles est née
des observations de Auty (1990) qui utilise ce terme pour qualifier le
phénomène « contre intuitif » qui fait que dans les
régressions de croissance, les pays richement dotés en ressources
naturelles soient ceux là même qui peinent à connaitre une
croissance économique soutenue. D'un coté on a des pays pauvre en
ressources telles que Singapour, Hong Kong, la Taiwan, ou le Japon qui, du
point de vu de la croissance se démarquent positivement. Tandis que le
Nigeria, le Gabon, ou le Venezuela qui sont plutôt bien dotés en
ressources naturelles, réalisent des performances médiocres et
stagnent depuis les indépendances (J. A. Frankel 2012).
En analysant les données de 1970 à 1990, Sachs
et Warner (1997) ont montrés que les pays riches en ressources
naturelles ont tendance à croitre moins vite que les pays peu
dotés en ressources naturelles. Ils ont effectué des
régression de croissance, en prenant en compte des
caractéristiques économiques telles que le « ratio
exportation en ressource naturelles par
rapport au PIB » ,« la population active »,
« l'intégration globale de
l'économique », «
l'ouverture économique », « le taux d'investissement »,
« le taux d'accumulation de capital humain », « le ratio des
dépenses publiques », « le déficit fiscal » et
« l'efficacité des institutions ».
Par ailleurs, Sala-i-Martin (1997) et Doppelhofer et al.
(2000) ont trouvé que les ressources naturelles font parties des 10
variables explicatives les plus robustes dans les
13
régressions de croissance. Cette étude vient
étayer les conclusions de Sachs et Warner (1995), Auty (1990), Gelb
(1988).
Sachs et Warner (2001) ont revu la littérature
empirique sur la théorie des ressources naturelles. Ils constatent qu'au
delà de la corrélation négative entre abondance en
ressources et croissance, l'introduction de variables géographiques et
climatiques ne modifie pas significativement les conclusions. En effet, selon
les auteurs (page 5): « en considérant la possibilité
qu'il existe un biais lié à l'existence de variables
géographiques non observables, les pays dont les conditions
géographiques sont favorables auraient une croissance soutenue en
laissant passer le temps. La part des ressources naturelles dans
l'économie apparaitra alors faible par ce que le reste de
l'économie aurait connu une croissance soutenue et non par ce que ces
pays sont pauvres. Les pays pauvres en ressources naturelles quant à
eux, apparaitrons comme riche (mesuré par le ratio exportation de
ressources naturelles sur PIB), le reste de l'économie n'ayant pas connu
de croissance soutenue ». De même, le test de contrôle
direct de la variable géographique dans la régression
réalisé par Gallup et al. (1999) et le test indirect consistant
à contrôler la croissance des périodes antérieur
réalisé par Sachs et Warner (1997), ont conclu que la prise en
compte des variables géographiques n'élimine pas la
malédiction des ressources naturelles.
2. Théories explicatives
Quelles sont les mécanismes qui expliquent la
malédiction des ressources naturelles ? La théorie
économique propose plusieurs explications que l'on peut résumer
en 6 groupes (Frankel 2012). Il s'agit notamment de : l'évolution
à long terme des prix mondiaux, la volatilité des prix des
matières premières, l'éviction permanente du secteur
manufacturier, institutions autocratiques ou oligarchiques, l'existence
d'institutions anarchiques et le syndrome hollandais.
a) L'évolution à long termes des prix
mondiaux.
Cette théorie remonte au années 1950 avec la
thèse de Prebish et Singer qui stipule que sur le long terme, les prix
des produits minéraux et agricoles suivent une trajectoire à la
baisse. Selon la loi d'Engel, les ménages consacrent une fraction plus
faible de leur revenu à la nourriture et autres nécessités
de base lorsque leur revenu augmente. Appliquée à
l'économie mondiale, cette loi se traduit sur le long terme par une
dégradation des termes des échanges au détriment des pays
du sud. Prebish (1950) observe que depuis 1876, les termes de l'échange
se sont dégradés pour les pays exportateurs de matière
première au profit des pays
14
exportateurs de produits manufacturés. Dans cette
logique on comprend bien que les pays riches en ressources naturelles qui n'ont
pas réussi à industrialiser leur économie réalisent
de faible performance économique sur le long terme. Néanmoins,
l'évolution récente des cours des matières première
remet en cause cette hypothèse. En effet, le cours des matières
premières, notamment les matières premières agricoles se
caractérise par une dynamique en escalier : la tendance
générale à la baisse depuis 1921 connait un retournement
à partir des années 2000 et se stabilise autour d'un nouveau
régime dynamique élevé à partir de 2006 (Couharde
et al. 2012). V. Geronimi et Taranco (2014), confirme également
l'hypothèse selon laquelle les termes de l'échange des produits
primaires s'orientent vers un niveau durablement plus élevé,
atteignant 104.09 (base 100 en 1977-79) contre 65.64 sur la période
1986-2005.
b) La volatilité des prix des matières
premières
Cette théorie soutien que la volatilité des prix
des matières premières est l'un des déterminants majeurs
de la malédiction. Le marché des matières premières
se caractérise par des changements brusques des prix de base, de la
découverte de nouveaux gisements, de nouvelles technologies ou des
fluctuations des taux de change. La volatilité s'explique principalement
par une faible élasticité-prix de la demande et de l'offre,
à court terme. De sorte que lorsque que les prix augmentent, la demande
ne diminue pas assez à court terme et lorsque les prix baissent, l'offre
ne diminue pas assez non plus. Cela s'explique par le fait que le
système de production nécessite toujours un temps d'ajustement
(Frankel 2012).
La volatilité des prix nuit gravement à la
croissance et à la productivité sur le long terme. Elle
occasionne un chômage frictionnel, une utilisation incomplète du
capital, et des coûts occasionnels très élevés. La
volatilité est non seulement mauvaise pour la croissance mais
également pour l'investissement, la distribution des revenus, la
pauvreté et l'éducation (Van der Ploeg 2011). Dans les pays
riches en ressources naturelles, caractérisés par un
marché financier peu développé, une polarisation ethnique
et de faibles institutions, Ramey et Ramey (1995) montrent que les effets
négatifs des ressources naturelles sur la croissance sont dus
principalement à la volatilité des cours des matières
premières.
c) L'éviction permanente du secteur
manufacturier
Les ressources naturelles sont néfastes à la
croissance par ce qu'elles induisent des effets d'éviction sur des
activités et des déterminants clés de la croissance. Sachs
et Warner (2001) évoque notamment l'hypothèse selon laquelle
l'abondance de ressources naturelles crée un excès de demande sur
le marché des produits non marchands. Cette hausse de
15
demande entraine une hausse du prix des intrants et de la main
d'oeuvre qui réduisent le profit du secteur manufacturier national dont
la compétitivité n'est plus garantie sur le marché
international. Ils ont ainsi pu montrer l'existence d'une corrélation
entre abondance de ressources et prix élevés dans ces pays
même après contrôle de la relation positive entre niveau de
revenu des pays et prix élevé observé par Ricardo, Balasa
et Samuelson. Un deuxième test dans le même article a permis aux
auteurs de vérifier que sur la période 19701990, la baisse de
compétition du secteur manufacturier a surtout eu pour effet une
compression de la contribution de ce secteur à la croissance.
La logique d'éviction ne s'applique pas uniquement au
secteur non manufacturier. L'abondance de ressource naturelles à des
effets négatifs sur l'entrepreneuriat et l'innovation, de sorte que
l'Etat et les entrepreneurs se tournent vers ce secteur qui offre des rentes
plus élevés au détriment des autres secteurs. Si les
salaires sont plus élevés dans le secteur de la ressource, les
entrepreneurs et les innovateurs potentiels sont encouragés à
travailler dans ce secteur et se transforment en chercheur de rente. Gylfason
et al. (1999) et Gylfason (2000) ont pu établir un lien négatif
entre ressources naturelles et éducation. Sachs et Warner (2001)
soutiennent que les variantes de la logique d'éviction sont apparemment
les théories qui expliquent le mieux la malédiction par ce
qu'elles survivent plus aux investigations empiriques.
Le syndrome hollandais s'inscrit également dans la
logique d'éviction. Historiquement, le syndrome hollandais apparait
lorsque l'augmentation des revenus provoquée par l'exploitation de la
ressource entraine une appréciation du taux de change réel avec
pour conséquence une contraction du secteur marchand et une
désindustrialisation. C'est ce qu'on a observé autour des
années 1960 au Pays Bas avec la découverte du gaz naturel. Le
syndrome hollandais regroupe maintenant un certains nombre d'effets pervers
liés à l'afflux de devise, notamment une augmentation des
dépenses publiques, une augmentation du prix des biens non
échangeables, un déplacement de la main d'oeuvre du secteur
manufacturier vers le secteur de la ressource et parfois un déficit du
compte courant.
Davis et Tilton (2005) critiquent la théorie de la
maladie hollandaise en soutenant qu'elle ne fait que refléter les
mécanismes par lesquelles l'économie nationale s'ajuste pour
tirer avantage du secteur de la ressource. Elle ne devient une maladie qu'a
partir du moment où la ressource s'épuise et que
l'économie échoue à reproduire le processus inverse pour
transférer la main d'oeuvre vers les secteurs traditionnels.
16
d) La mauvaise qualité institutionnelle
L'une des explications de la malédiction des ressources
naturelles est la mauvaise qualité institutionnelle. Bien que la
malédiction s'observe empiriquement dans les régressions de
croissance sur tout les pays riches en ressources, lorsqu'on prend en compte la
qualité institutionnelle, deux groupes apparaissent : d'un coté,
les pays avec de mauvaises institutions apparaissent victimes de la
malédiction, tandis que de l'autre coté, les pays avec de bonnes
institutions réalisent des performances nettement supérieures
à celles du premier groupe (graphique 1). Mehlum et al. (2006) affirment
donc que la variance dans les performances de croissances entre les pays riches
en ressources est principalement due à la façon dont la rente est
distribuée via l'arrangement institutionnel. Ils distinguent ainsi des
institutions dans lesquelles production et recherche de rentes sont
complémentaires et des institutions ou la faiblesse des lois, le
dysfonctionnement de la bureaucratie, et la corruption occasionnent des gains
avec stratégies d'accaparement. Dans le premier cas les entrepreneurs
sont incités à produire et donc soutenir la croissance tandis que
dans le second cas, ils sont plutôt incités à quitter les
activités productives vers des activités improductives.
Les auteurs construisent alors un modèle
théorique qu'ils testent en utilisant les données de Sachs et
Warner (1997b) et en introduisant un « terme d'interaction »
correspondant à une pondération de l'abondance de ressource par
la qualité des institutions. Ils constatent alors que dans ces
conditions, la malédiction est d'autant plus faible que la
qualité institutionnelle est élevée. Lorsque la
qualité institutionnelle est supérieure au seuil de 0.93, la
malédiction n'opère pas. Ce qui correspond au cas de 15 des 87
pays de l'échantillon.
17
Figure 1 : ressources et
institutions

Source : H. Mehlum, K. Moene & R. Torvik (2006) «
Institutions and the Resource Curse »,
page 2.
La qualité des institutions est mesurée par une
moyenne non pondérée de cinq indices basés sur des
données de Political Risk Services: un indice des règles de loi,
un indice de qualité de la bureaucratie, un indice de corruption dans le
gouvernement, un indice de risque d'expropriation et un indice sur la
répudiation des contrats par le gouvernement. Malgré les risques
de causalité inverse que les auteurs soulignent dans leur article, il
n'en demeure pas moins que ces résultats viennent remettre en cause la
position de Sachs et Warner (2001). Au sujet des institutions, ces derniers
soutenaient en effet que le manque d'évidences empiriques rend la piste
institutionnelle moins robuste pour expliquer la malédiction.
En outre, d'autres études viennent appuyer
l'hypothèse d'une malédiction par la mauvaise qualité des
institutions. Le succès du Botswana peut bien s'expliquer par ses bonnes
institutions (Acemoglu et al. 2002). Ce pays détient en effet les
meilleurs scores en terme de corruption et réalise depuis 1965, les taux
de croissance les plus élevés au monde malgré une part des
ressources naturelles de l'ordre de 40% du PIB. Lane et Tornell (1996,1999)
expliquent les mauvaises performances du Nigeria, du Venezuela et du Mexique
par un dysfonctionnement des institutions qui conduit à des
comportements d'accaparement.
18
Par ailleurs, Frankel (2012) identifie également
l'anarchie institutionnelle comme facteur explicatif de la malédiction.
Il regroupe sous cette rubrique les théories relatives à
l'exploitation insoutenable des ressources, les droits de
propriétés inapplicables, et les guerres civiles comme
mécanismes par lesquelles la malédiction opère.
La malédiction par l'épuisement rapide de la
ressource concerne surtout les cas ou la gestion anarchique de la ressource
conduit non seulement à son épuisement mais aussi au gaspillage
de la rente. Dans la plupart des cas, ce sont les gouvernements chargés
de la gestion de la ressource qui ont tendance à en extraire à un
taux supérieur à celui du sentier optimale d'extraction (Hartwick
1977, Solow 1986), soit par ce qu'il anticipe qu'ils ne vont plus être
réélu ou par ce qu'ils ont des préférences
très élevées pour le présent. Le manque de
réinvestissement de la rente et de diversification de l'économie
condamne les générations futures à souffrir d'une baisse
de consommation et de bien être. L'exemple de l'épuisement rapide
des gisements de Phosphate de l'ile de Nauru dans le sud du pacifique illustre
bien les effets pervers de l'abondance de ressources. Après avoir
été source de haut revenu, les terres qui abritaient ces
gisements ont été dévastées et l'île est
maintenant dans un état de précarité relative.
La tragédie des biens communs traduit également
des situations ou la faiblesse des droits de propriétés entraine
des situations d'épuisement rapide. L'incapacité de l'Etat
à définir les droits de propriété et à les
sécuriser est alors identifiée comme le principal moteur de la
malédiction. Lorsque la ressource est dispersée sur un vaste
territoire tel que le cas des aires de pêches, des zones de
pâturage ou des aquifères d'eau, une surexploitation collective de
la ressource conduit à son épuisement rapide, accompagné
d'une utilisation non contrôlé de la rente.
Le dernier mécanisme par lequel l'anarchie
institutionnelle explique la malédiction concerne l'apparition de
guerres civiles dans les Etats riches en ressources naturelles. Les analyses
contemporaines des guerres civiles voient dans les ressources naturelles un
déterminant majeur de l'apparition de guerres civiles : « Les
guerres civiles s'expliquent alors par un comportement rationnel des agents,...
(dont) les objectifs sont purement économiques » (Aknin 2009,
p 16). Pour reprendre les propos de Collier (2000, 3), cité dans Aknin
(2009), « les guerres civiles procèdent d'une «
prédation à grande échelle » sur des activités
économiques génératrices de revenus, dans le but de
financer la rébellion ». L'accaparement de la rente
liée aux ressources naturelles devient alors une condition sine qua non
de la survie de la rebellion, d'autant plus, que les ressources naturelles
issues de ces zones
19
de conflits sont « connectées aux marchés
mondiaux » (Aknin 2009). Wick et Bulte (2006) ont pu montrer que dans un
Etat sans ressources, la probabilité d'apparition de guerre civile se
situe autour de 0.5%, tandis que dans un Etat qui tire un quart de son P11B des
ressources naturelles, la probabilité d'apparition de conflit atteint
23%.
III. Développement soutenable et
malédiction des
ressources naturelles
La malédiction des ressources naturelles repose
principalement sur le constat que les Etats dotés d'importantes
ressources naturelles réalisent de mauvaises performances
économiques. A travers la littérature sur le sujet, on constate
que par mauvaises performances économiques, cette théorie entend
généralement faible croissance du P11B et ne prend pas toujours
en compte le caractère soutenable de la croissance. Elle ne fait pas
explicitement de lien entre croissance économique et
développement soutenable.
Nous pensons que l'intégration de la dimension «
soutenable » pourrait profondément mitiger les conclusions des
différentes études sur les ressources naturelles et « la
malédiction ». Il ne s'agit plus ici de maximiser simplement un
taux de croissance économique, mais plutôt de maximiser un taux de
croissance « vert » à même d'être
perpétué indéfiniment.
1. Le développement soutenable et la
malédiction des ressources naturelles
Le rapport Brundtland a popularisé la notion de
développement soutenable en insistant à la fois sur le fait de
pouvoir perpétuer indéfiniment le bien être de
génération en génération et aussi en tenant compte
de la durabilité, c'est-à-dire la préservation de
l'environnement. Selon les auteurs de ce rapport, « le
développement durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs » (rapport
Brundtland 1987). La deuxième édition de ce rapport remplace
« développement durable » par « développement
soutenable » (Editions du Fleuve, 1988). A la lumière de cette
définition, on comprend que les politiques de développement et
les recherches dans ce domaine doivent nécessairement prendre en compte
les trois dimensions du développement : l'économique, le social
et l'écologique.
Nous soutenons donc que la théorie de la
malédiction des ressources naturelles doit être
révisée de sorte à intégrer ces trois dimensions du
développement. En effet, jusqu'à présent, les
évidences empiriques à ce sujet ce sont focalisées sur
l'économique, parfois le
20
social et a très peu fait cas de l'écologique. A
l'heure actuelle, le débat serait donc de voir dans quelle mesure les
pays riche en ressource naturelles s'inscrivent sur une trajectoire de
développement soutenable et non plus de faire des comparaisons entre
pays sur la seule base du taux de croissance du PIB.
Les partisans de la croissance zéro avaient
déjà souligné les effets pervers des politiques
axées sur la croissance au sens traditionnel sans tenir compte de la
pression sur les ressources planétaires et les différentes
pollutions qui bouleversent les écosystèmes. Le rapport Meadows
du Club De Rome (1972), a eu le mérite d'attirer l'attention de
l'humanité sur son incapacité à soutenir une croissance
exponentielle dans un monde fini. Bien que l'effondrement de la croissance par
l'épuisement des ressources n'ait pas été constaté
ces dernières décennies, il n'en demeure pas moins que
l'humanité cours à sa perte toutes choses égales par
ailleurs, avec son rythme de croissance actuelle et les taux de pollutions qui
s'y rapportent.
Dans quelle mesure les pays riches en ressources naturelles
peuvent-elles réaliser de faibles performances économiques par
rapport au pays pauvres en ressource naturelles sans pour autant s'inscrire
dans une configuration de malédiction de ressources naturelles ?
Nous soutenons, que le développement soutenable au sens
de la conjugaison des trois dimensions : « économique »,
« social » et « écologique », permet de poser les
bases et d'apporter une réponse plus ou moins satisfaisante à
cette question. En effet, un pays riche en ressources naturelles ne serait plus
maudit, dès lors qu'il s'inscrit sur une trajectoire de
développement soutenable, et cela indépendamment de ses
performances économiques par rapport aux autres pays.
2. Soutenabilité forte ou faible
Selon les auteurs néoclassiques, le capital naturel, le
capital physique et humain peuvent se substituer entre eux. On parle alors de
soutenabilité faible. Cette conception de la soutenabilité est
celle que sous entend les indicateurs de développement soutenable telle
que l'épargne nette ajustée. Dans cette optique, les ressources
non renouvelables peuvent être entièrement consommées
dès lors qu'elles sont transformées en d'autres types de capitaux
et transmis aux générations futures.
La soutenabilité forte soutenue par Daly (1990) remet
en cause l'hypothèse de substituabilité entre les
différents types de capitaux. Daly estime que pour être
soutenable, le rythme de consommation des ressources renouvelables ne doit pas
excéder le rythme de
21
régénération de celle-ci. Quand aux
ressources non renouvelables, il faut prendre en compte le rythme de
développement des substituts. De même, le rythme d'émission
de pollution doit être contenu dans les limites de la capacité
d'absorption de l'environnement.
Nous contestons également l'hypothèse de la
substituabilité illimitée entre capitaux, en reconnaissant qu'au
delà d'un certain seuil, la baisse du stock de capital naturel ne peut
être compensée par un accroissement du stock de capital physique
et humain. Néanmoins, nous admettons dans cette étude que les
pays riches en ressources naturelles peuvent s'inscrire dans une trajectoire de
développement soutenable à partir du moment où la majeure
partie de la ressource est constituée de ressources fossiles et que son
exploitation s'accompagne d'une réparation des dommages causés
à l'environnement, une maitrise des taux de pollution. Dans ces
conditions, l'hypothèse de soutenabilité faible peut être
considérée dès lors que le principe de précaution
(Marechal, 1996) est appliqué : contenir les risques
d'irréversibilité qui menace l'environnement. L'accent sera alors
mis sur l'usage de la rente et la capacité de ses pays à la
convertir en capital physique et humain conformément à la
règle de Solow-Hartwick.
3. La règle de Solow-Hartwick
Pour Solow (1974) et Hartwick (1977), la recherche d'une
certaine forme d'équité intergénérationnelle et les
moyens pour y parvenir doivent être à la base de l'exploitation
des ressources non renouvelables. Ainsi, le critère
d'équité conduit Solow à soutenir que la consommation par
tête doit être constante à travers le temps de façon
à ce qu'aucune génération ne soit favorisée par
rapport à une autre. Le problème consiste alors à
déterminer le plus haut niveau de consommation pouvant être
indéfiniment perpétué à travers les
générations. Hartwick définit alors la règle de
soutenabilité comme celle qui consiste à investir toute la rente
des ressources non renouvelables dans d'autres types d'actifs (capital
fabriqué). «Avec un tel programme, la génération
présente convertit des ressources épuisables en machines et vit
des flux courants provenant des machines et du travail. Avec un tel programme,
on peut supposer que, dans un sens, le stock total de capital productif n'a
jamais été épuisé puisqu'en fin de compte le stock
de ressources épuisables sera converti en un stock de machines et,
compte tenu du fait que les machines sont supposées ne pas se
déprécier, aucun stock ou de machines, ou de ressources
épuisables ne sera jamais épuisé » (Hartwick
1977).
22
Conclusion
La théorie de la malédiction des ressources
naturelles a le mérite de mettre en exergue les dérives
liées à l'utilisation des rentes, d'insister sur les
conséquences des comportements rentier des politiques et des
entrepreneurs. La malédiction par l'éviction du secteur
manufacturier, la généralisation de la corruption,
l'émergence de guerres civiles et la dégradation des institutions
sont des fléaux qui situent la plupart des pays riches en ressources
naturelles sur des dynamiques très éloignées de la
règle de Solow-Hartwick.
A la lumière de la littérature sur le
développement soutenable dans ses trois dimensions (économique,
sociale et écologique), les investigations sur la malédiction des
ressources naturelles doivent nécessairement modifier leurs approches du
phénomène. Certes, les comparaisons entre pays, sont utiles par
ce que mettant en évidence les contradictions sur le niveau de
croissance des pays riches en ressources naturelles, mais le
développement soutenable est surtout celui qui préserve
l'environnement et assure aux générations futures un niveau de
vie au moins égale à celui des générations
présentes. Dans ce contexte, la logique des comparaisons qui reviennent
sans cesse dans la littérature sur la malédiction des ressources
naturelles nous semble obsolète. En effet, chaque pays ayant ses
institutions, sa propre culture et son mode de gouvernance, des conclusions et
recommandations spécifiques à chaque Etat pourrait mieux se
transcrire dans les stratégies nationales de développement. Aussi
nous exhortons les chercheurs à se recentrer sur des diagnostiques pays,
du moins dans une visée opérationnelle.
A la question comment conjurer la malédiction des
ressources naturelles, il s'agira donc dans un premier temps de voir dans
quelle mesure chaque pays riche en ressources naturelles s'écartent ou
non de la règle de Solow-Hartwick, ensuite un diagnostic des raisons de
cet écart (si écart il y'a), permettra d'identifier les actions
à mettre en place afin de réhabiliter la capacité de ces
Etats à s'inscrire sur une trajectoire de développement
soutenable.
23
Chapitre II : Spécialisation primaire et
développement soutenable au Burkina Faso
Introduction
Le Burkina Faso est géographiquement situé au
coeur de l'Afrique de l'ouest. Pays enclavé, il est limité par
six pays, notamment la Cote d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Benin, le Niger et
le Mali. D'une superficie totale de 273 187 km2 (donnée de
l'Institut National de la Statistique et de la Démographique du Burkina
Faso), la population du Burkina Faso est estimée à 18 365 123
habitants en juillet 2014. Le Burkina a hérité de la
colonisation, le Français comme langue officielle, à coté
de laquelle on identifie trois principales langues nationales : le
Mooré, le Dioula et le Fulfulde.
La population burkinabè est majoritairement agricole,
néanmoins le secteur tertiaire reste la première source de valeur
ajoutée. L'exploitation minière traditionnelle est historique
mais le boom minier commence en 2009, avec la mise en exploitation de 6 mines
modernes, qui vont porter l'or au rang de premier produit d'exportation du
Burkina Faso. Depuis 2010, le Burkina Faso est le quatrième plus grand
producteur d'or en Afrique.
L'or contribue-il au développement
socio-économique du Burkina ? Quelles sont les enjeux du secteur minier
au Burkina Faso en termes de soutenabilité et de risque de
malédiction des ressources naturelles ?
L'objectif de ce chapitre est de mettre en évidence
l'évolution récente des indicateurs de développement
socio-économiques du Burkina Faso, les caractéristiques du
secteur minier burkinabè, notamment le cadre réglementaire, la
contribution de ce secteur à l'amélioration du bien être
des populations et enfin l'exposition de ce pays aux risques de
malédiction des ressources naturelles.
I. Généralité sur le Burkina
Faso
Depuis les indépendances dans les années 60, le
développement du Burkina Faso repose principalement sur les produits
primaires. L'agriculture à joué un grand rôle jusqu'a
très récemment en 2008, ou l'or a pris le relais en tant que
premier produit d'exportation. L'analyse de l'évolution des taux de
croissance du PIB et du PIB par habitant, des sources de la croissance et de
l'évolution dans le temps des conditions de vie des populations au
Burkina Faso permet de mettre en évidence les grandes
caractéristiques de l'économie de ce pays.
24
1. Evolution récente des indicateurs de
développement
socio-économiques du Burkina Faso
a) La croissance économique au Burkina Faso
L'analyse des séries temporelles de la banque mondiale
sur l'évolution des taux de croissance du Burkina Faso, ainsi que ceux
de l'Afrique subsaharienne depuis 1980 montre que la santé
économique du Burkina est intimement liée à celle de la
sous-région. En effet, il semble exister une corrélation entre
les statistiques sur le Burkina Faso et celles portant sur la
sous-région. Ainsi, on peut identifier une première
période de vaste fluctuation s'étendant de 1980 à 1995.
Puis une seconde période de 1995 à 2014, composée de trois
sous périodes scindées par la chute cyclique du taux de
croissance par habitant. Il s'agit notamment de la période 1995 à
2000, de 2001 à 2009 et de 2009 à nos jours.
Jusqu'en 1995, il semblerait que l'Afrique subsaharienne, en
général, ait peiné à se trouver un modèle de
croissance soutenable dans le temps. Cette période se caractérise
par une succession de croissances positives et négatives
aléatoirement distribuées, des années de forte croissance,
suivi de faible croissance (9.56% en 1982 au Burkina, immédiatement
suivi de 0.34% en 83) et une croissance moyenne relativement faible sur toute
la période 1980-95 (3.3% par an pour le Burkina). Cette situation peut
s'expliquer en partie par une situation politique instable (le Burkina connait
un changement de régime en 1983), et une grande
vulnérabilité de l'ensemble de l'économie de la
sous-région. Notamment une grande dépendance aux aléas
climatiques, et un commerce extérieur peu diversifié et peu
compétitif.
La seconde période correspond à ce qu'on
pourrait appeler une croissance soutenue, exclusion faite de la baisse de la
croissance de l'année 2000 et de l'année 2009. En effet, le taux
de croissance bien qu'insuffisant pour le décollage économique de
pays tels que le Burkina Faso, s'est situé au dessus de 4% avec des pics
atteignant 8%. Dans l'ensemble le Burkina s'est distingué de la moyenne
sous-régionale, avec des performances relativement élevées
(graphique 2). La première explication de cette phase de croissance
soutenue se retrouve dans la dévaluation du franc CFA survenue en 1995.
La dévaluation à permis d'impulser une dynamique en
améliorant la compétitivité de l'économie,
notamment de la filière coton qui a été la base des
exportations du Burkina Faso jusqu'en 2008. Bedossa (2012) précise que
la stabilité politique et les effets d'entrainement d'un investissement
public élevé ont également contribués à
expliquer ce changement de régime au Burkina Faso. Le maintien du
caractère volatile de la croissance est toujours lié à la
dépendance aux chocs internes, principalement climatiques. Tandis que la
faible intégration à l'économie mondiale
25
protège toujours partiellement l'économie
burkinabè des chocs négatifs externes (Bedossa 2012).
Graphique 1 : Evolution du taux de croissance du
PIB et du PIB/hbt du Burkina et de l'Afrique subsaharienne

Sources : Données banque mondiale (Indicateurs du
développement dans le monde), graphique de l'auteur.
Malgré l'augmentation de la population
burkinabè, la création de richesse par habitant à
été beaucoup plus élevée sur la période
1995-2014 que celle observée en moyenne entre 1980 et 1995. De 0.58%,
sur la période 80-95, le taux de croissance moyen du PIB par habitant
est passé à 3.31 sur la période 96-2014. Néanmoins,
le graphique 2, qui reprend les taux de croissance moyens sur les
différentes sous périodes que nous avons identifié plus
haut, montre une tendance baissière des différents indicateurs
depuis 1996. Bedossa (2012, 4) montre que cette tendance est surtout
liée à la baisse de la contribution du secteur primaire dans la
création de richesse : « Le secteur primaire, dont la part dans
la valeur ajoutée totale reste forte (33 % en moyenne sur la
période 1980-2005), a vu sa contribution à la croissance se
réduire depuis 2005. De la même manière, le secteur
tertiaire, dont la part dans la valeur ajoutée est la plus importante
(46.5 % en moyenne sur la même période), a vu sa contribution
à la croissance baissée sur la période récente
». A la recherche de nouveau relais de croissance, le
développement du secteur secondaire burkinabè semble insuffisant
pour
26
garantir au pays un taux d'accumulation à même de
compenser le recul dans les deux autres secteurs.
Graphique 2 : Evolution des taux de croissance moyen
dans le temps
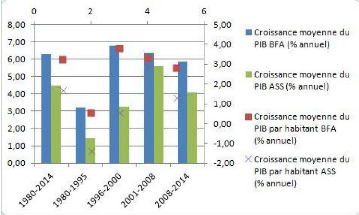
Sources : Données banque mondiale (Indicateurs du
développement dans le monde), calcul de l'auteur.
b) Les sources de la croissance au Burkina Faso
Le Burkina Faso est un pays à spécialisation
primaire. Son économie est surtout tirée par le secteur primaire,
notamment avec l'agriculture et l'élevage. La chute de la croissance en
2000 s'explique ainsi par une baisse significative dans la valeur
ajoutée du secteur agricole (-44% environ). Cette baisse semble avoir
entrainé vers le bas le secteur secondaire où on peut observer
une croissance négative de l'ordre de 20% dans la valeur ajoutée
du secteur de la Fabrication et 10% dans la valeur ajoutée des
activités industrielles. Le secteur agricole burkinabè souffre
depuis 2000 d'importantes fluctuations dans sa capacité à
créer de la valeur ajoutée. Selon les travaux de Yameogo (2009) :
« La valeur ajoutée du secteur qui avait augmenté de 17% en
2001 et de 11.8% en 2005 a connu un repli de 4.3% en 2007, liée à
une baisse de la production du coton et à une mauvaise
répartition des pluies dans l'espace et dans le temps ». A ces
aléas climatiques s'ajoute alors les fluctuations du cours du coton
à l'international et une mauvaise organisation de la filière qui
s'est traduit par des retards de paiements des paysans, des annonces tardives
du prix d'achat du coton aux producteurs. La valeur ajoutée du secteur
agricole continue ainsi de fluctuer, passant de 40% de croissance en 2008,
à - 17% en 2009, puis 19% en 2010, -8% en 2010 (graphique 3). Les
médias burkinabè dénoncent encore cette année
(2015), une saison des pluies qui a commencé tardivement,
27
s'accompagnant de pluies diluviennes, d'inondations saccageant
les habitations, causant de nombreux sinistres et une inquiétude
vis-à-vis de la capacité des populations à pouvoir se
nourrir décemment du fruit de leur labour.
Graphique 3 : taux de croissance de la valeur
ajoutée par secteur
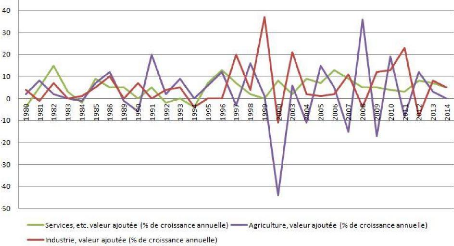
Source : construit a partir des données de la Banque
mondiale
Le secteur secondaire burkinabè peut être
subdivisé en trois catégories, notamment les industries
extractives, manufacturières et le sous secteur du Bâtiment et
Travaux Publics (BTP). Sur le graphique 3, le taux de croissance annuel du
secteur secondaire est représenté par la catégorie
Industrie. Elle comprend la valeur ajoutée du secteur minier,
manufacturier, de la construction, de l'électricité et de
l'eau.
On constate que depuis 2000, la contribution de ce secteur
à la croissance est globalement positive. En effet, hors mis 2008 et
2012, l'Industrie burkinabè à connu un taux de croissance
positif. Cette performance est en partie liée à l'apaisement de
la crise Ivoirienne qui a occasionné la création de nouvelles
unités de production, l'émergence du secteur aurifère
moderne avec la mise en exploitation de 6 mines d'or, et le démarrage de
grands projets dans le secteur du BTP, notamment avec les chantiers de Ouaga
2000 et du Projet ZACA (Yameogo 2009). Le repli observé en 2012
s'explique par une baisse de la production d'or qui s'est chiffré
à 32 405kg contre 32600 en 2011, la principale raison de cette baisse
étant due à une baisse du cours de l'or.
28
Le secteur tertiaire est le plus stable. Le taux de croissance
de la valeur ajoutée de ce secteur est moins sensible aux fluctuations
du secteur primaire. En termes de contribution à la formation du P11B,
le secteur tertiaire vient en tête avec environ 45% du P11B depuis 2000.
En 2012 par exemple, ce secteur a participé pour 53,3% à la
création de la valeur ajoutée totale, avec une contribution
à la croissance de 3.9% (Rapport CNPE 2013). Malgré le dynamisme
du tertiaire, la base de l'économie burkinabè demeure le secteur
primaire, qui occupe encore plus de 90% de la population.
c) Les inégalités et la pauvreté
au Burkina Faso
En dépit d'un taux de croissance positif depuis 1994,
la situation socio-économique des burkinabè n'a pas
significativement évolué. La pauvreté sévit
toujours au sein des couches inférieures de la population et les
inégalités sont toujours criantes.
Le tableau 1 permet d'observer l'évolution de la
distribution des revenus de 1994 à 2009. On constate que s'il y a bien
une diminution de la part de la richesse totale détenue par les 20% les
plus riches, cette diminution est néanmoins insuffisante pour
réduire significativement les inégalités. Le
quatrième et le cinquième quintile détenaient encore 67.9%
de la richesse totale en 2009, tandis que les deux premiers doivent se partager
seulement 17.3% de la richesse totale.
L'analyse de la pauvreté monétaire
mesurée en pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de
pauvreté met en évidence une faible contribution de la croissance
à la réduction de la pauvreté. En effet, malgré une
croissance soutenue ces dernières années, en 2009, 46.7% de la
population burkinabè vivait sous le seuil de pauvreté national
(données banque mondiale). Même si on note une réduction de
4.4% par rapport à 2003, la croissance moyenne de 6.39% entre 2001 et
2008 n'a eu que peu d'effet sur la réduction de la pauvreté. Le
rapport provisoire du CAPES (2010) sur la pauvreté au Burkina Faso cite
parmi les tentatives d'explication du faible impact, les différents
chocs exogènes qui frappent le pays : inondations,
épidémies, crises économiques et alimentaires, conflits
politiques dans la sous région, etc.
Malgré cette faible contribution à la
croissance, l'Indice de Développement Humain du Burkina Faso penche en
faveur d'une amélioration des conditions de vie des burkinabè. En
effet, sur une échelle de 0 à 1, ce dernier est passé de
0.321 en 2005 à 0.388 en 2013, soit une croissance annuelle moyenne de
2.41%. Le pays est ainsi passé de la 183ième place
dans le classement des nations 2013 à la 181ième place
en 2014 (PNUD 2014). Néanmoins, le rapport
29
annuel 2014 du PNUD sur le Burkina Faso fait remarquer que des
trois composantes de l'IDH burkinabè, l'éducation reste en marge
avec des performances relativement plus faibles.
Tableau : distribution des revenus au Burkina Faso de
1994 à 2009
|
1994
|
1998
|
2003
|
2009
|
Y2009-Y1994
|
|
Part du revenu du cinquième quintile (20%)
|
56.7
|
53.5
|
49.7
|
47
|
-9.7
|
|
Part du revenu du quatrième quintile (20%)
|
18.4
|
18.5
|
21
|
20.9
|
2.5
|
|
Part du revenu du troisième quintile (20%)
|
11.8
|
12.9
|
14
|
14.8
|
3
|
|
Part du revenu du second quintile (20%)
|
7.9
|
9.3
|
9.5
|
10.6
|
2.7
|
|
Part du revenu du premier quintile (20%)
|
5.1
|
5.9
|
5.8
|
6.7
|
1.6
|
Construit a partir des données banque mondiale
(distribution des revenus au Burkina Faso)
2. De la stabilité politique au Burkina Faso
La stabilité politique a constitué un atout
majeur du Burkina Faso depuis l'instauration du multipartisme en 1991. En
effet, des élections « démocratiques » ont
été régulièrement organisées, et en
matière de droits politiques et de liberté civile, le Burkina est
bien classé parmi ses paires du tiers monde (BAD, 2012).
Néanmoins, en 2011 le pays a enregistré des troubles politiques
qui selon le rapport de la BAD (2012, 2), s'expliquent surtout par le «
faible niveau de solidarité sociale caractérisant les politiques
publiques, et une crise de confiance dans les institutions ».
Les événements récents d'octobre 2014,
qui ont valu la chute de l'ex-président Blaise Compaoré avant la
fin de son mandat et la mise en place d'un régime de transition viennent
confirmer la crise de confiance des burkinabè dans leur institutions.
Cependant, le Burkina Faso demeure un exemple en matière de paix et de
stabilité, au regard de la manière dont ce pays à su
gérer « sa crise », en limitant les dégâts et en
réussissant à passer le cap de « l'ère Blaise
Compaoré », c'est-à-dire 27 ans de règne sans partage
du pouvoir et une dernière tentative manquée de modification de
la constitution pour se maintenir au pouvoir.
Le pays est actuellement dirigé par un gouvernement de
transition. Des élections sont prévues pour novembre 2015, et les
clauses actuelles de la Charte de la transition permettent de justifier un
optimisme vis-à-vis de la paix et de la stabilité politique au
Burkina Faso dans les prochaines années.
II. Du boom minier au Burkina Faso
Le Burkina Faso à profité de la hausse du cours
de l'or pour dynamiser son secteur aurifère et en faire aujourd'hui l'un
des piliers et des principales sources de revenu de son économie. Nous
tenterons de présenter sommairement les différentes phases de
30
développement du secteur minier burkinabè, le
cadre réglementaire et les innovations institutionnelles qui ont
favorisé son expansion, avant de discuter des performances de secteur et
de sa contribution à la croissance.
1. Développement du secteur minier
Le développement du secteur minier burkinabè est
très récent. En effet, l'exploitation de l'or existe depuis 1960
mais il faut attendre 2008 pour que le passage de l'exploitation traditionnelle
à l'exploitation moderne se concrétise par une croissance
exponentielle de la production. La production d'or du Burkina Faso a atteint
5.8 tonnes en 2008, contre 1.58 en 2007 (Rapport public CES 2011). Ce chiffre
à évolué à 12.5 tonnes en 2009, avec la mise en
exploitation de quatre mines industrielles. L'or devient alors le premier
produit d'exportation du Burkina Faso avant le coton. Depuis 2014, huit mines
aurifères sont en activité au Burkina Faso. Il s'agit de la mine
de Taparko, Youga, Mana, Kalsaka, Inata, Essakane, Guiro-Bayildiaga et
Bissa-Zandkom. La production d'or a progressivement évolué pour
se chiffrer a environ 32.5 tonnes en 2013 et 36.5 tonnes en 2014
(données nationales, Conseil des Ministres du 1er Avril
2015).
Pour répondre aux enjeux économiques, sociaux,
environnementaux et politiques liés au boom minier, le Burkina s'est
porté candidat à l'Initiative pour la Transparence des Industries
Extractives en 2009. En février 2013, Il obtient le statut ITIE de Pays
Conforme. Cela traduit d'une part les efforts du gouvernement en matière
de transparence et de bonne gouvernance et d'autre part, le résultat de
pressions internationales. D'après le rapport ITIE 2014, le gouvernement
burkinabè à déclaré avoir perçu au total
371.46 millions de dollars US de rentes tirés de l'exploitation
minière pour l'année 2012. Elles comprennent les recettes
fiscales (fiscalité intérieure et les recettes douanières)
et les recettes de service (royalties et taxes superficiaires).
A côté de ce secteur industriel, l'orpaillage
traditionnel occupe également une place non négligeable. Selon le
ministre Salif Lamoussa Kaboré, lors de sa conférence à
l'IFRI le 20/01/2014 : « On estime que plus de 1000 000 personnes sont
directement impliquées. Si on y ajoute les populations riveraines, on
évalue à 1.3 million environ, le nombre de personnes qui tire un
revenu quelconque de cette activité ». Le FMI insiste sur la forte
probabilité d'une sous estimation de la production des mines artisanales
: « Selon un rapport de 2011 du Ministère de l'environnement et
des affaires sociales et un rapport du CES, 700 000 personnes travaillent
directement dans les mines artisanales. La production artisanale
déclarée n'était que de 431 kg en 2011 : sur la base des
cours internationaux de l'or cette
31
année-là et d'hypothèses prudentes
sur le nombre de personnes (500.000) et les coûts des intrants nuls (0),
cela représenterait un revenu mensuel de 5 dollars par personne, ce qui
n'est absolument pas réaliste,... » (Rapport FMI N°
.14/230, page 23).
Graphique 4. Production d'or au Burkina
Faso
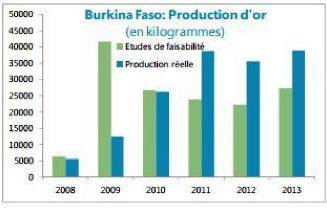
Source : Rapport FMI No. 14/230, page 22
2. Cadre réglementaire et institutionnel
L'activité minière du Burkina Faso
bénéficie d'un encadrement ministériel formalisé
depuis 1995. Depuis l'avènement du boom minier une restructuration a
été effectuée en avril 2012, donnant lieu à des
innovations telles que la création de la Direction
Générale des Carrières (DCG) et des structures
décentralisés, notamment les directions régionales.
Le ministère en charge des mines est organisé en
deux sections : Le Cabinet du ministre et le Secrétariat
Général qui comprend les Bureaux d'Etudes, la cellule
environnementale, la documentation, les archives, etc.
Le cabinet du ministre assure directement le contrôle
des activités à travers l'Inspection Technique des Services (ITS)
et la Brigade Nationale Anti-Fraude de l'or (BNAF). Le document de Politique
sectorielle des mines 2014-2015 (p14), du ministère, précise que
« L'ITS veille à l'application de la politique du
département dans le domaine des activités minières et
énergétiques et assure le suivi-conseil et le contrôle du
fonctionnement des services, des projets et programmes ». Tandis que comme
son nom l'indique, la BNAF « a
32
pour mission la recherche, la constatation et la poursuite des
infractions à la législation et à la réglementation
relative à la commercialisation de l'or ».
Le cadre législatif et réglementaire du secteur
minier burkinabè est régi par un ensemble de textes juridiques
nationaux, sous-régionaux et internationaux tels que la constitution et
ses modificatifs, les règlements de l'UEMOA et de la CDEAO, l'ITIE, le
Processus de Kimberley, le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
Le ministère en charge des mines attire l'attention sur
les insuffisances de ce cadre, l'existence de vide juridique et insiste sur la
nécessité d'actualiser certains textes réglementaires :
« Ainsi, il apparaît nécessaire d'actualiser certains
textes réglementaires ayant trait au transport, au stockage et à
l'utilisation des substances explosives, aux formes de rapports, à la
dépense minimale au km2, aux bijouteries. De même de
nouveaux textes pour réglementer le transport, le stockage et
l'utilisation des produits dangereux (cyanure...) doivent être
élaborés » Politique sectorielle des mines 2014 - 2025
(page 17).
Le code minier du Burkina Faso, adopté en 1997, a subi
une révision en 2003 qui a considérablement accru
l'attractivité du secteur. Ce code est critiqué de ne pas prendre
en compte le développement local, la sécurisation des sites
miniers et la protection de l'environnement. L'expansion sans
précédent du secteur minier burkinabè, est aussi un
argument qui interpelle à la nécessité d'une
réadaptation de l'environnement juridique national afin de renforcer la
contribution du secteur au développement soutenable du pays tout en
maintenant son attractivité (Politique sectorielle des mines 2014 -
2025).
3. Les potentialités et les facteurs explicatifs du
boom minier
a) Les facteurs explicatifs du boom minier au Burkina
Faso
Deux principaux facteurs expliquent le boom sans
précédent du secteur minier burkinabè :
l'attractivité du code minier burkinabè et la hausse du cours de
l'or.
? L'attractivité du code minier : elle
réside dans les nombreux avantages
fiscaux qu'il accorde aux investisseurs dans les
différentes phases de l'exploitation.
En phase de recherche, les investisseurs
bénéficient d'une exonération de la TVA pour les
importions et l'acquisition des équipements nécessaires à
leurs travaux. Les services fournis par les entreprises de géo-services
et assimilés sont exempts de TVA. Le code minier garanti
également aux investisseurs une exonération de l'impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de la patente, de
l'impôt minimum forfaitaire sur les professions
33
industrielles et commerciales (IMFPIC), de la taxe patronale
et d'apprentissage (TPA), des droits d'enregistrement sur les actes portant sur
une augmentation du capital. Les droits de douane sont également
réduits au taux de 5%.
Pendant la phase des travaux préparatoires,
l'exonération de la TVA se poursuit pendant les deux premières
années. Les droits de douanes s'annulent également pour les
importations de matériels, matières premières, carburant,
lubrifiants et pièces détachées.
En phase d'exploitation, le code minier gratifie les
investisseurs d'une réduction de 10% du taux de droit commun de
l'impôt sur les bénéfices industriels commerciaux (BIC),
d'une réduction de 50% du taux de droit commun de l'impôt sur les
revenus des valeurs mobilières (IRVM). Les droits de douanes sont de 5%
et pendant 7 ans, les investisseurs bénéficient d'une
exonération de l'impôt minimum forfaitaire sur les professions
industrielles et commerciales (IMFPIC), la contribution des patentes, la taxe
patronale et d'apprentissage (TPA), la taxe des biens de mainmorte (TBM).
La quantification des différentes exonérations
accordées par le code minier burkinabè, réalisée
par le ministère de l'économie et des finances fait état
d'environ 1% du PIB en moyenne sur la période 2007 à 2012. Ce
constat a conduit une partie de la société civile
burkinabè à revendiquer une révision du code minier. A cet
effet, un projet de loi à été introduit en 2013 et est
toujours en cours de relecture.

? Le prix de l'or : Il a connu une
flambée de plus de 450% entre 2003 et 2011
(Rapport KPMG 2011). La crise financière de 2008 aurait
contribué à accentuer la hausse en provoquant un
déplacement majeur de fonds vers l'or avec la chute des cours boursiers,
des prix de l'immobilier combiné à la grande incertitude
économique. Ainsi, une hausse de la demande et une offre mondiale qui
n'a pas pu s'ajuster immédiatement a occasionné une hausse du
prix de l'or qui s'est durablement maintenue avant de se stabiliser vers le
second semestre 2011 sur un palier élevé (graphique 6).
La combinaison de ces deux facteurs : avantages du code minier
et hausse providentielle des cours de l'or, à valu au Burkina Faso
l'afflux d'investissements ayant propulsé son secteur minier.
Graphique 6 : prix quotidien de l'or entre 2003 et
2013 ;
($ US/once troy; London Bullion Market)

(Extrait du rapport KPMG 2013, page 14)
b) Les potentialités du secteur minier
burkinabè
« L'or brille de partout au Burkina Faso », cette
phrase, intitulé d'un article affiché sur le site web de la
présidence du Burkina Faso1, résume l'étendue
du potentiel minier burkinabè. En effet, le pays dispose de plus 70 000
km2 de superficie de formation volcano-sédimentaire qui dans
la sous-région ouest africaine regorge de nombreuses
potentialités en ressources minérales. Les principales ressources
du Burkina Faso sont l'or, le cuivre, le zinc, le manganèse, le
phosphate et les calcaires. Des indices de Diamant, bauxite, nickel, et
vanadium ont été également répertoriés.
Depuis 2007, les travaux d'exploration se sont
accentués au Burkina Faso. Sur la base des travaux du service national
de géologie (BUMIGEB), les sociétés de recherche
minière investissent tout le territoire national pour mettre en
évidence les gisements prometteur en termes de stocks, de teneur et de
rentabilité. Plus de 600 permis de recherche valides sont
répertoriés au 31 décembre 2014. Ainsi, le Burkina Faso
est actuellement le pays le plus dynamique dans la sous-région avec plus
de 986 autorisations et titres miniers valides. Le
34
1
http://presidence.bf/les-dossiers-2/lor-brille-de-partout-au-burkina-faso/
35
Burkina Faso est quatrième producteur d'Afrique de
l'ouest, et troisième en matière d'activités
d'explorations.
Les réserves des mines en activités au Burkina
Faso sont estimées à environ 260 tonnes, soit une dizaine
d'années d'exploitations avec le rythme actuel de production de 30
tonnes environ par an. Selon le Rapport FMI n° 14/2030 (2014), les
récentes découvertes de gisements donnent à penser que les
réserves non exploitées sont beaucoup plus importantes, le pays
aurait ainsi le plus grand nombre de gisements reconnus non encore
exploités en Afrique de l'ouest. Le graphique 5 résume la
situation actuelle des ressources minières au Burkina Faso. Par
ailleurs, contrairement à la lecture du Rapport KPMG (2009), qui
estimait la qualité des gisements du Burkina Faso « moins que
remarquable » au regard de la teneur moyenne de 2 g/t des sites en
exploitation, la teneur de certains nouveaux gisements découverts laisse
présager une plus grande rentabilité (près de 12g/t sur le
site du projet Yaramoko). Le FMI table sur une activité minière
qui se poursuivra à un rythme robuste pendant les 10-15 prochaines
années.
Malgré l'importance du potentiel minier, force est de
reconnaitre que l'or en tant que ressource non renouvelable finira par
s'épuiser. Le pays doit donc se préparer dès maintenant
à cette évidence, afin de mieux faire de l'or une
bénédiction pour le Burkina Faso.
36
Graphique 5 : potentiel minier du Burkina
Faso
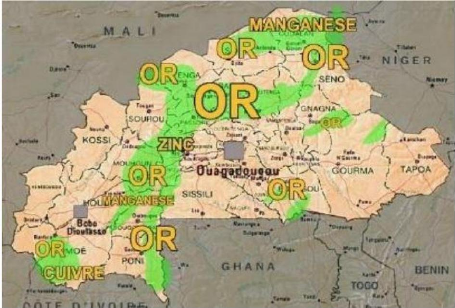
Sources : DGMG (Extrait du Rapport ITIE 2014, page
21)
III. Contribution, vulnérabilité et
risques
1. Contribution du secteur minier à
l'économie burkinabè
Les données disponibles pour évaluer la
contribution du secteur minier à l'économie burkinabè sont
essentiellement issues des différents rapports ITIE. Depuis
l'adhésion du Burkina Faso à l'initiative pour la transparence
des industries extractives, cinq rapports de conciliation ont été
publiés. Ils couvrent la période de 2008 à 2012. Le
tableau 6 résume les données tirées de ces rapports,
concernant les revenus du secteur minier, la part dans les exportations, la
part dans les revenus de l'état et la part dans le PIB. Par ailleurs, on
identifie plusieurs publications d'institutions nationales et internationales
tentant de situer la place du secteur minier dans l'économie. On peut
citer le rapport CES 2009, le rapport FMI No. 14/230, la communication CNPE
2013, etc.
Le secteur minier constitue une importante source de revenu
pour l'Etat burkinabè, entre 2008 et 2012, cette part n'à
cessé de croitre. Elle est passée de 0.24% du budget national en
2008 à 14% en 2012. Si on prend en compte le principe de l'unité
de caisse qui implique que toutes les recettes de l'Etat soient
centralisées avant d'être allouées aux différents
37
ministères pour la mise en oeuvre des politiques
publiques, on peut dire que l'Etat burkinabè a vu sa capacité
d'action s'accroitre d'environ 14%. Ainsi, lorsqu'on considère les deux
principales fonctions de l'Etat, à savoir l'Etat prestataire de service,
et l'Etat acteur de transformation sociale (Khan 2003), le secteur minier
participe directement au renforcement du rôle de prestataire de service.
Malgré l'importance de la contribution du secteur minier au budget de
l'Etat, c'est la capacité de l'Etat burkinabè à
transformer cette manne en infrastructures de développement, en
amélioration du capital humain (santé et éducation) qui
décidera du sort des générations présentes et
futures.
La part du secteur minier dans le PIB national a atteint 10.6%
en 2012. Le secteur minier à également vu sa part accroitre dans
les exportations du pays (72% en 2012 contre 22.6% en 2008), cependant nous
sommes amenés à penser qu'il n'y pas de quoi se féliciter,
mais plutôt de quoi s'inquiéter. En effet, Les données de
l'ITIE concernent particulièrement le secteur minier moderne, or ce
secteur est connu pour son faible effet multiplicateur dans les autres secteurs
de l'économie. Le principal canal par lequel le secteur minier moderne
participe à la dynamique économique nationale est sa
participation au budget de l'état, donc sa capacité à
accroitre le rôle de l'Etat prestataire de service.
Nous critiquons la vision traditionnelle consistant à
considérer les IDE du secteur minier comme un accroissement de capital
physique. En effet, la générosité du code minier
burkinabè exonère pratiquement de tout impôt et taxe
l'importation de matériels, d'équipement et toutes autres
fournitures entrant dans le processus de recherche et d'exploitation des
entreprises minières, ce qui veut dire que l'Etat ne tire pratiquement
aucun revenu sur ces transactions. Ensuite, le capital physique et
technologique importé, de même que les investissements en termes
d'expertise humaine investis dans les industries minières sont
entièrement amortis proportionnellement à la durée de vie
de la mine, donc il ne subsiste pratiquement aucune valeur résiduelle de
ces investissements à la fin du cycle d'exploitation de la mine. Nous
considérons donc que ces IDE sont stériles, et la mise en
exploitation d'une mine industrielle ne constitue pas à proprement
parler un accroissement du capital physique national.
La deuxième contribution du secteur minier
burkinabè est son rôle non négligeable dans la
création d'emplois. En effet, tandis qu'en 2005 on ne comptait que 180
employés dans ce secteur, au 31 décembre 2012, les mines
industrielles totalisent en tout 7217 employés. Parmi eux, seuls
quelques 396 employés (5%) sont des non nationaux. Certes cela traduit
toujours un manque d'expertise nationale, mais également un transfert de
savoir faire car les
38
non nationaux lorsqu'ils ne sont pas des dirigeants, sont des
experts dont les compétences sont rares au Burkina Faso.
Tableau 6 : Contribution du secteur minier a
l'économie burkinabè
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Montant des revenus selon les formulaires ITIE
|
1.83
|
19.46
|
--
|
--
|
--
|
|
Montant déclaré par les sociétés
minières
|
1.52
|
15.93
|
21.51
|
108.8
|
184.25
|
|
Montant déclaré par le gouvernement
|
1.67
|
10.7
|
22.83
|
109.9
|
186.84
|
|
Part dans les exportations
|
22.60%
|
46%
|
67%
|
77%
|
72%
|
|
Part dans le budget de l'état
|
0.24%
|
2.11%
|
2.60%
|
10.15%
|
14%
|
|
Part dans le PIB
|
--
|
--
|
0.70%
|
2.18%
|
10.60%
|
|
Emplois
|
|
|
|
|
0.16%
|
Synthèse des rapports ITIE de 2008 à
2012
2. Contribution du secteur au développement
local
La contribution du secteur minier au développement
local est surtout mesurable à travers les actions des entreprises
minières, le nombre d'emplois nationaux locaux créés et
surtout le type de partenariat. En effet, dans le souci de préserver la
cohésion sociale et d'accompagner l'Etat et les collectivités
dans leurs actions de développement local, les sociétés
minières ont entrepris un certain nombre de réalisations dans les
domaines de l'éducation, de la santé et autres services
sociaux
A titre d'exemple, en 2010 la Société
Exploitation Minière en Afrique de l'Ouest (SEMAFO) qui exploite la mine
de Mana a créé une fondation chargée de gérer le
volet social et humanitaire de son action. Elle a contribué entre autre
à la mise en place d'une unité de production de beurre de
karité biologique, d'une unité artisanale de savonnerie au profit
des femmes, à la construction d'écoles, de forage etc. La
société JAM GOLD, qui exploite le site d'Essakane, après
une relocalisation des populations sur un nouveau site de plus de 2000
bâtiments, continue de les accompagner dans la fourniture de services
sociaux et le développement d'activités
génératrices de revenu.
De toute évidence, le premier objectif d'une industrie
minière est la recherche de profit, c'est pourquoi nous pensons que les
actions menées par ces sociétés dans le social et au
profit des populations riveraines, bien que non négligeables, ne sont
que symboliques et principalement destinées a « apaiser les coeurs
». En effet, dans la communication CNPE de juillet 2013 sur la place des
ressources minières dans l'économie burkinabè, il est
question de : Huit (08) écoles ; quatre (04) dispensaires ; deux
(02) maternités ; deux mille cent dix
39
huit (2 118) logements , des forages, deux (02)
systèmes d'adduction d'eau potable ; des lieux de culte; deux (02)
garderies d'enfants; trois (03) ambulances , un (01) centre
d'alphabétisation , La réalisation et/ou l'entretien de routes
d'environ 257 km de route; la construction de deux barrages , des
réalisations en pisciculture et en culture maraîchère ,
deux (02) parcs de vaccination à bétail et de deux (02) abattoirs
, construction d'une banque de céréales ainsi qu'un marché
et 165 boutiques. Au regard de l'importance du secteur, de telles
réalisations paraissent insignifiantes et ne peuvent être que
symboliques.
Au delà des actions directes dans le social, les
industries minières participent au développement local par la
création d'emplois locaux. En effet, une distinction des employés
par origine géographique permet de voir l'importance de la main d'oeuvre
locale dans les industries minières. Ainsi, en décembre 2011,
environ 37,6% des emplois miniers sont occupés par des locaux. Quand on
sait que la rémunération moyenne du secteur est relativement au
dessus de la moyenne nationale, on peut dire que ce canal permet de dynamiser
la petite économie locale.
3. Vulnérabilité et risques de
malédiction
a) Boom minier et vulnérabilité de
l'économie burkinabè
La science économique définie la
vulnérabilité comme « le risque pour un pays d'être
durablement affecté par des facteurs exogènes et imprévus
» (Guillaumont 2006). Si nous retenons cette définition dans le cas
du Burkina Faso et en lien direct avec le développement récent de
son secteur minier, la principale source de vulnérabilité de ce
pays n'est autre que le cours mondial des matières premières,
notamment le cours de l'or. En effet, comme nous l'avons expliqué plus
haut (II.3.a les facteurs explicatifs du boom minier), sans la hausse du cours
de l'or, le secteur minier burkinabè n'aurait pas connu son essor
remarquable. Or le prix de l'or n'est qu'une donnée pour le Burkina
Faso. Il est déterminé depuis 1914 par les membres de la London
Bullion Market (LBM), le prix LBM sert ensuite de référence pour
les transactions « over the counter » (OTC) qui vont
déterminer à leur tour un prix spot ou à terme (Rapport
KPMG 2013).
Cette vulnérabilité liée au cours de l'or
est très élevée. D'après le Rapport Public CES
(2013), 84% des variations de la quantité d'or produite au Burkina Faso
s'expliquent par la variation du cours de l'or. Une hausse de 1 dollar US
entrainerait une augmentation de la quantité produite de 23.2 kg. Dans
le même ordre d'idée, le rapport KPMG précisait que l'or
40
du Burkina ne serait plus rentable si le cours de l'or passait
en dessous du seuil de 1425$ US l'once.
Malgré l'exposition du pays aux chocs extérieurs
liés directement au prix de l'or, le boom minier contribue à
réduire la vulnérabilité économique de
l'économie burkinabè dans son ensemble. La
vulnérabilité économique telle que mesurée par
l'Indice de Vulnérabilité Economique regroupe trois composantes :
l'ampleur et la fréquence des chocs exogènes, l'exposition aux
chocs et la résilience aux chocs qui mesure la capacité de
réaction par rapport à ces chocs. L'exploitation de l'or aurait
donc des effets sur les deux premières composantes. Elle contribuera
à réduire l'ampleur et la fréquence des chocs en
diversifiant la base de l'économie et les sources de revenu des
populations. Le niveau de production dans ce secteur étant moins
dépendant des aléas climatiques et des autres secteurs de
l'économie, ce secteur participera à réduire l'exposition
aux chocs naturels et donc la vulnérabilité. De même,
lorsqu'on considère l'indicateur d'exposition aux chocs tel que le
coefficient de concentration des exportations inclus dans l'EVI,
l'émergence du secteur minier participe à réduire la
concentration des exportations en augmentant le nombre de produits
exportés.
b) Le Burkina Faso et la malédiction des
ressources naturelles
Notre analyse porte particulièrement sur les risques
pouvant conduire le Burkina Faso dans une situation de malédiction des
ressources naturelles. Elle se base sur les conclusions du chapitre 1 du
présent document et consiste à voir par rapport aux
caractéristiques actuelles du pays et les théories explicatives
de la malédiction des ressources naturelles, comment le boom minier
pourrait engendrer des effets pervers et handicaper le décollage
économique et le bien être des générations
futures.
Des six principales théories explicatives de la
malédiction des ressources naturelles, trois d'entre elles retiennent
notre attention et semblent le plus menacer l'économie burkinabè
: la volatilité des cours des matières premières,
l'éviction du secteur manufacturier et la mauvaise qualité
institutionnelle.
c) La volatilité des cours des matières
premières
La volatilité des cours des matières constitue
l'un des premiers éléments de risque de malédiction au
Burkina Faso. En effet, la sensibilité de la production minière
du Burkina Faso au cours international n'est plus à démontrer
(les variations du cours de l'or explique environ 84% des variations de la
production d'or au Burkina Faso d'après le Rapport Public CES 2013). En
2012, la légère baisse du cours de l'or s'est pratiquement
traduite par une stagnation de la production, et une baisse de la contribution
du secteur au budget de l'Etat par
41
rapport aux prévisions nationales. Du fait de son
rôle décisif dans l'émergence du secteur minier
burkinabè, les cours mondiaux de l'or et leur volatilité
représentent un facteur de vulnérabilité et de risque
pouvant conduire le pays dans une situation de malédiction. Dans sa
publication sur les perspectives économiques en Afrique, l'AFDB (2012, p
2) précise que : « L'économie du Burkina Faso demeure
vulnérable, d'une part aux fluctuations des cours mondiaux des
matières premières, or, coton et pétrole essentiellement,
d'autre part aux conditions climatiques ». Une fluctuation des cours
autour du seuil de rentabilité pourrait entrainer des
micro-périodes de chômage frictionnel, de baisse des recettes de
l'Etat, et finalement une situation ou l'exploitation minière servirait
juste à couvrir des frais de fonctionnement sans accumulation de capital
physique et humain.
ii) L'éviction du secteur manufacturier
Lorsqu'on applique la théorie de la malédiction
par la logique d'éviction au cas du Burkina Faso, on se rend compte que
le boom minier crée de nombreuses distorsions dans l'économie
burkinabè. Ces distorsions s'observent aussi bien dans le secteur
manufacturier, dans l'agriculture, dans le marché de l'emploi, et au
niveau du système éducatif.
Dans le secteur manufacturier, on observe directement une
hausse généralisée des prix autour des sites miniers, de
sorte que les populations locales s'appauvrissent à cause de la baisse
de leur pouvoir d'achat. La hausse de revenu des orpailleurs est directement
absorbée par la hausse des prix. L'agriculture souffre surtout de la
perte de ses bras valides à cause de l'orpaillage artisanal. En effet,
des 13000002 personnes de la population qui tire un revenu
quelconque de l'orpaillage traditionnel, beaucoup sont issues du milieu rural
agricole.
Les distorsions du marché de l'emploi concernent
l'attractivité des salaires dans le secteur minier moderne et le manque
de personnel qualifié. Ainsi, le secteur minier a dans la
majorité des cas, extrait les compétences dont il avait besoin
dans le secteur public et les entreprises locales. Toutes choses qui
participent à une baisse de la productivité dans ces secteurs qui
ont pourtant un effet multiplicateur nettement plus élevé que le
secteur minier. De même, le ministère en charge du secteur minier
burkinabè manque de personnel qualifié pour appliquer les textes,
effectuer les contrôles et vérifier que les entreprises
minières respectent les clauses de leur contrat avec l'Etat
burkinabè.
2 LES ENJEUX DU SECTEUR MINIER DU BURKINA FASO
(Conférence du ministre Salif Lamoussa Kaboré à l'IFRI.
20/01/2014,
http://www.ambaburkina-fr.org/les-enjeux-du-secteur-minier-du-burkina-faso-conference-du-ministre-salif-lamoussa-kabore-a-lifri-20012014/
42
Le dernier point concerne les effets pervers du boom minier
sur le système éducatif national. En effet, nombreux sont les
enfants qui désertent l'école pour servir d'aides dans les mines
artisanales. Ce phénomène pose d'ailleurs un véritable
problème de droit humanitaire, et certaines ONG n'hésitent pas
à dénoncer les conditions de travail et de vie précaire
dans ces mines. C'est l'exemple du media indépendant IRIN, un article
publié en septembre 2012 souligne l'importance des effets de la
ruée vers l'or sur l'éducation au Burkina Faso3.
iii) La mauvaise qualité institutionnelle
La mauvaise qualité institutionnelle concerne
directement la façon dont la rente est redistribuée et/ou
réinvestie via l'arrangement institutionnel. A la lecture du code minier
burkinabè, les institutions burkinabè semblent clairement
afficher leur volonté de rechercher la rente à tout prix. Ainsi,
les nombreux avantages du code s'apparentent plutôt à une braderie
des ressources minières du pays au premier venu. Il n'est pas question
de créer les conditions de l'émergence d'un secteur minier acteur
de développement local et national soutenable, mais plutôt
d'attirer rapidement des investisseurs dans une logique d'accaparement rapide
de la rente. C'est ainsi que les vides juridiques, les nombreux
dysfonctionnements de la bureaucratie, la corruption entrainent des fuites
énormes en matière de collecte de la rente, et le principe
d'unité de caisse rend difficile l'observation de l'usage de la rente et
sa contribution au bien être des populations. Dans les deux premiers
rapports ITIE 2008 et 2009 réalisés par le groupe KPMG, la
méthodologie adoptée consistait dans un premier temps à
estimer le montant des recettes dues par les entreprises minières selon
les formulaires ITIE, puis ce que ces derniers déclarent avoir
payés et enfin ce que l'Etat déclare avoir reçu. On peut
ainsi constater un premier écart de l'ordre de 300 millions de FCFA en
2008 et 3.5 milliards de FCFA en 2009 entre ce qui est dû à l'Etat
burkinabè selon les formulaires ITIE et ce que les entreprises
déclarent avoir payé. Les rapports 2010, 2011 et 2012 ne font
plus ce type de rapprochement, cela traduit la faiblesse et la mauvaise
qualité des institutions qui semble n'avoir aucun moyen de
contrôle sur les entreprises, et préfèrent donc passer sous
silence certains points afin d'éviter les remous des populations.
3 BURKINA FASO: L'éducation, victime de la
ruée vers l'or,
http://www.irinnews.org/fr/report/96222/burkina-faso-l-%C3%A9ducation-victime-de-la-ru%C3%A9e-vers-l-or
43
iv) Le syndrome hollandais
Le Burkina Faso est loin d'être dans une situation
où le boom minier provoquerait une appréciation du taux de change
réel à même de déstructurer son économie.
Ainsi le Burkina Faso conserve malgré le boom minier la même
structure économique que celle d'antan : le secteur primaire constitue
toujours la base de son économie et le secteur tertiaire la
première source de valeur ajoutée. Néanmoins, au regard de
la tendance baissière de la contribution du secteur primaire et du
secteur tertiaire a la valeur ajoutée totale depuis 2005, et des taux de
croissance moyens qui ne se sont pas nettement améliorés, on
pourrait y voir les premiers signes de la maladie hollandaise. Le taux de
croissance du Burkina s'est situé en moyenne à environ 3%, 7% et
5% respectivement entre 1980 et 1995, 1995 et 2005, 2005 et 2011 : le
développement du secteur minier s'accompagne d'une baisse de dynamisme
dans les autres secteurs. Le syndrome hollandais se manifeste directement par
une augmentation du niveau général des prix, et une
appréciation du taux de change réel. Or dans le cas du Burkina
Faso, le FMI fait observer que malgré des pics occasionnels de l'ordre
de 10 à 14% comme en 2008-2009, le taux d'inflation s'est maintenu en
moyenne en dessous de 4%. Quant au taux de change réel, il
s'apprécie lorsque la balance commerciale est excédentaire :
l'entrée nette de capitaux provoquant une hausse du pouvoir d'achat, des
pressions inflationnistes et donc une augmentation du rapport des prix
intérieurs par rapport aux prix extérieurs. Dans le cas
précis du Burkina Faso, la balance commerciale demeure
déficitaire même si le pays enregistre par moment de faibles
appréciations du taux de change réel comme au premier trimestre
2012 (02%). Le Burkina Faso semble donc être à l'abri du syndrome
hollandais, contrairement a ce que la première lecture du recul du
secteur primaire et tertiaire pourrait laisser croire.
Les deux autres théories explicatives de la
malédiction que nous avons évoqué dans notre chapitre 1 ne
semblent pas tant que ça menacer l'économie burkinabè plus
que l'économie de tout autre pays en développement. En effet,
l'évolution des prix mondiaux a long terme telle qu'exposée par
la thèse de Prébish et Singer ne semble pas fonctionner dans ce
cas précis, du fait de la hausse soutenue du cours de l'or
observé depuis 2003. Quant aux risques d'éclatement de guerre
civile et d'apparition d'institutions anarchiques, jusqu'à
présent le peuple burkinabè s'est montré très
pacifique et les différents acteurs renouvellent à chaque
occasion leur ferme intention de préserver la paix et l'ordre social.
44
Conclusion
Le Burkina Faso à peiné à se trouver un
modèle de croissance stable et soutenu jusqu'en 1995. En faveur de la
dévaluation du FCFA, le coton a porté la croissance du pays
jusqu'en 2008, ou l'or a pris le relais en se hissant au rang de premier
produit d'exportation. Malgré une croissance économique soutenue
et relativement plus stable, les conditions de vie des burkinabè ne
semblent pas s'améliorer significativement. La croissance participe
faiblement à la réduction de la pauvreté malgré les
quelques progrès enregistré par l'IDH. Néanmoins, la
stabilité politique demeure un atout pour ce pays.
Le développement sans précédent du
secteur minier burkinabè est principalement dû à la
générosité de son code minier et à la hausse des
cours de l'or. Le Burkina s'est ainsi découvert d'énormes
potentialités minières et pourra très probablement compter
sur ce secteur dans la dizaine d'années à venir. L'or participe
directement au budget de l'Etat en augmentant sa capacité d'action
d'environ 15%. Néanmoins, la contribution du secteur au
développement local est très limitée et tout semble
indiquer que la contribution du secteur au développement soutenable
réside uniquement dans l'usage que l'Etat burkinabè fait de ses
recettes fiscales. De ce fait, La destruction du capital naturel doit
nécessairement s'accompagner d'une accumulation de capital physique et
humain, sans quoi l'or du Burkina ne pourrait être une
bénédiction pour les générations présentes
et futures.
La première source de vulnérabilité du
secteur minier burkinabè réside dans sa dépendance au
cours internationaux de l'or. La production est très sensible aux
variations du prix de l'or, malheureusement tout semble indiquer que l'Etat
burkinabè n'a aucun pouvoir sur cette donnée et doit se contenter
tout simplement de considérer l'éventualité dans la mise
en oeuvre de ses politiques. De façon globale, le boom minier participe
a réduire la vulnérabilité économique du Burkina
Faso en diversifiant ses sources de revenus, et en stabilisant les fluctuations
de son taux de croissance.
En matière de risque de malédiction des
ressources naturelles, la volatilité des cours des matières
premières constitue l'un des premiers facteurs de risque auxquels le
Burkina Faso est exposé. Une fluctuation des cours autour du seuil de
rentabilité pourraient entrainer des micro-périodes de
chômage frictionnel, de baisse des recettes de l'Etat, et finalement une
situation ou l'exploitation minière servirait juste à couvrir des
frais de fonctionnement sans accumulation de capital physique. Ensuite, dans
son développement, le secteur minier a créé de nombreuses
distorsions dans le secteur agricole par l'extraction de la main d'oeuvre, dans
le secteur manufacturier et l'Etat par l'extraction du personnel
qualifié, et dans le système
45
éducatif avec la déserte des
élèves vers les sites miniers. Si ce phénomène
n'est pas contenu, le secteur minier pourrait compromettre le
développement du pays dans les années à venir. La mauvaise
qualité institutionnelle apparait également être l'un des
principaux facteurs de risque de malédiction. En effet, la corruption,
les détournements, la faiblesse de la bureaucratie et les
stratégies d'accaparement de rente sont encore des fléaux qui
handicapent fortement la contribution du secteur minier au développement
soutenable du Burkina Faso.
Nous avons pu observer que le Burkina Faso ne manifeste pas
encore de signe de maladie hollandaise. Cependant, comment mesurer les effets
du boom minier sur la soutenabilité de la croissance au Burkina Faso ?
Si théoriquement le développement soutenable peut conjurer la
malédiction des ressources naturelles, quelle est alors la situation du
Burkina Faso ? S'inscrit-il dans une logique de transformation du capital
naturel selon la règle de Solow-Hartwick ou assistons nous à une
destruction pure et simple de ce capital ?
46
Chapitre III : De la soutenabilité du secteur
minier burkinabè
Introduction
Le secteur minier occupe une grande place dans
l'économie burkinabè. Du fait de sa concentration autour de
l'exploitation aurifère et autres minerais non renouvelables, le boom
minier peut être assimilé a une destruction de capital naturel.
Analyser la soutenabilité du secteur minier burkinabè implique
donc de définir dans un premier temps les conditions d'une politique
d'exploitation soutenable, puis d'identifier les indicateurs a même de
mesurer le phénomène et enfin de procéder a une analyse
empirique permettant d'avoir une idée sur le niveau de ces
indicateurs.
Dans le cadre de notre analyse, nous avons retenu la
définition du développement soutenable du rapport Brundtland.
Pour être soutenable, le développement doit pouvoir
perpétuer indéfiniment le bien-être de
génération en génération. Cela suppose donc par
rapport à la soutenabilité forte que tous les stocks de capitaux
soient constants au fil du temps, et selon la soutenabilité faible, que
le stock total de capital soit au moins constant dans le temps. Dans notre
travail, nous considérons l'hypothèse de soutenabilité
faible, tout en admettant qu'elle comporte des limites. Dans ces conditions, la
règle de Solow-Hartwick est celle qui définit le mieux les
conditions de soutenabilité de la croissance dans les économies
de rentes : la règle de soutenabilité consiste à investir
toute la rente des ressources non renouvelables dans d'autres types
d'actifs.
Dans quelle mesure l'usage de la rente au Burkina Faso
satisfait-il la règle de Solow-Hartwick ?
Pour répondre à cette question, nous
considérons l'hypothèse d'un changement de régime
d'accumulation du capital physique et humain depuis le boom minier au Burkina
Faso. Si la destruction de capital naturel s'accompagne d'une accumulation de
capital physique et humain plus élevée que celle d'avant le boom
minier, alors le Burkina Faso se serait engagé sur une trajectoire plus
ou moins soutenable. Si tel n'est pas le cas, le Burkina Faso est
nécessairement sur une trajectoire non soutenable, car au terme de
l'épuisement de la ressource, les générations futures
disposeront d'un stock total de capital inférieur à celle de la
génération actuelle.
Nous discuterons dans un premier temps des indicateurs
couramment utilisés pour mesurer le développement soutenable en
ses trois dimensions : économique, sociale et
47
environnementale. Ensuite nous nous pencherons
particulièrement sur l'aspect économique en justifiant le choix
des indicateurs retenus pour mesurer le capital physique et humain du Burkina
Faso, et enfin nous testerons dans le cas du Burkina Faso, l'hypothèse
d'un changement de régime d'accumulation de capital physique et
humain.
I. A la quête d'un indicateur de
développement soutenable
Le choix d'un indicateur dépend fondamentalement de ce
que l'on veut mesurer, des moyens techniques et de son
opérationnalité. Aussi, pour mesurer la capacité d'un Etat
comme le Burkina Faso à transformer la rente de son secteur minier en
d'autres types de capitaux, nous ne nous attarderons pas sur des indicateurs
composites de bien-être, de bonheur ou de dimensions
environnementales.
Il existe déjà une grande diversité
d'indicateurs de développement, nous ne nous vanterons donc pas
d'inventer un nouvel indicateur, mais plutôt d'identifier celui qui
s'approche le mieux de notre conception du développement soutenable, de
tenter d'apporter les ajustements nécessaires pour qu'il s'adapte au
contexte de notre étude. Nous passerons donc en revue quelques
indicateurs couramment utilisés dans la littérature en retenant
leur mérite, mais surtout en isolant les aspects opérationnels
nous permettant de répondre à la problématique de notre
étude. Il s'agit notamment de l'IDH, et de l'épargne nette
ajustée, l'objectif étant de nous inspirer de leur fondement
théorique et empirique afin d'en dériver des substituts
permettant de mesurer le capital physique et humain, pour vérifier notre
hypothèse d'un changement de régime d'accumulation de ces
facteurs au Burkina Faso.
1. De l'IDH à la mesure du capital humain
L'IDH est un indicateur composite créé par le
Programme des Nations Unies pour le Développement afin de mesurer
l'évolution d'un pays selon les trois critères du
développement humain que sont la santé, l'éducation et le
niveau de vie. En tant qu'indicateur composite, l'IDH opère une
pondération de ses trois dimensions. Cela suppose donc une
substituabilité entre ses trois composantes, une simplification
excessive de la réalité qui veut que l'espérance de vie
à la naissance permette d'appréhender la santé de la
population, que le taux d'alphabétisation des adultes et de
scolarisation des primaires capte la seconde dimension du capital humain,
notamment l'éducation. Le niveau de vie quant à lui est
mesuré par le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat en
dollars.
48
Dans notre contexte, l'IDH apporte enseignement sur
l'accumulation de capital humain. Malgré les limites de la
simplification, l'IDH permet d'appréhender les variations du taux
d'accumulation de capital humain (l'éducation et la santé) d'une
période à l'autre en faisant la différence directe entre
deux périodes. Par contre l'IDH n'apporte aucun enseignement sur
l'accumulation de capital physique. L'intégration du PIB par habitant
semble biaiser les données car ce dernier capte positivement la
destruction de capital naturel que représente la production d'or, aussi
en pondérant le PIB par habitant avec l'accumulation de capital humain,
on se retrouve dans une double comptabilité. En effet, en supposant que
l'Etat ait convertit l'intégralité de la rente en capital humain,
pondérer l'éducation et la santé au produit
intérieur reviendrait à comptabiliser la rente et son
équivalent en capital humain.
L'IDH n'est donc pas un indicateur permettant de mesurer
l'accumulation de capital humain et physique, néanmoins en diminuant du
PIB par habitant, on obtient un indicateur non exhaustif, mais suffisamment
robuste pour apprécier le niveau du capital humain.
2. L'épargne nette ajustée
Les premières tentatives de calcul d'un indicateur de
soutenabilité sont apparues autour des années 1990 avec des
économistes tels qu'Atkinson, Pearce ou Repetto. Ces derniers
proposaient alors de soustraire à l'investissement brut tel que
mesuré par la comptabilité nationale, la
dépréciation du capital fixe, la dépréciation du
capital naturel ou l'épuisement des ressources minières afin de
voir si l'extraction de ressource naturelle d'un pays était soutenable
ou pas (Antonin et al. 2011). Depuis lors, cet indicateur a fait l'objet de
nombreuses critiques et de nombreuses tentatives d'ajustement. Ainsi la banque
mondiale fournie de nos jours des statistiques sur l'épargne nette
ajustée, qu'elle définit comme étant égale à
l'épargne nette nationale plus les dépenses en éducation,
moins l'épuisement en énergie, en minéraux et en
ressources forestières et moins les dommages causés par le
dioxyde de carbone et les émissions de particules.
L'épargne nette nationale est calculée en
déduisant du revenu national brut la consommation totale, la
consommation du capital immobilisé et en y ajoutant les transferts
nets.
Dans le contexte de cette étude et dans notre tentative
de mesurer l'accumulation de capital physique et humain, l'épargne nette
ajustée telle que définie peut servir de base pour
l'appréciation de capital physique. En effet, en partant du revenu
national brut qui n'est autre que la somme des valeurs ajoutées produite
par tous les résidents, plus toutes les recettes fiscales (moins les
subventions) non comprises dans la valorisation de la production, plus les
49
réceptions nettes de revenus
(rémunérations des employés et revenus fonciers) provenant
de l'étranger, et en y soustrayant la consommation totale, la
consommation du capital immobilisé, l'épuisement des ressources
minérales, énergétiques, forestières ainsi que les
dommages causés par l'environnement, on obtient un résidu qui
correspond logiquement à l'accumulation de capital physique. En d'autres
termes, l'épargne nette ajustée, telle que calculé par la
banque mondiale, diminuée des dépenses d'éducation
équivaut à l'accumulation de capital physique, sous
réserve que l'épargne soit égale à
l'investissement.
Les données disponibles sur l'épargne nette
ajustée du Burkina Faso sont uniquement les statistiques de la Banque
mondiale. Malheureusement pour le Burkina Faso ces données se limitent
à l'année 2010. Or dans le but de mettre en évidence le
régime d'accumulation de capital physique lié au boom minier, il
est indispensable de disposer des statistiques des années
récentes afin de dégager une moyenne assez indicative. Cette
contrainte majeure nous oblige donc à nous tourner vers d'autres
alternatives de mesure de capital physique notamment la formation brute de
capital physique.
3. La Formation brute de capital fixe
Selon la définition de la banque mondiale, la «
Formation brute de capital (anciennement de l'investissement intérieur
brut) consiste en des dépenses pour des ajouts aux immobilisations
corporelles de l'économie plus les variations nettes du niveau des
stocks ». Elle comprend les améliorations des terres
(clôtures, les fossés, les égouts, etc.); des
végétaux, machinerie et de matériels achats; et la
construction de routes, de chemins de fer, etc., y compris les écoles,
les bureaux, les hôpitaux, les unités résidentielles
privées et les édifices commerciaux et industriels. Selon le SCN
1993, les acquisitions nettes d'objets de valeur sont également
considérées comme de la formation de capital. En d'autres termes,
cet indicateur mesure directement l'accumulation de capital physique par une
approche axée sur la dépense tout en faisant l'effort de prendre
en compte sa dépréciation.
Nous retenons donc cet indicateur dans notre tentative de
mettre en évidence les changements de régime d'accumulation. Nous
nous basons donc sur les statistiques de la Banque mondiale qui fournit les
données sur le Burkina Faso jusqu'à très récemment
en 2014. De même nous traitons directement du taux de croissance de la
formation brute de capital fixe du Burkina Faso sur la base des données
de la Banque Mondiale, qui calcul la croissance annuelle moyenne de la
formation brute de capital fixe en monnaie locale constante. Elle effectue
ensuite une agrégation basées sur les dollars américains
constants de 2005.
50
II. Du choix de la non-pondération du capital
physique et du capital humain
Dans le souci de simplifier et de mieux appréhender la
réalité par le chiffre, les chercheurs en sont arrivés
à des abstractions théoriques permettant de justifier
l'émergence d'indicateurs composites ramenés sur la même
échelle des aspects qualitatifs et des aspects quantitatifs, des objets
d'étude de natures différentes. Si l'accumulation de capital
physique peut facilement être mesurée par les dépenses
d'investissement, la subtilité du capital humain nous parait en revanche
insaisissable par la dépense uniquement.
L'IDH mesure le capital humain en prenant en compte la
santé et l'éducation, le choix de l'espérance de vie et du
taux de scolarisation traduit une logique axée sur les résultats.
Cette approche nous semble plus rationnelle comparativement a l'approche
basée sur les dépenses en éducation qui est retenue dans
la mesure de l'épargne net ajustée. En effet, l'épargne
nette telle que calculée par la banque mondiale ne retient que les
dépenses d'éducation comme indicateur du taux d'accumulation de
capital humain. Or le capital humain étant intrinsèque à
l'Homme, la dépense ne peut en aucun cas refléter son niveau.
C'est ainsi que la construction d'écoles engendre des dépenses
mais ne constitue pas en soit une accumulation de capital humain, encore
faut-il qu'il y'ait un enseignant et que des élèves y soient
instruits. Dans la même logique, des tentatives d'intégrer la
santé dans l'épargne nette ont été
opérées en y ajoutant positivement les dépenses de
santé (Dialga 2013), or nous savons que « des dépenses
élevées en santé peut traduire également une
population malade et donc improductif » Dialga (2013).
Dès lors que le capital humain ne peut
s'apprécier uniquement par la dépense, une pondération
avec les indicateurs monétaires du capital physique peut conduire
à un biais énorme. La soutenabilité faible autorise la
substituabilité entre facteurs de production, mais le prix relatif ou la
préférence sociale d'un facteur par rapport à un autre,
relève des choix politiques et nous parait hors de portée au
stade actuel de nos recherches. Nous nous contentons donc d'observer
individuellement la trajectoire de chaque type de capital, en
considérant que dès lors qu'il y'a destruction de capital
naturel, cela doit nécessairement s'accompagner d'une hausse du taux
d'accumulation du capital humain et/ou physique si la règle de
soutenabilité de Solow-Hartwick est respectée.
Bien que comprenant la logique sur laquelle repose les
pondérations opérées dans les indicateurs tels que l'IDH
ou l'épargne nette ajustée, nous préférons
restreindre le champ d'abstraction de cette analyse afin qu'elle demeure la
plus proche possible de la réalité et
51
aussi compréhensible que possible au profane. C'est
ainsi qu'au regard de la nature du capital humain, du capital physique, et de
l'objectif de cette étude, nous pensons que la non pondération
traduit le mieux la réalité que nous souhaitons quantifier.
III. Burkina Faso et l'hypothèse d'un changement
de
régime d'accumulation de capital physique et
humain
1. Evaluation du capital humain
Afin de vérifier l'hypothèse d'un changement de
régime dans l'accumulation du capital humain depuis le boom minier au
Burkina Faso, nous nous basons sur l'indicateur de développement humain
(IDH), mesuré par le PNUD. En considérant que le capital humain
peut être appréhendé à travers la santé et
l'éducation, nous dérivons de l'IDH l'espérance de vie
comme mesure de l'état de santé de la population et nous retenons
le taux d'alphabétisation des adultes combiné avec le taux de
scolarisation au primaire comme indicateur sur l'éducation. Cependant,
pour des raisons de disponibilité des données, nous ne traiterons
que du taux de scolarisation au primaire et de l'espérance de vie pour
la mesure de capital humain.
Les données sont principalement issues de la base de
données de la banque mondiale. Nous disposons ainsi des statistiques sur
l'espérance de vie (en nombre d'année) et le taux de
scolarisation au primaire en pourcentage du nombre d'enfants scolarisés
sur le nombre total d'enfants en âge d'être scolarisé de
1990 à 2013. Par contre les données sur le taux de scolarisation
des adultes ne sont pas assez complètes pour nous permettre de calculer
les taux de croissance. Nous limitons donc l'indicateur sur l'éducation
au seul taux de scolarisation au primaire.
a) L'espérance de vie au Burkina Faso
Sur la période 1990-2013, l'espérance de vie au
Burkina Faso est passé de 49.36 à 56.27 ; soit un gain de 7 ans
sur une période de 20 ans. Le graphique montre une différence
entre la situation des hommes et des femmes de l'ordre de deux ans en 1990. On
peut constater que cette différence présente une tendance
baissière sur toute la période et se stabilise autour d'un an en
2013. Bien qu'enrichissante, cette analyse ne nous enseigne pas sur les
changements de régimes d'accumulation. Pour mesurer le
phénomène, nous avons donc recours au taux de croissance de
l'espérance de vie, mesurée par la formule
suivante :
TEi =
E1-E1_1x100
52
Avec : TE le taux de croissance de l'espérance de vie,
exprimé en pourcentage de l'espérance de vie de l'année
i-1, pour une année i donnée.
TEi mesure donc la capacité du pays à accumuler
la dimension santé et bien être du capital humain d'une
année a l'autre.
Graphique 6 : Evolution de l'espérance de vie
au Burkina Faso
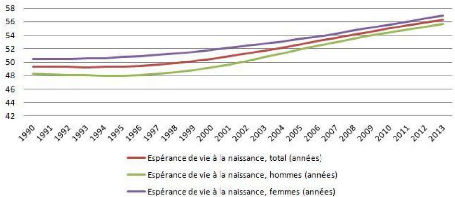
Sources des données : Banque mondiale, graphique de
l'auteur
L'évolution du taux d'accumulation de
l'espérance de vie au Burkina Faso (graphique 7) montre que
contrairement à ce à quoi l'on pourrait s'y attendre, le boom
minier s'accompagne d'un retournement de situation dans l'accumulation des
années de l'espérance de vie. En effet, si le Burkina Faso a
connu un taux de croissance de son espérance de vie en constante hausse
de 1991 à 2003 environ, cette croissance se plafonne autour de 0.9% en
2006, avant d'amorcer une tendance baissière depuis 2007. Ce constat
vient infirmer l'hypothèse d'un changement de régime
d'accumulation en faveur d'un taux plus élevé au niveau de
l'espérance de vie des burkinabè. Au stade actuel de nos travaux,
nous ne pouvons pas établir de liens de causalité directe entre
boom minier et baisse du taux d'accumulation de l'espérance de vie, nous
constatons seulement les résultats paradoxaux qui montrent que par
rapport a ce critère le Burkina Faso semble s'éloigner de la
règle de soutenabilité de Solow-Hartwick.
53
Graphique 7 : Croissance de l'espérance de
vie au Burkina Faso

Source : Calcul et graphique de l'auteur, à partir des
données de la Banque mondiale
b) Taux de scolarisation au primaire
L'analyse graphique de l'évolution du taux de
scolarisation du Burkina Faso, montre de prime abord que les efforts dans ce
domaine se sont concrétisés par une hausse continue de la part
des inscriptions à l'école primaire. En effet, si en 1990,
environ 32.5% des enfants en âge d'être scolarisé
intégraient le système éducatif, en deux décennies
cette part a plus que doublé pour atteindre 86.86% en 2013.
Néanmoins, on peut constater que la plus grande partie de cette hausse a
été réalisée entre 2003 et 2009. La première
décennie 1990-2000 a connue une hausse de 10.5 points environ, tandis
qu'entre 2000 et 2009, on observe une hausse de 32.6 points, soit 3.62 points
de croissance annuelle en moyenne. Par contre, depuis 2009, la situation a
relativement baissée, 2.25 point de croissance en moyenne par an.
L'analyse des taux de croissance de cet indicateur (graphique
8), vient confirmer cette observation en montrant que depuis 2009, le
régime d'accumulation de la dimension éducation du capital
humain, mesuré ici par la croissance du taux de scolarisation s'est
nettement détérioré. Plutôt que d'amorcer un
changement vers un régime plus élevé, le taux
d'accumulation de l'éducation a été négativement
perturbé. Tandis qu'il était stable au dessus de 5% depuis 2003
(de l'ordre de 9% en 2007), en 2010 il passe en dessous de 1%, puis 4% en 2011,
avant de rechuter à 0.2% en 2013. Ainsi, le boom minier ne s'accompagne
pas d'une hausse de la capacité du Burkina Faso à scolariser une
plus grande part des enfants en âge d'êtres scolarisé, mais
plutôt par des vagues de scolarisation et de déscolarisation. Sans
nul doute, l'or y est pour quelque chose et principalement l'exploitation
minière traditionnelle qui attire de plus en plus d'enfants hors du
système scolaire.
54
Pour lisser les données et dégager une tendance
générale, nous utilisons les moyennes mobiles centrées
d'ordre 3 (graphique 9). On constate que la croissance des inscriptions
à l'école primaire évolue autour d'une tendance cyclique.
A l'intérieur de chaque cycle, on peut alors calculer le niveau moyen de
la croissance des inscriptions au primaire, en tant qu'indicateur du
régime d'accumulation de ce facteur.
Graphique 8 : Evolution des inscriptions à
l'école primaire

Source : graphique de l'auteur, à partir des
données de la banque mondiale
Graphique 9 : Taux de croissance de la part des
enfants scolarisés
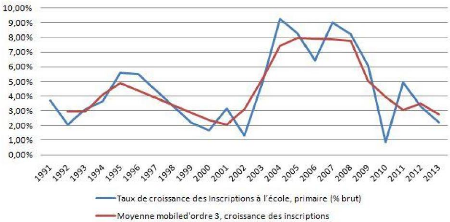
Source : calcul et graphique de l'auteur, à partir
des données de la banque mondiale
55
c) De l'accumulation du capital humain au Burkina
Faso
Nous mesurons l'accumulation de capital humain en faisant la
somme directe de l'accumulation de l'espérance de vie et de la
croissance des inscriptions à l'école primaire. Nous identifions
graphiquement les changements de régime et calculons la moyenne de
chaque période (Graphique 10). On constate alors que dans le cas du
Burkina Faso, le boom minier s'accompagne effectivement d'un changement de
régime d'accumulation, mais contrairement à la règle de
Solow-Hartwick qui veut que la destruction de capital naturel s'accompagne d'un
régime plus élevé dans l'accumulation des autres types de
capitaux, le Burkina est passé d'un régime plus
élevé (8% de croissance annuelle en moyenne) vers un
régime moins élevé de l'ordre de 4% de croissance. Ce
paradoxe empirique ne nous permet pas d'établir une corrélation
directe avec le boom minier, néanmoins ces résultats pourraient
remettre en cause les analyses officielles de la soutenabilité de
l'exploitation minière du Burkina Faso si toutefois l'accumulation de
capital physique s'inscrit dans la même dynamique.
Graphique 10 : l'accumulation de capital humain au
Burkina Faso.

Source : Calcul et graphique de l'auteur, à partir
des données de la banque mondiale
2. De l'accumulation du capital physique au Burkina
Faso
L'accumulation de capital physique du Burkina Faso,
mesurée par la formation brute de capital fixe montre une dynamique
relativement stable depuis 2001. Le graphique 11 représente son
évolution depuis 1990 et on constate que la formation brute de capital
fixe
56
évolue en dent de scie jusqu'à 2001, avant
d'amorcer une première phase de croissance jusqu'en 2006-2007 où
un léger pic marque de nouveau un changement de régime. On
observe ainsi une pente plus élevée depuis 2008, qui
malheureusement aura tendance à stagner en 2013-2014.
Nous retenons donc ces trois sous périodes
identifiées graphiquement, pour isoler les spécificités en
termes de taux de croissance moyen afin de vérifier notre
hypothèse d'une hausse dans le régime d'accumulation,
conformément à la règle de soutenabilité de
Solow-Hartwick. Il s'agit donc des sous périodes 1990-2000, 2001-2007 et
2008-2014.
Graphique 11 : Evolution de la formation brute de
capital fixe du Burkina Faso depuis 1990

Source : Calcul et graphique de l'auteur, à partir des
données de la banque mondiale
L'analyse graphique de la dynamique d'accumulation du capital
physique au Burkina Faso depuis 1990 (Graphique 12) révèle trois
principaux régimes. Un premier régime faible de 1990 à
2000 avec une moyenne 4.15% de croissance annuelle, un deuxième
régime relativement plus élevé de 6 points de plus que le
précédent et enfin le dernier régime de 2008 à 2014
avec une moyenne de 17% de croissance environ. Néanmoins, on constate
que la moyenne de la dernière période a surtout été
augmentée par les résultats spectaculaires enregistrés en
2011 et 2012. 2013 se traduit par une baisse de 40% environ.
Dès lors, la question se pose de savoir si la moyenne
élevée observée depuis 2008 est un phénomène
durable ou plutôt la résultante de phénomènes
aléatoires ? En d'autres termes il ne nous est pas possible de conclure
à partir de ce constat que la hausse du taux d'accumulation de capital
physique est le fruit d'une stratégie nationale de conversion de la
destruction de capital naturelle en capital physique. De plus, le choix d'une
analyse graphique
57
est très arbitraire et nous enseigne uniquement sur les
probabilités que le Burkina Faso se rapproche ou pas de la règle
de soutenabilité de Solow-Hartwick.
Graphique 12 : Accumulation de capital physique
(croissance annuelle de la formation brute de capital fixe
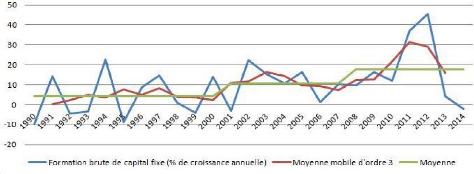
Source : Calcul et graphique de l'auteur, à partir
des données de la banque mondiale
58
Conclusion
L'or du Burkina Faso est-il vraiment une
bénédiction ?
Si le Développement soutenable peut conjurer la
malédiction des ressources naturelles par l'application de la
règle de soutenabilité de Solow-Hartwick, l'or du Burkina Faso
n'est autre qu'une bénédiction. Son exploitation s'accompagne
d'une hausse dans l'accumulation de capital physique (mesuré par la
formation brut de capital fixe).
Malheureusement, l'accumulation de capital humain ne suit pas
la même tendance. Il apparait en effet que, bien que présentant de
façon générale une tendance haussière si on ne
considérant que les valeurs brutes de l'espérance de vie et des
taux de scolarisation a l'école primaire, la dynamique d'accumulation du
capital humain est en net recul depuis le boom minier : Une lecture en termes
de croissance et donc de dynamique d'accumulation laisse entrevoir un recul des
performances du Burkina Faso depuis 2009.
Malgré les limites d'une analyse graphique, il apparait
que la période 2002-2008 à été celle qui a connu
des niveaux d'accumulation de capital humain très élevé.
Sur la même période le capital physique a affiché un niveau
plus élevé que la période 1990-2000. Depuis 2009,
l'accumulation de capital physique est passée de 10% en moyenne à
17%, soit une hausse de 70%. Parallèlement, l'accumulation de capital
humain est passée d'un niveau de 8.56% à 4.28% soit une baisse de
50%.
On pourrait être tenté de conclure qu'en absolu,
la dynamique d'accumulation de capital physique du Burkina est nettement plus
élevé que le recul observé dans l'accumulation de capital
humain, mais ce serait simplifier la réalité à
l'extrême, car si la soutenabilité faible autorise une
substitution entre capitaux, elle ne précise pas un taux de substitution
unitaire. Il est effectivement possible que le capital physique soit moins
onéreux que le capital humain mais également moins rentable que
le capital humain. Dans cette logique, un niveau plus élevé dans
l'accumulation de capital physique ne s'accompagnant pas d'une hausse dans
l'accumulation de capital humain est un abus de la théorie, une
ignorance de la complémentarité des facteurs dans le processus de
production, et peut être un signe précurseur de malédiction
par les ressources naturelles.
59
Bibliographie
ACEMOGLU, D. JOHNSON, S. and ROBINSON, J. A. (2002) Reversal
of Fortune: Geography and institutions in the making of the modern world income
distribution, Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(4), pp.
1231-94
AFDB (2012) Burkina Faso Note de Pays, Perspectives
économiques en Afrique
AKNIN A. (2009) Le développement durable peut-il
conjurer la «malédiction des ressources»?, Mondes en
développement 2009/4 (n° 148), p. 15-30. DOI
10.3917/med.148.0015
ANTONIN C., MELONIO T. et TIMBEAU X. (2011) L'epargne Nette
Ré-Ajustée , Revue de l'OFCE / Débats et
politiques - 120
Assemblée Nationale (1997) Loi N°023/97/II/AN,
portant Code minier du Burkina Faso, délibération séance
du 22 octobre
AUTY R. M. (2001) Resource abundance and economic development,
New York, Oxford University Press
AUTY, R. M. (1998) Social sustainability in mineral-driven
development, Journal of Internationonal Development, Vol.10,
487-500
AUTY, R. M. (1990) Resource-Based Industrialization: Sowing
the Oil in Eight Developing Countries, Clarendon Press, Oxford
Banque Africaine de Développement et Fonds Africain de
Développement (2012) Burkina Faso, document de stratégie pays
2012-2016, département des opérations pays - région
Afrique de l'ouest 1
BEDOSSA B. (novembre 2012), Burkina Faso : l'émergence du
secteur aurifère suffira-t-elle à redresser un modèle de
croissance en perte de vitesse ? » Macroéconomie &
Développement No5
CAPES (2011) Croissance et Pauvreté au Burkina Faso,
Rapport provisoire Centre d'Analyse des Politiques Economiques et
Social, Burkina Faso
CARBONNIER G, (2007) Comment conjurer la malédiction des
ressources naturelles ?, Annuaire Suisse de politique de
développement, Vol. 26, n°2
COLLIER, P. and HOEFFLER A. (2002) On the incidence of civil war
in Africa, in Journal of Conflict Resolution, 46 (1), pp. 13-28
60
COLLIER P. (2000) Economic Causes of Civil Conflict and their
Implications for Policy, World Bank Policy Research Working Paper.
Commission Mondiale sur l'Environnement et le
Développement (1988), Notre avenir à tous, Québec,
éditions du Fleuve.
Comité National de Politique Economique (Avril 2013)
Rapport sur la situation économique et financière du Burkina Faso
en 2012, Burkina Faso, CNPE Rapport final
Conseil Economique et Social (2011) Expansion du secteur minier
et développement durable au Burkina Faso : cas de l'exploitation
aurifère, Burkina Faso, CES rapport public
COUHARDE C. GERONIMI V. TARANCO A. (2012/3) Les hausses
récentes des cours des matières premières traduisent-elles
l'entrée dans un régime de prix plus élevés ?
», Revue Tiers Monde n°211, p. 13-34. DOI
10.3917/rtm.211.0013
DALY H. E. (1990) Toward some operational principles of
sustainable development, Ecological Economics, 1990, vol. 2, issue 1,
pages 1-6
DAVIS G. A., TILTON J. E. (2005) The resource curse,
Natural Resources Forum 29 (2005) 233-242
DE ROME, C. (1972) Halte à la croissance. Rapports sur
les limites de la croissance.
DIALGA I. (Septembre 2013) Du boom minier au Burkina Faso :
opportunité pour un développement durable ou risque de
péril pour les générations futures ? Mémoire de
recherche
DOPPELHOFER G., MILLER R. I., SALA-I-MARTIN X. (2000)
Determinants of long-term growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates
(BACE) Approach, OECD Economics Department Working Papers, No. 266,
OECD Publishing.
EASTERLY, W. (2005) Reliving the '50s: The Big Push, Poverty
Traps, and Takeoffs in Economic Development, Center for Global Development
Working Papers 65.
Fonds Monétaire International, (2014) Burkina Faso :
Questions Générales, Rapport FMI No. 14/230
FRANKEL J. A., ( April 2012) The Natural Resource Curse: A
Survey of Diagnoses and Some Prescriptions, Faculty Research Working Paper
Series, Harvard Kennedy School and NBER
GALLUP, J. L., SACHS, J. D., MELLINGER, A. D. (1999) Geography
and Economic Developpment, International Regional Science Review,
22(2), 179-232
61
GALLUP J. L. and SACHS J. D., with MELLINGER A. (March 1990)
Geography and Economic Development, CID Working Paper No. 1
GELB A. (1988) Oil Windfalls : Blessing or Curse ?,
Oxford and New York, Oxford University Press
GELB A. and GRASMANN, S. (August 2010) How Should oil
exporters spend their rents? Working Paper 221
GELB , A. (2010) Economic Diversification in Resource Rich
Countries, Center for Global Development. Seminar on Natural
resources, finance, and development: Confronting Old and New Challenges,
organized by the Central Bank of Algeria and the IMF Institute in Algiers, on
4-5 November 2010
GERONIMI V., TARANCO A. (Version en cours 15/01/2014) Les
matières premières sont-elles entrées dans un
régime de prix plus élevé ? Enjeux pour les pays les moins
avancés, Document de travail non publié
GUILLAUMONT, P. (17 Novembre 2006) La
vulnérabilité économique, défi persistant à
la croissance africaine/ Economic Vunerability, Still a Challenge for African
Growth
GYLFASON T. (2001), Natural resources, éducation, and
economic development, in European Economic Review, 45 (4-6), pp.
847-859.
GYLFASON, T. (2000) Resources, Agriculture and Economic
Growth, in Economies in Transition, Kyklos 53, Issue 4,
pp.545-79.
GYLFASON T., HERBERTSSON T. T., ZOEGA G. (1999), A mixed
blessing: natural resources and economic growth, in Macroeconomic
Dynamics, 3 (2), pp. 204-225.
HARTWICK, J. M. (1977) Intergenerational Equity the Investing
of Rents from Exhaustible Resources, American Economic Review, 67(5)
972-74
KARL, T. L. (1997) The Paradox of Plenty: Oil Booms and
Petro-States, Berkeley, University of California Press
KPMG (18 mars 2013), Analyse du partage des
bénéfices des activités aurifères au Burkina Faso,
rapport final
KPMG (2011), Rapport sur les procédures convenues
relatives aux recettes minières perçues par l'Etat pour les
années 2008 et 2009, Rapport ITIE Burkina Faso 2008-2009
LANE, P.R., TORNELL, A. (1996) Power, growth and the voracity
effect. Journal of Economic Growth 1, 213 - 241
62
MARECHAL J.P. (1996b) Le développement durable dans la
pensée néoclassique, in RENS I. (dir) (1996) Le
droit international face a l'éthique et à la politique de
l'environnement, Georg,270p, 223-230
MEHLUM H., Moene K. and TORVIK R., (2006) Institutions and the
Resource Curse, The Economic Journal,Vol. 116, No. 508, pp.
1-20Published
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (2011)
Analyse économique du secteur des mines liens pauvreté et
environnement, Burkina Faso, MECV Rapport final du 31 mai 2011
Ministère des Mines et de l'Energie (Mai 2013)
Politique sectorielle des mines 2014 - 2025, Burkina Faso
MOORE Stephens (2014) Rapport de conciliation des paiements
des sociétés minières à l'Etat et des recettes
perçues par l'Etat des dites sociétés pour l'exercice 2012
», Rapport ITIE Burkina Faso 2012, Décembre 2014
MOORE Stephens (2013) Rapport de conciliation des paiements
des sociétés minières à l'Etat et des recettes
perçues par l'Etat des dites sociétés pour l'exercice
2011, Rapport ITIE Burkina Faso 2011, Décembre 2013
MOORE Stephens (2012) Rapport final de conciliation des
paiements des sociétés minières à l'Etat et des
recettes perçues par l'Etat des dites sociétés pour
l'exercice 2010, Rapport ITIE Burkina Faso 2010, Juillet 2012
PREBISH, P. (1950) The economic development of Latin America
and its principal problem, Santiago : UNECLA
KHAN M. H. (2003) L'échec de l'Etat dans les pays en
développement et les stratégies de
réforme
institutionnelle, Revue d'économie du développement, vol
17, 2-3, p. 5-48
RAMEY G., RAMEY V. A. (2007) Cross-Country Evidence on the Link
Between Volatility and Growth, The American Economic Review, Vol. 85,
No. 5 (Dec., 1995), pp. 11
RAMEY G., RAMEY, V. A. (1995) Cross Country Evidence on the Link
between Volatility and Growth, American Economic Review, 85(5), 1138-51
RICARDO D. (1817) On the Principles of Political Economy and
Taxation, London, 1817
ROSENSTEIN-RODAN, P. N. (1943) Problems of Industrialisation of
Eastern and Southeastern Europe, Economic Journal, 53 202-11
63
SACHS J. D., WARNER A. M., (2001) The curse of natural
resources », European Economic Review 45 (2001) 827-838
SACHS J., WARNER A. (1999) The big push, natural resource
booms and growth, Journal of Development Economics, 6(3), 335-376.
SACHS J. D. and WARNER A. M. (1997) Natural resource abundance
and economic growth, Harvard University, working paper
SACHS J. D. (1996) Resource Endowments and the Real Exchange
Rate: A Comparison of Latin America and East Asia, NBER-EASE volume 7,
(p. 133 - 154)
SACHS J. D. and WARNER A. M., (1995) Natural resource
abundance and economic growth, NBER working paper 5398, December
1995.
SACHS, W., (1999) Planet Dialectics. Explorations in
Environment and Development, London, Zed Books.
SALA-I-MARTIN X. (1997) I just ran two million regressions,
American Economic Review: Papers and Proceedings, 87(2), 178-183.
SINGER H. (1950) The distribution of gains between investing
and borrowing countries, American Economic Review, Papers and
Proceedings, vol 40, may, p. 473-485
SOLOW, R. (1986) On the Intergenerational Allocation of
Natural Resources, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 88, No.
1, pp. 141-149
SOLOW, R. M. (1974) Intergenerational Equity and Exhaustible
Resources, Review of Economic Studies, 41, 29-45
TORNELL, A., LANE, P.R., (1999) The voracity effect,
American Economic Review 89, 22 - 46
VAN DER PLOEG F. (2011) Natural Ressources: Curse or
Blessing?, Journal of Economic Literature, American Economic
Association, Vol. 49, No. 2 (JUNE 2011), pp. 366-420.
WICK, K. & BULTE E. (2006) Contesting resources - rent
seeking, conflict and the natural resource curse, Public Choice,
Springer, vol. 128(3), pages 457-476, September 2006
XAVIER, X. SALA-I-MARTIN (1997) I just ran two million
regressions, The American Economic Review, Vol.87, N°.2. Paper
and Proceedings of the hundred and Fourth annual meeting of the American
Economic Association. (May, 1997),pp. 178-183
64
YAMEOGO K. I. (2009) Les moteurs de la croissance de
l'économie burkinabé et sa vulnérabilité aux chocs
extérieurs, Ecole National d'Administration et de Magistrature
(ENAM) Burkina Faso - Conseiller des affaires économiques 2009
Ressources internet
Compte rendu du conseil des ministres (1er Avril
2015), publié sur le quotidien
lefaso.net,
http://www.lefaso.net/spip.php?article64037
IFRI (2014) Les Enjeux Du Secteur Minier Du Burkina Faso,
Conférence du ministre Salif Lamoussa Kaboré à l'IFRI.
20/01/2014, site web de l'Ambassades du Burkina Faso
http://www.ambaburkina-fr.org/les-enjeux-du-secteur-minier-du-burkina-faso-conference-du-ministre-salif-lamoussa-kabore-a-lifri-20012014/
INRI (2012) Burkina Faso : L'éducation, victime de la
ruée vers l'or,
http://www.irinnews.org/fr/report/96222/burkina-faso-l-%C3%A9ducation-victime-de-la-ru%C3%A9e-vers-l-or



