|

UNIVERSITE PARIS EST CRÉTEIL
FACULTÉ DE
MÉDECINE DE CRÉTEIL
8 rue du général Sarrail -
94010 CRÉTEIL cedex
Tel : 01.49.81.37.94
Mémoire de Master 2
en
Gestion des Risques Associés aux
Soins
Mesure de la Perception de la Culture de
Sécurité
dans un Etablissement de Santé Privé
Tunisien
Année universitaire
2015/2016
Présenté le 27/6/2016
Par
Lotfi
BENMOSBAH
Responsable du Master 2: Pr. Jean Louis MARTY
Membres du jury : Pr Emmanuel SAMAIN
: Pr Christophe PONCELET
2
TABLE DES MATIERES
Remerciements.............................................................................................4
Tableaux et
Figures.......................................................................................5
Définitions et
Acronymes...............................................................................6
I/
Introduction...................................................................................................7
II/ Culture de
sécurité........................................................................................9
A/ Historique et
définition.............................................................................9
B/ Culture de sureté et culture de
sécurité.......................................................9
C/ Domaines de la culture de
sécurité.............................................................9
E/ Les approches de la culture de
sécurité......................................................10
1) Approche
culturaliste...................................................................10
2) Approche
fonctionnaliste...............................................................12
D/ Composantes de la culture de
sécurité.......................................................12
F/ Aspects de la culture de
sécurité...............................................................13
1) Aspects
psychologiques...............................................................13
2) Aspects
comportementaux............................................................13
3) Aspects
organisationnels...............................................................13
III/ Culture de sécurité des
patients.......................................................................14
A/Définition...............................................................................................14
B/Attributs de la culture de
sécurité................................................................14
C/ Relation entre culture de sécurité des patients et
sécurité des patients..............14
IV/ Outils de mesure de la culture de
sécurité des patients......................................16
A/ Outils quantitatifs : Questionnaires auto-administrés
17
B/ Outils qualitatifs 17
C/ Le HSOPSC 18
V/ Mesure de la perception de la culture de
sécurité par le personnel soignant
de la Clinique Pasteur 23
A/ But de l'étude 23
B/ Matériels et Méthodes 23
1) Matériels 23
2) Méthodes 23
C/ Résultats et Discussion 24
1) Population 24
3
2) Graphique des Scores des dimensions de la
sécurité des patients.........25
3) Scores des dimensions au sein de
l'unité..........................................25
a) Attentes et actions du supérieur
hiérarchique...........................25
b) Organisation
apprenante.....................................................26
c) Travail d'équipe dans le
service............................................27
d) Liberté
d'expression...........................................................27
e) Réponse non punitive à
l'erreur............................................28
f) Retour et communication autour des
erreurs............................28
g) Les conditions de
travail......................................................29
4) Scores des dimensions au niveau de
l'établissement...........................29
a) Soutien du Management pour la
sécurité..................................30
b) Travail d'équipe entre les
services...........................................30
c) Transfert des patients et
passation..........................................31
5) Scores des dimensions des résultats de la culture de
sécurité................31
a) Perception globale de la
sécurité.............................................31
b) Fréquence de signalement des évènements
indésirables.............32
6) Critiques et limites de
l'étude...........................................................33
VI/ Conclusion 34
Références 35
Annexe 1 : Autorisation de traduction du HSOPSC
39
4
Remerciements
Je remercie les personnes qui m'ont apporté leur aide
à la rédaction de ce Mémoire.
Je remercie les Professeurs Jean louis MARTY, Emmanuel SAMAIN
et Christophe PONCELET qui me font le grand honneur d'évaluer ce
travail.
Je remercie l'ensemble du groupe d'étude pour la
sécurité de notre établissement, notamment Emna Ben Slama
et Souha Mastouri, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour mener
cette enquête à bien.
Je remercie les 245 soignants qui ont répondu au
questionnaire.
Je remercie mes collègues Médecins
Anesthésistes, Nadia Slama, Mondher
Ben Ameur, Walid Miraoui et Zied Chaabène qui se sont
employés à me libérer pour que je puisse assister aux
cours du Master.
Enfin, un grand merci à ma compagne, mon épouse,
Hella Endesha qui m'a encouragé et soutenu dans cette entreprise et m'a
apporté une aide précieuse en acceptant de relire ce
mémoire.
5
Tableaux et Figures
Figure 1 : Domaines de la Culture de sécurité
(Rapport IRSN 2005/54)
Figure 2 : Méthodes d'évaluation de la Culture
de Sécurité
Figure 3 : Les cinq niveaux de sécurité
utilisés dans le Manchester Patient Safety
Framework
Figure 4 : Ancienneté dans le métier
Figure 5 : Ancienneté dans l'établissement
Figure 6 : Scores des dimensions de la culture de
sécurité
Tableau 1 : Dimensions étudiées par le HSOPSC
Tableau 2 : Attentes et actions du supérieur
hiérarchique concernant la sécurité des
patients
Tableau 3 : Organisation apprenante et amélioration
continue
Tableau 4 : Travail d'équipe dans le service
Tableau 5 : Liberté d'expression
Tableau 6 : Réponse non punitive à l'erreur
Tableau 7 : Feedback et communication autour des erreurs
Tableau 8 : Conditions de travail
Tableau 9 : Soutien du management pour la
sécurité des patients
Tableau 10 : Travail d'équipe entre les
différents secteurs de l'établissement
Tableau 11: Transfert des patients et passation
Tableau 12 : Perception globale de la
sécurité
Tableau 13 : fréquence de signalement des
évènements indésirables
6
DEFINITIONS ET ACRONYMES
- Erreur : action qui ne
s'achève pas comme prévu (erreur d'exécution) ou
utilisation d'un mauvais plan pour atteindre un but (erreur de
planification).
- Evénement indésirable :
évènement lié aux soins, et non à
l'évolution naturelle de la maladie, qui aurait pu ou a causé un
préjudice au patient.
- Evènement indésirable évitable
: tout évènement attribuable à une erreur
- Evènement indésirable grave
: Evènement indésirable qui a provoqué des
conséquences graves pour le patient telles qu'une mise en jeu du
pronostic vital ou fonctionnel, une prolongation de l'hospitalisation, un
décès ou des séquelles invalidantes
- AHRQ : Agency for Healthcare Research and
Quality, agence américaine de la qualité des soins et
sécurité des patients
- CS : Culture de sécurité
- EIG : Evènement indésirable
grave
- ENEIS : enquête nationale
française sur les évènements indésirables
liés aux soins
- ESQH : European Society of Quality in
healthcare
- HAS : Haute Autorité de Santé
- HSOPSC : Hospital Survey On Patient Safety
Culture
- IOM : Institute Of Medicine, Institut de
Médecine américain
- NHS : National Health Agency, agence nationale
anglaise de la santé
- NRLS : National Report and Learning System,
Système anglais de collecte des EIG et d'apprentissage
7
I/ INTRODUCTION
La sécurité des patients est définie par la
manière d'agir pour éviter et prévenir tout
préjudice éventuel au cours du processus du soin (1). La
sécurité des patients est une composante essentielle de la
qualité des soins.
En 1999, la publication du rapport de l'IOM, « To err is
human », révèle que chaque année, environ 98 000
patients décèdent en raison de complications liées aux
soins. Ces dernières tuent plus que les accidents de la voie publique ou
encore le cancer du sein (2). A peine publié, ce chiffre
considérable semblait déjà sous-estimé. Cela est
confirmé par une étude plus récente qui évalue, aux
USA, entre 250 000 et 440 000 le nombre de décès annuels en
rapport avec des complications liées aux soins (3).
En France, l'enquête ENEIS II a démontré
qu'il y avait 6,2 évènements indésirables graves (EIG) par
1000 jours d'hospitalisations. Il reviendrait à dire que dans un service
de 35 lits, il y aurait un EIG tous les cinq jours (4).
En Tunisie, une enquête, menée dans un hôpital
du centre-est, a recensé une proportion de 11,3% de patients
hospitalisés victimes d'un EIG (5).
Une enquête rétrospective, menée par l'OMS en
2012, auprès de huit pays émergents (Egypte, Jordanie, Kenya,
Maroc, Yémen, Tunisie, soudan et Afrique du Sud) trouvait que 2,5
à 18% des patients hospitalisés étaient victimes d'un EIG.
30% de ces EIG étaient mortels et 85% évitables (6).
Par ailleurs, une étude, menée en 2008 aux Etats
Unis, a montré que le coût des erreurs médicales
était de 19,6 milliards de dollars (7).
Il apparaît que le soin est une activité à
risque et que le coût de ses complications est très
élevé. Assurer la sécurité des patients au cours
des soins est un véritable défi.
L'IOM a établit que ce taux élevé de
complications liées aux soins est en rapport avec un taux
élevé d'erreurs humaines et que pour réduire ces erreurs,
il faut mettre en place un système qui, d'une part, érige des
obstacles à l'erreur, et, d'autre part crée les conditions
favorables aux bonnes décisions.
L'IOM a aussi suggéré que pour améliorer la
sécurité des patients, il faut encourager le signalement des
erreurs afin de les corriger et éviter qu'elles se reproduisent. Cela
impose la mise en place préalable d'une culture de
sécurité qui se fonde non plus sur le blâme mais sur
l'idée que l'erreur peut être traitée comme
l'opportunité de corriger et progresser(2). En Angleterre, la NHS a
considéré que la culture de sécurité est la
première des sept étapes à franchir pour améliorer
la sécurité des patients (8).
8
Ainsi, les deux agences, américaine et anglaise, mettent
en avant la culture de sécurité comme l'indispensable outil de
mise en place des conditions optimales pour la sécurité des
patients.
La Clinique Pasteur de Tunis (Tunisie), établissement
multidisciplinaire de 140 lits, a ouvert ses portes en mars 2015. En novembre,
elle s'est engagée dans une démarche qualité selon les
normes de la HAS. Dans le cadre de cette démarche et afin d'identifier
les domaines d'amélioration concernant la sécurité des
patients, nous avons mené, en janvier 2016, une étude sur la
perception de la culture de sécurité dans cet
établissement.
Nous présenterons dans la partie théorique de ce
travail, la culture de sécurité et les différents moyens
de la mesurer. Nous nous intéresserons particulièrement au
HSOPSC, « Hospital Survey On Patient Safety Culture », outil
développé par l'AHRQ. Puis, dans la partie pratique, nous
présenterons le résultat de la mesure de la perception de la
culture de sécurité du personnel soignant de la Clinique
Pasteur.
9
II/ La Culture de Sécurité
A/Historique et définition
L'expression culture de sécurité a
été utilisée pour la première fois en 1987 dans le
rapport d'analyse de la catastrophe de Tchernobyl. Cet accident a montré
qu'une organisation qui n'adopte pas des valeurs, des principes et des
attitudes résolument tournés vers l'amélioration de la
sureté, est prédisposée à ignorer les
procédures, à dépasser les limites de fonctionnement et
à contourner les systèmes de sécurité. La
définition de la culture de sécurité a ainsi
été formalisée: « La culture de sureté est
l'ensemble des caractéristiques et attitudes qui dans les organismes et
les individus, font que les questions relatives à la
sécurité des centrales nucléaires
bénéficient en priorité, de l'attention qu'elles
méritent en raison de leur importance » (9). Puis en 1990 dans
un second rapport : « La culture de sécurité
désigne l'engagement et le sens de la responsabilité personnelle
de tous les individus se consacrant à une activité qui a une
incidence sur la sûreté des centrales nucléaires. Un de ses
éléments clefs est constitué par une habitude
générale de penser en termes de sûreté »
qui se caractérise par « une attitude de remise en question
systématique, un refus de se contenter des résultats acquis, un
souci permanent de la perfection et un effort de responsabilité
personnelle et d'autodiscipline de groupe en matière de
sûreté » (10). Cela doit permettre que « toutes les
tâches importantes pour la sûreté soient
exécutées correctement, avec diligence, de manière
réfléchie, en toute connaissance de cause, sur la base d'un
jugement sain et avec le sens des responsabilités requis » (9)
B/ Culture de sécurité et culture de
sureté
Il est intéressant d'identifier les liens entre le terme
«sûreté» utilisé ci -dessus et le terme
«sécurité». De manière générale,
en matière de comportements humains, la culture de sureté
s'élabore sur le risque d'erreurs humaines alors que la culture de
sécurité prend aussi en considération des actes
volontaires menés dans l'intention de nuire. Quoiqu'il en soit, Le terme
de « culture de sécurité » est retenu invariablement
dans la suite de ce document.
C/ Domaines de la culture de sécurité
La culture de sécurité se manifeste dans trois
grands domaines (11) (Figure 1) :
1) Le premier est constitué par la
politique que l'Etat met en oeuvre compte tenu du contexte national et
international.
2) Le second est constitué par
l'organisation mise en place au sein de chaque organisme concerné en
tenant compte de la politique fixée par l'Etat. Dans ce domaine il y a
lieu de distinguer ce qui relève de l'organisme même et de ce qui
relève de ces dirigeants.
10
3) Le troisième domaine concerne les
individus impliqués à tout les échelons pour mettre en
oeuvre cette politique.
D/ Approches de la culture de
sécurité
L'utilisation du terme «culture de
sécurité« n'est pas anodine car elle est fortement
liée au contexte des années 1980, période durant laquelle
le terme «culture d'entreprise» a connu son apogée dans le
domaine du management (12). En un peu moins de trente ans, la notion de culture
de sécurité considérée comme la prise en compte des
facteurs organisationnels et humains dans la gestion des risques, a
été diffusée dans tous les secteurs industriels à
hauts risques. Néanmoins, dans la littérature scientifique, il
n'y a pas de consensus sur la définition, les caractéristiques et
le concept de la culture de sécurité. La culture de
sécurité, considérée comme une dimension du concept
plus global de culture organisationnelle, est donc tributaire des débats
sur cette même culture organisationnelle (13).
Gudelnmund cité par Nascimento identifie deux approches
(14) :
1) Une première approche culturaliste :
«Ce que l'organisation est»
Il s'agit de l'approche dominante où la culture est
analysée comme un objet en soi et cette analyse permet de comprendre le
fonctionnement du collectif et de l'organisation. La culture de
sécurité désigne les normes, les valeurs, les croyances,
les attitudes et les représentations partagées par un groupe de
personnes supposées être liées à la
sécurité.
On distingue trois types de mécanismes sociaux relatifs
à la CS :
-- l'intégration : la CS est
considérée comme le ciment social du groupe.
Ce mécanisme participe à l'uniformisation de la CS
au sein d'une organisation. L'identification d'éventuelles sous-cultures
témoignerait de la faiblesse de stratégie du leadership.
-- La différentiation : la CS est
analysée comme un produit construit socialement selon le pays, le
secteur, les services, les professions et les groupes. Cette perspective admet
l'existence de sous-cultures au sein des organisations. Le rôle de ces
sous-cultures dans la sécurité globale est le point focal de
l'analyse. Ce mécanisme pourrait expliquer les résultats
divergents entre différents services d'une même organisation.
-- l'ambiguïté : ce mécanisme
peut être considéré comme une extension du mécanisme
de différentiation. Il renvoie aux intentions des individus, chacun
pouvant appartenir à des sous-cultures différentes.
Figure 1 : Domaines de la Culture de
sécurité (Rapport IRSN 2005/54)
11
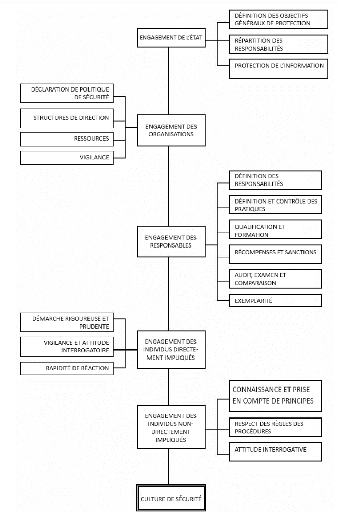
12
La culture de sécurité dans l'approche culturaliste
serait au carrefour de ces trois mécanismes et il est intéressant
d'observer et d'analyser leurs points de chevauchement (15). La culture de
sécurité s'élabore alors sur un ensemble
d'hypothèses et de pratiques associées qui forgent les croyances
sur les dangers et la sécurité (16). Ainsi Vaughan, cité
par J.L. Hall, pense que pour appréhender le contexte d'un
événement ou d'une activité il est nécessaire de se
pencher sur les manières dont la culture se développe et
influence notre quotidien (17). Vaughan prend l'exemple des ingénieurs
de la NASA, responsables du programme de la Navette spatiale. Il explique la
normalisation de la déviance par une conviction culturelle qui a
mené les ingénieurs à penser que tout allait bien alors
que les informations dont ils disposaient leur indiquaient l'inverse.
2) Une seconde approche fonctionnaliste :
«Ce que l'organisation a»
La culture de sécurité est considérée
comme une variable parmi d'autres. L'analyse, dans ce cas, porte sur le mode de
fonctionnement de l'organisation. On s'intéresse alors aux structures
pratiques et politiques prévues pour améliorer la
sécurité. Les recherches sont dirigées vers la description
des attributs de ces organismes « sûrs » qui sont :
-- l'engagement de la direction et du
management séniors en matière de sécurité
-- la vigilance à l'égard des
dangers et de leur impact potentiel
-- les normes et règles réalistes
et flexibles en rapport avec les dangers
-- la réflexion continue sur les
pratiques et apprentissages organisationnels grâce à
des systèmes de surveillance et des retours
d'expérience.
Dans cette perspective, la culture de sécurité est
ainsi une variable qui peut être isolée, analysée et
modifiée.
E/ Composantes de la culture de
sécurité
Reason identifie de la sorte quatre composantes d'une CS efficace
(18) :
1) Culture du signalement : une organisation
sûre dépend de la volonté du personnel de première
ligne de signaler leurs erreurs et presqu'accidents.
2) Une culture équitable : une ligne
claire est tracée entre comportement acceptable et inacceptable.
3) Une culture flexible: l'autorité
tient compte des connaissances des agents de première ligne et de leurs
suggestions en matière de sécurité.
4) Une culture apprenante : l'organisation
analyse les signalements et met en place les changements nécessaires.
13
F/ Aspects de la culture de sécurité
Selon Cooper (19) il existe trois aspects de La culture de
sécurité qui sont en interdépendance et forment le socle
constitutif de la culture de sécurité :
1) Les aspects psychologiques, «ce que les
gens ressentent».
Il s'agit ici de considérer les convictions, les
croyances, les perceptions, les attitudes et les valeurs des personnes.
L'aspect psychologique est souvent appelé climat de
sécurité. Comme cela est relevé par Gugelmund (20), il
existe une certaine confusion dans l'utilisation des termes «climat de
sécurité » et «culture de sécurité
». Certains utilisent indifféremment les deux termes.
Dans le cadre de ce travail, les deux termes seront
considérés comme synonymes.
2) Les aspects comportementaux, «ce que
les gens font»:
Ce facteur renvoie aux comportements observables des individus
dans le cadre de leurs activités sur le terrain.
3) Les aspects organisationnels, «ce que
l'organisation a»:
Le facteur organisationnel traduit le fonctionnement de
l'entreprise à travers sa politique, ses procédures et sa
structure. Cela fait référence, en pratique, au système de
management de la culture de sécurité.
14
III/ Culture de sécurité des patients
A/ Définition
L'introduction de la culture de sécurité dans les
organismes de soins comme un moyen de diminuer les risques, repose sur une
approche fonctionnaliste (21). La définition de la Société
Européenne pour la Qualité des Soins, reprise par la HAS (22),
définit la culture de sécurité comme un ensemble
cohérent et intégré de comportements, individuels et
organisationnels fondés sur des croyances et des valeurs
partagées, qui cherchent continuellement à réduire les
dommages aux patients qui peuvent être liés aux soins.
Par « ensemble cohérent et intégré de
comportements », il est fait référence à des
façons d'agir, des pratiques communes, mais aussi à des
façons partagées de ressentir et de penser en matière de
sécurité des patients.
B/ Attributs de la culture de la sécurité
des patients
L'IOM décrit une série d'attributs relatifs aux
organisations qui ont une culture de sécurité efficace (23) :
-- nos processus sont conçus pour prévenir les
échecs
-- nous sommes engagés à détecter nos
erreurs et à en extraire un enseignement -- nous avons une culture
équitable de telle sorte que la sanction est fondée sur le risque
injustifié pris par le personnel.
-- Le personnel qui travaille en équipe fait moins
d'erreur
C/ Relation entre culture de sécurité et
sécurité des patients
L'ensemble des études s'accordent sur le fait que les
structures de santé à culture de sécurité
développée, signalent davantage leurs évènements
indésirables (24).
Par ailleurs, Mardon démontre qu'il existe
également une corrélation positive entre une culture de
sécurité développée et la baisse des
évènements indésirables (25). Singer et coll (26) ont
porté leur attention sur 91 hôpitaux répartis dans 37
états des USA, pour étudier la relation entre culture de
sécurité et sécurité des patients en s'appuyant sur
l'analyse des indicateurs de la sécurité des patients (PSI). Ils
constatent que les hôpitaux où les employés signalaient les
évènements indésirables avec un sentiment de honte et
l'appréhension de la sanction, présentaient, de manière
significative, une plus grande défaillance sécuritaire. Ils
remarquent aussi, que les hôpitaux dont le personnel soignant avait une
culture de sécurité développée, rencontraient un
moindre nombre de problèmes de sécurité. Toutefois,
s'agissant des hauts cadres administratifs, la corrélation n'est plus
établie. Les auteurs en
15
déduisent que les cadres administratifs surestiment le
climat de sécurité de leur établissement du fait de leur
moindre connaissance de ce qui se produit sur le terrain.
Buerhauss (27) a constaté cette même distorsion
quand il a étudié le retentissement de la pénurie du
personnel paramédical sur les soins. 65% des infirmières pensent
que le retentissement est négatif contre 18% seulement des seniors
managers.
Enfin, Singer relève aussi que, si des études plus
anciennes n'ont pas pu démontrer la relation positive entre culture de
sécurité et sécurité des patients, cela est
dû au fait que ces études n'ont pas utilisé des
critères objectifs mais plutôt une perception de la
sécurité, ou des estimations auto-déclarées
(26).
16
IV/ Mesure de la culture de sécurité
L'intérêt porté à la mesure de la
culture de sécurité a augmenté avec la
nécessité croissante de l'amélioration de la
sécurité des patients. Les outils d'évaluation de la
culture permettent d'analyser les situations données et
d'élaborer un plan d'action pour améliorer la
sécurité des patients. Cependant, malgré le fait qu'il
existe plusieurs outils d'évaluation de la culture de
sécurité, on trouve peu d'éléments dans la
littérature pour faire le choix de l'outil adapté (28).
Les analyses du point de vue managérial et du point de vue
du personnel soignant restent, en toute circonstances, des
éléments importants et incontournables. Les outils d'analyse du
point de vue managérial évaluent la culture de
sécurité en fonction de la politique de l'établissement
alors que ceux du personnel soignant analysent les attitudes et perceptions du
personnel soignant (29).
Quoiqu'il en soit, la culture de sécurité est
mesurée pour les objectifs suivants :
1) Identifier les domaines d'amélioration
2) Augmenter la prise de conscience concernant la
sécurité des patients
3) Evaluer les interventions en rapport avec la
sécurité des patients
4) Effectuer des analyses comparatives (benchmarking) portant
sur les différents
services d'un même établissement ou sur des
établissements différents
5) appliquer des directives réglementaires telles que les
normes d'accréditation En conclusion, on peut considérer que
l'évaluation de la culture de sécurité des patients repose
sur différentes méthodes qui permettent d'évaluer les
aspects organisationnels, psychologiques et comportementaux décrit par
Cooper (19) et représentées en figure 2.
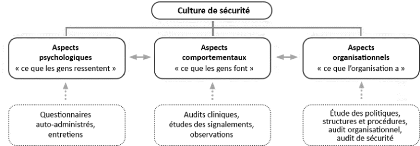
Figure 2: Méthodes d'évaluation de la
Culture de
Sécurité (Ocelli 2007)
17
A/ Les méthodes quantitatives : Les
questionnaires auto-administré
L'évaluation quantitative de la culture de
sécurité des patients se fait essentiellement au moyen de
questionnaires auto-administrés (30). Elle a été
empruntée aux méthodes développées pour les
industries à haute exigence de sécurité telles que
l'aviation.
Certains questionnaires utilisent une échelle à
cinq modalités de réponses, allant par exemple de «
jamais » à « toujours » et de « tout
à fait d'accord » à « désaccord total »
(échelle de Likert). Le traitement des données se fonde
alors sur la construction d'indicateurs, issus de l'agrégation et de la
stratification des réponses.
Dans une revue de la littérature, Aneesh, cité par
Al Doweiri (29), recense 13 instruments d'analyse de la sécurité
des patients, dont le HSOPSC que nous utilisons pour ce travail et qui sera
détaillé ci-après. Ces instruments utilisent
jusqu'à 23 dimensions regroupées en différentes
catégories telles que le management, les attentes des supérieurs
hiérarchiques, les conditions de travail, les compétences, les
règles, etc...
Pidgeon, cité par Mearns, rappelle que la plupart des
questionnaires existants mesurent les attitudes relatives à la
sécurité, avec peu et parfois aucune attention portée, ni
sur les modalités mises en oeuvre par les organisations pour faire face
aux risques, ni sur la manière dont l'organisation appréhende les
pratiques de sécurité. Cet auteur considère que les
études fondées sur des questionnaires, ont été
réduites à la mesure des attitudes et pratiques individuelles
dans un contexte donné, ce qui serait plus proche du concept de climat
de sécurité que de culture de sécurité (31).
En ayant à l'esprit l'existence de sous-cultures dans les
organisations, une autre question concerne le niveau du recueil et de l'analyse
des résultats: Est-il plus pertinent d'évaluer la culture et le
climat au niveau de l'établissement de soins, au niveau de
l'unité, au niveau de l'ensemble de l'équipe soignante, ou des
soignants par catégorie professionnelle ? Pronovost et Sexton (29)
suggèrent que l'analyse doit être effectuée au niveau de
l'unité de travail, tandis que Gaba affirme qu'il est important
d'explorer tous les niveaux d'analyse, considérant que les informations
apportées sont complémentaires (32)..
B/ Les méthodes qualitatives
L'évaluation qualitative de la culture de
sécurité est généralement fondée sur les
entretiens, les observations, les audits et l'analyse documentaire. Ce type
d'évaluation reste rare, car trop coûteuse en temps et en
financement. Dans le domaine de la gestion de risques industriels, plusieurs
études qualitatives, visant à analyser la culture d'une
organisation, ont été effectuées. Certaines furent
élaborées sur la base des données de terrain (9), d'autres
sur l'analyse de rapports de pannes et d'accidents (33).
Dans le domaine de la sécurité de patients ce mode
d'analyse est peu utilisé alors
18
qu'elles seraient très utiles dans le domaine
médical car elles permettraient d'obtenir des informations à la
source pour construire des outils quantitatifs mieux adaptés et de
valider et compléter les résultats d'études quantitatives
(34). En effet, c'est la connaissance du terrain qui confère toute la
pertinence au résultat du questionnaire.
Au Royaume-Uni, l'Agence Nationale pour la Sécurité
des Patients a développé un outil quali-quantitatif qui vise
à évaluer le progrès des établissements de soins en
termes de culture de sécurité: le Manchester Patient
Safety Framework. Neuf dimensions de la culture de
sécurité y ont été
prédéterminées. Un groupe de participants se
réunit, et, après discussion, positionnent chacune de ces neuf
dimensions selon les cinq niveaux de culture de sécurité
présentés en figure 3. Ces cinq niveaux s'inspirent des niveaux
de culture organisationnelle proposés par Westrum (35).
En conclusion, la triangulation des résultats issus de
diverses techniques de recueil de données constitue un moyen
d'accroître la validité des analyses (36).
C/ Le HSOPSC
Outil de mesure quantitatif, le HSOPSC,
Hospital Survey On
Patient Safety Culture, a
été développé en 2004 par l'AHRQ pour aider les
hôpitaux à évaluer leur politique de sécurité
(37). Depuis sa conception, le HSOPSC a été largement
utilisé aux USA mais aussi, traduit en plusieurs langues, dans d'autres
pays.
Il s'agit d'un questionnaire auto-administré. Le HSOPSC
inclut dix dimensions de la culture de sécurité et quatre
dimensions servant à évaluer le degré de
développement de la culture de sécurité. Les dix
dimensions de la culture de sécurité se répartissent d'une
part en sept dimensions qui analysent la perception de la culture de
sécurité au sein de l'unité et d'autre part en trois
dimensions qui l'analysent au sein de l'établissement de l'hôpital
(Tableau 1).
Chaque dimension est analysée à travers plusieurs
questions, Un score est déterminé pour chaque dimension, il est
calculé à partir de la moyenne des pourcentages de
réponses positives aux questions formant la dimension.
On considère comme réponse positive, une
réponse en faveur d'une culture de sécurité
développée. Les concepteurs du test considèrent de
manière empirique qu'une dimension est développée si elle
recueille plus de 75% de réponses positives, qu'elle est à
développer si elle recueille entre 75 et 50% de réponses
positives et qu'elle est à faible si la dimension recueille moins de 50%
de réponses positives.
19

Figure 3 : Les cinq niveaux de sécurité
utilisés dans
Le Manchester Patient Safety Framework
Au total le HSOPSC comprend 44 items qui reprennent les cinq
valeurs de l'échelle de Likert soit de «entièrement d'accord
» à « désaccord total » ou de « jamais »
à
« toujours ». Le questionnaire comportait, par
ailleurs, six questions portant sur les caractéristiques
socio-démographiques des répondants.
Siera et Nova ont mené une étude pilote pour tester
la validité et la fiabilité du HSOPSC (38). Il en ressort que le
HSOPSC est bien un test multidimensionnel et l'analyse factorielle
confirmatoire trouve un modèle solide à douze dimensions, dix
propre à la culture de sécurité et deux dimensions de
résultats. Ils ne tiennent plus compte, dans leur analyse globale, des
deux items « nombre de fiches d'EI remplies » et « niveau de
sécurité au sein de l'unité.
20
Version tunisienne du HSOPSC
Afin de rendre le questionnaire plus compréhensible au
personnel paramédical, le HSOPSC a été traduit en tunisien
par notre groupe d'étude de la sécurité des patients.
Après accord de l'Agence Américaine de Sécurité
(annexe 1). Le HSOPSC a été traduit en tunisien et validé
par la méthode de traduction contre-traduction (39).
Dans la version actuelle du test, la question « combien avez
vous rempli de fiches d'évènements indésirables ?» ne
paraît pas car au moment de la conduite de l'enquête nous n'avions
pas encore commencé à colliger les évènements
indésirables.
21
|
Type de la
dimension
|
Dimension
|
Item
|
|
A/Culture de la sécurité au sein de
l'unité
|
Attente des
supérieurs
Hiérarchiques
|
Mon supérieur hiérarchique immédiat exprime
sa satisfaction quand il/elle voit un travail effectué dans le respect
des règles de sécurité des soins
|
|
Mon supérieur hiérarchique immédiat tient
vraiment compte des suggestions du personnel pour améliorer la
sécurité des soins
|
|
Chaque fois que la pression augmente, mon supérieur
hiérarchique immédiat veut nous faire travailler plus rapidement,
même si c'est au détriment de la sécurité
|
|
Mon supérieur hiérarchique immédiat
néglige les problèmes récurrents de sécurité
des soins
|
|
Organisation
apprenante
|
Nous menons des actions afin d'améliorer la
sécurité des soins
|
|
Dans notre service, les erreurs ont mené à des
changements positifs
|
|
Apres avoir mis en place des actions d'amélioration de la
sécurité des soins, nous évaluons leur
efficacité
|
|
Travail
d'équipe dans
le service
|
Les personnes se soutiennent mutuellement dans le service
|
|
Quand une importante charge de travail doit être
effectuée rapidement, nous conjuguons nos efforts en équipe
|
|
Dans le service, chacun considère les autres avec
respect
|
|
Liberté
d'expression
|
Le personnel s'exprime librement s'il voit quelque chose qui
pourrait affecter les soins portés au patient
|
|
Le personnel a peur de remettre en cause les décisions ou
les actions de ses supérieurs
|
|
Le personnel a peur de poser des questions quand quelque chose ne
semble pas être correct
|
|
Retour et
communication
autour des
erreurs
|
Nous recevons un retour d'information sur les actions mises en
place suite au signalement d'un évènement
|
|
Nous sommes informés des erreurs qui se produisent dans ce
service
|
|
Dans ce service, nous discutons des moyens à mettre en
place afin que les erreurs ne se reproduisent pas
|
|
Réponse non
punitive à
l'erreur
|
Le personnel a l'impression que ses erreurs lui sont
reprochées
|
|
Lorsqu'un évènement est signalé, on a
l'impression que c'est la personne qui est pointée du doigt et non le
problème
|
|
Le personnel s'inquiète du fait que les erreurs soient
notées dans les dossiers administratifs du personnel
|
|
Conditions de
travail
|
Nous avons suffisamment de personnel pour faire face à la
charge de travail
|
|
Le nombre d'heures de travail des professionnels de
l'équipe est trop important pour assurer les meilleurs soins
|
|
Nous travaillons en mode de crise, en essayant de faire trop de
chose trop rapidement
|
Tableau 1 : Dimensions étudiés par le
HSOPSC
22
|
B/Culture de la sécurité au sein de
l'hôpital
|
Soutien du Management
|
La direction de l'établissement instaure un climat de
travail qui favorise la sécurité des soins
|
|
Les actions menées par la direction de
l'établissement
montrent que la sécurité des soins est une
priorité de premier ordre
|
|
La direction de l'établissement semble
s'intéresser à la sécurité des soins uniquement
après qu'un événement indésirable se soit
produit
|
|
Travail entre les équipes de l'établissement
|
Il y a une bonne coopération entre les services qui
doivent travailler ensemble
|
|
Les services de l'établissement ne se coordonnent pas bien
les uns avec les autres
|
|
Il est souvent déplaisant de travailler avec le personnel
des autres services de l'établissement
|
|
Les services de l'établissement travaillent ensemble pour
fournir aux patients les meilleurs soins
|
|
Passation et transfert des patients
|
Des dysfonctionnements surviennent quand les patients sont
transférés d'une unité à l'autre
|
|
D'importantes informations concernant les soins des patients sont
souvent perdues lors des changements d'équipes
|
|
Des problèmes surviennent souvent dans les échanges
d'information entre les services de l'établissement
|
|
C/Résultats de la culture de la sécurité
|
Fréquence de signalement des évènements
indésirables
|
Quand une erreur est faite, mais est détectée et
corrigée avant d'avoir affecté le patient, elle est
signalée
|
|
Quand une erreur est faite, mais n'a pas le potentiel de nuire au
patient, elle est signalée
|
|
Quand une erreur est faite et qu'elle pourrait nuire au patient
mais qu'elle n'a pas finalement pas d'effet, elle set signalée
|
|
Perception globale de la sécurité
|
La sécurité des soins n'est jamais
négligée au profit d'un rendement plus important
|
|
Notre fonctionnement est nos procédures sont efficaces
pour prévenir la survenue des erreurs
|
|
C'est uniquement par hasard s'il n'y a pas eu des erreurs plus
graves dans le service jusqu'ici
|
|
Nous avons des problèmes de sécurité des
soins dans notre service
|
|
Niveau de sécurité du patient au sein de
l'unité
|
|
|
Nombre de fichiers d'EI remplies
|
|
Tableau 1 : Dimensions étudiés par le
HSOPSC
23
V/ Mesure de la perception de la culture de la
sécurité des patients
A/ But de l'étude
La Clinique Pasteur de Tunis, établissement privé
de santé de 140 lits. Il s'agit d'une clinique pluridisciplinaires de 11
salles d'opérations, 20 lits de réanimation et salle de
cathétérisme cardiaque qui a ouvert ses portes en mars 2015. En
Novembre, cette structure s'est engagée dans une démarche
qualité selon les normes de la HAS. En janvier 2016, est
effectuée la mise en place d'un Comité de Gestion des Risques.
Afin d'évaluer l'existant, nous explorons les perceptions
et les attitudes des professionnels de santé relatives à la
sécurité des patients.
B/ Matériels et Méthode
1) Matériels
L'étude a concerné tout le personnel soignant
paramédical de la clinique. Ce personnel au nombre total de 256
était réparti comme suit :
-- Infirmiers : 15
-- Aides soignants : 80
-- Techniciens supérieurs* : 118
-- Autres : 43
Le personnel sans vocation de soins n'a pas été
concerné par l'étude.
*Il en est de même des médecins car la
version utilisée du HSOPSC n'est pas
adaptée à leur statut. En effet, les
médecins n'ont aucune obligation contractuelle envers la clinique et
travaillent à titre individuel. Dans ces conditions, l'adhésion
du corps médical à la démarche de culture de
sécurité relève de choix individuels et non du cadre de la
stratégie globale de l'Etablissement.
2) Méthodes
L'outil utilisé est le HSOPSC dans sa version tunisienne.
L'étude a été menée de manière anonyme entre
le premier et 15 mars. Nous avons :
-- Identifié les unités à étudier
-- Identifié le personnel concerné de chaque
unité que nous nous sommes chargés d'instruire au sujet de
l'étude
-- Désigné un référent par secteur
à explorer
-- Informé les différents responsables des
unités
* Le technicien supérieur est l'équivalent de
l'infirmier spécialisé. Dans notre établissement, Un grand
nombre d'entre eux sont recrutés en temps qu'infirmiers du fait de la
pénurie d'infirmiers
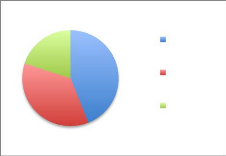
Fig 4: Ancienneté dans le
métier
36%
20%
44%
Plus de 5 ans
Moins de 2ans
3 à 5ans
24
- Insisté sur le caractère anonyme des
réponses
Les questionnaires ont été remis
individuellement à chaque soignant concerné par l'étude.
Le document rempli, le soignant devait le déposer dans une des boites de
recueils mises à disposition dans chaque unité.
Ont été exclus de l'analyse, les questionnaires
aux réponses lacunaires telles que: - Aucune des sections remplies dans
son intégralité
- Moins de la moitié de la totalité des items
remplis
- Même réponses à tous les items
Dans le cas particulier où plusieurs réponses sont
données au même item, est retenue la réponse la moins
favorable à une culture de la sécurité.
C/ Résultats et Discussion
1) Population
256 fiches ont été distribuées, 245 ont
été retournées Le taux de participation était de
94%. Cinq fiches ont été exclues. Sur 227 des 240 fiches
retenues, les fonctions
mentionnées se répartissaient comme suit :
|
Infirmiers :
|
13
|
|
Techniciens supérieurs* :
|
117
|
|
Aides soignants :
|
64
|
|
Autres :
|
33
|
- - - - Nous remarquons que dans les réponses
données, les soignants ont mentionné leur
titre et non leur fonction. Ceci peut témoigner du mal
être généré par le sous-emploi fréquent
de techniciens supérieurs recrutés pour la
fonction d'infirmier.
56% du personnel soignant a plus de trois ans dans le
métier (Figure 4). Au moment de l'étude, 31% du personnel avait
moins d'un an dans l'établissement. Cependant notre méthode
d'analyse ne nous permet de préciser s'il s'agit de recrutement pour un
poste laissé vacant (Turn over) ou un recrutement conséquent
à l'augmentation de l'activité (Figure 5).
25
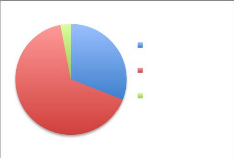
Fig 5: Ancienneté dans
l'établissement
66%
3%
31%
Moins d'un an 1 à 2 ans 3 à 5
ans
2) Graphique des Scores des dimensions de la
sécurité des patients
Notre étude a montré une disparité des
scores des 12 dimensions de la CS des patients exprimés par la moyenne
des pourcentages de réponses positives aux items correspondants à
chaque dimension (figure 6)
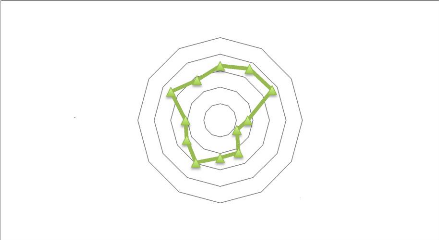
Travail d'équipe entre les services
Transfert des patients
Perception globale de la
sécurité
Signalement des
évènements
indésirables
Soutien du management
69%
42%
47%
59%
Attentes du supérieur
hiérarchique
56%
Conditions de travail
46%
Organisation apprenante
66% 72%
45%
24%
34%
Feedback
73%
Travail d'équipe dans le
service
Liberté d'expression
Réponse non punitive
Figure 6 : Scores des dimensions de la culture de
sécurité
3) Scores des dimensions au sein de
l'unité
a) Attentes et actions du supérieur
hiérarchique concernant la sécurité des
patients
Avec un score moyen de 66%, le personnel a plutôt une
opinion positive concernant les attentes et les actions de leur
supérieur hiérarchique immédiat en matière de
sécurité des patients (tableau 2). Il semble y avoir une bonne
communication entre le personnel et le supérieur hiérarchique
immédiat.
26
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
Mon supérieur hiérarchique
|
160
|
20
|
62
|
|
|
immédiat exprime sa
satisfaction quand il/elle
voit
un travail réaliser dans le
respect des règles de
sécurité
|
66%
|
8%
|
|
242
|
|
des soins
|
|
|
26%
|
|
|
Mon supérieur hiérarchique
|
143
|
32
|
62
|
|
|
immédiat tient vraiment
compte des suggestions
du
personnel pour améliorer la
sécurité des soins
|
60%
|
13.5%
|
26.5%
|
237
|
|
Chaque fois que la pression
|
152
|
29
|
63
|
|
|
augmente, mon supérieur
hiérarchique
immédiat veut
nous faire travailler plus
rapidement, même si
c'est au
détriment de la sécurité
|
62%
|
12%
|
26%
|
244
|
|
Mon supérieur hiérarchique
immédiat
néglige les
problèmes récurrents
de
sécurité des soins
|
185
75.5%
|
26
10.5%
|
34
14%
|
245
|
|
Score : 66%
|
|
Tableau 2: Attentes et actions du supérieur
hiérarchique concernant
|
|
la sécurité des patients
|
b) Organisation apprenante et amélioration
continue
Cette dimension obtient un score élevé de 72% et
témoigne que le personnel prend au sérieux la
sécurité des patients (tableau 3).
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
Nous menons des actions afin
|
218
|
5
|
16
|
|
|
d'améliorer la sécurité des
|
|
|
|
239
|
|
soins
|
90%
|
2%
|
8%
|
|
|
Dans notre service, les
|
162
|
39
|
38
|
|
|
erreurs ont conduit à des
|
|
|
|
239
|
|
changements positifs
|
67%
|
16%
|
17%
|
|
|
Apres avoir mis en place des
|
137
|
43
|
52
|
|
|
actions d'amélioration de la
sécurité
des soins, nous
évaluons leur efficacité
|
60%
|
18%
|
22%
|
232
|
|
Score:72%
|
|
Tableau 3: Organisation apprenante et
amélioration continue
|
27
c) Travail d'équipe dans le service
Cette dimension est bien développée (Tableau 4) et
témoigne de la bonne ambiance réelle qui existe dans les
différentes unités de l'établissement. Cependant, si les
membres d'une même équipe s'entraident en cas de surcharge de
travail, des efforts restent à faire en matière de respect
mutuel.
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
Les personnes se soutiennent
|
64
|
15
|
164
|
|
|
mutuellement dans le service
|
|
|
|
243
|
|
67.5%
|
6%
|
26.5%
|
|
|
Quand une importante charge
de travail doit être
effectuée
rapidement, nous conjuguons
nos efforts en
équipe
|
198
|
9
|
33
|
240
|
|
82.5%
|
4%
|
13.5%
|
|
|
Dans le service, chacun
|
165
|
27
|
49
|
|
|
considère les autres avec
|
|
|
|
241
|
|
respect
|
68.5%
|
11%
|
20.5%
|
|
|
Score: 73%
|
|
Tableau 4 : Travail d'équipe dans le
service
|
d) Liberté d'expression
Le personnel ne se sent pas libre d'exprimer son opinion
concernant la sécurité des patients (Tableau 5). Comparé
au score relativement bon des rapports avec le supérieur
hiérarchique immédiat (66%), ce résultat paraît
paradoxal. En fait, Il semble que le manque
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
Le personnel s'exprime
|
109
|
54
|
74
|
|
|
librement s'il voit quelque
chose dans les soins qui
peut
avoir des conséquences
négatives sur les patients
|
46%
|
23%
|
31%
|
237
|
|
Le personnel a peur de
|
55
|
41
|
138
|
|
|
remettre en cause les
décisions ou les actions
de
ses supérieurs
|
24%
|
17%
|
59%
|
234
|
|
Le personnel a peur de poser
|
74
|
71
|
95
|
|
|
des questions quand quelque
chose ne semble pas
être
correct
|
31%
|
29%
|
40%
|
240
|
|
Score: 33.5%
|
|
Tableau 5 : Liberté d'expression
|
28
de liberté d'expression exprimé par cette dimension
concerne le rapport du personnel soignant paramédical avec les
médecins et non le supérieur hiérarchique
immédiat.
e) Réponse non punitive à
l'erreur
Ce score de 23% est le plus bas enregistré dans cette
étude (tableau 6). Il révèle l'appréhension du
personnel paramédical de s'exposer au reproche, à la sanction.
Ceci peut être expliqué par le fait que les évolutions qui
se sont produites ces dernières années en Tunisie, peinent
à franchir le seuil des entreprises.
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
Le personnel a l'impression
|
39
|
39
|
162
|
|
que ses erreurs lui sont
|
|
|
|
240
|
reprochées
|
16%
|
16%
|
68%
|
|
Lorsqu'un évènement est
signalé, on a l'impression que c'est la personne qui est
pointée du doigt et non le
problème
|
88
37%
|
18
8%
|
130
55%
|
236
|
Le personnel s'inquiète du fait
|
45
|
40
|
157
|
|
que les erreurs soient notées
dans les
dossiers
administratifs du personnel
|
20%
|
16%
|
64%
|
242
|
Score: 23.5%
|
Tableau 6 : Réponse non punitive à
l'erreur
|
|
f) Retour et communications autour des
erreurs
Le score faible de cette dimension témoigne
probablement du fait que l'absence de liberté d'expression et la peur de
la sanction ne facilitent pas la communication autour des erreurs (Tableau
7)
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
Nous recevons un retour
|
83
|
63
|
96
|
|
|
d'information sur les actions
mises en place suite
au
signalement d'un évènement
|
34%
|
26%
|
40%
|
242
|
|
Nous sommes informés des
|
126
|
45
|
67
|
|
|
erreurs qui se produisent
|
|
|
|
238
|
|
dans ce service
|
53%
|
19%
|
28%
|
|
|
Dans ce service, nous
|
114
|
52
|
73
|
|
|
discutons des moyens à
mettre en place afin que
les
erreurs ne se reproduisent
pas
|
48%
|
21%
|
31%
|
239
|
|
Score: 45%
|
|
Tableau 7 : Retour et communication autour des
erreurs
|
29
g) Les conditions de travail
Le score moyen est bas. Il témoigne d'une perception
négative des conditions de travail (Tableau 8).
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
Nous avons suffisamment
|
93
|
19
|
132
|
|
|
de personnel pour faire face
|
|
|
|
244
|
|
à la charge de travail
|
38%
|
8%
|
54%
|
|
|
Le nombre d'heures de
|
138
|
37
|
65
|
|
|
travail des professionnels
de l'équipe est
trop
important pour assurer les
meilleurs soins
|
57.5%
|
15.5%
|
27%
|
240
|
|
Nous travaillons en mode
|
101
|
22
|
122
|
|
|
de crise, en essayant de
faire trop de chose
trop
rapidement
|
41%
|
9%
|
50%
|
245
|
|
Score: 45.5%
|
|
Tableau 8 : Conditions de travail
|
Ceci peut être en partie expliqué par au moins deux
raisons :
-- En Tunisie, il n'existe pas d'agence d'intérim et en
cas d'absence d'un soignant, le poste reste vacant. La surcharge de travail est
compensée par le personnel présent.
-- Dans notre établissement, le personnel soignant
travaille en double séance moitié moins de jours. Cette
façon de travailler, adoptée pour diminuer le coût du
transport, est visiblement source d'épuisement.
4) Scores des dimensions au sein de
l'établissement a) Le soutien du management pour la
sécurité des patients
Le rôle, décisif, joué par le leadership dans
le développement d'une culture de sécurité en intervenant
dans la conception, la promotion et la pérennisation de cette culture
est maintenant bien établi (40). Il est également constaté
qu'un manque de leadership est un obstacle au développement de la
culture de sécurité (41).
Les résultats de notre enquête
révèlent que le score global de cette dimension de 59% est bas
(Tableau 9). Il témoigne de l'opinion négative du personnel
concernant l'implication de la Direction dans la sécurité. La
moitié du personnel pense que la Direction s'intéresse à
la sécurité des patients seulement après la survenue d'un
événement indésirable. Ils ne sont que 48% à penser
que la sécurité des patients est la priorité de la
Direction. Cette dernière doit s'impliquer davantage dans la
sécurité des patients et améliorer sa communication en la
matière.
30
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
La direction de
|
176
|
30
|
31
|
|
|
l'établissement instaure un
climat de travail qui
favorise la
sécurité des soins
|
74%
|
13%
|
13%
|
237
|
|
Les actions menées par la direction de
l'établissement montrent que la sécurité des soins est une
des premières
priorités
|
123
52%
|
57
24%
|
56
24%
|
236
|
|
La direction de
|
116
|
49
|
65
|
|
|
l'établissement semble
s'intéresser à
la sécurité des
soins uniquement après
qu'un
événement indésirable se soit
produit
|
50%
|
21%
|
29%
|
230
|
|
Score 59%
|
|
Tableau 9: Soutien du management pour la
sécurité des patients
|
b) Travail d'équipe entre les différents
secteurs de l'établissement
Avec un score global de 47% (Tableau 10), Il existe manifestement
au sein de notre établissement un cloisonnement entre les
différentes unités. Chaque unité a développé
sa propre culture organisationnelle et cela rend le travail entre les
différentes unités désagréable. La démarche
qualité mise en place au sein de l'établissement devrait
permettre de mieux homogénéiser les procédures et diminuer
les disparités inter-unités.
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses totales
|
|
Il y a une bonne coopération
|
123
|
|
48
|
63
|
|
|
entre les services qui doivent
|
|
|
|
|
234
|
|
travailler ensemble
|
|
53%
|
20%
|
27%
|
|
|
Les services de
|
|
80
|
51
|
106
|
|
|
l'établissement ne se
coordonnent pas bien les
uns
avec les autres
|
|
34%
|
21%
|
45%
|
237
|
|
Il est souvent déplaisant de
|
|
93
|
40
|
103
|
|
|
travailler avec le personnel
des autres services
de
l'établissement
|
|
39%
|
17%
|
44%
|
236
|
|
Les services de
l'établissement
travaillent
ensemble pour fournir aux
patients les meilleurs soins
|
|
142
61%
|
44
19%
|
45
20%
|
231
|
|
Score: 47%
|
|
Tableau 10 : Travail d'équipe entre les
différents secteurs de l'établissement
|
31
c) Transferts des patients et passations
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses totales
|
|
Des dysfonctionnements
|
88
|
50
|
100
|
|
|
surviennent quand les patients
sont transférés
d'une unité à
l'autre
|
37%
|
21%
|
42%
|
238
|
|
D'importantes informations
|
110
|
33
|
93
|
|
|
concernant les soins des
patients sont souvent
perdues
lors des changements
d'équipes
|
47%
|
14%
|
39%
|
236
|
|
Des problèmes surviennent
|
104
|
50
|
83
|
|
|
souvent dans les échanges
d'information entre les
services
de l'établissement
|
44%
|
21%
|
35%
|
237
|
|
Score: 42%
|
|
Tableau 11: Transfert des patients et
Passation
|
Le score de cette dimension est très bas à 42%
(Tableau 11). Si l'on sait que développer une communication efficace
durant les changements de prestataires (42) est une des neufs solutions
proposées par l'OMS pour améliorer la sécurité des
patients, il nous apparaît que des efforts importants doivent être
déployés dans notre établissement pour palier à
cette faille sécuritaire.
5) Score des dimensions des résultats de la
culture de sécurité a) Perception globale de la
sécurité des patients
Le score moyen de cette dimension est de 69,25%. Le pourcentage
de réponse à chaque question constituant cette dimension est
représenté dans le Tableau 1. La perception globale de la
sécurité paraît être une dimension bien
développée dans notre établissement. Cependant, deux
remarques peuvent être retenues :
-- Il existe une disparité importante entre les
différents items de cette dimension
allant de 80 à 54%
-- la dimension « perception globale de la
sécurité» ne peut être analysée sans tenir
compte du contexte culturel national. A l'échelle nationale, en Tunisie
cette capacité à percevoir le danger, est plutôt mauvaise.
Le meilleur témoin en est la conduite automobile. Ainsi la perception de
la sécurité par le personnel peut être faussement
élevée en raison d'une capacité insuffisante à
apprécier les situations dangereuses.
32
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
La sécurité des soins n'est
|
30
|
18
|
191
|
|
|
jamais négligée au profit d'un
rendement plus
important
|
|
|
|
239
|
|
80%
|
7.5%
|
12.5%
|
|
|
Notre fonctionnement est nos
|
166
|
26
|
47
|
|
|
procédures sont efficaces
pour prévenir la
survenue des
erreurs
|
69.5%
|
11%
|
19.5%
|
239
|
|
C'est uniquement par hasard
|
172
|
24
|
28
|
|
|
s'il n'y a pas eu des erreurs
plus graves dans le
service
jusqu'ici
|
73.5%
|
10%
|
16.5%
|
234
|
|
Nous avons des problèmes
|
129
|
29
|
80
|
|
|
de sécurité des soins dans
|
|
|
|
238
|
|
notre service
|
54%
|
12%
|
34%
|
|
|
Score: 69.25%
|
|
Tableau 12 : Perception globale de la
sécurité
|
b) Fréquence de signalement des
évènements indésirables
Cette dimension recueille un score faible de 56% (Tableau 13)
témoin de l'absence de conscience de l'importance du report des
Evènements indésirables de la part du personnel soignant.
|
Réponse
positive
|
Réponse
neutre
|
Réponse
négative
|
Réponses
totales
|
|
Quand une erreur est faite,
mais est détectée
et corrigée
avant d'avoir affecté le
patient, elle est
signalée
|
152
64%
|
52
22%
|
35
14%
|
239
|
|
Quand une erreur est faite,
mais n'a pas le potentiel
de
nuire au patient, elle est
signalée
|
115
48%
|
59
25%
|
62
27%
|
236
|
|
Quand une erreur est faite et
|
133
|
52
|
50
|
|
|
qu'elle pourrait nuire au
patient mais qu'elle n'a
pas
finalement pas d'effet, elle est
signalée
|
56%
|
22%
|
22%
|
235
|
|
Score: 56%
|
|
Tableau 13 : fréquence de signalement des
évènements indésirables
|
33
6) Critiques et limites de l'étude
Nous avons validé notre version tunisienne de l'HSOPSC par
la méthode de traduction contre traduction. Il nous reste à
effectuer des tests psychométriques afin de valider
définitivement notre version et en proposer l'adoption à tous les
établissements tunisiens de santé.
La deuxième critique que nous pouvons faire au sujet de
cette étude est que nous avons mené une étude globale sans
tenir compte des sous-cultures. Sous-cultures qui peuvent être
présentes dans notre établissement puisque la plus grande partie
de nos soignants viennent d'horizons différents (figure 4).
Enfin, malgré l'anonymat il existe un biais habituel de
déclaration dans ce type d'étude, avec des réponses
exagérément positives des répondants par crainte de
stigmatisation ou pour une raison de désirabilité sociale.
Ces limites étant considérées, ce travail a
néanmoins montré que la culture de la sécurité est
relativement peu développée au sein de notre personnel soignant
puisque le plus grand nombre des dimensions ont eu un score de moins de 50
%.
.
34
VI/ Conclusion
Cette étude nous a permis de cerner la perception de la
culture de sécurité par le personnel soignant paramédical
de notre Etablissement. Considérant les résultats dans leur
ensemble, il apparaît que la culture de sécurité n'est pas
encore développée comme en témoignent les faibles scores
du plus grand nombre des dimensions. L'une d'elles, pourtant
déterminante, est celle qui concerne le management. En effet, pour qu'un
degré de développement satisfaisant soit atteint en
matière de culture de sécurité, l'implication de la
Direction doit être pleine et entière.
Le transfert des patients et la communication durant les
changements des prestataires de soins est une autre dimension sur laquelle nous
devons travailler en priorité pour améliorer la
sécurité des patients.
Il apparaît également nécessaire d'abandonner
les archaïsmes, comme la culture du blâme et les entraves à
la liberté d'expression, et d'instaurer une culture qui ne recherche pas
la stigmatisation et la sanction d'un coupable mais la compréhension des
mécanismes des erreurs. Toutefois, une culture équitable et
flexible ne doit en aucun cas se muer en culture permissive qui donnerait lieu
à une interprétation erronée de la tolérance dans
l'établissement.
Par ailleurs, le statut actuel des médecins,
évoqué précédemment, rend difficile leur
intégration dans la démarche de culture de
sécurité. Un nouveau cadre législatif régissant la
relation entre médecins et établissements de santé
privés, doit être impérativement mis en place.
Les résultats de cette étude viennent confirmer
avec force, la pertinence et l'actualité de la démarche
qualité qui a été mise en place au sein de la Clinique.
Une deuxième étude doit être effectuée à
l'achèvement de la phase actuelle du programme qualité afin d'en
évaluer le réel impact sur la culture de
sécurité.
35
Références
1) OMS. (consultée le 17/2/2016). Patient safety.
http://www.who.int/patientsafety/about/en/
2) Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson,
Institute of Medicine. 2000. To Err Is Human: Building a Safer Health
System. Washington, DC: National Academy Press.
3) James JT, A new evidence-evidence estimate patient harms
associated with hospital care. J Patient Saf 2013 ; 9 : 122-128
4) Michel Ph, Minodier C, Moty-Monereau C, Lathelize M, Domecq
S, Chaliex M, Kret M, Roberts T, Bru R. Quintard B, Quenon JL, Olier L. Les
événements Indésirables Graves dans les Etablissements de
Santé : Fréquence, Evitabilité et Acceptabilité,
Etudes et Résultats. DREES, N° 761
· mai 2011
5) Bouafia N, Bougmiza I, Bahri F, Letaief M, Astagneau P, Njah
M. Ampleur et impact des évènements indésirables graves
liés aux soins : étude d'incidence dans un hôpital du
Centre-Est tunisien. Pan Afr Med J. 2013; 16 :68.
6) Patient safety in developping countries: Retrospective
estimation of scale and nature of harm to patients in hospital ; BMJ 2012 ; 344
: e832
7) Shreve J, Van Den Bos J, Gray T, Halford M, Rustagi K,
Ziemkievicz E. The economic measurement of medical errors sponsored by society
of actuaries' health section. Milliman Inc. Educationnal Research, 2010 ;
99(6), 323-338
8) NHS. (consultée le 20/11/2015). Seven steps to patient
safety.
http://www.nrls.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/getresource.axd?AssetID=59971&
9) Groupe Consultatif International Pour la Sureté
Nucléaire. Culture de sureté. Collection Sécurité,
1991 ; No. 75-INSAG-4, 32 p.
36
10) International Nuclear Safety Advisory Group. Tchernobyl
accident : updating INSAG1. Safety series, 1992 ; No. 75-INSAG-7,
11) Culture de sécurité dans le domaine
nucléaire, Rapport IRSN 2005/54, 26 p.
12) Chevreau F. Maitrise des risques industriels et culture de
sécurité : le cas de la chimie pharmaceutique. Sciences de
l'ingénieur [physics]. Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Paris, 2008
13) Haukelid K. Theories of (safety) culture revisited- an
anthropological approach. 2008, 46 (3) ; 413-426
14) Nascimento A, Produire la santé, produire la
sécurité. Développer une culture de sécurité
en radiothérapie. [Thèse Doctorat en Ergonomie]. Paris :
Conservatoire National des Arts et Métiers ; 2009.
15) Richter, A. and Koch, C. Integration, differentiation and
ambiguity in safety cultures. Safety Science, 2004, 42(8): 703-722
16) Pidgeon N, O'Leary M. Man made disasters : Why technology
and organizations (sometimes) fail, Safety Science 2000, 34 ; 15-30
17) Hall J. L, Columbia and Challenger: organizational failure
at NASA. Space Policy, 2003 ; 19, 239-247
18) Reason JT. Organizational accidents, the management of human
and organizational factors in hazardous technologies. Cambridge : Cambridge
University Press ; 1997
19) Cooper MD. Towards a model of safety culture. Safety
Science, 2000, 36 (2) : 111-136
20) Guldenmund FW. The nature of safety culture. Safety Science,
2000 ; 34,215-257
21) Occelli P, Quenon JL, Hubert B, et al. La culture de
sécurité en santé : un concept en pleine émergence.
Risques et Qualité 2007; 4(4):207-212.
37
22) HAS. (consultée le 20/5/2016). Culture de
sécurité des soins : Du concept à la pratique.
http://www.has--
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011--
02/culture de securite des soins du concept a la
pratique.pdf
23) Institute Of Medicine : Patient Safety : Achieving a New
Standard of Care. Washington : National Academies Press ; 2004
24) Braithwaite J, Westbrook MT, Travaglia JF, Hughes C.
Cultural and associated enablers of,and barriers to, adverse incident
reporting. Quality and Safety in HealthCare, 2000 ; 19, 229-233.
25) Mardon RE. Exploring relationships between hospital patient
safety culture and adverse events. J Patient Saf. 2010; 6(4):226-32
26) Singer S, Lin S, Falwell A, Gaba D, Baker L. Relationship of
safety climate and safety performance in hospitals. Health Services Research.
2009, 44(2), 399-421.
27) Buerhaus PI, Donelan K, Ulrich BT, Norman L, DesRoches C,
Dittus R. Impact of the nurse shortage on hospital patient care:Comparative
perspectives. Health Affairs, 2007, 26(3), 853-862.
28) Scott T, Russel M, Huw D, Marshall M. The Quantitative
Measurement of Organizational Culture in Health Care: A Review of the Available
Instruments. Serv Res. 2003 Jun; 38(3): 923-945.
29) Al Doweri H, Al Raoush A, Alkhatib A, Batiha M A. Patient's
Safety Culture: Principles and Applications: Review Article. European
Scientific Journal May 2015 edition vol.11, No.15
30) Pronovost P, Sexton B. Assessing Safety culture: Guidelines
and Recommendations. Qual Saf Health Care, 2005 ; 14, 231-233.
31) Mearns K, Flin R. Assessing The State of Organizational
Safety. Current Psychology: Developmental, Learning,Personality, Social, 1999
;18(1), 5-17.
38
32) Gaba DM. Anaesthesiology as a Model for Patient Safety in
Health Care. BMJ. 2000 Mar 18; 320(7237): 785-788.
33) Largier A, Lot N. Secourir un train en panne : limites et
difficultés à l'écriture des règles de
sécurité. Activités, 2012 ; Volume 9 numéro 1
34) Choudhry RM, Fang D, Mohamed S. The Nature of Safety
Culture: A Survey of the State-Of-The-Art. Safety Science, 2007 ; 45(10),
993-1012.
35) Westrum R. A Typology of Organisational Cultures. Qual.
Saf. Health Care, 2004 ; 13, 2227.
36) Glendon AI, Stanton NA. Perspectives on Safety Culture.
Safety Science, 2000 ; 34, 193- 214.
37) Sorra, JS, Nieva VF. Hospital Survey on Patient Safety
Culture. AHRQ Publication, 2004 ; N°04-0041.
38) Sorra J, Nieva VF, Famolaro T, Dyer N. Hospital Survey On
Patient Safety culture : Comparative Database Report. AHRQ Publication 2007 ;
N°7-0025
39) BOULETREAU A, CHOUANIERE D, WILD P, FONTANA J.M. Concevoir,
traduire et valider un questionnaire. A propos d'un exemple. EUROQUEST. INRS,
1999 ; NS178
40) Blake SC, Kohler S, Rask K, Davis A, Naylor DV. Facilitators
and barriers to 10 national quality forum safe practices. American Journal of
Medical Quality, 2006 ; 21(5), 323-334
41) Dickey NW. Creating a culture of safety. Journal of Patient
Safety, 2005 ;1(2), 75.
42) OMS. (consultée le 20/5/2016). Solutions pour la
sécurité des patients.
http://www.who.int/patientsafety/events/07/patientsafety_solutions_french.pdf
39
Annexe 1 : Autorisation de traduction du
HSOPSC
Expéditeur: <
SafetyCultureSurveys@westat.com>
Date: 29 mai 2014 22:19:40 UTC+1
Destinataire: <
lbmosbah@ymail.com>
Objet: Rép : Authorization:
*ref#24-25121
Dear Lotfi,
Thank you for your interest in the AHRQ Hospital Survey on
Patient Safety Culture.
Your inquiry was forwarded to Westat, the contractor who provides
technical assistance for the safety culture surveys. We are happy to hear that
you will be using the Hospital Survey on Patient Safety Culture. Yes, your
organization has AHRQ's permission to use the Hospital Survey on Patient Safety
Culture in English or translate it into Tunisian Arabic language. The AHRQ
safety culture surveys for hospitals, nursing homes, medical offices, and
pharmacies are free and available for public use from the AHRQ Web site at:
http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/index.html.
Select the Hospital Survey on Patient Safety Culture and then you will find the
surveys and support materials.
We request that any surveys used in the study note that the
surveys were reprinted or translated from English with the permission of the
United States Agency for Healthcare Research and Quality. Any research studies
based on the survey results should give a source citation to the Hospital SOPS
Web page
http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/hospital/index.html
.
Each survey has an accompanying Toolkit which contains the
following materials:
o Survey Forms
o Survey Items and Dimensions
o A Survey User's Guide: Gives step-by-step instructions on how
to select a sample, administer the survey and obtain high response rates, and
how to analyze and report results.
o Survey feedback report PowerPoint® template: Can be
customized to display survey results to administrators and staff throughout the
organization, and for presentation purposes.
o Data Entry and Analysis Tool: A data entry and analysis tool
that works with Microsoft® Excel and makes it easy to input your
individual-level data from the survey. The tool then automatically creates
tables and graphs to display your survey
40
results. To request the tool for the hospital, medical office, or
nursing home survey, send an E-mail to:
DatabasesOnSafetyCulture@westat.com.
Since the release of the AHRQ Hospital Survey on Patient Safety
Culture in November 2004, the number of international survey users has grown.
This link
http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/pscintusers.html
will give you information on international users, including languages into
which the survey has been translated and guidelines for translation etc.
You may register for email updates from the AHRQ Web site by
going to
https://subscriptions.ahrq.gov/service/multi
subscribe.html?code=USAHRQ.
Choose from the following SOPS email subscription lists:
Surveys on Patient Safety Culture
· Hospital Survey
· Medical Office Survey
· Nursing Home Survey
· Translations and International Use
I would request you to provide us with your Organization address,
phone and fax for our International database record.
If you need further information, please let us know.
Thank you. Chris
Chris Gomes
AHRQ Surveys on Patient Safety Culture Technical Assistance
SafetyCultureSurveys@westat.com
1-888-324-9749
41
42
43
44
| 


