|
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE ET RECHERCHES
SCIENTIFIQUES
« E.S.U.R.S »
UNIVERSITE CATHOLIQUE DU GRABEN
« UCG »
B.P 29 BUTEMBO/NORD KIVU
ANNEE ACADEMIQUE 2008-2009
TRAVAIL DE FIN DE CYCLE
MUYISA LUSOLO Landry
Directeur : P.A VAHAVI MULUME
ENCADREUR : C.T TSASA BWEDE
« ETUDE DE LA RENTABILITE DES CYBERCAFES DES
TARIFICATIONS DIFFERENTES » CAS DU CONGO-SAT ET DU CENTRE ADEN
UCG

EPIGRAPHE
Un espoir différé rend le coeur malade, mais un
désir accompli est un arbre de vie,
Proverbe 13, 12
DEDICACES
À vous nos parents TAMBWE
MUSHOLO et KAHINDO CECILE, qui nous avez donné la vie et mis à
l'école ;
À vous nos
frères : BARAKA PUMA, DIDIER MUSHOLO, nos soeurs : KASOKI
FURAHA , FAIDA CHANTALE, TAMBWE MWANGAZA Collette, MBAMBU KOKO, cousins,
cousines, tantes, oncles et amis (es) qui espérez en nous et nous
soutenez en tout temps dans les moments difficiles de notre vie,
Nous dédions ce travail, fruit de tant d'années
de sacrifice et d'abnégation, qui saura nous lancer dans de nouvelles
perspectives d'avenir.
REMERCIEMENTS
En genèse de ce travail, qu'il nous soit permis
d'exprimer ici, tout d'abord notre sincère reconnaissance envers
l'Eternel, créateur du Ciel et de la Terre, car
: " Si le Seigneur ne bâtit la maison en vain
peinent les maçons, si le Seigneur ne garde la ville en vain la garde
veille. " nous déclare le Psaume 126,
1.
L'expression de notre gratitude s'adresse à nos parents
TAMBWE MUSHOLO et KAHINDO CECILE qui nous ont établi l'éducation
de base de ce que nous sommes aujourd'hui.
En suite, nous réitérons nos compliments
à notre directeur de travail le Professeur Associé VAHAVI MULUME
Bertrand et notre encadreur Chef des Travaux TSASA BWEDE qui malgré
leurs multiples occupations se sont donné pour coordonner ce travail,
nous remercions aussi le gestionnaire de CONGO SAT/Butembo MUYISA KAHINDULA
pour nous avoir bien encadré en menant nos recherches au sein de
l'entreprise dont il assume la gestion. Nous remercions aussi toute
l'équipe du centre ADEN de l'UCG pour avoir contribué à la
réussite de nos recherches, spécialement le
gestionnaire KAMBASU KASULA Florent.
Nos reconnaissances s'en vont également aux
autorités académiques ainsi qu'à tout le corps professoral
et administratif de l'Université Catholique du Graben pour toutes les
connaissances intellectuelles et morales nous transmises et pour tout autre
sacrifice consenti pour nous.
Nos sentiments de gratitude et de reconnaissance s'adressent
ensuite à tous les amis qui, de près ou de loin, ont concourus
à l'effectivité de cet oeuvre. En ce niveau nous voyons MASTAKI
Trésor, MWERA NGELEZA Willy, KINYATSI Tantine, MUGHOLE MAHAMBA Dina,
WASUKUNDI Jackson, MBAMBU MUYISA Yaya, MUSAVULI KASEREKA, MUHINDO KACHELEWA,
THOM'S BISIMWA, NZANZU VAKE, ZAWADI MBALI et les autres.
SIGLES ET ABREVIATIONS
ADSL : Assymetric Digital Subsciber Line
BRL : Boucle local radio
C.D : Compact Disk
F.A.I : Fournisseurs d'accès Internet
GSM : Global system for Mobil communication
I.P : Internet provider
ISDN : Integrated services Digital Network
ISP : Internet Services Provider (Fournisseurs de
service Internet)
Kb/s : Kilo bite par seconde
KHz : Kilo Hertz
Mb/s : Méga bite par seconde
MHz : Méga Hertz
PC : Personnal computer
RNIS : Réseau numérique à
Intégration de service
U.I.T : Union Internationale des
Télécommunications
USB : Universal serial Bus
VPN : Virtual privat network
SCAC : Services de coopération et d'actions
culturelles
ADEN : Appui au désenclavement numérique
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et
de la communication.
TFR : Tableau de formation de résultat
INTRODUCTION
1. Problématique
Plus récemment, dans la période moderne, la
rapidité des communications a gagné en importance, du moins dans
les pays industrialisés. Les services postaux et les transports se sont
accélérés et les télécommunications sont
nées. Pour les voyages lointains, l'avion a largement remplacé le
bateau et le train. L'échange d'informations, de messages a depuis
longtemps été un souci pour les hommes. Ainsi va-t-on voir se
développer certaines formes de communication depuis les temps
« primitifs » et "au début, l'homme
utilisait des moyens assez traditionnels tels que les signaux de fumée
des Indiens d'Amérique, le cor des Alpes en Suisse, le tam-tam ou les
signaux de sémaphore, pour allonger la distance à laquelle il
pouvait transmettre un message"1(*)
Comme nous pouvons le constater, les moyens de
communication existaient dans chaque société. Mais comment
s'échanger des informations sur de longue distance ? Ce souci a
poussé les hommes à des inventions qui dans leur temps
étaient spectaculaires (le morse, ....). Le télégraphe et
le téléphone ont de plus en plus rapproché les hommes. La
télécopie, le télex et le téléfax sont venus
pour renforcer les outils de communication déjà existants
Les développements concernant le traitement de
l'information et de la communication sont au coeur de nombreux changements
ayant marqué la seconde moitié du XXème
siècle. Le phénomène Internet illustre
l'accélération rapide de cette évolution et son impact
potentiel sur la vie économique, sociale et culturelle.
Depuis l'arrivée de l'Internet à Butembo, une
part importante de la fonction de la poste, celle de communication entre une
personne et une autre, lui est presque prise. Aujourd'hui, nous notons la
création des cybercafés ou cyberespaces avec l'innovation de
l'Internet. Les cybercafés sont plus adaptés et pratiques pour
l'envoi et la réception de courriers ordinaires, c'est-à-dire les
lettres. Très pratique et moins coûteux, le cybercafé est
devenu un lieu apprécié par bon nombre de personnes ayant une
connaissance de l'utilisation de l'Internet
Dans le monde des affaires, si un entrepreneur ne comprend pas
le présent, il est toujours incapable de prévoir l'avenir. Au
sein de son entreprise, l'entrepreneur doit s'inspirer des faits
constatés pendant une certaine période pour prévoir son
avenir. Dans le monde moderne où les entreprises sont soumises à
la concurrence, l'entrepreneur doit de temps en temps procéder à
une étude comparative d'éléments déterminant son
résultat tels que les recettes et dépenses d'exploitation. Il
doit donc apprécier la rentabilité de son activité
économique. Si cette dernière n'est pas rentable, pourquoi
continuer à nager dans le chao ? En situation pareille,
l'entrepreneur doit être encouragé à fermer ses portes. Si
l'activité est rentable, l'entrepreneur est à encourager de
continuer cette activité économique.
Les recettes réalisées au Cybercafé sont
une fonction linéaire du temps effectué. Le temps fait, est
assorti d'un prix de navigation qui dépend d'un Cybercafé
à un autre. Il s'avère important voire indispensable pour nous de
voir comment la tarification d'un Cybercafé influence les
résultats de ce dernier par rapport à la concurrence.
Vu la prolifération des Cybercafés à
Butembo, à travers cette étude nous voulons voir s'il y a
rentabilité financière dans ce secteur d'activité.
Une question a suscité notre
préoccupation :
- les cybercafés CONGO SAT et ADEN UCG sont -ils
rentables ?
2. Hypothèses de travail
L'hypothèse est une réponse provisoire et
probable qui est faite anticipativement2(*). Sans pour autant être livré dans une
confirmation nous entrevoyons que :
- Il se pourrait que les cybercafés CONGO SAT et ADEN
UCG soient moyennement rentables.
Nous allons partir de cette hypothèse pour atteindre
nos objectifs.
3. Objectifs
Ils nous permettent de décrire et d'identifier le but
poursuivi par l'étude. Ainsi distinguons-nous l' objectif
général et les objectifs spécifiques.
1.3.1. Objectif
général
Un objectif général est retenu pour ce travail.
Il s'agit pour nous de parvenir à étudier le système
financier des cybercafés dans domaine concurrentiel. De cet objectif
général ressortent plusieurs objectifs spécifiques.
1.3.2 Objectifs
spécifiques
Les objectifs spécifiques nous ont permis la
réalisation de l'objectif général. Et pour réaliser
notre objectif principal, décrirons-nous le cybercafé afin
d'identifier les types de cybercafés. Essayer d'identifier les
principaux acteurs du marché des cybercafés, les
différents systèmes de distribution de l'Internet et
présenter les infrastructures de commerce de l'Internet. Nous
déterminons les conditions de création d'un cybercafé et
d'entrée sur le marché des cybercafés et identifions les
rapports qui existent entre les deux cybercafés, de même que les
différents problèmes rencontrés par les
propriétaires de cybercafés. Nous voudrons également
étudier la rentabilité financière des cybercafés
Congo SAT et du centre ADEN de l' UCG, voir si leurs recettes leur permettent
de couvrir leurs charges d'exploitation.
4. Choix et
intérêt du sujet
Le choix du thème serait inutile s'il n'y avait pas de
problèmes. Car toute recherche naît de l'existence d'un
problème qu'il faut élucider ou contribuer à sa
résolution par des approches de solutions
Le choix du sujet est motivé par l'appréciation
de la commercialisation de l'Internet au sein du cybercafé Congo SAT et
du centre ADEN de l'UCG. Les recettes réalisées permettent non
seulement à couvrir leurs charges d'exploitation mais aussi contribuent
à la constitution du produit intérieur brut et au revenu
national.
Ce travail servira de support à tous ceux qui
s'engagent dans des activités commerciales dans la communication en
général et en particulier dans la commercialisation de l'Internet
au niveau des cybercafés.
Il leur permettra de comprendre les mécanismes de
fonctionnement du marché des cybercafés, pour un meilleur
résultat. Ce document pourra être utile à mieux faire
connaître l'Internet et à mieux orienter les acteurs dans le
domaine pour un choix judicieux et une bonne gestion.
De même c'est un appel lancé aux décideurs
publics afin qu'ils sachent que le secteur des communications et
télécommunications ne doit pas être négligé.
C'est un élément de croissance pour l'économie nationale
et par conséquent des mesures appropriées doivent être
prises afin de permettre un développement durable de ce secteur.
Ce travail de recherche présente l'intérêt
de montrer aux responsables de ces deux entreprises de services comment leurs
recettes ont évolué et quelles sont les causes de la variation de
ces recettes.
Au vu de notre étude financière, nous pensons
que les responsables de ces cybercafés pourront prendre des
décisions judicieuses pour une bonne gestion.
Ce travail de recherche est également utile à
tout entrepreneur désireux d'entreprendre une activité
économique.
5. Méthodes et
techniques utilisées
5.1. Méthodes
La méthode est une procédure particulière
appliquée à l'un ou l'autre stade de recherche ou de
l'exploitation, logique sous-jacente à un ensemble de
démarches3(*).
Pour bien mener nos recherches nous nous sommes servi des
méthodes ci-après :
a) La méthode
mathématique
Les paramètres et variations de notre recherche
imposent une mise en équation dont la résolution et la
discussion nous renvoient à des notions mathématiques.
b) La méthode
statistique
Cette méthode nous a permis de faire le
dénombrement quantitatif des recettes dans le temps. Elle nous a
aidé pour un bon traitement et une bonne interprétation des
données récoltées sur terrain.
c) La méthode
inductive
Celle-ci a permis de généraliser les
résulatats obtenus.
5.2.
TECHNIQUES
a) La technique
documentaire
Pour réaliser ce travail, nous avons consulté
les livres, revues, monographies de la bibliothèque de l'UCG et archives
des cybercafés Congo SAT et du centre ADEN de l'UCG, mais aussi nous
avons consulté différents sites Internet.
b) Autres techniques
Elles comprennent l'interview, l'entretien, les techniques
d'observation directe qui groupent les enquêtes
socio-économiques.
b.1 L'Interview
Dans le souci d'approfondir notre étude, et celui
d'apporter des réponses dignes de confiance, à notre
questionnement, nous avons eu des rencontres non seulement avec les personnes
qui maîtrisent le terrain mais aussi et surtout celles qui sont
impliquées dans la gestion des cybercafés, dans la fourniture de
la connexion à l'Internet (c'est - à - dire son installation et
son accès). Nous avons ainsi eu des entretiens avec le Directeur de CAFE
Informatique & Télécommunications, de la Poste, avec certains
propriétaires de cybercafés et les gestionnaires des
cybercafés Congo SAT et du centre ADEN de l'UCG.
b.2 La
Pré-enquête
Les informations issues de la documentation ont
été complétées par la préenquête qui
nous a été d'une utilité remarquable car, elle nous a
permis d'explorer, de prospecter le terrain et d'identifier les aspects
constitutifs de la problématique. Le terrain s'est
révélé à cet effet la meilleure documentation sinon
la documentation la plus complète. Il nous a permis de recenser les
différents propriétaires de cybercafés et de les
localiser
6. Délimitation du
sujet
Nous avons délimité notre travail dans le temps
et dans l'espace. La délimitation dans le temps consiste à
montrer la période pendant laquelle nous voulons mener nos recherches.
Pour notre cas, notre recherche porte sur l'année 2008
La délimitation dans l'espace revient à
localiser la maison de recherche. Nous avons jugé bon de mener nos
recherches dans deux maisons dont Cybercafé Congo SAT et du centre ADEN
de l'UCG, à l'Est de la RDC, dans la province du Nord Kivu, en ville de
Butembo.
7. Difficultés
rencontrées
Nous ne pouvons en aucun cas dire que, tout au long de notre
travail en général et en particulier à l'étape de
l'enquête sur le terrain, nous n'avons pas été
confrontés à des problèmes. Nous avons donc connu
d'énormes difficultés et elles variaient suivant les niveaux.
Le gros lot des problèmes ou difficultés a
été rencontré au niveau des propriétaires de
cybercafé. Si certains ont été très
compréhensifs, accueillants, d'autres par contre nous ont causé
de sérieux problèmes. Tout d'abord il y avait de la
réticence, de la méfiance, car nous disaient-ils :
"...on ne sait qui est qui et qui fait quoi et pour
qui." Et tout cet état de chose trouve sa raison dans la
situation socio - politique de notre pays. Ensuite pour certains nous sommes un
proche concurrent qui voudrait connaître les astuces, les
stratégies et les "tuyaux" comme le
disent-ils, du marché.
Un autre aspect des difficultés réside dans le
fait que les personnes trouvées sur place dans les cybercafés
n'étaient pas forcément leurs propriétaires.
Lors de la récolte des données, les
données étaient mal enregistrées, entassées dans
les livres de caisse. Il nous fallait encore arranger, différencier
différentes charges parmi les dépenses et les ventes
c'est-à-dire les entrées en caisse.
8. CONTENU DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
notre travail comprend un plan sommaire de 3 chapitres à
savoir :
Chapitre Premier : Généralités sur
le marché des cybercafés et Notions sur la rentabilité.
Chapitre Deuxième : Présentation des
Entreprises cibles.
Chapitre Troisième : Traitement des données et
interprétations des résultats
Chapitre Premier :
GENERALITES SUR LE MARCHE
DES CYBERS CAFE ET NOTIONS DE RENTABILITE
I.1. GENERALITES SUR LE
MARCHE DES CYBERCAFES
I.1.1. Structure du
marché
Le marché des cybercafés ne ressemble pas
physiquement au marché ordinaire, « place
géographique » déterminée avec des
infrastructures spécifiques et où le rapport entre l'offre et la
demande concourt à la formation du prix. Aussi bien l'on ne verra nulle
part appelée « Marché des
cybercafés », comme cela existe pour certains
produits (céréales, animaux,...)
Dans notre cas d'étude, ce n'est pas la place ou le
lieu qui est important, mais c'est l'ensemble de tous les mécanismes et
stratégies mis en oeuvre pas chacun des acteurs du marché, afin
de réaliser le maximum de bénéfice.
L'activité commerciale nécessitant un certain
nombre de critères, à savoir : Le cadre, les acteurs, les
produits et les mécanismes d'achat de transport et d'écoulement
des produits ; il s'avère important voire indispensable pour nous
de porter un regard approfondi sur presque tous les éléments
entrant dans le cadre de notre recherche. Ce qui nous conduit alors à
présenter ce que c'est qu'un cybercafé.
I.1.2. Description du
cybercafé
Notre travail de recherche portant sur l'étude de la
rentabilité des cybercafés à tarification
différente, il est important de présenter ce qu'est un
cybercafé en apportant des éléments descriptifs et
explicatifs.
En fait notre objectif dans cette description ou
présentation ne sera pas de parler trop techniquement des
éléments descriptifs, comme le ferait un professionnel des
télécommunications, mais de ressortir les différents
éléments d'un cybercafé en apportant quelques petites
explications, si nécessaires. Et ceci dans le but de permettre à
tout le monde d'avoir une notion plus claire sur le cybercafé. En effet,
le
« Cybercafé «
comme SANSON (1998) le présente,
est : « un bar ou un restaurant qui met
à la disposition de ses clients, des ordinateurs connectés
à l'Internet... »4(*)
Se basant sur cette définition, nous voyons très
bien qu'au Congo en général et plus particulièrement
à Butembo notre zone de recherche, nous sommes très loin de
cette réalité. Alors plusieurs questions méritent
d'être posées. Comment devons-nous appeler les structures que nous
avons chez nous ? Des
« Cyberespace » ou des
« Centre Internet » ? Pour
notre part, nous pensons que le terme
« cybercafé » n'est pas
approprié. Nous évoquons cet aspect pour faire ressortir un peu
ce que nous avons vu sur le terrain, étant donné que pour la
plupart (90%) de ces structures, leur enseigne porte l'inscription :
« CYBERCAFE... »
Dans notre recherche, ce que nous avons vu comme
cybercafé correspond à une salle mettant à la disposition
de la population l'Internet moyennant un prix de navigation fonction du temps
effectué.
Dans l'approche de la présentation du cybercafé,
nous avons eu à distinguer plusieurs types de cybercafés. Cette
différenciation repose sur plusieurs éléments à
savoir :
- Le cadre ou la salle qui fait office de cybercafé et
qui abrite le matériel de travail,
- Les équipements variés permettant d'avoir
accès à l'Internet.
A. Le cadre ou la salle
Le cadre ou la salle nous a permis de recenser plusieurs types
de cybercafé. La surface occupée varie d'un cybercafé
à un autre. Ainsi, avons-nous trouvé des cybercafés de
différentes formes en ce qui concerne la géométrie des
salles. Les surfaces peuvent aller de 25 m2 à plus de 100
m2.
Le facteur surface peut, dans une certaine mesure, être
un facteur déterminant dans la prospérité d'un
cybercafé. Ceci dit en ce sens qu'un cybercafé plus grand en
surface offre d'énormes avantages, à savoir :
· Plus grande capacité de recevoir plus
d'ordinateurs ;
· Meilleure disposition des ordinateurs ;
· Meilleur entretien et performance relative des
ordinateurs ;
· Idéal de cadre propice qu'un internaute aimerait
avoir
Du point de vue du nombre d'ordinateurs que la salle pourrait
contenir, il va de soi qu'une salle plus grande va contenir plus d'ordinateurs
qu'une petite salle. Cette situation ne se présentera bien entendu que
si le propriétaire du cybercafé a les moyens financiers requis
pour remplir sa salle d'ordinateurs.
La disposition des ordinateurs (l'esthétique) joue un
rôle, pas les moindres dans la qualité d'un cybercafé.
Ainsi, dans une salle plus grande, le propriétaire a toute une panoplie
de possibilités de disposition des ordinateurs, ajoutant ainsi un aspect
esthétique à son cybercafé. Ceci pourra rendre le cadre
plus agréable pour travailler. Comparativement à une petite
salle, le choix est très limité.
Sur le plan de l'entretien et de la performance, il s'agit de
faire mention du système d'aération de la salle qui pourrait dans
une certaine mesure permettre aux ordinateurs de durer un peu plus longtemps.
Une salle grande et aérée conviendrait mieux pour la
« vie » des ordinateurs et de leur efficacité.
Plusieurs spécialistes du domaine nous l'ont confirmé en ces
termes : « ...mieux vaut avoir une grande salle avec des
ventilateurs et des fenêtres bien orientées que d'avoir une petite
salle close avec une climatisation super froid » a dit le technicien
du congo Sat.
Certains nous dirons qu'une bonne climatisation suffirait pour
résoudre tout le problème d'aération. Certes que dans une
certaine mesure, cela semble être vrai. Mais dans la
réalité, il faut distinguer trois facteurs qui peuvent influer
sur la bonne marche d'un cybercafé :
· La consommation des climatiseurs en
électricité,
· Les coupures d'électricité,
· L'appréciation ou le jugement de la
clientèle.
La consommation électrique des climatiseurs doit faire
obligatoirement partir des charges que le propriétaire doit prendre en
compte dans sa gestion. Elle engendre d'énormes charges
financières en plus des charges déjà existantes à
savoir : la facture de connexion ; le salaire du personnel, l'achat
des autres matériels et la facture d'électricité
consommé par les ordinateurs et ses accessoires.
Les coupures d'électricité peuvent dans un
certain cas causer des dommages aux climatiseurs. En plus de cela, cette
coupure causera une grande chaleur si la salle n'est pas bien
aérée.
Alors, il va de soi que dans une telle situation, le
cybercafé mettra mal à l'aise les clients. Ce qui pourrait avoir
une incidence sur le chiffre d'affaire et par conséquent sur la
réputation du cybercafé.
De plus, un cybercafé de petite surface connaît
un certain nombre de problèmes dans la mesure où normalement pour
une bonne marche des activités, elle doit disposer de certains appareils
comme la photocopieuse, des étagères pour la vente d'autres
articles informatiques ou bureautiques pour ne citer que ceux -là et
beaucoup d'autres choses qui entrent dans le fonctionnement d'un
cybercafé.
De toute manière, nous n'avons pas eu à trouver
une dimension standard de surface pour un cybercafé. Mais, cela ne nous
empêcherait pas si nous voulons créer un cybercafé et pour
le confort, la qualité et la prospérité de penser que le
cybercafé ait des dimensions raisonnables.
B. Les
équipements
Au même titre que la surface d'un cybercafé, la
qualité des équipements est aussi d'une importance capitale. Le
tout n'est pas de disposer d'une grande salle, mais il faut que les
équipements soient en adéquation avec la salle.
Ainsi sous la rubrique équipements, nous
distinguons :
- La gamme d'ordinateurs ;
- Les types de connexion ;
- Les autres accessoires.
B.1. La gamme
d'ordinateurs
Etant donné que l'Internet s'utilise par
l'intermédiaire de l'ordinateur, il est indispensable d'avoir des
ordinateurs d'une bonne performance pour un travail efficace. De ce fait, il
est évident qu'un cybercafé équipé d'ordinateurs de
la gamme Pentium III ou IV aura moins de problème qu'un cybercafé
équipé d'ordinateurs de la gamme Pentium I ou II
c'est-à-dire de la basse gamme.
En dehors du facteur puissance des machines, il est difficile
de voir les ordinateurs de la basse gamme ou ancienne gamme supporter
correctement les nouveaux logiciels, à savoir : le Windows XP ou le
Linux.
Même pour une utilisation privée, cela n'est pas
conseillé pour la simple raison que la machine ne va pas répondre
comme le disent les techniciens de la matière c'est-à-dire les
maintenanciers.
Ainsi, dans la plupart (80%) des cybercafés que nous
avons visité, nous avons constaté qu'ils utilisent le Windows XP.
Ce qui suppose l'utilisation d'ordinateurs d'une gamme récente. Ceux qui
utilisent le Windows 2000, le Millenium ou le Windows 98 sont en faible
proportion. Rares sont les cybercafés qui utilisent le Linux. Le Linux
est utilisé seulement par le cybercafé DELVO et celui de Aden UCG
à l'ITAV.
B.2. Les types de
connexion5(*)
Le type de connexion est également important dans la
qualité du cybercafé. Dans notre recherche, nous avons
distingué essentiellement quatre types de connexion à
savoir :
- La connexion par un modem classique,
- La connexion par liaison RNIS,
- La connexion par une ligne spécialisée,
- La connexion par la boucle locale radio.
a. La connexion par un modem classique
Le modem est le périphérique utilisé pour
transférer des informations entre plusieurs ordinateurs via un support
de transmission filaire (lignes téléphoniques par exemple).
Les ordinateurs fonctionnent de façon numérique,
ils utilisent le codage binaire (une série de 0 et de 1), mais les
lignes téléphoniques sont analogiques. Les signaux passent d'une
valeur à une autre. Il n'y a pas de milieu, de moitié, c'est du
« Tout ou Rien » (Un ou Zéro). Les signaux
analogiques par contre n'évoluent pas « par pas »,
ils évoluent de façon continue.
Le piano par exemple fonctionne plus ou moins de façon
numérique car il y a un « pas » entre les notes. Un
violon par contre peut moduler ses notes pour passer par toutes les
fréquences possibles.
Un ordinateur fonctionne à la manière d'un
piano, un modem comme un violon. Le modem convertit en analogique l'information
binaire provenant de l'ordinateur afin de la moduler par la ligne
téléphonique. On peut entendre des bruits étranges si l'on
monte le son provenant du modem.
Ainsi, le modem module les informations numériques en
ondes analogiques. En sens inverse, il démodule les données
analogiques pour les convertir en numériques. Le mot
« modem » est ainsi un acronyme pour
(MODULATEUR/DÉMODULATEUR).
b. La connexion par RNIS
Le Réseau Numérique à
Intégration de Services (RNIS) ou ISDN en anglais
(Integrated Services Digital Network), est une liaison autorisant une
meilleure qualité et des vitesses pouvant atteindre 2 Mb/s (accès
S2) contre 56 Kb/s pour un modem classique.
Son fonctionnement repose sur le fait que, dans un
réseau téléphonique analogique, une boucle sur une
paire torsadée de fils de cuivre entre le commutateur
central de la compagnie de télécommunications et l'abonné
supporte un canal de transmission unique. Ce canal ne traite qu'un seul service
simultanément : la voix ou les données.
RNIS définit deux types de canaux logiques que l'on
distingue par leurs fonctions et leurs débits. Les canaux B transmettent
à un débit de 64 kbit/s en commutation de circuit ou de paquet
les informations utilisateur : voix, données, fax. Tous les
services réseaux sont accessibles à partir des canaux B. Les
canaux D transmettent à un débit de 16 kbit/s en accès de
base et 64 kbit/s en accès primaire. Ils supportent les informations de
signalisation : appels, établissement des connexions, demandes de
services, routage des données sur les canaux B et enfin
libération des connexions. Ces informations de signalisation ont
été conçues pour cheminer sur un réseau totalement
distinct des canaux B. C'est cette signalisation hors bande qui donne aux
réseaux RNIS des temps d'établissement de connexion rapides
(environ 4 secondes) relativement aux réseaux analogiques (environ 40
secondes).
Avec RNIS, les sites régionaux et internationaux de
petite taille peuvent se connecter aux réseaux d'entreprises à un
coût mieux adapté à la consommation réelle qu'avec
des lignes spécialisées. Les liaisons à la demande RNIS
peuvent être utilisées soit pour remplacer les lignes
spécialisées, soit en complément pour augmenter la bande
passante ou assurer une redondance. Avec ces mêmes liaisons, les sites ou
les utilisateurs distants peuvent accéder efficacement aux ressources
critiques à travers l'Internet en toute sécurité.
c. La connexion par Liaison
Spécialisée6(*)
Dans ce type de connexion, il y a également
l'utilisation du modem mais à la seule différence que la ligne
téléphonique utilisée est dédiée
exclusivement pour l'accès au serveur de votre opérateur ou
fournisseur d'Internet. Ce serveur bien entendu vous permet de vous connecter
à l'Internet.
En lançant la connexion chez vous, votre ordinateur va
chercher à joindre le serveur de votre fournisseur d'Internet. Dans ce
cas, il n'y pas de risque d'échec de connexion étant donné
que cette ligne est utilisée uniquement pour cela.
Par contre, dans le cas de la connexion par modem simple, la
ligne téléphonique sert à la fois pour les appels, les
réceptions téléphoniques et pour l'accès à
l'Internet. Ainsi, dans le cas où la ligne serait occupée pour un
appel ou une réception téléphonique, il vous serait
impossible de vous connecter au serveur de votre fournisseur d'accès
à Internet. Afin de pouvoir utiliser une seule ligne pour les appels,
les réceptions téléphoniques et pour l'accès
à l'Internet, il existe un autre type de connexion plus
approprié. Il s'agit de l'A.D.S.L. (Assymetric Digital Subsciber Line),
liaison numérique asymétrique, en français. L'ADSL est une
évolution de l'utilisation des lignes téléphoniques
usuelles. Les lignes téléphoniques sont souvent appelées
« paire cuivrée », du fait que la communication est
faite au moyen de deux fils en cuivre.
Le signal ADSL transite donc sur la paire cuivrée
téléphonique au même titre que le signal
téléphonique. Ces deux signaux sont séparés chez
l'abonné au moyen d'un filtre ADSL placé entre la prise
téléphonique et le téléphone. Le filtre ADSL fait
suivre le signal à destination de l'ordinateur à un
modem (contraction de modulateur - démodulateur), qui
transforme le signal analogique de la paire cuivrée en signal
numérique qui sera transmis à l'ordinateur soit via un
cordon Ethernet, soit via un cordon USB (Universal Serial
Bus) ou encore grâce à une liaison wifi. Dans l'ADSL, il
y a deux tuyaux ou flux indépendants et
simultanés (on peut envoyer et recevoir en même temps à
100 % des débits respectifs montant (envoi) et descendant
(réception). La paire de cuivre posée pour le
téléphone est utilisée en téléphonie
classique en dessous de 8 kHz. Cela permet de passer des
fréquences vocales de 0,1MHZ à 1,104 MHz en
sous -canaux de 4,312 kHz maximum 256. (Débit de chaque canal de 0
à 15 bit/s par Hertz (64 kbit/s maxi par canal)). L'ADSL utilise la
bande passante de la paire de cuivre jusqu'à 1104 kHz. On partage cette
plage de fréquence en 256 canaux dont la modulation (donc le
débit) dépend de l'atténuation de chaque canal.
Ce système de connexion permet de faire passer sur la
même ligne téléphonique et la voix qui est de basse
fréquence et les données informatiques qui sont de haute
fréquence. Le transport de données utilise des fréquences
supérieures à celles d'un signal voix. Les données et le
signal voix circulent simultanément sur la même ligne sans
interférer (utilisation de fréquences différentes). Mais
cela nécessite pour son application ou son utilisation des points de
relais qui doivent être implantés un peu partout dans la ville.
L'ADSL a plusieurs applications. L'ADSL est souvent associé à
« accès Internet à haut débit ». En
réalité, l'ADSL permet un accès à d'autres
réseaux, d'autres services. De plus, les premiers accès ADSL
étaient à 128 kbit/s alors que le haut débit commence en
général à 2 Mbit/s. En plus de l'accès à
l'Internet, l'ADSL permet, depuis peu, de faire passer des flux audiovisuels.
La télévision sur ADSL est très répandue. La
vidéo à la demande commence.
Des offres de téléphonie IP font
également leur apparition. Pour les entreprises, l'ADSL peut servir
d'accès à un VPN d'opérateur. C'est un
système qui permet de transmettre d'énormes quantités de
données informatiques avec une rapidité extrême.
Tout au long de nos visites dans les cybercafés, nous
n'avons pas vu cette nouvelle technologie de connexion. Apparemment, elle
serait en cours d'étude afin de permettre sa vulgarisation.
d. La connexion par Boucle Locale Radio
(B.L.R)7(*)
Dans le domaine de la télécommunication, on
appelle boucle locale le support qui relie l'abonné à
l'opérateur de téléphonie. La boucle locale radio est un
moyen pour un opérateur de télécommunication de relier
directement l'abonné à ses équipements en passant par une
liaison radio (faisceau hertzien), au lieu d'utiliser les fils de cuivre,
c'est-à-dire la ligne téléphonique.
C'est une technologie de connexion qui est à la fois
sans fils, fixe et bidirectionnelle à Internet :
- Sans fil, pour la simple raison qu'elle utilise des ondes
radio comme moyen de transmission.
- Fixe, car le récepteur doit être fixé,
il ne peut être mobile comme dans le cas du GSM (Global System for Mobile
Communications).
- Bidirectionnelle, parce que la liaison se fait dans les deux
sens : opérateur -client et client -opérateur.
Concrètement, une connexion BLR nécessite chez
le client une petite antenne plate visant directement ou non (selon la bande de
fréquence utilisée) l'antenne de l'opérateur,
appelé station de base. Ensuite un câble relie l'antenne à
un boîtier sur lequel se trouvent différents connecteurs :
prises téléphoniques, alimentation électrique
Le client ou l'utilisateur communique, par
l'intermédiaire de la liaison radio, avec une station de base (antenne),
elle-même reliée au central de l'opérateur. Ces antennes
sont généralement fixées sur le toit des maisons ou des
immeubles.
Il est à noter qu'il existe un risque de
déperdition de transmission, risque dû à l'influence de
certains facteurs comme :
- La distance : selon les opérateurs, à
partir d'une certaine distance (entre 2 à 4 km), il y a risque de
déperdition de transmission des données entre la station de base
et le client,
- Les obstacles (immeubles, relief) : Situés sur
le passage des ondes radio, ils peuvent altérer la qualité de la
transmission tout comme de mauvaises conditions météorologiques
(tempêtes, orages, neige, pluies).
e. Equipements accessoires
variés
Dans un cybercafé, mis à part l'Internet qui est
l'activité principale, il y a selon les cybercafés d'autres
activités connexes qui lui viennent en soutien. Ces activités
sont très variées et peuvent être toutes disponibles ou
partiellement dans un cybercafé. Ainsi pouvons-nous distinguer les
activités comme : la photocopie, l'impression, le scanner, la
reliure, la téléphonie et le fax, le gravage CD.
f. Autres activités
En dehors des principales activités citées plus
haut, nous distinguons d'autres activités selon les cybercafés.
Ces activités en fait ne constituent pas la vocation première de
ces cybercafés, mais elles viennent en appui, étant entendu qu'un
cybercafé a besoin de matériels informatiques et bureautiques.
Ainsi dans certains cybercafés, nous avons constaté qu'il y avait
d'articles informatiques et bureautiques comme : les souris d'ordinateurs,
les claviers, les imprimantes, les lecteurs de CD, les cartouches d'encre pour
imprimantes, des clés USB, les rames de papiers, les Disques compacts
(C.D : Compact Disk), les produits de nettoyage d'écran
d'ordinateurs, les téléphones portables et les ordinateurs. Tous
ces articles sur des étagères, mis en vente, constituent des
sources de revenu pour le cybercafé.
Le cadre des activités commerciales du cybercafé
présenté, voyons à présent les acteurs qui exercent
leurs activités économiques dans le marché des
cybercafés.
I.1.3. Les acteurs8(*)
Aucune activité commerciale ne peut se réaliser
sans acteurs. A cet effet ? dans la chaîne des acteurs du
marché des cybercafés, nous avons distingué plusieurs
composantes :
- Les Fournisseurs d'Accès Internet :
F.A.I,
- Les Fournisseurs de Services Internet (Internet Services
Provider (I.S.P), en anglais).
- Les propriétaires des cybercafés,
- Les utilisateurs ou internautes.
A. Les Fournisseurs d'Accès Internet :
F.A.I
L'Internet est la matière de base d'un
cybercafé. De ce fait, suivant les différents niveaux, il existe
une multitude de fournisseurs. L'Internet n'étant pas un produit
congolais, il va de soi qu'il y ait un fournisseur d'accès pour le Congo
qui est soit en Europe soit aux Etats-Unis d'Amérique. Ceci se comprend
sur un plan plus international.
B. Les Utilisateurs de cybercafés : Les
internautes.
Les utilisateurs sont ceux que nous pouvons appeler les
acheteurs ou les consommateurs. Ce sont des gens ordinaires que nous trouvons
dans toutes les couches socio-professionnelles. L'utilisateur d'un
cybercafé est toute personne lettrée et pouvant être
capable d'utiliser l'ordinateur et l'outil Internet.
1°) Fréquentation des
cybercafés.
Le nombre de fois que les utilisateurs vont au
cybercafé dans la semaine varie. Ceci dépend des
intérêts que tout un chacun porte pour la chose et les raisons
fondamentales qui l'y amènent. Si la majorité des utilisateurs
vont au cybercafé pour la consultation de leur boîte
électronique, il y a des utilisateurs qui pour des raisons
d'étude font des recherches ou certains consultent simplement les
actualités (politique, sportive, musicale etc.). Tous ces
différents aspects font que la fréquentation des
cybercafés varie énormément..
En plus des différentes raisons
énumérées plus haut, vient s'ajouter un autre facteur;
celui de l'argent qui en toute circonstance n'est pas à négliger.
Le prix à payer au cybercafé est fonction du temps
consommé. Ce qui fait que si vous n'avez pas assez d'argent vous ne
pouvez pas passer un temps relativement long.
2°) Les prix payés au cybercafé.
La dépense faite au cybercafé est une fonction
linéaire du temps effectué. Le temps consommé, est assorti
d'un prix de navigation qui dépend des cybercafés.
3°) Les difficultés des
utilisateurs.
Les utilisateurs consultés nous ont
révélé qu'ils sont confrontés à des
difficultés dans les cybercafés quand ils y vont pour travailler.
Les difficultés rencontrées par les utilisateurs de
cybercafés sont diverses et varient aussi selon tout un chacun.
Les difficultés peuvent être réparties en
deux grandes catégories :
- Les difficultés techniques ;
- Les difficultés d'ordre humain.
Les difficultés techniques relevées sont, entre
autres :
- La lenteur de la connexion, qui est la préoccupation
la plus importante des utilisateurs. Cette inquiétude des utilisateurs
s'explique par le fait que, bien qu'ayant payé leur temps de connexion,
ils n'arrivent pas à travailler.
- Des fois par des coupures d'électricité, si on
n'avait pas encore enregistré tout doit être repris. Ce qui
crée des disputes entre les clients et le (la) chargé(e) de
l'accueil au sein du cybercafé.
- Parfois ce sont les ordinateurs qui n'arrivent pas à
bien travailler car ils sont très vieux et la maintenance est
défaillante.
Les difficultés d'ordre humain résident tout
particulièrement dans les relations qui existent entre le personnel du
cybercafé et les utilisateurs. Si certains personnels sont accueillants,
d'autres par contre sont sources de malveillance et de disputes permanentes
avec les clients. Certaines personnes manquent de tact envers les clients et
oublient très souvent cette règle commerciale; «
le client est roi... »
C. Les propriétaires de
cybercafés9(*)
La taxe en vigueur pour les propriétaires n'est pas la
taxe de marché que nous retrouvons sur les marchés traditionnels,
mais c'est la taxe d'exploitation.
Cette taxe n'est pas la même en montant, pour tous les
propriétaires car certains paramètres entrent en ligne de compte.
Ces paramètres se composent par exemple de :
- La surface occupée par le cybercafé (l'ampleur
du cybercafé) les activités diverses menées à part
l'Internet.
- L'emplacement du cybercafé (centre ville par rapport
à la périphérie).
Signalons en passant que les conditions relatives à la
création d'un cybercafé sont : trouver une infrastructure
pour son activité, avoir un équipement complet pour
l'accès à l'internet, régler sa facture pour connexion
internet. Celles relatives à l'entrée au marché :
respecter les conditions données ci-haut, régler certaines
formalités (statuts,...).
I.2. NOTIONS SUR LA
RENTABILITE
1. Définition et types
de rentabilité
La rentabilité d'une activité économique
est sa capacité de produire un revenu exprimé en termes
financier10(*).
Calculer la rentabilité d'un investissement consiste
à apprécier sa capacité à sécréter un
surplus par rapport à la somme investie, surplus qui alimentera le
bénéfice11(*).
Il convient de signaler que la rentabilité
diffère de la productivité en ce sens que la première
consiste à comparer le capital à son revenu. Quant à la
seconde, c'est le rapport entre une quantité produite et les moyens mis
en oeuvre pour l'obtenir.
De ce fait, les activités qui ont la plus forte
productivité ne sont pas nécessairement celles qui ont la lus
grande rentabilité.
Au sens strict, la rentabilité comporte deux
caractéristiques spécifiques : c'est une capacité, un
potentiel de rendement12(*). C'est donc la mesure de la
rémunération des apporteurs des capitaux, propriétaires de
l'entreprise.
Au sens large, elle évoque l'aptitude de toutes sortes
des capitaux à apporter de l'argent. Il existe plusieurs sortes de
rentabilité parmi lesquelles nous évoquons :
- La rentabilité économique qui se
définit comme le rapport entre le profit et le capital mis en oeuvre
pour l'obtenir.
- La rentabilité commerciale qui est le rapport entre
le bénéfice ou perte et le chiffre d'affaires13(*).
Cependant il n'est pas directement facile d'identifier une
activité rentable.
2. Evaluation de la
rentabilité
Suivant les notions de capital et de résultats
financiers qu'il engendre, divers indicateurs de la rentabilité se
distinguent entre autre :
- Le taux de rendement économique du capital fixe,
c'est le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et les
immobilisations brutes.
- Le taux de productivité du capital : c'est la
valeur ajoutée de l'entreprise et son capital fixe.
- Le ratio : c'est le rapport entre deux grandeurs
caractéristiques de la situation ou de l'activité de
l'entreprise14(*).
Parmi les nombreux ratios existants nous limiterons notre
analyse uniquement à l'examen des ratios financiers.
Sortes de ratios
financiers15(*)
Il existe plusieurs sortes de ratios financiers parmi
lesquelles nous retenons :
1. Les ratios de situation ou de structure : ils
décrivent et mettent en relief les relations existant entre l'actif et
le passif.
2. Les ratios de gestion ou d'activité : ils
permettent de mesurer la vitesse de rotation des biens réels et
financiers.
3. Les ratios de rentabilité : la
rentabilité de l'entreprise s'exprime par le rapport «profit sur
capital ». Ces ratios permettent d'évaluer le profit et le
capital engagé, ils mesurent également l'efficacité des
moyens utilisés et fournissent une information suffisante sur la gestion
financière de la firme.
L'appréciation de l'efficacité d'une
entrepris se fait par l'analyse du résultat comptable et de son chiffre
d'affaires en tenant compte de la marge brute, de la marge nette.
- Le ratio de la marge brut est déterminé
par :

Ce rapport doit être inférieur à
l'unité.
- Le ratio de la marge nette :  . Ce rapport doit être différent de 1. . Ce rapport doit être différent de 1.
La rentabilité financière montre comment les
capitaux engagés des actionnaires sont utilisés par
l'entreprise.
Elle est déterminée par :

Pour dire, c'est ce que les actionnaires obtiennent pour
100unités monétaires mis à la disposition de l'entreprise.
Elle s'intéresse uniquement aux capitaux propres.
- La rentabilité économique : comment
l'entreprise utilise ses capitaux dans son activité ?
Elle est déterminée par : 
Contrairement à la rentabilité
financière, la rentabilité économique s'intéresse
aux dettes de l'entreprise c'est-à-dire à tous les capitaux
engagés.
Les ratios de
couverture de charges d'exploitation :
Ces ratios ont pour rôle de refléter le
degré de solvabilité de l'entreprise.
Formule : 
Une analyse plus poussée chercherait à
évaluer d'une façon générale l'aptitude de
l'entreprise à faire face à ses charges d'exploitation en rapport
avec son chiffre d'affaires
Le ratio de couverture des charges d'exploitation s'exprime
par la formule :
= 
* Si 0,5 et proche de 1, les charges sont très
élevées et diminuent le résultat d'exploitation. Dans ce
cas l'activité est moyennement rentable.
* Si 0,5 et proche de 0 ; les charges sont moins
élevées et par conséquent augmentent le résultat
d'exploitation d'où l'activité économique est rentable.
Les différentes charges peuvent être
ventilées par fonctions. Cependant un autre mode consiste à les
ventiler en charges fixes et en charges variables. Théoriquement, la
réalisation du bénéfice net devrait être plus forte
que celle du chiffre d'affaires ou de la charge brute du fait de l'existence
des charges fixes.
Il est donc important de porter une attention
particulière à la structure des charges ; leur
décomposition en charges fixes et en charges variables. Normalement
l'entreprise devrait enregistrer le C.A permettant de réaliser une marge
brute qui est suffisante pour couvrir l'ensemble des charges fixes. Ces niveaux
du chiffre d'affaires sont appelés " seuil de
rentabilité " ou " chiffre d'affaires critique".
3. Notions de seuil de rentabilité
(S.R)
Le S.R d'une entreprise est le C.A pour lequel cette
entreprise ne réalise ni profit ni perte. Le fait qu'une entreprise a
atteint son seuil de rentabilité peut être exprimé de 3
manières suivantes :
· Résultat d'exploitation = 0
· C.A = total des charges d'exploitation
· Marge sur coût variables = coûts fixes.
Par calcul, on peut déterminer le seuil de
rentabilité en se basant sur l'égalité : marge sur
coûts variables = coûts fixe (1)
Or d'une manière générale, on suppose que
les charges variables sont proportionnelles au C.A. Il en résulte que la
marge sur C.V soit-elle même proportionnelle au C.A, d'où la
relation : marge sur C.V = a C.A (2)
De (1) et (2), on a :  (3) (3)
Or (2) : 
D'où le seuil de rentabilité = 
Graphiquement, le S.R est représenté comme
suit :
Seuil de rentabilité
Graphique n°1 :
Zone de perte
Zone de profit
C.V
C.V
S.R C.F
C.A
Source : cours Economie Politique I, UCG 2006-2007
Le S.R est un outil d'analyse 16(*) par le fait qu'il intervient dans le calcul
de :
- La marge de sécurité : c'est une
représentation de la baisse du C.A qu'une entreprise peut supporter sans
tomber en déficit. Elle est trouvée par : marge de
sécurité = C.AS.R
- L'indice de rentabilité : c'est la marge de
sécurité exprimée en pourcentage du C.A. L'indice de
rentabilité = 
4. Les grandeurs du
résultat
a. La valeur
ajoutée
Si l'on compare ce qu'une entreprise produit (en terme
monétaire) à ce qu'elle a consommé pour produire, on pose
la notion de la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée résulte de la confrontation
des biens et services de l'entreprise aux exigences du marché. C'est en
définitive le consommateur qui réalise la valeur ajoutée
de l'entreprise, en achetant le produit aux prix auquel il lui est
proposé17(*).
La valeur ajoutée se propose de traduire le surplus de
richesse créé par l'entreprise.
Si la valeur ajoutée permet bien de mesurer la part
contributive de l'entreprise à la création de richesses, on peut
dire que le profit de cette même entreprise sera la substance
financière laissée disponible après que la valeur
ajoutée aura assurée : la rémunération des
salariés de l'entreprise, le prélèvement de la
collectivité (impôts), le maintien de son outil actuel de
production (autofinancement de maintien) et une rémunération
suffisante aux capitaux investis18(*).
b. Résultat net et
résultat net d'exploitation
v . Résultat net d'exploitation
Le résultat net d'exploitation est le résultat
avant l'incidence des résultats hors exploitation et des plus ou moins
values constatées sur les cessions ou les mises hors services de
certains éléments d'actif dont on ne peut pas considérer
la réalisation comme entrant dans l'activité normale de l'agent
économique. Il est la différence entre le total des
produits et le total des charges.
v Résultat net
Le résultat net est le résultat net
d'exploitation après l'incidence de résultats hors exploitation
et plus ou moins values constatées sur les cessions d'immobilisation ou
les mises hors services. Il comprend le résultat à conserver et
le résultat à distribuer.
c. Cash-flow
Le cash-flow est un terme d'origine anglo-saxonne. Le
cash-flow est la mesure globale du potentiel d'autofinancement, d'où il
est traduit en français par la marge brute d'autofinancement.
Le cash-flow ou marge brute d'autofinancement est le surplus
monétaire secrété par l'activité
déterminée par la sommation du résultat brut
d'exploitation et du résultat brut hors exploitation diminué de
la contribution sur le revenu.
Par définition, le cash-flow se trouve être dans
la très large majorité de cas, algébriquement
supérieur au résultat de l'exercice. Le cash-flow ne peut
être inférieur au résultat net que dans les très
rares cas où les charges non décaissées (amortissements)
sont globalement négatives, c'est-à-dire que les reprises
d'amortissements et de réduction de valeurs excédent les
dotations. En cas de pertes, il est alors tentant pour l'entreprise d'afficher
plutôt son cash-flow qui aura normalement meilleure mine que le
résultat de l'exercice.
Le cash-flow représente le potentiel d'autofinancement
de l'entreprise avant toute décision de distribution du
bénéfice. La capacité d'autofinancement est, en effet, la
meilleure synthèse de l'efficacité de l'entreprise sur chacun des
marchés auxquels elle s'adresse pour vendre ou acheter.
De même que, et on peut dire parce que la
rentabilité de l'entreprise est la toile de fond de tout ce qui touche
aux apports de capitaux permanents par le marché, la capacité
d'autofinancement est à la fois le complément nécessaire
et l'une des conditions de ces apports19(*).
v Cash-flow brut
Le cash-flow brut est celui qui comprend le résultat
brut d'exploitation ainsi que le résultat brut hors exploitation
diminué des provisions pour dépréciation.
v . Cash-flow net
Le cash-flow net est le cash-flow brut diminué de
contribution sur le résultat ou encore la somme du résultat net
de l'exercice et des amortissements.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce premier chapitre, il nous a été
indispensable de faire un aperçu sur le marché des
cybercafés en donnant sa structure et en définissant les acteurs
concernés par ce marché. Outre cet aspect nous avons
présenté la notion de rentabilité en évoquant les
différents ratios de rentabilité qui nous permettront de
vérifier notre hypothèse dans la partie qui suit.
Chapitre
deuxième :
PRESENTATION DES
ENTREPRISES CIBLES.
Section I : CONGO
SAT20(*)
§1. Dénomination -
siège social - objet et durée
A. Dénomination
La société est
nommée « CONGO SAT ». Ce qui nous conduit à
présenter son siège social.
B. Siège social
Comme toute autre
société, CONGO SAT a aussi son domicile qui est son siège
social. Son siège social est établi à Kinshasa au n°
08 Joli park, quartier Macampagne, commune de Ngaliema. Ce siège social
peut être transféré en tout endroit de la République
Démocratique du Congo, sur décision de l'assemblée
générale.
CONGO SAT peut installer des
sièges administratifs, d'exploitation et de transformation, des
succursales, des bureaux, agences, dépôts ou points de vente en
n'importe quel lieu, tant en République Démocratique du Congo
qu'à l'étranger, sur décision de la gérance qui en
fait rapport à l'Assemblée générale.
C. Objet social
CONGO SAT est une
société qui a pour objet :
- Fourniture d'accès
Internet
- Fourniture et exploitation de
cybercafé, cabine téléphonique et fax
- Montage et réparation
d'ordinateur
- Commercialisation de
matériels et équipements relatifs à l'informatique et
à la télécommunication (nouveau et occasion)
- Commercialisation de fournitures
de bureau
- Effectue pour elle-même et
pour le compte du tiers, toutes les opérations entrant dans son objet
social ou de nature et en favoriser la réalisation.
- Gérer toute autre
société ou groupement économique où elle aura des
intérêts.
Assemblée générale
Gérance
Associés
Technique
Comptabilité
Animation et accueil des clients
D. Structure
organisationnelle
§2. Capital social - Parts
sociales21(*)
A. Capital social
Les opérations de
constitution de CONGO SAT sprl sont comptabilisées à deux
niveaux :
- souscription du capital
- Libération des apports
Le capital social est fixé
à 5 000 000 Fc (cinq millions de Franc congolais),
représenté par 100 parts sociales d'une valeur nominale de 50000
Fc chacune.
Pour parer à la
dépréciation de la valeur monétaire du capital social, il
est indexé aux taux officiel du dollar américain à la date
de l'acte notarié.
1. Souscription du
capital
Les écritures comptables de
souscription du capital sont données dans le journal
ci-après :
|
N°
|
COMPTES
|
LIBELLE
|
|
|
|
Débit
|
Crédit
|
Débit
|
Crédit
|
|
1
|
444500
444501
|
10.4
|
Ass MANGOLOPA KIVUYASIKIRI
son compte apport
Ass KAMBALE NZANZU son comptable
apport
à capital
social
souscription du capital suivant
acte du 16/03/2006
|
2550000
2450000
|
5000000
|
|
TOTAL
|
|
5000000
|
5000000
|
Source : Nos calculs en
se basant aux statuts du CONGO SAT
Notons que ces écritures de
souscription du capital sont ici enregistrées en bloc, le détail
étant figuré dans le registre des associés.
2550 000 Fc représentent 51
parts sociales
2450 000 Fc représentent 49
parts sociales
2. Libération du
capital
Le capital social est
entièrement libéré en numéraire, et se trouve
dès à présent à la disposition de la
société.
Ecriture de la
constitution
|
N°
|
COMPTES
|
LIBELLE
|
|
|
|
Débit
|
Crédit
|
Débit
|
Crédit
|
|
1
|
44450
44451
|
10.4
|
MANGOLOPA son compte d'apport
NZANZU son compte d'apport
à capital
social
Constitution de CONGO SAT Sprl
|
2550000
2450000
|
5000000
|
|
2
|
57
|
44450
|
Caisse
à Mangolopa son compte
d'apport
libération totale de
Mangolopa
|
2550000
|
2550000
|
|
3
|
57
|
44451
|
Caisse
à NZANZU son compte
d'apport
libération totale de
NZANZU
|
2450000
|
2450000
|
Source : Nos calculs en
se basant aux statuts du CONGO SAT
B. Parts sociales
Les parts sociales ne pourront
aucunement être représentées par des titres
négociables. Les titres de chaque associé seront notés du
registre des associés tenu au siège social, qui contiendra la
désignation de chaque associé, le nombre des parts sociales lui
appartenant et l'indication des versements effectués. Chaque
associé n'est responsable des engagements de la société
que jusqu'à concurrence du montant de sa participation.
Le capital social pourra
être augmenté par décision de l'assemblée
générale, les associés s'accordent à souscrire des
augmentations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes
élaborés par la gérance.
Le défaut de
répondre à pareil appel de fonds, entraînera l'exclusion de
l'associé défaillant et la vente publique de ses parts sociales,
suivant la procédure prévue par les articles 62 et 63 de
décret du 23 juin 1960 sur les sociétés commerciales.
Toutes réductions du
capital seront subordonnées au respect aux contradictions
imposées par la législation congolaise. Chaque part sociale
confère un droit égal dans la répartition des
bénéfices et des produits de la liquidation. Il ne peut
être créé des parts bénéficiaires non
représentatives du capital. Les parts sont indivisibles. Les
propriétaires des parts sociales doivent se faire représenter
à l'égard de la société par une seule personne,
faute de quoi, la société a le droit de suspendre l'exercice des
droits affèrent à ces parts.
Les parts sociales ne peuvent,
à peine de nullité, être cédées entre vifs ou
transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au
moins des associés possédant les trois quarts du capital,
déduction faite des droits dont la cession proposée ; le
tout suivant la procédure prévue par les articles 58 et 59 du
décret du 23 juin 1960, complétant la législation relative
aux sociétés commerciales.
Toutefois, cet agrément
n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises
à un autre associé au conjoint du cédant ou du testateur,
à des ascendants ou descendants en ligne directe et aux personnes
physiques ou juridiques désignées par les associés
fondateurs lors de la transformation de la société en une
société par action à responsabilité limitée,
ou lors d'une augmentation du capital.
Les héritiers d'un
associé, personne physique, ne peuvent sous aucun prétexte
requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et
documents de la société, ni en demander le partage ou la
liquidité, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration. Ils sont tenus pour l'exercice de leurs droits de s'en
rapporter aux comptes et inventaires sociaux ainsi qu'aux décisions de
l'assemblée générale sans pouvoir exiger aucune
pièce, titre ou inventaire extraordinaire.
La part sociale ne peut être
représentée par un titre nominatif au porteur ou à
ordre ; le titre de chaque associé résultera du
présent acte ou de ceux qui la modifieront ultérieurement ainsi
ses cessions régulièrement consenties.
Les cessions des parts sociales
entre vifs, les transmissions pour cause de mort, les attributions en cas de
partage et des adjudications suite à une vente publique ne sont
opposables aux associés qu'à la date de leur inscription dans le
registre des associés. Il en est de même à l'égard
des tiers qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
§3. Gérance -
Surveillance
La société est administrée par un ou
plusieurs gérants nommés par l'assemblée
générale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux, l'
associé déclaré comme gérant de CONGO SAT, monsieur
KAKULE MANGOLOPA, prés qualifié d' engager la
société par sa seule signature.
Le gérant désireux de démissionner devra
en avertir les associés par fax et /ou email en s'assurant de la bonne
réception du message, avec préavis de 3 mois. En cas de
démission, il sera pourvu à son remplacement de la manière
que le gérant démissionnaire aura été
lui-même désigné. Le nouveau gérant pourra
être associé ou non.
Le gérant a tous les pouvoirs d'agir ou nom et pour le
compte de la société, il pourra notamment sous sa signature et
sans limitations des sommes ; faire tous comptes et factures, souscrire
tous billets, chèques et lettre de charges, les accepter, endosser,
escompte, ouvrir tous les comptes en banque, caisses administratives, postes et
douanes, et au service des chèques postaux y faire tous les versements,
virements, dépôts ou retraits de sommes ou autres colis ou
marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes
quittances ou décharges, contacter tous emprunts par voie d'ouverture
des crédits bancaires.
Le gérant pourra en outre, avec l'autorisation de
l'assemblée générale, acquérir, hypothéquer
et donner à bail tous meubles ou immeubles, contracter tous emprunts
autres que par vois d'ouverture de crédits bancaires, donner toute
garantie ou accepter tous gages, lotissements, hypothèques, actions
résolutoires, donner main levée avec ou sans paiements de toutes
inscriptions hypothécaires, ou privilégiées,
transcriptions, saisies oppositions, autres empêchements dispenser le
conservateur des titres fonciers de prendre toutes inscription d'office
régler l'envoi de fonds de réserve ou de prévisions. Les
énumérations qui précèdent sont énonciatives
et non limitatives.
Dans tous actes engagent la responsabilité de la
société la signature du ou des gérants doit être
précédée de la dénomination de la
société ou suivie immédiatement de l'indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Le gérant peut déléguer à l'un des
associés ou tiers ou attribuer à l'un de ses membres, tous
pouvoirs nécessaires à la gestion journalière, il pourra
en outre, déléguer à un autre associé, ses droits
pour l'exercice de l'ensemble de pouvoirs énoncés dans le
précédemment.
Le gérant nomme, révoque, engage ou licencie le
personnel qu'il juge nécessaire à la bonne exécution des
activités de la société, et il détermine les
traitements et conditions de ce personnel et s'il y a lieu, ses cautionnements.
Le gérant ne contracte pas l'obligation personnelle relativement aux
engagements de la société. Ils auront le droit,
indépendamment de ses frais de représentation, de voyages et
autres jugés nécessaires pour un accomplissement correct de ses
fonctions à un traitement fixe par l'assemblée
générale et qui sera prélevé sur les frais
généraux.
§4. Inventaire - Bilan
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le
trente et un décembre de l'année. Le gérant doit à
la fin de chaque exercice social, clôturer les écritures
comptables et dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs
mobilières, ainsi que toutes les créances et dettes de la
société avec une annexe contenant en résumé tous
ses engagements, notamment les cautionnements et autres garanties, ainsi que
les dettes et créances de chaque associé et gérant de la
société.
Le gérant doit faire, chaque année, un rapport
sur l'accomplissement de son mandat et sur les opérations de la
société réalisées au cours de l'exercice social. Ce
rapport commente le bilan et le compte des profits et pertes, en rapport avec
les pièces justificatives.
Pour besoin de viabilité dans la gestion, la
société fera appel à un expert comptable
agréé pour attester périodiquement les écritures et
certifier les états financiers à la fin de chaque exercice
comptable. Le bilan, le compte des pertes et profits et le rapport de la
gérance sont annexés aux invitations.
L'excédent favorable du bilan, après
déduction des charges, frais généraux et amortissements
nécessaires, constituent le bénéfice net de la
société. Il sera réparti entre les associés
possédant des parts en proportion, chaque part donnant un droit
égal.
L'assemblée générale pourra
décider que tout ou partie des bénéfices soit
affecté à la création d'un fonds de réserve
spécial ou d'un fonds d'amortissement de parts sociales ou report
à nouveau. Les dividendes sont payable chaque année, aux
époques et de la manière fixée par l'assemblée
générale.
§5. Dissolution -
liquidation
La société pourra être dissoute en tout
temps moyennant l'observation des formes prescrites aux modifications des
statuts. En cas de perte de la moitié du capital, la gérance doit
soumettre à l'assemblée générale, qui
délibérera dans les formes prescrites pour les modifications aux
statuts, la question de la dissolution de la société. Si la perte
atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être
décidée par les associés possédant un quart des
parts sociales.
En cas de dissolution de la société,
l'assemblée générale a les droits les plus étendus
pour désigner le ou les liquidateurs, de déterminer leurs
pouvoirs et fixer le mode de liquidation. A défaut de désigner
les liquidateurs, le gérant sera à l'égard des tiers,
considéré comme liquidateur.
Le solde favorable de la liquidation sera partagé
entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque
part conférant un doit égal.
§6. Dispositions
générales du Congo SAT
Tout associé domicilié ou résidant en
dehors de la RDC sera censé élire domicile au siège social
de la société, où toutes les assignations et
significations seront valablement faites.
Les gérants et liquidateurs qui résident hors de
la RDC seront censés, pendant toute la durée de leurs fonctions
élire domicile au siège social où toutes significations et
notifications peuvent être donnés relativement aux affaires de la
société et à la responsabilité de leur gestion et
de leur contrôle. Toutes contestations qui pourraient surgir entre les
associés lors de la liquidation ou entre la société et ses
associés, pendant la durée de la liquidation, seront de la
compétence des tribunaux de Kinshasa.
Pour tout ce qui ne pas prévu aux statuts, les
associés s'en référeront aux lois et aux usages en
matière et notamment aux dispositions du décret du 28 juin 1960,
complétant la législation relative aux sociétés
commerciales.
Toutes les dispositions impératives dudit décret
ne figurant pas aux statuts.
§7. Assemblée
générale22(*)
Les décisions de
l'assemblée générale sont prises à la
majorité quel que soit le nombre des parts sociales
possédées par les associés présents ou
représentés. Lorsqu'il s'agi de modification aux statuts, les
associés présents ou représentés doivent
posséder au moins la moitié du nombre total des parts sociales.
Si cette condition n'est pas remplie, un procès verbal de carence est
dressé, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde
assemblée générale délibère valablement quel
que soit le nombre des parts sociales possédées par les
associés présents ou représentés.
Aucune modification ne peut
être décidée qu'à la majorité des
trois/quarts des voix (parmi les membres présents à
l'assemblée générale), pour lesquelles il est pris part au
vote. Si la modification concerne l'objet social ou la nationalité de la
société requise est portée aux quatre cinquième des
voix.
Il sera tenu une assemblée
générale ordinaire chaque année pas plus tard que le 31
mars, et une date renseignée dans les convocations. Si le jour
fixé est férié, l'assemblée générale
aura lieu le premier jour ouvrable suivant au siège social ou à
tout autre endroit à déterminer par la gérance dans la
convocation. La convocation pour toute assemblée générale
contient l'ordre du jour fait par fax et/ou e-mail, en s'assurant de la bonne
réception du message, adressé 20 jours au moins avant la
réunion à chacun des associés, si l'ordre du jour contient
des modifications aux statuts, l'objet de modifications proposées se
rapportant à l'objet social, un rapport spécial de la
gérance sur ces modifications contenant un état récent et
résumé de la situation active et passive de la
société doit être joint à la convention.
Lorsqu'il s'agit d'une
réduction ou augmentation du capital social ou du nombre de parts
sociales, la convocation doit indiquer la manière dont la
réduction ou l'augmentation sera proposée. Si la réduction
doit se faire par un remboursement, il ne peut se faire que six mois
après la publication de la décision. En aucun cas, la
réduction ne peut préjudicier aux droits des tiers.
Une assemblée
générale extraordinaire peut être convoquée à
tout moment par la gérance ou la majorité des associés
avec les mêmes exigences pour les convocations et ordre du jour.
Chaque part sociale confère
une voix et tout associé a le droit de voter aux assemblées
générales. Les associés peuvent se faire
représenter soit par un mandataire choisi parmi les associés,
soit par un préposé ou représentant des personnes
juridiques, associés, s'il s'agit d'elle.
Ils peuvent émettre leur
vote par écrit. A cet effet, la convocation contiendra le texte des
résolutions proposées que les associés pourront approuver
ou rejeter. Les procès verbaux sont signés par le
président désigné parmi les associés ou leurs
représentants et leur expédition est assurée par les soins
de la gérance.
L'assemblée
générale annuelle entend le rapport de la gérance et
délibère en statuant sur le bilan et le compte de pertes et
profits : elle procède ensuite à l'affectation du
résultat. Elle se prononce enfin, par un vote spécial sur la
décharge des gérants.
§8. Nomination de
Gérant23(*)
Les associés après
approbations des statuts, ont décidé de la nomination en
qualité de Gérant Mr KAKULE MANGOLOPA, de nationalité
congolaise, né à Kiroshe le 30 mars 1980 et résidant
à Kinshasa, avenu Jolie Park n°8, Q. MACAMPAGNE, commune de
Ngaliema, République Démocratique du Congo.
Mandat
Les associés donnent mandat
au Gérant pour comparaître devant le notaire aux fins
d'authentifier les statuts. Le pouvoir lui est en outre donné pour
procéder aux formalités de leur dépôt au greffe du
commerce, de leur publication au journal officiel et de toute autre
formalité nécessaire à la constitution de la
présente société.
II. CYBER CAFE ADEN - UCG
BUTEMBO
II.1 Présentation
Le Cybercafé ADEN UCG est l'un des plus modernes de la
Ville de Butembo. Il est créé depuis décembre 2004 dans le
cadre du projet de la Coopération Internationale du Ministère des
Affaires Etrangères Français qui a largement contribué
à son installation.
Ce Centre poursuit et réalise avec détermination
les objectifs du Programme ADEN, à savoir :  démocratiser l'accès à l'Internet, démocratiser l'accès à l'Internet,  vulgariser la formation à l'utilisation de nouvelles
technologies, vulgariser la formation à l'utilisation de nouvelles
technologies,  Encourager la production africaine des contenus. D'abord, le
12/12/2004, les installations de l'antenne et la connexion Internet ont
été finalisées. Encourager la production africaine des contenus. D'abord, le
12/12/2004, les installations de l'antenne et la connexion Internet ont
été finalisées.
Du 21/12/2004 au 24/01/2005, le Cybercafé ADEN UCG a
commencé à fonctionner avec une seule machine dans le cadre
d'essai de l'état de la connexion.
Le 25/01/2005, le Cybercafé a été
doté, par le Ministère français des Affaires
Etrangères, de 7 ordinateurs, 1 serveur, 1 imprimante, 1 scanneur, 6
onduleurs et 1 climatiseur. Cet équipement a été
renforcé par 14 ordinateurs Pentium IV dont l'achat a été
préfinancé par l'Université.
Enfin, le 25/01/2005, le délégué de
l'Ambassade de France à Kinshasa M. Farid Ali, en compagnie de Ms.
MATESO et LYANZALA Julien, est venu finaliser l'installation de tout le
réseau.
Structure organisationnelle
Gestionnaire du Centre
Gestionnaire Adjoint
Technicien
Comptable
Animation et accueil des clients
Sentinelle
II.2 Notions sur ADEN24(*)
A. RESSOURCES
Aden est un projet de coopération internationale du
ministère français des Affaires étrangères.
Démocratiser l'accès à Internet, former à
l'utilisation des nouvelles technologies, encourager la production africaine de
contenus, tels sont les objectifs d'ADEN avec les pays partenaires du projet.
Il s'agit d'une réponse à "comment réduire la fracture
numérique en Afrique ?", par la mise en place d'un dispositif
complet pour la création de points d'accès publics à
l'Internet dans des zones numériquement enclavées. Un
accès plus large aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication passe par un effort important d'initiation et de formation. Les
compétences existent en Afrique et il s'agit maintenant de partager le
savoir-faire de quelques-uns au profit du plus grand nombre. C'est pourquoi,
ADEN organise des formations à destination des gestionnaires de points
d'accès collectifs à Internet, afin qu'ils puissent organiser
à leur tour des formations à destination du grand public.
La formation de
formateurs
Dans chacun des
pays concernés par
le projet, ADEN organise trois formations de formateurs, ouvertes à
un public plus large que les seuls gestionnaires des centres.
- Administration et gestion d'un réseau
informatique ;
- Animation culturelle et pédagogique d'un point
d'accès public à Internet ;
- Gestion administrative d'un point d'accès public
à Internet.
Un forum ouvert à tous
permet de continuer à collaborer pour trouver des solutions aux
problèmes concrets qui se posent dans le cadre des activités
quotidiennes.
Les formations
organisées par les centres ADEN
Chacun des centres organise plusieurs formations par an
à destination de ses publics traditionnels : initiation à
Internet, à la production de sites web, à la création
multimédia, administration d'un réseau informatique, bases de la
programmation, etc.
Les centres ADEN publient les comptes-rendus et les
enseignements tirés des formations qu'ils ont organisées dans
leur partie du site
Le projet Aden se décline dans des zones africaines
enclavées numériquement. Dans chaque pays partenaire, il est
piloté par des comités rassemblant des représentants de
l'ambassade de France et des partenaires locaux. La coordination internationale
du projet est assurée par le Bureau pour les NTIC(nouvelles technologies
de l'information et de la communications) du ministère français
des Affaires étrangères. Le site Internet africaden.net est la
plateforme de collaboration du projet.
Aden est un projet contribuant à réduire la
fracture numérique dans 11 pays d'Afrique sub-saharienne. Il est
piloté au niveau de chaque pays par un comité de pilotage
national, regroupant les partenaires locaux du projet et des
représentants de l'ambassade de France dans le pays. A Paris, le bureau
pour les NTIC assure sa coordination.
Sur le terrain, les centres Aden sont gérés par
des acteurs de la société civile : association, organisation
non-gouvernementale, antenne universitaire, église, collectivité
locale, station de radio...Ils bénéficient de l'appui technique
et pédagogique d'une équipe de formateurs nationaux et
internationaux et des services rendus par des sociétés pour les
installations techniques (équipements, télécommunications,
Internet, informatique...).
L'ensemble de ce dispositif humain, réparti sur 11 pays
et une trentaine de centres ADEN, élargi à la communauté
des acteurs du développement des TIC en Afrique,
intéressés à participer à la dynamique du projet,
utilise quotidiennement le site Internet africaden.net, véritable
plateforme de collaboration du projet. Celle-ci est utilisée
quotidiennement, non seulement par tous ceux qui sont impliqués dans le
projet, mais également par tous ceux qui oeuvrent à la diffusion
des TIC sur le continent.
L'objectif est de partager les expériences, de
mutualiser les compétences et de fédérer les expertises,
afin de donner à chacun un accès simple à un ensemble de
ressources et de contacts les aidant dans la pérennisation de leurs
activités.
Outil majeur dans la
politique française de coopération visant à réduire
la fracture numérique, le projet d'Appui au Désenclavement
Numérique (ADEN) est mis en oeuvre dans 12 pays d'Afrique sub-saharienne
francophones, anglophones et lusophones, sur la période 2003-2008.
Doté d'un budget de 6 millions d'euros, il poursuit trois
objectifs : démocratiser l'accès aux Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication (NTIC) ; former les populations
locales à leur utilisation ; appuyer les usages, contenus et
applications Internet favorables au développement.
B. Organigramme du projet

Source ;
http://www.africaden.net/spip.php,rubrique1
L'ambition d'ADEN est de permettre au maximum une prise en
compte des besoins réels des acteurs du terrain. C'est pourquoi, autant
que possible, la décision émanera de ces derniers, à
savoir les comités de pilotage pays, les gestionnaires des centres ADEN
et les Services de coopération et d'action culturelle (SCAC).
La coordination et la définition des grandes
orientations du projet, seront, elles, du ressort du ministère
français des Affaires étrangères en France.
Responsabilités des
principaux acteurs du projet
Le gestionnaire du centre ADEN
C'est le(s) responsable(s) désigné(s) au sein de
la structure gestionnaire (association, collectivité territoriale,
établissement d'enseignement).
Assure le bon fonctionnement technique, financier et
administratif du centre ADEN dont il a la responsabilité. ![]() Détermine, propose et met en oeuvre les actions qui se
déroulent au sein du centre ADEN (formations, rencontres ouverture au
public payant, etc.) Détermine, propose et met en oeuvre les actions qui se
déroulent au sein du centre ADEN (formations, rencontres ouverture au
public payant, etc.)![]() Elabore le budget
prévisionnel, et l'exécute en concertation avec le SCAC. Elabore le budget
prévisionnel, et l'exécute en concertation avec le SCAC. ![]() Participe à la constitution du réseau ADEN et
à l'échange d'expérience, notamment en alimentant
régulièrement le site Internet et en fournissant des
données chiffrées de fréquentation, ainsi que d'ordre
budgétaire. Participe à la constitution du réseau ADEN et
à l'échange d'expérience, notamment en alimentant
régulièrement le site Internet et en fournissant des
données chiffrées de fréquentation, ainsi que d'ordre
budgétaire. ![]() Recherche des sources de
financements complémentaires au projet à travers notamment
l'augmentation régulière des ressources propres du centre et
l'implication d'autres bailleurs locaux ou internationaux. Recherche des sources de
financements complémentaires au projet à travers notamment
l'augmentation régulière des ressources propres du centre et
l'implication d'autres bailleurs locaux ou internationaux. ![]() Participe à la formation de formateurs et à toutes
les rencontres du réseau ADEN financées par le projet. Participe à la formation de formateurs et à toutes
les rencontres du réseau ADEN financées par le projet. ![]() Propose des actions nouvelles et sélectionne des
micros-projets d'usages et d'applications des NTIC pour le
développement, s'appuyant sur le centre dont il a la charge. Propose des actions nouvelles et sélectionne des
micros-projets d'usages et d'applications des NTIC pour le
développement, s'appuyant sur le centre dont il a la charge. ![]() Rend compte régulièrement au comité de
pilotage de l'utilisation des subventions et des mises à disposition du
matériel, dont il bénéficie pour la gestion du centre. Rend compte régulièrement au comité de
pilotage de l'utilisation des subventions et des mises à disposition du
matériel, dont il bénéficie pour la gestion du centre.
Le comité de pilotage pays
Sa composition peut varier d'un pays à l'autre. Il doit
en tout état de cause comprendre en son sein un représentant des
autorités du pays de résidence, ayant la charge de la
stratégie de développement des NTIC au niveau national, sectoriel
ou régional. Il devra également comporter, dès la
sélection des gestionnaires effectuée, un responsable par centre
ADEN.
Chapitre
troisième
PRESENTATION, TRAITEMENT
DES DONNEES ET INTERPRETATION DES RESULTATS
L'un des principaux objectifs de l'entreprise est la
réalisation d'un bénéfice maximal et à cette
réalisation correspond l'idée de la rentabilité.
Avant le traitement des données
récoltées, présentons tout d'abord les charges et les
produits qui interviennent dans l'exploitation du Congo SAT et du
Cybercafé Aden UCG.
1. Matières et fournitures consommés (compte
61) : ce compte enregistre le montant des matières et fournitures
achetées par les deux entreprises et consommées pendant la
période donnée. Ce sont par exemple : l'encre, le carburant,
du papier, cartouche, ...
2. Les transports consommés (compte 62) : il
enregistre les montants de transports consommés autre que le transport
sur achat. Ce sont des transports du personnel, de déplacement ou
voyages.
3. Les autres services consommés (compte 63) : il
enregistre les services consommés autres que le transport. C'est par
exemple : le frais de restauration, achat unité
téléphone, ...
4. Les charges et pertes diverses (compte 64) :
Malgré l'intitulé du compte, il faut veiller à ne pas y
enregistrer n'importe quelle charge. Ce compte comprend en fait certaines
charges qu'il est difficile de classer avec précision. Il
comprend : les assurances, les dons, les créances
irrécouvrables, les amendements pénales, les cotisations
syndicales, ...
5. Les charges du personnel (compte 65) : celui-ci
enregistre les différentes charges supportés par les deux
entreprises et qui prennent leur source dans le contrat du travail conclu et
bénéficiant directement ou indirectement aux salariés.
6. Dotation aux amortissements et provisions (compte
68) : il enregistre les charges annuelles calculées quand il s'agit
des consommations dues à l'usage ou à l'obsolescence des
couvertures de risques de l'équipement utilisé ;
7. Contribution et taxe (compte 66) : Ce compte
enregistre les différentes contributions et taxes perçues par les
villes ou collectivités.
8. Intérêts payés (compte 67) : ce
compte enregistre les intérêts, escomptes et autres charges
financières payés dus à des tiers. Ex : escomptes
accordés aux clients, intérêts sur traits, ...
La modification de produits du Congo SAT et du
Cybercafé Aden UCG suit la même logique que celles de charges.
1. Production vendue (compte 71) : il enregistre les
recettes réalisés provenant des services rendus par Congo SAT et
Cybercafé du Graben ;
2. Production stockée (compte 72) : ce compte
n'intervient pas dans nos calculs parce que leurs services rendus en faveur des
clients ne peuvent pas être stockés.
III.1. PRESENTATION DES
DONNEES
Tableau 1 : Evolution des
recettes du Congo SAT et du Cybercafé Aden UCG en dollars pour
l'année 2008
|
Mois
Entreprise
|
Janv
|
Fév
|
M
|
A
|
Mai
|
Jn
|
Jt
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
Congo SAT
|
1270,7
|
995,5
|
1190
|
1333,8
|
1114
|
920,2
|
1245,6
|
1144,8
|
1104
|
753,7
|
1250,2
|
804,2
|
|
Cyber UCG
|
619
|
594,36
|
486
|
370,3
|
974,2
|
595
|
757
|
501
|
692
|
632
|
683
|
795
|
Source : Documents comptables de deux
cybercafés
|
Entreprise
|
Total recette
|
|
Congo SAT
|
13126,7
|
|
Cybercafé Aden UCG
|
7698,86
|
Tableau 2 : Evolution des
charges d'exploitation de CONGO SAT pour l'exercice 2008 en dollars
|
Mois
N° Comptes
|
Janv
|
Fév
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
juillet
|
Aout
|
Sept
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
61
|
25.5
|
39
|
51
|
18
|
33
|
31
|
22.5
|
6
|
96.5
|
39
|
545
|
23.5
|
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
200
|
-
|
-
|
-
|
40
|
|
63
|
424
|
163.8
|
37.6
|
127.4
|
132.6
|
240.8
|
46.8
|
120.8
|
32.8
|
70.6
|
90
|
208
|
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
65
|
120
|
-
|
120
|
220
|
100
|
120
|
-
|
140
|
340
|
190
|
190
|
340
|
|
66
|
23
|
316.8
|
30
|
20
|
115
|
193
|
472
|
18
|
75
|
16
|
18
|
-
|
|
67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
50
|
2
|
150
|
|
68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
122
|
-
|
-
|
-
|
Source : Documents comptables du CONGO SAT
Tableau 3 : Evolution des
charges d'exploitation du Cybercafé du Graben pour l'exercice
2008
|
Mois
N° Comptes
|
Janv
|
Fév
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
juillet
|
Aout
|
Sept
|
Oct
|
Nov
|
Déc
|
|
61
|
94
|
93
|
26
|
156.9
|
28
|
43
|
59
|
77
|
97
|
52
|
49
|
36.5
|
|
62
|
1
|
3.36
|
1
|
3.44
|
-
|
3
|
8
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
|
63
|
10
|
15
|
|
19
|
23
|
7
|
19
|
6
|
6
|
22
|
5
|
35.5
|
|
64
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
65
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
67
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
68
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Source : Documents comptables du
Cybercafé Aden UCG
Commentaire : la constante du montant pour les charges du
personnel s'explique par le fait que le salaire du personnel est fixé
par forfait. A la fin du moi quelle que soit la variation des recettes,
l'employé a son salaire fixé dans le contrat du travail.
Toutefois, si les recettes sont basses, le reste de son salaire peut être
reporté pour le moi prochain.
III.2. TRAITEMENT ET
INTERPRETATION DE DONNEES
1. Tableau des recettes
réalisées
Tableau 4 : Moyenne des
recettes réalisées
|
Entreprise
|
Moyenne
|
|
Congo SAT
|
1093,8917
|
|
Cybercafé Aden UCG
|
641,57
|
Interprétation : Nous constatons que
Congo Sat a réalisé en moyenne un chiffre d'affaires
supérieur à celui du Cybercafé Aden de l'UCG. Cela est
dû à la situation géographique dans laquelle se trouve
chaque cybercafé, à la fréquentation de clients. Signalons
que Congo SAT adopte une tarification élevée celle de 15Fc
à la minute par rapport à celle du Cybercafé Aden de l'UCG
pour l'année 2008 qui de 10Fc à la minute.
2. Représentation
graphique des recettes réalisées
Graphique n°2 : Evolution des recettes du Congo SAT
et du Cybercafé Aden de l'UCG pour l'année 2008

Interprétation du graphique
Au cours de l'année 2008, Congo SAT a
réalisé une recette de valeur maximum, qui est égale
à 1333,8$ pour le moi d'avril. Le minimum des recettes est
observé au moi d'octobre et est égal à 753,7$. Cela
s'explique par le fait que les jours où le réseau est stable, on
gagne plus et dans le cas contraire, on assiste à une baisse de recette.
Le maximum des recettes du cybercafé Aden est observé au mois de
mai est 974,2. Son minimum des recettes est 370,3$ au mois d'avril.
3. Calcul de la
rentabilité financière
A. Marges
réalisées et calcul des taux de rentabilité
Les différentes marges sont calculées selon la
logique du tableau de formation de résultat. Ainsi, les
différents résultats sont représentés dans les
tableaux ci-après :
Tableau 5 : Tableau de
formation du résultat du Cybercafé Aden de l'UCG pour
l'année 2008 en dollars
|
DESIGNATION
|
Janv
|
Fév
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Sept
|
Octobre
|
Nov
|
Déc
|
|
71 Production vendue
|
619
|
594,36
|
486
|
370,3
|
974,2
|
595
|
757
|
501
|
692
|
632
|
683
|
795
|
|
61 M & fournitures cons.
|
94
|
93
|
26
|
156.9
|
28
|
43
|
59
|
77
|
97
|
52
|
49
|
36.5
|
|
62 Transports consommés
|
1
|
3.36
|
1
|
3.44
|
-
|
3
|
8
|
3
|
3
|
3
|
4
|
2
|
|
63 Autres services cons.
|
10
|
15
|
|
9
|
23
|
7
|
19
|
6
|
6
|
22
|
5
|
35.5
|
|
61 Valeur ajoutée
|
514
|
483
|
440
|
186.96
|
939.2
|
530
|
684
|
415
|
570
|
571
|
625
|
721
|
|
81 valeur ajoutée
|
514
|
483
|
440
|
186.96
|
939.2
|
530
|
684
|
415
|
570
|
571
|
625
|
721
|
|
64 Charges et pertes diverses
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
65 Charges du personnel
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
450
|
|
66 Contribution et taxe
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
67 Intérêts payés
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
82 Résultat brut d'expl.
|
64
|
33
|
-10
|
-263.04
|
489.2
|
80
|
234
|
-35
|
120
|
121
|
175
|
271
|
|
82 RBE
|
64
|
33
|
-10
|
-263.04
|
489.2
|
80
|
234
|
-35
|
120
|
121
|
175
|
271
|
|
68 Dotation aux amort. et provision
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
83 Résultat net d'exploitation
|
64
|
33
|
-10
|
-263.04
|
489.2
|
80
|
234
|
-35
|
120
|
121
|
175
|
271
|
 = 1279,16$ ; = 1279,16$ ;  = 6679,16$ = 6679,16$
Source : Nos calculs
Tableau 6 : Tableau de
formation du résultat pour Congo SAT à l'exercice 2008 en
dollars
|
DESIGNATION
|
Janv
|
Fév
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Sept
|
Octobre
|
Nov
|
Déc
|
|
71 Productions vendues
|
1270,7
|
995,5
|
1190
|
1333,8
|
1114
|
910,2
|
1245,6
|
1144,8
|
1104
|
753,7
|
1250,2
|
804,2
|
|
61M & fournitures consommés
|
25.5
|
39
|
51
|
18
|
33
|
31
|
22.5
|
6
|
96.5
|
39
|
545
|
23.5
|
|
62 Transports consommés
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
200
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
63 Autres services cons.
|
428
|
163.8
|
37.6
|
127.4
|
132.6
|
240.8
|
46.8
|
120.8
|
32.8
|
70.6
|
90
|
208
|
|
61 Valeur ajoutée
|
821,2
|
792.7
|
1101.4
|
1188.4
|
948.4
|
648.4
|
1146.3
|
808
|
974.7
|
644.1
|
615.2
|
532.7
|
|
81 valeur ajoutée
|
821,2
|
792.7
|
1101.4
|
1188.4
|
948.4
|
648.4
|
1146.3
|
808
|
974.7
|
644.1
|
615.2
|
532.7
|
|
64 Charges et pertes diverses
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
65 Charges du personnel
|
120
|
-
|
120
|
220
|
100
|
120
|
-
|
140
|
340
|
190
|
190
|
340
|
|
66 Contribution et taxe
|
23
|
316.8
|
30
|
20
|
115
|
193
|
472
|
18
|
75
|
16
|
18
|
-
|
|
67 Intérêts payés
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
50
|
2
|
150
|
|
82 Résultat brut d'exploitation
|
678.2
|
475.9
|
951.4
|
948.4
|
733.4
|
335.4
|
674.3
|
650
|
379.7
|
388.1
|
405.2
|
42.7
|
|
82 RBE
|
678.2
|
475.9
|
951.4
|
948.4
|
733.4
|
335.4
|
674.3
|
650
|
379.7
|
388.1
|
405.2
|
42.7
|
|
68 Dotation aux amorts. et provision
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
180
|
122
|
-
|
-
|
-
|
|
83 Résultat net d'exploitation
|
678.2
|
475.9
|
951.4
|
948.4
|
733.4
|
335.4
|
674.3
|
470
|
257.7
|
388.1
|
405.2
|
42.7
|
 = 6360,7$ ; = 6360,7$ ;  = 10221,3$ = 10221,3$
Source : Nos calculs
Commentaire sur le TFR CENTRE ADEN
UCG
Nous constatons que le centre ADEN UCG dépense trop
pour son personnel. Une partie considérable est réservée
à ses employés, mais aussi aux matières et fournitures. Ce
qui diminue son résultat par rapport à ses recettes
réalisées. Le centre doit donc minimiser les coûts pour
permettre le profit maximum.
Commentaire sur le TFR du CONGO SAT
Au vu du TFR Congo SAT, le compte des charges 63 a une valeur
élevée par rapport aux autres comptes des charges. Cela
s'explique par le fait que Congo SAT faisait trop des dépenses pour la
restauration journalière de son personnel. A plus elle dépensait
trop pour les unités téléphoniques. Congo SAT pouvait
réaliser un profit considérable si elle minimisait les
coûts.
A l'aide de ces différentes marges
réalisées et du capital fixe de chaque entreprise,
c'est-à-dire du Congo SAT et du Cybercafé Aden UCG nous pouvons
passer au calcul des taux de rentabilité annuelle.
Le taux de rentabilité global (annuel) est donné
par :
 - Capital fixe Congo SAT = 20350$ - Capital fixe Congo SAT = 20350$
- Capital fixe Centre Aden UCG = 23760$
Les taux de rentabilité globale pour les deux
cybercafés sont résumés dans le tableau
ci-après :
Tableau 7 : Taux de
rentabilité annuelle
|
Entreprise
|
Taux de rentabilité annuelle
|
|
Congo SAT
|
31,25%
|
|
Cybercafé du Graben
|
5,4 %
|
Source : Nos calculs
Interprétation :
Le taux de rentabilité du Congo SAT est de 31,25%. Ce
qui revient à dire que 100$ engagés dans ses activités
apportent 31,25$ par an. Donc l'on peut dire que la rémunération
du capital utilisé est de 2,6% le moi, un pourcentage négligeable
compte tenu de la conjoncture économique de notre milieu.
Le taux moyen de rentabilité du cybercafé Aden
UCG est de 5,4% c'est-à-dire 100$ encagés dans ses
activités apportent 5,4$ par an. On peut dire que la
rémunération du capital utilisé est de 0,45$ par mois,
pourcentage qui est non satisfaisant.
Pour apprécier la rentabilité de deux
entreprises, il est important de calculer les différents ratios de
rentabilité réalisés durant l'an 2008.
B. Calcul des ratios de
rentabilité
B.1. La rentabilité de l'activité du
Congo SAT et du Cybercafé Aden UCG
L'appréciation des performances d'une entreprise se
fait par la confrontation du résultat comptable et de son chiffre
d'affaire.
B.1.1. Pour Congo SAT
Le ratio de la valeur ajoutée : 
Ce ratio est généralement inférieur
à 1.
Ce ratio est : 
Interprétation : Au vu de ce ratio, nous
constatons qu'en 2008, l'activité au Congo SAT n'a dégagé
qu'une marge bénéficiaire de 77,9% du chiffre d'affaires.
- Le ratio du résultat net : 
Il est égal à : 
Interprétation : L'activité du
Congo SAT a dégagé un bénéfice net de 48,4% par
rapport au chiffre d'affaires.
B.1.2. Pour le Cybercafé Aden de l'UCG
- Le ratio de la valeur ajoutée : 
Ce ratio est généralement inférieur
à 1
Ce ratio est : 
Cela signifie que le cybercafé Aden de l'UCG a
dégagé une marge bénéficiaire de 67,5% du chiffre
d'affaires.
Le ratio du résultat net est : 
Cela signifie que l'activité du cybercafé Aden
de l'UCG a dégagé un bénéfice net de 16,6% par
rapport au chiffre d'affaires.
B.2. La rentabilité des capitaux
engagés
B.2.1. Pour le Congo SAT
La rentabilité financière : 
Cette rentabilité =
Interprétation : les capitaux
engagés par Congo SAT ont apporté 63,6% de bénéfice
pour l'an 2008.
B.2.2. Pour le Cybercafé Aden de l'UCG
La rentabilité financière = 
Cette rentabilité =
Nous constatons que les capitaux engagés par le
cybercafé Aden UCG ont apporté 14,2% de bénéfice
pour l'an 2008.
B.3. Le ratio de couverture de
charge

B.3.1. Pour Congo SAT
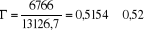
Interprétation :  qui est supérieur à 0,5. Nous constatons que les
charges sont élevées et par conséquent diminuent le
résultat d'exploitation. Ce qui nous amène à dire que
l'activité économique du Congo SAT est moyennement rentable. qui est supérieur à 0,5. Nous constatons que les
charges sont élevées et par conséquent diminuent le
résultat d'exploitation. Ce qui nous amène à dire que
l'activité économique du Congo SAT est moyennement rentable.
B.3.2. Pour le Cybercafé Aden UCG
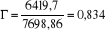
Interprétation :  qui est supérieur à 0,5 et proche de 1. Nous
remarquons que les charges sont très élevées et pour ce
fait, il y a diminution du résultat d'exploitation. Nous pouvons ainsi
dire que l'activité économique du cybercafé Aden UCG est
moyennement rentable. qui est supérieur à 0,5 et proche de 1. Nous
remarquons que les charges sont très élevées et pour ce
fait, il y a diminution du résultat d'exploitation. Nous pouvons ainsi
dire que l'activité économique du cybercafé Aden UCG est
moyennement rentable.
Tableau 8 : Tableau de
synthèse des différents ratios de rentabilité
|
DESIGNATION
|
CONCO SAT
|
Cybercafé Aden UCG
|
|
Ratio de la Valeur Ajoutée
|
0,779
|
0,867
|
|
Ratio du résultat net
|
0,484
|
0,166
|
|
Rentabilité financière
|
0,636
|
0,142
|
|
Ratio de couverture de charge
|
0,515
|
0,834
|
Source : Nos calculs
A présent nous calculons le seuil de
rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaire permettra de
réaliser une marge sur coût variable, qui soit suffisante pour
couvrir l'ensemble des charges fixes.
Après ventilation des charges en charges fixes et
véritables nous constatons que pour Congo SAT, les charges fixes
s'élève à 2182 et les charges variables à 4584 et
pour le cybercafé Aden UCG, les coûts fixes égalent 5400 et
les coûts variables 1019,7.
B.4. Calcul de la marge sur CV
1. Marge sur coût variable pour Congo SAT
Marge sur CV = 13126,7 - 4584 = 8542,7
2. Marge sur coût variable pour Cybercafé du
Graben
Marge sur CV = 7698,86 - 1019,7 = 6679,16
B.5. Calcul du seuil de rentabilité
(S.R)
1. Pour Congo SAT

Interprétation : Congo SAT pouvait
réaliser un chiffre d'affaire de 3352,85$ sans connaître ni perte,
ni bénéfice.
2. Pour le Cybercafé Aden UCG

Interprétation : Aden UCG pouvait
réaliser un chiffre d'affaire de 6224,42$ sans connaître ni
bénéfice, ni perte.
* Représentation graphique du seuil de
rentabilité
A chacune des expressions du seuil de rentabilité
précédentes correspond une solution graphique. Si on
désigne x le chiffre d'affaires, la marge sur C.V est de 
D'où les équations du résultat
d'exploitation de deux entreprises sont :
y1 = 0,650788x1 - 2182 (1) où
y1 = résultat du Congo SAT
y2 = 0,86755x2 - 5400 (2) où
y2 = résultat du Centre Aden UCG
Or, lorsqu'une entreprise atteint son S.R, le résultat
est nul.
D'où 0,650788x1 - 2182 = 0 x1 =

0,86755x2 - 5400 = 0 x2 = 
Graphique n°3 : Seuil de rentabilité du Congo
SAT
Charges
C.V
y = 2182 C.F
3352,85 = x C.A
Source : Nos calculs
Graphique n°4 : Seuil de rentabilité
du Cyber Aden UCG
Charges
C.V
y = 5400 C.F
6224,42 = x C.A
Source : Nos calculs
Interprétation : Entre 0 et x, la marge
sur CV ne couvre pas les charges fixes et les charges totales sont
supérieures au chiffre d'affaires. D'où le triangle (0, y, S.R)
correspond à la zone de perte.
Après X, la marge sur CV couvre les charges fixes et
les C.A sont supérieurs aux charges totales, d'où le triangle
(S.R, Ms/C.V, CF) correspond à la zone de profit.
III.3. CONCLUSION
PARTIELLE
Après calcul des moyennes de recettes
réalisées par les deux cybercafés, nous constatons que le
cybercafé à tarification élevée gagne plus que
celui à tarification moins élevée, c'est-à-dire
Congo SAT sont supérieurs à celle de Aden UCG.
De même, le calcul des différents ratios de
rentabilité vient de nous montrer que l'entreprise Congo SAT et celle du
cybercafé Aden UCG sont moyennement rentables, le bénéfice
réalisé au sein du cybercafé Aden UCG est peu satisfaisant
par rapport à ses capitaux engagés. Mais la rentabilité
des capitaux encagés par Congo SAT est satisfaisante, ce sont les
charges élevées qui ont diminué son résultat. Ce
qui nous amène à dire que dans l'ensemble Congo SAT est
moyennement rentable.
CONCLUSION GENERALE
Aujourd'hui, l'information constitue un élément
indispensable dans la vie économique, sociale et culturelle des nations.
L'Internet qui est l'outil d'information et de communication le plus en
expansion, a suscité beaucoup d'engouement aussi bien au niveau des
Etats que les acteurs commerciaux. Dans l'esprit de faire profiter à
tout le monde cet outil, beaucoup des cybercafés ont vu le jour dans
notre pays la RDC. Ceci s'est répandu sur tout le territoire national de
la République démocratique du Congo.
Notre thème intitulé :
« étude de la rentabilité de cybercafés à
tarification différente : cas du Congo SAT et du Centre Aden
UCG » a eu pour problématique : les cybercafés
Congo SAT et Aden UCG sont-ils rentables ? A cette question,
l'hypothèse a été qu'il se pourrait que les
cybercafés Congo SAT et Aden UCG soient moyennement rentables. Pour
vérifier cette hypothèse nous nous sommes servi de
méthodes telles que les méthodes mathématique,
statistiques et inductive. Nous avons également utilisé la
technique documentaire, l'interview, la pré enquête.
Pour adapter notre thème aux concepts
économiques et financiers, hormis l'introduction et la conclusion
générale le travail comprend trois chapitres : le chapitre
premier a concerné le marché des cybercafés et la notion
de rentabilité, le chapitre deuxième a présenté les
entreprises cibles ; le troisième chapitre a présenté
les données et interprété les résultats.
Les résultats obtenus sont les suivants : les
ratios de couverture des charges du Congo SAT et du Centre Aden UCG ont
été respectivement de 0,515 et 0,834. Leurs chiffres d'affaires
ont été respectivement de 13126,7$ et 7698,86$. Leurs charges ont
été de 6766,8$ et 6419,7. Les rentabilités de leurs
capitaux engagés sont 0,636 et 0,1421. Leurs résultats nets
d'exploitation ont été de 6360,7 et 1279,16. Ce qui nous conduit
à confirmer notre hypothèse de départ et nous concluons
que les cybercafés Congo SAT et Aden UCG sont moyennement rentable.
Nous constatons aussi que la rentabilité dépend
largement de la tarification, de la qualité de la connexion, mais aussi
du milieu géographique dans lequel se trouve le cybercafé. Tous
ces aspects ont eu une influence sur les recettes réalisées.
Raison pour laquelle le cybercafé CONGO SAT avec un tarif de 15Fc
à la minute a réalisé un chiffre d'affaires plus
élevé que celui du centre Aden UCG qui adoptait un tarif de 10Fc
à la minute. Pour le cas du cyber Aden UCG, le prix bas par rapport
à celui de l'autre cybercafé a été adopté
pour respecter les finalités du projet Aden afin de désenclaver
l'Afrique.
Au vu de résultats obtenus, nous pensons avoir atteint
notre objectif et à partir de tout ce qui précède, nous
suggérons ce qui suit :
a) Aux propriétaires de
cybercafés
Une meilleure organisation du marché constituant un
élément favorable pour le bon déroulement des
activités. Notre analyse nous a fait constaté qu'aucune
organisation formelle ou informelle n'existe sur le marché des
cybercafés. Ce qui fait que la fixation des prix devienne un
problème crucial pour tous les propriétaires.
Le manque d'un système adéquat d'informations
sur l'évolution du marché rend un peu difficile la mise en place
des meilleures stratégies commerciales qui pourront permettre la
rentabilité de l'activité. Aussi faudrait-il que tous ceux qui
aimeraient se lancer dans les activités de cybercafés aient une
connaissance plus profonde du fonctionnement du marché et d'un
marché.
b) Aux autorités
politico-administratives
Une bonne politique en matière des
télécommunications serait une base importante pour
l'évolution de l'Internet au Congo. Il faudrait offrir un cadre
permettant une concurrence réglementaire pour tous les
opérateurs. Même si la communication est élément
capital dans la politique d'une nation, offrir des atouts aussi bien sur le
plan juridique que commercial permettra de faire entrer notre pays dans le
monde de l'information et de la communication.
D'autant plus que le monde devient un village
planétaire, un impérieux devoir incombe aux autorités de
faciliter l'accès à l'Internet à tout un chacun.
c) Au personnel des cybercafés
Que le personnel chargé de l'accueil des clients
améliore ses relations sociales avec les clients. Ne pas être
méchant ou méfiant devant les clients.
Que le personnel chargé de la comptabilité
améliore sa tenue de comptabilité.
Sans avoir la prétention de faire de notre recherche
une étude définitive, nous pensons avoir répondu à
notre préoccupation. Il importe toutefois de souligner qu'un travail
scientifique, quels que soient ses mérites, ne manque pas de soulever
les controverses et donc le champ est ouvert à tout chercheur pour
l'évolution de la science.
BIBLIOGRAPHIE
A. Ouvrages
1. BEAUD S., WEBER F., Guide d'enquête de terrain,
éd. La découverte, Paris 2003.
2. BEAUJEU-GARNIER, DELOBEZ A., Géographie de
commerce, éd. Masson, Paris, 1997.
3. BERNARD et Colli, Dictionnaire économique et
financier, 6ème éd. Seuil, Paris 1996.
4. BERNARD J., CATIN M., Les conditions économiques
du changement technologique, L'Harmattan, Paris, 1998.
5. BLAISE J-B, Commerçant, distribution,
Librairie générale de Droit et de jurisprudence, Paris,
2000.
6. C. BUISSART, Analyse financière, éd.
Fouché, Paris, 1991.
7. C.D ECHAUDEMAISON et al., Dictionnaire
d'économie et des sciences sociales, éd. Nattan, Pari
1993.
8. DAVID DAUTRESME, Economie et marchés des
capitaux nationaux, éd. La revue banque, Paris 1985.
9. DEGRANGES P.D., Accéder à Internet en
déplacement, éd. First interactive, Paris, 2001.
10. GEORGES, DEPALLENS, Gestion financière de
l'entreprise, éd. Sirey, Paris 1975.
11. Gérard ALFONSI et Paul GRANDJEAN, Analyse
financière d'une entreprise privée, éd. Foucher,
Paris 1999.
12. GIANNELLONI J-L., VERNETTE E., Etudes de
marché, 2ème édition, Vuibert, Paris,
Novembre 2001.
13. Huber COGHE, Charles Van WYMEERSCH, Traité
d'analyse financière, tome I, PUN, 4ème
éd., 1990
14. J.P COUVREUR, Gestion financière,
première partie « la décision d'investir »,
Dunod, Paris 1982, p. 112.
15. Pierrette RONGERE, Méthodes des sciences
sociales, éd. Dalloz, Paris 1975.
16. QUIVY R., CAMPENHOUDT L.V, Manuel de recherche en
sciences sociales, Dunod, Paris 1995.
17. SANSON T., Internet en 10 leçons : savoir
naviguer sans écueils, Menerva, Genève, 1998.
18. TOUCHARD J-B, POUTS-LAJUS S., Découvrir
l'Internet, éditions Ganndal, 1999.
B. T.F.C
1. Benjamine KATUNGU VASIMA,
« Appréciation de la rentabilité d'un centre
informatique à Butembo », TFC 2003-2004, inédit,
UCG Butembo.
2. KAHAMBU VAKULAVANZWA : « La
rentabilité d'un investissement économique. Cas du centre
d'Accueil Mont-Sinaï », TFC 2003-2004, UCG.
3. KAHAMBU MALEKANI, Etude comparative de la
rentabilité des principales cultures des fautes terres, TFC,
1997-1998, UCG Butembo.
C. Rapport et Revues
1. Rapport sur la communication dans le monde, UNESCO, 1990
2. Rapport sur les Indicateurs des
télécommunications africaines, U.I.T Mai 1998
3. Revue, Information, télécommunication et
développement, UIT, avril 1996
D. Site Internet
http://www.africaden.net
LISTE DE TABLEAUX
Tableau 1 : Evolution des recettes du Congo SAT et du
Cybercafé Aden UCG en dollars pour l'année 2008
47
Tableau 2 : Evolution des charges d'exploitation de CONGO SAT
pour l'exercice 2008 en dollars
48
Tableau 3 : Evolution des charges d'exploitation du
Cybercafé du Graben pour l'exercice 2008
48
Tableau 4 : Moyenne des recettes réalisées
49
Tableau 5 : Tableau de formation du résultat du
Cybercafé Aden de l'UCG pour l'année 2008 en dollars
51
Tableau 6 : Tableau de formation du résultat pour Congo
SAT à l'exercice 2008 en dollars
52
Tableau 7 : Taux de rentabilité annuelle
53
Tableau 8 : Tableau de synthèse des différents
ratios de rentabilité
56
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACES
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
2
Chapitre Premier :
9
GENERALITES SUR LE MARCHE DES CYBERS CAFE ET NOTIONS DE
RENTABILITE
9
I.1. GENERALITES SUR LE MARCHE DES CYBERCAFES
9
I.1.1. Structure du marché
9
I.1.2. Description du cybercafé
9
A. Le cadre ou la salle
10
B. Les équipements
12
B.1. La gamme d'ordinateurs
12
B.2. Les types de connexion
13
I.2. NOTIONS SUR LA RENTABILITE
21
1. Définition et types de rentabilité
21
2. Evaluation de la rentabilité
22
Chapitre deuxième :
30
PRESENTATION DES ENTREPRISES CIBLES.
30
Section I : CONGO SAT
30
§1. Dénomination - siège social - objet et
durée
30
A. Dénomination
30
B. Siège social
30
C. Objet social
30
D. Structure organisationnelle
31
§2. Capital social - Parts sociales
31
A. Capital social
31
B. Parts sociales
33
§3. Gérance - Surveillance
35
§4. Inventaire - Bilan
36
§5. Dissolution - liquidation
37
§6. Dispositions générales du Congo -
SAT
37
§7. Assemblée générale
38
§8. Nomination de Gérant
39
II. CYBER CAFE ADEN - UCG BUTEMBO
40
II.1 Présentation
40
II.2 Notions sur ADEN
41
Chapitre troisième :
46
PRESENTATION, TRAITEMENT DES DONNEES ET INTERPRETATION DES
RESULTATS
46
III.1. PRESENTATION DES DONNEES
47
III.2. TRAITEMENT ET INTERPRETATION DE DONNEES
49
1. Tableau des recettes réalisées
49
2. Représentation graphique des recettes
réalisées
49
3. Calcul de la rentabilité financière
50
A. Marges réalisées et calcul des taux de
rentabilité
50
B. Calcul des ratios de rentabilité
54
III.3. CONCLUSION PARTIELLE
59
CONCLUSION GENERALE
60
BIBLIOGRAPHIE
63
LISTE DE TABLEAUX
65
TABLE DES MATIERES
66
* 1 Rapport sur la communication
dans le monde, UNESCO, 1990
* 2 OMERE MATSORO,
Techniques de recherche, cours inédit, UCG G2 Eco,
1999-2000.
* 3 Pierrette RONGERE,
Méthodes des sciences sociales, éd. DALLOS, Paris, 1975,
p. 20.
* 4 SANSON T, internet en 10
leçons :savoir naviguer sans éceuils, MINERVA,
Génève,1998.
* 5 Information,
télecommunication et développement, Révue UIT ,Avril 1996,
p. 5.
* 6 Information,
télécommunication et développement, Revue UIT ,Avril 1996,
p. 10.
* 7 Information,
télécommunication et développement, Revue UIT ,Avril 1996,
p. 10.
* 8 Nos enquêtes sur
terrain
* 9 Nos enquêtes sur
terrain
* 10 Mundeke K.,
« Etude de la rentabilité et causes de
prolifération de salon de coiffure électrique en ville de
Butembo », TFC, inédit, UCG, 2002.
* 11 J.P COUVREUR, Gestion
financière, première partie « la décision
d'investir », Rue, 4ème éd. 1982, p.
112.
* 12 BERNARD et Colli,
Dictionnaire économique et financier, 6ème
éd. Seuil, Paris 1996, p. 70.
* 13 C.D. ECHAUDEMAISON et al,
Dictionnaire d'économie et des sciences sociales, Ed. Nattan,
Paris 1993, p.20.
* 14 SENRIOU et CHABRIOL :
analyse des bilans et de gestion. Etude des cas, cité par K.
KALEEMA : Analyse financière de l'entreprise commerciale,
TFC, inédit, UNIKIS, 1981, p. 35.
* 15.GEORGES, DEPALLENS,
Gestion financière de l'entreprise, Ed Sirey, Paris 1974, p. 63.
.
* 16 C. BUISSART, Analyse
financière, Ed. Foucher, Paris, 1991, p. 43
* 17 Hubert OOGHE, Charles Van
WYMEERSCH, Traité d'analyse financière, tome 1,
P.U.N.,4ème éd., 1990
* 18 Gérard ALFONSI et
Paul GRANDJEAN, Analyse financière d'une entreprise
privée, Ed. Foucher, Paris, 1999, p.33.
* 19 David DAUTRESME, Economie
et marché des capitaux nationaux, éd. La revue banque, Paris
1985.
* 20 Statuts CONGO SAT, p.
1.
* 21 Statut CONGO SAT, p. 1.
* 22 Statuts CONGO SAT, p.
7.
* 23 Statuts Congo SAT, p.
8.
* 24 Auteur Anonyme,
« africaden, Article 219 », in Spip, [en ligne],
[Réf du 29/6/2009, 14h50] disponible sur http://www.africaden.net
| 


