
EPIGRAPHE
« Réussir est devenu l'obsession
générale de notre société, et cette Réussite
est mesurée par notre capacité à l'emporter dans des
Compétitions permanentes »
Albert Jacquar
II
DEDICACE
A nos chers parents ; A nos frères et soeurs ;
MATENDO GIYE Rodrigue
MATENDO GIYE Rodrigue
III
REMERCIEMENTS
Nombreux sont ceux qui ont contribué à
l'élaboration de ce travail. Nous avons l'obligation de leur
témoigner notre gratitude.
A Dieu Tout Puissant, pour son amour, sa protection et sa
bonté de nous faire arriver à ce jour longtemps rêvé
et attendu avec soif, que la gloire et la louange lui soient rendues de notre
part.
Nos remerciements s'adressent aux corps académique
et scientifique de l'Institut Supérieur Pédagogique de
Bukavu(ISP) en général et ceux du département des sciences
commerciales et administratives en particulier pour la formation qu'ils ne
cessent de fournir à notre faveur. Un cachet spécial à
l'assistante SYLVIE IMATA qui, en dépit de ses multiples et lourdes
responsabilités a accepté d'encadrer ce travail. Son
dévouement et sa disponibilité toutes les fois qu'il devait nous
recevoir sans être gênés pour des orientations, a permis la
réalisation de ce travail. Qu'il trouve à travers ce modeste les
résultats de leur efficacité et l'expression de notre
gratitude.
Nos remerciements s'adressent également à
notre défunt Père MWAMBA RULESHA, à notre père GIYE
RULESHA mais aussi à notre père KAMOLE KA MWAMBA Janson et
à notre mère MWAVITA BALOLA Charlotte, qui nous ont donné
la grâce de poursuivre nos études et qui du jour le jour prennent
soin de nous, nous ne cesserons jamais de scander ce que nous avons
hérité de vous.
Nous pensons à nos chers frères et soeurs,
AMANI MWAMBA, MATEGANE MWAMBA, MASHAURI MWAMBA, DAVID NDAYISHIMIYE, NABINDU
PAUL, AIMEE PAUL, NGEMA PAUL, SHUKURU MATABARO Nicole, ...
En fin, nous ne pouvons pas oublier tous nos camarades et
compagnons de lutte, nos amis et connaissances : USHINDI BISIMWA Audace,
SHABANI MUZAZI Christelle, SAMUEL MILEMBA, KEVIN OMAR, ACHILE, MILINGANYO
AKILIMALI Agnès, AKONKWA KABISHI Yannick, KIYONGWE MUGISHO Alexis, ZEKA
WILONDJA Sylvie, MANALUSU
KABUZI Fabrice ....
A tous ceux qui n'ont pas été cités
et qui nous ont conseillé et stimulé, nous disons grand
merci.
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
ASBL : Association Sans But Lucratif
B.F.R : Besoin en Fonds de Roulement
COOCEC : Coopérative Centrale du
Congo
E.B.E : Excédent Brut
d'Exploitation
F.E.C : Fédération des
Entreprises du Congo
F.R : Fonds de Roulement
F.R.N : Fonds de Roulement Net
I.N.P.P : Institut National de
Préparation Professionnelle
I.N.S.S : Institut National de
Sécurité Sociale
I.P.M.E.A : Industries Petites et Moyennes
Entreprises et Artisanat
I.S.P :Institut Supérieur Pédagogique
L.R : Liquidité Réduite
P.M.E : Petite et Moyenne Entreprise
P.M.E.A : Petites et Moyennes Entreprises et
Artisanat
P.M.I : Petites et Moyennes Industries
R.F : Rentabilité financière
R.O.E : Return On Equity
R.O.I : Return On Investissement
RDC : République Démocratique
du Congo
S.A : Société Anonyme
S.N.C.C : Société Nationale de
chemin de fer au Congo
T.N : Trésorerie Nette
V
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1regroupement des PME du Sud-Kivu et leur secteur
d'activité 15
Tableau 2Répartition de la population de Bukavu par
commune 24
Tableau 3Répartition de l'échantillon selon le
secteur d'activité 32
Tableau 4De la Raison sociale 34
Tableau 5Commune où se trouve la firme 35
Tableau 6Genre du gestionnaire 35
Tableau 7Nombre du salarié 36
Tableau 8l'année de création de l'entreprise
37
Tableau 9Forme juridique de l'entreprise 37
Tableau 10Activité principale de l'entreprise 38
Tableau 11Sources de financement de l'entreprise 39
Tableau 12Crédit obtenu du principal partenaire
financier 39
Tableau 13Motivation à rester dans le secteur 40
Tableau 14Mode de financement préféré
40
Tableau 15degré de préférence de la
source utilisée 41
Tableau 16Appréciation de la clientèle 42
Tableau 17De l'influence du mode de financement utilisé
42
VI
RESUME
Le mode de financement et croissance des PME de la province du
Sud-Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier. Ce
travail,analyse lelienentre le mode de financementetles facteurs favorisant la
croissance desP.M.E de la ville de Bukavudufaitde sonintérêt
à se faire croitreetdese développerdansuncontexte
théorique renouvelé où l'étude duprocessus
decroissancedevaleur estassimilée fréquemmentà une
intention stratégique du comportement del'entreprise.
Pour atteindre cet objectif, l'étude a recouru à
plusieurs méthodes et techniques dont entre autre : la méthode
analytique, descriptive, statistique et la méthode qualitative ainsi que
la technique documentaire, d'interview et surtout au questionnaire
d'enquête. Les résultats trouvés ont montrés que
:
Sur 88 PME enquêtés, 1 soit une proportion de
1,2% prouve que le mode de financement qu'il utilise influence à 45% ; 2
sur 88 enquêtés, soit 2,4% prouvent que le mode de financement
qu'ils utilisent influencent à 50 % ; 7 sur 88 enquêtés,
soit 8,3% prouvent que le mode de financement auquel ils font recourt influence
à 55% ; 23 sur 88 enquêtés, soit 27,4% prouvent que le mode
de financement auquel ils font recourt influence à 60% ; 17 sur 88
enquêtés, soit 20,2% disent que le mode de financement auquel ils
font recourt influence à 65% ; 15 sur 88 enquêtés soit
17,9% prouvent que le mode de financement auquel ils font recourt influence
à 70% ; 18 sur 88 enquêtés, soit 21,4% disent que le mode
de financement auquel ils font recourt influence à 75% et 1 sur 88
enquêtés, soit 1,2% prouve que le mode de financement auquel il
fait recourt influence à 80%.
3 sur 88 enquêtés, soit 33,3% disent que le mode de
financement auquel ils font recourt n'influence pas leurs croissances à
cause des intérêt payés lors du remboursement du
crédit, 3 sur 88 enquêtés, soit 33,3% disent que le mode de
financement auquel ils font recourt n'influence pas leurs croissance à
cause de taux d'intérêt qu'il supportent lors du remboursement ; 2
sur 88 enquêtés, soit 22,2% disent que le mode de financement
auquel ils font recourt n'influence pas leurs croissances à cause de
l'échéance du payement du crédit et 1 sur 88
enquêtés, soit 1,1% dit que le mode de financement auquel il fait
recourt n'influence pas leur croissance à cause du déficit qui se
manifeste du jour au jour.
VII
ABSTRACT
The fashion of financing and growth of the SME of the province
of the South-Kivu in general and of the city of Bukavu in particular. This
work, analyze the tie between the fashion of financing and the factors
encouraging the growth of the P.M.E of the city of Bukavu because of
his/her/its interest to make itself/themselves grow and to develop
itself/themselves in a renewed theoretical context where the survey of the
process of value growth is frequently assimilated to a strategic intention of
the behavior of the enterprise.
To reach this objective, the survey resorted to several
methods and techniques of which between other: the analytic, descriptive,
statistical method and the qualitative method as well as the documentary
technique, of interview and especially to the questionnaire of investigation.
The found results showed that:
On 88 SME investigated, 1 either a proportion of 1,2% proves
that the fashion of financing that it uses influence to 45%; 2 on 88
investigated, either 2,4% prove that the fashion of financing that they use
influences to 50%; 7 on 88 investigated, either 8,3% prove that the fashion of
financing to which they make resorts influence to 55%; 23 on 88 investigated,
either 27,4% prove that the fashion of financing to which they make resorts
influence to 60%; 17 on 88 investigated, either 20,2% say that the fashion of
financing to which they make resorts influence to 65%; 15 on 88 investigated
either 17,9% prove that the fashion of financing to which they make resorts
influence to 70%; 18 on 88 investigated, either 21,4% say that the fashion of
financing to which they make resorts influence to 75% and 1 on 88 investigated,
either 1,2% prove that the fashion of financing to which he/it makes resorts
influence to 80%.
3 on 88 investigated, either 33,3% say that the fashion of
financing to which they make resorts doesn't influence their growths because of
the interest paid at the time of the repayment of the credit, 3 on 88
investigated, either 33,3% say that the fashion of financing to which they make
resorts doesn't influence their growth because of interest rate that he/it
supports at the time of the repayment; 2 on 88 investigated, either 22,2% say
that the fashion of financing to which they make resorts doesn't influence
their growths because of the deadline of the payment of the credit and 1 on 88
investigated, either 1,1% said that the fashion of financing to which he/it
makes resorts doesn't influence their growth because of the
deficit that appears from the day on the day.
1
INTRODUCTION
Dès les années 60 l'industrialisation a
été inscrite parmi les objectifs de développement, mais
l'option pour les grandes unités industrielles n'a pas répondu
aux attentes prévues comme était prévue. Il devient donc
nécessaire de développer des PME capables de promouvoir
l'économie nationale et de donner une nouvelle poussée en
avant.
La PME fait l'objet actuellement d'une étude
particulière dans la mesure où elle participe au
développement économique et social du pays, c'est l'outil le plus
efficace pour mobiliser la volonté et les capacités
créatrices humaines.
L'importance de la PME vient du fait qu'elle est dotée
d'un certain nombre d'outils irremplaçable. Cette catégorie
d'entreprise peu capitaliste, mais dont la contribution à l'emploi est
intéressante, surtout dans un pays comme la RD Congo où le
problème du chômage tend à s'intensifier chaque
année, elle permet de décentraliser les investissements, de
mobiliser l'épargne privée, par conséquent favoriser la
régionalisation et enfin, rationaliser la production par la diminution
des coûts qui permet l'amélioration de la concurrence de
l'économie sur les marchés étrangers.
Le secteur des Petites, et moyennes entreprises (PME) a
été identifié comme un secteur stratégique
important dans les objectifs généraux du gouvernement de la RDC
avec notamment la création en 2014 du Ministère des PME. Ce
secteur est considéré comme un facteur de changement pour la
croissance économique inclusive, le développement
régional, la création d'emplois et la réduction de la
pauvreté et qu'il joue un rôle essentiel dans le
développement durable, l'égalité des sexes et la
viabilité environnementale (Dominique Séran. Stratégie
nationale des PME)
Aucune activité ne peut commencer sans la
disponibilité des fonds, c'est-à-dire pour qu'une activité
entre dans son exploitation, on doit mobiliser des moyens financiers.Ces moyens
peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur de
l'organisation, tout comme ils peuvent provenir de deux cotés à
la fois (intérieur et extérieur à la fois) ; en d'autres
termes, il s'agit d'un financement interne ou externe.
Que le financement soit interne ou externe ; l'homme rationnel
ne doit pas l'utiliser comme il veut, c'est-à-dire ne pas affecter les
capitaux comme bon lui semble, car on ne commence pas une activité pour
l'arrêter mais pour la pérenniser. C'est pourquoi l'homme
rationnel et possédant toutes ses facultés, doit être
à mesure de savoir d'où il vient, où il est et où
il va. (TFC de KulondwaNtole Roger portant sur la structure
financière d'une PME : cas des établissements UMOJA SHOP de
Goma.2015 p.1).
2
Depuis sa création, l'entreprise, tout au long de son
développement a besoin de ressources financières. En effet, quel
que soit sa taille, dans la plupart des cas, l'entreprise ne peut pas se
contenter de ses ressources propres pour satisfaire continuellement tous ses
besoins de financement. De ce fait, elle devrait recourir aux ressources
externes qui sont principalement le marché financier et la banque. Cela
est d'autant plus valable dans une économie d'endettement, telle que
l'économie congolaise, que la banque entant que source de financement a
toujours occupé une place primordiale dans le financement des
entreprises congolaises. Ajoutons, pour dire que les entreprises congolaises,
pour diverses raisons (incertitude du marché, forte concurrence, crise
financière,...) font recours aux financements personnels. La politique
mise en oeuvre par les banques était construite sur une allocation
administrative des ressources financières. Ce qui fait que les
entreprises étaient soumises à l'acte d'investir dans les
intérêts réciproques, autrement dit, les entreprises
n'avaient pas le pouvoir de décision leur permettant de choisir les
investissements appropriés ainsi que leur mode de financement, et aussi,
elles ne pouvaient choisir leurs clients, elles finançaient les projets
des banques sans avoir le pouvoir de refuser une demande émanant de ces
dernières.
De plus les crédits octroyés pour le financement
appropriés pour le financement des entreprises ont été
accordé à des taux complétements déconnectés
du marché. Ainsi cette planification financière a réduit
les entreprises à des simples exécuteurs des plans
préétablis par les banques. Ce qui engendrait le plus souvent des
surcouts et une rentabilité très faibles, voire inexistante
(percherons.Economie des entreprises, Masson, Paris, 1985,
pp.76-77)
Plus d'une décennie, l'économie congolaise est
caractérisée par une prévalence d'une crise aigüe qui
a contraint la plupart des petites et moyennes entreprises à mettre la
clé sous le paillasson.
L'instabilité politique, les pillages ainsi que les
différentes guerres d'agression en sont les causes. Cette crise a
conduit à la fragilisation du système financier congolais.
(Rapport de la banque africaine de développement sur le micro
finance 2004, P.9).
Vers les années septante, il a
étédémontré que les petites et moyennes entreprises
sont les vecteurs principaux du développement des nations. Qu'il
s'agisse des pays industrialisés ou des économies
émergentes et en développement, elles constituent les sources
essentielles de la croissance économique, de dynamisme et de
flexibilité de l'économie de ces pays.
3
L'environnement dans lequel évolue ces petites et
moyennes entreprises est devenu très compétitif, et oblige qu'une
attention toute particulière soit accordée à celles-ci
pour leur promotion ainsi que leur épanouissement. Dans cet
environnement instable, les entreprises sont amenées à concevoir
des produits nouveaux ou à modifier ceux existants afin de donner
satisfaction aux attentes et besoins même les plus latents de leurs
clients, et investir dans des nouveaux sites de production afin
d'étendre leurs activités. (Freddy KatengaMenda.
problématique de financement de petites et moyennes entreprises par les
institutions financières en RDC : cas de la ville de Kinshasa.
P.1).
Le secteur des PME doit contribuer à transformer la RDC
d'une région en retard à une région émergente et
prospère.
Les PME sont l'épine dorsale de l'économie.
Elles constituent la plus grande partie du tissu économique et
représentent plus de 90 pour cent de toutes les entreprises. Elles sont
la source la plus importante d'emploi dans tous les secteurs économiques
et dans les zones rurales et urbaines et contribuent à la
réduction des écarts de développement. Elles favorisent un
développement équitable sur une large base et offrent plus de
possibilités pour les femmes et la participation des jeunes dans le
développement économique du pays. Avec la mondialisation, le
secteur des PME est non seulement considéré comme un secteur de
"protection et de promotion», mais, aussi comme une force pour "la
croissance et le développement".
Le secteur des PME, cependant, est confronté en RDC
à un large éventail de défis institutionnel, financiers et
autres parmi lesquels un accès limité aux finances, aux
technologies et aux marchés. S'y ajoutent aussi la question de l'esprit
d'entreprise, et les compétences de gestion au sein des PME. Ces
problèmes sont aggravés par le manque d'information, la
capacité inadéquate de mise en conformité avec les normes
et la certification, et l'absence d'un environnement politique et des affaires
favorable. Quant aux nouvelles tendances de la conduite des affaires, utilisant
les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) avec
des liens en ligne avec la chaîne de valeur ainsi que les
stratégies d'externalisation et de réseautage, les PME en sont
absentes. Tout cela nécessite que les PME et le gouvernement
entreprennent, de façon proactive, le renforcement des capacités
en prenant des mesures pour assurer et soutenir la participation des PME dans
les réseaux d'approvisionnement et affuter leur
compétitivité, leur flexibilité et donc la
durabilité de leurs affaires. (Dominique Séran.
Stratégie nationale des PME)
4
Plusieurs Etats du monde y compris la RDC, connaissent des
problèmes d'ordre économique affectant directement le
déroulement des activités dans d'autres secteurs. Il s'agit
nomment des cas tels que le chômage, allusion faite au social, la
paralysie des activités au niveau du secteur ou du système
éducatif, sécuritaire, etc.
Tout ceci étant perçu comme des
conséquences liées au disfonctionnement du système
économique et financier qui est censé allouer des moyens
nécessaires aux autres secteurs de la vie.
Le Sud-Kivu et plus précisément la ville de
Bukavu notre cible, n'est pas épargnée face à ce
problème étant donné le taux de chômage qui ne fait
que s'accroitre alors que les industries ainsi que les grandes entreprises
devant employer la main d'oeuvre disponible semblent ne plus progresser.
Pour faire face à ce fléau "chômage" et
couvrir ainsi les besoins vitaux et économiques au quotidien, les
citoyens congolais en générale et ceux de la ville de Bukavu en
particulier ont songé depuis un temps pour ceux qui en ont la
possibilité, à entreprendre des activités
économiques quelques petites qu'elles soient, sous forme de production,
de petit commerce ou vente des services en vue de se procurer des revenus leurs
permettant de survivre.D'où la création des entreprises
dénommées ?petites et moyennes
entreprises??PME? en sigle qui aussi
font face à des problèmes généralement financiers
dans l'exercice de leurs activités.
Néanmoins, malgré l'importance de ce genre
d'entreprises, force est de constater que les efforts en terme de financement
des PME n'ont souvent pas donné les résultats escomptés.
Elles ont toujours des difficultés d'accès au financement pouvant
stimuler leur croissance. Les PME en Afrique en général et celles
de la RDC en particulier souffrent d'un accès limité au
financement qui contraint ainsi leur croissance et leur développement
ultérieur. La croissance d'une PME nécessite des ressources,
notamment financières et une gouvernance qui oriente vers la
création de la valeur. Cependant, étant rationnés suite
aux différences d'informations entre les intervenants, les PME adoptent
un comportement de financement axé sur l'autofinancement et la finance
informelle souvent limitée qui ne facilite pas leur croissance suite aux
exigences et le montant souvent non satisfaisant. Cet aspect rend presque
impossible le financement des nouveaux projets et bloquent la mise en place des
nouvelles idées. Le PME de la RD Congo en général et
celles de la ville de Bukavu en particulier ne sont pas exemptées de
cette réalité. Une observation faite sur le
5
fonctionnement de ces entreprises, fait présumer
qu'elles sont confrontées à de nombreux problèmes dont le
problème financier apparait être le plus important.
Se focalisant dans la ville de Bukavu, notre démarche a
pour question suivante: Quel est le mode de financement des PME ? De cette
question principale découle trois autres questions secondaires :
- Quels sont les moyens auxquels recouvrent les PME pour financer
leurs activités ?
- Quelle est la source de financement la plus utilisée
par les PME de la ville de Bukavu ? et pourquoi ?
- Le mode de financement influence-t-il leurs niveaux de
croissance ?
0.1 HYPOTHESES
Nous pensons que avant d'apporter des solutions aux questions
soulevées dans la problématique, nous pensons à priori que
:
? Pour le financement de leurs activités, les PME de la
ville de Bukavu feraient principalement recours à l'épargne
disponible et aux emprunts.
? La source de financement la plus utilisée par les PME de
la ville de Bukavu serait l'autofinancement.
? Le mode de financement influence leurs niveaux de
croissance.
0.2 OBJECTIF DU TRAVAIL
Le présent travail se propose comme objectif global
d'appréhender l'impact du mode de financement sur la croissance des PME
de la ville de Bukavu. Outre cet objectif global, cette étude poursuit
les objectifs spécifiques suivants :
· Identifier les difficultés auxquelles se
heurtent les PME de la ville de Bukavu pour accéder au financement ;
· Identifier la source de financement la plus
utilisée par les PME de la ville de Bukavu ;
· Apprécier la volonté de croître
des PME de la ville de Bukavu. 0.3 CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Nous pouvons situer l'intérêt de l'analyse du
mode de financement des PME de la ville de Bukavu à différent
niveaux :
6
- D'abord, les PME sont des secteurs économiques qui
jouent un rôle primordial dans l'économie, et il s'avère
très important d'étudier les différents modes de
financement de ces dernières ;
- Les banques aussi constituent l'une de financement
disponible pour les entreprises en générale et les PME en
particulier.il est aussi important
à ce niveau de vérifier si le financement par banque est
bénéfique pour cette catégorie d'entreprise. En somme, ce
travail trouve son intérêt en conciliant ces objectifs
contradictoires entre les entreprises qui sont en besoin de financement et
celles qui ont la capacité de financement ou d'octroyer le financement ;
dans le cas d'espèce, les PME qui ont le besoin de financement.
O.4 METHODES ET TECHNIQUES
Il nous a semblé nécessaire de faire recourt aux
méthodes et techniques suivantes :
0. Méthodes
Dans ce travail nous avons retenus les méthodes suivantes
:
- La méthode qualitative : dans
l'approche qualitative, nous allons partir d'une situation concrète
comportant un phénomène particulier que nous ambitionnons de
comprendre et non de démontrer, de prouver ou de contrôler. Nous
avons voulus donner le sens au phénomène à travers ou
au-delà de l'observation (chapitre troisième)
- La méthode statistique : Elle nous
permettra d'analyser et d'interpréter l'ensemble d'observations
relatives aux phénomènes rencontrés sur le terrain. Par
cette méthode, nous avons eu à représenter les
données sous forme des tableaux pour faciliter la compréhension
et l'interprétation.
- La méthode analytique : Elle nous
permettra d'analyser les données ou les informations concernant le mode
de financement et à mieux comprendre tout au long de notre travail, les
données recueillies en des éléments essentiels afin de
saisir les liens et donner ainsi un schéma d'ensemble ou un
résultat eu égard à nos analyses. Elle nous a
également permis de traiter systématiquement toutes les
informations et les données collectées en insistant sur chaque
cas.
- La méthode descriptive :cette
méthode nous sera aussi d'une grande importance dans la description des
PME et des faits économiques dans le temps et dans l'espace eu
égard à la réalité contextuelle de notre
environnement.
7
1. Techniques
- Technique de la documentation : Nousaurons
la prérogative de consulter la documentation nécessaire compte
tenu de la complexifié du sujet que nous avons traité, les
ouvrages spécialisées, les rapports de vérification des
brochures et d'autres documentation écrite.
- Technique d'interview : Elle nous permettra
de collecter les données à travers nos entretiens avec certains
agents et cadres des PME faisant parties de notre échantillon.
- Questionnaire d'enquête : Nous
permettra à adresser un questionnaire d'enquête aux PME pour
chercher à connaitre le mode de financement des PME de la ville de
Bukavu.
0.5 DELIMITATION DU SUJET
Pour bien l'aborder, nous le délimitons du point de vue
temporaire et spatial.
A. Délimitation spatiale : Du point
de vue spatial, notre étude porte sur les PME de la ville de Bukavu,
province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.
RDC-SK-BKV.
B. Délimitation temporaire : Les
différentes analyses fournies dans le cadre de ce travail concernent une
durée maximale de trois ans soit de 2017, 2018, 2019.
0.6 SUBDIVISION DU TRAVAIL
Nous avons structuré notre étude en trois
chapitres à part l'introduction et conclusion :
- Le premier est consacré à la revue de la
littérature théorique et empirique,
- Le second sera consacré à la présentation
du milieu et cadre méthodologique,
- Enfin le troisième chapitre va essayer de parcourir
une analyse empirique des PME à travers l'analyse des données
fournies par les PME de la ville de Bukavu tirées
aléatoirement.
8
CHAP 1 : REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE ET EMPIRIQUE
SECTION I. REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE
Ce chapitre passe en revue différentes théories
relatives à la finance des entreprises dans la première section.
La deuxième section présente une généralité
sur les PME. La troisième section enfin présente la notion sur la
croissance.
I.1. LES MODES DE FINANCEMENT I.1.1. Modes de financement
de l'entreprise
Les problèmes de finance dans une entreprise comportent
des enjeux vitaux. Leur résolution est une condition nécessaire
pour sa survie, ses perspectives d'avenir, ses performances présentes et
futures ainsi que pour l'autonomie de ses propriétaires et de ses
dirigeants. En effet, diversifier les sources de financement permet à
l'entreprise d'accéder aux différents types de services
adaptés à ses besoins spécifiques. Précisons que
toutes les sources de financement auxquelles l'entreprise opte pour financer
ses activités comportent ses exigences particulières.
D'une manière générale, on distingue
trois sources de financement constituées de fonds propres, des dettes et
des modes alternatifs de financement
I.1.1.1. Financement par ressources propres
Les fonds propres peuvent être d'origine interne et/ou
externe. Les ressources internes proviennent des excédents que
l'entreprise engendre durant l'exercice par l'ensemble de son activité.
Les ressources externes correspondent aux ressources qui ont été
effectivement apportés par les actionnaires : ce sont les apports de
créateurs à l'initiation de la société ou les
apports des actionnaires ultérieurs à l'occasion des
augmentations du capital.
· L'autofinancement
Ce sont les fonds que l'entreprise dégage de son
exploitation et qu'elle utilise pour financer ses investissements. Elle
représente la richesse créée par l'entreprise. Par
définition, l'autofinancement est la part de la capacité de
l'autofinancement qui restera à la disposition de l'entreprise pour
être réinvestie. Il constitue de façon
générale le pivot du financement des entreprises et pour
certaines d'entre elles, la source exclusive du financement dans les phases
décisives de leur développement.
9
L'autofinancement est une pratique ou un
procédé de financement qui consiste à affecter au
financement des investissements des ressources puisées dans l'entreprise
ou provenant de la rentabilité ou capacité d'autofinancement.
Celle-ci à l'exclusion de concours extérieurs
appropriés.
- Avantage :
L'autofinancement constitue l'une des ressources de financement
les plus utilisées par les entreprises, son avantage réside dans
le fait que :
· il traduit la capacité ou aptitude de
l'entreprise à assurer la reproduction des capitaux qui lui sont
confiés, il permet seul de constituer un financement indépendant,
stable et capable de secréter des fonds grâce aux quels seront
remboursés les emprunts souscrits.
· Son niveau actuel et son évolution
récente sont parmi les éléments essentiels que les
apporteurs des capitaux externes chercheront à prendre en compte avant
d'accepter de s'engager dans l'entreprise.
Désavantage :
L'autofinancement a des désavantages et des limites qui
sont :
· L'autofinancement donne à l'entreprise une
liberté d'action plus grande puisque elle n'aura pas à subir le
contrôle des créanciers sur sa gestion ;
· L'autofinancement apparaît comme un moyen de
financement gratuit à l'entreprise car elle ne verse pas aucun
intérêt sur les fonds ainsi utilisés.
· L'autofinancement permet de financer la croissance
d'une entreprise qui rencontre des difficultés pour se procurer des
capitaux soit auprès d'éventuels associés (actionnaires
par exemple), soit auprès des divers créanciers
(l'établissement de crédit par exemple).
· L'autofinancement est encouragé par les
pouvoirs publics (dégrèvements fiscaux,...) cette forme de
financement est donc intéressant pour les entreprises.
· Les capitaux engagés par l'autofinancement
peuvent s'avérer insuffisants pour financer l'investissement
projeté ;
· L'apparence gratuite de ce mode de financement peut
biaiser le processus de décision d'investissement, par exemple en
favorisant les investissements somptuaires ou tout au moins des investissements
dont le rendement est insuffisant ;
10
· L'autofinancement diminue les revenus des
associés et peut les conduire à se retirer de l'entreprise.
Notons que l'autofinancement est la source la plus utilisée par les PME
évoluant en RDC en général et à Bukavu, en
particulier, par le fait que le crédit institutionnel reste difficile
à trouver.
· Les ressources propres d'origine
externe
Lors de la création de l'entreprise, les actionnaires,
par leurs apports, vont constituer un capital social ou fonds propres. Les
fonds réunis ne sont pas une sécrétion de
l'activité de l'entreprise. Elles sont de ce fait, d'origine externe
à la société. Il en est de même lorsqu'ils seront
sollicités pour augmenter le capital. Cette augmentation peut se
réaliser par d'autres moyens : aides et subventions, capital-risque et
le rachat de l'entreprise parle salariés.
Signalons que l'augmentation du capital constitue un moyen
essentiel de financement des entreprises qui présentent l'avantage de
permettre une mobilisation des ressources obtenues et sans obligation de
remboursement. Elle peut prendre diverses formes. Chacune d'elles correspondant
à un objectif particulier, il peut s'agir :
· Une augmentation du capital du capital en
numéraire : apport en espèce des associés de l'entreprise
en vue de répondre à un besoin de financement ;
· D'une augmentation en nature : apport d'un meuble ou
immeuble en vue de répondre à un besoin posé par
l'entreprise ;
· D'une augmentation de capital par conversion des
créances ou incorporation des réserves : il s'agit d'un simple
jeu d'écriture qui constitue une dette ou à des
bénéfices, mise en réserve la création d'actions
nouvelles remises soit aux créanciers soit aux actionnaires.
Les instruments classiques de financement peuvent
s'avérer inadéquats pour certaines entreprises, très
innovantes, assez risquées, ou dont le marché potentiel est mal
connu. Dans ce cas, elle préfère recourir à des
sociétés de capital-risque pour assurer leurs besoins en fonds
propres nécessaires pour maintenir et accroître leurs
activités. Ce mode de financement qui fait rage dans toutes les
industries reste encore inconnu en RDC. Cette pratique a permis à la
majorité de PME les plus risquées ou évoluant dans le
secteur mal connu de trouver le financement nécessaire pour leur
projet.
11
I.1.2.2. Financement par crédit
Insuffisance des fonds propres pour les besoins de
financement des entreprises, aussi bien au moment de la création que
lors du développement de celle-ci. Dans ce cas, il faut faire appel
à des ressources de financement externes. Nous distinguons à ce
niveau, les emprunts indivis et les emprunts obligataires.
· Les emprunts indivis
Il s'agit des emprunts contractés auprès des
banques et des établissements financiers spécialisés. Ils
sont dits indivis parce que la dette n'est pas divisible et qu'en outre, la
banque ou l'établissement financier est l'unique interlocuteur de
l'entreprise. En général, ce type d'emprunt est destiné
à un projet particulier, et le financement accordé est
accompagné d'une prise de garantie. C'est pourquoi on parle à ce
propos du crédit objectif. C'est ce type de crédit que les
banques accordent généralement aux PME en RDC.
· Les emprunts obligataires
Contrairement à l'emprunt indivis, l'emprunt
obligataire suppose un nombre très élevé d'interlocuteurs
pour l'entreprise et donc, par conséquent, un émiettement de la
dette.
Une obligation est un titre représentatif d'une dette,
la propriété d'une fraction d'un emprunt émis par une
société, une collectivité publique ou par l'Etat. Ces
titres de créances sont négociables et confèrent les
mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Ce sont en d'autre termes des titres financiers
(appelés obligations) sont émis sur le marché et
proposés à des souscripteurs. Chaque titre représente une
créance sur l'entreprise et est rémunéré par un
revenu appelé intérêt.
Comme on ne peut pas parler de financement par crédit
sans pour autant parler de l'effet de levier, disons que l'effet de levier
consiste à analyser l'accroissement de la rentabilité
financière suite aux recours à l'emprunt. La conception qui a
longtemps prévalue en matière de structure financière est
fondée sur un argument de concept comptable de l'effet de levier
financier. Elle postule l'existence d'un point neutre de rentabilité de
l'entreprise, qui permet de définir d'une part, l'endettement comme
avantage croissant pour l'actionnaire (effet de levier positif) et d'autre
part, l'endettement présente un désavantage croissant
c'est-à-dire quand le taux d'endettement devient tel que cette
compensation ne se produit plus, l'espérance de perte due à
l'effet de levier négatif.
Elle est née de l'article fondamental de F. Modigliani
et Miller (1958) se plaçant dans cadre du marché parfait ont
montré le non pertinence de structure financière.
12
Si ces hypothèses de comportement se confirment dans
la réalité, l'allure du coût moyen pondéré du
capital en fonction du taux d'endettement passe par un minimum au niveau
limité de celui-ci
La valeur de l'entreprise est donc maximale à ce point
qui désigne la structure financière optimale pour la firme.
1.1.2. Choix de financement
On choisit des modes de financement sur le long terme
(financement d'investissement) : emprunt, autofinancement, augmentation du
capital, crédit-bail,...
En choisissant un financement, on cherche à minimiser
le coût global de l'opération, ceci revient à minimiser une
somme de flux de décaissement actualisés (particularité de
certains flux : prise en compte des économies d'impôt
découlant des intérêts,...).
Il existe une très vaste littérature tant
théorique qu'empirique concernant de la répartition des fonds
propres et les dettes appelées la structure financière.
La question de structure financière est l'une des plus
importantes dans le domaine de la finance d'entreprise, et également
l'une de plus complexes à des conclusions controverses
Le choix d'une structure financière est une
décision majeure car elle affecte :
· Le taux de rentabilité offert aux actionnaires
et sa sensibilité à l'évolution de la conjoncture ;
· Le risque de faillite de la firme ;
· Le risque pour les créanciers ;
· Le risque pour les dirigeants susceptibles de perdre
leur poste en de défaillance.
La problématique de la structure financière des
entreprises connaît trois approches majeures : l'approche classique,
l'approche néoclassique et l'approche moderne de la firme.
? Approche néoclassique ou Position de
neutralité
La "théorie moderne de la finance" naît au
milieu des années 70, a été proposé pour
relâcher des hypothèses de modèle de Modigliani et
Miller.
13
Cette théorie repose sur le fait que la valeur d'une
entreprise est fondamentalement liée à sa capacité
bénéficiaire et la structure financière n'a aucune
incidence sur la valeur de la firme. La structure choisie par l'entreprise ne
peut pas modifier sa valeur. Peu importe la façon dont cette structure
est partagée entre la dette, les capitaux propres et autres titres de
créances, la valeur de placement se maintient. Les investissements sont
capables de substituer un endettement de l'entreprise et de produire ainsi
toute structure que la firme pourrait vouloir atteindre.
Par conséquent, les changements dans la structure
financière sont une chose sans valeur selon Modigliani et Miller dans un
marché parfait.
De 1963-1966, ils présentent une extension à
leurs propositions initiales et tiennent compte de l'impôt qui touche les
résultats des entreprises. Ils ont été très proches
de la réalité lorsqu'ils introduisent dans leur modèle
révisé la variable fiscalité. Dans cette étape la
valeur de l'entreprise devient une fonction croissante de son niveau
d'endettement. Par ailleurs, on suppose également que les coûts de
faillite ne sont pas nuls au fur et à mesure que le taux d'endettement
augmente ; la probabilité que celle-ci éprouve des
difficultés augmente aussi surtout lorsque l'entreprise est en
présence d'une conjoncture défavorable.
En tenant compte de coût de faillite, on comprend que
dans un premier temps la valeur de l'entreprise augmente avec son endettement
en raison d'économie d'impôt réalisé sur les frais
financiers. Puis le risque de faillite s'aggrave et le coût de faillite
annule l'avantage fiscal des emprunts.
Les théories classiques et l'approche de Modigliani et
Miller qui traitent de la structure financière ne permettent pas de bien
saisir et expliquer le comportement de l'entreprise au niveau du choix de
financement tel qu'il est observé réellement, ni de comprendre et
d'appréhender les nouveaux modes de financement de plus en plus
complexes qui ne cessent de se développer et qui peuvent répondre
à des nouvelles préoccupations des entreprises.
Cela étant dit, plusieurs auteurs ont mis en cause ces
théories pour expliquer le comportement financier des firmes.
· L'approche moderne de la finance
14
Les principaux courants qui apparaissent à ce stade
dans la littérature scientifique et qui envisagent explicitement la
problématique du choix d'une structure financière sont, d'une
part, deux qui semblent en concurrence ; la théorie de Trade off et la
théorie de peckingorder et d'autre part, une troisième
théorie suggère de prendre en compte les insuffisances de ces
deux précédentes : la théorie de market timing.
· Les theories de static Trade-off et Pecking
order
La prise en compte de la fiscalité, du risque et des
conflits d'intérêts entre les différents agents participant
à la vie de l'entreprise a donné lieu à deux analyses
distinctes de la structure de capital de l'entreprise, les modèles de
« statictrade off » et ceux de « peckingorder ».
· La théorie de static
Trade-Off
Le premier modèle, dont le cheminement
théorique s'inspire de celui décrit ci-dessus, est un
raisonnement « par compromis ». Ce modèle repose sur un
principe méthodologique classique dans le raisonnement économique
: la maximisation sous contraintes. En supposant qu'il existe implicitement une
répartition optimale entre dettes et fonds propres, le raisonnement
marginaliste permet d'ajuster la structure financière en fonction des
avantages et des coûts des fonds propres et de l'endettement. Non
figée, la structure financière est donc ajustée pour
atteindre l'optimum. Ainsi, une entreprise désireuse de maximiser sa
valeur égalisera les coûts et les bénéfices de
l'endettement en opérant à la marge. Cette théorie se
transforme en hypothèse empirique assez simplement, puisque supposant
l'existence d'un ratio de dette sur fonds propres optimal. Elle prédit
un « retour » du ratio observé vers un ratio cible ou optimal.
Ce ratio optimal étant défini en fonction des
caractéristiques propres à l'entreprise en déficit de
financement ou estimé comme la moyenne observée sur une
période souvent fixée à la période
d'échantillon.
I.2. LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Selon la charte des petites et moyennes entreprises et de
l'artisanat du 24 Août 2000, on entend par PME en R.D Congo, toute
unité économique dont la propriété revient à
une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui représentent les
caractéristiques suivantes :
- Nombre des emplois permanents de 1 (un) à 200 (deux
cents) personnes par an ;
- Chiffre d'affaires hors taxes compris entre 1 (un) et 400 000
USA (Quatre cents mille) ;
- Valeur des investissements nécessaires mis en place
pour les activités de l'entreprise
inférieure ou égale à 350 000 USA trois
cent cinquante mille) ;
- Mode de gestion concentrée ;
15
Dans ce travail, nous avons considéré comme
PME, toute entreprise reprenant ces caractéristiques.
Ces différentes caractéristiques nous ont servi
de base pour l'identification des PME aussi la constitution de notre
échantillon. Les informations sur les chiffres d'affaires, le
résultat, le capital d'exploitation, les charges et produits, bref les
états financiers n'ont pas été livrés par les
gestionnaires, nous nous sommes contentés des données presque
théoriques mise à notre disposition à partir du
questionnaire d'enquête. Nous nous sommes également servis de la
base de données de la division des petites et moyennes entreprises et
artisanat.
La division des PME, dans son répertoire de Mai
2017(inédit), recense 506 PME réparties en différents
secteurs tel que repris dans le tableau suivant :
Tableau N° 1 : Statistique des PME
Tableau1 : regroupement des PME du Sud-Kivu et leur
secteur d'activité
Numéro
|
Secteurd'activité
|
effectifs
|
1
|
Commerce general
|
1010
|
2
|
Boulangerie
|
22
|
3
|
Agence voyage et transport
|
51
|
4
|
Hôtel, bars, et cafeteria
|
187
|
5
|
Pharmacie, dispensaire, écoleprivée
|
192
|
6
|
Savonnerie
|
70
|
7
|
Garage et atelier
|
81
|
8
|
Comptoirminier et artisanat
|
252
|
9
|
Restaurant et similaire
|
145
|
10
|
Groupe d'acteur de micro-finance du Sud-Kivu
|
133
|
11
|
Secteuragricole
|
40
|
12
|
Centre d'hébergement
|
18
|
13
|
Association
|
19
|
14
|
Cyber café et internet
|
24
|
15
|
Bibliothèque
|
3
|
TOTAL
|
2247
|
|
Tableau 1regroupement des PME du Sud-Kivu et leur secteur
d'activité
Source : division de l'IPMEA, rapport 2017
16
I.2.1. Caractéristiques des PME
· La gestion est confiée à une seule
personne, responsable qui est à la fois chef et propriétaire de
l'entreprise ;
· Le patrimoine de l'entreprise n'est pas distinct de
celui de l'exploitant ;
· Absence de comptabilité ou la tenue d'une
comptabilité élémentaire.
· Contact personnel étroit ;
· Difficulté d'obtenir le capital et le
crédit ;
I.2.2. Les critères qualitatifs de
définition des PME
Pour définir la PME, aucun critère ne saurait
avoir une valeur absolue. En fait, la PME paraît se caractériser
davantage par des critères qualitatifs. Les critères de fonds
peuvent être selon nous être ramenés à trois : la
responsabilité, la propriété de la recherche d'un objectif
de richesse particulier, la centralisation de la structure.
y' La responsabilité : il s'agit de
la responsabilité directe, personnelle et finale du patron qui
apparaît en définitif bien souvent comme seul décideur. La
propriété du patrimoine social est le fait d'un homme ou de sa
famille quelle que soit la forme juridique adoptée, ce qui se traduit le
plus souvent par une confusion de patrimoine. Une structure centralisée
: le système décisionnel de la PME est fortement
centralisé, même si l'organigramme peut donner l'apparence d'une
relative délégation d'autorité. Il est vrai que la
distinction propriétaire-dirigeant n'existe pas. Dans plus de 80% de
cas, l'autorité réelle est détenue par le ou les
propriétaires, phénomène qui tient à l'origine
familiale.
y' Les critères quantitatifs de
définition des PME
Ils reposent sur trois éléments suivants :
· Le nombre d'employés qui conduit par exemple
à considérer en Union Européenne : la TPE ou micro
entreprise dont l'effectif est au plus ou égal à 10
employés, la PE dont l'effectif est compris entre 10 et 100
employés, et ME comprenant au plus 250 employés.
· Le chiffre d'affaires qui, dans le cas
précédent doit être inférieur à 40 million
d'Euros.
· Le total bilan selon la même base doit
être inférieur à 27 million d'Euros.
17
I.3. LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
Dans le monde des affaires, le concept de croissance est un
concept très répondu qui fait partie du vocabulaire de tout
gestionnaire. Il évoque le succès, la performance, la
rentabilité, la réussite financière. Lorsqu'une entreprise
fixe ses objectifs, indéniablement on parlera de croissance des ventes,
croissance de la part de marché, croissance des profits, des actifs, des
effectifs...etc.; pour plusieurs dirigeants, la croissance devient presque une
fin en soi , dans la mesure où on l'associe généralement
à la réussite. Très souvent, la notion de croissance
d'entreprise sous-entend l'internationalisation, une augmentation des
résultats en termes de : chiffre d'affaires, de résultat net, de
volume de production, etc., alors qu'elle peut concerner l'augmentation de ses
moyens de production (capital et travail) ou /et de ses résultats.
BIENAYME A., définit la croissance de l'entreprise
« comme un phénomène dont le caractère
multidimensionnel découle des critères retenus pour en mesurer la
taille »(BIENAYME A.: « la croissance des entreprises »,
analyse dynamique des fonctions de la firme, ed, bordas, 1973, p14)
La croissance de l'entreprise correspond à
l'augmentation de la taille de celle-ci dans le temps(NEGRE C. « la
croissance de l'entreprise », cahier français, n° 234,
janv-fev, 1988, p21-25) Le concept de taille est difficile à cerner
pour les entreprises du fait que sa mesure dépend du critère
choisi (volume de production, chiffre d'affaire, effectif, moyens
matériels, etc.).
Les indicateurs de taille sont de deux natures: ceux qui se
réfèrent aux facteurs de production (inputs), ce sont les moyens
nécessaires à la production d'un bien ou d'un service et ceux se
référant aux résultats de l'entreprise. Cette façon
de définir la croissance de l'entreprise (selon la taille) n'explique
pas d'une manière précise le type de processus d'augmentation
concerné : ses moyens de production, ses résultats ou les deux en
même temps (puisque l'augmentation peut concerner les deux notions). Il
est vrai que, d'une manière générale, l'entreprise
familiale serait réticente à la croissance. Habituellement,
néanmoins, la croissance est l'un des objectifs primordiaux que poursuit
l'entreprise. Toutefois, elle nécessite une prise de risque importante
par des dépenses ou des investissements supplémentaires dont les
retours ne sont pas certains. Or, comme le soulignent Donckels et Frohlich
(1991), le dirigeant de la PME préfère un revenu constant et
certain à un revenu plus élevé mais forcément plus
incertain.
? Sur certains marchés, il existe une
taille minimale appelée taille critique. Elle est
variable selon les domaines d'activité. L'entreprise doit l'atteindre si
elle veut rester compétitive.
18
La croissance nécessite par ailleurs, en cas
d'insuffisance des fonds personnels et de l'autofinancement, le recours
à des parties externes telles que les banques, les organismes de
capital-risque ou bien les partenaires de l'entreprise. Cette intervention
extérieure touche à un pilier de la philosophie de la famille
contrôlant l'entreprise : le principe d'indépendance, parfois
consacré en religion de l'entreprise, pourrait être violé.
Aussi, les entreprises familiales, et surtout celles de taille moyenne, ne
rechercheraient-elles pas la croissance de crainte de ses retombées
négatives.
Surtout quand les conditions environnementales garantissent la
stabilité et la prévisibilité et assurent une
rentabilité suffisante, il semble que la PME en général ne
serait pas attirée par l'option de croissance.
La croissance est l'accroissement de
la taille de l'entreprise. Elle se traduit par une augmentation de ses
dimensions, par exemple de son chiffre d'affaires. Cette augmentation
quantitative s'accompagne d'une évolution qualitative (au niveau des
structures, de l'organisation...).
Cette croissance, l'entreprise peut l'opérer seule,
c'est la croissance interne, ou s'associer avec d'autres,
c'est la croissance externe.
A. La nature de la croissance
L'entreprise peut grandir de 3 manières
différentes :
? par croissance horizontale
L'entreprise développe des activités
situées au même stade de production. Cette croissance permet de
gagner des parts de marché. C'est la plus fréquente car elle
n'oblige pas l'entreprise à changer de domaine technologique.
? par croissance verticale
L'entreprise développe des activités
complémentaires ou s'oriente vers l'amont pour contrôler ses
fournisseurs ou vers l'aval pour intégrer ses clients
B. Les raisons de la croissance
Il existe de multiples raisons à une stratégie de
croissance liées aux avantages de la dimension :
19
? La taille permet de réduire les coûts. Les
économies d'échelle obtenues avec l'augmentation
des quantités produites et vendues rendent les produits plus
compétitifs et permettent de meilleures marges.
? De manière générale, la taille
confère un pouvoir plus important sur l'environnement,
facilite les rapports avec les partenaires, clients, fournisseurs,
banquiers...
? Une entreprise d'une taille importante possède des
moyens financiers et matériels qui lui permettent d'améliorer la
qualité de son travail : recherche - marketing - formation...
Partant des types de croissance nous en distinguons deux : la
croissance interne et la croissance externe.
SECTION II. REVUE DE LA LITTERATURE EMPIRIQUE
Personne ne peut se prévaloir le droit
d'exclusivité scientifique d'autant plus que la notion de monopole est
inexistante dans ce domaine.
Ainsi, les oeuvres des chercheurs suivants ont attiré
notre attention :
1. SIFA MUBOLWA Rosette (SIFA MUBOLWA Rosette, La politique
de financement et son incidence sur la performance financière d'une
entreprise. Cas de GINKI 20082012, Mémoire, Inédit, FSEG,
UOB, 2013-2014) cherchant à évaluer l'incidence de la politique
de financement sur la performance financière part des questions
suivantes : - Quelle est la structure financière de GINKI ?
- Cette structure permet-elle à l'entreprise de maximiser
sa valeur ?
En guise d'hypothèses, elle a estimé qu'il
existe une structure financière optimale au sein de GINKI qui
maximiserait la création de la valeur étant donné que
l'entreprise recourt à la combinaison de financement : financement
interne et financement externe surtout lorsqu'il y a l'insuffisance de la
couverture des dépenses par les recettes d'exploitation.
Pour tester ses hypothèses, elle a fait recours aux
méthodes statistiques, analytique appuyées par les techniques
documentaire et d'interview.
Selon ses résultats, la politique de financement a un
impact à la fois positif et négatif vu l'évolution de
l'EVA au sein de GINKI pendant la période allant de 2008 à 2012.
Ainsi, pour une période de 5 ans considérée, l'EVA de deux
premières années soit 2008 et 2009 est positive, ce qui prouve
que pour cette période la rentabilité des capitaux investis est
supérieure au coût moyen pondéré du capital. Son
rapprochement par rapport à notre travail est que tous nous
20
parlons de financement des PME. Toutefois, pendant que ce
travail se penche sur l'analyse de mode de financement des PME de la ville de
Bukavu, l'auteur précédent cherche à identifier la
conséquence de la politique de financement sur la performance
financière de la société GINKI.
2. Bilenge KISULU Jean Pierre analysant l'impact de
décision de financement sur la croissance des PME de la ville de Bukavu,
est parti d'une problématique consistant à savoir s'il existe des
facteurs déterminant les décisions de financement des PME de la
ville de Bukavu et comprendre le type d'effets que ce financement dispose sur
les indicateurs de la croissance de ces PME. Après vérification
de ses hypothèses, il est arrivé aux résultats selon
lesquels le système financier de notre pays et le niveau de
l'entrepreneuriat, le choix de financement sont déterminés par la
volonté de conserver la propriété de son entreprise.
Enfin, chaque mode de financement influencerait positivement
ou négativement la croissance des PME estime-t-il.
Pour vérifier ses hypothèses, il a fait recours
de la méthode statistique et analytique appuyées par des
techniques documentaire, d'entretien et du questionnaire ; ce qui lui a conduit
aux résultats ci-dessous :
· Par le modèle de régression mis en place
au seuil de 5%, les variables croissance, rentabilité et la durée
ont été statistiquement significatives avec un effet positif sur
le recours aux fonds propres ;
· les variables coût de financement et la
tangibilité des actifs sont également significatives, mais avec
un effet négatif sur la variable expliquée ;
· la variation positive des fonds propres entraîne
une variation positive des richesses de l'entreprise, mais avec un niveau
faible et inversement pour une variation négative ;
· pour les fonds empruntés, une variation
positive des dettes induit une diminution du total du bilan les années
précédentes avec une faible proportion ;
· enfin, il existe une relation positive entre la
rentabilité et les fonds propres. Vu les résultats de son
travail, toutes ses hypothèses ont été
confirmées.
Par rapport à notre travail, le
prédécesseur s'attèle à identifier les
conséquences de différentes variables de financement sur la
croissance des PME pendant que nous analysons le mode de financement sur la
croissance des PME de la ville de Bukavu.
21
3. Jean Louis KAYUMBA MUZALIWA voulant mettre à la
disposition des investisseurs potentiels et ceux déjà en
activité, des éléments qui déterminent leurs
décisions stratégiques à travers les variables expliquant
l'investissement dans tel ou tel autre secteur d'activité ; montrer aux
décideurs économiques tant régionaux que nationaux le
bien-fondé de l'investissement dans l'économie.
Selon l'auteur, à Bukavu, la décision des
entreprises est fonction des variables telles que le niveau de
rentabilité du secteur, le taux d'intérêt, le niveau de la
demande et les prix des biens et des facteurs sur le marché, le niveau
des secteurs, la détention du stock de capital, ...
Il confirme que le niveau d'investissement à Bukavu
est expliqué positivement ou négativement par les variations de
la demande et les prix des biens, des services et des facteurs de
production.
· Le point de démarcation entre son travail et le
nôtre est que cet auteur s'est borné à analyser
l'investissement qui est évidemment l'un des aspects d'aide à la
décision stratégique des entreprises de manière
générale. Après avoir observé les
réalités des PME et leur mode de fonctionnement, l'auteur a
estimé que la gestion de ces entreprises devrait être
poussée plus loin pour y apporter des améliorations. Il avait
tenté de porter sa réflexion aux différentes
interrogations sur les voies et moyens pouvant permettre aux PME
d'opérer un choix optimal de leurs finances et améliorer leur
performance financière, alors que dans ce travail, nous voulons
apprécier le mode de financement qui convient le mieux pour les PME de
la ville de Bukavu.
4. Samuel MUDOGO MAGABE voulant savoir les différents
moyens auxquels recourent les PME de Bukavu, déterminer les
problèmes, les contraintes liées à ces moyens de
financement et le cas échéant, proposer les pistes des
solutions.
Pour mener à bon port sa recherche, il s'est servi des
méthodes analytique, statistique et descriptive, doublées des
techniques à savoir la technique documentaire, d'interview et
d'échantillonnage. Ainsi, il est arrivé aux résultats
selon lesquels les PME de la ville de Bukavu font recours à plusieurs
sources de financement notamment les fonds propres, les emprunts aux
institutions financières, aux amies et membres de la famille, au FPI
pour celles du secteur industriel. Les PME se heurtent à des
difficultés liées notamment à l'insuffisance des fonds
propres, le taux d'intérêt, les échéances, manque de
garantie exigée par des institutions financières, la
fiscalité qui réduit ainsi leur chiffre d'affaires et
bénéfice,...
Il propose à l'Etat de mettre en place des politiques
économiques pouvant bien permettre de financer les PME ; et aux
entrepreneurs de fournir des informations fiables reflétant la
réalité de leurs entreprises.
22
Son travail se rapproche au nôtre en ce sens que nous
parlons tous de financement des PME, cependant alors que nous
développons ensemble la politique de financement des PME, nous nous en
déterminerons lesquelles conviennent pour les PME de Bukavu.
De façon générale, les travaux de nos
différents prédécesseurs ont abordé d'une
manière ou d'une autre les conséquences d'une politique de
financement sur la performance financière ou sur la croissance des PME,
l'impact de mode de financement sur la croissance des PME de la ville de
Bukavu.
CONCLUSION PARTIELLE
Nous constatons qu'à travers les travaux de nos
prédécesseurs, SIFA MUBOLWA avait parlé de la politique de
financement et son incidence sur la performance financière d'une
entreprise. Cas de GINKI 2008-2012 avait trouvé les résultats
selon les quels, la politique de financement a un impact à la fois
positif et négatif vu l'évolution de l'EVA au sein de GINKI
pendant la période allant de 2018-2012.
KISULU Bilenge Jean pierre avait analysé l'impact de
décision de financement sur la croissance des PME de la ville de Bukavu.
Il avait trouvé les résultats selon lesquels les variables couts
de financement et la tangibilité des actifs sont également
significatives, mais avec un effet négatif sur la variable
expliquée ; il trouva aussi que la variable positive de fonds propres
entraine une variation positive des richesses de l'entreprise, mais avec un
niveau faible et inversement pour une variation négative.
KAYUMBA MUZALIWA voulant mettre à la disposition des
investisseurs potentiels et ceux déjà en activité, des
éléments qui déterminent leurs décisions
stratégiques à travers les variables expliquant l'investissement
dans tel ou tel autre secteur d'activité ; montrer aux décideurs
économiques tant régionaux que nationaux le bien-fondé de
l'investissement dans l'économie.
Après avoir observé les réalités
des PME et leur mode de fonctionnement, l'auteur a estimé que la gestion
de ces entreprises devrait être poussée plus loin pour y apporter
des améliorations. Il avait tenté de porter sa réflexion
aux différentes interrogations sur les voies et moyens pouvant permettre
aux PME d'opérer un choix optimal de leurs finances et leur performance
financière, alors que dans ce travail, nous voulons apprécier le
mode de financement qui convient le mieux pour les PME de la ville de
Bukavu.
23
CHAPITRE 2 PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE ET
APPROCHE
METHODOLOGIQUE
1. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE
1.1 Bref aperçu sur la ville de Bukavu
La ville de Bukavu est le chef-lieu de la province du Sud-Kivu
en République Démocratique du Congo. Elle se situe à
l'extrême sud-ouest du lac Kivu. Elle s'étend sur 2° 2' au
3° 23' de latitude sud et du 28° 53' de longitude est avec une
superficie de 44,90 Km2. Elle est administrativement
subdivisée en trois communes :
? La commune de Kadutu
? La commune de Bagira
? La commune d'Ibanda
Son niveau d'altitude est de 1200 à 1500 à
partir du niveau de la mer, c'est une ville à mi-chemin entre Nord et
sud de la région des grands lacs africains. Cette disposition
géographique prédispose la ville à jouer un rôle de
point de passage obligé des produits importés et de carrefour
d'échange et de communication entre le nord et le sud de la
région. Cette ville est essentiellement commerciale, touristique,
industrielle, intellectuelle et religieuse, elle est la plus importante ville
de la province. Sa population qui environne un million d'habitants connait un
taux élevé d'exode rural à cause principalement des
troubles politiques présentes dans la province depuis 1996.
1.11. Population
En 2012, la population de Bukavu est estimée à
806.940 habitants avec une densité de 13,449 habitants par
km2, cette population est essentiellement constituée des
Bashi, des Barega suivis des Bafuliru, Bahavu, Babembe, Bavira, pygmées,
etc. Selon les services de la mairie et de l'Etat civil il a été
constaté que chaque mois la population en ville ne cesse d'augmenter,
ceci dû à l'exode rural très fréquent, les
populations des villages et celles des territoires de la province
préfèrent venir vivre en ville, cela entraine diverses
conséquences : prostitution, le phénomène « enfants
de la rue », le banditisme, le vol (qui est d'actualité dans la
ville) et autres conséquences désastreuses voire même
destructrices de l'exode rural.
24
Tableau 2 : Répartition de la population de Bukavu
par commune
|
KADUTU
|
IBANDA
|
BAGIRA
|
|
GA
|
H
|
F
|
GA
|
H
|
F
|
GA
|
H
|
F
|
|
[0-18[
|
53047
|
54593
|
[0-18[
|
66211
|
79771
|
[0-18[
|
47558
|
49552
|
|
[18-65[
|
28776
|
29597
|
[18-65[
|
28883
|
36506
|
[18-65[
|
20777
|
41970
|
|
[65-100[
|
7924
|
7558
|
[65-100[
|
6152
|
7514
|
[65-100[
|
5789
|
7412
|
|
89747
|
91748
|
|
101246
|
123871
|
|
74124
|
98934
|
|
TOTAL
|
181495
|
225117
|
|
|
173058
|
Tableau 2Répartition de la population de Bukavu par
commune
Source : Mairie de Bukavu
GA= groupe d'âge, H=
homme, F= femme.
A partir de ce tableau, nous remarquons que dans toutes les
communes il y a plus de femmes que d'hommes et donc par conséquence le
nombre d'individus enquêtés y sera grand.
1.1.2 Situation économique
La ville de Bukavu constitue un centre important
d'activités commerciales et artisanales à l'Est de la RDC
à cause de son positionnement géographique qui l'ouvre sur
plusieurs marchés, mais malheureusement sa structure économique
est délabrée comme cela en est la situation de la nation
entière.
Du point de vue économique elle se subdivise en trois
secteurs : secteur primaire, secteur secondaire et le secteur tertiaire qui
à leur tour peuvent se retrouver soit dans le secteur formel ou
informel.
? Au niveau de secteur primaire
On compte la pêche, l'élevage, l'agriculture,
l'extraction minière, les traitements des produits agricoles.
L'élevage, pêche et agriculture comme les activités qui se
développement partout et de manière paysanne dans la ville de
Bukavu à telle enseigne que la ville de Bukavu se ruralise. On constate
néanmoins la présence des divers groupes de sensibilisations pour
améliorer l'agriculture dans les villages qui jusque-là leurs
résultats sont presque non remarquables.
25
? Au niveau du secteur secondaire
Ce secteur transforme les matières premières
extraites du sol et du sol pour en faire des produits industriels. Il comporte
l'industrie alimentaire, textile, chimique, les fabricants mécaniques,
des constructions, le service distribution d'eau et électrique et
d'autre diverses industries.
a) Industries pharmaceutiques
- Pharmacie diocésaine (BDOM-DIOPHAR) :
implantée sur la colline de Bugabo dans la commune de Kadutu et qui se
spécialise dans la production des divers types de médicament
solides (comprimés, semi solide (des paumes) et liquide (suspension,
sirops et émulsions)
- Pharmakina : société privée à
responsabilité limitée, spécialisée dans la
production de la Quinine d'autres sous-produits de la quinine et le traitement
de la totoquina. Elle est située sur l'avenue P.E Lumumba à 4Km
du centre-ville.
b) Industrie d'Electricité et eau
- SNEL : se charge de la production et distribution du courant
électrique
- REGIDESO : Société jouissant d'un monopole
national de la production et de la distribution de l'eau potable.
c) Industries alimentaires
Nous avons des boulangeries, des minoteries, des boucheries,
des brasseries, etc. Pour le cas des boulangeries, on peut citer 2 types de
production à Bukavu : production artisanale et semi industrielle.
d) Industries de production d'autres types des
biens
Nous avons les entreprises comme GINKI S.P.R.L.
spécialisée dans la production des matelas, GPI S.A.R.L, etc.
? Au niveau du secteur tertiaire
Ce secteur est aussi appelé secteur de service, il
compte à son tour le commerce, le transport, les compagnies
d'assurances, les professions libérales, les hôtels et restaurants
etc. les services publics : administration, service sanitaire, information,
poste et télécommunication.
A côté de tout ceci on retrouve des ONG locales
et internationales qui donnent des emplois à la population mais aussi
des sociétés commerciales. On constate que le secteur informel
est plus pratiqué que le secteur formel.
26
Le commerce est pratiqué en majorité par les
femmes et les hommes en minorité en ce sens que ce sont les femmes qui
se démènent plus pour assurer la subsistance de leurs
ménages. Les hommes sont à la tête des grandes affaires et
les femmes pratiquent plus généralement le petit commerce. La
promotion des PME s'impose dans la ville et devient d'actualité dans la
province en général et dans la ville en particulier, le pouvoir
public ne pouvant pas réaliser ses promesses vis-à-vis de la
population, encourage l'initiative privée. Ainsi le commerce est
pratiqué par diverses personnes mais tous en général le
font pour satisfaire les besoins vitaux. La crise économique, le
chômage et la précarité des salaires font que tout le monde
crée sa propre affaire, on remarque ainsi la présence des PME
informelles.
La création de toutes ces PME montre la vitalité
de la population et sa capacité de s'adapter aux nouvelles situations
car nombreux pratiquent cette activité pour leur moyen de subsistance,
cette situation favorise l'esprit de l'initiative privée dans la
mémoire des populations et résout certaines difficultés de
pauvreté, crée l'intégration économique et la
consolidation des classes moyennes et la création des petits emplois.
Etant donné que ce type d'entreprises favorise le
développement économique rapide, ces PME devraient payer
l'impôt et les différentes taxes leur imposé par l'Etat
1.2 Cadre contextuel des PME en ROC
Au niveau général, les PME sont une «
épine dorsale » pour l'économie mondiale, et en particulier
en RDC où elles sont l'un des principaux moteurs de l'innovation, de la
création des richesses et de l'emploi ainsi que l'intégration
sociale (S. ABOLE, 2016).
En réalité, suite à une série des
guerres, des crises et des tumultes a fait place dans le pays et a
créé des situations de chômage défiant toute logique
et amenant ainsi les agents économiques (surtout les jeunes) à
des situations de manque d'activité, c'est ainsi que nombreux se
réfugient dans la pratique et l'ouverture des petites affaires
appelées « micros et petites entreprises » qui souvent
fonctionnent sans structure traduisant ainsi le secteur informel.
Ainsi en tenant compte de cette influence qu'ont les PME sur
l'économie congolaise, le gouvernement avait mis en place des
institutions chargées de suivre de près la question liée
aux PME. Il s'agit notamment de la division provinciale des PME et l'office de
promotion des petites et moyennes entreprises du Congo (OPEC), qui ont pour
fonction :
- D'une part la division provinciale devrait se charger
d'identifier, de recenser, former, informer les PME et leur doter des documents
nécessaires pour leur fonctionnement ;
- D'autre part, l'OPEC doit quant à lui :
? Défendre les intérêts
des membres (PME)
27
? Les accompagner et les appuyer dans leurs transactions
? Faciliter les PME l'accès au financement à
travers des bureaux de micro crédit ? Aider les PME à quitter
l'informel vers le formel
? Encourager les investissements nouveaux.
1.3Présentation des PME de la ville de Bukavu
1.3.1 L'importance des PME dans l'économie
Les PME sont des acteurs majeurs du tissu productif d'un pays,
à plus d'un titre.
A. Rôle de la PME
Les PME contribuent à l'intégration
économique, l'augmentation de la consommation des ressources locales, la
création de richesse, l'intégration industrielle, l'innovation
technologique, la contribution à la centralisation et la
régionalisation de l'économie et de l'industrie (M. Ekwa, 2004)
:
- En dynamique, les PME sont responsables de la grande
majorité des créations d'emplois sur le long terme. Elles sont
bien les entreprises qui créent massivement les emplois, même si
cela ne se voit pas immédiatement dans les statistiques du fait des
franchissements de seuils (une entreprise de moins de250 salariés qui
grandit franchira le seuil de 250 salariés, et donc ne sera plus
considérée comme une PME) ;
- Surtout, au-delà de leur rôle dans la
création directe d'emplois, les PME contribuent fortement à la
croissance par le processus de remplacement d'entreprises en place par de
nouvelles entrantes, plus efficaces et porteuses d'innovations.
- Contribution à l'intégration économique
: la PME se prête mieux à ce rôle car elle exerce des effets
d'entrainement, c'est-à-dire qu'elle contribue à la valorisation
des ressources internes par la création d'autres activités de
base tel que le développement de l'agriculture, l'intégration du
secteur artisanal, pour une entreprise manufacturière, le
développement du secteur tertiaire.
- Création des foyers de richesse :
l'existence ou la promotion de PME constitue pour l'Etat une source
importante de mobilisation des recettes publiques par le biais de la
fiscalité. Par des achats des matières premières et de
versement des salaires, elles distribuent des revenus.
- L'intégration industrielle et innovation
technologique : les PME/PMI contribuent au sort de l'industrie
et de l'innovation technologique. Elles occupent une place
prépondérante dans la fabrication des pièces et des
composantes pour les grandes entreprises en raison de la
28
spécialisation de leur compétence et de leur
coût de production. Au total, les PME contribuent de façon
essentielle à la croissance et à l'emploi. Les PME d'aujourd'hui
feront les grands groupes de demain.
B. Les atouts et faiblesses des PME congolaises
Ici, nous présentons les points faibles et les atouts
que présentent les PME en RDC tels que repris par Mukadi Ilunga J.
(2006.) cité par Mushagalusa R(2013).
1. Atouts
? La souplesse ou la flexibilité : il est vrai que
pendant les périodes traversées après le pillage du 1991
et 1993, c'est grâce à la PME qui par sa facilité
d'adaptation au changement de l'environnement, a pu soutenir l'économie
congolaise en répondant aux besoins de la population
? Le dynamisme : dans le plan de la relance économique
; le dynamique dans les dirigeants des PME font montrer de plus multiplient les
efforts pour les surmonter et maintenir les activités ;
? La facilité d'implantation : la PME manifeste une
grande facilité à s'installer, ce qui justifie leur
dissémination à travers le territoire national, fait qui devrait
être pris en compte dans le plan de la relance économique ;
Faible investissement : pour leur implantation les PME
n'exigent pas nécessairement de gros investissements. Les niveaux
hiérarchiques étant souvent très réduits, les
processus de décisions sont plus rapides pour régler les
problèmes liés à l'activité. L'information circule
également de manière plus efficace même si elle revêt
un caractère informel.
2. Faiblesses
Problèmes économiques liés à la
petite taille
? Difficulté à atteindre la taille critique et
à réaliser des économies d'échelle ;
? Faiblesse du budget de recherche et développement ;
? Faible capacité d'exportation
? La taille de la PME est aussi un handicap. En effet, la PME est
vulnérable de par son
domaine d'activité. Si la PME est mono-produit, une chute
de la demande entraînera une baisse
des revenus que la PME ne pourra pas compenser par un autre
produit.
? Problèmes de recrutement du personnel : Il y a souvent
pénurie de la main d'oeuvre
qualifiée, un problème de formation.
29
? Problèmes de gestion : Les patrons
propriétaires ont des compétences techniques mais pas toujours
économiques ou financières. Les méthodes de gestion,
d'accès aux informations sur l'environnement, sont souvent plus modestes
fautes de moyens.
? La carence administrative: beaucoup des PME appartiennent au
secteur dit informel, elles n'ont ni registre de commerce, ni d'adresse
fixe.
Les problèmes financiers :
? Financement difficile (capacité d'autofinancement
plus faible, avec un accès limité aux marchés financiers,
coûts plus élevés du crédit bancaire).
? La petite taille conduit à des conditions de
crédit désavantageuses par manque de confiance de la part des
banques.
II.2 METHOLOGIE DE L'ETUDE
Cette partie se concentre sur l'ensemble des méthodes,
procédés et techniques utilisés pour atteindre les
objectifs de notre recherche. Ainsi, nous préciserons les
différentes approches qui ont guidé notre travail et nous ont en
effet aidé d'atteindre nos résultats.
A) METHODES
Dans ce travail nous avons retenus les méthodes
suivantes :
- La méthode qualitative :dans
l'approche qualitative, nous allons partir d'une situation concrète
comportant un phénomène particulier que nous ambitionnons de
comprendre et non de démontrer, de prouver ou de contrôler. Nous
avons voulus donner le sens au phénomène à travers ou
au-delà de l'observation (chapitre troisième)
- La méthode statistique :Elle nous
permettra d'analyser et d'interpréter l'ensemble d'observations
relatives aux phénomènes rencontrés sur le terrain. Par
cette méthode, nous avons eu à représenter les
données sous forme des tableaux pour faciliter la compréhension
et l'interprétation.
- La méthode analytique : Elle nous
permettra d'analyser les données ou les informations concernant le mode
de financement et à mieux comprendre tout au long de notre travail, les
données recueillies en des éléments essentiels afin de
saisir les liens et donner ainsi un schéma d'ensemble ou un
résultat eu égard à nos
30
analyses. Elle nous a également permis de traiter
systématiquement toutes les informations et les données
collectées en insistant sur chaque cas.
- La méthode descriptive :cette
méthode nous sera aussi d'une grande importance dans la description des
PME et des faits économiques dans le temps et dans l'espace eu
égard à la réalité contextuelle de notre
environnement.
B. TECHNIQUES
- Technique de la documentation : Nous aurons
la prérogative de consulter la documentation nécessaire compte
tenu de la complexifié du sujet que nous avons traité, les
ouvrages spécialisées, les rapports de vérification des
brochures et d'autres documentation écrite.
- Technique d'interview : Elle nous permettra
de collecter les données à travers nos entretiens avec certains
agents et cadres des PME faisant parties de notre échantillon.
- Questionnaire d'enquête : Nous
permettra à adresser un questionnaire d'enquête aux PME pour
chercher à connaitre le mode de financement des PME de la ville de
Bukavu.
II.2.1 collecte de données
A) Présentation de la population
cible
La population cible de notre enquête comprend toutes
les PME de la ville de Bukavu. Les informations qui proviennent du bureau
urbain en charge des PME indiquent que la ville de Bukavu compte un effectif de
2247 petites et moyennes entreprises réparties dans le tableau
N°1
B) Détermination de
l'échantillon
Un échantillon est un choix d'un nombre limité
d'activité d'objets ou d'évènements dont l'observation
permet de tirer des conclusions explicatives de la population. Un
échantillon parait en outre comme un segment ou sous ensemble de la
population étudiée, les mesures qu'on utilise pour décrire
une population s'appellent « les paramètres » et les mesures
utilisées pour décrire ce dernier s'appellent « statistiques
» (Léonard BITUBI, 2016, inédit).
Il nous a été difficile d'atteindre toutes les
PME dans la ville de Bukavu c'est la raison pour laquelle nous nous sommes
servis de la technique d'échantillonnage. Nous allons alors
31
déterminer une partie de la population sur laquelle
nous avons explorés les résultats de toute la population
d'étude.
Ainsi, pour déterminée la taille de notre
échantillon nécessaire afin d'obtenir une précision
relativement fixé à priori, la formule d'Alain Bouchard nous a
permis de calculer la taille en terme de nombre d'enquêtés
à retenir pour la récoltes des données.
L'échantillonnage est nécessaire car il constitue une
façon rapide et peu couteuse de connaitre certaines
caractéristiques d'une population à partir d'un
échantillon et permet de généraliser les résultats
de l'échantillon sur l'ensemble de la population ciblée (Bouchard
A. 1989-1990).

Avec n =taille de l'échantillon
N=taille de la population
Concernant la taille de l'échantillon de nos
enquêtes, nous avons fait recours à cette formule
énoncée. Elle stipule que quand l'univers de l'échantillon
est supérieur à 1000000 d'individus, on fait correspondre un
échantillon de 96 individus étant donné qu'une marge
d'erreur de 5% et le degré de précision de 95%.
Au cas où la population mère serait
inférieure à 1000000 d'individus, on calcule l'échantillon
corrigé.
Ainsi, notre population étant inférieur à
1000000 individus, il a fallu appliquer la formule approuvée pour
trouver la taille de l'échantillon corrigé.
En vue de bien mener notre étude nous avons fait recours
à l'échantillonnage.
Cette formule pose comme postulat et émet comme
hypothèse ce qui suit :
- Le niveau de confiance est de 95%
- La marge d'erreur est de 5% Ainsi, la formule donne :
No 96 96 96 96
|
n=
|
|
=
|
|
=
|
|
|
|
=
|
|
|
|
= 1, 04272363 =92, 066 92 PME
|
|
1+ No
N
|
96
1 + 2247
|
|
2247+96
|
|
|
2343
|
|
|
|
|
|
2247
|
|
|
|
2247
|
|
No : 96 individus
N : taille de la population
Ainsi l'échantillon corrigé sera trouvé en
utilisant la formule suivante :
no x N 92 x 2247 206724
|
ne =
|
=
N+no
|
2247 + 92 =
|
2339 =88, 381 88 PME
|
Nous aurons donc 88 PME à enquêter reparties de la
manière suivante:
32
L'échantillon par catégorie de PME sera
trouvé en procédant de la manière suivante :
Tableau N° 3 : Répartition de
l'échantillon selon le secteur d'activité
|
Secteurd'activité
|
effectif
|
échantillon
|
%
|
|
Commerce general
|
1010
|
40
|
45
|
|
Boulangerie
|
22
|
1
|
1
|
|
Agence voyage et transport
|
51
|
2
|
2
|
|
Hôtels, bars et cafeteria
|
187
|
8
|
9
|
|
Pharmacie, dispensaire, écoleprivée
|
192
|
8
|
10
|
|
Savonnerie
|
70
|
3
|
3
|
|
Garage et atelier
|
81
|
3
|
3
|
|
Comptoirminier et artisanat
|
252
|
10
|
11
|
|
Restaurant et similaire
|
145
|
6
|
7
|
|
Groupe d'acteur de micro-finance du Sud-Kivu
|
133
|
5
|
6
|
|
Secteuragricole
|
40
|
2
|
2
|
|
Centre d'hébergement
|
18
|
1
|
1
|
|
TOTAL
|
2201
|
88
|
100
|
Tableau 3Répartition de l'échantillon selon le
secteur d'activité
Source : nos calculs à partir des données de la
division des PMEA C. Commentaire sur le déroulement de
l'enquête
Notre première question de recherche nous a plus
guidée jusqu'à l'enquête vu que nous étions
obligés de savoir le mode de financement des PME de la ville de Bukavu
et leurs croissances. Et pour ce faire nous devrions connaitre les moyens
auxquels recouvrent les PME pour financer leurs activités mais aussi la
source de financement la plus utilisée par les PME de la ville de Bukavu
et pourquoi et enfin savoir si le mode de financement influence-t-il leurs
niveaux de croissance. C'est dans ce sens qu'un questionnaire leur a
été adressé. Nous étions obligés de prendre
plus de temps pour que nous ayons ces données auprès.
33
Notons par ailleurs que nous nous sommes entretenus avec
quelques dirigeants des différentes PME. Nous avons effectué
notre enquête pendant une période d'une semaine soit du samedi 07
au vendredi 13 septembre 2019.
II.2.2 Techniques de traitement de données
Pour traiter nos données recueillies sur le terrain,
deux logiciels nous ont servis pour arriver à cette fin. Le logiciel
SPHINX. Le logiciel SPHINX nous a permis de constituer une base de
données des réponses recueillies sur terrain. Après avoir
construit cette base de données, nous avons exporté ces
données nous sommes à leur analyse afin qu'elles soient
traitées et ainsi aboutir à des résultats voulus. Ce
dernier, nous a permis de présenter nos résultats sous forme des
tableaux.
Il ressort de ce tableau, tous les noms des PME de la ville
que nous avons enquêté reparties dans les trois communes de la
ville de Bukavu.
34
CHAPITRE TROISIEME : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS
Ce chapitre se consacre à l'analyse des résultats
obtenus sur le terrain grâce aux questionnaires
d'enquêtes administrés à nos enquêtes
qui sont les différents gérants et dirigeants des PME de la ville
de Bukavu.
1. De raison sociale de l'entreprise
Le tableau ci-dessous réparti les PME échantillons
selon leur emplacement dans les trois
communes de la ville de Bukavu. Ceci nous a permis d'identifier
les noms des PME de la ville de Bukavu que nous avons enquêtés.
Tableau N° 4 : De la Raison sociale
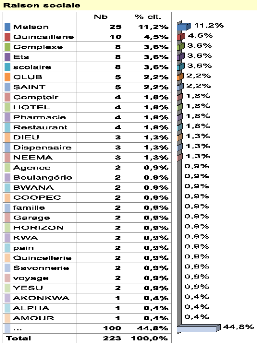
Tableau 4De la Raison sociale
Source: Nos enquêtes
Commentaire :
Il relève de ce tableau que sur 88
enquêtés, 25 sont des femmes représentant une proportion de
28,4 % alors que 63 sur 88 sont des hommes, soit une proportion de 71,6 %. Il
reste à
35
2. De l'adresse communale des PME
Le tableau ci-dessous réparti les PME échantillons
selon leur emplacement dans les trois
communes de la ville de Bukavu. Ceci nous a permis d'identifier
laquelle de communes contient plus de PME enquêtées.
Tableau N° 5 : Commune où se trouve la
firme
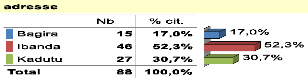
Tableau 5Commune où se trouve la firme
Source: Nos enquêtes Commentaire :
Il ressort de ce tableau que la commune de Ibanda est celle
qui possède plus de PME enregistrées que les autres communes,
soit 46 PME sur 88 enquêtées soit une proportion de 52,3 %, suivie
de la celle de Kadutu avec 27 PME sur 88 enquêtées, soit une
proportion de 30,7 %, et enfin la commune de Bagira qui a 15 PME sur 88
enquêtées, soit une proportion de 17,0%.
3. Du genre du gestionnaire
Le tableau ci-dessous reparti le PME échantillon selon
leur sexe dans la ville de Bukavu. Ceci nous a permis à identifier le
quel du genre masculin ou féminin comporte plus des PME à
enquêtée.
Tableau N° 6 : Genre du gestionnaire
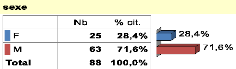
Tableau 6Genre du gestionnaire
Source : Nos enquêtes Commentaire :
36
encourager les femmes de la ville de Bukavu à entreprendre
étant donné que leur proportion est faible par rapport à
celle des hommes.
4. Du nombre de salarié
Le tableau ci-dessous reparti le PME échantillon selon
leur nombre de salarié dans la ville de Bukavu. Ceci nous a permis
à identifier le nombre de salariés des PME
enquêtée.
Tableau N° 7 : Nombre du salarié
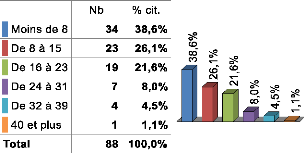
Tableau 7Nombre du salarié
Source: Nos enquêtes
Commentaire :
Il relève de ce tableau que sur 88
enquêtés, 34 PME ont moins de 8 salariés soit une
proportion de 38,6%, 23 PME ont 8 à 15 salariés soit une
proportion de 26,1%, 19 PME ont de 24 à 31 salariés soit une
proportion de 21,6%, 7 PME ont de 24 à 31 salariés soit une
proportion de 8,0%, 4 PME ont de 32 à 39 salariés soit une
proportion de 4,5% et 1 PME à 40 et plus salariés soit une
proportion de 1,1%.
5. De l'année de création de
l'entreprise
Le tableau ci-dessous reparti le PME échantillon selon
leur année de création dans la ville de Bukavu. Ceci nous a
permis à identifier les années de création des PME
enquêtée.
37
Tableau N° 8 : l'année de création de
l'entreprise
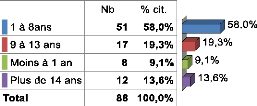
Tableau 8l'année de création de
l'entreprise
Source: Nos enquêtes Commentaire :
Il relève de ce tableau que sur 88 PME
enquêtées, 51 PME sur 88 enquêtées soit une
proportion de 58,0% ont de 1 à 8ans, 17 PME sur 88
enquêtées soit une proportion de 19,3% ont de 9 à 13ans, 8
PME sur 88 enquêtées soit une proportion de 9,1% ont moins d'un an
et 12 PME sur 88 enquêtées soit une proportion 13,6% ont plus de
14ans.
6. De la forme juridique de l'entreprise
Le tableau ci-dessous reparti les PME échantillon selon
leur forme juridique des entreprises. Ceci nous a permis d'identifier la forme
juridique de PME enquêtée.
Tableau N° 9 : Forme juridique de
l'entreprise
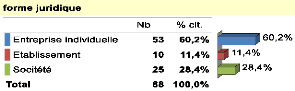
Tableau 9Forme juridique de l'entreprise
Source : Nos enquêtes Commentaire :
Il ressort des résultats de ce tableau que 53 PME sur
les 88 enquêtées sont de la forme individuelle et
représentant une proportion de 60,2 %, suivies de 10 sur les 88, soit
une proportion de 11,4 % qui sont de la forme établissement; les
sociétés quant à elles représentent une proportion
de 28,4 %, soit 25 PME sur les 88 enquêtées.
38
7. De l'activité principale de l'entreprise
Le tableau ci-dessous reparti les PME échantillons
selon leur principale activité. Ceci nous a permis d'identifier les
activités principales des entreprises.
Tableau N° 10 : Activité principale de
l'entreprise
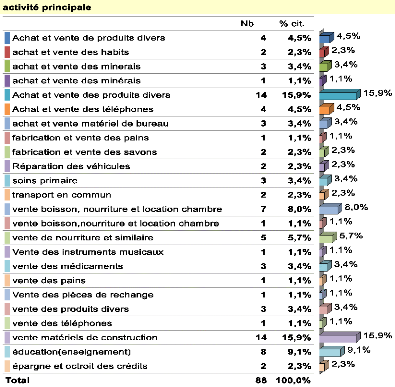
Tableau 10Activité principale de l'entreprise
Source: Nos enquêtes Commentaire :
Il ressort de ce tableau, les différentes activités
principales des PME de la ville de Bukavu dans les trois communes de la ville
de Bukavu.
Ce tableau ci-dessous reparti les PME échantillon selon
leur sources de financement de l'entreprise. Ceci nous a permis d'identifier
l'origine de fond utilisé dans les PME enquêtées.
8. De la source du financement de l'entreprise
39
Tableau N° 11 : Sources de financement de
l'entreprise
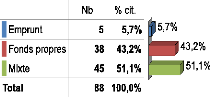
Tableau 11Sources de financement de l'entreprise
Source : Nos enquêtes Commentaire :
Nous remarquons que 38 sur 88 enquêtés, soit une
proportion de 43,2 % ont comme source de financement de leurs activités
uniquement les fonds propres, donc ne recourent pas aux fonds empruntés
ou venant de l'extérieur, elles s'autofinancent ; 5
enquêtés sur un total de 88, soit une proportion de 5,7% recourent
aux fonds empruntés ; 45 sur 88 enquêtées, soit une
proportion de 51,1% ont comme source de financement de leurs activités
la source de financement mixte, donc le fonds propre et l'emprunt.
9. De la majorité des crédits
reçus
Ce tableau ci-dessous reparti le PME échantillon selon
leur crédit obtenu du principal partenaire financier dans les 3 communes
de la ville de Bukavu. Ceci nous a permis d'identifier l'échéance
de crédit auquel recours les PME enquêtées.
Tableau N° 12 : Crédit obtenu du principal
partenaire financier
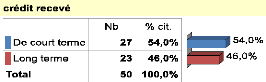
Tableau 12Crédit obtenu du principal partenaire
financier
Source : Nos enquêtes Commentaire :
Il ressort de ce tableau que 27 enquêtés sur un
total de 88, soit une proportion de 54,0 % recourent aux crédits
à court terme ; 23 enquêtés sur un total de 88, soit une
proportion de 46,0 % recourent aux crédits à moyen terme.
Source : Nos enquêtes
40
10. De la motivation à rester dans
l'activité
Ce tableau ci-dessous reparti les PME échantillon selon
leur motivation à rester dans le secteur de la ville de Bukavu. Ceci
nous a permis d'identifier les raisons qui les poussent à se maintenir
plus longtemps dans ce secteur.
Tableau N° 13 : Motivation à rester dans le
secteur
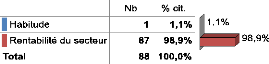
Tableau 13Motivation à rester dans le secteur
Source : Nos enquêtes Commentaire :
Il ressort de ce tableau que 87 enquêtés sur 88,
soit une proportion de 98,9 % est motivé par la rentabilité de
leurs activités et qui fait à ce qu'ils désirent s'y
pérenniser ; 1 enquêté sur 88, soit 1,1 % affirme qu'il
désire se pérenniser dans ce secteur, car celui-ci est
déjà pour elle une habitude et il risquerait peut-être
selon elle, d'avoir des difficultés s'ils pouvaient embrasser un autre
secteur d'activité.
11. De la préférence du mode de
financement
Ce tableau ci-dessous reparti les PME échantillon selon
leur préférence du mode de financement. Ceci nous a permis
d'identifier la quelle de financement préfèrent les PME
enquêtées.
Tableau N° 14 : Mode de financement
préféré
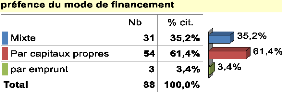
Tableau 14Mode de financement
préféré
41
Commentaire :
Nous remarquons sur base des résultats de ce tableau
que 54 enquêtés sur un total de 88, soit une proportion de 61,4 %
désirent le financement par capitaux propres comme mode de financement
de leurs affaires ; 3 enquêtés sur 88, soit 3,4 %
préfèrent recourir au financement par emprunt pour financer leurs
activités ; 31 enquêtés sur 88, soit 35,2 % souhaite le
financement mixte pour financer ses activités.
12. Du degré de préférence de la
source utilisée
Ce tableau ci-dessous reparti les PME échantillon selon
leur degré de préférence du mode de financement. Ceci nous
a permis d'identifier le degré de financement préfèrent
les PME enquêtées.
Tableau N° 15 : degré de
préférence de la source utilisée
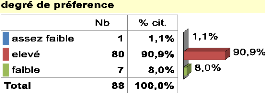
Tableau 15degré de préférence de la
source utilisée
Source: Nos enquêtes Commentaire :
Il ressort de ce tableau que 1 sur 88 enquêtés,
soit 1,1% prouve que le degré de préférence de la source
de financement préférée est assez faible ; 80 sur 88
enquêtés, soit 90,9% prouvent que le degré de
préférence de la source de financement
préférée est élevé et 7 sur 88
enquêtés, soit 8,0 disent que le degré de
préférence du mode de financement préféré
est faible.
13. De l'appréciation de la clientèle
Le tableau ci-dessous reparti les PME échantillon selon
leur type d'entreprise. Ceci nous a permis d'identifier parmi ce type
d'entreprise celui qui contient plus des PME enquêtées.
42
Tableau N° 16 : Appréciation de la
clientèle

Source: Nos enquêtes
Tableau 16Appréciation de la clientèle
Source: Nos enquêtes Commentaire :
Nous remarquons sur bases résultats de ce tableau que
58 enquêtés sur 88, soit une proportion de 65,9% apprécient
bien la clientèle ; 1 enquêtés sur un total de 88, soit une
proportion de 1,1% n'apprécie pas du tout bien la clientèle et 29
enquêtés sur un total de 88, soit une proportion de 33,0%
apprécient très bien la clientèle.
14. De l'influence du mode de financement
utilisé
Le tableau ci-dessous montre l'influence qu'au mode de
financement dont l'entreprise fait recours pour financer leurs
activités.
Tableau N° 17 : De l'influence du mode de
financement utilisé
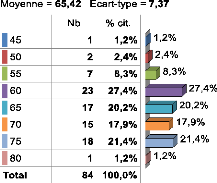
Tableau 17De l'influence du mode de financement
utilisé
43
Commentaire :
Il ressort de ce tableau que 1 sur 88 enquêtés
soit une proportion de 1,2% prouve que le mode de financement qu'il utilise
influence à 45% ; 2 sur 88 enquêtés, soit 2,4% prouvent que
le mode de financement qu'ils utilisent influencent à 50 % ; 7 sur 88
enquêtés, soit 8,3% prouvent que le mode de financement auquel ils
font recourt influence à 55% ; 23 sur 88 enquêtés, soit
27,4% prouvent que le mode de financement auquel ils font recourt influence
à 60% ; 17 sur 88 enquêtés, soit 20,2% disent que le mode
de financement auquel ils font recourt influence à 65% ; 15 sur 88
enquêtés soit 17,9% prouvent que le mode de financement auquel ils
font recourt influence à 70% ; 18 sur 88 enquêtés, soit
21,4% disent que le mode de financement auquel ils font recourt influence
à 75% et 1 sur 88 enquêtés, soit 1,2% prouve que le mode de
financement auquel il fait recourt influence à 80%.
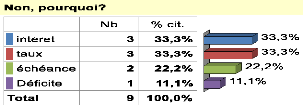
Source: Nos enquêtes
Commentaire :
Il ressort dans ce tableau que 3 sur 88 enquêtés,
soit 33,3% disent que le mode de financement auquel ils font recourt
n'influence pas leurs croissances à cause des intérêt
payés lors du remboursement du crédit, 3 sur 88
enquêtés, soit 33,3% disent que le mode de financement auquel ils
font recourt n'influence pas leurs croissance à cause de taux
d'intérêt qu'il supportent lors du remboursement ; 2 sur 88
enquêtés, soit 22,2% disent que le mode de financement auquel ils
font recourt n'influence pas leurs croissances à cause de
l'échéance du payement du crédit et 1 sur 88
enquêtés, soit 1,1% dit que le mode de financement auquel il fait
recourt n'influence pas leur croissance à cause du déficit qui se
manifeste du jour au jour.
Abstraction faite, sur 88 enquêtés, 25 sont des
femmes représentant une proportion de 28,4 % alors que 63 sur 88 sont
des hommes, soit une proportion de 71,6 %. Il reste à encourager les
44
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail de fin de cycle de graduat portant
sur le mode de financement et croissance des PME de la ville de Bukavu,
il nous a été amené de constater que le mode de
financement des PME de Bukavu est beaucoup plus interne qu'externe et qu'en
conséquence, ces entreprises devraient penser recourir à
l'endettement à long et à moyen terme jusqu'à un niveau
raisonnable pour combiner efficacement le mode de financement interne au mode
externe et espérer ainsi améliorer leur croissance.
L'objet de ce travail ayant été d'analyser le
mode de financement et son influence sur la croissance de l'entreprise, nous
sommes partis d'une problématique consistant à savoir si le choix
de financement des PME de la ville de Bukavu est-il adéquat, les
facteurs déterminants le choix de financement des PME de la ville de
Bukavu.
En guise d'hypothèses, nous avons estimé que
l'adoption d'un tel ou tel autre mode de financement ou la combinaison de modes
de financement aurait un impact positif sur la croissance des PME de la ville
de Bukavu.
· Pour le financement de leurs activités, les PME de
la ville de Bukavu feraient principalement recours à l'épargne
disponible et aux emprunts.
· La source de financement la plus utilisée par les
PME de la ville de Bukavu serait l'autofinancement.
· Le mode de financement influence leurs niveaux de
croissance.
Pour tester ces hypothèses, nous avions fait usage de 4
méthodes : statistique, analytique, descriptive et qualitative
appuyées par trois techniques à savoir la technique documentaire,
la technique d'interview et questionnaire d'enquête.
Outre l'introduction et la conclusion générale,
notre présent travail était subdivisé en trois chapitres :
le premier consacré à la revue de la littérature
théorique et empirique, le second décrit le milieu d'étude
et la méthodologie d'étude alors que le dernier porte sur la
présentation et analyse des résultats. Dans ce dernier, nous
sommes arrivés aux résultats suivants :
Il a été remarqué que la commune de
Ibanda est celle qui possède plus de PME enregistrées que les
autres communes, soit 46 PME sur 88 enquêtées soit une proportion
de 52,3 %, suivie de la celle de Kadutu avec 27 PME sur 88
enquêtées, soit une proportion de 30,7 %, et enfin la commune de
Bagira qui a 15 PME sur 88 enquêtées, soit une proportion de
17,0%.
45
femmes de la ville de Bukavu à entreprendre
étant donné que leur proportion est faible par rapport à
celle des hommes.
73 PME sur les 88 enquêtées oeuvrent dans le
secteur commercial, soit une proportion de 82,95 % ; 1,14 % des PME oeuvrent
dans l'artisanat, concernant le secteur industriel sur 88
enquêtées oeuvrent dans ce secteur industriel représentant
ainsi un pourcentage de 6,82 % et 8 PME sur 88 enquêtées, soit une
proportion de 9,09 % de pharmacie.
51 PME sur 88 enquêtées soit une proportion de
58,0% ont une ancienneté de 1 à 8ans et qui représentent
l'effectif le plus élevé selon nos enquêtes, 17 PME sur 88
enquêtées soit une proportion de 19,3% ont une ancienneté
qui varie de de 9 à 13ans, 8 PME sur 88 enquêtées soit une
proportion de 9,1% ont une ancienneté moins d'un an et 12 PME sur 88
enquêtées soit une proportion 13,6% ont une ancienneté de
plus de 14ans.
Parlant du nombre de salarié d'entreprise, il a
été remarqué que sur 88 enquêtés, 34 PME ont
moins de 8 salariés soit une proportion de 38,6%, 23 PME ont 8 à
15 salariés soit une proportion de 26,1%, 19 PME ont de 24 à 31
salariés soit une proportion de 21,6%, 7 PME ont de 24 à 31
salariés soit une proportion de 8,0%, 4 PME ont de 32 à 39
salariés soit une proportion de 4,5% et 1 PME à 40 et plus
salariés soit une proportion de 1,1%.
Partant de la forme juridique de l'entreprise, 53 PME sur les
88 enquêtées sont de la forme individuelle et représentant
une proportion de 60,2 %, suivies de 10 sur les 88, soit une proportion de 11,4
% qui sont de la forme établissement; les sociétés quant
à elles représentent une proportion de 28,4 %, soit 25 PME sur
les 88 enquêtées.
Parlant de la source de financement de l'entreprise, il a
été remarqué que 38 sur 88 enquêtés, soit une
proportion de 43,2 % ont comme source de financement de leurs activités
uniquement les fonds propres, donc ne recourent pas aux fonds empruntés
ou venant de l'extérieur, elles s'autofinancent ; 5
enquêtés sur un total de 88, soit une proportion de 5,7% recourent
aux fonds empruntés ; 45 sur 88 enquêtées, soit une
proportion de 51,1% ont comme source de financement de leurs activités
la source de financement mixte, donc le fonds propre et l'emprunt.
27 enquêtés sur un total de 88, soit une
proportion de 54,0 % recourent aux crédits à court terme ; 23
enquêtés sur un total de 88, soit une proportion de 46,0 %
recourent aux crédits à moyen terme et 30 n'ont jamais
empruntés de l'argent pour financer leurs activités.
46
87 enquêtés sur 88, soit une proportion de 98,9 %
affirment être motivé par la rentabilité de leurs
activités et qui fait à ce qu'ils désirent s'y
pérenniser ; 1 enquêté sur 88, soit 1,1 % affirme qu'il
désire se pérenniser dans ce secteur, car celui-ci est
déjà pour elle une habitude et il risquerait peut-être
selon elle, d'avoir des difficultés s'ils pouvaient embrasser un autre
secteur d'activité.
54 enquêtés sur un total de 88, soit une
proportion de 61,4 % désirent le financement par capitaux propres comme
mode de financement de leurs affaires ; 3 enquêtés sur 88, soit
3,4 % préfèrent recourir au financement par emprunt pour financer
leurs activités ; 31 enquêtés sur 88, soit 35,2 % souhaite
le financement mixte pour financer ses activités.
1 sur 88 enquêtés, soit 1,1% prouve que le
degré de préférence de la source de financement
préférée est assez faible ; 80 sur 88
enquêtés, soit 90,9% prouvent que le degré de
préférence de la source de financement
préférée est élevé et 7 sur 88
enquêtés, soit 8,0 disent que le degré de
préférence du mode de financement préféré
est faible.
58 enquêtés sur 88, soit une proportion de 65,9%
apprécient bien la clientèle ; 1 enquêtés sur un
total de 88, soit une proportion de 1,1% n'apprécie pas du tout bien la
clientèle et 29 enquêtés sur un total de 88, soit une
proportion de 33,0% apprécient très bien la clientèle.
Parlant de l'influence du mode de financement utilisé,
il a été remarqué que 1 sur 88 enquêtés soit
une proportion de 1,2% prouve que le mode de financement qu'il utilise
influence à 45% ;
2 sur 88 enquêtés, soit 2,4% prouvent que le mode
de financement qu'ils utilisent influencent à 50 % ; 7 sur 88
enquêtés, soit 8,3% prouvent que le mode de financement auquel ils
font recourt influence à 55% ; 23 sur 88 enquêtés, soit
27,4% prouvent que le mode de financement auquel ils font recourt influence
à 60% ; 17 sur 88 enquêtés, soit 20,2% disent que le mode
de financement auquel ils font recourt influence à 65% ; 15 sur 88
enquêtés soit 17,9% prouvent que le mode de financement auquel ils
font recourt influence à 70% ; 18 sur 88 enquêtés, soit
21,4% disent que le mode de financement auquel ils font recourt influence
à 75% et 1 sur 88 enquêtés, soit 1,2% prouve que le mode de
financement auquel il fait recourt influence à 80%.
3 sur 88 enquêtés, soit 33,3% disent que le mode
de financement auquel ils font recourt n'influence pas leurs croissances
à cause des intérêt payés lors du remboursement du
crédit, 3 sur 88 enquêtés, soit 33,3% disent que le mode de
financement auquel ils font recourt n'influence pas leurs croissance à
cause de taux d'intérêt qu'il supportent lors du remboursement ; 2
sur 88 enquêtés, soit 22,2% disent que le mode de financement
auquel ils
47
font recourt n'influence pas leurs croissances à cause
de l'échéance du payement du crédit et 1 sur 88
enquêtés, soit 1,1% dit que le mode de financement auquel il fait
recourt n'influence pas leur croissance à cause du déficit qui se
manifeste du jour au jour.
Ainsi, nous proposons en termes de suggestions aux PME de
Bukavu : de respecter la logique que nous propose la théorie des
structures financières dans le cadre de la réalisation de leurs
activités au quotidien ; d'augmenter de plus en plus leurs capitaux, car
plus ces derniers augmentent, plus l'entreprise crée de la richesse et
enfin d'adresser leur demande de financement au FPI qui accorde des dettes
à long terme qui ne sont pas exigibles à tout moment.
Nous ne pouvons pas nous prévaloir d'avoir
épuisé tout le contour de l'étude du choix de financement
des PME, mais nous pensons toutefois avoir apporté quelques pistes
à tout chercheur qui voudrait approfondir ses investigations dans ce
domaine et, qui, par suite de sa capacité intellectuelle pourrait
l'améliorer en comblant toutes nos insuffisances et lacunes sur le choix
de financement et la performance financière, et pour
l'intérêt général du monde scientifique.
48
BIBLIOGRAPHIE
A. OUVRAGES
BIENAYME A.: « la croissance des entreprises »,
analyse dynamique des fonctions de la firme, éd, bordas, 1973,
p14
Michel LEVASSEUR, Aimable QUINTRAT, Finance,
2ième édition, Economica, Paris, 1984
P.Vernimen et Al, finance d'entreprise, Paris, Dalloz,
2009-2010
RAYBAUD et JL., CORDON, Economie d'entreprise, Premier
G, édition Michèle,Paris, Juin,
1998
ROBERT C., Théorie financière, Ed.
Economica, Paris, P 163
Dominique SERAN, stratégie nationale des PME,
paris, 1990, p23
PERCHERONS. Economie des entreprises, Masson, Paris,
1985, p76-77
NEGREC C. la croissance des PME, cahier
français, N° 234, janvier-février 1988, p21-25
B. MEMOIRES ET TFC
AKONKWA Z, les déterminants de la performance des
PME dans la ville de Bukavu, mémoire, inédit, UCB,
2008-2009.
BILENE KISULU Jean Pierre, impact du choix de financement
sur la croissance des petites et moyennes entreprises de la ville de Bukavu,
Mémoire, inédit, FSEG,UOB, 2011-2012
F. MENDA. Problématique de financement de petite
et moyennes entreprises par les institutions financières en RDC . cas de
la ville de Kinshasa, mémoire, inédit, UNIKIN 20102011
Louis KAYUMBA MUZALIWA, Analyse des déterminants
de l'investissement dans les PME de Bukavu, Mémoire, Inédit,
GEFIN, UOB, 2001-2002
Ntole R. structure financière d'une PME . cas des
établissements UMOJA SHOP de Goma, TFC, inédit, ISP/Bukavu
2005
Samuel MUDOGO MAGABE, Financement des PME àBukavu
: Moyens, Contraintes et Solutions, Mémoire,
Inédit, ISP/Bukavu, 2009-2010
SIFA MUBOLWA Rosette : « La politique de financement et
son incidence sur la performance financière d'une entreprise. Cas de
GINKI 2008-2012», Mémoire, Inédit, FSEG, UOB,
20132014
C. COURS
Augustin MUTABAZI, comptabilité
générale, Cours, inédit, G1 SCA, ISP Bukavu,
2016-2017 BASHOMBE. Expertise comptable, cours, inédit, G3 SCA,
ISP Bukavu, 2018-2019
49
IBRAHAM. cours de contre de gestion et audit,
inédit, G3 SCA, ISP Bukavu, 2018-2019 MARDOCHE NGANDU, Cours
d'initiation à la recherche scientifique, G2 SCA, ISP, 20172018
NDJANGAL J.gestion financière à cours terme,
Cours, inédit, G3 SCA, ISP Bukavu 20182019
D. ARTICLES, REVUES ET AUTRES RAPPORTS
BLACK F, et SCHOLES M., «The princing of option and
corporate liabilities», InJournal of Economy, in endettement,
capitauxpropres et theories des options, n° 66, 1973 CADICEC-Information,
« Bulletin du Centre d'Action pour Dirigeants et cadres d'entreprises
chrétiens au Congo », 81, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa,
Décembre 2003
Kim Auclair, « Pour la pérennité des PME au
Québec », In Les affaires, janvier 2015
Mairie de la ville de Bukavu, 2ème Bureau
Ministère de PME, Charte des IPMA de 2009 Service
commercial de GINKI SARL Sud-Kivu, 2016
SOULIER D, rapport de la banque Africaine de
développement sur le micro finance, Edicef, Paris, 1992
50
Table des matières
EPIGRAPHE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
LISTE DES TABLEAUX V
RESUME VI
INTRODUCTION 1
0.1 HYPOTHESES 5
0.2 OBJECTIF DU TRAVAIL 5
0.3 CHOIX ET INTERET DU SUJET 5
O.4 METHODES ET TECHNIQUES 6
0. Méthodes 6
0.5 DELIMITATION DU SUJET 7
0.6 SUBDIVISION DU TRAVAIL 7
CHAP 1 : REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE ET EMPIRIQUE
8
SECTION I. REVUE DE LA LITTERATURE THEORIQUE
8
I.1. LES MODES DE FINANCEMENT 8
I.1.1. Modes de financement de l'entreprise
8
1.1.2. Choix de financement 12
I.2. LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 14
I.2.1. Caractéristiques des PME 16
I.3.2. Les critères qualitatifs de
définition des PME 16
I.3. LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 17
A. La nature de la croissance 18
B. Les raisons de la croissance 18
SECTION II. REVUE DE LA LITTERATURE EMPIRIQUE
19
CHAPITRE 2 PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE ET
APPROCHE
METHODOLOGIQUE 23
1. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE 23
1.1 Bref aperçu sur la ville de Bukavu
23
1.11. Population 23
1.1.2 Situation économique 24
1.2 Cadre contextuel des PME en RDC 26
51
1.3 Présentation des PME de la ville de Bukavu
27
1.3.1 L'importance des PME dans l'économie
27
B. Les atouts et faiblesses des PME congolaises
28
II.2 METHOLOGIE DE L'ETUDE 29
A) METHODES 29
B. TECHNIQUES 30
C. Commentaire sur le déroulement de
l'enquête 32
II.2.2 Techniques de traitement de données
33
DIFFICULTES RENCONTREES Erreur ! Signet non
défini.
CHAPITRE TROISIEME : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS 34
De raison sociale de l'entreprise 34
De l'adresse communale des PME 35
1. Du genre du gestionnaire 35
2. Du nombre de salarié 36
3. De l'année de création de l'entreprise
36
4. De la forme juridique de l'entreprise 37
5. De l'activité principale de l'entreprise
38
6. De la source du financement de l'entreprise
38
7. De la majorité des crédits reçus
39
8. De la motivation à rester dans
l'activité 40
9. De la préférence du mode de financement
40
10. Du degré de préférence de la
source utilisée 41
12. De l'influence du mode de financement utilisé
42
CONCLUSION GENERALE 44
BIBLIOGRAPHIE 48
A. OUVRAGES 48
B. MEMOIRES ET TFC 48
C. COURS 48
D. ARTICLES, REVUES ET AUTRES RAPPORTS 49
52
ANNEXE
53
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
Nous, MATENDO GIYE Rodrigue, étudiant en G3 SCA
à l'ISP/BKV, nous venons vers vous dans le cadre de la rédaction
de notre travail de fin de cycle de graduat en sciences commerciales et
administratives portant sur le mode de financement et croissance des PME de la
ville de Bukavu. Les réponses fournies serviront dans le cadre
scientifique. Nous vous remercions d'avance.
F
I. IDENTITE
1. Nom de l'entreprise :
2. Adresse :
3. Genre du gestionnaire ou Responsable : M
4. Nombre de salarié :
II. QUESTIONS LIEES A L'ACTIVITE DE
L'ENTREPRISE
1. Quelle est l'année de création de votre
entreprise ?
a) Moins à 1 a b) 1 à 8 ans ) 9 à 13 ans d)
plus de 14 ans
2. Quelle est la forme juridique de votre entreprise ?
a) Société individuelle
b) Société par action à
responsabilité limitée (SARL)
c) Société anonyme
d) Autres à préciser
3. Quelle est l'activité principale de votre entreprise
?
III. PROPRIETAIRE /DIRIGEANT FONDATEUR
1. Quel est l'âge du dirigeant ?
a) Moins de 30 ans b) 30 et 39 ans c) 40 et 49 ans
d. 50 et 59 ans e. Plus de 60 ans
2. Quelle est la formation initiale du dirigeant de l'entreprise
? a) Formation professionnelle b) Formation académique c) Autres
IV. FINANCEMENT D'ENTREPRISE ET RELATION AVEC LE
POTENTIEL 1. Quelles sont les sources de financement de votre
entreprise ?
a) Fonds propres
b) Micro finances
c) Crédit bancaire de long terme
|
d) Crédit fournisseur
e) Subvention
f) Familles proches ou amis
|
g) Tontines h) Autres
2. Depuis quand êtes-vous en relation avec votre
principal partenaire financier (banque ou IMF)
a) Moins de 3 ans b) 3 à 5 ans c) Plus de 5 ans
3. La majorité des crédits que vous recevez du
principal partenaire financier sont
a) De court terme b) Long terme
4. Qu'est-ce qui vous motive à rester dans ce secteur
d'activité ? a) Rentabilité du secteur b) Habitude c) Imitation
d) Fiscalité e) Autres
5. Parmi les différents modes de financement, lequel
préférez-vous ?
a) Par emprunt b) par capitaux propres c) mixte
6. A quel degré préférez-vous cette source
?
a) Très faible (moins de 10%) c) faible (entre 26
à 50 %)
b) Assez faible (11 à 25 %) d. Elevé (51 à
75%)
7. Comment appréciez-vous vos relations avec la
clientèle ? a) Moins bonne b) Bonne c) Très bonne
8. Pensez-vous que le mode de financement auquel vous faites
recours influence sur votre croissance ?
Si oui, à combien de pourcentage estimez-vous cet impact ?
Si non pourquoi ?
Merci pour votre contribution.



