|
REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de
l'Innovation


UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI DE NIAMEY Faculté des
Lettres et Sciences Humaines Département de
Géographie
Urbanisation et précarité de
l'énergie électrique dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest
: l'exemple de Niamey au Niger (Analyse bibliographique)
MEMOIRE DE MASTER
Option : Aménagement des espaces
urbains

Présenté et soutenu par ABDOURAZACK
NIANDOU Abassa
MEMBRES DU JURY
Sous la direction de :
Dr. BONTIANTI Abdou
Maître de Recherches, IRSH/UAM
Codirecteur :
Dr. ABDOU YONLIHINZA Issa Maître-assistant,
Géo./FLSH/UAM
Année académique : 2016 -
2017
Président :
Pr. MOTCHO Kokou Henri
Professeur titulaire, Géo./FLSH/UAM
Assesseur :
Dr. YAYE SAIDOU Hadiara Assistante, Géo./FLSH/UAM
2
Table des figures
figure 1 : Carte de l'Afrique de l'Ouest 19
figure 2 : Champs spatial de l'étude
20
figure 3 : Quartiers de Niamey concernes par l'entretien
23
figure 4 : Evolution du sémi des villes en Afrique de
l'Ouest 49
figure 5 : Evolution de la population de Niamey
55
figure 6 : Répartition par source d'approvisionnement
65
figure 7 : Structure arborescente d'un départ
aérien 66
figure 8 : Hausse de la temperature 68
figure 9 : Réseau de distribution électrique de
Niamey 62
Table des photos
photo n°3 et 4 : Utilisation de bougies et lampes à
pile pour l'eclairage 73
photo n°5 et 6 : La retrocession de
l'électricité dans le quartier koirategui 74
photon° 7 et 8 : Panneaux solaires pour l'eclairage public
et d'autre usage 75
photo n° 9 et 10 : Groupes electrogenes de secours
76
photo n°11, 12 et 13 : Réfrigerateur et ventilateur
solaires (chargeables) 76
photon°14 et 15 : Outils de recherche des défauts
77
photo n°16: Power fault locator, pfl 40 A
77
Table des tableaux
tableau 1 : Evolution de la consommation et de la pointe de
charge de Niamey 56
tableau 2 : Evolution du taux de desserte en
électricité de la ville de Niamey 57
tableau 3 : Temperatures et consommation de
l'électricité à Niamey en fonction des
mois 67
tableau 4 : Comparaison du prix du kwh du niger à d'autres
unites geographiques 59
tableau 5 : Consommation moyenne annuelle
d'électricité par pays ou groupe de pays 60
tableau n° 5 : Differentes sources d'éclairage des
populations de Niamey 74
SIGLES ET ABREVIATIONS
3
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maitrise de
l'Energie
AFD : Agence Française de Développement
AIE : Agence Internationale de l'Energie
ANPER : Agence Nigérienne de Promotion de
l'Electrification en milieu Rural
AOF : Afrique Occidentale Française
ARM : Autorité de Régulation Multisectorielle
ARREC : Autorité de Régulation Régionale
du secteur de l'Electricité
ARSE : Autorité de Régulation du Secteur de
l'Energie
BAD : Banque Africaine du Développement
BIA : Banque Internationale pour l'Afrique
BM : Banque Mondiale
BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement
BOLT : Build-Own-Lease-Transfer
BT : Basse Tension
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
CEREEC : Centre Régional pour les Energies
Renouvelables et de l'Efficacité Energétique
CFA : Colonie Française Africaine
CNEDD : Conseil Nation de l'Environnement et du
Développement Durable
CNES : Centre National de l'Energie Solaire
CNME : Comité National Multisectoriel Energie
CNT : Comité National de l'Electricité
CREN : Commission de Régulation de l'Energie au
Niger
DDM : Direction de Distribution et Marketing
ECOMAG : Economic Community of West Africa States Cease-Fire
Monitoring Group
EDF : Energie De France
EEEOA : Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain
ENR : Energie Renouvelable
FMI : Fond Monétaire International
GWH : Gigawatt heure
Ha : Hectare
HC/AVN : Haut-Commissariat à l'Aménagement de la
Vallée du Niger
HT/HTB : Haute Tension
4
INS : Institut National de la Statistique
INSEE : Institut National de la statistique et des Etudes
Economiques
IRENA : Agence Internationale pour les Energies
Renouvelables
KVA : Kilo voltampère
KWh : Kilowattheure
MEP : Ministère de l'Energie et du Pétrole
MT/HTA : Moyenne Tension
MW : Mégawatt
NELACEP : Niger electricity Access Expansion Project
NEPA : Nigeria Power Autority
NIGELEC : Société Nigérienne
d'Electricité
ODD : Objectif de Développement Durable
OMD : Objectif du Millénaire pour le
Développement
ONERSOL : Office National de l'Energie Solaire
PDD : Plan Directeur de Distribution
PERC : Politique en matière d'Energie Renouvelable de
la CEDEAO
PIB : Produit Intérieur Brut
PNUD : Programme des Nations Unis pour le
Développement
PRASE : programme de Référence d'Accès
aux Services Energétique
SAFELEC : Société Africaine
d'Electricité
SBEE : Société Béninoise
d'Electricité et d'Eau
SEEN : Société d'Exploitation des Eaux du
Niger
SEM : Service Energétique Moderne
SES-Niger : Société Solaire Eau Niger
SIG : Système d'Information Géographique
SONIBANK : Société Nigérienne de
Banque
SONICHAR : Société Nigérienne de Charbon
d'Anou Areren
SONIDEP : Société Nigérienne des Produits
Pétroliers
SORAZ : Société de Raffinage de Zinder
TEE : Taux d'Effort Energétique
UEMOA : Union Monétaire Ouest Africaine
VRD : Voirie des Réseaux Divers
WAPP : West African Power Poor
5
DEDICACES
Ce travail est dédié à toute la
population de Niamey qui vit dans la précarité de
l'énergie électrique.
6
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont à l'endroit de Dr BONTIANTI
Abdou, Maître de Recherches à l'IRSH (UAM) et à Issa ABDOU
YOLIHINZA, Maitre-assistant au département géographie (UAM) qui,
en dépit de leurs multiples préoccupations, ont accepté de
diriger ce travail de Master, qu'ils reçoivent notre profonde
reconnaissance. Mes remerciements vont à Monsieur JENART Carlos et son
équipe, pour la documentation qu'ils ont mise à notre
disposition. Nos remerciements vont également à tous les
enseignants chercheurs du département de Géographie de
l'Université Abdou Moumouni de Niamey pour leur formation à
l'endroit des étudiants ; et au Directeur général de la
direction de la distribution et du Marketing de la NIGELEC pour avoir
accepté de nous livrer les informations indispensables à la
réalisation de ce travail. J'exprime ma profonde gratitude à tous
ceux qui, de près ou de loin, ont oeuvré à l'aboutissement
de ce travail.
7
RESUME
Ce travail de master sur l'urbanisation et la
précarité de l'énergie électrique dans les grandes
villes de l'Afrique de l'Ouest à travers l'exemple de Niamey, met en
exergue les effets de la croissance urbaine sur l'accès à
l'énergie électrique dans les villes Ouest-Africaines. En raison
des besoins sans cesse croissants engendrés par la croissance urbaine,
le problème de l'électricité se pose en termes de
disponibilité et d'accessibilité. En effet, la ville
connaît depuis sa création une urbanisation galopante et un
développement socioéconomique liés d'une part aux
activités administratives, politiques et de l'autre à son site
favorable. En effet, la ville est alimentée par la ligne 132 KV
provenant de Birnin-Kebbi du Nigeria avec un taux de desserte de 63%.
L'urbanisation croissante, les températures élevées, la
dépendance vis-à-vis du Nigeria voisin et l'absence de
planification sont les principaux facteurs du problème. La
précarité énergétique à Niamey est un
facteur dégradant la vie socioéconomique des populations. Pour
mener à bien cette étude, nous avons procédé
à une approche bibliographique et analytique complétée par
la collecte des données de terrain. Ce qui nous a permis de comprendre
l'ampleur de la précarité énergétique et les
stratégies adoptées par les consommateurs pour y faire face.
Mots clés : Précarité
énergétique, Urbanisation, Niamey
ABSTRACT :
This master thesis on urbanization and energy poverty in the
cities of the West through the example of Niamey African highlights the
urbanization and the problem of access to electricity in West African cities.
The electricity problem in terms of availability and accessibility, so the city
knows since its inception a galloping urbanization and socioeconomic
development lies on the one hand in administrative activities, policies, and
the other has its favorable site. Indeed, the city is powered by the 132 KV
line from Birnin-Kebbi in Nigeria with a 63% service rate. Increasing
urbanization, high temperatures, dependence on neighboring Nigeria and the lack
of prior study in the sector of electrical energy are the main factors of the
problem. Energy insecurity in Niamey is a factor in degrading the socioeconomic
life of the people. To carry out has well this study.
Keywords: poverty, energy, urbanization, Niamey
8
INTRODUCTION GENERALE
La problématique de l'accès à
l'électricité constitue l'un des défis majeurs de notre
siècle avec des statistiques alarmantes. Ainsi, on estime qu'en 2002,
1,6 milliards d'individus, soit 27 % de la population mondiale, vivent sans
électricité affirme TANGUY (2010). Les pays de l'Afrique de
l'Ouest, notamment ceux du sahel, se caractérisent
généralement par un déficit de l'énergie dû
au manque de moyens et à l'absence de planification. Ce déficit
est aussi exacerbé par les fortes températures rendant difficiles
les activités socio-économiques. Pourtant,
l'électricité est généralement perçue comme
la clef du monde moderne pour atteindre les objectifs du développement.
Sans elle, les individus et les communautés sont privés d'un
grand nombre de services et conforts, considérés comme
élémentaires dans le monde développé.
Dans ce contexte, les villes d'Afrique de l'Ouest connaissent
une augmentation de l'effectif de leur population mais aussi un
étalement de leurs territoires urbains. Cette croissance
démographique et spatiale des villes pose cependant un problème
de satisfaction des besoins en services urbains (transport,
électricité, eau etc.,). C'est ainsi que, l'offre du service de
l'électricité à toute la population urbaine de
façon continue fait partie des services les plus mal fournis dans ces
villes. Cette situation a été enclenchée par le processus
d'urbanisation mal maîtrisée que connaît la région
depuis plusieurs décennies. Les politiques urbaines n'ont pas suivi et
ont rendu le service défaillant devant servir les besoins de plus en
plus croissants des populations. Ces dernières ont alors adapté
des stratégies permettant tant bien que mal la satisfaction de leurs
besoins primaires en énergie électrique. Elles font ainsi recours
à des sources d'énergie palliatives afin de combler ce manque.
Malgré tout, le déficit d'électricité pèse
lourdement sur le développement socioéconomique des pays Ouest
africain. Ceci a amené des acteurs du secteur de l'énergie
à mettre en place des politiques visant à redresser le secteur
sur l'ensemble des pays de la région. Ces politiques sont relatives au
développement des sources d'énergies renouvelables afin
d'accroitre l'accès universel des populations aux services
énergétiques. C'est dans ce cadre que les pays de la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) et de l'UEMOA
(Union Montataire Ouest Africaine) ont entrepris ensemble un programme
d'efficacité énergétique : l'approbation du livre blanc en
2006 et la création du Centre Régional pour les Energies
Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (CEREEC) en 2007
pour une politique régionale d'efficacité
énergétique et le développement des énergies
renouvelables au sein de la région.
9
Au Niger, la politique énergétique a
été adoptée depuis 2004. A travers cette politique, le
gouvernement se proposait de dégager des orientations par lesquelles
l'énergie doit apparaitre comme moteur du développement
économique durable. C'est ainsi que l'Etat et ses partenaires se sont
engagés pour faire rayonner le secteur de l'énergie
électrique sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, plusieurs
projets d'électrification ont vu le jour visant à augmenter
l'offre du service. A noter également la création du Centre
National de l'Energie Solaire (CNES) qu'avait précédé
l'Office National de l'Energie Solaire (ONERSOL). Ce centre vise le
développement de l'énergie photovoltaïque afin de permettre
la production décentralisée de l'électricité dans
les zones non connectées au réseau de distribution de la
Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC).
A Niamey, en dépit des politiques sur le secteur de
l'énergie électrique, la précarité
énergétique persiste du fait de l'urbanisation mal
maîtrisée et des conditions climatiques contraignantes. En effet,
la ville de Niamey à l'instar des autres villes de l'Afrique de l'Ouest
connaît également une forte urbanisation rendant le service
insuffisant à couvrir les besoins des populations. A cela s'ajoute le
climat, car c'est une ville sahélienne où les températures
sont extrêmement élevées frôlant parfois les 50°
C pendant les périodes de canicules. Plusieurs autres problèmes
comme l'absence de planification dans le secteur qui affectent également
la NIGELEC qui éprouve des difficultés à satisfaire les
besoins croissants en électricité. Il se pose ainsi un
sérieux problème de l'énergie électrique de la
ville de Niamey, lesquels problèmes seront exposés dans ce
travail structuré en quatre chapitres :
Le premier chapitre présente le cadre théorique
et la méthodologie de l'étude. Le deuxième traite de
l'approche signalétique qui classe les documents par thèmes avec
le résumé des ouvrages les plus significatifs sur la question de
l'urbanisation et de l'énergie. L'analyse de la dynamique urbaine et de
la précarité de l'énergie électrique dans les
grandes villes d'Afrique de l'Ouest au niveau du troisième chapitre,
fait l'analyse et l'interprétation de la documentation issue du
précédent chapitre, selon les quatre rubriques. Enfin, le dernier
chapitre porte sur l'analyse des politiques internationales et nationales de
l'énergie.
10
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Ce chapitre vise à donner une base théorique
à ce travail intitulé « Urbanisation et
précarité de l'énergie électrique dans les grandes
villes d'Afrique de l'Ouest : exemple de Niamey au Niger (analyse
bibliographique). » C'est ainsi qu'il s'articule autour de points tels que
: la problématique, les hypothèses de recherche, les objectifs de
l'étude ainsi que l'approche méthodologique.
1.1. La problématique
1.1.1. Contexte et justification de l'étude
L'urbanisation est l'une des manifestations les plus
plausibles de la dynamique du peuplement. Le terme urbanisation est couramment
employé pour désigner aussi bien le processus physique et la
croissance urbaine, que l'évolution de la part de la population totale
d'un pays ou d'une région vivant dans des centres urbains affirment
POTTS (2005) et SOTTERTHWAITE et al (2010). En Afrique subsaharienne, le rythme
de l'urbanisation est beaucoup plus rapide que celles qu'ont connues les pays
développés souligne BRICAS (2008).
L'urbanisation a commencé dès la période
précoloniale. Elle s'est renforcée au cours de la colonisation et
a pris progressivement de l'ampleur dans la région ouest africaine. En
effet, MOTCHO KOKOU H. (2005) montre que, vers 1930, la région comptait
10 villes de plus de 50 000 habitants ou proches de ce chiffre, dont Ibadan
(387 000 habitants), Lagos (120 000), Ogbomosho, Iwo, Ede, Kano (60 000),
Oshogbo (plus de 50 000), Ilorin (47 000) qui sont toutes du Nigeria, Dakar au
Sénégal (près de 100 000), Kaolack
(Sénégal), Accra et Koumassi (Ghana), Freetown (Sierra Leone)
etc. En 1960, le nombre des centres de plus de 5 000 habitants atteignaient 600
et la population urbaine totalisait près de 13 millions d'habitants,
soit un niveau d'urbanisation moyen de 13%, variant de 10 % au Niger à
29 % au Sénégal, pays le plus urbanisé à cette
date. Cette dynamique s'est poursuivie dans les années qui suivent et la
région comptait quelques 2 300 centres de plus de 5 000 habitants et une
population urbaine totalisant 50 millions d'âmes d'après toujours
MOTCHO KOKOU H. (opp cit). Cette population va ensuite connaître une
lente évolution entre les années 1980 et 1990 due à la
crise économique qu'a connue la région ouest Africaine.
Après cette période, la région a poursuivi le processus
d'urbanisation pour atteindre 117 millions d'habitants en 2010 avec un taux
d'urbanisation de 41% pour la plupart des pays de la région ajoute
THOMAS A.
11
(2010), soit une augmentation de 67 millions en trois
décennies. Ce que ROLAND P1. (2001) qualifie de
révolution urbaine parce qu'elle a engendré des transformations
dans tous les domaines. Il rapporte à cet effet que « le
caractère du phénomène urbain de l'Afrique subsaharienne,
rapide et récent a battu les records de croissance urbaine ».
Ce qui fera augmenter la demande des services sociaux de base dont celle de
l'énergie électrique. Cela se dessine dès aujourd'hui
à travers le taux d'accès à l'électricité.
Ainsi depuis les années 1990, si le pourcentage du taux d'accès
à l'électricité a favorablement évolué, le
nombre des personnes n'ayant pas accès à
l'électricité a quant à lui augmenté en raison de
la croissance démographique affirment ANJALI S. et al (2012) et le
Groupe de la Banque Africaine du Développement (2012). En effet, la
région couvre un taux d'accès de 40 % selon une étude de
la BANQUE MONDIALE (2009).
Les Nations Unis (2007) estiment que la population urbaine des
pays en développements augmentera de façon exponentielle pour
atteindre 850 millions de plus que les ruraux d'ici 2050. De ce fait, la
population rurale diminuera partout sauf dans les pays à faible revenue.
Cette reconfiguration rapide du peuplement n'est pas sans conséquence
sur la demande des services urbains en général et la prestation
des services énergétique en particulier. Bien souvent
l'urbanisation s'accompagne d'une amélioration des conditions de vie, on
constate une hausse de la demande des services par habitants. C'est ainsi que
dans la plupart des villes de cette partie de l'Afrique, les besoins en
énergie dépassent très largement la capacité des
sociétés à offrir le service. Cela témoigne donc de
l'ampleur des défis avenir dans la région notamment sur la
capacité des services à satisfaire les besoins sans cesse
croissants des citadins.
Par ailleurs, le processus d'industrialisation et le
développement économique que connaissent ces pays aggravent le
déficit entre la demande et la capacité des
sociétés à offrir l'énergie électrique. Ceci
est d'autant plus vrai que depuis les indépendances, on assiste à
l'implantation de plusieurs unités industrielles dans presque tous les
pays de l'Afrique de l'Ouest. Les unités de productions
électriques font face à une mauvaise gestion et bien d'autres
difficultés d'ordre techniques et financières. Les
difficultés financières se font sentir dans presque toutes les
sociétés de distribution d'électricité à
cause de la faible capacité de nos Etats à s'investir durablement
dans le domaine affirme CHRISTINE H. (1988). Ce qui handicape bien souvent la
desserte du service.
1 Roland P. (2001) Afriques Noires. Hachette livre,
43, quai de Grenelle, 75905, Paris Cedex 15. Pp151-188.
12
Dans les grands centres urbains du Niger,
particulièrement à Niamey, ces contraintes observées
à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest se traduisent aussi par une
défaillance de la qualité de la prestation de services
énergétiques. Dans un tel contexte, il convient de se poser la
question suivante :
· Qu'est ce qui explique la précarité
del'énergie électrique dans les grandes villes d'Afrique de
l'Ouest et particulièrement à Niamey?
A cette question principale, découlent les questions
subsidiaires suivantes :
· Comment se manifeste-t-elle et comment en est-on
arrivé à cette situation dans la ville de Niamey ?
· Quels sont les effets de cette précarité
sur le développement socioéconomique de la ville ?
· Quelles sont les stratégies
développées par les services techniques et les usagers pour
tenter de s'adapter à cette situation ?
· Les réponses apportées par l'Etat et ses
partenaires permettent-elles d'apporter des solutions durables aux
problèmes ?
1.1.2. Les hypothèses de recherche
Hypothèse 1 : La non maitrise de
l'urbanisation et les conditions climatiques contraignantes, conduisent
à la précarité de l'énergie électrique qui
se caractérise par des coupures intempestives dans les grandes villes
d'Afrique de l'Ouest et particulièrement à Niamey.
Hypothèse 2 : Face aux effets de ce
phénomène, les consommateurs ont adopté des formes de
résilience qui ne permettent pas d'apporter des solutions durables aux
problèmes de la desserte en énergie électrique.
1.1.3. Les objectifs de recherche
1.1.3.1. L'objectif général
L'objectif général de cette étude est de
comprendre les facteurs de la précarité de l'énergie
électrique dans la ville de Niamey ainsi que ses effets sur le
développement socioéconomique de la ville.
1.1.3.2. Les objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques de cette étude sont :
· Analyser la croissance urbaine et ses effets sur la
précarité energetique ;
13
? Etudier les stratégies adoptées par les usagers
pour faire face à cette situation de précarité ;
? Identifier quelques pistes à suivre pour pallier le
problème de déficit électrique.
1.1.4. Délimitation du champ de l'étude
1.1.4.1. Le cadre conceptuel
Précarité énergétique
: la définition de la précarité
énergétique fait partie d'un processus de construction sociale.
C'est pourquoi la réponse à la question « Qu'est-ce que
la précarité énergétique ? » n'est pas
univoque. Ce constat ressort d'une large étude bibliographique.
BROADMAN (1991) montre que l'étude du
phénomène de la précarité énergétique
prend ses racines au Royaume-Uni, où les travaux ont commencé
dès les années 1990 avec la parution du premier ouvrage de
référence, « Précarité
énergétique » (Fuel Poverty). Même si la
problématique y faisait déjà depuis longtemps l'objet de
diverses études telles que Department of Energy(1978) et BRADSHAW,
HUTTON(1983). C'est à la suite de ces premiers travaux de recherche qu'a
découlé la définition officielle britannique, laquelle
considère en situation de précarité
énergétique un ménage qui alloue plus de 10 % de son
revenu aux dépenses d'énergie afin de maintenir une «
température adéquate » dans son logement (21°C
dans les pièces à vivre principales et 18°C dans les
autres). On parle ici d'un « Taux d'Effort Energétique
» (TEE) dans le logement supérieur à 10 %. La
précarité énergétique fait référence
à une situation dans laquelle une personne ou un ménage rencontre
des difficultés particulières dans son logement à
satisfaire ses besoins élémentaires en énergie. Il
convient de souligner une importante constatation : bien que la première
définition inclue une gamme plus large d'usages
énergétiques, elle se limite souvent dans la pratique au besoin
de chauffage et ne tient pas compte de la consommation
énergétique pour l'eau chaude sanitaire, l'éclairage ou
les appareils électriques. Cela ressort clairement dans la seconde
définition. En outre, le seuil utilisé est assez strict : 10% des
dépenses peuvent être consacrées à l'énergie.
Ce seuil de 10 % a été défini à l'époque car
le ménage moyen en Angleterre consacrait alors 5 % du budget
hebdomadaire aux frais énergétiques et que les dépenses
deux fois supérieures à cette moyenne étaient
considérées comme « disproportionnellement
élevées » selon ISHERWOOD et HANCOCK (1979).
DUBOIS (2007) formule une autre remarque par rapport à
ces définitions, à laquelle nous pouvons adhérer sur la
base de la définition même de la pauvreté. Elle les trouve
trop restreintes, car la précarité énergétique
(comme la pauvreté en général) est un problème
14
multidimensionnel, qui ne peut donc pas être
défini sur la base d'un seul critère, comme la part des revenus
à y consacrer. L'auteur fait un parallèle avec les
différentes définitions ou représentations possibles de la
« pauvreté ». Elle considère qu'elles sont
complémentaires pour aborder les différents problèmes
liés à la pauvreté. Elle développe sa thèse
en voyant la précarité énergétique comme une
combinaison de trois facteurs, à savoir le non-accès à un
certain niveau d'utilité, le fait de ne pas disposer de certains biens
primaires et le manque de capacités (« capabilities»)
suffisantes.
Son second point de vue porte sur l'absence de certains biens
sociaux primaires, comme RAWLS (1971) les définit. RAWLS estime que ces
biens sociaux primaires doivent être répartis
équitablement, car ils sont à la base de chaque plan de vie. La
précarité énergétique est donc une
conséquence d'un manque de moyens, suite à quoi certaines
personnes ne peuvent pas suffisamment chauffer leur logement, dépendent
d'appareils moins performants et sont plus vulnérables aux augmentations
des prix.
Une troisième perspective concerne les
capacités de SEN (1983). Les capacités renvoient à ce
qu'une personne peut être ou faire, ce qui dépend des choix
possibles. En ce qui concerne la précarité
énergétique, cela se traduit par la moindre possession de
capacités pour chauffer suffisamment son logement. Cette perspective
tient compte de la vulnérabilité liée à la
précarité énergétique (à quel point est-on
sensible aux chocs externes, comme une augmentation des prix de
l'énergie) et considère aussi la pauvreté comme un
phénomène relatif. La précarité
énergétique et le fait de ne pas se chauffer de manière
adéquate et doit donc être définis par rapport aux
modèles de vie généralement admis par la
société. Cette troisième approche indique surtout que
différentes familles ne disposent pas des mêmes « armes
» que les autres pour se procurer les services
énergétiques nécessaires et que leur
vulnérabilité à ce sujet est un facteur important
affirment FREDERIC H. el al (2011).
Le cas de nos villes renvoie au premier facteur de DUBOIS qui
fait apparaitre le problème d'accessibilité. En effet la
précarité énergétique se présente pour la
plupart des villes d'Afrique de l'Ouest par un taux faible d'accès en
général et des délestages tournant pour ceux qui sont
déjà raccordés aux réseaux de distribution
électrique. Cette situation est pareille à la
réalité de la ville de Niamey où la prestation de
l'énergie électrique reste discontinue durant toute
l'année.
Urbanisation : Ce terme qui dérive de
« urbain », s'entend par la croissance de la proportion de population
vivant dans les zones urbaines. Cette croissance s'inscrit dans un processus
dont la finalité est la transformation du mode de vie rural en mode de
vie urbain. Dans l'agglomération urbaine, dominent des activités
autres que rurales à savoir l'administration, le
15
commerce, l'industrie, les services, etc. La permanence de ces
activités apparaît ici comme l'amorce d'un processus qui
transforme la vie dans l'agglomération considérée
soulignent OUATTARA A. et SOME L. (2009). Un tel processus, dynamique par
essence, est appelé à se renforcer et à se
développer avec de nouvelles réalisations induisant d'autres
activités. L'accroissement des besoins de logement induit à son
tour des extensions de l'agglomération consécutives aux
aménagements, à la construction d'équipements marchants,
l'installation des services d'eau et d'électricité, etc. La
finalité du processus étant l'amélioration des conditions
de vie des populations concernées.
Ville : La ville est complexe à
définir, sa définition varie d'un auteur à un autre, d'une
science à une autre. Ainsi, le géographe, l'historien, le
sociologue, l'économiste, ont chacun sa définition de la ville.
Plusieurs critères concourent à sa définition et varient
considérablement d'un pays à l'autre. Le nombre d'habitants
agglomérés est le critère le plus répandu, mais il
peut couvrir des différences : en France, une ville est, au sens de
l'Insee, une commune de plus de 2 000 habitants ; au Danemark le seuil minimal
est fixé à 200 habitants, en Afrique le seuil diffère
selon les pays. C'est ainsi qu'au Niger ce seuil est de 5000 habitants, au
Japon à 50 000. Dans d'autres pays comme au Royaume-Uni, en Union
sud-africaine, en Tunisie...c'est l'organisation administrative qui sert de
principe de définition. Certains pays combinent les deux critères
: c'est le cas des Etats-Unis, du Canada. Le facteur économique n'est
pas toujours absent : en Italie, par exemple, les communes dont la population
active est majoritairement agricole ne sont pas des villes.
Pour les géographes contemporains comme Pierre George,
une ville se définit comme « un groupement de populations
agglomérées caractérisées par un effectif de
population et par une forme d'organisation économique et sociale »
rapporte HASSANE A. (2015). On fait aussi souvent la distinction entre
ville et village avec les activités dominantes, en tenant compte de la
population : la ville n'a pas une activité essentiellement agricole ou
artisanale, contrairement au village, elle a aussi une activité
commerciale, politique, intellectuelle. Avec cette définition, une ville
pourrait être plus petite qu'une agglomération fortement
peuplée à partir d'un réseau de communication.
Selon JACQUES C. (1985) cités par HASSANE A. (opp
cit), une ville est un milieu physique où se concentre une forte
population humaine, et dont l'espace est aménagé pour faciliter
et concentrer ses activités : habitat, commerce, industrie,
éducation, politique, culture, etc. Les principes qui régissent
la structure et l'organisation de la ville sont étudiés par la
sociologie urbaine, l'urbanisme ou encore l'économie urbaine.
16
Pour d'autres, la ville se distingue du village par certaines
particularités d'aménagement ; la ville du Moyen Age, dira-t-on,
est ce qui possède un mur d'enceinte ; de même pour la
période actuelle on pourra reconnaître la ville à la
hauteur de ses maisons: c'est ce que nous appellerons la définition
architecturale.
Il y a plusieurs types de villes dont nous avons, la petite
ville, la ville moyenne et la métropole considérée de
grande ville. Cette dernière est une agglomération
exerçant un pouvoir de commandement. C'est une ville d'une région
géographique ou d'un pays, qui à la tête d'une aire urbaine
importante, par ses grandes populations et par ses activités
économiques et culturelles, permet d'exécuter des fonctions
organisationnelles, sur l'ensemble de la région qu'elle domine (http//
fr.wikipedia.org/wiki/
grande _ ville.).
Service urbain : Les services urbains sont
des services rendus aux ménages et aux entreprises installés en
ville. Ils sont nés du développement des réseaux
techniques dans les villes du 19ème siècle. Ils sont
organisés en réseaux et ont pour vocation la satisfaction des
besoins fondamentaux, vitaux et quotidiens des habitants de la cité :
eau, Assainissement, énergie, transport, télécommunication
et Technologies de l'information et de la communication.
Service public : Du grecque «
utilitas communis », qui désigne l'intérêt du
peuple, la «chose publique» au-delà des intérêts
immédiats de l'État. Au XIIIème siècle,
le concept prend la connotation d'utilitas publica, qui se
réfère au bien commun. Ce n'est qu'avec la naissance de
l'absolutisme au XVIème siècle que le terme finit par
prendre le terme service publique indiquant la force publique qui "est
instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée".
Un service public est une activité exercée
directement par l'autorité publique (Etat, collectivité
territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire
un besoin d'intérêt général2.
Par extension, le service public désigne aussi
l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Il peut
être une administration, une collectivité locale, un
établissement public ou une entreprise du droit privé qui s'est
vu confier une mission de service public. Dans ce dernier cas, la mission de
service public peut prendre diverses formes : concession, licence, franchise,
cahier des charges, fixation de tarifs, contrôle des investissements.
Certaines de ces activités
2 Intérêt de l'ensemble d'une
population, différent des intérêts particuliers
17
sont liées à la souveraineté de l'Etat
(activités dites régaliennes comme la justice, la police, la
défense nationale, les finances publiques...), d'autres relèvent
du secteur marchand, notamment lorsque les prix et le niveau de qualité
des prestations ne seraient pas ceux attendus par le pouvoir politique, si
elles étaient confiées au secteur privé. Le fondement de
la notion de service public est que, certaines activités sociales
considérées comme essentielles et stratégiques doivent
être gérées selon des critères spécifiques
pour permettre un accès à tous et contribuer à la
solidarité et à la cohésion sociale, culturelle et
économique de la société. Ces activités doivent
donc échapper à la logique du marché et à la
recherche du profit. C'est le cas, en particulier, lorsque sont
nécessaires : des investissements lourds non rentables à court
terme, une gestion à long terme, la sauvegarde d'un bien rare et
précieux, la gestion d'un espace.
Les trois grands principes auxquels sont soumises les
missions de services publics sont la mutabilité (capacité
d'adaptation aux conditions et aux besoins), l'égalité (dans
l'accès au service et dans les tarifs) et la continuité.
Selon PIERRE B. (1998), « l'idée de service
public repose sur le fait que certaines activités sociales doivent
échapper à l'application de la seule logique marchande et
à la recherche du profit, pour être gérés selon des
critères spécifiques, permettant un accès facile de tous
à certains biens et services et concourant à l'équilibre
et à la cohésion économique, sociale, territoriale et
culturelle de la société ». Il ajoute aussi que les
services publics apparaissent ainsi nécessaires pour garantir à
chacun la pleine appartenance à la collectivité. Il y a service
public urbain si une collectivité locale urbaine estime qu'à un
moment donné et dans son aire de responsabilité, un bien ou un
service essentiel pour tous (existant ou nouveau) ne peut être
réalisé uniquement sur la seule logique marchande.
Le modèle africain des services publics est
calqué sur le modèle français qui distingue :
? D'un côté les services publics nationaux : une
entreprise publique nationale, sous tutelle de l'Etat, disposant d'un monopole
et d'un personnel à statut particulier, fournissant sur l'ensemble du
territoire un même service avec la même technique (le raccordement
par exemple) et au même tarif.
? D'un autre côté, des services locaux, une
autorité organisatrice communale déléguant la gestion
à une entreprise privée : « le French model »
cher à la Banque Mondiale, fruit de l'émiettement communal et de
la présence historique des grands groupes privés de services.
18
Service public énergétique :
c'est le système de production, de transport et de distribution à
l'aide d'installation pour la satisfaction des besoins des populations et des
unités industrielles. Les services de l'électricité sont
souvent de nature public, qu'ils soient gérés par le secteur
public ou privé, ils doivent être gérés de
manière politiquement acceptable, socialement équitable et
économiquement viable.
1.1.4.2. Le champ spatial de l'étude
L'Afrique de l'Ouest est une région couvrant toute la
partie occidentale de l'Afrique subsaharienne. Elle comprend approximativement
les pays côtiers au nord du Golfe de Guinée jusqu'au fleuve
Sénégal, les pays couverts par le bassin du fleuve Niger ainsi
que les pays de l'arrière-pays sahélien.
Depuis les indépendances, l'Afrique de l'Ouest
connaît une forte croissance démographique mal maitrisée,
surtout dans les milieux urbains. A elles seules, les villes ont réussi
à accueillir plus de 70 millions d'habitants supplémentaires
répartis dans près de 3 000 villes. Cette croissance urbaine mal
maitrisée et le manque des politiques fiables sont responsables des
carences des équipements publics, de la médiocrité des
services municipaux, des risques sanitaires de l'environnement souligne ROLAND
P. (2001).
L'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui une communauté
des peuples, qui tend à se reconstituer politiquement, avec notamment la
Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
et un espace de civilisation forgé par une histoire millénaire.
Selon le FMI, le PIB PPA global des États membres de la CEDEAO
s'élève à 564,86 milliards de dollars ; ce qui en fait la
25e puissance économique du Monde. Les États
ouest-africains ont créé la CEDEAO avec le but initial de
créer une union économique et monétaire ouest-africaine.
Toutefois, en 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la
stabilité régionale avec la création de l'Economic
Commmunity of West Africa States Cease-Fire Monitoring Group (ECOMOG), groupe
militaire d'intervention qui devient permanent en 1999 ; ce qui lui
confère d'importants moyens de pression diplomatique.
Selon HASSANE A. (2015), l'Afrique de l'Ouest présente
une grande variété géographique et culturelle entre
l'océan Atlantique à l'ouest et au sud, le Sahara au nord, et
approximativement le 10e méridien à l'est. Tandis que
le fleuve Niger est généralement considéré comme la
frontière septentrionale de la région, sa frontière
orientale est plus floue. Certains la placent le long de la
Bénoué, d'autres sur une ligne reliant le mont Cameroun au lac
Tchad. Les États de la CEDEAO revendiquent ouvertement leur
caractère ouest-africain tandis que la Mauritanie y est incluse dans la
définition de l'Organisation des Nations Unies.
19
La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000 et fait
désormais partie de l'Union du Maghreb arabe et de la Ligue arabe. Les
pays ouest-africains peuvent être classés en trois groupes selon
leur position géographique.
D'abord, Les pays du Golfe de Guinée (Côte
d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria) fortement concentré sur
une bande côtière de faible profondeur. Cette bande polarise
l'essentiel du marché régional et c'est là que se trouve
le plus grand potentiel d'échanges régionaux. Ensuite viennent,
Les pays de la façade atlantique (Cap Vert, Sénégal,
Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone et Liberia)
constituent un groupe relativement autonome par rapport au marché
régional et beaucoup plus tourné vers les marchés
mondiaux, notamment européens et en fin Les grands pays enclavés
(Mali, Burkina Faso, Niger) confrontés à de nombreuses
contraintes liées à l'enclavement, l'immensité de leurs
territoires corrélée à une faible densité de
peuplement et aux fortes contraintes écologiques.
Figure 1 : Carte de l'Afrique de l'Ouest
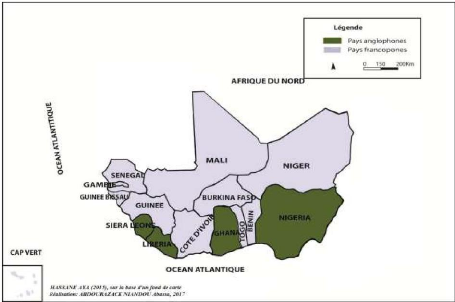
Ainsi, la ville de Niamey capitale du Niger se situe à
l'extrême ouest du pays. C'est dans cette ville que concentre un nombre
plus important de la population urbaine du Niger à cause de ses pouvoirs
politiques et administratifs. C'est aussi le plus gros centre d'affaire par
excellence de l'ensemble du territoire national.
20
Figure 2 : Champs spatial de l'étude

21
1.2. La méthodologie de recherche:
La méthodologie utilisée pour mener cette
étude comporte une recherche documentaire, l'exploitation des cartes,
l'analyse des données statistiques et l'utilisation d'un guide
d'entretien destiné à collecter les données sur le
terrain. Cependant, l'exploitation de cette documentation s'est faite en deux
étapes :
· Une approche signalétique qui classe les
documents par thématique avec des résumés des ouvrages les
plus significatifs ;
· Une approche analytique dans laquelle les documents
ont été analysés et interprétés.
1.2.1. La recherche documentaire :
Cette étape constitue le premier point de la
réflexion sur ce thème et nous a permis d'avoir une idée
sur la documentation afin de mieux comprendre le sujet et ces contours. Elle
s'est déroulée en différents niveaux. D'abord dans les
centres de documentations de la ville de Niamey comme la bibliothèque de
la faculté des lettres et sciences humaines (FLSH), la
bibliothèque du département de géographie, la
bibliothèque de l'Institut des Recherches en Sciences Humaines (IRSH),
la bibliothèque du Centre Culturelle Jean Rouch, au centre de
documentation de l'Institut Nationale de la Statistique (INS), au centre de
documentation de la Société Nigérienne
d'Electricité, puis sur l'INTERNET. A ce niveau plusieurs sites ont
été consultés pour renforcer la documentation obtenue dans
les bibliothèques de la place. Ce qui nous a permis d'avoir une fois de
plus un certain nombre de connaissance sur le sujet. Et en fin au niveau du
centre de documentation regards. Ce dernier nous a été possible
grâce aux relations de Mr BONTIANTI Abdou, Directeur de mémoire et
l'initiative de cette relation. Cette documentation nous a été
envoyée sous forme de lots de documents imprimés et sous forme
électronique.
1.2.2. L'exploitation des cartes :
A ce niveau, nous nous sommes donnés à
l'exploitation des cartes de l'Afrique de l'Ouest sur des sites divers afin de
pouvoir illustrer notre argumentaire. Il s'agit principalement des :
· cartes administratives et politiques ;
· cartes d'évolution de la population urbaine de
l'Afrique de l'Ouest ;
· carte des réseaux électrique de la ville de
Niamey ;
· carte de localisation des endroits ciblés pour
l'entretien.
22
1.2.3. L'analyse des données statistiques :
Pour appuyer notre argumentaire, plusieurs données
statistiques sont utilisées. Ces données ont été
collectées au niveau de l'INS, de la NIGELEC et de la Direction
Nationale de la Météorologie.
1.2.4. L'élaboration du guide d'entretien :
Des guides d'entretien ont été
administrés aux acteurs concernés dans le secteur de
l'énergie électrique à Niamey. Il s'agit essentiellement
du Directeur général de la distribution et du marketing, du
Directeur du Service Régional exploitation et Maintenance des
Réseaux de Distribution de Niamey et plusieurs autres usagers à
travers la ville, dont nous avons l'hôpital national Lamordé,
Niger lait S.A, la SPEN, la SEEN, des ménages et super marchés.
L'administration des guides permet d'avoir l'appréciation et le point de
vue des personnes ressources.
23
Figure 3 : Quartiers de Niamey concernées par
l'entretien

24
CHAPITRE II : BIBLIOGRAPHIE SIGNALETIQUE
Ce chapitre présente l'approche signalétique,
qui classe les documents par thématique avec des résumés
des ouvrages les plus significatifs.
2.1. Le processus d'urbanisation en Afrique de
l'Ouest
La présente bibliographie résume les documents
de base et dégage le point de vue des auteurs par rapport à
l'évolution de l'urbanisation et le changement qu'il accompagne dans des
secteurs socioéconomiques de nos villes.
1) BALLA S. 2009_Urbanisation d'Afrique de l'Ouest :
approche bibliographique des mutations fonctionnelles et morphologiques des
rues. Mémoire de DEA, Université Abdou Moumouni,
département géographie. 93p
Résumé : la plupart des villes
ouest africaines sont d'origine coloniale. L'urbanisation a changé la
morphologie des agglomérations par la production duale de l'espace
aménagé qui est divisée en deux sous ensemble : d'une part
la « la ville indigène » et de l'autre la «
ville blanche » avant 1945, puis, aujourd'hui, « ville
légale » et « ville illégale ». Ces
agglomérations se distinguent par une morphologie fondée sur les
différentiations socioéconomiques des quartiers et de leurs
habitats. Ce processus d'urbanisation a joué sur les formes et fonctions
des rues. C'est ainsi que la rue passe des stades fonction traditionnel au lieu
de nombreux usagers. Aussi, les différents plans de création
d'extension des villes et d'aménagement des rues qui ont suivi, ont
aboutis à des changements qui se traduisent par la multiplication de
leurs fonctions et la diversification de leurs formes.
2) PATRICK G. 1991_Urbanisation, croissance urbaine et
transport en Afrique. 5p
Résumé : Pour cet auteur
l'étude de l'urbanisation présente trois intérêts
:
un intérêt intrinsèque, puisque
l'urbanisation apporte des modifications dans la répartition
géographique et sociale des populations, ainsi qu'une mutation des
activités économiques, puis un intérêt
démographique dans la mesure où la ville va jouer un rôle
primordial dans la transition démographique puisqu'on peut penser que
c'est en ville que les variables démographiques connaissent en premier
une évolution qui se diffusera progressivement dans le reste du pays et
en fin un intérêt statistique parce que cette population urbaine
va
25
représenter une proportion croissante de la population
totale et que, par conséquent, les données urbaines pèsent
d'un poids élevés dans les données nationales.
Il ajoute aussi que cette urbanisation se caractérise
par un faible taux d'urbanisation, un très fort accroissement de la
population urbaine et une forte concentration de la population urbaine dans les
grandes villes, au détriment des villes moyennes.
3) PHILIPPE H. 1970_L'urbanisation de masse en question
.
· quatre villes d'Afrique
noire. Colloques internationaux de
CNRS no539_la croissance urbaine en Afrique noire et a Madagascar.
Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 15, quasi
Anatole-France - Paris -VII. 28p
Résumé : L'auteur souligne
qu'au fur et à mesure que les villes capitales d'Afrique noire se
transforment en de grosses agglomérations, les problèmes
d'urbanisme deviennent extrêmement préoccupants. A partir d'une
certaine échelle, les manques en ce domaine prennent l'aspect de
véritables catastrophes, car un rattrapage devient de plus en plus
illusoire.
4) MOTCHO KOKOU H. 2005_Comportement et attitudes de la
population de Niamey,
capitale du Niger, vis-à-vis des
infrastructures publiques .
· L'invasion de la rue, une règle
établie. Pp179-192
Résumé : les fonctions
politiques, administratives et économiques ont contribués, en
plus de l'exode rural à faire de Niamey la plus grande ville du pays
avec 16,2% du total national. Cependant un déséquilibre se fait
apparaitre entre croissance de la population et les moyens d'encadrements
technique et financiers. L'empreinte de la pauvreté dans la vie
socioéconomique allait amener cette population à adopter des
attitudes et comportements contraires au model urbain choisi au Niger, ce qui
se matérialise par l'invasion des rues.
Cette invasion des rues, qu'elle soit autorisée ou non
est un motif de conflits entre les pouvoirs publics et les acteurs du secteur
informels. Ce qui se traduit par des déguerpissements et des
arrestations. Des populations riveraines ne cessent de condamner cette pratique
porteuse d'insalubrités, de nuisances sonores.
5) AFRICAPOLIS 2008_Dynamique de l'urbanisation ouest
africaine de 1950-2020.
12p
Résumé : depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, l'Afrique de l'Ouest s'est
caractérisée par une urbanisation galopante en raison d'une forte
croissance naturelle et de l'exode rural. Cette partie de l'Afrique reste l'une
des régions les moins urbanisée, mais elle
26
est l'une où la croissance urbaine est la plus rapide
au monde. Cette remarquable évolution de la population ne s'accompagne
pas d'une croissance industrielle et financière et du cout engendre
d'énormes défis.
6) LEONIDAS H. et al 2011_Dynamique d'urbanisation Ouest
africaine. Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ;
perspectives-Ouest-Africaines N°1. 8p
Résumé : L'Afrique de l'Ouest
est le siège depuis d'un demi-siècle, d'un mouvement
d'urbanisation intense. Cette urbanisation et la croissance urbaine concernent
autant les grandes villes que les petits centres urbains. Ainsi, la distance
moyenne séparant les agglomérations a été
divisée par trois, passant de 111 km à 33 km. Cependant les
niveaux de cette urbanisation est différente selon que l'on se trouve
dans les pays côtiers qu'à l'intérieure du continent.
7) IDRISSA W., FREDERIC L. 2005_Urbanisation, consommation
et sécurité
alimentaire en Afrique subsaharienne. 8p
Résumé : La flambée des
prix alimentaire des pays ouest africains a réunis en exergue la
persistance d'une forte dépendance aux importations alimentaire et des
risques sociaux politiques qu'elle peut engendrer dans cette région.
Cette dépendance alimentaire est le résultat d'une urbanisation
accélérée et de l'incapacité des agriculteurs de
ces pays à répondre à cette demande urbaine croissante
alimentaire tant en termes de quantité que de qualité. D'une
autre minière, cette déconnexion entre l'offre et la demande
alimentaire locale serait le produit, d'une part d'une agriculture familiale,
qui est la principale source de production agricole dans ces pays, qui ne
serait pas en mesure d'accroitre suffisamment son rendement et, de l'autre des
changements des comportements alimentaires des consommateurs urbains.
8) DZIONOU Y. 2001_Urbanisation et les
aménagements urbains en question. Université de
Lomé-Togo ; département de géographie. 11p
Résumé : l'extraordinaire
urbanisation que connait l'Afrique subsaharienne est présentée
à travers les défis considérables que les villes posent
aux populations et aux autorités. En dépit des progrès
réalisés dans certaines villes, les méthodes de
planification et d'aménagement urbain ne sont pas à la mesure de
la croissance urbaine. Les irrégularités foncières et
l'inégalité dans l'accès à l'habitat paraissent
toujours non maitrisées.
9)
27
YAYE SAIDOU H. 2007_Croissance urbaine et transport dans
la communauté urbaine de Niamey ; mémoire de maitrise,
Université Abdou Moumouni de Niamey, département de
Géographie. 98p
Résumé : La ville de Niamey
connait depuis la période précoloniale une forte croissance
urbaine. Ainsi, de 1905 à 1950, la croissance moyenne annuelle de la
ville fut de 4,7 % avec des pointes de 17 % en 1905 et 10,6 % en 1926 qui
traduisent l'arrivée massive d'immigrants ruraux attirés par
l'installation de l'administration à Niamey. Cette croissance
démographique de la ville va s'accélérer avec un taux
moyen annuel qui sera de l'ordre de 10 % pendant les années 1960. Ce qui
a favorisé sa multiplication par trois entre 1960 et 1972, passant de 33
816 habitants à 108 000 habitants. Cette population était
estimée 674 950 habitants en 2001. Pendant ce temps, la ville
s'étend horizontalement de façon démesurée faisant
naitre plusieurs nouveaux quartiers à la périphérie tandis
que ceux du centre-ville et péricentral se densifient du fait de la
colonisation par les activités commerciales. L'extension spectaculaire
de l'espace urbain qui est une conséquence de l'essor
démographique a entrainé l'éloignement des zones
d'habitations au centre-ville. Ce qui fait apparaitre des nombreux
problèmes dont celui des transports et déplacement dans la ville
de Niamey.
10) HASSANE A. 2015_Etudes bibliographique sur la
dynamique des villes secondaires satellites des métropoles ouest
africaines. Mémoire de maitrise en géographie,
Université Abdou Moumouni de Niamey. 113p
Résumé : Cette étude
vise à revisiter les études sur les villes secondaires d'Afrique
de l'Ouest et d'en dégager les différentes tendances de leur
émergence et leur contribution au développement de la
sous-région, selon les auteurs et les périodes. Il résulte
de l'analyse de ces travaux le constat d'une insistance sur le rôle du
développement des liens villes secondaires/campagnes dans l'essor
économique, les productions agricoles et les relations commerciales. Par
ailleurs, le rôle joué par les métropoles dans
l'émergence des petites et moyennes villes reste primordial dans bien de
cas. Lieux d'échange des sous-produits de l'agriculture et de
l'élevage, centres culturels et de services, mais aussi espaces relais
entre zones rurales et zones urbaines, les villes secondaires constituent de
véritables leviers de développement en Afrique de l'Ouest.
11) NOMA A. 2011_Centre ville de Niamey en mutation :
l'exemple de Gandatché (Commune II). Mémoire de Maitrise.
Département géographie. UAM. 93p
28
Résumé : L'urbanisation est une
donnée majeure de l'évolution contemporaine des pays du tiers
monde et particulièrement de l'Afrique. Elle exprime de plus en plus une
croissance démographique qui trouve son origine dans la croissance
naturelle de la population urbaine résidente. Contrairement à ce
qu'on a observé dans les années 1970 et 1980, la part de l'exode
rural est bien moindre. La ville de Niamey n'échappe pas à cette
urbanisation galopante. En effet, la croissance démographique et
spatiale de la ville est spectaculaire et pourtant Niamey manque de politique
urbaine conséquente. Le centre-ville de Niamey connait depuis quelques
temps une importante transformation dû à la libéralisation
de l'économie avec la démocratisation de la vie politique. La
mutation qu'on observe à Gandatché n'est pas spécifique
à ce quartier. Elle est relative à une grande majorité des
quartiers du centre-ville de Niamey qui subissent de plein fouet cette
métamorphose. A la place des vieilles maisons en banco à but
essentiellement résidentiel se dressent des immeubles de commerce
à 2 ou 3 niveaux. La fonction du centre historique de même que son
paysage se trouvent ainsi transformés. Mais tous ces changements
laissent apparaitre beaucoup de dysfonctionnement.
12) CENTRE FRANÇAISE SUR LA POPULATION ET LE
DEVELOPPEMENT 1999_Transition urbaine est-elle achevée en Afrique
subsaharienne ? no34
Résumé : En 1950, 28% de la
population mondiale vivait en ville. C'est ainsi que les localités de
plus de 10 000 habitants abritent 0,7 milliards de personnes, dont 36 % dans
les pays en développement. Le taux d'urbanisation attendrait 47,4 % en
l'an 2000 d'après les projections des Nations Unis et les villes
abriteraient 2,9 milliards de personnes, dont 68,7% dans les pays en
développement. Le continent africain n'échappe pas à cette
urbanisation. Ainsi, l'Afrique est le continent le moins urbanisée du
globe mais la forme actuelle de ses villes et le niveau d'urbanisation qui en
résulte, obéissent à un mouvement séculaire.
13) ERIC D. ET FRANÇOIS M. 2009_ La croissance
urbaine en Afrique de l'ouest, de l'explosion a la prolifération. La
chronique du CEPED. Pp1-5
Résumé : En Afrique de l'Ouest,
un habitant sur trois vivait dans une ville en 2010 contre treize en 1950.
Malgré cette croissance urbaine remarquable, le taux d'urbanisation y
demeure l'un des plus faibles de la planète. En effet, la population
urbaine a doublé tous les dix ans entre 1950 et 1970 pour ensuite
connaitre un ralentissement dans les trente années qui suivent. Mais,
entre 2000 et 2020, 500 nouvelles agglomérations franchiront le seuil de
10 000 habitants. Pendant ce temps, la population urbaine y attendra 124
million d'habitant donnant ainsi une nouvelle aire urbaine.
29
14) VINCENT M. 2011_Processus
d'urbanisation de la ville de Kigali, Rouanda :
relation entre la dynamique spatiale et
démographique. Communication pour la chaire ketelet 2011 «
Urbanisation, migrations internes et comportements démographiques.
17p
Résumé : La pression
démographique face à la faible structurelle des institutions
publiques en matière de planification urbaine durable constitue un
facteur bouleversant la physionomie des villes à travers la
densification et l'étalement considérable des quartiers
spontanés, comblant des zones tampons et périphériques.
Dans la ville de Kigali, l'ampleur de cette problématique qui persiste
actuellement a été considérable depuis
l'indépendance du Rwanda en 1962 quand l'effort d'urbanisation formelle
commença à se heurter à des vagues migratoires internes
des populations. Cette étude analyse l'impact de la croissance de la
population sur l'extension et l'occupation de l'espace urbain, la dynamique
d'urbanisation à la fois formelle et informelle qui a
caractérisé cette ville à tel point que plus de 70% de ses
quartiers sont spontanés.
2.2. Urbanisation et besoins énergétiques
des pays ouest africain
La bibliographie concernant cette rubrique met en exergue les
relations entre urbanisation et besoins énergétiques dans les
grandes villes d'Afrique de l'ouest. A cet effet plusieurs auteurs se sont
penchés sur l'effet de la croissance urbaine dans la distribution de
l'énergie électrique dans ces villes. Ainsi nombreux sont ce qui
abordent les changements causés par le phénomène urbain
dans les pays de l'Afrique de l'ouest. Les auteurs clés de cette
rubrique sont principalement ROLAND P., DAOUDA H., LOURDES D. et al, CARINE B.
et al, HALIDOU K. etc.
1) ROLAND P. 2001_ Afriques Noires.
Hachette livre, 43, quai de Grenelle, 75905, Paris
Cedex 15. Pp212-213
Résumé : l'explosion
démographique constitue un des facteurs fondamentaux des dynamiques
contemporaines de l'Afrique noire. Ce domaine où les mutations sont
extraordinaires : celui de l'urbanisation. L'Afrique est depuis longtemps
considérée comme un continent rural, elle s'urbanise sur un temps
exceptionnellement rapide. C'est ainsi qu'elle engendre des profonds
bouleversements économiques, sociaux, culturels et politiques. Ce qui a
amené l'auteur à la qualifiée de révolution
urbaine. Ainsi, les villes d'Afrique sont
30
confrontées à d'incommensurables
problèmes d'aménagement de l'espace, d'équipement,
d'emplois.
Il ajoute aussi que la croissance démographique
explosive et l'insuffisance des moyens financiers sont responsables des
carences des équipements publics, de la médiocrité des
services urbains. Ces contrastes se lisent dans l'état de la voirie et
des réseaux divers ou des inégalités des
équipements se font croire dans ces villes à travers
l'inachèvement des infrastructures dans certains quartiers.
2) DAOUDA H. 2010_Dynamique actuelle du centre-ville de
Niamey ; mémoire de maitrise, Université Abdou Moumouni de
Niamey, département de géographie. 93p
Résumé : Devenu le premier
centre urbain du Niger en 1960 avec 12 000 habitants, Niamey a connu et entrain
de connaitre une évolution démographique très rapide selon
la Banque des données urbaines. Avec 12%, le taux de croissance, la
ville comptait 33 816 habitants à l'indépendance du pays. En
1977, lors du deuxième recensement Niamey faisait 242 973 habitants soit
3% de la population totale du Pays. Au troisième recensement cet
effectif a atteint 398 365 habitants. Le recensement de la population en 2001
établie la population de la ville de Niamey à 674 950 âmes
soit 6,25% de la population totale du Niger.
Pour cet auteur cette forte croissance s'explique par une
forte natalité et une mortalité en baisse liée à
l'efficacité des services de santé. A cela s'ajoute
l'arrivée des jeunes ruraux qui viennent gonfler le cercle de
sans-emplois. Cette émigration rurale a d'ailleurs été
très significative durant les périodes de sécheresses avec
l'apparition des nouveaux quartiers situés à la
périphérie de la ville. Ces jeunes ruraux s'activent dans les
secteurs informels, contribuant ainsi à l'accroissement de la population
urbaine et par conséquent à la demande en besoins alimentaire et
énergétique.
3) LOURDES D. O. et al 2001_Etalement urbain, situation
de pauvreté et accès à la ville en Afrique subsaharienne.
L'exemple de Niamey. In BUSSIERE YVES, Madris Jean-Loup(EDS).
Démographique et transport : ville du nord et ville du sud, l'harmattan.
Pp.147-175
Résumé : Pour ces auteurs, les
capitales de l'Afrique francophone n'ont connu un véritable essor
démographique que durant ces dernières décennies. En
dépit de leurs développements récents et sont tout autant
concentrées que les villes du nord par l'étalement urbain, par le
fait même de leurs croissances rapides. Ces villes connaissent une
urbanisation désordonnée et ce
31
d'autant plus que ces changements de taille se produisent dans
une période de crise économique. Dans des pays déjà
parmi les plus pauvre de la planète, cette persistance de la crise se
traduit par des faibles croissances financières tant pour les
collectivités publiques que pour la grande majorité des
citadins.
Dans cette logique de croissance et de pauvreté, les
interventions publiques ne sont alors pas à l'échelle des besoins
des citadins. Il est d'autant plus difficile pour les pouvoir publics de
répondre à l'explosion démographique que l'habitat
individuel dominant en Afrique de l'ouest entraine une croissance urbaine
horizontale et souvent anarchique.
4) CARINE B. et al 2007_L'accès aux services
essentiels dans les pays en
développement au coeur des politiques
urbaines. Paris, France. 22p.
Résumé : L'urbanisation des
pays en développement se fait aujourd'hui à un rythme
inégal dans l'histoire du monde. Cette situation est d'une
manière générale due au solde démographique local
et de l'autre au flux migratoire. L'anticipation et la prise en charge globale
de ces peuplements, avec ses dimensions technologiques, institutionnelles,
sociales et économiques est un défi majeur de ce siècle.
L'accès aux services urbains essentiels en est aussi une des
composantes.
Il s'agit pour ces chercheurs de faire le point sur les
conditions techniques et socioéconomiques ainsi que les dynamiques
urbaines de développement de la fourniture des services essentiels dans
les pays en développement.
5) HALIDOU K. 2010_ Elaboration du schéma du
réseau de distribution électrique de
la ville de Niamey.
Mémoire de Master spécialisé en Génie Electrique,
Energétique et Energie renouvelable à l'Institut international
d'Ingénierie de l'eau et de l'environnement. 60p.
Résumé : Le présent
document traite de l'élaboration du schéma directeur du
réseau de distribution MT/BT (Moyenne Tension/ Basse Tension) de la
ville de Niamey. Ce qui doit permettre d'aboutir à un schéma
d'évolution de ce réseau pour le court, moyen et long terme. Dans
le cadre de cette étude le calcul prévisionnel de la charge
s'appuie sur les données statistiques exploitation réseau de 1998
à 2008. Ces données statistiques couplées avec des
données du développement démographique de la ville de
Niamey ont permis de faire la projection sur l'évolution de la demande
en énergie de la ville. Ainsi prenant en compte les forces et faiblesse
du réseau, il est proposé des solutions permettant de faire face
à l'évolution
32
de la charge. Les solutions apportées portent
essentiellement sur le renforcement de capacité des lignes, des postes
de transformation et les extensions requises (Résumé de
l'auteur).
6) AHMADOU B. O. 2014_Etat de lieux et enjeux de
l'efficacité énergétique au Cameroun. Atelier
régional sur le climat et l'énergie en Afrique centrale.
Yaoundé du 22 au 24 juillet 2014. ARSEL.12p
Résumé : A travers cette
étude, l'auteur montre d'abord qu'il y a un déséquilibre
entre l'offre et la demande d'énergie électrique, malgré
la libéralisation du secteur de l'électricité au Cameroun
et la privatisation de la SONEL en 2001. Ensuite, il décrit les mesures
qui ont été prises afin d'augmenter l'offre
énergétique. Mais ses mesures se heurtent à des
difficultés majeures liées au manque des capitaux pour faire face
à tous les besoins identifiés.
7) CATHERINE F. V. et al 2007_Developpement des villes
maliennes : enjeux et priorités. Série document de travail
de la région Afrique No 104b. 82p
Résumé : Cette étude
expose l'état des lieux du secteur urbain au Mali et développe
les points d'entrée les plus porteurs en terme d'appui futur au
développement urbain et municipal. Le Mali est un pays faiblement
urbanisé comparé aux autres pays de la région, mais la
croissance urbaine y est très rapide. Le manque d'infrastructures et de
services de base est au coeur de la problématique de l'urbanisation au
Mali. Cette caractéristique résulte de l'insuffisance notoire des
fonds alloués au développement urbain, qui n'ont pas permis de
faire face au rythme accéléré d'urbanisation. Les efforts
d'amélioration de la gestion des villes nécessitent d'être
renforcés dans le cadre du processus récent de
décentralisation. Pour cela, Un engagement du gouvernement dans le
secteur urbain est stratégiquement important à double
égard : par rapport aux objectifs de développement
économique mais aussi de réduction de la pauvreté.
8) OMER T. ET MAMA D. 2008_ La question de l'urbanisation
et de l'offre de service au Benin, en Afrique de l'ouest. 12p
Résumé : Les notions des villes
et de population urbaine posent des problèmes de développement
territorial au Benin. Les communes généralement
constituées d'un noyau urbain entouré par une zone rurale, offre
à leur population des services qui sont très en
deçà des fonctions élémentaires de la ville. A
travers cette étude du taux d'urbanisation théorique et le taux
d'urbanisation réel de 77 communes que compte le Benin, ces chercheurs
montrent qu'on peut appréhender combien, il est difficile de distinguer
les territoires réellement urbains, des territoires ruraux.
9)
33
AFRICA PROGRESS PANEL 2015_Energie, population et
planète : saisir les
opportunités énergétiques
et climatiques de l'Afrique. Rapport 2015 sur les progrès en
Afrique. 32p
Résumé : ce rapport, qui
s'appuie sur une large consultation de responsables de la planification
énergétique, de négociateurs des politiques climatiques,
de chercheurs et de gouvernements africains, présente le point de vue de
l'AFRICA PROGRESS PANEL sur les défis énergétiques et
climatiques. Il propose également un programme de changement et un appel
à l'action destinée non seulement aux dirigeants africains, mais
aussi à l'ensemble de la communauté internationale.
10) OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE 2003_L'énergie et la ville. 8p
Résumé : Les citadins
utilisent plus d'énergie que les autres. En raison des styles de vie et
de production, des modes de déplacement et des modalités
d'aménagement de l'espace, les agglomérations urbaines
représentent plus des 3/4 de cette consommation, alors qu'elles occupent
moins d'un dixième de la surface du territoire. Cette consommation
excessive demande un apport extérieur croissant de ressources naturelles
et donne lieu à des rejets de plus en plus importants de déchets
et de nuisances hors du milieu urbain.
11) AGENCE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 2001_ Ville,
énergie et environnement. Beyrouth (LIBAN) 17, 18 et 19 septembre
2001. Acte du colloque. 232p Résumé :
L'humanité fait face à une forte urbanisation et continuera d'en
connaitre. Pour cela, il faudra dans les 40 prochaines années,
construire dans le monde l'équivalent de mille villes de trois million
d'habitants. Cette révolution urbaine touchera surtout les pays en
développement. Ce qui aura pour conséquence l'augmentation de la
demande des produits et des services énergétiques sans cesse
croissante. En plus des problèmes d'urbanisation et d'aménagement
posé par l'étalement des villes, les responsables municipaux sont
de plus en plus confrontés à des problèmes
d'approvisionnement de toutes sortes de produits, en particulier les produits
énergétiques.
12) ANJALI S ET AL 2012_Accés à
l'électricité en Afrique subsaharienne :
retour
d'expérience et approche innovent. 103p
34
Résumé : Cette étude a
été réalisée dans l'objectif de développer
de nouvelles approches et une capitalisation méthodologique sur la
thématique de l'accès pour tous aux services électriques
en Afrique subsaharienne. La première partie de cette étude est
consacrée à une analyse des enjeux : le faible niveau de taux
d'accès en Afrique subsaharienne doit être mis en perspective avec
la nécessité de concevoir l'équipement et
l'aménagement des territoires en tenant compte des dynamiques de
développements économique et social, ainsi que des impacts des
programmes et des réformes sectorielles entrepris dans le passé.
La deuxième partie se focalise sur des propositions
opérationnelles basées sur une revue des différentes
options techniques de production, notamment en matière d'énergies
renouvelables, dont les récentes évolutions présentent,
certes, un fort potentiel mais également des difficultés. L'enjeu
essentiel que représente la distribution est également
abordé dans ses multiples dimensions. La troisième et
dernière section porte sur les enjeux financiers : mobiliser des
financements nationaux, reflet d'un engagement politique fort, est une
nécessité ; faire le meilleur usage possible des rares dons
disponibles, un enjeu majeur. L'analyse fine de la perception des risques de
projet et de la qualité des porteurs permet d'apporter un
éclairage sur des orientations possibles d'une ingénierie
financière à fort impact.
13) ADEME 2014_L'accès à l'énergie en
Afrique. 5p
Résumé : cet article
présente, les enjeux de l'accès à l'énergie durable
pour tous. Pour cela, l'Agence a eu à faire l'inventaire de plusieurs
années d'expérience sur l'accès à l'énergie
du continent africain.
14) VIJAY M et al 2005_Accroitre l'accès aux services
énergétique pour la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. 124p
Résumé : Ce rapport souligne
les liens entre services énergétiques et réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Il met aussi en
lumière une stratégie pratique pour la fourniture des services
énergétique améliorer en faveur des populations les plus
diminues à travers le monde et surtout celle des pays d'Afrique
subsaharienne.
15) BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE CENTRE DE
DEVELOPPEMENT DE L'OCDE, 2010_ Un meilleur accès à
l'énergie pour les africains. Quatrième forum international
sur les perspectives africaines. 8p.
Résumé : L'accès
à l'énergie est une composante essentielle du
développement économique, social et politique. Il favorise le
développement individuel via l'amélioration des conditions
35
éducatives et sanitaires. Il permet le
développement de l'activité économique par la
mécanisation et la modernisation des communications. Il participe
à l'amélioration de l'environnement économique en
permettant une intervention publique plus efficace, un meilleur respect de
l'environnement et le renforcement de la démocratie. Cependant,
malgré un potentiel énorme en énergies fossiles et
renouvelables, l'Afrique présente des déficits
énergétiques importants dus à plusieurs facteurs. En
conséquence, l'offre disponible pour les populations est largement
insuffisante et la consommation d'énergie s'articule essentiellement
autour de la biomasse.
2.3. Les aspects de la précarité
énergétique en Afrique de l'Ouest
Le concept précarité énergétique
est d'origine Britannique, qui fait référence à une
situation dans laquelle une personne ou un ménage rencontre des
difficultés particulières dans son logement à satisfaire
ses besoins élémentaires en énergie affirme
Fréderic H. et al (2011). En outre, la précarité
énergétique se traduit par une grande diversité de
situations. Elle comprend également une importante composante
subjective. La perception que chacun en a et est relative dans le temps et dans
l'espace. Tous ces éléments laissent le champ libre aux
interprétations. Cette notion se manifeste en Afrique par la hausse du
prix de l'électricité et une insuffisance dans la prestation du
service énergétique. En effet à travers cette rubrique
bibliographique, plusieurs auteurs montrent que la majorité des pays
africains présentent de taux d'électrification inferieur à
la moyenne mondiale.
1) CHRISTINE H. ET AL 2011_Energie,
croissance et développement durable, Une
équation africaine, les études de IFRI.
75p
Résumé : En matière
d'électricité, l'Afrique est le continent de paradoxe : elle est
à la fois un géant énergétique par les ressources
dont elle dispose et un nain électrique par les capacités
réelles sur lesquelles elle peut s'appuyer aujourd'hui. Mais une large
partie de ce continent souffre d'un déficit en énergie
électrique, handicapant son développement économique. En
effet la capacité de production électrique du réseau
d'interconnexion de toute l'Afrique reste faible pour couvrir les besoins des
populations. Quant à la capacité pour l'Afrique subsaharienne,
elle est de 34 GW pour 820 million d'habitants soit l'équivalent de la
Pologne avec ses 38 million d'habitants.
36
L'auteur souligne aussi que cette capacité de
production d'énergie électrique se concentre uniquement dans
quelques pays. Ce qui fait la précarité du réseau
électrique du continent.
2) MOUSTAPHA K. 2014_Energie, on n'est pas tous
égaux. Collectif pour la décence
du droit à
l'énergie(CODDAE). 4p
Résumé : L'accès
à l'énergie et plus particulièrement à
l'électricité est une condition indispensable pour le
développement économique et sanitaire d'un pays. Or le continent
africain souffre d'éventuels problèmes de son approvisionnement
en électricité du faite de sa capacité de production. Ce
qui se traduit au Niger par une précarité
énergétique. Cette dernière se traduit par un taux
très faible d'accès des ménages à
l'électricité, une inégalité d'accès, une
faible utilisation des sources d'énergies renouvelables et une
prédominance à la biomasse.
L'auteur met aussi en évidence la faiblesse du
réseau de distribution sur toute l'étendue du territoire
Nigérien. Cela est de même pour la ville de Niamey ou le taux
d'accès à l'électricité est de 55%. Il est à
noter le prix élevé du Killowater(KW) pour des nombreux
ménages à faible revenu. Ce qui amène l'auteur à
qualifier de « vague chimère », le service public de
l'énergie.
3) ANTOIN E. ET AL 2006_ L'énergie n'est pas au
rendez-vous : état du secteur de
l'énergétique en
Afrique subsaharienne. Diagnostics des infrastructures nationales en
Afrique. 12p
Résumé : Le secteur
énergétique d'Afrique subsaharienne est aujourd'hui en situation
de crise : sa capacité de production insuffisante, approvisionnement
irrégulier, prix très élevés et accès au
réseau électrique très limité.
Caractérisée par la stagnation, la capacité de production
énergétique de la région est inférieure à
celle des autres régions. L'énergie africaine coûte deux
fois plus que celle des autres régions en développement, et son
approvisionnement n'est pas fiable. Dans plusieurs pays, la croissance des
connexions des ménages au réseau électrique est
inférieure à la croissance de la population, avec pour
résultat que le taux d'électrification, déjà
faible, est actuellement en déclin. Les manifestations de la crise
actuelle sont les symptômes de problèmes plus profonds qui sont
passés en revue dans cette étude consacrée aux
institutions du secteur énergétique dans 24 pays de l'Afrique
subsaharienne. Cette étude s'appuie sur les travaux de recherches
entreprises dans le cadre des Diagnostics des Infrastructures Nationales en
Afrique (AICD), une initiative qui réunit plusieurs bailleurs de fonds.
(Résumé de l'auteur)
4) 37
ANDRIS P. 2012_De l'énergie durable pour tous. 45p
Résumé : Le monde en
développement a besoin de l'énergie durable pour soutenir sa
croissance et sortir sa population de la pauvreté afin d'augmenter le
taux d'électrification qui est de 12% seulement dans les zones rurales.
Il relate la manière dont l'union européenne, qui verse plus de
la moitié de l'aide public au développement au niveau mondial,
participe à cette initiative d'accroitre de réduction de la
pauvreté en mettant l'accent sur l'accès aux services
énergétique modernes, l'intégration régionale
à travers des projets de portée régionale et la production
diversifié d'électricité d'origine renouvelable.
5) FREDERIC H. et al 2011_La précarité
énergétique en Belgique.198p
Résumé : Pour ces auteurs, la
précarité énergétique est une problématique
complexe située aux confins d'enjeux sociétaux et
environnementaux majeurs : adéquation des revenus aux besoins
élémentaires pour une vie digne, détermination de ces
mêmes besoins, droit au logement décent et droit à
l'énergie, inclusion/exclusion sociale, défi climatique,
performance énergétique des bâtiments, etc. Cette notion
relative est fortement dépendante du contexte d'analyse et il est donc
essentiel de prendre en considération les facteurs clés qui
pourront modifier ce contexte dans un avenir plus ou moins proche.
6) GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DU DEVELOPPEMENT,
2015_Problématique de l'accès à
l'électricité au Togo. Afrique de l'ouest Policy note.
40p
Résumé : Cette étude
montre qu'au Togo, les ménages pauvres qui n'ont pas accès
à l'électricité utilisent des sources d'énergie
plus chères. Le taux d'accès à
l'électricité, estimé à 27% dans le pays, est la
conséquence de l'absence d'investissement et de restructuration sur la
chaîne de valeurs de l'électricité dominée depuis
plus de 35 ans par le secteur public. Les métiers de production, de
transport, de distribution et de vente de l'électricité ne sont
pas assez segmentés pour réaliser des économies
d'échelles ni assez concurrentiels pour conduire à plus
d'efficacité. C'est ainsi que de 1971 à 2013, la consommation
d'électricité s'est multipliée par neuf et la production
seulement par deux. L'application d'un prix de vente de
l'électricité inférieur au coût de production locale
mais en même temps supérieur au prix de
l'électricité importée reste un grand défi à
relever. Une réforme structurelle et en profondeur sur toute la
chaîne de valeurs de l'électricité, y compris la
participation du secteur privé, permettra d'avoir une meilleure
lisibilité sur la rentabilité des différents
métiers de
l'électricité. Ces restructurations
déboucheront sur d'autres mesures idoines pour la production de
l'électricité en grande quantité et aux meilleurs
coûts afin d'augmenter le niveau d'accès
7) DEDJINOU V. F. 2014_Analyse des dommages des coupures
d'électricité à Abomey-Calavi au Benin : Cas des
ménages. Université d'Abomey-Calavi, faculté des
sciences économiques et gestion ; master en science économique.
22p
Résumé : Ce travail propose
une analyse descriptive des dommages liés aux coupures
d'électricité au Bénin à partir d'une enquête
auprès des ménages. Cet article, qui porte sur
l'évaluation des dommages des coupures d'électricité met
en évidence les stratégies adoptées par les ménages
pour faire face à l'inconstance de l'offre de
l'électricité et les consentements à payer des
ménages pour éviter les coupures non planifiées sur le
réseau de distribution.
8) ONPE 2015_Les chiffres clés de la
précarité énergétique. Édition No1.
36p
Résumé : cette étude a
pour rôle de présenter le phénomène de la
précarité énergétique tout en montrant certains de
ses éléments, comme la qualité du parc de logement,
l'évolution des prix énergétiques ou des mesures des
coupures. L'étude présente aussi, les différents
indicateurs permettant de quantifier le phénomène et les
dispositifs d'action de lutte contre la précarité
énergétique.
9) DJIBY D. et al 2009_ Le Sénégal face
à la crise énergétique mondiale : enjeux de
l'émergence de la filière des biocarburants. 52p.
Résumé : A travers cette
étude l'auteur aborde d'abord, la situation énergétique de
l'Afrique de l'Ouest en générale et du Sénégal en
particulier, en la plaçant dans un contexte de crise mondiale. Puis
analyse le potentiel et les expériences du Sénégal en
matière de biocarburant.
10) ALEXANDRE B. ET AL 2011_Precarite
énergétique : état des lieux et propositions
d'action.36p
Résumé : cette étude
donne une explication rationnelle de la précarité
énergétique. En effet, cette dernière est la
résultante de plusieurs facteurs et affecte surtout les ménages
à faible revenu. Pour cela, il fait un état des lieux de la
précarité énergétique pour finir par dresser des
pistes permettant de sortir de ce phénomène qui tend à
être mondiale.
38
11) ANDRE P. 2005_Problematique
énergétique des Etats Unis.8p
39
Résumé : cette étude
présente l'historique de la production pétrolière tout en
montrant l'évolution pétrolière des Etats-Unis. L'auteur
évoque aussi les aspects actuels de la situation
énergétique du pays.
12) BRUNO M. 2013_La précarité
énergétique : posé la question du coût du logement
en France. 4p.
Résumé : la
précarité énergétique illustre les
difficultés croissantes d'une population à joindre les fins de
mois. En effet, elle devient un symbole de fragilisation des populations de
classe moyenne. Cette précarité qui est le résultat de
plusieurs phénomènes qui se cumulent demeure l'une des causes du
prix élevé du logement.
13) MURIEL B. 2011_Precarite énergétique
dans les logements et les déplacements domicile-travail en
Rhône-Alpes. 33p
Résumé : cette étude
fait un état des lieux de la précarité
énergétique et montre ces causes et conséquences sur le
Rhône-Alpes. Elle analyse aussi le phénomène à
l'aide d'une approche statistique et géographique.
14) MARION C. 2014_Precarite et
vulnérabilité énergétique dans
l'agglomération
grenobloise. 28p
Résumé : Ce travail consiste
à synthétiser et diffuser les éléments de
connaissance d'une problématique sur le territoire de
l'agglomération Grenobloise. Il fait un état des lieux de la
précarité et de la vulnérabilité
énergétique de la ville et croise les constats issus de
l'habitat, des déplacements, de l'environnement et du social. Cet
état des lieux de la vulnérabilité
énergétique s'appuie sur les connaissances actuelles et pose des
jalons sur la définition du problème que sur sa
réalité dans l'agglomération Grenobloise.
15) EDF et Col 2011_Etat des lieux régionaux de la
précarité énergétique. Mobilisation
des
acteurs en PACA. 64p.
Résumé : le présent
document fait un état des lieux de la précarité
énergétique dans le but de mieux caractériser ses
phénomènes. Cet état de lieux vise à renforcer la
connaissance des acteurs et des actions de lutte contre la
précarité énergétique, consolider la mise en
réseau des initiatives menées à l'échelle locale,
départementale ou régionale afin de leur assurer
visibilité, productibilité, pérennité et encourager
l'émergence d'une dynamique structurelle de réalisation d'action
en adéquation avec les besoins identifiés.
16)
40
OBSERVATOIRE INTERNATIONALE DES COUTS ENERGETIQUES
2006_Etude internationale sur les prix de l'électricité.
20p.
Résumé : Cet article,
présente l'évolution des prix d'électricité dans
différents pays à l'échelle d'une année. Il montre
aussi, l'évolution du prix intervenu entre 2001 et 2006 puis fait
l'analyse de ces prix d'électricité à l'échelle
internationale.
17) SARAH B. 2006, L'accès à l'eau et
à l'électricité dans les pays en
développement.
Comment penser la demande ? institut du
développement durable et des relations internationales. Paris France.
125p.
Résumé : L'objet de cette
étude est de mettre en débat un certain nombre des questions
concernant l'analyse de la demande de services essentiels dans les programmes
de développement. La méthodologie adoptée, par retour
d'expériences, repose sur une série d'études de cas
reprenant quelques programmes ou politiques d'accès à l'eau ou
à l'électricité dans des pays en voie de
développement, sur la base desquelles, l'auteur cherche à mettre
en perspective la « perception de la demande » des
initiateurs des projets et l'évaluation qui en est faite. L'approche
choisie ne vise ni à l'exhaustivité ni à la
représentativité dans l'étude des programmes de
développement. Elle permet de poser les bases empiriques d'une
réflexion sur les enjeux liés à la définition de la
demande en services.
2.4. Les politiques énergétiques en
Afrique de l'Ouest :
La documentation existant dans cette partie traite en
général de la politique énergétique de l'ensemble
du continent Africain et en particulier des Etats de l'Afrique de l'ouest.
C'est ainsi que les différents Etats de l'espace CEDEAO et UEMOA ont
entrepris depuis quelques années la mise en place des projets et
commission visant à augmenter l'efficacité
énergétique de la sous-région afin de permettre
l'accès à tous aux sources d'énergie modernes. Ses
politiques visent en générale l'exploitation des sources
d'énergie nouvelles et plus particulièrement l'utilisation de
l'énergie photovoltaïque. Ce qui permettra de réduire la
pauvreté à travers l'accès à tous à
l'énergie et d'accroitre la préservation de l'environnement par
l'utilisation des sources d'énergies renouvelables.
1) CEDEAO 2012_Politiques en matière
d'énergie renouvelable de la CEDEAO. 102p.
Résumé : L'objectif de la
politique en matière d'énergie renouvelable de la CEDEAO (PERC)
est d'assurer que de plus en plus des sources d'énergies renouvelables
comme les
41
énergies solaires et éoliennes, les petites
centrales hydrauliques et les bioénergies alimentant le réseau
électrique et assurent l'accès aux services
énergétiques dans les zones rurales. La politique se concentre
essentiellement sur le secteur de l'électricité, mais envisage
aussi d'autres questions primaires lesquelles les usages thermiques dans le
secteur de l'énergie domestique et la production potentielle des
biocarburants. Cette politique vise aussi à encourager la
création d'emplois et le développement économique tout au
long de la chaine de valeur technologies liés aux énergies
renouvelables comme la production, l'installation, la construction ou
l'exploitation et l'entretien (Résumé de l'auteur).
2) CEDEAO 2012_Politique sur l'efficacité
énergétique de la CEDEAO. 72p.
Résumé : le système
énergétique de l'Afrique occidentale est confronté aux
défis interdépendants de l'accès à
l'énergie, de la sécurité énergétique et de
l'adaptation au changement climatique. De plus, au cours de douze
dernières années, la région ouest africaine traverse une
crise énergétique qui entrave son développement
socioéconomique et affecte particulièrement les groupes de
population à faible revenus. Pour relever ces défis, la CEDEAO a
pris des mesures à adapter et mettre en oeuvre pour une politique de
l'efficacité énergétique.
Cette politique de la CEDEAO contribuera aux succès de
ses objectifs pour le secteur énergétique, notamment pour la
sécurité énergétique et l'accès aux services
énergétiques. L'objectif de la CEDEAO à travers cette
politique est le développement des énergies photovoltaïques
afin d'atteindre l'énergie durable pour tous, visant l'accès
universel aux services énergétiques d'ici 2030. Ce qui
permettrait le développement de condition de vie des populations de la
région en réduisant les coûts des factures
énergétiques, et en rendant l'accès à
l'énergie plus favorable et plus facile dans les régions urbaines
et rurales. Cette politique permettra également l'approvisionnement en
énergie pour tous les sévices publics et va réduire les
externalités environnementales négatives de l'utilisation de
l'énergie.
3) CRI DE CIGOGNE(CDC) 2009_Bilan
énergétique et perspectives pour une
politique
énergétique ambitieux au Niger. 27p.
Résumé : Cette étude
vise à présenter de façon aussi intelligible que possible
les données disponibles sur le secteur énergétique
Nigérien et à dégager des objectifs clairs que doit
atteindre la politique énergétique au Niger. Pour mener à
bien cette politique un état de lieu a été dressé
sur les potentialités énergétiques du pays. L'étude
s'est ensuite portée sur une analyse critique de la politique actuelle
afin de voir des pistes de réflexion pour une politique ambitieuse.
4)
42
MAÏNA B. 2011_Etude sur le partage des
bénéfices issus de la vente de l'électricité
de
Kandadji. Rapport. 36p
Résumé : Le secteur de
l'énergie au Niger présente des caractéristiques suivantes
: faible taux d'accès aux services énergétiques modernes
(SEM), moins de 6,5% avec pour corollaire la dégradation du maigre
couvert végétal par l'utilisation exclusive du bois compromettant
ainsi la survie des générations futures et discrimination
prononcée de l'accès au SEM, entre les villes et les
campagnes.
Devant cette situation, le gouvernement Nigérien avait
entrepris en 2004, une politique énergétique convenable afin
d'assurer l'approvisionnement énergétique à un prix
abordable. La politique a pour objectif d'assurer la sécurité de
l'approvisionnement énergétique à travers une promotion
des énergies de sources variables. Dans le but d'atteindre ces
objectifs, plusieurs stratégies ont été formulées
par les autorités administratives.
5) MINISTERE DE MINE ET DE L'ENERGIE DE LA COTE D'IVOIRE
2012_Defis et
enjeux du secteur de l'énergie en côte
d'Ivoire : Mesures d'urgence et plans à moyen et long termes.
Séminaire national sur l'énergie 2012 ; plan d'action et
d'investissement en production-transport. 5p.
Résumé : Le système
électrique Ivoirien connait depuis quelques années
d'énormes contraintes au niveau de la capacité de son parc
d'ouvrages de production face à la demande et de la fiabilité de
son réseau de transport. Le réseau de transport du système
électrique ivoirien n'est plus adapté pour assurer en toute
sécurité le transit nécessaire pour satisfaire la
puissance appelée, notamment en période de pointe de la demande.
L'insuffisance de la mise en oeuvre des plans directeurs successifs a conduit
à la dégradation de la qualité du service du réseau
électrique ivoirien en raison d'une inadéquation de l'offre et de
la demande en énergie électrique.
Devant cette situation commune à tous les pays
d'Afrique Subsaharienne, les Chefs d'Etat des pays de l'espace CEDEAO avaient
mis en place le système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain
(EEEOA) avec un plan d'actions dans lequel le système électrique
ivoirien occupe une position privilégiée grâce aux lignes
d'interconnexion existantes ou envisagées avec les pays voisins. (
Résumé de l'auteur)
6) 43
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE ET LA NIGELEC 2015_Projet de
renforcement et d'extension des réseaux électrique des villes de
Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Zinder, Maradi et Tillabéri. Rapport.
153p.
Résumé : la situation de
l'énergie électrique du pays est caractérisée par
une insuffisance de l'offre et la dépendance vis-à-vis de
l'extérieur, les faibles taux d'accès, l'insuffisance et le
vieillissement du parc de production, de transport et de distribution. Ce qui
conduit à la mauvaise qualité du service, l'inadéquation
du tarif et l'absence de régulation. Dans le cadre de la recherche
continue de l'amélioration de ses prestations, la NIGELEC a
initié le projet de « Renforcement et d'Extension des
réseaux électriques des villes de Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez,
Zinder, Maradi et Tillabéri ». Ce projet vise l'atteinte d'une
meilleure satisfaction de la demande électrique en vue de permettre
l'accès d'un plus grand nombre des populations.
7) BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE FAD
2012_Politique du secteur de l'énergie du groupe de la banque
africaine de développement. 39p.
Résumé : La présente
politique du secteur de l'énergie fournit un cadre général
pour les opérations du Groupe de la Banque Africaine de
Développement dans le secteur de l'énergie. Elle vise un double
objectif : appuyer les efforts des pays membres régionaux à
fournir à l'ensemble de leurs populations et aux secteurs productifs,
l'accès à des infrastructures et à des services
énergétiques modernes, fiables et à un coût
abordable et les aider à développer un secteur de
l'énergie viable au plan social, économique et
environnemental.
La politique souligne qu'un accès adéquat
à l'énergie est essentiel pour le développement social et
économique du continent. Pourtant, la plupart des pays africains sont
confrontés à un accès inadéquat à des
services énergétiques modernes, fiables et à un coût
abordable, en particulier pour les populations à faible revenu. En
même temps, le secteur énergétique du continent a besoin
d'évoluer rapidement pour être en mesure de répondre aux
préoccupations environnementales locales et mondiales, en particulier le
changement climatique, et de réduire de façon significative la
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles qui sont souvent
importés. Par conséquent, bien que l'objectif premier de cette
politique soit de répondre aux besoins énergétiques
urgents, la Banque africaine de développement (BAD) est
déterminée à soutenir l'adoption progressive par les pays
membre régionaux d'une trajectoire de croissance durable et sobre en
carbone. Pour cela plusieurs principes sont formulés afin d'atteindre
ces objectifs combien de fois importants.
8) 44
JEAN PIERRE F ET AL 2009_Energie en Afrique à
l'horizon 2050. Paris. 84p.
Résumé : En comparaison
à son poids démographique l'Afrique consomme peu
d'énergie. En effet, en Afrique subsaharienne, la consommation par
habitant et par an (hors Afrique du Sud) est de l'ordre de 100 kilos
d'équivalent pétrole contre 8000 aux États-Unis et 4000
dans les pays OCDE. Cette situation est à la fois cause et
conséquence du faible développement économique. Plus de 60
% de la population africaine vit avec moins de 2 dollars par jour et plus de 60
% de la population africaine n'a pas accès à l'énergie
commerciale et doit se contenter du bois de feu. A terme, l'augmentation
prévisible de la population et l'amélioration du niveau de vie
entraîneront des besoins accrus en énergie Cette situation est
paradoxale dans la mesure où l'Afrique est riche en ressources
naturelles, et tout particulièrement en pétrole, gaz et
charbon.
Le développement de l'Afrique est aussi freiné
par les inégalités énergétiques propres au
continent dans la mesure où l'essentiel de la consommation et de la
production d'énergies non renouvelables sont concentrées en
Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Face à ces
inégalités, les pays africains doivent sans doute apprendre
à mieux gérer leurs ressources naturelles en favorisant leur
consommation locale et en améliorant l'utilisation des revenus issus de
leurs exportations. L'Afrique devrait aussi favoriser le développement
du secteur des énergies renouvelables qui reste jusqu'à
maintenant largement inexploité : l'Afrique dispose en effet de
«gisements» substantiels d'énergie hydraulique et dans une
moindre mesure d'énergie éolienne, solaire et
géothermique.
9) DJEZOU W. B. 2009_ Analyse de la consommation
d'énergie et gestion durable en Côte d'Ivoire.35p.
Résumé : Le
développement durable passe inéluctablement par la
résolution de la question énergétique qui est au coeur de
toute l'activité économique. Notre étude s'inscrit dans
cette optique car elle analyse la consommation d'énergie domestique en
Côte d'Ivoire qui menace la forêt et recherche par la même
occasion les moyens de sa gestion durable. Il ressort de l'étude que les
variables économiques les plus pertinentes pour une consommation durable
des combustibles domestiques sont les prix relatifs gaz/charbon de bois et le
revenu en milieu urbain et le revenu en milieu rural. Pour atteindre les
objectifs de l'étude, nous proposons la mise en oeuvre dans
l'activité d'exploitation forestière à la fois une
réglementation tarifaire efficace basée sur la taxe Pigouvienne
et un système de reboisement populaire à l'effet de
contrôler le processus de déforestation. Ces mesures doivent
être accompagnées d'une politique d'amélioration du niveau
d'éducation des ménages, de l'augmentation des points de vente de
gaz butane, de la poursuite du processus d'urbanisation et de l'extension du
réseau
45
électrique. Toutefois, ces actions doivent s'inscrire
dans le cadre plus général des politiques de lutte contre la
pauvreté (Résumé de l'auteur).
10) MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE DU NIGER
2004_Déclaration des politiques énergétiques.
14p.
Résumé : Au Niger, tout comme
dans la plupart des pays en voie de développement, l'accès aux
services énergétiques modernes est fortement discriminatoire
suivant qu'il s'agisse du milieu urbain ou rural. Cette politique
d'approvisionnement inéquitable en énergie se traduit par une
forte disparité du taux d'accès aux services
énergétiques entre différentes zones et cela s'observe
surtout dans le secteur de l'électricité.
Or la priorité est à l'heure actuelle
donnée au développement économique et social en
conformité avec les Objectifs du Millénaire pour le
Développement qui sont subordonnés à
l'établissement des infrastructures essentielles pour le
développement dont l'exploitation requiert l'utilisation de
l'énergie. C'est dans ce cadre l'Etat du Niger et ses partenaires se
sont fixé des objectifs visant à produire et utiliser partout
sans discrimination entre zone, une énergie qui soit viable sur le plan
économique, social et environnemental. A travers cette
déclaration, le gouvernement s'est proposé de dégager les
orientations à observer dans le secteur de l'énergie, en
conformité avec celles de la communauté internationale, afin
d'impulser une dynamique de développement en harmonie avec le reste du
monde.
11) BENJAMIN P. ERIC B ION H. 2011_Programme
linéaire pour la gestion de l'énergie électrique d'un
habitat. Moret sur loin France. 10p.
Résumé : Cette étude a
pour objectif principal d'améliorer la gestion énergétique
d'un habitat multi sources et multi usages. Les contextes actuels
économiques et énergétiques, nous amène à
concevoir de nouvelles approches, afin d'optimiser la gestion d'un parc
électrique multi sources. Il s'agit de développer un outil d'aide
à la décision, capable de proposer la meilleure solution d'un
point de vue économique, sans altérer le confort des occupants,
c'est-à-dire en répondant entièrement au besoin à
un moment donné. Pour cela, la programmation linéaire,
appliquée grâce à l'algorithme du simplexe, permet de
déterminer la solution optimale d'une fonction objectif en tenant compte
d'un certain nombre de contraintes, comme le prix d'achat au réseau ou
encore l'intermittence de la production des ressources à énergies
renouvelables.
46
Conclusion partielle :
Au terme de ce chapitre, on constate une diversification de la
documentation. Mais, cette dernière est surtout dominée par des
auteurs internationaux que nationaux dû principalement à
l'insuffisance des écrits sur la question de l'énergie
électrique.
47
CHAPITRE III : ANALYSE DE LA DYNAMIQUE
URBAINE ET DE
LA PRECARITE DE L'ENERGIE
ELECTRIQUE DANS LES GRANDES VILLES
D'AFRIQUE DE
L'OUEST
Depuis l'époque coloniale en Afrique de l'Ouest, on
assiste à la multiplication des centres urbains. Ainsi, plusieurs villes
à travers l'espace Ouest Africain dont, Niamey ont vu le jour durant
cette période. La ville de Niamey, capitale du Niger, connait une
urbanisation mal maitrisée. Cette urbanisation ajoutée à
d'autres phénomènes n'est pas sans conséquence sur l'offre
des services urbains surtout celle du secteur de l'énergie
électrique.
3.1. Le processus d'urbanisation en Afrique de
l'Ouest
La région Ouest africaine connait depuis quelques
décennies une forte urbanisation. En effet l'étude de THOMAS A.
(2012), montre que l'Afrique de l'Ouest s'est fortement urbanisée depuis
1960. Ainsi, la population urbaine de l'ensemble de la région est
passée d'un peu plus de 12 million en 1960 à près de 117
million en 2010, soit une multiplication par 10 en 50 ans. Le poids relatif de
la population urbaine par rapport à la population rurale est aussi
passé de 1/6 en 1960 pour presque atteindre la parité urbaine en
2010. D'après cet auteur, cette forte urbanisation de la région
est la conséquence d'un taux de croissance élevé durant
ces dernières décennies. Ce qui prouvera que la région est
dans une première phase de transition démographique et cela se
caractérise par une réduction de la mortalité et le
maintien d'un taux de natalité élevé.
Même si l'Afrique de l'Ouest demeure l'une des
régions les moins urbanisées, sa population urbaine (39 %)
s'accroit sans discontinue bien que les facteurs de cette croissance soient
différents selon les périodes. Elle est l'une de celles où
la croissance urbaine est de plus rapide au monde d'après une
étude du Centre Française sur la Population et le
Développement (1999) et BALLA S. (2009). Ce qui, selon BALLA (Opp cit)
donnera une nouvelle forme à la ville par sa division en deux
sous-ensemble : d'une part la « ville indigène » et
de l'autre la « ville blanche » avant les
indépendances, puis aujourd'hui, « ville légale »
et «ville illégale ». En effet, cette
morphologie est fondée sur les différentiations
socioéconomiques des quartiers et de leurs habitats dont, on a le
centre-ville et péricentral où les infrastructures sont au
rendez-vous et la périphérie dans laquelle habitent les
populations démunies. On assiste alors
48
à la montée du chômage, à la
faiblesse d'accès aux services et infrastructures de bases, à
l'informalisation généralisée, à la
promiscuité et au développement anarchique de vastes quartiers
spontanés et des bidonvilles. C'est le cas par exemple de la ville de
Kigali au Rouanda où, l'étude de VINCENT M. (2011) montre que 70
% de ses quartiers restent spontanés.
Le caractère du phénomène urbain de
l'Afrique subsaharienne, rapide et récent, a battu les records de
croissances urbaines souligne ROLAND P. (2001). Ce qui posera d'énormes
problèmes surtout en termes d'urbanisme comme l'affirme PHILIPPE H.
(1970). Pour cet auteur, ses problèmes d'urbanisme seront difficiles
à résoudre parce que ces villes d'Afrique noire n'ont pas de
moyens pour mener à bien une politique de rattrapage3.
Selon les études d'AFRICAPOLIS (2008), l'urbanisation
de l'Afrique de l'Ouest a commencé pendant la deuxième guerre
mondiale et avait progressivement pris d'ampleur au fil des années.
D'après ces études, cette urbanisation est due principalement au
croit naturel des villes et l'émergence des nouvelles
agglomérations. Cependant, elle se diffère de celle qu'ont connu
les pays développés car c'est une urbanisation qui ne
s'accompagne pas par des infrastructures industrielles et du coup, expose les
citadins à des nombreux problèmes. C'est ainsi que, les
irrégularités foncières et l'inégalité dans
l'accès, à l'habitat paraissent toujours non maitrisées
comme affirmait DZIONOU Y. (2001). Mais cette urbanisation se fait de
manière inégale d'une part entre les pays et de l'autre, entre
les villes d'un même pays soulignent PATRICK G. (1991) et LEONIDAS et al
(2011). Ainsi, les villes des pays côtiers sont fortement
urbanisées (40-50%) que ceux de l'intérieur du continent (moins
de 25%). En effet, le niveau d'urbanisation est plus élevé dans
ces pays côtiers parce qu'ils n'ont pas connu des crises sociopolitiques
majeures. Cette inégale urbanisation s'observe aussi au
niveau des villes d'un même pays où on constate une multiplication
des populations des villes capitales de l'Afrique de l'Ouest au
détriment des villes moyennes et petits centres. C'est le cas par
exemple de la ville de Niamey au Niger qui reçoit plus de nouveaux
citadins au désavantage des autres villes du pays affirme MOTCHO KOKOU
H. (1991).
La carte n°4 traduit de manière explicite la
multiplication rapide des centres villes de la région Ouest Africaine de
1950 à 2010.
3 Politique visant à résoudre de
façon définitive tous les problèmes liés au
processus d'urbanisation.
49
Figure 4 : Evolution du semi des villes en Afrique de
l'Ouest

Source : Africapolis 2009, Hassane A., 2015
|
En 1950 : 7,5% (taux
d'urbanisation) 125
agglomérations urbaines Population urbaine .
· 4 millions
d'habitants
|
En 2000 : 31 % (taux
d'urbanisation) 992
agglomérations urbaines Population urbaine .
· 78 millions
d'habitants
|
Il ressort de l'analyse de ces deux cartes que
l'évolution de la population urbaine au sein de l'Afrique de l'Ouest.
Ainsi, il est constaté une multiplication des centres urbains entre 1950
et 2000. Ces centres étaient passés de 125 en 1950 à 992
en 2000. Entre ces deux périodes, il est constaté une
évolution du taux d'urbanisation passant de 7,5% pour une population
estimée à 4 millions d'habitants à 31% pour une population
d'environ 78 millions d'habitant. Soit une multiplication du nombre de la
population par 19,5 en espace d'un demi-siècle.
Selon ERIC D. et FRANÇOIS M. (2009), cette population
urbaine continuera de croitre et la région comptera 500 nouvelles
agglomérations entre 2000 et 2020, qui atteindront le seuil de 10 000
habitants. L'Afrique de l'Ouest comptera alors autant d'agglomération
que l'Amérique du Nord. Pendant ce temps, la population urbaine
africaine atteindra 124 million d'habitants contre 74 million en 2000. Il
faudra donc compter 50 million d'habitants supplémentaires. A cet effet,
on assistera d'après ces auteurs à un métropolisation
marqué par la prolifération des petites agglomérations.
Cette reconfiguration rapide de la population a des incidences
considérables sur la géographie économique, les
comportements sociaux et alimentaires de la région ouest-africaine.
C'est ainsi que IDRISSA W. et al (2015), ont montré que l'urbanisation
est l'une des facteurs de la hausse des prix alimentaires dans les villes
d'Afrique de l'Ouest. En effet, du fait de l'inadéquation entre l'offre
et la demande alimentaire, les populations de ces villes assistent à la
cherté des prix des denrées alimentaires car, ces derniers sont
importés des zones rurales
50
qui connaissent une régression significative de leurs
rendements agricole dû au phénomène du changement
climatique que connait la région depuis quelques décennies. Ce
qui va conduire les acteurs du secteur agricole à promouvoir
l'agriculture urbaine plus intensive reposant sur l'investissement et
l'expertise d'opérateurs privés. C'est ainsi que l'étude
de HASSANE A. (2015) montre que l'urbanisation est l'un des enjeux majeurs du
développement économique de nos pays car permet l'extraversion
des économies rurales à travers la modernisation du secteur
agricole.
Le Niger à l'instar des autres pays de la
sous-région connaît une forte urbanisation. En effet, sur une
population évaluée en 1988 à 7 25 383 habitants, le Niger
comptait 1 113 582 personnes vivant dans des agglomérations de plus de 2
500 habitants. En 1960, Cette population était estimée à
190 000 personnes pour une population totale de 3 051 000 habitants. Entre ces
deux dates, la population urbaine a été multipliée par 3,
passant de 6,22 à 15,35 % souligne MOTCHO KOKOU H. (1991). Cette
croissance urbaine est selon l'auteur, le résultat de plusieurs facteurs
dont entre autres, le croit naturel, l'exode rural, l'annexion de certains
villages et de leur irritation en centre urbain. Cette urbanisation ajoute
MOTCHO, s'effectue de façon inégale entre différentes
villes du pays. En effet, c'est Niamey qui reçoit l'essentiel des
nouveaux citadins, du fait du poids de ses fonctions de capitale politique et
économique dans un pays où le secteur public continue à
jouer un rôle fondamental.
Né de la colonisation, la ville de Niamey comptait 1
730 habitants en 1931 ; vingt-deux ans plus tard, en 1953, sa population
était passée à 15 710 habitants soit une croissance
annuelle de 7%. A partir de 1970, ce taux augmente pour atteindre 10%. En 1988,
selon le résultat provisoire du recensement général de la
population, la capitale du Niger comptait 398 265 habitants ajoute MOTCHO KOKOU
H. (opp cit). Cette croissance s'est poursuivie pour atteindre 674 950
habitants en 2001 (RGP/H 2001) et plus de 1 500 000 aujourd'hui selon les
projections à partir du recensement 2012 qui estimait la population de
Niamey à 1 026 848 habitants. Ces chiffres expriment l'ampleur de la
croissance démographique de la ville de Niamey. Ce qui fait apparaitre
des disparités entre croissance de la population et besoins
d'encadrement techniques et financiers affirme MOTCHO KOKOU H. (2005). Et cela
amènera la population de la ville à adopter des comportements
contraires au model urbain choisis à travers l'invasion de la rue. Cette
invasion de la rue ajoute l'auteur, qu'elle soit légale ou pas, est un
facteur de mécontentements entre les autorités publiques et les
acteurs du secteur non structuré. C'est ainsi qu'on assiste à des
déguerpissements et arrestations de plusieurs ordres. C'est de cette
situation que sont victime actuellement les populations de la ville de Niamey
et de Zinder au Niger. Cette situation de déguerpissement permettra
selon les
51
autorités de la place de dégager les trottoirs
des principales voies de ces villes et d'éviter la pollution sonore au
niveau des écoles et établissements publics. Toutefois, cette
opération dont sont victime ses deux villes est source
d'insécurité. En effet, on constate une recrudescence des
attaques de populations par des malfrats pendant certaines heures de la
journée surtout les nuits. Et cela parce qu'aucune mesure
préalable d'éclairage public de ces espaces concernés par
l'opération n'a été prise.
Parallèlement à cette croissance
démographique, la ville s'étend de façon
démesurée affirment YAYE SAIDOU H. (2007) et NOMA A. (2011).
C'est ainsi qu'en espace de 50 ans, la superficie urbanisée de la ville
est passée de 800 ha en 1960 à plus de 12 000 aujourd'hui tandis
que la population est multipliée par 30 souligne HASSANE (2009). Cette
croissance spatiale de la ville qui est le résultat de l'essor
démographique va engendrer selon YAYE SAIDOU H. (opp cit),
l'éloignement des nouveaux quartiers au centre-ville. Ce qui
nécessite d'après elle, le développement du transport
urbain notamment, le transport collectif et cela dans le but d'atténuer
l'impact de la pollution sur l'environnement urbain.
En somme, il convient de noter que les villes d'Afrique de
l'Ouest connaissent une forte croissance urbaine rendant difficile les
politiques d'aménagement urbain. Cette croissance urbaine récente
a pris 3 formes : une densification des agglomérations existantes, un
étalement de ces agglomérations existantes et l'émergence
de nouvelles agglomérations, soit à partir de noyaux villageois
existants (urbanisation in situ), soit sous la forme de villes nouvelles
spécialement crées (urbanisation ex-nihilo), soit sous la forme
de rassemblements ou de concentrations non-planifiées donnant naissance
à de nouvelles agglomérations. Ces données remettent en
question la perception classique d'une croissance urbaine principalement issue
des migrations en provenance des zones rurales.
3.2. De l'urbanisation à la
précarité de l'énergie électrique à
Niamey
3.2.1. Urbanisation et enjeux de l'accès
à l'énergie électrique à Niamey
Selon les études de ROLAND P. (2001) et LOURDES D. ET
al (2001), la croissance démographique et spatiale des villes d'Afrique
de l'Ouest et l'insuffisance de moyens financiers sont responsables des
carences des équipements publics, de la médiocrité des
services urbains. En effet, les contrastes sociaux de l'espace urbain se lisent
dans l'état de la Voirie et des Réseaux Divers (VRD). Ainsi, une
ségrégation s'installe dans l'accès aux services urbains
et cela s'observe surtout dans l'inachèvement des infrastructures qui
pèsent
52
lourdement sur la vie de la majorité des habitants
confrontés quotidiennement aux revers de l'urbanisation affirme ROLAND P
(opp cit). Cette ségrégation ajoute l'auteur, se traduit par la
mise en place des infrastructures sociaux de base au niveau des centres villes
et leurs désertes dans les quartiers périphériques. En
effet, le réseau de distribution d'électricité ne desserve
qu'une partie des territoires urbains et présente des taux
d'équipement très variables d'un pays à l'autre ou d'une
ville à une autre. Cette situation d'insuffisance en infrastructure
électrique s'observe aussi dans la ville de Niamey où on constate
depuis quelques décennies une dynamique urbaine rendant le réseau
précaire à l'atteinte des besoins des populations. Ainsi, dans
l'étude menée par DAOUDA H. (2010), sur la dynamique actuelle du
centre-ville de Niamey, il fait le point sur l'archaïsme du réseau
électrique de cette unité urbaine. En effet, il démontre
les difficultés du service électrique à s'adapter à
la dynamique actuelle de la ville. Il montre également que ce
réseau électrique fut au paravent établi pour des
populations de moindre consommation électrique, alors qu'aujourd'hui le
caractère aérien du réseau ne va pas de pair avec la
hauteur du bâti du centre-ville. Il est donc nécessaire de
réhabiliter le réseau de façon à l'adapter aux
exigences du moment. Devant l'incapacité du réseau
électrique à suivre Cette dynamique urbaine, HALIDOU K. (2010)
avait traité du schéma directeur du réseau de distribution
électrique de la ville de Niamey. Ce qui lui a permis d'aboutir à
un schéma d'évolution pour le court, moyen et long terme. Pour ce
faire, il s'est intéressé aux données statistiques,
démographiques et économiques afin d'établir la projection
de la demande d'électricité de la ville de Niamey. Ainsi prenant
en compte les forces et faiblesses du réseau de distribution, il propose
des solutions permettant de faire face à l'évolution de la
charge.
Face à cette situation de défaillance de ce
service, quels sont les enjeux de l'accès à
l'électricité dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest ?
Comme dans les autres continents, l'accès à
l'énergie constitue la clef de voute du développement
socioéconomique. Du fait de son importance, plusieurs auteurs se sont
intéressés à cette thématique. Ainsi, LUCAS P.
(1997), souligne que l'accès à l'énergie représente
un double enjeu pour le continent africain : Celui de l'industrialisation, du
développement économique et de l'accès des populations
à un meilleur cadre de vie. Il dresse un panorama de la situation
énergétique du continent, évalue la demande et les
ressources disponibles, de son transport et de sa distribution. Ce rôle
primordial que joue l'électricité a amené les groupes
régionaux multisectoriels de la CEDEAO à Bamako en 2005 pour
l'adoption d'une stratégie visant à améliorer
l'accès aux services énergétiques. Cette
stratégie
53
vise la multiplication des sources d'approvisionnement
énergétique afin de permettre l'accès d'un plus grand
nombre des populations à l'électricité.
Dans le même ordre d'idée, SARAH B. (2006) avait
mis en débat un certain nombre des questions concernant l'analyse de la
demande des services essentiels dans les programmes de développement.
Cette étude démontre l'apport de l'énergie
électrique au développement des pays
sous-développés. A cet effet, KERRI E. et al (2008),
prévoient l'utilisation des ressources renouvelables pour le
renforcement de la sécurité énergétique, en
particulier pour les pays qui ne produisent pas du pétrole. Ce qui
permettrait de créer d'emplois et contribuer à la lutte contre la
pauvreté en améliorant l'accès à l'énergie
des populations isolées.
Selon l'Organisation Internationale de la Francophonie (2004);
OMER T. et MAMA D. (2008) et AFRICA PROGRESS PANEL (2015), l'énergie
joue un rôle primordial pour le développement
socioéconomique des populations africaines, car elle permet de lutter
contre la pauvreté tant en milieu rural qu'urbain. En effet, la
croissance économique dépend aujourd'hui des services
énergétiques surtout pour les pays en développement. Elle
permet également de lutter contre le changement climatique à
travers l'utilisation des sources d'énergies renouvelables. Abondant
dans le même sens, CHRISTOPHE G. (2013), pense que l'énergie, dans
un contexte de développement, nécessite que soit pleinement
compris le rôle qu'elle joue dans l'amélioration des conditions de
vie des populations pauvres. L'énergie influence profondément le
bien être des individus, que ce soit à travers l'accès
à l'eau, la production agricole, la santé, l'éducation et
la création d'emplois ou la durabilité environnementale selon
ADEM (2014).
Pour QUOILIN S. (2008), les enjeux de l'accès à
l'énergie sont multiples sur la vie sociale car il est
généralement admis que l'accès à
l'électricité peut améliorer l'éducation des
enfants, génère des revenus supplémentaires et
réduire l'exode rurale. Pour cet auteur, l'électricité
joue également un rôle majeur pour le décollage industriel
des pays en développement. Par exemple en permettant la création
d'atelier d'usinage du métal, qui sert de pré requis à la
production d'éléments de machines. Il ajoute aussi qu'il y a une
corrélation entre la consommation d'énergie d'un pays et certains
indicateurs sociaux comme la mortalité infantile, la
fécondité et le taux d'alphabétisation car selon lui, une
consommation d'énergie supérieure va de pair avec un taux
d'alphabétisation supérieur. Ce point de vue de QUOILIN est
corroboré par le Groupe de la Banque Africaine du Développement
et de l'OCDE (2010), pour qui l'accès à une offre
d'énergie de qualité permet d'améliorer substantiellement
les conditions de vie des populations car, elle favorise la lutte contre la
faim et la malnutrition grâce à la cuisson et la
préservation des aliments par les réfrigérations, à
l'amélioration de la
54
productivités au sein de la chaine alimentaire et au
développement de mode de production agricole moderne. Il constitue un
élément essentiel de progrès sanitaire via
l'amélioration de l'hygiène alimentaire et le perfectionnement
des équipements médicaux. Il ajoute aussi qu'une meilleure offre
d'énergie permettra à l'Etat d'offrir des services
d'éducation, de sante et de communication à meilleur coût
et en plus grande quantité à la population. Selon ce groupe,
l'accès à l'énergie favorise également la
circulation de l'information, élément essentiel de prise de
décisions politiques. Elle permet ainsi de cibler les populations dans
les besoins et de faire un choix éclairé des politiques les mieux
adaptées au contexte local et national. Cette réciprocité
de la circulation de l'information et l'amélioration des conditions de
vie des populations favorise d'après toujours ce groupe le
développement de la participation des populations aux choix nationaux,
pouvant permettre un approfondissement du caractère démocratique
des institutions. Ce qui poussera ainsi les autorités à plus de
transparence et de responsabilité dans leurs décisions.
En 2010, l'assemblée générale des Nations
Unis qui avait déclaré l'année 2012, comme année
internationale de l'énergie durable pour tous, reconnait que
l'accès à des services énergétiques fiables et
à des coûts supportables dans les pays en développement
soit capital pour la réalisation des Objectifs de Développement
Durable (ODD), car permettrait de réduire la pauvreté et
améliorer les conditions de vie des populations. En 2012, une
deuxième commission de cette assemblée a approuvé un
projet de résolution beaucoup plus performant surtout dans un souci de
préserver l'environnement. Cela est relatif à la promotion des
sources d'énergie renouvelables. C'est dans cette optique que la
décennie 2014-2023 est déclarée comme la «
décennie internationale de l'énergie durable pour tous
». L'objectif est d'accroitre le développement des
énergies renouvelables en vue de permettre l'accès de tous aux
services énergétiques modernes. D'après ces études
l'accès aux services énergétiques moderne a un impact
positif sur les services sociaux de base et favorisera la croissance des
activités productives.
Cette analyse de la bibliographie sur les enjeux de
l'accès à l'énergie montre que l'électricité
constitue un moteur indispensable pour le développement
socio-économique d'un territoire. Ainsi, l'accès à
l'énergie s'accompagne de l'amélioration des conditions de vie et
de santé notamment grâce à un meilleur approvisionnement en
eau et un développement des télécommunications et de
progrès éducatifs et sanitaires. Elle peut donc contribuer
à la réduction de la pauvreté. L'électricité
participe également à la création et au
développement d'activités indispensables à la croissance
économique comme le souligne EDF (2014). Elle
55
permet également l'accroissement de la participation
des populations aux prises de décisions politiques.
3.2.2. Urbanisation et besoin en énergie
électrique à Niamey
On estime que pour l'ensemble du Niger, les populations
urbaines augmentent actuellement au rythme de 4 à 5 % par an et qu'elles
doublent en l'espace d'une quinzaine d'années, ce qui représente
un rythme d'accroissement environ deux fois plus rapide que celui de la
population totale de l'ensemble du pays souligne MOTCHO KOKOU H. (opp cit).
Pour cet auteur, dans ce taux global d'accroissement des populations urbaines,
la croissance démographique de Niamey est beaucoup plus
élevée que celle des autres villes du Niger. C'est ainsi qu'entre
1977 et 2001, la population de Niamey a été multipliée par
trois (3), passant de 242 973 à 674 950 habitants. En 2012, selon les
données statistiques de l'Institut National de la Statistique (INS), la
population de la ville de Niamey était estimée à 1 011 277
habitants ; ce qui donne un taux de croissance de 7,3 % d'après INS
(2014).
La figure n°4 donne une explication de l'évolution
de la population de la ville depuis l'époque coloniale jusqu'à
2020.
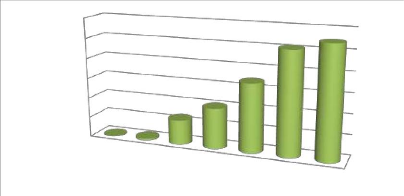
Figure 5 : Evolution de la population de
Niamey
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000
0
1930 1953 1977 1988 2001 2012
2020
Cette remarquable évolution de la population est le
résultat de trois facteurs : d'une part le taux élevé de
la natalité qui est de 3,1% auquel s'ajoute un allongement de
l'espérance de vie de la population, d'autre part l'annexion de certains
villages et l'apport de l'exode rural. Selon MOTCHO KOKOU. H. (2005), ce
dernier phénomène est actuellement responsable de l'augmentation
de la population de la capitale. Il est aussi responsable de l'arrivée
annuelle d'environ 30 000 nouveaux Niaméens provenant de la campagne.
Pour YAYE SAIDOU H. (2007), et la NIGELEC (2016), cette
urbanisation galopante de la ville ne va pas sans poser des problèmes en
terme de besoins pour un bon cadre de vie (accessibilité à
l'énergie électrique, logements descentes, besoins de transport,
éducation,
56
santé, et autres équipements sociaux). En effet,
ces dernières années, la ville de Niamey (notamment les quartiers
périphériques tels que Niamey 2000, Aéroport, Talladje,
Kirkissoye, Banga Bana, Zarmagandeye, Koubia, Nordiré etc.), a connu un
étalement urbain accéléré et
incontrôlé, entrainant du coup un accroissement des besoins des
services urbains, notamment dans le secteur de l'énergie
électrique. Ainsi, sur la période allant de 2004 à 2014,
le nombre total d'abonnés à la NIGELEC (pour la ville de Niamey)
est passé de 59 538 à 114 754, soit une augmentation annuelle
d'environ 5 480 abonnés et un taux de croissance moyenne annuel
équivalent de 7%. Mais ce taux varie de 4% à 12% durant cette
même période. Ainsi, en 2014, la ville de Niamey a consommé
477 GWh (Gigawatt heure) pour une pointe de charge de 111,6 MW
(Mégawatheure) comme l'illustre le tableau n°1.
Tableau 1 : Evolution de la consommation et de la
pointe de charge de Niamey
|
Année
|
ventes nettes en KWh
|
pointe de charge
|
|
Basse Tension
|
Moyenne Tension
|
TOTAL
|
Taux
d'évolution
|
MW
|
|
2004
|
113 288 179
|
88 963 905
|
202 252 084
|
|
47
|
|
2005
|
127 117 806
|
97 659 558
|
224 777 364
|
11%
|
51
|
|
2006
|
140 168 352
|
103 974 880
|
244 143 232
|
9%
|
57
|
|
2007
|
157 830 762
|
103 364 221
|
261 194 983
|
7%
|
64
|
|
2008
|
164 445 424
|
105 576 776
|
270 022 200
|
3%
|
67
|
|
2009
|
193 249 099
|
115 846 727
|
309 095 826
|
14%
|
71
|
|
2010
|
211 582 185
|
117 441 429
|
329 023 614
|
6%
|
76
|
|
2011
|
228 289 351
|
121 622 266
|
349 911 617
|
6%
|
77
|
|
2012
|
262 839 621
|
132 220 072
|
395 059 693
|
13%
|
97
|
|
2013
|
283 507 382
|
133 816 814
|
417 324 196
|
6%
|
102
|
|
2014
|
327 882 564
|
148 787 704
|
476 670 268
|
14%
|
112
|
Source : NIGELEC, 2016
Ce tableau n°1 montre que la consommation en
énergie électrique de la ville de Niamey a été
multipliée par environ 2,3 fois en 11 années passant de 202 GWh
en 2004 à 477 GWh en 2014 soit un taux de croissance moyen annuel de 9 %
(NIGELEC, 2016) alors que les besoins restent toujours insatisfaits. Durant
cette même période le taux de desserte de la ville est
passé de 44 % à 63 %, soit une hausse annuelle moyenne de 2
points, comme l'indique sur le tableau 2.
57
Tableau 2 : Evolution du taux de desserte en
électricité de la ville de Niamey
|
Année
|
Population
|
Ménages
|
Nombre total d'abonnés Basse Tension
|
Taux de desserte
|
|
|
|
|
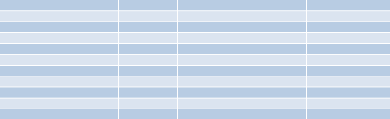
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
932 574
976 405
812 537
850 726
890 711
1 022 296
1 070 344
1 120 650
1 011 277
1 056 627
1 087 269
135 423
141 788
148 452
155 429
162 734
170 383
178 391
186 775
171 141
176 104
181 211
59 538
64 427
72 371
76 304
92 542
98 156
80 626
84 538
88 019
106 344
114 129
44%
45%
49%
49%
49%
50%
50%
50%
57%
60%
63%
Source : NIGELEC, 2016
A travers le tableau n°2, on constate une augmentation du
nombre d'abonnés. Ce qui a pour corollaire l'augmentation du taux de
desserte de la ville. Cette situation peut s'expliquer par la croissance
démographique de la ville et l'amélioration des conditions de vie
des populations. Elle est aussi responsable de l'évolution croissante de
la consommation d'énergie de la ville de Niamey.
3.2.3. Les aspects de la précarité
énergétique à Niamey
Dans cette partie nous essayerons d'analyser les
différents aspects de la précarité de l'énergie
électrique ainsi que les stratégies adaptées par les
populations pour tenter de réduire l'impact de ce
phénomène sur le développement socioéconomique des
populations.
3.2.3.1. Les caractéristiques de la
précarité énergétiques
Toute définition de la précarité
énergétique fait partie d'un processus de construction sociale.
C'est pourquoi la réponse à la question « Qu'est-ce que
la précarité énergétique ? » n'est pas
univoque. Ce constat ressort d'une large étude bibliographique. Il n'y a
pas d'unanimité sur les critères à l'aide desquelles on
peut définir et mesurer la précarité
énergétique soulignent FREDERIC H. et al (2011) ; MURIEL B.
(2011) ; EDF et col (2011). Pour ces auteurs, le Royaume-Uni est le premier
pays de l'Union Européenne à adopter une définition
officielle de la précarité. Ainsi, il s'agit pour ce pays d'une
situation dans laquelle se trouve un foyer lorsqu'il doit dépenser 10%
de ses revenus pour couvrir ses dépenses d'énergie pour son
logement afin de chauffer correctement sa résidence. Alors que pour
ISOLDE D. (2007), c'est l'imbrication d'une situation sociale et
économique fragile, d'un logement insalubre et d'un accès
à l'énergie problématique dans un contexte de crise de
logement. Cette définition d'ISOLDE se rapproche de celle du Belge,
FREDERIC H. (2011), pour qui la précarité
58
énergétique traduit l'insuffisance des revenus,
un logement inadapté et des prix croissant de l'énergie.
En France, la définition de la précarité
a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
(dite loi Grenelle 2), portant engagement national pour l'environnement. Ainsi,
la précarité énergétique se définit comme
suit : « est en situation de précarité
énergétique au titre de la présente loi, une personne qui
éprouve dans son logement des difficultés particulières
à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à
la satisfaction de ses besoins élémentaire en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses condition d'habitat ».
Selon l'ONEP (2015), cette définition française
est restrictive à la seule relation entre le ménage et son
habitat et laisse à l'appréciation d'un tiers les sources de
l'inconfort thermique qu'elles soient d'ordre économiques, technique ou
performance énergétique globale. Elle évite aussi la
question des usages ou des pratiques domestiques qui peuvent ne pas être
conforme ou vertueuses, en référence aux économies
possibles. Elle ajoute également qu'elle met de côté la
notion de vulnérabilité liée à la mobilité
et à son coût.
Pour les chercheurs d'IDDRI comme TIMOTHEE, LUCAS C., MATHIEU
et MARION C. (2014), la précarité énergétique se
caractérise par une situation de faible revenu disponible,
combinée à des dépenses énergies et transport
élevés, dues à un certain nombre de contraintes
techniques, territoriales ou infrastructurelles. Pour eux, le
phénomène de la précarité résulte non
seulement du cumul de la mauvaise qualité thermique de l'habitat mais
aussi de l'éloignement des espaces, des services publics, commerciaux,
accroissant le coût de la mobilité résidentielle. Alors que
pour d'autres comme BRUNO et MARECAS (2013), la précarité
énergétique pose la question du coût du logement pour la
simple raison que les logements du centre-ville sont beaucoup plus solliciter
que ceux de la périphérie du fait qu'ils sont bien desservis par
les réseaux d'énergie.
Cependant, nous constatons que tous ces auteurs ont
traité de la question de l'énergie d'une manière
générale sans pour autant l'aborder sous ses différents
sous-secteurs comme la présente étude. Nous constatons
également qu'il existe plusieurs critères dans la
définition de la précarité énergétique selon
les pays et parfois même les auteurs. C'est ainsi que certains pays
utilisent une définition stricte et assez claire, comme le Royaume uni,
tandis que d'autres ne disposent d'aucune définition ou restent assez
vague, sans critères objectives. En effet, pour ces auteurs, la
précarité énergétique se caractérise par un
accès problématique à l'énergie, la mauvaise
qualité thermique de l'habitat et le coût élevé de
la facture énergétique poussant les populations à investir
une part croissante de leurs revenus pour l'énergie afin de lutter
contre l'inconfort au niveau des bâtiments. Partant de ce constat, il est
important de se
59
demander comment se manifeste ce phénomène dans
les grandes cités africaines et plus particulièrement à
Niamey ?
L'une des principales caractéristiques de la
précarité énergétique des pays d'Afrique de l'Ouest
est du prix élevé de la facture d'électricité par
rapport aux pays développés affirment ANTOIN et al (2006) ; AFD
(2009) ; BAD (2015). Or la quasi-totalité des populations issues de nos
villes ont des faibles revenus (moins de 2 dollars par jours) qui ne les
permettent pas de répondre suffisamment au coût de la facture
d'électricité. Ainsi, ALEXANDRE B. et al (2011), ajoutent que le
faible niveau de revenu des ménages, rendant difficile le paiement des
factures, et empêchant tout investissement permettant de diminuer la
facture pour atteindre un niveau de confort supérieur. Ce qui se
manifeste bien souvent par le désabonnement des populations au
réseau par les sociétés de distribution électrique.
Ainsi, le coût élevé du prix de l'électricité
est selon ces auteurs, le résultat de deux facteurs : d'une part la
dépendance énergétique de certains pays d'Afrique de
l'Ouest comme le Niger, et de l'autre, l'utilisation des groupes
électrogènes par les sociétés en charge de
l'électricité, qui demandent des gros investissements. Ce
coût élevé de l'électricité est
illustré par le tableau ci-dessous.
Tableau 3 : Comparaison du prix du KWh du Niger à
d'autres unités géographiques
|
Pays
|
Prix du KWh en Franc CFA pour l'année 2009
|
|
|
|
Afrique Subsaharienne
|
56 franc CFA
|
|
Amérique Latine
|
30 franc CFA
|
|
Asie du Sud
|
17 franc CFA
|
|
|
79 franc CFA
|
|
Niger
|
|
|
|
Source : Groupe de la Banque Africaine du Développement,
2015
Selon les études de ANTOIN E. et al (2006); CHRISTINE
et al (2011), cette situation de précarité se manifeste aussi par
la faiblesse du taux d'accès à l'énergie électrique
dû principalement à l'insuffisance de capacités de
production électrique installées au niveau des pays ouest
africains, la faiblesse du réseau d'interconnexion reliant les grandes
villes de la région et la dépendance énergétique
des certains pays comme souligné si-haut. C'est ainsi qu'en 2012, la
capacité installée reliée aux réseaux
électrique de l'Afrique de l'Ouest était de 20 GW contre 128,9 GW
en France en 2014. En plus la moitié de cette capacité
électrique provient des centrales à gaz, essentiellement
situées au Nigeria. Dans cette région, plus de 250 million de
personnes comptent sur la biomasse pour cuire leurs aliments car elles n'ont
pas accès à l'électricité. La région dispose
en effet un taux d'électrification de 40 % d'après les
études de CHRISTINE et al (2011). Cela montre la faiblesse de la
couverture en énergie
60
électrique. Ce taux varie d'un pays à un autre
ou d'une ville à une autre. C'est ainsi que, le Niger présentait
en 2012, un taux d'électricité d'environ 25 % (INS, 2015). La
consommation électrique par habitant était inférieure
à 50 kilowattheures (kWh) par an durant cette même période
par rapport à une moyenne régionale de 200 kWh et une moyenne
mondiale de 3 104 kWh souligne le Groupe de Banque Africaine de
Développement (2015).
Tableau 4 : Consommation moyenne annuelle
d'électricité par pays ou groupe de pays
|
Pays
|
Consommation du KWh/habitant en 2013
|
|
Afrique du Nord
|
2 880
|
|
Afrique Subsaharienne
|
488
|
|
Monde
|
3104
|
|
Niger
|
49
|
|
France
|
7 292
|
|
Etats-Unis
|
13 246
|
Source : Groupe de la Banque Africaine de développement,
2015
De ce fait, le citoyen moyen nigérien fait partie des
plus faibles consommateurs d'électricité au monde. Ce qui est
paradoxal quand on sait que 3 ampoules sur 5 en France sont alimentées
grâce à l'uranium du Niger. Pourquoi donc le Français doit
consommer plus de l'électricité que le Nigérien qui
dispose de la matière première ? En plus, environ 76 % de la
population n'ont pas accès à l'électricité,
majoritairement limitée en zone urbaine. Cela indique une importante
demande latente dans le secteur de l'électricité et le besoin de
combler l'écart entre la demande et la disponibilité soulignent
GAURI S. et al (2014). Ainsi la ville de Niamey présente un taux
d'électrification de 63 % pour plus de 114 129 abonnés (NIGELEC,
2014). Ce taux peut être considéré comme bon dans
l'ensemble mais présente des déséquilibres d'une part
entre centre-ville comme affirme MAINA B. (2011).
Pour GAURI S. (opp cit), le profil énergétique
4nigérien est celui d'une économie à faible
revenu dans laquelle le secteur des ménages demeure le principal
utilisateur d'énergie. Cela implique une utilisation limitée de
l'énergie dans le secteur productif. Nombreux sont les ménages
qui, dépendent lourdement de la biomasse traditionnelle pour
répondre à leurs besoins énergétiques.
Mais un des handicape majeurs est l'alimentation haute tension
provenant du Nigeria. Cette alimentation reste discontinue selon des
périodes de l'année, surtout pendant l'étiage du fleuve
par manque d'eau pouvant alimenter les barrages qui produisent de
l'électricité (AFP,
4 Profil énergétique : c'est une vue
d'ensemble de la consommation de l'énergie par secteur
d'activité.
61
13/06/2016 à 09heure 18). Ce qui plonge le plus souvent
la ville dans des coupures intempestives. Ces coupures
répétées pouvant durer des heures, voir toute la
journée, sont observées de jours comme de nuits à Niamey,
a constaté un journaliste de l'AFP (Agence France-Presse).
Durant l'année 2014, d'après le rapport
intérimaire de la NIGELEC en 2016, la situation du réseau de
distribution de la ville de Niamey est la suivante :
? La longueur du réseau HTA (Moyenne Tension) est de
542 km contre 4 472 km pour le pays entier, soit 12 % ;
? La longueur du réseau BT (Basse Tension) est de 509
km contre 2 418 km pour l'ensemble du pays, soit 21 %.
Ces nombres de kilomètre comparés aux nombre
d'hectares sur lesquels la ville s'étale demeurent insuffisants pour
desservir l'ensemble des quartiers surtout ceux de la périphérie.
Ainsi, la ville s'étale sur environ 12 000 hectares. Alors si on tient
compte du rapport kilomètre BT au nombre d'hectares, on aura 42 m/ 10
000 m2. Partant de cette analyse, plusieurs quartiers seront
totalement dépourvus d'électricité. Cela témoigne
de la disparité qui existe dans l'accès à
l'électricité dans la ville. C'est ainsi que des populations sont
raccordées aux réseaux électrique et d'autres restent
toujours à la périphérie de celui-ci comme le montre la
carte ci-dessous.
62
Figure 6 : Réseau de distribution
électrique de Niamey
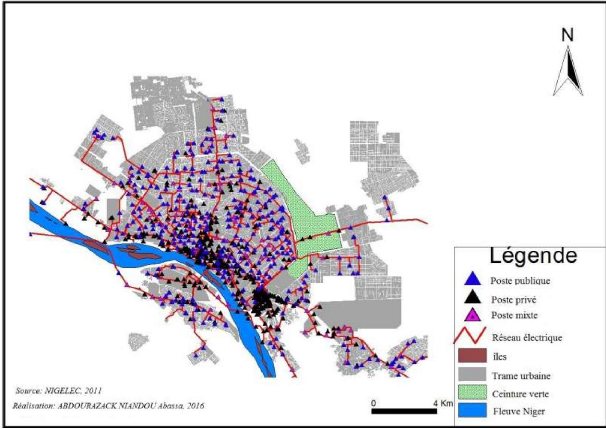
63
A travers la figure n° 6, nous avons d'abord la
concentration du réseau électrique dans le centre-ville et la
péricentrale. Cette concentration est le résultat de la
redynamisation du centre-ville à travers le développement du
commerce et de l'entreprenariat. Ce qui explique le développement des
postes privées au centre plus qu'ailleurs, due nécessairement
à l'insuffisance de la prestation du service électrique. Ce qui
amène certains usagers à la mise en place de ces postes afin de
pouvoir s'approvisionner librement sans qu'il ait des moindres baisses de
tension car l'énergie émis par ses postes n'est que la demande
maximale des usagers mais ces derniers ont la charge de leurs emplacements et
entretiens. Puis la faiblesse du réseau dans les quartiers
périphériques due à l'étalement anarchique de la
ville. Cet étalement se fait à travers des promoteurs immobiliers
qui ne respectent pas les textes de viabilisation des terrains. Ensuite, la
présence des postes publiques et mixtes sur l'ensemble de la ville dont
les premiers sont placés pour le besoin du publique et les seconds, pour
le privé tout en permettant à d'autres usagers de s'alimenter.
Enfin, le caractère archaïque du réseau malgré sa
densification dans le centre-ville et péricentral. Cela est dû
à la dynamique actuelle de ses quartiers.
Selon PATRICE C. (2014), cette précarité se
manifeste aussi par un déséquilibre entre l'offre et la demande
en énergie électrique. Pour lui, ce déséquilibre se
produit à travers une demande nettement supérieure à
l'offre. Ce déséquilibre est surtout perceptible pendant la
période de chaleur où la demande est particulièrement
élevée. Durant cette période de forte demande, la
population fait face à des délestages dans la distribution du
service électrique.
Pour la NIGELEC (2016), la situation du sous-secteur de
l'électricité se caractérise par l'insuffisance et le
vieillissement du parc de production, de transport et de distribution et par la
mauvaise qualité du service. En effet, des difficultés
d'exploitation et de maintenance des matériels sont observées au
niveau de différents départs alimentant la ville de Niamey. Ces
difficultés sont entre autres :
? La présence des tronçons
5vétustes ;
? Déclenchement dû au claquage des câbles
vétustes ;
? Dépassement de la charge admissible6 aux
heures de points; ce dépassement de la charge s'observe par un surcharge
des départs pouvant aller jusqu'à 100 %; c'est la raison pour
laquelle certains onduleurs se claquent;
5 Tronçon : c'est le réseau
électrique qui existe entre deux postes.
6 La charge normale qui est admise par les
câbles.
64
? Départ ayant très longue dérivation en
périphérie, d'où son instabilité. c'est le cas ici
du départ de Goudel;
? Départ en antenne n'ayant aucune possibilité
de bouclage avec un autre départ (sans possibilité de secours),
c'est le cas du départ Rive droite issue du poste de Goudel alimentant
88 transformateurs ;
? Départ neuf saturé car alimentant des zones en
pleine développement ;
? Rupture des conducteurs et anomalie sur les isolateurs dus
à la surcharge.
? Etc.
Ces difficultés vont se traduire par la
défaillance du réseau et du coup, interrompre la prestation du
service continu de l'électricité.
Cette précarité se manifeste également
par la faiblesse de l'éclairage public de la ville affirme SALEY M.
(2008). En effet, avec théoriquement environ 86 km de voiries
éclairées pour 310 km de voiries primaires soit 27,75 % le taux
d'éclairage public. Selon cet auteur, L'éclairage public est
essentiellement concentré dans les secteurs centraux et au long des
voies principales. Il est en général absent au niveau des voies
de dessertes à l'intérieur des quartiers. Ainsi les quartiers des
ménages à faible revenu sont généralement
plongés dans l'obscurité.
Il y a aussi la présence d'autres sources
d'énergies comme les groupes électrogènes et les panneaux
solaires dans certains services et ménages qui montrent bien
l'insuffisance de la Société à satisfaire les besoins des
populations.
Cette analyse de la bibliographie sur les
caractéristiques de la précarité de l'énergie
électrique dans les grandes villes, reste marquée par la
prédominance des auteurs occidentaux sur ceux d'Afrique. Elle laisse
apparaitre le fait que l'énergie n'est pas un phénomène
isolé de l'espace géographique. La perception de la
précarité énergétique par les auteurs est
divergente. C'est ainsi que certains la qualifie d'une situation dans laquelle
un ménage ou un individu rencontre des difficultés
particulières à satisfaire ses besoins énergétiques
tandis que d'autres lui donnent des caractéristiques plus complexes. En
effet, pour ces derniers, la précarité énergétique
se caractérise par le coût élevé de
l'énergie, le faible taux d'accès, la faible consommation
énergétique des populations, les coupures
d'électricité, la faiblesse du réseau électrique,
le déséquilibre entre l'offre et la demande et la
vétusté des équipements électriques. Il est donc
intéressant de se questionner sur les facteurs qui expliquent cette
précarité au niveau de la ville de Niamey.
65
3.2.3.2. Les facteurs aggravants de la
précarité énergétique à Niamey
D'après les études de HALIDOU K. (2010), la
ville de Niamey et sa périphérie représentent 60 % du
chiffre d'affaire de la NIGELEC. Le Nigeria fournit plus de 80 % de
l'électricité au Niger. Pour lui, la ville de Niamey est
largement dépendante de l'électricité provenant du Nigeria
voisin. En effet, le réseau HT (Haute Tension) qui alimente le
réseau de distribution de la ville et ses alentours (Niamey et
Tillabéry) est issu de la ligne 132 kV (Kilo Voltampère) en
provenance de Birnin-Kebbi au Nigéria. Donc Niamey et ses environs font
partie de la zone Ouest interconnectée ou zone fleuve.

Figure 7 : Répartition de
l'électricité par source d'approvisionnement au Niger
Importations
production propre achats SONICHAR groupe AGGREKO
Source : NIGELEC, 2016
Il ressort de la figure qu'une grande partie de
l'électricité consommée dans le pays provient des
importations du Nigeria avec 80 % % du total de l'énergie
électrique commercialisée par la NIGELEC. La production locale se
chiffre à 20 %, dont la production propre de la NIGELEC
représentant 11 %, les achats au niveau de la SONICHAR à hauteur
de 5 % et l'utilisation des groupes AGGREKO à 4 % pour l'année
2012.
Actuellement Niamey est alimenté par 20 départs
à moyenne tension (20 kV) issus des postes de répartition de
Niamey 3, Niamey nord et Goudel.
Figure 8 : Structure arborescente d'un départ
aérien

Interrupteur Aérien HTA
Disjoncteur Têtede départ
Interrupteur
de
Bouclage avec un
autre départ

Postes de
Transforma
tion
HTA/BT
Source : NIGELEC, 2016
66
Cette figure ci-haut présente le caractère
physique d'un départ aérien. Elle est d'abord constituée
d'un disjoncteur dont son rôle est d'interrompre le courant
électrique en cas de surcharge ou d'anomalie sur le circuit
électrique ; puis des interrupteurs qui permettent d'interrompre le
courant électrique à des échelles réduites ; en
suite des postes de transformation qui servent de lien entre la moyenne tension
et la basse tension afin de permettre le raccordement des consommateurs ; et
enfin un interrupteur de bouclage avec un autre départ. Ce dernier
permet de secourir en fonction de ses disponibilités en cas de
défaut au niveau du disjoncteur placé à la tête du
départ.
La puissance de pointe appelée par Niamey et ses
environs était de 76,2 MW affirme HALIDOU K. en 2010 et 140 MW en 2016,
dépassant largement les prévisions de 125 MW de la NIGELEC
d'après nos investigations au niveau de la NIGELEC. Le transit de cette
puissance à travers les différents départs 20 kV est
très délicat. En effet la plupart des départs 20 kV sont
saturés, c'est-à-dire que leurs capacités maximales de
transit sont atteintes voire dépassées dans certains cas. Ce qui
explique bien souvent la défaillance du service à couvrir les
besoins des citadins. Cette situation trouve son origine dans le
développement accéléré de la demande en
énergie électrique au niveau de la ville de Niamey. La hausse de
la demande est engendrée pour ce chercheur, par la forte croissance qu'a
connue la ville ces dernières années ainsi qu'à une
relance des activités socio-économiques. Il faut noter que les
contraintes auxquelles est soumis le réseau de distribution de la ville
de Niamey résultent non seulement de sa structure mais aussi de
l'insuffisance de la capacité de ses sources d'alimentation. Ces sources
sont composées de transformateurs HT/MT installés au niveau des
postes de répartition 132 kV/20kV de Niamey 2, 66 kV/20kV de Niamey nord
et de Goudel. A cela
67
s'ajoute le retard de la société à mettre
en place un schéma directeur du réseau de distribution
d'énergie électrique concernant la ville de Niamey. C'est une des
raisons essentielles qui explique les insuffisances présentées
par le réseau de distribution de la ville. Les différentes
extensions qui ont vu le jour sur ce réseau de distribution
électrique ont été réalisées au fil des
besoins. On remarque que la gestion de ce réseau n'a pas
bénéficié des avantages que procure le schéma
directeur dont le principal avantage est la planification des investissements
pour le court, moyen et long terme afin d'assurer un service de qualité
à un coût optimal. Ce qui se matérialise par une offre
inferieure à la demande affirment MOUSTAPA K. (2014) et MINISTERE DE
L'ENERGIE ET DU PETROLE et NIGELEC (2015). Cette situation conduit selon
MOUSTAPHA, à la précarité énergétique du
service à satisfaire les besoins de sa clientèle. Cette
précarité qui était au paravent conjoncturelle tend
aujourd'hui à être structurelle car le phénomène est
observé douze mois sur douze.
La Direction Nationale de la Météorologie
relevant du ministère du Transport et du Tourisme dispose de
données climatiques qui vont servir à définir les
périodes de l'année pendant lesquelles la demande en
énergie électrique reste très forte. Aussi les
températures minimales, moyennes et maximales des périodes les
plus froides ainsi que les plus chaudes de l'année 2015 sont
relevées en ce qui concerne la ville de Niamey pour montrer combien de
fois la température influence la distribution de l'énergie
électrique de la ville.
Tableau 5 : Températures et consommation de
l'électricité à Niamey en fonction des mois
|
Mois
|
Température en °C
|
Consommation d'énergie en KWh pour l'année 2015
|
|
T. maximale
|
T. moyenne
|
minimale
|
|
Janvier
|
36,8
|
31,3
|
26,6
|
26 770 426
|
|
Février
|
41,3
|
37,4
|
32,0
|
33 279 800
|
|
Mars
|
42,0
|
38,6
|
34,5
|
42 384 229
|
|
Avril
|
43,5
|
41,1
|
38,0
|
47 149 506
|
|
Mai
|
45,0
|
42,6
|
36,5
|
47 038 530
|
|
Juin
|
42,9
|
39,4
|
28,0
|
50 928 989
|
|
Juillet
|
40,0
|
35,3
|
29,5
|
45 408 073
|
|
Aout
|
37,2
|
33,0
|
28,2
|
45 061 948
|
|
Septembre
|
38,5
|
34,9
|
28,8
|
42 421 804
|
|
Octobre
|
41,0
|
38,5
|
34,0
|
45 000 040
|
|
Novembre
|
39,0
|
36,7
|
34,8
|
41 355 262
|
|
Décembre
|
34,5
|
30,2
|
27,5
|
31 945 518
|
Source : NIGELEC et Direction de la Météorologie
(2016)
68
A travers le tableau n°5, on remarque une hausse de la
température maximale enregistrée au cours du mois de Mars
à juin. Nous constatons également que, c'est durant cette
même période que la consommation énergétique de
ville a atteint son pic. Cette forte consommation périodique est due
à la hausse de la température qui influence l'appel en puissance
pour l'alimentation des appareils destinés au conditionnement de l'air
au niveau des bâtiments afin de maintenir la température interne
à une valeur constante. Cette situation s'observe au niveau de plusieurs
pays africains où on assiste à des coupures
d'électricité durant les périodes de pointes et cela
surtout pendant les canicules soulignent GERAUD M. (2007) et PATRICK G. (2014).
Pour ces auteurs, la température influence beaucoup l'appel en puissance
de l'électricité. La tendance à la hausse des
températures est reflétée par la figure 9.
Figure 9 : Hausse de la
température
|
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
|
|
|
|
Source : Direction de la Météorologie (2016)
On voit que l'allure de l'histogramme ci-dessus est en dent de
scie. Cependant, nous remarquons que l'histogramme présente son pic
entre le mois d'Avril, Mai et Juin qui correspondent à la période
de forte consommation comme nous montre le tableau n°5. D'où on
peut affirmer qu'il y a une corrélation entre les variations de
températures et la demande en énergie électrique de la
ville de Niamey. En définitive, le climat au niveau de la zone de Niamey
dans son ensemble est caractérisé par :
? Une température moyenne très
élevée,
? Des saisons bien tranchées, une brève saison
des pluies ou hivernage de juin à septembre, une longue saison
sèche d'Octobre à Mai caractérisée par une
période de moindre chaleur (de décembre à février)
et une période de forte chaleur (de mars à mai) ou saison
sèche chaude.
69
Il convient en somme de noter que les facteurs de la
précarité de l'énergie électrique sont multiples.
Mais les plus important sont : l'urbanisation à travers l'augmentation
croissante de la demande imprévisionelle de l'énergie, la
dépendance énergétique vis-à-vis de
l'extérieur, le manque de planification dans le secteur et la hausse des
températures durant certaines périodes qui demandent l'appel en
puissance pour le conditionnement de l'air au niveau des bâtiments.
3.2.3.3. Impacts de la précarité de
l'énergie électrique à Niamey
La NIGELEC, société d'Etat, dispose d'un
monopole dans la production, la distribution et la commercialisation du courant
électrique. Cette société qui reçoit des
subventions de l'Etat et plusieurs autres partenaires, rencontre des
difficultés à jouer son rôle tout en assurant sa mission de
service public par la fourniture efficace et continue de
l'électricité devant alimenter les ménages et les
commerces mais aussi les services de l'Etat et autres pour que ces derniers
soient rentables en exécutant convenablement les taches, chacun en ce
qui le concerne, au grand profit de l'intérêt de tous. Ce qui se
traduit par la précarité du service et cela se manifeste à
travers des coupures intempestives. Ces dernières ne sont pas sans
conséquence sur le développement socioéconomique de la
ville. Ainsi, nous assistons à des supplices de plusieurs ordres.
D'après un article publié par le COURIER le 02
Octobre 2015 à 16heure 19 minutes dans société, «
on assiste à un climat nauséabond de vie chez les
ménages, qui caractérise le quotidien des populations car sans
électricité la vie ressemble à une sorte de non vie et que
tout bien être devient impossible ajoutés aux pertes
énormes enregistrées grâce à l'arrêt ou la
reprise subites de la fourniture du courant qui détruisent des appareils
électroniques et électroménagers par le
dérèglement de l'intensité du courant ». Cela a
été démontré par DEDJINOU V. F. (2014) au Benin
où il montre que les ménages, surtout ceux à faible revenu
sont plus touchés par les coupures d'électricité du fait
des dégâts causés par ces derniers. D'après toujours
le COURIER, durant les périodes d'hivernage finissantes, les familles
dorment encore dans les chambres, en recourant notamment à des appareils
(ventilateurs, humidificateurs, climatiseurs, etc.) pour atténuer les
piqûres de moustiques, qui sont à l'origine du paludisme. La
fourniture d'énergie électrique n'étant plus
régulière la nuit, les familles sont du coup exposé
à cette maladie fortement mortelle. C'est dans ce même cadre qu'a
été démontré en France par EDF et col (2011) et
MARION C. (2013) que la précarité énergétique a un
impact sur la santé des populations car l'inconfort permanent provoque
le développement des maladies pulmonaires, des infections et même
des décès.
70
Les coupures d'électricité plongent
généralement la ville dans l'obscurité à travers le
manque de l'éclairage publique affirme SALEY M. (2008). Pour cet auteur,
l'absence de cet éclairage de manière générale,
favorise la criminalité, le banditisme et les accidents de la
circulation et ne favorise pas les activités marchandes se
développant le long des rues. Ce qui entraine un manque à gagner
pour le petit commerce se développant la nuit.
Selon MOUNKAILA A. (2014), les commerçants, surtout
ceux qui utilisent ou s'alimentent à base du courant électrique,
sont simplement en cessation d'activité du fait de l'arrêt de la
fourniture ou de son caractère intermittent qui ne facilite pas la bonne
marche des affaires donc une stagnation de l'activité économique
ou de son ralentissement. Cela s'est confirmé pendant notre passage dans
quelques supers marchés de la place. Ces derniers subissent des dommages
de plusieurs ordres et qui ne sont pas remboursés par la NIGELEC. En
effet, des avaries des réfrigérateurs et plusieurs autres
produits cosmétiques sont observées dans toutes ses unités
commerciales. Ce qui n'est pas sans conséquence sur leurs chiffres
d'affaire. Les dommages sont estimés de 5 000 à 20 000 par jours
(pendant la saison chaude, période pendant laquelle les coupures sont
répétées) selon la taille de la boutique et souvent
conduit à l'endettement des propriétaires comme l'Affirme EDF et
col (2011) en France ou la fermeture systématique des boutiques. C'est
dans cette optique que IBRAHIM A. affirme à travers le journal
?Administrateur que « tous les produits liés au froid sont en
danger et beaucoup de petits commerçants qui ne vivent que de cette
activité ont fermé boutiques». Par contre fait la joie
des vendeurs des lampes (à piles ou à pétroles) et bougies
qui voient l'écoulement rapide de leurs produits.
Les coupures de courant pèsent lourdement sur
l'économie. En effet, les études de ANTOIN E. et al (2006) et de
la BANQUE MONDIALE (2009), montrent qu'en termes de ventes perdues et de
dégâts matériels, le coût moyen se chiffre à
2,1 % du PIB en Afrique subsaharienne et le manque à gagner pour les
entreprises, représente 6 % du chiffre d'affaires en moyenne pour les
entreprises du secteur structuré, et près de 16 % pour les
entreprises du secteur informel qui ne disposent pas de système
d'alimentation de secours. Ces pourcentages expriment l'impact de la
précarité de l'énergie électrique sur les
activités commerciales.
Autre secteur paralysé, c'est celui de l'administration
publique dans la fourniture des services publics aux usagers en l'occurrence
les contribuables de l'Etat car les fonctionnaires, certains d'entre eux
désertent les postes de travail en cas de coupure et d'autres restent
sur place sans aucune utilité en attendant vainement le
rétablissement inespéré de la fourniture pour enfin vaquer
normalement à leurs tâches qui ne sont pas du tout aisées
dans ce contexte de forte canicule ajoute MOUNKAILA A. (opp cit). Cela est l'un
des problèmes dont souffre
71
l'administration Nigérienne en générale
et celle de Niamey en particulière. C'est dans cette optique que le chef
du département de géographie de l'Université Abdou
Moumouni, DAMBO L. (2016), affirme au cours de notre entretien que les coupures
d'électricité constituent un blocus pour le bon fonctionnement de
l'administration et l'arrêt systématique des cours dans certaines
salles comme l'Amphi A de la Faculté des lettres et Sciences Humaines.
Et cela est l'une des causes du retard académique que connait
l'université de manière générale. Selon toujours le
chef du département, ces coupures provoquent aussi des
dégâts matériels.
L'énergie est incontestablement la base du
développement de l'activité humaine et industrielle et du
surcroit le mobil pour une véritable production de richesse dans un
pays.
Pour DJIBY D. et al (2009) et VIJAY, et al (2005), la
précarité énergétique a aussi un impact sur les
services sociaux de base. En effet l'électricité joue un
rôle crucial dans la fourniture des services sociaux de base dont
l'accès à l'eau, à l'éducation et la sante,
où le manque d'énergie constitue souvent un obstacle à la
stérilisation, l'approvisionnement en eau, sa purification, à
l'assainissement et à l'hygiène ainsi qu'à la
réfrigération des médicaments. Ainsi, l'adjoint au chef
maintenancien de l'hôpital Lamordé nous, a souligné (le 13
juin 2016) un certain nombre des problèmes liés aux coupures
d'électricité. Ces dernières pèsent lourdement sur
le bon fonctionnement du dit hôpital. C'est ainsi qu'il assiste à
des dommages de plusieurs ordres dont nous avons, les avaries des produits
sanitaires et des matériels liés au soin ou à la
climatisation. Ces dommages pouvant aller jusqu'à l'atteinte de vies des
patients affirme le maintenancien adjoint. En termes de pertes
financières, les dommages matériels sont estimés à
plus de 6 million par an. Le manque d'énergie est le principal facteur
de la discontinuité de la fourniture d'eau dans les villes
sahéliennes en générale et à Niamey en particulier
pendant les périodes de canicule affirme HASSANE Y. (2014). Il ajoute
aussi que ces périodes sont marquées par une forte demande en eau
et en énergie, ce qui occasionne des multiples intermittences qui vont
jusqu'à l'arrêt total de la fourniture du service d'eau potable de
la ville. Ainsi, les Niaméens sont durement frappés par cette
situation qui plonge les ménages branchés et ceux qui ne le sont
pas dans le même calvaire en les lançant dans un combat pour
s'approvisionner aux points d'eau collectifs. Ce qui amène selon AMY G.
(2012), les ménages branchés à faire des dépenses
imprévues pour l'eau qu'ils auraient pu investir ailleurs et cela
pourrait provoquer une instabilité financière qui
n'empêchera pas de payer la facture d'eau. C'est ainsi qu'un fût de
120 litres d'eau potable qui se vendait ?en temps normal à 350 FCFA? se
négocie ?jusqu'à 1 000 FCFA?, a dénoncé un
résident de Lazaret, un quartier périphérique et populaire
de Niamey. Il est, à noter le cramage des
72
installations électriques comme les armoires
électriques, affirme le chef d'exploitation des eaux de Niamey Mr
ABDOUL-RAZAK7. Aussi faute de courant, des télévisions
locales sont contraintes d'arrêter de diffuser leurs émissions
plus tôt que prévu (AFP, 12 mai 2016).
Cette précarité de l'énergie
électrique apparait comme le principal facteur de dysfonctionnement des
sociétés chargées de distribuer l'eau potable presque
partout en Afrique souligne YOUNSA H (opp cit). En effet, le service d'eau est
largement dépendant de la disponibilité de
l'électricité étant donné que la production de
l'eau est assujettie à celle de l'électricité ajoute AMY
G. (opp cit). Ainsi, pour SOGHA H. (SPEN, 2016), la précarité de
l'énergie électrique a trois dimensions : elle a d'abord une
dimension sociale. A cet effet, elle crée des mécontentements des
populations voir même des soulèvements ; puis une dimension
financière à travers les moyens que la société
mettra en place pendant les périodes des coupures afin de permettre la
continuité de la prestation du service ; enfin, une dimension technique
par la destruction sans dédommagement de certains matériels. Ce
point de vue de SOGHA H. (2016) est aussi partagé par TAHIROU D. (2016),
le chef de surveillance de la station de pompage de Goudel. En effet celui-ci
nous fait comprendre que l'usine n'est pas épargnée des coupures
d'électricité et ces dernières pèsent lourdement
sur le fonctionnement régulier de l'usine car pouvant aller
jusqu'à 8heures de temps par jour. Ainsi, pendant ces périodes de
coupures, il arrive souvent que les moteurs de secours consomment plus de 2000
litres de gasoil par jour sur fond propre de la SEEN. Ces coupures provoquent
aussi l'avarie de certains appareils. Mais ces derniers sont remboursés
par l'UGAN grâce à un contrat d'assurance.
Cette précarité a également des effets
sur le fonctionnement de la NIGELEC. En effet, du fait de la chaleur
exceptionnelle et de la forte demande, des évènements se
manifestent sur certaines composantes du réseau de distribution. Il
s'agit essentiellement de : certains câbles souterrains qui, ne pouvant
plus dissiper la chaleur dégagée du fait du transit de la forte
puissance fournie aux clients dans un sol déjà surchauffé
par le soleil, se mettent à se détériorer par claquage de
l'isolant, ce qui crée des courts circuits et empêche d'assurer la
continuité du service sur les tronçons concernés. Certains
transformateurs, particulièrement ceux qui sont dans les postes cabines
maçonnés, soumis aussi à la fois à la chaleur
ambiante excessive et à l'échauffement lié à la
forte demande d'énergie, subissent des avaries qui les rendent
indisponibles et parfois jusqu'à provoquer des incendies affirme
MOUSTAPHA K. (2010). Ce qui selon l'auteur a des répercussions
financières sur la société. Ainsi, on assiste à
7 Chef d'exploitation des eaux de Niamey au titre de
l'année 2016
l'achat des pièces de rechange ou aux remplacements des
certains matériels. Il est aussi prévu sur fond propre de la
NIGELEC, la production d'énergie électrique par des groupes
diesels en place, en cas de problèmes survenu sur la ligne
d'interconnexion du Nigeria ou pendant les fortes canicules. Durant ces
périodes la NIGELEC consomme plus d'un milliard de gasoil par mois
fournis par la SONIDEP.
3.2.3.4. Les stratégies d'adaptation des
populations
Selon les estimations d'EDF (2011), « seulement 30 %
de la population africaine, a accès à l'électricité
et ce pourcentage baisse encore de 2 points dans les zones rurales où
vit la majorité de la population. Les électriciens nationaux sont
largement dépassés par les besoins considérables notamment
en zones urbaines et n'ont pas les moyens de s'intéresser à la
demande grandissante dans les zones rurales ».
A cela s'ajoute l'inégalité face à
l'approvisionnement énergétique puisque seules les couches
sociales les plus aisées sont approvisionnées de façon
décente en électricité affirme GIRAUD M. (2007). Le reste
de la population (87 %) vivant avec un revenu avoisinant 2$ par jour et par
personne, consomment très peu d'électricité (en moyenne de
5 à 30 kWh/mois).
Selon la même source, face à cette situation, une
résilience énergétique se fait remarquer dans les pays
d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, les foyers africains les plus pauvres font par
conséquent recours aux énergies traditionnelles telles que la
bougie, la pile, le pétrole ou encore le kérosène dont les
coûts sont élevés et l'utilisation souvent dangereuse pour
la santé souligne DEDJINOU V. F. (opp cit).
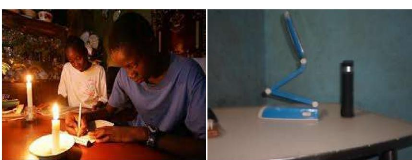
Photo n°3 et 4 : Utilisation de bougies et lampes
à pile pour l'éclairage
73
Source : Abdourazack N. Abassa 2016
Pour Roland P. (opp cit), face à la rareté de
l'électricité et au manque des moyens pour se raccorder au
réseau, plusieurs ménages se raccordent indirectement au service
à travers leurs voisins qui ont les moyens de placer un compteur. Pour
cet auteur, les propriétaires de ses compteurs sous-louent
fréquemment le courant aux maisons voisines, selon un barème
précis :
une ou plusieurs ampoules, un réfrigérateur, une
télévision
etc. il en résulte aussi que les fils
électriques sont tirés de maison en maison, dans la plus grande
anarchie et sans précaution. Ce qui selon l'auteur pourrait
déclencher un incendie dans ces quartiers qui sont le plus souvent
inaccessible aux pompiers.
La population de Niamey, quant à elle n'échappe
pas à cette logique de résilience énergétique.
C'est ainsi qu'on remarque sur l'ensemble de la ville, l'utilisation d'un seul
compteur par plusieurs ménages. Cette situation est illustrée par
les photos 5 et 6 :

Photo n°5 et 6 : La rétrocession de
l'électricité dans le quartier KoiraTegui
74
Source : Abdourazack N. Abassa 2016
En effet, le plus souvent, un seul ménage est
officiellement abonné à la NIGELEC qui vend à son tour
l'électricité à ces voisins. C'est qui est
qualifiée de rétrocession. Le prix de cette rétrocession
est de 1000 franc CFA par mois pour une ampoule ou un poste radio ou pour un
lecteur DVD ; 1500 franc CFA par mois pour un poste téléviseur ou
pour un ventilateur de table ou sur pied souligne DAOUDA H. (2010). Mais
d'après cet auteur, dans cette ville, rare sont des propriétaires
qui acceptent les autres appareils tels que les réfrigérateurs,
les cuisines électriques, les fers à repasses. Ces coûts ne
sont pas à la portée de tous les ménages ; pour cela
certains s'emparent et utilisent des lampes à pétrole ou à
batterie pour s'éclairer affirme SALEY M. (2008).
Tableau n° 6 : différentes sources
d'éclairage des populations de Niamey
|
Localités
|
Pétrole/paraffine
|
électricité
|
gaz/batterie/bougie et bois
|
autres énergies
|
|
ville de Niamey
|
48,8
|
49,2
|
1,4
|
0,7
|
|
autres urbains
|
65,7
|
31,6
|
2,6
|
0,1
|
|
Rurales
|
84,4
|
0,5
|
12,5
|
2,6
|
|
exemple du pays
|
80,1
|
7,2
|
10,4
|
2,2
|
Source : Saley M. 2008
75
Le tableau n° 6 nous montre qu'il y a presque une
parité égale entre la population utilisant
l'électricité comme source d'éclairage et celle utilisant
d'autres sources. Cela est probablement dû à l'insuffisance du
réseau à parcourir les différents quartiers de la ville et
au coût élevé de la facture qui ne permet pas le
raccordement des ménages à faibles revenue. Ce qui amène
cette population à faire recours à d'autres sources
d'éclairage.
Selon les études du CNEDD (2011) et de RAACH (2014),
certains ménages et services administratifs utilisent l'énergie
solaire. Cette source d'énergie est surtout utilisée par l'Etat
et les services de téléphonie mobile afin de pallier aux
insuffisances du service de la NIGELEC. Ce sont des panneaux avec des batteries
enterrées ou protégées dans une petite cabane au pied de
leur réseau, permettant le fonctionnement de celui-ci en cas de coupure
électrique et L'Etat à travers l'éclairage public. C'est
ainsi depuis une décennie, l'Etat Nigérien procède
à l'électrification des certaines zones et principales voies de
la capitale Nigérienne communément appeler lampadaires solaires.
Ces derniers sont constitués de têtes de lampes LED (Light Emiting
Diode=Diode électroluminescente) et avec jusqu'à 4 modules
solaires de 50W chacun. Le poteau en métal semble être solide, les
batteries sont enterrées, probablement pour les protéger contre
des températures très élevées et la pluie sous les
modules solaires.
Photon° 7 et 8 : Panneaux solaires pour
l'éclairage public et d'autre usage

Source : Abdourazack N. Abassa 2016
Selon toujours ANTOIN et al (2006) et GAURI S. et al (2014),
les coupures et les opérations de délestage sont aussi courantes
au Niger qu'au Nigeria, incitant la plupart des entreprises et des
ménages urbains à investir dans des générateurs
diesels, ou « groupes électrogènes », comme
source d'énergie électrique de réserve. Mais, ils ajoutent
que ces générateurs ne sont pas à la portée de tous
car ils sont beaucoup exigeants pour leurs entretiens et donc demandent des
gros moyens.
76
Photo n° 9 et 10 : Groupes
électrogènes de secours

Source : Abdourazack N. Abassa 2016
Pendant ce temps certaines populations utilisent des
réfrigérateurs et ventilateurs solaire, ainsi que des
ventilateurs chargeables afin de pouvoir bien mener leurs affaires.
Photo n°11, 12 et 13 : Réfrigérateur
et ventilateurs solaires (chargeables)

Source : Abdourazack N. Abassa 2016
Devant aussi l'incapacité de répondre à
une demande de plus en plus croissante, la NIGELEC procède à des
délestages dans la distribution du service électrique. Ce
système de délestage vise tant bien que mal à satisfaire
de moitié les besoins primaires des populations.
Autre stratégie adopter par la NIGELEC est
l'association de deux centrales dites en réserve froide de 23,6 MW
à la ligne d'interconnexion haute tension 132 KV Birnin-Kebbi du Nigeria
Niamey ; situées respectivement à Niamey-2 (Zone Industrielle) et
Goudel (route de Tillabéry) qui ne sont théoriquement
utilisées que lorsque cette ligne d'interconnexion n'est pas disponible
ou lorsqu'elle n'est pas suffisante pour couvrir la demande souligne MOUSTAPHA
K. (2014). Ce qui permettrait d'après l'auteur d'alimenter certains
services sociaux de base comme les hôpitaux pendant l'absence de cette
ligne d'interconnexion.
Il arrive de fois que la NIGELEC fait des emplacements des
portiques de 250 KVA afin de répondre à la demande d'un quartier.
Cette stratégie est surtout appliquée quand la demande est
nettement supérieure à la capacité du transformateur et
que cette même demande n'atteigne pas un niveau où on devrait
implanter un nouveau poste.
Pour aussi palier aux problèmes de surcharge que
rencontrent les transfos, la société le renforce avec un
autre.
Pour localiser avec précision un défaut sur le
réseau électrique, la NIGELEC utilise un outil de recherche de
défauts de plus performant et qui a retenu mon attention, le Balto et le
Power Fault Locator, PFL 40 A.
Photon°14 et 15 : Outils de recherche des
défauts

Le Balto
Les écouteurs
L'Ecomètre
La canne
Source : NIGELEC 2016
Cet appareil appeler le Balto est interconnecté
à l'Ecomètre qui relie la canne aux écouteurs en cas
d'opération. Cette canne est laissée sur la surface du sol au fur
et à mesure que cette personne avance tout en suivant le tracé du
réseau. Arriver à l'endroit précis du défaut, la
canne émet un signal sonore à l'Eomètre qui à son
tour le transmettra aux écouteurs.

Photo n°16: Power Fault Locator, PFL 40
A
77
Source : NIGELEC 2016
78
On constate également que sur toute la chaîne de
distribution des postes privées et mixtes (voir carte no4).
Ces derniers constituent ainsi, des stratégies pour réduire le
coût des investissements. Ainsi, pour le premier, dont l'utilisation est
souvent individuelle, les dégâts matériels sont sur la
charge du propriétaire. Ce sont des postes créés pour les
entreprises et d'autres services de grandes envergures selon une étude
de la NIGELEC (2014); pour le second, la charge des dommages revient à
la société car d'autres ménages en
bénéficient de son utilisation.
L'analyse de cette bibliographie sur les stratégies
d'adaptation montre que devant l'incapacité du service à couvrir
les besoins de plus en plus croissant des populations, les usagers ont
adopté une résilience énergétique qui ne leur
permet pas de résoudre durablement les problèmes issus de la
précarité. En effet, ce sont des stratégies qui leur
permettent tant bien que mal de répondre à leurs besoins
primaires. Quant à la NIGELEC, elle se sert souvent des
délestages, l'utilisation des groupes, dit en réserve froide, des
portiques et l'implication de certains outils dans la recherche des
défauts sur le réseau électrique.
Conclusion partielle :
Pour l'ensemble des auteurs, l'accent est beaucoup mis sur la
forte urbanisation que connaissent les villes d'Afrique de l'Ouest. Cette
urbanisation ajoutée à d'autres facteurs conduit à la
précarité de l'énergie électrique à laquelle
les populations ont adopté des formes de résiliences.
79
CHAPITRE IV : ANALYSE DES POLITIQUES NATIONALES ET
INTERNATIONALES DE L'ENERGIE
L'accès à l'énergie électrique est
une composante essentielle du développement économique, social et
politique. Il favorise le développement individuel via
l'amélioration des conditions éducatives et sanitaires. Il permet
le développement de l'activité économique par la
mécanisation et la modernisation des communications. Il participe
à l'amélioration de l'environnement économique en
permettant une intervention publique plus efficace et un meilleur respect de
l'environnement. Cependant, malgré un potentiel énorme en
énergies fossiles et renouvelables, l'Afrique présente des
déficits énergétiques importants. Les ressources du
continent sont sous-exploitées, ou exportées sous forme brute, ou
bien encore gaspillées lors de l'extraction ou du transport. En
conséquence, l'offre disponible pour les populations est largement
insuffisante et la consommation d'énergie s'articule essentiellement
autour de la biomasse. Ce qui a amené plusieurs pays et institutions du
continent à s'engager efficacement afin de surmonter les caprices
liés au manque d'énergie électrique.
4.1. La question énergétique : une
préoccupation majeure de la communauté internationale
Depuis quelques décennies, l'accès à
l'électricité est considéré au niveau de la
communauté internationale comme un droit. Le sommet mondial de
Johannesburg en Afrique du Sud sur le développement durable en 2002, a
été l'occasion pour la communauté du lancement de
l'initiative énergie pour l'éradication de la pauvreté et
le développement durable soulignent DFLD (2002) et AIE (2002). Le
rapport intitulé « Energy For the Poor »,
publié lors de ce sommet, avait défini le conteste dans lequel
s'inscrivait cette initiative. Il est mis en relief le lien important existant
entre l'accès à l'énergie et la réduction de la
pauvreté en soulignant qu'il manquait un Objectif du Millénaire
pour le Développement en se référant explicitement
à l'énergie. D'après ces institutions, avec l'adoption des
OMD, l'importance de l'énergie est soulignée comme un moyen de
lutter contre la pauvreté, d'améliorer la santé et de
l'éducation. De même, FRIEDEL H. et al (2004), ont fait une
estimation de l'importance de l'électricité pour le
développement humain des pays africains. Ils ont également eu
à évaluer le rôle de l'énergie hydraulique dans la
production mondiale et locale, ensuite ont fait l'état
80
actuel de la production d'électricité enfin,
montré la place de celle-ci dans le développement durable. VIJAY
et al (2005), affirment que l'électricité joue un rôle
crucial dans la fourniture des services sociaux de base dont l'éducation
et la santé, où le manque d'énergie constitue souvent un
obstacle à leur bon fonctionnement. Pour cela, toute communauté
doit assurer son indépendance énergétique afin
d'espérer le développement de ses secteurs. Face à
l'ampleur de la question énergétique, l'Agence Internationale des
Energies (AIE) a démontré en 2006 la manière dont les
technologies de l'énergie peuvent modifier la cour des choses en
s'appuyant sur plusieurs scénarios mondiaux avant 2015. Elle examine en
détail la situation et les perspectives de technologie
énergétiques dans la production d'électricité et
les moyens par lesquels le monde pourrait renforcer la sécurité
énergétique et freiner la croissance des émissions de gaz
à effet de serre, en recourant à un portefeuille de technologies
actuelles émergentes. Ainsi l'Agence Internationale de l'Energie (2009),
encourage les pays en développement dans le déploiement des
énergies renouvelables. Cela dans le but de permettre l'accès de
tous aux services énergétiques modernes et à moindre
coût. C'est dans ce cadre qu'un atelier a été
organisé à Ouagadougou en avril 2010, réunissant les
directeurs de l'énergie de la région. Il était pour cet
atelier, la mise en place du « livre Blanc » sur
l'efficacité énergétique pour les pays membres de l'UEMOA
et de la CEDEAO. Il est recommandé dans ce livre la création d'un
système d'information sur l'efficacité, le renforcement des
capacités, la formation et la coopération en appuis aux actions
nationales sur l'efficacité énergétique. Ce livre a
été élaboré dans un souci de procurer de
l'énergie durable pour tous. Cet engagement est vite compris par l'Union
Africaine (UA) qui incite le développement des ressources renouvelables
afin de fournir de l'énergie propre, fiable abordable et sans atteinte
à l'environnement. Elle a réaffirmé cette volonté
politique en 2010 dans la déclaration de Maputo au Mozambique,
établissant la conférence de l'Union Africaine. En 2011, des
chefs d'Etats et ministres africains en charge de l'énergie, ont
adopté le communiqué d'Abou Dhabi sur les énergies
renouvelables en vue d'accélérer le développement de
l'Afrique, en prônant une plus grande utilisation des ressources
énergétiques renouvelables du continent. Cela permettrait de
favoriser des économies d'échelles à travers la protection
des pays de la volatilité des prix (des combustibles fossiles). Ainsi,
lors du sommet mondial Rio +20, l'assemblée générale des
Nations Unis pour le Développement Durable avait proclamé
l'année 2012, « l'année internationale de
l'énergie durable pour tous » en fixant des objectifs
ambitieux en vue d'améliorer d'une part l'accès aux services
énergétiques modernes et de l'autre l'efficacité
énergétique dans tous les secteurs d'activités
économiques et développer d'avantage des énergies
renouvelables. Lors de ce
81
sommet des nouveaux objectifs ont été
fixés par les Nations Unis en matière d'accès à
l'énergie durable à l'horizon 2030. Il s'agit de garantir
l'accès universel à l'électricité et de doubler la
part de l'énergie provenant des ressources renouvelables de 15 à
20 % ainsi que l'amélioration de l'efficience énergétique.
ANJALI S. (2012), pense qu'il faut développer des nouvelles approches et
une capitalisation méthodologique sur la thématique de
l'accès pour tous, aux services électriques en Afrique
subsaharienne. Alors que, l'Agence Internationale des Energies Renouvelables
(2013), place l'énergie au service du développement
économique. Pour cela, elle prévoit le développement des
énergies renouvelables afin de permettre l'accès d'un nombre
important à l'électricité.
Ainsi des nouvelles mesures ont été prises par
la CEDEAO visant la création du Centre Régional pour les Energies
Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (CEREEC). Cet
organisme sera chargé de mener des actions au niveau régional
pour l'utilisation des énergies renouvelables. Le CEREEC, avec le
soutien de la commission européenne, de l'Agence de l'Environnement et
de la Maitrise de l'Energie (ADEME), du programme des Nations Unis pour le
Développement (PNUD), de l'Autriche et de l'Espagne aura pour mission
d'engager une démarche visant à capter l'énorme potentiel
de l'économie apporte IBRAHIM S et al (2012). Dans le même ordre
d'idées, un atelier régional sur le climat et l'énergie en
Afrique Centrale a vu le jour à Yaoundé du 22 au 24 juillet 2014,
visant à faire l'état des lieux et l'enjeu de l'efficacité
énergétique du Cameroun afin d'élaborer une politique des
stratégies et un plan d'action en matière d'efficacité
énergétique souligne AHMADOU B. (2014).
Au Niger, nombreux sont des études traitant de la
distribution et de la politique énergétique. Ainsi en 2004,
l'Etat Nigérien à travers une déclaration s'est
proposé de dégager des orientations dans le secteur de
l'énergie, en conformité avec celles de la communauté
internationale, afin d'impulser une dynamique du développement en
harmonie avec le reste du monde. Ces orientations visent entre autres une
meilleure gestion des entreprises énergétique, une mobilisation
accrue du partenariat privé ainsi qu'une promotion de l'accès aux
services énergétiques modernes en milieu rural et urbaine. C'est
dans cette optique que MOUSTAPHA K. (2010) a fait un état de lieux de la
situation électrique au Niger. En effet, il avait
énuméré les différentes contraintes qui minent la
Société Nigérienne d'électricité (NIGELEC)
ainsi que les stratégies adoptées par cette dernière et
ses abonnés afin de pouvoir surmonter ses difficultés. Au regard
des contraintes que rencontre le Niger dans son alimentation en énergie
électrique le Fonds Monétaire International (2013), affirme que :
« le principal défi consiste à promouvoir l'accès
à l'énergie électrique en milieu rural, à
améliorer la desserte en milieu urbaine et à renforcer
l'indépendance énergétique notamment à partir de
sources
82
renouvelables telles que le solaire et
l'hydroélectricité ». Abondons dans le même sens,
GAURI S. (2014) pense que le Niger doit explorer une multitude d'option
technologiques afin de diversifier son approvisionnement
énergétique et instaurer la stabilité
énergétique du pays. Ce qui impliquerait, l'exploitation
d'importantes sources d'énergies renouvelables. Partant du même
constat, la NIGELEC à travers ses rapports d'activités des
années 2011 à 2015, a montré les efforts déployer
par l'Etat et ses partenaires dans une politique de renforcement des
équipements existants et de production des nouvelles sources
d'énergie afin de pallier aux déficits de l'offre
accentuée par la demande dans le but de favoriser l'accès de tous
à l'électricité.
4.2. Les débats sur la gouvernance
énergétique
Plusieurs études ont été menées
dans le cadre de la gestion de l'électricité à travers le
monde. C'est ainsi que BERTEL E. et MOLINA P. (1993), présentent les
débats sur les stratégies énergétiques en
Amérique latine et les Caraïbes. En effet, ils prévoient le
développement de l'énergie nucléaire pour répondre
à la demande croissante d'électricité dans la
région au cours des prochaines années. Tandis que d'autres voient
des conséquences néfastes dans l'exploitation de cette source
d'énergie car pourrait engendrer la pollution de l'environnement et
plusieurs autres risques. C'est le cas par exemple de l'explosion de la
centrale nucléaire de Fukushima en 2011 en Chine. C'est dans cette
foulée que RAYMOND M8. (1993) pense « plutôt
qu'il faut développer l'énergie solaire surtout pour les pays
africains où la constante solaire avoisine 1000 watts au m2
à l'instant « T » sur la surface de la terre en (terme de
puissance lorsque le soleil brille) et 1400 watts dans quelques régions
du Sahara ». Pour cet auteur, l'Afrique reste le continent le plus
riche au monde en matière d'énergie. Pour cela le continent doit
nécessairement exploiter ce potentiel énergétique pour la
satisfaction de besoins de sa population. Ce qui s'avère
intéressant quand on sait que l'Afrique s'est engagé depuis un
certain dans le processus du développement durable. Cela permettrait de
préserver les ressources écologiques à travers le
développement des sources d'énergies non polluantes. Pour
POUZOLES (1995), la solution revient à la lutte contre le gaspillage, la
rationalisation des processus de fabrication et la substitution de
l'électricité aux énergies traditionnelles comme le
charbon minéral ou l'autoproduction à partir des
récupérations. Pour lui l'électricité doit
être gérée rationnellement sans qu'il y ait le moindre
gaspillage au niveau des unités industrielles. Ce qui permettrait selon
lui de répondre aux besoins de tous en matière
8 RAYMOND L. 1993_Le Monde et l'Afrique. Extrait des
Marchés Tropicaux, Septembre 1993. P.45
83
d'électricité. Cette étude est d'une
grande importance pour les pays du sud qui amorcent un processus
d'industrialisation.
Aujourd'hui, dans un souci de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations future à répondre au leurs, la
majorité des pays de la planète se reconnaissent dans cette
volonté de mise en oeuvre d'une politique visant l'exploitation des
sources d'énergie nouvelles. Ceci a des conséquences sur la
manière de concevoir la production d'énergie électrique et
son utilisation souligne le Conseil Economique et Social Régional
(2010). A cet effet, FRANÇOIS S. (2012) pense que la Banque Mondiale
doit s'engager à aider les pays africains à construire ou
à rénover les infrastructures énergétiques
existantes, tout en renforçant la gouvernance des compagnies
d'électricité. C'est ainsi que l'Energie De France (EDF) (2012),
prévoit le renforcement des potentiels hydrauliques et le
développement d'autres sources d'énergies renouvelables. Ce qui
est primordial dans un monde où le développement durable est
prôné par les politiques.
Cependant SECOUR S. (2012), pense que la problématique
de la gestion énergétique devrait être repensé en
donnant la priorité non pas à l'accès à
l'éclairage moderne, mais aussi aux sources d'énergie nouvelles.
A cet effet il prévoit la mise en valeur des énergies
photovoltaïques en vue de renforcer la création d'emplois, de
revenues et de la valeur ajoutées, qui demeurent des
éléments clés de la croissance économique et de
lutte contre la marginalisation. SECOUR à travers cet argumentaire se
réfère aux énergies renouvelables qui permettent de
réaliser des économies d'échelles. DOMINIQUE A. et al
(2014), affirment que l'Union Européenne (UE) doit assurer
l'approvisionnement en énergie de qualité et de quantité
suffisante, la préservation du pouvoir d'achat et la
compétitivité européenne ainsi que la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Pour
cela EMILIE F. et al (2014), avaient étudié le réseau
électrique afin de mener une bonne politique
d'électricité. En effet, ils se sont intéressés au
fonctionnement actuel des réseaux électriques, de la production
jusqu'à la consommation en passant par le transport, puis étudier
sa mise en place, le fonctionnement et la portée des énergies
renouvelables avant d'écrire les limites ainsi que des pistes
alternatives pour une meilleure gestion de l'électricité. A cet
effet l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) affirme que la gestion devient
une obligation pour tous les pays, dans la mesure où la demande
énergétique mondiale augmenterait de 60% d'ici 2030, grâce
notamment au développement de l'industrialisation. C'est dans ce cadre
que BENJAMIN P. et al (2011), ont développé un outil de gestion
de l'énergie électrique. Cet outil permettra pour ces auteurs
d'améliorer le fonctionnement de plusieurs sources d'énergie au
sein d'un bâtiment. Cet outil se base sur la programmation
linéaire appliqué via
84
l'algorithme du simplexe. Ce dernier permet selon eux de
déterminer précisément lors d'une sollicitation de la
charge, quelle puissance doit être utilisée pour chacune des
sources dans l'optique de minimiser un coût économique.
Pour parvenir à harmoniser le secteur de
l'énergie en Côte d'Ivoire, DJEZOU W. B. (2009) pense qu'il faut
redynamiser le cadre institutionnel nécessaire dans le sens d'une
gestion plus globale du secteur plutôt qu'une gestion sectorielle. Il
ajoute aussi que les niveaux de responsabilités des différents
opérateurs devraient être clairement définis et
éviter que les fonctionnaires exerçant dans le secteur soient en
même temps operateurs. Cela pour une gestion objective du secteur de
l'énergie. C'est ainsi qu'il prévoit l'élaboration d'un
système de réglementation institutionnelle et tarifaire incitatif
et une redéfinition des politiques énergétiques et
environnementales englobant tous les sous-secteurs de l'énergie, et
particulièrement les sources d'énergies renouvelables. Il
encourage aussi la consolidation des actions communes en matière de
coopération énergétique et environnementale pour aboutir
à la création d'un marché régional de
l'énergie. Ce qui a poussé le gouvernement Camerounais à
élaborer un plan énergétique national d'après une
étude de HELIO INTERNATIONAL (2011). Ce plan a pour but de
préserver l'indépendance énergétique et le
développement des échanges extérieurs, de promouvoir
l'accès à l'énergie à un prix raisonnable et
compétitif, de maitriser l'énergie tout en préservant
l'environnement, d'améliorer l'efficacité du cadre juridique,
réglementaire, institutionnel et des mécanismes de financement du
secteur de l'énergie. Dans le même ordre d'idée, le groupe
de la BANQUE MONDIALE (2009), propose des stratégies
énergétiques afin de décanter un des principaux
défis de la plupart des pays en développement et d'assurer un
approvisionnement en électricité plus fiable et à la
hauteur des besoins, tout en permettant à l'ensemble de la population
d'avoir financièrement accès aux services
énergétique modernes. La politique de la Banque Mondiale est
d'assurer l'approvisionnement à un prix raisonnable de
l'électricité. Ce qui nécessite des financements pour
accroitre la base d'approvisionnement, réduire les pertes de transfert
et assurer une utilisation plus rationnelle de l'énergie que bon nombre
des pays ne sont pas parvenus à mobiliser jusqu'à présent.
Cette politique de la Banque Mondiale a été applaudie par
plusieurs chercheurs et a permis le développement des nouvelles
stratégies adopter par d'autres. ANDRIS P. (2012), pense qu'il faut
revoir les politiques énergétiques des pays en
développement pour permettre l'accès de tous aux sources
d'énergie durable. A travers cette étude il évoque le taux
d'électrification des régions de l'Afrique subsaharienne qui est
de 30 % et mentionne la participation de l'Union Européenne à
l'initiative des Nations Unis pour l'accès aux services
énergétiques modernes. Pour accroitre l'accès à
l'énergie, cet auteur
85
propose l'intégration à travers des grands
projets d'électrification de portées régionales et la
production diversifiée d'électricité d'origine
renouvelables. Dans le même ordre d'idée, JEAN PIERRE F. et col
(2009) pensent qu'il faut diversifier les sources d'alimentation
énergétique et surtout faire recourt aux sources d'énergie
renouvelable. Ce qui permettrait non seulement d'accroitre le taux
d'accès à travers la production décentralisée, mais
aussi de réduire l'impact de la production énergétique sur
l'écosystème à travers également l'utilisation de
ces sources d'énergies renouvelables. Cela va de pair avec la politique
de la BANQUE AFRICAINE DE DEVELEOPPEMENT et de la FAD (2012). Pour ces
institutions, la politique du secteur de l'énergie doit viser un double
objectif ; d'une part, appuyer les efforts des pays membre régionaux qui
visent à fournir à l'ensemble de leur population et au secteur de
production, l'accès aux infrastructures et aux services
énergétiques modernes, fiables et à un coût
abordable, de l'autre à aider ces pays à développer un
secteur de l'énergie durable au plan social, économique et
environnemental. Cela permettrait de réduire les
inégalités d'accès et le renforcement de la
compétitivité économique du continent qui enclenchera,
à son tour, une croissance économique plus rapide et un
développement social équitable.
L'analyse de ce qui précède montre que la
gestion de l'énergie consiste à orienter sa demande vers
l'utilisation de plusieurs sources d'énergie. Ainsi, pour une meilleure
gestion de l'énergie, l'analyse de cette rubrique montre que
l'unanimité est faite par les auteurs sur la diversification des sources
d'énergie. Mais, ces auteurs proposent surtout l'utilisation des sources
d'énergie renouvelable et cela dans le but d'accroitre l'accès
d'un plus grand nombre des populations aux sources d'énergie moderne,
à moindre coût et sans atteinte à l'environnement. Pour
mener à bien l'utilisation de ces sources d'énergie, certains ont
développé un outil de gestion énergétique. Cet
outil sert à améliorer le fonctionnement de plusieurs sources
d'énergie au sein d'un seul bâtiment. Cet outil se base sur une
approche mathématique qui permet de déterminer
précisément lors d'un appel en puissance, l'énergie que
doit émettre chaque source installée sur le bâtiment. Alors
que pour DJEZOU W. B. (2009) et HELIO INTERNATIONAL (2011), en Côte
d'Ivoire et au Cameroun, il est important de revoir le cadre juridique,
règlementaire et institutionnel de la politique
énergétique de ces pays afin de promouvoir les projets
d'électrification des portées régionales.
4.3. La stratégie de promotion des
énergies renouvelables au Niger
86
4.3.1. Analyse du cadre institutionnel de la politique
énergétique du Niger
Le cadre institutionnel est marqué par la
responsabilité Etatique à travers le Ministère de
l'Energie et du Pétrole, le Comité National Multisectoriel de
l'Electricité (CNME), le Comité National de l'Electricité
(CNE), le Centre National de l'Energie Solaire (CNES), La NIGELEC et plusieurs
autres institutions intervenant dans la production de l'énergie
électrique.
Le Ministère de l'énergie fixe les orientations
de la politique sectorielle et exerce la tutelle sur la NIGELEC. Ainsi,
l'article 7 du projet de nouveau code prévoit que le ministère
est chargé notamment de planifier et définir, avec les autres
partenaires, les programmes de développement d'électrification
selon les besoins du pays et prendre part à l'élaboration des
plans généraux de développement économique en ce
qui concerne plus particulièrement les actions relatives à la
politique énergétique. Ce qui permettrait de tenir compte des
priorités des zones à électrifier. C'est ainsi qu'il
veille au développement rationnel de l'offre de l'énergie
électrique pour un approvisionnement sécuritaire du pays tout en
définissant la politique tarifaire dans le sous-secteur de
l'électricité. Ce qui favorisera l'accès d'un grand nombre
de la population à l'électricité et cela à travers
le développement de l'électrification rurale. Ce qui fait du
ministère un véritable organe de décision, de
planification et d'orientation. Ainsi compte tenu du caractère
stratégique du sous-secteur de l'électricité, il est
parfaitement fondé que le ministère puisse avoir ce rôle
central.
Le projet de nouveau code de l'électricité
prévoit la création d'un organe de régulation concernant
le secteur de l'électricité. Cet organe appelé, Commission
de Régulation de l'Energie au Niger qui viendra se substituer à
l'Autorité de Régulation Multisectoriel (ARM) créée
par l'ordonnance 99-044 du 26 octobre 1999 telle que modifié par la loi
n° 2005-31 du 1er décembre 2005 et par l'ordonnance n° 2010-83
du 16 décembre 2010.
Elle est chargée de missions de proposition et de
consultation. Pour cela elle consiste d'abord à soumettre au
gouvernement les propositions et les tarifs fiscaux garantissant
l'équilibre financier du secteur et mettre en oeuvre les
mécanismes de leur révision périodique et assure le
respect de leur application par les opérateurs puis développe le
model de régulation garantissant l'équilibre économique et
financier du sous-secteur de l'électricité. Elle initie les
projets de textes régissant les rapports entre les opérateurs du
sous-secteur de l'électricité, les associations des consommateurs
et les utilisateurs. Elle veille aussi au respect par les opérateurs du
cadre réglementaire régissant le sous-secteur de
l'électricité ainsi que les conventions entre ses operateurs et
l'Etat. Et cela dans le but de permettre l'accès équitable et
transparent des tiers aux réseaux de transport et de distribution, dans
la limite des capacités
87
disponibles, suivant des conditions fixées par
décret et de s'assurer de la qualité de desserte, de la
continuité du service public de l'électricité. Elle veille
également au respect des normes et standards applicables à
l'environnement, à la qualité de la vie et aux équipements
de production, de transport et de distribution de quelques sources que ce soit.
En fin, elle veille au respect des accords internationaux ratifiés
relatifs aux échanges transfrontaliers notamment dans le cadre du
marché régional de l'électricité de la CEDEAO pour
une politique d'efficacité énergétique. Cette politique
vise l'utilisation des sources d'énergie variables afin de permettre
l'accès d'un plus grand nombre des populations à
l'électricité et surtout à moindre coût.
Toutefois, cette future autorité de régulation
au demeurant, force est de constater qu'elle dispose de très peu de
pouvoir décisionnaires.
Ainsi pour une meilleure gestion du secteur de
l'électricité, il a été mis en place un
Comité National Multisectoriel Energie (CNME). Ce Comité est le
seul organe où une véritable interaction peut opérer entre
les différentes entités intervenant dans le secteur de
l'électricité et donc une meilleure concertation et un partage de
l'expression des besoins, des contraintes et des projets. Dans ce cadre,
l'institution CNME, par l'arrêté n°078/MME/DERD du 18 Aout
2005 et par l'arrêté n°9/MEP/DGE/DERED du 12 mars 2012,
regroupant notamment les ministères, le conseil de l'environnement pour
un développement durable, les sociétés privées de
l'énergie, les utilisateurs d'énergie ainsi que des organismes
internationaux actifs dans le secteur de l'électricité du Niger
en se référant au PNUD et l'Union Européenne, est un point
très positif. Il sensibilise les acteurs sur l'importance de la
composante énergie sur leur développement; maximise les effets de
la ressource énergétique sur le développement
économique et social. A ce niveau il encourage le développement
des ressources renouvelables afin d'affaiblir l'impact des ressources
énergétique sur la vie socioéconomique. Pour cela, il
cherche à promouvoir les projets énergétiques
multisectoriels dans l'optique d'accroitre l'accès à
l'énergie des équipements sociaux et de développer des
usages productifs pour la création de richesse. Il contribue à la
mise en oeuvre et au suivi des activités du « livre blanc
» de la CEDEAO en matière d'accès aux services
énergétiques.
Ainsi, sans disposer de réels pouvoirs contraignants ou
de décision, la CNME consiste en un organe de facilitation, de
coordination et d'harmonisation.
Toutefois, outre la question institutionnelle, le CNME devra
être d'avantage associé et consulté à toutes les
réflexions en matière énergétique afin d'en faire
un réel organe de facilitation, de coordination et d'harmonisation.
88
Par ailleurs, compte tenu du rôle croisant que les
collectivités territoriales dont notamment à Niamey devraient
avoir dans le sous-secteur de l'électricité, il sera pertinent
que la composition du CNME soit revue pour inclure une représentation
des collectivités territoriales.
S'agissant du Comité National de l'Electricité,
il donne son avis sur les dossiers d'extension des réseaux
électriques des villes et communes, la sécurité des
installations électriques intérieures et toutes les questions
relatives à la production, au transport et à la distribution
d'électricité. Cependant, il semble être un organe informel
pour lequel aucun texte fondateur n'a pu être identifié. Il ne
s'agit pas de prévoir l'institution de cette entité par voie
législative. En revanche, un décret d'application du nouveau code
de l'électricité pourrait porter sur cette entité afin
d'organiser son fonctionnement et surtout de délimiter sa mission.
Au titre du dispositif institutionnel, le Niger s'est
doté d'un Centre National de l'Energie Solaire anciennement
appelé Office National de l'Energie Solaire (ONERSOL), qui est un
établissement public à caractère administratif
créé par la loi n° 98-017 du 15 juin 1998. Son statut est
fixé par le décret 99-460 PCRN/MNE du 22 novembre 1999.
Le CNER est chargé de réaliser les études
prospectives et diagnostiques en matière d'utilisation des
énergies renouvelables pour tous les secteurs de l'économie
nationale. Il participe à la formation et à la promotion de la
diffusion des équipements dans le domaine des énergies
renouvelables. Mais cette institution fait face depuis sa mise en place d'un
manque de financement. Ce qui fait que le Niger reste toujours à la
traine par rapport au développement de l'énergie
photovoltaïque.
Concernant la NIGELEC, elle a été
créée le 7 septembre 1968 par l'Etat du Niger pour
succéder à la Société Africaine
d'Electricité (SAFELEC) qui était la société qui
gérait la production et la distribution de l'énergie
électrique dans toute l'Afrique Occidentale Française. Elle
exerce ses activités sous un régime de concession et a pour
mission, la production, l'achat, l'importation, le transport et la distribution
de l'énergie électrique sur tout le territoire de la
République du Niger. Elle est chargée de l'approvisionnement du
pays en énergie électrique conformément aux textes en
vigueur et suivant un traité de concession signé le 03 mars 1993
entre l'Etat et la NIGELEC qui définit les obligations
réciproques des deux parties. Ainsi, l'Etat a la charge de
réaliser tous les investissements d'électrification de nouveaux
centres, et la NIGELEC a pour obligation d'exploiter, d'entretenir et de
renouveler les ouvrages électriques concédés. Mais depuis
quelques décennies, cette société de l'Etat a du mal
à satisfaire de façon continue les besoins en
électricité des populations. En effet, la NIGELEC fait face
à des multiples problèmes qui assaillent son rôle de
prestataire public
89
d'électricité. Ces difficultés sont entre
autres, la mauvaise gestion de la société, la dépendance
vis-à-vis du Nigeria, le manque du financement par l'Etat dans le
secteur, la multiplication de la population et l'étendue du pays.
Jusqu'en 2003, la production d'électricité
était un monopole de la NIGELEC. Le code de l'électricité
du 31 janvier 2003 est venu remettre en cause ce monopole en prévoyant
la possibilité, d'une part, d'une production indépendante et,
d'autre part, de l'autoproduction. En effet, la production
d'électricité souffre d'un déficit structurel, que la
NIGELEC ne pourra pas résorber seule. Des lors, il est nécessaire
de permettre à d'autres opérateurs de pouvoir développer
et exploiter des moyens de production électrique. Et cette
possibilité devrait concerner tant des moyens de production thermique
qu'à partir de sources d'énergies renouvelables. Dans ce cadre,
l'Etat peut autoriser le développement d'outils de production
électrique indépendante ou des installations d'autoproduction.
Toutefois, au-delà du principe lui-même,
certaines modalités et dispositions administratives devraient être
revues pour donner sa pleine efficacité à la
libéralisation de la production électrique.
Le traité de concession de 1993 a été
signé dans le cadre juridique établit par l'ordonnance n°
88-064 du 22 décembre 1988, portant sur le code de
l'électricité, sans qu'il soit révisé ou
remplacé lors de prise d'effet du nouveau code de
l'électricité. Dans ce contexte, il existe une incohérence
voire une contradiction entre les dispositions du code de
l'électricité et celle du traité de concession. Ainsi,
alors que le code de l'électricité a libéralisé la
production d'électricité, le traité de concession
considère encore qu'il s'agit d'un monopole légal.
Par ailleurs, il est essentiel que la concession en tant que
mode de gestion indirecte par l'Etat d'un service public puisse permettre
à l'Etat d'atteindre des objectifs, lesquels doivent figurer dans le
traité de concession et de constituer des principes d'orientation pour
le délégataire. Par conséquent, le traité de
concession devrait traduire les orientations de l'Etat. Par exemple en
matière de maitrise de l'énergie ou d'énergie
renouvelables. Dès lors, il est nécessaire qu'un nouveau
traité de concession soit rapidement signé à la suite de
l'adoption du nouveau code de l'électricité.
En outre, l'inadéquation avec le cadre
réglementaire en vigueur, des critiques intrinsèques peuvent
être formulé à l'égard du traité de
concession. Il s'agit de l'absence d'objectifs. En effet, il est patent que le
traité de concession ne contient pas d'objectifs en termes de
qualité, de continuité, d'investissements, branchements, pertes
etc.
Or, quelle que soit l'appellation du document, il est
essentiel que le concédant du service public fixe au
délégataire les objectifs qu'il souhaite atteindre. Ainsi, l'Etat
devrait être en
90
mesure, régulièrement ou lors de tout
contrôle, de vérifier si les objectifs sont atteints ou non,
d'identifier les causes et de tirer les conséquences. Ces objectifs
devraient être formulés de manière objective,
précise et mesurable. Il est aussi à noter l'absence de
critère de performance. En effet, la fixation des objectifs
précis pourrait s'accompagner de la fixation de critère de
performance permettant au délégant de vérifier à
différents pas de temps la courbe d'atteinte des objectifs afin de
procéder à des ajustements qui s'avéraient
nécessaires. Cela est d'autant plus le cas que jusque- là, les
concessions sont accordées pour des durées longues (50 ans). Il y
a aussi l'absence de mesures incitatives. C'est ainsi que la fixation des
objectifs et l'établissement de critères de performance
pourraient également s'accompagner de mesures incitatives permettant au
délégant d'inciter le délégataire à
optimiser ses efforts, ses programmes et ses moyens en vue d'une atteinte des
objectifs de manière optimale. Il est également constaté
l'absence de dispositions adéquates en matière de financement des
investissements. Ainsi, lorsqu'un délégant met à la
disposition d'un délégataire des biens qu'il a financé, il
est constant qu'une redevance soit due au délégant. Ces biens
sont en effet, les moyens permettant au délégataire d'assurer les
missions de service public et de se rémunérer à travers le
tarif payé par les clients. Or, aucune redevance n'est prévue. Et
cela, n'est pas favorable à l'autofinancement des activités
relevant du traité de concession et implique un financement des travaux
d'extension sur les ressources de l'Etat.
L'ensemble de ces contraintes et obstacles de nature
institutionnelle et contractuelle appellent donc à une adoption rapide
du nouveau code de l'électricité.
4.3.2. Les projets de lutte contre la
précarité énergétique au Niger
Il s'agit ici d'analyser les actions visant à
améliorer la situation de l'énergie électrique du pays. Ce
sont essentiellement des projets de renforcement, d'extension du réseau
et du développement des sources d'énergies nouvelles afin de
fournir de l'électricité sur l'ensemble du territoire
national.
4.3.2.1. Projet de renforcement et d'extension du
réseau de distribution électrique D'après nos
investigations au niveau de la NIGELEC en Mars 2016, plusieurs projets
interviennent dans le cadre du renforcement et d'extension du réseau de
distribution électrique au Niger.
Ainsi, la NIGELEC avec la collaboration de l'Agence
Française du développement a engagé la réalisation
du projet d'extension des réseaux de distribution en zone urbaine et de
développement de l'accès à l'électrification en
zone rurale.
91
Pour la ville de Niamey, il s'agit de réaliser
l'extension du réseau de distribution HT/BT dans quatorze (14) quartiers
par la construction de 45 000 mètres de réseaux aériens
MT, 81 postes cabines de types H59 de 400 KVA et 630kVA, 4 100 mètres de
réseau souterrain MT, 18 poste de type H61 de 160 KVA, 710 000
mètres de réseaux aériens BT. Ce qui permettrait de
rattraper le retard dans l'extension du réseau électrique face
à la croissance démographique de la ville. Mais, cela pourrait
être source de problème pour la NIGELEC, car l'offre
d'électricité étant déjà inferieure à
la demande. Alors il sera impératif pour la NIGELEC d'augmenter ses
capacités de production afin de répondre à cette demande
déjà supérieure à l'offre et à celle des
nouveaux raccordées.
Pour accompagner la NIGELEC, La Banque Mondiale entreprit un
projet d'expansion de l'accès à l'électricité au
Niger (Niger Electricity Access Expansion Project-NELACE) souligne la NIGELEC
(2016). Ce projet va, entre autres permettre la réalisation d'une partie
du programme d'investissement en matière de distribution de
l'électricité, à travers sa composante 1 : extension et
renforcement du réseau de distribution.
Pour la ville de Niamey, les extensions portent d'après
la NIGELEC sur le quartier KoiraTegui, avec la construction de 18 nouveaux
postes de distribution MT/BT, équipés d'un transformateur de 400
KVA chacun, avec les lignes de distribution MT/BT associées. Il est
prévu au total de construire 12,2 km de lignes MT (Moyenne Tension) et
110 km de lignes BT (Basse Tension). Ce qui permettrait de réduire le
caractère inégal de la rétrocession qui sévit dans
ce quartier depuis un certain temps et rompre avec tous les risques d'incendies
que cela pourrait engendrer.
Il est aussi prévu, la réhabilitation de sept
(7) anciens postes de distribution MT/BT, munis d'équipements
obsolètes et dangereux qui seront remplacés par de nouveaux
postes en cabine maçonnée. Cela va permettre de redynamiser le
réseau électrique afin qu'il puisse être performent. Les
transformateurs proches de leurs limites de charge seront également
remplacés. Ce qui réduira les risques d'incendie causé par
le claquage de ces transformateurs surchargés. Douze (12) postes de
distribution MT/BT équipés de vieilles cellules (vercos 500)
seront renouvelés avec des nouveaux appareillages. Les câbles MT
obsolètes en aluminium de 3×150 mm2 seront remplacés par des
câbles unipolaires de 3× (1×150mm2) pour améliorer la
fiabilité du réseau MT.
Le renforcement couvre vingt-huit (28) transformateurs ayant
atteint 75 % de leur capacité, qui seront remplacés par d'autres
d'une plus grande capacité. Vingt-trois (23) postes de distribution
MT/BT sur poteaux, fonctionnant à plus de 75 % de leur capacité
seront convertis en postes cabine maçonnée, équipée
de transformateurs d'une plus grande capacité. En outre,
92
157 km de câbles BT seront posées pour atteindre
des nouveaux clients ou anciens. Ce qui permettrait de désenclaver
certains quartiers de leur manque d'électricité et réduire
la criminalité et le banditisme dans ses quartiers à travers
l'éclairage public auquel les autorités vont s'adonner.
Cependant, il incombe à la NIGELEC de renforcer ses moyens de production
car le problème de la prestation du service électrique ne se
limite pas seulement à la faiblesse du réseau électrique
mais de la capacité de production électrique de la
société.
La densification concerne douze zones identifiées
où 67 postes de distribution MT/BT vont avoir leur capacité
augmentée avec 3 km de réseaux souterrains MT et 188 km de
réseau BT construits. Ce qui permettrait d'adapter le réseau
à la dynamique actuelle de la ville.
Ce projet de renforcement et de réhabilitation des
postes sources vont se traduire par la fourniture et l'installation des
équipements sur le poste de Goudel, Niamey 3, Niamey Nord et le poste de
répartition. Dans ce même cadre il est prévu la
création d'un nouveau départ, dénommé départ
Hamdalaye 2. Et cela a pour but de désenclaver certains quartiers de
Niamey 2000.
Cependant, divers ouvrages sont en cours de réalisation
ou d'achèvement afin de pouvoir augmenter la capacité de
production électrique de la société. On peut citer entre
autres les projets suivants :
· Construction d'une centrale Diesel de 80 MW à
Niamey (en cours d'achèvement), sous financement BOAD-BID à un
coût de 75 milliards de franc CFA ;
· Numérisation du réseau de distribution
de Niamey et mise en place d'un système d'information
géographique sous financement de la NIGELEC à 160 millions de
franc CFA ;
· Mise en place d'un logiciel de gestion
(Comptabilité, gestion clientèle et GRIT) sous financement
NIGELEC à un coût de 2,3 milliards de franc CFA ;
D'autres projets sont en cours d'étude ou en voie de
démarrage, notamment :
· Etude de la politique et de la stratégie
d'accès à l'électricité assortie d'un plan d'action
sur 5 ans ;
· Etude d'un plan directeur de la production et du
transport de l'électricité au Niger ;
· Etude d'un modèle financier pour la NIGELEC
;
· Appui à la préparation d'un projet
solaire photovoltaïque ;
· Etude d'un dispatching et d'un système de
téléconduite du réseau de distribution ;
·
93
Au plan sous régional, mise à jour de
l'étude du tracé et de l'avant-projet détaillé de
la ligne d'interconnexion WAPP Dorsale Nord 330 kV Birnin
Kebbi-Niamey-Ouagadougou et Zabori-Malanville.
Il existe également d'autres perspectives à plus
long terme, dont nous avons :
· La construction de la 1ere phase de
l'interconnexion WAPP Dorsale Nord 330 kv Birnin Kebbi-Niamey et
zabori-malanville : instruction du projet en cours au niveau d'Eximbank de la
Chine pour permettre de résorber le déficit de l'offre de
production résultant du retard des autres grands projets de
production.
· La construction de la centrale hydroélectrique
de Kandadji : 130 MW y compris la ligne d'évacuation d'énergie en
132 kV vers Niamey sous financement de la BAD-BID-Banque Mondiale-BADEA, etc.
à l'horizon 2021.
· La construction de la centrale thermique à
charbon de Salkadamna : 600 MW y compris les lignes 330 KV Salkadamna-Niamey et
Salkadamna-Tahoua-Malbaza sous financement de la BOOT (Build - Own - Operate -
Transfer) à l'horizon 2020 ;
· La construction de la centrale solaire
photovoltaïque à Niamey : 20 à 30 MW ;
· L'extension et le renforcement des réseaux de
distribution des chefs-lieux de région ;
· Le renforcement du réseau national de
transport.
La réalisation de tous ces projets va permettre la
réduction de la dépendance énergétique du pays et
du coup augmentera l'accès à l'électricité d'un
plus grand nombre de la population nigérienne à travers la
réduction du prix du kilowattheure. Toutefois, la production
d'électricité par les centrales diesels et thermiques est source
de problèmes. En effet, la production d'électricité
à partir des centrales diesels demeure moins rentable pour la NIGELEC,
car demande des gros investissements. Elle accentue aussi le
phénomène du changement climatique à travers la
destruction de la couche d'ozone par la fumée qui sera
dégagée. Pour cela, il serait mieux de développer les
sources d'énergies renouvelables.
4.3.2.2. Projet de développer les
énergies renouvelables et de maitrise de l'énergie
Face à la situation énergétique qui
prévaut depuis plusieurs années au Niger, l'Etat et ses
partenaires ne sont pas restés sans rien faire. Ainsi, le projet de code
de l'électricité dispose en son article 48 que la maitrise de
l'énergie électrique vise à orienter la demande
d'énergie vers une plus grande efficacité du système de
consommation et qu'elle permet d'assurer et d'encourager le progrès
technologie, d'utiliser rationnellement l'énergie électrique, et
de
94
contribuer au développement durable d'après nos
investigations au niveau de la NIGELEC (2016).
Dans ce cadre, l'Etat joue le rôle de promoteur, de la
maitrise de l'énergie électrique et à cet effet, il
conçoit et met en oeuvre un programme national de maitrise de
l'énergie électrique. C'est ainsi qu'a été
créé le CNES en 1998 dont ces missions ont été
citées ci-haut.
Toutefois, les collectivités territoriales peuvent
mener des actions dans le domaine de la maitrise de l'énergie
électrique en collaboration avec d'autres partenaires, avec l'assistance
du ministère en charge de l'énergie électrique.
Cependant, le projet de code précise que l'Etat assure
la promotion et le développement des énergies renouvelables pour
accroitre significativement leur part dans le mix énergétique du
pays et qu'il peut recourir à des mécanismes de promotion des
énergies renouvelables et d'incitation au partenariat
public-privé.
Or, dans la mesure où les difficultés
d'alimentation électrique que rencontre le Niger en
général et la ville de Niamey en particulier dépendant de
l'acheminement mais également et surtout de l'approvisionnement
électrique, le développement des programmes de maitrise de
l'énergie et des projets de production d'électricité
à partir de sources d'énergie renouvelables permet de
répondre aux difficultés d'alimentation électrique
susvisées. Dans ce cadre, il a été adopté en 2012,
un Plan de Développement Economique et Social (PDES), préconisant
le rôle prépondérant des énergies renouvelables.
Pour cela le gouvernement s'est fixé un objectif de 10 %
d'énergie renouvelables dans le mix énergétique national
d'ici 2020 affirme GAURI S. (2013). Ce qui permettrait selon l'auteur de
répondre efficacement aux besoins des populations sans atteinte à
l'environnement. Ce point de vue de GAURI est aussi partagé par RAYMOND
M. (1993) ; AIE (2009) ; JEAN PIERRE F. (2009) ; SECOUR S. (2012) ; IRENA
(2013) ; EMILIE F et al (2014) pour qui l'utilisation des sources
d'énergie renouvelables permettra non seulement d'augmenter le taux
d'accès à l'énergie mais aussi de réduire l'impact
de la production électrique sur l'environnement.
Conclusion partielle :
Face à cette situation de précarité
énergétique, plusieurs politiques ont vu le jour. Ces politiques
visent surtout l'amélioration de la situation de l'énergie
électrique du pays en générale et celle de la ville de
Niamey en particulière.
95
CONCLUSION GENERALE
Les conclusions auxquelles nous sommes parvenues dans ce
travail confirment nos hypothèses de départ. C'est ainsi que la
première hypothèse selon laquelle, la non maitrise de
l'urbanisation et les conditions climatiques contraignantes accentuent la
précarité énergétique, est confirmée par les
travaux de GERAUD M. (2007), HALIDOU K. (2010), PATRICK C. (2014), MOUSTAPHA K.
(2014), MINISTERE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE ET LA NIGELEC (2015) et les
données statistiques de la NIGELEC et de la direction nationale de la
météorologie sur la température ; la seconde
hypothèse qui affirme que les services ont adaptés des formes de
résiliences qui ne permettent pas d'apporter des solutions durables aux
problèmes de la desserte en énergie électrique est aussi
confirmée par les travaux de ROLAND P. (2001), SALEY M. (2008), DAOUDA
H. (2010), EDF (2011), DEDJINOU V. F. (2014), ..., et nos données
collectées sur le terrain. Apres cette étude, on constate que, la
réflexion mérite d'être continuée sur la question de
l'énergie électrique au Niger, pays sahélien qui dispose
plusieurs sources d'énergies renouvelables non encore viabilisées
comme le solaire, le nucléaire, l'hydroélectricité, et
l'éolienne. La promotion de ces sources d'énergie devrait
permettre de vaincre la précarité énergétique et
d'enclencher le développement économique et le progrès
social. C'est pourquoi, dans la perspective de la thèse, nous
envisageons aborder l'énergie solaire, une perspective pour vaincre la
précarité de l'énergie électrique à
Niamey.
Pour mener à bien cette étude, la
démarche et les outils méthodologiques déterminés
pour la recherche s'appuieront non seulement sur ceux utilisés durant la
recherche de Master, notamment la recherche bibliographique croisant les
approches disciplinaires, qu'il conviendrait d'enrichir et de
préciser, mais également sur la collecte de données de
terrain.
96
BIBLIOGRAPHIE
1) ABDOU SALAM F. et ROKHAYA C. 2007_Migration
internationale et pauvreté en Afrique de l'ouest. Institut fondamentale
d'Afrique noire. Université de Dakar. 26p
2) ADDO M. et al 2011_Etat de la gouvernance en Afrique
de l'Ouest. Projet de suivi de la gouvernance en Afrique de l'Ouest.
Pp.99-104
3) ADEM 2008_ «urbanisme-énergie : les
ecoquartiers en Europe » 36p
4) ADEM 2014_action de l'ADEM en Afrique. Vol. 3.7.
5p.
5) ADEME 2014_L'accès à l'énergie en
Afrique. 5p
6) ADER 2015_Revue annuelle sur l'efficacité du
développement 2015. Pp15-29
7) ADER 2016_Revue annuelle sur l'efficacité du
développement 2016. Pp.16-21
8) ADJI I. 2009_Impact du changement climatique sur
l'énergie éolienne : Cas du Niger. SIFEE, 14em
colloque international en évaluation environnementale du 26 au 2 Mai
2009. Niamey-Niger. p.
9) AFRICA PROGRESS PANEL 2015_energie, population et
planète : saisir les opportunités énergétiques et
climatiques de l'Afrique. Rapport 2015 sur les progrès en Afrique.
32p
10) AFRICAPOLIS 2009_ dynamiques de l'urbanisation,
1950-2020, approche géostatistique. Afrique de l'ouest. Geopolis.
104p
11) AFRICAPOLIS 2008_dynamique de l'urbanisation ouest
africaine de 1950-2020. 12p
12) AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 2014_afrique
sub-saharienne : cadre d'intervention régionale 2014-2016. 40p
13) AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 2006_Perspectives
des technologies de l'énergie : Scenarios et stratégie à
l'horizon 2050. 15p.
14) Agence Internationale de l'Energie 2006_Perspectives des
technologies de l'énergie. 15p.
15) AGENCE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 2001_ Ville,
énergie et environnement. Beyrouth (LIBAN) 17, 18 et 19 septembre
2001. Acte du colloque. 232p
16) AGENCE NATIONALE POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE DE TUNISIE
ET L'AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 2007_financer la maitrise de
l'énergie en Tunisie ; acte de la conférence internationale,
Hammamet Tunisie 2007.186p.
17) AHMADOU B. 2014_etat des lieux et enjeux de
l'efficacité énergétique au Cameroun. 12p.
18)
97
AHMADOU B. O. 2014_Etat de lieux et enjeux de
l'efficacité énergétique au Cameroun. Atelier
régional sur le climat et l'énergie en Afrique centrale.
Yaoundé du 22 au 24 juillet 2014. ARSEL.12p
19) AISSATA B. H. 2010_Acquiferes superficiels et
profonds et pollution urbaine en Afrique .
· cas de la
communauté urbaine de Niamey(Niger). thèse de doctorat, UAM.
249p
20) ALAIN C. 2008_les outils d'urbanisme municipaux au
service du développement durable. p
21) ALAIN DE QUERO ET BERTRAND L. ET PHILIPPE 2009_Plan
bâtiment grenelle, groupe de travail précarité
énergétique. 55p
22) ALAIN I. L. 2012_Strategie de croissance des
unités territoriales du Cameroun, production décentralisé
d'électricité. Mémoire de master a l'Institut
Panafricain pour le Développement en Afrique Centrale. 165p.
23) ALAIN I. L. 2012_Strategies des unités
territoriales au Cameroun, production décentralisée
d'électricité. 180p.
24) ALAIN M, 2015_le stockage de l'énergie
électrique .
· une dimension incontournable de la transition
énergétique. 130p.
25) ALBERT M. 2015_Les CSP (Système solaire
promoteur), une solution à la demande énergétique en
Afrique de l'Ouest. Conférence internationale-Ouagadougou 25 au 27
juin, AFRCASOLAR 2015. Défis énergétique et enjeux
environnementaux. 23p.
26) ALEXANDRE B. ET AL 2011_precarite
énergétique .
· état des lieux et propositions
d'action.36p
27) AMELIE VONINIRINA ET SAMINIRINA A. 2014_etude sur
l'énergie à Madagascar. centre de recherches d'études et
d'appui à l'analyse économique à Madagascar. 57p
28) ANDRE P. 2005_problematique énergétique
des Etats Unis.8p
29) ANDRE P. 2005_Problemeatique
énergétique aux Etats-Unis. 3p.
30) ANDRIS P. 2012_de l'énergie durable pour tous
extrait de .
· coopération pour le développement 2012,
comment intégrer durabilité et développement.15p
31) ANDRIS P., 2012_de l'énergie durable pour tous.
45p
32) ANJALI S ET AL 2012_acces à
l'électricité en Afrique subsaharienne .
· retour
d'expérience et approche innovent. 103p
33) ANNE C. 2015_Interconnexion de l'Afrique de l'Ouest
.
· prêt global de 85ME. Banque Européenne
d'investissement. 2p.
34)
98
ANTOIN E. ET AL 2006_ L'énergie n'est pas au
rendez-vous . état du secteur de l'énergétique en Afrique
subsaharienne. Diagnostics des infrastructures nationales en Afrique.
12p
35) ANTOINE DE SAINT EXUPERY
2010_l'électricité . de la centrale a la maison au
Québec. 52p.
36) ARMIN B., BERNHARD P. MIRIAM B. 2005_politique
énergétique, programme détaillé des verts Suisse :
les perspectives des verts à l'horizon 2050 ; un approvisionnement
énergétique de base à 100% sur les énergies
renouvelables. 33p.
37) ARNAUD A. et al 2007_quel avenir pour le solaire en
Afrique en 2020. 36p.
38) ARONA R. et col 2005_Audit de la sécurité
d'approvisionnement en énergie électrique du
Sénégal. Commission de régulation du secteur de
l'électricité. 165p
39) AYOUBA T. B. 2012_ Mobilités
résidentielles et habitat spontané à Niamey.
Mémoire de maîtrise, département de géographie. UAM.
77p
40) BALLA S. 2009_Urbanisation d'Afrique de l'ouest .
approche bibliographique des mutations fonctionnelles et morphologiques des
rues. Mémoire de DEA, Université Abdou Moumouni,
département géographie. 93p
41) BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE CENTRE DE
DEVELOPPEMENT DE L'OCDE 2010_ Un meilleur accès à
l'énergie pour les africains. Quatrième forum international
sur les perspectives africaines. 8p.
42) BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LE FAD
2012_politique du secteur de l'énergie du groupe de la banque
africaine de développement. 39p.
43) BANQUE DE FRANCE 2010_L'initiative régionale pour
l'énergie durable (IRED) . une stratégie communautaire pour
résorber le déficit énergétique dans les Etats
membre de l'UEMOA. Rapport annuel de la zone franc. Pp95-102
44) BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 2016_Repondre aux
besoins énergétiques de l'Afrique. 4p
45) BANQUE MONDIALE 1993_le monde et l'Afrique, une nouvelle
politique de la banque mondiale : efficacité énergétique
et développement de l'électricité. Marches tropicaux.
46p.
46) BANQUE MONDIALE 2014_eau et énergie :
rapport mondiale des nations unis sur la mise en valeur des ressources. 8p.
47) BENIGNE R. et col 2012_Rapport d'information sur la
problématique de l'énergie et de l'eau au BURUNDI. 63p
48)
99
BENJAMIN P. ERIC B ION H. 2011_programme linéaire
pour la gestion de l'énergie électrique d'un habitat. Moret
sur loin France. 10p.
49) BERTEL E. ET MOLINA P. 1993_Strategies de
l'énergie et électricité en Amérique Latine et les
Caraïbes. 7p.
50) BRUNO M. 2013_la précarité
énergétique : posé la question du coût du logement
en France. 4p.
51) Bulletin de Codesria, numéro 1, 2000.
Dakar, Sénégal. Pp86-91
52) CAMILLE B. ET AL 2012_ collection « la revue
» du service de l'observation et des statistique(SOS) du commissariat
générale au développement durable : urbanisation et
consommation de l'espace, une question de mesure. 106p
53) CARINE B. ET AL 2007_L'accès aux services
essentiels dans les pays en développement au coeur des politiques
urbaines. Paris, France. 22p.
54) CATHERINE ET JEAN J. 2013_la transition
énergétique : 2020-2050, un avenir a bâtir, une voie
à tracer. Les éditions des journaux officiels de la
république française. 122p.
55) CATHERINE F. V. et al 2007_developpement des villes
maliennes : enjeux et priorités. série document de travail
de la région Afrique No 104b. 82p
56) CAVALLIER C. 1996_ L'urbanisation des pays en
développement. De «la ville a l'urbain». 8p
57) CEDEAO 2012_Politique sur l'efficacité
énergétique de la CEDEAO. 72p.
58) CEDEAO 2012_Politiques en matière
d'énergie renouvelable de la CEDEAO. 102p.
59) CEDEAO-UEMOA 2006_livre blanc pour une politique
régionale sur l'accès au service énergétique des
populations rurales et périurbaines pour l'atteinte des objectifs du
millénaire pour le développement. 82p.
60) CENTRE FRANÇAISE SUR LA POPULATION ET LE
DEVELOPPEMENT 1999_transition urbaine est-elle achevée en Afrique
subsaharienne ? no34
61) CHARPENTIER J. P. 1990_ planification
énergétique pour divers Etats européens et arabes. Un
projet de PNUD et de la BM. 7p.
62) CHEIK ANTA D. 1985_Problematique
énergétique africaine. Communication au symposium international
de Kinshasa, 20-30 Avril 1985 : la science et le développement de
l'Afrique. L'Afrique et son avenir. 5p
63) CHRISTINE H. ET AL 2011_Energie, croissance et
développement durable, Une équation africaine, les
études de IFRI. 75p
64)
100
CHRISTOPHE B. ET AL 2010_Analyse sociotechnique
comparée des dispositifs de réduction des situations de
précarité énergétique et construction des
stratégies d'intervention ciblées. Rapport final du
programme prebat ADEM-PUCA. 112p
65) Christophe G. 2013_ énergie renouvelable en
Afrique de l'Ouest : enjeux, état de lieux
et obstacles.
Institut Henri-Fayol. ENSM, Saint Elienne France. 14p.
66) CHRITOPHE B. 1989_Contribution à
l'étude du ruissèlement urbain en Afrique de l'Ouest application
à la simulation des écoulements sur petit bassin urbain.
Thèse en mécanique, génie mécanique,
génie civil. 344p
67) CILSS 2004_etat de lieu des stratégies
énergie domestique au Niger. 71p
68) COMMISSION EUROPEENNE 2015_Cadre stratégique
pour une vision de l'énergie résiliente, dotée d'une
politique clairvoyante en matière de changement climatique. 25p
69) COMMISSION EUROPEENNE 2015_Pacquet « Union de
l'énergie ». cadre stratégique pour une union de
l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante
en matière de changement climatique. 25p.
70) CONFEDERATION SUISSE 2015_Penurie
d'électricité : analyse nationale des dangers. Dossier
pénurie d'électricité. 12p
71) CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL
2010_l'électricité : un moyen de développement pour la
réunion. 45p.
72) CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL,
2010_l'électricité comme enjeux du développement.
45p.
73) CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE 2005_ Intégration
régionale de l'énergie en Afrique. 102p.
74) CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE 2013_ les Politiques
d'efficacité énergétique dans le monde. 24p.
75) CONSEIL NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT
DURABLE, PNUD et FAO 2003_Strategie Nationale et plan d'action sur les
énergies renouvelables. 60p.
76) CONSEIL MONDIALE DE L'ENERGIE 2004_reseau mondiale
des leaders de l'énergie destine à promouvoir la fourniture et
l'utilisation durable de l'énergie pour le plus grand bien de tous.
16p.
77) CONSIL DES INVESTISSEMENT PRIVE DU BENIN (CIPB)
2007_l'énergie électrique au Benin. 21p
78)
101
CRI DE CIGOGNE(CDC) 2009_Bilan énergétique et
perspectives pour une politique énergétique ambitieux au
Niger. 27p.
79) DAN KOBO L. 1988_l'auto-développement de la
société Nigérienne d'électricité,
NIGELEC. mémoire de maitrise, université Québec.
271p
80) DAOUDA H. 2010_Dynamique actuelle du centre-ville de
Niamey ; mémoire de maitrise, Université Abdou Moumouni de
Niamey, département de géographie. 93p
81) DAVID V. 2016_Changement politique et espace urbain en
Afrique de l'Ouest. Note d'analyse. 16p
82) DAVOC (Draw A Vision Of Cameroon),
2008_«Problématique de l'énergie au Cameroun».
11p
83) DEDJINOU V. F. 2014_Analyse des dommages des coupures
d'électricité a Abomey-Calavi au Benin : Cas des
ménages. Université d'Abomey-Calavi, faculté des
sciences économiques et gestion ; master en science économique.
22p
84) DENIS M., DIDIER M. JACQUES S., 2010_Guide de
l'installation électrique 2010. Collection technique de Schneider
électrique en France. 274p.
85) DIEUDONNE M. 1994_la périurbanisation :
étude comparative Amérique du nord Europe occidentale Afrique
noire. Cahier de géographie du Québec, vol 38, No
105.Pp413-432
86) DJEZOU W. B. 2009_ Analyse de la consommation
d'énergie et gestion durable en Côte d'Ivoire.35p.
87) DJIBY D. et al 2009_ Le Sénégal face a la
crise énergétique mondiale : enjeux de l'émergence de la
filière des biocarburants. 52p.
88) DOMINGO E. 2004_ « Les nouvelles échelles de
l'urbain en Afrique : métropolisation et nouvelles dynamiques
territoriales sur le littoral béninois », in
Vingtième Siècle dossier Ghorra-Gobin C. (ed.),
numéro 81, janvier-mars 2004, pp. 41-54.
89) DOMINIQUE A. 2014_La crise du système
électrique européen : Diagnostic et solution. 136p.
90) DOMINIQUE B. 2013_Reduire la précarité
énergétique. Journée thématique du 23 Mai,
école nationale supérieure d'architecture de paris-belle ville.
52p
91) DOMINIQUE T. 2000_La ville et l'urbanisation dans les
théories du changement démographique. Document de travail
n°6. 40p
92) DOMMINIQUE H. et al 2010_Urbanisation en Afrique centrale et
orientale. Rapport général
de l'étude «
Africapolis II, e-Geopolis. 20p
93)
102
DZIONOU Y. 2001_Urbanisation et les aménagements
urbains en question. Université de Lomé-Togo ;
département de géographie. 11p
94) EDF et Col 2011_etat des lieux régionaux de la
précarité énergétique. Mobilisation
des
acteurs en PACA. 64p.
95) EDF 2012_Indicateur du développement durable
au niveau national qu'international.
Cahier des indicateurs du
développement. P.
96) EDMOND B. et al 2015 gestion du secteur
énergie. Congo. Projet supervisé : valoriser des infrastructures
énergétiques du Congo. 39p
97) El Hadj Ibrahim T. 2015_Acces universel à
l'énergie en Afrique de l'Ouest. Rôle de
la
coopération réglementaire. 11p
98) ELISABETH B. 2008_acte de la conférence
internationale sur la politique et efficacité énergétique
au Vietnam. 194p.
99) EMILE F. et al 2014_ réseau électrique
et énergie renouvelable : transport et
production. 50p.
100) ERIC D. ET FRANÇOIS M. 2009_ la croissance
urbaine en Afrique de l'ouest, de l'explosion a la prolifération. La
chronique du CEPED. Pp1-5
101) ERIC V. 2011_la distribution de
l'électricité et le rôle d'état dans la
sous-région du mashek. 6p.
102) ERIC V. 2009_electricite et territoire : un regard
sur la crise libanaise. Revue tiers monde, presse université de
France. PP421-436
103) FALKE I. S. 2012_La taille des ménages et la
qualité de vie dans un quartier de Niamey : cas de FoulanKoira,
KoiraTégui. Mémoire de Maitrise, département
géographie. UAM. 88p
104) FELIX D. ET AL 2011_Economie
d'électricité : petit bilan des incitations tarifaires dans le
monde. 40p.
105) FLORIANE C. ET MARION F. 2008_L'Afrique de l'ouest
comme espace migratoire et espace de protection. 52p
106) FRANCOIS P. Y. 2003_Les enseignements des
études des cas sur les villes Ouest-africaines et les économies
locales (ECOLOC). Note et Document. 20p
107) FRANCOIS S. 2012_La politique
énergétique de la Banque Mondiale en Afrique : une
opportunité du secteur privé. 4p
108) FREDERIC G. ET FRANÇOIS M. 1994_Densification
du semi des petites villes en Afrique de l'ouest. 12p
109) FREDERIC H. et al 2011_la précarité
énergétique en Belgique.198p
110)
103
FRIEDEL H. ET SARAH G. 2004_energie hydraulique des
barrages d'Inga : grand potentiel pour le développement de la
république démocratique du Congo et de l'Afrique. p
111) FRIEDEL H. 2008_energie et eaux en république
démocratique du Congo. Le service des églises
évangéliques en Allemagne pour le développement(EED).
58p
112) GEOSENEGAL 2016_L'occupation de l'espace à
Dakar, un phénomène d'urbanisation à réguler.
Bulletin d'information du plan national de géomantique de
Sénégal. 5p
113) GERARD S. 1986_Crise urbaine et contrôle social
à Pikine. Borne fontaine et clientélisme. 18p
114) GERAUD M. 2007_L'Afrique subsaharienne face aux
famines énergétiques. Echo-géo [en ligne]. 14p
115) GLOBAL ENVIRONMENT OUTLOUK 2012_L'urbanisation
croissante, mondialisation et une gouvernance déficiente constituent des
menaces majeurs pour l'environnement. Synthèse pour l'Afrique a la
veille de Rio +20. 7p
116) GONDA A. influence des conditions
socioéconomiques et culturelles sur la dynamique des
écosystèmes sahélien : cas des zones reverdies(Warzou) et
dégradées (Maissokoni) du département de Mayahi.
Mémoire de maitrise, Université Abdou Moumouni de Niamey,
département Agronomie. P
117) GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
2013_etude relative au diagnostic et à l'évaluation des
besoins de renforcement des capacités du secteur de l'énergie en
Afrique subsaharienne, tome1 et 2. 162p.
118) GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DU DEVELOPPEMENT
2015_Problématique de l'accès à
l'électricité au Togo. Afrique de l'ouest Policy note.
40p
119) HALIDOU K. 2010_ Elaboration du schéma du
réseau de distribution électrique de la ville de Niamey.
Mémoire de Master spécialisé en Génie Electrique,
Energétique et Energie renouvelable à l'Institut international
d'Ingénierie de l'eau et de l'environnement. 60p.
120) HAMIDOU B. ET BOUBACAR N. 2006_les statistiques des
travailleurs migrants en Afrique de l'ouest ; Genève, Bureau
international du travail. 79p
121) HAROU M. 2001_Bilan diagnostique des
stratégies, programmes et projets passés, en cours et en attente
dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables au Niger.
République du Niger ; cabinet du premier ministre. Conseil National
de l'Environnement pour le Développement Durable (CNEDD). 95p.
122)
104
HASSANE A. A. 2015_Etudes bibliographique sur la dynamique
des villes secondaires satellites des métropoles ouest africaines.
Mémoire de maitrise en géographie, Université Abdou
Moumouni de Niamey. 113p
123) HASSANE S. G. 2009_Cartographie de la dynamique de
l'occupation des sols et de l'érosion dans la ville de Niamey et sa
périphérie. mémoire de maitrise, université
Abdou Moumouni de Niamey. mémoire online. p
124) HEIN DE HAAS 2007_Migration
irrégulière de l'Afrique de l'ouest au Maghreb et en union
européenne. Le mythe de l'invasion. 81p
125) HELIO INTERNATIONAL 2011_Traitement de l'information
pour des politiques énergétiques favorisant
l'écodéveloppement. SIE-Cameroun. 93p.
126) HILAIRE K. M., 2014_Urbanisation et fabrique urbaine
à Kinshasa : Défis et opportunité
d'aménagement. Geography. Université Michel
Montaigne-Bordeaux III. 50p
127) HOUNDEDAKO S. ET AL, 2014_etude pour la
synchronisation des réseaux électriques de la communauté
électrique du Benin (CEB) : Cas de la Volte Riva Autority(VRA) et de la
transmission Company of Nigeria. Pp.18-26
128) HOUNGNINOU E. 2012_ situation
énergétique en Afrique : cas de l'Afrique de l'Ouest.
Conférence « partager le savoir à travers la
méditerranée (7)». 22p
129) HUBERT F. 2007_le futur énergétique de
la France ; déterminant scientifique et techniques. 68p.
130) IBRAHIM S. et al 2012_politique régionale sur
l'efficacité énergétique de la CEDEAO : faciliter
l'accès universel à l'énergie par le biais de
l'efficacité énergétique en Afrique de l'ouest.
6p.
131) IDRISSA W., FREDERIC L. 2005_Urbanisation,
consommation et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne.
8p
132) INS 2014_annuaire statistique 2009-2013.
Edition 2014. 245p
133) IRENA 2013_L'Afrique et les énergies
renouvelables : la voie vers la croissance durable. 36p.
134) IRENA 2013_Pool énergétique d'Afrique
de l'Ouest : planification et perspectives pour les énergies
renouvelables. 100p
135) ISN 2014_Annuaire statistique du Niger 2008-2012.
Pp.201-205
136) ITAI M. 2005_L'énergie, clé de la
perspective en Afrique. Afrique renouveau, vol 18#4. 6p
137) JEAN BORLOD ET AL 2015_l'énergie en Afrique
en 2050 p
138)
105
JEAN LOUIS B. et al 2012_Les enjeux
énergétiques. Séminaire organisé par la
fondation Gabriel Péri sur le thème de l'énergie. 34p
139) Jean Marie C. et Serge S. 1998_Etude prospective
à long terme en Afrique de l'ouest. Pour préparer l'avenir de
l'Afrique de l'Ouest. Une vision à l'horizon 2020. Club du sahel.
160p.
140) JEAN PAUL M. 1999_la question
énergétique au sahel. Edition Karthala et TRD. 173p
141) JEAN PIERRE F ET AL 2009_energie en Afrique à
l'horizon 2050. Paris. 84p.
142) JEAN T. 2012_ Efficacité
énergétique : Levier de la transition énergétique
en France. 52p.
143) JEAN T. 2012_Efficacite énergétique en
France, un outil d'aide à la décision des pouvoirs publics.
52p.
144) JEAN MARIE C. ET AL 2012_la précarité
énergétique : comprendre pour agir. Acte du colloque au
palais bourbon 101, rue de l'université. 59p
145) JEROME C. 2008_urbanisation, planification urbain et
model de ville en Afrique de l'ouest : jeux et enjeux de l'espace public.
10p
146) JEUNE AFRIQUE 2013_Gros délestages
d'électricité à Niamey. Article publier le 15
Novembre 2013 à 12h 48mn. 1p
147) JOHAN T CECILE B. ALEXIA L. 2013_lutter contre la
précarité énergétique : analyse des politique en
France et au royaume unis. Etude climat No 42. 42p.
148) KABOUCHE A. 2012_Architecture et efficacité
énergétiques des panneaux solaires. Mémoire de
master, département d'architecture et d'urbanisme de l'université
Montouri. 215p
149) KANDO G. 1995_L'agriculture urbaine en Afrique
tropicale. Evaluation in situpour initiation regional. Cites Feeding
People Series Report 14. 29p
150) KARIM M. 2013_L'énergie photovoltaïque :
un outil de développement efficace pour les économies d'Afrique
subsaharienne. IFRI, Gouvernance Européenne et Géopolitique
de l'énergie. 44p.
151) Karim M. 2013_L'énergie photovoltaïque :
un outil de développement efficace pour les économies
subsaharienne. IFRI, gouvernance européenne et géopolitique
de l'énergie. 44p
152) KERRI E. ET AL 2009_stimuler le secteur de
l'énergie en Afrique au moyen du financement Carbonne. 26p.
153) KHLAUT R. 2004_ Accès à
l'énergie et lutte contre la pauvreté. Acte du
séminaire, Ouagadougou-Burkina Faso du 10 au 12 Mai 2004. 193p
154)
106
KOUEVI A. A. 2012_Taille des ménages et
qualité de vie dans un quartier de Niamey : Cas de Banga-Bana.
Mémoire de maîtrise, département géographie. UAM.
80p
155) LA BANQUE MONDIALE 2009_strategie
énergétique du groupe de la banque mondiale : synthèse
sectorielle, réseau du. 39p.
156) LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 2012 guide
géothermique : Planification et financement de la production
d'énergie. 170p.
157) LEONIDAS H. et al 2011_Dynamique d'urbanisation Ouest
africaine. Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ;
perspectives-Ouest-Africaines N°1. 8p
158) LILIEN J. 2006_transport et distribution de
l'énergie électrique. Institut d'électricité
Montefiore, université de liège. 46p
159) LIMAN G. 2013_NIGELEC : situation actuelle et
perspectives. Niamey-Niger. 33p.
160) LIONEL T. 2012_L'Afrique subsaharienne et
électricité, l'Europe et la France prend pied. 10p
161) LOI NO 2003-04 DU 31 JANVIER 2003, portant code de
l'électricité du Niger. J.O. No 08 du 15 avril 2003. 12p.
162) LOUIS S. 2012_Acces a l'énergie pour les
Etats de l'Afrique de l'ouest : défis et succès. 45p.
163) LOURDES D. O. ET AL 2001_Etalement urbain, situation
de pauvreté et accès à la ville en Afrique subsaharienne.
L'exemple de Niamey. In BUSSIERE YVES, Madris Jean-Loup(EDS).
Démographique et transport : ville du nord et ville du sud, l'harmattan.
Pp.147-175
164) LUCAS P. 1997_L'énergie en Afrique. Dans
accroitre à l'accès aux services énergétique pour
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement. 2005. 124p
165) MAÏNA B. 2011_etude sur le partage des
bénéfices issus de la vente de l'électricité de
Kandadji. Rapport. 36p
166) MAMAN O. O. 2012_Taille des ménages et
qualité de vie à Niamey : exemple du quartier Karadjé.
Mémoire de maîtrise, département de géographie.
UAM. 82p
167) MANDIOGA N., NELLY R. 2010_Les migrations
internationales en Afrique de l'ouest : Une dynamique de régionalisation
articulée à la mondialisation ; International Migration
Institute, Jannes Martin 21st CountryschoolUniversity of Oxford. 48p
168) MANSOUR A. 1951_les problèmes des
réseaux électriques maillées et leur solutions à
l'aide des tables de calcule. Thèse de doctorat a l'école
polytechnique fédérale, Zurich. Imprimerie aschmann&schellier
SA. 270p
169)
107
MARIA V. 2014_a focus on energy prespect in subsaharian
Africa. Paris ladex 15, France. 242p
170) MARION C. 2014_precarite et
vulnérabilité énergétique dans
l'agglomération grenobloise. 28p
171) MARTHIN C. 2003_Maitriser l'étalement urbain.
Bonnes pratiques des villes européennes et américaines.
63p
172) MATHIDE D. 2011_Modelisation prospective et analyse
spatio-temporelle : intégration de la dynamique du réseau
électrique. Paris 2011. 201p
173) MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L'ENERGIE EN FRANCE 2014_un nouveau model énergétique
français : énergie d'avenir, croissance verte, emploie
durable. 29p.
174) MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 2009_Rapport
d'analyse des données du RGPH-2006 : thème 09 : la croissance
urbaine au Burkina Faso. Pp21-35
175) MINISTERE DE L'ENERGIE EN CHARGE DES RESSOURCES
NATURELLES 2013_Forum de dialogue sur le secteur de l'énergie
à Djibouti. Acte du forum. 35p.
176) MINISTERE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE ET LA NIGELEC
2015_Projet de renforcement et d'extension des réseaux électrique
des villes de Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Zinder, Maradi et
Tillabéri. Rapport. 153p.
177) MINISTERE DE L'ENERGIE, DES RECHERCHES PETROLIERES ET
MINIERES ET DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 2015_Programme pour
la valorisation à grande échelle des énergies
renouvelables au Benin. Plan d'investissement SREP-Benin. 137p.
178) MINISTERE DE MINE ET DE L'ENERGIE DE LA COTE D'IVOIRE
2012_Defis et enjeux du secteur de l'énergie en côte d'Ivoire
: Mesures d'urgence et plans à moyen et long termes.
Séminaire national sur l'énergie 2012 ; plan d'action et
d'investissement en production-transport. 5p.
179) MINISTERE DE MINE ET DE L'ENERGIE 2007_Projet
SIE-Afrique. Rapport annuel SIE-Niger 2006. 43p.
180) MINISTERE DE MINE, DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
2008_Document de politique et de stratégie de développement
du secteur de l'énergie électrique au Benin. Groupe de
réflexion sur la vision du secteur de l'énergie
électrique. 117p
181) MINISTERE DE MINES ET DE L'ENERGIE 2006_Strategie
nationale d'accès aux services énergétiques modernes des
populations Nigériennes (SNASEM). 58p
182)
108
MINISTERE DE MINE ET DE L'ENERGIE DU NIGER 2007_systeme
d'information énergétique du Niger. 85p.
183) MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE DU NIGER
2004_declaration des politiques énergétiques. 14p.
184) MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE 2006_Strategie
Nationale d'accès aux services énergétiques modernes des
populations Nigérienne (SNASEM). Rapport 2006, république du
Niger. 58p.
185) MINISTERE DES MINES, DES CARRIERES ET DE L'ENERGIE et
col 2005_La stratégie énergie domestique au Burkina
Faso. 128p
186) MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE DU BURKINA
2013_politique sectorielle de l'énergie 2014-2025. 55p.
187) MOCTAR A. 2009_ énergie solaire au
Niger. Sahel Dimanche 29 Mai 2009. 5p.
188) MOCTHO KOKOU H. 2005_Urbanisation et rôle de
la chefferie traditionnelle dans la communauté urbaine de Niamey.
Dans les cahiers d'Outre-mer. Une Afrique de l'Ouest en méditation.
Presse universitaire de paris. 11p
189) MOMAR C. D. 2016_La politique sociale en Afrique de
l'ouest : quel changement depuis le sommet de Copenhague ? synthèse
des études des cas (Benin, Burkina Faso, Côte d'ivoire, Mali,
Sénégal). 77p
190) MONIQUE B. 2012_Gouvernance des services essentiels
a Bamako, Mali. Contribution au chapitre «Métropole» du
rapport GOLD III. 59p
191) Monique B. 2013_Gouvernance des services essentiels
à Bamako, Mali. Contribution au chapitre
«Métropole» du Rapport Gold III. 52p
192) MOTCHO K. H. 2005_comportement et attitudes de la
population de Niamey, capitale du Niger, vis-à-vis des infrastructures
publiques : L'invasion de la rue, une règle établie.
Pp179-192
193) Motel P. et KERE E. 2015_defis
énergétique en Afrique subsaharienne. 10eme
édition des journées de l'Afrique. Ecole d'économie,
université de l'Auvergne. 25p
194) MOUNKAILA A. 2014_Coupures intempestives du courant
électrique à Niamey : La NIGELEC, incapable d'assurer
efficacement sa mission! Journal administrateur, dans actualité,
contributions, société n° 632 du 15 Avril 2014. Journal.
P
195) MOUSTAPHA K. 2014_Energie, on n'est pas tous
égaux. Collectif pour la décence du droit à
l'énergie(CODDAE). 4p
196) MOUSTAPHA K. 2010_Rapport sur la situation
électrique au Niger.
lettre-situation-électrique-Niger-CODDAE-dae. 1p
197)
109
MOUTAIROU R. et HERBERT K. 2009_Systemes
énergétiques :
Vulnérabilité-adaptation-résilience (VAR). Afrique
subsaharienne.35p
198) MURIEL B. 2011_Precarite énergétique
dans les logements et les déplacements domicile-travail en
Rhône-Alpes. 33p
199) NAZIM P. 2009_mise en place des outils de suivi et
de prédiction de la demande électrique à l'échelle
d'un territoire, application au département du Lot. Thèse de
Doctorat de l'université de Toulouse. 228p
200) NIGELEC, 2012_Rapport d'activités 2011.
Conseil d'administration. 23p.
201) NIGELEC, 2013_rapport d'activités 2012.
26p.
202) NIGELEC, 2014_Rapport d'activités 2013.
42p.
203) NIGELEC, 2015_Rapport d'activités 2014.
42p.
204) NIGELEC, 2016_Etude d'un plan directeur de
distribution d'énergie électrique de la ville de Niamey
2014-2029. Rapport intérimaire. 188p.
205) NOMA A. 2011_Centre ville de Niamey en mutation :
l'exemple de Gandatché (Commune II). Mémoire de Maitrise.
Départementgéographie. UAM. 93p
206) OBSERVATOIRE INTERNATIONALE DES COUTS ENERGETIQUES,
2006_Etude internationale sur les prix de l'électricité.
20p.
207) OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE 2003_l'énergie et la ville. 8p
208) OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE 2006_developpement urbain durable, étalement
urbain et service publique. université de Lausanne. 8p
209) OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE 2009_ville et climat. université de Lausanne,
institut de géographie. 8p
210) OIM, 2013_Le bien-être des migrants en Afrique
de l'ouest : Etude de cas de quatre pays d'accueil dans la région.
Document de travail du rapport : état de la migration dans le monde.
18p
211) OMER T. ET MAMA D. 2008_ la question de
l'urbanisation et de l'offre de service au Benin, en Afrique de l'ouest.
12p
212) ONPE 2015_les chiffres clés de la
précarité énergétique. Édition No1.
36p
213) ONU-HABITAT 2014_integration des mesures
d'efficacité énergétique et de conservation des ressources
dans les normes de construction au Cameroun. 15p.
214) ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 2009_
Etude préliminaire d'adaptation aux changements climatiques en
Afrique. énergie. 60p
215)
110
OUEDRAOGO R. et BADOLO M. 2014_Cadre de
référence indicatif pour la promotion de l'efficacité
énergétique dans les entreprises au Burkina Faso. Note de
recherche de l'IAVS. 8p
216) PATRICE C. 2014_les grandes problématiques
d'une société de distribution: le réseau électrique
au Coeur des débats dans de nombreux pays. 30p
217) PATRICK G. 1991_urbanisation, croissance urbaine et
transport en Afrique. 5p
218) PAUL C. ET ANTONY J. 2013_logement et urbanisation
en Afrique : libérer le développement du marché formel.
Université d'Oxford. 22p
219) PAUL GEREMIE B. 2011_analyse du secteur de
l'énergie électrique au Cameroun, bilan des actions des
plaidoyers et système de tarification de
l'électricité. 16p
220) PAUL GERMIK B. 2014_Analyse du secteur de
l'énergie électrique au Cameroun, bilandes actions de plaidoyers
et système de tarification de l'électricité.
Réseau Associatif des Consommateurs de l'énergie. P
221) PAUL M. 2013_Dynamique géographiques des
grandes continentales. 7p
222) PELLECUER C. 1988_la distribution
d'électricité en Afrique. Article. Thème :
équipements et infrastructures. 8p.
223) PENE P. et al 1992_environnement urbain en Afrique
subsaharienne et pathologie. Médecine d'Afrique Noire. 5p
224) PHILIPPE A. 1990_Croissance urbaine et insertion des
migrants dans les villes africaines. Acte du colloque international. Des
langues et des villes. Organisé conjointement par CERPL (Paris V) et le
CLAD (DAKAR) à Dakar, du 15 au 17, 1990. 19p
225) PHILIPPE B. RENE B. CHRITELLE M., 2012_lutte contre
la précarité énergétique. Analyse des
initiatives et des besoins en Ile-de-France. 76p
226) PHILIPPE B. ET AL. 2010_etat de la
littérature anthropologique sur la consommation d'énergie
domestique en particulier de chauffage. 70p
227) PHILIPPE H. 1970_l'urbanisation de masse en question
: quatre villes d'Afrique noire. Colloques internationaux de CNRS
no539_la croissance urbaine en Afrique noire et a Madagascar.
Edition du Centre National de la Recherche Scientifique, 15, quasi
Anatole-France - Paris -VII. 28p
228) PHILIPPE H. 2013_ l'énergie électrique au
Benin : Etat des lieux et perspectives de développement par adoption
d'une nouvelle politique nationale. 8p
229) PHLIPPE A. 1996_Crise et l'accès au logement
dans les villes africaines. CEPED.-Paris. Université Paris VI.
Pp.273-288
230)
111
PIERRE B. ET AL. 2012_L'urbanisme durable : enjeux
pratiques et outils d'intervention. 94p
231) PIROTTE G. et al 1999_Les associations urbaines en
Afrique subsaharienne. Recherche en appui à la politique de
coopération CIUF-AHCD. Types fonctionnement et initiatives en
matière du développement. 100p.
232) PNUD, 2013_ « Energie durable pour tous
à l'horizon 2030 » ; rapport national de la république
démocratique du Congo. 82p.
233) POUZOLS C. G. 1995 gestion de l'énergie dans
le processus industriels. Cahier technique n°133. 15p.
234) PUCA-ADEM-ANAH, 2011_soutien à l'innovation,
réduction de la précarité énergétique.
Rapport sur le projet Réseau Régional « énergie
et précarité ». 206p
235) QUOILIN S. 2008_Energie et développement :
quels enjeux ? Université de Liège, institut des sciences
humaines et sociales. 20p
236) RAFAEL D. ET AL 2003_L'électricité au
service du développement : examen de l'action menée par le groupe
de la Banque Mondiale pour promouvoir la participation privée dans le
secteur de l'électricité. 174p
237) REGIS M. 2009_etude sur les perspectives
d'approvisionnement en électricité 20082017 ; rue du
progrès, 50-B-1210 Bruxelles. 244p.
238) REINOUT V. 2004_l'electricite à bord,
almer-haven. 73p
239) RFI, 21-06-2013_les Nigériens en
colère face aux délestages électrique. Article. 1p
240) ROBERT L. 2013_la ville de demain : intelligente,
résiliente, frugale, post-carbone ou autre ; une synthèse
documentaire. 22p.
241) ROGER L. et NORMAND M. 2014_ Maitriser notre avenir
énergétique. Rapport de la commission sur les enjeux
énergétiques du Québec. 310p.
242) ROLAND P., 2001_ Afriques Noires. Hachette
livre, 43, quai de Grenelle, 75905, Paris Cedex 15. Pp212-213
243) ROLAND P. 2001_l'Afrique Noire; hachette livre
2001, 43, quai de Grenelle, Paris Cedex 15, 250p
244) YAYE SAIDOU H. 2007_Croissance urbaine et transport
dans la communauté urbaine de Niamey ; mémoire de maitrise,
Université Abdou Moumouni de Niamey, département de
Géographie. 98p
245) SALIFOU G. 2016_Le secteur de l'énergie du
Niger : perspectives et opportunités dans le cadre de l'accès
à l'énergie et aux investissements. 25p.
246)
112
SANI I. 2011_analyse du cadre institutionnel en
matière d'adaptation du secteur énergie/transport. Bureau
d'étude en ingénieur pour l'environnement. 27p.
247) SARA A. 2014_ Les énergies renouvelables et
les populations rurales pauvres : cas du Maroc. Essai de maitrise en
environnement. Université de Sherbrooke. 112p.
248) SARAH B. 2006, l'accès à l'eau et
à l'électricité dans les pays en développement.
Comment penser la demande ? institut du développement durable et
des relations internationales. Paris France. 125p.
249) SEBASTIEN G. 2011_ systèmes socio-temporels
de suivi de l'urbanisation littérale ouest-africaine et des impacts
socio-environnementaux.5p
250) SECOUR S. 2012_L'Afrique de l'Ouest face aux enjeux
de la transition énergétique. Pp.10-12
251) STEPANIE V. ET SONIA E. 2010_demain, comment nourrir
plus de la moitié de l'humanité vivant en ville ? alimentation et
urbanisation.16p
252) SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL, 2012_Evaluation rapide
et analyse des Gaps de la Cote d'ivoire : énergie durable pour
tous. 44p
253) TANGAY B. 2010_Etude d'impact des programmes
d'électrification rurale en Afrique subsaharienne. 25p.
254) TANGUY B. 2010_etude d'impact de programme
d'électrification rurale en Afrique subsaharienne. Agence
française de développement, Rue Roland Barthes 75012, paris
France. 25p
255) THE GLOBAL WATER INITIATIVE 2011_etude sur le
partage de bénéfice issu de la vente de
l'électricité de kandadji avec les populations affectées.
36p.
256) THOMAS A. 2012_ Urbanisation en Afrique de l'ouest
et ses implications pour l'agriculture et l'alimentation : une analyse
rétrospective de 1960 à 2010.p
257) TRIMOTHEE E. ET AL 2015_la précarité
énergétique face au défi des donnes. IDDRIS science.
80p
258) UEMOA, 2008_Etude pour l'élaboration d'une
stratégie de résolutions durable de la crise de l'énergie
électrique dans les Etats membre de l'UEMOA. Rapport
définitif, volume 2 : Monographie Pays. 81p.
259) UEMOA, 2008_etude pour l'élaboration d'une
stratégie de résolution durable de la crise de l'énergie
électrique dans les Etats membres de l'UEMOA. Rapport
définitif, volume 1 : diagnostique, scenarii, vision stratégie.
186p.
260) UPDEA, 2009_Etude comparative des tarifs
d'électricité pratiques en Afrique. 16p
261)
113
VIJAY M et al 2005_Accroitre l'accès aux services
énergétique pour la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. 124p
262) VIJAY M. et al 2005_Accroitre l'accès aux
services énergétiques pour la réalisation des objectifs du
millénaire. 124p.
263) VILLE DE DAKAR ET Col 2014_Ville en
développement . restauration et de valorisation des paysages urbains
historiques en Afrique et dans l'espace francophone. Enjeux d'un réseau
francophone du patrimoine, de l'architecture et de l'urbanisme. Acte de la
conférence internationale(DAKAR). 149p
264) VINCENT M. 2011_Processus d'urbanisation de la ville
de Kigali, Rouanda . relation entre la dynamique spatiale et
démographique. Communication pour la chaire ketelet 2011 «
Urbanisation, migrations internes et comportements démographiques.
17p
265) VINCENT N. K. 2010_L'approvisionnement des
ménages en énergie dans la ville de N'Djamena . cas du
troisième arrondissement. Mémoire de master en
géographie ; Université de N'Gaoundéré. 149p
266) VINCENT N. 2010_L'approvisionnement des
ménages en énergie dans la ville de N'Djamena . Cas du
troisième arrondissement. Mémoire de Master en
géographie ; Université N'Gaoundéré, Cameroun.
126p
267) XAVIER P. 2011_ quel mode de gestion pour les
services publics locaux de l'électricité en France. 71p.
268) YASMINA A. 2007_Peri-urbanisation,
métropolisation et mondialisation des villes . exemple de Constantine ;
thèse de Doctorat d'Etat, université Aix Marseille 1 France.
Pp105-119
269) YAYA D. 2007_Consommation
d'électricité et croissance dans l'UEMOA . une analyse en termes
de causalité. Mémoire de DEA, Université CHEIKH
Antadiop de Dakar. 92p
270) YOUBA S. ET AL 2004_les enjeux de technologie
d'énergie renouvelable dans la lutte contre la
désertification. Nairobi, Kanya. 22p.
114
TABLE DES MATIERES
TABLE DES FIGURES 2
TABLE DES PHOTOS 2
TABLE DES TABLEAUX 2
SIGLES ET ABREVIATIONS 3
DEDICACES 5
REMERCIEMENTS 6
RESUME 7
ABSTRACT: 7
INTRODUCTION GENERALE 8
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE 10
1.1. LA PROBLEMATIQUE 10
1.1.1. Contexte et justification de l'étude 10
1.1.2. Les hypothèses de recherche 12
1.1.3. Les objectifs de recherche 12
1.1.3.1. L'objectif général 12
1.1.3.2. Les objectifs spécifiques : 12
1.1.4. Délimitation du champ de l'étude 13
1.1.4.1. Le cadre conceptuel 13
1.1.4.2. Le champ spatial de l'étude 18
1.2. LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE: 21
1.2.1. La recherche documentaire : 21
1.2.2. L'exploitation des cartes : 21
1.2.3. L'analyse des données statistiques : 22
1.2.4. L'élaboration du guide d'entretien : 22
CHAPITRE II : BIBLIOGRAPHIE SIGNALETIQUE 24
2.1. LE PROCESSUS D'URBANISATION EN AFRIQUE DE L'OUEST 24
2.2. URBANISATION ET BESOINS ENERGETIQUES DES PAYS OUEST AFRICAIN
29
2.3. LES ASPECTS DE LA PRECARITE ENERGETIQUE EN AFRIQUE 35
2.4. LES POLITIQUES ENERGETIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST : 40
CHAPITRE III : ANALYSE DE LA DYNAMIQUE URBAINE ET DE LA
PRECARITE DE
L'ENERGIE ELECTRIQUE DANS LES GRANDES VILLES D'AFRIQUE DE
L'OUEST 47
3.1. LE PROCESSUS D'URBANISATION EN AFRIQUE DE L'OUEST 47
3.2. DE L'URBANISATION A LA PRECARITE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE A
NIAMEY 51
3.2.1. Urbanisation et enjeux de l'accès à
l'énergie électrique à Niamey 51
3.2.2. Urbanisation et besoin en énergie électrique
à Niamey 55
3.2.3. Les aspect de la précarité
énergétique à Niamey 57
3.2.3.1. Les caractéristiques de la
précarité énergétiques 57
3.2.3.2. Les facteurs aggravants de la précarité
énergétique à Niamey 65
3.2.3.3. Impacts de la précarité de
l'énergie électrique à Niamey 69
3.2.3.4. Les stratégies d'adaptation des populations 73
CHAPITRE IV : ANALYSE DES POLITIQUES ET INTERNATIONALES
NATIONALES DE
L'ENERGIE 79
4.1. LA QUESTION ENERGETIQUE : UNE PREOCCUPATION MAJEURE DE LA
COMMUNAUTE
INTERNATIONALE 79
4.2. LES DEBATS SUR LA GOUVERNANCE ENERGETIQUE 82
4.3. LA STRATEGIE DE PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES AU
NIGER 85
115
4.3.1. Analyse du cadre institutionnel de la politique
énergétique du Niger 86
4.3.2. Les projets de lutte contre la précarité
énergétique au Niger 90
4.3.2.1. Projet de renforcement et d'extension du réseau
de distribution électrique 90
4.3.2.2. Projet de développer les énergies
renouvelables et de maitrise de l'énergie 93
CONCLUSION GENERALE 95
BIBLIOGRAPHIE 96
ANNEXES 116
116
ANNEXES
I. Les textes législatif et réglementaire
de la politique énergétique au Niger
Le Niger dispose d'importants textes législatifs et
réglementaires, les documents de références
sur
lesquels se base la politique de la gouvernance en matière de
l'énergie électrique qui sont :
· Accord relatif à la fourniture d'énergie
électrique à la république fédérale du
Nigeria, 21 décembre 2010 ;
· Contrat de fourniture d'énergie électrique
entre Power Holding Company of Nigeria (PHCN) et la Société
Nigérienne d'électricité, 22 décembre 2010 ;
· Arrêté n° 000009/MEP/DG/DERED du 12
Mars 2012, portant création, attribution et organisation du CNME
(Comité National Multisectoriel Energie) ;
· La loi n° 98-17 du 15 juin 1998, portant
création d'un établissement public à caractère
national d'énergie solaire (CNES) établissement public à
caractère administratif ;
· Décret n° 1999-640 PCRN/MME du 22 Novembre
1999, portant statut du centre national d'énergie solaire (CNES),
établissement public ;
· Traité de concession du 03 Mars 1993 entre la
république du Niger et la NIGELEC ;
· Projet de termes de référence de mai 2007
de l'étude de faisabilité du Programme de Référence
d'Accès aux Services Energétique modernes au Niger (PRASE) ;
II. Guide d'entretien
1. Guide d'entretien administration
a. comment trouvez-vous la prestation du service
électrique à Niamey ?
b. y a-t-il une précarité dans la prestation du
service électrique à Niamey ? si Oui, qu'est-ce qui explique
selon vous cette précarité ?
c. Comment elle se manifeste ?
d. Quel est l'impact de ce phénomène au sein de
votre établissement administratif ?
e. Quelles sont vos stratégies d'adaptation ?
f. Ces stratégies vous permettent-elles de
résoudre durablement vos problèmes de l'électricité
?
g. Que doivent faire l'Etat et ses partenaires pour combattre ce
fléau ?
2. Guide d'entretien industrie y compris le petit
commerce
a. comment trouvez-vous la prestation du service
électrique à Niamey ?
b. y a-t-il une précarité dans la prestation du
service électrique à Niamey ? si Oui, qu'est-ce qui l'explique
selon vous ?
c.
117
Comment elle se manifeste ?
d. Subissez-vous des dommages causés par les coupures
d'électricité ?
e. Quels sont les types de dommages auxquels vous assister
?
f. Pouvez-vous nous donnez l'estimation en chiffre
réel de ces dommages par an ou par période ?
g. Recevez-vous des dédommagements de la NIGELEC ? si
oui, quelle est la procédure à suivre ?
h. Quelles sont vos stratégies d'adaptation pour
tenter de résoudre vos problèmes en électricité
?
i. Ces stratégies vous permettent-elles de
résoudre durablement vos problèmes en électricité
?
j. Que doivent faire l'Etat et ses partenaires pour combattre
ce fléau ?
3. Guide d'entretien au centre de
santé
a. comment trouvez-vous la prestation du service
électrique à Niamey ?
b. y a-t-il une précarité dans la prestation du
service électrique à Niamey ? si Oui, qu'est-ce qui explique
selon vous cette précarité ?
c. Comment elle se manifeste ?
d. Y a-t-il une période pendant laquelle cette
situation s'aggrave d'avantage ?
e. Quel est l'impact de cette précarité sur la
santé des populations surtout celles des patients ?
f. Subissez-vous des dommages matériels causés
par les coupures d'électricité ?
g. Pouvez-vous nous donnez l'estimation en chiffre
réel de ces dommages par an ou par période ?
h. Recevez-vous des dédommagements de la NIGELEC ? si
oui, quelle est la procédure à suivre ?
i. Quelles sont vos stratégies d'adaptation pour
tenter de résoudre vos problèmes en électricité
?
j. Ces stratégies vous permettent-elles de
résoudre durablement vos problèmes en électricité
?
k. Que doivent faire l'Etat et ses partenaires pour combattre
ce fléau ?
4. Guide d'entretien ménage
a. comment trouvez-vous la prestation du service
électrique à Niamey ?
b.
118
y a-t-il une précarité dans la prestation du
service électrique à Niamey ? si Oui, qu'est-ce qui explique
selon vous cette précarité ?
c. Comment elle se manifeste ?
d. Y a-t-il une période pendant laquelle cette situation
de précarité s'aggrave d'avantage ?
e. Subissez-vous des dommages causés par les coupures
d'électricité ? si oui quels sont ses dommages ?
f. Pouvez-vous nous donnez l'estimation en chiffre réel
de ces dommages par an ou par période ?
g. Recevez-vous des dédommagements de la NIGELEC ? si
oui, quelle est la procédure à suivre ?
h. Quelles sont vos stratégies d'adaptation pour
résoudre vos problèmes en électricité ?
i. Est-ce que ces stratégies vous permettent de
résoudre durablement aux problèmes de l'électricité
?
j. Que doivent faire l'Etat et ses partenaires pour combattre ce
fléau ?
| 


