III- 5) L'analyse de l'enquête
Dans la première partie du questionnaire, j'ai voulu faire
une comparaison entre l'explication donnée au patient et la
définition du masque de contention qu'ont les MERM selon le nombre
d'années d'expérience. Je voulais savoir si avec les
années d'expérience, le MERM peut expliquer avec des mots
différents pour rassurer le patient. En effet , dans l'étude
d'ARINO C. (2014) « le masque de contention : une source
d'anxiété » , la représentation du masque est
influencée par l'information donnée au patient.
Il est intéressant de noter l'effort que les MERM font
pour adapter leurs explications du masque thermoformé avec le patient et
leurs connaissances du masque thermoformé quel que soit le nombre
d'années d'expérience.
Dans la représentation du masque de contention chez les
MERM ayant moins d'un an d'expérience (5), on retrouve des notions de
« reproductibilité », de « positionnement », de
« limiter les mouvements voulu et non voulu », de «
protéger les organes à risques ». On retrouve
également dans les explications données au patient, les notions
de « positions ». mais
44
on explique au patient les étapes de fabrication du
masque. Un des MERM caractérise le masque de contention comme «
moulage », « corset » dans son explication donnée au
patient. Il est important de noter la connotation d'être restreint que
peut dégager ces mots et ainsi favoriser l'état
d'anxiété du patient. Dans un des questionnaire, la
représentation du masque de contention est que, je cite, «
ça permet de travailler en sécurité pour protéger
les organes à risques » et les explications face au patient
sont : « C'est un accessoire qui permet de réaliser le
traitement avec assurance d'avoir une position parfaitement identique suite au
scanner de centrage. » Ici, on voit bien l'adaptation des
connaissance du MERM face au patient dans un but à la fois de rassurer
mais aussi d'expliquer. Cependant j'ai eu des difficultés pour analyser
les réponses d'un questionnaire avec des questions non
répondus.
Chez les MERM ayant 1 à 5 ans d'expérience (3), on
retrouve également des notions de « positionnement » et de
« reproductibilité ». Un des MERM montre l'importance du
masque dans ses explications au patient « c'est un passage difficile mais
on s'habitue et surtout c'est indispensable pour le traitement ». On voit
effectivement que le MERM essaie de banaliser le masque avec la notion
d'habitude, ce qui peut être un moyen de décrédibiliser le
masque et ainsi rassurer le patient.
Ensuite, chez les MERM ayant 5 à 10 d'expériences
(4), on retrouve bien les notions de «ne pas bouger », de «
moyens », « d'immobilisation » dans leurs connaissances face aux
masques de contention. De plus, dans les explications données au
patients, nous retrouvons une réponse qui montre l'importance de montrer
le masque au patient, probablement lors de la consultation d'annonce
paramédicale. Dans une des réponses, nous voyons qu'il y a
l'importance du choix du patient face à l'ouverture des yeux et de la
bouche « je lui dis que nous allons mouler un masque à son
visage,le pourquoi nous faisons un masque, nous lui montrons a quoi ça
ressemble, nous lui laissons la possibilité de choisir si grand ouvert
ou pas ( possibilité d'avoir des ouverture pour les yeux et la bouche)
». Il est important de noter ici la démarche destinée
à rendre le patient acteur de son traitement et ainsi cela pourrait
effacer ce sentiment d'impuissance, ou de subir le masque de contention.
45
Par rapport au MERM ayant 10 à 15 ans d'expérience
(8), on retrouve encore une fois les notions de « reproductibilité
», d'« immobilité », de « moyen de contention
», de « sécurité de soins ». dans la
représentation du masque des MERM. Pour un des MERM, il exprime la
difficulté de porter le masque mais également l'importance de le
mettre pour le patient, je cite, « Une épreuve mais aussi une
nécessité pour le traitement. » Pour donner les
informations aux masques du patient, on retrouve l'importance de montrer la
matière du masque, « Je lui montre la matière du masque
avant de le mouler sur la partie de son corps. » On remarque
également la notion « d'éviter de bouger » mais aussi
de montrer la manière dont le masque est fait : « La plus
simple possible: j'insiste sur la chaleur, la sensation
désagréable (sans employer ce mot), la nécessité de
respecter le temps de séchage et notre présence pendant tout ce
temps là ».
Dans la tranche des MERM ayant plus de 15 ans
d'expérience, on retrouve la représentation du masque comme
« un moyen sûr de maintenir le patient »,
« reproductibilité », « moyen de contention
». Il est important de noter que dans une réponse pour
l'explication donnée au patient, le MERM met l'accent sur l'aide que
peut apporter le masque de contention : « On leur dit que c'est avant
tout une aide pour ne pas bouger car sans cela c'est impossible... ».
Dans une autre réponse, on retrouve également la notion de
banaliser le masque : « D'une manière très souple et le
banaliser auprès du patient pour qu'il puisse l'accepter ».
Pour conclure, le temps d'expérience influence sur la
différence des mots employés pour l'explication donnée au
patient du masque et de sa représentation du masque. Les mots
employés par les MERM ayant plus de 15 ans sont plus accessibles et
rassurants que les MERM ayant moins de 1 an. Les MERM ayant moins d'un an
d'expérience montre plus la notion d'« immobilité », de
« reproductibilité » dans le discours face au patient. Tandis
que les MERM ayant entre 1 à 5ans, 5 à 10 ans, 10 à 15
ans. On note une similitude entre la représentation du masque et
l'explication donnée au patient avec des notions d'immobilisation et
reproductibilité. Ainsi, nous remarquons une légère
différence entre les MERM avec plus de 15 ans d'expérience et les
MERM avec moins d'un an d'expérience.
46
Deuxièmement, j'ai voulu quantifier la fréquence
des patients anxieux liés aux masques de contention en
radiothérapie.

Selon les MERM, 39,1 % ont répondu que le nombre de
patients anxieux liés par semaines est de 1, 34,8 % ont répondu 3
par semaines, 13 % ont répondu 5 par semaines et 13 % ont répondu
plus de 5 par semaines. J'ai eu une réponse intéressante d'un
MERM « une fois par semaine mais le même patient tous les jours
», en effet, en radiothérapie on voit les patients tous les jours
ainsi il y a bien un par semaines mais c'est le même patient qui revient
tous les jours. Ce qui explique le taux élevé des réponses
pour 1 par semaine.
On remarque alors que les patients anxieux sont pas très
fréquents mais qui nécessitent un temps en plus pour chaque
séance quotidienne. Ce qui montre l'impact que peut avoir un patient
anxieux face au masque dans l'organisation de la journée des salles de
traitement ou scanner et qu'il est quand même important de
dépister les signes d'angoisses pour prévenir d'une
éventuelle crise.
Ensuite, j'ai voulu savoir si les MERM ont déjà
vécu un cas de crise de panique et à quel moment du traitement
47
Plus de 95,7 % ont vécu une crise de panique dans leur
carrière. Contre, 4,3 % qui ne l'ont pas vécu.

Près de 46,7 % des MERM ont eu un patient anxieux avoir
une crise de panique à la première séance. 45,3 % s'est
déroulé au scanner, 6,7 % au milieu du traitement et 3,3 %
à la fin du traitement. Cela nous montre que la crise de panique
survient généralement au début du traitement. Il est
important de noter ici le dépistage précoce des signes de
l'anxiété pour éviter cette crise de panique. En effet,
faire cette évaluation en consultation d'annonce paramédicale et
médicale serait à mon sens judicieux pour prévenir cette
crise. L'accompagnement de départ est alors essentielle face à
l'anxiété du patient.
Cependant, j'ai voulu savoir si dans les services, il y a la
présence d'outils de mesure de l'anxiété.
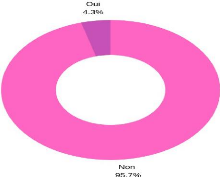
48
Un MERM m'a justifié qu'il utilisait sa propre analyse
pour mesurer l'anxiété. Toutefois, dans les services de
radiothérapie il est rare de voir des outils de mesures de
l'anxiété. En effet, dans mes différents stages, j'ai vu
utilisé l'EVA (Évaluation analogique de la douleur). Ce qui est
intéressant ici c'est de mettre en place un outil simple à
utiliser en pratique pour évaluer l'anxiété des patients
cela peut être utiliser avec les patients anxieux à cause de
l'utilisation du masque mais également pour d'autres patients
anxieux.
Ensuite j'ai voulu analyser les facteurs favorisant
l'anxiété lié à l'utilisation du masque selon les
MERM.
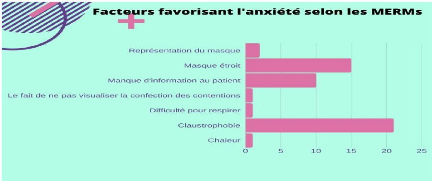
49
On remarque dans la majorité des propos des MERM la notion
de claustrophobie. Puis on retrouve de manière décroissante le
masque étroit, le manque d'information et la représentation du
masque. En effet, la claustrophobie fait partie des facteurs favorisant
l'anxiété liée à l'utilisation du masque. Ces
prédispositions amènent à une double anxiété
du patient. Ici, nous avons le point de vue des MERM mais cependant cela ne
reflète pas non plus ce que ressent le patient comme la crainte des
effets secondaires comme on a pu développer dans notre cadre
conceptuel.
De plus, grâce à mon pré-questionnaire et
quelques recherches sur les patients anxieux. J'ai remarqué que pour
diminuer l'anxiété du patient liée à l'utilisation
du masque de contention, les MERM peuvent attachés partiellement le
masque pour qu'il soit moins oppressant. J'ai voulu alors analyser si elle
était courante et sécurisée.

Sur les 23 MERM questionnés, plus de la moitié ont
déjà attaché un masque de contention partiellement. Parmi
ces MERM, plus de la moitié ont eu une validation médicale. Dans
certaines réponses, il est intéressant de noter que cette
pratique est accordé seulement pour la séance du jour. Cela
montre que cette pratique est un dernier recours face à
l'anxiété du patient.
En menant mon enquête de terrain, j'ai remarqué
une corrélation entre le ressenti du MERM et l'action de ne pas attacher
complètement le masque. Les MERM qui ont répondu de l'impuissance
à la question onze seraient plus susceptibles de ne pas attacher
50
complètement le masque de contention. Alors que les
personnes qui ressentent de la colère seraient plus susceptibles
d'attacher complètement le masque. Une des réponses d'un MERM m'a
interpelée, en effet pour lui, il ressenti cette envie de les aider et
la conviction que le patient va réussir à surmonter cela :
« Je me sens utile car je sais que c'est réalisable donc il
doivent y arriver et je les aide... ». Il a ainsi répondu non
au fait de ne pas attachés le masque partiellement. L'état
d'esprit de ce MERM peut ainsi encourager le patient a vaincre sa peur. Avec
une compréhension de la part du MERM et un discours rassurant, il serait
important de noter que les patients peuvent se sentir dans un climat de
confiance et d'évolution face à sa lutte contre sa peur.
Dans une partie du questionnaire, j'ai voulu savoir comment les
MERM prennent en charge les crises de paniques lors de la mise en place du
masque de contention. Dans la majorité des propos, on remarque
l'importance de rassurer le patient avec la communication « beaucoup de
communication », « beaucoup de discutions », « discours
positif »,
« rassurer ». Il est important également
d'inspirer la confiance « On peut appeler le médecin
référent pour qu'il ait un repère de confiance ».
Beaucoup de MERM utilisent la respiration pour calmer le patient.
On remarque beaucoup l'utilisation de l'hypnose. On remarque de plus la
recherche de la cause de la crise « on essaie de comprendre ce qui a
engendré la crise ». On note également le fait de leur
parler durant la séance « Je leurs parle pendant la séance
», c'est un moyen de faire penser au patient autre chose que le port du
masque. Ce que nous pouvons noter aussi, c'est que l'utilisation des
traitements médicamenteux comme les anxiolytiques sont un dernier
recours pour calmer la crise de panique « En dernier recours c'est les
anxiolytiques donné par son médecin. »
Pour conclure, ils existent différentes manières de
calmer une crise de panique en recherchant un climat de confiance ; faire
évader le patient par l'hypnose, la musique, la communication ; et enfin
les anxiolytiques en dernier recours si les méthodes alternatives ne
fonctionnent pas. Il est alors important de noter que les MERM sont plus
favorables à calmer les crises de paniques avec des méthodes plus
douces que de donner un traitement de plus à un patient
cancéreux. On note également que pour le MERM que cette peur est
surmontable, c'est une épreuve pour le patient mais avec le soutien et
l'accompagnement du MERM, il
51
réussit à vaincre sa peur. A noter qu'il aurait
était intéressant de savoir quels sont les méthodes qui
marchent le plus et qui ont le moins d'inconvénients pour le patient.
Ce questionnaire a pu répondre partiellement à mes
hypothèses de recherches. D'une part, on a pu montrer que l'utilisation
des mots dans l'explication du masque donné au patient pourrait
engendrer une anxiété face au masque de contention. Les patients
anxieux face au masque de contention sont pas très nombreux mais sont
fréquents, c'est-à-dire, qu'il peut y avoir un patient anxieux
à cause du masque par semaine mais comme nous le voyons tout les jours,
les MERM requiert un temps et une démarche adapté lors de la mise
en place de la contention. On a pu également montrer que la crise
d'angoisse survient le plus souvent au début du traitement lors du
scanner dosimétrique et la première séance. Cela nous
montre l'importance de savoir dépister ces signes
d'anxiété le plus tôt possible c'est-à-dire, lors
des consultations d'annonce médicales et paramédicales. Ce
dépistage est alors une démarche pluridisciplinaire qui
concernent le radiothérapeute, le MERM et l'infirmière du
service.
D'autres part, le questionnaire n'a pas permis de vérifier
si la formation des MERM face aux patients anxieux ont pu diminuer la
fréquence de patients anxieux dans le service. On ne peut pas non plus,
savoir si le fait de ne pas attachés le masque totalement pourrait
diminuer l'anxiété. Pour cela, on n'aurait dû avoir l'avis
d'un patient en entretien pour confronter le vécu des deux parties. Ce
qui a été difficile, c'est que certains MERM n'ont pas
répondu à certaines questions comme par exemple l'explication du
masque au patient. Ainsi, je voulais déceler si le discours se changeait
par rapport à leur connaissance du masque. On notait ainsi que les MERM
ayant moins d'an d'expérience ne changeait pas leurs vocabulaire alors
que les MERM ayant plus de 15 ans d'expérience, n'employait pas les
mêmes mots que leurs connaissance, on voit bien qu'il insiste sur la
notion d'aide et de protection du masque de contention.
Cependant, vu le nombre de questionnaires remplis (22), cela peut
avoir des biais et ainsi il serait intéressant et de le faire sur une
plus grande échelle.
52
| 


